Vous avez le choix :
Un outil professionnel qui est Le Dico Bourguignon
Dictionnaire & Traducteur : Français - Patois Bourguignon
ou une base de données (compilation) de 66 parlers bourguignons-morvandiaux ci-dessous !!!
Le numéro entre parenthèse vous indique la source, par exemple : (54) = 54 : Lexique du parler creusotin
Pour voir les 66 sources
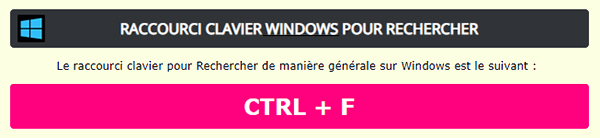

Le chargement de la base de données (77 822 lignes) peut être long, soyez patient !!!
- Filtre de recherche -
Ce glossaire est disponible au format PDF accessible à la recherche. Me le demander
Si vous souhaitez consulter une source (liste à la page : Les parlers bourguignons-morvandiaux) en particulier, tapez son numéro entre parenthèse. Exemple : (01)
| â (l') : planche au-dessus de la cheminée - (39) |
| â (nom masculin) : tablette de la cheminée qui accueille de petits objets utiles ou simplement décoratifs. - (47) |
| a : (â: - subst. m.) age de charrue. - (45) |
| â : âge (charrue) - (48) |
| a : Première lettre de l'alphabet. Au figuré, commencement, « dépeu a jusqu’à z » depuis le commencement jusqu'à la fin, d'un bout à l'autre. - (19) |
| à : S'emploie pour « de » dans certains cas « Le pré à Jean ». S'emploie également pour « et », « à peu après » ? Voyez à « peu ». On dit aussi : « voisin à », comme en italien : « vicino a ». - (19) |
| a bade : voir bade. - (19) |
| à bas : par terre - (43) |
| à bas, loc. par terre. - (22) |
| a bas, par terre - (38) |
| a beurnancio : En très grande quantité. « Y a des fruts (fruits) à beurnanci st'année ». - (19) |
| à brousse - à beurnonsiau : énormément - (57) |
| à cause : Pourquoi ? Pour quelle cause ? « A cause dan qu 'o n'est pas veni » : pourquoi donc n'est-il pas venu ? - (19) |
| à cause don: (loc) parce que - (35) |
| a cause que ? loc. interrog., pourquoi ? On dit aussi : d'à cause que ? — Lorsque cette question semble indiscrète à la personne interrogée, on entend cette dernière répondre volontiers : « A cause de pasque ». (V. ce dernier mot). - (14) |
| a chez, loc. chez. Dites « à chez pierre » que nous nous portons bien. il est arrivé un malheur « à chez guillaume. » - (08) |
| à ch't'eure: (adv) maintenant - (35) |
| à cor, à couant, à la cot. Voyez caut. - (10) |
| à couté : à côté - (43) |
| à coutre : à l'abri de la pluie - (43) |
| à creupton: (adv) accroupi - (35) |
| a c't'heure, loc. adv., en ce moment, maintenant. Formule des plus usitées. - (14) |
| à la co : dehors - (57) |
| à la coi (voir à coi) : A l'abri de la pluie. « O s'est mis à la coi seu in noué » : il s'est abrité de la pluie sous un noyer. - (19) |
| à la pique du dzeu : à l'aube - (43) |
| à la revoyure : à la prochaine - (44) |
| a l'aco : à l’abri. - (29) |
| a lai grippe é lai grappe, loc. attrape qui peut ; distribution faite au hasard de la force ou de l'adresse. - (08) |
| a l'arbo : à rebours. - (29) |
| à l'esqueprés (voir à esqueprés) : Exprès. « ol y a fait à l'esqueprès » : il l'a fait volontairement. - (19) |
| a l'houtte. exp. - Appel du vigneron pour demander au porteur de venir avec sa houtte, sa hotte. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| à l'oeuvri (voir à euvri) : A l'abri du vent. « La Croix Rotte est à l'oeuvri de la bige » le coteau dit « La Croix Rotte » est abrité du vent du Nord. - (19) |
| a mitan (louïa d'), terme de marinier. (Voir Louïa). - (14) |
| â ou ae : Age, partie de la charrue destinée à transmettre au corps de l'instrument le mouvement qui lui est donné. - (19) |
| a ou as - ais - c'est-à-dire planche sur laquelle on met pain et provision. Dans ce sens voyez Pannetière. - En n'i ai pu ran su l'â. - Regardez l'â, ce qui vos beillerai du cœur. - (18) |
| à peu (voir aussi peu) : Et, et puis. « Ol a miji sa sope à peu ol est allé se couchi » il a mangé sa soupe et puis il est allé se coucher. A peu s'emploie presque toujours au lieu de « et ». - (19) |
| à pi : a pied - (57) |
| à pou prés : a peu près - (57) |
| à pou près : presque - (43) |
| a prend un t euphonique devant une voyelle. Exemple : El al étraipai, il est attrapé. - Ai nos at aivi, nous sommes d'avis de. - El at aivan, il est parti. - (02) |
| à qui don' ? exp. - « C'est à qui ? » - (42) |
| à r’va, à te r’va : (excl) au revoir - (35) |
| à revoir, si je ne vous revois pas ! Formule d'adieu d'une exquise politesse, puisqu’elle prévoit toutes les hypothèses ! Ingénieuse ellipse, très dijonnaise, mais aussi très usitée le samedi sur la place Saint-Etienne. Traduction : « Je vous fais mes adieux, pour le cas où j'aurais le regret de ne plus vous rencontrer avant mon (ou votre) départ. » - (12) |
| à r'vouair : au revoir - (57) |
| à steure : à cette heure - (43) |
| à t'aleu. loc. - À tout à l'heure. - (42) |
| à tas, loc. en monceau. Il a des écus « à tas » mettez le grain « à tas ». - (08) |
| à tenant. En grande quantité ; sans s'arrêter : « y pieu à tenant». - (49) |
| à ti-à-taille. exp. - À tour de bras, à tort et à travers : « Pernisiau grattait su ses cordes, à ti-à-taille, à son idée. » (Fernand Clas, p.308) - (42) |
| à toutze ! : à la prochaine ! - (43) |
| à tsau cosse : par intermittence - (43) |
| à tsevau : à califourchon - (43) |
| a vârse : Abondamment. « i pliô à vârse » il pleut à seaux. - (19) |
| a vue d’pays, loc, coup d'œil d'ensemble, aperçu général. Signifie surtout : sans y regarder de trop près. - (14) |
| a yé bê temps : il y a longtemps - (48) |
| a - au - préposition pour le masculin et le singulier. - Il â bô cueilli de l'harbe. - I ons traiveillei teute lai maitenée â prai. - Te monterez â cliaicher. (Pour les autres cas voyez les articles Es ou E et Ai) - (18) |
| a - est - 3° personne du présent de l'indicatif du verbe être. – Al â ben eumade to le monde. - Lai Marie â été charcher des treuffes. - (18) |
| a - il ou elles. Pronom de la 3° personne au singulier pour le masculin seulement et devant une consonne, et au pluriel pour les deux genres. - A traiveille bein note gairçon. - I a vu le Pierrot ; â réussirai cair à ne cor pas les cabarats. - A se portant ai merveille. (Voyez al et il pour les autres cas). - (18) |
| a : (â: - subst. m.) ne s'emploie que dans la locution â: d'chœvné:, linteau de cheminée, en bois à l'origine. - (45) |
| â : aux. cail’ot pâs lai ! ail’ot â à’amps ! : il n’est pas là ! il est aux champs ! - (37) |
| â : s. f. haie de la charrue. - (21) |
| â, â l' : 1 art. Au. - 2 pron. pers. Elle, elles. Devant une consonne, s'écrit et se prononce : « â ». Devant une voyelle, s'écrit et se prononce : « â l' ». – 3 pron. pers. Il, ils. Même explication. - (53) |
| a, al : il, ils - (48) |
| a, alle. Pron. Pers. - Elle. Alle devant une voyelle devient a devant une consonne. « Marcelle, a prendra l'chemin des vignelles ! Alle a ben rai'on, a rentrera pus toût. » - (42) |
| a, contract. de Alle. Pr. pers.. Elle. « A n' dit ran su son compte ». - (14) |
| a, employé pour "et" : et puis , a peu ; et bien : a ben. - (38) |
| a, il (patois de Buxy) qu'il va lui dire : qu'a li va dire ; que je lui veux : qu'a li voux. - (38) |
| à, prép. redondante, employée dans certaines locutions, telles que : « Hier à soir ; à c' matin ». - (14) |
| à, pvép. fréquemment employée pour de : « La fillôte à Jean ; le garçon à Sylvain ; la poule à Dodiche. » — Nous disons encore « à boune heure » : « On t'attend por diner ; veins à boune heure ». - (14) |
| â, s. m. ais, planche qui remplace dans nos campagnes les tablettes de cheminée et sur laquelle on pose la lampe, l’almanach, la croix de par dieu et les autres menus objets du mobilier rustique. - (08) |
| a, s'emploie pour il, pronom, 3ème pers. du masc. au sing. et au plur. « a dreume, a vin », il dort, il vient. - (08) |
| a. Est. El a vrai, il est vrai. A se met devant une consonne, at devant une voyelle. El at étraipai, il est attrapé. - (01) |
| à. préposition : se dit fréquemment pour de. La fille à Jean-Louis. Le jupon à ma femme. - (10) |
| a. voyelle : s'emploie souvent pour il, pour alle et pour elle devant une consonne. Ton pere travaille-t-il aujourd'hui ? A travaille. - Ta mée, a vinra-t-i (la mère, viendra-t-elle) ? A viendra. Dans certains cantons de l'Avallonnais, A (voyelle) se prononce O ; de même, dans les cantons d'Aillant et de Joigny, où, par contre, O se prononce A. La vallée d'Aillont. Le pant de Joigny. Dans beaucoup de communes du Senonais, on prononce a pour e et vice versa. Un cherretier, une sarpe. - (10) |
| a. : Cette voyelle prend fréquemment i dans les mots, par exemple lé maige pour les mages, lai pour la, imaige pour image, aivoi pour avoir, vo saivé pour vous savez, ai faire pour affaire etc. - (06) |
| a. : devant une consonne et at devant une voyelle se disent pour est. 3e pers. sing. du verbe substantif être. Exemples: el a convenaule, il est convenable, - el at acoizai, il est apaisé, en parlant du vent. - (06) |
| â[y]é : aisé, facile. Ç'ot ben â[y]é : c'est bien facile. - (52) |
| aà ou â : pièce maîtresse de la charrue. - (33) |
| aâ, s. f. eau - (08) |
| aâge, s. f. durée, degré de la vie, époque de l'existence - (08) |
| aâsie, part. pas. D’un ancien verbe « aasier », mettre à l'aise, qui est peu usité à l'infinitif. Commode, facile, d'un bon usage. Au féminin « aâziére. » - (08) |
| aâyance, s. f. aisance, commodité. - (08) |
| aâye, adj. aise, content, satisfait : « i seu aâye d' vô voua », je suis content de vous voir. une partie du Morvan prononce « âge, âgé », pour aise, aisé. - (08) |
| aâye, s. f. aise, contentement, bien-être : « ai l'aâye », à l'aise, avec facilité, dans l'aisance. - (08) |
| aâyeman, s. m. meuble, ustensile de ménage, vaisselle de terre ou de bois, etc. - (08) |
| aâyemans (nom masculin) : ustensiles de cuisine. - (47) |
| aâyeté, s. f. état d'une personne qui est aise, contente, satisfaite. - (08) |
| abade (voir bade) n.f. (lat. pop. batare, ouvrir les lèvres). 1. Liberté. 2. Abandon. - (63) |
| abade : (nf) « mettre à l’abade » : détacher les bêtes - (35) |
| abadé, v. a. mettre du bétail en liberté. - (22) |
| abader (s') v. 1. S'enfuir, s'échapper. 2. Fig. Se donner du bon temps - (63) |
| abader (s'), s'échapper. - (05) |
| abader : v. faire avancer les vaches. - (21) |
| abader, v. a. mettre du bétail en liberté : abade le poulain ! - (24) |
| abafou. adj. - Étourdi, écervelé, affolé. - (42) |
| abafou. n. m. - Oiseau : l' engoulevent. - (42) |
| abafou. s. m. Angoulevent, oiseau du genre passereau. Au figuré, homme écervelé, étourdi, sans réflexion. Le comte Jaubert donne dans le même sens abohifou. - (10) |
| abaissi : abaisser - (51) |
| abali (être) : être fatigué - (61) |
| abali (s') (v. pr.) : se gâter, s'altérer, en parlant d'un aliment, d'une boisson (un vin qui s'abalit) - (64) |
| abali. adj. - Éventé, qui a perdu son bouquet, en parlant d'un vin. - (42) |
| abalir (s') : perdre du goût (se dit d'un produit). Ex : "Bouche don ta bouteille ! Ton vin va s'abalie." - (58) |
| abalourdir (verbe) : rendre quelqu'un lourd et stupide. - (47) |
| abande : Abondance. « A lieu d'eune omoulette, fa no in matefaim, i fara pu d'abande ». - (19) |
| abander (v.) : Ne pas abander, faire une petite quantité. Ne pas suffire abîmer : Gâter, détériorer, déchirer, salir. « Ol a to abîmé sa culotte ». - (19) |
| abarbouler (s') (v. pr.) : écarquiller les yeux, regarder avec insistance et curiosité (syn. s'areûiller) - (64) |
| abarbouler (s') : rouler des yeux ronds, chercher à voir. Ex : "N’y fésé nuit nouère, j'avais beau m'abarbouler." - (58) |
| abarbouler (s'). v. pronom. S’étonner de voir une chose qu'on n'a pas encore vue, y fixer son regard avec curiosité. - (10) |
| abarbouler. v. - Regarder d'un air étonné, avec curiosité. - (42) |
| abarlûter (v.t.) : éblouir - p.p. abarlûté - (50) |
| abas : (adv) en bas, par terre : « ol a tsé abas » - (35) |
| ab'asse (ās), sm. farceur, sot, diseur de riens, toqué - (17) |
| abâtardir. v. a. Supprimer, abolir. Abâtardir un passage, un chemin. - (10) |
| abâteleux. s. m. Bateleur, charlatan. Abaubi, ie. adj. Surpris, étonné, ahuri, déconcerté. AI ot tout abaubi (il est tout ahuri). Du latin Balbus. - (10) |
| abat-flanc. n. m. - Planche suspendue verticalement à une certaine hauteur au-dessus du sol d'une écurie, pour séparer les chevaux. - (42) |
| abat-foin. n. m. - Trappe aménagée dans le plafond d'une étable ou d'une écurie, pour descendre le foin ou la paille. Ce mot, employé en français jusqu'en 1970 environ, n'est plus utilisé aujourd'hui que dans le vocabulaire rural. - (42) |
| abâtler (v. tr.) : séduire, tromper par de belles paroles, embobiner - (64) |
| abâtleux (n. m.) : charlatan - (64) |
| abatleux. n. m. - Charlatan, imposteur, bonimenteur de foire. - (42) |
| abatouaire : n. m. Abattoir. - (53) |
| abattis : bras - (44) |
| abattouaîr (n') : abattoir - (57) |
| abaubi. adj. - Ébaubi, étonné, ahuri, déconcerté. Se faire abaubi, se faire surprendre : « Gué mon gârs, un sanglier ! l' f'sait ben son quintal, j'en étais tout abaubi ! » Les adjectifs ébaubi et abaudi, du latin balbus (bègue), furent couramment employés au Moyen Âge ; le français classique du XVIIe siècle les utilisait encore ; seul subsiste aujourd'hui l'emploi dialectal. - (42) |
| abaubir. v. a. Surprendre désagréablement, déconcerter, ahurir, stupéfier. Dans certains cas, aplatir, écraser au figuré, sans doute. S'abaubir. v. pron. Se renverser, se dresser sur les mains pour faire l'arbre fourchu (Bléneau). - (10) |
| abaudis : clématite - (60) |
| abaudréiller (v.t.) : écrabouiller, écraser - (50) |
| abauli, v. a. combler une excavation. - (22) |
| abaupin (un) : une aubépine - (61) |
| abaupin. s. m. Aubépine. Aléa spina. - (10) |
| abbatadze : abattage - (51) |
| abbate : abattre - (51) |
| abcher (v. int.) : sortir de l'œuf, en parlant du poussin ou de l'oiseau nouveau-né - (64) |
| abdiquer : v. n., cesser une action. - (20) |
| abe (n. m.) : arbre - (64) |
| abe : arbre. Plutôt féminin !...on dit : une abe. - (58) |
| âbe : n. m. Arbre. - (53) |
| abeauch'votter. v. - Bêcheveter, mettre tête-bêche, changer de sens : « Faudra abeauch'votter les gearbes pour qu'a teunnent ! » (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| abecqué (ée). adj. Fatigue, affame à n'en avoir plus de bec, à n'avoir plus la force de manger. De a privatif et bec. - (10) |
| abeigé : insulté. (S. T III) - D - (25) |
| aberdir : rendre berdin (voir ce mot). III, p. 50-7 - (23) |
| aberdir. v. n. Aller trop vite, aller à l'étourdie. - (10) |
| abergement : s. m., hébergement, auberge ; forme de bail rural. Deux communes et une quinzaine de hameaux ou écarts du département de Saône-et-Loire portent ce nom. - (20) |
| aberger. Donner asile. - (49) |
| abergouelles : insectes d'eaux, petites crevettes d'eau douce. - (58) |
| aberlucoter, aberlicoter, aberlutter. v. - Éblouir : le soleil m'a aberlucoté. Ce mot rappelle l'expression « avoir la berlue », avoir des visions. Belluer signifiait au XIIIe siècle : éblouir tromper. Aberlucoter est donc directement issu de cet emploi médiéval. - (42) |
| aberlucoter. v. a. Eblouir, frapper les yeux par un éclat trop vif. Il fait de tels éclairs que j'en suis aberlucoté. - (10) |
| aberluté (ée). adj. Qui a la berlue, qui ne voit pas bien. - (10) |
| aberluté (être) : être ébloui - (61) |
| aberluté : éblouir - sens passif. Ex : "J'seus bramant aberluté." - (58) |
| aberluter (v. tr.) : éblouir, aveugler, en parlant d'une lumière violente (y'a l'soleil qui m'aberlute) - (64) |
| aberluter : aveugler - (60) |
| abernaudi. adj. - Assombri : « Le ciel s'abernaudit su' la Montagne des alouettes. » (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| abertâs (n. m. pl.) : fouillis, amas confus d'objets - (64) |
| abertas (toujours au pluriel) : choses ou objets qui gênent le passage. Ex : "La cour du Baptiste, c'est qu'un abertas !" - (58) |
| abeucquer : donner la becquée - (57) |
| abeuger. v. a. Ranger, mettre de côté. On dit aussi abeurger. - (10) |
| âbeûiller : accoucher (c’est-à-dire « pard’e sai beûille ») - (37) |
| âbeûiller : s’effondrer, s’écraser, s’ébouler - (37) |
| abeûraiche (y s') : (exp. à Sivignon) le temps se couvre - (35) |
| âbeurdiné : « abruti », choqué, momentanément par un coup reçu. (rendu provisoirement) « beurdin » - (37) |
| abeurdiner, ébeurdiner, verbe transitif : donner le vertige, étourdir. - (54) |
| abeuré : gros nuage, cumulus prédisposant à l'orage. A - B - (41) |
| abeuré : gros nuage, cumulus, prédispose à l'orage - (34) |
| abeurêchi (s') v. (de bure). Se gâter, en parlant du temps. - (63) |
| abeurer (s') (s'aceurna) : devenir menaçant, s'assombrir en parlant de la météo - (51) |
| âbeûrleûté : ébloui, abasourdi, aveuglé - (37) |
| abeurluter (verbe) : éblouir par une source de lumière puissante qui fait cligner, voire fermer les yeux. (Ferme don c'te volet, qu’eul soleil m'abeurlute). - (47) |
| abeurniauder (verbe) : se couvrir. Menacer en parlant du temps. - (47) |
| abeurnonciau : beaucoup, à saturation. « Y’en cheu abeurnonciau » : Il en tombe (choir) beaucoup…à l’excès. Du latin ecclésiastique ab renuntio (au renoncement). - (62) |
| abeurnonciau, loc. à renoncement, en trop grande quantité, trop : « Ol en a fiôlé abeurnonciau ». - (14) |
| abeurnoncio, adv. beaucoup (il pleut abeurnoncio). - (65) |
| abeurnonsiau : adv. à profusion , emprunté au latin : abrenuntio. - (21) |
| abeurnonziô : (adv) en grande quantité « y pyout abeurnonziô » : il pleut à verse. - (35) |
| abeurrée : averse. (S. T IV) - B - (25) |
| abeursat. s. m. Sac de toile dans lequel les bergers et les mendiants mettent leur pain. Se dit sans doute pour havre-sac, dont il semble être une forte altération, le v, dans certaines contrées, prenant souvent le son du b, et vice versa. - (10) |
| abeurtas (nom masculin) : objets, généralement de peu de valeur laissés en désordre. - (47) |
| abeurvoir. Abreuvoir. - (49) |
| abeutner (s') v. Gâter, pourrir. - (63) |
| abeuzé, v. a. amuser. - (22) |
| abeuzer, v. a. amuser, retarder. - (24) |
| abille, adj. habile. - (17) |
| abille, vite. - (26) |
| abillot. s. m. Billot de bois, bûche. - (10) |
| abimer, v. tr., frapper, meurtrir : « Ol ainme tant sa fonne, qu'ô l’abime de coups ! ». - (14) |
| abimer, v. tr., salir, gâter, détruire : « En jouant, ôl a trop couru ; ôl a tôt abimé sa culotte, é peu ô s'a étou abimé l’pied ». - (14) |
| abionde : triton, grosse salamandre noire, à rayures jaunes vivant en terre fraîche - (43) |
| abionde, ablonde : petite salamandre que l'on trouve dans les vieux puits. - (30) |
| abiouner, ébiouner. v. - Émonder, retirer les bions, les bourgeons inutiles. - (42) |
| abisois. s. m. Grand vent, le vent de bise. - (10) |
| abisoué, abisois. n. m. - Vent du nord. - (42) |
| abistrogni v. (du lyon. abistrogner) Détériorer, abîmer. - (63) |
| ablager : v. a., vx fr. ablasmer, endommager, abîmer (au prop. et au fig.). Il a tout ablagé sa biaude (bliaude). Je n'ai jamais entendu ablager personne comm' çui-Ià. - (20) |
| ablançoire, balançoire, avec cette différence que ablançoire indique mieux que balançoire l'action de lancer d'un point vers un autre la personne qui se tient sur l’ablançoire. - (16) |
| ablâyer, v., accabler. - (40) |
| ablègé ; v. t. Éclabousser. - (53) |
| ableger : écraser de coups. (VDS. T IV) - VdS - (25) |
| abléger et aibléger : Charger. C'est le contraire d'alléger. Voiqui un âbre qu’ast aiblégé : c'est-à-dire chargé de fruits. Dans l'Yonne, on dit bléger. Dans les villages de la Côte, on nomme aiblégie le premier tour de pressoir donné sur un sac de raisins. - (13) |
| abliessa, gratiole. - (05) |
| abôchi, v. a. renverser un objet face contre terre : abochi un pot, un cuvier. - (24) |
| aboidrailler, abadrouiller, aboudriller, abouaquer (s'). v. - S'écraser, s'affaler, s'étaler de tout son long en tombant d'un cheval, d'un arbre, etc. - (42) |
| aboifou : agité - apeuré - affolé (prononcer : abouéfou) Ex : "En passant avec yeu'auto, mes poules courin' coum' des aboifous !" - (58) |
| aboirer, aboirou, abreuver, abreuvoir. - (05) |
| aboirer. Abreuver les bestiaux. Se dit aussi plaisamment des hommes. - (03) |
| abôli, v. a. combler une excavation. - (24) |
| abolir, gâter, annuler. - (05) |
| abolir, v. tr., démolir, abattre : « O veint d’abolir sa cadole, por la r' monter ». - (14) |
| abomifreux (adj.) : très laid, affreux, horrible à voir - (64) |
| abonde : faire de l’abonde = récolter avec un bon rendement. A - B - (41) |
| abonde (de l') : trouver largement ce qu'il faut pour satisfaire tout le monde. Ex. : "A r'prend don des truffes, na d'labonde, la Lucie, alle a pas apargné la marchandie." - (58) |
| abonde (faire de l'), locution verbale : faire du volume, faire du profit. - (54) |
| abonde (faire de l'). Abonder, foisonner. - (49) |
| abonde : (nf) volume, quantité : « y fait pas bié d’abonde » - (35) |
| abonde n.f. Abondance. Vés la Raymonde y'a d'l'abonde : il y a de la quantité. Y fait d'l'abonde : cela fait du profit. - (63) |
| abonde : s. f., abondance. « Y a-t-il de la pomme de terre cette année ? - Ah ! ça ne fait pas d'abondé. » Un plat (mets) qui ne fait pas d'abonde. - (20) |
| abonde, s. f., quantité, abondance : « Mettez c'qui dans la panière; i f'ra d' l’abonde ». - (14) |
| abonder : (vb) travailler vite et bien : « t’abondes pas ! » - (35) |
| abonder : travailler vite et bien - (43) |
| abonder v. Suffire. - (63) |
| abonder : v. n., suffire à, venir à bout de. S'emploie généralement avec la négation. « L'amiral Avellan n'abonde pas à saluer, à remercier de la tête et de la main. » (Journal local du 26 octobre 1893.) - (20) |
| abopbertis : arbrisseau sarmenteux - (60) |
| aboquer : v. a., emboquer. - (20) |
| abord (D') : adv., vite. Du train qu'il va, il sera d'abord là. — D'abord que, conj., puisque. D'abord que t'as fait ça, c'est fini entre nous. - (20) |
| aborgné (p.p.et adj.) : éborgné, rendu borgne - (50) |
| aborgnir. v. a. Eborgner, rendre borgne. I m'a aborgni d'un coup de pierre. - (10) |
| aborjaule, adj. abordable, accessible, avenant. se dit des personnes et des choses : un homme « aborjaule », une maison « aborjaule », c’est-à-dired'un accès facile. - (08) |
| abossumé : v. t. Submerger. - (53) |
| abossumer, v. a., accabler quelqu'un d'injures. - (11) |
| abossumer, v. tr., donner des coups de poings. - (14) |
| aboteloup : charlatan. - (30) |
| aboter. abouter, v. a. Aboutir, toucher, joindre par un bout. Mon champ aboute au chemin. Du bas latin abbotare. - (10) |
| abotiner, bot'ner. Boutonner. - (49) |
| abouacassé (verbe) : démoli, écrasé, mis hors d'usage. - (47) |
| abouailler. v. a. Renverser, ébouler. - (10) |
| abouairer : abreuver - (57) |
| abouairer : donner à boire - (57) |
| abouairou (n') : abreuvoir (rivière) - (57) |
| abouaqué (verbe) : se dit d'un gâteau (ou un soufflé) qui "retombe". Se dit aussi d'un fauteuil ou d'un canapé qui s'avachit. - (47) |
| abouchan : Tourné abouchan, tourné de telle sorte que ce qui devrait être dessus se trouve en dessous. « Ol est couchi abouchan » il est couché sur le ventre, la bouche en dessous. - (19) |
| abouchant (en). Sens dessus dessous ; posé du côté du bouchon, de l'ouverture. - (49) |
| abouchau, s. m., sorte de panier dont on se sert pour pêcher. - (14) |
| aboucher : v. a., renverser, retourner, mettre sens dessus dessous, mettre à bouchon (voir Bouchon). Abouche donc ce pot. - (20) |
| aboucher : v. a., vx fr., renverser, retourner, mettre sens dessus dessous, mettre à bouchon. Abouche donc ce pot. - (20) |
| aboucheton (à l’). Placer un vase à l'aboucheton, c'est le mettre la bouche en bas. - (13) |
| abouchi (s') (v.) : Se couvrir en parlant du temps. « Le temps s'abouche ». - (19) |
| abouchi, v. a. renverser un objet face contre terre ; abouchi un pot, un cuvier. - (22) |
| abouchon (à l’), loc, sur le nez, par terre ; « En montant su la levée, ôl a tombé à l'abouchon ». Cela se traduirait bien par : s'est flanqué le nez par terre. Cette loc. a voulu dire d'abord : tomber sur la bouche. On dit aussi : être en abouchon, dans le sens d'être courbé : « C'te pauv' vieille, ail' marche en abouchon ». (V, A boucheton, bouchon). - (14) |
| aboudrier. v. a. Ecraser. - (10) |
| aboudriller (v. tr.) : écrabouiller, réduire en bouillie - (64) |
| abouère, m. : boisson pour le repas. (M. T IV) - Y - (25) |
| aboulé. : Jeter, pousser vers. - (06) |
| aboulée. s. f. Accouchée, en parlant d'une femme. - (10) |
| abouler (v.t.) : ébouler - (50) |
| abouler : donner, rendre. Généralement très impératif : « Aboule ce qu’t’dois ! ». - (62) |
| abouler : ébouler - (57) |
| abouler, aboler. Rendre ce qui n'appartient pas. « Aboule-moi çà ». Par extension : donner. - (49) |
| abouler, v. a. apporter, transmettre à quelqu'un un objet désigné : « aboule-moi mon chapeau, mon bâton. » - (08) |
| abouler, v. tr., jeter, envoyer, amener en certaine abondance. Souvent employé au jeu : « Eh ! m'n émi, j' t'ai gagné... aboule ! aboule! ». - (14) |
| abouler. v. - Donner, apporter. Autre sens : tomber (Arquian) En français contemporain, ce mot n'est plus utilisé que dans le vocabulaire argotique. En patois, selon M. Jossier, il s'employait au figuré en parlant d'une femme qui accouchait : «Alle est en train d'abouler son sixiéme. » - (42) |
| abouler. v. n. Venir, apporter, donner. Les enfants disent souvent dans leurs jeux : Aboule, pour donne, apporte. C'est sans doute, dans le même sens, qu'on dit d'une femme qui accouche Elle est en train d'abouler, all' aboule, ail' ot aboulée. - (10) |
| abouris, s. m., de l'ancienne marine fluviale. Bateau d'un train, où l'on attache les cordages et les amarres tirés par les chevaux. - (14) |
| aboutai, apporter.- Aboute donc, c'est-à-dire donne donc (Châtillon). - En terme de grimoire on appelait about un fonds assigné à un créancier. Abouter, c'était apporter ce qui était dû. (Voir la coutume de Metz.) - (02) |
| abouter, v. intr., aboutir, toucher à : « Son champ aboute su l’ mien ». - (14) |
| aboutonné, boutonner ; s'aboutoné, se boutonner; s'désaboutoné, se déboutonner. - (16) |
| aboutonner (v. tr.) : boutonner - (64) |
| aboutonner : boutonner - (44) |
| aboutonner : boutonner. Ill, p. 5-2 - (23) |
| aboutonner : v. a., boutonner. Voir emboutonner. - (20) |
| aboutonner, v. tr., boutonner : « Eh ben ! t' n'aboutonnes pas ta biaude ? ». - (14) |
| aboutonner, v., boutonner : aboutonne-toi don ! - (40) |
| aboutonner, verbe transitif : boutonner. - (54) |
| aboutounner, aboutonner. v. - Boutonner : « A boutonne don' ta ch'mie avant de sorti', te vas attraper fré ! » - (42) |
| aboutsi (s') v. S'aplatir, s'étendre, s'étaler, tomber à plat ventre. - (63) |
| aboutson (en) loc. adv. (de bouche). A plat ventre. Tsère en aboutson : tomber face contre terre. - (63) |
| aboutson : à l'envers, le fond en l'air, etc. - (30) |
| âbr : s. m. arbre, grosse poutre du vieux pressoir. - (21) |
| abra : cri de joie, de colère, de terreur, etc. - (30) |
| abraer (Syncope d'abraser) v. a. Renverser violemment, détruire, écraser du latin abradere, qui fait au participe passé abrasus. - (10) |
| abrais (pour abrasis). s. m. Débris, démolitions. Bâtiment en ruine, ou mal construit, mal organisé. Au figuré, femme mal fagotée, mal bâtie. C'est un vrai abraïs que cette femme-là. Du partic. passé latin abrasus. - (10) |
| abrancher. v. - Ebrancher. - (42) |
| abrancher. v. a. Blesser nn oiseau à l'aile, l'abattre de dessus la branche. - (10) |
| abrâser (s'). v. - S'effondrer, s'écrouler : « Aveuc les agas ieau de c't'hiver, l'mur du fumier a fini d's'abraser ! » - (42) |
| abraser : aplatir - écraser. Ex : "L'orage ? Il a abrasé tout mon blé !" - (58) |
| âbre : (nm) arbre - (35) |
| abre : arbre - (43) |
| âbre : arbre - (48) |
| abre : arbre - (51) |
| âbre : arbre. - (52) |
| abre : Arbre. « In greu abre » : un gros arbre « L 'abre de la liberté » arbre planté en 1848 sur la place publique. - (19) |
| âbre : arbre. Vaugelas a écrit qu’à la Cour on disait « abre ». - (62) |
| âbre : un arbre - (46) |
| âbre : arbre. J'a planté une âbre : j'ai planté un arbre. - (33) |
| abre macchabe, m. : nuage qui présage la pluie. (M. T IV) - Y - (25) |
| âbre n.m. Arbre. - (63) |
| abre : (â:bre - subst. m.) arbre... - (45) |
| abre : s. m., arbre. - (20) |
| abre, âbe. n. m. - Arbre. - (42) |
| abre, arbe. Arbre. - (49) |
| abre, arbre et grosse pièce de bois traversée de deux barres servant à la faire tourner et à mouvoir, par ses tours sur elle-même, la roue des vieux pressoirs. - (16) |
| abre, arbre. - (05) |
| abre, arbre. - (26) |
| âbre, n. masc. ; arbre. - (07) |
| âbre, s. m. arbre. Nous prononçons « âbre » avec les bourguignons, les picards, les lorrains, etc. - (08) |
| abre, s. m., arbre : « Les autres fois, y avot iqui de grands âbres ». - (14) |
| abre, s.m. arbre - (38) |
| âbre, sm. arbre. - (17) |
| abre. s. m. Ancienne prononciation, conservée chez nous, du mot Arbre. Des Abres morts. Un bel Abre. Au temps de Vaugelas, le beau monde de la cour ne disait pas autrement. - (10) |
| abre-cabri. n. m. - Nuage cotonneux. (Mézilles, selon H. Chéry) - (42) |
| âbre-cabri. s. ni. Nuage cotonneux ressemblant à un arbre, qui apparait dans la soirée et qui, suivant la direction dans laquelle on le voit, présage la pluie ou le beau temps (Perreuse). - (10) |
| abredener, attredener : apprivoiser un animal - (43) |
| abredzi : se percher. - (30) |
| abrée. n. f. - Cep de vigne accolé à un arbre. - (42) |
| àbrée. s. f. Cep de vigne embrassant le tronc d'un arbre. - (10) |
| abrelin, petit arbre de jardin. - (05) |
| abrelodi, gâté, désœuvré. - (05) |
| abresai. : Havre-sac. (Del.) - (06) |
| abressiau, s. m., petit mât élevé sur un train de bois ou sur un bateau, et à l'aide duquel les mariniers établissent une voile, ou auquel ils attachent une corde pour tirer de là sur le bord (arbrisseau est-il étranger à ce mot ?). - (14) |
| abreure, s, f. 1. bruyère. 2. clématite. - (22) |
| abreuver, imbiber. - (26) |
| abreuver, v., tr., imbiber d'eau pour faire gonfler le bois ; s' emploie surtout pour les tonneaux ; jamais pour les animaux (on les fait boire). - (40) |
| abreuvouaîr (n') : abreuvoir (auge) - (57) |
| abrevier, abreuier : vx fr., abrevier, abréger. S'abreuver à faite quelque chose, se mettre vivement à l'ouvrage. - (20) |
| abric'eut : Prononcez : abrikeut. Abricot. « Des abric 'euts bien meus (mûrs) ». - (19) |
| abric'euté : Abricotier. - (19) |
| abricotay, s.m. abricotier. - (40) |
| abricoteil : un abricotier - (46) |
| abricoter. v. a. Casser les branches d'un arbre. - (10) |
| abrière, m. : verger. (M. T IV) - Y - (25) |
| abrigas. s. m. pl. Objets de minime importance. Voyez Abringats. - (10) |
| abrignauder : perdre son temps. - (30) |
| abriguats. s. m. pl. Vêtements et objets mobiliers de peu de valeur, jetés pêlemêle. Semble être le même qu'abrigas. - (10) |
| abrisac, abresac, sm. havresac. - (17) |
| abrisac, musette. - (27) |
| abrivent, s. m., sorte de paillasson tressé avec la paille du panis. Il est utilisé pour les fours et les garnitures de fumiers. - (14) |
| abro – indique généralement des objets de peu d'importance, et plus spécialement un vase dans lequel on met par exemple, le repas d'un enfant, le manger des petites bêtes. – Note pliaicair à portant pliain de tote sorte d'abro. – Daudi aipote voué ton abro qui te beillâ des faiviôles. - (18) |
| âbro : (â:bro - subst. m.) ustensile de cuisine, et de préférence récipient. Le mot est nettement péjoratif : l'â:bro est toujours inutile et encombrant. - (45) |
| abro : (â:bro - subst. m.) ustensile de cuisine, et de préférence récipient. le mot est nettement péjoratif : l’â:bro est toujours inutile et encombrant. - (45) |
| âbrô, s. m. se dit des menus engins qu'on emploie à divers usages champêtres. Un pêcheur va à la pêche muni de tous ses « âbrôs », c’est-à-direde tous les petits objets qui sont nécessaires pour pêcher - (08) |
| abrogi : abroger - (57) |
| abrondi : crépuscule. A - B - (41) |
| abrondi (s') Se couvrir, s'obscurcir. - (63) |
| abrondi : crépuscule - (34) |
| abrondi : crépuscule - (43) |
| abrondie (à l'), loc. au crépuscule. - (24) |
| abrondie (à l'). Crépuscule du soir, à la brune, aux dernières lueurs du jour. - (49) |
| abrondir. Commencer à faire nuit. - (49) |
| âbroqu’né : ébréché - (37) |
| abros (nom masculin) : petit matériel ou ustensiles usés en cuisine. - (47) |
| âbrot : utile à rien (personne ou objet) - (48) |
| âbrot, âbro (n.m.) : menu engin qu'on emploie dans les champs - (50) |
| abrot, s.m. écrou de bois, pièce du pressoir entourant la vis. - (38) |
| abrousseter, ébrousseter, rabrouster. v. - Tailler l'extrémité des branches, dans une haie ou un taillis. - (42) |
| abrouster. v. a. et n. Rogner, Couper le brout des arbres, les broustilles, les broussailles pour les bestiaux. Du bas latin abrostura, droit de faire brouter le bétail, dans certains cas, sur certaines terres. - (10) |
| abrouti. Abruti. - (49) |
| abrundir (abrondir) : v. n.. vx fr., abrunir, brunir, s'assombrir. Voir brundir. - (20) |
| abséethe. s. f. Absinthe (Etais). - (10) |
| absteni (s') : abstenir (s') - (57) |
| abuer (s'). v. pronom. Se dit, par syncope, pour s'abuger, s'abuser, lesquels se disent eux-mêmes l'un et l'autre pour s'amuser. On dit aussi s'ébùer, s'ébuser. Jeannot Collin, quand il était petit, s'ébusait ben tout seul. - (10) |
| abujer, abuher, v. a. amuser, dissiper. - (08) |
| abujotte, s. f. jouet, objet dont on s'amuse. - (08) |
| abuote, ebuote. s. f. Jouet d'enfant. Se dit pour abusotte, amusotte. - (10) |
| abusi : abuser - (57) |
| abû-yer (s'), v., s’amuser, se faire rire. - (40) |
| abymé, ce qu'on a souillé, gâté et dont on n'a pas eu soin. - C'est par une singulière extension qu'on a atténué ainsi (dans le Châlillonnais, par exemple) le sens du mot abimé, qui signifie perdu, anéanti... - (02) |
| âç’ârrer (s’), (s’) échârrer : (se) brûler avec de l’eau bouillante - (37) |
| âç’neau : chéneau - (37) |
| acabaîchi v. (de cap, tête, et baissé). Courber. - (63) |
| acabaner (s') (verbe) : se disait, au temps où la morale était plus stricte, des gens qui choisissait de vivre en ménage sans être passés devant le maire et le curé. - (47) |
| acabassé: accablé. - (30) |
| acabêchi : courbé par la vieillesse. A - B - (41) |
| acabêchi : courbé par la vieillesse - (34) |
| acabéssi, v. a. aplatir à demi. - (22) |
| acabit : espèce - (34) |
| acabit : espèce - (43) |
| acabit n.m. Espèce, genre, individu. - (63) |
| acafauiller (v.t.) : écrabouiller, écraser - (50) |
| acagnardi (s') : Acagnarder, s'engourdir, se blottir. - (19) |
| acagnardir (s') t. pronom. Faire le cagne, le paresseux ; se coucher, s'étendre comme un chien. Du latin canis. - (10) |
| acagnardir (s'), v. pr., s'acagnarder. - (14) |
| acagner. v. a. Provoquer, exciter, taquiner proférer des injures contre quelqu'un, figurément, aboyer contre lui comme un chien. Du latm canis. - (10) |
| acailler, accailler (s'). v. pronom. Ecarter ses bras et ses jambes pour faire la roue. - (10) |
| açaipper (v.t.) : échapper - (50) |
| acaler : écosser - (60) |
| acaler : écosser. Ex : "Faut qu'jacalint les pois avant qu'ils chan - nissent." (Le pois étant le haricot). - (58) |
| acaler. v. - Écaler, écosser. Se dit également d'une personne qui a rencontré de grandes difficultés : « Alle en a ben acaié la poure femme !' » - (42) |
| acaler. v. n. Souffrir, endurer de grandes peines. All' en a ben acalê la pour' femme. On dit mieux ecaler. - (10) |
| acalonner, acalouner, ecalouner. v. a. Poursuivre à coups de pierres ou d'autres projectiles. Forte altération du mot canonner. - (10) |
| acaman. s. m. En général, invalide, impotent. Dans le sens absolu, manchot, qui est sans main, qui n'a qu'une main. Voir acamander. - (10) |
| acamandé (adj.) : placé dans une situation difficile et peu enviable, par suite d'une infirmité, du décès d'un proche, ... (Eh mon poûre vieux, t'es bin acamandé (tu es bien à plaindre)) - (64) |
| acamandé (-e) (adj.p.p.m. ou f.) : las, à bout de force - (50) |
| acamander : affliger - handicaper. Ex : "Avec ta patte cassée, te v'la ben acamandé !" (S’emploie exclusivement avec l'auxiliaire être). - (58) |
| acamander. v. - Rendre impotent : « Il est ben acamandé avec son bras dans le plâtre. » Au sens passif.: être fatigué, exténué. La particule affirmative ac précède l'ensemble a-manus (a privatif, manus-main), telle serait, selon M. Jossier, l'origine de ce mot. - (42) |
| acamander. v. a. Dans le sens absolu. Rendre impotent, priver d'une main. Par extension et figurément, fatiguer, exténuer, paralyser. De ac, particule affirmative et complétive, de a privatif et de manus. - (10) |
| acamant. adj - Infirme, handicapé physique. Se dit également d'une personne abattue, dépressive. - (42) |
| acant'a : en même temps que - (61) |
| acaper (s'). v. pronom. Se roidir contre une difficulté se retenir, s'arc-bouter pour ne pas tomber. On dit, en bon français, Se camper, se mettre en garde, s'affermir sur ses jambes, sur ses pieds. - (10) |
| acaper(s') (v. pr.) : s'exciter - (64) |
| acapi (adjectif) : amorphe, avachi, sans ressort. - (47) |
| acâpi : accroupi. - (52) |
| acaquelourdir. v. - Étourdir par un coup donné à la tête. - (42) |
| acaquelourdir. v. a. Etourdir d'un coup donné sur la tête. - (10) |
| acarcouaillé (adjectif) : accroupi, comme plaqué au sol. - (47) |
| acardzi : village où les habitations sont très proches et mal disposées. A - B - (41) |
| acardzi : village où les habitations sont très proches et mal disposées - (34) |
| acardzi n.m. Ecart, hameau où les maisons sont groupées. - (63) |
| acaré, v. a. cerner dans un coin, ou «care ». - (22) |
| acarer, v. a. cerner dans un coin, ou « care » : acarer une vache échappée. - (24) |
| açarni (v.t.) : imiter en se moquant - (50) |
| açarnisseman (n.m.) : acharnement, obstination - (50) |
| acarter (v.t.) : écarter - (50) |
| acarter. v. - Ecarter. - (42) |
| acartiller (s'). v. - S'étirer. - (42) |
| açarvaler v. Saboter, abîmer. - (63) |
| açarvelé (-e) (n. et adj.) : étourdi (-e) - (50) |
| acassi : arraché, recroquevillé en parlant d’une personne (voir acouéri*). A - B - (41) |
| acassi : arraché, recroquevillé - (34) |
| acassi : recroquevillé - (43) |
| acater, v. tr., acheter, faire emplette de. - (14) |
| acaudir. v. - Raccourcir. Couper la queue d'une bête. Mot directement hérité du latin cauda, queue. Ce mot, encore employé en français dans la première moitié du XXe siècle, est aujourd'hui tombé en désuétude. - (42) |
| acaur, m. : portion mal cuite d'un pain ou d'un gâteau. (M. T IV) - Y - (25) |
| âcaûzet : aicouzâs : houx. (plus rarement : « aigreûle ») - (37) |
| acbi : Accroupi. « Ol était acbi daré la boucheure » : il était accroupi derrière la haie. - (19) |
| acc. s. m. et ace. s. f. Herse. Se dit pour arc et arche. - (10) |
| accabasser : v. a., aplatir (comme un cabas ?), écraser, rapetisser. — Accabasser (S') : v, r., se ratatiner. - (20) |
| accablié : Accablé. - (19) |
| accabyi : accabler - (43) |
| accagnarder (verbe) : paresser. - (47) |
| accagner (verbe) : poursuivre quelqu'un en l'injuriant. - (47) |
| accagnotir (s'). Se tenir quelque part avec paresse sans vouloir en bouger. Etym. cagne ; voyez ce mot. - (12) |
| accalancé : installé confortablement - (61) |
| accaloner : v. a., lat. calo (s. m.), gréer (un bateau). - (20) |
| accarcouassé (adjectif) : mal assis ou vautré sur un siège. - (47) |
| accasi (s') : accroupir - (51) |
| accassonner : (vb) mettre en tas - (35) |
| accatsi : s'accroupir. - (30) |
| accaux (d') : pourquoi ? - (09) |
| accenser. v. a. Amodier, affermer, donner à cens, prendre ou donner a bail. - (10) |
| accerter. : Attester (du latin ad certare). Coutumes de Beaune, 1370. - (06) |
| accessouaîre (n') : accessoire - (57) |
| accessouaîr'ment : accessoirement - (57) |
| acc'eu (Nom) : Accord « L 'acc 'eu règne pas dans leu ménage ». - (19) |
| acchatir. Habituer aux friandises, aux aliments succulents ; rendre friand. - (49) |
| accider. : Arriver par accident. Franchises de Seurre, 1341. - (06) |
| accin. s. m. Enclos attenant à une habitation. Du latin accingere, accinctus. - (10) |
| acciper, v. a. saisir rapidement, happer. - (08) |
| accmoder : accommoder - (51) |
| accmoder v. Accomoder. - (63) |
| accoder (s'). S'accouder. - (49) |
| accoder v. Accouder. - (63) |
| accoindre (y s’) : (vb) le temps se gâte - (35) |
| accointai (s'), se lier intimement ; se dit particulièrement d'une liaison des deux sexes.- Le vieux mot français coint signifie joli, agréable... - (02) |
| accointance (nom masculin) : accord, fréquentation. - (47) |
| accointer (s') (verbe) : se lier. Se mettre en rapport avec quelqu'un pour traiter des affaires ou faire un mauvais coup. - (47) |
| accointer (s'). : (Dial.), s'accointai (pat.), se lier avec quelqu'un. - (06) |
| accolage : s. m., action d'accoler. - (20) |
| accoler : v. a., attacher ensemble avec ou sans échalas les jeunes sarments de vigne de manière à les réunir en touffe. - (20) |
| accommoder : assaisonner - (60) |
| accompagna : accompagner - (57) |
| accordâilles n.f.pl. (fr. accordailles). Première visite officielle des parents du garçon aux parents de la jeune fille avant les fiançailles. - (63) |
| accordailles. n. f. pl. - Fiançailles. (Arquian) - (42) |
| accorder : Se dit du geste des batteurs en grange qui frappent en cadence avec le fléau le blé étendu dans l'aire. - (19) |
| accords, s. m,, accordailles, fiançailles : « La Tiennette reveint prou à not' fieu j' vons faire les accords dimanche ». - (14) |
| accorraudi v. (de corroyer, préparer, dégrossir, travailler, malaxer toutes les matières, du cuir à la terre). 1. Durcir, endurcir. 2. Fig. Endurcir. - (63) |
| accot. (Se mettre à l’) : S'abriter contre la pluie, le froid ou la chaleur, s'accoter. Pour ne pas eite moyé, i me sens mis ai l’aiccot pendant lai pleue. Les Autunois disent : ai l'aicouan et les Châtillonnais : ai l’acoyo. En terme de jardinage, un accot est un amas de fumier autour d'une couche. M. Mignard tire ce mot du sanscrit acaya : je ne suis pas assez savant pour le contredire. - (13) |
| accoter (verbe) : fermer une porte à clef. Fermer tout simplement. - (47) |
| accoter. v. a. Appuyer, ranger sur le côté. – Accoter (S'). v. pron. S'appuyer, se ranger sur le côté. S'accoter contre un arbre, contre un mur. - (10) |
| accotoires. s. m. pl. Sorte de hausses mises autour d'un envier, d'un tombereau, d'une hotte, etc., pour en soutenir le trop plein. A Auxerre, on dit des écoutoires. - (10) |
| accotouée. n. f. - Accoudoir. - (42) |
| accouailler, acarcouailler. v. - Écarter, éparpiller de la paille, du foin, etc. S'acarcouailler : s'étirer. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| accoubi, atioubi. adj. - Accroupi. - (42) |
| accoublier: accoupler, assortir. « Ces deux bûs (bœufs) sant bien ccoubliés ». - (19) |
| accoublir (s'). v. pronom. S'asseoir sur ses talons, s'accroupir. - (10) |
| accoudouaîr (n') : accoudoir - (57) |
| accouer : (vb) atteler - (35) |
| accouer : atteler une remorque - (34) |
| accouer v. (v. fr. attacher par la queue). Atteler en remorque. - (63) |
| accouer: (vb) atteler - (35) |
| accoutieau, accotoir, appui. - (05) |
| accoutrer v. Vêtir d'une façon peu seyante. - (63) |
| accoutumance. s. f. Coutume, habitude. - (10) |
| accrècher : attacher une vache à l’auge, la crèche, à l’aide d’une chaine et de façon plus globale rentrer tous les animaux dans les bâtiments pour la période hivernale. - (59) |
| accreubaîchi, accrobaîchi v. Accroupir, baisser, courber. Voir acabaîchi. - (63) |
| accreup'ter (s’) - se mettre à creup'ton : accroupir (s') - (57) |
| accreupton : accroupi - (51) |
| accreupton adj. Accroupi. - (63) |
| accreuptonner (s') : s'accroupir - (51) |
| accreuptoñner (s') v. S'accroupir. - (63) |
| accreut : Déchirure. « Alle a fait in biau accreut à san devanté » : elle a fait une belle déchirure à son tablier. - (19) |
| accreutsi (accrotsi) : accrocher - (51) |
| accreutsi, accrotsi v. Accrocher. - (63) |
| accrobâichi, accreubâichi v. Accroupir, baisser. - (63) |
| accroc : (nm) cueille-fruits - (35) |
| accroc : crochet pour cueillir les fruits - (43) |
| accroc n.m. Crochet pour abaisser les branches des fruitiers en vue de la cueillette. - (63) |
| accroc, subst. masculin : branche formant crochet. - (54) |
| accroc. Croc, instrument pour tirer, sortir le fumier de l'étable. - (49) |
| accrochi : accrocher - (57) |
| accrochou (n') : accrocheur - (57) |
| accrotsi (accreutsi) : accrocher - (51) |
| accrotsi : accrocher - (43) |
| accruchi : Agrafer. « Accruche me dan » : agrafe moi donc. - (19) |
| accruës, broussailles d'un pré, etc. - (05) |
| accueudre, aiguillonner. - (05) |
| accueuler (S’) (akeuler) : v. r., s'acculer, s'accroupir. - (20) |
| acculer, v. faire basculer (j'ai acculé le tombereau). - (65) |
| accuseur (euse) : s. m. et f., vx fr. acuseur, accusateur, dénonciateur. - (20) |
| accuter, écouter. - (05) |
| accutsi : accoucher - (43) |
| a-ce ? Est-ce ? A-ce ici le moitre ? Est-ce ici le maître ? - (01) |
| ace t'heure : maintenant - (44) |
| ace, s. f. herse, instrument agricole. - (08) |
| acein : clos (jardin ou autre). (F. T IV) - Y - (25) |
| acer, v. a. herser, cultiver avec la herse. - (08) |
| acertainer, affirmer, donner l'assurance qu'une chose est certaine. - (27) |
| acervellé. adj. - Écervelé. - (42) |
| ac'eulé : Accroupi « In ban vendange ou ne s'ac'eule pas au pid du chot » : un bon vendangeur ne s'accroupit pas au pied du cep. - (19) |
| aceuler : déverser par l'arrière - (51) |
| ac'eulére : Fatigue que l'on ressent dans les cuisses quand on s'est trop longtemps ac'eulé « Quan an s'est ac'eulé tot le jo an a l'ac'eulère quand y est né ». - (19) |
| aceurna (s') (abeurer (s')) : devenir menaçant, s'assombrir en parlant de la météo - (51) |
| achâhigner (v. tr.) : déchiqueter - (64) |
| achahigner : provoquer - (60) |
| achainte, achaintre, chainte. n. f. ou m. - Chaintre : désigne, à l'extrémité d'un champ, l'espace sur lequel tournent les attelages ou le tracteur. - (42) |
| achâner, v., achever une bête blessée. - (40) |
| achanner, échanner, verbe transitif : abasourdi. - (54) |
| achaouiller. v. - Briser en mille morceaux, déchiqueter, broyer. - (42) |
| achardon (n. m.) : chardon - (64) |
| acharer. v. - Ébouillanter, échauder. - (42) |
| acharni (s') : acharner (s') - (57) |
| acharnir. v. - Se moquer de quelqu'un avec gentillesse, en l'imitant, en répétant ses paroles immédiatement après lui. Ce mot provient de escharnir, lui-même dérivé de l' allemand Sherz, plaisanterie. Escharnir employé dès le Xe siècle dans le sens de railler, tourner en dérision. Rescharnir signifiait se moquer à son tour. Voir aussi écharnir. - (42) |
| acharnir. Voyez écharnir. - (10) |
| acharreu, écharrer. v. a. Echauder avec de l'eau bouillante. Chien écharré craint l'eau froide. - (10) |
| achassé. adj. - Se dit d'un tissu trop vieux, trop usé pour être réparé. (Mézilles, selon H. Chéry) - (42) |
| achati (v.) : Affriander, allécher. « Ol y est achati ». - (19) |
| achati, adj., habitué aux friandises. - (14) |
| achati, v. tr., allécher, montrer un appât, attirer, amadouer. - (14) |
| achatie : Appât, amorce. « Tan fû (feu) ne prendra pas, te n’y a pas mis prou d'achatie ». (pas assez de petit bois). - (19) |
| achatié, adj. verbal, amadoué, attiré par flatterie, par caresses ou présents. - (11) |
| achâtir (C.-d ., Chal., Y.), échaiti (C.·d. ), aichati (Morv. ). - Allécher, amadouer, attirer par l'appât de la gourmandise, par des chatteries ; rendre chat, c'est-à-dire friand, délicat comme chat, et, par extension, amollir. - (15) |
| achâtir (s'). v. - Se calmer, se détendre, tel un chat. - (42) |
| achatir. Deux sens : 1 - Allécher par les mêmes procédés dont on se servirait pour un chat, par quelque caresse ou quelque friandise ; 2 - Devenir très délicat, gourmand, difficile. Etym. chat et a, ad, devenu chat. Ce mot s'est répandu dans l’est, en Franche-Comté' notamment. - (12) |
| achatir. v. a. Attirer, prendre par la gourmandise. - (10) |
| achavoner, v. n. tourner un attelage de labour à l'extrémité d'un champ (vieux français chavon, extrémité). - (24) |
| ache, arche, s. f. Coffre, huche au pain. Du latin arca. - (10) |
| acheiller (n. m.) : échalier, petit échelle servant à franchir une clôture - (64) |
| acheniller. v. - Chasser sans ménagement. Se dit lorsqu'on repousse avec virulence une personne indésirable. - (42) |
| acheniller. v. a. Chasser, repousser avec violence quelqu'un qui l'a mérité le mettre dehors, comme on chasse un chien du chenil. On dit, dans certains pays, faire décaniller. Ces trois mots, acherniller, chenil et décaniller, dérivent du même mot latin canis. - (10) |
| acheteut : Aussitôt (voir asseteut). - (19) |
| acheudzi : installé. A - B - (41) |
| acheudzi : installé - (34) |
| acheudzi, asseudzi v. (lat. assidere, asseoir auprès de) 1. Asseoir, installer, rendre indépendant. 2. Bien assembler, fixer solidement, assujettir. - (63) |
| acheumer : entasser - (51) |
| acheuri v. Assurer. - (63) |
| acheurtoir, s. m., lisiège. - (40) |
| achevaler. v. - Action de faire passer les roues d'une charrette en dehors des ornières tracées d'un chemin. (Sougères-enPuisaye) - (42) |
| achève : part, pass., achevé. Mon travail est achève. - (20) |
| achevri (n. m.) : espèce de carotte sauvage - (64) |
| achevris. n. m. - Carotte sauvage. - (42) |
| achiaquer (v.t.) : écrabouiller, écraser - (50) |
| achiardi (v.t.) : éclaircir - (50) |
| achinte (n. f.) : chacune des deux extrémités d'un champ, qu'on laboure transversalement (syn. défrontue) - (64) |
| achiter (s') (lat. pop. sitare, mettre en place) v. S'asseoir. - (63) |
| achlotte (n. f.) : échelette, ridelle placée sur le devant d'une charrette afin de maintenir le chargement - (64) |
| achô, aichô, particule d'affirmation. Oui, c'est ainsi. - (08) |
| achter : acheter - (51) |
| ach'ter : acheter - (57) |
| achtheûre adv. Maintenant, actuellement. - (63) |
| achtiver. v. - Rendre chti : rendre méchant ou mauvais, un enfant ou un animal. - (42) |
| achtôt, dachtôt adv. Bientôt, aussitôt. - (63) |
| ach'tou (n') : acheteur - (57) |
| aclassé, éclassé. adj. - Se dit d'un arbre ayant éclaté sous l'effet d'un choc, de la foudre, ou de la gelée. Aloissé à Sougères-en-Puisaye. - (42) |
| âcle, (en) en âcle, démoli, percé, usé ; des souliers en âcle : des soulés en âcle. - (38) |
| acles (en), loc. se dit d'étoffes, de linge, de vêtements usés ou très déchirés : « Ah ! ce p'tiot drôle ! ô m' met toutes ses afâres en âcles ». - (14) |
| acloter (s'), v., s'accroupir sur les talons pour vendanger ou cueillir les légumes. - (40) |
| acmeude : Fricassée, préparation culinaire. « Fâ nos eune bonne acmeude de faviolles » : fais nous un bon plat de haricots. - (19) |
| acmeuder : Accomoder. « Des tapines acmeudées au lâ » : des pommes de terre préparées avec du lard. - (19) |
| ac'moder, v. tr., accommoder, préparer. - (14) |
| ac'moder. Accommoder. - (49) |
| ac'moûder - ec'moûder : accommoder - (57) |
| acner v. (or. inc.) Bégayer. Conjug. Dz'acone. - (63) |
| acnî (adj.) : d'une maigreur extrême (syn. dég-netté) - (64) |
| acni (adjectif) : fatigué, sans force, éreinté. - (47) |
| acni (être) : fatigué, las. Ex : "Les vaches m'ont fait couri', j'seus acni !" - (58) |
| aco, abri couver ; se mettre à l'aco, se garer de la pluie sous un aco. - (16) |
| acoi (à l'), loc. a l'abri de la pluie. - (22) |
| acoinchan (n. m.) : dans un champ de forme irrégulière, partie qu'on doit labourer séparément - (64) |
| acoinçon, acoueson. n. m. - Se dit d'un champ dont une extrémité se termine en triangle, en pointe. - (42) |
| acoindri : bien peigné, lissé - (43) |
| acoïöt (ai l’), loc. a l'abri du vent. Voir soute. - (17) |
| acoîri v. (dérivé du lat. cooperire, operire, qui a donné couvrir en français) Aplatir, voûter, recroqueviller. - (63) |
| acoiser et s'acoiser. : (Dial.), acoisai et s'acoisai (pat.), du latin acquiescere, signifie se mettre en un lieu où le vent est coi (quietum) et n'a plus de prise. - (06) |
| acoité, v. a. se dit des rameaux qui s'inclinent vers la terre sous l'effet de la pluie. - (22) |
| acoiter, v. a. se dit des rameaux qui s'inclinent vers la terre sous l'effet de la pluie : l'averse a acoité le sarrasin. - (24) |
| âcole (n.f.) : école - (50) |
| açolle (n.f.) : échelle - (50) |
| acorci, v. tr., accourcir, abréger : « En coupant po les prés, j' ons brament acorci la route » (V. Pu court). - (14) |
| acôrder, v. tr., accorder. - (14) |
| acoriau. s. m. Écureuil. - (10) |
| acorner. v. - Élaguer, couper le bout des branches. - (42) |
| acorner. v. - Encorner. - (42) |
| acorner. v. a. Elaguer, couper les jeunes branches, les vrilles, les cornes de certains arbustes, de certaines plantes. Acorner la vigne. - (10) |
| acornifleux. n. m. - Pique-assiette ; écornifleur, s'employait encore en français populaire au XIXe siècle. Au XXe siècle, on dit écornifler en français familier, pour escroquer, rafler, resquiller. - (42) |
| acorniller. v. - Donner des coups de cornes. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| acòt. - Voir : Cot. - (15) |
| acoter : appuyer, consolider, soutenir. - (09) |
| acoter, v. tr., fermer, étayer, soutenir. (V. Acouter). - (14) |
| acouâiller (s') (v. pr.) : se ramasser sur soi-même, se recroqueviller - (64) |
| acouassé : ramassé comme une poule dans son nid, aplati (talon d'une pantoufle) - (61) |
| acoué (à l'), loc. à l'abri de la pluie : courir se mettre à l'acoué (du latin ad quietem). - (24) |
| acoué : abri - se mettre à.... Ex : "Avec ce bon Dieu d'orage, j'ai pas eu l'temps d'me mett' à l'acoué !" - (58) |
| acouée, s. f., abri ; se mettre à l'acouée ! - (40) |
| acouer : mettre un véhicule en remorque derrière un autre. A - B - (41) |
| acouer : atteler l'un derrière l'autre - (51) |
| acouer : mettre un véhicule en remorque - (43) |
| acouer. v. a. Du latin cauda. Attacher à la coue, à la queue, ainsi que le font les maquignons pour les chevaux qu'ils conduisent aux foires, attachés à la queue l'un de l'autre. - (10) |
| acouéri : syn. de acassi*. A - B - (41) |
| acouéri : voir acassi - (34) |
| acouéru, écoru : écureuil - (43) |
| acoueson, acoinçon, acoinson (pour écoinçon, écoinson). s. m. Triangle dans un champ ; raies de plus en plus courtes dans un champ formant trapèze. En général, objet placé dans une encoignure, dans un angle. - (10) |
| acouésonner. v. a. et n. Finir en acouéson, en écoinson, en raies de plus en plus courtes, en parlant d'une terre labourée. - (10) |
| acouler : v. accoler. - (21) |
| acouo, aicouo : n. m. Abri. - (53) |
| âcoûrue : poursuite, accompagnée de menaces vociférées - (37) |
| acoussé, v. a. poursuivre vivement, prendre à la course. - (22) |
| acouté. Ecoutez… - (01) |
| acouter (du grec axouo, ou du latin auscultare). v. a. Ecouter, et surtout attendre. Acoute-le. J'vas t'acouter. Acouter (s'). v. pronom. Je parle bas. Se dit aussi, plus particulièrement, des personnes qui prennent de leur santé plus de soin qu'il n'est raisonnable, de ceux qui semblent écouter si leur pouls bat plus fort ou plus vite une fois qu'une autre. Je ne dis pas qu'il ne soit pas un peu malade, mais bien certainement il s'acoute trop. - (10) |
| acouter (s') v. Se croire malade à la moindre petite gêne ou indisposition. - (63) |
| acouter (v.t.) : écouter - (50) |
| acouter (verbe) : écouter. Peut être pris aussi dans le sens d'obéir. - (47) |
| acouter : (vb) écouter - (35) |
| acouter : Ecouter. « Acoute dan voir » : écoute donc. - (19) |
| acouter v. Ecouter. - (63) |
| acouter, écouter. S'emploie également dans le sens d'attendre : Acoute donc ! Attends donc ! - (04) |
| acouter, écouter. S'emploie également dans le sens d'attendre : Acoute donc ! Attends donc ! - (36) |
| acouter, v. a. écouter, faire attention, prendre garde. - (08) |
| acouter, v. tr., accoter, accouder, appuyer. (V. Acoter). - (14) |
| acouter, v. tr., écouter : « Acoute ! acoute ! j’vas t’bailler quête chouse ». - (14) |
| acouter. Ecouter - (03) |
| acouter. Écouter. - (49) |
| acouter. v. - Écouter. Autre sens : attendre. - (42) |
| acouteumer une chose, loc. pour s'accoutumer à une chose : « J'ai acouteûmé mon vare de vin blanc tos les maitins ». - (14) |
| acoûtiau : appui, parapet, rampe. - (62) |
| acoutiau, s. m., accotoir, rampe, appui, parapet. - (14) |
| acouver, v. a. attacher à la file, à la queue. - (24) |
| acoyo, expression bourguignonne du Châtillonnais. Se mettre à l' acoyo du vent, signifie se meltre à l'abri du vent... - (02) |
| acquebutte : s. f., vx fr., hacquebutte, arquebuse. - (20) |
| acqueni. adj. -Très fatigué, épuisé, fourbu. - (42) |
| acquéri : part, pass., acquis. - (20) |
| acrâ adj. et n. Ecrasé. En ruine, à l'abandon. - (63) |
| acrâ n.m. Onom. Gros coup de tonnerre. - (63) |
| acrabouiller. v. - Écrabouiller. - (42) |
| acraer, acraser, écraer. v. - Écraser. - (42) |
| acramocher (v. tr.) : ébréché (un bol acramoché) - (64) |
| acrampouté, v. n. accroupir. - (22) |
| acrapounies, accrapougnies. n. f. pl. - Courbatures. - (42) |
| acrasé : écrasé - (61) |
| acrâyer (v.t.) : écraser - (50) |
| âcrâyer : écraser - (37) |
| acre : Zeste, membrane sèche qui cloisonne l'intérieur de la noix. « Des acres de calas ». - (19) |
| âcré interj. et adj. Sacré. Voir sâpré. - (63) |
| acrécher (v.t.) : mettre les animaux à la crèche - (50) |
| acrécher (verbe) verbe) : attacher les animaux à la crèche dans l'étable. - (47) |
| acreîcher, v. a. mettre à la crèche. Se dit des animaux qu'on attache aux mangeoires dans lesquelles se trouve leur nourriture. - (08) |
| acreîchot, s. m. crochet, agraffe. - (08) |
| acrepton. Voyez : crepton. - (13) |
| âcreûter, âcreûiller : enlever la croûte - (37) |
| âcrit, s. m. écrit. Je ne veux pas de parole, je veux un « âcrit. » - (08) |
| acriteure (n.f.) : écriture - (50) |
| âcriteure, s. f. écriture, ce qui est écrit. - (08) |
| acro : crochet pour tirer l'eau du puits - (48) |
| acrô, s. m., gros hameçon à quatre crochets pour draguer les seaux tombés dans le puits. - (40) |
| acroûgner (v. tr.) : entamer, écorner, en parlant d'une somme d'argent - (64) |
| acroupetoner (s'), v. pr., s'accroupir (Voir Aqueùler, Boucheton, Croupeton). - (14) |
| ac'teu : maintenant - (61) |
| acubî (s') (v. pr.) : s'accroupir - (64) |
| acuéri, caressi : caresser - (43) |
| acuison, acuson et accusson. - Contestation, amende. Charte de 1270. - (06) |
| aculer, v. tr., éculer : « Ton p'tiot marche ben mau ; ôl a tôt aculé ses souleis ». - (14) |
| acurie (nom féminin) : écurie. - (47) |
| acurie d'oueilles (nom féminin) : bergerie. - (47) |
| acùyé, v, a. attacher à la file, à la queue. - (22) |
| adan. Ardent, ardents. Eüille adan, yeux ardents. - (01) |
| adevant. prép. et adv. - Avant, dans un sens temporel : « Il est mort ben adevant la derniée guée ! ». Cet adverbe de temps correspond exactement à l'ancien français du XIIe siècle devant exprimant une notion de temps : auparavant. - (42) |
| adfi : engrais, fumier. A - B - (41) |
| adfi v. (du lat. aedificare, construire une maison) Elever, cultiver, acclimater une plante, un animal. Voir attrauder. - (63) |
| âdiè : aider - (46) |
| adié : évier. - (52) |
| âdièse : objet sans valeur - (48) |
| adieu galoux, loc., s'employait par les enfants pour désigner une dernière tournée au jeu : Allons, encore un adieu galoux ! - (20) |
| adigrai, s.m. marches d'escalier ; à Saint-Germain-du-Plain, on dit esgra ; balayer les escaliers : panna les esgras ; à Touches, on dit rmaer les adigrai. Prononciation adigrailles ("l" mouillée). - (38) |
| adivin ; adv., pourquoi ? - (40) |
| adje (dj. = d mouillé), sf. aide. - (17) |
| âdjée : évier (forme entendue dans un hameau voisin) - (39) |
| adjugi : adjuger - (57) |
| adodiner v. (du v. fr. dodiner, bercer, caresser). Cajoler. - (63) |
| adolicher. v. - Dorloter, gâter. (Villeneuve-les-Genêts, selon M. Jossier) - (42) |
| adolicher. v. a. Dorloter, soigner trop bien, gâter. Des enfants adolichés (Villeneuve-les-Genêts). - (10) |
| adon - Eh bien, c'est pourquoi. - Adon, allez brâment. - Adon, vô fairâ ben de ne pas causa ai ces gens qui. - (18) |
| adonfe : à demeure pour l'année (un valet est loué —). - (30) |
| adopter : v. a., adapter. - (20) |
| ados : (adô: - subst. m.) billon, sorte de sillon en relief ; dans une "hâte", on en fait autant qu'on en veut, pour y semer des betteraves fourragères, des haricots, des carottes, des asperges ... - (45) |
| âdouellé : usé, cassé, brisé - (37) |
| adoûssi - accoûter : adosser - (57) |
| adouvin ? : D’où ça vient ?. Pour quelle raison ? Au nom de quoi ? Comment se fait-il ?... - (62) |
| adoux : tous les corps gras utilisés en cuisine. - (30) |
| adoux n.m. Corps gras pour cuisiner. - (63) |
| adrache : Adresse. « T'as fait in biau cô d'adrache! »: Tu as fait un beau coup d'adresse, donc une grosse maladresse. - (19) |
| adrachi : Adresse. Prov. « Vaut mieux s’adrachi au Ban Dieu qu'es saints » : vaut mieux avoir à faire au maître qu'à ses subordonnés. - (19) |
| adrait : adroit - (57) |
| adrait, adroit. s. m. Se dit souvent pour endroit. L'adrait, l'adroit d'une étoffe, le côté opposé à l'envers. Se dit, quelquefois pour adresse. Ne pas savoir s'y prendre d'adrait. - (10) |
| adrait, aite. adj. Qui a de l'adresse, qui est adroit. Ah mon pour' peut, que t'n' es donc gué adrait. - (10) |
| adrait. Adroit. - (49) |
| adrat : Adroit. « Ol est bien adrat ». Ironiquement : « Ol est adrat c'ment in chin de sa coue » : il est adroit comme un chien de sa queue. Manière, façon. « S'y prendre de la bonne adrat » : s'y prendre adroitement. - (19) |
| adratement (adv.) : Avec adresse. - (19) |
| adressi : adresser - (57) |
| adret (avoir de l') : savoir s'y prendre pour faire un travail - trouver le bon geste, la bonne position - savoir par où commencer. Ex : "L'pour'houme, il a pas d'adret, ar'gadez don coument il fé ses jarbes." (jarbes = gerbes). - (58) |
| adret : adroit. IV, p. 21-4 - (23) |
| adret, m. : côteau ensoleillé propice à culture de la vigne. (M. T IV) - Y - (25) |
| adrêt, s. m., adroit, habile. - (14) |
| adret. n. m. adj. - Endroit. Autre sens : adroit. - (42) |
| adreû : adroit - (43) |
| adreut(e) : (adj) adroit(e) - (35) |
| âdrîllé : déchiré - (37) |
| adroictement. : (Du latin ad directum) selon le strict droit. - (06) |
| adroit : endroit de quelque chose. Par opposition avec « envâr » qui est l’envers. Si ce n’est une déformation de « endroit », adroit pourrait venir de « adret » : le côté (de la montagne) exposé au soleil. - (62) |
| adroit, s. m. endroit ; ne s'emploie qu'au pluriel. Les « adroits » d'une localité, c’est-à-direles environs : « a n' traige pas dans nos adroits » ; il ne vient pas souvent dans le pays que nous habitons. - (08) |
| adroit, s. m., l'endroit d'une étoffe, d'un linge : Y èt eùne balle robe ; en v'qui l'envar, j' vas vous en montrer l’adroit ». - (14) |
| adroit. Pour endroit. Etym. mauvaise prononciation du mot endroit. - (12) |
| adrot, -rette adj. Adroit. - (63) |
| adruzené, garni de plumes. - (05) |
| ad'taleu' : tout à l'heure - (61) |
| aduvin ? pourquoi ? aduvindon ? pourquoi donc ? - (38) |
| adveni : advenir - (57) |
| adventer : v. a., garnir une chose. Adventer la table, mettre le couvert. - (20) |
| adye, s. f. eau. - (22) |
| adze : âge - (51) |
| âdze n.m. Âge. - (63) |
| adzi : âgé - (51) |
| adzu (aidzu, adzuer) : aider - (51) |
| adzu(er) : (vb) aider (p.passé: èdzu) - (35) |
| adzu, aidi : aider - (43) |
| adzuer v. (du lat. adjutare, aider) Aider. - (63) |
| adzuer(adzu, aidzu) : aider - (51) |
| adzuinde v. Adjoindre, ajouter. - (63) |
| adzuint n. Adjoint. - (63) |
| aesmer. : (Dial.), juger, estimer. - (06) |
| afaire de (l'), loc. adv., environ, à peu près : « Y a l’afaire d’un mois qu'ôl é rev'nu » (ou r'venu). - (14) |
| afaire et afare, s. m , ustensile, vêtement, nippe, et en général tout ce dont on se sert : « Y ét un afaire en bos qu'ô m'a v'nu emprôter ». « Y é son vouésin qui l’i a baillé c’brave petiot afaire ». - (14) |
| afaire, s. f., quantité : « Vous n'é point de poumes dans vot' eurti ; moi, j'en ai éune boune afaire ». - (14) |
| afaité, élevé, amoncelé, enfaité. - (04) |
| afaiter (v.) : Terminer le sommet, le faite d'une meule de paille, d'une motte de fagots. - (19) |
| afaré : furoncle (ou plaie infectée), arrivé à maturité. A - B - (41) |
| afauberti, m. adj. Etourdi, affolé, ahuri. Au figuré, qui a quitté le droit chemin, qui a mal tourné, qui s'est perverti. Voyez afauvertir. - (10) |
| afaubertie (-e) (adj.m. ou f.) : exténué (-e) - (50) |
| afaul. : (Lat., ad folium), vendre vin à afaul, signifiait, dans les anciennes chartes, tenir taverne. - (06) |
| afautri : mou, sans force (comme du feutre). - (32) |
| afauvertir, afaubertir (ad falsum vertere). Affoler, ahurir, hébéter quelqu'un, lui retourner, lui fausser, lui renverser l'esprit, soit en le brutalisant, soit en lui donnant coup sur coup, avec menaces, des ordres contradictoires. Se dit aussi, figurément, des mauvais conseils, des mauvais exemples, des mauvais livres qui vous détournent du bien en vous faussant les idées, en vous pervertissant l'esprit, le cœur, le sens moral. - (10) |
| aferloter. v. - Exciter la gourmandise. (Mézilles, selon H. Chéry) - (42) |
| afét’yi, v. a. briser les mottes à l'aide d'un râteau. - (22) |
| afétrer, v. a. terminer le sommet, le faîte d'une meule de bois ou de paille. - (24) |
| affaib'illi : affaiblir - (57) |
| affaie. n. f. - Affaire. - (42) |
| affaire, subst. féminin : mets. - (54) |
| affaîter (v. tr.) : remplir ou charger au maximum (affaîter un tombériau) - (64) |
| Affaîter. v. - Entasser dans un grenier, la paille ou le foin, le plus haut possible, le plus au faîte possible. - (42) |
| affaîter. v. a. Amonceler, élever en faîte, mettre en comble aussi haut que possible. - (10) |
| affaizée. s. f. Quantité d'herbes, de menus bois ou autres objets contenus dans le tablier qu'on porte relevé devant soi. Une boune affaizée de luzarne. De faix. - (10) |
| affalé : tombé à plat ventre, fatigué, membres pendants - (43) |
| affaler (s') v. Tomber à plat. - (63) |
| affaner: v. a., ahaner, amasser, acquérir péniblement. Voir atreauder. - (20) |
| affâre : Affaire, chose quelconque; « Range bien tes affâres ». Commerce, affaires, « Les affâres sant les affâres ». - (19) |
| affarer. v. - Faire peur. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| affâres : affaires. Dont des vêtements…par exemples. - (62) |
| affauberdi, affauberti. adj. - Étourdi, affolé, fou-fou. Se dit également d'une personne qui a mal tourné. - (42) |
| affaubertir. v. - Affoler, troubler quelqu'un par des menaces ou des ordres contradictoires. L'origine de ce mot est « rendre fou » ; un fabert au XIVe siècle est un nigaud, un sot, peut-être par déformation de fol : fou. Foberter signifie tromper, duper.. - (42) |
| affaudi ie, adj., affaibli par manque de nourriture. - (11) |
| affauti, ie. adj. Qui se sent défaillir. J'ai l'estoumac affauti de besoin. - (10) |
| affener : gagner péniblement. - (30) |
| affeni. Fatigué. - (49) |
| affére (n') : affaire - (57) |
| affergeander. v. a. Affriander. - (10) |
| afferlicher (s') : se réjouir à l'avance - (61) |
| affermage : s. m., vx fr., engagement d'un serviteur pour un temps déterminé. Voir louée. - (20) |
| affermé (ée) : s. m. et f., serviteur engagé pour un temps déterminé. - (20) |
| affétlè, aiffétlè : v. t. Charger par-dessus le faîte (surcharger). - (53) |
| affeurmer (s’) : (vb) se louer comme valet de ferme - (35) |
| affeurmi v. Affermer (les commis), engager du personnel agricole. - (63) |
| affiamer. v. - Enflammer. Ce verbe correspond exactement à l'usage de aflamer au Moyen Âge, dans le sens de allumer, mettre la flamme. - (42) |
| affianné (ée). adj. Essoufflée, qui bat du flanc. - (10) |
| affian-né, ée. adj. - Essoufflé, qui bat du flanc. - (42) |
| afficat. n. m. - Appétit : être de bon afficat, avoir bon appétit, ne pas être difficile, toujours content de ce que l'on a dans son assiette. (Villiers-Saint-Benoît, selon M. Jossier) - (42) |
| afficat. s. m. Appétit. Être de bon afficat, avoir bon appétit, n'être pas difficile, trouver toujours tout bon (Villiers-Saint Benoit). - (10) |
| affichi : afficher - (57) |
| affichoter (v. tr.) : tailler en pointe (syn. affioûler, apointucher) - (64) |
| afficot. n. m. - Petit objet destiné à retenir l'aiguille à tricoter ; le plus souvent constitué d'un noyau de pêche ou d'abricot percé d'un trou, ce petit ustensile était maintenu au tablier de la tricoteuse. Afficot est la déformation de affiquet, ancien mot employé encore en français au milieu du XXe siècle pour désigner un petit objet de parure fixé sur le vêtement. L'affiquet était le diminutif.de affiche : ce qui est fiché, fixé, ou ce qui sert à fixer, le porte-aiguille par exemple. L'affiche, au Moyen Âge était une boucle, une sorte d'agrafe. - (42) |
| affilée (d') : A la suite, sans désemparer, sans discontinuer. « O nos a chanté quat' chansans d'affilée ». - (19) |
| affilée n.f. File d'attente. - (63) |
| affilée. s. f. Suite, file, rangée. – D'affilée, locut. adverb. De suite, sans interruption. - (10) |
| affilière, affilure. s. f Morceau de fer ou de fonte soudé à l'extrémité du soc d'une charrue pour en refaire la pointe, pour lui redonner du fil. - (10) |
| affilloure, s. f. cape, manteau des bergères qui ressemble, pour la coupe et l'étoffe, à la limousine des charretiers. - (08) |
| affinouaîr (n') : affinoir - (57) |
| affioler. v. a. Lisser, polir, remettre en place, avec la brosse, les poils d'un chapeau, d'un tissu quelconque, lorsqu'ils sont rebroussés. Au figuré, flatter, caresser, flagorner, ou, comme on dit vulgairement, passer la main sur le dos à quelqu'un. - (10) |
| affioûler (v. tr.) : tailler en pointe (syn. affichoter, apointucher) - (64) |
| affiouler. v. - Flatter. (Arquian) - (42) |
| affiquet : ornement, petit ustensile pour tricoter. - (09) |
| affiquot. s. m. Petit ustensile que certaines tricoteuses suspendent à leur côté droit pour soutenir leur aiguille, et qui, d'ordinaire, consiste en un simple noyau de pêche ou d'abricot percé en dessus. On ne s'en sert plus guère aujourd'hui. Boiste et d'autres lexicographes donnent affiquet, dans le même sens. - (10) |
| affiter, effiter. v. - Exciter, agacer gentiment un enfant ou un animal. On emploie afitier au XIIe siècle dans le sens de provoquer, voire insulter ; le mot patois affiter en serait un usage affaibli. - (42) |
| affiter. v. a. Exciter, agacer, irriter, particulièrement un chien, - (10) |
| afflan-né (adj.) : efflanqué - (64) |
| afflanné : exténué. Ex : "J'ai couru avant la puie (pluie), et j'seus bramant afflan - né." (on allonge la prononciation des 2 premières syllabes, et l'on chute sur la dernière). - (58) |
| affligé (être). Avoir des infirmités. On dit aussi « attigé ». - (49) |
| affligé adj. Handicapé, diminué par la maladie. - (63) |
| affligé : part, pass., infirme, estropié. - (20) |
| affligi (être) : Etre dans le malheur par suite de maladie ou d'infirmité. « Ol est bin affligi ce paure bougre ! ». - (19) |
| afflinger (verbe) : asperger généreusement. (C'te beurdin m'a tout afflingé avec le jet d’eau). - (47) |
| afflir. : (Dial.), accabler, tourmenter. - (06) |
| affoler : Blesser, faire mal. « Je me sus affolé le pid » : je me suis fait mal au pied. - (19) |
| affoler. Avorter ; s'emploie en parlant des animaux. - (49) |
| affouâiller (v. tr.) : effaroucher apeurer, affoler (affouâiller les poules – il est tout affouâillé (se dit d'une personne très agitée)) - (64) |
| affouailler. v. - Tomber violemment : « T'aurais vu le grous poummier coumme i' s'est affouaillé. » (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| affouberti (adj. et n. m.) : abruti - (64) |
| affouler : v. a., vx fr. fouler, affoler, faire mal, faire souffrir. Te m’affoules. Y m'affoule dans l'épaule. - (20) |
| affouler. v. - Affoler. - (42) |
| affourée, affourure. n. f. - Ration de fourrage pour la journée. - (42) |
| affourgnat (pour affouriat, afforiat). S. m. Petit oiseau assez fort pour sortir du nid, et qui s'envole au dehors. Du latin foris - (10) |
| affourgnat, afforgnat. n. m. - Jeune oiseau assez vigoureux pour s'envoler. - (42) |
| affourgner, afforier (s'). v. pronom. Se dit d'un petit oiseau assez fort pour quitter son nid, et qui s'envole au dehors. Du latin foris. - (10) |
| affourure. s. f. Ration de fourrage, nourriture donnée aux moutons dans l'étable. - (10) |
| affranchi : affranchir - (57) |
| affranchir : v. a., régulariser par une section franche et nette une surface inégale. On affranchit à l'aide du couleau le pain qui a été rompu à la main. On affranchit un arbrisseau que l'on transplante, lorsqu'on en coupe l'extrémité des racines. - (20) |
| affranchir. v. - Parler clairement, distinctement : « T'as entendu nout' député, coumme il affranchit ses paroles. » Ce mot est directement issu de l'ancien français affranchir : nettoyer, purifier. La franchise au XIe siècle signifiait liberté, générosité, noblesse ; dérivé du latin franc us (libre), le mot est conservé dans l'expression « avoir les coudées franches. » Affranchir témoigne d'un glissement de sens, de rendre libre à rendre clair. - (42) |
| affrantsi v. Nettoyer avant un premier usage une poêle, une casserole. - (63) |
| affremer (s'), parti en maître, se piéci : se louer comme valet de ferme - (43) |
| affrier, effrier (contraction pour efriser, effriter), v. a. Emietter. Quoi qu't'as à effrier ton pain coume ça ? T'as donc pas faim ? Se dit, figurement, comme menace. J'vas te bréger, j' vas t’affrier, te mincer en mouciaux, te mettre en mille miettes. - (10) |
| affriser, affrier. v. - Émietter. - (42) |
| affronteux (euse) : s. m. et f., vx fr. afronté et affronteux, effronté. - (20) |
| affrou : affreux. IV, p. 21-2 - (23) |
| affrou : goinfre. - (29) |
| affût (d'). loc. ad v. - Esprit vif, intelligent, rusé : c'est une femme d'affût. - (42) |
| affût (d'). locut. adverbiale. Qui a le fil, dont l'esprit est vif, rusé, bien affûté. On dit à Auxerre C'est un homme d'affût, son père était canon. - (10) |
| affutchau : matériel hétéroclite - (34) |
| affuter : aiguiser. - (09) |
| affutiance, bagatelle.- En vieux picard, on disait affutiau pour exprimer quelque chose de peu d'importance. En latin, fustis signifie baguette, branchage de peu de valeur. - (02) |
| affutiance. : Bagatelle. - (06) |
| affutiau : Littré. Brimborion « Qu'est ce que te veux fare de ç't'affutiau ? » - (19) |
| affutiau : matériel hétéroclite - (43) |
| affutiau : pierre à aiguiser. - (31) |
| affûtiau n.m. (v.fr.) Matériel ou vêtements hétéroclites, sans valeur (souvent employé au pluriel). - (63) |
| affutiau : vêtement ridicule. Par dérision : vouloir faire l'élégant. - (58) |
| affutiau, s. m., bagatelle, ustensile ou vêtement de peu de valeur. - (40) |
| affûtiaut, affûtiaux : galopin, énergumène - (66) |
| affutiaux (nom masculin) : outils, généralement rudimentaires. Se dit aussi des habits de fêtes. - (47) |
| affutiaux : (nmpl) vieux habits, nippes - (35) |
| affutiaux : objet hétéroclite - (44) |
| affutiaux : vieux habits, nippes - (43) |
| affûtiaux. n. m. pl. - Vieux vêtements : «J'l'avons vêtu d'un attirail d'affutiaux, à sa convenance, et j'ons fait un épouvantail ! » (Fernand Clas, p.l68). Ce mot s'emploie toujours dans le français familier. - (42) |
| affûtiot : un drôle d'affûtiot. - (56) |
| afilée (d'), locut. adv. de suite, sans interruption. Ex. : j'ai dormi douze heures d'afilée. - (11) |
| afilée (tout d'une), loc, d'affilée. - (14) |
| afiqué, adj., paré, qui a mis ses affiquets, qui est sur son trente-six. Comp. affique (épingle), qui sert tant lorsqu'on s'ajuste, et affiquet a désigné tout objet de toilette. - (14) |
| afité, v. a. terminer le sommet, le faîte d'une meule de bois ou de paille. - (22) |
| aflegi (être), loc. avoir des infirmités. - (22) |
| aflinger : éclabousser - (61) |
| aforé : soigner le bétail lorsqu'il revient des champs. - (21) |
| aforner : v. enfourner. - (21) |
| afôti, celui qui ne mange pas selon son besoin et dont la santé en souffre ; se dit aussi d'un animal. - (16) |
| afoulé, v. a. contusionner ; causer une blessure interne. - (22) |
| afouler, v. a. contusionner ; causer une blessure interne. - (24) |
| afre. adj. Avide, goulu, gourmand, glouton, et, dans certains cas, pingre, avare. Se dit, par suppression de l’s pour safre. - (10) |
| afre. Transe, effroi, épouvante, horreur. C'est de ce substantif qu'on a formé affreux, puis effroi. - (01) |
| afuquiau : objet manuel. - (09) |
| afut’yau, s. m. pl. objets accessoires (sens plaisant) : il a ramassé ses afut'yaux. - (22) |
| afutchau : ustensile - (51) |
| afutcho : objet ou matériel hétéroclite. A - B - (41) |
| afuthiô, petits objets de toilette ou servant à faire diverses petites choses. - (16) |
| afutiau, s, m., dénomination s'appliquant à toutes sortes d'objet. On dit : «Mes afûtiaux » pour : mes ustensiles, mes outils, etc., tandis que le français affûtiau ne désigne que des brimborions. - (14) |
| afutiaux (des) : habits, vêtements - (61) |
| afut'yau, s. m. pl. objets accessoires (sens plaisant) : il a ramassé ses afut'yaux. - (24) |
| aga ! : (interjection.vb) regarde ! - (35) |
| aga ! : interjection exprimant la surprise. (M. T IV) - Y - (25) |
| aga ! aigué ! se dit pour appeler l'attention sur une personne ou sur une chose. Aga le ! le voici. Ce mot doit être un adoucissement de l'eccè des latins. - (16) |
| aga ! interj. regarde ! attention ! vois ! - (08) |
| aga ! : regarde ! Ex : "Aga ! Té vas tomber !" (Souvent, c'est déjà fait !). "Aga la barrée, al va ben s'sauver !" (Une barrée c'est une vache bi-colore). - (58) |
| aga (v. tr. impératif) : regarde (aga lu (regarde-le)) - (64) |
| aga : regarde - (61) |
| aga : regarde - (48) |
| aga : regarde. - (52) |
| aga : tiens (Aga- lu : le voici ou Aga le ; aga la). - (33) |
| aga d'eau (nom masculin) : pluie abondante et de longue durée. (C’est tombé des agas d’eau). - (47) |
| aga don : regarde donc (avec étonnement) - (51) |
| aga et egué. Interjection admirative qui me parait être l’impératif d'agarder ou regarder, bien qu'on l’ait dérivé du grec ayaw, j'admire. - (13) |
| aga impératif d'agader. Regarde ! - (63) |
| aga ! interj. courage !! attrape ! voir ga [ga et aga sont les vieux impératifs de garder et agarder]. - (17) |
| aga ! ou aigai ! - exclamation pour montrer quelque chose, ou quelque chose que l'on cherchait, dont on parlait. - Aga lu, lâvan. - Aga ! tein le vouéqui. - Aigai. - (18) |
| aga! excl., sorte d'impérat., d'Agater : tiens ! voilà ! regarde ! « Aga donc ! aga-lu ! Le v'qui ! » (V. Egué !) - (14) |
| aga, agardez, ardez, regarde, regardez. - (04) |
| aga, vois, regarde... - (02) |
| aga. - Impératif.de regarder. Aga-lu ! Regarde-le ! Aga don' ! Regarde donc ! - (42) |
| aga. interject. Regarde ! - Aga-lu, Regarde-le ! Au plur. Agadez, regardez ! Du grec agaô, j'admire, je regarde avec admiration On doit dire, au reste, que aga est l'impératif même du verbe agaô. - (10) |
| aga. Interjection équivalente à voilà. - (03) |
| aga. Regarde, impératif abrégé du verbe patois argarder, Ce temps seul est usité. - (12) |
| aga. Regarde. Terme très employé surtout avec « don ». On dit : « aga don». - (49) |
| aga. : Sorte d'impératif. On a dit argarder et agarder comme nous disons aujourd'hui regarder. - (06) |
| agaçai, provoquer, impatienter quelqu'un. - (02) |
| agàce (Chal., Y.), aiguaise (C.-d.), aigaisse (Morv.), oyasse (Char.). - Pie, du bas latin agasia. - (15) |
| agace : s. f., agacerie. Agace ! se dit au jeu de quinet par l'un des joueurs lorsqu'il veut prendre le droit de simuler le jet du bâtonnet. L’autre joueur prive le premier de ce droit, s'il dit avant lui : Pas d'agace ! - (20) |
| agace, accace, le crépuscules (latin "occasum" ?) : s'en veni à l'accace, àl'agace. - (38) |
| agace. Pie. - (03) |
| agaci - érigni : agacer - (57) |
| agaci : agacer - (51) |
| agaci, agci v. 1. Agacer. 2. Exciter, inciter (un chien) à mordre. - (63) |
| agacia (n') : acacia - (57) |
| agacia : (nm) acacia - (35) |
| agacia : acacia - (43) |
| agacia : acacia - (48) |
| agacia : Acacia. Robinia pseudo-acacia. « In ban paicheau d'agacia » : un bon échalas en bois d'acacia. - (19) |
| agacia n.m. Acacia. - (63) |
| agacia, acacia, essence d'arbre. - (16) |
| agacia, s. m., acacia. - (14) |
| agacia, subst. masculin : acacia. - (54) |
| agacia. Acacia. On dit encore « éguécia ». - (49) |
| agacin n.m. Cor aux pieds. Ce mot de vieux français (XVIe s.) résulte de la contraction d'œil d'agace (œil-de-pie). Il désigne également un œil de vigne, placé en bas d'une branche et ne donnant jamais de grappe. - (63) |
| agacin, agassin : s. m., cor aux pieds. - (20) |
| agacin, s. m., durillon, cor au pied : « Quand l' temps veut sanger, y é mou agacin qui m' fait mau ! » - (14) |
| agader v. (v. fr. agarer, regarder) Regarder. - (63) |
| agadi : déformer par l'eau en parlant d'un vêtement - (51) |
| agage, agasse. s. f. Pie. Babiller, faire la belle, se carrer comme une agace. Du bas latin agasia. - (10) |
| agai (prononcer agaille, avec " l" mouillée) , évier (du latin "aquarium") ; piarre d'agai ; pierre d'évier. - (38) |
| agaiter, v. a. guetter, surveiller de près, épier. Cet homme est méchant, mais je vais bien « l'agaiter. » - (08) |
| agaler, égaler. Égaliser. - (49) |
| aga-lou ! exclamation ; regarde-le !, le voilà (cf. italien "ecco lui !") (cf. latin "ecce hoc !".) - (38) |
| agalu (verbe) : regarde. Souvent suivi de soué pour accentuer le sens. - (47) |
| agalu : regarde le - (61) |
| aga-lu : regarde-le. - (09) |
| aganacher (s'). Prendre de mauvaises habitudes ; s'habituer au mal. - (49) |
| agâs (n. m.) : grosse quantité (des agâs d'iau) - (64) |
| agas d'yau - amayau - avayau : supposé : amas d'eau, suite à des pluies d'orage. Débordements. Ex : "Anvec ces amayaux, te vas gauger avec tes sabiots." - (58) |
| agas. n. m. pl. - Grandes quantités ; des agas iau ou des agas d'iau signifie des pluies torrentielles : « Seux pieds sont trempés coumme deux soupes, d'pis l'temps qu'i' tombe des agas d'iau ! » (Fernand Clas, p. 56) - (42) |
| agasse : pie. Aussi : jaquette, asshe ; de l’allemand ancien « agaza ».La Fontaine dit agasse dans l’aigle et la pie. - (62) |
| agasse : pie. II, p. 31 - (23) |
| agasse n.f. Pie. On dit surtout oyesse. - (63) |
| agasse tambouinette, s. f. pie-grièche. - (08) |
| agasse : pie. Ex : "Ces bon dieu d’agasses, al vont ben manger toutes mes c’ries !" (= cerises). - (58) |
| agasse, s. f., pie. - (40) |
| agasse, s. f., pie; au fig., femme qui parle beaucoup : « Oh ! c'te Claudine, alle bavarde .. Y êt eùne vrà agasse, quoi ! » - (14) |
| agasse, subst. féminin : pie. - (54) |
| agasse. n. f. - Pie. (Sainte-Colombe-sur-Loing). Mot très ancien, du XIe siècle, resté vivant en poyaudin sans aucune modification. - (42) |
| agasse. Pie. Ce nom vient-il du verbe agasser, où bien est-ce agasser qui dérive d’agasse ? Le verbe me parait avoir deux acceptions. - (13) |
| agassis. n. m. - Petite flaque d'eau. (Mézilles, selon H. Chéry) - (42) |
| agât d'eau, s. f. Pluie torrentielle, qui ravage et dévaste. Du vieux mot agaster, gâter, ravager. - (10) |
| agate : s. f., cornaline (voir ce mot) ; bille de verre contenant à l'intérieur une hélice colorée. - (20) |
| agater, v. tr., regarder. (V. Aga, Aguéter et Ar'gca'der). - (14) |
| âgausser dâs gaûs : écosser des haricots, en grains - (37) |
| agaye : pluie torrentielle. - (30) |
| agàyé, v. r. assouplir les membres, les rendre gais sous l'effet des premiers mouvements. - (22) |
| agayée : flaque d'eau. - (30) |
| age (d'), loc. adj., âgé : « L' père Ponsot, qu'é-ce qu'ô peut beu avouêr ? — hum ! ôl è d'âge ! ». - (14) |
| age (en). locut. adverb. En sueur, en eau. Être en age, Être trempé de sueur, être tout en eau. Du latin aqua, et du vieux français aigue, aige, age. C'est donc à tort que beaucoup de personnes disent : Je suis à nage, je suis tout en nage. - (10) |
| âge : Agé. « Y est in homme d'âge ». - (19) |
| âge : Content, satisfait, joyeux. « Que nos serins âges, copère (compère) Bliase (Biaise) le jo que nos les mairierins (marirons) ». Vieille chanson. « Etre à son âge » être dans l'aisance Plaisamment on dit d'un homme qu'une pointe de boisson a mis en gaîté : « O n'est pas treu riche ma ol est bien à son âge ». - (19) |
| âgé : aisé, facile. Ç'o ben âgé : c'est bien facile. - (33) |
| age ; un homme d’âge, un homme âgé. - (16) |
| age : s. m., moyen âge, âge moyen. « Y a donc ben d' la mort avec c'té sacrée grippe? — Oui, et pis avez-vous r'marqué qu'elle tape principalement sur les gens du moyen âge ? » - (20) |
| age, s. f. Nous comptons un certain nombre de mots dont nous avons changé le genre : « La belle âge ! » - (14) |
| age. adj. Aise, content, satisfait. Ol ot b'n'age, Il est bien aise. (Domecy-sur-le-Vault). - (10) |
| âgement : Ustensile de ménage « Alle vend bien san laitage pasqu'an sait que ses âgements sant bien tenis preupes (propres) ». Au figuré, on dit d'une personne laide : « Y est in vilain âgement ». - (19) |
| âgement : ustensile de cuisine. - (33) |
| agements, sm. aisements, ustensiles de ménage. - (17) |
| agenoiller (s'), v, pr., s'agenouiller. - (14) |
| agère : adj. f., âgée. - (20) |
| agergotte. n. f. - Sorte de petite crevette d'eau douce. (Saints, selon D. Levienaise-Brunel) - (42) |
| ageter : Acheter. « Ol a ageté eune vaiche (vache) à la foire de Tôrneu (Tournus) ». En parlant de quelqu'un qui a plus de sa part de naïveté, on dit : « O n'y a pas ageté ! ». - (19) |
| ageter, v. tr., acheter. Simple adoucissement de prononciation. (V. Acater). - (14) |
| ageurla : (nm) pied de houx - (35) |
| âgeûrnée (ail’) : (à l’) égrenée, les uns après les autres - (37) |
| aggleti (pain). Pain mal levé, mal fait, c'est-à-dire agglutiné, collant. - (12) |
| aggravé (être). Avoir les pieds fatigués par la marche sur le gravier ; se dit surtout pour les bovins : « mes bûs sont aggravés, je vas les faire ferrer ». - (49) |
| agi (ï), adj. aisé ; commode ; facile à manier. - (17) |
| agider (v. tr.) : aider - (64) |
| agider et, mieux, Ajider. r. a. Seconder quelqu'un, l'aidera faire son ouvrage. Du latin adjuvare. - (10) |
| agider. v. - Aider. - (42) |
| âgie (n.f.) : évier ; pierre creusée qui servait d'évier (de l'a.fr. age, ève = eau) - (50) |
| âgie, s. f. evier, pierre creusée sur laquelle on lave et d'où l'eau s'écoule au dehors. - (08) |
| agissance, s. f., manière d'agir : « T' la veux ? Prends garde ; alle a des agissances que j' n'ainmons point. » - (14) |
| agîvrer (v. int.) : s'activer, se hâter - (64) |
| agland. Gland. Autrefois gland était féminin ; « a » de là a dû s'agglutiner avec gland d'où « agland ». On dit aussi « éyant ». - (49) |
| aglée, s. f., chute de neige. - (40) |
| agmel : vieux couteau dont la lame est branlante - (51) |
| agneau : voir pressoir. - (20) |
| agnéte : mouton (lat. agnete). - (32) |
| âgni : (vb) (vache) donner son lait - (35) |
| âgni : donner son lait au pis - (43) |
| âgni v. (du lat. agnum, l'agneau) Donner son lait (en parlant de la vache). - (63) |
| âgnon : (nm) poignée de foin que l’on donne à une vache pour la faire « âgni » - (35) |
| agnon : poignée de foin qu'on donne à une vache avant de la traire pour la faire « âgni » - (43) |
| âgnon n.m. Poignée de foin offerte à la vache pour l'inciter à donner son lait. - (63) |
| agoguener v. Acoquiner, dévergonder. - (63) |
| agoni : Agonir, accabler de, « Alle l'a agoni de seutijes » : elle l'a accablé d'injures. - (19) |
| agoni v. Agonir, accabler, injurier. - (63) |
| agoni, égôni accablé d'injures. - (38) |
| agonies : s. f. pl., agonie. Il est aux agonies. - (20) |
| agonir (verbe) : proférer des sottises, des méchancetés à l'égard de quelqu'un. - (47) |
| agonisé d'sotize, accabler d'injures. - (16) |
| agoniser, injurier, invectiver. - (05) |
| agoniser, v. tr., agonir, injurier, outrager en paroles : « Ol é mauvais c'ment eùne gale ; ôl agonise tout l’monde de sottises ». - (14) |
| agoniser. Accabler d'injures, injurier. - (49) |
| agorcer, v. tr., tromper, agir de mauvaise foi dans un échange. - (14) |
| agorer : dans un moulin ou une batteuse, caler par excès d'apport de grain ou de paille. A - B - (41) |
| agorer v. Etouffer. - (63) |
| agorrer : qui étouffe en mangeant - (51) |
| agot : gouttes qui tombent du toit - (43) |
| agöt, sm. logette de l'évier. Piare d'agôt, pierre d'évier. - (17) |
| agotasse (n. f.) : pot en terre cuite, à bords évasés, dans lequel on fait égoutter le caillé - (64) |
| agoter : Egoutter. « Mantre (mettre) agoter des fremâges ». - (19) |
| agotiaux (pl.) : Eaux tombant d'un toit qui n'a pas de chénaux. « Retire dan ce ché (char), t'vois bin qu 'ol est seu les agotiaux ! ». - (19) |
| agotou : égouttoir à fromage - (43) |
| agotou : Vase sur lequel on met égoutter le fromage frais et qui reçoit le petit lait. - (19) |
| agottaille : (nf) gouttes qui tombent du toit - (35) |
| agottaille : eau qui tombe des toits (qui égoutte : qu'agotte) - (51) |
| agottailles, agottiaux n.f.pl. ou m.pl. Gouttes qui tombent du toit. - (63) |
| agotter : (vb) traire à fond - (35) |
| agotter : égoutter - (51) |
| agotter : traire à fond - (43) |
| agotter v. Traire à fond. Egoutter. - (63) |
| agotton : (nm) dernières gouttes de lait à la fin de la traite - (35) |
| agottons : dernières gouttes de lait au pis - (43) |
| agouanstie (n. f.) : caractère d'une personne difficile à contenter – caprice - (64) |
| agouant (adj.) : exigeant, difficile, qu'on a peine à contenter - (64) |
| agouant : turbulent - insupportable (on parle surtout d'un enfant) Ex : "Oh vieux Saint Agouant, te vas-t-y t'arrêter !" - (58) |
| agouant, ante. adj. - Fatigant, exigeant, désagréable. - (42) |
| agouant, ante. adj. Contrariant, fâcheux, maussade, ennuyeux, fatigant. - (10) |
| agouantie (pour agouantise). s. f. Exigence ennuyeuse et fatigante. - (10) |
| agouanties. n. f. pl. - Soucis, tracas. - (42) |
| agoué (adj.) : excédé (j'seû agoué (j'en ai assez)) - (64) |
| agoué : ayant mangé à satiété - (61) |
| agoué : Qui n'a plus d'appétit. « Ce cochon est agoué, o ne veut pieu ran migi (manger) ». - (19) |
| agoué. adj. - Écœuré, dégoûté, fatigué de quelqu'un ou de quelque chose. - (42) |
| agouer (s') : (vb) s'étrangler - (35) |
| agouer (s') v. (de s'engouer). S'étrangler. - (63) |
| agouer (s'). S'étouffer en mangeant trop vite ; « être agoué », être repu. - (49) |
| agouer (s’): (vb) s’étrangler - (35) |
| agouer : étrangler (s'), étouffer (s') - (43) |
| agouer : s'étrangler en mangeant. - (30) |
| agouer : ennuyer, agacer. Ex : "Arrête de sauter sur la chée (chaise) té m'agoues !" - (58) |
| agouer. v. a. Dégoûter. – Au passif, Être agoué, être dégoûté, rassasié, fatigué d'une personne ou d'une chose. De a privat., et goût. - (10) |
| agouffer (s') (v. pr.) : hausser le ton, parler avec colère - (64) |
| agouffer (s'). v. - Hurler à s'étrangler. - (42) |
| agouffer. v. n. Parler avec volubilité pt d'une voix entrecoupée par la colère. Se dit aussi d'un chien qui se jette sur les gens, la gueule ouverte, en aboyant avec furie. - (10) |
| agouiller, agouyer : v. a., embêter. Ah ! t' m 'agouilles ! - (20) |
| agouiller. v. - Gaspiller, disperser. - (42) |
| agouiller. v. a. Gâter, gaspiller, faire mauvais emploi. Agouiller son argent. - (10) |
| agoutasse : faisselle - voir : fercielle. - (58) |
| agoutasse, agotasse. n. f. - Pot à égoutter sous la faisselle. - (42) |
| agouter, v. tr., égoutter, faire tomber les gouttes d'un liquide : « On va souper; sœurette veint d'agouter la salade » . - (14) |
| agoutouée, égoutouée. n. f. - Égouttoir. - (42) |
| agoutter : v. n., épuiser, égoutter. J' vas m' servir d'un agouttiau qu'on agoutte les bateaux. - (20) |
| agoutter. v. - Égoutter. - (42) |
| agouttiau, agotiau, égoutiau : s. m., écope. Pass' me donc l'agouttiau ! - (20) |
| agoutton : s. m., petit lait résultant soit de la coagulation, soit du battage. - (20) |
| agouyé, v. a. ennuyer ; importuner. - (22) |
| agôyer, v. a. ennuyer; importuner. - (24) |
| agra (v.) ou égra : Braquer les roues d'un char. - (19) |
| agrabelle. adj. Agréable. Sorte de prononciation anglaise assez singulière. - (10) |
| agrafer, v. a. saisir, agripper. - (08) |
| agrafigner (v. tr.) : égratigner - (64) |
| agrain-ner : agrainer - (57) |
| agrains, s. m., mauvais grains, criblés et destinés aux volailles. - (14) |
| agraper, v. tr., agripper, saisir, s'emparer vivement d'un objet : « O s'a si ben agrapé à moi, que je n' pouvô pus bouger ». - (14) |
| agrapper : v. a., vx fr., agripper. - (20) |
| agravé. adj. - Se dit d'un animal qui boite parce que l'un de ses sabots est encombré de graviers. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| agravelée, s.f., houx. - (40) |
| âgre : Aigre, piquant. « La bige est âgre » : le vent du nord est piquant. - (19) |
| agrechon, agrejon : s. m., vx fr. agregi, grincheux. Un agrechon. Ah ! qu'elle est agrechon. - (20) |
| agrejon, s. m. sournois et mal gracieux, qui a des paroles aigres. - (24) |
| agrela : Houx. Iles aquifolium. « In batan d'agrela » : un bâton en bois de houx. - (19) |
| agrèle (agrele) : s. f., lat. acrifotium, houx. - (20) |
| agremiaulé, v. r. accroupir, mettre d'un « miau » (tas) sous l'effet du froid. On dit aussi acrroumé. - (22) |
| agremiauler, v. r. accroupir, mettre d'un « miau » (tas) sous l'effet du froid. On dit aussi agrômer. - (24) |
| agret (agré), agreut, agrôt : s. m., vx fr. aigret, grappillon de raisin qui vient après la première floraison et ne mûrit pas. Voir grumette et conscrit. - (20) |
| agreu : s. m. raisin de verjus. - (21) |
| agreule : houx - (43) |
| agreume : (nf) verjus - (35) |
| agri ou agrie : Sorte de petit lait qui se sépare de la crème. Voir Crâme. - (19) |
| agriffer. v. a. Empoigner vivement, saisir, retenir de force en serrant les doigts - S'agriffer. v. pronom. Se cramponner avec force en serrant les doigts. Du bas latin agrifare. - (10) |
| agrillan : Raidillon, montée courte et rapide. « I faut doublier pa manter c't'agrillan » : il faut doubler l'attelage pour monter ce raidillon. - (19) |
| agrillon, terre ferrugineuse, stérile. - (05) |
| agrion. Terre inculte ou incultivable. - (03) |
| agriotte : cerise sauvage. - (09) |
| agrippai. : (Dial. et pat.), prendre violemment. - (06) |
| agripper. Saisir avec les grippes ou griffes, et par extension avec les mains. Not’ matou vint d'agripper eune rette. — Tins, voiqui eune poumme, aigrippe ! - (13) |
| agro (nom masculin) : ergot du coq ou de tout autre volatile. - (47) |
| agrô, s. m. ergot du coq et de certains oiseaux ; tubercule corné de quelques mammifères. - (08) |
| agrœle, s. m. houx (du latin agrifolium). - (24) |
| agrœle, s. m. houx. - (22) |
| agrognon : s. m., vx fr. engroigne et groignet, coup de poing, horion. - (20) |
| agromé : accroupi. A - B - (41) |
| agromé : accroupi - (34) |
| agromé : accroupi - (44) |
| agromé, à crepeton, agrabessi, agreubessi : accroupi - (43) |
| agromer (s') : faire le dos rond - (43) |
| agrômer (s’) : (vb) faire le dos rond - (35) |
| agromer (s’) : se pelotonner - (51) |
| agrômer v. (de grume) Recroqueviller (de froid) accroupir, regrouper, agglomérer. - (63) |
| agron, s. m. sournois et mal gracieux, qui a des paroles aigres. - (22) |
| agron. Héron. - (03) |
| agrostis. - (63) |
| agrot : Raisin tardif et aigre qui ne parvient pas à complète maturité et que, pour cette raison, on laisse sur le cep au moment de la vendange ; on le cueille plus tard pour en faire de la piquette, de la « boissan d'agrots ». - (19) |
| agroué , accroué , accroupi, œuf groué, œuf couvé. - (04) |
| agrouer (s') : accroupir (s') (pour les poules) - (43) |
| agrouer (s’) : (vb) s’accroupir - (35) |
| agrouer v. (de grouer) Accroupir, dans la position de la poule qui couve . Voir grouer, grouèche. - (63) |
| agu (acutus), aigu, agu-ie, aiguille, aiguion, aiguillon. - (04) |
| aguarer. v. - Égarer. - (42) |
| aguemelle : mauvais couteau. A - B - (41) |
| aguemelle : mauvais couteau - (34) |
| aguer, aguger. v. a. Appointir. Aiguiser. Aguer des échalas. Aguger des passiaux. - (10) |
| aguer, aguiser. v. - Aiguiser, tailler en pointe. - (42) |
| aguergeote : crevette d'eau douce. IV, p. 31 - (23) |
| aguerguelle : peu de chose. IV, p. 31 - (23) |
| aguerguelle : voir aguergeote - (23) |
| agueriote : voir aguergeote - (23) |
| agueriotte, aguerjotte. S. f. Merise, griotte, fruit de l’agueriottier, de l'aguerjottier. - (10) |
| agueriottier, aguerjottier. s. m. Griottier, merisier. Dans certaines communes, on prononce agueurjottier. - (10) |
| aguerjotte. n. f. - Fruit du merisier, cerise sauvage. (Sougères-En-Puisaye) - (42) |
| aguesiau. s. m. Houx. Ainsi appelé sans doute à cause de ses feuilles qui ont des piquants, qui sont aiguës. - (10) |
| aguesse : pie. - (29) |
| aguéter, v. tr., guetter, épier, être aux aguets : « Ol a ben aguété sa p'tiote ; ma ô n'a ran vu ». - (14) |
| agueuïlle n.f. Aiguille. - (63) |
| agueuille, aigueuille : aiguille à coudre - (43) |
| agueuillon : aiguillon ; dard de l'abeille ou de la guêpe - (43) |
| âgueûlé : trop ouvert, écarté - (37) |
| âgueûllion : aiguillon - (37) |
| agueuriabe, adj., agréable, qui convient. - (14) |
| agueurion (n.m.) : héron - (en a. fr. aigron) - (50) |
| agueurion (n.m.) : héron (métathèse d'aigrion, égron = héron) - (50) |
| agueurion, s. m. héron, oiseau de l'ordre des échassiers. - (08) |
| agueurlat n.m. (du lat. acrifolium, houx). Houx. - (63) |
| agueurle : (genre ?) houx - (35) |
| âgueûrner : égrener en enlevant l’enveloppe des grains - (37) |
| âgueûrner sâs seûv’nîs : raconter ses souvenirs - (37) |
| agueurni v. Monter en graine. - (63) |
| agueusi : aiguiser - (43) |
| aguger (verbe) : aiguiser. - (47) |
| aguicher. Agacer, taquiner. - (12) |
| aguichi : aguicher - (57) |
| aguier (l'), évier, lavoir. - (05) |
| aguilaneuf, guilhanet. Mot qu'on criait jadis en signe de réjouissance et qui reproduit le cri des Druides : « Au gui l'an neuf. Dans la commune d'Arleuf, les enfants, à Carnaval, vont encore quêter dans les campagnes des œufs et autres comestibles au cri de « Guilhanet ! » On sait que l'année a commencé, jusqu'en 1564, tantôt au 25 mars, tantôt au lendemain de Pâques. - (04) |
| aguiller, v., aiguillonner (les bœufs). - (40) |
| agûjeux n.m. Affuteur, aiguiseur. - (63) |
| agûji v. Aiguiser. - (63) |
| agulon : aiguillon. - (32) |
| agulon : aiguillon. III, p. 31 - (23) |
| aguouée, aguvouée, agusouée (pour aigusouée). s. f. Aiguisoir, pierre à aiguiser. - (10) |
| agutsi v. Aguicher. - (63) |
| aguyons. Prononciation patoise d’aigusons, qui est lui-même un provincialisme. Les aguyous sont les éclats de bois qui restent en petits tas dans la vigne après que les paisseaux ont été aiguisés : Va-t-en queri les aguyons vez les bôrdes de paissias. - (13) |
| agüzi : (vb) aiguiser - (35) |
| agüzoule : (nf) « piarre d’aguzoule » : pierre à aiguiser - (35) |
| ah vouate : pas du tout, mais non - (48) |
| ah! exclam, constamment placée devant le nom de la personne qu'on appelle, ou qu'on interpelle : « Ah ! Gogote ! Ah ! Jacquot ! ». - (14) |
| ahaie, s. f. haie vive ou sèche. - (08) |
| ahanères. : (Dial.), laboureur. - (06) |
| ahers. : (Dial.), attaché à.- S'emploie au sens physique comme au sens moral ; c'est le participe passé du verbe aherdre, dérivation naturelle du latin adhoerere, part. adhoesus. - (06) |
| ahontir. v. - Faire honte. Verbe provenant directement de l'ancien français du XIIe siècle ahontir ou ahonter. Il a ensuite évolué en hanter avant de disparaître du français ; le poyaudin en a conservé la forme première. - (42) |
| ahontir. v. a. Faire honte, honnir. - (10) |
| ahoutat. s. m. Petit bouton. - (10) |
| ahusson. n. m. - Hérisson. - (42) |
| ai - a, sur, vers. - A vinrai ai ce sar. – Mettons nos ai l'ombre. - Ai lai neu. - (18) |
| ai (prép.) : à - (50) |
| ai 1'aigueurnotte : exp. Les uns après les autres (à l'égrenée). - (53) |
| ai bâ : à terre, par terre - (48) |
| ai bas : à terre - (39) |
| ai blot : en vrac - (48) |
| ai blot : tel quel - (48) |
| ai bouèch'ton : à califourchon - (48) |
| ai bouèjvolée : à l'envers, tête bêche - (48) |
| ai bouj'ton : à califourchon - (48) |
| ai ce sair - ce soir. - En fauro que vos eussain fini ai ce soir. - En fairé bon piaiché nos treufes ai ce tantô. - (18) |
| ai crepoton : accroupi - (48) |
| ai c't'heure : à présent (à cette heure). Ai c't'heure vins ai table. : à présent vient à table. - (33) |
| ai Dieu vô command, je vous recommande à Dieu. - (02) |
| ai lai borgnotte : dans l'obscurité, à tâton - (48) |
| ai lai r'voyeûre : au revoir - (48) |
| ai l'aival : chez soi - (48) |
| ai l'aivolée : vers le bas - (48) |
| ai lè r'voyure : au revoir - (46) |
| ai pan : en vrac - (48) |
| ai peu, et puis. - (16) |
| ai pouègne : à peine - (48) |
| ai pour à et pour de. Vo vinrë ai bon'heure, vous viendrez à ou de bonne heure, non tardivement. - (16) |
| ai profit : en gestation, attend une naissance. - (33) |
| ai quan, loc. en même temps : « i m'en vé ai quan lu », je m'en vais en même temps que lui. - (08) |
| ai s'teûre : à cette heure, maintenant, de suite - (46) |
| ai varse : pleuvoir très fort - (39) |
| ai verse : à verse - (48) |
| ai : 1 prép. À. - 2 conj. Et. - (53) |
| ai : à - (39) |
| aï, haïr ; j’aï, t'aï, et aï, je hais, tu ais, il hait. - (16) |
| ai, prép. à, marque la tendance ou la possession. Ai pour a est essentiellement bourguignon. - (08) |
| ai, prép., à : « C’qui ét ai moi ». Cette prononciation vient de la Côte-d'Or et n'est pas tout à fait générale. (Voir A). - (14) |
| ai. C'est tantôt l'article qui marque le datif singulier ou pluriel : Ai monsieu, à monsieur ; ai messieu, à messieurs… - (01) |
| ai. : Pour a. Cette dernière lettre est fréquemment adoucie par la voyelle i, soit dans le dialecte, soit dans le patois. - (06) |
| a-iant, prononciation de : ayant, répandue aussi dans le Midi et le Lyonnais. - (14) |
| aibaché, vt. abaisser. - (17) |
| aibaicher : abaisser - (48) |
| aibaitou, s. m. abatteur, celui qui abat. Se dit principalement des bûcherons qui abattent les arbres dans la fabrication du bois de moule - (08) |
| aibaitre, v. a. abattre. - (08) |
| aibandon, s. m. désordre, confusion - (08) |
| aibâtairdi : dégénéré - (48) |
| aibâtardi : qui ne profite plus, dégénéré - (39) |
| aibatardir : animaux ou humains revenus à l'état primitif, ayant perdu sa personnalité. Abètir. - (33) |
| aibate, aibatte : abattre - (48) |
| aibatelou (n.m.) : bateleur, baladin - (50) |
| aibatelou, s. m. bateleur, celui qui donne des spectacles en plein air, baladin, farceur qui amuse le public en faisant des tours ou des grimaces. - (08) |
| aibatleur : bateleur, charlatan, animateur de foire, beau parleur. So des histoires d'aibatleur : ce sont des histoires de charlatan. - (33) |
| aibâtlou : bateleur - (39) |
| aibatre, vt. abattre. - (17) |
| aibattage : n. m. Abattage. - (53) |
| aibattaige : abattage - (48) |
| aibatte - (39) |
| aibattè : n. m. Abattre. - (53) |
| aibattouère : abattoir - (48) |
| aibaudi (-e) (p.p. et adj.) : ébahi (-e), abasourdi (-e), surpris (-e) - (50) |
| aibaussumer, aibôssumer (v.) : apostropher avec violence, insulter (de Chambure écrit aibôssumer) - (50) |
| aibe (n.m.) : arbre - (50) |
| aibeurio (n.m.) : abri, lieu où l'on se met à couvert - (50) |
| aibeuriô, s. m. abri, lieu où l'on se met à couvert. - (08) |
| aibeuriot, aiveuriot : n. m. Abri. - (53) |
| aibeutné, vt. boutonner. - (17) |
| aibeûvrou (n.m.) : abreuvoir - (50) |
| aibeûyer (s') (v.t. et pr.) : amuser ; s'amuser - (50) |
| aibiâmi (v.t.) : rendre blême, pâlir - p.p. et adj., aibiâmi - (50) |
| aibiancer (s'), se balancer. - (27) |
| aibiancher. v. a. Casser une aile à un oiseau. Voyez abrancher. - (10) |
| aibiégé, surchargé par un lourds poids. (Un arbre aibiégé par la neige se courbe et se casse). - (27) |
| aibîme, s. f. abîme, lieu profond, où l'on enfonce, marais. Nous disons une « aibime » et même une « ambîme. » - (08) |
| aibîmer : abîmer - (48) |
| aibîmer : abîmer - (39) |
| aibinmé, vt. abîmer, pp. aibinmé, aibinmie. - (17) |
| aiblaige : n. f. Pagaille. - (53) |
| aiblaiger : inonder, mouiller, éclabousser - (48) |
| aiblâmi, part. pass. d'un v. aiblâmir, inusité. Rendu blême, défait, abattu, souffreteux : « l' ptiô ô aiblâmi por lai mailaidie. » - (08) |
| aiblége, s. f. une quantité de, un amas de… - (08) |
| aiblégée (n.f.) : surcharge, quantité - (50) |
| aibléger, v. a. accabler, surcharger, écraser. On est « aiblége » de grêle, de coups, d'injures. - (08) |
| aiblioti - blotti, accroupi derrière quelque chose pour se cacher, être protégé. – A s'é aiblioti darer lai meurée por n'éte pas vu. I l'ons trouvai aiblioti sô l'escalier : â plieuro. - (18) |
| aibloti(r) (v.) : accabler, écraser, surcharger - (50) |
| aiblôti, v. a. accabler, écraser. La pluie, le vent, dans un orage, «aiblôlit» le voyageur. - (08) |
| aibonder : abonder, avoir un bon « rendement », en récolte - (37) |
| aiborjaule (adj.) : abordable - (50) |
| aiborni, aibornir. v. a. Eborgner. Dans beaucoup de localités, l'r des verbes termines en ir ne se prononce pas. - (10) |
| aibossumer : agonir - (48) |
| aibôssumer, v. a. apostropher avec violence, accabler d'injures, d'insultes. - (08) |
| aibotenai - boutonner, mettre les boutons dans la boutonnière. - Aibotenne don ton p'tiot frère. - In boton de mes guètes s'â desaibotenai. - (18) |
| aibouaichai : casser la coquille au moment de l'éclosion. Les pitots sont en train d'aibouaichai sous la couotte : les poussin sont en train de casser la coquille sous la poule couveuse. - (33) |
| aibouaicher, et aibouaicho, c'est-à-dire mettre à Bouricho (V. ce mot). - (18) |
| aibouècher : casser la coquille, fêler - (48) |
| aibouéquer, v. a. écraser, aplatir contre un mur ou contre un corps dur. On dit cependant des œufs, brisés à la sortie des petits poussins, qu'ils sont « aibouéqués. » - (08) |
| aibouére (n.m.) : boisson mélangée de farine que l'on donnait aux porcs - (50) |
| aibouére, s. m. boisson mélangée de farine qu'on donne aux petits porcelets ; pâtée très liquide - (08) |
| aiboulai - aboutir, arriver, réussir. - A n'aiboulerant pas, quoi ! çà fini. - Le pôre homme, à ne pourrai jaimâ aiboulai. - (18) |
| aibouli, v. a. abolir, effacer, abattre. - (08) |
| aiboulition, s. f. désordre, désastre, ruine - (08) |
| aiboussumer : assommer de paroles - (39) |
| aibout'ner : boutonner - (48) |
| aibout'ner, v. a. boutonner, attacher quelque chose avec des boutons : « aibout'né vô », boutonnez-vous. - (08) |
| aîbre (n) : arbre - (57) |
| aibreuvau, s. m. partie sensible qui correspond à une blessure, à une meurtrissure, à une plaie. - (08) |
| aibreuvé, abreuver une personne ou une chose ; aibreuvé une cuve, un fût, se dit pour : verser et laisser un temps de l'eau dans ces objets pour en gonfler les douves desséchées. - (16) |
| aibreuver, v. a. abreuver, donner à boire : « aibreuver l'neurin », faire boire le bétail. - (08) |
| aibreuvou, s. m. abreuvoir, lieu où les animaux s'abreuvent. - (08) |
| aibrevou (nom masculin) : abreuvoir. - (47) |
| aibri : abri - (48) |
| aibri : abri - (39) |
| aibri. Abri. Ai l’aibri, à l'abri. - (01) |
| aibriter : abriter - (48) |
| aibriter : abriter - (39) |
| aibruti : adj. et n. Abruti. - (53) |
| aibtiéger, v. ; saccager ; ces drôles-là ont aibliégé note âbre, ai caps de pierre. Ces mauvais sujets ont aibliégé ai caps de pierre note poiré, por aivoi les poires. - (07) |
| aibu, s. m. amusement; abus ou perte de temps. Il y a beaucoup « d'aibu » dans un ouvrage minutieux, c'est-à-dire beaucoup de perte de temps. - (08) |
| aibûer (s’) (v.pr.) : s'amuser (aussi aibeûyer, de Chambure écrit aibuïer) - (50) |
| aîbugeai, aîmugeai : amuser. On s'o ben aîbuger : on s'est bien amusé. - (33) |
| aibuger. v. a. Amuser. - (10) |
| aibuïeman, s. m. amusement, flânerie, dissipation, abus ou mauvais emploi du temps. - (08) |
| aibûi'ement : n. m. Amusement. - (53) |
| aibuïer, v. a. amuser, dissiper, détourner de l'ouvrage, faire perdre le temps à quelqu'un. - (08) |
| aibû-illé, aibûïé : v. t. Amuser. - (53) |
| aibuillement : distraction, amusement. - (32) |
| aibuïot. s. m. jouet d'enfant, hochet, tout objet avec lequel on s'amuse. - (08) |
| aibuyé : amusé,(C. T IV) - A - (25) |
| aibûyeman (n.m.) amusement ; aussi mauvais emploi du temps - (50) |
| aibuyer (S'). S'amuser. Cors don t'aibuyer d'aivou les autes petiots. Le patois dijonnais écrit et prononce s’aubuzer. - (13) |
| aibuyer (s’) : s'amuser. (RDC. T III) - A - (25) |
| aibûyer : amuser - (48) |
| aibûyer : amuser - (39) |
| aibuyer, aibuyon - amuser, s'amuser, perdre son temps. - C't enfant qui n'aipran ran ; â ne fait que s'aibuyer dans l'Ecole. - I nô sons ben aibuyé ai lai fête. - Ces mairchans lai vouraint nos aibuyer, en le voit ben ; mâ... - (18) |
| aibûyot : petit jouet - (39) |
| aibûyotte (n.f.) : jouet ; objet avec lequel on s'amuse - (50) |
| aibûyotte : jouet - (48) |
| aibûyotte : petit jouet, amusette - (39) |
| aibûyotterie : petit amusement - (39) |
| aibuyottes – amusements, bagatelles. - Tein, mon enfant voiqui des aibuyottes. - A vos raiconte des aibuyottes de p'tiots. - (18) |
| aic’ni, aichnolé, aif’nî : épuisé - (37) |
| aic’reûssé : accroché - (37) |
| aicaboicher, aicabouécher (v.) : écraser sous un poids - (50) |
| aicaboicher, v. a. charger la tête, écraser, fouler sous un poids. - (08) |
| aicâgement. s. m. Ecarquillement. - (10) |
| aicâger. v. a. Ecarquiller. Aicâger les œils. - (10) |
| aicâgnai, et s'aicâgner – s'acagnarder, devenir paresseux comme un chien ; négligent. - Le cabarat ne sart qu'ai aicagnai les gens. - Ne t'aicagne pas, remue tai don. - (18) |
| aicâgnardi, v. a. acoquiner, amollir, énerver. - (08) |
| aicaiciâ, aigaicia : n. m. Acacia. - (53) |
| aicailoffer : enlever l’enveloppe des noisettes, des noix, des marrons, des châtaignes, de « l’oeuillette », etc… - (37) |
| aicailoufiâs : écorce, enlevée, des châtaignes, des noix, etc… - (37) |
| aicaïouner, v. a. poursuivre quelqu'un à coups de pierres, lapider. - (08) |
| aicaper (s') : s'affaisser, se recroqueviller - (39) |
| aicasse, aigasse, écasse. s. f. Casse, sorte de casserole en cuivre jaune, avec queue de même métal, qui est d'un usage général dans les villes et les campagnes, et qui sert à puiser l'eau dans le seau. - (10) |
| aicaûnie : très fatigué, « à plat » - (37) |
| aiccagnard, écaniâts : courbatures - (37) |
| aiccense, s. f. accense. Loyer d'une maison, d'un terrain ; usité dans quelques parties des cantons de Château-Chinon, de fours, etc. - (08) |
| aiccenser, v. a. louer, amodier, donner ou prendre en location ; s'emploie usuellement aux environs de Château-Chinon, mais seulement lors-qu'il est question des biens-fonds, des immeubles : aiccenser un champ, un pré, une ferme, une maison. - (08) |
| aiccident : n. m. Accident. - (53) |
| aiccolè : v. t. Accoler. - (53) |
| aiccouaire (s’) : se mettre à l’abri - (37) |
| aiccouotter (s') : s'accroupir - (39) |
| aiccouter (s') : s'appuyer - (39) |
| aiccroc : 1 n. m. Accroc, déchirure ou incident malheureux. - 2 n. m. Crochet. - (53) |
| aiccrochot (n.m.) : crochet - (50) |
| aïce, à droite, en parlant aux bœufs. - (05) |
| aice, s. f. petite hache, cognée à manche très court et dont le taillant ressemble à celui d'une pioche. - (08) |
| aiceter (v.t.) : acheter - (50) |
| aiceter. v. a. Acheter. - (10) |
| aiceurjou, esceurjou et escarjou, de chétive apparence. Dans l'idiome breton, kesk signifie maigre, et karguz, poids, d'un maigre poids. (Le Gon.) - (02) |
| aich’t’hûre : à cette heure, maintenant - (37) |
| aichailandè : achalandé - (48) |
| aichaiti, v. a. attirer, allécher par l'appât d'une friandise, d'une récompense. Être « aichaiti » à quelque chose exprime l'idée d'un désir stimulé par une jouissance antérieure. - (08) |
| aichaiti, vt. amadouer, attirer à l'aide de friandises. - (17) |
| aichale : Aisselle. « Sa reube est suée seu (sous) les aichales ». - (19) |
| aichan-né : très fatigué, rompu à la suite de coups reçus. (LF. T IV) - A - (25) |
| aichan-nè : 1 v. t. Achever, terminer. - 2 v. t. Très fatigué. - (53) |
| aicharné : adj. et n. Acharné. - (53) |
| aichauffouâjon. s. f. Echauffaison. - (10) |
| aichaule, sf. clochette de tôle pour le bétail. - (17) |
| aichaumi, v. a. engazonner. - (08) |
| aiche : Petite planchette dont on se sert pour prolonger les douves du cuvier dont on augmente ainsi la capacité. « Des aiches de boiri (cuvier pour la lessive) ». - (19) |
| aichenillé : v. pr. S'acharner. - (53) |
| aichetè : v. t. Acheter. - (53) |
| aichetou, aichtou (-ouse) (n.m. ou f.) : acheteur (-euse) - (50) |
| aicheureté : assis (se mettre sur une « chaire »). - (32) |
| aicheurtè (s') : v. pr. S'asseoir. - (53) |
| aicheurtè : adj. Assis. - (53) |
| aichi - essieu de voiture. – D'où vint don que vos gairdez in aichi de bô ? Ceux'qui de far son pu cher, ma â son bein moillou. - Mettez des aichi de fer moinme dans les charrues. - (18) |
| aichi (n.m.) : essieu - (50) |
| aichi : essieu d'une voiture ou char à bœuf - (39) |
| aichi, s. m. essieu - (08) |
| aichistance, s. f. assistance, aide, secours. Prêter « aichistance », donner du secours. - (08) |
| aichiter (s'), v. pronom. S'asseoir. - (10) |
| aichiter (v.t. et pr.) : asseoir, s'asseoir - (50) |
| aichiter. v. a. asseoir. - (08) |
| aichiton (nom masculin) : petit siège rustique à trois pieds. - (47) |
| aichiton, s. m. escabeau à trois pieds, petit siège bas sans dossier. - (08) |
| aichitot : siège - (39) |
| aichitou, sm. séant, derrière. - (17) |
| aichitte (s’) : s'asseoir - (39) |
| aichitu (-e) (p.p.) : assis (-e) - (50) |
| aichnée – échine dorsale, plus spécialement dans le cochon quand il est tué. - I vâ fàre cueûre in bou d'aichenée pou note soupaï (On écrirait mieux Echenée, à cause de la prononciation). - (18) |
| aichônai - finir, terminer avec difficulté. - I seû si lassai qui ne peut pas aichônai mai jornée. - C'te pôre béte souffre trop… aichônez lai don ben vite. - (18) |
| aichoner. Achever. Devant que de parti , au fau aichôner tai vigne. Au Moyen Age on disait eschener ; « Pour eschener les tumultes, débats et estende qui se pouiroient ensuivre ». Citation de M. Rossignol â propos de l'élection du maire de Beaune, en 1407. - (13) |
| aich'ta : acheter. (S. T IV) - B - (25) |
| aichté (s'), vr. s'asseoir. - (17) |
| aich'té, acheter. - (16) |
| aichté, vt. acheter. - (17) |
| aich'ter : acheter - (48) |
| aiciau (nom masculin) : hachette. - (47) |
| aiciter, v. a. citer, appeler à comparaître devant le juge de paix. - (08) |
| aic'ler, aiqueler. v. a. Acculer, éculer. - S'aic'ler. v. pronom. S'accroupir, se mettre sur son derrière, s'acculer. - (10) |
| aicoinçons : sillons de plus en plus courts dans un champ, de forme irrégulière. - (33) |
| aiçoller. s. m. Echalier, haie, clôture de branchages. – Echelle basse appuyée sur le côté d'une haie pour aider à la franchir - (10) |
| aicompaingner, v. a. accompagner, aller de compagnie avec quelqu’un : « i va l’aicompaingner cheu lu. » - (08) |
| aiconai – baissé jusque sur les talons ; accroupi. – Al étein tot aiconai devant le feu. - Aicone tai pou mieux ramassai cequi. - (18) |
| aicor. Accord, accords. D’aicor, d'accord. - (01) |
| aicorci, v. a. accourcir, rendre plus court, abréger. - (08) |
| aicôté : avoère des aicôtés : avoir des économies - (39) |
| aicoter (s') (v.t. et pr.) placer contre une chose, s'appuyer - (50) |
| aicoter, v. ; appuyer pour empêcher de tomber. Tai meuraille n'est pas solide ; aicote-la. - (07) |
| aicoter. v. a. Accoter, appuyer. - (10) |
| aicoter. v. a. appuyer, soutenir, mettre d'a-plomb, — barrer, fermer au moyen d'un obstacle, — accouder. - (08) |
| aicôteumer, v. a. acoutumer. - (08) |
| aicou (Ai l’) : à l'abri du vent. (RDM. T II) - B - (25) |
| aicouau (ai l') (loc.) ; à l'abri, à couvert - (50) |
| aicouau (ai l'), loc. a l'abri, à couvert. - (08) |
| aicouchie, s. f. accouchée, une femme qui vient d'accoucher. - (08) |
| aicouée : qui glousse, demande à couver (adjectif). - (33) |
| aicouillou, aicouillot : écureuil. - (33) |
| aicouiou. s. m. Ecureuil. - (10) |
| aicouo - abri contre la pluie. - Voiqui la plieue ; ailons vite no mette ai l'aicouo. - Sarre ces arnoua qui, en vai pliore. - (18) |
| aicouô : abri - (48) |
| aicouo : abri. Quand o pieu, faut se mettre ai l'aicouo : quand il pleut il faut se mettre à l'abri. - (33) |
| aicouoder. v. a. Ecouer, couper la queue. Du latin cauda et de a privât. - (10) |
| aicoure, vt. battre au fléau. - (17) |
| aicouria : écureuil - (48) |
| aicouter : accoter, soutenir, appuyer - (48) |
| aicouteumance, s. f. coutume, habitude. - (08) |
| aicrapaudi (s'), v. réfl. s'affaisser, se mettre à plat à la manière des crapauds. - (08) |
| aicrapodir : se baisser vivement. Une herbe aicrapodie : une herbe versée. - (33) |
| aicre botai : couché en chien de fusil. (C. T IV) - A - (25) |
| aicréché, vt. accrocher. - (17) |
| aicrecher, aicresser. v. a. Accrocher. - (10) |
| aicrechot. s. m. Crochet. - (10) |
| aicrepi (s'). v. pronom. S'accroupir, se blottir. Voir aiborni - (10) |
| aicrepoter (s') : accroupir (s') - (48) |
| aicresser : accrocher - (39) |
| aicressot : crochet - (39) |
| aicreupi, vt. accroupir. Voir eliatré. - (17) |
| aicro : accroc, crochet - (48) |
| aicro : crochet pour tirer l'eau du puits - (48) |
| aicrô, s. m. croc, crochet, agraffe, tout instrument avec lequel on peut accrocher quelque chose et notamment celui dont on se sert pour le flottage des bois de moule sur les ruisseaux ou rivières du pays. - (08) |
| aicroicher, v. a. accrocher. - (08) |
| aicroincher (v.t. et pr.) : accrocher ; s'accrocher - (50) |
| aicrouècher : accrocher - (48) |
| aicru : rejet sur racine - (48) |
| aictionnè : v. t. Actionner. - (53) |
| aictiouner, v. a. appeler devant le juge de paix, citer en justice. Le mot et le fait sont très usités. « s'a contùne, i m'en va l'aictiouner », s'il continue, je vais lui faire un procès. - (08) |
| aictiouneu, adj. actif, énergique, ardent. - (08) |
| aictive : n. f. Active. - (53) |
| aicuerjou. : Esceurjou, escarjou. - De chétive apparence. Le patois a emprunté cette expression au mot du dialecte escars, qui signifie mesquin. - (06) |
| aicû-illé : v. t. Aiguillonner, stimuler, inciter. - (53) |
| aicuyer, aicueillai - faire avancer, faire marcher les bêtes. - En faut que te venne ai lai charrue d'aivou mouai pour aicueillai les chevaux. - Meune tes bêtes es champs, et prends le fouai pour les écueillai. - (18) |
| aider, alider. v. a. Aider. - (10) |
| aideux, aidieux, aindeux. s. m. Un bel aïdeux qu'toi. - (10) |
| aidhors : dehors - (39) |
| aidi ou aidyi : Aider. « Vins dan m'aidyi » : viens donc m'aider. - (19) |
| aidie, aidio, aidiro, aidieussaint - différents temps du verbe Aider. - Ailons aidie les enfants. - Le Ravaud aidio son ginre ai fouâcher. - I vourra ben que vo m'aidieussaint ai fini. - (18) |
| aidiement : aide. - (32) |
| aidier, v. a. aider, donner du secours. - (08) |
| aidieu vo queman. A Dieu vous command, feçon de parler ancienne et familière pour dire : Je vous recommande à Dieu… - (01) |
| aidieu, s. m. adieu. Prenant congé de ses lecteurs. - (08) |
| aidieu. Adieu. Aidieu bon tam, adieu bon temps. Quand on sépare à de Dieu, cela fait un autre sens. Par exemple : A Dieu honneur, Deo honor ; c'est une devise que certaine femme de vertu problématique avait prise, ce qui donna lieu aux railleurs, dit Tabourot, de lire comme s'il y avait eu : Adieu honneur, vale honor. - (01) |
| aidiôle : averse. (RDF. T III) - A - (25) |
| aidiöle, smf. idiot, affolé. - (17) |
| aidire - aidji : aider - (57) |
| aid'ja : à dia, cri destiné à faire tourner un cheval à gauche - (46) |
| aidje (n') : aide - (57) |
| aidju : aigu - (57) |
| aidjusi - ramouler : aiguiser - (57) |
| aidjusi - tailli : appointer - (57) |
| aidon. Alors, du vieux mot adonc. Aidon que, alors que, ou pour mieux parler, lorsque… - (01) |
| aidor : dehors - (48) |
| aidouci, vt. adoucir. - (17) |
| aidresser (v.t.) : adresser - (50) |
| aidret : adroit (adjectif) ou endroit. Ç'o pas tout le monde qu'o aidret : ce n'est pas tout le monde qui soit adroit. Contraire d'envers : Mets ta ch'mise ai l'aidrai : mets ta chemise à l'endroit. - (33) |
| aidret : adroit - (39) |
| aidroce, s. f. adresse. - (08) |
| aidroci, v. a. rendre droit, redresser. - (08) |
| aidroit (L et d) - le côté d'une chose opposé à l'envers, avec adresse, ordre, fait comme il faut. - Ma bein tai bliaude ronde ai l'aidroit. - A n'é pas trouvai l'aidroit de fàre son ôvraige. - T'é bein fa cequi d'aidroit. - (18) |
| aidrouè : 1 adj. Adroit. - 2 n. m. Endroit (à l'). - (53) |
| aidrouet : adroit - (48) |
| aidye, s. f. eau. - (24) |
| aidyéu ! adieu ! - (16) |
| aidzu (adzu, adzuer) : aider - (51) |
| aïe : Exclamation dont font usage les bouviers pour accélérer la marche de leurs bêtes. « Aïe Bliandin ! Aïe Fremoitin ». Vieux français. - (19) |
| aie :eau - (48) |
| aie, ais (pour aise). adj. Content, satisfait. J' seus ben ais. - (10) |
| aie. s. f. Eau. Contraction pour aige. - (10) |
| aïements, s. m. qui s'emploie surtout au pluriel, ustensiles de ménage, vaisselle. - (11) |
| aifaibji, vt. affaiblir. - (17) |
| aifaire. Affaire, affaires. - (01) |
| aifaité (-e) (adj.m; ou f.) : se dit d'un récipient rempli jusqu'au bord (au faîte) - (50) |
| aifaîter (v.) : élever jusqu'au faite en tassant ou en débordant - (50) |
| aifaîter, v. a. élever jusqu'au faite en amoncelant. On « aifaîte » un charriot de foin, un tas de paille. S’emploie encore dans le sens de combler, remplir en entassant jusqu'à la dernière limite. - (08) |
| aifare, sf. affaire. Ène petitje aifare, un peu : j' vais prenre enco ène petitje aifare de ce piait-lai. El a ène petitje aifare bête (il est un peu bête). - (17) |
| aifârmi, v. a. affermir, rendre ferme, consolider : « lai tarre s'ô aifàrmie. » - (08) |
| aifaudi (-e) (adj.m. ou f.) : affamé (-e) ; éte aifaudi = être dans le besoin - (50) |
| aifaudi, adj. affamé. - (08) |
| aifauti, vt. priver de sa subsistance, faire maigrir ; pp. aifauti, souffreteux, qui n'a pas sa subsistance. Voir Dioire. - (17) |
| aifétè : affêté - (48) |
| aifété : se dit de quelque chose qui est rempli jusqu'au bord - (39) |
| aifét'lai : plein jusqu'au faite. (Voir aussi rai'aifait'lai) Un panier de treuffes aifét'lai : un panier de pommes de terre plein à ras bord. - (33) |
| aifét'lè : affêté - (48) |
| aifeuriander, v. a. affriander, attirer quelqu’un par l'appât de la gourmandise. - (08) |
| aifeurner : arrêter, rester tranquille - (48) |
| aifeurner, v. n. demeurer en repos, rester coi, ne pas bouger : « a n'veu pâ aifeurner c'gà lai, a fau qu'a r'mue. » - (08) |
| aiffaimé, part, passé. Affamé, qui a une grande faim. - (08) |
| aiffaire (n.f.) : affaire - (50) |
| aiffaire : affaire - (48) |
| aiffalè : 1 v. t. Affaler. - 2 v. i. Tomber. - (53) |
| aiffére : affaire - (39) |
| aiffére : n. f. Affaire. - (53) |
| aiffét'lée : exp. Charge au-dessus du faîte. - (53) |
| aiffeuriander : affriander - (39) |
| aiffeurner (v.) : demeurer en repos, ne pas bouger - (50) |
| aiffeûtiaux : vêtements et sous-vêtements, féminins, d’apparat - (37) |
| aiffilée (d') loc. adv. avec continuité, sans interruption et comme à la file : il a fait son ouvrage « d'aiffilée » ; nous avons fait dix lieues « d'aiffilée. » - (08) |
| aiffoinces : morceaux de bois situés sur les côtés du chariot - (39) |
| aiffoti : privé de forces, épuisé. (E. T III) - VdS - (25) |
| aiffouaudit : anéanti, sans forces, sans volonté. - (33) |
| aiffoulée : avortée, (se dit d'une vache) voir aussi aivortée. - (33) |
| aiffreuter (v.t.) : mûrir (fruits) - (50) |
| aiffrites : mûres - (37) |
| aiffront (n.m.) : affront, offense - (50) |
| aiffrouinches: ridelles de chariot, ranches. - (33) |
| aiffûtiau : objet inutile - (39) |
| aiffutiaux (n.m.pl.) : objets sans valeur, de peu d'utilité et démodés - (50) |
| aifin. Afin. - (01) |
| aifiquet, s. m. affiquet, petit bijou, objet de toilette en général. - (08) |
| aiflonger, v. n. être comblé, gorgé, pourvu avec affluence, avec surabondance. - (08) |
| aifni (y seu), je suis mort de faim - (36) |
| aifoinge : rancher - (48) |
| aifölé, vt. affoler. - (17) |
| aifonger (v.t.) : écraser sous un-poids - (50) |
| aifougelé, vt. écraser, trépigner sur ; pp. aifougelé : se dit de quelqu'un, de quelque chose écrasé de pluie ou de neige. - (17) |
| aifougelée, sf. masse, grosse quantité. - (17) |
| aifouger, v. a. écraser sous un poids. Le bois mort « aifouge » une haie vive sur laquelle on le jette en masse. - (08) |
| aifouler, v. a. meurtrir, blesser par contusion. - (08) |
| aifranchi, v. a. franchir, traverser en sautant : « aifranchir » un fossé, un mur. - (08) |
| aifreumer, v. a. affermer, donner ou prendre à louage. Se dit des personnes et des choses. - (08) |
| aifreuter : mûrir - (48) |
| aifreuter, v. n. affruiter, devenir mûr. Le mot s'emploie en parlant de tous les fruits de la terre quels qu'ils soient. - (08) |
| aifrinche : n. f. Affranche. Pièce de bois retenant les ridelles aux quatre coins d'une voiture. - (53) |
| aifroinche, s. f. effranche, traverse de bois mobile qui soutient les ridelles ou les planches d'un charriot. Quelques localités du Morvan prononcent « enfronche. » - (08) |
| aifroinches (n.f.pl.) : montants de ridelles traverses de bois mobiles qui soutiennent les planches d'un chariot - Les aifroinches soutenaient les ridelles (de l'a.fr. effranche) - (50) |
| aifroinge : rancher - (48) |
| aifrou, ouse, adj. gourmand, avide. - (08) |
| aifuter, v. a. affûter, aiguiser, rendre pointu au propre et au figuré. - (08) |
| aifûtiau : n. m. Colifichet, drôle d'outil. - (53) |
| aifutiau, s. m. engin de chasse ou de pêche, en général tous les menus objets qui servent à divers usages - (08) |
| aifutiau, sm. maladroit, empaillé. - (17) |
| aifutiaux : colifichets, petits objets ou vêtements. - (33) |
| aifûtiô : petit objet sans valeur - (48) |
| aiga ! : regarde ! - (39) |
| aiga : regarde - (48) |
| aigà yer, v. a. assouplir les membres, les rendre gais sous l'effet des premiers mouvements. - (24) |
| aigaice : pie - (48) |
| aigaice : pie. (E. T IV) - S&L - (25) |
| aigaice, pie. - (27) |
| aigaice-gruinche, pie grièche. - (27) |
| aigaicer : agacer - (48) |
| aigaidon ! : regarde-donc ! - (37) |
| aigailu ! : le voilà qui arrive ! - (37) |
| aigairoûyau (n.m.) : épouvantail (cf. lai. Pouélée) - étym. : (qui égare les oiseaux) - (50) |
| aigaissai - outre le sens français égaré, irrité, ce mot veut dire mouillé, trempé d'eau. - I seu revenu tot aigaissai. - Lai rosée m'ai aigaissai, trempai. - (18) |
| aigaisse - nom populaire de la pie. - I â bein embêtant, i a entendu des aigaisse. - (18) |
| aigaisse (n.f.) : pie - (50) |
| aigaisse : n. f. Pie. - (53) |
| aigaissé : v. t. Agacer, énerver, taquiner. - (53) |
| aigaisse. : Pie. - (06) |
| aigaisse-bâtarde, pie grièche. - (28) |
| aigaisser, aiguesser : énerver. - (66) |
| aigasse : casserole pour prendre de l'eau,(en Côte-d’Or, c'est le baissin). (F. T IV) - Y - (25) |
| aigasse : pie, synonyme de « Ouasse ». O cause coume une aigasse : il parle comme une pie. - (33) |
| aigasse : pie - (39) |
| aigasse, n. fém. ; pie. - (07) |
| aigasser : secouer, avant de le laver, le linge très sale, dans l'eau. (M. T IV) - Y - (25) |
| aige (en). loc. adv. - Être en nage, en sueur. Au Moyen Âge, être en ai gue signifie être trempé, mouillé jusqu'aux os ; aigue est dérivé du latin aqua, agua : eau. - (42) |
| aîgé : âgé - (37) |
| aigé : se dit des mains d'une laveuse après son travail ou d'une personne ayant un pansement humide. (M. T IV) - Y - (25) |
| aigé : mouillé. I seus aigé par la giboulée : je suis mouillé par la giboulée. - (33) |
| aige. (Être tout en). Transpirer par suite du travail ou de la marche. J'ai coru dêpeu Biâne, i sens teut en aige. On sait que le vieux mot aige ou aigue signifie Eau, C'est par suite d'une altération qu'on a dit et écrit : Je suis en nage. - (13) |
| aigé. v. adj. - Se dit du chanvre que l'on fait macérer dans l'eau (Mézilles, selon H. Chéry). Pour une personne : trempé, mouillé jusqu'aux os (Sougères-en-Puisaye). Voir l'expression « être en aige » ; en ancien français aiguer signifie arroser. - (42) |
| aigeai : rouir, mettre le chanvre aiger : mettre le chanvre dans un ruisseau pour le ramollir. Le cheinde éto aigé : le chanvre était roui. - (33) |
| aigelongné, vt. agenouiller. - (17) |
| aigelongnou, sm. agenouilloir. - (17) |
| aigement : récipient, seau, pot en terre cuite. A - B - (41) |
| aigenoillée, s. f. coussin de paille ou autre sur lequel on s'agenouille. - (08) |
| aigenoiller, v. a. agenouiller, mettre à genoux. — Morvan « azenoiller » - (08) |
| aigenoillons, loc. a genoux, sur ses genoux . - (08) |
| aigeoir. s. m. Endroit d'un ruisseau, d'une mare, etc., où l'on fait rouir le chanvre. - (10) |
| aiger : mouiller. - (09) |
| aiger, v. a. mettre dans l'eau, mouiller, rouir le chanvre. - (08) |
| aiger. v. a. Rouir. Se dit du chanvre qu'on fait macérer dans l'eau. Les blanchisseuses, les laveuses de lessive ont presque toutes la peau des mains aigée. De aqua, aigue, aige (eau). L'orthographe Eger, adoptée aujourd'hui, est certainement une altération de l'orthographe primitive. - (10) |
| aigiaude (nom féminin) : pluie subite et violente. - (47) |
| aigille, adj. agile. - (17) |
| aigllie, s. f. aiguillée : « aine aigllie d' filot », une aiguillée de fil - (08) |
| aignâ : n. m. Agneau. - (53) |
| aignaie : agneau - (48) |
| aignais, aignas. s. m. Agneau. Un aignais de berbis. - (10) |
| aignais, n. masc. ; agneau. - (07) |
| aignant (en) qui s'étiole. - (38) |
| aignea, s. m., agneau ; au figuré, personne douce. - (14) |
| aignea. Agneau, agneaux. - (01) |
| aigneai, s. m. agneau : « mé beurbis m'an beillé chis aigneais. » - (08) |
| aigneau : agneau - (39) |
| aigneau, agneau. - (05) |
| aigneau. Agneau. - (49) |
| aignelöt, sm. agneau. - (17) |
| aigner : se dit d'une volaille qui demande à couver - (39) |
| aignerie, s. f. toile d'araignée. - (08) |
| aigniaux, agneaux. - (04) |
| aignoutai : bricoler, ne pas agir efficacement. S'attacher à des détails futiles et inutiles. - (33) |
| aignoutai : espionner, quémander, épier. - (33) |
| aigolai : affamer. Aigolai d'souai : être très altéré. - (33) |
| aigolé, adj. gourmand, avide ; intéressé au figuré. - (08) |
| aigoni : couvrir d'insultes - (39) |
| aigonir : injurier - (48) |
| aigonir : v. i. Invectiver, v. t. injurier. - (53) |
| aigonisai: invectiver, injurier, agonir d'injures. On o des fois aigonisai : On est parfois injurié. - (33) |
| aigoniser : agoniser - (48) |
| aigoniser, v. a. injurier, assaillir de paroles outrageantes. Nous disons aussi « aigonir. » - (08) |
| aigorzer. v. a. Echancrer la gorge d'une robe, d'un corsage, d'un vêtement quelconque. - (10) |
| aigou, s. m. ecoulement de l'eau, égout, gouttière, rigole d'égouttement. Les « aigous » d'une cour, d'un chemin, d'un toit. - (08) |
| aigouares : après de grosses pluies, les ruisselets sur le sol. Après la pieu les aigouares coulont : après la pluie les ruisseaux coulent. - (33) |
| aigoucher (s') (v.pr.) : avaler de travers - (50) |
| aigoué (-e) (adj. m. .ou f.) : rassasié (-e) - (50) |
| aigouè : rassasié, repu, saturé - (48) |
| aigoué : rassasié, repus. Quel bon repas, j'en seus aigoué : quel bon repas, je suis rassasié. - (33) |
| aigoué, part. pass. d'un verbe « aigouer » inusité. Gorgé, rassasié jusqu'au dégoût. - (08) |
| aigoué, repus - (36) |
| aigouer (s') (v.pr.) : s'étouffer en avalant (aussi égouer) - (50) |
| aigouére, s. f. égout, écoulement d'eau. Les « aigouéres » d'un chemin, d'un toit. - (08) |
| aigouja (n.m.) : houx (haut-Morvan) - (50) |
| aigoujâ, s. m. houx. Environ de Château-Chinon. - (08) |
| aigouriau (n.m.) : houx - (50) |
| aigouriau, n. masc. ; houx. - (07) |
| aigouriou, aicoussa (n.m.} : houx (aussi aigru, Morvan-Nivenlais) - (50) |
| aigraichot, aicraichot : crochet. Tire la aiquant un aigraichot : tire la avec un crochet. - (33) |
| aigraiver, v. a. meurtrir, blesser au pied. Se dit surtout des boeufs fatigués par un long voyage ou par la marche sur des chemins rocailleux. - (08) |
| aigrappe (pour agrappe). s. f. Agrafe. Du verbe agrapper, agripper ; d'ou le mot français grappin. - (10) |
| aigre (faire). voir egre (faire). - (20) |
| aigreuillon. s. m. Houx. Ainsi appelé sans doute à cause des piquants de ses feuilles, qui ne sont pas doux. - (10) |
| aigreville, egreville. s. m. Espèce de pissenlit qui se mange en salade. - (10) |
| aigrin, héron, cigogne. - (05) |
| aigrô : crochet, naturel, en bois, pour agripper les branches de noisetiers, et les amener au ras de terre, afin de ramasser commodément les noisettes - (37) |
| aigrô, bénitier.- Ce mot semble avoir la même origine qu'aiguière, c.-à-d. celle du latin aquarium. - (02) |
| aigrô. : Bénitier (du lat. aquarium). - (06) |
| aigrôlon : gros taon. - (31) |
| aigron, s. m. héron, oiseau de l'ordre des échassiers. - (08) |
| aigron, s. m., héron. - (11) |
| aigrot : aigrelet - (37) |
| aigru, s. m. houx. - (08) |
| aigü’ye : aiguille. - (62) |
| aiguaisse, s. f. agasse ou agace, pie. - (08) |
| aiguanci. v. n. diminuer par l'effet de l'évaporation. Se dit d'un liquide qui baisse en bouillant trop longtemps sur le feu : retirez la chaudière, votre eau « s'aiguancit. » - (08) |
| aigucher, aiguger, aiguser, aigusser. v. a. Tailler en pointe, aiguiser. - (10) |
| aiguchon. s. m. Morceau de bois taillé en pointe, aiguillon. - (10) |
| aigué : évier. A la fois la «cuvette » et la pièce où elle se trouve ; Vient de « aygue », de « aiga » : l’eau en occitan. « Y’avo de vassalle à fare : la piarre d’aigué en playo » : il y avait tellement de vaisselle à faire que la pierre d’évier en pliait (Humour !). - (62) |
| aigue, aidje : s. f., eau. - (20) |
| aigue, aige (aqua), eau, aiger le chanvre. - (04) |
| aigue, s. f. eau. Le mot n'est plus usité ; il subsiste encore dans les noms de lieu et surtout dans la toponomastique rurale. - (08) |
| aigue. Eau, vieux mot français. - (03) |
| aiguée : Evier, lieu où l'on lave la vaisselle. « La saille est su la piarre d'aiguée » : le seau est sur la pierre de l'évier. La piarre d'aiguée est une dalle creusée pour recevoir l'eau de la vaisselle et pourvue d'une gouttière pour l'écoulement de cette eau. - (19) |
| aigueiller, aigueuiller (pour aiguiller). v. a. Taquiner, pointiller, asticoter. - (10) |
| aiguelle, aigueille, aigueuille. s. f. Aiguille. - (10) |
| aiguerguelle : voir aguergeote - (23) |
| aigueriot : houx - (48) |
| aigueriot : houx - (39) |
| aigueriot, s. m. entonnoir. De « aigue », eau. - (08) |
| aigueron. s. m. Héron. Du vieux mot aigue, eau, le héron étant un oiseau aquatique. - (10) |
| aiguerot (nom masculin) : entonnoir. - (47) |
| aigueruelle, s. f. animalcule qui abonde dans les eaux de source, dans les fontaines. - (08) |
| aiguesse : pie. - (66) |
| aiguesse : une pie, un bavard - (46) |
| aigueuille. Aiguille. - (49) |
| aigueuillotte, f. : mauvaise herbe. (M. T IV) - Y - (25) |
| aigueurdon, s. m., édredon, couvre-pied rempli d'un duvet très fin. Certains disent aigredon, aigledon. Dans nos campagnes on le garnit tout bonnement avec des plumes de volailles. - (14) |
| aigueûri : gâter (un enfant) - (48) |
| aigueuri : aguerrir - (39) |
| aigueuriaibe, adj. agréable, par métathèse. - (08) |
| aigueuriau, s. m. houx. Le houx est extrêmement commun dans le Morvan. - (08) |
| aigueurlot, adj., aigrelet. - (14) |
| aigueurner : agrainer - (48) |
| aigugeoure : aiguisage - (51) |
| aigugi : aiguiser - (51) |
| aigûgi : Aiguiser. « V'la in cutiau qu'a bien faute d'aigûgi » voilà un couteau qui a grand besoin d'être aiguisé. - (19) |
| aiguian (n.m.) : gland - (50) |
| aiguian, s. m. gland, fruit du chêne. « aillan », avec les ll mouillés. - (08) |
| aiguiand, guiand : gland. - (33) |
| aiguiaure (n.f.) : grosse averse (aussi aivolte). - (50) |
| aiguiaure, s. f. pluie subite et torrentielle, grosse averse. Quelques localités prononcent « aiguore, aiguiore », et même « aidiore. » - (08) |
| aiguiaurer, v. n. tomber avec violence. Se dit de la pluie lorsqu’elle tombe à verse. - (08) |
| aiguïer, v. a. aiguiser, rendre aigu, pointu. « aigujer. » - (08) |
| aiguieu (n.m.) : glu, matière visqueuse - (50) |
| aiguieu, s. m. glu, matière visqueuse qui sert à plusieurs usages. - (08) |
| aiguieucher. v. n. Envoyer de l'eau, la faire jaillir, éclabousser, au moyen d'une pierre ou d'un bâton. De aigue, eau, et heucher, élever, soulever. (Annay-sur-Serein). - (10) |
| aiguigne (V. Oguigne). - (18) |
| aigû-illaige : n. m. Aiguillage. - (53) |
| aigu'ille (n') : aiguille - (57) |
| aigu'ille : aiguille - (48) |
| aigûille : une aiguille - (46) |
| aigû-ille : n. f. Aiguille. - (53) |
| aigû-illé : v. t. Aiguiser. - (53) |
| aiguille : voir pressoir. - (20) |
| aiguille, aiguillette, s. f., plume d'oiseau en voie de développement soit après la naissance, soit après la mue. Les pennes qui forment. les ailes et la queue sont des aiguillettes de première (s.-ent. formation, ou poussée) ; les tectrices qui couvrent le reste du corps sont des aiguillettes de seconde (s.-ent. le même mot). - (20) |
| aiguille, s.f., partie médiane d'un bâtiment, d'une porte à chapiteau. - (38) |
| aigû'iller : aiguiser - (48) |
| aigû-illeur n. m. Aiguilleur. - (53) |
| aigû'illie : aiguillée - (48) |
| aigû'illon : aiguillon - (48) |
| aigu-illon : aiguillon. - (33) |
| aigû-illon : 1 n. m. Aiguillon. - 2 n. m. Dard des insectes. - 3 n. m. Piquant. - (53) |
| aigû-illou : n. m. Aiguiseur. - (53) |
| aigû-illouère : n. f. Pierre à aiguiser les outils. - (53) |
| aiguisou : aiguiseur - (44) |
| aigûjan : Eclat de bois produit quand on taille la pointe de piquets. - (19) |
| aigujoué, s. m. aiguisoir, pierre à aiguiser. - (08) |
| aigujouere : pierre à aiguiser les outils et principalement les faux. I passe l'aigujouere sur mon dard : je passe la pierre à aiguiser sur ma faux. - (33) |
| aigûjouse : Qui sert à aiguiser. « Eune piarre aigûjouse ». - (19) |
| aigulle (ŭye), sf. aiguille. - (17) |
| aigu'lle : Aiguille. « Alle s'est piqué le da (doigt) dav' (avec) san aigu'lle ». - (19) |
| aigullian, aigu-yan : Aiguillon, long et mince bâton terminé par une pointe de fer dont se servent les bouviers pour stimuler et guider leur attelage « L'aigullian est en agrela » l'aiguillon est en bois de houx. - (19) |
| aigûllon, ll mouillés, s. m. aiguillon, longue baguette au bout de laquelle se trouve une pointe de fer pour exciter les bœufs. - (08) |
| aigumelle. s. f. Lame de couteau. J'ai cassé l’aigumelle de mon couquiau. - (10) |
| aiguseutes, déchets des échalas qu'on aiguise. - (27) |
| aiguson, sm. pièce de terre en forme d'angle aigu. - (17) |
| aigûye - (39) |
| aigüye : aiguille - (51) |
| aigûye : aiguille, timon de voiture, ou de chariot - (37) |
| aigûyé ou aigûyai (V. Raiguyai). - (18) |
| aigûyer : aiguiser - (39) |
| aiguÿî : affuter, aiguiser. On peut même dire : raiguÿî. - (62) |
| aigûyon : aiguillon - (39) |
| aiguyotes. (Tirer les). La veille et le matin d'un mariage, les jeunes gens invités tirent des coups de fusil devant la maison et à la porte de l'église. L'explication de cet usage est curieuse : Au Moyen Age, certains sorciers, à la requête des femmes jalouses et des amantes délaissées, se chargeaient de « nouer les aiguillettes » du marié. Ils faisaient trois nœuds à une banderolle en prononçant des paroles cabalistiques, et empêchaient, au moyen de ce sortilège, la consommation du mariage. Pour comprendre le sens allégorique de cette expression, il faut se rappeler que les hauts-de-chausses ne se fermaient pas avec des boutons, mais avec des lacets ferrés ou des tresses de couleur appelés aiguillettes « Lâcher l'aiguillette » était synonyme de : satisfaire un besoin naturel. Les coups de fusil avaient pour but d'éloigner les mauvais esprits, de détruire le charme évoqué par les noueurs d'aiguillettes. La coutume de tirer les aiguyotes est pratiquée dans tous les villages des environs de Beaune. - (13) |
| aigyisser : éclabousser. (M. T IV) - Y - (25) |
| aihâble, s. m. érable. - (08) |
| aihâbye (n.m.) : érable (de Chambure écrit : aihâbe) - (50) |
| aihè, aihié, aisié. adj. Facile. Si vou' êtes pas content, c'est ben aihè ! –Veut dire aussi, qui a de l'aisance, une certaine fortune. « Ç'ot des gensses qu'ont ben de quoi ; i sont ben aihiés, ben aisiés. » - (10) |
| aihiance, aisance, s. f. Petit sentier, petit chemin pour faciliter l'exploration d'une propriété, pour la desserte d'une habitation rurale. - Se dit aussi des personnes qui sont dans une situation de fortune aisée. C'est des gensses qu'ont ben de l’aihiance, ben de l'aihance. Partout. - (10) |
| aijance, agacement. - Lé fru var baille l'aijance, c.-à-d. les fruits verts agacent les dents. - (02) |
| aijance. : Agacement. - (06) |
| aijautei (v.t.) : ajouter - (50) |
| aijement n.m. (v. fr. aisement) Récipient. - (63) |
| aiji adj. Facile, aisé. - (63) |
| aiju p.p. Eu, participe passé du verbe avoir. - (63) |
| aik'môder : accommoder - (48) |
| ail (ai) - (39) |
| ail (planter un) : loc. Se dit lorsqu'un animal enfonce ses crocs dans une masse charnue. « Donnez-vous d’ garde du chien; il vous planterait un ail dans le c...! » - (20) |
| ail ! - exclamation de surprise, d'impatience, de contrariété ! C'est le contraire de âille (content). - Ail, en ne faillo pu que ce qui ! – Voiqui qu'âl ailant veni, ail ! - (18) |
| ail, est employé, au féminin dans toute la région du Creusot. - (54) |
| ail’maice : limace - (37) |
| ail’mmer : allumer (le feu), avoir la trogne rubiconde - (37) |
| ail’motte. s. f. Allumette. - (10) |
| ailai : aller. - (33) |
| ailambic : n. m. Alambic. - (53) |
| ailan, ante, part. prés. du verbe aller. Actif, bien portant, vigoureux. - (08) |
| ailangouéré, part, passé d'un verbe inusité à l'infinitif. Languissant, maigre, efflanqué. - (08) |
| ailant - qui se porte bien, qui est fort vu sa position. - Al â ben ailant por son âge. - Al â étai mailaide, ma al â ben ailant métenant. - (18) |
| ailant, ailo, aileussain - divers temps du verbe aller. - En sero bon que vos aileussain ai Airnay demain. - I l'ons rencontrai hier qui ailain ai Crugey. - (18) |
| ailantor. Alentour. - (01) |
| ailè : v. i. Aller. - (53) |
| ailé, aller ; ailè ai mâtre, aller à maître. - (16) |
| ailecie (n.f.) : grenier à foin au-dessus des étables, des écuries. Le grenier aux-dessus de la grange est appelé : chafaud - (50) |
| ailecie (nom féminin) : grenier à foin au-dessus des écuries. - (47) |
| ailecie, s. f. grenier à foin au-dessus des écuries, des étables. Le grenier au-dessus de la grange est appelé chafaud. - (08) |
| ailemer, v. a. allumer. « ail'mer lai chandeille. » - (08) |
| ailemette, s. f. allumette, tout ce qui sert à allumer le feu. - (08) |
| ailentaurs (n.m.pl.) : alentours - (50) |
| ailentor, adv. alentour. - (17) |
| ailer (v.t.) : aller - (50) |
| ailer : aller - (48) |
| ailer : aller - (39) |
| ailer, v. a. aller. (Voir ailan.) - (08) |
| ailer, vn. aller. - (17) |
| Ailfred (l’) : (l’) Alfred - (37) |
| ailiger, v. a. alléger, soulager, donner de l'aide, du secours. - (08) |
| ailigö, sm. élagage. - (17) |
| ailigre, adj. allègre, content, joyeux. - (08) |
| ailingé, vt. aléser, rendre glissant. - (17) |
| ailiré, part, passé d'un verbe alirer inusité. Uni, poli, glissant, se dit des chemins lorsqu'ils sont verglacés et de toutes les surfaces unies et polies. - (08) |
| aillançon : s. m., mauvaise herbe des prés, spécialement l'ail et l'euphorbe. - (20) |
| aille - aise, content, bonne position. - Vos é gagnai vot' procès, i en seus ben âille. - Al an aivu ben de lai pogne tote lio vie : métenant â sont ai los âilles. - (18) |
| â'ille : aise - (48) |
| aille : (â:y’ - adj. inv.) 1 - heureux, satisfait. 2 - l'â:y' (subst. f.) : contentement, aise. - (45) |
| âille : adj. fam. À l'aise. - (53) |
| aillemen : (â:ymen - subj. m. pl.) ustensiles de cuisine, surtout récipients. - (45) |
| aillemenas (âyement) - vases, vaisselle en général. - Voiqui in âillement gros utile. – Dans le pu petiot mannège an faut encor ben des âillements. - (18) |
| aîllements : ustensiles de cuisine - (48) |
| aillements ; cf. â-yements. - (40) |
| âillements, s.m. pl. aisances. - (38) |
| aillemer. Allumer : « le fû vout pas aillemer ». - (49) |
| aillemette, eillemette. Allumette. - (49) |
| ailler, v. ; aller. - (07) |
| âilles, aises : ol s'ôt mis à soun âille : il s'est mis à son aise les "ailles" d'une "maison, les aises d'une maison. - (38) |
| aillet. Petit enfant criard, encore à la mamelle. Etym. peut-être brailler condensé par corruption. - (12) |
| ailli, hangar. - (28) |
| aillié, ai-yer : Même sens que aigullian. - (19) |
| aillïer, v. a. délayer, détremper avec de l'eau, avec un liquide quelconque. Il faut « aillier » la terre argileuse pour faire une chaussée d'étang, une aire de grange, etc. - (08) |
| aillieure, s. f. liaison, terme de cuisine désignant la matière, farine, œufs, etc., qui sert à lier ou épaissir les sauces. - (08) |
| âillil : adj. Facile. - (53) |
| âill'ment : 1 n. m. Attirail. - 2 n. m. Ustensile. - (53) |
| aillons, sm. haillons. - (17) |
| aillot, s.m. sorte d'alisier à baies rouges. - (38) |
| aillotée, s.f. lieu planté d'alisiers. - (38) |
| äillti n.m. Alisier. - (63) |
| ailly : Alisier, crataegus aria. « Eune varge d'écousson en ailly » : une verge de fléau en alisier. Vieux français, alier. - (19) |
| ailmace : limace. Quand o pieu on voit des ailmces : quand il pleut on voit des limaces. - (33) |
| ailmaile : couteau (mauvais) - (48) |
| ailmale : couteau (mauvais) - (48) |
| ailman-na : almanach - (39) |
| ail'mè : v. t. Allumer, éclairer. - (53) |
| ailmelle : lame de couteau - (39) |
| ailmer (v.) : allumer (Roger Dron et de Chambure écrivent ailemer) - (50) |
| ail'mer : allumer - (48) |
| ailmer : allumer - (39) |
| ail'mer. v. a. Allumer. - (10) |
| ail'mette : allumette - (48) |
| ailoche : alise. (CLF. T II) - D - (25) |
| ailoche, sf. alouche, fruit de l'alisier. - (17) |
| ailochö, sm. alouchier, alisier. - (17) |
| ailodje, sf. eclair dans la nuit. qqf. étoile filante. - (17) |
| ailoiri (-e) (adj. m. et f.) : étourdi (-e) - (50) |
| ailoiri, v. n. étourdir, avoir des vertiges par éblouissements ou autre accident. S’emploie quelquefois dans le sens actif : le soleil « m'ailoirit » toujours. - (08) |
| ailoirisseman, s. m. étourdissement, éblouissement, vertige. - (08) |
| ailombrau : n. m. Abri. - (53) |
| ailongne, sf. alène. - (17) |
| ailonner (v.) : découvrir quelque chose de lointain ou caché. - (50) |
| ailonner, v. a. découvrir quelque chose de lointain ou de caché, par le flair, l'instinct, ou même, chez les personnes, par intuition. - (08) |
| ailordi, v. a. alourdir, rendre lourd, étourdi, braque. Un « ailordi » est un étourdi, un évaporé, un être sans cervelle. - (08) |
| ailordition, s. f. étourdissement, vertige. - (08) |
| ailors : adv. Alors. - (53) |
| ailot (conj. du v. aller à l'imp. de l'i.nd.) : non pas ailiot, car s'il n'y a pas de trait d'union on prononce ayot (ou ayer pour aller) en palatisant le l - (50) |
| ailoti, v. a. lotir, mettre en lot ; disposer en groupe, en tas régulier pour la vente. - (08) |
| ailouàgne – alêne de cordonnier, de bourrelier. - Al â bon qu'in voituré ai ine ailouâgne. - (18) |
| ailouâgne : alêne - (48) |
| ailouagne : alêne de couteau ou de bourrelier. - (33) |
| ailouâgne. s. f. Alêne. - (10) |
| ailouin-ne : n. f. Alêne de couteau ou de bourrelier. - (53) |
| ailuché, vt. entretenir, nourrir. - (17) |
| ailumette : allumette - (39) |
| ailunette, s. f. lunette. Un vieillard ne peut lire sans ses « ailunettes. » - (08) |
| ailurai - qui se tient bien, qui a une allure fort convenable. - Le Pierrot é in gairçon vraiment ben ailurai. - C't'e pôre feille, qu'ile n'à don dière délurée ! - (18) |
| ailûre : n. f. Allure. - (53) |
| ailure, sf. allure. - (17) |
| aimaillanter, v. a. meurtrir, écraser. Un bras, une jambe « aimaillantés », c'est-à-dire dans l'état d'une chair frappée à coups de marteau. - (08) |
| aimandai - grandir, se développer, bien venir. - Vote petiote aimande bein. - L'âbre plantai l'année passée ai joliment aimandai. - (18) |
| aimande. Amende. - (01) |
| aimander : grossir, profiter, prendre du poids - (37) |
| aimander : grossir, prendre du poids, profiter. Un bon viau ! O l'aimande ben : un bon veau ! Il profite bien. - (33) |
| aimander : grossir - (39) |
| aimâr c’mment du c’icotin : très amer - (37) |
| aimartoiller, v. a. ecraser, piler, assommer. « Martoiller » est pour marteler - (08) |
| aimaule (adj. m. et f.) : aimable - (50) |
| aimaur (n.m.) : amour - (50) |
| aime : voir esme. - (20) |
| aime, esprit, cœur, courage. - (05) |
| aimendaule, adj. qui amende, qui améliore, qui fait grandir, croître, se développer. Un temps de chaleur et d'humidité est « aimendaule » pour la végétation. - (08) |
| aimendè : 1 v. t. Amender. - 2 v. t. et v. i. Grossir. - 3 v. i. Grandir. - (53) |
| aimende : n. f. Amende. - (53) |
| aimendeman, s. m. amendement, croissance, développement, engraissement, amélioration. - (08) |
| aimender : amender, grossir - (48) |
| aimender, v. n. amender, croître, grandir, se développer, engraisser. Un enfant qui grandit, un bœuf qui engraisse, un arbre qui grossit, une herbe qui pousse, « aimendent. » - (08) |
| aimenitié, s. m. bénitier. - (08) |
| aïment : ustensile de cuisine. - (52) |
| aimer : allumer - (43) |
| aimer de beu. : Fiel de boeuf ou partie amère du foie de l'animal (ms Del.), du latin amarum. - (06) |
| aimer, s. m. amer, fiel, humeur qui est renfermée dans une vésicule chez les bœufs et autres animaux. - (08) |
| aimeron : camomille sauvage, plante. - (33) |
| aimeudier : louer. (E. T IV) - VdS - (25) |
| aimeudier, aimendier : louer un champ, une part de chasse. - (66) |
| aimeun' : adj. Amène. - (53) |
| aimi (-e) (n.m. et f.) : ami (-e) - (50) |
| aimi : (nm) ami - (35) |
| aimi : ami - (48) |
| aimi : ami - (39) |
| aimi, aimie : n. f. Ami, amie. - (53) |
| aimi, ami. - (05) |
| aimi, s. m. ami. On appuie sur la première syllabe comme si elle était précédée d'une h aspirée : « mon haimi. » - (08) |
| aimie. Amie, amies. - (01) |
| aimignôder, v. a. flatter, câliner quelqu'un. - (08) |
| aimije, s. f. fil de chanvre qu'on ajoute au besoin dans le tissage. - (08) |
| aimin. Ami, amis. Mnaimin, mon ami… - (01) |
| aimioti (-e), aimioti (r) (adj.m.ou f. et v.) : 1) devenu (-e) muet/-ette - 2) devenir muet/ette - (50) |
| aimioti (s'), v. réfl. devenir muet. (Voir miot.) - (08) |
| aimiquiaule, adj. amical, porté à l'amitié, disposé à aimer, sociable: «ç'ô eun bon garçon, bin aimiquiaule. » - (08) |
| aimiquié (n.f.) : amitié - (50) |
| aimiquié, s. f. amitié. - (08) |
| aimitchôlle : affectueux(se) - (39) |
| aimitiou, adj. aimable, affectueux. - (17) |
| aîmné (-e) (adj.m. ou f.) : au lieu de aîn-né (-e) - (50) |
| aim'nè : v. t. Amener. - (53) |
| aim'ner : amener - (48) |
| aim'ner, aimouner. v. a. Amener. Fait à l'indicatif j'aimeune ou j'aimoune, formes qui s'appliquent à tous les temps dérivés de celui-là. Aimeune-nous donc ta femme, pour nous la far voir. Quant aux autres temps, ils se forment sur l'infinitif : j'aim'nai, j'ai aim'né. J'y eux ai aim’né une voiture de bois. - (10) |
| aim'ner. v. – Amener : «J'vas aim'ner les viaux dans l'renfermi. » - (42) |
| aimoder : lorsque l'on se dit commence à faire monter le lait au cours de la traite - (39) |
| aimodié, vt. amodier. - (17) |
| aimoiller, ll mouillés, v. n. mouiller. se dit des femelles d'animaux et principalement des vaches lorsque le lait commence à paraître. - (08) |
| aimoincher (v.t.) emmancher - (50) |
| aimoincher, v. a. emmancher, mettre un manche, (voir moinche.) - (08) |
| aimoinzeter (v.t.) : gaspiller (aussi amaucheter) - (50) |
| aimoinzeter : gaspiller (mot ancien) - (39) |
| aimoizeter, gaspiller - (36) |
| aimoizeter, v. a. gâcher, galvauder, détériorer, diminuer la valeur de quelque chose par insouciance ou maladresse. - (08) |
| aimon lai rue : en montant la rue. (S. T III) - D - (25) |
| aimon, s. m. amont, le haut, par opposition avec aval, le bas. - (08) |
| aimont : amont, haut - (48) |
| aimôr, s. m. amour. Ce mot éternellement jeune, n'apparaît que très rarement dans notre patois… - (08) |
| aimor. Amour, amours. - (01) |
| aimorôte. Amourette, amourettes. Que d'’aimorôte ! au quatorzième Noël, signifie que de caresses amoureuses ! - (01) |
| aimouaidiations : locations - (39) |
| aimouaidier : louer - (39) |
| aimouèdier : amodier (louer) - (48) |
| aimouègner : amener - (48) |
| aimouègner : amener - (39) |
| aimougner, aimoigner (v.) : amener (de Chambure écrit : aimougner) - (50) |
| aimougner, v. a. amener, mener vers… - (08) |
| aimugeai (s') : s'amuser. O s'aimugeot : il s'amusait. - (33) |
| aimunition. s. f. munition de guerre ou de chasse, plomb, poudre, etc. - (08) |
| aimusar, s. m. flâneur, celui qui perd son temps à des choses inutiles. - (08) |
| ain : un - (37) |
| ain p’so, ain p’cho : un peu - (37) |
| ain, aine : un, une - (39) |
| ain, aine. s. num. un, une. Le féminin est souvent nasalisé en aigne. - (08) |
| ain. Ayez. N’ain pô de ran, n'ayez peur de rien. - (01) |
| ainche. s. f. hanche. — « aince » - (08) |
| aincré : enfoncé dans la tête - (37) |
| aindai : aider, se donner un coup de main. O mé ben aindé : il m'a bien aidé. Les amis venont vous ainder : les amis viennent vous aider. - (33) |
| ainder (v.t.) : aider - (50) |
| ainder : aider. - (52) |
| ainder : aider - (39) |
| ainder, hinder. p. a. Aider. Vienras-tu nous hinder? Oui, si j'ai le temps. - (10) |
| ainder. v. - Aider : « Venez nous ainder un peu, à piquer des roses. » (Colette, Claudine à l'école, p.l49) - (42) |
| aindier : aider - (48) |
| aine : une - (37) |
| aine, âne. - (05) |
| aineai, s. m. anneau, bague. - (08) |
| ainge, ange. Anj’luss, l'Angélus. - (16) |
| ainge. Ange, anges. A Dijon, anvié un Ainge, envoyer un ange, c'est envoyer un Sergent… - (01) |
| aingne, f. : aine. (M. T IV) - Y - (25) |
| aingne. Dans l'Avallonnais et toutes les communes des cantons de Coulanges-sur-Yonne et de Vermenton, finale des mots terminés par ain. Maingne, paingne, parraingne, demaingne, étaingne. - (10) |
| aingne. s. f. Aine Du latin inguen. - (10) |
| ainicrôche, obstacle imprévu. C'est un mot que les Anglais ont laissé aux Bourguignons ; any crooked, quelque chose d'accroché. - (02) |
| ainicrôche. : Obstacle imprévu. - (06) |
| ainiée : poule qui garde le nid (adjectif). - (33) |
| ainieû : à nouveau - (37) |
| ainille, agneau. - Cent brebi d'aivô los ainille. (Virg. vir.) - (02) |
| ainille. : Agneau (latin agnellus). - (06) |
| ainique, adj. unique, seul. - (08) |
| ainité, s. f. unité. - (08) |
| ainmâbye adj. Aimable. - (63) |
| aiñme : (nf) esprit, intelligence - (35) |
| ain-me : esprit, intelligence - (43) |
| ainme n.f. Amour propre. - (63) |
| ain-mer (s'), v. pr , se plaire : « J' m'ainme ben iqui ; y é plasant ». - (14) |
| ain-mer : aimer - (51) |
| ainmer : aimer - (57) |
| ainmer v. Aimer. - (63) |
| ain-mer, aimer. - (26) |
| ain-mer, v, tr., aimer. Dans plusieurs de nos mots, à ai français correspond ain. - (14) |
| ainmi, -ie n. Ami. - (63) |
| ainne - une. - Vo m'é demandai des corges ; demain i vos en envirai déji ainne. - (18) |
| ain-ne (l') : aine - (57) |
| ainné, adj. aîné, le premier né d'une famille : « ç'ô l'ain-né de nos p'tiots ». - (08) |
| aîn-né, aîné. - (16) |
| ainnoma ! Interjection pour exprimer le doute, l'incertitude : vraiment ! Allons donc ! Vous plaisantez ! - (08) |
| ainoché, ie, adj. ereinté, trop chargé. - (17) |
| ainombrer, v. a. compter, dénombrer. - (08) |
| ainoncè : v. t. Annoncer. - (53) |
| ains (que v's), que vous ayez. - (14) |
| aint, ains - temps du verbe avoir. - En faut qu'al aint tot pliain de coeur.- Que vos n'ains pas pô ! - (18) |
| aintre ou eintre : Jante. « Les aintres de la rôe (roue) ». - (19) |
| ainuïan, ante, adj. contrariant, taquin. - (08) |
| aipaicher, v. a. apaiser, calmer, adoucir. - (08) |
| aipâillai - apaiser, calmer.- Aquemance ai s'aipâillai. - Le vent s'épâille in pechot. - (18) |
| aipairoiller (s'), v. réfl. se mettre à l'aise, s'étendre, se détirer. - (08) |
| aiparceu (p.p.) : participe passé du verbe apercevoir « I m’en seu aiparceu héiar » - (50) |
| aiparceu, part, passé. aperçu, entrevu - (08) |
| aiparcevouère : apercevoir - (39) |
| aipauri, v. n. appauvrir, devenir pauvre. Nous disons « paure » et « poure » pour pauvre, d'où les verbes « apaurir, apourir. » - (08) |
| aipercevouère : apercevoir - (48) |
| aipéritif (n.m.) apéritif - (50) |
| aipetioti. v. a. rendre plus petit, plus mince, plus pointu. - (08) |
| aipeuïot, s. m. appui, soutien. - (08) |
| aipeurai - apurer, faire sortir l'eau d'un linge ou de tout autre objet pour commencer à le sécher. - Etendons les draps su le cordais po les fâre aipeurai. - (18) |
| aipeurcer : approcher - (39) |
| aipeurchai (s') : pronominal : s'approcher doucement d'un homme ou d'un animal .Ou, employé comme verbe actif ; approcher : aipeurche mouai le sel : approche moi le sel. - (33) |
| aipeurchè : v. t. Approcher. - (53) |
| aipeurcher : approcher - (48) |
| aipeurcher, v. a. approcher : « aipeurche toué d' lu » - (08) |
| aipeurçue, s. f. aperçue, vue sommaire d'une chose. - (08) |
| aipeurer : essorer, égoutter - (48) |
| aipeuriander. v. a. appréhender, craindre : « n'aipeuriande pas, va ! » - (08) |
| aipeurnant, aipeurno, aipeurneussaint - divers temps du verbe apprendre. - I me raipeule qu'ai l'écôle i n'aipeurnâ pas mô. - (18) |
| aipeurtir (s') (v.pr.) : devenir mauvais, s'assombrir (étym. : devenir « peut » = devenir mauvais) - (50) |
| aipeuter, v. ; faire des reproches à quelqu'un. - (07) |
| aipiaiti, vt. aplatir. - (17) |
| aipiéter, v. n. avancer beaucoup en marchant, marcher très vite. - (08) |
| aiplaini, v. a. aplanir, mettre de niveau, rendre plan. - (08) |
| aiplani, vt. aplanir. - (17) |
| aip'lè : v. t. Appeler. - (53) |
| aip'ler : appeler - (48) |
| aipler, vt. appeler. Indic. prés. épeule. - (17) |
| aiplèyer : atteler. - (31) |
| aiplomb, s. m. aplomb. « d'aiplomb » s'emploie quelque fois pour exprimer l'intensité d'un effet produit : « l’soûlai chauffe d'aiplomb. » - (08) |
| aipoigne, loc. adv. a peine, avec peine. - (08) |
| aipoincer. v. a. Epandre, éparpiller. - (10) |
| aipoirner (v.) : provoquer, menacer - (50) |
| aipoirner, v. a. agacer, picoter, provoquer par des taquineries. - (08) |
| aipoli, v. a. polir, rendre uni, lisse. - (08) |
| aiponde : relier, réunir, abouter - (48) |
| aiponde : attraper - (39) |
| aipondre. v. a. rejoindre, joindre ensemble. S’emploie activement pour exprimer l'idée de réunion à une personne qui est en route. Cette femme était fort loin, mais je l'ai « aipondue » ou « r'joindue. » - (08) |
| aiponouére : bas du ventre de l'oie - (39) |
| aipotaizé (éte bin) :être embarrassé - (39) |
| aipôte (n.m.) ; 1) apôtre - 2) personne de mauvaise renommée - (50) |
| aipôte, s. m. apôtre : « ain boun aipôte », un hypocrite. - (08) |
| aipotier, v. ; apporter ; on dit aussi aipoutier ; aipoutie-moi-ça. - (07) |
| aipouli (s') v. réfl. se dit du ciel lorsqu'il prend une teinte uniforme. le temps « s'aipoulit » à l'époque des grandes pluies d'automne. - (08) |
| aipourtè : v. t. Apporter. - (53) |
| aipourter : apporter - (48) |
| aippeau. s. m. appeau, espèce de sifflet dont on se sert pour imiter le cri des oiseaux et les attirer au piège. - (08) |
| aippétit (n.m.) : appétit - (50) |
| aippeûrc’er (s’), sans breût : (s’) approcher sans bruit - (37) |
| aippeurcer (s') (v.pr.) : s'approcher - (50) |
| aippor, s. m. apport, assemblée qui se réunit chaque année à jour fixe, marché, foire. - (08) |
| aipport : fête patronale. - (33) |
| aipposer. v. a. opposer : « i m'aippose ai ç'iai » — aipposer (s'), v. réfl. s'opposer. - (08) |
| aippreuve, s. f. preuve. Il a vendu ses bœufs, et pour « aippreuve », il a reçu des arrhes. - (08) |
| aipprôter (s’) : « (se) préparer, (s’) habiller - (37) |
| aipprôter (v.t.) : préparer, mettre en état de fonctionnement - (50) |
| aipprôter l’goûter : préparer le repas du midi - (37) |
| aipré : après. - (33) |
| aipré. Après. - (01) |
| aiprée : après - (48) |
| aiprée : 1 prép. et adv. Après. - 2 adj. Suivant. - (53) |
| aiprenre, aiprenraint, aiprenrons - divers temps du verbe apprendre. - En fau fâre aiprenre in bon métier ai vot petiot. – Cequi lio-z-aiprenrai ai éte pu rasonabe. - (18) |
| aiprés (prép., adv.) : après - (50) |
| aiprés : après - (39) |
| aipreucher : approcher - (48) |
| aipris - instruit, élevé. - Ces gairçons lai sont ben aipris. - Voiqui ine enfant ben aiprise. - (18) |
| aipropi : nettoyer - (48) |
| aipropri : nettoyer - (39) |
| aipropri, v. a. nettoyer, tenir propre. - (08) |
| aiprôtè : v. t. Préparer. - (53) |
| aiprôter (s') : préparer (se) - (39) |
| aiprôter : (èprô:tè - v. trans.) apprêter, préparer. Ce verbe est surtout usité au réfléchi : s'èprô:tè, "se préparer". - (45) |
| aiprôter : apprêter - (48) |
| aiprôter, v. a. apprêter, préparer, disposer. - (08) |
| aiprousse - empressement extraordinaire indiquant de la frayeur ou de la grande impatience. - A son venus d'ine aiprousse qu'en se demande quoi qu'airivo don ! - Ça ben de l'aiprousse po ran. - (18) |
| aiquabeuch'nè, aiquabeus'nè : affalé - (48) |
| aiquabeus'née : courbée (par la vieillesse) - (48) |
| aiquaitai : accroupi sur les jarrets pliés. (C. T IV) - A - (25) |
| aiquaîvâillé : écarté, ouvert - (37) |
| aiquaîvaîller : ouvrir, en écartant - (37) |
| aiquand : avec - (48) |
| aiquand qu' …? : quand …? - (48) |
| aiquand : quand, avec quelqu'un - (39) |
| aiquant, quand : avec. Ol 'éto d'aiquant li : il était avec lui. Faut ailler aiquant les autres : il faut aller avec les autres. Faut lai quand les autres. - (33) |
| aiquelé : accroupi. (pour se dissimuler ou pour un besoin pressant). O s'o aiquelé : il s'est accroupi. - (33) |
| aiquelè : 1 adj. Affaissé. - 2 adj. Fatigué. - (53) |
| aiquelée : n. f. Accumulation subite et importante. - (53) |
| aiqueler (s') : accroupir (s') - (48) |
| aiquemaudai - accommoder, assaisonner. – Note fonne aiquemaude ben le maigre. - Les ovrai an trouvai les treuffes ben aiquemaudées. - (18) |
| aiquemôder. v. a. accommoder, préparer, satisfaire. « aiquemôder » un mets, l'accommoder, le préparer ; « aiquemôder » un chaland, se mettre d'accord avec lui. - (08) |
| aiquenée, sf. charge, lourd fardeau. - (17) |
| aiqueni, e, part. passé d'un verbe « aiquenir » inusité à l'infinitif. Emacié, celui qui est très amaigri. - (08) |
| aiqueter (v.t.) : acheter - (50) |
| aiquêter : trouver, acheter - (39) |
| aiquéter, v. a. faire une acquisition, acquérir, acheter, gagner, ramasser : « ol é aiqueté ain bon beutingn' », il a ramassé un bon bien. - (08) |
| aiqueuillon : arbuste : houx. Un bouquet d'aiqueuillon : un bouquet de houx. - (33) |
| aiqueulè : accroupi (e) - (48) |
| aiqueuler (s') : s'accroupir - (39) |
| aiqueuler (st) (v.pr.) : s'accroupir - (50) |
| aiqueuni(é) (adj.m. ou f.) : très amaigri (-e) - (50) |
| aiqueur : noisetier - (48) |
| aiqueurboté, ée, adj. accroupi, assis sur les talons. « aiqueurboté » semble une corruption de à-cul-bouté, mis à cul. - (08) |
| aiqueurché : 1 v. t. Accrocher. - 2 v. t. Écorcher. - (53) |
| aiqueurni, e, adj. maigre, rachitique. - (08) |
| aiqueurpotè (s ') : v. pr. S'accroupir. - (53) |
| aiqueuté, vt. [accoter]. Attacher légèrement à l'aide d'un petit lien. - (17) |
| aiquit, s. m. acquit, reçu, quittance. - (08) |
| aiquiter, v. a. acquitter, rendre quitte : « a n'me doué pu ran, al ô aiquité », il ne me doit plus rien, il est quitte. - (08) |
| aiquitié, vt. acquitter. - (17) |
| aiquot, n. masc. ; abri contre la pluie. Se mettre ai l'aiquot ; se faire un aiquot, prononcé aiquot. - (07) |
| aiquouer : attacher un cheval à la queue du précédent - (48) |
| aiquouobi : accroupi pour se cacher. - (33) |
| air : vent - (48) |
| air n.f. Air. - (63) |
| air : s. m. Avoir l'air. Cette locution, suivie d'un substantif, s'emploie en réponse à un individu dont on ne partage pas la manière de voir. « Viens-tu au ciné, ce soir? — Oh! T' m'as ben l'air ciné, toi... » - (20) |
| air’taiper l’lit : « refaire » le lit - (37) |
| airâgnai - exciter surtout par la parole, les bêtes de trait à avancer, à tirer. - Les chevaux ne tirant pas airâgne les don fort. - Te vâ, toi, airâgnai les bétes. - (18) |
| airâgnai : encourager, stimuler de la voix ou de l'aiguillon. - (33) |
| airâgner (forte altération de railler). v. a. Exciter, taquiner par des railleries. - (10) |
| airâgner ('v.) : stimuler de la voix ou avec l'aiguillon - (50) |
| airagner (verbe) : exciter de la voie les animaux au travail : le cheval attelé ou les bœufs sous le joug. - (47) |
| airâgner : encourager, stimuler avec un bâton, accélérer, filer, activer - (48) |
| airâgner : conduire des bêtes - (39) |
| airâgner, v. ; exciter le pas des animaux, les conduire . A te faut airâgner les chevaux ; airâgne donc lai pouliche. - (07) |
| airâgner, v. a. exciter, stimuler de la voix, de l’aiguillon, harceler : « allon, viâ, airâgné le bœu ! » allons, vite, excitez, piquez les bœufs ! - (08) |
| airai, héritier. Certains l'écrivent aussi haîrai, en latin heres. - (02) |
| airai. Aurai. Je n’airai qu’ai jüé, je n’auraî qu’à jouer. - (01) |
| airai. : Héritier (du latin hoeres). - (06) |
| airaibie. Arabie. - (01) |
| airaiché, vt. arracher. - (17) |
| airaignan, ante, part. prés. hargneux, taquin, querelleur. - (08) |
| airaigniant. : (Dial. et pat.), honnête, civil, retenu, rangé: ène dame ben airaignante. (M Del.) - (06) |
| airaignîe : araignée. - (62) |
| airaignie : l'araignée - (46) |
| airaimer : mettre des rames - (39) |
| airain, airant - temps du verbe avoir. - Si al an bon temps âl airant aito ben chaud. - I airrin besoin de plieue. - (18) |
| airaingé : v. t. Arranger. - (53) |
| airaingnie, sf. araignée. - (17) |
| airâler, v. a. écorcher, enlever la peau, déchirer. - (08) |
| airapper (s') : se cramponner pour essayer de prendre quelque chose - (39) |
| airaquai : accrocher. O s'o airaquai dans un fil de fer : il s'est accroché dans un fil de fer. - (33) |
| airâser, v. a. mettre de niveau : « airâser » un mur, un trou en remplissant le vide. - (08) |
| airbàyé, v. n. apparaître partiellement : il a airbàyé un instant. - (22) |
| airbépin, s. m. aubépine. - (22) |
| airbeuillai, r'beuillai : fouiller. Les couechots, les sanlliers airbeuillent : les cochons, les sangliers, fouillent. - (33) |
| airbor (l') - au rebours, à l'envers, le contraire. - Ile ai mis ses chausse ai l'airbor. - I â ai l'airbor de ce qu'an feillot. - (18) |
| airbouécer ou, mieux, erbouécer. v. a. Reboucher. - (10) |
| airboûler dâs z’ûyots : écarquiller les yeux - (37) |
| airç’eûpe, airç’oûpe : bas de tronc d’arbre, coupé - (37) |
| airc’iper : couper la cîme - (37) |
| aircaiç’inne : membre du corps humain (le plus souvent : cuisse) - (37) |
| aircandier : grugeur, personne malhonnête, roublard, voleur - (48) |
| aircandier : personnage louche, sans foi ni loi - (37) |
| airch’eimbier : ressembler - (37) |
| aircipe : tout petit morceau - (37) |
| aircoin : recoin - (37) |
| aird’voler : redescendre - (37) |
| airdouaise : n. f. Ardoise. - (53) |
| airdouèze : ardoise - (48) |
| airdouiller : disputer fortement - (37) |
| airdounance, s. f. ordonnance. - (08) |
| airdouner, v. a. ordonner. - (08) |
| aire : aigre - (48) |
| aire, adj. desséché, rugueux au toucher. - (17) |
| aire, airou - âpre, raide au toucher se dit aussi du temps. - I ne veut pas de ce drap qui, âl â tro aire. - Frotte ton ailemette su quique chouse in pecho aire. - En ne fait dière bon ; ça in temps airou. - (18) |
| airé, se fâcher, se courroucer, en latin irasci. On dit aussi airigô, pour chicane. - (02) |
| airé, vt. aérer. - (17) |
| airé. Aurez. Vos airé, vous aurez ; el airé, il aura ; tu airé, tu auras. - (01) |
| airée : Aire, sol de la grange sur lequel on battait au fléau. On dit aussi « pliéche de grange ». L'aire à l'extérieur de la grange est le « su ». - (19) |
| airéeter : arrêter - (48) |
| airèille (n.f.) : oreille (aussi érèille) - (50) |
| aireille (nom masculin) : versoir de la charrue. - (47) |
| aireille : n. f. Oreille. - (53) |
| aireille : oreille, socle de charrue - (39) |
| aireille, airelle, s. f. Oreille. - (10) |
| aireille, s. f. oreille. « aiheille », par la chute de l'r : « i é mau ez aireilles. » - (08) |
| aireilles : oreilles. - (33) |
| aireillon, s. m. oreillon, anneau, agrafe de fer qui fixe l'anse d'un seau, d'une chaudière, d'une marmite, etc. : les deux « aireillons » d'un vase... par assimilation avec les oreilles. Nous disons aussi les « aireilles » pour les ouïes d'un poisson. - (08) |
| airein. J’airein, nous aurions ; vos airein, vous auriez ; el airein, ils auraient ; airein-je ? aurions-nous ? - (01) |
| aireng : n. m. Hareng. - (53) |
| airer, v. tr., aérer : « Faut airer c'te chambre ; aile sent l’renfarmé ». - (14) |
| airer. : (Dial. et pat.), se fâcher, se courroucer. Dérivation du latin irasci. - Airigô, en patois, signifie chicane. - (06) |
| airétau, s. m. obstacle qui arrête, barrière, palissade, fossé, etc. : il a mis un « airétau » dans son champ pour qu’on n'y passe pas. - (08) |
| airèté, vt. arrêter. - (17) |
| aireufé : s'être écorché en tombant. (CT. T II) - S&L - (25) |
| airfromer : refermer - (37) |
| airgairdant (ât’e) : être « près de ses intérêts », mesurer chichement - (37) |
| airgardai : regarder. - (33) |
| airgent : n. m. Argent. - (53) |
| airgent, s. m. argent : « i n' l' fré ne por or ne por airgent. » - (08) |
| airgentaule, adj. argenteux, celui ou celle qui a de l'argent, qui a la poche bien garnie : ces gens-là sont « airgentaules. » - (08) |
| airgenter, v. a. convertir en argent une valeur en nature : vous me devez douze poulets, « airgentons-les ». C’est-à-dire donnez-m’en le prix en argent. - (08) |
| airgnie (n.f.) : araignée - (50) |
| airgnie, s. f. araignée et toile d'araignée, sync. De « araignie » « ailgnie. » - (08) |
| airgognai, airgogné - passer son temps à des choses inutiles ou mal conduites un homme qui chicane pour des riens. - A ne fait qu'airgognai.- En ne peu pas contai su lu, ç'à in airgogné. - (18) |
| airgot : griffe, ongle - (48) |
| airgot : ongle de main, ou de pied - (37) |
| airgrîgner (s’) : (se) rapetisser - (37) |
| airguignai - contrarier, provoquer au mécontentement par des agacements quelconques. – Al airguigne continuellement ses camarades. - Veux tu ben ne pas airguignai le chien ? - (18) |
| airiâ : 1 n. f. Enrayure. – 2 n. f. Ride. - (53) |
| airiâ : désordre - (39) |
| aîriâs : complications, ennuis - (37) |
| airie : largeur de céréales que l'on battait au fléau et expression pour faire reculer les bêtes - (39) |
| airie, couche de gerbes dans l'aire. - (05) |
| airie, s. f. airée, ce qui est sur l'aire de la grange au moment du battage, la quantité de gerbes qu'on va battre au fléau. « aihie. » - (08) |
| airie. Couche de blé ou d'autres céréales étendues dans une grange, de area, aire. - (03) |
| airie. Gerbes de blé déliées et étendues sur l'aire de la grange pour être battues au fléau. - (49) |
| airigné : v. t. Taquiner. - (53) |
| airigö, sm. protubérance, nodosité sur un morceau de bois, esquille de bûche. Se dit également des troncs coupés d'arbustes, coudriers, fusains, etc. - (17) |
| airigote, airigotouse, difficultueuse , tracassière. C'est l'opposé d'aisille, aisé, facile. - (02) |
| airigueu : souche d’arbuste qui dépasse le niveau du sol. - (66) |
| airiotte, s. f. petite ruelle, chemin, sentier étroit entre deux haies, ou deux murailles : « a vô fau sigre l'airiotte », suivez le sentier. - (08) |
| airivai - dans le sens français d'arriver, mais particulièrement se dit d'un mets quelconque que l'on assaisonne. -Voiqui in bout de moton ben airivai ! - I n'eûmes pas les nentilles, ma airivées qu'ment çequi â son ben bonnes. - (18) |
| airiver : arriver - (48) |
| airjigner, airç’igner : retrousser les lèvres et grincer des dents - (37) |
| airmaîre (n’) - armaîre (n') : armoire - (57) |
| airmale - lâme de couteau, ou mieux, vieille lâme séparée du manche. On dit en proverbe de quelqu'un qui n'a pas fait une affaire avantageuse : Al é choingé son coutais conte un airmale. - (18) |
| airmale : mauvais couteau. Tu parles d'un airmale : tu parles d'un mauvais couteau. - (33) |
| airmalle. Allumelle, lame de couteau ou d'épée. Etym. Ai est pour a comme dans notre patois ; armalle pour alemalle, alumelle, qui lui-même est, selon Littré, formé de a et de lumelle. - (12) |
| airmana (n.m.) : almanach - (50) |
| airmana, s. m. almanach. - (08) |
| airmettu : remis - (37) |
| airmonâ- almanach. - I ne veut pâ d'in airmonâ qui ne marque pas les foires. - (18) |
| airmouère : armoire - (48) |
| airnaird (l’) : (le) renard - (37) |
| airné : fatigué, éreinté (voir aussi eurné). - (33) |
| airné : très fatigué - (39) |
| airnifier : renifler - (37) |
| airnire (n’) - airgnére (n') : araignée - (57) |
| airnouâ – harnais ; tout ce qui sert à l'attelage des bêtes. - Airnouaiche voué les chevaux. - (18) |
| airo. Aurais, aurait. - (01) |
| airôde : arête de poisson - (39) |
| airôde, airôte : arête - (48) |
| airôde, s. f. arête de poisson, dard, épine, piquant. Environs d'Avallon. - (08) |
| airoicher (v.t.) : arracher - (50) |
| airoicher, v. a. arracher, extraire. - (08) |
| airoïlle, sf. oreille. - (17) |
| airon. Aurons, auront. - (01) |
| aironces : âronces : ronces - (37) |
| airondelle, s. f. hirondelle. — « arondelle. » - (08) |
| airosè : v. t. Arroser. - (53) |
| airösé, vl. arroser. - (17) |
| airösou, sm. arrosoir. - (17) |
| airôsoue : arroseur - (48) |
| airotai- en parlant des voitures qui sont arrêtées par les difficultés du chemin. - Les chevaux airotans ai to manman. - Le père Martenot ai airotai vé le Cordon. (V. Enrotai). - (18) |
| airoté (ö), vt. appeler de loin. - (17) |
| airou : andain de foin avant la mise en tas ou en botte. On metto le foin en airou : on mettait le foin en andain. - (33) |
| airou : foin relevé en lignes - (39) |
| airouai - tout ce qui sert à assaisonner les aliments : graisse, huile, beurre, poivre, etc.. - (18) |
| airouai : assaisonner ou assaisonnement. - (33) |
| airouaicher : arracher - (48) |
| airouaichoû d'dents : dentiste - (48) |
| airouè : matière grasse pour la cuisson - (48) |
| airouè : saindoux, huile ou autre matière grasse pour la cuisson. - (33) |
| airouet. s. m. Roux, sauce. - (10) |
| airougi, v. a. rougir, rendre rouge. Le vent de solaire « airougit « les sarrasins. - (08) |
| airouinger : arranger - (48) |
| airous : plusieurs andains rapprochés pour créer les condition favorables facilitant l'enlèvement ou la mise en tas du foin. - (33) |
| airouser, v. a. arroser, irriguer. - (08) |
| airoy, culture, du latin arare; au figuré, parure, ajustement ; ce qui est en désairoy ou désaroy est ce qui est abandonné, ce qui est mal cultivé. - (02) |
| airpairti : reparti, repartir - (37) |
| airpaisser : repasser (le linge). passer, à nouveau, au même endroit - (37) |
| airpaitraiç’er : trainer les pieds à nouveau là où l’on a déjà causé des dégâts, en y marchant une première fois - (37) |
| airpe : unité pratique de longueur, écartement maximum des doigts - (37) |
| airpent (ain) : (un) arpent, mesure de superficie (4 m² 221, en moyenne) - (37) |
| airpent : n. m. Arpent. - (53) |
| airpenter : marcher, à grandes enjambées - (37) |
| airpion : pied - (48) |
| airpiquer chû sâs quîlles (s’) : (se) remettre debout, après une chute - (37) |
| airpiquer d’bout (s’) : aller mieux, après une maladie - (37) |
| airpiquer en pienne târre : repiquer, dans le jardin, des semis de légumes ayant déjà progressés, sous châssis - (37) |
| airpreind’e (s’) : (se) « reprendre », faire une pause, « souffler » un peu - (37) |
| airpreind’e l’coûyier : prendre le travail - (37) |
| airquer : marcher - (48) |
| airqueûvrie : recouverte - (37) |
| airquînquer (s’) : (se) remettre d’une maladie, revenir en bonne santé, « reprendre des couleurs » - (37) |
| airraichai : arracher. Airracher ses treuffes ou ses biottes : arracher ses pommes de terre ou ses betteraves. - (33) |
| airraiché : v. t. Arracher. - (53) |
| airraisser (v.) : arracher - (50) |
| airranzer (fâre) : (faire) réparer - (37) |
| airrapai (s') : Se dépêcher, être actif au travail . Ol o ben airrapé : il est bien actif au travail. - (33) |
| airrapper, v. ; prendre; emploi pronominal : s'airraper ; a s'airrapèrent pas lai quoue. - (07) |
| airrée : n. m. Arrêt. - (53) |
| airrètai : arrêter. - (33) |
| airrétè : v. t. Arrêter. - (53) |
| airrhes, s. f. plur. arrhes, gage. - (08) |
| airriements : assaisonnements, condiments, aux-goûts - (37) |
| airrivaige, s. m. arrivage, à peu près synonyme de « arroi. ». L’arrivage désigne toutes les denrées qui servent à accommoder les mets, le beurre, la graisse, l'huile, le lard, le sel, etc. - (08) |
| airrivaize (n.m.) : arrivage - (50) |
| airrivaize : assaisonnement - (39) |
| airrivè : v. i. Arriver. - (53) |
| airrivée : n. f. Arrivée. - (53) |
| airriver - (39) |
| airriver (v.t.) : arriver - (50) |
| airrôter (v.t.) : arrêter - (50) |
| airroy. : Culture, ajustement, parure (M Del.). Or, de l'idée matérielle de culture (arare en latin), on est venu à l'idée morale qui s'y rapporte. Etre en grant airroy signifie être en bel ajustement ; être en desairroy renferme l'image opposée. - (06) |
| airroyer : ajouter des condiments - (37) |
| airsaige. : Hachis de viande. (A. P.) - (06) |
| airsouille : arsouille - (48) |
| airsseimbier l’oraize : être, très mal, habillé et peigné - (37) |
| aîrsuer (fâre) : laisser quelque temps, sur la surface de la terre des légumes (principalement des pommes de terre), qui viennent d’en être extraits, afin d’en faire évaporer l’humidité superficielle - (37) |
| airtelé, part. pass. altéré : un homme « airtelé d'gaingner », celui qui a soif de bénéfice. - (08) |
| airter : arrêter - (48) |
| airter, v. a. arrêter, saisir. - (08) |
| airteûner lâs s’angs (s’en) : (s’en) faire un très gros souci - (37) |
| airteûrné (en ât’e tout) : (être) décontenancé, peiné, surpris - (37) |
| airteûrner (s’) : (se) retourner (dans une pièce, pouvoir évoluer) - (37) |
| airtillerie (n.f.) : artillerie - (50) |
| airtique (n.m.) : article - (50) |
| airtîrer : retirer - (37) |
| airtoillon - insecte qui ronge les étoffes. (V. Cot) - (18) |
| airtot : orteil - (48) |
| airtrou’aîlles (lâs) : (les) retrouvailles - (37) |
| airtroué : retrouvé - (37) |
| airtrouer (s’) : (se) retrouver - (37) |
| airvârper (s’) : réagir brusquement, se rebiffer - (37) |
| airveûni : revenu, revenir - (37) |
| airzenter : posséder de l’argent - (37) |
| airziper (s’) : (se) détendre nerveusement - (37) |
| ais’couer l’bail’on : « secouer le ballon », faire des remontrances - (37) |
| aisaumée, s. f. etendue de terre qu'un homme couvre de grains à chaque fois qu'il traverse un terrain en projetant la semence. Bande de terre en général. Mesure de superficie. — « aichaumée. » - (08) |
| aisceai, s. m. hachette à l'usage des sabotiers. - (08) |
| aisch’caiyiers : escaliers - (37) |
| aisciau (n.m.) : herminette de sabotier - (50) |
| aiscouer (s') : secouer (se) - (39) |
| aiscouer : secouer - (48) |
| aise. Etre à son aise, se dit après un repas, quand on y a mangé et bu « tout son soûl ». On dit auisi : n'avoir plus ni faim ni soif. - (20) |
| aiseman, s. m. récipient en général pour loger l'eau, le vin, la vendange. - (24) |
| aiseman, vase, ustensile. - Dans l'idiome breton, ais ou eaz signifie aisance, commodité. (Le Gon.)... - (02) |
| aiseman. - ( Dial. et pat. ) , vase, ustensile, écuelle. - (06) |
| aisement : (nm) récipient - (35) |
| aisement : panier, sac, enveloppe pour emporter quelque chose. - (66) |
| aisement : récipient en général - (43) |
| aisement : s. m., vx fr., ustensile, vaisselle. - (20) |
| aisement, âsement, ustensile de ménage, casserole, pot. - (27) |
| aisement, m. : outil, ustensile. (M. T IV) - Y - (25) |
| aisement. Facilité, commodité ; ustensile, local pratique. - (49) |
| aisement. Vaisselle, bas latin aisamentum. - (03) |
| aisements, pièces de vaisselle, ustensile. - (05) |
| aisements, s. m., vaisselle, ustensiles de cuisine, de ménage : « R'laver les aisements ». - (14) |
| aisements. s. m. pl. Meubles, vaisselle, ustensiles divers, qui rendent service dans un ménage, qui contribuent au bienêtre et font qu'on est bien aise. - (10) |
| aises (les), s. m., les êtres d'un appartements : « Ol ira ben vous q'ri l'afaire ; ô sait tous les aises de la maïon ». - (14) |
| aisi : (adj) facile - (35) |
| aisi : facile - (43) |
| aisié : facile - (61) |
| aisié, aisière. s. f. Raie pour l'écoulement des eaux dans un champ ensemencé ; petite rigole d'assainissement. - (10) |
| aisote (n.f.) : arête - (50) |
| Aïss ! : A droite !. Ordre de conduite des bœufs sous le joug. Peut-être ordre au bœuf de droite pour tourner à gauche ? - (62) |
| aiss’ter (s’) : asseoir (s’). On dit aussi : « se s’ter ». Ex : « Set’te don » : assieds toi donc. - (62) |
| aissaiboui : abêti, « assommé » - (37) |
| aissaime : compréhension - (39) |
| aissaimer : comprendre - (39) |
| aissainni, vt. assainir. - (17) |
| aissaissin, sm. assassinat. - (17) |
| aissaivouâ, v. a. savoir, connaître, informer : « a mé fé aissaivouâ qu'avinrô », il m'a fait savoir qu'il viendrait. - (08) |
| aissare : pièce pour enserrer le timon d'un char à bœuf - (39) |
| aissas : relief du repas, débris de n'importe quoi… - (33) |
| aissé. Assez. - (01) |
| aisseau : herminette (sabotier) - (48) |
| aisseaux, diminutif de ais, planche, aisseaunes (bardeaux). - (04) |
| aisselée, s. f., ce que le bras peut embrasser en se recourbant sous l'aisselle : « Eùne aisselée de foin, de paille, etc. » - (14) |
| aisselle, s. f., étagère où la batterie de cuisine, les plats et les couverts sont placés et tenus par des entailles. - (14) |
| aissembié, vt. assembler. - (17) |
| aissembler : assembler, préparer à donner son lait (vache) - (48) |
| aissèmer : comprendre - (48) |
| aisseter, v. tr., asseoir ; « Eh ! l’vieux pâre, aiss'tez-vous proche du feu ». - (14) |
| aisseupi (s'), vr. s'assoupir. - (17) |
| aisseurance, s. f. assurance, sûreté, sécurité. - (08) |
| aisseurer, v. a. assurer. - (08) |
| aissez (adv.) : assez - (50) |
| aissi. s. m. Essieu. (Ligny-le-Châtel.) - (10) |
| aissi. : (M Del.), essieu de voiture. - (06) |
| aissiâ ou assiô - si oui. - Vos n'é don pas fait ce qui vos aivâ dit ?... Aissiâ. - (18) |
| aissiau : petit outil du sabotier, herminette. - (33) |
| aissiaules : bardeau. I, p. 20-1 - (23) |
| aissiaune (n.f.) : lame de bois de chêne qui servait à couvrir le toit des maisons (aussi assiaune, aissiaule) - (50) |
| aissiéger, v. a. asseoir, en parlant des choses, mettre d'aplomb. On « aissiége » les fondations d'un mur, une roche, un bloc. - (08) |
| aissiô, particule d'affirmation. Oui, assurément. - (08) |
| aissis. s. m. Petit ais, bardeau, planchette pour couvrir les toits. Diminutif de ais. - (10) |
| aissodji, vt. assourdir. - (17) |
| aissorder (v.t.) : assourdir - (50) |
| aissorder, v. a. assourdir : « a m'é aissordé aivou sai meusiqhie. » - (08) |
| aissoubi (s'), v. réfl. s'assoupir, s'endormir. - (08) |
| aissouèfè : assoiffé - (48) |
| aissouélé (-e) (adj. m. et f.) : assoiffé (-e) - (50) |
| aissouété, adj. celui qui a soif, qui est très altéré. - (08) |
| aissoumasser, essoumasser. v. a. et n. Retrancher les talles, les branches, les membres inutiles d'un cep de vigne. - (10) |
| aissoumat, essoumat. s. m. Membre d'un cep de vigne qui n'a pas de fruits et qu'on doit retrancher. - (10) |
| aissoumer, v. a. assommer, frapper avec violence. - (08) |
| aissouriller, v. a. rendre sourd, assourdir. - (08) |
| ais'tè : assis - (48) |
| ais'ter (s') : asseoir (s') - (48) |
| ais'teure : maintenant - (48) |
| aisteure, aichture (loc.adv.) : (à cette heure), à présent, maintenant - (50) |
| aisteure, loc. adv. a présent, à cette heure ; « i seu dijeuné aisteure », je viens de déjeuner. En plusieurs lieux on ne prononce pas la dernière syllabe. - (08) |
| aitaiche, s. f. attache, lien, épingle, agrafe, cordon, ruban et en général tout ce qui sert à attacher quelque chose. - (08) |
| aitaiché, vt. attacher. - (17) |
| aitainé (-e) (adj.m. ou f.) : fatigué (-e), dégoûté (-e) - (50) |
| aitainer, v. a. fatiguer, ennuyer, taquiner, importuner, dégoûter : « laiché moue, vo m'aitainés », laissez-moi, vous me fatiguez ! « i seu aitainé de ç'lai », je suis ennuyé de cela. - (08) |
| aitaingnai - ennuyer, embêter. – Que ces petiots lai m'aitaingnent don d'aivos los cris. - Si vos saivain combein cé m'aitaingne ! - (18) |
| aitainné, vt. assommer ; étourdir ; ennuyer. - (17) |
| aitain'ner : lasser, fatiguer, énerver - (48) |
| aitaiquer, v. a. attaquer, harceler. - (08) |
| aitairi : tarir - (39) |
| aitairi, v. a. tarir, dessécher, mettre à sec : « mon poué ô aitairi », mon puits est à sec. N’est usité qu'en parlant d'un réservoir naturel. - (08) |
| aitandre, attendre. - (16) |
| aitaner, casser les oreilles en faisant un grand bruit. - (27) |
| aitau (adv.) : aussi, itou, de même - (50) |
| aitaulai (S') - s'attabler, se mettre à table. - I nos son aitaulai in quart d'heure. - Quant à son aitaulai, an ne peu pu les aivouair. - (18) |
| aitaut (prép.) : avec (aussi aiquant) - (50) |
| aitefice, s. m. engrais, fumier, amendement quelconque. - (08) |
| aitefier (v.t.) : améliorer le sol par la fumure - (50) |
| aitefier, v. a. fumer, mettre un engrais en terre ; améliorer, amender le sol et, en général, tout ce que l'on possède. On dit d'un homme laborieux et soigneux qu'il « aitefie » ses propriétés. - (08) |
| aiteloure : bois de cornouiller qui fixait le timon au joug. - (66) |
| aitentiouneu, euse, adj. attentionné, qui a des attentions, des égards, des prévenances pour quelqu'un : « çô eune gentite fonne, bin aitentiouneuse. » - (08) |
| aiteu : aussi. - (66) |
| aiteujer, v. a. tisonner, remuer les tisons : « aiteujé l'feu », tisonnez le feu. - (08) |
| aiteûyer (v.t.) : attiser - (50) |
| ai-t-i !- vous plait-il ? que dites-vous ? - Tontine, apportez-moi mon livre… Ai-t-i not mossieu ? - (18) |
| aitifer, v. a. attifer, parer avec prétention et mauvais goût. - (08) |
| aitiger : exagérer - (48) |
| aitiger, aitiver. v a. Attiser. Le premier de ces mots, altération évidente d'attiser, est employé dans son sens propre le second, altération non moins évidente d'activer, s'emploie comme synonyme ou, plutôt, comme analogue, puisque pour activer le feu, il faut nécessairement l'attiser. Dans certains endroits, on dit atlier. - (10) |
| aitiolon (ö), sm. avorton. - (17) |
| ait'nêille (n’) - t'naille (na) : tenaille - (57) |
| aito - aussi, de même. – Moi aito i irai li parlai. - Ah vos voiqui aito, vo ? - (18) |
| aitö, adv. [atout]. aussi. - (17) |
| aitojon, sm. artison (insecte). - (17) |
| aitolai, aitolée – atteler des bêtes de trait ; le temps que les bêtes sont attelées pour un ouvrage. - Vos aitoleras les chevaux vé les neives heures. - En prend trente so por ine aitolée de charrue. - (18) |
| aitolè, aittolè : v. t. Atteler. - (53) |
| aitolée : n. f. Laps de temps de travail entre l'attelage et le dételage. - (53) |
| aitolée, s. f. attelée, la durée d'un travail d'attelage pour les bœufs ou les chevaux ; espace de temps où les animaux de trait sont attelés. - (08) |
| aitoleman, s. m. appareil d'attelage, et non pas comme en français action d'atteler. - (08) |
| aitoler, v. a. atteler, mettre les animaux de trait sous le joug ou sous le harnais. - (08) |
| aitoller, v. ; atteler. - (07) |
| aitolouère, aittolouère : n. m. Timon. - (53) |
| aitoloure, s. f. cheville de bois ou de fer qui sert à l'attelage des bœufs. - (08) |
| aitor. A tour, atours. - (01) |
| aîtot : doigt de pied - (37) |
| aitôt, aitou : adv. Aussi. - (53) |
| aitou : atout - (48) |
| aitou : aussi - (48) |
| aitou : aussi. T'es content ? moué aitou : tu es content ? moi aussi. - (33) |
| aitou : aussi, avec - (39) |
| aitou, adv. aussi, également, pareillement : « al ô airivé aitou », il est arrivé aussi. « aitou » signifie avec : « aitou lu », avec lui. - (08) |
| aitre : voir etres. - (20) |
| aitres. An n'ai pas besoin de leumière quand an counnât les aitres de lai mason. C'est à tort que l'on écrit êtres. Du latin atrium, entrée, vestibule, et, par extension, toutes les parties d'une habitation. - (13) |
| aittaicer (v.t.) : attacher - (50) |
| aittaichai : attacher. Ol aittaiche pas ses chiens aiquant des saucisses : on n'attache pas ses chiens avec des saucisses. - (33) |
| aittaichant : attachant - (57) |
| aittaiché : v. t. Attacher. - (53) |
| aittaicher : attacher - (48) |
| aittaichi : attacher - (57) |
| aittaquè : v. t. Attaquer. - (53) |
| aittelouère : pièce d'attelage qui reliait le joug. - (33) |
| aittende (v.t.) : attendre - (50) |
| aittende : v. t. Attendre. - (53) |
| aittention : n. f. et interj. Attention. - (53) |
| aitteûyer, aitteûy’ner : disputer, « secouer les puces », attiser - (37) |
| aittigé : v. t. Exagérer. - (53) |
| aittolai : atteler, composer un attelage. Fayo aittolai pou partir : il fallait atteler pour partir. - (33) |
| aittolaige : attelage - (48) |
| aittolaize (n.m.) : attelage - (50) |
| aittolaize : attelage - (39) |
| aittolée : attelée - (48) |
| aittolée : attelée - (39) |
| aittolée : attelée. - (32) |
| aittoler (s') (v.t. et pr.) : atteler ; s'atteler - (50) |
| aittoler : atteler - (48) |
| aittollé : attelé - (37) |
| aittoupir : courir pour empêcher le froid. Faut aittoupir quand o jale : il faut courir quand il gèle. - (33) |
| aittraipe : attrape - (48) |
| aittraiper (v.t.) : attraper - (50) |
| aittraiper : attraper - (48) |
| aittrape : attrape, farce - (39) |
| aittribuer - bailli : attribuer - (57) |
| aittügai : attiser le feu. - (33) |
| aittû-yer : attiser (le feu) - (48) |
| aittûyer : attiser - (39) |
| aituïer, v. a. attiser, tisonner. - (08) |
| aituser, activer un feu. - (28) |
| aitû-yé : v. t. Attiser. - (53) |
| aitûyer - attiser. - Aituyez don le feu por qu'à ne s'étoinde pa. - Al ai renversai sai lampe queman qu'âl l'aituyo. - (18) |
| aiva : alise. (RDM. T IV) - C - (25) |
| aivaicher, v. a. saillir une vache : le taureau blanc a « aivaiché lai beurnotte. » - (08) |
| aivaigni (-e) (adj. m. et f.) : affaibli (-e) - (50) |
| aivailie (ai l’), aivaulée, loc. a l'avalée, en bas. Chö ai l’aivaulée, tomber, dégringoler. - (17) |
| aivaint, aivo - temps du verbe avoir. - En é tirai lai loterie, et peu ile è évu in petiot paroissien. - Vos aivaint ben le temps de pairtir. - Il aivo raillon. - (18) |
| aivalanche (n.f.) : avalanche - (50) |
| aivan, lëz aivan, les dimanches de l'Avent. - (16) |
| aivan, prép. avant ; en avant ; plus loin, hors du lieu où l'on est : « a n'o pâ iqui, al ô aivan », il n'est pas ici, il est parti. - (08) |
| aivan. Avant, tantôt préposition, tantôt adverbe. C'est aussi le substantif masculin Avent, le temps des quatre dimanches avant Noël ; et comme à Dijon, des hautbois payés exprès ont ordre de jouer pendant ce temps de rue en rue, depuis les neuf heures du soir jusqu’à minuit, le menu peuple appelle ces hautbois les Aivan. Velai, dit-on, les Aivan qui passe, c'est-à-dire : voilà les hautbois de l’Avent qui passent. Les Bourguignons disent aussi, el at aivan, pour il s'en est allé ; ce qui fait croire à de bonnes gens que pour exprimer cela en bon français, il n'y a qu'à dire : il est avant. - (01) |
| aivan. :El at aivan, il s'en est allé (ms Del.). On disait les ai van de Noël. - (06) |
| aivançaule, adj. qui donne de l'avance, qui se fait vite. Un travail minutieux n'est pas « aivançaule » - (08) |
| aivance (n.f.) : avance - (50) |
| aivance : avance - (48) |
| aivance : avance - (39) |
| aivancé : v. t. Avancer. - (53) |
| aivance, s. f. espace de chemin ou de temps franchi avant le moment fixé ; argent libre dont on peut disposer sans délai : « al é d'laivance », il a de l'argent comptant. - (08) |
| aivancée : n. f. Prolongation d'une toiture, n. m. auvent. - (53) |
| aivancer : avancer - (48) |
| aivancer : avancer - (39) |
| aivanci, e, part. pass. d'un verbe « aivancer » inusité. Celui qui a de l'avance, qui est à l'aise. - (08) |
| aivanpeue (nom masculin) : auvents, volets. - (47) |
| aivanpleue, s. m. avant-pluie, côté de la pluie, face exposée à l'ouest. — un « aivanpleue », auvent qui abrite une maison. - (08) |
| aivant - parti. - En i é ben ine heure qu'âl a aivant. - A son to aivant : pu nun dans lai boutique. - (18) |
| aivant (prép., adv.) : avant - (50) |
| aivant : avant - (48) |
| aivant : avant. - (33) |
| aivant : avant - (39) |
| aivant : prép. adv. et n. m. Avant. - (53) |
| aivant, adv. dehors. - (17) |
| aivanter : « tirer » quelque chose à soi - (37) |
| aivanture. Aventure, aventures. - (01) |
| aivar (v.t.) : avoir - (50) |
| aivâr, aivouair : v. t. et n. m. Avoir. - (53) |
| aivârie : n. f. Avarie. - (53) |
| aivarpin, sm. aubépine. - (17) |
| aivarse : averse - (39) |
| aivarti (v.t.) : avertir - (50) |
| aivarti, v. a. avertir : « i n'veu pà l'seurprenre, al ô bin aivarti. » - (08) |
| aivarticheman (n.m.) : avertissement - (50) |
| aivarticheman, s. m. avertissement ; avis donné aux plaideurs de comparaitre devant le juge de paix - (08) |
| aivaulai. : Avaler (M Del.). - (06) |
| aivaulé, vt. avaler. - (17) |
| aivauler, v. a. avaler, faire descendre. - (08) |
| aivaulou, ouse, adj. avaleur, avaleuse. Celui qui est gourmand : « eun gran aivaulou. » - (08) |
| aivé. Avez. - (01) |
| aivec : avec - (39) |
| aiveilli, v. n. devenir vieux, vieillir : « al ô bin aiveilli. » - (08) |
| aivein. J'aivein, nous avions ; vos aivein, vous aviez ; el aivein, ils avaient. - (01) |
| aivencement : prolongation d'une toiture, auvent. - (33) |
| aiventrïer (s'), v. réfl. se coucher sur le ventre, se mettre à plat ventre. - (08) |
| aiveû : avec - (46) |
| aiveu lé, aveu lu : avec elle, avec lui. - (66) |
| aiveuc : avec (se dit aussi aiquant ou quant). - (33) |
| aiveughie, s. et adj. aveugle. Le son de la désinence est très mouillé. « aiveuille » - (08) |
| aiveughier, v. a. aveugler, éblouir : « l'soulai m'é aiveughié. » — « aiveuiller. » - (08) |
| aiveughiotte (ai l'), loc. a tâtons, dans l'obscurité. — « aiveuillotte. - (08) |
| aiveu-là : avec lui. - (66) |
| aiveune - advienne, arrive, advenir. - L'aifâre â faite, aiveune qui vouré ! - Quoi qu'an aiveunne, i en airai mon cœur cliair. - An ne sa pà ce qui peut aiveni. - (18) |
| aiveûye (adj. m. et f.) : aveugle - (50) |
| aiveuye : aveugle - (39) |
| aiveûyer (v.t.) : aveugler - (50) |
| aiveuyer : aveugler - (39) |
| aivi - avis dans le sens français. - A m'â t-aivi que vos faite ine bêtise. - (18) |
| aivi, avis. - Ai mat aivi, j'ai l'idée que. - (02) |
| aivi. Avis. Ce m’at aivi, ce m'est avis, pour ce me semble. - (01) |
| aivi. : Ai nos at aivi, nous sommes d'avis que (M Del.). - (06) |
| aivïer, v. a. aviser, apercevoir : « auchutô qui m'en seu aivïé ; — n'taiville pâ d'fére ç'lai. » - (08) |
| aiviger, v. a. inventer, imaginer des choses fausses le plus ordinairement. — « aiviger » est une forme d'aviser. - (08) |
| aivillonnes- avelines, noisettes de jardin. – I on ben des aivillonnes ceute année. - I ailon encore pliantai des aivillonnés. - (18) |
| aivindre (v.) : atteindre (étym. : de ad venire : venir à ...) - (50) |
| aivindre, v. a. atteindre. - (08) |
| aivïon. s. f. avis, aperçu, vue rapide d'un objet, ou au figuré d'une idée. - (08) |
| aivionne, sf. aveline. - (17) |
| aivioti, e, adj. amaigri, émacié, miné par la faim ou la misère. Ne s'emploie guère qu'en parlant des animaux. - (08) |
| aivis : avis - (48) |
| aivis : avis - (39) |
| aivis, s. m. avis, opinion, sentiment : « c'm'ô aivi », ce m'est avis ; je suis d'avis ; je crois que... - (08) |
| aiviser (v.t.) : aviser - (50) |
| aivision - adresse, invention. - Çâ de mon aivision cequi. - Le pôre houme, à n'ai guère d'aivision. - (18) |
| aivives, s. f. plur. avives, glandes derrière la machoire. - (08) |
| aivo (ō), vt. avoir. - (17) |
| aivo : avait. Ol aivo eu pou : il avait eu peur. Ol aivo été pou. - (33) |
| aivo ou aivoo. Avais, avait. - (01) |
| aivö, prép. avec. Voir daivö. - (17) |
| aivô. Avec. Le circonflexe sur l'o final d’aivô, marque une certaine prononciation bourguignonne, qu'il n'y a que les naturels qui puissent attraper. C'est une espèce de diphtongue, dont le son grossier approche de celui que formerait ohu prononcé très vite, comme si c'était un monosyllabe des plus brefs. - (01) |
| aivô. : Avec, aivô lo, aivô no, avec lui, avec nous. Le dialecte disait avoc (S. B.) . - (06) |
| aivocar. : Avocat. Je m'an répote és aivocar, disent les paysans. Le patois bourguignon répugne aux finales muettes : c'est pour cela qu'il ajoute la consonne r au mot avocat, ainsi qu'aux mots cié, mié (ciel, miel), qu'il articule cier, mier. - (06) |
| aivochö, sm. piquet ou tige ébranchée, destinés à marquer la limite d'une coupe de bois. - (17) |
| aivödier, vt. aveugler. - (17) |
| aivödje, adj. aveugle. - (17) |
| aivödje-brebis, sm. brôme stérile. - (17) |
| aivoère : avoir - (39) |
| aivoi de quei. : Être riche. - (06) |
| aivoi. Avoir. - (01) |
| aivoigne, s. f. avoine. - (08) |
| aivoinde - atteindre, pouvoir prendre un objet. - Çâ tro haut, jaimâ in ne pourai l'aivoinde.- I ne peut pâ aivoinde mon bâton. - (18) |
| aivoindre : attraper. (A. T II) - D - (25) |
| aivoindre, v. ; atteindre; c'est trop haut ; Y ne chouros l'aivoindre, y aivoindre. - (07) |
| aivoinge (n.f.) : avance - (50) |
| aivoinge, aivoingeai - avance, avancer, aller vite. - Al ai de l'aivoinge su mouai. - Al aivoinge to pliain. – Al aivoingeant pas mau. - (18) |
| aivoinge, s. f. avance. Le dicton du pays est : « quan ai pieu l'dimoinge, lai s'maigne n'ô pâ d’aivoinge », quand il pleut le dimanche, la semaine donnera du retard à l'ouvrage. - (08) |
| aivoingeaule, adj. qui avance, qui va vite, qui se fait avec promptitude. Un travail « bin aivoingeaule » est celui qui peut s'exécuter avec rapidité. - (08) |
| aivoinger (v.t.) : avancer - (50) |
| aivoinger, v. a. avancer, donner de l'avance. - (08) |
| aivoirde - même sens qu'avoinde peu employé. - (18) |
| aivolai (d') - outre le sens ordinaire d'avaler, cela veut dire descendre, s'enfoncer, se mettre plus bas par exemple dans le lit. - Aivole tai don in pecho sô l'aideurdon, t'airez pu chaud. - (18) |
| aivolai : avaler. J'aivole quand y meuge : J'avale quand je mange. - (33) |
| aivolè : v. t. Avaler. - (53) |
| aivolée : aval, bas - (48) |
| aivoler (v.) : 1) avaler - 2) abattre, courber vers le bas, coucher - (50) |
| aivoler : avaler - (37) |
| aivoler : avaler - (48) |
| aivoler : avaler - (39) |
| aivoler : avaler. - (32) |
| aivoler, v. ; étendre ; se dit des jambes ou du corps dans le lit ; aivole tes pieds ; aivole-toi. - (07) |
| aivoler, v. a. abattre, courber en bas, couher. - (08) |
| aivolouair (un bon) : (une bonne) « descente » de gosier - (37) |
| aivolouèr' : n. m. Avaloir. - (53) |
| aivolte (nom féminin) : averse violente qui ravine les chemins. - (47) |
| aivolte, s. f. grosse averse qui entraîne les terres, qui ravine : les « aivoltes » ont couru dans les chemins. - (08) |
| aivon. J'aivon, nous avons. - (01) |
| aivondre, avoindre, vt. [aveindre]. tirer à soi. - (17) |
| aivonne, sf. avoine. - (17) |
| aivortée: avortée (en parlant d'une vache). - (33) |
| aivorter : avorter - (48) |
| aivotion, sm. avorton. - (17) |
| aivou (et par euphémie d') - avec, en même temps. - En s'en ailant âl an emportai lai chairpaingne aivou lai piaiche. - Vein don d'aivou mouai cherché de lai luzerne. - (18) |
| aivou : avec - (48) |
| aivou : voir danvec - (23) |
| aivou avec, en patois de Buxy. - (38) |
| aivou, daivou : prép. Avec. - (53) |
| aivou, prép. conjonct. Avec : « al ô v'ni aivou ou daivou nô », il est venu avec nous. - (08) |
| aivouâ, v. aux. avoir. - (08) |
| aivouain' : n. f. Avoine. - (53) |
| aivouainé (âte brâment) : (pour un humain) avoir bien mangé, bien bu - (37) |
| aivouaine (n.f.) : avoine - (50) |
| aivouaine d’queûré : poivre ordinaire - (37) |
| aivouainée : dispute reçue, fortes remontrances - (37) |
| aivouainée : n. f. fam. Avoinée, une bonne et sévère correction. - (53) |
| aivouainer : nourrir, particulièrement une volaille, pour la faire grossir - (37) |
| aivouair l’oeû : (pour la poule) elle va bientôt pondre - (37) |
| aivouair l’oeû : (pour un humain) être ivre - (37) |
| aivoucai, s. m. avocat : «eun boun aivoucai. » - (08) |
| aivoucaisserie, s. f. avocasserie, parlage à tout propos et sans fin avec esprit de chicane. - (08) |
| aivoucat (n.m.) : avocat - (50) |
| aivoué (n.m.) : avoué - (50) |
| aivouègne : avoine - (48) |
| aivouènée : correction - (48) |
| aivouère : avoir - (48) |
| aivouère du tintouin : avoir du travail, avoir des soucis - (48) |
| aivouère le temps deurè : s'ennuyer - (48) |
| aivou'li : avec lui (ou aiveuc li). - (33) |
| aivreulöt, öte, adj. toqué, agité, nerveux. - (17) |
| aivri (n.m.) : avril. On pourrait écrire avril avec un l final puisqu'il n'est pas prononcé en morvandiau - (50) |
| aivri : avril - (48) |
| aivri : avril - (39) |
| aivri : n. m. Avril. - (53) |
| aivri, s. m. avril, le 4e mois de l'année. - (08) |
| aivri, sm. avril. - (17) |
| aivûille - aveugle. – Mon pôre houme i devainré aivûille i croi.- An dit les aivûilles ben aidroits. - (18) |
| aivûillé : v. t. Aveugler. - (53) |
| aivûillotte (ai l') - à l'aveuglette chercher, faire à tâton, sans y voir. - I m'en retorne chez no ai l'aivûillotte. - (18) |
| aizer : faire tremper le chanvre - (39) |
| aizeter : acheter - (39) |
| aizi, v. a. agir, se mettre en mouvement. - (08) |
| aizu (n.m.) : lieu où l'on rouissait le chanvre - (50) |
| aizu : lavoir (cf lavouère) - (39) |
| aizu, s. m. lieu où l'on rouit le chanvre, où on le fait aizer = aiger. - (08) |
| aj’deu : aujourd’hui. - (66) |
| âjdeu : aujourd'hui - (48) |
| ajdeu, a j'd'heu : aujourd'hui. - (32) |
| âj'dheu : adv. Aujourd'hui. - (53) |
| ajedeu - aujourd'hui. - An foré fini cequi âjedeu. - (18) |
| ajeter, verbe transitif : acheter. - (54) |
| ajider. v. - Aider. Ce verbe est resté très proche de l'origine latine adjudare, alors que l'ancien français prononça ainder puis aidier. - (42) |
| ajnœlli, v. a. agenouiller. Pour une plante, se replier vers le sol. - (22) |
| aj'nouilli - se mettre à geonet : agenouiller - (57) |
| ajo : Juché. « Les pouleilles sant ajo » les poules sont sur leur perchoir. Au figuré : suspendu : « ma casquette a demoré ajo su eune brainche » : ma casquette est restée suspendue à une branche. - (19) |
| ajo : se dit des poules juchées sur leur perchoir. - (21) |
| ajou, adj., perché pour la nuit : « les poulailles a sint ajou. » - (40) |
| ajoubir (s'). Se mettre à genoux. - (10) |
| ajoubir (s'). v. - S'accroupir. - (42) |
| ajoué : Appareillé, en parlant des bœufs ou des vaches de trait. « Ces deux bûs (bœufs) sant bien ajoués ». - (19) |
| ajouer, dans le sens de aider, très bonne contraction du latin adjuvare. - (11) |
| ajouer, mettre au joug, appareiller - (05) |
| ajouper. v. n Percher, en parlant d'un oiseau. - (10) |
| ajouteure : Morceau d'étoffe que l'on ajoute à une autre étoffe trop courte. - (19) |
| ajouture : s. f., ajoutage. - (20) |
| ak’ner : (vb) bégayer : « ol akeune » - (35) |
| akercher. Accrocher. - (49) |
| akerchot. Crochet de bois à long manche pour tirer à soi les branches d'arbres et cueillir les fruits. - (49) |
| akèter : avancer les rangs d'uni voiture de foin ou de gerbes ou les rangs d'une meule de façon à faire surplomber les rangs supérieurs comme les étages des maisons à encorbellement du Moyen Age. (VDS. T IV) - VdS - (25) |
| akeûler : (vb) renverser (un tombereau) - (35) |
| akeuler v. 1. Présenter par l'arrière, basculer (un tombereau). 2. Accroupir. - (63) |
| akeurchot, subst masculin : branche formant crochet. - (54) |
| akeurqueuji v. et adj. Recroquevillé, rabougri, ratatiné. - (63) |
| al – il ou elle. Troisième personne de plusieurs temps des verbes devant une voyelle au singulier et au pluriel pour les deux genres au pluriel seulement pour le féminin. - Al aiprend ben ce petiot qui. - Al eûmant bein lai gotte les pores vieux, cequi les réchauffe. - (18) |
| al ; ol (pron. pers. 3ème pers. du sing.) : il - (50) |
| al' quiée, altiée, l'tchiée. n. f. - Litière : « On vas fai'e l'altiée aux vaches ! » - (42) |
| al, pr. pers. m., il : « Al o », il est. - (14) |
| al, pron. masc. qui désigne la 3ème personne du sing. il : « al ô saivan, al ô p'tiot, al ô saige. » au pluriel « a » pour ils devant une consonne : « a son mailaides » ; et « al » devant une voyelle : « al y feure. » - (08) |
| alà ! hélas - (38) |
| alai. Aller. - (01) |
| alaise, Camisole de femme, vêtement du matin, dans lequel on est à l'aise ; dans les environs de Beaune, on lui donnait aussi le nom bizarre de chien. - (13) |
| alaise. Laiteron. - (49) |
| alaiton s. m. Jeune animal qui tette encore sa mère. - (10) |
| alambi : alambic - (51) |
| alambie : alambic. Installation de distillation mobile. Ex : "L’alambie passe bentout. Vas-tu fée d’la goutte ?" (= bientôt). - (58) |
| alampiaux. s. m. pl. Chiffons, vieux habits. (Vertilly.) - (10) |
| âlangué : celui qui n’arrête pas de parler - (37) |
| alanto, adv. autour. - (24) |
| alayer, aleyer, elayer. v. - Élaguer. - (42) |
| alayer. v. a. Elaguer. - (10) |
| alayeur. s. m. Elagueur. - (10) |
| alayeux, elayeux. n. m. - Élagueur. - (42) |
| albeûrdâ : un peu fou. (R. T IV) - Y - (25) |
| albeurdat. s. m. Personne étourdie, sans réflexion. - (10) |
| alcade : autrefois magistrat espagnol. - (55) |
| âle, s. f., aile de volaille, - (40) |
| ale, s. fr., aile : « La p'tiote a cassé l’âle à sa poule ». - (14) |
| alègre, adj., agréable, avenant. (V. Agueùriâbe). - (14) |
| alègre, gai, joyeux, dispos. - (05) |
| alègre. n'a pas le sens de vif, dégagé, de ce vieux mot conservé en français. Il veut dire gai, agréable. - (03) |
| alein. Allions, alliez, allaient. - (01) |
| alein-ne, s. f., alêne. - (14) |
| alelua. Alléluia, cri de réjouissance dont use l’Eglise au temps de Pâques. C'est un mot hébreu qui signifie, louez Dieu. - (01) |
| alemale ou alamale : Mauvais couteau. « Changi san cutiau cantre eune alemale » équivaut à changer son cheval borgne contre un aveugle. Ancien français, alumelle. (Rabelais). - (19) |
| alemelle (n.f.) : lame de couteau - (50) |
| alemelle, lame. - (04) |
| alemelle, s. f. lame de couteau. - (08) |
| alemer : Allumer. « alemar le fû (le feu), alemer sa pipe ». Au figuré, excité par la boisson : « Ol était in p'tiet bout alemé ». Bourguignon, élemai. - (19) |
| alemette : Allumette. « In paquet d'alemettes chimiques ». Au figuré, mince comme une allumette : « Ol a des chambes (jambes) c'ment des alemettes ». - (19) |
| alento : alentour - (57) |
| alentor du (aux), loc. adv., environ, à peu prês : « Y é ben aux alentor de c' qui ». - (14) |
| alenvers : s. m., le contraire de ce qui doit être. Ce mot est formé avec à l'envers, comme alentour l'est avec à l’entour. - (20) |
| âler : sécher, dessécher - (48) |
| aleron, s. m., aile de volaille, servant aux ménagères pour épousseter les meubles. - (14) |
| ales, smpl. hâle de mars. - (17) |
| aleugette. s. f. Alouette. - (10) |
| âleûrdir : étourdir, donner le vertige - (37) |
| âleûrdiss’ments : vertiges, maux de tête, malaises - (37) |
| âleûter, alûter : vomir - (37) |
| aleuve, s. m. élève, nourrisson. Se dit des animaux, du bétail : Grand Jean fait de bons « aleuves. » On prononce « éleuve » dans le Morvan bourguignon. - (08) |
| alfessier, alfessi. n. m. - Personnage grossier, mal élevé: « Nout'e poure province était parcourue par des bandes d'alfessiers, d'galtrus et de ch'tits gars. » (Fernand Clas, p.355) - (42) |
| alguairade, algaradé, dispute cherchée à quelqu'un. Dans l'idiome breton, argaden (La Ville et Le Gon.) signifie irruption, invasion de l'ennemi. - (02) |
| ali. Allai, allas, alla. - (01) |
| alibourat, m. : petit entonnoir conique. (M. T IV) - Y - (25) |
| alibourat. s. Petit entonnoir. (Collan.) - (10) |
| alicher, v. tr., allécher, attirer : « La linaude ! alle voudrot prou alicher mon Piare ». - (14) |
| alichi : masser. (BY. T IV) - S&L - (25) |
| alider. v. a. Aider. Se dit sans doute pour aïder, prononciation un peu dure qu'on aura voulu adoucir en introduisant un l entre l'a et l'i. (Maillot.) - (10) |
| alie : s. f., lie de vin. Du vin d'alie. Des alies. - (20) |
| alier (ailler) : s. m., vx fr., alisier. - (20) |
| aliger. v. tr,, alléger, décharger partiellement pour rendre plus léger, soulager. - (14) |
| aligni : aligner - (57) |
| aligoté, aligueuté, pinot blanc. - (16) |
| alingue, allingue. adj. Fluet. (Soucy). Boiste donne Allingue, sorte de pieu, ou plutôt, de perche employée à l'assemblage des trains de bois sur les rivières. Ètre allingue, serait donc être comme une perche. Cette dernière locution, au reste, est fort employée à Auxerre. - (10) |
| alipiau. s. m. Guenille, oripeau. Voyez alampiaux. - (10) |
| alire. Allâmes, allâtes, allèrent. - (01) |
| alirent, 3° pers , allèrent : « Ol éteint m'nus leû dire bonjor ; mâ du cop ô s'en alirent ». - (14) |
| alirier. s. ni. Alizier. - (10) |
| Alison. Nom de femme, diminutif d’Alix, qu’on écrirait plus régulièrement Alis, puisque la dernière se prononce comme dans Senlis… - (01) |
| alissé, ée. adj. - Rugueux : une piau alissée. (Saint-Privé, selon M. Jossier) - (42) |
| alissé, ée. adj. Rugueux. Peau alissée, peau rugueuse. De a privât, et lisse, doux, égal, uni, poli. (St-Privé.) - (10) |
| alizé, adj. uni, au sol tassé : un sentier alizé. - (22) |
| allâ, v., aller ; lavou qu o l allâ. - (40) |
| allage (en). loc. - En bon état de fonctionnement : « La ieuse n 'est pas jà en allage pour la mouésson ! » Au Moyen Âge, l'aller signifiait l' énergie, la force de marcher. Être en allage est une déviation logique pour indiquer un bon fonctionnement. Il subsiste dans le français actuel l'expression « avoir de l'allant», dans le sens de : avoir de l'activité, de l'entrain. - (42) |
| allage (mettre en) : commencer, organiser la marche d'un travail. (M. T IV) - Y - (25) |
| allage : en l n’a pas en allage (en train). - (66) |
| allage. s. m. Action d’aller, d’être en bon train. La moisson, la fenaison est en bon allage. - (10) |
| allant, allante. Bien portant, bien portante. ETYM. aller, dans le sens qu'il a quand on dit : Comment allez-vous ? - (12) |
| alle : elle - (51) |
| alle : Elle. « Alle est allée au bé (lavoir) ». Le pluriel de alle est i « i sant allées au bé » : elles sont allées au lavoir. - (19) |
| alle pron. pers. Elle. Alle a ren peur li. Elle n'a rien pour elle. - (63) |
| alle, all', a, pr. pers., elle : « Qua c'a qu'âlle a qu’a crie? — Alle a qn'âlle a chu ». Cette phrase bizarre peut avoir besoin d'être traduite. La voici littéralement ; « Quoi c'est qu'elle a, qu'elle crie ? — Elle a qu'elle est tombée ». (Voir A). - (14) |
| allé. adj. - Sec, plus étanche en parlant d'un fût : un fût âllé . (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| alle. pron. pers. f. - Elle. - (42) |
| allée. n. f. - Cuite : « L 'Bébert i' sortait d'la cave, il en t'nnait eune sâcrée âllée ! » (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| allegrains, s. m., ridelles de charrette. - (14) |
| allement. s. m. Vaisselle ; la vaisselle courante probablement celle qui va toujours. Du verbe aller. (Bessy). Voyez amman. - (10) |
| aller (s'en), v. pr., fuir, laisser échapper, en parlant d’un vase, d'un ustensile de cuisine : « Allons, bon ! J'ai métu la sope su l’feù, è pi v'là ma marmite qui s'en va ! ». - (14) |
| aller aux béquilles. Marcher avec des béquilles. - (12) |
| aller aux portes, loc, mendier. Les mendiants vont par les rues, et demandent à chaque porte. - (14) |
| aller aux portes. Mendier. - (12) |
| aller aux,.., loc, partir pour ramasser, pour cueillir certains produits : « Vons-jou aux champignons ? aux sersifis ? » Jou, ici, remplace je. Vons-je, Allons-nous ?... - (14) |
| aller avec, loc, fréquenter : « Joset va avec la Benoîte ; ben sûr ô va la d'mander ». - (14) |
| aller et retour : loc., paire de gifles partagée entre les deux joues par une seule et même main. - (20) |
| aller : verbe actif, aller. Que l’on conjugue au présent du subjonctif. Ex 1 : Il faut qu’ j’alle. Ex 2 : Faut ben qu’jalle. Ex 3 : pluriel : Qu’j’allons - ou qu’j’allint (formulation très orthodoxe). Ex : Lundi en huit, faura qu’j’allint aux Rouesses fée des fagots. - (58) |
| alleure ou allôle : Allure. « En allant de ç't'alleure o sera bin teut arrivé» On dit aussi « allôle », mais cette forme n'est guère employée que dans cette locution : « Eune mauvâse allôle » un voyage dont on ne revient jamais. « Te revindras, Si je ne revenais pas je farais eune mauvâse allôle ». - (19) |
| alli !, interj. va-t-en ! - (22) |
| all'mer : allumer - (57) |
| allmer v. Allumer. - (63) |
| all'mer, all'mant, all'mé, J'alleume, formes diverses du verbe actif allumer. - (10) |
| allmette n.f. Allumette. - (63) |
| allongi : allonger - (57) |
| allouer v. Louer (une terre). - (63) |
| allourer : soûler quelqu'un de paroles - (61) |
| allumage, allumance. s. f. Incendie. - (10) |
| alman'na, arman'na : calendrier des postes. Almanach. - (33) |
| almette : allumette - (43) |
| alogne : noisette. B - (41) |
| alogne : (nf) noisette - (35) |
| alogne : noisette - (34) |
| alogne : noisette - (43) |
| alogne : noisette - (51) |
| alogne n.f. (du v. fr. avellanea) Noisette de forme allongée recouverte complètement par l'involucre qui dépasse même le fruit. - (63) |
| alogne ou aneuille : Noisette. Voir aneuille. - (19) |
| alogne : noisette. - (21) |
| alogne, alêne pour percer le cuir. - (16) |
| alogne, allogne : s, f., noisette de forme « allongée », recouverte complètement par l'involucre (qui dépasse même le fruit), puis, par extensions successives, noisette des bois et toute noisette. Voir Lombarde. - (20) |
| alogne, s. f. noisette. — Alogni, noisetier. - (24) |
| alogne,, n.f. noisette. - (65) |
| alogne. Grosse noisette. - (49) |
| alognes, avelines, noisettes. - (05) |
| alogni : noisetier. B - (41) |
| alogni : (nm) noisetier - (35) |
| alogni : noisetier - (34) |
| alogni : noisetier - (43) |
| alognî n.m. Noisetier. - (63) |
| alognie : noisetier - (51) |
| alognier, allognier : s. m., noisetier. Ce mot a donné leurs noms a plusieurs hameaux et écarts, comme Les Allogners, commune d'Avenas (Rhône); et à de très nombreux lieuxdits, comme En Allogneray, à Charnay-lès-Mâcon et à Crèches (Archives départementales, G. 221. 4). - (20) |
| aloigne, s. f. alêne dont on se sert pour percer le cuir. - (08) |
| aloisser. v. a. Ecorcer. - (10) |
| alombrager. Ombrage. L'arbre nous donne son « alombrage ». - (49) |
| alon-je ? Allons-nous ? - (01) |
| alôrs, alô adv. Alors. - (63) |
| alôse*, s. f. corsage, caraco. - (22) |
| alotte. n. f. - Jeune fille, adolescente. - (42) |
| alotte. s. Jeune paysanne dans l'adolescence. (Villiers-Saint-Benoit). - A Marchais-Beton, on dit Annotte ; c'est sans doute le même mot, prononcé différemment : lequel est le bon ? - (10) |
| alouaige, s. m. louage, location : il cultive un champ qu'il a « d'alouaige » ; il en paie une pistole « d'alouaige » - (08) |
| alouchier, m. : alisier. (M. T IV) - Y - (25) |
| aloue s. f., alouette. - (14) |
| alouègne : alène - (39) |
| alouer, v. a. louer, prendre en location, amodier. On « aloue » une maison, une ferme, un domestique, etc. - (08) |
| alouète : Alouette. « O fa c'ment l'alouète o se dedit » : il fait comme l'alouette, il ne tient pas parole. - (19) |
| alougne, s. f. noisette. — alougni, noisetier. - (22) |
| alouott. s. f. Synonyme d'anloupiau. Voyez ce mot. (Perrigny-lès-Auxerre). - (10) |
| alouotte : alouette - (39) |
| alourdir, élourdir, élordir. v. a. Abasourdir, étourdir, rompre, briser la tôle, la cervelle à quelqu'un, en faisant du bruit. - (10) |
| alourer (verbe) : être lourd, se montrer pénible, insupportable. - (47) |
| alouzi : qui provoque le besoin de boire pour un aliment pâteux ou sec - (51) |
| alpette. s. m. et f. Enfant chétif et malingre gamin, gamine. Paraît être une altération du mot arpette. (Percey). - (10) |
| alpreill'man, adv. pareillement, également. - (08) |
| alquiller. v. a. Lisser. Alquiller les cheveux. - (10) |
| alquiner. v. a. Exiger d'un homme ou d'un animal un travail qui dépasse ses forces. - (10) |
| als (pron. pers. m. et f. pl.) : ils, elles - (50) |
| alsan : arceaux qui soutiennent les rideaux du berceau. - (21) |
| altauffiers. s. m. pl. Bande d'enfants, de gamins tapageurs, qui taquinent et harcèlent les passants. (Percey). - Le mot altoufier, usité à Tronchoy pour désigner un vagabond, doit être, bien certainement, une variante d'altauffier. - (10) |
| altaufier, m. : vagabond. (M. T IV) - Y - (25) |
| altéhé, part. pass. altéré, qui a soif. - (08) |
| altiée (n. f.) : litière d'une étable ou d'une écurie - (64) |
| altiée : pièce en désordre, litière - (61) |
| altise. s. f. (Voir Bête noire). - (14) |
| altour n.m. Environs, alentours. Dz'étos l'seu d'altour : j'étais le seul des environs. - (63) |
| aluchot : cri fort et aigu - (60) |
| aluchot : voix forte et aigus. III, p. 15-4 - (23) |
| alude : éclair d'orage. - (30) |
| alué : alisier. (RDM. T IV) - B - (25) |
| alumement. : (Dial.), éclairement de l'esprit, si l'on peut parler de la sorte, pour définir un mot qui exprime l'action des lumières acquises. - (06) |
| alunette, f. : linotte. (M. T IV) - Y - (25) |
| alunette, s. f. linotte, oiseau de la famille des granivores. - (08) |
| alunotte, elunotte. S. f. Linotte, oiseau. - (10) |
| alûter (v.t.) : avoir envie de vomir - (50) |
| aluzi, adj. uni, au sol tassé : un sentier aluzi. - (24) |
| alvin, s. m. bétail d'élève, animaux du premier âge, poulains, jeunes veaux. - (08) |
| alviner, v. n. aleviner, produire de l'alevin, c’est-à-direle fretin ou menu poisson avec lequel on peuple les étangs. Chez nous les carpes qui alevinent sont appelées pisseuses ou en patois « pichouses. » - (08) |
| am - cherchez divers mots par An, Em, En, etc… - (18) |
| amab'. adj. - Aimable. - (42) |
| amadou (sainte), dénomination, qui fait partie d'une loc. facétieuse. Se dit d'une personne présente. Ainsi : « Aile êt iqui en char et en os, tôt c' ment Sainte Amadou ». - (14) |
| amadou, s. f., large champignon, de nature très résistante, poussant horizontalement sur les vieux troncs de noyers. - (14) |
| amadouere : calmer - (44) |
| amalssi, v. r. aggraver, en parlant d'une maladie. - (22) |
| amalssi, v. r. aggraver, en parlant d'une maladie. - (24) |
| amandelaÿ, s. m., amandier. - (40) |
| amandre : Amande. « des amandres vardes (vertes) ». Bourguignon, aimandre. - (19) |
| amandré : Amandier. Amigdalus communis. « Les amandrés sant flieuris ». - (19) |
| amandre : s, f., amande. - (20) |
| amandrier : s. m., amandier. - (20) |
| amangenner. v. - Attacher les mains, enchaîner. (Perreuse, selon M. Jossier) - (42) |
| amanghenner (contraction d 'amangéhenner). v. a. Oter l'usage des membres, et plus particulièrement des mains. Mot composé de a augmentatif et de deux mots latins manus gehennare, entraver, enchaîner les mains, les mettre dans la gehenne. (Ferreuse). - (10) |
| amanvier, v. tr., mettre de côté, amasser du bien. (Mervans). - (14) |
| amanvir, se procurer, élever. - (05) |
| amar adj. amer, amère. - (38) |
| amarine : osier - (51) |
| amarine n.f. Branche d'osier. - (63) |
| amarine, ambre, veillon : osier - (43) |
| amarine, n.f. osier. - (65) |
| amarmeler. v. a. Battre à outrance, briser la figure à quelqu'un, le mettre en marmelade. - (10) |
| amarné : arbuste qui produit de l'osier. (B. T IV) - S&L - (25) |
| amasser, v. tr., contracter, gagner : Ol a pris frèd ; ôl a amassé du mau ». - (14) |
| amati : A demi sec, en parlant du foin récemment fauché « Ce foin n'est pas so (sec) ma ol est déjà bien amanti ». - (19) |
| amati adj. Demi-sec (pour un fromage). - (63) |
| amati. Demi-sec, se dit surtout du fromage. - (49) |
| amaucheter, v. a., gâter, gâcher, perdre, mettre à mal que l'on prononce à mau. - (11) |
| amaujeter : méduser - (60) |
| amauvi, adj. pâle, amaigri, qui fait mal à voir. - (22) |
| amauvis : Mauviette. « Ol est allé à la chaiche (chasse) es amauvis ». - (19) |
| amauvis : s, m., mauvis, grive des vignes (turdus musicus). Le véritable mauvis est le turdus iliacus. - (20) |
| âmaûz’ter : émietter, gaspiller - (37) |
| amazoute : camomille sauvage(DC. T IV) - Y - (25) |
| ambadous. adj. des 2 genres. Couché sur le dos. Cette femme porte son enfant ambadous. (Perrigny-lès- Auxerre). Nous croyons cette orthographe de Perrigny défectueuse. Voyez badoue. - (10) |
| ambataize : tour des roues en bois - (39) |
| ambéjaloure : s. f. marque laissée sur deux pains par leur contact lors de leur cuisson. - (21) |
| ambia : lien qui relie le joug au timon. - (33) |
| ambîme, s. m. abîme, endroit profond ou dangereux. - (08) |
| ambitionnou, ouse, adj. envieux, qui a ledésir d'avoir, le plus souvent aux dépens du prochain. - (08) |
| amblâ (n.m.) : tige servant à fixer le joug des bœufs sur le timon - (50) |
| amblâ : pièce pour enfiler le timon d'une voiture ou char à bœuf - (39) |
| amblâ, s. m. tige ou branche de bois tordue en forme d'anneau servant à fixer le joug des boeufs sur le timon d'une voiture. - (08) |
| amblai. Embler, vieux mot qui signifie dérober. Le bien d'autrui tu n’embleras. Embler vient d’involare. - (01) |
| amblai. : (Dial. et pat.), dérober - (06) |
| amblas : pièce pour attelage de bœufs (pour fixer le timon) - (48) |
| ambler. Piller, voler. Ce verbe est employé dans la vallée de la Saône et surtout dans la Bresse châlonnaise. - (13) |
| amboké, embecquer un petit enfant, un oiseau. - (16) |
| amborbé, embourber. - (16) |
| ambraissan. Embrassant. - (01) |
| ambre : s. m., osier. - (20) |
| ambre, s. m. osier (du latin salix amerina, de la ville d'Amerie (Ombrie)). - (24) |
| ambre, s. m. osier. - (22) |
| ambrenai ou embrenai. - (Infinitif, participe passé et adjectif), couvrir et être couvert d'une substance quelconque. - (06) |
| ambrenai, tout couvert de quelque chose de malpropre. Dans l'idiome breton, amprevan (Le Gon.) et ambréan (LEP.) signifient vermine. - (02) |
| ambrenai. Embrené, embrenez, embrener. - (01) |
| ambres : (n.pl.) osier - (35) |
| ambreuille ou lambreuille. : Le nombril (M Del.). - (06) |
| ambreuille, le nombril. - (02) |
| ambroder : (anbrô:dè - v. trans.) enduire d'une matière sale et épaisse (boue, etc.) - (45) |
| ambruaehé. Fâché de mauvaise humeur… - (01) |
| ambruai (s'). : Se mettre en train de vitesse (M Del.,) et s' ambrui, verbe appartenant à une double conjugaison. - Part. : ambrué ou ambrui, mis en train. (Lac). - (06) |
| ambruer, « L » prendre son ambrue, se mettre en route, s'élancer, lancer une chose sur une pente ; ce mot nous parait venir directement d'ambulare). - (04) |
| ambruer. Mettre en train vivement, prendre de l'élan. - (03) |
| ambrui ou ambrué, qui est mis en train de ... , qui commence son mouvement... - (02) |
| ambrui. Mit en train. Il ne se dit qu'avec le pronom personnel. S'ambruï de proché ; se mit en train, en humeur de prêcher. L'infinitif de ce verbe c'est ambruer, formé, ce semble, dz la préposition en et de bruit. Quand les enfants voient que leur sabot, leur toupie ou leur moulinet commence à tourner de bonne sorte, ils disent en bourguignon, que leur trebi, leur fiade, leur melin s’ambruë, c'est-à-dire commence à taire du bruit en tournant, et de là par métaphore s’ambruër, pour se porter à faire quelque chose avec ferveur. Le velai ambrué, le voilà en train. - (01) |
| ambrunchai, mine que l'on fait en fronçant les sourcils... - (02) |
| ambruncher (s') : (s’anbrin:ché - v. pr.) se couvrir, s'assombrir (en parlant du ciel) - (45) |
| ambruyé, mettre en train, à l'ouvrage. S'ambruyé, s'élancer pour courir. - (16) |
| amcharboté, enchevêtrer ; du fil amcharboté : du fil enchevêtré. - (16) |
| ame, s. f., personne, individu : « J' seû été cheù vous ; n'y avot âme qui vive ». - (14) |
| amelette, s. f. omelette. - (08) |
| amena, amenau (Paille d'). s. f. Paille d'orge et d'avoine, paille de menus grains, amena et amenau étant une altération de menu. (Villiers-Bonneux). - (10) |
| amendé : grandi. Ex.: Elle ai bai amendé. (N. T IV) - C - (25) |
| amender, grossir, grandir en parlant des enfants, des bêtes, des arbres. - (27) |
| amender, v. intr., grandir : « Ah! y é vot' petiot ? Dêpeù que j' l’ons vu, ôl a ben amendé ». - (14) |
| amender, v. n. Grandir, prospérer, s'améliorer. – Employé activement, signifie engraisser, améliorer. Le fumier amende les terres. - (10) |
| amender, v., se développer, grossir. - (40) |
| amender. Croître rapidement, devenir fort, Dépeu qu'an ai plevû, mon troqué (blé de Turquie), ai bin aimendé — Not' petiot darré aimeude teut son sô (tout son saoul). Ce verbe était employé au XVIIIe siècle. - (13) |
| amender. Grandir, ne se dit qu'au propre. - (03) |
| amender. Mot du plus pur francais, signifiant rendre meilleur (Littré) ; mais qu'on détourne chez nous de son sens primitif pour lui faire signifier croître, grandir. Etym. emendare. - (12) |
| amendeu : croître, profiter. - (29) |
| amendise. : (Dial.), réforme, perfectionnement. Du latin emendatio. - (06) |
| amener, v. élever (cette lapine amène bien ses petits). - (65) |
| amener, verbe transitif : élever, amener à maturité. - (54) |
| amenter (s') (s'aminter) : v. r., s'affaiblir. - (20) |
| amer (être sur son), loc, se dit du vin qui devient amer quelques jours après le pressurage, et aussi de l'enfant qui est à l'âge de la formation. - (20) |
| âmer : Aimer. « Pu je te vois pu je t'ame », nom du myosotis. « Petite Catherinette, veux tu m'amer ? » (vieille chanson). - (19) |
| amer coum' chicotin : amer. Vraiment très amer. Ex : "Ta salade de pissenlits, al est amére coum'chicotin." (avec un accent aigu... sur amer). - (58) |
| amer, subst. masculin : fiel d'une volaille. - (54) |
| amerale, s. f. camomille vulgaire. - (08) |
| amère. Fiel. - (49) |
| amerelle : fausse camomille. - (31) |
| ameron. s. m. Etat du vin amer. Ce vin tourne à l'ameron. - (10) |
| amesouche. adj. Un peu amer. (Mont-Saint-Sulpice, Seignelay). - (10) |
| amesoute. s. f. Marguerite des champs. (Mont-Saint-Sulpice, Seignelay). - (10) |
| amesser. v. a. et n. Dire une messe de relevailles. Se faire amesser, se faire dire une messe pour ses relevailles. - (10) |
| ameulat, s. m. Gagne-petit, rémouleur. - (10) |
| ameuler, v. a. mettre en meule, en tas, en groupe. - (08) |
| ameuseler. v. - S'abîmer le nez, le « museau ». - (42) |
| ameusser (s'), v. réfl. se baisser, se cacher, se tapir. S’emploie quelquefois sans le pronom : « al ô ameussé dan l’crô », il est tapi dans le trou. - (08) |
| ameuz'lé (adjectif) : couvert de blessures spectaculaires mais sans gravité réelle. - (47) |
| amfrèli : abats de porcs accommodés au vin rouge : c'est le carquelin de la région de Genlis, en Côte-d'Or). (CH. T II) - S&L - (25) |
| amialé (adjectif) : écrasé. Se dit notamment d'un gâteau qui manque de consistance. - (47) |
| amiârder v. Gâter excessivement un enfant. Voir miâ. - (63) |
| amiauder, amignauder. v. - Amadouer, flatter, entortiller. - (42) |
| amiaule. : (Dial. et pat.) Les adjectifs latins terminés en abilis se traduisent dans le dialecte et dans le patois par la terminaison aule : « 0 naissance amiaule as hommes. (S. B., vig. de la Nativ.) - (06) |
| amibrunchai, ambrunchi et ambrun. : Fâché, d'humeur noire ou rembrunie. -Le dialecte disait embronchiés. - (06) |
| amicoler : Caresser, cajoler. « T'ame bien te fare amicoler ». - (19) |
| amicoloux : Caressant en paroles et en actions. - (19) |
| amignauder (v. tr.) : cajoler, amadouer par une attitude aimable, des paroles tendres - (64) |
| amignauder, aminauder. v. a. Flatter, caresser. Dans le glossaire de Roquefort, on trouve amignauder, amignoter. - (10) |
| amigounerie. n. f. - Câlinerie : « Et quand i' n'savant pus quoué s'die i' s'font des amigouneries, s'arrêtont pou mieux s'ergarder et s'enlaçont pour se bicher ... » (Fernand. Clas, p.l66). L'histoire de ce joli mot remonte à l'adjectif.mignot signifiant au XIIe siècle : mignon, joli, agréable. Mignoter veut dire rendre mignon, dorloter, entourer de soins ; la mignotie ou la mignotise est une gentillesse, une caresse. Amignauder, d'où vient amigounerie, c'est donc caresser, câliner, flatter. Le français a plutôt évolué vers le mot minauder : prendre des manières, des mines, pour séduire ou attirer l' attention. Voir aussi Migounerie. - (42) |
| amigrer. v. a. Epandre, écarter, en parlant du fumier Du latin migrare, emigrare, écarter, éparpiller. - (10) |
| amijoler, v. tr., cajoler, enjôler : « Alle sait s'y prende, celle-là ! alle vous l’amijôle gentiment ». - (14) |
| aminci : amincir - (57) |
| amiotter (v. tr.) : émietter - (64) |
| amiotter : émietter - (61) |
| amiotter. v. - Émietter. - (42) |
| amitant, adj. caressant, affectueux. - (22) |
| amitiaule, adj., qui fait des démonstrations d'amitié. - (11) |
| amitiaule, amiquiaule. adj. Amical. - (10) |
| amitiole, affectueux, qui fait des amitiés. - (27) |
| am'lette : une omelette - (46) |
| ammaillôlai. Emmailloter, emmailloté, emmaillotez. - (01) |
| ammaillôtai. Le même qu’ammaillôlai. - (01) |
| amman, s. m. Vaisselle qui vient de servir et qui n'est pas encore nettoyée. - (10) |
| ammeïnoter : emmailloter. - (21) |
| ammi. Emmi, au milieu. Emmi ne se dit plus il y a déjà du temps. - (01) |
| ammistôflai (s'), s'envelopper. Ammistôflai de forure, enveloppé de fourrures. - (02) |
| ammistôflai ou emmitouflé. : (Dial. et pat.), enveloppé, caparaçonné. - Ammistôflai de forure. (M Del.) - (06) |
| am'na : paille d'avoine. (F. T IV) - Y - (25) |
| amnée (n.f.) : année - (50) |
| amner (s') : venir - (51) |
| amner : amener - (51) |
| amocher. Blesser, contusionner ; « être amoché » être blessé, malade. (Argot). - (49) |
| amocheter : (prononcer amoch'ter) abîmer - mettre en morceaux. Ex : "Arrête-don d'amoch'ter ton pain." - (58) |
| amogeter : gaspiller - (61) |
| amoilli : Donner les signes d'une prochaine délivrance en parlant de vaches prêtes à vêler. Au figuré « La vaiche (vache) amoilli » signifie : la vendange approche. - (19) |
| amoïlli v. (de amouiller) S'apprêter à vêler. - (63) |
| amomon, s. m., pomme d'amour, fruit de la morelle, faux piment. C'est exactement le mot grec (aromate de l'Inde). Le nom se donne à l'arbuste et au fruit. Les amoureux s'en offrent des bouquets. - (14) |
| amonder : gronder - (61) |
| amonèti v. (or. inc.) Calmer, tranquilliser. - (63) |
| amor, s. m., considération, égard : « J'ai fait c' qui po l'amor de li ». - (14) |
| amoraichi (s') : S'amouracher. « O s'est amoraichi de c 'te dreûlesse (de cette fille) ». - (19) |
| amoratsi (s') v. S'amouracher. - (63) |
| amorci : amorcer - (57) |
| amorti : amortir - (57) |
| amotsé : sangle de cuir ou de corde servant à fixer le joug sur la tête d'un bœuf. A - B - (41) |
| amotsi v. Amocher. - (63) |
| amoucha. Oiseau de proie, du français émouchet. - (03) |
| amoucher. v. - Chasser les mouches. - (42) |
| amouchet, émouchet, tiercelet. - (05) |
| amouchet, émouchet. Lien, partie lanière de cuir, partie corde pour consolider le «je » (joug) sur la tête du bœuf. - (49) |
| amouchouée. n. f. - Émouchette, chasse-mouche : filet équipé de cordelettes flottantes, placé sur le dos du cheval afin d'éloigner les mouches et les taons ; synonyme de barbaquiaux. - (42) |
| amouder : amorcer, commencer. - (09) |
| amouder, amoder. v. - Préparer le pis d'une vache ou d'une chèvre avant la traite, en le massant. - (42) |
| amouder. v. n. Donner son lait en abondance, volontiers, facilement. Se dit des vaches bonnes laitières. - (10) |
| amouderé : tranquillisé, calmé. A - B - (41) |
| amouderé : tranquillisé - (34) |
| amoudèrer adj. (de modérer) Tranquilliser, sécuriser. - (63) |
| amoudeuré : tranquillisé - (43) |
| amoudjer. Amodier; affermer. - (49) |
| amoûdji : amodier - (57) |
| amoûdji : louer - (57) |
| amouèdiation : location - (48) |
| amouézi, v. a. chauffer et couler la lessive. - (22) |
| amouezi, v. a. chauffer et couler la lessive. - (24) |
| amouilles, glaires de vache en vêlage. - (05) |
| amouner,v. tr., amener, conduire : « Ol a été genti ; j’amoune mon gar à la fête ». - (14) |
| amounition, amunition. s. f. Munitions, vivres. Pain d'amounition, pain distribué aux soldats. Du bas latin amonitio, subsistance, suivant Ducange. - (10) |
| amourciller. v. a. Mettre, diviser en petits morceaux. - (10) |
| amoureux : voir chvau - (23) |
| ampau : voir empau. - (20) |
| ampège : (an:pèj’ - subst. f.) entrave; au figuré, personne encombrante. - (45) |
| ampéger : (an:péjé - v. trans.) entraver (un cheval). - (45) |
| ampereu. Empereur, empereurs. - (01) |
| amphitryons : hôte chez qui l'on va dîner. - (55) |
| ampigé, ampeingé et empingé. : Embarrassé d'obstacles matériels. - (06) |
| ampigé, embarrassé ; en latin impeditus. - (02) |
| ampiges ou empiges : Entraves pour les chevaux. « Mens (mets) les ampiges à tan chevau ». Au figuré on dit d'une jeune femme qui vient d'avoir un enfant : « Alle a troué eune bonne ampige ». Se dit aussi d'une personne peu dégourdie « Y est eune brâve ampige ». - (19) |
| ampigi : Entraver « San chevau est ampigi ». Au figuré : embarassé, « Etre ampigi en biau chemin » : être arrêté par le moindre obstacle. « Etre ampigi c'ment eune pouleille qu'a troué un cutiau », être dans un grand embarras. - (19) |
| amplanter : implanter - (57) |
| ampòché. Empêcher, empêché, empêchez… - (01) |
| ampoixeni. J'empoisonnai , tu empoisonnas , il empoisonna. - (01) |
| ampotai. Emporter. C'est aussi le participe tant singulier que pluriel. Le Diale l’é ampotai , le Diable l’a emporté ; le Diale les é ampotai , le Diable les a emportés. - (01) |
| ampouaché : (an:pouâ:ché – v. trans.) empêcher. Doublé de an:péjé. - (45) |
| ampoule (n.f.) : petite rainette - (50) |
| ampoule, s. f. petite rainette qui monte sur les arbres. - (08) |
| amt'iou, adj. caressant, affectueux : un enfant am'tiou. - (24) |
| amûji v. Amuser. - (63) |
| amunition, s. f., munition. Employé seulement dans le sens de fournitures militaires : « Un pain d’amunition ; un fusil d'amunition. - (14) |
| amusard (adj. et n. m.) : se dit de quelqu'un qui aime perdre son temps à des futilités (syn. arcan-yer) - (64) |
| amusard, s. m., musard. - (20) |
| amûse n.f. Amusement, distraction. - (63) |
| amusotte (n. f.) : objet d'amusement, de distraction - (64) |
| amusou (n’) : amuseur - (57) |
| amusser. v. a. et n. Boucher, détruire les musses ou passages cachés, secrets, pratiqués dans une haie par le gibier ; en général, cacher, couvrir. - (10) |
| an : On. « An peut to ce qu'an veut » on peut tout ce que l'on veut. Remarque dans le patois de Mancey, « on » se prononce toujours « an », soit seul soit dans le corps d'un mot. - (19) |
| an ni : année - (51) |
| an ou ant- il, on, ont. - Al an été ai lai charrue. - AI ant gros de mérite. V. par en. - (18) |
| an pour on ; an di, on dit ; an fé, on fait. - (16) |
| an por, en échange de... - (16) |
| an, terminaison de la 3e personne du pluriel au présent de l'indicatif, au futur, etc. : « a dian, a fian, a mingean », ils disent, ils font, ils mangent. Une partie du Morvan nivernais prononce on : « a dion, a fion, a mingeon. » - (08) |
| an. Année, années. - (01) |
| an. En. Quelquefois au, comme an leù, au lieu. Nos anciens ont dit en lieu. - (01) |
| an’nées : années - (37) |
| anan : Espèce de mure, fruit de la ronce rampante. Rubus cassius. - (19) |
| anas. s. m. pl. Immondices, débris de vaisselle. (Pasilly). - (10) |
| anaû : virole de la faux - (48) |
| ancairner : puer - (48) |
| ançan. Encens. - (01) |
| ancarner : (an:carnè - v. intr.) sentir très mauvais, puer très fort. - (45) |
| ançatre (n.m. et f.) : ancêtre - (50) |
| ancenat, ancenet, ancenot : s. m., bas-lat. ancinus et uncinus, vx fr. oncin, timon qui s'accroche (uncus) à une charrette, une herse, un rouleau, etc. - (20) |
| ancenet : timon qu'on passait dans le joug pour tirer la charrue - (43) |
| ances. n. f. pl. - Champ attenant à la ferme. Les ances est le résultat de la fusion de deux mots de la même famille, aise et aisance, dérivés du latin adjacens (situé à côté de). En aiace, puis a aise signifiaient jusqu'au XVIe siècle près de. Aisance indiquait (au XIIIe siècle) les dépendances d'une maison. Le poyaudin a conservé le sens étymologique de lieu situé près de la maison, alors que le français a gardé le second sens de bien-être, confort, plaisir (voir l' expression être à l'aise), ainsi que le terme spécifique du droit « aisance de voirie » (droits d'accès des riverains sur la voie publique). Les ances, toujours employé au pluriel, désigne le champ rattaché à une ferme. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| ancharbouillé, mal à l'aise. - (26) |
| anchotte : n. m. Entonnoir. - (53) |
| anchotte, s. f., petit entonnoir de ménage. - (40) |
| anchotte. Petit entonnoir en fer blanc. C'est ce qu'on appelle, à Autun, un aigueriot. - (13) |
| anchouaîs (n’) : anchois - (57) |
| anchoune, adj. qui est tordu, qui a la hanche démise. - (22) |
| anciens : Les vieux, les aïeux. « Neutés anciens » nos aïeux. Dans le langage forestier, le mot Ancien désigne un baliveau de plus de cent ans. - (19) |
| ancin que. conjonct. Tandis que, pendant que, à mesure que. « Ancin qu'on moissonnait, on liait. » (Percey). - (10) |
| anciner, v. a. exciter un chien, le lancer à la poursuite de quelqu'un : le chien s'est « anciné » contre lui. - (08) |
| anc'lle (anc'ill) : Oncle. « Ol est allé voir san an'clle ». Autrefois les enfants appelaient par respect « man an'clle, ma tante », les grandes personnes avec lesquelles ils n'avaient aucun lien de parenté. « Dis banjo à c't'an 'clle» dis bonjour à ce monsieur. Nota : jadis, les jeunes appelaient souvent oncle et tante, le cousin germain ou la cousine germaine de leur père ou de leur mère. - (19) |
| anco, encore. - (38) |
| ancoinçon, sm. écoinçon. - (17) |
| ancor. Encore. Le Bourguignon dit aussi ancore, et se conforme à l’ortographe italienne ancora… - (01) |
| ancre - âpre, trop fort. - Ce vin qui â tro ancre. - Que le frouai â don ancre ajedeu. - AI ai in caractère ben ancre. (Pour le toucher V. aire). - (18) |
| ancre : Acre, acide, mordant « Du lichu treu ancre » de l'eau de lessive trop chargée en potasse. - (19) |
| ancre ; on dit d'un mets qu'il est ancre quand il est trop épicé et qu'il prend à la gorge. Se dit aussi pour tenace, obstiné. - (16) |
| ancre, âcre, opiniâtre, tenace. - (05) |
| ancre, adj. acharné, enragé. - (17) |
| ancre, adj. acre, âpre, aigre, violent, ardent. - (08) |
| ancre, adj. se dit d'un cheval ombrageux et craintif. - (40) |
| ancre, adj., être ancre, se montrer ardent, tenace, persévérant. A aussi le sens de âcre. - (11) |
| ancre, adj., tenace, opiniâtre, têtu ; aigre, violent, âpre : « N'y a pas mo-ïen d’li fâre fâre c’qu’on vout ; ôl êt ancre c'ment eùne mule ». - (14) |
| ancre, pour acre, du latin acer ; quelques personnes disent aincre. - (02) |
| ancre. Opiniâtre, tenace - (03) |
| ancreman, adv. avec âpreté, violemment, ardemment - (08) |
| ancrement : Avec ardeur. « O s'y prend bin ancrement » il s'y met avec bien de l'ardeur. - (19) |
| ancrement, opiniâtrement. - (05) |
| ancrené, ée. adj. Qui est ancré profondément et depuis longtemps. Maladie ancrenée, maladie invétérée, qu'on ne peut plus guérir. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| ancreni, adj., recouvert d'une couche de saleté. - (40) |
| ancreté : Acidité, acreté. « L'ancreté du lichu ». - (19) |
| ancroté ; jeter une bête périe dans un creux et la couvrir de terre. On ancrote aussi l'homme qu'on enterre sans cérémonie religieuse. - (16) |
| and’li : (nm) chenet - (35) |
| andâ : (nm) andain - (35) |
| anda : andain. Tas de foin en ligne, formé par le faucheur. Du latin : «ambitus » : bord. - (62) |
| andâ n.m. Andain. - (63) |
| andain - chenet de feu (outre le sens français de rangée de foin). - Ces andains qui ne sont pâ aissez hauts. - L'andain du poèle â trop lairge. - (18) |
| andain : Jonchée de foin qu'un faucheur couche d'un bout à l'autre du pré à chaque passée, et non pas , comme le dit Littré, l'étendue que le faucheur peut faucher en un pas. - (19) |
| andain : rangée de foin ou de paille déposée sur le sol. - (59) |
| andain : largeur d'une coupe de foin - (39) |
| andain : s. m, signifie tantôt la traînée de foin rejetée sur la gauche du faucheur et qui s'allonge à chaque coup de faux, tantôt la bande de pré ainsi mise a découvert. - (20) |
| andain, espace qu'occupe l'herbe coupée par la faucille... - (02) |
| andain, n. masc. ; le sillon d'herbe tombé sous la faux. - (07) |
| andain, n. masc. ; chenet du foyer. - (07) |
| andain, n.m. chenet. - (65) |
| andain, s. m. chenet, landier. - (08) |
| andain, s. m., largeur d'une coupe de foin. - (40) |
| andain. - Delmasse donne à ce mot deux significations, celle de grand thcnet de cuisine, et celle, dit-il avec Lamonnoye, de l'espace entre les deux jambes écarquillées (écartées).- De ce que l'intervalle entre les grands chenets de cuisine d'autrefois mesure à peu près une enjambée, on les a appelés des andains - (06) |
| andains (mot masculin) : chenets. - (47) |
| andains et andiers. Chenets élevés, appelés, dans certains pays, des Landiers, par la réunion de l'article et du substantif, « Item, deux beaux andiers en la cheminée de ladite chambre, ayant chacun une bocle de fer a (Inventaire dressé, en 1501, à l’Hôtel-Dieu de Beaune). La plupart des andains bourguignons étaient surmontés d'une sorte de corbeille en fer destinée a supporter et à maintenir chaud le creuset de soupe des retardataires. Les andouillers de cerf ont la forme de certains andains. Dans une autre acception, un andain est l’étendue de pré qu'un faucheur coupe à chaque pas. Les Bretons disent : lander. - (13) |
| andaivai, endesver, endever. : (Dial. et pat.), enrager. - (06) |
| andaivai, être très-contrarié d'une chose. - (02) |
| andé : andain. A - B - (41) |
| andè : Landier, chenet « Eune pare de vieux andès » une paire de vieux chenets. - (19) |
| andé : s. m. chenêt. - (21) |
| andée : andain - (51) |
| andée, s. f., espace entre les deux pieds d'un faucheur ; « mener en andée » ; en avançant en ligne droite, entre deux rangs. - (40) |
| andées (des) – régulièrement, pas mal, de temps en temps - Queman que cequi vait métenant ? Mon Dieu, cé vai to des andées. - L'ovraige n'â dière aivancé, ma voiqui qu'â va ailai des andées. - (18) |
| andées (des). Par intervalles, d'une façon intermittente. Etym. la même que celle d'andain (voyez ce mot dans Littre). Des andées veut dire, à proprement, en faisant puis en suspendant l’action d'aller. - (12) |
| andément. De suite, sans désemparer, directement tiré de l'italien andantemente. Andain, ce que le faucheur abat autour de lui en marchant, de l'italien andare. - (03) |
| andés (des), en une fois (bas-latin "andena"). - (38) |
| andèu, chenet. - (16) |
| andier : s. m., vx fr., landier. L’usage a consacré l'agglutination de l'article et du substantif (l'andier), tandis qu'il ne l'a pas admise pour l'évier (le lévier). - (20) |
| andier, landier, chenet. - (05) |
| an-d'lai : Ioc. adv., loc. prép. et n. m. inv. Au-delà. - (53) |
| and'lai, adv.de l., au-delà, de l'autre côté, là-bas : « And'lai l'iâ » (de l'autre côté de l'eau). - (14) |
| andoche (in) - un maladroit, un propre à guère surtout par défaut d'intelligence. - Ma, ne nos aimeune pas cequi ç'â in vrai andoche. - Ote-tai don pôre Andoche que t'é ! - (18) |
| andoille : Andouille. « Eune andoïlle grillie ». Au figuré : personne à l'air naïf et empêtré. « Quelle andoïlle! ». - (19) |
| andormî. Endormir, endormi, endormis. - (01) |
| andouilles (voir Dèpendeux). - (14) |
| andreuzi, v. a. donner de la vigueur, de la « dreuze ». - (22) |
| andruji, v. a. donner de la vigueur, de la « druje ». - (24) |
| and'vë, and'vère ; en comparaison de, tandis que (du latin adversiun). - (16) |
| andzalouze : (nf) javeleuse - (35) |
| ane (faire un). n. m. - Dans un champ, petite bande de terre qui n'a pas été labourée ou fauchée, du fait d'une maladresse du cultivateur ou d'une déviation de la machine sur une grosse pierre. - (42) |
| ane (n. f.) : dans un champ, emplacement non labouré ou non fauché à la suite d'un écart involontaire - (64) |
| anéanti : anéantir - (57) |
| aneçi, v. a. agacer, irriter, pousser à la colère. - (24) |
| anée : Mesure valant 15 doubles décalitres. - (19) |
| anée : s. f., ancienne mesure de capacité pour les grains correspondant à la charge que peut porter un âne, contenant 21 coupes cubées ou mesures « rases « et valant 273 litres 693. A Mâcon, « L’ânée de bled froment pèse 420 livres » Almanach du Mâconnois, 1786, p 131). - (20) |
| Aneire. Village nommé Anières à une lieue de Dijon, fameux par ses grottes, et encore plus par son Université, où il se reçoit plus de docteurs qu'en toute autre. - (01) |
| anemiablement. : (Dial.), hostilement ; adverbe pris au subst. anemi. - (06) |
| anémie : adj., anémique. J'ai été anémie autrefois. - (20) |
| anémique : s. f., anémie. Elle a une anémique. - (20) |
| ânes. s. m. pl. Echasses. Marcher sur des ânes. (Saint-Martin-sur-Oreuse). - (10) |
| aneubllié, v. n. assombrir, surtout par le crépuscule. - (22) |
| aneuilles : Noisettes, fruits du noisetier (Corylus avellana) On dit aussi « aleugnes » de alogne grosse noisette. - (19) |
| aneut, adv., aujourd'hui. - (14) |
| aneute, petit tubercule noir qu'on trouve au pied du latyrus tuberosus, plante de la famille des papilionacées, et qui est comestible. - (27) |
| anfan. Enfant, enfants. Mnanfan, mon enfant. - (01) |
| anfantaigne. Enfantine, enfantines. - (01) |
| anfâr, enfer. - (16) |
| anfar. Enfer, enfers. - (01) |
| anfilleron. Enfilerons, enfileront. Les deux ll d’anfilleron se mouillent. - (01) |
| anfin. Enfin. - (01) |
| anflicutai. : Engrosser. - (06) |
| anflicuterai, engrosser... - (02) |
| anfrâler : (anfrâ:lè - v. trans.) enduire de façon superficielle mais consciencieuse. - (45) |
| angabouèrer : (angabouèrè - v. tr.) enduire de matière et de manière très sale. - (45) |
| angaigé, engager ; s'angaigé, s'engager, prendre du service. - (16) |
| angauche. adj. Qui n'est pas adroit. (Charny, Seignelay). - (10) |
| angaudre. s. m. et f. Qui est empoté, maladroit, peu agissant. - (10) |
| angélus. S. m. Parties gélatineuses, tendons, cartilages impropres à l'alimentation, qui se rencontrent dans les viandes, et que les bouchers trouvent moyen de glisser et de faire payer à leurs pratiques. A Joigny, l'angélus et la réjouissance doivent être exclus des fournitures faites aux pauvres pour le compte du Comité de l'Extinction de la mendicité ; un des articles du cahier des charges et conditions imposées à l'adjudicataire de ces fournitures contient même sur ce point une interdiction spéciale. - (10) |
| anger, v. enger. - (05) |
| angevautreur : (anj’vô:treu:r - subst. f.) chaîne qui, dans une charrue, relie l'age à l'avant-train de rouelles. - (45) |
| angin (similaire de engeance) se dit par mépris à un enfant. - (16) |
| angive, s. m. contrefort de bâtiment. - (08) |
| angiverne. adj. Maladroit. (Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes). - (10) |
| ang'lle : Ongle. « O s'est tapé in cô de martiau su l'ang'lle». Au figuré « Rogni les ang'lles à quéquin » enlever à quelqu'un ses moyens de défense. - (19) |
| angôdrer : (angô:drè - v. tr.) enduire tout ou partie d'une chose, en la salissant moyennement. On dira, par exemple, qu'on angaudr' un mur de briques, quand on y applique un premier enduit auquel on veut qu'adhère un second. - (45) |
| angola, angora ; un chat angola. - (16) |
| angon*, s. m. onguent. - (22) |
| angouaissi - tremanter : angoisser - (57) |
| angouècher (s') : ((s’) angouèché - v. pr.) s'étrangler, s'engouer. - (45) |
| angoulouses : piqûres de serpent. IV, p. 32 - (23) |
| angouyi, v. n. gêner par l'adhérence de la terre mouillée collant à l'outil. - (22) |
| angover (s'), v., s'irriter la gorge avec un morceau d'aliment ; avec une pomme, en parlant des vaches. - (40) |
| angraisse. Engraisse, engraissent. - (01) |
| angraler, n.m. houx. - (65) |
| anguelue. n. f. - Bord d'un récipient ou de tout autre objet : un bidon, un sac, un puits. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| angüier, angüiller : boîter, ne pas être d'aplomb, bancale. - (56) |
| anguigne, s. f., femme de peu de ressource, qui ne sait rien dire ni faire, et même quelque peu idiote : « Ta Mariette ? Laisse-me donc. Y ét eùne jolite anguigne ! ». - (14) |
| anguignônai, causer du désappointement et une vive contrariété à quelqu'un... - (02) |
| anguignonai. : Causer de l'ennui, du désagrément, du guignon. - (06) |
| anguille de buisson, s. f., serpent. - (14) |
| anguillé, e, part. prés. d'un verbe « anguiller » inusité à l'actif : une carpe « anguillée » est celle qui prend la forme d'une anguille. - (08) |
| angûllier : se dit d’une voiture à deux roues, dont le timon se pointe en l’air brusquement, parce que l’arrière a été chargé excessivement - (37) |
| angûyer (s’) : pour une charrette, à deux roues, (se) dresser le timon en l’air - (37) |
| anichon, s. m., petit âne ; au figuré, enfant qui n'apprend rien. - (14) |
| anicroche, s. f., obstacle imprévu. - (40) |
| anille, aneille : s. f., vx.fr. anille, béquille. - (20) |
| animau - (39) |
| animau n.m. 1. Animal. 2. Péj. Individu. - (63) |
| animau : s. m., animal. - (20) |
| animô, au singulier connue au pluriel (prononcer ân-niniô) ; se dit méme à l'homme peu pourvu d'intelligence. - (16) |
| anjaulure. Engelure, engelures. Plusieurs en Bourgogne, croyant bien parler, disent des égelures. - (01) |
| anj'lusse (l') : angélus - (57) |
| anjôlai, flatter quelqu'un pour le tromper... - (02) |
| anjoluce. s. f. Angélus. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| anliens : maladie qui attaque l'oeil du boeuf - (60) |
| anligner, v. a. aligner, mettre en ligne. - (08) |
| anloupiau. s. m. Forme très-fortement dénaturée des mots envelouppiau, enveloppiau, enveloppeau. A Auxerre, à Joigny et presque partout, dans le Département, on appelle anloupiaux, des morceaux de toile servant comme de guêtres, dont les vignerons s'enveloppent les jambes dans les vignes et lorsqu'ils font des ouvrages malpropres, par exemple, lorsqu'ils portent des terres, qu'ils tirent, qu'ils chargent ou répandent du fumier. - (10) |
| anmusé, aumusé, vt. amuser. - (17) |
| anmusöte, sf. amusette. - (17) |
| annaige, s. m. bête ovine d'un an qu'on appelle prime dans le langage technique. - (08) |
| Anne (nom propre) : Anne, Annette. Prononcez : An-ne, An-nette, l'An-ne Marie. - (19) |
| Anne, Anne (prononcer ân-ne). - (16) |
| annë, année (prononcer ân-në). - (16) |
| an-née (n’) - an-nia (n') : année - (57) |
| an'née : année - (48) |
| an-née : année. - (52) |
| année : Année. Prononcez : an-née « L'année que vint » : année prochaine. - (19) |
| ânnée : une année - c'tânnée : cette année - l'ânnée qu'vint : l'an prochain -l'ânnée passée : l'an dernier - (46) |
| añnée n.f. Année. - (63) |
| an-née : (an:-né: - subst. f.) année ; l'an:-né: qu'vin:, l'année prochaine. - (45) |
| an-née : n. f. Année. - (53) |
| an-née, année. - (38) |
| annemaîn. Ennemi, ennemis. - (01) |
| annemi, e, adj. ennemi. On prononce an-n'mi. - (08) |
| an-nerser : (an:nêrsè - v. trans.) stimuler, exciter (au travail). Le mot s’emploie également pour les abeilles excitées par une intrusion, ou pour un chien qu’on excite. Pour le feu on dira qu’il s’est an:nersè ou s’est envâ:lè quand il devient trop vif. - (45) |
| anneu, s. m. ennui, langueur, tristesse, chagrin, embarras. On prononce an-neu. - (08) |
| anneumitié, s. f. inimitié, haine. - (08) |
| anneùyé, annuè, ennuyé (prononcer (ân-neuyè, an-nuè). - (16) |
| annille, petit agneau ; du latin agnellus. - (02) |
| annimau (qu'on prononce han-ni-mau). s. m. Animal. Dans beaucoup de localités, on dit annimal, au pluriel un annimau, des annimals. - (10) |
| an'nimau : animal - (48) |
| annimau : Animal. Prononcez an-nimau. « Chèque (chaque) annimau a san instinct ». Injure : « espace d'annimau ! ». - (19) |
| annimau, s. m. animal : « l'poure an-nimau ô péri », le pauvre animal est mort. - (08) |
| an-nimau, s. m., animal : « V'tu ben te côger ! Côge-te donc, fichu an-nimau ! » - (14) |
| annimau. n. m. - Animal : se prononce han-ni-mau. - (42) |
| annioussè (s'): s'étouffer, s'étrangler - (46) |
| anniové : gorgé d'eau, ce mot s'emploie pour qualifier une terre - (46) |
| an-n'mi, s. m. et adj., ennemi. - (14) |
| an-n'miquié, s. f., inimitié. - (14) |
| anno, adv. non. Dans le Morvan nivernais «ainn'no » le premier n est une épenthèse d'euphonie. On redouble l'interjection dans la locution « oh qu' ann' nô! » oh que non. - (08) |
| an-n'O, an-n'A - non (style familier). – Vosé é étai fâre lai commission ?... An-n'O., i n'ai pâ aivu le temps (prononcer anne-no). - (18) |
| annô, en haut (prononcer an-no). Ce même mot, prononcé de la même manière, s'emploie, de plus, pour désigner le service anniversaire que l'on fait célébrer pour l'âme d'un défunt. - (16) |
| annonci : annoncer - (57) |
| annorser (s'), v., s'égosiller en toussant. - (40) |
| an-nossé, qui a avalé un os. - (26) |
| annote ou arnotte. Racine comestible du lathyrus bulbosus. Au figuré fruit médiocre ou trop petit. - (12) |
| annotte. n. f. - Jeune fille, adolescente. (Marchais-Beton, selon M. Jossier) - (42) |
| annotte. s. f. Jeune fille. - (10) |
| an-nouèj' : (subst. f.) : brebis d'un an ; par extension, jeune fille candide ou peu dégourdie. - (45) |
| annublir : v. a., vx fr., couvrir d'un nuage, obscurcir, faire ombrage. - (20) |
| annuiter (s'), v. pronom. S'attarder à la nuit, rentrer de nuit. Ou dit aussi s'anuiter. - (10) |
| anœllye, s. f. béquille (du vieux français annille). - (24) |
| anœllye, s. f. béquille. - (22) |
| anoious. : (Dial.), fâcheux, désagréable. –Le substantif anoi, d'où cet adjectif dérive, signifie ennui. - (06) |
| anon ! pour allons ! interjection par laquelle on excite une personne a faire une chose. - (16) |
| anorser (s’) : s'étrangler en buvant ou en mangeant. (RDM. T IV) - B - (25) |
| anosse (nom féminin) : anesse. - (47) |
| anosse, s. f. anesse. - (08) |
| anote. Sorte de bulbe que ceux qui croient bien parler nomment arnote, mot que les Bourguignons ont emprunté des Flamands, lorsque les uns et les autres avaient un même souverain… - (01) |
| anotte : boule de poils chez un animal - (46) |
| anpigé, embarrasser. Anpige, entrave ; un homme qui gène, au travail, est un anpige. - (16) |
| anpiyé, empiler, par exemple, des paisseaux qu'on a sortis de terre. - (16) |
| anpoiché, empêcher ; anpoîch'man, empêchement. - (16) |
| anpoigne, poignée d'un objet, anpoigné, prendre, saisir une personne ou une chose, de manière à la bien tenir. È s'à fè anpoigné se dit d'un malfaiteur arrêté par la justice. - (16) |
| anpoi'zné, empoisonner. - (16) |
| anpor. Pour, pour le prix, en échange. - (01) |
| anpôtré, embarrassé par un obstacle. - (16) |
| anpoussö, sm. embarras, manières pour se donner de l'importance. - (17) |
| anpremi (à l'), loc. au début, en premier lieu : à l'anpremi il était plus courageux. - (24) |
| anpremi (à l'), loc. au début, en premier lieu : A l'anpremi il était plus courageux. - (22) |
| anprès : auprès, près de. - (52) |
| anprès, adv., après, et aussi : près, auprès. - (14) |
| anprês, prép. près, auprès. - (08) |
| anprôté, emprunter une chose. - (16) |
| anquié, e, adj. repu, gorgé, saoulé. « i seu anquié », je suis rassasié à l'excès. - (08) |
| anquieume : (an:kieum’ - subst. f.) enclume. - (45) |
| anraige. Enrage, enrages, enragent. - (01) |
| anroté, ce qui est ralenti ou arrêté dans sa marche par la boue et les mauvais chemins. - En Champagne on dit anhotté. La première de ces locutions semble venir du latin rota, roue de voiture. - (02) |
| anrôte. Engagé dans une ornière, car c'est proprement lorsque la roue d'une voiture est engagée dans une ornière, qu'on dit en bourguignon , qu’on at anrôtai , mot qui semble venir d’inrotare, à moins qu'on n'aime mieux le faire venir de route, parce qu'être enrôtai , c'est être arrêté sur la route par quelque difficulté du chemin ; mais comme alors c'est toujours quelque roue qui est arrêtée, je m'en tiens à la première étymologie. - (01) |
| anroué, enroulé, placé autour d'une roue... - (02) |
| anroué. : Enroulé. Du latin in rotatum. - (06) |
| ansaiché, ensacher. - (16) |
| ansain : voir ensein. - (20) |
| ansanne. Ensemble. Les plus anciens poètes français disaient ensement, qui a quelque chose de l'italien insiememente. - (01) |
| anscouai - faire verser ou décharger une voiture par derrière. - Ne chairgez pâ tant darré, cé anscouro. - An fauré anscouai de faiçon ai ne pas embaraisser le chemin. - (18) |
| anscuiller, renverser un tombereau et son contenu. - (27) |
| anseau : champ se prenant en friches - (39) |
| anselé, adj., défraichi, fané. - (40) |
| anselure, s. f., tache de moisissure. - (40) |
| ansère : Sorte de bretelle en osier tressée qui soutient la hotte. « Eune ansère d'heutte ». - (19) |
| ansin que. Dans le temps que. Ainsi que pour lorsque, dans le moment que, a vieilli en français, mais en bourguignon ansin que est très élégant dans cette signification. - (01) |
| ansin, adj. ainsi. - (17) |
| ansin. Ainsi. Nos poêles du règne de Charles FX, écrivaient ainsin, pour éviter dans leurs vers le choc de quelque voyelle… - (01) |
| ansin. : Ainsi, de même que. - Ansin sô ti, ainsi soit-il ; ansin que, lorsque. - (06) |
| ansorsalé, ensorceler, jeter un sort à quelqu'un. Beaucoup de gens croient encore à l'ensorcelage. - (16) |
| ansôvé ; s'ansôvé, fuir au plus vite, pour éviter d'être arrêté. - (16) |
| anssire*, s. f. anse en osier d'une hotte. - (22) |
| anstain que. conjonct. En même temps que, aussitôt que, au moment que. Ansiain qu'on entre cheux eux, i faut dire bonjour. (Pasilly). - (10) |
| ant ou an - temps du verbe avoir et du verbe être. (V. An). - (18) |
| antaler, somnoler. - (38) |
| antan (de pire qu' ou de peiqu') - de plus en plus mal, de pis en pis. - I ne sais pâ, ma les aiffâres ailant de pire qu'antan. - De pei qu'autan, ça in peu refrain - (18) |
| antan. L'an passé, du latin ante annum. De là ç’a pei qu'antan, pour dire c'est pis que l’an passé, pis que jamais. Antan est aussi entens, et entend du verbe entendre. - (01) |
| antan. : Ce mot abrégé du latin ante annum, signifie l'année avant celle où l'on est, c'est-à-dire l'année passée. - (06) |
| antandan. Entendant. - (01) |
| antande. Entende, entendent. - (01) |
| antandé. Entendez. - (01) |
| antandein. Entendions, entendiez, entendaient. - (01) |
| antandren. Entendrons, entendront. - (01) |
| antarrée. Enterrée, enterrées. - (01) |
| anté, faire une ante, c'est-à-dire, une greffe. Anté se dit aussi pour entier, dans cette locution : teut anté, tout entier. - (16) |
| antei. Entier, entières. - (01) |
| anteire. Entière, entières. - (01) |
| antion (t dur), sm. femme lourde, gauche, bêtasse. - (17) |
| antiquaille. n. f. - Antiquité. - (42) |
| antireûille (n’) : antirouille - (57) |
| antissé, faire des tisses, des amas de gerbes de blé, de foin, etc. - (16) |
| antodvillai. : Attacher, envelopper, faire un tout de diverses parties ou effets mobiliers. - (06) |
| antômé, entamer ; antômé une miche de pain ; antômé se dit encore adjectivement d'une partie du corps qu'une plaie a déchirée. - (16) |
| Antone. Antoine, nom propre. C'est aussi le singulier des trois personnes du verbe antonai , entonner, au présent de l’indicatif. - (01) |
| antonerð. Entonnerais, entonnerait. - (01) |
| antoni. Entonnai, entonnas, entonna. - (01) |
| antoûnoie. s. f, Sansonnet, oiseau. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| antraille. Entrailles. - (01) |
| antraipai. : Embarrassé dans un trou, dans une trape. (M Del.) - (06) |
| antre. J'entre, tu entres, il entre, ils entrent. Cest aussi la préposition entre. Pour antre dans la signification du latin, antrumj ou du grec …., ce n'est pas un mot qui soit employé en bourguignon. - (01) |
| antremé, antremi, au milieu de... - (16) |
| antrèpe, sf. propre à rien, fainéant. - (17) |
| antres, jantes de roue. - (05) |
| antri. Entrai, entras, entra. - (01) |
| antyan, malhabile. - (26) |
| anubier, v. n. assombrir, surtout par le crépuscule. - (24) |
| anuiter (S') : v. r., vx fr., se loger pour la nuit. - Faudrait pourtant que j' trouve un endroit pour m'anuiter. - (20) |
| anv : avec - (51) |
| anvairimai. Envenimer, envenimé, envenimez. Voyez vairin. - (01) |
| anvairimé, envenimé. - (02) |
| anvairimé. - Corrompu. Cette expression est formée du mot patois vérin, qui signifie corruption engendrée par les vers. - (06) |
| anvâlé, enflammé. On dit d'un feu qu'il est envâlé quand il commence à flamber. - (16) |
| anvâler (s') : ((s’) an:vâlè - v. pron.) 1- se ranimer brusquement (en parlant du feu), s'embraser d'un coup. 2- s'emporter, entrer dans une colère subite. - (45) |
| anvë, envers ; anvëkhe, tandis que.,. - (16) |
| anvec : voir danvec - (23) |
| anvelôpe. Enveloppe, substantif féminin… - (01) |
| anvermé : (an:vêrmè - part.passé pris comme adj.) plein de vers. - (45) |
| anvi. Involontairement, contre son gré, malgré soi, avec répugnance. On a écrit en vieux français envis et envi du latin invitus… - (01) |
| anvi. : Involontairement (du latin invitus). - (06) |
| anvié. Envoyer, envoyé, envoyez. - (01) |
| anviot - reptile qui se casse facilement, et dont on dit en proverbe : Lai serpent bon onguent, ma l'anviot le cro. C'est l'orvet. - (18) |
| anviot. Petit serpent que l’on appelle aussi Orvet, et qui a donné son nom à la combe d'Orvau, près de Gevrey. Un préjugé populaire veut qu'il soit aveugle, comme la taupe, et de plus très venimeux; c'est une double erreur. - (13) |
| anvo : voir borgne - (23) |
| anvô. : Cornet à bouquin, désigné ainsi à cause de la forme de serpent de cet instrument d'église. (Del.) - (06) |
| anvoin, oingne, adj. agressif, acariâtre, grognon. - (17) |
| anvoin. Opiniâtre, obstiné… - (01) |
| anvoin. : Obstiné, têtu, opiniâtre. - (06) |
| anvöt, sm. orvet. - (17) |
| anvyé, envoyer ; anvie-le ; envoie-le. - (16) |
| anvyou, anvyouse, envieux, envieuse. - (16) |
| an-yâ : lien terminé par une cheville dont on se sert en Bresse pour lier le joug au timon. - (21) |
| aoi : avoir - (43) |
| aoi le tsicot : avoir le hoquet - (43) |
| aoi sa : avoir soif - (43) |
| aoi son : avoir sommeil - (43) |
| aoire. : (Dial.) , accroître, augmenter. – Dérivation du latin attgere. -Le part. passé est avoit (auctns). - (06) |
| aot, s.m. manche du fléau. - (38) |
| aot. Août. - (49) |
| aou, s.m. couenne, oint. - (38) |
| aoû: (nm) août - (35) |
| A-oût : Août. « Le mois d’A-oût ». - (19) |
| aoûter, s.m. bois de vigne de l'année qui est mûr en août. - (38) |
| apaîcher, apêcher, apancher, apincher. v. a. Epancher, jeter çà et là, éparpiller. Apaîcher, apincher du fumier. Sans doute pour épancher. (Puysaie). - (10) |
| apaïer, apaiser. - (04) |
| apâïer, v. a. apaiser, calmer, tranquilliser. - (08) |
| apaisanter. : Le dialecte employait ce mot, qui est devenu, en français, apaiser - (06) |
| apaise: (nf) tranquillité - (35) |
| apan*, s. m. appentis - (22) |
| apan, adv. en bloc, en masse, tout ensemble, sans choix. - (08) |
| apan, m. appentis. - (24) |
| apanchî (n. m.) : ensemble d'objets répandus, épars sur le sol - (64) |
| apanchou : fourche. (F. T IV) - S&L - (25) |
| apandre : Atteindre. « Y est treu haut je peux pas y apandre » ; c'est trop haut, je ne peux pas l'atteindre. - (19) |
| apané, v. a. rationner. - (22) |
| apaner, v. a. rationner de nourriture par économie ou pour remédier à la gourmandise. - (24) |
| apanteau. n. m. - Épouvantail. - (42) |
| apanteau. S. m. Épouvantail. Du verbe apanter, syncope d'épouvanter. - (10) |
| apanter. v. a. Faire peur, effrayer, épouvanter. Voyez apanteau. - (10) |
| aparmenmes. : (Dial.), à l'instant. M. Burgny fait dériver cette locution des mots ad per metipsissimum (tempus). - (06) |
| aparmer. v. - Épargner. - (42) |
| aparne. n. f. - Épart, pièce de bois servant à maintenir l'écart entre les limons d'une charrette. (Sainpuits, selon M. Jossier) - (42) |
| aparne. s. f. Épart, traverse qui tient les limons épars. (Sainpuits). - (10) |
| aparnir. v. n. Éclairer, faire des éclairs. Nous allons avoir de l'orage, il aparnit. - (10) |
| apatties. n. f. pl. - Filasse grossière laissée par le peignage du chanvre. - (42) |
| apatties. s. f. pl. Filasse grossière provenant du pied, de la patte du chanvre. (Villeneuve-les-Genêts). - (10) |
| apattis. s. m. pl. Empreintes de pas, glissades. De patte. - (10) |
| âpaule (n.f.) : épaule - (50) |
| apché, ée. adj. Eclos. C'est une altération du mot ébeché, qui se dit de l'œuf becqué, brisé sous l'effort du bec du petit poulet qui vient d'en sortir. - (10) |
| apcher, abcher. v. - Éclore ; se dit d'un œuf.qui est brisé par le bec du poussin. - (42) |
| apcherou abcher : éclore - (60) |
| apchieou abchie : nourriture des petits oiseaux - (60) |
| ape - ap' : et - (57) |
| ape - pis – api : et puis - (57) |
| ape - pis : puis - (57) |
| apeger : v. a., agripper. Voir Peger. Un apege-toid, qui agrippe tout. - (20) |
| apégner (v. tr.) : briser l'extrémité d'une douelle d'un fût au ras du fond (apégner un fût ou une tine) - (64) |
| apendis : appentis - (61) |
| apenser (S’) : v. r., vx fr., penser. « Je m'apense bian que deman et après deman i s'ra tuje la même chuse. (Je pense bien que demain et après-demain ce sera toujours la même chose ). » (Le Pt’eu, p. 391). - (20) |
| apensi (s') Penser. - (63) |
| apenter (s') (v. pr.) : s'inquiéter, s'affoler - (64) |
| apenter (v. tr.) : causer une vive inquiétude - (64) |
| apentiot (n. m.) : épouvantail - (64) |
| apentisse, appentis. - (26) |
| apercevouair : apercevoir - (57) |
| apercevu p.p. Aperçu. - (63) |
| apercevu : part, pass., aperçu. - (20) |
| âperiau : fruit du sorbier - (37) |
| apeu, a peu conj. Et (et puis). - (63) |
| apeu, adv., et puis, ensuite. - (40) |
| âpeûne (aine) : (une) épine - (37) |
| âpeune (n.f.) : épine - (50) |
| apeurvégi : apprivoisé. A - B - (41) |
| apeuter. v. - Faire peur. - (42) |
| apfèces, s. m. pl., latrines en planches au-dessus d'une fosse à purin pailleux (happe-fesses ?). - (40) |
| apfice, s. m, fumier emmené aux champs. - (40) |
| âpi (n.m.) : épi - (50) |
| api : s. m., vx fr. aplat, céleri. - (20) |
| âpiâler, dâpiâler : enlever la peau d’un animal - (37) |
| apianer, v. a. caresser du plat de la main. - (24) |
| apianter, v. a., rendre pointu un morceau de bois ou de fer. - (11) |
| apiayie : bourrelet de terre versé par la charrue - (51) |
| apidancer (v. tr.) : nourrir - (64) |
| apidancer : voir pidancer. - (20) |
| apié : atteler les bœufs. Par extension, commencé un travail. A - B - (41) |
| apié, v. a. rejoindre en pressant le pas. - (22) |
| apiée, s. f. attelage. Verbe apiéyer, atteler. - (24) |
| apièilleu : s. f. demi-journée de travail. - (21) |
| apieilleure : attelage de bœufs. A - B - (41) |
| apieilli : travail fait dans un demie ou une journée complète sans dételer les bœufs. A - B - (41) |
| apieilli : v. atteler. - (21) |
| apier : v. a., rejoindre à la marche, rattraper, atteindre. - (20) |
| apier, v. a. rejoindre en pressant le pas : je t'aurai bientôt apié. - (24) |
| apièyée, s. f. séance de travail : on a fait une bonne apièyée ce matin. - (24) |
| apignauder v. 1. Gâter (un enfant). 2. Cajoler, consoler. - (63) |
| apincher, epincher. v. - Éparpiller, épandre le fumier dans les champs. - (42) |
| apin'ye (n.f.) : épingle (peut être aussi écrit apin-ye) - (50) |
| apion, n.m. enfant polisson. - (65) |
| âpion, subst. masculin : garnement. - (54) |
| apionner (s') : se regarnir en herbe en parlant d'une prairie - (51) |
| apionner : endroit où l'herbe pousse - (43) |
| apitance, épitance. n. f. - Nourriture. Lorsqu'un patron employait un journalier, en plus du salaire, il devait le loger et lui donner l'apitance, excepté le pain qui restait toujours à la charge du journalier. (Mézilles, selon H. Chéry) - (42) |
| apitancer. v. - Donner l'apitance. - (42) |
| apîter (s') : se préoccuper, s'apitoyer. - (09) |
| apla : s. f. lien terminé par une cheville, avec lequel on attelle les bœufs. - (21) |
| aplaner, aplanier : v. a., vx fr., aplanir ; caresser de la main. - (20) |
| aplater : aplatir - (61) |
| aplater, apléter. v. n. Aller vite; fournir beaucoup. Voyez épléler. - (10) |
| apléter : avancer à l'ouvrage. (P. T IV) - Y - (25) |
| apléter : travailler vite - (60) |
| apleyer : v. a., vx fr. aplegier, garantir, précautionner. - (20) |
| apliati : Aplatir, tomber à plat. « Je me su-t-apliati su la glièche » : je suis tombé à plat sur la glace. - (19) |
| aplliané, v. a. caresser du plat de la main. - (22) |
| aplomb (d') loc. De niveau, droit, bien réalisé. - (63) |
| aplouner, aplonner (s'). v. - Se tenir droit, se mettre d'aplomb : « Aploune-toi don', te vas avouère mal au dous ! » - (42) |
| apogne (n.f.) : petite brioche aux grattons (aussi petit pain) - (50) |
| âpogne : petit « reste » de pâte à pain, que l’on met à cuire sur le devant du four, destiné aux enfants (on dit aussi : « chaûboulon ») - (37) |
| apogne : petit pain. (BY. T IV) - S&L - (25) |
| apogne : voir épogne - (23) |
| apoier et appoier. : (Dial. et pat.), appuyer. Du bas latin appodiare. (Duc.). - (06) |
| apoigne : soir épogne - (23) |
| apoincer (v.t.) : épancher ; écarter le fumier - (50) |
| apointer, v. épointer (des piquets apointés). - (65) |
| apointi v. Tailler en pointe, épointer. - (63) |
| apointi, v. a. rendre pointu. - (22) |
| apointion n.m. Objet taillé en pointe ou de forme pointue. - (63) |
| apointucher (v. tr.) : tailler en pointe (syn. affichoter, affioûler) - (64) |
| apointucher : tailler en pointe, rendre pointu ou, en adjectif : apointuché = pointu. Ex : Si j’veux qu’mon pôô il enterre ben, faut qu’il soué bén’apointuché. (Si je veux que mon poteau entre bien (en terre), il faut…). - (58) |
| apointyi, v. a. rendre pointu. - (24) |
| apoité. adj. - Fruit trop mûr, blet. - (42) |
| aponde v. (du lat. ad et ponere, poser vers) 1. Atteindre, attraper. 2. Accourir. - (63) |
| apondre : atteindre, attraper - (43) |
| apondre, v. a. attacher avec un nœud. Atteindre en s'allongeant. - (24) |
| apondre, v. tr., atteindre : « Aide-me donc. Mon bras n’é p’assez long : j’peux pas apondre à la fenêtre ». - (14) |
| apondre, v. tr., joindre, attacher, allonger : J'ai apondu eun bout à ma ficelle ». (Voir Rapondre et Aponser). - (14) |
| apondre, v., atteindre de justesse, avec peine. - (40) |
| apondre. - Voir : ràpondre. - (15) |
| apondre. Atteindre, en étendant le bras. - (49) |
| aponse, s. f., allonge d'une étoffe, d'un panneau, etc. : « C'te jupe é trop courte ; aile a besoin d'eùne aponse ». — « Faut mettre eùne aponse au bas d’ta porte ». - (14) |
| aponser, v. tr., allonger à l'aide d'une pièce, d'un morceau, etc. Montr., apponser. (V. Apondre, Raponser). - (14) |
| aponsse, f. nœud, raccord à une corde, à un fil allongés. - (24) |
| aponsse, s. f. nœud, raccord à une corde, à un fil allongés. Verbe apondre. - (22) |
| aporiau, apriau. s. m. Ypréau. - (10) |
| aport, s. m., assemblée, fête de village, où l'on boit, où l'on mange, où l'on danse. Les aports sont, comme les veillées et sur une plus grande échelle encore, des motifs à rapprochements entre garçons et filles, et il est peu de ces fêtes qui n'amènent quelque mariage. - (14) |
| âpos (adj. m.) : épais (au fém., âposse) - (50) |
| âpôs : épais - (37) |
| apostume, v. postume. - (05) |
| apotager : bien traiter, bien s'occuper de... Ex : "Ce gamin là, il est ben apotagé, t'entends ben !" - (58) |
| apotagi (être mal), loc. être défavorisé. - (24) |
| apôtre, s. m., péjoratif, pour parler d'un absent. - (40) |
| apotre, s. m., usité en accolement à l'adj. bon. Ainsi, dire d'un gas : « Y ét ein boun apôtre », équivaut à dire : c'est un bon garçon. - (14) |
| apôtre. En Bourgogne et particulièrement dans le Châtillonnais on traite familièrement de bon apôtre un enfant vif et égrillard. Or, dans ce sens, ce mot aurait une analogie directe avec celui de l'idiome breton paôtr, garçon. (Le Gon.) Bon apôtre signifierait donc tout simplement bon garçon. - (02) |
| apouaquer (v.t.) : écrabouiller, écraser - (50) |
| âpoudrîller, âpoutrâiller : répandre, disperser, semer à tous vents - (37) |
| apouéssi, v. a. apaiser. - (22) |
| apouéssi, v. a. apaiser: petite pluie apouésse grand vent. - (24) |
| apougne : voir épogne - (23) |
| apoussonner. v. - Retirer les pousses, les bourgeons. - (42) |
| apoutaji (être mal), loc. être défavorisé. - (22) |
| âpoutir : écraser - (37) |
| apoutir, époutir (Br., Chal.,Char.), époutir, époitir, épouter (Y.). - Ce mot exprime l'action d'aplatir en écrasant ; racine : aplatir ou épater. - (15) |
| apoutir, époutir. Écraser, aplatir par compression. - (49) |
| appalandrer. v. - Se laisser tomber, s'étaler, sur une chaise, dans l'herbe. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| appaler - ch’per : appeler - (57) |
| apparaissance. s. f. Apparence. - (10) |
| appareil (n’) : faucheuse (équipée pour les moissons) - (57) |
| appareilli : appareiller - (57) |
| apparier : (vb) égaliser - (35) |
| apparier : égaliser - (43) |
| apparier v. Mettre en paire. - (63) |
| appeler : appuyer - (57) |
| appendis, petit bâtiment adjoint. - (05) |
| appendu. s. ln. Morceau d'étoffe rapporte et cousu sur le trou d'un vêtement. - (10) |
| appenter : appréhender - (61) |
| appétit ou app'tit : Appétit. « Ol est d'in greux appétit » : c'est un gros mangeur. - (19) |
| appeurvégi : apprivoisé - (34) |
| appeurvéji v. Apprivoiser. - (63) |
| appeûyer : appuyer - (43) |
| appié : atteler les bœufs, par extension commencer un travail - (34) |
| appieileure : attelage de bœufs - (34) |
| appieilli : travail fait dans une demie ou une journée sans dételer les bœufs - (34) |
| appiéyée : attelée, quantité de travail qu'on fournit avec un attelage dans une demi-journée - (43) |
| appiniauder, appiniaucher : caresser, flatter. - (30) |
| appion : gosse dégourdi, curieux. - (30) |
| applèï, applèïer. Atteler les bœufs deux à deux pour le travail. Le contraire est « dèplèïer ». - (49) |
| appléiée, séance de travail. J'ons fait l’ôvraige dans deux appléiées. Ce mot vient peut-être du bas-latin apellidum qui était une sorte d'impôt seigneurial. Une charte de 1267, citée par Ducange, mentionne : collectam, monetam, apellidum, fossadum, etc. On pourrait encore rapprocher appléiée de plôyeie, qui est un terme de tisseur. La plôyeie est la quantité d'étoffe que l'ouvrier fait tout d'une fois. Dans ce cas il faudrait dire lai pléiée et non l’appléiée. On connaît l'importance des anciennes manufactures de draps établies à Beaune. - (13) |
| appleuter, applater. v. - Travailler avec rapidité, fournir beaucoup de travail : « Tâchez seulement d'appleuter plus que ça, que vos ouvrages soient prêts. » (Colette, Claudine à l'école, p.I38) - (42) |
| appleyée, attelage de chevaux à une charrue. - (27) |
| appli : s. m., vx fr. aploit, harnais, harnachement et, par extension, matériel de culture. - (20) |
| applia (nom commun) : Temps pendant lequel un attelage est au travail (est attelé). « J'ai fais in ban applia s'tu métin ». - (19) |
| applia (verbe) : Mettre les bœufs sous le joug, les lier ensemble ; on dit aussi d'un cultivateur qui possède un bon attelage : « Ol est bien applia ». - (19) |
| applia, s. m. attelage. Verbe appliàyé, atteler. - (22) |
| appliée de charrue, durée d'un labour. - (05) |
| applier, applayer : vx fr. aploitier, atteler harnacher, appareiller, apparier, assortir. - (20) |
| applier, mettre les bœufs au joug. - (05) |
| applier. Mettre les bœufs sous le joug. On appelle appliée le labour que peuvent faire deux bœufs sans quitter la charrue. - (03) |
| appoiger. v. n. Éclabousser, éclater. (Saint-Sauveur). - (10) |
| appointi : (vb) tailler en pointe - (35) |
| appointi : tailler en pointe - (43) |
| appointuser : v. a., appointer, appointir. - (20) |
| appointuser, épointir. Épointer, appointir. - (49) |
| appondre : (vb) atteindre, attraper, accourir - (35) |
| appondre : atteindre avec la main - (34) |
| appondre, allonger, attacher. - (05) |
| appondre, apondre : v. a., vx fr., atteindre, arriver à ; ajouter, allonger. Ces poires sont trop haut, je peux pas les appondre. — I s'a sauvé, mais je l'ai appondu tout de même. - (20) |
| apponse, aponse : voir rapponse, raponse. - (20) |
| apponser, allonger avec une pièce. - (05) |
| apport (nom masculin) : fête de village. - (47) |
| apport : fête où on louait les ouvriers agricoles (louée) - (60) |
| apport, affluence de pèlerins. - (04) |
| apport, Fête de village que les Normands appellent une assemblée ; les Picards une ducasse ; les Bretons un pardon ; et les Flamands une kermesse. J’irons ai l’apport de Parmand minger du guétiâ. - (13) |
| apporter (s') : venir - (51) |
| appouger (S'), v. pronom. Se poser, se percher, et, certains cas, s'accroupir. Un oiseau s'appouge. Une petite fille s'appouge aussi, quand tournant sur elle-même pour développer l'ampleur de ses jupes, elle se baisse tout d'un coup de manière à leur faire former la cloche. (Puysaie). - (10) |
| appouger (s'). v.- Se percher : les poules s'appougent pour dormir. - (42) |
| apprende v. Apprendre. - (63) |
| apprentisse : s. f., vx fr., apprentie. - (20) |
| appresser. : (Dial.), comprimer. Du latin vulgaire ad pressare. - (06) |
| apprêter (s') : S'apprêter, se préparer, s'habiller. « I te faut dan bin du temps pa t'apprôter ? ». - (19) |
| appréter (s') S'habiller, se changer. - (63) |
| appreuchi : Approcher. « Si les côtaines en voulant qu'i s'appreuchint » si les côtés en veulent, qu'ils s'approchent. Remarque ironique que l'on fait, lorsqu'en balayant, une ménagère laisse de la poussière dans les coins. - (19) |
| appreutsi (approtsi) : approcher - (51) |
| appreutsi v. Approcher. - (63) |
| apprevési : apprivoiser - (43) |
| appre-yondi : donner de la profondeur - (43) |
| appriandi : Appronfondir, rendre plus profond. « Ol a fait appriandi san poui (puits) », de « priand », profond en patois. - (19) |
| apprindre : apprendre - (43) |
| approchi : approcher - (57) |
| approfondi : approfondir - (57) |
| appropir v. Nettoyer, rendre propre. - (63) |
| appropir. Nettoyer, rendre propre. - (49) |
| approprir, v., nettoyer, rendre propre. - (40) |
| approprir, verbe transitif : nettoyer, rendre propre. - (54) |
| approsse ou approusse, très-grande hâte ; du latin ad proximum. - (02) |
| approsse ou aprousse. : (Dial.), du latin ad proximum, hâte, empressement. - (06) |
| approter (s'). S'apprêter. S'endimancher. - (49) |
| approtsi (appreutsi) : approcher - (51) |
| approusse (d'une) : vite, nerveusement. (LF. T IV) (RDF. T III) - A - (25) |
| appuer (verbe) voir chauchi : Appuyer. « Appûe dans pas si feu (fort) ». - (19) |
| appuer : v. a., appuyer. - (20) |
| appuser : v. a., vx fr. aposer, poser. - (20) |
| appuyer sur : loc. jouer d'un instrument de musique à touches. - (20) |
| appyéyée : (nf) attelée, quantité de travail fournie avec un attelage - (35) |
| appyéyer: (vb) commencer, démarrer - (35) |
| aprailli v. Semer en herbe, mettre en pré. - (63) |
| aprë, pour a et dans ; lai kyë al âprë lai pôte, la clé est à ou dans la porte, c'est-à-dire, dans la serrure. Aprë, aiprë se dit aussi pour l'adverbe derrière, comme dans : monter aiprë lai voèture ; monter derrière la voiture. - (16) |
| aprentisse, s. f., apprentie, au fig., personne inexpérimentée. - (14) |
| aprés - ape - pis : ensuite - (57) |
| aprés (d') adv. Après. - (63) |
| après : (adv) en train de « ol é après tiri les vatses » : il est en train de traire les vaches - (35) |
| après : a) Après, en train de. « Alle est après fare sa chausse » elle est en train de tricoter un bas - b) Sur, « Y a de la borbe (boue) après ta culotte (sur ta culotte) ». - c) A ses trousses, « Les chiens se sant mis après liune (lui) ». - d) Dans, « La clé est après la sarreure (serrure) ». - (19) |
| aprés : après - (57) |
| aprés adv. En train de. - (63) |
| aprés prép. 1. Sur le dos de quelqu'un. 2. Contre. 3. à. Le chtit grimpe aprés eun âbre. 4. Sur. La clé est aprés la pôrte. - (63) |
| après : prép., à. Grimper après un arbre. La clef est après la porte. — En train de. Etre après s'habiller. - (20) |
| aprés, adv., le long de, à : « m'a dévoré toutes ses culottes en gravichant aprés les murs vou ben aprés les âbres ». — « T'as lassé la clé aprés la porte ». — « Qu’é c’que t’as donc tôjor aprés moi? » - (14) |
| après, loc, prép., en train de : « T'vas l’trouver au bouchau du carre ; ôl ét aprés boire ». — En français, ces deux derniers mots signifieraient que le biberon a fini de boire ; chez nous, au contraire, ils disent qu'il est en train- de boire. - (14) |
| après, prép. placé devant un verbe signifie « en train de » : être après écrire ; il est après vendanger. - (24) |
| après, prép. placé devant un verbe signifie « en train de » : être après écrire ; il est après vendanger. - (22) |
| aprés-d'main : après-demain - (57) |
| aprés-midi (n) - tantoû (on) - saîrnia (na) : après-midi - (57) |
| apreyer : v, a., vx fr. aprayer, mettre en pré (une terre). - (20) |
| âprîvier : épervier - (37) |
| apropir. v. - Nettoyer, rendre propre. - (42) |
| aprousse ou approusse. Ce mot est intraduisible littéralement, il n'a pas d'équivalent en français. II exprime la rapidité et correspondrait au sens de l'adverbe précipitamment, mais avec l’idée de quelque chose de plus vif. II ne s'emploie d'ailleurs qu'avec les mots qui indiquent un départ, une fuite. Ex. : « Quand il a vu qu'on allait chanter, il s'est sauvé d'une aprousse !....» Etym. ex-abrupto (?) ou ad proximum (?) - (12) |
| aprousse. Hâte, ardeur, empressement. Aprousse vient de l'ancien mot apresse, dit pour âpreté, et qui se trouve dans Nicot. - (01) |
| apuceter. v. - Épuceter. Au figuré : houspiller, secouer les puces. - (42) |
| apuceter. v. a. Épuceter, chercher les puces. - Au figure, apuceter quelqu'un, lui dire des ventes un peu dures autrement, lui secouer ses puces, suivant le mot usité à Auxerre. - (10) |
| apyati v. Aplatir. - (63) |
| apyencer (s') : se dit d'une personne qui conserve dans sa bouche un mets, qui lui plaît, par gourmandise. (MLV. T III) - A - (25) |
| apyiélleure n.f. Attelage (de bœufs). - (63) |
| apyiélli v. Atteler les bœufs. - (63) |
| apyiéllie n.f. Temps de travail à plusieurs sans interruption. - (63) |
| apyier v. (du lat. ad plicare, plier sous le joug). Atteler les bœufs, commencer un travail. - (63) |
| âqieûser : écluser, boire beaucoup - (37) |
| âquâipoutir : écraser complètement - (37) |
| aquan : voir danvec - (23) |
| aquand, adv., quand, à quelle époque, surtout pour interroger ; « On t'attend cheù nous ; à quand veindras-tu ? » - (14) |
| aque, s. f. acte : une « aque » de mariage. Le notaire a fait « l'aque. » - (08) |
| âqûelle : écuelle - (37) |
| aqueni, équeni. adj. Qui n'a que la peau et les os, qui est sans force, épuisé, réduit à rien. Du verbe aqueniter, venant lui-même de nihil. Quand les vignerons d’Auxerre sont abattus, extenués par la chaleur, ils disent qu'ils sont équenis. - (10) |
| aquerciau. n. m. - Enfant très maigre, chétif, n'ayant que la peau sur les os. - (42) |
| aquerciau. s. m. Petit enfant maigre, qui n'a que la peau et les os. (Ferreuse). - (10) |
| aquerciot : petit- menu - maigre (mais pas maladif). Ex : "Eh ! aquerciot" (l'interpellé doit se reconnaître) "C'te gamine, c'est un vrai aquerciot !" - (58) |
| aqueriâ. Mot sans correspondant dans le français ; il faut une périphrase pour le traduire ; un naqueriâ est le produit obtenu quand on se mouche ; par extension, gros crachat. Etym. niaque. - (12) |
| aquernot. s. m. Coffre, tiroir (Perreuse). Doit être une corruption de créneau. - (10) |
| aquerselle (n. f.) : se dit d'une personne extrêmement maigre et chétive (syn. aquersiot) - (64) |
| aquersiot (n. m.) : se dit d'une personne extrêmement maigre et chétive (syn. aquerselle - c'est un chtit aquersiot) - (64) |
| aquetouflé (adjectif) : ramassé sur soi-même. - (47) |
| aqueûbi : rendu niais, abruti, interdit (celt. akoubet : rester interdit). - (32) |
| âqueûç’er : enlever les cuisses d’un animal - (37) |
| âqueûç’ie : écartement, endroit où une unique branche d’arbre se divise en deux, en ressemblant à un « y » - (37) |
| aqueudre, v. tr., exciter le bétail à marcher (Mervans). - (14) |
| aqueudre. Pousser le bétail, participe aqueuillo, du latin aculeus, aiguillon pour activer les bœufs. - (03) |
| âqueûlé, aiqueûlé : effondré, abattu, plié en deux - (37) |
| âqueûlée, aiqueûlée : pluie intense, averse - (37) |
| aqueuler (s'), v. pr., s'accroupir, s'asseoir sur ses talons. On prend fréquemment chez nous cette posture familière, pour s'approcher du feu, caresser un enfant, etc. - (14) |
| aqueuler (s'), v., « poser son cul » sur les talons. - (40) |
| aqueûler : renverser un tombereau - (43) |
| aqueuler, v. a. accroupir, asseoir très bas sur les genoux ployés. - (08) |
| aqueurguégi : personne rabougrie, repliée sur elle-même. A - B - (41) |
| aqueurguégi : personne rabougrie repliée sur elle même - (34) |
| aqueûrie : écurie - (37) |
| âqueûriot : écureuil - (37) |
| âqueûrpoté : accroupi - (37) |
| aqueurpoter (s') (v.pr.) : s'accroupir - (50) |
| aqueurpoter (s'), aqueurpouter (s’), verbe pronominal : s'accroupir. - (54) |
| aqueurvisse (n.f.) : écrevisse - (50) |
| âqueûter (s’), âcoûter (s’) : (s’) exagérer l’importance d’une maladie bénigne - (37) |
| aqueuter : écouter - (43) |
| aqueûter. v. -Équeuter : « On va aqueûter les c'ries. » - (42) |
| aquia: attelage immobilisé. - (33) |
| aquiairer : éclairer, faire des éclairs, dans le ciel, la nuit - (37) |
| âquiaits d’bouais : éclats de bois - (37) |
| aquiapi (adjectif) : brisé, fatigué outre mesure. (Voir acapi). - (47) |
| âquiâré : éclairé - (37) |
| aquiger : v. a., disputer, attraper, enlever (au sens argotique), T’ vas t’ faire aquiger ! - (20) |
| aqu'ner : bégayer - (43) |
| âquouaûder : couper la queue - (37) |
| aquouériau. n. m. -Écureuil. (Mézilles, selon H. Chéry) - (42) |
| ar (n.f.) : air - (50) |
| ar : air - (37) |
| âr : Air. « An ne vit pas de l'âr du temps. Quand an craiche en l'âr y vos cheut sur le nez » : quand on crache en l'air, cela vous tombe sur le nez. - (19) |
| ar, loc. être en ar, être en disposition, en velléité de « al étô en ar d'ailer en viaige », il était disposé à aller en voyage. - (08) |
| ar, s. air. - (38) |
| ar, s. f., air « I m' leùve de grand maitin, por aller prend'e la boun âr ». Mais une euphonie naturelle fait dire air si l'on veut parler de « l'air fraîche ». - (14) |
| ar. Air, dans toutes ses significations. C'est aussi arc, l'un et l'autre tant au pluriel qu'au singulier. - (01) |
| ar. s. m. Air, dans toutes ses acceptions. « I crache en l'ar pou qu'ça l'i retombe su le bê. » - (10) |
| arable, arabe. n. m. - Érable. - (42) |
| aradzi v. Avoir envie de, enrager, désirer violemment. - (63) |
| arager. v. - Enrager, mettre en colère : « T'as-ti fini d'jai'e arager l'chien ! » On employait aragier pour exaspérer, mettre en colère, depuis le XIIe siècle. - (42) |
| arâgne, irâgne n.f. Araignée. - (63) |
| aragne. Araignée. - (49) |
| aragnée, s. f., araignée. Dans les villes, comme dans les campagnes, on entend couramment employer ce proverbe : Aragnée du maitin, Y é du chagrin ; Aràgnée du soir, Y é d' l'espoir. - (14) |
| aragnelle : s'utilise uniquement dans l'expression : « maigre comme des pattes d'aragnelle » - (39) |
| aragner (s'). v. pronom. Se harceler. - (10) |
| arâgner : stimuler de la voix, du bâton ou de l'aiguillon. Cf. ancien français arener, éreinter, briser les reins. - (52) |
| arâgner, v. a. exciter, stimuler les animaux de trait, les bœufs, les vaches. On laboure d'autant plus de terrain en un jour qu'on « arâgne » davantage ses bêtes. - (08) |
| aragner. Voyez érragner. - (10) |
| arâgnoîre n.f. Tête de loup. Femme longue et maigre. - (63) |
| araignant, honnête, civil. Il faut chercher la racine de ce mot dans l'idiome breton, où éré, éréa et, par abus, éren, signifient lier, attacher. - (02) |
| araigne. : Ornement proscrit pour certaines conditions par l'édit somptuaire de 1580 rendu à Dijon. - (06) |
| araigner : v. a., enlever les araignées. - (20) |
| araignie : araignée. IV, p. 29 - (23) |
| araignoir, araignoire : s. m. et f., tête-de-loup. Pour désigner une femme longue et maigre, on dit volontiers : « Une grande araignoire. » - (20) |
| araire : Charrue simple, sans avant train (chargeou). « An ne pourrai pas labourer les tarres de Manci d'ave eune araire ». En français, araire est masculin. - (19) |
| araire, s. f., charrue sans avant-train, à soc triangulaire garni de deux ailes. - (14) |
| araler (v. tr.) : érafler, écorcher (araler des feuilles (effeuiller les branches d'un arbre) – l'diable m'arale ! (juron)) - (64) |
| araler : balayer feuilles ou graines d'un revers de main, élaguer - (60) |
| araler : élaguer. - (09) |
| araler : élaguer, abattre. Ex : "Va fallouée qu’jaralint nout’ châgne." - (58) |
| araler. v. - Couper les nouvelles pousses d'une branche. - (42) |
| araler. v. a. Enlever, détacher les raies, émonder, ébrancher. – Se dit aussi en parlant de l'épiderme, et, dans ce cas, il est synonyme d’érafler. J'me suis aralé toute la piau des mains. - (10) |
| araloué. n. m. - Fouloir en bois à trois dents utilisées pour éraler leraisin, avant de le porter au pressoir. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| aramer (s’), érêmer (s') (v.pr.) : se dit du soleil lorsqu'il disparaît à l'horizon, c.-à d. qu'il disparaît derrière "les rames" : les branches des arbres - se coucher pour le soleil - (50) |
| aramer : s'aramer : se prendre dans des branches. III, p. 44-n - (23) |
| arâmer, v. n. entrer dans les rameaux, dans les branches d'un arbre. On prononce en quelques lieux « airaimer ». - (08) |
| aramis et alramis. - Autorisé par justice. Charte d'affranchissement de la ville de Seurre, 1278. - (06) |
| arandale*, s. f. hirondelle. - (22) |
| arandon. Espace de terrain inculte entre les sillons pour pouvoir retourner la charrue. - (03) |
| arâpé, part. pass. d'un verbe « araper » inusité à l'infinitif dans ce sens. Avide, ladre, passionné pour ses intérêts. - (08) |
| arâper (s'), v. réfl. se prendre à... se mettre vivement à... un bon ouvrier « s'arâpe » à son ouvrage; il s'est « arâpé » à sa vigne. - (08) |
| araper. v. n. et s’araper. v. pronom. S'accrocher, se mettre à l'ouvrage fortement par opposition à déraper, quitter le fond, se décrocher. (Sermizelles). - (10) |
| araquer, v. a. accrocher. - (08) |
| araude. n. f. - Chénopode blanc, épinard sauvage ; cette plante était autrefois cultivée comme légume. (Saints, selon G. Pimoulle) - (42) |
| araÿ, adv., arriè (fonctionne comme renforcement d'une phrase négative). - (40) |
| arbanderie : groupe de mauvaises personnes. A - B - (41) |
| arbanderie : troupe de mauvais personnage - (34) |
| arbannâh : almanach - (37) |
| arbayer : v. n., briller, reluire, éclairer, refléter. C'est-i toi qu'as ciré, tes grolles qu'elles arbayent tant ? — J'ai vu arbayer quéqu' chose ? Y est-i une élide ? - (20) |
| arbàyer, v. n. apparaître partiellement : il a arbayé un instant. - (24) |
| arbe aux couchons, f. : renouée. (M. T IV) - Y - (25) |
| arbe aux vers, f. : tanaisie. (M. T IV) - Y - (25) |
| arbe, herbe. - (26) |
| arbe, s. f., herbe. - (40) |
| arbe, sf. herbe. - (17) |
| arbelaite. Arbalète. - (01) |
| arbelet : s. m., vx fr. arbetest, arbalète. - (20) |
| arbelète : Jouet d'enfant ayant la forme d'une arbalète. - (19) |
| arbépin : Aubépine. Mespilus oxyachanta. « Eune boucheure d'arbépin » : une haie d'aubépine. Bourguignon, aibopin. - (19) |
| arbépin : s. m . aubépine. - (21) |
| arbépin, s. m. aubépine. - (24) |
| arbes grasses, f. : laiteron, épervière. (M. T IV) - Y - (25) |
| arbeu : clématite sauvage (botanique) - (51) |
| arbeuiller (verbe) : fouiller en faisant de grands désordres. (On dit aussi r'beuiller). - (47) |
| arbeuiller : fouiller - (60) |
| arbeuille-vertiot : couteau pointu, fouineur, curieux - (60) |
| arbillot. n. m. – Ardillon : pointe de métal faisant partie d'une boucle, et qui s'engage dans un trou de ceinture ou de courroie. - (42) |
| arbillot. s. m. Ardillon. - (10) |
| arbiquer (verbe) : qui rebique, qui dépasse, en parlant d'un vêtement mal ajusté. - (47) |
| arblanchir : se changer - s'habiller de vêtements propres. Ex : "Avant d'aller au bourg, té vas tout' même t'arblanchi !" - (58) |
| arboit : Se dit d'une pioche : si le manche fait un angle trop aigu avec la pioche elle-même, elle arboit trop. Si cet angle est trop obtus, elle n'arboit pas assez « S'te pieuche arboit treu ». - (19) |
| arboler, v. n. désherber (du vieux français herbeler). - (24) |
| arböre, sf. [herbière]. terme de boucherie : tube de l'œsophage. - (17) |
| arbot : Cytise, Cytisnon laburnum. « In fagueut (fagot) d'arbot ». - (19) |
| arboub (à l’), loc, au rebours. - (14) |
| arboulé, v. n. désherber. - (22) |
| arbranchir (s'). v. - S'habiller. (Arquian) - (42) |
| arbre : voir pressoir. - (20) |
| arbrousser (verbe) : rebrousser son chemin. - (47) |
| arc a balle (are à bâle) : s. m., arbalète dont le projectile est une balle, de la grosseur d'une noix, en terre grasse desséchée. C'est plutôt un jouet qu'une arme. Vers 1870, le principal fabricant d'arcs à balle, dans le pays, était un sieur Genetier, de Ponianevaux. Dans la même région, au milieu du XIXe siècle, on donnait encore a l'arc à balle les noms d’arbelet et d'arcagelet. - (20) |
| arc. n. m. - Petit râteau en fer. - (42) |
| arc. s. m. Herse, râteau. (Puysaie). - A Domecy-sur-le-Vault, on dit acc, dans le même sens. - (10) |
| arcainge. Archange, archanges. - (01) |
| arçan : Brin de bois flexible dont on se sert pour faire les paniers. - (19) |
| arcancié. Arc-en-ciel. - (01) |
| arcandage (n. m.) : action d'arcander, travail peu sérieux ou de faible rapport - (64) |
| arcandage. s. m. Mauvais équipage; ouvrage difficile, désagréable, qu'on ne sait par où commencer. - (10) |
| arcander (v. int.) : aller et venir, perdre son temps à des futilités (syn. berlaiser, beûtiller) - (64) |
| arcander : bricoler, (arcander quelqu'un : se jouer de lui) - (60) |
| arcander, arcanyer. v. - Travailler dans de mauvaises conditions, avec difficulté, souvent pour un piètre résultat. - (42) |
| arcander, v. n. Travailler sans suite et sans ordre à toutes sortes d'ouvrages, suivant le caprice du moment, et quelquefois sans objet ou sans résultat utile ; se donner beaucoup de peine pour rien. - (10) |
| arcanderie (nom féminin) : comportement ou manœuvre qui est plus ou moins empreint de malhonnête. - (47) |
| arcanderie : nom donné à ce qui est gênant ou importun - (60) |
| arcanderie n.f. Groupe de malfaiteurs, bande de jeunes oisifs. - (63) |
| arcandie, arcanderie. n. f. - Souci, ennui. Avoir des arcandies : avoir des ennuis, des complications. Se dit également, par comparaison en parlant d'un vieil objet sans valeur, bon à jeter. - (42) |
| arcandié, arcandjié. n.m. - Personne maladroite, compliquée, manquant d'imagination et d'organisation dans son travail. - (42) |
| arcandié, s. m. coureur de grands chemins, vagabond. - (08) |
| arcandier (n.m.) : vagabond ; personne peu recommandable - (50) |
| arcandier (nom masculin) : personne en qui on ne peut avoir confiance, personne malhonnête. - (47) |
| arcandier (un) : mauvais ouvrier - (61) |
| arcandier : âpre au gain (personne) - (43) |
| arcandier : aventurier. - (30) |
| arcandier : homme en qui on ne peut guère avoir confiance, sur qui on ne peut compter. - (52) |
| arcandier : personne âpre au gain - (35) |
| arcandier : vagabond, vaurien, celui qui se fatigue pour ne rien faire, malhonnête - (60) |
| arcandier : homme sans profession ou qualification bien définie, touche à tout. - (33) |
| arcandier n.m. Aventurier, malfaiteur, arnaqueur, jeune désœuvré. - (63) |
| arcandier : n. m. Homme sans profession ou qualification bien définie, un touche à tout. - (53) |
| arcandier, m. : mauvais ouvrier. (M. T IV) - Y - (25) |
| arcandier, subst. masculin : mauvais ouvrier. - (54) |
| arcandier. s. m. Celui qui prétend savoir tout faire, qui travaille en effet sans suite à toutes sortes d'ouvrages et ne fait jamais rien de bien. - (10) |
| arcandies. s. f. pl. Embarras, difficultés ; par allusion, sans doute, à la situation gênée dans laquelle se trouvent souvent les arcandiers. - (10) |
| arcangelet, arcagelet, arc a jalet : s. m., arbalète dont le projectile est une balle de terre durcie ou un caillou. - (20) |
| arcan-yer (n. m.) : personne qui aime arcander (syn. amusard) - (64) |
| arc-à-plomb, subst. masculin ou féminin : fronde, lance-pierre. - (54) |
| arcdeveillon : crochet de bout de chaine avec une ouverture facile composée d’une lamelle souple - (51) |
| arce (n.f.) : grand coffre où l'on pétrissait la pâte à pain - (50) |
| arce, f. : herse. (M. T IV) - Y - (25) |
| arceillier. n. m. - Bon à rien, gauche, qui exécute mal son travail : « l' m’faudra pren' des ouvriers qui n'feront que de m'en promettre, qu'travail'ront coumm' des arceil1iers. » (Fernand Clas, p.l88) - (42) |
| arcelet, arcelot. s. Petit cercle de métal mis autour d'un sabot fêlé ou casse pour le consolider. - (10) |
| arcelier, arceiller, arseiller, s. m. Voyez harcelier. - (10) |
| arcelot, m. : petit cercle de fer pour consolider le dessus d'un sabot. (M. T IV) - Y - (25) |
| arcelot. n. m. - Cercle de métal ou fil de fer servant à consolider un sabot fêlé. - (42) |
| arcer, archer. v. - Herser. - (42) |
| archalle,"fil d'archal" posé sur le dessus d'une porte. - (38) |
| arche : herse. On pourrait écrire : harche . - (62) |
| arche : huche à pain. IV, p. 37-8 - (23) |
| arche : maie - (61) |
| arche : coffre à abattant, avec ou sans tiroir au-dessous, servant de garde-manger ou de laitages. Ex : "Argad' don dans l'arche, na encor' ène fercielle dé froumage." - (58) |
| arché, adj., mal fait, mal exécuté. - (40) |
| arche, airche. s. f. Coffre, huche au pain, maie. Du latin arca. – Se dit, dans plusieurs localités, pour herse, et quelquefois pour râteau. - (10) |
| arche, s. f. grand coffre en bois, avec dossier. - (40) |
| arche, s. f. mait, coffre où l'on pétrit le pain. Le Morvandeau nivernais dit indifféremment mait ou arche, prononcé « airce. » - (08) |
| arche. : Coffre (latin arca), 1366. - (06) |
| arche-banc : banc-coffre. - (32) |
| archelot, s. m., baguette de vigne rabattue et rattachée au « siot » avec une « rôte ». - (40) |
| archelot, s.m. sarment de vigne lié en couronne ; on taille et lie le pinot en archelots ; le gamay se taille en billons. - (38) |
| archer, v., mal faire son travail. - (40) |
| archer. v. a. Herser. - (10) |
| archet à bourrique : loc, fouet dent la forme rappelle un archet de violon lorsqu'il est tenu à la fois par le manche et la corde pour frapper. Quand on frappe avec la corde flottante, le fouet devient « l'éventail à bourrique ». - (20) |
| archet : s. m., rameau de vigne, dont l'extrémité, qui vient d'être taillée, est recourbée et fichée dans le sol aux fins de provignage. - (20) |
| archigner (s') : faire la grimace - montrer de la mauvaise humeur - rire. (Quand le rire impatiente l'autre). - (58) |
| archigner (verbe) : rechigner. Montrer les dents. - (47) |
| archigneute : Ers, ervum gracile Gesse Tuberense. Genre de légumineuse voisine des vesces qui croît dans les blés. - (19) |
| archiment : adv., excessivement, superlativement. - (20) |
| archlot - (39) |
| archlot : armature d'un panier - (48) |
| archot : Archet, chassis en arceau que l'on place sur le berceau des enfants (Littré). « Fi d'archot » : fil d'archal. « Archot de pi », long bois que l'on laisse sur le cep en le taillant et dont on enfonce l'extrémité en terre, ce qui forme un arceau. - (19) |
| arciau. s. m. Herminette; en général, instrument tranchant. Se dit sans doute pour asciau, qu'on trouve dans Jaubert et qui dérive du latin ascia. - (10) |
| arcier (un) : un frelon - (61) |
| arcier : frelon. Appelé aussi Lombard, ou Gourlon-Lombard. - (58) |
| arcier. n. m. - Frelon. (Puisaye nivernaise, selon F.P. Chapat) - (42) |
| arç'lot : n. m. Support de panier en osier. - (53) |
| ar'commencer, v. tr., recommencer. L’a préfixe, qui paraît d'abord singulier dans ce mot, peut s'expliquer bien naturellement. Supposons cette phrase : « C'est mauvais ; c'est à recommencer ». On voit sans difficulté comment l'oreille populaire a perçu la chose et rattaché le a en vedette à son verbe. - (14) |
| arçon : s. m., vx fr., toute chose courbée en arc, notamment l'arceau qui, à la tête du berceau ou greut, portait un linge destiné à protéger l'enfant contre l'air, les mouches, etc. - (20) |
| arcöte, sf. petit râteau de fer pour le jardinage. - (17) |
| arcoté, vt. râtisser. - (17) |
| arcotte : piochot ou petite pioche : véritable nom français : serfouette. - (66) |
| arcôve : Alcôve. « San lit est dans l'arcôve ». - (19) |
| arculer (s') ou arqueuler (s'), verbe pronominal : se reculer. - (54) |
| ardailli v. (de hardi). Activer. - (63) |
| arde : branches servant à retenir ce que l'on met dans un chariot - (60) |
| arde : perche qui s'introduisait dans la vis de bois des anciens pressoirs actionnée par plusieurs hommes de façon à effectuer le pressurage. - (30) |
| ardeluche : mésange «dame liche » (anc. fr. larderele). - (30) |
| ardent, erdent (pour Redent). s. m. Ressaut qui se rencontre quelquefois dans les pièces de charpente. - (10) |
| ardentcher, ardentier, aglantier, églantchier. n. m. - Églantier. - (42) |
| arderanche, s. f. mésange (du vieux français larderele). - (24) |
| ardevelle : arqué - (44) |
| ardevelle : adj. En désordre. - (53) |
| ardevillon (Brionnais) : petite pièce de bois qui sert à cheviller deux pièces de menuiserie. - (30) |
| ardevion : ardillon. A - B - (41) |
| ardevion : ardillon - (43) |
| ardevllon n.m. (d'ardillon) Bouton, cheville de chaîne. - (63) |
| ardez, impér. d'un verbe fictif « arder » pour regarder. - (08) |
| ardezelle, ardelle, ardrelle. n. f. - Enfant chétif, malingre. - (42) |
| ardez-lu : regardez-le. - (09) |
| ardillant. adj. Brûlant. Du latin ardere. - (10) |
| ardillat. s - m. Terrain argileux. - (10) |
| ardille (n.f.) : argile - (50) |
| ardille, f. : argile. (M. T IV) - Y - (25) |
| ardille, s. f. argile, terre grasse et fraîche. - (08) |
| ardille. S. f. Argile. - (10) |
| ardiller (s'). v. - Se redresser avec fierté. (Arquian) - (42) |
| ardillère, s. f. terrain argileux. Les ardillères, grande prairie près de Saulieu. - (08) |
| ardilleu, ardillou, adj. argileux, qui est de la nature de l'argile. Au féminin euse et ouse. - (08) |
| ardilleux, euse. adj. Argileux. Sol ardilleux. Terre ardilleuse. - (10) |
| ardis : s. m., vx fr. ardeis, feu follet. - (20) |
| ardouaîse (n') : ardoise - (57) |
| ardouèze : ardoise - (39) |
| ardouneux : mauvais joueur qui reprend ses billes. - (32) |
| ardouteux : méfiant. - (32) |
| arduelle, aruelle. n. f. - Espace entre le lit et l'armoire, ou le lit et le mur. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| ardzent n.f. Argent. - (63) |
| aré : aussi (en B : ari) ; syn. eto*. A - (41) |
| are ! : (interjection (à un animal) en arrière ! - (35) |
| aré : encore, certes, en effet. Souligne la contrariété : « Vla t’y pas, aré, qui câsse ». Viendrait de «à regret » ou du latin « ad retro » - (62) |
| aré : Encore. « Y est aré né » : c'est encore nuit. « Te v'la aré » : te voilà encore ! - (19) |
| are, arié, adv. explétif. éh mais ! Pourtant. Que dites-vous ? - (17) |
| aré, arré et arriez, terme de désappointement et répondant, de plus, au mot encore. - (02) |
| aré, aussi - (36) |
| are. n. m. - Air. - (42) |
| arégi : calmer, revenir à la normale. A - B - (41) |
| areine, s. f. arène, granit en décomposition, lequel forme un sable à gros grains. - (08) |
| areiner, v. a. couvrir avec le gros sable appelé « areine ». On areine un chemin neuf, une allée de jardin, etc. - (08) |
| areiner. v. a. Ereinter. De a privat. et de reins. - (10) |
| areinné. adj. - Épuisé, exténué. (Sougères-en-Puisaye). Emprunt direct à l'ancien français du XIIe siècle esréner, dérivé de rein, et signifiant rompu de fatigue, éreinté. - (42) |
| areire. Arrière. - (01) |
| areji : v. arracher. - (21) |
| arenalaille : voir renalaille. - (20) |
| arène, sable. - (04) |
| arengs (cori lé-z-), loc, courir les harengs. Promenade - procession locale des plus piquantes, faite le mercredi des Cendres, et où jadis se mêlait une grande partie de la population. Tous les acteurs, une chemise de femme par dessus leurs habits, à la main une ligne à pêcher, au fil de laquelle pendait le poisson symbole de carême, couraient les rues, psalmodiant : « Un n'âreng ! deux z'arengs ! trois z'arengs ! » - (14) |
| arére : s. m. ancienne charrue en bois. - (21) |
| aréte (n') : courtillière - (57) |
| aréte de bû n.f. Bugrane. - (63) |
| aréte n.f. Barbe de l'épi. - (63) |
| areûillé. adj. -Éveillé, vif, intelligent en parlant d'un enfant. - (42) |
| areûiller (s') (v. pr.) : écarquiller les yeux, regarder avec insistance et curiosité (syn. s'abarbouler) - (64) |
| areuiller (s') : ouvrir de grands yeux. Par excès : s'émerveiller, être ébloui. Ex : "T'as-t-y vu coume y s'areuille ton gamin !" - (58) |
| areuiller (verbe) : avoir des difficultés pour voir. - (47) |
| areuiller(s') : ouvrir de grands yeux, se réveiller - (60) |
| areuiller, arroeiller (s'). v. - S'étonner, écarquiller démesurément les yeux à la vue de quelque chose d'insolite : « Qui est-ce qui va venir ici aujourd'hui ? Ils vont m'arroei11er, tous ces gens. Si je m'en allais ? » (Colette, Claudine à Paris, p.211) Ce verbe réunit deux mots de l'ancien français : d'une part, aoeillier, dérivé de oeil, signifiant éblouir les yeux, et d'autre part roeil1er, de rota-roue et oeil, signifiant rouler en parlant des yeux. - (42) |
| areuti : étiolé. - (09) |
| areuti. adj. - Abruti, idiot : « Aga-lu s't'areuti d'chien, i' mange d'la marde ! » - (42) |
| arfion : ergot, ongle - (60) |
| arfions (nom masculin) : doigts de pieds. On dit aussi arpions. - (47) |
| argadou (à la) ! loc. exclam., de nos mariniers, réplique à l'appel : à la civadou ! - (14) |
| argarder (verbe) : regarder. - (47) |
| ar'garder, v. tr.. regarder. (Voir Ar'commencer pour l’a préfixe). - (14) |
| argarder, verbe transitif : regarder. - (54) |
| argarder. Regarder. On dit aussi « ergarder ». - (49) |
| argarder. v. - Regarder. Ce verbe correspond exactement à l'usage de l'ancien français du Moyen Âge, puis du français de la Renaissance. Agarder était alors un dérivé de garder : prendre soin, surveiller. Le patois a renforcé agarder en argarder, et le français en regarder. - (42) |
| argée : après. - (09) |
| argiler : pousser des cris - (60) |
| argipe : piège à oiseaux. VI, p. 3-7 - (23) |
| argiper : sursauter - (60) |
| argiper : voir erziper - (23) |
| arglantier. s. m. Églantier. - (10) |
| argnelle : roue de l'avant-train d'une charrue - (60) |
| argo, ongle de boeuf, de porc, etc. ; se dit aussi d'un langage incompris. - (16) |
| argogné : personne courageuse, entreprenante. A - B - (41) |
| argogné : personne courageuse, entreprenante - (34) |
| argogné : se dit de la terre qui se travaille mal, du temps qui n'est pas bon. (T. T IV) - S&L - (25) |
| argogné adj. (v. fr. argogner : faire un travail difficile ou ennuyeux). Courageux, entreprenant. - (63) |
| argôgner : v, a., faire de mauvais travail. A rapprocher de regôgner. - (20) |
| argogner, v. tr., faire un travail difficile, ou ennuyeux. - (14) |
| argognier : mauvais travailleur. - (62) |
| argognier : personne courageuse, entreprenante - (43) |
| argôgnier : s. m., ouvrier maladroit, gâcheur de besogne. A rapprocher de regôgneur. - (20) |
| argola : houx. - (30) |
| argolet, argolat (n.m.) : houx (Morvan-sud) - (50) |
| argolet, s. m. houx. Ce mot était très usité dans le Morvan nivernais. Les bâtons « d'argolet » jouaient autrefois un rôle fort actif dans les foires et les apports de la contrée - (08) |
| argolet. s. m., houx. - (14) |
| argolette. Chétif, frêle, de peu de valeur, tiré du vieux mot argoulet. - (03) |
| argonié : courageux - (44) |
| argoniè : quelqu'un qui bâcle son travail, on dit aussi borcheilloux ou bousillou - (46) |
| argonié, celui qui travaille mal. - (16) |
| argonié, qui est de mauvaise foi, qui ne tient pas sa parole dans les marchés, les conventions. - (27) |
| argonié, s. m., mauvais ouvrier. - (14) |
| argònier (C.-d.), argogner (Br.). – Chercher dispute, se chamailler. Voir : Ragonier. - (15) |
| argonier : homme qui cherche noise. (RDV. T III) - A - (25) |
| argonier ou argogner. Arguer pris dans un sens violent, chercher chicane, ou dire de mauvaises raisons. Etym. argutare. - (12) |
| argonier : n. m. Escroc, filou. - (53) |
| argonier, s. m., sujet peu recommandable. - (40) |
| argonier, sm. chercheur de querelles. - (17) |
| argonier. Homme de mauvaise foi. En patois dijonnais, arguigne est synonyme de chicane. - (13) |
| argonner. Verbe et substantif qui signifient travailler mal et mauvais ouvrier. - (03) |
| argonnier (n’) : roublard - (57) |
| argonnier ou argognier. Celui qui argogne. - (12) |
| argonnier, n.m. mauvais travailleur. - (65) |
| argonnier, subst. masculin : mauvais ouvrier. - (54) |
| argonnier. Charretier qui faisait autrefois de longs charrois ; aujourd'hui, désigne plutôt le charretier qui charrie les arbres de la forêt. Désigne encore un mauvais charretier. Fig. Rusé, malin, peu consciencieux, dont il faut se défier. - (49) |
| argot : ergot - (48) |
| argot : sabot de vache - (43) |
| argot n.m. Ergot du coq ou du chien. - (63) |
| argot. Ergot. - (49) |
| argoté. Hardi, malin, effronté. - (49) |
| argouin, s. m., ergot de coq. - (40) |
| argoula, s. m. ne désigne pas seulement le houx, mais aussi le genêt épineux, genista anglica de Linné. - (11) |
| argoulat, ergoulet. Houx. - (49) |
| argoulet, s. m., porteur d'ergot ; gendarme à cheval. - (40) |
| argousin, s. m., gendarme à pied ou gabelou. - (40) |
| argousin. n. m. - Gamin terrible. (Sougères-en-Puisaye). Ce mot résulte curieusement de plusieurs influences ; argousin : surveillant de galère, employé au XVIe siècle, et qui serait une déformation de l'espagnol alguazil, garde civil, ou de l'italien algozzino. Au XXe siècle, on a employé argousin pour désigner le surveillant des forçats dans un bagne, puis de manière péjorative, un mauvais policier. L'argousin poyaudin, riche d'une telle ascendance, doit être une petite terreur ! - (42) |
| argout, argot. n. m. - Ergot. Se dit familièrement pour les ongles des pieds : « T'as les argots aussi longs ! Faudra p't'ête ben t'les couper ! » - (42) |
| argout, hargout. s. m. Ergot. Se dit familièrement, et souvent par ironie, des ongles de l'homme. En v'Ià des hargouts d'une longueur ! Pourquoi qu'tu n'les coupes pas ? - (10) |
| arguignè : taquiner, exciter (un chien par ex.) - (46) |
| arguigné, exciter, provoquer, taquiner. - D'après Lacombe, le vieux mot français aguigner signifie faire signe des yeux. - (02) |
| arguigne, sf. contrariété, vexation. - (17) |
| arguigné, vt. contrarier, vexer. - (17) |
| arguigné. : Piquer, agacer quelqu'un. – Aux Fourgs, en Franche-Comté, on dit arguenai, expression que M. Tissot fait dériver de l'allemand (voir son Glossaire des Fourgs) ; j'y verrais plutôt l'influence du latin arguere. - (06) |
| arguigner : faire enrager. (REP T IV) - D - (25) |
| arguigner : exciter. - (32) |
| arguigner, exciter un animal. - (28) |
| arguigner, exciter, un chien par exemple. - (27) |
| ari : aussi, mot également utilisé pour appuyer une idée : y fait ari bié bon. - (51) |
| ari, adv. aussi. - (22) |
| ari, adv. aussi. - (24) |
| ari, arimé: (adv) aussi - (35) |
| ari, éto : aussi - (43) |
| aria : mauvais outil, machine en mauvais état. A - B - (41) |
| aria (n.m.) : embarras, aléas - (50) |
| aria : aléa. - (32) |
| aria : attelage ou véhicule - (51) |
| âriâ : ennui, contrariété - (48) |
| aria : machine en mauvais état - (44) |
| aria n.m. (mot fr.) 1. Mauvais outil. 2. Contrariété, ennui, difficulté. - (63) |
| aria, désordre qui occasionne des difficultés pour exécuter un travail. - (27) |
| aria, embarras, importance inutile. - (05) |
| aria, s. m., embarras, difficulté, obstacle. Ex. : quel aria ! que d'arias ! - (11) |
| aria. Objet sans valeur, encombrant. - (49) |
| aria. s. m. Mot d'origine espagnole, qui, au Chili, signifie Convoi de mules. - Se dit, dans l'Yonne, par similitude sans doute, pour grand attirail, grand train, besogne incessante, difficile, exigeant beaucoup d'attention et de surveillance. Les vendanges donnent ben de l'aria. I gna ben de l'aria dans ç'te maison-là. - (10) |
| aria. voir haria. - (20) |
| arias et arié. Voyez Harias et Harié. - (13) |
| arias : (âryâ: - subst. m. pl.) embarras, contrariétés. - (45) |
| arias, obstacles, tracas. - (02) |
| arias. n. m. pl. - Désigne des ennuis, de la misère : « On a eu ben des arias aveuc le fré ! » Ce mot couramment employé en Puisaye, et toujours au pluriel, était encore usité en français dans la première partie du XXe siècle. - (42) |
| ariau (nom féminin) : araire. Charrue. - (47) |
| ariba, s.m. charançon. - (38) |
| aricandier : hargneux, querelleur, difficile en affaires. (RDV. T III) - A - (25) |
| arichal (fil d'). s. m., fil d'archal. - (14) |
| aridelles : brancards d'un chariot - (60) |
| arie - l'aire d'une grange, le grain à battre qui est dessus. - Al â choué du fenau su l'ârie. - Entre l'ârie et le fliais. - (18) |
| arié ! loc. expl. A le sens de mécontentement, d'ennui, d’étonnement, d'impatience : « V’là-t-i pas, arié ! qu'j'ai pardu mon échevette ! » Se dit pour exprimer une contrariété, mais parfois signifie : aussi, encore, cependant, tout de même. Quelques-uns l'écrivent arrié ! - (14) |
| arié (interj.) : eh bien, ma foi - (64) |
| arié (usité dans toute la Bourgogne), arré (C.), arrié (Morv., Br.). - Expédient de langage sans équivalent en français et dont il est, par cela même, assez difficile de donner le sens. Ce mot exprime surtout une idée de mécontentement, de contrariété, d'impatience…. Une autre étymologie, moins compliquée, a été proposée et paraît préférable, c'est: ad horam (à cette heure), locution commune, dont ârié serait un dérivé. A l'appui de cette assertion vient l'opinion de Guillemin, qui cite plusieurs textes d'ancien français, dans lesquels le mot arrier se trouve avec le sens de : à cette heure. Ne pas confondre ârié avec arrié, fréquemment employé par les charretiers pour faire reculer leurs chevaux et qui n'est qu'une corruption du mot : arrière ! - (15) |
| arié : au contraire - (60) |
| arie : lit de blé, disposé dans l'aire. (VDS. T IV) - VdS - (25) |
| ârié : sûrement, encore - (37) |
| arié : n. m. De surcroît. - (53) |
| arié : par contre - (39) |
| arié, contient l'idée de contrariété, de contradiction. - (16) |
| arié, interj. maintenant, enfin, en effet, et correspond ordinairement à l'interj. « jar, jaré. » - (08) |
| arie. Aire de grange. Par extension, quantité de gerbes que l’on étend à chaque couche pour escoure, c'est-à-dire pour battre le blé. V. Escoure. - (13) |
| arié. Aussi : « aul est arié malède ». S'emploie comme interjection, sans sens bien précis. - (49) |
| arie. s. f. Bergerie, et, par extension, vacherie, étable en général Du latin aries, bélier. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| arié. Se prononce ârié, avec â très long. Pas d’équivalent en français. Arié est un petit mot explétif que l’on ajoute pour renforcer une expression. Etym. Peut-être arrière, qui vient lui-même de ad retro, selon Littré. - (12) |
| arié. : Locution explétive, soit d'étonnement, soit d'impatience. - (06) |
| ariens, aurions, airins. - (04) |
| arignée, s. f., araignée. (Voir Aragnée). - (14) |
| arigner, arâgner. – Voir : harigner. - (15) |
| arigner, faire mettre en colère une personne ou un animal. An ne faut jaimâs arigner les chiens. À Avallon, on dit airâgner. - (13) |
| arigner, v. tr., railler, taquiner, agacer, provoquer. - (14) |
| arigner, v., provoquer, agacer. - (40) |
| arignie : voir araignie - (23) |
| arignie des amoureux : voir chvau - (23) |
| arjan. Argent. - (01) |
| arlanvé ou arlenvé : A l'envers. Dicton : « Alle a mis san c'eutillan (son cotillon) arlanvé o deurera (durera) deux hivé (hivers) ». Proverbe qui semble amené par la rime plutôt que par la raison. - (19) |
| arlequin et arloquin. s. m., barque très légère, ne pouvant guère contenir qu'une personne, et destinée à la chasse sur l'eau. (V. Nëye-chrètien). - (14) |
| arlever : relever, à propos de gerbes que l'on met en javelles - ou la vigne que l'on relève après la première pousse. Ex : "J'monte à la vigne ! Il est ben temps d'arlever !" - (58) |
| arlinger (s') (v.pr.) : se dit du temps qui s'améliore "le temps s'arlinge" - (50) |
| arlu, s. m. feu follet. - (22) |
| armagnac : s. m., matière fécale. Cette expression est vraisemblablement un souvenir de la haine violente qui, au moyen âge, a régné entre Armagnacs et Bourguignons. - (20) |
| armagnol. Ce terme était autrefois synonyme de bohémien, de camp-volant et de gordiâ. (V. Gorder). C’est un souvenir des Armagnacs, des Tard-venus et des grandes compagnies de routiers qui désolèrent la Bourgogne dans le cours du XIVe siècle. - (13) |
| armai. Armer, armé, armés. - (01) |
| armana. Almanach. - (01) |
| arman-nach, armanach. Almanach. - (49) |
| ar'marcier, v. tr., remercier. - (14) |
| armel : petit couteau. - (09) |
| armële, s. f., armoire . - (40) |
| armelle, f. : mauvais couteau, outil. (M. T IV) (F. T IV) - Y - (25) |
| armelle, s. f. marguerite, genre de pyrêthres. - (11) |
| armelle. n. f. - Couteau de petite taille. Se dit aussi pour un vieux couteau ou un couteau sans manche. « Une grande armelle » s'emploie comme une injure, synonyme de « grande bringue ». - (42) |
| armena, s. m. almanach. - (22) |
| armena, s. rn. almanach. - (24) |
| armenusier. s. m. Armurier. - (10) |
| armer, v., tr., harnacher un cheval de trait. - (40) |
| armère, sf. armoire. - (17) |
| armeuse, s. f., balai de genêt ou bouleau. - (40) |
| arminah, almanach. - (05) |
| armoeure*, s. f. armoire. - (22) |
| armôna : Almanach. « Regarde dan voir su l'armôna si y va fare chaud demain ». L'almanach de grande tradition dans le pays, l'almanach Marybas, indique par des signes et pour toute l'année le temps de chaque jour. - (19) |
| armonà, almanach. - (16) |
| armona, s. m., almanach. - (14) |
| armône, aumône. - (02) |
| armonée, aumônerie. - (02) |
| armonnat, sm. almanach. - (17) |
| armouére (n.f.) : armoire - (50) |
| armouère (nom féminin) : armoire. - (47) |
| armouère : armoire - (39) |
| arnaijan : Lombago, mal de reins. « Ol a étrapé eune arnaijan, o ne peut pas se baichi (baisser). - (19) |
| arnais : ensemble du matériel agricole - (43) |
| arné (-e) (adj. et p.p. m. et f.) : fatigué (-e) à l'excès - (50) |
| arné : éreinté. - (52) |
| arné, ée (pour harné, hernie), adj. Fatigué, à bout de force. - (10) |
| arné, fatigué - (36) |
| arné, part, passé d'un v. « arner » inusité à l'infinitif. Ereinté, fatigué à l'excès : « i seu arné », je suis éreinté. - (08) |
| arné. adj. - Exténué. - (42) |
| arnée. n. f. - Désigne une bête désobéissante : « Te parles d'une arnée ! A veut rein acouter. » Au figuré : une personne déplaisante, désagréable. - (42) |
| arné-las. adj. Composé redondant des deux mots harné et las, exprimant l'un et l'autre la même idée la lassitude, la fatigue. Et cependant, c'est cet accouplement qui indique l'excès de lassitude et d'épuisement de celui qui dit Je suis arné-las. - (10) |
| arnenvâ (à l’) : envers (à l’), pour certains : « à la renverse », on pourrait écrire : à la r’nenvâ . Voir l’équivalent : envar . - (62) |
| arner : frapper rudement une personne ou un animal - (60) |
| arnéssi, v. a. harnacher. - (22) |
| Arnest (l’) : (l’) Ernest - (37) |
| arniale : Enfant mince, chétif. « I est eune vra arniale ». - (19) |
| arnicage. s. m. T. de dérision, de mépris. Equipage ridicule, grotesque, qui provoque le rire et la moquerie. - (10) |
| arnie. n. f. -Terme de mépris : « C'est toi, Claudine, qui as bu. Trois grands verres d'asti, petite amie ! Comme c'est bon ! » (Colette, Claudine à Paris, p.280). Se dit également d'un outil en mauvais état. - (42) |
| arnige ou arnije : Alise, fruit de l'alisier. - (19) |
| arniji : Alisier, voir aïlly. - (19) |
| arnillouze, qui cherche querelle - (36) |
| arnin : Légère brume à l'horizon en été. - (19) |
| arnois. s. m. Mauvais garnement. Ce mot nous semble avoir beaucoup d'affinité avec arnaud, débauché, mauvais sujet, et arnauder, quereller, chercher noise et dispute, maltraiter. - (10) |
| arnote pour annotte, petite gesse sauvage dont les enfants recherchent la racine tubéreuse. - (16) |
| arnote. Petite plante bulbeuse grimpante et vivace qui croît spontanément dans les terres arables. Sa fleur rose exhale une délicieuse odeur et son petit tubercule est comestible. Ce mot est flamand : cernote, noix de terre. - (13) |
| arnotte, s. f., toute petite chose chétive. - (40) |
| arnoueille : voir guernouille - (23) |
| arnouille (arnoueille) : grenouille - (39) |
| arnouille, s. f., grenouille verte. - (40) |
| arnoyale, s.f. grenouille. - (38) |
| arnuquer : regarder - (61) |
| arô, orteils. - (02) |
| arochi, v. a. couvrir d'une épaisse couche de boue : ce mauvais chemin m'a arochi. - (24) |
| arochier : v. a., vx fr., saupoudrer, parsemer, cribler. Etre arochié de bourbe (être couvert de boue). - (20) |
| arœiller (s'). v. pronom. S'étonner, s'effarer, ouvrir, écarquiller démesurément les yeux à la vue d'une chose, d'un spectacle qui vous surprend. - (10) |
| aroeiller ouvrir tout grand son œil. (P. T IV) - Y - (25) |
| aroi. s. m. Assaisonnement. (Bessy.) – Roquefort donne arroi, ligne, trait, rang, disposition, façon…, arrangement…. - (10) |
| ar'oir. Au revoir. - (49) |
| aronce (n. f.) : ronce - (64) |
| aronce (nom féminin) : ronces. - (47) |
| aroncé : égratigné. VI, p. 41-15 - (23) |
| aronce : ronce, églantier. VI, p. 41-15 - (23) |
| aronce. n. f. - Ronce. - (42) |
| arondale, s. f. hirondelle. - (24) |
| arondelle, airondelle (n.f.) : hirondelle - (50) |
| arondeulle: (nf) hirondelle - (35) |
| arondon, lisière de terrain limitative, lisière d'andain de foin. - (05) |
| aronze, èronze. Ronce. - (49) |
| arosse, courtilière. v. tarette. - (05) |
| arosse. Courtillière ou taupe-grillon commune. Insecte qui cause du dégât dans les jardins en coupant les racines des plantes. - (03) |
| arôte, s. f., chétif, malingre, maigrichon. - (40) |
| arotter, être arrêté avec un char. - (05) |
| arou, s. m. arrosoir. Apocope de « arousoir. » - (08) |
| aroua : au revoir - (43) |
| arouchi, v. a. couvrir d'une épaisse couche de boue : ce mauvais chemin m'a arouchi. - (22) |
| aroufer (s'), v. pr., s'accroupir, s'abaisser : « C'ment c' qui, t' peux pas y voir ; aroufe-te ». A beaucoup d'analogie avec Se mettre à croupeton. - (14) |
| arouffe, accroupi. - (05) |
| arouher, v. a. arroser. - (08) |
| arouisser. v. a. et n. Essiller, enlever les feuilles des arbres avec la main. On dit aussi aruisser. - (10) |
| arouser : v. arroser. - (21) |
| arpailler (pour harpailler). v. a. Chercher querelle à quelqu'un, l’asticoter, le harceler, le bousculer, le mettre en colère. – S'arpailler. v. pronom. Se colleter, se quereller, se bousculer avec d'autres. Derivé du vieux mot arpe, harpie. - (10) |
| arpaillette : voir épaillette. - (20) |
| arpan : s. m., empan. Ce mot, employé au jeu de billes, désigne la mesure que fournit la longueur comprise entre l'extrémité du pouce et celle du petit doigt dans leur plus grand écartement. Voir patte. - (20) |
| arpanter : v. n., faire un ou plusieurs arpans. - (20) |
| arpe, subst. féminin : mesure employée au jeu de billes. - (54) |
| arpent : s. m., ancienne mesure de surface pour les terres. - (20) |
| arpenteux, f. : araignée (phalangium opibio). (M. T IV) - Y - (25) |
| arpenteux. n. f. - Faucheux, de la famille des araignées. - (42) |
| arpenteux. s. m. Araignée à longues pattes qu'on trouve dans les blés et qu'on nomme aussi faucheux. - (10) |
| arpentou : Arpenteur, géomètre expert. Sorte de chenille qui dans son mouvement de translation tout particulier semble mesurer le chemin qu'elle parcourt. - (19) |
| arpette, harpette (par contraction de harpiette). s. m. et f. Mauvais petit garçon, mauvaise petite fille. Proprement, enfant de harpie, comme on dit enfant de garce, enfant de limace, enfant de bique, enfant de chien. - (10) |
| arpi : voir harpi. - (20) |
| arpi, s. m., grande perche à l'usage des bateliers. L'extrémité est armée d'une pointe et d'un crochet en fer. - (14) |
| arpian : Ergot de coq. Au figuré pied; « I ne fa pas ban li fouler su les arpians » : il ne se laisse pas marcher sur le pied. - (19) |
| arpiau (pour harpiau). s. m. Gamin, polisson, vaurien, fils de harpie. - (10) |
| arpie : Longue perche dont se servent les bateliers. - (19) |
| arpigner (s'). v. - Se disputer, se critiquer, se lancer des piques. (Arquian) - (42) |
| arpion (n’) : ergot - (57) |
| arpion : orteil. Vient peut-être de harpago :griffe, grappin. - (62) |
| arpion n.m. (du provençal arpioun, griffe). Orteil. - (63) |
| arpion, doigts de pied du porc. - (16) |
| arpion, s. m., griffe, ongle, serre, corne des pieds de cochon. - (14) |
| arpion. Orteil ; par extension pied. (Argot). Ce mot est très employé. - (49) |
| arpions : orteils - (44) |
| arpions : pieds - (60) |
| arpions, doigts du pied- Lai roue i ai écafoillé les arpions, Cest certainement un terme d'argot. A rapprocher de pionpions, terme enfantin qui désigne les pieds. - (13) |
| arpöte, sf. faiseur d'embarras. - (17) |
| arqueduc. Aqueduc. - (49) |
| arquer, v., marcher, avancer - (40) |
| arquer. v. - Râteler. - (42) |
| arquer. v. n. Ramasser des pierres avec un râteau, avec un arc ; râteler la terre, l'égaliser. - (10) |
| arquette : retenu de jardin. (F. T IV) - Y - (25) |
| arqueutte (f), rateau en fer. - (26) |
| arquiemper (s'). v. - Se faire beau, s'endimancher. (Arquian) - (42) |
| arquotte : râteau de jardin. - (66) |
| arra, adv. de mariniers, vite ! : « Arrâ dou davant ! Arrâ dou d'arrié ! Arrâ dou partout ! Arrâ dou bou viri ! » (Vite en avant ! Vite en arrière ! Vite de partout ! Vite, et tournez !) Nos hommes de bateau emploient ces locutions lorsqu'ils ont à faire éviter aux chevaux qui tirent la maille un obstacle quelconque au bord de la rivière. Quand la maille porte bien, elle passe facilement par dessus tout. - (14) |
| arrache pi (d') : arrache-pied - (57) |
| arracher : v. a., la tête m'arrache, la tête m'est arrachée (par la douleur). - (20) |
| arrache-sciou (n’) : arrache-clou - (57) |
| arracheux d'dents. n. m. - Dentiste. - (42) |
| arrachi : arracher - (57) |
| arrachis. n. m. - Terrain qui vient d'être déboisé. - (42) |
| arrachou (n') : arracheur - (57) |
| arragner : aiguillonner les bœufs. - (09) |
| arrailler. v. - Racler : « J 'm'araille l'gargari, aveuc eune bounne goutte d'ratafia. » - (42) |
| arraingi : arranger - (57) |
| arraler. v. - Tourmenter, agacer : «Que le diable les emporte ! Il va falloir encore que je m'arrale à découvrir le fin mot de l'histoire. » (Colette, Claudine à l'école, p. 50). Se dit également pour une petite écorchure : « J'm'seus aralé la piau en grimpant su' la grousse fouelle. » - (42) |
| arramber : v. a., terme de batellerie, attraper, empoigner. Arrambe-le donc ! - (20) |
| arrandzi : arranger - (51) |
| arrangeant. Accommodant. Se dit surtout du commerçant qui sait satisfaire le client. - (49) |
| arranger : v. a., arranger quelqu'un, être accommodant avec lui sur le prix d'une marchandise. « Trop cher pour moi ! — Venez donc, je vas vous arranger. » - (20) |
| arrapé : occupé à une besogne. - (09) |
| arraper (s') v. (du germanique râpon se saisir de) S'agripper, s'accrocher. - (63) |
| arraper (s'). S'agripper, s'accrocher pour se retenir. - (49) |
| arraper : v. a., vx fr. araper, agripper, adhérer fortement. - (20) |
| arrat : Repos, immobilité. « C't'enfant n'a point d'arrat, o n'est jamais d'arrâte » : cet enfant n'est jamais en repos. « Arra !» cri que font entendre les bouviers pour arrêter leur attelage et qui équivaut à halte ! - (19) |
| arrater (v) : arrêter, « Arrâte tu voir que je te cause ». - (19) |
| arratseux n. Arracheur. L'arratseux d'dents est djôrs. - (63) |
| arratsi : arracher - (43) |
| arratsi : arracher - (51) |
| arratsi v. Arracher. - (63) |
| arrayer : v. a., vx fr. araier, labourer, commencer un sillon, mettre en train un travail. - (20) |
| arrè ! : Arrière ! en arrière. Cri de commandement que les bouviers adressent à leurs bœufs pour les faire reculer, de même que aïe pour les faire marcher et arra pour les faire s'arrêter. - (19) |
| arré (loc.) : en vérité, par contre - (50) |
| arré- mot explétif qui exprime la contrariété, l'ennui. - Voiqui arré qu'à veint me deraingeai. – Quoi que vô velez don arré fâre de ce qui ? - (18) |
| arrégeou : Arracheur. « Arrégeou de dents » : arracheur de dents, dentiste, charlatan « Ol est mintou (menteur) c'ment eun arrégeou de dents ». - (19) |
| arrégi : Arracher. « arrégi des tapines » récolter de pommes de terre, extraire du sol les tubercules. On dit aussi tiri (tirer) « tiri des tapines ». - (19) |
| arrégi : calmer, normaliser - (34) |
| arrégi v. (du lat. ad + regulare, discipliner) Calmer, normaliser. - (63) |
| arrenoille, n. fém.; grenouille. - (07) |
| arrête (être), locution verbale : rester tranquille. - (54) |
| arrête (moment d'). Tranquillité, apaisement. - (12) |
| arréte adj. Immobile, en arrêt. Ôl'tot arréte : il était immobile, il s'était arrêté. - (63) |
| arrête bu : arrête-boeuf, bugrane - (43) |
| arrête d’bu : (nf) bugrane - (35) |
| arrête : part, pass., arrêté, inactif. La fontaine est arrête. J' peux pas rester arrête ; i faut que j' fasse quequ’ chose. - (20) |
| arrête, adj. arrêté (la pendule est arrête). - (65) |
| arréter : arrêter - (57) |
| arrêter de : Ioc., cesser de. - (20) |
| arrêtot. n. m - Empêchement, obstacle, tout ce qui arrête. - (42) |
| arrêtot. s. m. Empêchement, obstacle, tout ce qui arrête. - (10) |
| arrétouaîr (n') : arrêtoir - (57) |
| arrêtoué. n. m. - Obstacle matériel ou humain. Se dit généralement lorsque l'on est arrêté et retardé par quelqu'un pour bavarder, alors qu'on n'en a pas envie. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| arrézi : calmer, normaliser - (43) |
| arri : adv., vx fr. arier et arrere, aussi. - (20) |
| arri : aussi - (34) |
| arri adv. (or. inc.) Aussi, également. - (63) |
| arri ou hardi. Locution d'encouragement. - (03) |
| arri, interj. arrière ! Cri à l'usage de ceux qui veulent faire reculer les bœufs : « arri, arri ! » - (08) |
| arria : mauvais outil, machine en mauvais état - (34) |
| arria : mauvais outil, machine en mauvais état - (43) |
| arria : embûche. Ex : "Mon pour' garçon, pour fée ça, te vas avoir ben d'l'arria !" - (58) |
| arriâ, s. pl. désagréments, contretemps. - (38) |
| arria. s. m , embarras, obstacle, tracas, étalage, confusion : « Ses afàres me donnont ben de l’arriâ ». - (14) |
| arriai ! interjection. arrié ! quel ennui ! - (38) |
| arrias : aléas (ou : encombrement, mélange). - (33) |
| arriau : araire. - (32) |
| arrié ! interj., arrière ! - (14) |
| arrié (louïa d'), terme de mariniers. (V. Louïa). - (14) |
| arrié : ainsi, en revanche, en vérité - (48) |
| arrié : arrière, d'autre part, par contre. - (52) |
| arrié : voici que...(ou : retard : ol o arrié : il est en retard). - (33) |
| ârrié, adv., locution exclamative intercalée dans une phrase pour en appuyer l'idée générale : « ale arrié fin horché » (Le voilà complètement saoul). - (40) |
| arrié, adverbe. Cet adverbe n'a pas vraiment d'équivalent en français. Il signifie encore, souvent avec un sentiment désagréable d'inquiétude ou de colère. - (54) |
| arrié, cependant (explétif). - (26) |
| arrié, prép. et adv. arrière. « en arrié », en arrière ! - (08) |
| arriée : après. - (09) |
| arriée. loc. adv. - Expression pour ainsi dire intraduisible qui exprime, sous forme de ponctuation de la phrase, une idée de doute, de contradiction, d'étonnement : « M'en parle plus ! La petite est pourtant bien plaisante, arriée ; mais c'est fini. » (Colette, Claudine à l'école, p.60) - (42) |
| arrier. adv. Alors, aussi, encore. – Exprime souvent une idée d'opposition, de contradiction et, dans certains cas, de doute, d'hésitation. Vous partez pour Paris ; moi, arrier, je vas du côte de Lyon. Tu veux t'aller promener ; moi, arrier, je ne veux pas sortir. Quand donc viendrez-vous me voir? Oh ben! ma foi, arrier, je ne sais pas ; j'n'ai gué l'temps. Exprime aussi quelquefois une sorte d'étonnement, de surprise désagréable, et alors c'est une exclamation. Un tel va venir vous demander de l'argent. Arrier! Il prend joliment son temps, j'nai pas l'sou. – A Châtel-Censoir, on prononce argée. - (10) |
| arrier. Mot invariable, assez fréquent et peu explicable. Il signifie au contraire, d'un autre côté. - (03) |
| ârrieu, adv., exclamation pour faire reculer un cheval attelé. - (40) |
| arrigailles, harigailles (?) : s. f. pl., objets de rebut. - (20) |
| arriher, v. a. accommoder avec la graisse ou autre assaisonnement. Le bon lard « arrie » bien ; il faut de l'huile pour « arriher » la salade. - (08) |
| arrindzi v. 1. Arranger, réparer. 2. Couvrir la femelle. 3. Accommoder, faciliter. 4. Abîmer. - (63) |
| arrindzment n.m. Accord négocié entre deux personnes. - (63) |
| arriremain : s. m., vx fr., arrièremain. Adv, en arrière, après coup, ensuite. - (20) |
| arrivage : accommodage - (60) |
| arrivage : assaisonnement (d'après JAUBERT). III, p. 32 - (23) |
| arrivage : d'une sauce qui accompagne un mets et qui n'est pas savoureuse, on dit que cette sauce manque d’arrivage. (SS. T IV) - N - (25) |
| arrivage. n. m. - Quantité de lait que l'on verse dans la soupe, ou dans une préparation cuisinée. (Sainpuits, selon M. Jossier) - (42) |
| arrivage. s. in. Se dit, en particulier, à Sainpuits et sans doute aussi dans la Puysaie, de la quantité de lait qu'on met dans une soupe ou dans une fricassée pour la rendre meilleure ; mais, en général, ce mot s'entend de l'assaisonnement et de tout ce complément de légumes, de beurre, de sel, de poivre et de lard qu'on ajoute à un ragoût, au pot-au-feu, par économie, pour fournir, dans les familles un peu nombreuses. C'est l'accessoire qui arrive par-dessus, qu'on ajoute après coup. Dans certaines communes, on dit errivège, par conversion de l'a en e. - (10) |
| arrive que plante, arrive qui plante : loc, advienne que pourra. - (20) |
| arriver : assaisonner. - (52) |
| arrivèze : assaisonnement (arrivage, ce mot vient de la marine). On peut dire d'un plat qu'el ot ben arrivé, qu'il est bien assaisonné. - (52) |
| arrivoir : s. m., vx fr., lieu où l'on arrive, port. Avant de s'appeler la Madeleine, le hameau qui est sur la route de Mâcon à Bourg avait nom Le Bon-Arrivoir. - (20) |
| arroffé (-e) (adj.m. ou f.) : égratigné (-e) - (50) |
| arroi (n.m.) : huile, beurre, lard qui servent à assaisonner les mets - (50) |
| arroi : assaisonnement (voir aussi airrouai). - (33) |
| arroi n.m. (du v. fr. aréer, arroyer, arranger) Complexité, difficulté. Voir aria. - (63) |
| arroi, s. m. tout ce qui sert à assaisonner les mets, l'huile, le beurre, la graisse, le lard. La maison du pauvre est souvent « sans arroi. » cela se dit et cela est. - (08) |
| Arroi, voir héroi. - (07) |
| arroiler, arrouëler : mettre de l'arrimant, de l'arrouet : assaisonner. - (56) |
| arroite : petite baguette longue et flexible - (60) |
| arrosoi : Arrosoir. On dit d'une pluie qui vient à point « V'là in ban cô d'arrosoi » : voilà un bon coup d'arrosoir. - (19) |
| arrosoir (est féminin). - (27) |
| arrosouaîr (n') : arrosoir - (57) |
| arrosouère (nom féminin) : arrosoir. - (47) |
| arrou (être en), animé, excité, en train, en arroi. - (05) |
| arroucher, v. tr., poursuivre des volailles avec des cailloux. - (40) |
| arroué (n.m.) : tout ce qui sert à assaisonner les mets : (huile, beurre, graisse, lard...) - (50) |
| arrouère. exclam. - Au revoir ! On dit également à la r'voyure. - (42) |
| arroûjer v. Arroser. - (63) |
| arroûjoî n.f. Arrosoir. - (63) |
| arrouser : arroser - (43) |
| arroy, train, équipage (On disait autrefois « piteux arroy », triste équipage. C'est l'origine probable de notre locution mauvais charroi, (mauvais arroy), en parlant d'un individu dans une triste situation de santé ou de fortune.), charroi. - (04) |
| arrôyer, v. tr., bercer un enfant dans ses bras. - (40) |
| arr'ver - err'ver : arriver - (57) |
| arsé : harassé, courbatu - (61) |
| arsea. Charbon d’un bois moins brûlé que le charbon ordinaire… - (01) |
| arseá. : Bois à moitié réduit en charbon. – Le mot ars (brûlé) du dialecte est l'origine de cette expression. -Arsure signifie incendie dans les Franchises de Semur de 1262. - (06) |
| arseau, Morceau de charbon de bois qui n'est pas encore assez brûlé, Ce mot, de même que le suivant, dérivent d’arsus et du verbe ardere. - (13) |
| arseiller : ouvrier maladroit. (F. T IV) - Y - (25) |
| arseiller. s. m. Ouvrier maladroit, qui prend mal, qui exécute mal son ouvrage. - (10) |
| arsené, brûlé, desséché (de "ardre", 'brûler'). - (38) |
| arséni (n. m.) : se dit d'un enfant espiègle (c'est un drôle d'arseni) - (64) |
| arséni. n. m. - Enfant vif, turbulent. - (42) |
| arseuiller, m. : mauvais ouvrier. (M. T IV) - Y - (25) |
| arsi. Participe passé du vieux verbe ardre ou ardoir : Je participe présent ardant, a formé l'adjectif que l’on connaît Voici ce que Ménage a écrit : « on dit à Beaune que le vin sent l’arsi quand il a un certain goût de brûlé. » Le village de Corcelles les Ars, ou les Arcis, dans le canton Sud de Beaune, doit son nom à un incendie. On a employé jadis la forme arse : Aucunes fois on seult baiser - La main qu'on voudroit qui fust arse. - (13) |
| arsie : sieste au milieu du jour. II, p. 43-b - (23) |
| arsiée : sieste, pause (celt. arsav : repos, arrêt, trêve) ? - (32) |
| arsiée : voir arsie - (23) |
| arsiée. s. f. ou arsis. s. m. Après-midi, ainsi appelée parce que c'est le moment du jour où se fait la plus grande chaleur. Du latin arsus, ardent, enflammé, brûlé. Lorsqu'on est accablé, brûlé par la chaleur, on dit adjectivement : « Je suis arsi. » - (10) |
| arsier : voir guichard - (23) |
| arsion : voir guichard - (23) |
| arsouille- mot de très bas étage, assez employé, qui signifie une personne sale, surtout au moral. - Çâ moins que ran, ine vrai arsouille. - An le prenro por in arsouille ran qu'ai l'entende. - (18) |
| arsouille, personne ennuyeuse ; enfant exigeant. - Dans l'idiome breton, harz, pluriel harzou, signifie obstacle, embarras. (Le Gon.) Ce mot est très-employé dans le Châtillonnais. - (02) |
| arsouille, s. m. et f., personne malpropre, de mauvaise tenue, et surtout de mauvaises mœurs. - (14) |
| arsouille. s. m. Homme effronté, impudent, dont le langage et les manières ne respectent rien. - (10) |
| arsouille. : En patois picard, arsoule, expression de mépris pour qualifier une personne malpropre. - (06) |
| arsouiller (s') (verbe) : boire plus que de raison. Se faire mouiller par une averse. - (47) |
| arsouye, homme méprisable. - (16) |
| arsure, extrait obtenu de la réduction au feu de mauvaises graisses ; du latin ardere, brûler. - (02) |
| arta : Orteil « Le greu arta » le gros orteil. - (19) |
| arta : s. m. orteil. - (21) |
| artau, artou. n. m. - Orteil. Artau représente la forme pluriel de arteil, mot du XIIe siècle employé dans le sens de griffe ou de doigt de pied ; il est issu du latin articulum : jointure. - (42) |
| artault, ertaul : orteil. - (32) |
| arté : gros orteil - (34) |
| arte : mite - (43) |
| arte : s. f., artison. Des artes (avoir soin de prononcer comme s'il y avait un h aspirée, orthographe que d'ailleurs adopte le Nouv. Larousse illustré). Des papillons de artes. - (20) |
| arte, s. f. mite rongeant les étoffes. - (24) |
| arte. Mite : petit insecte lépidoptère qui lèche les étoffes de laine. - (49) |
| arteiI, orteil, artoil. - (04) |
| artet (n) - daigt d'pi (on) : orteil - (57) |
| artet : doigt de pied - (51) |
| artet, artot, artoit. Orteil. - (49) |
| artet, artot. s. m. Orteil. Sert à désigner les doigts du pied. Le petit artet. Le gros artet. L'artot du mitant. - (10) |
| arteû : (nm) orteil - (35) |
| arteû : orteil - (43) |
| artevalle, chaèdre en artevalle, allusion à la défaite des Bourguignons qui tombèrent, en morceaux, sous Jacques Artevalle. - (38) |
| artic' (ne pas être à son). exp. - Article, ne pas être en forme : « Il est ben malade, l'poure gars, i1 est pas à son artic ! » Expression influencée par la formule française « être à l'article de la mort » : approcher le moment de la mort. - (42) |
| artifaille, n.m. ensemble des outils. Genre hésitant (plutôt masculin) (il est venu avec tous ses artifailles). - (65) |
| artifaille, s. f. , ajustement, objet de toilette : « Alle se fait bé brâve ; alle met toutes ses artifailles ». — Corruption d'attifage. - (14) |
| artifaille. Attifet, ornement ou affiquet. Etym. Corruption évidente du mot attifet qui est alourdi par une prononciation vulgaire. - (12) |
| artifailles : s. f, pl., attirail, outils, instruments. - (20) |
| artillerie de replonges : loc, matériel qu'amenaient autrefois les paysans de la Bresse pour enlever la gadoue à Màcon. A Lyon, c'est l’artillerie de Vénissieux. - (20) |
| artingoute*, s. f. redingote. - (22) |
| artioeu, s. m. orteil. - (22) |
| artiot, arquiot. s. m. Le gros orteil. (Mâlay-le-Vicomte). - (10) |
| artiou : s. m., orteil. Avoir mau aux artioux. - (20) |
| artiou, s. m. orteil (du latin artuculum). - (24) |
| artique (n.m.) : article - (50) |
| artison : larve d’insecte dans le bois. Voir : « artuÿené ». - (62) |
| artison, n.m. ver du bois. Il s'agit des petits vers que l'on trouve dans les vieux meubles et qui laissent des trous. - (65) |
| artiss', vétérinaire. - (16) |
| artisse n. Artiste. - (63) |
| artisse, s. m. artiste vétérinaire. Nos campagnes, en fait d'art, ne connaissent que l'art vétérinaire et encore « le r'bouteux » tient le haut du pavé. - (08) |
| artisse. n. m. - Vétérinaire. - (42) |
| artisse. s. m. Vétérinaire. Nout' vaiche est malade ; j'm'en vas qu'ri l'artisse. - (10) |
| arto : doigt de pied. - (29) |
| arto, airto : n. m. Orteil. - (53) |
| arto, doigt de pied. - (28) |
| arto, s. m., orteil, doigt de pied, particulièrement le gros. - (14) |
| artô, s. m., orteil. - (40) |
| arto, s.m. orteil (latin Articulum). - (38) |
| arto, subst. masculin : doigt de pied. - (54) |
| artoi, orteil. - (05) |
| artois ou artiô : orteil. Certains disent artot, et de manière redondante : artois d’ pied. Du latin : articulus. - (62) |
| artoison ou artouison. Pour artison. Nom donné à tous les insectes qui rongent les étoffes, et même le bois. Etym. inconnue (Littré). - (12) |
| artorner : retourner. - (32) |
| artot : orteil. Les artots queurnon (?) : les cors. - (33) |
| artots : orteils. - (56) |
| artou (n. m.) : orteil - (64) |
| artou : orteil - (60) |
| artou ou artou d'pîd n.m. (du v.fr. arteil, doigt). Orteil. - (63) |
| artoué (n.m.) : gros orteil du pied (plus souvent artau) - (50) |
| artouè : orteil - (39) |
| artoué, s. m. orteil, le gros doigt du pied. Une partie du Morvan nivernais prononce « artau. » - (08) |
| artouézon, s. m. artison, insecte qui ronge les étoffes, les fourrures, les bois blancs. - (08) |
| artoupan : s. m., chenapan, vaurien. - (20) |
| artoupiau, arsoupiau : n. m. Petit garnement sympa. - (53) |
| artourner (verbe) : retourner. Faire demi-tour. - (47) |
| artous : orteils. Ex : "j’me seus douné un coup su’ les artous. Eh j’ai coualé ! T’entends ben ?" (Coualer étant ici une litote- voir ce verbe). - (58) |
| artrousser (verbe) : retrousser. (Artrousse tes manches mon gars et au travail). - (47) |
| artugeon : asticot, puceron. A - B - (41) |
| artugeon (artuzon) (zanzon) : vers du bois - (51) |
| artugeonner (artuzonner) (zanzonner) : piqué par les vers du bois - (51) |
| artujan : Insecte qui creuse des galeries, qui dévore le bois, les peaux et les étoffes. « Ce beu (bois) est tot piqué par les artujans ». - (19) |
| artujené : Vermoulu. « Ol a vendu bien cher in vieux meub'lle to artujené ». - (19) |
| artujon n.m. (du v. fr. artison, ciron). Ver de bois, asticot, charençon, vermine en général. - (63) |
| artuné, vermoulu, véreux. - (38) |
| artus’né, adj., rongé des artisons. - (14) |
| artusené, bois piqué d'artusons. - (05) |
| artuson : asticot, ver du bois - (43) |
| artuson, s. m., artison, insecte qui ronge les bois, les étoffes les pelleteries, etc. - (14) |
| artusonné : piqué par les vers - (34) |
| artusonné : vermoulu - (43) |
| artuÿené : vermoulu. Rongé des « artisons » : les vers à bois ; en Côte d’Or on dit aussi « artusons », voire artuÿons, et l’ « arte »est la mite. - (62) |
| artû-yon, s. m., ver rongeur des meubles. - (40) |
| artuz'né - peurtusi - veurcalé : vermoulu - (57) |
| artuz'né : vermoulu - (57) |
| artuzon (artugeon) (zanzon) : vers du bois - (51) |
| artuzon : (nm) charançon - (35) |
| artuzonné : (p.passé) vermoulu - (35) |
| artuzonner (artugeonner) (zanzonner) : piqué par les vers du bois - (51) |
| arveire, s. f. rivière. - (08) |
| ar'veni (s'il'), v. pr., s'en revenir : « J’l’ons rencontré qu'ô s'n'arvenot d’cheù vous ». - (14) |
| arveuille : s. f., clématite sauvage ou vigne blanche. - (20) |
| arviére : rivière - (39) |
| ar'vin : venir en tournant - (43) |
| arvioule, s. f. regain de prairie. - (08) |
| arvivre : herbe qui a repoussé après le fauchage - (60) |
| arvivre, s. m. regain de prairie. Synonyme de « arvioule » pour revivre. - (08) |
| arvoi ! arvoir ! au plaisir de vous revoir. - (16) |
| ar'voyote (à l’), loc, au revoir ! « Allons, Piarre, portez-vous ben... à l'ar’voyote ! » - (14) |
| arwoî, à rwoî n.m. Au revoir. Arwoî, Reine ! - (63) |
| arzent (n.m.) argent - (50) |
| as (art.cont.) : aux. Article contracté masculin et féminin pluriel mis pour ai las - aussi es - (50) |
| as de pique : croupion du poulet. On dit aussi : « Foutu c’ment l’as de pique » : fait comme l’as de pique : mal conformé. - (62) |
| âs n.m. As, champion. L'Alphonse, y'est eun âs à la manille. - (63) |
| as, aux, à les. - (08) |
| as, aux. - (04) |
| as. (L's ne se prononce pas). Forme bourguignonne du vieux mot ais, planche. Spécialement, planche suspendue au plafond et destinée à porter les miches de pain. « Aivoir du pain su l’as » est synonyme « d'être riche ; » cela correspond à la locution : « il a du foin dans ses bottes. » Le diminutif, aisselle ou aichelle, subsiste dans le patois wallon avec la même signification. Nos campagnards appellent le foyer un A, mais ici l’étymologie est différente : le dernier terme me parait être une prononciation vicieuse de notre mot âtre. V. Oiseau et Layette. - (13) |
| asain : s. m. bande de terre labourée faite de plusieurs sillons. - (21) |
| asar, s. m., hasard, aventure. - (14) |
| ascayé : escalier. - (58) |
| asciau, s. m. petite hache à manche très court dont on se sert avec une seule main, outil à l'usage des charpentiers, des sabotiers, etc. - (08) |
| asciô, s. m., marteau de cave. - (40) |
| ascuser, v. a. excuser, pardonner : « ascusé moué », pardonnez-moi. - (08) |
| ascuser, v. tr., excuser. - (14) |
| âse, adj., aise, satisfait : « Jamà j’ons vu nun pu âse que lu ; ôl é ben hureux ! » - Malgré cette prononciation, le Verdunois dit : aise dans un autre cas. (V. Aises (les). - (14) |
| âse, s. f., aise, aisance, bien-être : « Y ét ein bon parti qu’Jacot ; ôl é bén à l’âse ». - (14) |
| asemein, s. m. récipient en général pour loger l'eau, le vin, la vendange. - (22) |
| asements : vaisselle. (VDS. T IV) - VdS - (25) |
| asements et aisements. Ustensiles de ménage et de cuisine placés sur des rayons de bois, sur des ais. Les plats, les assiettes, les pots, les marmites, les verres sont des aisements. Beille-moi don un touaiyon pour récurer mes aisements. - (13) |
| asements, ustensiles. - (28) |
| asié : (â:zyé - adj.) facile, aisé. - (45) |
| asiée - aisée, facile commode.- I vos aissure que ç'â ben asiée dans le mannège. - Vos an veinrâ bein ai bout, cair çà bein asiée. Moins usité qu'âsille. - (18) |
| asille - même sens qu'asiée.- Ah! Ah! ç'à asille ai dire ma ç'â aute chose de fâre. -Les terres sont tot ai fait asilles, çâ se laibore an ne peut mieux. - (18) |
| asille : facile. (VDS. T IV) - VdS - (25) |
| asine, s. f. bête asine. - (08) |
| asme : Asthmatique. « Ol est asme » : il est asthmatique. - (19) |
| asmée. n. f. - Largeur de terre ensemencée d'un seul geste par le semeur (six pas, environ six mètres). Cela suppose un geste très régulier, comme l'illustre parfaitement le tableau bien connu de J.F. Millet (1850). (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| ason. n. m. - Oison, petit de l'oie. (F.P. Chapat, p.29) - (42) |
| aspârge : Asperge. « Eune plianche d'aspârges » : une planche d'asperges. - (19) |
| aspergès, s. m., goupillon, comme en français, mais aussi et surtout l'aspersion faite pour lutiner : « J' nous sons baignés en Saône avou l’petiot, et j’t’li ai envoyé un aspergès !... » - (14) |
| aspergès. s. m. Aspersoir, goupillon pour asperger. Se dit par allusion à ce verset du psaume 50 : Asperges me, Domine, hyssopo, et mundabor. - (10) |
| aspic, vipère. - (05) |
| assâ : a) Désaltérer. « Donnes me à boire dan in grand varre (verre), y est pas qu'an boit pu que dan in ptiet (petit) ma y assa mieux ». - b ) Saturer. Après une longue pluie on dit : « La tarre est bien assa ». Les latins disaient « satis prata biberunt ». - (19) |
| assaboui : fatigué, ensuqué - (61) |
| assaboui, adj., abasourdi, surpris, interloqué. - (40) |
| assaboui. adj. - Abasourdi, assommé, ébahi par le bruit ou par une personne. Cet adjectif.est directement dérivé de l'ancien français essaboir qui signifiait au XIIe siècle être interdit, être stupéfait. - (42) |
| assabouir : étourdir, abrutir. Ex : "Assabouis-nous pas ! Arréte-don d'lucher". - (58) |
| assachi : Assécher, mettre à sec. « Assachi eun étang ». Aux cartes « jouer à l'assachi » c'est jouer à la bataille, au « cu so » (cul sec) ou encore au ju de bouéran (jeu de berger). - (19) |
| assadi v. Rendre sade, c'est-à-dire savoureux, goûteux. Il ne faut pas confondre avec affadir, rendre fade, sans goût. - (63) |
| assadir : v. a., rendre sade. - (20) |
| assai. Hier soir, sai pour soir. - (03) |
| assaingne. s. m. Essaim. - (10) |
| assais (n. f. pl.) : reliefs d'un repas - (64) |
| assaisonner (v. tr.) : parvenir à maturité, en parlant d'une récolte - (64) |
| assarge (adjectif) : turbulent, insupportable. - (47) |
| assarmenter : ôter les sarments de la vigne. - (21) |
| assarper (v. tr.) : tailler à coups de serpe - (64) |
| assarper (verbe) : bâcler ; saccager un travail. - (47) |
| assarres : congères - (43) |
| assarteni : Assurer. « Y est vra, o m'y a assarteni » : c'est vrai, il me l'a assuré. - (19) |
| assarter : tailler une haie, une bordure de végétation dépassante. Ex : "Té vas t-y laisser ta bouchue manger mon pré ? Té voué ben ! Té vas falloir assarter moun'houme. A pas r'tarder !" - (58) |
| assarter, dessarter. v. - Essarter, défricher, débroussailler. - (42) |
| assas, assais. s. m. pl. Restes de foin, de paille, de fourrage laissés par les animaux repus au dédaigneux. Ces mots, surtout le second, assais, ne seraient-ils pas une altération du mot assez, satis? Quand on laisse de la nourriture, parce que la faim est repue, c'est qu'on en a assez. - (10) |
| assas. n. m. - Reste d'un repas, détritus. Se dit aussi du fourrage laissé par les animaux repus. - (42) |
| assassin, assassinat ; é s'ë k'mi ein assassin, il s'est commis un assassinat. - (16) |
| assassin, s. m., assassinat : « Y ét ein un vrâ brigand ; ôl a commis eun assassin ». - (14) |
| assavoir (faire), v. tr., annoncer, publier par la ville. C'est toujours le tambour attitré qui remplit cette fonction : « Eh! v'là l’tambournier. Qu’é-ce qu'ô va nous faire assavoir ? » - (14) |
| assavoir (faire). v. a. Faire connaitre une chose, informer quelqu'un, porter à la connaissance de… M. le Maire fait assavoir au public. Quand tu saras queuque choue, tu me l'f'ras assavoir. - (10) |
| assavorer. : (Dial. et pat.), goûter avec plaisir d'une chose (du latin saporare, assaisonner, et de la préposition ad). - (06) |
| asse, s. f. herse. - (22) |
| assec (en), loc, une des manières dassoler les étangs. L'assolement en assec est en usage dans l'Autunois et quelques localités du Chalonnais. — Lorsque les étangs sont restés en eau pendant quelques années, on les dessèche (on les met en assec) et on les sème ordinairement en avoine. - (14) |
| asseji, v. a. tasser dans un sac. - (22) |
| asseji, v. a. tasser dans un sac. - (24) |
| assemblés, qui s'emploie généralement au pluriel et se dit d'un homme et d'une femme qui vivent ensemble sans être mariés. - (11) |
| assemblier : Epeler. « Ce p'tiet (petit) va à l'écôle, o commache à assemblier » : il commence à lire en épelant. - (19) |
| asseter (s'), s'asseoir. - (05) |
| asseter (s'), v. pronominal ; s'asseoir. - (07) |
| asseter (s’), v. pr., s'asseoir ; « T'nez, la brav’ fonne, ass’tez-vous d’vant l’eù ». - (14) |
| asseter. S'asseoir. - (03) |
| asseteut : Aussitôt, dès que. « J'y écrirai asseteut que j'pourrai » : je lui écrirai aussitôt que je pourrai. Bien vite, « Ol a asseteut fait » : il a vite fait. - (19) |
| asseuchi : assécher - (57) |
| asseuchi : tarir - (57) |
| asseudzi : installé - (43) |
| asseudzi : tranquille, se calmer - (51) |
| asseudzi, acheudzi Voir acheudzi. - (63) |
| asseupé, v. a. buter par mégarde, achopper. - (22) |
| asseveisser. : (Du latin suaviare), adoucir les sujétions féodales. Franchises de Tart, 1275. - (06) |
| asséyer (s'), v. pr., s'asseoir. - (14) |
| assi : aussi - (51) |
| assi : Aussi, « Ol est assi haut q'eune parche. Y est assi bin fait ». Quand aussi n'est pas suivi d'un adjectif on emploie : ato, « J'y vas ato ». - (19) |
| assi : essieu. - (29) |
| assi bié : aussi bien - (51) |
| assi, v. a. herser. - (22) |
| assiantrer. : (Dial.), discerner, juger avec connaissance de cause. Rac. lat. Scientia. - (06) |
| assiau (l’) ou la siau, marteau tranchant d'un côté employé en tonnellerie. - (38) |
| assiau. s. m. Essieu. (Molesmes). - (10) |
| assiaumes (nom masculin) : lames de bois de chêne que l'on employait en guise de tuiles pour couvrir les habitations. L'équivalent des bardeaux. - (47) |
| assiaune, aissiaune, aisseaune, s. f. bardeau, lame de bois de chêne qui sert à la toiture des bâtiments. La couverture en « assiaunes » était autrefois très en vogue à Château-Chinon. - (08) |
| assiéner. v. - Essaimer. - (42) |
| assienner. v. n. Essaimer, en parlant des abeilles. - (10) |
| assiéte : Assiette, le contenu d'une assiette. « Eune bonne assiéte de plé » : une bonne assiette de gaudes. - (19) |
| assiette : s. f, vx fr, assiete, cabaret où l'on consomme assis, par opposition au porte-pot, où l'on consomme debout et l'on achète du vin « à emporter ». L’ancIenne administration des aides du Maçonnais contrôlait rigoureusement les « charges, ventes et débits » des « cabaretiers et autres vendans vin tant à pot qu'à assiette. » (Archives dép., série C. Supplément, registres de 1722 et 1723). - (20) |
| assiger : asseoir, appuyer, entasser - (60) |
| assigout. n. m. - Zeste, membrane qui divise en quatre l'intérieur de la noix. - (42) |
| assigout. s. m. Zeste, cloison ligneuse au milieu des noix. Un assigout de calon. - (10) |
| assiler, assiller. v. a. Enlever avec la main les feuilles des arbres pour la nourriture des bestiaux. Voyez essiller. - (10) |
| assiller. v. - Effeuiller ou égrainer, une plante ou une branche, en la faisant glisser dans la main. Au Moyen Âge, essiler signifia exiler , puis dans un emploi affaibli, séparer ; c'est ce dernier sens que le poyaudin a conservé pour l' appliquer au vocabulaire rural : effeuiller. - (42) |
| assimblier (verbe) : Assembler. Proverbe « Oui se ressimblie, s'assemblie » : qui se ressemble, s'assemble. - (19) |
| assiô – même sens que aissiâ, mais moins usité. - Vô n'éte don pas été ai Cueulète quéman c'éto convenu ?... Aissiô. - (18) |
| assioner (v. int.) : essaimer, en parlant des abeilles - (64) |
| assire, assiter, assieter. v. - Asseoir : « T'as ben l'temps, te vas ben t'assire eune mineute ? » Assire n'est pas un néologisme erroné, mais correspond à l'usage exact de l'ancien français du XIIIe siècle, employant assire par dérivation du bas latin assidere. - (42) |
| assis (se mettre), loc, s'asseoir : « Mettez-vous donc assis ; j'vons causer un brin ». - (14) |
| Assistance n.f. Assistance Publique. - (63) |
| assiter (s), v., s'assenoir. - (40) |
| assiter, assiéter. v n. Asseoir. On dit aussi essiter, essiéter. S'assiter. n. pronom. S'asseoir. Assitez-vous. - (10) |
| assitoir, essitoir. s. m. Banc, chaise, escabeau, fauteuil, siège quelconque. - (10) |
| assole (nom féminin) : échelle. - (47) |
| âssolle : échelle - (37) |
| assollée : échelée (passage construit sur une haie) - (37) |
| assomasser : ébourgeonner la vigne. - (09) |
| assomeiller (s') (verbe) : s'endormir. - (47) |
| assorgir. v. a. Ameublir. Assorgir la terre, la rendre sorge, meuble, légère. - (10) |
| assorre. : Absoudre (dérivation du latin absolvere). Franchises de Dijon, 1313. - (06) |
| assote (à 1'). A l'abri de la pluie. - (03) |
| assote (à l'), loc, à l'abri. On entend parfois dire : Essote, et même A la sote : « I pleùvot ; âlle s’é métu à l'assote sou ein âbre ». - (14) |
| assotte (à l'), à l'abri de la pluie. - (05) |
| assoumasser, aissoumasser. v. n. Retrancher des ceps, dans une vigne, les bourgeons inutiles les membres qui ne portent pas de fruit. - (10) |
| assoumasser, essoumasser. v. - Enlever, sur le cep, les bourgeons qui ne portent pas de fruit. - (42) |
| assoumasseux, essoumasseux. n. m. - Celui qui assoumasse. - (42) |
| assoumer. v. - Assommer. - (42) |
| assoumouée. n. f. - Assommoir. Se dit d'un endroit très bruyant : « Cheu allé au café du haut, te parles d'eune - (42) |
| assoyé : part, pass., assis. - (20) |
| ass'tot, adv., aussitôt, au moment que. - (14) |
| assu, trou. - (38) |
| assuager, asuager, asoacer. : (Dial.), soulasger, adoucir (du latin suaviare). Rac. suavis. - (06) |
| assui (adj.) : se dit d'un fromage dont le séchage n'est pas terminé - (64) |
| assui (pour essui). adj. Qui a sué, qui a jeté son eau, qui a séché. Un froumage assui. - (10) |
| assui. adj. - Qui a séché, qui a sué. Un fromage assui, la terre assuie. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| assurance (en) : loc, assurément. Voir la citation rapportée au mot charon. - (20) |
| assurance : s. f., portefeuille d'assurances. II a une assurance. - (20) |
| assurant, envieux de ce qui se mange ou se boit, exprime aussi une idée de jalousie. - (27) |
| assurger : v. n.. se lever, surgir. - (20) |
| a's'teur, à cette heure, présentement, de nos jours, maintenant. - (16) |
| astheure. Contraction de « à cette heure », se dit presque exclusivement pour maintenant. - (03) |
| asthme (asme, asse) : adj., oppressé. II est asthme. - (20) |
| âsthme adj. Oppressé. - (63) |
| asthme. Ce mot est employé pour asthmatique : « aul est asthme». - (49) |
| asticotai. : Tracasser, piquer quelqu'un sans relâche ni miséricorde. Delmasse a dit fort ingénieusement que ce verbe doit son existence à l'astic, os creux rempli de suif dans lequel les cordonniers enfoncent souvent leurs alênes. - (06) |
| astomac, s. m. estomac, poitrine. En Morvan, et ailleurs probablement, l'estomac, c'est tout à la fois la poitrine, le cœur, la gorge, le sein. Un bel estomac promet une bonne nourrice - (08) |
| at. Est. Voyez a. - (01) |
| at’heulé, v. a. accroupir. - (22) |
| ataine, querelle... En Bourgogne et surtout dans le Châtillonnais, on dit tu m'étaines, c.-à-d. tu me casses la tête, tu m'ennuies. Dans l'idiome breton, atahin signifie noise, chicane, et le verbe atahinein veut dire irriter, provoquer. (Le Gon.) - (02) |
| atainer ou atagner. Fatiguer, importuner, taquiner. Etym. le mot existait dans le vieux français. - (12) |
| atainer, contrarier, provoquer. - (05) |
| atainer. Ennuyer, provoquer. - (03) |
| atainer. : ( Dial. et pat.), quereller, obséder quelqu'un. Peut-être on parle mal en disant étainer. Le mot ataine signifie noise, chicane. - (06) |
| atâné (pour atainé). adj. Fatigué, exténué, sans force, épuisé. De a privatif, t euphonique et aine (qui n'a plus d'aine). On dit atâné pour échiné, éreinté. - (10) |
| atang (n.m.) : étang - (50) |
| âtant : adv. Autant. - (53) |
| atapir (s'). : (Dial.), s'aitaipi (pat.), se cacher, se courber pour se dissimuler.- On a contredit l'étymologie latine de talpa sous prétexte que la lettre l ne se syncope point. - (06) |
| atarer : Altérer, provoquer la soif. « Ce temps est bien atarant ». - (19) |
| atarzler, atarger. : (Dial.), retarder. D'où atarzie, atargie et même : atarjance, retard, délai. -Du latin atarditare, rac. tardus. - (06) |
| atatri. adj. - Pilé, écrasé par de fortes pluies. (Mézilles, selon H. Chéry) - (42) |
| atauper, ataupiner. v. - Enlever les taupinières, ce travail était effectué à l'aide d'un sabattage (cerclage métallique d'une ancienne roue de tombereau) tiré par un cheval. (Sougères-En-Puisaye) - (42) |
| ataurniau (n.m.) : étourneau - (50) |
| atche (faire), loc. se dit d'un terrain qui fait encoche dans un autre. - (24) |
| âte : champ en longueur - (48) |
| ate : petit sillon de 3 ou 6 raies, ou rangée de pieds de vigne - (60) |
| ate, hâte : (â:t’ - subst. f.) champ étroit et long. Les "hâtes" composent avec les forêts l'essentiel du paysage, la surface agricole étant relativement réduite dans cette région sans plaines. L'hâte à Liernais n'est pas une mesure de superficie ; c'est un champ qu'on a pris l'habitude d'évaluer à un journal, ou à un demi-journal. - (45) |
| âte, v. subst. être. - (08) |
| âte. s. f. Espace de terre contenu entre deux raies dans un champ labouré. - (10) |
| ateirement. : (Dial.), humilité, bassesse naturelle à notre condition terrestre. - (06) |
| atéle, s. f. morceau de bois qui entre dans l'appareil d'attelage pour les chevaux de trait. - (08) |
| atelle : la planche du collier - (46) |
| atelon, ételon. n. m. - Étalon. - (42) |
| atelonier, atelounier. n. m. - Personne qui s'occupe de l'étalon. - (42) |
| atemprer. : (Dial.), tempérer, adoucir (du latin ad temperare). - (06) |
| aterbou (n. m.) : tourbillon de vent - (64) |
| aterni. v. - Éternuer. (Arquian) - (42) |
| atêter. v. - Étêter. - (42) |
| atêton, etêton. n. m. - Arbre étêté, le plus souvent dans une haie. Les branches qui repoussaient étaient régulièrement coupées tous les cinq ou six ans pour faire des fagots. Cette coupe se faisait uniquement sur le chêne, l'orme, le charme et le saule. - (42) |
| atêton, étêton. s. m. Dans la Puysaie, tronc d'arbre laissé dans une haie et que, tous les cinq ou six ans, on étête, on dépouille de ses branches pour faire des fagots. - (10) |
| ateu : doigt de pied. (REP T IV) - D - (25) |
| ateule (n.f.) : ensemble du chaume - (50) |
| ateûré : v. t. Défier. - (53) |
| ateurnuer (v.t.) : éternuer - (50) |
| atfié, v. a. élever et amener en rapport une jeune vigne, un plant d'arbre. - (22) |
| atfier : Créer, mener à bien, soigner. « Atfier eune planche d'asparges » : créer une planche d'asperges En parlant des personnes : « Te l'as bien atfié » : tu l'as bien arrangé. D'un homme extrêmement brutal on dit : « Ol âme autant tuer qu'atfier »: il aime autant détruire que soigner. - (19) |
| atfier, v. a. élever et amener en rapport une jeune vigne, un plant d'arbre : il faut au moins trois ans pour atfier une vigne (du latin aptificare). - (24) |
| athanor instrument, en magie-alchimie : vase où s'accomplit le grand’œuvre. - (32) |
| atiaut : orteil. - (66) |
| atier. s. m. Se dit par syncope pour atelier. - (10) |
| atifer (s') (verbe) : soigner sa personne, sa présentation. - (47) |
| atiger : exagérer - (61) |
| atigi : exagérer - (57) |
| atin, doigt de pied. - (26) |
| atiö, atö, sm. orteil. - (17) |
| atiot : un orteil (au pluriel : des aitiots) - (46) |
| atiöte (ā), sf. attelle. Petite lamelle, planchette, soutien d'un pansement. - (17) |
| atiote. n. m. - Se prononce ati-ote. Petite aiguille de bois ou d'os, dont on se servait autrefois pour remonter la mèche d'une lampe à huile. - (42) |
| atioter. v. Se servir de l'atiote. - (42) |
| atiquet, s. m. les femmes se servent de l'atiquet comme d'un point d'appui pour leurs aiguilles à tricoter. L’atiquet se place sur la poitrine. C’est ordinairement une amande, une noisette ou même une dent de porc, un corps dur en un mot. - (08) |
| ato : Aussi. « Si t'y va j'y érai ato » : si tu y vas, j'y irai aussi. Devant un adjectif on emploie assi. - (19) |
| atoffer : (vb) étouffer - (35) |
| âtôr : adv. Autour. - (53) |
| atou : aussi, également, itou. - (62) |
| atou, adv., tout comme. - (40) |
| atou, étou, aussi ; moè ètou, moi aussi. - (16) |
| atou, prép., avec, ensemble, aussi. (V. Étou, Itou). - (14) |
| atou. Aussi ; on voit dans le patois de Molière itou. Atou veut dire avec tout. - (03) |
| atoûle : chaume d'un blé, ou d'avoine (éteule) - (60) |
| atoule : éteule (reste du blé fauché) - (61) |
| atounan, ante, adj. étonnant, surprenant. - (08) |
| atounant, adj., étonnant. - (14) |
| atoune ben si (m'). loc. - Expression placée en début de phrase : je me demande si ..., j'aimerais bien savoir si ... - (42) |
| atoune ben si (m'). Locution interrogative et hésitative par laquelle on commence une phrase énonçant une supposition. Je m'étonne bien si… Je me demande si... Je voudrais bien savoir si… - (10) |
| atouner (verbe) : étonner. - (47) |
| atounnant (adj.) : étonnant, inquiétant - (50) |
| atounné -(-é} : (adj., m.et f.) : étonné (-e), surpris (-e) - (50) |
| atounner (v.t.) : étonner - (50) |
| atounner. v. - Etonner. - (42) |
| atoupe (n.f.) : étoupe (filasse grossière) - (50) |
| atoupe. n. f. - Étoupe. Autre sens : éteignoir, étouffoir, eune atoupe cigare. - (42) |
| atoupe. s. m. Éteignoir. Un atoupe-ciarges. (Puysaie). - (10) |
| atouper, atoupir. v. - Éteindrai, étouffer : atouper la flamme. - (42) |
| atoupir, atouper. v. a. Éteindre, étouffer. Atoupir le feu. Atouper un brasier. (Perreuse). - (10) |
| atoupon. n. m. - Poignée d'étoupe ou de chiffons pout boucher un conduit, un trou. - (42) |
| atoupon. s. m. Poignée d'étoupes pour boucher, pour tamponner quelque chose. - (10) |
| atouppi, adj. qui est envahi par les mauvaises herbes, comme une « toppe ». - (24) |
| atourbou. n. m. - Tourbillon de poussière observé l'été pendant les grandes chaleurs. Selon M. Jossier, ce mot serait dérivé du latin turbo : troubler, agiter. Il n'a pas été trouvé de trace écrite de ce nom en ancien français. - (42) |
| atourbout. s. m. Tourbillon de poussière. Du latin turbo. (Bléneau). - (10) |
| atourgneau. s. m. Etourneau. - (10) |
| atourignon : maigre. - (29) |
| atout, aussi. - (05) |
| atout, aussi. - (38) |
| atout, s. m., coup bien appliqué : « Ol étot tôjor à me r'chigner ; j' t' li ai fichu eun atout !... » Les joueurs aux cartes, prenant le mot au sens propre, disent : « battre atout » pour : jouer atout. - (14) |
| atout. Se dit d'un homme propre à tout faire, dans un sens de déconsidération absolue. Etym. abréviation de bon ou propre à tout, comme on dit un propre à rien. - (12) |
| atrader : élever, adopter un animal - (43) |
| atranhier (pour atrangler) v. a. Étrangler ; du latin strangulare. Nous donnons ce mot à cause de sa prononciation singulière, laquelle provient de ce que, dans Atrangler, le gl est mouillé (atranglier), comme dans aveugle, aveugler, qu'on prononce aveuille, aveuiller, dans plusieurs de nos campagnes. - (10) |
| atranhier. v. - Étrangler. - (42) |
| atran-yer (v. tr.) : étrangler - (64) |
| atran'yer (v.t.) : étrangler - s'atran'yer (v. pr.) : s’étrangler en avalant (écrit aussi atran-yer) - (50) |
| atranyer : étrangler. - (58) |
| atraper (s'), v. pr., se heurter, se faire mal contre un corps quelconque : « Oh ! là là ! j' m'é atrapé la main cont' le mur ! y m'fâ bé mau ! » - (14) |
| atrapote, s.f., piège, lacet disposé pour prendre les oiseaux. Au fig., ruse, artifice. - (14) |
| atrapou, s. m., attrapeur, rusé, qui trompe. - (14) |
| atrau. On appelle âtrau, chez nous, des rognures de bas morceaux du porc qu'on enveloppe dans des fragments du péritoine et que l’on fait frire ainsi. C'est le mets préparé de cette façon qui constitue des âtraux. C'est un médiocre régal, aussi, au figuré, est-on venu à appeler âtraux des gens qui ne valent pas cher ! Etym. le vieux francais avait astériaux, astréaux, astilles, qui désignaient des morceaux de viande grillés. - (12) |
| atrauder : attirer - (34) |
| atraux : Paupiettes, boulettes de veau farcies. - (19) |
| atray. : (Du latin attrahere), droit de retenir un étranger dans une seigneurie dont il n'est pas membre. Coutumes de Châtillon, 1371. - (06) |
| atreau (C.-d., Chal.), âtriau (Chal.). - Terme de cuisine. Boulette de hâchis, généralement enveloppée d'une tranche de viande. Du vieux français hâtereau, même sens, pris probablement pour hâterôt (rôti hâté, vite fait). - (15) |
| atreau : s. m., escalope de veau roulée, contenant a l'intérieur un hachis. - (20) |
| atreauder : v. a., amasser, acquérir péniblement, sou à sou, par morceaux. « Si c'est pas malheureux d'avoir tant travaillé pour atreauder un petit bien et pis le voir vendre comme ça ? » - (20) |
| atreaux, ou atriaux, s. m., boulettes de foie, de cœur et de mou de cochon, très agréables aux délicats. Ces boulettes se confectionnent aussi avec des tranches de viande roulées et grillées (Atelets). Employé aussi dans le sens de : fricandeau. - (14) |
| âtriller : disputer - (37) |
| atrimer : mettre en place - (60) |
| atrinqué, adj., à son aise, ayant bien tout ce qu'il lui faut : « J' sons été voir nout tante ; âll’é ben atrinquée ». - (14) |
| atriubler. : (Dial. et pat.), troubler, bouleverser (du latin tribulare). -Le mot patois tribouilli vient, comme le verbe qui précède, du latin tribulatio. - (06) |
| atro, foie de porc enveloppé de sa graisse. - (16) |
| atroder : elever, adopter un animal. A - B - (41) |
| atrogne, étrogne. n. f. - arbre étêté ; synonyme de atêton. - (42) |
| atrogner, etrogner. v. - Etêter un arbre. - (42) |
| atros : mot au pluriel désignant une sorte de crépinette cuisinée à partir de foies, de rognons, de coeurs et de poumons de cochon (porc) - (46) |
| âtrôs, s. m. pl., pâtés faits, avec le cœur, le poumon et un peu de foie de porc. - (40) |
| atsanner : abattre une bête qui souffre - (43) |
| atsati v. Rendre difficile, exigeant, allécher. - (63) |
| atsi : (excl) merci - (35) |
| âtsi : (nm) bouton d’or - (35) |
| atsi : merci - (43) |
| atsi interj. Merci. - (63) |
| atsopchon adv. (on retrouve l'équivalent, "ts" mis à part, en Berry, Touraine, Anjou, Bourbonnais, dans le Rhône, l'Isère, l'Ain) Peu à peu, petit à petit, progressivement. - (63) |
| atster v. Acheter. - (63) |
| attabyi v. Attabler. - (63) |
| attacher (s’) : v. r., se marier. - (20) |
| attaiche : Attache « O tint bin san chin à l'attaiche » Liaison amoureuse, « Si o ne veut pas se mairier ave c'te fille y est qu'ol a eune autre attaiche ». - (19) |
| attaichi : Attacher. « V'là les bus qui rentrant à l'écurie, va les attaichi ». - (19) |
| attaigné ée, adj., dégoûté, repu. - (11) |
| attani (ie) : adj., tanné, affaissé, mou, flasque. - (20) |
| attaque n.f. Congestion cérébrale. - (63) |
| attatsi (éttatsi) : attacher - (51) |
| attatsi : attacher - (43) |
| attatsi v. Attacher. - (63) |
| attefier : v. a., vx fr., élever, assurer le développement normal d'un êlre vivant (homme, animal, plante). - (20) |
| attefier, créer, élever, établir. - (05) |
| attenant : adv., sans interruption, sans arrêt, jusqu'au bout. Le temps menace ; il faut rentrer les foins attenant. Boire une bouteille attenant. - (20) |
| attend ben (m') : vraiment. - (09) |
| attende v. Attendre. - (63) |
| attifailles. s. f.pl. Objets de toilette, vêtements. - (10) |
| attifer v. Habiller. - (63) |
| attifiau. s. m. Ajustement, objet pour s'attifer. - (10) |
| attifiaux. n. m. pl. - Vêtements pour s'attifer, s'habiller bizarrement. - (42) |
| attigé, estrafilé, affugé. Avoir une infirmité ; blessé, malade, avoir perdu l'usage d'un membre. - (49) |
| attiger v. (terme d'argot du XIXe s. signifiant blesser, heurter et même torturer) 1. Blesser, meurtrir, handicaper. Est attigée une personne atteinte d'une infirmité, d'une maladie. 2. Exagérer. Ce mot fait partie des rares exceptions au principe de transformation du "ge" en "dze". - (63) |
| attiqué. s. m. Quatre en chiffre, piège pour prendre les oiseaux. - (10) |
| attiri : attirer - (57) |
| attitchet (n’) - carré (on) : carrelet (engin de pêche) - (57) |
| attladze : attelage - (51) |
| att'lée. n. f. - Attelage. - (42) |
| attler : atteler - (51) |
| attofant : étouffant - (43) |
| attofer : étouffer - (43) |
| attoler (verbe) : atteler. - (47) |
| attoufoué, attouffe. n. m. - Étouffoir : « Te parles d'un attoufoué ! » - (42) |
| attrader, v. n. 1. gagner, s'enrichir, amasser du bien : il a bien attradé. — 2. v. a. Se procurer d'une variété déterminée de plante, d'une espèce d'animal : ces poules noires sont belles, je m'en suis attradé dernièrement. — 3. Introduire un personnage indésirable : ne m'attrade pas de cet individu. - (24) |
| attrape n.f. Surprise. - (63) |
| attraper le coup, loc. s'habituer à un tour de main, un travail. - (24) |
| attraper v. 1. Surprendre. 2. Heurter par mégarde. - (63) |
| attraubyi (s') : attabler (s') - (43) |
| attraubyi (s’) : (vb) s’attabler - (35) |
| att'raudé, v. a. 1. Tromper, carotter : tu m'as attraudé. — 2. Se procurer d'une variété déterminée de plante, d'une espèce d'animal : ces poules noires sont belles, je m'en suis attraudé dernièrement. — 3. Introduire un personnage indésirable : ne m'attraude pas de cet individu. - (22) |
| attrauder (s') : attribuer (s') - (43) |
| attrauder (s’) : (vb) s’attribuer (qqch. indûment) - (35) |
| attrauder v. (du v. fr. atraire, attirer) Elever, adopter un animal, choisir un objet, acquérir, s'attribuer. - (63) |
| attraux : (nmpl) paupiettes (« oiseaux sans tête ») - (35) |
| attroder : récupérer prendre possession - (51) |
| attron : grosse merde, surtout en parlant de ce que pose un cheval en une fois - (60) |
| attrouper (s') Se réunir, se regrouper. - (63) |
| attuji v. Attiser (le feu). - (63) |
| attuyer, verbe transitif : gronder. - (54) |
| atugi : attiser le feu. Mouiller un fût pour le rendre étanche. A - B - (41) |
| atujeu : attiser. - (29) |
| atulas (n.m.) : brin coupé d'un chaume - (50) |
| âtules, âteules (n.m.pI.) : tiges des céréales coupées après la moisson, chaumes - (50) |
| atver v. (de attiser ?) Exciter. - (63) |
| au (pron. : ô très ouvert), sf. eau. A Echalot : iau. A Salives : iā. - (17) |
| au cote. À l'abri de la pluie : se mettre « au cote ». - (49) |
| au devant. À la rencontre. On dit : « au m'est veni au devant ». - (49) |
| au dret : en face de... - (52) |
| au droit de, loc. a côté de… près de… à la portée de… - (08) |
| au droit de…, loc. , à la portée de. . . - (14) |
| au et eau. : Ces diphthongues étaient réputées comme trop sourdes par le patois bourguignon, lequel dans les désinences en eau supprime l'u et accentue e et a. Ainsi, lorsque le dialecte disait: aignel, mantel, et le français : agneau, manteau, le patois prononçait aigneà, manteà ; quand le français, après plusieurs dérivés du latin aqua, adoptait la dernière forme eau, le patois disait eà et eaa. - (06) |
| au fin d'su : tout en haut - (46) |
| au travers (par la). Signifie un endroit qui n'est pas précis, que nous ne pouvons pas indiquer exactement, mais non éloigné, à portée. On joint toujours un geste de la main à cette locution, comme pour montrer I‘endroit. - (12) |
| au. Aulx, pluriel d'ail. Le mortier sent toujours les aulx, le motei san tôjor les au. - (01) |
| aubade : voir jiolées - (23) |
| aubârge (n.f.) : auberge - (50) |
| aubarge : Auberge, cabaret. « O mige to san argent à l'aubarge » : il dépense tout son argent au cabaret. Alberge. « Eune pêche d'aubarge ». - (19) |
| aubarge. n. f. - Auberge. - (42) |
| aubé, s. m. enfant nouveau-né. - (08) |
| aubé. Petit enfant au maillot. Du latin albatus qui signifie : vêtu de blanc. Le mot français abbé a la même étymologie. - (13) |
| aubé. s. m. Aubier ; saule, dans certaines communes. Du latin albus. - (10) |
| aubépin (n.m.) : aubépine (arbuste) - (50) |
| aubépin : aubépine - (48) |
| aubépin, n. masc. ; aubépine. - (07) |
| aubépin, n.m. aubépine. - (65) |
| aubépin. s. m. aubépine. Les aubépins sont ébaumis = sont en fleurs épanouies. - (08) |
| auber, aubeur. s. m. Aubier. - (10) |
| auberdie, aubeurdie. s. f. Etourderie, irréflexion, moment de folie, frayeur subite. Une aubeurdie a pris mon cheval. Voyez éberdie. - (10) |
| aubérdze n.f. Auberge. - (63) |
| auberpin. n. m. - Aubépine. - (42) |
| aubertons. s. m. pl. Petits obstacles. Le comte Jaubert donne aubertas, embarras, saletés. - (10) |
| aubeur (n.m.) : aubier - (50) |
| aubeur, s. m. aubier. - (08) |
| aubî n.m. Aubier. - (63) |
| aubion : triton ou salamandre. A - B - (41) |
| aubion n.m. (du lat. pop. ablinda désignant entre autres la salamandre). Salamandre, triton. - (63) |
| aubour : aubier - (60) |
| aubreteau (aubr'tiau) : s. m, terme de marinier, mat au sommet duquel s'attache la corde servant à tirer le bateau. - (20) |
| aubri, s. m. abri, petit remblai sur le bord d'une rigole d'arrosement. - (08) |
| aubriô. Freçai d'Aubrîô. On entend par là tout procès où l'on emploie des pièces fausses, telle qu'était cette dénonciation qu'un notaire fit faire le 20 août 1697, par un autre notaire contre le sieur Massenot, lieutenant-général au bailliage de Dijon , laquelle ayant été reconnue fausse , et faite sous le nom supposé de Thomas d'Aubriot, marchand de Paris , ces deux notaires furent condamnés à diverses peines contenues dans l'arrêt rendu sur cette affaire, par le parlement de Besançon, le 15 mars 1701. Thomas d'Aubriot était un fantôme. - (01) |
| aubu, s. m. terre argileuse, humide ou fraîche. Une terre d'aubu est ordinairement un sol gras et fertile. - (08) |
| aubue. Voyez eaubue. - (10) |
| aubuser, amuser. - (05) |
| aubuzan, amusant ; aubuzai (s'), s'amuser... - (02) |
| aubyonde : (nf) salamandre - (35) |
| auchi (adv.) : aussi - (50) |
| auchi : aussi - (39) |
| auch'tot. Aussitôt. - (49) |
| auchu. adv. Aussi. (Athie). - (10) |
| aucuens. : (Dial.), quelqu'un (du latin aliquis unus). - (06) |
| aucueune, adj. indéf., aucune. - (14) |
| aucuin, aucun. - (38) |
| aucun, aukeun, aukeune adj. pron. et n. Aucun, aucune. - (63) |
| aucung (adj., pron. ind.) : aucun - (50) |
| audaicieu, euse, adj. audacieux. Se prend en mauvaise part avec le sens d'effronté, d'impudent. - (08) |
| audepin : arbuste : aubépine (ou aub'pin). Dans les friches o yé de l'audepin : dans les friches il y a de l'aubépine. - (33) |
| audepin, s.m. aubépine. - (38) |
| au-dret : en face - (48) |
| au-dret : en face de... - (33) |
| au-d'sus - u (i) couchot : au-dessus - (57) |
| audze n.f. Auge. - (63) |
| audzeurdeû, audzeurdi : aujourd'hui - (43) |
| audzire : (nf) auge en pierre dans un pré - (35) |
| audzord'heu adv. Aujourd'hui. - (63) |
| aufligé, part. pass. affligé, infirme, estropié. Se dit d'une personne atteinte d'une grave infirmité physique, d'un boiteux, d'un muet, d'un sourd, etc… - (08) |
| aufrage, s. m. naufrage. - (08) |
| augeler. s. m. Sillon, rigole, petit canal entre deux ados, dans une terre labourée en billons. - (10) |
| augeler. v. a. Labourer une terre en billons, y faire des augelots. - (10) |
| auget, augerot. s. m. Garde-genoux à l'usage des laveuses. - (10) |
| augie, sf. augée. - (17) |
| augment : Augmentation. « Y a in feu (fort) augment su mes impôts s't'année ». - (19) |
| augrelets, houx. - (05) |
| augruyé – houx. - Al â quement in bôchon d'aigruyé. - Çà in joli pied d'augruyé. - (18) |
| auj'deu (nom masculin) : aujourd'hui. On dit aussi aj'deu, augnu. - (47) |
| aujdeu : aujourd'hui - (48) |
| aujd'eû : aujourd'hui, - (46) |
| aujd'eu : aujourd'hui. Feillot pas v'nir aujd'eu : Il ne fallait pas venir aujourd'hui. - (33) |
| aujdeû, adv., aujourd'hui. - (40) |
| auj'deu, adv., aujourd'hui. — Contration d'aujordeù. (V. ce mot). - (14) |
| auj'd'heu, aujord'heu. adv. Aujourd'hui. - (10) |
| aujd'heû, lè p'tiots eûbion teûjo d'dire bonjo, aujourd'hui, les enfants oublient toujours de dire boujour - (46) |
| aujdö, adv. aujourd'hui. Aujdö po demain, au premier jour. - (17) |
| aujedeu, adv. ; aujourd'hui. Voir hojedeu. - (07) |
| aujeurdeu : aujourd’hui. - (62) |
| aujordeu, adv., aujourd'hui. - (14) |
| aujord'heu,audzord'heu. Aujourd'hui. - (49) |
| aujourd'eu : Aujourd'hui. « I fa ban aujourd'eu » : il fait bon aujourd'hui. « Au jo d'aujourd'eu » à l'époque actuelle, maintenant. - (19) |
| aul (au) : il - (51) |
| aulai, appeler, demander quelque chose à haute voix... - (02) |
| aulai. : Appeler à haute voix. En français on dit héler. - (06) |
| aule : (nf) aile - (35) |
| aule : aile - (43) |
| aule : Aile « Eune aule de pigean ». « Battre de l'aule » : être mal dans ses affaires, être éclopé. Au figuré : bras. « O s'est cassé eune aule ». « Gauche c'ment eune aule de melin (moulin) à vent », se dit de quelqu'un très maladroit de ses mains. - (19) |
| aûle : aile. - (62) |
| aule : s. f. aile. - (21) |
| aule n.f. (lat. ala) Aile. - (63) |
| aulegresse. Allégresse. - (01) |
| Aulemaigne. Allemagne. On a écrit et prononcé avant et pendant tout le règne de François 1er et sous une partie de celui de Henri II, Alemaigne, Espaigne, Bretaigne, Champaigne, à cause de l’i final d’Alemania, Hispania, Britannia, Campania, etc. - (01) |
| Aulemain. Allemand, Allemands… - (01) |
| aullée, allée d'arbres ou de maison. - (02) |
| aulx : Prononcez : O. Ail. « Alle a mis de l'aulx dans le gigueut (gigot) ». - (19) |
| aulx, ails. - (05) |
| aumailles. s. f. pl. Bêtes à cornes. Du latin animalia. - (10) |
| aumale, terme injurieux qui correspond à animal. Ceux qui l'emploient n'en comprennent plus le sens qui est bien celui d'animal - (08) |
| aumêze, f. : armoire. (M. T IV) - Y - (25) |
| aumusse ou aumuce : peau de martre ou de petit-gris que les chanoines et les chantres portent sur le bras lorsqu'ils font l'office. - (55) |
| aune : s. f., ancienne mesure de longueur en général. - (20) |
| aune. n. f. - Ancienne mesure de longueur valant 1 m 20, qui fut définitivement supprimée en 1842 : « On mangea quat'e ou cinq aunes de boudin, des ratons, d'la fersue et un grous roûti qu'avait cuit dans l'jour.» (Fernand Clas, p.237) - (42) |
| aunelle. s. f. Aunaie, plantation d'aunes de vernes. - (10) |
| aunot, s. m., oison sortant de l'œuf : « Ol é ben futé c'ment ein aunot ». - (14) |
| auprépin, s. m. aubépine. - (08) |
| auqueilles. s. f. pl. Mauvais meubles, effets mobiliers de peu de valeur. - (10) |
| auquéne. Aucune, aucunes. - (01) |
| auquennes, (prononcer au que ne), certaines ; d'auquennes néts : certaines nuits. - (38) |
| auqueune (adj., pron. ind.) aucune - (50) |
| auréole : s. f., région anale (chez les animaux). - (20) |
| auriôle, s.m. peut-être nerprun à baies noires à saveur âpre. - (38) |
| aurisse, orisse (n.f.) : coup de vent violent avant l'orage, ouragan (de Chambure écrit ourisse) - (50) |
| aurle (pour orle). s. f. Aile. Une aurle d'oie. - (10) |
| ausqueulè : v. i. Basculer. - (53) |
| ausseron, s. m. bosse du terrain, point exhaussé. - (22) |
| aussitò. Aussitôt. - (01) |
| auss'tot, adv., aussitôt : « Voui, auss'tôt qu’ses bas ont des portus, ô t' les met au rancart ». - (14) |
| aussu, adv. aussi, également. - (08) |
| aut ou ôt, est, 3ème personne de l'indicatif présent du verbe être. - (38) |
| aût' : adj. et pron. indéf. Autre. - (53) |
| aut'. adj. - Autre : aut'choue, autre chose. - (42) |
| autai. Autel, autels. - (01) |
| autan. Autant. - (01) |
| autant adv. Comme, ainsi que. - (63) |
| autant. C'est l'adverbe français, mais pris dans un sens diffèrent de sa signification habituelle. Les exemples seuls peuvent faire comprendre ce que les Bourguignons tirent de ce mot : « Comme vous avez l’air fier, autant un soldat ! » « Comme il y a du monde dans les rues aujourd'hui, autant Paris ! » - (12) |
| autaur (n.m., adv.) : autour - (50) |
| aute (adj., pron.ind.) : autre - (50) |
| aute : autre - (51) |
| aute : autre - (57) |
| aute adj. indéf., n. Autre. - (63) |
| aute : autre - (39) |
| aute, adj. autre. « ç'ô eune aute aifére » — l'aute ou l'autre, un des noms du diable. - (08) |
| aute, autre (latin "alter"). - (38) |
| aûte, oûte : autre - (37) |
| auteu. Auteur. Le bourguignon retranche les r finales de la plupart des noms en eur… - (01) |
| auteur, s. m. cause, mobile d'une action. il a été malade, c'est « l'auteur » qu'il n'a pas donné de ses nouvelles ; cet homme est méchant, c'est « l'auteur » qu'on ne l'aime pas. - (08) |
| aut'foué, autrefoué. adv. - Autrefois. - (42) |
| aution (n.f.) : action, effet - (50) |
| autiure, auteur, sf. hauteur. - (17) |
| auto (l') : l'autobus. Ex : "J'seus allé l'attende à l'auto" (prononcer l'autto). - (58) |
| aûto : autour - (46) |
| aûto : autour - (57) |
| aûto : environ - (57) |
| autons, m. : résidus grossiers séparés du grain en vannant. (M. T IV) - Y - (25) |
| autons. n. m. pl. - Résidus du battage ou du vannage. - (42) |
| autons. s. m. pl. Résidus du battage et du vannage du blé, épis cassés, paille ou il reste encore du grain. Du bas latin auto. L'abbé Corblet, dans son Glossaire du Patois picard, donne aulton, autons, et hotons, avec la même signification. - (10) |
| autôr adv. Autour. - (63) |
| autor, prép. autour. - (17) |
| autor, prép., autour. - (14) |
| autor. Autour, préposition. - (01) |
| autoune, s. f., automne. - (14) |
| autour des une heure de l'après-midi ; autour des trois heures. Pour vers telle ou telle heure. Cette expression est surtout curieuse en y englobant une heure du matin ou du soir. Elle est très courante ici, et nul n'hésite à s'en servir. - (12) |
| autre. Autres. - (01) |
| autrefoi. Autrefois. - (01) |
| autrefouais - dans l’temps : autrefois - (57) |
| autrepin : aubépine (mot ancien) - (39) |
| autres (nom masc. plu.) : S'emploie dans l'expression « Aller chez les autres » se louer comme domestique ou comme employé de maison. - (19) |
| autrevò*, adv. autrefois. - (22) |
| autrevouè, adv. autrefois. - (24) |
| autureau, s. m. élévation de terre, monticule, talus, ados dans un champ, sur un fossé. Le Morvandeau bourguignon prononce « autureai. » - (08) |
| auturô, petite élévation. - Un méchant auturô, c.-à-d. une petite colline. - (02) |
| auturô. : Diminutif. - Ein méchan auturô signifie, par exemple, une petite colline comparativement à une hauteur plus considérable. (M Del.) - (06) |
| auturöt, sm. petite élévation, gradin supérieur d'un coteau. - (17) |
| auvargnat : Auvergnat, Auvergne. « Du fromage d'auvargne ou d'auvarne ». - (19) |
| auvargne : Espèce de fromage semblable au fromage de Gruyère. - (19) |
| auve, s. f. graisse de porc. On prononce « auvre » dans quelques localités - (08) |
| auvens, s. m. plur. avent, le temps qui précède la grande fête de noël : « les auvens de noué. » - (08) |
| auvert. : (Dial.), du latin apertum et provenant du verbe dont voici les variations: aovrir, auvrir, ovrir, olvrir, ouvrir. - (06) |
| auvraize (n.m.) : ouvrage (aussi auvraige) - (50) |
| auvraize : ouvrage, travail. El é fait d'lè bounne auvraize : il a fait du bon travail. - (52) |
| auvrer (n.m.) : ouvrier - (50) |
| auye : brebis - (34) |
| aûyer, v. int., avoir envie de vomir. - (40) |
| auzdé (Mhère) ou auzdeu (Brassy) : aujourd'hui - (52) |
| aûzdé : aujourd’hui - (37) |
| auzd'hai (adv.) : aujourd'hui (aussi ozedé, ozourdé) - (50) |
| auzd'heu : aujourd'hui - (39) |
| av' vous ? contract. de : avez-vous ? Parfois se contracte encore davantage en : A’vous ? - (14) |
| av', avu, avto : avec - (43) |
| av', contraction d'avez : « Av’vous besoin que j' veùne ? » (V. Av’vous). - (14) |
| ava : (vb) avoir (p.passé : ésu) - (35) |
| ava : avoir - (51) |
| avage. Excavation, terme minier originaire du Nord. Les haveurs travaillent à abattre le rocher autour du filon de charbon. - (49) |
| avaingni, v. a. affaiblir, amollir, rendre lâche, paresseux. Se dit des personnes comme des animaux. Un cheval « avaingni » par la fatigue, un homme « aivaingni » par la maladie. - (08) |
| avalée, s. f., descente, pente de terrain. - (14) |
| avalée. Descente. - (03) |
| avaler, v. intr., descendre : « A l’aval, aïe ! » est le cri du berger rassemblant son troupeau. On a dit autrefois « à bride avalée » pour : à bride abattue. - (14) |
| avaler, v. tr., quereller en criant fort, s'emporter brutalement : « Je m' garderai ben d'li en parler ; ô m'avalerot ». - (14) |
| avale-royaume : s. m., dépensier, dilapidateur. - (20) |
| avale-royaume, loc. adj., mange-tout. (V. Avale-tout-cru, dont il est synonyme). - (14) |
| avale-royaume, loc. mange-tout, panier percé. - (08) |
| avale-toi, étends-toi. - (27) |
| avâle-tot-cru n. Goinfre. - (63) |
| avale-tout-cru : s. m., gros mangeur, goinfre. - (20) |
| avale-tout-cru, loc. adj., goinfre, glouton : « L'inviter, c'gas ? Oh ! côge-te ; y ét eun avale-tout-cru ». (V. Avale-royaume). - (14) |
| avaleux-d’pois-gris. s. m. Orateur à grands mots, à grands gestes ridicules ; tout niais bavard, ayant des prétentions à l'esprit. - Se dit aussi de ceux qui ont toujours les yeux écarquillés, qui ont l'air de s'étonner de tout. (Auxerre). - (10) |
| avaloir. Gosier, œsophage. « Avoir un bon avaloir », c'est bien boire. - (49) |
| avalon. s. m. Se dit communément à Auxerre et dans tout le Département pour gorgée. Un bon avalon. On entend souvent une mère dire à un enfant malade qui répugne à prendre une potion désagréable : « Voyons, rien qu'un petit avalon ! » - (10) |
| avalou (adj. et n. m.) : gourmand - (64) |
| avalou, avaloué. n. m. f. - Personne ayant un gros appétit : « Te parles d'eune avalou, il ar'pris troués joués d'la dinde. » - (42) |
| avance : « Avoi le cô d'avance » (avoir le coup d'avance) : aller vite en besogne, avoir une certaine adresse pour avancer rapidement dans son travail. - (19) |
| avancer : v. n. Suivi de la préposition à, avec un infinitif, signifie faire vite l'action qu'indique cet infinitif. Avancer à manger, avancer à travailler. - (20) |
| avanci : avancer - (57) |
| avanci à v. Faire preuve de rapidité, d'efficacité. - (63) |
| avanci v. Avancer. - (63) |
| avanî (v. tr.) : asphyxier - (64) |
| avanpleue, s. m., auvent, tente pour garantir de la pluie (avant-pluie). - (14) |
| avant (louïu d’), terme de mariniers. (Voir Louïu). - (14) |
| avant d' lai, adv. de lieu, loin d'ici : « Y a biau jeù qu'ôl é part i; ôl é ben avant d’lai ». - (14) |
| avant z'hiya : Avant-hier. « Y a pliu avant z'hiya ». - (19) |
| avant, adj. et adv., loin, profond, profondément : « Por avouér eun p'chot d'ombre, j'ai r'planté l'âbre pu avant ». « J'ai vu l’trou ; ôl é ben avant ». - (14) |
| avantadzi v. Avantager. - (63) |
| avantage (A l’) : loc. adv., avantageusement. Se dit surtout d'un vêtement que l'on fait plus grand qu'il ne faut, pour les enfants qui doivent grandir ou pour les personnes qui veulent être à l'aise. - (20) |
| avantager (S') : v. r., se faire valoir, se vanter. - (20) |
| avantageux : adj., qui est fait à l’arantage. - (20) |
| avant-brais (n') : avant-bras - (57) |
| avant-déri (l’) : avant-dernier - (57) |
| avanté, v. a. retirer, arracher. - (22) |
| avanter, aveindre, atteindre, arracher, extraire. - (05) |
| avanter, v. a. retirer, arracher : avanter un seau tombé dans le puits (du latin aventare). - (24) |
| avanter, v. tr., aveindre : « Avante-me c'te bouéte ; i n' seù p'assez grande ». - (14) |
| avanter. Tirer une chose du lieu où elle se trouve : « avanter son mouchoir de sa potse » (poche). - (49) |
| avantò, s. m. partie d'un arbre fruitier surplombant le champ du voisin. Littéralement en avant sur toi. - (22) |
| avantre : Prendre, retirer un objet de l'endroit où il est placé. « Ol a avantu san cutiau de sa peuche » : il a retiré son couteau de sa poche. - (19) |
| avant-touaît (n’) - sevron (le) : avant-toit - (57) |
| avant-vin, m. : vieille branche de vigne qui, après plusieurs années, peut atteindre 2 m et qui est obtenue en taillant toujours le sarment qui se trouve à l'extrémité. Le raisin provenant d'un avant-vin fait un meilleur vin que ceux placés plus près du cep. (M. T IV) - Y - (25) |
| avanzière, avant-hier, la veille d'hier. - (16) |
| avâr, v., avoir ; « avâr sâ » : avoir soif. - (40) |
| avarigot : relief tourmenté - (51) |
| avaro (m), aventure. - (26) |
| avarô : 1 n. m. Avatar. - 2 n. m. Changement malheureux, n. f. aventure pénible. - (53) |
| avârse : Averse, ondée très forte, comme si l'eau était versée du ciel. « Le temps se charge, i va cheu eune avârse » : le ciel s'obscurcit, il va tomber une ondée. - (19) |
| avarti : Avertir, prévenir. « In homme avarti en vaut deux ». - (19) |
| avartichement : Avertissement. « Ol a ésu eune attaque i est in mauvâ avartichement » : il a eu une congestion cérébrale, c'est un mauvais présage, l'avertissement d'une fin prochaine. - (19) |
| avarver. v. a. Ebruiter. - (10) |
| avau : En bas. « Ol a cheu avau d'in noué » il est tombé d'un noyer. - (19) |
| avau : s. m., aval. Il y a en Saône-et-Loire plusieurs hameaux ou écarts dits Bois-d’Avaux, par opposition à Bois-d’Amont. - (20) |
| avau, en bas, daivau. - (04) |
| avau, te, adj., profond : « L'ià é frôche à mon pouit ; ôl é ben avau ». - (14) |
| avau. Profond. A vau l'eau, à la descente de l'eau. - (03) |
| avaurienner v. Dévergonder. - (63) |
| avaûser : écrouler - (57) |
| avaut, avaute, profond, profonde. - (05) |
| ave : Avec, « An prend pu de môches ave du mié qu'ave du vinâgre ». A la fin d'une phrase, on emploie : aveu. - (19) |
| ave, avo prép. et adv. Avec. Voir dave. - (63) |
| avé. f. m. Grappin pour tirer les seaux tombés dans les puits. - (10) |
| avé. n. m. - Grappin pour retirer le seau tombé dans un puits. Au XIIIe siècle un havet ou un haf.désignait un crochet, un croc ; ces mots seraient d'origine francique. - (42) |
| aveçou, s. m. orgelet. - (24) |
| aveîlli n.m. (du gaul. avia). Liseron. Voir veûillie, voîllie. - (63) |
| aveindre : v. n., vx fr., atteindre, arriver à, tirer sans effort. Voir Appondre et Aventer. - (20) |
| aveindre. Attirer. On dit aussi avanter. - (03) |
| aveindu, ee. partic. p. du verbe aveindre. Se dit pour aveint. - (10) |
| aveini. Mot fort expressif qui veut dire sans force, anéanti, comme si l'on n'avait plus de sang dans les veines. - (03) |
| avéne, s. f., avoine. - (14) |
| aveni : Echoir. « Quand i ant partagi leu butin le premé lot li est aveni » : quand ils ont partagé leur bien le premier lot lui est échu. Seoir, « San chépiau li avint bien » : son chapeau sied bien. - (19) |
| aveni, v. a. tirer de… arracher de… faire venir de... ma charrette était embourbée, je n'ai pu « l'av'ni. » - (08) |
| avenière, s. f., champ d'avoine. - (14) |
| aventer v. Sortir (de la literie ou des vêtements) de l'armoire pour les aérer (ce verbe figure dans le Littré avec le sens de placer au bon vent). - (63) |
| aventer : v. a., bas-lat. aventare, vx fr., tirer avec effort. Aventer une paire de draps (la tirer d'une armoire). - (20) |
| avents : Avent, les quatre semaines qui précèdent la fête de Noël. Ne s'emploie qu'au pluriel. - (19) |
| avêque, s. m. évêque. - (08) |
| aver (ai l'), loc. au revers, à l'opposé du soleil. Un champ est moins bon lorsqu'il est situé « à l'avers » c’est-à-dire au nord. En quelques lieux le champ de l'avers, c'est le cimetière. - (08) |
| avergeat, s. m. et avergée.s. f. Mèche de fouet ; verge ou ficelle qui le termine. - (10) |
| averi, abri. - Dans l'idiome breton, aber signifie havre, lieu où les navires sont abrités des vents. - (02) |
| averi. : Abri (M Del.), du latin apertura qui a aussi formé le mot aber (havre) du dialecte. - (06) |
| averio, s. m., abri léger dans les vignes. - (40) |
| avêtis et evétis. Ce qui est cultivé annuellement dans un champ. En terme de coutume locale « récolte pendant par racines, » Tous nos avétis sont saccagés parleks sangliers. Du latin adventus. - (13) |
| avette, s. f., abeille. - (14) |
| aveu : Avec « O n'âme pas miji san pain tout sou, il ly faut quèque chose aveu » : il n'aime pas manger son pain sec, il lui faut quelque chose avec. - (19) |
| aveu, èveu, avou, èvou ; aveu, èveu-lu, avec lui. - (16) |
| aveu. s. m. et aveùre. s. f. Nielle, carie du blé. - (10) |
| aveuc. Prép. - Avec. - (42) |
| aveugler, v. a. Boucher, fermer. Aveugler une voie d'eau dans un bateau, dans un navire, une brèche dans un bâtardeau, dans une digue. - (10) |
| aveuglote (à l'), loc, à l'aveuglette, sans lumière, sans y voir : « T'as ôblié ta lantarne ; t’vas t'en r'torner c'ment c'qui à l'aveûglote ». (V. Eveûglote). - (14) |
| aveuille : aveugle. - (29) |
| aveuillé, adj., émoussé (hache, scie). - (40) |
| aveuiller, aiveuiller. Aveugler - (49) |
| aveuilly, liseron. - (05) |
| aveule. s. f., aveugle. - (14) |
| aveuleteiz. : (Dial.), aveuglement. (S. B.) - (06) |
| aveur (ai l"), loc. en faveur de... à cause de... dans le but de... « i é fé ç'lai ai l'aveur de lu », j'ai fait cela en sa faveur. - (08) |
| aveuye : (adj) aveugle - (35) |
| aveuye n. ou adj. Aveugle. - (63) |
| aveu-yi : aveugler - (43) |
| aveuyi v. Aveugler. - (63) |
| aveuyon n.m. (à rapprocher de l'expr. : Ô cope autant qu'ô woit clair') Couteau mal aiguisé. - (63) |
| âviander : enlever la viande d’un animal, désosser - (37) |
| avié, 1. v. r. mettre en mouvement. — 2, adj. turbulent. - (22) |
| aviement, adv., promptement, lestement. - (11) |
| avier (s'), v. rèfl., se dit d'une machine, ou plutôt d'une montre qui, après s'être arrêtée, s'est remise en marche seule : « Ma montre s'étôt érâtée dans la neùt ; àll' s'è aviée pendant la preûmenade ». - (14) |
| avier : activer - (57) |
| avier : v. a., vx fr., aviver, activer, exciter. - (20) |
| avier v. (or. inc., p.ê. de activer). Avancer, accélérer, démarrer une activité, activer. - (63) |
| avier : v. a., mettre dans la voie (par opp. à dévier). - (20) |
| avier, 1. v. a. mettre en mouvement : la voiture s'est aviée subitement. — 2. adj. turbulent : il est trop aviè (du latin ad viam). - (24) |
| avier, mettre en train, en chemin. - (05) |
| avier. Mettre en marche. - (03) |
| avigner. v. a. Aveindre. - (10) |
| avigniaman. : Adverbe du cru et signifiant chose faite comme une vigne bien cultivée. Charte de Fontenai, 1272. - (06) |
| avis don (qu'). loc. interr. - Pourquoi. - (42) |
| avis donc (qu'). locul. interrogat. Pourquoi donc ? Comme si l'on disait : quel avis, quelle pensée, quelle idée donc avez-vous ? (Bleneau). - (10) |
| avisé, s'avisé. Te n't'an aviz'ré pas, d'fâre s'ki, ne songe pas de faire cela, se dit à quelqu'un pour le détourner d'une mauvaise action. - (16) |
| aviser : (vb) regarder - (35) |
| aviser : Regarder. « Avise le dan, le v'là qu'o passe ». - (19) |
| aviser v. (fr. : le verbe aviser était employé à la place de regarder jusqu'au XIXème siècle). 1. Regarder, voir. Avise-don chti qu'vint ! 2. Hasarder, risquer. T'avises pas de rcmenchi ! - (63) |
| aviser : v. a., vx fr.; regarder, voir. Avise-le. Voir viser. - (20) |
| aviser, regarder avec attention. Ou trouve aussi ce verbe dans les putois du nord de la France. - Qui bien se mire bien se voit ; - Qui bien se voit bien se cognoit ; - Qui bien se cognoït peu se prise. - Qui peu se prise Dieu l'avise. - (13) |
| av'niôles : étincelles. (B. T IV) - S&L - (25) |
| avò p'fare, loc. avoir d'une chose en abondance. Etre dans une situation aisée, prospère : l'avenir lui sourit, car il a p’fare. - (22) |
| avœrti, adj. habitué ; apprivoisé, pour un animal. - (22) |
| avœrti, adj. habitué; apprivoisé, pour un animal. - (24) |
| avoi, v. tr., avoir : « I voudro bon avoi l’temps, j’te plaindro, vrâ ! » - (14) |
| avoidre. v. a. Se dit, dans la Puysaie, pour aveindre, tirer une chose du lieu où elle est placée. Avoins tes habits. - Au figuré, se faire avoindre, se faire dire des sottises ou, autrement, se faire ramasser. - (10) |
| avoilli : v. arracher. - (21) |
| avoin’ne : avoine. Ainsi écrit pour assurer la prononciation « oin ». On dit l’avoin-ne de curé pour le poivre. - (62) |
| avoinde (v. tr.) : atteindre, arriver à prendre une chose éloignée ou élevée - (64) |
| avoindre : retirer,(B. T IV) - Y - (25) |
| avoindre, atteindre quelque chose ; en latin advehere. - (02) |
| avoindre. v. - Atteindre, extraire, tirer une chose du lieu où elle est placée. Ce verbe est une déformation de l'ancien français du XIIIe siècle aveindre, signifiant arriver, atteindre, avec une notion de temps. Le poyaudin a utilisé ce mot avec une notion de lieu, d'espace. - (42) |
| avoindre. : Usité à tort pour aveindre (vehere ad), atteindre. - Part. passé aveindu .(comte Jaubert). Nos paysans disent avoindre. - (06) |
| avoiner : disputer - (44) |
| avoiner, v. tr., engueuler quelqu'un. - (40) |
| avoiner. v. a. Régaler d'avoine. On donne l'avoine à un cheval pour l'encourager, pour l'exciter au travail par contre, on houspille, on régale de horions l'enfant qui n'a pas de cœur à l'ouvrage. C'est une autre manière d'avoiner qui produit aussi son effet. Autre définition. - Avoiner. v. a. Se dit, par antiphrase, pour battre, châtier, rosser. Tu as été bien avoiné ; j'espère que tu t'en souviendras. - (10) |
| avoin-ner : exciter un ouvrier en lui donnant à boire. (M. T IV) - Y - (25) |
| avoir de la remarque, locution verbale : être dégourdi, éveillé. - (54) |
| avoir la reutse : être enroué - (43) |
| avoisiné : Se dit en mauvaise part : « J'sins bien mau avoismé ». - (19) |
| avôler, v. tr., avaler. - (40) |
| avoltierge. : lDial.), dérivation du latin adulterium, adultère. - (06) |
| avone, avoine. - (16) |
| avorte : l' avoine - (46) |
| avot’chan : avorton. (LCSS. T IV) - S&L - (25) |
| avou (d’), aivou (d’) : avec. - (32) |
| avou : avec. Ou d’avou suivant (semble-t-il) la place de cette préposition dans la phrase. - (62) |
| avou, avec ; d'avou soi : avec lui. - (38) |
| avou, prèp., avec. - (14) |
| avou, prép., avec. - (40) |
| avoua ou avoi : Avoir. Se conjugue ainsi : j'ai, t'as, ol a, j'ins, vos ez, i ant. - J'avais, t'avais, ol avait, vos avez, i avaint. - J'ai ésu, t'as ésu, ol a ésu, j'insésu, vos ez ésu, i ant. - J'arai, pluriel j'arins. - (19) |
| avouain-ne : Avoine : « les avouain-nes sant balles ». - (19) |
| avouair : avoir - (57) |
| avouair faûte : avoir besoin - (57) |
| avouair seune : sommeil (avoir) - (57) |
| avouairer (v.t.) : chasser les mouches - (50) |
| avouanée, avouénée. n. f. - Correction, châtiment corporel. - (42) |
| avouaner, avouéner. v. - Corriger, châtier. - (42) |
| avoucat. n. m. - Avocat. - (42) |
| avoué (n') ni trotte ni mode, loc. manquer d'élégance, de distinction. - (24) |
| avoué p’faire, loc. avoir d'une chose en abondance. Être dans une situation aisée, prospère : l'avenir lui sourit, car il a p'faire. - (24) |
| avouène : avoine. - (52) |
| avouène : avoine - (39) |
| avouéne. n. f. - Avoine. - (42) |
| avouénée (n. f.) : correction, raclée (syn. ourser) - (64) |
| avouènée : raclée, vives remontrances. - (52) |
| avouenée : correction. - (33) |
| avouéner (v. tr.) : infliger une correction, une raclée (syn. ourser) - (64) |
| avouer, v.tr., avoir. - (14) |
| avouère. v. - Avoir. - (42) |
| avouillé, ée. adj. - Aveuglé, en prendre plein les yeux : « J'ons rentré les blettes, y en avait ! J'en étais tout avouillé ! » - (42) |
| avouillé, ée. adj. Aveuglé. - (10) |
| avouiller. v. a. Dégoûter d'un mets en en donnant trop souvent ou trop abondamment. - (10) |
| avouin-ne (gagni l'), loc. action pour un cheval de se rouler sur le dos dans le pré. - (24) |
| avouiñne : (nm) avoine - (35) |
| avouin-ne : s. f. avoine. - (21) |
| avouiñne de keûré : poivre - (35) |
| avouin-ne de queûré : poivre - (43) |
| avouin-ne, aouin-ne : avoine - (43) |
| avouin-ne, s.f. avoine (latin "avena") ; prononcer a-vou-in-ne - (38) |
| avouinne. Avoine. Prononcer « avou-in-ne ». - (49) |
| avourton, s. m., avorton. Outre son sens propre, s'emploie en injure contre les gamins : « Sauve-te d'iqui avourton! » - (14) |
| avoyâ, s. m., grenier ajouré et bien aéré (partie supérieure du hangar) pour faire sécher le chanvre, les haricots, etc... - (40) |
| avri : (nm) avril - (35) |
| avri : Avril. « Nos v'là au mois d'avri. Si i tonne en avri prépare tes baris ». « Poisson d'avri - mois d'avri » à la campagne c'est une farce qui consiste essentiellement à charger une personne naïve d'une commission absurde, comme par exemple de l'envoyer avec une hotte chercher chez le voisin un « meule de boudin », petit entonnoir à peine grand comme une tasse à café. - (19) |
| avrî n.m. Avril. - (63) |
| avri, abri ; s'mète ai l’aivri, se mettre à l'abri du vent. - (16) |
| avri, avril. - (38) |
| avri, avriller, abri, abriter. - (05) |
| avri, avril. Le mois d'avril ne commence guère sans que l'on donne à quelqu'un un poisson d'avri, c'est-à-dire, sans l'induire dans quelque erreur inoffensive, pour le plaisir de rire de lui, en le faisant aller d'un lieu à un autre. … - (16) |
| awe. : (Dial.), eau.- En patois eà et éaa. C'est la forme la plus rapprochée du dialecte français qui, de son point de départ aqua (latin), a donné successivement les formes aigue, aighe, aiwe, awe, ève, iève, iave, eave, eaue, et enfin eau. - (06) |
| awil. : (Dial.), oui.- Awil senz dotte, trouve-t-on dans les sermons de saint Bernard pour oui sans doute. - (06) |
| awoî n. et v. Avoir. - (63) |
| awoiñne de keûré n.f. Poivre. - (63) |
| awoiñne n.f. Avoine. - (63) |
| axordre. : (Dial.), pour assordre (du latin assurgere), faire sourdre, faire jaillir. - (06) |
| aya : age de la charrue - (43) |
| a-yan : gland - (43) |
| ayan : gland. - (30) |
| aÿanci : églantier - (51) |
| äyand, yand n.m. Gland. - (63) |
| ayangi : églantier. - (30) |
| a-yansi : églantier - (43) |
| äyansî, äyandé n.m. Eglantier. Les baies rouge-oranger de l'églantier sont appelées des gratte-culs. - (63) |
| ayant drouait (n’) : ayant droit - (57) |
| aye : age (ou flèche) de la charrue. A - B - (41) |
| âye (ai l') : facilement - (39) |
| âye (ât’e ben) : être bien content - (37) |
| aye (n.f.) : aise - (50) |
| âyé : aisé, facile - (37) |
| âyé : facile - (39) |
| ayé, aisé - (36) |
| aye, s. m. un coup d'aye, coup de fouet donné au cheval pour l'exciter - (08) |
| âyemans (n.m.pl.) : récipients de cuisine - (50) |
| â-yements, s. m., ensemble des instruments nécessaires au ménage, vaisselle. - (40) |
| ayensi : églantier. A - B - (41) |
| ayensi : églantier - (34) |
| ayer : hangar. (M. T IV) - Y (N. T IV) - C - (25) |
| ayette. s. f. Se dit pour layette, menu coffre, boîte, tiroir de bois blanc léger. - (10) |
| ayeumer : allumer - (51) |
| ayeure : gerbes déliées sur l'aire de la grange avant d'être battues au fléau. A - B - (41) |
| ayeuter : avoir des haut-le-cœur. A - B - (41) |
| ayeuter : avoir envie de vomir - (44) |
| ayeuter : contractions de l'estomac - (34) |
| ayeuter, èyeuter. Faire des efforts pour vomir. - (49) |
| ayi, interj. va t'en. - (24) |
| ayianné (adjectif) : fatigué à l'extrême. - (47) |
| äyinsi : (nm) églantier - (35) |
| az’man, aiz'man, vaisselle de ménage. - (16) |
| aza (bé d") : bien étonnant. (S. T III) - D - (25) |
| âze (n.m.) : âge - (50) |
| aze, aise ; el ènme sëz àze, il aime ses aises. - (16) |
| âze, s. m. âge. « l'âze preuntanié », la jeunesse. - (08) |
| azerotte : n. m. Asticot de rivière dans un étui. - (53) |
| aziau : ustensile usé - (39) |
| âzié : aisé, facile - (48) |
| azille : facile, aisé - (46) |
| aziye, aisé, facile, d'où dérive môlâziye, malaisé, difficile. - (16) |
| az'rotte : traîne-bûche (larve de phrygane) - (48) |
| azu, lavoir - (36) |
| b : Deuxième lettre de l'alphabet. « O ne sait ni a ni b » : il est complètement illettré. - (19) |
| b. (Être marqué au). Avoir tous les défauts, j'ai cru longtemps que cette locution était tout à fait locale ; le bourreau de Beaune marquait au fer rouge, sur l'épaule de certains malfaiteurs, l'empreinte de la lettre B : un document de l’année 1575 relate une exécution semblable. Mais l'usage de ce dicton dans des pays fort éloignés du nôtre m'a fait abandonner cette croyance. - (13) |
| b’laiyer, bailaiyer : balayer - (37) |
| b’ler : (vb) donner des secousses dans un membre (« y m’beule ») - (35) |
| b’leutte : (nf) belette - (35) |
| B’nat : (NP) Benoît - (35) |
| b’nati : bénitier - (43) |
| b’non : (nm) panneton pour faire lever la pâte du pain - (35) |
| b’non : paneton, corbeille en paille où la pâte du pain est mise à lever - (43) |
| b’saiçou : porteur de besaces, colporteur - (37) |
| ba dos (à), locution, (marcher) en se baissant. - (38) |
| ba, bec. - (05) |
| ba, s.m. bec. - (38) |
| ba. Bas. - (01) |
| baa. Baal, idole des Phéniciens révérée à Samarie par Achab roi d’Israël. Baa pour Baal, comme on prononce arsena quoiqu'on écrive arsenal. - (01) |
| baba (à), loc, à boire ! On emploie ces mots avec les enfants, et les enfants les ont adoptés dans leur vocabulaire. - (14) |
| Bâba, Baliche, n. propre. Elisabeth. - (38) |
| babaude : s. f., vx fr. raballe, pelle composée d'une planchette rectangulaire et d'un long manche, servant à ramasser le blé sur l'aire, à déblayer là neige, etc. - (20) |
| babeigne. Babine, babines, burlesquement lèvres… - (01) |
| Bâbète, Elizabeth. - (16) |
| babeuille n.f. Femme qui parle à tort et à travers. - (63) |
| babeula : pleurnicheur - (51) |
| babeuler : pleurnicher - (51) |
| babeute : auge chez les bovins (anatomie) - (51) |
| babeute, babia : bavard, quelqu'un de bavard - (43) |
| babia : bavard - (51) |
| babiche, philibert. - (05) |
| babieau, homme à grosses lèvres. - (05) |
| babigne. Babine, lèvre. - (49) |
| babignier. n. m. - Désigne celui qui a de grosses lèvres. - (42) |
| babignotai : remuer les lèvres. Le chien babignote. - (33) |
| babignoter : grignoter, remuer les lèvres - (39) |
| babilla : Babillard, causeur. « Les fanes (femmes) sant pu babillardes que les hommes ». « Copère babilla, commère babillarde » jadis à la cérémonie du baptême on conviait, outre le parrain et la marraine un copère babilla, chevalier servant de la marraine, et une commère babillarde capable de babiller avec le parrain. - (19) |
| babïllâ adj. Bavard. - (63) |
| babille, s. et adj., femme qui cause beaucoup, babillarde : « N'crès pas tout c’ qu’all’te dit ; y et eùne grande babille ». - (14) |
| babïlli v. Parler abondamment jusqu'à ce que l'interlocuteur n'écoute plus. - (63) |
| babine, babigne. s. f. Lèvre. - (10) |
| babines : lèvres. L'hiver les babines gerson : l'hiver les lèvres gercent. En français : lèvres en ce qui concerne les animaux. - (33) |
| babinier. s. m. Qui a de grosses lèvres. Dans la Puysaie, on dit babignier. - (10) |
| babinotter. v. - Marmonner, parler du bout des lèvres : « J'la vue, a babinottait des priées pa' l'ch'min d'Druyes. » - (42) |
| babinotter. v. n. Marmotter, remuer les lèvres, les babines. - (10) |
| babioler v. Dire des futilités. - (63) |
| bablot. s. m. Qui répète sans cesse la même chose en bégayant. Du latin balbus. - (10) |
| bablotter. v. n. Répéter incessamment la même chose en bégayant. – Par une sorte d'analogie, sautiller, courir ca et là. Voyez bablot. - (10) |
| babo : Mal, bobo dans le langage enfantin. « Plieure pas, man p'tiet, y a point de babo » : ne pleure pas mon petit, il n'y a pas de mal. - (19) |
| babô, s. m. bobo, petit mal, souffrance légère dans le langage enfantin : « poure p'tiô, al é deu bâbô » - (08) |
| babo, s. m., bobo. Se dit volontiers en parlant aux enfants : « T'as babô ? Attends ; j’vas t' biser ». Le baiser compte toujours pour le meilleur remède. - (14) |
| baboche (faire la) : faire la moue - (60) |
| baboche : moue - (44) |
| baboésser : parler à tort et à travers - (39) |
| baboéssou : quelqu'un qui « baboésse » - (39) |
| babole : s. f., babiole, jouet d'enfants, chose de peu de valeur. - (20) |
| babolin : escargot. - (58) |
| babouéé : n. m. Babouin. - (53) |
| baboueille (ai lai), a la débandade. On dit le jour d'une foire ou d'un marché que tout va « ai lai baboueille », lorsque les denrées sont à vil prix, lorsque les marchandises ne trouvent pas d'acheteurs. - (08) |
| babouigniére, s. f. celle qui a de grosses lèvres ; femme qui fait la moue. Au figuré grognon, maussade. - (08) |
| babouille (à la), à foison. - (27) |
| babouille, à profusion. - (26) |
| babouin, enfant au berceau. - Dans l'idiome breton, babouz signifie bave, salive. (Le Gon.) Le mot français bavard semblerait avoir la même étymologie. - (02) |
| babouin, s. m. celui qui a de grosses lèvres, des lèvres pendantes, qui fait la moue. - (08) |
| babouin, s. m., qui a de grosses lèvres, lippu. - (14) |
| babouin. Petit enfant qui commence à parler. A Autun, un babouin, que l’on prononce boboingne est tout simplement une poupée. La racine de ce mot, bab est le premier son qui s'échappe des lèvres d'un petit enfant. Elle a formé notre patois babouines, lèvres, babil, balbutier, bébé, et le vieux mot babinage. - (13) |
| babouine (nom masculin) : babine d'un animal. - (47) |
| babouine, s. f. babine d'animal ou grosse lèvre humaine comme terme de moquerie. - (08) |
| babouine, s. f., babine, grosse lèvre. - (14) |
| babouine, subst. féminin : lèvre, babine. - (54) |
| babouine. Grosse lèvre. « Tendre la babouine » c'est faire la grimace, être de mauvaise humeur. - (49) |
| babouines : grosses lèvres. - (52) |
| babouines : lèvres - (44) |
| babouines : lèvres, babines - (48) |
| babouines : babouines - (39) |
| baboulette : voir barboulotte - (23) |
| baboulotte (une) : une coccinelle - (61) |
| babter : parler pour ne rien dire - (51) |
| babter, tabailli : bavarder - (43) |
| babyi : bavardage - (43) |
| bacaiche : Bécasse, le mot bacaiche est vieilli et peu usité, aujourd'hui on dit plutôt bécasse. - (19) |
| bacailler. v. - Marchander, discuter, parler fort comme un maquignon. - (42) |
| bacailler. v. n. Aimer à crier fort, à parler, à marchander, à disputer, comme font les maquignons entre boire. - (10) |
| bacailleux. adj. et s. m. Se dit des maquignons et autres gens qui courent les foires et les marches, en parlaillant, en criant, en buvant, en discutant tout haut leurs marchés. - (10) |
| bacailleux. n. m. - Celui qui bacaille. Se dit généralement des maquignons, des camelots et des personnes qui courent les foires. - (42) |
| bacaler v. (or. inc. on retrouve ce verbe avec le sens de bêler dans le patois poitevin). Bêler de souffrance en parlant spécialement de la chèvre lorsqu'elle met bas. - (63) |
| bacelon. Sorte de sarcloir. - (03) |
| bachas, bachasse. Auge. - (49) |
| bachasse : 1° auge, 2° pétrin. - (21) |
| bachasse : long baquet évasé recevant peau d'une source pour servir d'abreuvoir et de lavoir. - (30) |
| bachasse : s. f., vx fr., auge ; syn. aussi de pâtière. - (20) |
| bâchasse, n.f. abreuvoir, auge. - (65) |
| bachassée : s. f., contenu d'un bachat. Not’ Mossieu à mangé une pleine bachassée de truffes. - (20) |
| bachat (nom masculin) : auge à cochon (généralement en fonte). - (47) |
| bachat : baquet plus petit qu'une hachasse servant à la volaille. - (30) |
| bachat : s. m., vx fr., auge à cochons, et, par dérision, assiette d'un individu qui mange salement. Manger au même bachat, boire au même verre, être très familier avec quelqu'un, ne pas se craindre. - (20) |
| bache (bâche) : s. f., ancienne mesure de capacité pour le charbon de bois, valant 200 décalitres 197. - (20) |
| bache (bâche) : s. f., vx fr., bachut, s. m., banneton, boutique à poissons, coffre en bois, percé de trous, et faisant ordinairement partie intégrante d'un bateau, pour conserver le poisson dans l'eau vive. - (20) |
| baché (bâché), bachée : part. pass., habillé. S'emploie avec bien ou mal. - (20) |
| bâche et bage. s. f. Auge, récipient propre à contenir une certaine quantité d'eau. La bâche d'une pompe. La bâche d'une forge. - (10) |
| bache, couverture en toile ou en cuir pour soutenir et préserver les objets placés au-dessus d'une voiture. - Dans l'idiome breton, bac'ha signifie renfermer. (Le Gon.) - (02) |
| bâche, s. f., sac à grains ou à légumes. - (40) |
| bâche, s.f. sac. - (38) |
| bache. Grand sac de toile grossière. - (49) |
| bâche. n. f. - Couchette, paillasse d'un lit réservée au commis de ferme pour dormir. (Voir F.P. Chapat, p36) - (42) |
| bâche. s. f. Lit, paillasse d'un lit. Va-t-en à la bâche, va te coucher. (Champignelles). - Se dit peut-être aussi parce que souvent, dans les campagnes, les lits ne consistent qu'en une sorte de boite ayant la forme d'une auge. - (10) |
| bâche. Signifie en Bourgogne un sac en grosse toile propre à toutes sortes d’usages, mais particulièrement à mettre des grains ou de la farine. Etym. bâche, pièce de toile grossière ou de cuir dont on recouvre les charrettes, les diligences, les bateaux, etc. Dans un autre sens bâche est une mesure locale usitée pour les céréales, les farines, et certains légumes. Elle n'est pas la même pour toute la région, et varie avec les localités. - (12) |
| bachée : Becquée. « Donner la bachée es p'tiets ujos (oiseaux) ». Ce qu'un oiseau peut emporter dans son bec : « Eune bonne bachée ». - (19) |
| bachelan : Sarcloir, sorte de petite pioche dont on se sert pour sarcler le jardin. - (19) |
| bachelé : adj., muni d'un bachut. Bateau bachelé, bateau dont le bachut occupe presque toute la longueur, et qui ne sert guère que de réservoir à poisson. - (20) |
| bachelon : petite pioche étroite A - B - (41) |
| bachelon : petite pioche étroite - (34) |
| bachelon. Sarcloir, binette. - (49) |
| bacher (ā), vt. baisser. - (17) |
| bâcher, v. a. baisser. Se bâcher. v. pronom. Se baisser. (Domecy-sur-le-Vault). - (10) |
| bachesse, s. f. abreuvoir. - (24) |
| bachet : Auge pour les porcs. - (19) |
| bachet : auge des porcs. - (21) |
| bachet, s. m. petite auge de pierre (vieux français bachas). - (24) |
| bachevot. s. m. Manière de disposer certains objets qu'on met on pile, et qui consiste à placer alternativement les gros bouts sur les petits ou la tête sur les pieds ou à côté des pieds, afin que la pile soit plus égale. Les cochons, dit-on, se couchent à bachevot, c'est-à-dire côte à côte, le derrière de l'un contre la tête de l'autre ; de même, les petits pigeons dans leur nid. On dit mieux béchevet, et mieux encore bichevet, mot qui s'entend d'un lit à deux chevets, l'un à la tête et l'autre aux pieds. De bis et chevet. - (10) |
| bachevotter. v. a. Mettre à bachevot. - On dit aussi bichevoter, ce qui est plus correct et plus conforme à l'étymologie. - (10) |
| bachi : Briser les mottes avec une pioche à cornes, dans une terre fraîchement labourée : « Ol est allé bachi en la Mauvase tarre » : il est allé briser les mottes à la Mauvaise terre. - (19) |
| bachin : louche en cuivre servant à prendre de l'eau dans un seau. A - B - (41) |
| bachin (n.m.) : échelon, barreau - (50) |
| bachin n.m. Louche à fond plat, spécialement pour prendre l'eau potable dans le seau. Alle prend bachin p'seuille. Elle fait tout à l'envers. (Il n'y a plus guère que dans cette expression que l'on emploie le mot seuille à la place de siau). - (63) |
| bâchins, s. m. bâtons d'échelle, échelons. - (08) |
| bachlon Voir beuchlon. - (63) |
| bachò, s. m, auge de pierre. - (22) |
| bachois : dernier-né, petit (bouculet) - (60) |
| bachole : vx fr., bachoule, bechoule, s. f., cheval (voir ce mot) dont les barreaux et les portions de perches qui dépassent la traverse sont garnis d'un treillis d'osier, de manière a former un récipient dans lequel on transporte la terre, le fumier, et autres choses semblables ; tout genre de hotte servant au transport des mêmes matériaux. - (20) |
| bâchot : bachut de barque. Compartiment dans une barque de pêche, réserve intégrée où le poisson pêché peut rester en eau vive. Une bachotte est un tonneau pour transporter des poissons vivants. - (62) |
| bachot : Jumeau. « Alle a ésu deux bachots » : elle a eu deux jumeaux. - (19) |
| bachot : s. m., bateau qui contient un bachut. - (20) |
| bachot, s. m., dimin. de bac. bateau à compartiments troués pour garder le poisson vivant : « J' voulons eùne meûrette ; vas qu’ri c’qu’i faut dans ton bâchot ». Ce substantif désigne le bateau tout entier. - (14) |
| bachoûle : récipient de bois en forme d'auge, où le tuilier mettait son sable. - (21) |
| bachoule, s. f. hotte sans anses pour la terre ou le fumier. - (24) |
| bachut, s. m., partie du milieu du bateau de pêche, fermée et à jour, et dans laquelle le poisson reste en eau vive jusqu'à ce qu'on le mette à la sauce ou à la poêle. Les Verdunois emploient un peu indistinctement bâchot et bâchut, et pour les uns ils sembleraient presque synonyme, alors que chez d'autres nous avons remarqué la nuance indiquée. - (14) |
| bâchut. Petit réservoir en bois percé de trous pour permettre à l'eau d'y pénétrer, et conserver le poisson qu'on y renferme. Ce réservoir fait souvent partie du bachot (petit bateau (Littré), ou des bateaux qui servent à la pèche. Etym. bâche, dans le sens français du mot, qui signifie un encadrement en bois pour toute sorte d'usage, et même une cuvette à recevoir de l'eau (Littré). - (12) |
| baclot, baculot. Jeu de plein air. Se joue avec un bâton de trente à quarante centimètres, de la grosseur d'un manche à balai et un autre à peu près de la même grosseur, long seulement de dix à quinze centimètres, appointi à chaque extrémité : c'est le baculot proprement dit... - (49) |
| baclote. s. f. Vieille voiture pouvant encore à peine servir, et qu'on ne charge qu'à moitié. - (10) |
| bacolle. s. Belette. - (10) |
| bacon. : Emprunt fait aux Anglais. Bacon de porc, quartier de lard. (Franchises de Châtillon, 1371.) - Chambes de baquons salez, jambons. (Franchises de Seurre, 1341.) - (06) |
| bacot : Bec. « Le miarle (merle) a le bacot jaune). Dans le langage enfantin, bacot, bacotte, veut dire bouche : « Euvre (ouvre) voir tan p'tiet' bacot! ». - (19) |
| bacot, paquet de paille. - (02) |
| bacot, sm. gerbe de seigle enfunnie, propre à faire des liens. - (17) |
| bacoulé, frapper à coups de bâton ; en latin baculum. Etre baculé à coups de souliers à double gensive (escraignes de Dijon), c.-à-d. être battu à coups de souliers à double semelle. - (02) |
| bacqueillôt : entrave (vaches) - (48) |
| bacqueîllot : pièce de bois attachée au cou et laissée pendante entre les pattes pour entraver le bétail. On met un bacqueîllot è une vache maline. - (33) |
| bacquer : Becqueter, frapper avec le bec. « T'appreuche pas de la cluche (poule qui couve) alle te bacquerait ». On dit d'une personne marquée de la petite vérole : « Alle a été bien bacquée ». - (19) |
| bacquerieau, petit baquet emmanché. - (05) |
| baculard. s. m. Littéralement, traineur de bâton. - Au figuré, traînard, lanternier, badaud, musard. Du latin baculum. - (10) |
| baculer et bacouler. : (Dial.), baculé (pat.), frapper à coups de bâton (du latin baculus). - (06) |
| bacûlot, s.m., sujet « bas du cul ». - (40) |
| bâculot, subst. masculin : jeu inspiré du hockey. - (54) |
| bacuter : paresser. (F. T IV) - Y - (25) |
| bacuter. v. n. Travailler sans soin à des ouvrages qui demandent peu de soin. - (10) |
| bacutier. s. m. Celui qui bacute. - (10) |
| bacutis. s. m. pi. Objets, travaux de peu d'importance. - (10) |
| bade (à la) : en liberté - (51) |
| bade (à la) : en liberté. Aller, lâcher un troupeau « à la bade ». - (62) |
| bade : Usité seulement dans « aller à bade ». Qui se dit des animaux de trait qui cheminent en liberté à côté de leurs pareils qui sont attelés ou qui sont menés simplement par le licol sans être attelés « Le chevau était applia, mâ la jement allait à bade » : le cheval était attelé mais la jument suivait en liberté ; « j'ai mené farrer (ferrer) man chevau, ma je l'ai mené à bade (à la main) ». - (19) |
| bade n.f. Aller à la bade : aller de-ci, de-là, errer. Voir abade. - (63) |
| badet. badette, ou badé, badée. Mêlé de blanc et de noir, nuance. Etym. badius, bai, très probablement. Mais alors, il est extraordinaire que notre sens soit si éloigné de celui de bai. - (12) |
| badiet : pans de veste. - (21) |
| badigoinces, badigoines, badingoinces. s. pl. Les joues, les lèvres, les mâchoires en général, tout ce qui tient à la bouche. Du bas latin badare, bader, ouvrir la bouche. - (10) |
| badigoinces. Mâchoires, dents, joues. M. Jossier dérive ce mot du bas-latin badare, ouvrir la bouche, bâiller. Badaud, bagout, l'adjectif bagouin, usité dans l'Yonne, et le verbe baragouiner : On trouve dans tous ces termes les syllabes ba ou bad, lèvres et gan mâchoire, qui a formé le français guenon. Une meire gangan est une vieille femme au menton branlant. Notre mot ganache est la traduction de l'italien ganascia qui signifie : mâchoire. - (13) |
| badigoincher (v. int.) : manquer de stabilité, osciller, remuer de ci de là - (64) |
| badigoincher : faire des plis disgracieux, aller de travers - (60) |
| badigoincher. - Se dit d'un objet ou d'un ensemble peu stable, en déséquilibre : « Gade la r'morque, ça badigoinche su' l'couté. » (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| badigoinches : mâchoires - (60) |
| badigoinches, babignes. n. f. pl. - Badigoinces, babines, lèvres : se lécher les badigoinches. - (42) |
| badinage : s. m., jouet. - (20) |
| badinguet : simplet - (39) |
| bâdio : bête, benêt, simplet - (46) |
| badji. n. m. - Ourlet. (Mézilles, selon H. Chéry) - (42) |
| badoche (na) : bal (de mariage) - (57) |
| badolin, adj. faible d'esprit, en langage plaisant. - (24) |
| badoue (en). Locut. adverb. usitée dans cette expression : Porter en badoue, pour porter sur ses épaules. - (10) |
| badralle : femme qui parle à tort et à travers - (43) |
| badrée (n. f.) : compote de prunes cuites avec du sucre - (64) |
| badrée : bouillie épaisse. Des légumes trop queutes font une badrée : des légumes trop cuits font une bouillie épaisse. - (33) |
| badrée : matières, légumes ou fruits (souvent cuits) réduits en purée. Ex : "T'as si ben fait cuie tes truffes qu' tu nous doune de la badrée !" (Dans ce cas, ce n'est certes pas un compliment !). - (58) |
| badrée. n. f. - Bouillie épaisse. Autre sens : terre boueuse. Au figuré : grosse femme à l'apparence négligée. « Te parles d'eune grousse badrée, c'te femme là. » - (42) |
| badrée. s. f. Tarte à la crème, au fromage ; bouillie épaisse faite de légumes ou de substances farineuses. - Se dit aussi, en certains endroits, d'une grosse femme à l'air malpropre. - (10) |
| badrelle : (nf) femme bavarde - (35) |
| badrouille : pas très malin - (46) |
| bafeugnon : groin du porc. A - B - (41) |
| bâfeûgnon n.m. (de la racine baf, bouche boursouflée et de feugnon, museau d'après Mario Rossi). Groin du porc. - (63) |
| baffe (bâfe) : s. f., vx fr., soufflet, giffle. - (20) |
| baffer : v. a., « foutre » une baffe, giffler. - (20) |
| baffer. v. a. Se moquer de quelqu'un, le bafouer, le souffleter. (Percey). - (10) |
| baffiner, ébaffiner : v. a., égratigner. - (20) |
| baffutai : discuter sans conviction. - (33) |
| baffuter. v. - Critiquer, dénigrer. Autre sens : plaisanter. « On baffute la marchandie, on s'dispute, on s'dit des sotties, pou' ach'ter un méchant poulain. » (Fernand Clas, p.l42) - (42) |
| baflard : vantard - (60) |
| bafleux, menteur - (36) |
| bâflou (-ouse) (n.m. ou f.) menteur (-euse). Celui ou celle qui trompe sans scrupule - (50) |
| bâflou, ouse, adj. menteur impudent, celui qui trompe sans scrupule - (08) |
| bafoïlli v. Bafouiller. - (63) |
| bafouèiller : bafouiller - (48) |
| bafoueiller : bafouiller, bredouiller - (39) |
| bafoueillou (oure) : quelqu'un qui « baffoueille » - (39) |
| bafouiller. Bredouiller ; parler à tort et à travers, sans bien savoir ce que l'on dit. - (49) |
| bafouilli - bejotter : bafouiller - (57) |
| bafouillon, bafouilloux. Bafouilleur. - (49) |
| bafouillou : n. m. Bafouilleur, qui raconte des balivernes. - (53) |
| bafrai, faire bombance ; en vieux français baffrer. (Lac.)... - (02) |
| bafrai. : Faire bombance. (Dial. et pat.) - (06) |
| bâfrée, s. f., bâfre, repas copieux, abondant, et pris avec gloutonnerie : « Ol a migé à la noce... Dieu de Dieu ! Queuee bâfrée ! . . . » - (14) |
| bâfrer : manger rapidement et salement - (48) |
| bâfrer, v. tr., manger copieusement et gloutonnement : « O bâfre, ô bâfre ; j' sais vrâment pas queù ventre qu'ôl a ». - (14) |
| bâfrer. v. n. Manger gloutonnement. - (10) |
| bâfreur. s. m. Glouton, mange-tout. - (10) |
| bafrou, s. m., glouton, bâfreur. - (14) |
| bafuter (v. tr.) : dire du mal de, dénigrer - (64) |
| bafuter : critiquer, déprécier - (60) |
| bafuter : médire, bousculer verbalement, gronder. Ex : "Té vas-t-y m'bafuter longtemps ?" - (58) |
| bafûter. v. n. et v. a. Dire ou faire quelque chose d'inconvenant, de blâmable. Douter de la probité, de la capacité de quelqu'un. Critiquer, déprécier, dénigrer, rebuter, rejeter avec dédain. « I n' faudrait pas avoir l'air de bafûter. » - (10) |
| bagages (faire ses), paquets (faire ses) : loc, se dit dea personnes qui présentent de la carphologie (signe de danger imminent dans certaines maladies). - (20) |
| bage (pour bâche), s. f. Auge. - (10) |
| bage. n. m. - Abreuvoir, auge. - (42) |
| baggueulle : se dit de quelqu'un qui « bagueulle » - (39) |
| bag'nauder : errer (nez en l'air) - (48) |
| bagnauder, muser, lambiner. - (38) |
| bagne (na) - bugnot (on) : beignet - (57) |
| bagne (na) : baignade - (57) |
| bagneau. n. m. - Enclos (Dracy, selon M. Jossier) - (42) |
| bagneau. s. m. Enclos, verger. (Dracy). - Petite voiture à panier en usage dans la Puysaie, pour transporter le charbon. - (10) |
| bagni (se) : baigner (se) - (43) |
| bagni : baigner - (57) |
| bâgnî v. Baigner. - (63) |
| bagnole. s. f. Mauvaise voiture. - (10) |
| bâgnon n.m. 1. Cuvier à lessive. 2. Egouttoir à fromage. Voir freumâdzîre. - (63) |
| bagnon : s. m., vx fr. baignon, baquet en bois, « Entre vos baquets et vos bagnons... », dit à une plattière le rédacteur du Courrier de Saône-et-Loire à Chalon (7 mars 1905). - (20) |
| bagnot : grande corbeille en osier avec ou sans anses (resse) - (60) |
| bagnou (on) : baigneur - (57) |
| bagoin. n. m. - Personne très bavarde, qui ne cesse de parler. - (42) |
| bagoter : se déplacer, dans le sens perdre du temps en déplacements inutiles. - (56) |
| bagotter : se déplacer, dans le sens de perdre du temps en déplacements inutiles. - (56) |
| bagoueillai : parler vite. Bafouiller : Quouai qu'tu bagou'eilles ? : qu'est-ce que tu bafouilles ? - (33) |
| bagouéiller : bafouiller, parler vite - (48) |
| bagouillé : celui qui parle trop. Un bavard. Ex : "Acoute don pas çu bagouillé". - (58) |
| bagouiller : parler sans cesse, c'est-à-dire trop. - (58) |
| bagouiller. v. - Parler trop rapidement, de manière incompréhensible. Se dit également de celui qui bégaie. - (42) |
| bagouin. s. m. Homme qui parle sans cesse en bredouillant. - (10) |
| bagouler, bagouiller. v. n. Parler à tort et à travers, déraisonner. - Se dit aussi de celui qui bégaye. - Bagouiller le sang, rendre le sang par la bouche. - (10) |
| bague : Anneau, alliance. « Alle a pardu sa bague ». Le jeu de bague que l'on voyait autrefois dans les fêtes foraines était une sorte de manège de chevaux de bois taillés à coup de serpe, au-dessus desquels était suspendue une bague qu'il s'agissait d'enlever au passage au moyen d'une baguette que l'on tenait à la main. - (19) |
| bagué, part. pass. d'un v. « baguer » inusité a l’infinitif. Entassé, empaqueté, empilé. - (08) |
| bagueau. n. m. - Petite voiture équipée d'un panier pour le transport du charbon (M. Jossier, p.ll ). Grand panier d'osier (F.P. Chapat, p36). - (42) |
| baguenaudai, s'amuser à des riens. - Le mot breton bachgen, d'après Davies, et, chez les Gallois, bychan, signifient petit. (Voir le Gloss. de Price.) - (02) |
| baguenauder (verbe) : perdre son temps. - (47) |
| baguenauder, v .; bavarder. - (07) |
| baguenauder. S'amuser avec des camarades. Ce mot pourrait venir du celtique bagad, rassemblement. C'est l'origine du nom des Bagaudes, paysans révoltés, au III e siècle, contre le césarisme de Dioclétien. - (13) |
| baguer : se dit d'un tricot trop large, mal ajusté. - (30) |
| bagues, n. fém. plur. ; linge, habits ; laver les bagues, sarrer les bagues. - (07) |
| bagues, s. f. pl. habits en général. - (22) |
| bagues. s. f. pl. Linge, vêtements, bagages. On disait autrefois des habitants d'une ville conquise, un peu ménagée par les vainqueurs, qu'ils avaient pu sortir vie et bagues sauves. - Les bagues et joyaux d'une mariée, son trousseau, ses bijoux. - (10) |
| baguet. s. m. Mouvement saccadé, brusque, intermittent. - (10) |
| baguette : Férule dont faisaient jadis usage les maîtres d'école, qui en guise de punition, en frappaient l'écolier fautif obligé de tendre sa main ouverte pour recevoir le coup, bien heureux encore quand on ne l'obligeait pas à dire : merci ! - En viticulture : courson de la taille longue « I faut laichi (laisser) des baguettes es chaudenas » : la taille longue convient aux plants de chardonnais (cépage blanc), il faut leur laisser des baguettes. - (19) |
| baguetter (bag'ter) : v. a., vx fr., battre des vêtements, des tapis, etc. - (20) |
| bagueuler (verbe) : prendre un mauvais pli agissant d'un vêtement. - (47) |
| bagueuler(baigueuler) - (39) |
| baguis. s. m. Cousage au moyen duquel sont maintenus les plis multiples et longitudinaux d'une garniture de robe, de jupon ou de bonnet. - (10) |
| bagunauder : baguenauder (français) - (51) |
| bahuler : crier très fort, aussi : hurler en modulant. Se dit à propos du chien, surtout, quoique l'homme ne soit pas exempt de l'acte de bahuler, ce qui devient désobligeant le concernant. Ex : "T'as don pas fini d'bahuler coumme ça ?" - (58) |
| bahuler, bahurler. v. - Hurler à la mort, comme un loup. - (42) |
| bahurler. v. n. Hurler comme un loup. - (10) |
| bahut, vieux coffre. A Genève on dit bahiu... - (02) |
| bahuter. v. - Chahuter, malmener, bousculer. - (42) |
| bahuter. v. a. Malmener, bousculer, chasser. - (10) |
| bai (adv.) : bien - (50) |
| bai : (bê:, belle - adj.) beau, belle (ne s'emploie qu'en fonction d'attribut) - (45) |
| bai. : Bec, d'où haiquée (becquée). - (06) |
| baibillé, vn. babiller. - (17) |
| baibillô. Bavette. Baibillô de l’italien babaivola. - (01) |
| baibingne, sf. babine. - (17) |
| baiblue : étincelle. (MLV. T III) - A - (25) |
| baiche : Vallée, dépression de terrain. « La baiche de Vaumorian, la baiche du Creux des Las (lieux dits) ». - (19) |
| baiché : v. t. Baisser. - (53) |
| baicher (se) : baisser (se) - (39) |
| baicher (v.t.) : baisser - (50) |
| baicher : baisser - (48) |
| baicher : baisser. Baiche un peu l'abat-jour ! : baisse un peu l'abat-jour ! - (33) |
| baicher, v. a. baisser, mettre plus bas. Ces hommes-là « baichan lai tête »..., baissent la tête. - (08) |
| baichi : Baisser, s'affaiblir. « Sa vue baiche » sa vue s'affaiblit. - Diminuer de prix, « Le blié a bien baichi »: le prix du blé a bien diminué. - (19) |
| baîchi v. Baisser. - (63) |
| baie : beau - (48) |
| baie. s. f. Attrape, mystification. Faire la baie à quelqu'un, c'est lui offrir, lui présenter une chose, et la retirer vivement au moment où Il croit mettre la main dessus. - (10) |
| baie-pére : beau-père - (48) |
| baiffe (aine) : (une) gifle - (37) |
| baîffrer : manger goulûment, gloutonnement - (37) |
| baifouillou : celui qui dit n’importe quoi, menteur - (37) |
| baigneuse : s. f., repli fait a une robe ou à une jupe pour l'orner, ou pour pouvoir l'allonger en cas de besoin. - (20) |
| baigni : Etre voilé de brume en parlant des astres. « Quand la leune baigne y est signe de pliô (pluie) ». - (19) |
| baignoire : s. f., cuve ovale en bois destinée a recevoir le vin qui sort du pressoir, et, dans certaines localités, a transporter aussi le raisin de la vigne au tinalier. Syn, de recevou. - (20) |
| baignouaîre (na) : baignoire - (57) |
| baignouée : espace de ruisseau (ou mare) réservé aux bestiaux ou chevaux pour s'abreuver. Ex : "Té conduis-t-y tes j'ments au baignouée ?" - (58) |
| baigou ou bagou , bavardage. - Chez les Bretons, bek ou beg, au pluriel begou, signifie bec, bouche. Dans le vieux français, bagouler veut dire parler beaucoup. (Lac.)... - (02) |
| baigouillou : n. m. Bègue. - (53) |
| baigues. Bagues, pour bagages, nippes. - (01) |
| baigues. Linges, vêtements et joyaux appartenant en propre à un individu. Lorsqu'un mariage est décidé, les futurs viennent acheter leurs baigues à la ville. Les bagues du bijoutier ne sont qu'un accessoire, car les garnitures de lit, les robes et autres vêtements constituent les baigues. C'est probablement de là que vient notre mot bagage ; de même que le verbe baguer, qui n'est pas usité en Bourgogne : il signifie coudre à grands points les plis d'une étoffe, faufiler. Les pauvres gens au lieu de baigues n'ont que des bagatelles : leur trousseau tiendrait dans un mouchoir de poche. - (13) |
| baigueulou (bagueulou) : se dit de quelqu'un qui « bagueulle » - (39) |
| bailaisier. n. m. - Fabricant de balais, selon J.C. Tsavdaris. - (42) |
| bailanç’es, péç’ettes : ustensiles pour la pêche aux écrevisses - (37) |
| bailer, v. n. bêler. - (08) |
| bailet : genêt - (37) |
| bailhou (nom masculin) : bahut. - (47) |
| bailhou, s. m. bahut, petite armoire à deux portes où l'on met le pain, le laitage, etc. - (08) |
| bailiböt, sm. salsifis des prés. - (17) |
| bailivarne, s. f. baliverne, plaisanterie absurde, propos en l'air. - (08) |
| bailiviau : arbrisseau - (37) |
| bailla. s. m. Fromage mou. (Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes). - (10) |
| baillage : tribunal jugeant au nom et sous la présidence d’un bailli (procureur du roi au bailliage) ; juridiction d’un bailli. La révolution supprima les bailliages. - (55) |
| baillai. : Donner. Baillai loupo desu. (bas latin lobus), c'est-à-dire donner dans la bosse.- Baillai lai féte, c'est-à-dire donner une aubade. - (06) |
| baillance : faculté de bonimenter, faconde - (61) |
| baillard (nom masculin) : sorte d'échelle sur laquelle on plaçait le cochon tué afin de le découper. - (47) |
| baillard : grand panier, à forme allongée et peu profond. (P. T IV) - Y - (25) |
| baillard, n.m. civière. - (65) |
| baillard. n. m. - Grand panier d'osier, plat, de forme allongée, sans anse. - (42) |
| baillé, vt. donner, faire présent de. - (17) |
| baillé. Bailler, donner. Baillé, donné et donnez. - (01) |
| baille. Donne, donnent… - (01) |
| bâille-bec. n. m. - Maladie du poussin. - (42) |
| bailler , donner. - (04) |
| bailler : donner. - (66) |
| bailler, beiller. v. a. Donner. - (10) |
| bailler, donner. - (38) |
| bailler, que l'on prononce béyer, donner à bail et par extension : donner. « Prou nous promettent, peu nous baillent. » - (13) |
| bailler, v. ; donner. - (07) |
| bailler, v., donner. - (40) |
| baîller. v. - Crier très fort, synonyme de hucher. (F.P. Chapat, p.36) - (42) |
| baillerein. Donnerions, donneriez, donneraient… - (01) |
| bailli : (vb) donner, entrouvrir, bailler - (35) |
| bailli : donner - (57) |
| bailli : officier royal qui rendait la justice. - (55) |
| bâilli v. 1. Bâiller. 2. S'entrouvrir, s'écarter. 3. Donner. - (63) |
| bailli : s. m., vx fr. baille, intendant, régisseur, valet, serviteur. - (20) |
| bailli, 1. v. a. donner (du vieux français bailler). — 2. v. n. suppurer : son mal baille. - (24) |
| bailli. Donnai, donnas, donna. - (01) |
| baillire. Donnâmes, donnâtes, donnèrent. - (01) |
| bailloç’es : testicules - (37) |
| bailloo, baillò. Donnais, donnait. Bailloo fait par contraction baillò pour la commodité du vers ; mais il faut se souvenir que cet o est toujours long. - (01) |
| baillot, s. m., soupir. Se dit des animaux : ( O rend son dârei bâillot ». - (14) |
| baillou (on) : donneur - (57) |
| baillou, adj., donneur, qui fait volontiers l'aumône. - (14) |
| bailonge et son diminutif bailongeotte. : Cuve elliptique pour transporter la vendange. (Del.) - (06) |
| baîlonge, s. f., cuve elliptique pour la vendange. - (40) |
| bain-née, f. : secousse, maladie, surmenage (se dit surtout des enfants). - (27) |
| baiôlai, capuchon de femme. - En Bretagne on dit bagnolet. - (02) |
| baiôlai. : Espèce de capuchon de femme nommé en Bretagne bagnolet. (Del.) - (06) |
| Bair : Bar-le-Régulier - (48) |
| bairbaipoux (ain) : (un) homme ennuyeux, (un) raseur - (37) |
| bairbe : barbe - (48) |
| bairbiç’ou : celui qui a une petite pointe de barbe au menton - (37) |
| bairbillon : bouton sur la langue - (48) |
| bairbillons : petits boutons sur la langue - (37) |
| bairbitoué (n.m.) : presbytère (de l'a.fr. barboter = grommeler + suffixe -oué = -oir, pour de Chambure : barbitoué) - (50) |
| bairboiller, v. a. barbouiller, salir, peindre grossièrement. - (08) |
| bairbouaiç’e : saleté sur le visage - (37) |
| bairbouaire (fâre), (fâre) barbîller l’couéç’ot : passer rapidement à la flamme, en ce qui concerne les « soies » du porc, qui vient d’être saigné (à l’aide d’un « tortillon » de paille enflammée) - (37) |
| bairbouaire (fâre), (fâre) beûcler : passer rapidement à la flamme le poulet, plumé et cru, afin d’en éliminer les restants de pennes (les « picots ») - (37) |
| bairbouéiller : barbouiller - (48) |
| bairbouillé (s’ seinti tout) : avoir des nausées, avoir « mal au cœur » - (37) |
| bairbouillé : celui qui a la figure sale, malpropre - (37) |
| bairbouillé d’au d’choûs ! (y’ot) : le temps se gâte là-bas ! - (37) |
| bairbouiller : peindre médiocrement - (37) |
| bairbouillou : peintre médiocre - (37) |
| bairboûlotte : coccinelle (bête à bon dieu) - (37) |
| bairboulotte : coccinelle - (48) |
| bairdâ : ensemble d’objets que l’on transporte avec soi - (37) |
| bairdée : grosse charge - (48) |
| baire : bouleau ; les branches du bouleau étaient utilisées pour faire des balais - (43) |
| baires : (npl.) branches de bouleau (pour faire des balais) - (35) |
| bairnaiger, v. n. profiter, réussir, prospérer, s'accroître : « tô bairnaige en c'te mâion laite », tout profite dans cette maison-là. - (08) |
| bairnèger : (bêrnègé - v. intr.) proliférer, croître, abonder (végétaux). - (45) |
| bairque, s. f. barque, bateau, peu usité dans une contrée où il y a beaucoup d'eaux courantes mais peu de rivières navigables. - (08) |
| bais. adj. Beau. Mon bais-père. - (10) |
| baise (a) : Ioc. Etre à baise, ne pas avoir fait encore un seul point dans une partie de jeu. - (20) |
| baiser : s. m., baiser du mitron, partie d'un pain dépourvue de croûte par suite de contact pendant la cuisson avec un pain voisin. - (20) |
| baishî (se) : baisser (se). - (62) |
| baisselon, bouss'helon, sarcloir. - (05) |
| baisselon, s. m., espèce de sarcloir. - (14) |
| baisser, v. a. Attacher la vigne au printemps. (Béru). - (10) |
| baissi : baisser - (43) |
| baissie (lai), (lai) baiç’ie : pièce ou « coin » de rangement des ustensiles de laitage, avec trou d’écoulement des eaux usées à l’extérieur, percé directement dans le mur - (37) |
| baissie (n.f.) : encoignure où l'on posait les seaux d'eau - pierre d'évier - (50) |
| baissie : évier. - (52) |
| baissie : pierre d'évier - (48) |
| baissière. s. f. Dépression du sol, endroit ou le terrain s'est abaissé. - (10) |
| baissigné, vt. bassiner. - (17) |
| baissignoure, sf. bassinoire. - (17) |
| baissin, sm. bassin. - (17) |
| baissin. Bassin, bassins. - (01) |
| baissinner : abasourdir, assourdir quelqu’un à force de lui répéter la même chose (lui faire résonner la tête, comme résonne une bassine sur laquelle on frappe) - (37) |
| baissinouére, s. f. bassinoire. - (08) |
| baissins-cliairs - les fleurs de la renoncule dite piépou qui fleurit en mai. - (18) |
| baitaille (n.f.) : bataille - (50) |
| baitaivie, s. m. baptême. E permute en a comme dans « quairâme » et « crame », pour carême et crème. - (08) |
| baitâme (n.m.) : baptême - (50) |
| baitan. Battant. Tambor baitan, tambour battant. On appelle aussi baitan un trébuchet à prendre des oiseaux… - (01) |
| baitïer, v. a. baptiser, donner le baptême. - (08) |
| baitijer, v. a. baptiser. - (08) |
| baitillo - baptême. - Teins, voilai qu'an carillonne in baitillo. - A nos an beillé des draigies du baitillo. - (18) |
| baittante (n. m. et adj.) : battant - (50) |
| baitterie (n.f.) : aire de battage au fléau - (50) |
| baittouai (n.m.) : machine à battre le grain - (50) |
| baitu - petit lait qui reste de la crème quand on a fait du beurre. - C'â vraiment demaige de beiller ce baitu qui es couchons. - (18) |
| baivaite. Bavette, bavettes. - (01) |
| baiveire. Bavière. L'électeur de Bavière, en 1701. - (01) |
| baivoché, vn. baver. Trop parler. - (17) |
| baivochou, sm. baveux. Bavard. - (17) |
| baivou : quelqu'un qui dit du mal d'autrui - (46) |
| baivou, adj. baveux. - (17) |
| baivouç’ou : celui qui bave en parlant - (37) |
| baiyè : v. t. Donner. - (53) |
| baizairder : jeter, mettre au rebut - (37) |
| bajat : hurluberlu - (60) |
| bajater (verbe) : radoter, bavarder, tenir des propos sans intérêts. - (47) |
| bajaune. n. f. - Petite limace jaune. - (42) |
| bajé, adj. se dit des pains qui se touchant dans le four n'ont pu former leur croûte. - (08) |
| bajin. Ivraie. - (49) |
| bajo : Imposte. « La vitre du bajo est cassée » la vitre de l'imposte est cassée. - (19) |
| bajonne. s. f. Petite limace jaune des vignes. Ne serait-il pas mieux d'écrire bajaune ? (Mouffy). - (10) |
| bajou, sm. abajoue. - (17) |
| bâkié, bâcler, faire une chose imparfaitement, trop à ta hâte. - (16) |
| bâlâ : un simple d'esprit, bêta - couiste don bâlâ, tais-toi donc bêta - (46) |
| balai : genêt, bouleau (parfois autre plante comme le saule) servant à fabriquer les balais. A - B - (41) |
| balai (n.m.) : genêt - (50) |
| balai : genet - (44) |
| balai : genêt - (60) |
| balai : genêt - (48) |
| balai : genêt. - (52) |
| balai : genêt (voir genête). - (33) |
| balai dou, balai fait de panaches de roseau. - (16) |
| balai n.m. (du gaul. banatlo ou du breton balazn, genêt). Genêt sauvage. Le terme genêt a pris le dessus dès le XVIème siècle, réservant au balai l'usage que l'on sait. Voir tsiquenaude. - (63) |
| balai pneu : ajonc (en B : etopon*) A - (41) |
| balai : genet - (39) |
| balai : s. m., genêt à balais. - (20) |
| balai, s. m. genêt à balai : un champ de « balais » ; les « balais » sont en fleur. On coupe les «balais» et on les brûle sur place pour répandre la cendre sur le terrain. - (08) |
| balai, subst. masculin : genêt. - (54) |
| balai. Ce mot est employé pour désigner le genêt à balais. - (49) |
| balaiger, baliger.n. v. a. Balayer. - (10) |
| balais : voir balaîtier - (23) |
| balaîtier : génêt à balais. VI, p. 40-12 - (23) |
| balan (du) : équilibre - (57) |
| balan : équilibre instable, balancement - (48) |
| balan : équilibre. En balan : en équilibre. - (52) |
| balan : équilibre. En balan : En équilibre, objet en équilibre qui, en principe, ne doit pas tomber. - (33) |
| balan n.m. Equilibre. - (63) |
| balan : mouvement de balance - (39) |
| balan. n. m. - Oscillation, balancement, mouvement de va-et-vient d'une pendule, d'une cloche, ou du chargement d'une charrette. - (42) |
| balan. s. m. Oscillation, mouvement de va-et-vient d'une chose suspendue à qui un balancement est imprimé. Le balan d'un pendule. Le balan d'une cloche mise en branle. - (10) |
| balance (en) : loc., exactement, c'est-à-dire les plateaux de la balance étant en équilibre. Ça pèse 350 grammes, en balance. - (20) |
| balanci - bransaler : balancer - (57) |
| balanciner (se). Se balancer. - (49) |
| balancinoire. Balançoire. - (49) |
| balançouaîre (na) : balançoire - (57) |
| balançouaire : n. f. Balançoire. - (53) |
| balandra : (balandrâ) lourde charge, très encombrante et surtout mal arrimée. - (45) |
| balandras. C'est le nom d'un ancien manteau. A rapprocher de baladin et du verbe se balader. Le mot bal et le verbe baller (avoir les bras ballants), me paraissent être de la même famille. On appelle maintenant balandras un vêtement trop long. - (13) |
| balansi, n’envier éplosse : balancer, se débarrasser de quelqu'un - (43) |
| balant (être en), loc, être indécis, ne savoir de quel côté pencher. Une femme, qui avait des prétentions et voulait quitter le patois pour le français, me dit un jour, répudiant le mot balant : « Je ne sais vraiment que faire, je suis dans le décis (l'indécision) ». - (14) |
| balant : équilibre - (44) |
| balasse. n. f. ou balasson. n. m. - Paillasse : sac rempli de balles d'avoine ou de feuilles sèches, utilisé comme matelas pour un lit d'enfant. - (42) |
| balate : Belette. - (19) |
| balatiau. s. m. Grand niais. (Etivey). - (10) |
| balayer (se) (balailler) : v. r., vx fr. baloier, se hâter, se dépêcher ; presser, être urgent. - (20) |
| balchot. n. m. - Ridelle d'une charrette. - (42) |
| bâle : la balle d'une arme à feu - (46) |
| bale, petite corbeille qu'on appelle aussi montre, et dont on se sert, au marché, pour vendre les légumes. - (16) |
| baléger, v. a. balayer, se servir du balai. - (08) |
| baleîn-ne (na) : baleine - (57) |
| bâlement : doucement, aller doucement avec des bœufs dans un passage difficile. Bâlement mes gros, bâlement ! : Doucement mes gros, doucement ! - (33) |
| bâler : (vb) bêler - (35) |
| bâler : Pleurer, crier. « Marie, tan p'tiet bâle » Marie, ton enfant pleure. - (19) |
| baliage. s. m. Balayage. - (10) |
| balibot ou talibot, quelquefois balibeu, talibeu. Le salsifis sauvage ou scorsonère (tragopogon pratensis). Quand il commence à monter, au printemps, les enfants en sont très friands et vont en cueillir dans les prés. Mais l’expresion dijonnaise aller au talibeu ne fait aucune allusion à cet usage, elle désigne une toute autre cueillette ! - (12) |
| balier. Balayer. - (49) |
| balier. v. a. Balayer. - (10) |
| baliette : s. f., vx f r. balaiete, balion, s. m., balayette, - (20) |
| balieu. S. m. Balayeur. - (10) |
| baligeotte. S. f. Balayette, petit balai. - (10) |
| baligouère. s. f. Mâchoire inférieure. (Plessis-Saint-Jean). - (10) |
| balin (n. m.) : nuage - (64) |
| balin : gros nuage noir menaçant. Ex : "Ar'gade l'grous balin, c'est d'yau à pas r'tarder !" - (58) |
| balin. n. m. - Gros nuage noir annonçant la pluie. - (42) |
| baliste : s. m. et f., patron et patronne de bal public. - (20) |
| baliures. s. f. pl. Balayures. - (10) |
| balivarne, s. f., baliverne. - (14) |
| baliver, v. a. faire un balivage, choisir, marquer les baliveaux d'un bois et par extension tous les arbres réservés dans un taillis. - (08) |
| balivia. m. baliveau. (Ménades). - (10) |
| baliviau (n.m.) : baliveau dans un bois taillis, arbre réservé pour qu'il puisse croître - (50) |
| baliviau : Baliveau Jeune arbre d'une coupe en exploitation qui ne doit pas être abattu et qu'on laissera croître en futaie. « Les gârdes ant marqué les baliviaux ». - (19) |
| baliviau. n. m. - Baliveau, jeune arbre non ébranché. - (42) |
| baliyer, v. tr , balayer. - (14) |
| baliyette, s. f., dim , petit balai. - (14) |
| baliyure, s. f., résidu du balayage. - (14) |
| ball’-fille (na) - fiaûtre (na) : belle-fille - (57) |
| ballan, loc. équilibre. Emporter le «ballan », faire perdre le « ballan. » - (08) |
| ballant : Force d'oscillation d'une personne, d'un objet. - (19) |
| ballasse. s. f. et ballasson. s. m. Paillasse d'enfant remplie de balles d'avoine, quelquefois de feuilles sèches. Se dit au pl., pour balles de blé. - (10) |
| ballasse. s. f. Gros ventre d'une vache pleine. - (10) |
| balle (ai lai), loc. porter à la balle, porter sur le dos comme une hotte ou une besace. - (08) |
| balle (bâle) : s. f., corbeille d'osier. - (20) |
| balle (l'homme) (m), colporteur. - (26) |
| bâlle (na) : balle (projectile) - (57) |
| balle : « Alle se fa balle pour aller au bal » : elle se fait belle pour aller au bal. - « Balle-fille », bru ; « balle-sue », belle sœur ; « balle-mère », belle mère. « Coper du pain de balle-mère » : couper de tout petits morceaux de pain, en tranches minces, comme pour l'épargner. - (19) |
| bâlle : Balle. Proverbe : « chéquin porte sa bâlle » chacun est responsable de ses actes. « Porter à la bâlle » porter à califourchon, « Papa porte me à la bâlle ». Voir aussi « c'eucbelin ». - (19) |
| balle : enveloppe du grain de blé, détachée après battage. Ex : "Il est là qui s'areuille ! On dirait ben un chat qui chie dans les balles !" (Expression d'usage dans laquelle le chat doit être tenu pour innocent !). - (58) |
| balle, adj. belle. - (38) |
| balle, s. f. berceau d'enfant très jeune. - (08) |
| ballement : Bellement, tout beau ! - (19) |
| ballement, beulement, adv. bellement, doucement, interj. pour arrêter, contenir, modérer : « tô bâlleman, tô beuleman ! » - (08) |
| ballement. Doucement. - (49) |
| ballement. Quand on demande à nos paysans comment ils se portent, Tout ballement, répondent-ils. - (03) |
| balle-sor. s. f. Belle-sœur. (Domecysur-le-Vault). - (10) |
| balleut : Balle du blé ou de l'avoine et autres céréales qui se sépare du grain au moment du battage. - (19) |
| ballier (prononcez bailler), s. m. Endroit où l'on met les halles de blé, d'avoine ou autre. - (10) |
| ballier. n. m. - Endroit où l'on dépose les balles provenant du battage ou du vannage. - (42) |
| ballin : gros nuage noir. V, p. .55 - (23) |
| ballin, ballou. s. m. Coup de vent, tourbillon qui emporte la poussière des chemins et le fom des meules dans les prés. Du grec ballein, emporter, jeter. - (10) |
| ball'-mére (na) : belle-mère - (57) |
| ballon (on) : groseille à maquereau - (57) |
| ballon : (nm) groseille à maquereau - (35) |
| ballon n.m. Groseille à maquereau. - (63) |
| ballon : s. m., groseille à maquereau. - (20) |
| ballonge : cuve de section oblongue où l'on récolte le raisin.. - (32) |
| ballonge, dont le diminutif est bailongeôtte, est une cuve pour entasser les raisins de la vendange. – Dans l'idiome breton, balok, au pluriel balogeu, dans le dialecte de Vannes, signifie cuvier. - (02) |
| balloni : (nm) groseillier à maquereau - (35) |
| balloñnî n.m. Groseillier à maquereau. - (63) |
| ballonnier : s. m., groseillier à maquereau. - (20) |
| ballossou, s.m. balai fait avec de la paille pour séparer le son du grain. - (38) |
| ballot (du) - ballou (du) : balle (enveloppe du blé) - (57) |
| ballot (du) : enveloppe (du grain) - (57) |
| ballot : (balo - subst. m. pl.) déchets de menue paille, d'épis, que laisse le vannage des céréales. - (45) |
| ballot, balle d'avoine, de blé. - (05) |
| ballot, balot : débris de paille, déchet de paille (au battage) - (48) |
| ballôt, s. m., bouffe de blé ou d'avoine. - (40) |
| ballot. s. m. Sorte de hangar, endroit ou l'on mot les balles, les résidus du battage et du vannage. (Gy-l'Evêque). - (10) |
| ballou : (nm) balle du blé - (35) |
| ballou, boffe : balle de céréales, récupérée lors des battages - (43) |
| ballouge : Terrain d'alluvion moderne. Nom de lieu : « Es Balouges ». - (19) |
| ballouse, s. f. femme qui aime courir les bals. - (40) |
| balloux : s. m., balle, enveloppe des grains. Voir ratouffe. - (20) |
| balloux, ballouse : adj., léger (comme de la balle). Terre ballouse. Des ballouses (terres légères). - (20) |
| ball'-sϞ (na) : belle-soeur - (57) |
| balluchon : ballot de vêtements - (60) |
| bal'm an ; teu bal'man, tout simplement. - (16) |
| balme, barme, baume, baumée : s. f., berme ; talus, naturel ou artificiel, sur le bord d'une rivière, d'une pièce d'eau, d'un fessé. La balme est une espèce de douve (voir ce mot). - (20) |
| balmeyer : v. n., se dit du bouliste qui utilise les balmes ou les saillies du terrain pour diriger sa boule. - (20) |
| balo. Criblure de blé. - (03) |
| baloffe ou blou ou boffe : déchets de l'enveloppe des céréales après le battage. On appelait aussi ainsi l’enveloppe des panouilles dont on se servait pour remplir les paillasses. - (30) |
| balofre, s. f. balle d'avoine. - (24) |
| bàlonge (Chal.), bailonge, belonge (C.-d.) - Sorte de cuvier ovale servant à transporter le raisin vendangé de la vigne à la cuve où doit s'opérer sa fermentation, avant le pressurage. L'origine du mot se trouve vraisemblablement dans sa forme allongée (bis longa ?). - (15) |
| balonge : benne à raisin ou « boine » (voir) de forme ovale, pour le transport du raisin. - (62) |
| balonge : cuve à raisin - (48) |
| balonge : s. f., syn, de bedoule. - (20) |
| balonge, pâtière du sarrasin. - (05) |
| balonge, s. f., maie d'une forme spéciale pour la préparation du pain de sarrazin. - (14) |
| balonge, sorte de cuvier oblong dans lequel on amène la vendange à domicile. - (16) |
| balonge. Grand vaisseau de bois dans lequel on place la vendange pour l’amener aux cuves. Elle est de taille variable et ne sert pas de mesure. Etym. balingium. - (12) |
| balongée. Le contenu d'une balonge. (Voir ce mot). - (12) |
| baloquer, balouquer. v. a. et n. Cahoter, secouer, ballotter. - Remuer, aller de ci, de là, par défaut de solidité. - (10) |
| bàlôt, bàllot (C., Chal.). - Balle d'avoine ou de blé. Ce mot est cité ici à cause de la singularité qui a fait masculiniser le mot français, contrairement à l'habitude bourguignonne de les féminiser d'ordinaire, comme plote, pour plot, et panière, pour panier. La balle ou balot s'appelle encore bouffe dans le Chalonnais et la Côte, par contraction du vieux français baloffe, balouffe, même signification. - (15) |
| balot, s. m. menu grain qui se trouve dans les déchets, après l'opération du vannage. Le cultivateur soigneux ramasse les « balôs » et les distribue par petits tas au bétail. - (08) |
| balot, s. m., criblure de blé, d'avoine. - (14) |
| balote ! s. f., terme employé par les paysans pour appeler les oies. - (14) |
| baloter, v. a. ramasser avec un râteau les balles et « balos » répandus sur l'aire ou ballier de la grange, séparer le grain des « balos » qui en forment la criblure de choix. - (08) |
| balotte, belette. - (05) |
| balou : déchets des épis de blé s'entassant lors du battage. - B - (41) |
| balou : déchet des épis de blé, sous la batteuse - (34) |
| balou : gros lourdaud - (60) |
| balou n.m. (du gaul. balu, criblure d'avoine) Bale ou balle, déchet des épis de blé ou d'avoine sous la batteuse. Syn. de boffe. - (63) |
| balou, balot (n.m.) : balle ou bale, capsule qui enveloppe les grains de céréales - (50) |
| balouffe : s. f., vx fr. baloffe, balle, enveloppe des grains. Voir balloux. - (20) |
| baloufre, s. f. balle d'avoine. - (22) |
| balouquer. v. n. Laper. - (10) |
| balouse n.f. et adj. (du gaul. belisa). Terre franche, terre légère. - (63) |
| balqueue. s. f. Branle-queue, bergeronnette. - (10) |
| Baltasar, Melkior, Gaspar. Noms vulgairement donnés aux Mages qui vinrent adorer le Sauveur. L'Ecriture ne les qualifie point rois, ne spécifie point leur nombre, et ne les nomme point… - (01) |
| baltié. : (Dial. et pat.), c'est-à-dire qui porte le baudrier. - Au moyen âge, il n'y avait pas rien que les gens de guerre qui portassent le baudrier. - (06) |
| baluchon, s. m. paquet que les voyageurs à pied portent sur le dos et qui renferme leur bagage. On dit en plaisantant d'une femme enceinte qu'elle ne sort jamais sans son « baluchon. » - (08) |
| baluchon. Balle, paquet contenant les habits, le linge ou les outils d'une personne partant en voyage, d'un ouvrier qui se déplace. - (49) |
| baluchon. s. tn. Petit paquet de hardes, ordinairement contenu dans une serviette ou un mouchoir dont les quatre cornes sont nouées ensemble. - (10) |
| balÿi : balayer - (51) |
| balyi v. Balayer Voir rméchi. - (63) |
| bambille. s. f. Amusement d'enfants consistant à sauter par dessus une paille ou une petite baguette, en croisant alternativement les pieds et en chantant la Bambille. - (10) |
| bambiner, v. intr., muser, flâner : « On' fait qu' bambiner po les rues ». - (14) |
| bamboche : pantoufle. - (66) |
| bamboche : sandale de tresse à semelle de cuir. (R. T IV) - Y - (25) |
| bamboche, s. f., babouche, savatte, pantoufle, chaussure de chambre. - (14) |
| bambocher, v. intr., godailler, riboter, passer son temps en plaisirs. - (14) |
| bamboches s. f., balivernes, dires de peu d'importance : « Côge-te donc, te m' dis des bamboches ». - (14) |
| bamboches, s. f., se prend dans l'acception de plaisirs peu modérés : « fait ses bamboches ». - (14) |
| bambochou : bambocheur - (39) |
| bambotse n.f. Bamboche, fête. - (63) |
| bambotsi v. Bambocher, faire la fête. - (63) |
| bambourée, s. f., fauvette. - (40) |
| Bamboye, nom propre : surnom du patron de l'usine Schneider. - (54) |
| ban - banc, planche disposée comme un banc. - Le pôre homme, al â su le ban. - En fau vîtement mette main mère su le ban, cair an vai veni ll'y jetai laie benite. - On mettait le cercueil sur une planche ou banc posant sur deux chaises. Cette locution disparait. - (18) |
| ban : Bon. « Du ban vin, du ban, de la viande, du fricot ». « Dis ran man p'tiet t'aras du ban d'ave tan pain ». - (19) |
| ban Dieu : Bon Dieu, les derniers sacrements. « Ol est bin malède, an li a porté le ban Dieu » : il est bien malade, il a reçu les derniers sacrements. - « Porter le ban Dieu ave eune meilleuche (mailloche) » : donner un bouillon d'onze heures. - (19) |
| banadiö, sm. ringard ; tire-marrons. - (17) |
| banaton. s. m . Hottereau. Du latin - (10) |
| banboçhe, sm. pantoufle. Soûlard. - (17) |
| banc : voir pressoir. - (20) |
| bancailou : claudicant, estropié, qui oscille en marchant - (37) |
| bancaler : (vb) boîter - (35) |
| bancaler v. Boiter. - (63) |
| bancaler. Marcher comme un bancal, en se dandinant ; boîter. - (49) |
| bancaler. v. - Boiter. - (42) |
| bancaler. v. n. Boiter. - (10) |
| bancalon. s. m. Diminutif de bancal (boiteux), qui est français. - (10) |
| bancalou (ze) : (adj) boiteux (se) - (35) |
| bancalou. n. m. - Boiteux. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| bancaloux, -ouse adj. Boîteux, euse. - (63) |
| bance (nom féminin) : tourtière où l'on entreposait les miches de pain. On dit aussi paingnée. - (47) |
| bancégne (n.m.) : barreau d'échelle - (50) |
| bancelle (n.f.) : petit banc - (50) |
| banche, s. f. ridelle de char en bois plein. - (22) |
| banche, s. f. ridelle de char en bois plein. - (24) |
| bandâdze : (nm) cercle d'une roue, d'un tonneau - (35) |
| bandan : Bouchon de bois ou de liège que l'on met dans la bonde du tonneau. « Chauche bien le bandan » : frappe fort sur le bandan pour qu'il tienne. - (19) |
| bande : Bonde. Trou par lequel on remplit le tonneau et que l'on bouche avec le bandan. - (19) |
| bande de vatses : troupeau de vaches - (43) |
| bandée, troupe, multitude. Dans l'idiome breton, band en signifie multitude. (Lavil.) - (02) |
| bandée. : C'était la publication de ban des vendanges. - (06) |
| bandener : Bondonner. « I faut bien bandener les tonneaux, que (afin que) le vin ne s'évente pas ». - Mugir, « Entends-tu bandener le teuriau (taureau) ? ». - Faire bandener une pierre, la lancer avec une violence qui lui fait produire une sorte de ronflement. - (19) |
| bandias. s. m. Bandeau. - (10) |
| bandits. : Soldats désorganisés et associés en bandes pour le pillage. C'est un nom de plus à ajouter à ceux qu'on donnait aux XIVe et XVe siêcles aux Grandes Compagnies. - (06) |
| bandore. Prison. Métaphore tirée de la paume, où bander une balle , c'est la jeter dans les filets qui lui servent de prison. - (01) |
| bandore. : Prison. Ce mot semble être particulier à Dijon et je n'en trouve la défmition que dans le Glossaire des noëls de Lamonnoye.. - (06) |
| bane : Benne, grand baquet de bois dans lequel on transporte le raisin de la vigne à la cuve au temps de la vendange. « Ecuer les banes », y mettre de l'eau pour les rendre étanches. La contenance d'une benne « eune bane de vendange ». - (19) |
| bâne : se dit d'un légume qui n'a pas de cœur. On remarque que, souvent, la consonance française « cl » se retrouve en patois sous la forme de kieu, par exemple : clou : kiou, clouer : kiouler, oncle : onkie, clouter : kiouter, clé : kié, débâcle : débâkie, claque : kiaqué, etc. - (46) |
| bane de môches : Ruche. « Ol a des banes de môches au fand de san jardin ». - (19) |
| bâne, adj. borgne. - (17) |
| bane, borgne. Chez les Bretons banné veut dire taie, pellicule ou tache blanche qui se forme sur l'oeil. (Le Gon.) - (02) |
| baneire, s. f., bannière. - (14) |
| baneulet : petit oiseau du nid, un peu plus gros que le plus petit - (60) |
| baneut : Petite benne, diminutif de bane. - (19) |
| bangniée, s. f. bannière, étendard que l'on porte dans les cérémonies religieuses. - (08) |
| bangniëre, bannière. - (16) |
| banguions : appendices charnus placés sous le museau de la chèvre - (43) |
| baniole : Petite voiture en mauvais état « Eune vieille baniole ». - (19) |
| banjo : Bonjour, salut. « Banjo teurto » bonjour à tous. - Visière, « In banjo de casquette ». - (19) |
| banné (nom) : Artisan fabriquant des bennes, ou les réparant. - (19) |
| banne et même benne. En Bretagne banna signifie étendre, élever, hausser. (Le Gon.) Ce mot s’appliquait d'abord aux toiles tendues devant les boutiques ou placées sur les charrettes ou sur les compartiments en osier. C'est seulement par extension qu'on a nommé bannes ces voitures elles-mêmes, et notamment les charrettes à charbon. De même on a appelé bannettes certaines corbeilles en osier, bannetons des coffres pour conserver le poisson dans la rivière, etc. A Dijon, on nomme benatons des paniers d'une certaine dimension ; à Châtillon, on donne le nom de benetons aux cages d'osier sous lesquelles s'engraisse la volaille. - (02) |
| banne ou benne. : Compartiment en osier placé sur des roues et servant au transport du charbon. - (06) |
| banne. s. f. Charge à dos d'une personne en bois ou herbe. C'est une sorte de métonymie indiquant le contenu pour le contenant. (Villechétive). - (10) |
| banneire. Bannière, bannières… - (01) |
| bannelle. Diminutif de banne, panier d'osier. Par extension, tout récipient très ouvert en osier. Etym. banne, qui vient de benna, voiture d'osier ou de branchages en usage chez les Gaulois, et dont nos charbonniers se servent encore aujourd'hui pour transporter leur marchandise. On appelait jadis basnage le mesurage du charbon par bannes. - (12) |
| ban-nère : Bannière. « La ban-nère de Saint-Georges ». - « Porter la ban-nère » : apparaître le premier, marcher en tête. - (19) |
| banneret (chevalier banneret) : gentilhomme qui avait droit de porter bannière et de mener ses vassaux au combat. - (55) |
| banneton, benaton. s. m. Petite hotte ; panier long, sans anses, et garni de toile à l'intérieur, dans lequel les boulangers font lever leurs pains. - (10) |
| banni : Prononcer : ban-ni. Charrue Banni, charrue à versoir métallique, du nom de l'inventeur, comme charrue Dombasle. - (19) |
| bannir, v. a. Annoncer, publier. v. n. Etre banni, être publié, avoir des bans à l'église. - (10) |
| banque : Comptoir sur lequel le boutiquier étale sa marchandise. « J'ai mis les sous su la banque ». - (19) |
| banque n.f. Comptoir de commerçant. - (63) |
| banque : s. f., comptoir de magasin. - (20) |
| banque, subst. féminin : comptoir. - (54) |
| banquette (lai) d’lai reûte : (le) terre-plein d’herbes bordant la route - (37) |
| banquette : accotement - (43) |
| banquillou : un boiteux - (46) |
| bansa : Bonsoir « Dis bansa, à peu va te couchi » : dis bonsoir et va te coucher. - (19) |
| bansins : morceaux de bois assemblés pour faire une barrière, une échelle - (37) |
| bansseron n.m. (p.ê. de banche, des banches de bois ont été utilisées pour la construction des murs en pisé). Arceau d'un panier. - (63) |
| baptillot (n.m.) : cortège du baptême - (50) |
| baptisi : baptiser - (43) |
| baptisi v. Baptiser. - (63) |
| baquer v. Baigner. - (63) |
| baqueulot : n.m. Pièce pour le jeu "Fiolet" aussi appelé "Baculot". Petite boule ovoïdale en bois, qui a une partie plate se terminant par un bec. But du jeu : frapper le baculot posé sur une pierre lisse et arrondie, avec un bâton et le projeter le plus loin possible. Se joue sur un terrain herbeux. - (53) |
| baquiau, s. m. bateau, barque. - (08) |
| bâquiè : bâcler - (46) |
| baquins. s. m. pl. Nom donné par les habitants de Sommecaise aux habitants de la vallée d'Aillant. Gens d'en bas, - (10) |
| Bar’srin : NL Bergesserin - (35) |
| bara, s. m. cagneux, celui qui a des jambes difformes. - (08) |
| barache, s. f. terme injurieux qui correspond à grande bête. - (08) |
| baragne (na) - bargeagne (na) : rive - (57) |
| baragne (na) : berge - (57) |
| baragoin. S. m. Celui qui mange ses mots, qui parle entre ses dents, ou qui contrefait sa voix. - (10) |
| baragouégner : bafouiller, maugréer - (48) |
| baragouin, jargon d'un enfant qui ne sait encore que demander pain et vin bara et guïn. (Voir ces deux derniers mots dans le Vocabulaire celto-breton de Le Gon.). - (02) |
| baragouiner : parler indistinctement, bafouiller. - (33) |
| baragouiner. v. a. et n. Parler entre ses dents, d'une manière peu intelligible, ou en contrefaisant sa voix. - (10) |
| baraitte (nom féminin) : baratte. - (47) |
| barandiau : (nm) personne impétueuse - (35) |
| barandiau n.m. (p.ê. de barauder, errer). Homme bizarre, impétueux ou enfant très remuant. - (63) |
| barandjau : enfant très remuant - (34) |
| barandjo : enfant très remuant. A - B - (41) |
| baraouette : s. f., barquette, espèce de chaussure en étoffe ou de pantoufle. - (20) |
| baraque, s. f. Pie. - (10) |
| baratté. s. m. Battis, lait de beurre. - (10) |
| barauder. v. - Traîner, se balader sans but précis. (Arquian) - (42) |
| barbaillé (nom féminin) : race ovine en général. - (47) |
| barbaille, s. f. race ovine en général. Une ferme qui a beaucoup de « barbaille » est souvent prospère. On dit ailleurs « mottenaille, mouttenaille. » - (08) |
| barbanchon, s. m. brabançon, ouvrier nomade qui travaille le chanvre. - (08) |
| barbançon : peigneur de chanvre - (39) |
| barbançon, s. m. nom que les charretiers donnent quelquefois à leurs bœufs avec le sens de gaillard, rude, hardi. - (08) |
| barbantale. s. f. Pièce de 1 feuillette et demie à 2 feuillettes. (Villiers-Bonneux.) - (10) |
| barbaquiaux, barbattiaux. s. m. pl. Franges, ornements. Se dit, en particulier, des caparaçons de filet de longues franges flottantes que l'on met aux chevaux, l'été, pour écarter les mouches. (Perreuse.) - (10) |
| barbaquiaux, barbottiaux. n. m. pl. - Émouchette, chasse mouche ; synonyme de amouchouée. (Perreuse) - (42) |
| barbattiaux. n. m. pl. - Caroncule : excroissance charnue rouge et bleu violacé, qui orne le cou du coq et du dindon. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| barbau, s. m. salsifis des prés. - (24) |
| barbaude (n. f.) : mixture, préparation culinaire d'aspect répugnant (syn. régaume) - (64) |
| barbaude. n. f. - Massette, roseau des marais. - (42) |
| barbauiller (v.t.) : barbouiller - (50) |
| bârbe (na) : barbe - (57) |
| bârbe : fauvette. (C. T IV) - S&L - (25) |
| bârbe n.f. Barbe. - (63) |
| barbe, barbette. Fauvette. - (49) |
| barbe, s. f., barbe. - (14) |
| barbeau : s. m., salsifis des prés. - (20) |
| barbelote. Ver luisant. - (03) |
| barbelotte : grosse chenille. - (31) |
| barbetan : Ration de nourriture pour gros bétail faite de son mélangé à des betteraves crues ou cuites, coupées en lamelles, ou à des pommes de terre. - (19) |
| barbette s. f., dim. de barbe, barbe naissante. - (14) |
| barbette, barbichette : s. f., dim. de barbe. - (20) |
| barbette, s. f. petite barbe naissante. - (08) |
| barbeute : Façon sommaire d'accommoder certains légumes en les faisant simplement cuire à l'eau avec un peu de sel et sans les écosser. « Miji des pois à la barbeute ». - (19) |
| barbeuter : Barboter. « Fare barbeuter le bestiau » : donner pour nourriture au bétail de l'eau mêlée de son, de tourteau ou de farine. - (19) |
| barbi : barbier - (51) |
| barbi : n. f. Brebis. - (53) |
| barbi, s. f. brebis. - (08) |
| barbiau. s. m. Dans une charrue, tige de fer qui attache le sep à l'oreille. - (10) |
| barbiche : Barbiche. Jeu enfantin, deux enfants se tiennent réciproquement le menton et disent « je te tins par la barbiche, si te ris, j'te flanque eune clique » : celui qui ne peut s'empêcher de rire reçoit une gifle. - (19) |
| barbiche. s. f. Écrevisse. - (10) |
| barbillons, s. m., pluriel ; eczéma galeux du veau. - (40) |
| barbillons. s. m. pl. Petits boutons qui envahissent la langue et la bouche des veaux de lait. Sans doute pour bourbillons, boutons purulents. - (10) |
| barbis (nom féminin) : brebis. - (47) |
| barbitoue, s. m. presbitère, demeure du curé de la paroisse. - (08) |
| barbitras (nom masculin) : publicités. Écrits sans importance. (Ma boîte aux lettres est pleine de barbitras). - (47) |
| barboché, vn. murmurer en grognant. - (17) |
| barboïllan: Qui parle à tort et à travers. « Couge te, t'es in barboÏllan ». - (19) |
| barboïlle : Employé seulement dans cette expression : « être à la barboïlle » : abonder, être à vil prix. « Les cheriges (cerises) sant à la barboille c't'année (cette année)». - (19) |
| barboïlli (verbe) : Salir. « T'es tôt barboïlli, va te débarboïlli ! (relaver) ». - (19) |
| barboilli : barbouiller - (51) |
| barboilli : Parler d'une manière confuse, marmotter, parler sans réfléchir. « Qu'est-ce que te barboïlles ? ». - (19) |
| barboïlli v. Barbouiller. - (63) |
| barbölé, vn. bavarder. - (17) |
| barbolotte : n. f. Herbe courte rebelle. - (53) |
| barbonnais, bourbonnais. En quelques lieux barbounâ. - (08) |
| barbôtaigne, hésitation, tremblement. - En languedocien, barbouti, et, dans le roman français ; barboter, signifient frissonner... - (02) |
| barbote (a la) : Ioc., qui fait ou est fait en barbotant. Un cuisinier a la barbole. Du travail a la barbote. - (20) |
| barboté dans l’iâ, barboter dans l'eau, L'on dit aussi barboté des prières, pour : prier mal, sans attention. - (16) |
| barboteignai. : Bredouiller, parler comme en tremblant. Ce mot est un diminutif de barbotai. - (06) |
| barboter, v. intr., bégayer, parler de façon peu intelligible : « Qu'è-c' que t’ nous barbotes ? On n' t'entend pas » - (14) |
| barboter, v. tr., salir : « Alle a joliment barboté sa jupe! » - (14) |
| barboti (chardon), s. m. sorte de gros chardon hérissé, très piquant. - (24) |
| barbotte. Salsifis sauvage (Scorsonère humilis) poussant dans les prés humides. - (49) |
| barboueillé (éte) : avoir envie de vômir, être sale - (39) |
| barboueiller : gribouiller, barbouiller - (39) |
| barbouére. Flamber : « faire barbouére in-ne poleille » (volaille). - (49) |
| barbouillaud, de, s. d. g. chien de chasse de l'espèce des griffons, appelé ainsi à cause des barbes qu'il porte à la tête et qui paraissent avoir formé ce nom, comme aussi celui du barbillon. - (11) |
| barbouille (a la) : loc., en désordre, en désarroi. Ah! la marchandise a bien baissé d' prix ; y est tout à la barbouille. - (20) |
| barbouille (être à la), loc. se dit lorsqu'il y a un désarroi dans les prix en baisse : le vin est à la barbouille. - (22) |
| barbouillé : avoir du mal à digérer - (44) |
| barbouiller : syn. de bredouiller. - (20) |
| barbouiller, berboiller. v. n. Parler inintelligiblement, bredouiller. - (10) |
| barbouiller, v. tr., affadir, déranger : « J'ons mingè l'oie de la Saint-Martin ; ma âlle étot si grasse, qu'àll' me barbouille le cœur ». - (14) |
| barbouilli : barbouiller - (57) |
| barbouillon, barbouillonne : syn. de bredouillon, -bredouillonne. - (20) |
| barbouillon, s. m. bouton qui pousse sur la langue des veaux. - (08) |
| barbouillon, s. m., qui ne sait ni parler, ni se tenir, décontenancé : « Olé sâle, ô,n' dit mot ; y ét eun vrâ barbouillon ». - (14) |
| barbouillöt, sm. renoncule des marais. - (17) |
| barbouillou (adjectif) : barbouillé, sale, négligé. - (47) |
| barbouillou (ze): sale (en parlant du visage) - (35) |
| barbouillou : un mauvais peintre - (46) |
| barbouilloux, barbouilleur. Malpropre, sale. Fig. Bavard, qui cause sans réfléchir. - (49) |
| barboulaude : voir barboulotte - (23) |
| barboulot (n. m.) : coccinelle - (64) |
| barboulot : voir barboulotte - (23) |
| barboulot : coccinelle. - (58) |
| barboulote, subst. féminin : coccinelle. - (54) |
| barboulotte (n.f.) : coccinelle - (50) |
| barboulotte : coccinelle, bête à bon Dieu. La barboulotte est censée porter bonheur. - (52) |
| barboulotte : coccinelle. 111, p. 42 ; IV, p. 26 - (23) |
| barboulotte : coccinelle, bête à bon Dieu. La barboulotte porte bonheur. - (33) |
| barboulotte : coccinelle - (39) |
| barboulotte, barbelotte. s. f. Bète au bon Dieu, coccinelle. Montillot. - En général, insecte ailé, petit scarabée portant des antennes, des barbilles, entre les yeux. - (10) |
| barboulotte, s. f. insecte de l'ordre des coléoptères. Il y en a un qui est rouge pointillé de noir ; l'autre est entièrement noir. - (08) |
| barboulotte. n. f. - Coccinelle. - (42) |
| barbourotte : courtilière. (PSS. T II) - B - (25) |
| barbouti (chardon), s. m. sorte de gros chardon hérissé, piquant. - (22) |
| barbouti : adj., vx fr. barboté, hérissé. Vous êtes aimable comme un chardon barbouti. - (20) |
| barboutière (pour barbottière). s f. Lieu rempli de boue. - (10) |
| barboux. Barbu. - (49) |
| barbòye (être à la), loc. se dit lorsqu'il y a un désarroi dans les prix en baisse : le vin est à la barbòye. - (24) |
| barche : Brèche. « J'ai fait eune barche à man cutiau (couteau) ». - (19) |
| barchot : Brèche-dent. « Y a longtemps que man grand (grand père) est barchot ». - (19) |
| barchot : édenté partiellement. - (62) |
| bardadeau ! beurduieau ! Exclamation qui se pousse lorsqu'on entend la chute d'un objet qui fait du bruit, du fracas en tombant. - (10) |
| bardadô, bardadou, beurdadeau ! - Exclamation émise lorsqu'on entend la chute bruyante d'un enfant ou d'un objet : « Bardadô ! Comme on dit chez nous quand un enfant tombe. » (Colette, Claudine à Paris, p.227) - (42) |
| bardane : s. f., punaise. - (20) |
| bardat, bardot adj. Tacheté, bariolé. Voir barré. - (63) |
| bardat. Bariolé de blanc. On appelle le loir « rat bardat ». - (49) |
| bardeau. n. m. - Grosse cloche suspendue au cou d'une vache. - (42) |
| bardeau. s. m. Grosse sonnette au cou des bêtes à cornes. (Bléneau.) - (10) |
| bardée : grosse charge. Une bounne bardée : une bonne charge. - (52) |
| bardée : grosse charge. Y en avo une bounne bardée : il y en avait une bonne charge. - (33) |
| bardée. n. f. - Forte charge sur une charrette, ou sur tout autre moyen de locomotion. En français non dialectal, on dit barda. Bardée, comme barda, est directement issu du bas latin bastum : ce qui est porté. La bardée peut être aussi ce que peut porter un bard, sorte de civière à claire-voie transportée par deux hommes chargeant des pierres ou tout autre matériau. La bardée était encore employée en français au milieu du XXe siècle. - (42) |
| bardée. s. f. Forte charge. - (10) |
| bardelé, adj. taché de rouge ; se dit surtout des raisins commençant à mûrir. - (22) |
| barder : Déraper, faire un écart brusque, une embardée. « Le chai (char) a bardé à la descente ». Au figuré : « Attention y va barder » : méfions nous, il va y avoir du grabuge. - (19) |
| barder. Bien aller, aller vite, rondement. Etym. inconnue ; comparez embarder. - (12) |
| barder. v. a. Mettre en état, tailler, rogner. – Se dit, neutralement, d'une voiture dont les roues glissent sur la glace au lieu de tourner. - (10) |
| bardeux. s. m. Croissant, serpe au bout d'une perche pour barder les haies. - (10) |
| bardœ, adj. bariolé de rouge et de blanc. - (22) |
| bardolé : Polychrome. « Des ûs bardolés » des œufs de Pâques coloriés. Un procédé pour bardoler les œufs de Pâques consiste à les faire cuire dans une décoction de pelures d'oignons après en avoir enduit de cire les parties qu'on veut laisser blanches. - (19) |
| bàrdôler, berdôler (Chal.), barrôlai (C.). - Barioler, de variolatus, d'où bardot et berdot pour bariolé. Le té bardot désigne, dans le Chalonnais, la salamandre terrestre, qui est jaune avec des taches noires. Dans la même région, des cocos bardots sont des oeufs de Pâques teints de couleurs variées. - (15) |
| bardoler, et berdoler, v. tr., barioler, peindre de plusieurs couleurs les œufs de Pâques. - (14) |
| bardolet, de divers tons. - (38) |
| bardoller, barioler. - (05) |
| bardot : briques de galandage, gros rat. - (30) |
| bardot : multicolore - (57) |
| bardot : multicolore, tacheté. « Un rat bardot » : le lérot. « Un’ne panaille bardotte » : épi de maïs aux grains de plusieurs couleurs. - (62) |
| Bardot : Nom qu'on donne aux bœufs dont le pelage est taché de roux. « Pique le Bardot ». - (19) |
| bardot et berdot, adj., bariolé. Pour Pâques, les marchandes mettent en vente les cocos bardots, c'est-à-dire peinturlurés de diverses couleurs. On les dit aussi bardolès, du verbe qui précède. S'applique aussi aux taches de rousseur : « C'te fonne é bardote ». - (14) |
| bardot : adj. de couleur bariolée. Nom donné aux vaches tachetées. - (21) |
| bardôt, adj. bariolé de rouge et de blanc : un taureau bardot. Fém. bardotte. - (24) |
| bardot, adj. de différentes couleurs ; in ta bardot : une salamandre. - (38) |
| bardot, adj., de deux couleurs ; croisé. - (40) |
| bardot, bardote : adj., blanc et brun. Se dit de la robe des animaux de l'espèce bovine. - (20) |
| bardot, bardotte, bariolé, - ée. - (05) |
| bardzotte : (nf) poire d’hiver - (35) |
| bardzotte : poire d'hiver - (43) |
| bardzotte n.f. (p.ê. de bardat, bardot, tacheté). Poire d'hiver. - (63) |
| baré(é) : nom de bœuf, vache - (39) |
| bâré, celui dont l'esprit est peu ouvert. - (16) |
| baréger. v. n. Aller de côté et d'autre sans rien faire. (Mont-Saint Sulpice.) - (10) |
| barègnon : s. m. lisière du champ, ordinairement recouverte d'herbe. - (21) |
| barelot, barelet (bar'Iot, bar'Iet) : s. m., vx.fr., barillot, petit baril de bois dans lequel les travailleurs emportent leur boisson. Sa contenance varie de 1 à 6 litres. - (20) |
| bârére : barrière - (48) |
| barére : s. f. barrière. - (21) |
| bârëre, barrière. - (16) |
| baret, s. m. baliveau, jeune arbre de réserve. - (08) |
| bareu : tombereau. B - (41) |
| bareu (tomberieau) : tombereau - (51) |
| bareu : tombereau - (34) |
| bareu : tombereau d'une contenance de 430-500 kg - (43) |
| bareugnon. Figure, museau. «Taise-te ou je te fous un coup de poing su le bareugnon ». - (49) |
| bareuler (verbe) : aboyer. - (47) |
| bareuzai, barosai, bairosai. La signification de ce mot est peu précise. II est essentiellement local et parait avoir été un surnom. Aujourd'hui on l'applique plus particulièrement aux gens des faubourgs de Dijon et, par extension, aux paysans des villages voisins. - (12) |
| bargé, borgé, berger ; bargerie, bergerie. - (16) |
| barge. n. f. - Assemblage de poignées de chanvre, liées ensemble pour le rouissage. Autre sens : berge - (42) |
| barge. s. f. Nuage. Ainsi appelé, sans doute, parce que les nuages flottent dans l'air, dans l'espace, comme une barge sur l'eau. - (10) |
| bargeaille, s.m. berger. - (38) |
| bargeat. s. m. Troupeau de moutons. - (10) |
| bargée, beurgée. n. f. - Bergère. - (42) |
| bargée. s. f. Bergère. - (10) |
| bargée. s. f. En général, chose qui flotte ; se dit, en particulier, de l'assemblage de plusieurs gros paquets de chanvre, mis à l'eau pour le rouissage. De barge, esquif, canot, radeau, barque en général. - (10) |
| bargeonnette. n. f. - Bergeronnette. - (42) |
| bargeonnette. s. f. Bergeronnette. – On dit aussi barjounette. - (10) |
| barger : n. m. Berger. - (53) |
| barger, beurger, berbitcher. n. m. - Berger. - (42) |
| barger, beurger. s. m. Berger. - (10) |
| barger, s. m., berger. - (14) |
| bargère, s. f., bergère. - (14) |
| bargerie, s. f., bergerie. - (14) |
| bargie, beurgie, bargerie. n. f. - Bergerie. - (42) |
| barguigné. : (Dial. et pat.), hésiter, être indécis, marchander ; en basse latinité barcaniare ou barganiare. (Duc.) Le vieux mot français barge signifie esquif, navire, d'où l'idée de commerce, d'où celle de débattre des conventions d'échange ou le prix des choses, d'où l'hésitation de deux parts pour tomber d'accord, d'où, en un mot, la position de marchander. - (06) |
| barguigner (verbe) : hésiter, mettre du temps avant de prendre une décision. - (47) |
| barguigner. v. n. Marchander, tâtonner, hésiter, faire l'indécis. - Se dit, au Mont-Saint-Sulpice, pour tromper au jeu, peut-être parce que celui qui hésite, qui semble indécis en jouant, fait cela par ruse, par calcul, afin de mieux surprendre son partenaire. - (10) |
| barguin. s. m. Qui marchande, qui tâte, qui hésite. - Se dit aussi de celui qui, par calculs, par ruses ou surprises, essaie, en jouant, de prendre ses partenaires en defaut. - Se dit egalement pour pédant. Faire son barguin, faire le pédant, se donner de l'importance. - (10) |
| bari : Baril. « Boire au bari » : boire à même le baril. Les cultivateurs qui vont travailler l'été dans les champs ou dans les vignes n'ont garde d'oublier le bari. - (19) |
| bariau (un) : un portillon devant la porte d'entrée - (61) |
| bari-bouché, sm. se dit d'un silencieux qui ne se livre pas et profite du bavardage des autres. - (17) |
| baricolé : A le même sens que bardolé, voir ce mot. - (19) |
| baricolé : part. pass., bariolé. - (20) |
| baricolé, adj. coloré diversement : une fiarde (toupie) baricolée. - (24) |
| baricolé, part. pass. bariolé, bigarré. - (08) |
| baricoulé, v. a. colorer diversement. - (22) |
| barignon, s. m., chemin creux. (V. Conchise). - (14) |
| barigolé, adj., bariolé. - (14) |
| barigoler, v. tr., barioler. - (14) |
| barigoulot, bariolé, - (38) |
| barjale : Primevère. Primula officinalis. « Alla cudre (cueillir) de la barjale dans les beus (bois) ». Barjale ou bargealle, margelle. « La barjale du pouits (puits) ». - (19) |
| barjale, s. f. margelle. - (22) |
| barjale, s. f. margelle. - (24) |
| barjaque n. et adj. Qui parle à tort et à travers, qui est fou, insensé, téméraire. Ce mot, que l'on retrouve dans les monts du Forez pourrait avoir la même origine que le mot d'argot "barjot" pour lequel on n'est pas sûr de l'étymologie et qui pourrait venir du verlan de jobard. - (63) |
| barle, a. f. lieu où l'on parque les bestiaux : parc, enceinte close. - (08) |
| barler, v., crier, appeler fort. - (40) |
| barleû : (nm) petit tonneau à vin - (35) |
| barleû : petit baril à vin, on le plaçait sous le char quand on allait au bois - (43) |
| barleuter : Vaciller, perdre l'équilibre. « J'ai foulé su eune piarre, i m'a fait barleuter » : j'ai marché sur un caillou, cela m'a fait perdre l'équilibre. - (19) |
| barli, barlô, dimin. de Philibert. - (08) |
| barlificoter v. Bricoler superficiellement. - (63) |
| barlœ, s. m. petit baril pour porter à boire dans les champs. - (22) |
| barlœ, s. m. petit baril pour porter à boire dans les champs. - (24) |
| barlon (ou plutôt barlong). s. m. Tonneau, cuvier, sans doute à cause de leur forme. (Sacy). - (10) |
| barlue : avoir la berlue - (39) |
| barlue, berlue. - (04) |
| barna : Tige de fer recourbée au moyen de laquelle on peut de l'extérieur, faire glisser un verrou en passant cette espèce de crochet par un trou pratiqué à cet effet dans la porte. - (19) |
| barnager, v. n. multiplier, profiter, pousser, croître en nombre. Ex. : cette variété de pommesde terre barnage bien. - (11) |
| barnager, v., prospérer, grossir. - (40) |
| barnager. v. intr., réussir, prospérer : « C'te famille a mau torné : all’ n’a point barnargé ». S'emploie aussi pour produire, fructifier: « Ces àbres ne barnagent point ; la târre ne leû convient pas. Les pommes de târre n'ont point barnagé c't' an-née ». - (14) |
| barnaizer : être prolifique (se dit à propos d'une famille qui a beaucoup d'enfants) - (39) |
| barni. : (Dial.), brave, noble, vaillant, fort. - (06) |
| barnouaijè : adj. Aller bien, qui va bien. - (53) |
| bâro, petit fût servant à contenir le vin que le vigneron porte aux vignes pour s'abreuver. - (16) |
| barôche, paroisse... - (02) |
| barôche. : Paroisse (du latin parochia). - (06) |
| baronfler, v. intr., respirer bruyamment et péniblement : « (Ol a quêque cbouse qui le geinne ; ôl en baronfle ». - (14) |
| barôt, s. m., petit fût de bois pour aller aux champs. - (40) |
| barot. Tombereau. - (49) |
| barote : petite charrette - (51) |
| baroter : remuer en faisant du bruit. A - B - (41) |
| baroter : secouer en se déplaçant, en roulant - (51) |
| barotte :petite bétaillère pour le transport des porcs. - (30) |
| barozai - nom du patois bourguignon que nous citons dans la préface et qui veut dire les vignerons de la côte. - (18) |
| barôzai, bareuzai (Dij.). - Sobriquet donné aux vignerons. Malgré plusieurs explications ingénieuses : bec rosé (nez rouge), bas rosé, pas rusé, l'origine de ce sobriquet est encore à déterminer. Bien que cette originale appellation ne soit pas, croyons-nous, en usage ailleurs que dans le Dijonnais, le fameux Guy Barosai (B. de La Monnoye, qui a écrit sous ce pseudonyme Les Noëls Bourguignons), l'a tellement fait connaître qu'il ne paraît pas possible de l'écarter d'un recueil de patois bourguignon. - (15) |
| barôzai. Vigneron ainsi nommé, parce que d'ordinaire il portait un bas couleur de rose. Comme il s'était rendu célèbre dans le corps des vignerons de Dijon, et qu'il était un de ceux qui parlaient le bourguignon le plus franc, il est arrivé de là que le nom de Barôzai est devenu commun à tous les vignerons de la ville, en sorte qu'aujourd'hui vigneron et Barôzai (en français bas-rosé) sont synonymes. Voy. dé-Barôzoo. - (01) |
| barque : s. f., pâtisserie sèche et mince, de forme ovale et à bords relevés. Syn. de semelle. - (20) |
| barquot (un) : petite barque non compartimentée, souvent utilisée pour la chasse au gibier d’eau. - (62) |
| barquot : Petit bateau. « J'ai passé la revire (rivière) en barquot ». - (19) |
| barquot : s. m., vx fr., barque à fond plat, carrée aux deux extrémités et légèrement relevée à l'avant. Voir farquette et nagerat. - (20) |
| barquot, s. m., petit bateau, dim. masc. de barque : « Monte au barquot ; j' vons pocher ». Plusieurs l'écriraient barcot ; mais devant l’orthogr. de barque, d'où il procède, il n'y a pas à discuter. - (14) |
| barrage, s. m. étoffe à couleurs tranchantes fabriquées par les tisserands du pays et avec laquelle on confectionnait des vêtements. - (08) |
| barrage. s. m. Action de barrer, d'arrêter des malefices, de charmer un mal par des paroles, des signes mystérieux, des sortilèges. - (10) |
| barramine. Barre de fer pour forer les trous de mine. Terme minier. - (49) |
| barrauder : faire du bruit en traînant des meubles, des chaises... - (30) |
| barrault, barrot : baril. - (32) |
| barrayer. v. n. Aller de côté et d'autre, marcher de travers, tituber, chanceler. (Soucy). - (10) |
| bârré (adj.) : se dit d'un bovin dont le pelage est blanc marqué de roux (des vaches bârrées) - (64) |
| barré : bœufs barrés = ancienne race de bœufs à l'échine rayée de blanc. III, p. 21-1 : VI, p. 6 - (23) |
| barré : variété d'escargot. IV, p. 30 - (23) |
| bârré adj. Taché, tacheté, de couleurs différentes. - (63) |
| bârre n.f. Pierre de taille plus longue que large. - (63) |
| barré, adj. et subst. aux environ de Château-Chinon ce mot désigne à la fois les gendarmes, les enfants naturels et les bœufs dont le pelage est bariolé. - (08) |
| barré, bigarré. (Barrés, le morvandeau donne ce nom aux bœufs bigarrés et aux ... gendarmes. Autrefois on appelait ainsi les Carmes qui portaient des habits de diverses couleurs. Enfants barrés, bâtards). - (04) |
| barre, fermeture de porte. - De ce mot barre, qui signifie obstacle, on a fait barreau, lieu où se tiennent les avocats et qui est séparé de celui où sont les juges... - (02) |
| barre, s. f., le devant : « la barre du lit, la barre de la porte ». On dit aussi : la barre du cou, pour : la nuque, qui n'est plus le devant. - (14) |
| barrée (nom féminin) : vache dont la robe est de deux couleurs. - (47) |
| bârrée : vache pie (noire ou rouge) - (48) |
| barrée : (une, ou la) vache bicolore. Pas très valorisant pour qui la possède en milieu Charollais. - (58) |
| barrée : adj. Bicolore pour une vache. - (53) |
| barrées. s. f. pl. Grandes peines, chagrins, tourments. - (10) |
| barreire, s. f. barrière, claie mobile qui ferme l'entrée des enclos, terres ou prairies. - (08) |
| barrer (v.t.) : fermer une porte avec une barre - (50) |
| bârrer : fermer au verrou (« barre-don’ vit’ment lai porte ! ») - (37) |
| barrer la porte : fermer la porte à clef. - (59) |
| barrer, v. a., fermé. Ex.: la porte est barrée, vocable qui doit son origine à l'usage de fermer les portes au moyen d'une barre horizontale mobile s'emboîtant dans les montants en pierre ou en bois de la porte, et qui a survécu à ce mode de fermeture. - (11) |
| barrer, verbe transitif : fermer. - (54) |
| bârrer. v. - Fermer: « Va don' bârrer la pourte. » Ce verbe, encore employé en français vers 1950, est toujours très vivant au Canada. Il évoque un temps où les portes se fermaient avec une barre, et non une clef. - (42) |
| barrer. v. a. et n. Mettre des entraves à une chose, faire de l'opposition, faire grève, mettre une usine, un atelier, un chantier en interdit. Arrêter les malefices, guérir ou charmer les maux au moyen d'un sortilège, par des paroles secrètes, des prières baroques, des signes, des influences magiques. On barre une foulure, une entorse, par exemple, en faisant sur la partie malade trois croix avec l'orteil du pied gauche et en disant Antè, contra antè, super antè, après quoi la douleur cesse et le mal est guéri.C'est aussi de cette manière qu'on barre le charbon, le chancre, la maumarche, le croup et la chute de la glotte (prononcez gliotte, le gl se mouillant à la manière italienne). - (10) |
| barrère (n.f.) : claie mobile, barrière - (50) |
| barrère : Barrière. « La barrère est fremée (fermée) ». - (19) |
| bârrére : n. f. Barrière. - (53) |
| barrêre, s. f., barrière, clôture. - (40) |
| barrére. Barrière. - (49) |
| barres : Rayures. « Eune culotte à barres ». - (19) |
| barreut : s. m., vx fr., barote (s. f.) : tombereau. - (20) |
| barreutter : remuer en faisant du bruit - (43) |
| barreux, euse. s. m. et f. Nom donné à celui ou à celle qui barre les maux, les maléfices. - (10) |
| bârreux. n. m. - Sorcier, guérisseur, celui qui barre le mal synonyme de empicasseux. - (42) |
| barrias. s. m. Barreau. (Domecy-sur-le-Vault.) - (10) |
| barriau (nom masculin) : à la campagne, demie-porte à claire-voie qui empêchait les volailles d'entrer dans l'habitation. On dit aussi vanteille. - (47) |
| barriau : petite barrière - (60) |
| barriau : petite barrière devant la porte de la cuisine d'une maison d'habitation. (SS. T IV) - N - (25) |
| barriau. Barreau, se dit également pour désigner une petite barrière. - (49) |
| bârriau. n. m. - Petite barrière ou petite porte à claire-voie. - (42) |
| barriau. s. m. Petite porte à claire-voie. - (10) |
| barricade n.f. Clôture. - (63) |
| barricoulé. adj. Bigarré. - (10) |
| barriée : barrière. - (58) |
| barriée, s. f. barrière. - (08) |
| barrière : s. f., pont de pantalon. Culotte à, barrière. Voir trappon. - (20) |
| barriolage. s. m. Barres, marques diverses et capricieuses faites ou peintes sur un objet. - (10) |
| barriolé, ée. adj. Qui est marqué de barres, de dessins bizarres et de couleurs variées. Qu'est-ce qu'une robe comme ça, toute barriolée de rouge, de vert, de jaune et de bleu ? En voilà un goût ! - (10) |
| barrioleux, barrioleur. s. m. Employé d'octroi, prépose à la garde d'une barrière d'entrée d'une ville. - (10) |
| bârriot (n. m.) : petite barrière située devant la porte d'entrée d'une maison - (64) |
| barrire (na) - scia (na) : barrière (grande) - (57) |
| barrire : (nf) barrière - (35) |
| barrire : barrière - (51) |
| barrire : entrée de pré - (43) |
| barrîre n.f. Barrière. - (63) |
| barrô, brouette... - (02) |
| barrotté : remué en faisant du bruit - (34) |
| barroux, barrouse : s. m. et f., habitant du quartier de la Barre à Mâcon. - (20) |
| barsô, s. m., grand panier en osier pour les vendanges, à double anse. - (40) |
| bartavelle : perdrix, bavarde. - (30) |
| Barthan ou Barthe : Nom de baptême employé au lieu de Philiberthe ou Berthe. « Mens y de l'ignan, Barthan » : mets y de l'oignon, Berthe. - (19) |
| Bartiche, nom propre, Berthe. - (38) |
| bas (ai) (loc.) : par terre - (50) |
| bas (descendre en), amplif. incorrect, employé un peu partout. - (14) |
| bas : (adj) profond (en parlant d’un puit) - (35) |
| bâs n.m.pl. Fond de vallée. - (63) |
| bas : s. m., berlingot dont la forme rappelle celle d'une paire de bas enroulée et rabattue. - (20) |
| bas(à) : à terre - (51) |
| basaine : Tablier de cuir. « Ol a mis sa basaine pa aller fagueuter des épeunes (fagoter des épines). - (19) |
| basaine, s. f., basane, peau de mouton préparée. - (14) |
| basane : tablier en forte toile ou en cuir. A - B - (41) |
| basané adj. Sombre, gris, couvert, en parlant du ciel. - (63) |
| basané : part, pass., gris, noirâtre, embrumé, trouble. Ciel basané. Vin basané. - (20) |
| bas-culot. s. m. Dernier né d’une nichée d’oiseaux, qui est ordinairement le plus faible et reste, dit-on, quelques jours de plus au nid. - (10) |
| bas-flanc. n. m. - Planche suspendue verticalement à une certaine hauteur du sol dans une écurie, pour séparer les chevaux ; synonyme de abat-flanc. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| basioles. s. f.pl. Contes, sornettes, gaudrioles. (Gisy-les-NobIes). - (10) |
| bassache. Abreuvoir des animaux. - (49) |
| bassan : s. m. louche à long manche servant à prendre de l'eau dans le seau. - (21) |
| bassée : n. m. Bassin. - (53) |
| basse-goutte. n. f. - Petite construction dont le toit descend très bas, en appui sur un bâtiment plus important, et généralement composée d'une seule pièce, remise, poulailler, chambre, etc. - (42) |
| basse-goutte. s. f. Petite chambre, petit cellier à l'arrière de quelques habitations, et dont le toit descend très-bas. - (10) |
| basseigne. s. f. Bassin, bassine. (Menades). - (10) |
| bassén d'or, fleur de l'anémone appelée pièpou. - (16) |
| bassén, vase à long manche servant à puiser l'eau dans un seau. - (16) |
| basser (prononcez Bacer). v. a. et v. n. Remuer, se soulever, s'agiter. Les porteurs d'eau ont l'habitude de mettre une petite planchette arrondie dans leurs seaux pour empêcher l'eau de basser. Dans l'Yonne et probablement partout, on basse le vin après qu’il a été collé. - (10) |
| bassette. Jeu de cartes connu depuis plus de 300 ans en Italie, d’où un noble Vénitien l'apporta en France, où il était ambassadeur de la république en 1678. - (01) |
| basseur, s. f. profondeur. Ce trou est profond, je n'en connais pas la « basseur. » - (08) |
| bassi : pièce servant de débarras et pour la vaisselle dans une ferme. A - B - (41) |
| bassi : baisser - (57) |
| bassi : pièce servant de débarras dans une ferme - (34) |
| bassie (n. f.) : évier de pierre - (64) |
| bassie : (nf) coin où se trouve l’évier - (35) |
| bassie : évier, pierre d'évier, coin où se trouve l'évier - (43) |
| bassie : évier, par extension : pièce où l'on fait la vaisselle - (60) |
| bassie : évier. - (30) |
| bassie : évier. (SS. T IV) - N - (25) |
| bassie : évier. III, p. 5-3 ; III, p. 49-4 ; IV, p. 32 - (23) |
| bassie : pierre d'évier - (61) |
| bassie : pierre d'évier, pièce où se trouve la pierre d'évier - (51) |
| bassie n.f. (du gaul. baccinon, bouclier creux à poignées) Arrière cuisine, souillarde, coin de l'évier, pierre d'évier. - (63) |
| bassie : évier (mot entendu dans les villages voisins) - (39) |
| bassie : évier en pierre, très plat, avec une sortie dehors, par un trou ménagé dans le mur. - (58) |
| bassie, n.f. petite pièce où l'on fait la vaisselle. Peut désigner aussi l'évier. - (65) |
| bassie, s. f. lieu où on lave la vaisselle, terme à peu près synonyme de cellier. - (08) |
| bassie. Évier ; par extension local où est l'évier. - (49) |
| bassie. n. f. - Évier en pierre. Simplification du mot bassin - bacin, employé dès le XIIe siècle, et dérivé du bas latin baccinus : récipient creux à fond plat. - (42) |
| bassie. s . f. Evier, recoin où on lave la vaisselle, et, dans quelques endroits, placard ou on la serre. - (10) |
| bâssier : pierre d'évier, synonyme « seiller ». - (33) |
| bassier. s. m . Fabricant de bas, bonnetier. Un bonnetier fabrique bien des bas, un bassier peut bien en retour fabriquer des bonnets de coton. - (10) |
| bassiére, s. f. lie, dépôt qui se trouve au fond d'un vase. - (08) |
| bassieu : Le seuil de la porte. « Ol est sité su le bassieu » : il est assis sur le seuil de la porte. - (19) |
| bassin : (nm) louche à fond plat (pour se désaltérer en rentrant de champs) - (35) |
| bassin : Espèce de grande cuillère en métal, à long manche, qui sert à puiser de l'eau dans le seau. Le contenu de cette cuillère : « In bassin d'iau fraîche ». - (19) |
| bassin : louche en métal, à fond plat, servant à prendre l'eau dans un seau - (43) |
| bassin d'or. Sorte de renoncule des prés. - (03) |
| bassin p’seuille : (exp) sens dessus dessous - (35) |
| bassin Voir bachin. - (63) |
| bassin : s. m., poche à puiser l'eau dans le seau. - (20) |
| bassin, baissin, s. m. petit bassin en cuivre et muni d'une queue ou manche. Dans chaque maison, le bassin, qui remplace le verre à boire, est suspendu au-dessus du « soillau » ou seau. - (08) |
| bassin, s. m., petit vase en cuivre et à queue, accompagnant toujours le siau qui contient l'eau à boire. - (14) |
| bassin. Petit vase en cuivre ou en fer blanc muni d'un très long manche qui sert à puiser l'eau dans les seaux. - (12) |
| bassin. s. m. et bassine, s. f. Renoncule des prés. Voyez Clair-Bassin, Piépou. - (10) |
| bassin. Vase à boire à longue queue, généralement en cuivre. Placé dans le seau d'eau ou suspendu à proximité, il sert à chacun pour boire l'eau du seau. - (49) |
| bassin. Vase en cuivre, à longue queue, accroché en permanance à côté du soillot d'iâ. On appelait jadis plats bassins des plais creux, à mettre les viandes et simplement bassins les plats à barbe : on reconnaissait la boutique d'un chirurgien à ses bassins argentés et celle d'un simple barbier à ses bassins de cuivre jaune. Les chirurgiens, jadis très nombreux à Beaune, ont disparu et les barbiers deviennent rares : il n'y a plus que des « parfumeurs. » - (13) |
| bassin-d'or, s. m., renoncule des prés. - (14) |
| bassine : s. f., bassin, vase plat qu'on passe sous le siège des malades alités quand ils ont à satisfaire leurs besoins naturels. La vielle bassine en faïence, de forme circuJaire, à bords rabattus en dedans, et se vidant par le manche, tend à disparaître devant le « bassin » moderne en tôle émaillée. - (20) |
| bassiner (verbe) : lasser, fatiguer, importuner. - (47) |
| bassins. n. m. pl. - Mancherons de la charrue. - (42) |
| bassins. s. m. pl. Manches de la charrue. - (10) |
| bassis. s . m . Liquide altéré pour avoirélé bassé. - (10) |
| bassöyé, vn. faire le goûter de quatre heures. - (17) |
| bastant. adj. Qui est en bonne santé, dans un état satisfaisant. A Jaulges, les gens malades, souffreteux, ne sont pas bastants. - (10) |
| baste. : (Dial et pat.), suffit ! exclamation fournie par le verbe impersonnel italien bastare, suffire. - (06) |
| bastéger. f. a. Mettre à bas, renverser, jeter par terre, atterrer. De Bas. - (10) |
| basterò. Suffirait, de l'italien bastare, suffire… - (01) |
| Bastien, enne, nom propre. Seul usité pour Sébastien, Sébastienne. - (08) |
| bastringue, s. m., bruit dissonnant qui agace, tapage : « V’tu ben, ch' ti botriau, fini ton bastringue ; te m' casses les orilles ». - (14) |
| bat' : battre - (48) |
| bat' en gueule : v. i. Bavarder pour ne rien dire. - (53) |
| bat’as' : averse. (LCSS. T IV) - S&L - (25) |
| bât’ner. v. a. Bâtonner. - (10) |
| batâ : Bâtard. « Alle n 'a jamâ été mairiée, ses p 'tiets sant des batâs » : elle n'a jamais été mariée, ses enfants sont des bâtards. - « Pieuche batârde » pioche plus grosse que la pioche ordinaire mais moins grosse que la pioche des terrassiers dite en patois « plieuche pionère ». - (19) |
| bataclan : Ce qu'on possède. « Ol a to miji san bataclan » : il a mangé tout son avoir. - Attirail encombrant : « Ol est parti ave to san bataclan ». - (19) |
| bataclan. Tout le bataclan, c'est tout ce qui compose un train de maison, tout ce qu'une personne a d'argent. – Ce mot se dit aussi dans d'autres provinces ; clan veut dire tribut, famille... - (02) |
| batafi. s. m., petit morceau de corde non tordue, dont les mariniers se servent pour attacher ensemble deux autres cordes, deux petits bouts de bois, etc. - (14) |
| batafil (batafi) : s. m., ficelle qui sert aux mariniers pour relier les cordes que leur calibre empêche de nouer. - (20) |
| batafil. Câble en fil d'aloès ou de chanvre, d'un usage courant à la mine. - (49) |
| bataillarde : s. f., pièce de bols qui, dans la trêche d'avant d'un char, est parallèle h la volée. - (20) |
| bataille-champel. : Duel judiciaire. (Franchises de Molesmes, 1260.) - (06) |
| bâtan : Bâton. - (19) |
| batant : élocution facile . Ol'e un bon batant : il parle facilement. - (33) |
| bâtant, s. m., sorte de piège en planchettes pour prendre les oiseaux, trébuchet. - (14) |
| batardiau n.m. Barrage provisoire, digue artificielle. - (63) |
| batardjau : cloisonnement en bois - (51) |
| batardjeau. Batardeau. - (49) |
| batchau : bateau - (51) |
| batcheau (on) : bateau - (57) |
| batchet (on) : baquet - (57) |
| bâte : Bête, naïf « Ol est pu riche qu'o ne cra, ol est bâte à peu o n'y sait pas » : il est plus riche qu'il ne le croit, il est bête et il ne le sait pas. - « Bâte à Ban Dieu » sorte de coléoptère qui n'est pas la coccinelle. - Les bâtes : le bétail. « Ol est allé en champ les bâtes » : il a mené le bétail au paturage. - (19) |
| bâte ou ah bate ! - bah ! peu importe! A peu près le même sens que Voitte, mais plus sérieux ; sens d'indifférence. - (18) |
| batelé, v. n. surnager sur l'eau, comme un bateau. - (22) |
| batènme, baptême. - (16) |
| bateron, s. m., espèce de tresse formée avec le chanvre qu'on ne ferrote pas. - (14) |
| bati : bas beurre. - (21) |
| bâti : Bâtir, construire « Ol a fait bâti » : il a fait construire un bâtiment. Au figuré, en parlant d'une femme dont la grossesse commence à être apparente, on dit : «Alle bâti su le devant ». - (19) |
| bâti, part. pass. bâti, construit. S’emploie adjectivement. Un homme dit : « i seu bâti » pour dire qu'il a une maison, qu'il a achevé une bâtisse. - (08) |
| batiau (n.m.) : bateau - (50) |
| batiau : Bateau, « Aller en batiau », canoter. - (19) |
| batiau, s. m,, bateau. - (14) |
| batiau. n. m. - Bateau. - (42) |
| bâtichoux. s. m. bâtisseur. - (10) |
| batie (bâtie) : s. f., bâtiment, bastide. Des écarts de Charnay-lès-Mâcon et de La Chapelle-de-Cuinchay portent ce nom. - (20) |
| bâtié, s. m. blatier, marchand de blé, celui qui fait le commerce des grains. - (08) |
| bâtier (v.t.) : baptiser - (50) |
| bâtier, bâtié (n.m.) (de l’a. fr. blatier : marchand de blé) - (50) |
| bâtîje : Bêtises, sottise, erreur, faute « Prends garde de fare eune bâtîje» : prends garde de faire une sottise. « Dire des bâtijes » tenir des propos licencieux. - (19) |
| batiji : Baptiser. « Y est le curé Mautrey que m'a batiji ». - (19) |
| batin, s. m., petit lait, résidu aqueux, qui s'est produit à la battue du beurre. - (14) |
| batin. Résidu aqueux du beurre. On sait qu'on dit battre le beurre. - (03) |
| batiô : un bateau - (46) |
| Batisse, Baptiste. - (16) |
| bâtisse, maison en construction. - (16) |
| bat-l’âne. s. m. Garçon meunier qui, muni d'une corne ou d'une trompe, parcourait autrefois les villages avec un ou plusieurs ânes, quêtant les sacs de grains à moudre et reportant la ferine. Aujourd'hui, le bat-l'âne n'existe plus ; tous les meuniers ont des chevaux ou des voitures. - (10) |
| bat'l'âne : garçon meunier. Au mèlin y avo un bat'l'âne : au moulin il y avait un garçon meunier. - (33) |
| bât-lâne. n. m. - Garçon meunier qui, muni d'une corne ou d'une trompette, parcourait autrefois les villages avec un ou plusieurs ânes, quêtant les sacs de grain à moudre et rapportant la farine. On reconnaît dans le bât-lâne l’'âne au bât ; le bât posé sur le dos de l'animal servait à porter de lourdes charges. - (42) |
| bâtner. n. m. - Bâtonner. - (42) |
| baton (du) : babeurre - (57) |
| bâton deu lit : bâton non écorcé, patiné à l’usage, que l’on promène horizontalement sur la literie d’un « lit de coin » afin de l’égaliser - (37) |
| baton. Ce mot s'emploie couramment pour désigner un barreau de chaise, d'échelle. - (49) |
| bâtonnat. s. m. Batte à beurre. - (10) |
| batou, s. m., batteur de blé, qui bat au fléau, en grange. - (14) |
| bàtràce, bàtrasse, bàtteràsse (Chal., C.). - Averse; pleuvoir à batrace, pleuvoir à verse. On pourrait croire que ce mot vient de batracoi (grenouilles)… Cette noble étymologie n'a été proposée que sur de fausses apparences et par suite d'une façon mauvaise d'orthographier le mot qui doit s'écrire simplement batterasse ou battrasse. Nous voyons, en effet, dans le vieux français, le mot batteresse ou batresse signifiant celle qui bat, employé pour désigner un subit orage de grêle. - (15) |
| batrace. Forte averse subite. - (49) |
| batrasse : averse. (B. T IV) - S&L - (25) |
| batrasse, grosse pluie battante. - (05) |
| batrasse, n.f. forte averse. - (65) |
| batrasse, s. f., pluie orageuse de courte durée ; engueulade. - (40) |
| batrasse, subst. féminin : pluie soudaine, violente. - (54) |
| batrasse. s. f., forte pluie, averse, parfois mélangée de grêle : « La vigne a passé fleur, mais gare la batrasse ! » - (14) |
| batre de la caisse, loc, tambouriner, fonction du « tambournier ». - (14) |
| batre, v. tr., pris dans une acception absolue pour : battre le blé : L' pâre Chose bat à Saint-Jean » . Une locution très usitée est encore celle-ci : « batre en grange ». - (14) |
| batron*, s. m. paquet de chanvre pour mettre sous la meule. - (22) |
| batsat, batsé : (nm) auge pour les porcs - (35) |
| batsé : auge à porc. A - B - (41) |
| batsé de cotson : auge à porc - (43) |
| batsêche : abreuvoir en pierre pour bovins (en B : batsèsse). A - (41) |
| batsèche n.f. (du gaul. baccos) Abreuvoir en pierre. - (63) |
| batsesse : (nf) abreuvoir - (35) |
| batsèsse : abreuvoir en pierre - (34) |
| batsesse : abreuvoir en pierre - (43) |
| batsesse : bassin servant d'abreuvoir - (51) |
| batset : auge à porcs - (34) |
| batset : bac - (51) |
| batset n.m. Auge des porcs. - (63) |
| batsi : œuf fêlé par le poussin au moment de l'éclosion. A - B - (41) |
| batsi : œuf fêlé par le poussin qui éclot - (34) |
| bâtsi v. Bâcher. Voir caper. - (63) |
| battain, babeure, lait de beurre. - (05) |
| battant n.m. Porte, surtout quand elle était en 2 parties. - (63) |
| battant. adv. Complétement, tout-à-fait. Un chapeau, un habit battant neuf. - (10) |
| battant. n. m. - Langue : toujours employé dans un sens péjoratif: «J'ons renconté la belle-mée au Pierrot, alle en a un battant c'te femme là ! » - (42) |
| battant. s. m. Langue, et principalement langue de femme. All'en a un battant, c'tefumell'là. - (10) |
| batte és flancs v. Respirer bruyamment, avec difficulté. - (63) |
| batte v. Battre. - (63) |
| batte : (bat’ - v. trans.) battre dans tous les sens du verbe français. - (45) |
| batte, battouée. s. f. Baratte. - (10) |
| battée (n. f.) : procédé consistant à se réchauffer en frappant énergiquement et à plusieurs reprises ses deux bras contre sa poitrine - (64) |
| batterasse (batrasse) : s. f., vx fr., baterie, averse prolongée. Voir garrot. Boire à batterasse, boire tant que tant que (voir tant que.,.). - (20) |
| batterasse. Violente pluie d'orage. - (13) |
| batterie : (bat’ri - subst. f.) aire de battage dans la grange. - (45) |
| batterie, partie de grange à battre. - (05) |
| batterie, s. f. aire de grange, emplacement réservé pour le battage des gerbes au fléau. Le sol de la batterie est ordinairement formé d'argile damée avec soin. - (08) |
| bâtterie. n. f. - Endroit où l'on bat les céréales au fléau. - (42) |
| batterie. s. f. Endroit ou l'on bat le blé dans une grange. (Sommecaise). - (10) |
| batteur : s. m., vx. fr., bateor, moulin a drap, moulin à tan. - (20) |
| batteûre (na) : baratte - (57) |
| batteure : Rixe. « Dan'in temps la fête n'était pas balle si i n'y avait pas quéque batteure ». Autrefois la fête du village n'était pas complète s'il n'y avait quelque rixe entre les jeunes gens de la localité et ceux des villages voisins. Ces mœurs brutales n'existent plus. - (19) |
| batteure, beurrière. - (05) |
| batteux. n. m. pl.- Batteurs : nom donné aux ouvriers agricoles qui travaillent au battage. « Va don' pourter du cid' aux batteux ! » - (42) |
| batti : Petit lait qui reste dans la baratte quand on en retire le beurre qui vient d'être battu. « Eune écualle de batti » : une écuelle de petit lait. - (19) |
| battis. s. m. Lait de beurre. - (10) |
| battoïasse. Pie grièche. Ainsi nommée parce qu'elle se bat avec « l'oïasse », la pie. - (49) |
| battoir, subst. masculin : battage. - (54) |
| battou (-ouse) (n.m. ou f.) : celui ou celle qui bat au fléau - (50) |
| battoû : batteur (homme) - (48) |
| battou : batteur - (39) |
| battou, paleute : battoir à linge - (43) |
| battou, s. m. batteur en grange, celui qui bat au fléau. - (08) |
| battou: (nm) battant du fléau - (35) |
| battouaîr (on) : battoir - (57) |
| battouaire (nom féminin) : machine à battre le grain. - (47) |
| battoué. n. m. - Battoir utilisé pour laver le linge. - (42) |
| battouère : batteuse - (48) |
| battouère : le battage, le battoir, la batteuse - (46) |
| battouère : le battoir avec lequel la lavandière battait le linge à laver sur sa planche, on dit également le rouillo. - (46) |
| battouère : batteuse. - (33) |
| battouère : n.m. Battoir. - (53) |
| battrasse : Grosse averse, pluie battante. « Y a cheu eune bonne battrasse » : il est tombé une grosse averse. - (19) |
| battrasse n.f. Pluie battante. Boire à battrasse. - (63) |
| battre : Tasser. « Y a si bin pliu que le tarrain est battu c 'ment eune plièche de grange » : il a tant plu que le terrain est tassé comme l'aire d'une grange. Fabriquer le beurre : « Je n'ai plieu guère de beurre, ma je batterai venredi (vendredi) ». - (19) |
| battre des manigoinches, battre des badigoinches. expr. Parler pour ne rien dire. - (42) |
| battre son plein : frapper avec l'index sur un tonneau en vidange afin d'évaluer le degré de remplissage. (M. T III) - B - (25) |
| battre, v. gauler la noix. - (65) |
| battre, v. n. livrer combat, lutter. Nous avons « battu » plusieurs heures ; à la fin nous avons gagné. - (08) |
| battrie : sol de la grange où s'effectuait le battage au fléau - (48) |
| battrie n.f. Battage à la machine. Grosse battrie, grosse beuvrie ! - (63) |
| battrie : sol de la grange - (39) |
| battue : Quantité de beurre que la ménagère fabrique en une fois « Eune battue de quat'livres ». - (19) |
| battue : fil du tranchant d'un outil - (39) |
| batue : (subst. f.) partie amincie de la lame de la faux que l'on pose sur une petite enclume spéciale, pour la rebattre avec le bec du marteau. - (45) |
| bature, sf. lait de beurre. - (17) |
| bau bié: (exp. Adv.) bel et bien - (35) |
| baubituelle : vieille maison. (LS. T IV) - Y - (25) |
| baubutaine. s . f. Masure. — A Tannerre, une maisonnette est appelée bobitaine. - (10) |
| bauche : s, f., jeu de bauche, jeu de boules. - (20) |
| bauche : s. f. échelle transversale sur laquelle on faisait sécher le pain sorti du four. - (21) |
| bauche*, s. f. caisse ou panier de marchand forain. - (22) |
| bauché, s. m., fenil. (V. foincau). (Mervans). - (14) |
| bauche. s. f. Longue tranche de lard. (Pasilly). - (10) |
| baucher : v. a., chasser une boule par um autre sans que celle-ci ait touché le sol. - (20) |
| baucher, fenil supérieur. - (05) |
| baucheton : bûcheron. (P. T IV) - Y - (25) |
| baucheton. n. m. - Bûcheron. L'ancien français du XIIe siècle disait baschillon pour bûcheron, mot dérivé de boschier, couper du bois ; là se situe l'origine du mot baucheton. - (42) |
| baucheton. s. m. Bûcheron. - (10) |
| bauchetonner, bûchetonner. v. - Faire le bûcheron. - (42) |
| bauchetonner. v. n. Faire le bûcheron, couper, débiter du bois comme les bûcherons. - (10) |
| bauchoule, s. f. hotte spéciale pour la terre ou le fumier. - (22) |
| baude : (nm) âne - (35) |
| baude n.m. Baudet, âne. - (63) |
| baude*, s. m. baudet. - (22) |
| baude, adj. gai, jovial, de bonne humeur. - (08) |
| baudement. Joyeusement. Même racine que Ribaud et s'ébaudir. Ce mot est devenu un nom de famille assez répandu. - (13) |
| baudet (nom masculin) : pelote à épingles. - (47) |
| baudet, s. m. pelote à épingles. - (08) |
| baudi, boudi. n. m. - Jeune veau. On l'appelle en disant « baudi, baudi, baudi ! » - (42) |
| baudi. Garantir. Je baudi, je garantis ; tu baudi , tu garantis ; ai haudi , il garantit. Je baudi, ai dire d'espar, le méne aussi frianque l’autre, signifie : je garantis, à dire d'experts, mon Noël aussi délicat que l'autre… - (01) |
| baudin (n.m.) : boudin (aussi bodin) - (50) |
| baudir. : (Dial. ), baudi (pat.). Ce mot a deux sens, selon qu'il s'emploie dans le dialecte ou dans le patois. Dans le dialecte il signifiait se réjouir et venait du haut-allemand bald. (Burgny.) - Bauderie exprimait à la fois hardiesse, courage et joie, comme si la gaîté devait être l'apanage des coeurs vifs et hardis. - Baldret était le ceinturon ou baudrier de l'homme de guerre. - Le patois donnait au mot baudir le sens de garantir. (Del.) - (06) |
| baudot. s. m. Qui a peu de sens, peu d'intelligence. - (10) |
| bauge : sac de jute pour le grain - (60) |
| bauge : (bô:j’ - subst. f.) gîte du lièvre. - (45) |
| bauge. s. f. Hutte, cabane maçonnée en baugis. - (10) |
| baugé. s. m. Valet de charrue, garçon bouvier. - (10) |
| bauger, v. n. entrer, se retirer dans une bauge, une tanière, un trou. Se dit de beaucoup d'animaux, du lièvre, du lapin, etc… - (08) |
| bauger. v. n. Faire une clôture, un mur en baugis. - (10) |
| baugis. s. m. Mortier de terre glaise mélangée de paille. - (10) |
| baular et bolar, adj., celui qui crie, qui pleure. - (14) |
| baulée et bolée, s. f., cri, hurlement, mais aussi chant de joie. - (14) |
| bauler (v. int.) : flotter, nager dans des vêtements trop amples (bauler dans son linge) - (64) |
| bauler (v.) : meugler pour le taureau et le bœuf - (50) |
| bauler et boler, v. intr., pleurer avec des cris, beugler : « E'-ti mauvais, ce p'tiot ! ô n'fait qu' bauler ! » - (14) |
| bauler, bouâler (v.t.) : beugler en parlant du boeuf - (50) |
| bauler, v. n. se dit de l'eau qui coule à pleins bords, d'un ruisseau qui submerge ses rives en se déversant au dehors : « al ô choué tan d'pleue que l’bié en baulô », il est tombé tant de pluie que le bief en débordait. - (08) |
| bauler, v.n. exprime particulièrement le mugissement prolongé des taureaux. - (08) |
| bauler. v. - Baigner, en parlant de quelque chose séjournant dans un liquide. - (42) |
| bauler. v. n. Flotter sur l'eau en gondolant, en se renflant. Une blouse, une robe. un vêtement jeté sur l'eau baule ; une planche, un morceau de liège ou de bois flotte, surnage, mais ne baule pas. Se dit, par extension, d'une personne qui a des vêtements beaucoup trop larges. Le pauvre garçon, est si maigre, qu'il baule dans son paletot. – Se Bauler. v. pron. Se vautrer, se rouler dans la poussière et la boue en jouant. - (10) |
| baulou, s. m., bûcheron vivant dans les bois, où il fabrique le charbon de bois. - (40) |
| baume (n.f.) : menthe - (50) |
| baume, s. f. Borne. (Courgis). - (10) |
| baume, s. f. nom commun à plusieurs plantes aromatiques, à la menthe-baume entre autres, qui abonde dans certains sols de notre contrée granitique. - (08) |
| bauméri, s. m , nom que les mariniers donnent aux chevaux de renfort qui, de l'autre côté de la rivière, aident au tirage des bateaux. - (14) |
| bauquing (n.m.) : bouc - (50) |
| baurégeux. s. m. Lambin, lanternier, musard. - (10) |
| baurger (v.t.) : couler à plein bord - (50) |
| baurger, v. n. couler à plein bord, tomber à flot. Après une averse, l'eau « baurge » dans les rigoles. - (08) |
| bauscule : Culbute : « Ol a fait la bouscule dans le fossé ». - (19) |
| bausculer : Faire la culbute : « Prends garde de bausculer ». - (19) |
| bausser, v. n. faire bosse, former une proéminence, un gonflement. On dit d'une femme enceinte que son ventre « bausse. » on en dit autant du carnier d'un chasseur heureux. - (08) |
| baustchule, bauscule. n. f. - Culbute, au sens propre et au sens figuré : « L'bicassier il a fait la baustchule en r'vendant ma chieuve au pée Coutin ! » - (42) |
| bauter (v.t.) : mettre (aussi bouter) - (50) |
| bautriller (se). v. pronom. Se rouler par terre; pour vautriller, par conversion du v en b. (Seignelay). - (10) |
| baux : bois - (51) |
| bavadié, vn. bavarder. - (17) |
| bavard. Mot employé dans le sens de menteur. - (49) |
| bavaroise, s. f., petit pont de pantalon. - (14) |
| bavasson, bavassonne : s. m. et f., bavard, bavarde. - (20) |
| bavasson, -onne adj. bavard. - (63) |
| bavassou : qui parle à tort et à travers. - (52) |
| baver, v. intr., bavarder, parler continuellement. - (14) |
| bavette, s. f., bavardage, longue conversation : « Voù c'ét-i qu'à' sont, nos fonnes ? — Cheû la Roussote. A' taillont eùne fine bavette ». - (14) |
| bavette. s. f. Cancan, caquetage. Tailler des bavettes, bavarder, cancaner à son aise. — Figurément, On donne le nom de bavette, à toute petite fille babillarde, qui est comme une personnification du cancan et du caquetage. - (10) |
| bavignoter : baver, bavotter. - (32) |
| bavocher, bavoucher, bavoicher, bavouécher. v. - Boire sans soif. Se dit également pour baver. - (42) |
| bavocher, bavoucher. v. n. Baver. (Béru). - (10) |
| bavocher, boire trop souvent, fréquenter les cabarets. - (27) |
| bavocheur, celui qui fréquente trop les cabarets. - (27) |
| bavocheux. n. m. - Se dit d'une personne qui boit beaucoup, et va boire à droite et à gauche, chez les uns et chez les autres. - (42) |
| bavoicher, v. a. baver, jeter de la bave, bavarder. - (08) |
| bavoicher. v. n. Buvotter. On dit aussi buvacher, dans le même sens. (Cravant, Auxerre). - (10) |
| bavoichou, ouse, adj. baveux, euse, celui ou celle qui bave, bavard, ivrogne. - (08) |
| bavoîllan : Bavoir : « Sa p'tiete a lot sali san bavoîllan » : sa petite a tout sali son bavoir. - (19) |
| bavoire, s. f. grand pont de culotte à l'ancienne mode. Les bavoires sont encore en usage dans le pays. - (08) |
| bavolette : s. f., bavolet ; jeune fllle de la campagne. - (20) |
| bavou : bavard, menteur. On dit également un bavouyou. - (62) |
| bavou : baveux, bavard - (48) |
| bavou : Baveux. Après la cérémonie du baptême le parrain doit embrasser sa commère (marraine) pour éviter que l'enfant soit « bavou ». - Bavard, blagueur, « Couge te, t'es-t-in bavou » : tais toi tu es un blagueur. - (19) |
| bavou : bavoir - (48) |
| bavou : personne qui bave - (44) |
| bavou : qui bave - (39) |
| bavou, adj., qui bave, sens propre (?), mais surtout au fig. : bavard, craqueur, menteur : « Y é pas vrai. Côge-te ; t"ét ein p'tiot bavou ». - (14) |
| bavou, bavard. - (05) |
| bavou, ouse, adj. celui ou celle qui bave : « un vieux bavou », rabâcheur, radoteur. - (08) |
| bavou. Bavard. - (03) |
| bavouaichai : parler à tort et à travers . - (33) |
| bavouaiché : v. i. Parler à tort et à travers. - (53) |
| bavouaicher (v.t.) : bavarder, parler - (50) |
| bavouaichou (n.m.) : bavard, qui parle beaucoup - (50) |
| bavouaichou : celui qui parle à tort et à travers. Ç'o agaçant un bavouachou : C'est agaçant quelqu'un qui parle à tort et à travers. - (33) |
| bavouaichou : n. m. Personne qui parle à tort et à travers. - (53) |
| bavouècher : baver, parler à tort et à travers - (48) |
| bavouesser : même sens que « baboesser » - (39) |
| bavouessou(oure) : même sens que « baboessou » - (39) |
| bavouiller : parler pour ne rien dire. - (66) |
| bavouillou, celui qui bave en parlant, celui qui se fait mal comprendre. - (27) |
| bavouilloux : qui bavouille et qui peut être un beutiot ou un beurnaziaud. - (66) |
| bavouse : baveuse - (57) |
| bavoux, baveux, qui bafouille, dit des bêtises - (36) |
| bavoux, -ouse n. et adj. Baveux. - (63) |
| bavoux,.bavououse : s. m, et f., baveur, baveuse. Une omelette bavouse. - (20) |
| baya : civière, brouette (en B : tsevire). A - (41) |
| baya : civière - (43) |
| baya. Cheval ou boeuf marqué en tête d'une tache blanche. - (03) |
| bayard, nom de bœuf au poil bai ou rouge foncé. - (08) |
| bayé d'gade, s'apercevoir. - (26) |
| bàyé, bâiller ; kèkte bùye don ? se dit de quelqu'un qui regarde sottement, en restant inactif, comme s'il bâillait d'ennui. - (16) |
| bâyé, vt. ouvrir (dans l'expression bâye tai gueule, ouvre la bouche). - (17) |
| bayi : bâiller - (43) |
| bayi : donner - (43) |
| baÿî : donner. « Baÿe à migî » : donne à manger. À rapprocher du français bail (contrat de cessions), bailler. - (62) |
| bäyie : (p.passé) (porte) entr’ouverte - (35) |
| bayou - bavassou (on) - bavousou (on) : baveux - (57) |
| bayou (on) : bavoir - (57) |
| bayous. Bavard parlant étourdiment, à tort et à travers. Voir : « barbouilloux ». - (49) |
| bazaine. s. f., étoffe employée jadis dans les costumes de femmes, et très goûtée de nos grand'mères. - (14) |
| baziñne n.f. (de basane) Tablier de cuir. - (63) |
| b'chée, b'chie. n. f. - Becquée (donner la b'chée) utilisé pour un animal ou un enfant. Ce mot est dérivé de l'ancien - (42) |
| b'chée, béchée. s. Becquée. Donner la b’chée. - (10) |
| bdien : petite cage dans laquelle on donne à manger aux petits poussins. - (21) |
| bè ! Interject. qui exprime le dégoût. - (10) |
| bê (n.m.) : bec - (50) |
| bé : bec - (37) |
| bè : bec, bouche - (48) |
| bé seur, adv., bien sûr, certainement. - (14) |
| bè : (subst. m.) bec ; par extension, et péjorativement, bouche de l'être humain (avec des connotations de niaiserie). - (45) |
| bè, adj. beau. - (17) |
| bé, adv , bien, fort, beaucoup. - (14) |
| bé, bec - (36) |
| bé, bec. - (04) |
| bê, biô : beau - (48) |
| be, boeuf. - (16) |
| be, s. m. bec. - (08) |
| bè, sm. biens (fonds). - (17) |
| bé. Bien ; bé devant une consonne, bén devant une voyelle. El a bé contan, il est bien content ; el a bén aise, il est bien aise. Bé, de même qu'en français bien , est tantôt adverbe, tantôt substantif… - (01) |
| bé. : Se met devant une consonne : Ça bi bon. On écrit devant une voyelle: El a ben aipri, c'est-àdire il est bien élevé. - (06) |
| bé: Lavoir, « Mener la beue au bé » transporter la lessive au lavoir. - Bief, « Le bé du melin » le bief du moulin ; « Le grand bé » la mer. - (19) |
| bea. Beau, beaux. - (01) |
| beacô. Beaucoup… - (01) |
| bea-fraire. Beau-frère, comme on dit beau-sire, beau-cousin… - (01) |
| Beane. Beaune, jolie ville à sept lieues de Dijon… - (01) |
| bea-peire. Beau-père. - (01) |
| béatille, s. f., bagatelle, débris, objet de peu de valeur ou de minime format. - (14) |
| béatilles, abattis de volailles. - (04) |
| béatus : Terme de jeu, celui qui assiste à la partie sans y prendre part. Exemple: la quadrette (jeu de cartes) se joue à 4, 2 contre 2, si l'on est 5 on jette une carte devant chaque joueur jusqu'à ce que les quatre rois soient sortis, désignant les quatre qui joueront pendant que le cinquième les regardera. - (19) |
| beau de treufe : une fane de pomme de terre - (46) |
| beauce, n.f. terre grasse et fertile. - (65) |
| beaucuat. n. m. - Dernier né, le plus petit. Employé indifféremment pour un enfant ou un animal. - (42) |
| beaucuat. s. m. Dernier né d'une famille. Synonyme de basculot, basculat. - (10) |
| Beaune (de), Ioc. adv., de reste, de trop. Une personne qui arrive â table sans qu'il y ait de place pour elle, est dite de Beaune. Raillerie à l'adresse des gens de Beaune. - (20) |
| Beaune (se trouver de), loc, être de reste, laissé de côté ; n'être pas suivi, pas pris au sérieux : «... Un tas de résolutions, qui toutes se trouvent de Beaune devant la dernière, la meilleure qu'elle ait jamais pu prendre » (correspondance de 1833). Cette locution chalonnaise était encore très usitée dans mon jeune temps. - (14) |
| beau-pére (on) : beau-père - (57) |
| bec, subst. masculin : brochet. - (54) |
| bécafi, s. m. becfigue. - (08) |
| becafigue, becfigue, becafi. - (04) |
| bécais : qui fait la fine bouche (se dit d'un enfant ayant peu d'appétit) - (39) |
| becaler : assoupir (s') - (57) |
| becaler : v. somnoler. - (21) |
| becarne, s. f. chassie, humeur séchée des yeux. - (22) |
| bec-de yèvre (on) : bec-de-lièvre - (57) |
| bécer. v. - Bècher. - (42) |
| becfi : Bec-figue : « Ol est allé tiri des becfis dans san jardin ». - (19) |
| becfi, becafi : s. m., becfigue. - (20) |
| becfi, s. m., becfigue, oiseau qui béquette les figues et que l'on trouve d'un manger délicat. - (14) |
| bech’lon, be’selon, piotson : petite pioche à deux dents - (43) |
| bêche : s. f., vx fr. besche, bateau servant aux bains de rivière. Il y a vingt ou trente ans, on disait couramment : Viens-tu aux bêches? Aujourd'hui on dit : aux bains de Saône. — Les bêches sont des bateaux qui, à Lyon, servaient autrefois a la traversée de la Saône. - (20) |
| bêché. adj . Becqueté. Œuf bêché. - (10) |
| bechelon, s. m. petite pioche. - (24) |
| béchelon, s. m., bêche. (Mervans.) - (14) |
| bêcher. v. a. Donner des coups de bêche. - Figurement, donner des coups de langue. Bêcher une personne, c'est la décrier, dire du mal d'elle. - (10) |
| bêcher. v. n. Etre pris de maladie, commencer à être malade (Soucy). - (10) |
| bechevet (à), loc. tête-bêche. - (24) |
| bêcheveter, béchevotter. v. a . Entrecroiser, mettre tête à pieds. De bêchevet , lit à double chevet, l’un à la tête, l’autre aux pieds. De bis et chevet. - (10) |
| bechi, v. a. effleurer, raser : la pierre l'a bechi. - (24) |
| bechi, v. a. effleurer, raser : la pierre l’a bechi. - (22) |
| bécho. Jumeau du vieux mot besson, racine le latin bis. - (03) |
| béchoiter. v. a. Disposer, croiser en sens contraire, de manière à ce que les extrémités d'un objet soient à côte de la tête ou sur la tête d'un autre de même nature. C'est une altération de bécheveter. - (10) |
| bechon : buisson. A - B - (41) |
| bechon : haie de clôture - (34) |
| bechon bian : aubépine. A - B - (41) |
| bechon bian : aubépine - (34) |
| bechon na : prunellier. A - B - (41) |
| bechon na : prunelier - (34) |
| béchoueter, béchevoter, bachevoter, bég'voter. v. - Bêcheveter, placer tête-bêche, croiser en sens contraire : « A vont ben t'ni', t'as qu'à béchouetter les gearbes ! » - (42) |
| becleûte : becquée. (RDM. T IV) - C - (25) |
| beclöte, sf. petite voiture de fourrage. - (17) |
| becnelle. s. f. Péronelle, femme sotte, babillarde, effrontée, qui a toujours le bec ouvert pour crier. - (10) |
| bécô, s. m. petit baiser, terme enfantin qui signifie au propre petit coup de bec. De bec pris dans le sens de bouche. - (08) |
| bécot, s. m., baiser : « Allons, p'tiote. vein et fais-me ein bécot ». - (14) |
| bécot, s. m., bec, petit bec. - (14) |
| bécot, subst. masculin : bouche. - (54) |
| becquignon. Bec d'un pot, d'un broc. - (49) |
| becquiller, béquiller. v. a. Manger. Je l'ai trouvé en train de becquiller. Dérivé de Bec. - (10) |
| becquin. Surnom ironique donne par ceux de la plaine aux habitants de la montagne. Etym. inconnue. - (12) |
| becrin : s. m., bigorne dont les deux branches sont rapprochées et soudées à leurs extrémités inférieures, et qui sert à travailler les sols pierreux. - (20) |
| bédame. interj. - Exclamation insistant sur l'idée énoncée ; synonyme de dame : « L 'Odette, alle est partie chez ses enfants pou' la Nouël ! Bédame, alle a hen raion ! » - (42) |
| bedau, s. m. bêta. - (22) |
| bedau, s. m. bêta. - (24) |
| bede (qu'on prononce beude, de bedon, bedaine). s. f. Se dit, dans l'Yonne et Seme-et-Marne, pour ventre. J'ai mangé plein ma beude. Voulez-vous du pain ? Oui, de la beude, s'il vous plaît. - (10) |
| bedeau (b'deau) : s. m., bêta. - (20) |
| beder. v. - Grossir, prendre du ventre, de la « bedaine ». - (42) |
| beder. v. n. Prendre du ventre, commencer à avoir la bedaine. (Puisaye). - (10) |
| bediais, n. masc. ; nuage. - (07) |
| bedion n.m. (p.ê. à rapprocher de bedon, compte tenu de sa forme arrondie). Petite gerbe de blé - (63) |
| bedion, onne n. et adj. (du francique bisunnia). Méticuleux à l'excès, au détriment de l'efficacité. Délicat. Y'est-ti bedion à faire ! C'est délicat à faire. - (63) |
| bedionner v. Travailler méticuleusement et très lentement. - (63) |
| bedole, bedoule : s. f., corbeille ovale et peu profonde, ordinairement sans anse, à l'usage des maraîchers ; hotte en osier, ailleurs appelée bachole. Une bedoule de fraises. - (20) |
| bédolouaie (une) : un dépotoir - (61) |
| bedon : peu malin. - (31) |
| bedon, s. m. cage ronde à poules, à couveuse. - (24) |
| bedon, s. m. petit ventre, ventre d'enfant. - (08) |
| bedon, s. m., bedaine, gros ventre. En français, signifie : homme replet, le gros ventre s'appelant : bedaine. « Ol a eun fameux bedon ; ma y é pas étonnant, ô bâfre tôjor ». - (14) |
| bedone : voir boudone - (23) |
| bedoucher (verbe) : porter, caliner un enfant en le tournant dans tous les sens. (Arrête don de l’bédoucher qu'y va êtes malade ce p'tiot). - (47) |
| bedouilles. s. m. pl. Gros sabot couvrant tout le pied. (Armeau). - (10) |
| bedoule, s. f. corbeille de marchand forain. - (24) |
| bédouzer : travailler de façon inefficace, malhabile - (61) |
| béét' : 1 n. f. Bête, animal. - 2 adj. Bête. - (53) |
| bée'te : bête - (48) |
| befouiner : embrasser à pleine bouche. - (30) |
| bégaiyou (n.m.) : celui qui bégaie (fém. bégaiyouse) - (50) |
| bégasse. Bécasse. - (49) |
| bégau (-de) (n.m. et f.) : bègue - (50) |
| bégau, s. m. bègue, celui qui bégaie. Au féminin bégaute, celle qui est bègue. - (08) |
| bégauter, v. a. bégayer, parler avec difficulté. - (08) |
| bégaya : Bègue : « Y a pas moyen de camprandre ce que dit ce bégaya ». - (19) |
| bégigi : ferblantier un peu bricoleur - (60) |
| begigi. Rémouleur ; ce mot est importé d'Auvergne. - (49) |
| bégint : Ivraie, lolium timulentum. « Tan pain est bien cré, i avait dan du bégint dans ton blié ? » : ton pain était bien amer, il y avait donc de l'ivraie dans ton blé ? - (19) |
| begne : coup asséné. A - B - (41) |
| begnette : bugne (pâtisserie lyonnaise) préparée le jour de mardi gras. A - B - (41) |
| bégneure : s. f. grand récipient ovale dans lequel on transporte les raisins. - (21) |
| bégneuse : Repli qu'on fait à une robe ou à une manche pour les orner ou les raccourcir. - (19) |
| begou, adj. engourdi par le froid. - (22) |
| bégu, beillu. adj. Ventru. - (10) |
| bèguai : bégayer. - (33) |
| bègué, vn. bégayer. - (17) |
| béguenou : bègue. - (29) |
| béguer : bégayer - (61) |
| bèguer : bèguer - (48) |
| béguer, v. n. parler à la manière des bègues, bégayer. - (08) |
| béguer. Bégayer. - (49) |
| béguer. v. - Bégayer. - (42) |
| béguer. v. n. Bégayer. On dit aussi Bègaiyer. - (10) |
| bègues : linges, vêtements. (RDM. T II) - B - (25) |
| bégueuler : dire du mal d'une personne. - (66) |
| bêh (mouton), loc, nom donné au mouton par les enfants qui, toutes les fois qu'une ou plusieurs de ces douces bêtes passent, conduites par le boucher, ne manquent jamais de formuler ce petit dialogue : Mouton bêh, — où vas-tu ? — A la boucherie, — Perdre la vie. — Mouton bêh, — Quand r' tiendras-tu? — Jamais... — Mouton bêh ! - (14) |
| behaisse. s. f. Besace. - (10) |
| beignard. adj. - Honteux. (Marchais-Béton, selon M. Jossier) - (42) |
| beignard. adj. Honteux. S'emploie généralement avec la négation. (Marchais-Beton). - (10) |
| bêillai : donner. Y vote bêillai des éteurnes : je vais te donner des étrennes. - (33) |
| béille (n.f.) : bille - (50) |
| bèillè : donner - èl é mô è lè main qu'beille, il a mal à la main qui donne (il est radin) - i eûteû mes gants pou beillè lè main, j'ôtai mes gants pour donner la main - si tu peux, beille-me un coup d'main, si tu peux, donne-moi un coup de main - si tu v'leu i t'beillereû ben un coup d'main, si tu voulais, je te donnerais bien un coup de main - i veu ben t'beillè un coup de main, je veux bien te donner un coup de main - (46) |
| beiller - donner. - Beille-mouai voué cequi. - A li é beillé ce qu'à mérito. - (18) |
| béiller (v.t.) : donner - (50) |
| bèiller : donner - (48) |
| beiller : donner. - (56) |
| beiller : (bèyé - v. trans.) donner. Etymologie: du lat. bajulare, "porter", d'où "apporter", et de là "donner ". Cf. le français bailler, "donner", d'un usage courant jusqu'au XVII ème siècle. - (45) |
| beiller : donner - (39) |
| bèiller, bailler. Payer. - (49) |
| beiller, donner. - (27) |
| beiller, donner. - (28) |
| beiller, v. a. bailler, donner, remettre quelque chose à quelqu'un. Ce mot est le seul usité chez nous pour donner. - (08) |
| beiller, v. tr., bailler, donner : « Qu'é-ce que te m' beilles iqui ? Y et eùne prou jolite afâre ! » - (14) |
| beiller. n. m. - Bélier. - (42) |
| beiller. Pour bailler, donner. - (03) |
| bêilli : bailler - (57) |
| beilli, v. a. 1. Donner [bailler]. — 2. Suppurer : son mal beille. - (22) |
| beillir, bailler, donner. - (05) |
| bein (adv.) : bien - (50) |
| bein : bien - (51) |
| bein, s. m. bien, propriété, fortune. - (08) |
| beinhireu, euse, adj. et subst. bienheureux. - (08) |
| beite. Prononciation patoise de bête : le diminutif, beîtion, appliqué aux individus, est très usité. Voici un joli proverbe des environs de Nuits : suivant lai beîte, lai campeune. La campène est la clochette suspendue au cou des vaches. - (13) |
| bejiare : s. f. herse. - (21) |
| béjot. n. m. - Invitation pour fêter un événement. - (42) |
| béjot. s. m. Régal offert à des amis à l'occasion d'un événement heureux. (Saint-Sanveur). - (10) |
| békas. s. m. Bêtat. - (10) |
| békin, niais, peu intelligent. - (16) |
| bélat. Niais, nigaud. - (49) |
| bélement, adv., doucement, agréablement: «Eh ben ! la mère, ça va-t-i ? — Marci, tout bêlement ». - (14) |
| béler - tchouner : pleurer (des larmes) - (57) |
| bêler, v. intr. crier en pleurant. (V. Bauler, Couiner.) - (14) |
| beligné, vl. couvrir une brebis. - (17) |
| belin : (nm) agneau - (35) |
| belin : pou de bois sur un mouton. - (30) |
| belin : s. m., vx fr., agneau. Mot également appliqué aux jeunes enfants : Comment t'appelles-tu, mon, p'tit belin? - (20) |
| belin, adj., gentil, beau, mignon. Expression caressante dans le langage des enfants : « Veins m' biser, mon p'tiot belin ! » - (14) |
| belin, beline : adj., joli, mignon, petit. - (20) |
| belin, blin n.m. (du lat. belare, bêler). Agneau. - (63) |
| belin, s. m. mot de caresse pour un enfant : viens, mon petit belin. - (24) |
| belin, s. m. petit veau en langage plaisant. - (22) |
| belin, sm. bélier. Voir robin. - (17) |
| belin. Mot d'amitié aux enfants comme qui dirait mon mouton. Il a ce sens dans le Roman du Renard. - (03) |
| beline : s. f., chèvre. Se dit aussi par ironie des personnes qui ressemblent physiquement ou intellectuellement à cet animal. - (20) |
| bélle (adj. f.) : belle - (50) |
| belle (n. f.) : avouèr la belle de (avoir l'occasion de, être dans des conditions favorables pour (t'avais bin la belle de l'fée c'matin) - (64) |
| belle. Belles. - (01) |
| belluche. Sorte d'adverbe interjectif qui signifie « il y a longtemps. » I vins charcher lai Daudon ? — Il âst partie an y ai belluche. Bellurette, qui a le même sens et potron minet, de grand matin, ont été l'objet de recherches linguistiques : on n'a pas trouvé d'étymologique satisfaisante. V. Luron. - (13) |
| bellurette (pour belle hurette , belle heurette). adv. Il y a longtemps, il y a belle heure, une belle petite heure. - (10) |
| belô, adj., idiot, imbécile. - (40) |
| bélonge. Sorte de cuve ovale fixée sur une voiture ; on y jette les raisins pour les conduire au pressoir : Mai bélonge tint quatre pièces de râsins. L’inventaire dressé à l’Hôtel-Dieu de Beaune en 1501, porte cette mention : « Item. Une bélonge de bon merrain pour mettre sur le chart ou temps des vendanges. » La forme oblongue de ce vaisseau nous indique l’étymologie. - (13) |
| bélot : simplet. (A. T IV) - S&L - (25) |
| belot, chevreau, cabri. V. bica. - (05) |
| bélot, niais. Cette application était, dans l'origine, un terme de mépris, adressé par les chrétiens des villes aux pagani, adorateurs de Bel, le grand Dieu gaulois. Bêleg signifie prêtre, en breton. - (13) |
| bêlot, subst. masculin : naïf, simplet. - (54) |
| bélou (on) - pioûnou (on) : pleureur - (57) |
| bélouse (na) - pioûnouse (na) : pleureuse - (57) |
| belsamine, s. f., balsamine. - (14) |
| beluse, , n.f. terre franche. Mot vieilli, mais bien connu par les très nombreuses traces toponymiques en Saône-et-Loire. - (65) |
| béma, eh bien. - (26) |
| ben : bien (c'est ben bon) - (61) |
| ben siésant, ante, adj. Synonyme d'aimable, de gracieux. Une jeune fille, une jeune femme ben siésante. Voyez siésant. - (10) |
| ben, adv., bien, beaucoup. - (14) |
| bèn, bien, substantif et adverbe. - (16) |
| ben, bien. - (38) |
| ben, bin. adv. - Bien. (Voir F.P. Chapat, p.44) - (42) |
| ben, s. m., bien, propriété. Ce mot a, dans les diff. patois, les mêmes analogues que ben. adv. (V. ce mot). - (14) |
| bén. Voyez Bé. - (01) |
| benaton : gros récipient (celt. Benn : gros récipient). - (32) |
| benaton, panier oblong dans lequel on transporte des raisins dans la bailonge. (V. au mot banne de ce Glossaire.) - (02) |
| benâton, s. m., panier en osier, à une seule prise. - (40) |
| benaton. Panier à mettre la vendange. Un benaton, des benatons. Ce mot vient de béne, sorte de grande manne ovale dans la-quelle on voiture du charbon en Bourgogne… - (01) |
| benaton. Panier sans anse, très en usage pour mettre les fruits et surtout pour la vendange. Etym. banneton - (12) |
| bénaton. s. m. Syncope de benaton, qui lui-même se dit pour banneton. Manne d’osier, hotte, panier long à l’usage des jardiniers , boulangers. (Annay-sur-Serein). - (10) |
| bénéfier, v. n. bénéficier, faire du profit, du bénéfice. - (08) |
| beneilles : Période de la seconde façon de la vigne. - (19) |
| bénéquier, bénétchié. n. m. - Bénitier. - (42) |
| benêquier, benêtier, aie-Benêtier, eau-benêtier. s. m. Bénitier. - (10) |
| bener : Donner une seconde façon à la vigne : « J'ins causu fini de bener » : nous avons presque fini de biner. - (19) |
| bener : v. piocher la vigne pour la seconde fois. - (21) |
| bêner. v. n. Sécher un peu. (Seigneiay). - (10) |
| bèngnié, baigner ; s'bèngnié, se baigner ; ce mot contient le mot bain. - (16) |
| benheureu. Bienheureux. Les paysans de Bourgogne prononcent benheurou , aimorou , gloriou , et de même tous les adjectifs qu'on termine en eu à Dijon, aimoreu, glorieu, dont la terminaison latine est en osus. - (01) |
| béni : bénir - (57) |
| bénijon. s. f. Semaille, emblavaison des blés. (Savigny-en-Terre-Pleine). - (10) |
| bénin - bédin : enfant de l'Assistance Publique placé par l'administration dans une Famille pour y être élevé. (Ces enfants étaient relativement nombreux dans la Région). - (58) |
| benissi. Bénit, benedixit. - (01) |
| bénissoir n.m. Goupillon. - (63) |
| bénissoir : s. m., goupillon. Que le bon Dieu vous bénisse avec son plus grand bénissoir ! - (20) |
| benissoire, s. m., goupillon ; « L' bon Dieu t' bénisse avou son grand benissoire ! » Se dit à l'éternuement. - (14) |
| bénissouée. n. f. - Bénédiction : « Quand erriva l'moument d'la bénissouée des bagues. » (Fernand Clas, p.344) - (42) |
| bénissu (-e) (p.p. et adj. m. et f.) : béni (-e) - (50) |
| bénissu, e, partic. pas. du verbe bénir, bénit. - (08) |
| benissu, part., bénit, bien conditionné. - (14) |
| bénit : Bénit. « Du bouis bénit » du buis bénit le jour des Rameaux : « De l'iau bénite » de l'eau bénite ; jeter de l'eau bénite, pratique religieuse qui consiste à asperger d'eau bénite le cercueil d'un mort ; « Des raijins bénits » raisins que l'on fait bénir le jour de l'Exaltation de la Sainte Croix (14 Septembre) et qu'on mêle à la vendange dans la cuve. - (19) |
| benne (C.-d., Chal., Morv.), banne (C.-d.). - Panier servant à transporter les raisins vendangés de la vigne à la balonge, ou bien petit cuvier dans lequel on transporte au tonneau le vin tiré de la cuve. Le bas latin a le mot benna, bennata, pour désigner un objet à peu près analogue. - (15) |
| benne (n.f.) : grande corbeille d'osier - (50) |
| benne : s. f., ancienne mesure de capacité pour les charbons de terre et de bois. La benne de Mâcon valait 6 décalitres 306 pour le charbon de terre et 7 décalitres 006 pour le charbon de bois. - (20) |
| benne : s. f., récipient ovalaire en bois, formé de douves verticales, et qui sert à transporter le raisin de la vigne au pressoir. Le fabricant de bennes, ou bennier, a soin de laisser aux deux douves extrêmes une corne, ou branche de grosseur convenable et coupée à la longueur d'environ 0.15 centimètres, qui permet le transport de la benne. - (20) |
| benne, s. f. grande corbeille en osier ou cage formée de claies dans laquelle on transporte le charbon de bois. - (08) |
| benne, s. f., corbeille destinée au transport des fruits, légumes, grains, etc. Elle est ordinairement tressée en jonc ou en osier, et assez profonde. - (14) |
| benneton à Gomméville ou un benneçon à Belan : cage en grillage à poser à terre pour des lapins ou poules. - (66) |
| benneton, s. m., dim. de Benne. En Bourgogne, c'est le panier oblong qui sert à transporter les raisins dans la balonge. (V. Benne.) - (14) |
| bennier : s. m., fabricant de bennes. - (20) |
| benoî. Bénin, doux, bienveillant. - (01) |
| benon (on) : corbeille - (57) |
| benon : petit baquet. - (30) |
| benon : s. m. : petite corbeille de paille ou de joncs tressés. - (21) |
| benon, benot : s. m., petite benne. - (20) |
| benore, burette. - (02) |
| benot : récipient en bois (approx. 50 l) - (43) |
| bensiésant. adj. Bienséant. - (10) |
| bèn'ti (on) : bénitier - (57) |
| bentot, adv., bientôt. - (14) |
| bentoût, bintoût. adv. - Bientôt. - (42) |
| beque (na) : bique - (57) |
| beque : chèvre. - (21) |
| béquet, s, m., bouquet. - (14) |
| béquiller. v. - Manger. - (42) |
| béquillou : n. m. Béquillard. - (53) |
| bêquoi : bêta. - (09) |
| bérais, s. m. lourdaud, maladroit. - (08) |
| berbe, s. f. barbe. - (08) |
| Berbis (la) : nom de cheval. VI, p. 16 - (23) |
| berbis et aignais - brebis et agneau. Ce sont de ces mots que je n'ai pas mis dans le vocabulaire parce qu'ils ressemblent pas mal au français j'ai peut-être eu tort. - (18) |
| berbis, beurbis, barbis. n. f. - Brebis. Berbis, mot déjà utilisé sous cette forme en ancien français du XIe siècle, et issu du latin berbicem. - (42) |
| bérbis. Brebis. - (49) |
| berbitchier. n. m. - Gardien d'un troupeau de berbis (brebis). - (42) |
| berboiller, v. ; bredouiller. - (07) |
| berbouillé, adj. quai. ; crotté, mouillé. - (07) |
| berce, beurce, beurçais, beurriée : berceau (celt. gaulois bers). - (32) |
| berce. s. f. Bèche, pelle à fouir, à remuer la terre. Du latin berca. - (10) |
| bercer. v. a. Bècher. - (10) |
| bercher : cruche à l'eau. - (09) |
| berchet, berchie. s. m. Brochet, vase de grès bombé, renué dans le milieu de son pourtour, ayant trois anses, une en dessus et les deux autres de chaque côté, avec un petit goulot en forme de broche ; d'ou sans doute son nom de brochet, du bas latin broca. - (10) |
| berchet. n. m. - Brochet. - (42) |
| berchet. n. m. - Brochet. Autre sens : cruche en grès bombée, avec deux anses sur le côté et une troisième sur le dessus. Cette cruche était utilisée pour puiser l'eau dans les puits ou les citernes. - (42) |
| berchie : s. f. cruche pour emporter à boire aux champs. - (21) |
| bercho. Brèche – dent. - (03) |
| berchot, berchotte, édenté, - ée. - (05) |
| berchot, s. m., brèche-dents, à qui il manque des dents. Sans trop s'éloigner de la prononciation, on pourrait écrire beùrchot. - (14) |
| bérchot. Édenté. - (49) |
| berchu. adj. - Édenté. (Mézilles, selon H. Chéry) - (42) |
| berçoir : s. m., hachoir courbe a double poignée. - (20) |
| berçonnette.s. f. Barcelonnette, berceau d'enfant. - (10) |
| berçou : menuisier - (61) |
| berda - berdat : variante de "berdin", même sens. - (58) |
| berdagot. s. m. Mauvais ouvrier ; mauvais instrument, mauvais outil. (Laduz). - (10) |
| berdaguer. v. a. Remuer, faire marcher dans des conditions anormales, saccadées. (Laduz). - (10) |
| berdâiller (v. int.) : produire une sorte de ronflement tumultueux, manifester une activité intense (ça berdâille (il y a beaucoup d'activité)) - (64) |
| berdâiller (v. tr.) : secouer vigoureusement - (64) |
| berdailler, berdoller, berlouquer, beurdoler. v. - Secouer, cahoter. Autre sens : faire beaucoup de bruit en déplaçant des objets. « La Corine, quoué qu'alle est don' en train d'berdailler dans c'te maie ! Alle a-ti bintoût fini ! » - (42) |
| berdaillon, berdaillou. n. m. - Personne qui parle beaucoup, qui s'agite, mais qui n'est pas efficace. - (42) |
| berdaillon. s. m. Qui est sans soin, sans ordre. (Saint-Sauveur). - (10) |
| berdandaine, beurdandaine (à la). loc - Au hasard de nous revoir, à la prochaine fois. - (42) |
| berdat. adj. - Épais, grossier, en parlant d'un tablier ou d'un tissu. - (42) |
| berdauler : secouer. - (66) |
| berdauler. v. a. Secouer. Voyez berdôler. - (10) |
| berdidi : galop de l'âne - (60) |
| berdig, berdog. Sorte d’onomatopée indiquant le bruit d’un pas lourd et lent. - (10) |
| berdigue-berdogue , beurdique-beurdoque. loc. adv. – Cahincaha : « C'est à ce moment qu'arrive berdigue-berdogue notre retour à la terre, tirant derrière lui au bout d’une ficelle une jolie biquette. » (G. Pimoulle, Parfums d'enfance, p.64) - (42) |
| berdin (adj.) : niais, stupide (syn. berlaud) - (64) |
| berdin (n. m.) : parasite du mouton - (64) |
| berdin (un) : un faible d'esprit - (61) |
| berdin : parasite du mouton. III, p. 50-8 - (23) |
| berdin : simple d'esprit, fou. - (30) |
| berdin : simple d'esprit. III, p. 50-8 - (23) |
| berdin : vermine des moutons - (60) |
| berdin : innocent, idiot. Ex : "J'avions nout berdin, à Chatiauneu...l'pour' Bellat !" - (58) |
| berdin, berda. n. m. - Pou du mouton. - (42) |
| berdin, beurdin : faible d'esprit, fou, avec nuance d'excitation. - (32) |
| bèrdin, beurdin, bredin (Chal.), bredin (Char.), beurdais, beurdâle (Morv.), albeurdat (Y.). – Brouillon, étourdi, personne qui titube et marche de travers ; viendrait, suivant Chambure, du bas latin burdare, d'où le vieux français burdu, folâtrer, faire quelque chose avec un bruit importun, comme une mouche qui bourdonne. A ce mot se rattache beurdôler qui a la même origine. Voir ci-après. Dire des beurdineries ou bredineries, c'est plaisanter. - (15) |
| berdin. Badin. Ce mot désigne à la fois un niais et un farceur. On dit souvent « beurdin ». - (49) |
| berdin. n. m. - Se dit d'une personne peu futée, innocente synonyme de berlaud. - (42) |
| bérdiner. Badiner ; s'amuser à faire des farces. - (49) |
| bérdinerie. Badinerie, plaisanterie ; niaiserie. - (49) |
| berdineries. n. m. pl. - Idioties, bêtises. - (42) |
| berdo. De différentes couleurs ; des berdos, ce sont les oeufs de Pâques. - (03) |
| berdôler. Tomber avec bruit ; dégringoler. « Faire berdôler » faire tomber avec bruit. - (49) |
| berdôler. v. a. et n. Secouer, cahoter ; gronder, faire grand bruit. V’là la tounaie qui berdôle. (Puisaye). - (10) |
| berdonner (v. int.) : tonner (ça berdonne) - (64) |
| berdot - de diverses couleurs, bariolé. Se dit surtout des bêtes.- C'â in joli beu berdot.- Berdot n'a pas beurot. - (18) |
| berdougnier. n. m. - Grognon, râleur. (Merry-la-Vallée, selon M. Jossier) - (42) |
| berdougnier. s. m. Grognon, grondeur. (Merry-la-Vallée). - (10) |
| berdouilier. v. n. Grogner, faire entendre des bruits sourds, bizarres, désagréables. Ça me berdouille dans le ventre. - (10) |
| berdouille. adj. - Bredouille. - (42) |
| berdouille. s . f. Qui fait entendre des grognements, des bruits sourds, désagréables, en partant du ventre. - (10) |
| berdoulé : v. i. Tomber en roulant. - (53) |
| berdoule, berdaule (ça). v. -Évoque le ronflement du tonnerre dans le lointain. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| berdoule, berdouille. s. f. Petite prune. - (10) |
| berdoulée. Terrain en pente rapide ; fort talus. - (49) |
| berdouler : tomber - (61) |
| berdouler, berdouiller, berdauler. n. m. - Bruit sourd : bruit du tonnerre dans le lointain, ou gargouillis émis par le ventre : « Eh man', ça berdoule dans l'bétri ! » - (42) |
| berdouler. Rouler à terre sur un terrain en pente, sur une « berdoulée ». - (49) |
| berdoulle. n. f. - Petite prune bleu foncé. - (42) |
| berdouner. v. - Murmurer. - (42) |
| berdouner. v. n . Murmurer. (Merry-la-Vallée.) — Se dit sans doute pour bourdonner. - (10) |
| berée, beurée. Orage ; gros nuage noir avec tonnerre, éclairs ; pluie abondante de peu de durée. - (49) |
| bereigne. Bénigne, nom du saint que la ville de Dijon reconnaît pour son apôtre, en latin Benignus , que Colomiés dans ses Mélanges historiques a traduit Bénin,^ ne sachant pas qu'il fallait, quand c'est un nom propre, dire Bénigne… - (01) |
| bergasse, beurgasse. s. f. Brebis, moutons groupés réunis en certain nombre. Percey, Roffey. — C’est le bergeas de la Puysaie. - (10) |
| bergaud (adj.) : lait bergaud (colostrum, premier lait d'une femelle après l'accouchement) - (64) |
| berge, s. f. nuée flottante dans le ciel, amas de nuages. - (08) |
| bergeas, bergeat. s. m. Troupeau de moutons. - (10) |
| berges - nuages, particulièrement ceux qui sont isolés et qui annoncent la pluie. - En i é des berges dan le temps. - Vo viez ces grosses berges ! - (18) |
| bergette (n. f.) : braguette - (64) |
| bergette : braguette. Ex : "Te frais ben d' boutonner ta bergette, l'ouéyau va avouée fré !" - (58) |
| bergette, brayette. n. f. - Braguette. - (42) |
| bergette, brégette (pour brayette et braguette), s. f. Ouverture sur le devant de la culotte, du pantalon. - (10) |
| bergniole : voir borgniole. - (20) |
| bergnotte : s. f. 1° petites niches disposées de chaque côté du four pour recevoir les cendres chaudes. 2° fenêtre borgne. - (21) |
| beriauder : brouiller. - (30) |
| berier. n. m. - Chargement de foin ou de paille ne dépassant pas la hauteur des ridelles d'une charrette. (Mézilles, selon H. Chéry) - (42) |
| berjaugeon. n. m. - Celui qui berjauge. - (42) |
| berjauger. v. - Agir sans réfléchir, à tort et à travers. - (42) |
| berjuter : macérer, rendre du jus. Ex : "Les pernes que j'ons mis dans l'siau, all coumencent à berjuter" (Sous-entendu : il serait temps de s'en occuper !). - (58) |
| berlaiser (v. int.) : aller et venir, perdre son temps à des futilités (syn. arcander, beûtiller) - (64) |
| berlaiser : s'amuser, faire traîner en longueur - (61) |
| berlaiser. v. n. Employer son temps à des choses de rien, à des minuties, des inutilités. Le comte Jaubert fait ce mot synonyme de berlauder , c’est â tort : il y a dans ce dernier une idée de locomotion nécessaire, que ne comporte pas le plus habituellement le verbe berlaiser, car on peut très-bien berlaiser chez soi, sans sortir et même sans bouger de place. - (10) |
| berlander : un peu comme berlaiser ! - (61) |
| berlaud (adj. et n. m.) : sot, niais, nigaud (syn. berdin) - (64) |
| berlaud, berlaudiot, berluche. adj. - Pas malin, innocent, naïf.; synonyme de berdin. - (42) |
| bèrlaud. Niais. Individu agissant à la légère, sans réflexion ; cavité aménagée dans le mur de la cuisine ; à côté de l'âtre, pour mettre les cendres de bois et les coquilles d'œufs pour la lessive. - (49) |
| berlauder : errer sans but. Ne rien faire. Ex : "Té vas-t-y belauder longtemps coum' ça ? Té m'envornes." - (58) |
| berlauder. v. a. Promener ou, plutôt, promenauier sans but, sans objet, pour tuer le temps. Un jeune mari paresseux ou oisif berlaude sa femme. Une femme paresseuse berlaude ses enfants. – berlauder (Se). v. pronom. Se promenailler, aller de droite et de gauche, sans but arrêté. Si, au lieu de se berlauder toute la sainte journée comme il fait, il travaillait, ça lui vaudrait ben mieux ; sa femme et ses enfants ne seraient pas si guerlus. - (10) |
| berlaudeux : traînard. (DC. T IV) - Y - (25) |
| berle : herbe de cours d'eau - faux cresson. Ex : "Il est allé à la fontaine d'Asvins queuler du crésson, il nous rappourte ben de la berle, le loup-fou !". - (58) |
| berler : gober (un œuf). (F. T IV) - Y - (25) |
| berler. v. a. Percer un œuf à chaque bout et le gober en aspirant. - (10) |
| berlichassot. Bissac. - (49) |
| berliche : jeune génisse - (60) |
| bèrliche, beurliche n.f. Verge, surtout dans le langage enfantin. Comment ne pas rapprocher ce mot de la beurlette, équivalent féminin. Tout porte à croire que les contrepétistes seront comblés avec ces deux petits mots. - (63) |
| berliche. Verge. Mot plutôt enfantin. - (49) |
| berliés : berceau d'enfant fait avec des planches - (60) |
| berlin. Petit chariot employé à l'intérieur de la mine. Terme minier. - (49) |
| berlit : petit veau - (60) |
| berloiche. s. f. Espèce de fraise. - (10) |
| berloque : breloque - (39) |
| berloquer : brinquebaler - (61) |
| berloquet : petit berlot...que l'on peut assimiler à "Petit con"… - (58) |
| berlot : repas après la quête de mai ou de la Saint-Martin ou repas de baptême. VI, p. 39 - (23) |
| berlot : pas bien malin, voisin de berdin, mais sans état permanent. Le verbe "berlauder". Le substantif "berlaudier" (faisant partie des berlots). - (58) |
| berlotter. Balloter, cahoter, secouer. - (49) |
| berlou. n. m. - Sans équilibre, de travers, inégal. (Mézilles, selon H.Chéry) - (42) |
| berlu (adj.) : atteint de strabisme - (64) |
| berlu (br'lu), berlue : adj., qui a mauvaise vue. Voir éberluter. - (20) |
| bèrlu (Chal.), beurlu (Morv.), breulu (C.-d.).- Louche, vient de berluté. Voir plus loin ce mot. - (15) |
| berlu : yeux de travers. - (09) |
| berluchonner. v. n. Cligner de l'œil, loucher. - (10) |
| berlue. Mauvaise vue ; vue basse. « Avoir la berlue ». Celui qui a une mauvaise vue est un « berlu ». - (49) |
| berlugeotte (br'lugeotle) : s. f., lumignon, mauvaise lumière. - (20) |
| berlûter : éblouir - (48) |
| berlutonner : paresser. (F. T IV) - Y - (25) |
| bernanciau (à). Beaucoup, en grande quantité, à profusion. « Pieuvoir à bernanciau ». - (49) |
| bernasse, bernasserie, bernassie. n. f. - Futilité, frivolité (M. Jossier, p.l4). Au XIIIe siècle, on créa l'adjectif.bernart, dans le sens de niais, nigaud, à partir du nom de l'âne dans le Roman de Renart. Le mot poyaudin est directement inspiré de cet emploi, vivace jusqu'au XVIIe siècle. - (42) |
| bernasse, bernasserie, bernassie. s. f. Futilité, niaiserie, vilenie, (Puysaie). De bren, ordure, saleté. Au plur., menus travaux, ouvrages infimes, rebutants. - (10) |
| bernasser. v. n. S'occuper des choses tes moins propres du menage, nettoyer, faire les lavages et la cuisine. - (10) |
| bernassis. s. m. pl. Ramassis. - (10) |
| bernauder, v. intr., lambiner, musarder, perdre du temps. - (14) |
| berne, s. f. bordure, lisière, marge, talus : les bernes d'une rivière, les bernes d'une route, etc. - (08) |
| berne, s. f. Tétine de la truie. - (10) |
| bernet, bernot (pour Brunet , Brunot). s. m. Bœuf brun. - (10) |
| bernette, bernotte. s. f. Vache brune. - (10) |
| Bernic'ille (exclamation) : Bérnique, exprime un espoir déçu. - (19) |
| bernicle ! interj., bernique! « Teins ! pasque t' l’as treùvée jolite, i t'a r'semblé que t' peûvos la prende... mâ bernicle ! » - (14) |
| bernicler : regarder par un trou ou une porte, entrouverte. (F. T IV) - Y - (25) |
| bernicler. v. - Chercher avec les yeux. Autre sens : se promener sans but précis. (Mézilles, selon H. Chéry) - (42) |
| bernicler. v. n. Tâtonner de l’œil, chercher, regarder d’un œil incertain. Qu’as-tu à bernicler de la sorte ? - (10) |
| bernicles. n. f. pl. - Lunettes : « La grand mée, alle a mis ses bernicles pou' écri '. » Déformation de besicles, ce mot contient une longue histoire. Du mot béryl, pierre précieuse variante de l'émeraude ayant servi à fabriquer des loupes et des lunettes au XIIe siècle, on passa à béricle, puis à bézicle, toujours usité au XVIIe siècle. - (42) |
| bérnicles. s. f. pl. Lunettes, besicles. — Yeux clignotants, hésitants. - (10) |
| bernicleux, eüse. s . m. et f. Celui, celle qui bernicle. - (10) |
| bernique (prononcez beurnique), en vieux français bernicles (Lac.), sorte d'exclamation qui exprime un refus, un rien, une petite quantité de ... - Dans l'idiome breton, bernik est le diminutif de bern, tas, monceau, amas. (Le Gon.)... - (02) |
| bernis. n. m. - Un peu, une miette, une goutte : « Domme moué don' un bernis d'cid'. » - (42) |
| bernis. s . m. Peu. Un bemis , un brin, un peu. - (10) |
| bernoise. s . f. Lucarne. - (10) |
| béron (n.m.) : rouge-gorge (étym. bec rond) - aussi reuche - (50) |
| béron, s. m. rouge-gorge ou linotte. - (08) |
| berot. Noirâtre. S'emploie comme nom et comme adjectif. - (49) |
| bérouatte. Brouette. - (49) |
| bérouatter. Charrier avec une brouette. « Être bérouatté » : être cahoté, secoué. - (49) |
| bérouette (n. f.) : brouette - (64) |
| berouette (une) : une brouette - (61) |
| Bérouette, beurouette : Brouette. Une beurouette de bois. : une brouette de bois. - (33) |
| berouette, subst. féminin : brouette. - (54) |
| bérouette. n. f. - Brouette. - (42) |
| bérouettée. n. f. - Contenance d'une bérouette, une brouette. - (42) |
| bérouetter. v. - Secouer. Autre sens : transporter, mener dans une brouette : « L'Émile était si enflé qu'il a fallu l'bérouetter jusqu'à sa pourte. » - (42) |
| berouetter. v. a. Mener dans une brouette, dans une berouette. — Berouetter quelqu'un, le faire aller, se moquer de lui, l’envoyer de Caïphe à Pilate. (Villiers-Saint-Benoît). - (10) |
| beroui : buis. (DC. T IV) - Y - (25) |
| berouis. s. m. Buis. On dit aussi bervouis. - (10) |
| berqer. - (21) |
| berquille. Béquille. - (49) |
| berquiller. Boiter. - (49) |
| berquilloux. Boiteux. Individu marchant difficilement. Fém. « Berquillouse ». - (49) |
| berriat (adj. et n. m.) : berrichon - (64) |
| berriauder, bousculer, maltraiter. - (27) |
| berriée : voir beurriée - (23) |
| berrier. s. m. Banne, berceau d’enfant. Voyez beurrier. - (10) |
| berrouette : brouette - (60) |
| bers, berceau. Les annales du temps disent que trois porcs furent suppliciés en 1404, à Rouvres (Bourgogne), pour avoir tué un enfant au bers. - (02) |
| bers. : (Dial. ), berceau. -Trois porcs furent condamnés et suppliciés en 1401, à Rouvre (Bourgogne), pour avoir dévoré un enfant au bers, dit la sentence. (Del.)- Ce mot est l'apocope. du bas latin berciolum (Duc.), d'où est aussi venu le mot patois bressore, qui a le même sens que bers. - (06) |
| berson (par corruption de besson , du bas latin bisso ). s. m. Jumeau. Dans nos campagnes, On prononce généralement b'son. Un b'son. Des b'sons. Ces deux sœurs sont b'sonnes. Ce n’est guère que dans la Puysaie qu’on dit berson. - (10) |
| bérson. Jumeau ; (dérivé de besson, mal prononcé). - (49) |
| bertauche. s. f. Passage couvert allant de la rue dans une maison située derrière une autre. A Joigny, Tout le monde connaît la Bertauche au père Malou, place du Pilori. - (10) |
| bertaudé. : (Pat.) et bertauder (dial.). Quelques-uns prononcent bretauder. - Tondre inégalement, et, au figuré, faire pitoyablement une chose. - (06) |
| berte (beurte) : s. f., vx fr., cruche à eau ; vase en fer blanc, en forme d'arrosoir, pour le transport du lait. Les dictionnaires impriment berthe. - (20) |
| bèrte n.f. Cruche à eau, récipient en fer blanc pour transporter le lait. - (63) |
| berteler. v. a. Remuer quelque chose pour faire du bruit. — v. n. Flâner, aller de droite et de gauche, aller de travers. - (10) |
| bertelle (une) : une bretelle - (61) |
| bertille (toujours au pluriel) : des bertilles. Petit bois et surtout bouts fins des fagots pour allumer le feu. Ex : "Pour fée mon feu, j'ai de bounes bertilles, ben chèches". - (58) |
| bértille. n. f. - Brindille, petit bois. - (42) |
| bertiller. v. n. Ramasser des menus copeaux, des brindilles de bois. - (10) |
| bertilles. s. f.pl. Brindilles de bois. - (10) |
| bertillons. s. m. pl. Menues brindilles. - (10) |
| bertonner. v. - Labourer en faisant des billons. (Villeneuve-les-Genêts, selon M. Jossier) - (42) |
| bertonner. v. a. et n. Labourer à gros billons. (Villeneuve-les-Genèts). - (10) |
| berullô et breuillô. : Nombril. (Del.) Ce sont les mêmes mots pour le sens qu'ambreuille ou lambreuille cités en leur lieu. Le dialecte appelait breuilles les entrailles. Roquefort fait venir ce mot de la basse latinité burbalia. - (06) |
| berullô, nombril. (Voir au mot breuillô de ce Glossaire.) - (02) |
| bervacher. v. n. Boire souvent, sans soif, inutilement. (Laduz). - (10) |
| berzelle. Miette ; menu morceau. On dit aussi : « braise ». - (49) |
| besàde, b’zade. s. f. Promenade. Être en b'zade , être à la promenade. - (10) |
| besaice : Besace. « Y est toje au pauvre la besaice » : c'est toujours au pauvre la besace, c'est toujours sur les malheureux que fondent les calamités. - (19) |
| besaice, s. f. besace, grand sac que l'on porte sur le cou autant que sur le dos, pendant de droite et de gauche. Il n'y a pas que les mendiants qui se servent de ce moyen de transport, il est à l'usage de tous nos campagnards. - (08) |
| bésaigre (bisacer). s. m. Etat d’une chose qui est très-acide, qui est deux fois aigre. Ce vin tourne au bésaigre. - (10) |
| bésaigre, bésaigue. adj. - État d'un liquide ou d'un aliment qui a tourné à l'aigre. - (42) |
| bescogner : v. n. vx fr., bescochier, aller de ci de là, flâner. - (20) |
| béscu, loc, ironiq., baise-cul. Tient lieu de réponse au questionneur que l'on trouve trop curieux s'il demande : « Qui' c' qui é v'nu t' vouer ? » — « Béscu l’ jeune, lui réplique-t-on ; l’ vieux é môrt ». - (14) |
| béseilli : v. : bêcher. - (21) |
| beser, b’zer. v. n. Se promener. - (10) |
| beser, courir à cause des mouches. - (05) |
| besicler. Regarder attentivement ou assidûment. Etym. besicles. - (12) |
| bésiller : abîmer - (60) |
| besin - fin, minutieux à faire. - Ci n'aivoinge pâ cequi, ç'â don si besin ! – Du si besin, c'â bon pour les demoiselles. - (18) |
| besin (b'zin) : adj., vx. fr., bessln, lent, traînard. Au flg., obtus. Se dit aussi des choses molles et flasques, comme par exemple d'une étoffe sans apprêt, sans consistance. - (20) |
| besin, adj., lent, musard. - (14) |
| besin. Lent à travailler, paresseux. Ce mot a été légèrement détourné de son acception primitive : il a signifié mendiant, porteur de besace. - (13) |
| besin. Lent, synonyme de lambin, d'où le verbe besiner. - (03) |
| besiner, v. intr., lambiner, musarder, aller lentement. - (14) |
| béslot, adj. bête. - (38) |
| besognou, adj., besoigneux. - (14) |
| besoin (avouer de), loc, avoir besoin. - (14) |
| besoin : s. m., vx. fr., affaire. Avoir besoin à... un endroit quelconque, avoir affaire à cet endroit. - (20) |
| besoingnou, ouse, adj. besogneux, celui qui a besoin, qui manque du nécessaire. - (08) |
| besoniables. : (Dial.), adjectif signifiant une chose dont le besoin se fait sentir. - (06) |
| besou (b'zou) : s. m., ventre, bedon. - (20) |
| besougne. n. f. - Besogne. - (42) |
| bêsse (à la), loc, au gré de l'eau : « Mon batiau s'en va à la bêsse ». - (14) |
| besse (n.f.) : bêche - (50) |
| bèsse : Bêche : « In mange de bèsse » : un manche de bêche. « In fi de bèsse » : la couche de terre ou plutôt l'épaisseur de la couche de terre qu'on peut retourner avec la bêche. - (19) |
| besse, besselle : s, f., bas-lat. bessa, bêche, pioche. - (20) |
| besse, s. f. bêche, instrument pour travailler la terre. - (08) |
| bèsse, s. f. bêche. Verbe bèssé. - (22) |
| besselon : s. m., vx f r. besson, bêchelon, piochon, petite binette. - (20) |
| besser (v.t.) : bêcher - (50) |
| besser, v. a. bêcher, remuer la terre avec une bêche. - (08) |
| bésseu : s. m seuil. - (21) |
| bessi : Bêcher. « Ol est après à bessi san jardin » : il est en train de bêcher son jardin. - (19) |
| bessière (verbe) : petite dépression de terrain. - (47) |
| bessin : (bèssin: - subst. m.) 1- sorte de louche, large et peu profonde, à l'aide de laquelle on puisait dans le seau d'eau qu'on avait rapporté du puits. On buvait à même le "bassin". 2- bèssin: kyêr, nom de la renoncule. - (45) |
| bèssine, bassine. - (26) |
| besson, -nne, jumeau, -elle. - (05) |
| besson. n. m. - Jumeau. Ce mot, formé sur le bas latin bissem de bis - deux fois, est employé en français depuis le XIIe siècle. Georges Sand l'utilisait encore au XIXe. Le poyaudin l' a conservé sans altération. - (42) |
| bessons , jumeaux, boissins. - (04) |
| béssu, s. m. seuil : être assis sur le béssu. - (22) |
| beste, bête. - (38) |
| besterie, bêtise. - (04) |
| besterie, s. f. bêtise, niaiserie, propos équivoque. - (08) |
| bestia, adj., sot, bête, maladroit, bestiasse. - (14) |
| bestiau n.m. Animal en général. - (63) |
| bestiau : s. m., vx fr. bestial, bétail. - (20) |
| bestiau, s. m. bétail, les bêtes à cornes principalement. - (08) |
| bestiau, s. m. Bétail. Nout’ bestiau est ben soigné, ben gras. - (10) |
| bestiau, s. m., bêtes, bétail, troupeau : « J'ons eùn bestiau d’malade ». - (14) |
| bet ou bai - bec. - Le chardonneret â tôjeur ai beillé des co de bet â petiot canari. - Quainne vilaine fonne ! en fau qu'ile beille des co de bai, quoi ! - (18) |
| bêt’ ç’ien : tout bête - (37) |
| bét’chien, adj., imbécile, peu malin. - (40) |
| bêtacer. v. n. Faire des bêtises, des inconvenances, des sottises. Se dit particulièrement, dans la Puysaie, des jeunes garçons et des jeunes filles qui ont ensemble des relations trop intimes. - (10) |
| bêtager, bêtéger. v. - Agir bêtement, faire des bêtises. - (42) |
| bétassai : faire des bêtises. Ç'o un bétassou : il ne fait que des bêtises. - (33) |
| bêtasse, adj., bêta, simplet, naïf. - (14) |
| bètasserie, s. f., bêtise, simplicité, naïveté. - (14) |
| bétat(atte) : bête avec une nuance gentille - (39) |
| bétchau. Bête, innocent. On prononce aussi « bêtiaut ». - (49) |
| bétchiâ : n. m. Bêta, nigaud. - (53) |
| bêtchot, bêtiot. n. m. - Bêta, pas malin. - (42) |
| béte (na) : animal - (57) |
| béte (na) : bête - (57) |
| béte à bon dieu n.f. Coccinelle. Voir papioûle. - (63) |
| bête à bon Dieu, s. f., coccinelle. - (40) |
| béte à Bon Djeû (na) : coccinelle - (57) |
| bête à côte : loc. en manière de jeu de mots, côte de bette. - (20) |
| béte à pain n.m. Nom donné parfois à un être humain, par plaisanterie. - (63) |
| bête à pain : s. f., individu de l'espèce humaine. La foire des bêtes à pain, la louée aux domestiques. - (20) |
| béte adj. Stupide, bête. - (63) |
| bête de Saint-Jean : coléoptère noir (Timarcha). III, p. 42 ; IV, p. 26. - (23) |
| béte faramine : animal dangereux. Bête légendaire, réputée extraordinairement dangereuse. Du latin « fera » : bête sauvage. - (62) |
| béte fâramine : animal imaginaire méchant - (48) |
| béte nouére, s. f., bête noire, petit coléoptère qui dévore, au printemps, les jeunes siliques du colza. On l'appelle encore Altise, et Tiquet. - (14) |
| béte : (bé:te - subst. f. et adj.) bête. On désigne par bé:te (subst.f. pl.) le gros bétail, et principalement les bovins. « on: n' peu pu vend' de bé:t', è st'an:-né:, on: mé:j'ro d'l èrjen. - On ne peut plus vendre de bétail, cette année, on y perdrait. » - « Bé:t' è sin:-Jean : bête à Saint-Jean », nom donné à la timarche, timarcha - (45) |
| beté : adj. Creux. - (53) |
| béte, s. m. béte, qui est sans esprit. Un gros « béte », un vieux « béte. « « couye-toué, mon n-aimi, teu n'équ'eune béte. » tais-toi, mon ami, tu n'es qu'une bête. - (08) |
| bêtéger. v. n. Agir sottement, bêtement. - (10) |
| betene : adj., lent de corps et d'esprit, las. - (20) |
| beter : v. a., bouter, mettre, placer. Bettes-y donc là. - (20) |
| béterie (n.f.) : bêtise - (50) |
| bèterie : bêtise. - (33) |
| bêterie : n. f. Bêtise. - (53) |
| bétes n.f.pl. Ensemble du cheptel et de la basse-cour. - (63) |
| beteune. Animal péri, en putréfaction. Fig. Vaurien. « Ch'tite beteune » veut dire : petit polisson. - (49) |
| beteux : creux - (44) |
| bétiâ : bête, pas bien malin - (48) |
| bétia : (bé:tyâ: - subst. m.) crétin, imbécile. - (45) |
| bétiâ, adj., même sens que bét’chien ; mais plus accentué. - (40) |
| bétiâ, bête. - (26) |
| bétiau : benêt - (44) |
| bétïe, s. f. bêtise, propos léger ou peu raisonnable, niaiserie. - (08) |
| bêtie. n. f. - Bêtise. - (42) |
| bétïer, v. n. dire des bêtises, des niaiseries, des choses légères, faire des riens, faire la bête, l'idiot. - (08) |
| bétije, s. f. bêtise. Même sens que bétie. - (08) |
| bétijer, v. n. même sens que bétier. - (08) |
| bêtiolot, bêtiot : un peu stupide. - (56) |
| bétion : sot. - (29) |
| bêtiot (n. m.) : animal – personne stupide - (64) |
| bêtiot : quelqu'un de pas très malin (au féminin, eune bêtiote) - (46) |
| bêtiot : pas bien malin. - (33) |
| bétiot : n. m. Pas bien malin. - (53) |
| bëtise, chose insensée ou de nulle importance ; c'â eune bëtise de ran, ce n'est rien. - (16) |
| betléam. Bethléem le premier rime avec Océan, le second avec l’interjection ehem. - (01) |
| béto, bétote - bête, dans le sens d'enfant, de pas hardi. - Laiche-lu don ; c'â in petiot béto. - (18) |
| bétô, s. m. petite bête, bétat, diminutif de bête. - (08) |
| bétolle : baratte. (RDM. T III) - B - (25) |
| bétot(otte) : bête avec une nuance gentille - (39) |
| bétôt, adv. bientôt. - (17) |
| bétot, adv., bientôt. - (14) |
| betôtte, petite bête. - (02) |
| betôtte. : Petite bête. - (06) |
| bétoure : une baratte - (46) |
| bétourna : s. f. grande terrine. - (21) |
| betouser : perdre son temps à des riens. (E. T IV) - VdS - (25) |
| bêtout. adv. Bientôt. - (10) |
| bètri : nombril, ventre. - (33) |
| bétri, bédri, beurdouille. n. m. - Ventre : « Quand au même moment ça s'met à y gargouiller dans l'bétri ... » (Fernand Clas, p.331) - (42) |
| betri, beutri. s. m. Ventre. - (10) |
| bét'rie : bêtise. - (52) |
| bétry : nombril. - (09) |
| bètun, l'eau que le beurre contient et qu'il produit lorsqu'on le bat. - (16) |
| betun, tabac. (Voir au mot petun.)... - (02) |
| beu (beû) : s. m., bœuf. - (20) |
| beu : bœuf ou taureau. Ç'te vaisse veut les beus. - (52) |
| beu : bœuf - (48) |
| beû : bois - (43) |
| beû : Bois. « Mens dan in bout de beû dans le poîle » : mets donc un morceau de bois dans le poêle. - Forêt, « I faut le premission des gârdes pa aller en champ dans le beû » : il faut l'autorisation de l'administration forestière pour mener paître le bétail dans la forêt. - « Beû de lune » bois de lune, bois volé, le vol de bois se faisant surtout la nuit. - Proverbe : « La faim fa seurti le loup du beû » : la faim fait sortir le loup du bois. « Ol est du beû qu'an fa les flieutes » il est du bois dont on fait les flûtes, on fait de lui tout ce que l'on veut. - Terme de jeu : « Je n'ai point de carte de ce beû » : je n'ai pas de carte de cette couleur. - (19) |
| beû : s. f. : lessive. - (21) |
| beû : un bœuf - (46) |
| beu : (beu - subst. m.) boeuf. Cet animal est, dans l'esprit des usagers, un parangon de puissance et de virilité. D'où l'expression: m'nè lé: beu, « être en chaleur », qu'on emploie à propos de toutes les femelles, et même en parlant des femmes. - (45) |
| beû : s. m. bois. - (21) |
| beu, bœuf. - (26) |
| beu, bœuf. - (27) |
| beu, bû. Bœuf. - (49) |
| beu, s. m., bœuf. - (14) |
| beu. Bœuf, bœufs. - (01) |
| beubine : Bobine. « Eune beubine de fi roje » une bobine de fil rouge. - (19) |
| beuc : (nm) bec - (35) |
| beuc : bec - (43) |
| beûç’e (aine) : (une) bûche - (37) |
| beûç’e (aine) : (une) chute - (37) |
| beûç’er (l’) : (le) bûcher - (37) |
| beûç’er : travailler avec ardeur - (37) |
| beucaler - fére on s'mouillon : sommeiller - (57) |
| beucaler : somnoler - (57) |
| beûce (n.f.) : bûche - (50) |
| beûceron (n.m.) : bûcheron - (50) |
| beûch’lon : (nm) petite pioche à deux dents - (35) |
| beuchaille, s.f. mauvais échalas. - (38) |
| beuche : bûche - (48) |
| beûché : bûcher - (48) |
| beûche : Bûchette. « J'ai troué (trouvé) eune beuche dans man paquet de tabac ». - Paille, « Tiri es beuches » : tirer à la courte paille. - (19) |
| beuche : grosse bûche de bois. La beuche de Noué : la bûche de Noël. - (33) |
| beuche, s. f. brin de paille. - (22) |
| beuche, s. f. brin de paille. Teri es beuches, tirer à la courte paille. - (24) |
| beuche, s. f. bûche, morceau de bois préparé pour le feu. - (08) |
| beûche. Bûche. Fig. Coup. « attrapper in-ne beûche » - (49) |
| beuche. Buse. - (03) |
| beucheillé : v. t. Nettoyer les haies. - (53) |
| beucheiller : nettoyer les prés en ramassant des brindilles le long des haies pour les brûler. (RDM. T II) - B - (25) |
| beûcher : bûcher. - (33) |
| beucher, v. a. frapper avec force, travailler en frappant, en taillant. « beucher » une pièce de bois, c'est la dégrossir. beucheron, s. m. bûcheron. - (08) |
| beûcher. Travailler avec opiniâtreté. « Se beûcher » se dit pour se battre. - (49) |
| beucher. v. n. Eclore. Les poussins beuchent. (Percey). Se dit sans doute pour bêcher, becqueter. - (10) |
| beûcheron. Bûcheron. - (49) |
| beuchi (beutssi) : bûcler - (51) |
| beuchi : bucler le porc - (34) |
| beuçhi n.m. Odeur de grillé, de roussi. - (63) |
| beuçhi v. Griller les poils et racler la peau du cochon. - (63) |
| beuchille, beuchottes - petits morceaux de bois sec et menus ; avec variantes dans le sens. - En fau raimassai totes ces beuchilles ; c'â gros asille pour ailemai le feu. - Aitendez, vos ailai tirai es beuchottes. - (18) |
| beuchille, sf. petite bûchette, débris de bois. - (17) |
| beuchilles, n. fém.plur. ; petits morceaux de bois ; beuchiller , v. ; ramasser des beuchilles . - (07) |
| beûchiotte, beûchotte : petite bûche - (48) |
| beuchir : passer à la flamme le porc abattu pour griller les poils avant raclage. A - B - (41) |
| beuchllié, v. a. roussir au soleil ou au feu. - (22) |
| beuchllier, v. a. roussir au soleil ou au feu. - (24) |
| beuchlon, bachlon n. m. (p.ê. de bec long, on ne peut éviter de penser à son bec long et double). Petite pioche, serfouette. - (63) |
| beuchon (n.m.) : buisson - (50) |
| beûchon : (nm) buisson - (35) |
| beuchon : buisson - (51) |
| beuchon : buisson, bosquet (petit) - (48) |
| beuchon : haie - (44) |
| beûchon bianc: (nm) aubépine - (35) |
| beuchon byanc n.m. Aubépine, épine blanche. - (63) |
| beuchon n. m. Buisson. A noter l'expression, pas évidente de prime abord : Ôl a rencontré un beuchon. Il a été arrêté en chemin par une personne très bavarde. - (63) |
| beuchon na n.m. Prunelier, épine noire. - (63) |
| beûchon na: (nm) prunellier sauvage, églantier - (35) |
| beuchon. Buisson. - (49) |
| beuchotte : une bûchette. - (56) |
| beuchotte : petite bûche de bois, bûchette. - (33) |
| beuchotte, s. f. bûchette, brin, fétu de paille ou de bois dont on se sert pour tirer au sort. - (08) |
| beuchotte, s. f., bûche refendue pour allumer le feu. - (40) |
| beuchotte. (Jouer à la) C'est le jeu du jonchet qui se compose d'une crossette et de quarante petits morceaux de bois. Beuchotte est le diminutif de bûche. - (13) |
| beûchotte. n. f. - Bûchette. - (42) |
| beûçhyi : (vb) brûler les soies du porc - (35) |
| beûchyi : brûler les soies du porc - (43) |
| beucler, bucler : flamber un porc ou une volaille. En ce qui concerne le porc, cela donne un parfum spécial à la couenne. - (30) |
| beucler, v, tr., regarder insolemment. (V. Beûiller.) - (14) |
| beucler. Flamber. On dit aussi « barbouère » ou « barboire ». - (49) |
| beuclier : Flamber avec des torches de paille le cochon qui vient d'être saigné. - (19) |
| beuclier. v. a. Regarder quelqu’un de près, fixement, en face. De bis et oculus. (Éiivey). — Roquefort donne beulier dans le même sens. - (10) |
| beude (n.f.) : ventre (aussi beuille) - (50) |
| beude , bedon : ventre, petit ventre - (48) |
| beude : ventre - (39) |
| beude, beudon : ventre. En français : bedaine. Il a une bounne beude : il a un bon ventre ou : ol é un bon bedon. - (33) |
| beude, s. f. ventre, gros ventre, panse. - (08) |
| beudène, ventre (de l'allemand beden qui a le même sens). - (16) |
| beudignoure, sf. boudinière. - (17) |
| beudin, s. m. boudin. - (22) |
| beudin, sm. boudin. - (17) |
| beudion, f s. m. cage ronde à poules. - (22) |
| beûdires : grands feux allumés le jour des Bordes. - (21) |
| beudjener : ergotter - (57) |
| beudnè (v. tr.) donner des bourrades, frapper à coups de ventre, frapper sans faire de mal. Dérivé de bedon. - (45) |
| beudon - (39) |
| beudrailli : répandre un élément liquide de manière incontrôlée - (51) |
| beudréla : se dit de quelqu'un un peu fou-fou et pas très malin - (51) |
| beûdzon n.m. (du bourguignon bougeon). Barreau d'échelle, de chaise, de cage. - (63) |
| beûdzon, boudzon : (nm) barreau d’une échelle - (35) |
| beûe : Lessive. « Fare la beûe » : faire la lessive ; « causer c'ment eune lavouse de beûe » : bavarder comme une laveuse de lessive. - « Ol a fait la beûe » : se dit de quelqu'un qui est pâle comme un linge et a beaucoup maigri. - (19) |
| beue. s. f. buse, oiseau de proie. - (08) |
| beuge : gros ventre. - (09) |
| beuge : s. f., vx fr. bouge, étable. - (20) |
| beugener. v. n. Faire des riens. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| beugeon. s. m. et adj. Musard, lambin, négligeant ; personne lourde, d’esprit borné. Se dit pour beuson, buson. - (10) |
| beuger. v. n. Se dit de l’agitation, des mouvements désordonnés, des envies de courir qui s’emparent des bestiaux, lorsqu’ils sont surexcités par les piqûres des mouches. - (10) |
| beuglis. n. m. - Beuglement. - (42) |
| beugnat, beugnot. s. m. Beignet. - (10) |
| beûgne - enflure résultant d'un coup. - Vos é don choué, que vos é ine grosse beûgne su le front ? – En ne fau pas tolai ine beugne. - (18) |
| beûgne (aine) : (un) coup reçu - (37) |
| beûgne (n. f.) : bosse résultant d'un coup - (64) |
| beugne (n.f.) : coup, bosse - (50) |
| beûgne (na) : coup - (57) |
| beugne (pour beigne). s. f. Bosse au front, provenant d’une chute, d’un coup qu’on reçu ou qu’on s’est donné. - (10) |
| beugne : (nf) beignet de Mardi Gras ; bosse, coup - (35) |
| beûgne : beignet (ou bugne) fait le jour de carnaval (mardi gras) - (43) |
| beugne : bosse - (60) |
| beûgne : bosse, beugner : heurter…Du gaulois bunia : souche. - (62) |
| beûgne : coup (choc, contusion), bosse - (48) |
| beugne : coup de poing - (44) |
| beugne : coup violent donnant une bosse. - (66) |
| beugne : coup, bosse. - (52) |
| beugne : Coup. « Ol a pris eune bonne beugne ». - (19) |
| beûgnè : frapper - (46) |
| beugne : recevoir un gros coup - (34) |
| beûgne : un mauvais coup - (46) |
| beûgne n.f. Beigne, coup, bosse. - (63) |
| beûgne n.m. (du gaul. bagon, le bois de hêtre) Orme. - (63) |
| beugne : (beu:gn’ - subst. f.) contusion, meurtrissure sans plaie (bosse, ecchymose) - (45) |
| beugné : (v.tr.), provoquer une beugne, frapper. - (45) |
| beugne : bosse à la tête. - (09) |
| beugne, beigne et boigne, coups sur la tête, et, par extension, enflure qui en résulte. - (02) |
| beugne, beigne : s. f., vx fr. buigne, bïgne, coup, contusion. Je me suis flanqué une beugne contre mon lit. Voir bougner. - (20) |
| beûgne, bigne : bosse à la tête, tumeur. (RDV. T III) - A - (25) |
| beugne, bosse au front - (36) |
| beugne, n.f. bosse. Désigne à la fois le coup et la bosse qui en résulte ; d'où le verbe beugner (deux voitures se sont beugnées au coin de la rue). - (65) |
| beugne, s. f. bosse, enflure à la tête par suite d'un coup ou d'une chute. - (08) |
| beugne, s. f. coup, horion : il a reçu une bonne beugne (du vieux français bigne). - (24) |
| beugne, s. f., choc, bosse, enflure. - (40) |
| beugne, s. f., grosseur, bosse résultant d'un coup reçu, principalement à la tête : « Jacquot m'a battu ; ô m’a fait eûne beûgne. - (14) |
| beugne, subst. féminin : bosse, enflure, coup. - (54) |
| beûgne, tumeur, enflure provenant d'un coup reçu. - (16) |
| beugne. Bosse qui vient à la suite d'un coup, plus particulièrement à la tête. Etym. vieux français bingne, bègne, tumeur. C'est là aussi la disgracieuse étymologie de beignet (cette pâtisserie ressemblant à une ampoule), qui, en Bourgogne, se prononce beugnet. - (12) |
| beugne. Coup, meurtrissure. Se beugner, c'est se donner un coup. Fig. Se battre. - (49) |
| beugne. Enflure, bosse que l’on se fait en tombant. A s'âst fait eune beugne en choisant ai lai vallée des esgrés (escaliers) Ce mot, dérivé de notre vieux substantif bigne, a formé beugnet, que le français écrit beignet. Nous avons aussi le verbe patois s'écabeugner. - (13) |
| beugne. n. f. - Bosse, beigne : « Le p'tit s'est fait une beugne en tombant. » - (42) |
| beugne. : Bosse, enflure, apostume à la tête. - (06) |
| beugner (se) (verbe) : se cogner, heurter violemment quelque chose et se blesser. - (47) |
| beugner (se) : se cogner. - (56) |
| beugner (se) : se faire mal en se cognant contre un obstacle. - (66) |
| beugner (se) : cogner, se cogner - (39) |
| beugner (se), v., se cogner. - (40) |
| beugner (se), verbe : (se) cogner. - (54) |
| beugner (se). v. - Se cogner. Autre sens : se baigner. - (42) |
| beûgner (v. tr.) : baigner - (64) |
| beugner (v.t.) : donner des coups - (50) |
| beugner (verbe) : cogner, bosseler, cabosser. - (47) |
| beûgner : cabosser, cogner - (48) |
| beugner : frapper, donner un coup. È s’sont beugnés : ils se sont battus. - (52) |
| beugner : heurter, cogner - (60) |
| beugner : se toquer, se cogner. - (56) |
| beugner : rouer de coups (celt. Beug : enflure)? - (32) |
| beugner, v. a. causer une enflure, faire une bosse, bossuer. - (08) |
| beugner, v. tr.. frapper, heurter violemment, surtout à la tête : « Que qu' t'as là ? T' t'é beûgné le front ». - (14) |
| beugner. Beugler. Fig. Se dit d'un enfant qui pleure en poussant des cris. - (49) |
| beugnet, beugnot. n. m. - Beignet. - (42) |
| beugnet, s. m. beignet, friture renfermant d'ordinaire une tranche de fruit. - (14) |
| beugnette : beignet - (51) |
| beugnette n.f. Beignet de Mardi-Gras. - (63) |
| beugnette, beugnot. Beignet. - (49) |
| beûgni : (vb) heurter, donner un coup - (35) |
| beûgni : Pousser, cogner, jouer des coudes dans la foule. « An a bin été beugni à c'te foire ». - (19) |
| beûgni v. Choquer, meurtrir. - (63) |
| beugnier, bosseler. - (26) |
| beûgnôle : Jeu enfantin dans lequel on s'efforce de faire reculer ses adversaires en les poussant de tout son poids et de toute sa force. « La beûgnôle est in vilain jû (jeu) ». - (19) |
| beugnot : beignet - (44) |
| beûgnot : un beignet - (46) |
| beugnot, subst. masculin : traditionnel beignet de mardi gras. - (54) |
| beugnoux, beuilloux. Qui a un défaut à la vue, dans les yeux, soit le strabisme, soit la myopie. Par extension, celui qui regarde attentivement, indiscrètement. Etym. bouler, mettre en boule (Littré) enfler ses yeux. - (12) |
| beuhaice, s. f. besace. - (08) |
| beuhon : bricoleur, travailleur sans ordre ni méthode. - (58) |
| beuhouner : travailler comme un beuhon (toujours péjoratif). S'adonner aussi à des petits travaux peu valables. Ex : "Quion' qu'té beuhoune à c't'heue ?" (heue = heure). - (58) |
| beuil : (nm) morceau de bois pour serrer le nœud d’une gerbe - (35) |
| beuil : morceau de bois ou aiguille pour serrer le nœud de la gerbe - (43) |
| beuil n.m. (du gaul. bilia). Barre de serrage en bois d'une gerbe. - (63) |
| beuilla (d' la) : bouillie - (57) |
| beuillâ : ventru - (43) |
| beuillai - voyez Rebeuillai. - (18) |
| beuillalou, boïllalou n. et adj. Gros, ventru, bedonnant, gonflé. - (63) |
| beuillasse : (nf) gros ventre - (35) |
| beuillassou, ouse, adj. celui qui a un gros ventre, ventru. Un homme beuillassou, une femme beuillassouse. - (08) |
| beuillat. Qui a un gros ventre. - (49) |
| beuille : ventre. A - B - (41) |
| beuille (une) : un ventre - (61) |
| beuille : (nf) lessive - (35) |
| beuille : (nf) ventre - (35) |
| beûille : lessive - (43) |
| beuille : ventre - (44) |
| beuille : ventre - (51) |
| beuille n.f. (de l'anc. fr. bueille). Gros ventre. - (63) |
| beuillé ou beuyé. : Ouvrir de grands yeux et regarder de près comme font les boeufs. On dit d'une personne étonnée : Ai beuille et rebeuille. - (06) |
| beuille : ventre (celt. beuil : ventre) ? - (32) |
| beuille, beûillot : ventre proéminent - (37) |
| beuille, lessive - (36) |
| beuillé, regarder de près et avec étonnement comme les bœufs. Le mot français béer a le même sens et la même origine... - (02) |
| beuille, s. f. ventre, gros ventre. On dit encore « boille. » - (08) |
| beuille, subst. féminin : ventre. - (54) |
| beûille. n. f. - Ventre proéminent. Se dit bouillasse à Arquian. Autre sens panier d'osier ventru s'ouvrant par-dessous, disposé sur le dos d'un âne, et servant au transport du fumier. - (42) |
| beuille. Regarde, regardent. Le verbe beuillé signifie regarder de près et avec attention, de beu et d’euille, c'est à dire de bœuf et d’œil… - (01) |
| beuille. s. m. Ventre, nombril. Du bas latin botulus. - (10) |
| beuille. Ventre. S'emploie surtout pour désigner un gros ventre. « Oh ! C'te beuille ! » : Oh ! Ce gros ventre ! - (49) |
| beuilleau. s. m. Bélier. Domecy-sur-Cure. Même étymologie que dessus. - (10) |
| beuiller, rebeuiller. Qui est beugnoux, beuilloux ou rebeuilloux. - (12) |
| beuiller, v. tr.. regarder comme font les bœufs, de près et fixement ; avec obstination, indiscrétion : « Qu'é-ce que t’as à m' beuiller c'ment c'qui ? » - (14) |
| beuiller. v. n. Fouiller partout ; fixer, regarder bien en face, ce qui nous porterait a croire que ce moi doit s’écrire - (10) |
| beuilles. s. f. pl. Sorte de paniers ventrus, s’ouvrant en dessous, pour le transport du fumier à dos d’âne. De beuille, ventre. - (10) |
| beûilli : bouilli - (43) |
| beuillier, gros ventre. - (05) |
| beuillon : (nm) diminutif de beuille (ventre) - (35) |
| beûillon : bouillon - (43) |
| beuillon : pas dégourdi. (E. T II) - B - (25) |
| beuillon, qui regarde avec obstination d'un air étonné. - (27) |
| beuillot, subst. masculin : petit ventre. - (54) |
| beuillot. Diminutif de beuille. S'emploie surtout pour désigner le ventre d'un petit enfant. Le terme enfantin est « bebeule ». - (49) |
| beûillou : (nm) cuvier à lessive - (35) |
| beuillou : corpulent - (61) |
| beûillou : cuvier pour la lessive - (43) |
| beuillou n.m. Petit ventre rond. - (63) |
| beuillou, beuillu, ad. ventru. - (08) |
| beuillouts. s. m. pl. Paniers à âne ; sans doute pour billouts. - (10) |
| beuillu, ue. adj. beuillard. n. m. - Ventru. - (42) |
| beuillu, ue. adj. Ventru. - (10) |
| beujon, s. m. buson, lambin, celui qui agit avec lenteur. - (08) |
| beujouner (verbe) : chercher quelque chose sans idée précise. - (47) |
| beuké, bouquet, même une seule fleur. - (16) |
| beulé, vn. téter à vide. Se dit des petits enfants qui tètent leur lèvre, inférieure. - (17) |
| beuler, v, intr., crier, beugler. Se dit des enfants qui crient par malice (V. Bauler.) - (14) |
| beulet : bélier - (60) |
| beûlin : agneau - (43) |
| beulon, sm. gomme sécrétée par certains arbres, cerisiers, pruniers, etc. - (17) |
| beulot, n. masc. ; roitelet (oiseau). - (07) |
| beulou : mouton - (44) |
| beulter. v. a. Bluter. - (10) |
| beultiau. s. m. Bluteau. - (10) |
| beun’ti : (nm) bénitier - (35) |
| beune : baquet en bois (en A : dzarle*). B - (41) |
| beune (na) : benne - (57) |
| beune (na) : ruche - (57) |
| beune : benne, récipient en bois pour raisins (approximativement 100 l) - (43) |
| beûne de moutses à mie : ruche - (43) |
| beune, s. f., cigale. - (40) |
| beune, s.f. cigale qui chante au moment du binage. - (38) |
| beuner (verbe) : labourer une seconde fois. - (47) |
| beuner : benner - (57) |
| beuner, v. a. sombrer, donner le second labour à une terre en friches. - (08) |
| beuner, v., piocher la vigne pour la 2ème fois. - (40) |
| beunetî du diabye n.m. Echancrure du corsage. - (63) |
| beunetî n.m. Bénitier. - (63) |
| beunite : bénie (eau) - (57) |
| beunitre, v. a. bénir, donner une bénédiction, forme archaïque du verbe « beunir » qui est aussi usité. - (08) |
| beunne : (nf) benne à vendanges - (35) |
| beunne de moutses : (nf) ruche - (35) |
| beunne de moutses, beunne à moutses n.f. Ruche. - (63) |
| beunne n.f. Benne. - (63) |
| beunnon n.m. Benne de vendange portée par deux hommes avec une barre de bois appelée brevis dans le Beaujolais. - (63) |
| beuon. adj. - Empoté, maladroit, lourdaud. (Mézilles, selon H. Chéry) - (42) |
| beuon. s. m. Maladroit, lambin, musard, empoté. Se dit pour beugon, buson. - (10) |
| beuqué (se), boqué, vr. se heurter. - (17) |
| beûquer (v.t.) : brûler, roussir les soies du porc lorsqu'il est tué - (50) |
| beuquer : Se cogner du front, soit volontairement en manière de jeu, soit par inadvertance ; cosser comme font les béliers et les boucs. - (19) |
| beuquet, sm. bouquet. Fleur. - (17) |
| beuquillon, veau mâle. - (26) |
| beuquin : un bouc - (46) |
| beuquin, bouc, taureau. - (27) |
| beuquins. Habitants de l'arrière-côte et de tout le pays d'Auxois. Les cultivateurs du pays de Beaune se servent exclusivement de chevaux : ils ont donné le nom de beuquins à leurs confrères de la montagne qui emploient les bœufs, On a hasardé de savantes étymologies au sujet des beuquins et des laillots. V. ce mot. - (13) |
| beur et beurre, pâturage. - (02) |
| beura. Espèce de panier dans lequel on met les jeunes poulets. - (03) |
| beurai : Herbe de mauvaise qualité qui vient dans les prés. - (19) |
| beurailler. Graillonner, tousser de façon à expulser les secrétions de la gorge. Etym. Ce mot est évidemment une onomatopée. - (12) |
| beûran : (adj) sombre - (35) |
| beûran neit : (exp) nuit noire - (35) |
| beûrant adj. (de bure) Sombre. A beûrant neit. A la nuit noire. - (63) |
| beurau (adj.) : de couleur brune ou rousse - (50) |
| beurau, aude, adj. de couleur rousse, brune ou même noire : un chien « beurau », une vache « beuraude ou beurotte. » - (08) |
| beurbî, borbî n.m. Bourbier. Voir gasse. - (63) |
| beurbi, s. f. brebis. - (08) |
| beurbis (nom féminin) : brebis. Voir barbis. - (47) |
| beurbis : brebis - (48) |
| beurbis, bobis. s. f. Brebis. - (10) |
| beurbis, s. f. brebis. - (14) |
| beurbis, sf. brebis. - (17) |
| beurçais : voir beurriée - (23) |
| beurce (nom masculin) : berceau. - (47) |
| beurce : bêche - (51) |
| beurce : voir beurriée - (23) |
| beurce, beurçais (n.m.) : berceau (haut-Morvan) - (50) |
| beurceau : berceau, fond d'un chariot - (39) |
| beurcer, v. a. bercer : « beurce ton p'tiô », berce ton enfant. - (08) |
| beurcer, v. tr., bercer. - (14) |
| beurchaude (n. f.) : tisonnier tige de fer rougie au feu - (50) |
| beurchaude (nom féminin) : tisonnier. - (47) |
| beurchaude : tisonnier - (60) |
| beurchaude, s. f. tige de fer qu'on fait rougir au feu pour percer quelque chose. - (08) |
| beurche (na) : brêche - (57) |
| beurche : coin de campagne reculé et isolé difficile d’accès (terme un peu péjoratif). - (59) |
| beurche : édenté (une ou plusieurs dents) - (57) |
| beurche : n. f. Broussaille. - (53) |
| beurches, subst. féminin pluriel : lande isolée, endroit perdu et sauvage. - (54) |
| beurchie - cruche. - Vai cherchai de l'aie dans lai beurchie. - (18) |
| beurchie (n.f.) : cruche à deux anses avec un bec - (50) |
| beurchie (nom féminin) : cruche à deux anses. - (47) |
| beurchie : vessie, outre, cruche à deux anses et petit goulot pour conserver la boisson fraiche dans les champs. - (33) |
| beurchie, n. fém. ; vase en terre pour porter l'eau aux travailleurs des champs. - (07) |
| beurchie, s. f. cruche à deux anses avec un petit bec pour verser le liquide. - (08) |
| beurchie. Cruche grand vase de terre. On lit, dans - (13) |
| beurchie. s. f. Cruche de grès, brochet. - (10) |
| beurchou (adjectif) : se dit d'un enfant qui a perdu ses dents de lait de devant. - (47) |
| beurchou (n.m.) : tarrière pour creuser les sabots (aussi breuçu) - (50) |
| beurchou, s. m. tarière à l'usage des charpentiers. - (08) |
| beurchou, subst. masculin : qui vient des beurches, un peu benêt ou maladroit. - (54) |
| beurdâ – étourdi, brusque, qui va et vient sans faire attention et dérange tout. - N'ailez pâ nos aimené cequi, c'a in gros beurdâ que nos retairdero pu qu'a nos aivouaingero. - C'te petiote lai, c'a ine vraie beirdale. - (18) |
| beurda : peu soigneux dans son travail. - (33) |
| beurda, beurdale, celui ou celle qui agit précipitamment et à qui survient un accident, par suite de sa précipitation. - (16) |
| beurdâ, s. m. brouillon par précipitation, celui qui agit étourdiment. - (08) |
| beurda, tête en l'air, peu appliqué, qui ne réfléchit pas. - (27) |
| beurdâcher. v. n. Chanceler, tituber. (Percey). - (10) |
| beurdagô, s. m. homme sans raison, braque, à demi fou. - (08) |
| beurdaiche, beurnaiche (y) : (vb) il pleuvine - (35) |
| beurdailler. v. - S'occuper, bricoler au sens péjoratif.: « C'était un p’tit manicotier qu'était p'us souvent malade que ben pourtant, qu'travaillait en beurdaillant pou' les uns et pou' les autres. » (Fernand Clas, p.333) - (42) |
| beurdailli : ? - (51) |
| beurdais, dale, adj. étourdi, désordonné, qui marche de travers. - (08) |
| beurdalaud adj. Bête, demeuré. Voir beurdin, beurlot, beûznot. - (63) |
| beurdâleman (n.m.) : bruit fait par un véhicule qui roule sur des chemins mal entretenus - (50) |
| beurdaleman, s. m. bruit d'une voiture soumise à des cahots. - (08) |
| beurdâler (v.t.) : faire du bruit en remuant - (50) |
| beurdaler : secouer, brutaliser - (48) |
| beurdaler : (bœrdalè - v. trans.) maltraiter, brutaliser, manquer d'égards envers quelqu'un : précipiter les choses (dans un travail). - (45) |
| beurdaler, v. n. se dit d'une voiture en mauvais état ou mal graissée qui fait du bruit en roulant : « sai chairote beurdalô dan l'chemi », sa charrette beurdalait dans le chemin. - (08) |
| beurdaller, v. ; faire du bruit. - (07) |
| beurdalon : petit chariot de foin - (48) |
| beurdandaine (A la). Locut. adverb . Au hasard, à l’aventure, sans qu’on s’en préoccupe. (Trucy). - (10) |
| beurdandaler, beurdandler, beurdoûler, beurdôler v. (de l'anc. fr. bredeler, qui a donné bredouiller, et a pour racine berd, onomatopée imitant la difficulté de parler). Tonner au loin, faire du bruit, tomber à la renverse, tomber en roulant, secouer violemment. - (63) |
| beurdasser (verbe) : porter un enfant en le secouant. - (47) |
| beurdaulé : v. t. Secouer. - (53) |
| beurdauler : secouer. (VDS. T IV) - VdS - (25) |
| beurdauler : tomber en pirouettant - (44) |
| beurdauler : Tomber sous l'effet d'une bousculade. « O m'a fait beurdauler » : il m'a fait tomber en me bousculant. - (19) |
| beurdauler, verbe transitif : tomber en roulant. - (54) |
| beurde (na) - beurdon (on) : bride - (57) |
| beurde : Bride. « La route est mauvase, te fera bien de teni tan chevau pa la beurde ». - (19) |
| beurdê : brutal, sans soin au travail, idiot - (48) |
| beurdé : (bœrdê - subst. m.), un brutal, un rustaud, homme sans modération. - (45) |
| beurde : s. f. bride. - (21) |
| beurde, borde : feu de joie - (43) |
| beurde. Noyau d'abricot. Le jeu des beurdes consistait à prendre une poignée de ces noyaux et à la jeter dans un petit creux, à quelques pas du joueur. On comptait les points, c'est-à-dire le nombre de beurdes tombées dans le trou. V, Beurdôler. - (13) |
| beurdèchi, beurdeuilli v. Bruiner. Voir brouillèchi. - (63) |
| beurder (v.t.) : cosser se heurter la tête en parlant des chèvres (aussi teûler) - (50) |
| beurder : Brider, raccommoder au moyen d'une bride. « Ol a beurdé san sabeut qu'était fendu » : il a mis une bride pour raccommoder son sabot fendu. - (19) |
| beurder, v., accoler la vigne. - (40) |
| beurdes, s. f. brides de bonnet, de chapeau. - (22) |
| beurdet (n.m.) : bélier - (50) |
| beurdet : simplet - (39) |
| beurdi- beurdou : Etourdi, agité. « Ol est to beurdi-beurdou ». - (19) |
| beurdia : grosses moyettes. (BD. T III) - VdS - (25) |
| beurdiâ : adj. Fou-fou, bébête, personne un peu simplet. - (53) |
| beurdidi : voir bourdoudou - (23) |
| beurdieûle : s. f. hanneton. - (21) |
| beurdignot (nom masculin) : simplet, personne un peu "demeurée" mais sans agressivité. - (47) |
| beurdin : idiot, simple d'esprit. A - B - (41) |
| beurdin (adjectif) : simple d'esprit. - (47) |
| beurdin (bredin) : fou, esprit simple - (51) |
| beurdin (e): (nm.adj) idiot(e) - (35) |
| beurdin (nom et adjectif) : Idiot, imbécile, ou plutôt un peu fou, toqué. - (19) |
| beurdin : (bœrdin: - adj.inv.), sot, demeuré, simple d'esprit. Quelqu'un dont la santé mentale est suspecte sera volontiers qualifié de boerdin: ou de drô:Io (litt. "bizarre"), les deux termes étant synonymes. Cette épithète, quoique de sens relativement atténué (et donc, paradoxalement, se prêtant bien à l'euphémisme), revient souvent dans les reproches : l'enfant coupable d'une bêtise (une boerdin'ri:) s'entendra dire : mâ t'ô: pâ: imcho boerdin:? « Ne serais-tu pas un peu crétin ? » - (45) |
| beurdin : benêt. Beurdineries : bêtises, sottises. Beurdin vient de bredin par (la classique) métathèse du « r ». - (62) |
| beûrdin : celui qui n’a pas tous ses esprits, étourdi, niais - (37) |
| beurdin : étourdi, idiot. - (52) |
| beurdin : fou. - (59) |
| beurdin : idiot - (34) |
| beurdin : idiot - (44) |
| beurdin : idiot, étourdi, fada,simplet, innocent - (48) |
| beurdin : simple d'esprit - (60) |
| beurdin : étourdi, idiot. - (33) |
| beurdin : n. m. Fou-fou, bébête, personne un peu simplet. - (53) |
| beurdin : simplet - (39) |
| beurdin, adj., étourdi, brouillon, sot. - (14) |
| beurdin, adj., évaporé, étourdi, sot. - (40) |
| beurdin, adjectif qualificatif ou subst. masculin : sot, naïf, benêt. - (54) |
| beurdin, demi-fou, bizarre. - (38) |
| beurdin, -ine n. et adj. (ce mot très utilisé pourrait venir du latin burdum, désignant le bardot ou encore du gallo berdein désignant un homme lent, mais la racine berd – voir beurdandaler- n'est pas à exclure, le déséquilibre de la parole s'étant étendu à celui des gens et des choses). Idiot, innocent, demeuré, bêtat. Voir beurdalaud. - (63) |
| beurdin, n.m. innocent. - (65) |
| beurdin, s. m. brouillon, étourdi et même quelquefois imbécile, idiot. - (08) |
| beurdinerie : idiotie, gauloiserie. A - B - (41) |
| beurdinerie (nom féminin) : idiotie. Faute bénigne. - (47) |
| beurdinerie : Action ou propos digne d'un « beurdin ». « O raconte ran que des beurdineries ». - (19) |
| beurdinerie : idiotie - (34) |
| beurdinerie n. f. Idiotie, bêtise, stupidité, plaisanterie. - (63) |
| beurdinerie : bêtise - (39) |
| beurdinerie, s. f., sottise, farce, attrape. - (40) |
| beurding (n.m.) : idiot, nais - (50) |
| beurdoillan : Celui qui bredouille. « Couge te dan sacré beurdoillan ! » : tais-toi donc bredouilleur ! - (19) |
| beurdoiller (v.) : bredouiller - (50) |
| beurdoiller, v. a. bredouiller, parler d'une manière indistincte, articuler avec difficulté. - (08) |
| beurdoilli : bredouiller - (57) |
| beurdoilli : Bredouiller, parler à tort et à travers et aussi mal articuler. « An ne peut ran camprandre à c'qu'au beurdoille ». - (19) |
| beurdoillon (on) : bredouilleur - (57) |
| beurdoillou, beurdouillou (-ouse) (n.m. ou f.) : celui ou celle qui bredouille, qui parle mal - (50) |
| beurdoillou, ouse, adj. celui qui bredouille, qui parle mal et indistinctement. - (08) |
| beurdolé (ö), vt. secouer rudement. - (17) |
| beurdôlè : secouer avec force, comme un prunier - (46) |
| beurdôlè : v. t. Rouler. - (53) |
| beurdôlée. s. Y- Voiture chargée haut et lourdement. (Etivey). - (10) |
| bèurdôler (C.-d., Y., Chal.), beurdâler, beurdouler (Morv., Char.). - S'agiter, remuer en tout temp s; se dit aussi d'une voiture lourdement chargée qui vacille et dont les essieux gémissent ; par extension, faire du bruit comme une roue mal graissée. Ce mot pourrait venir de beurdouiller, pour bredouiller. D'autre part, le vieux français a le mot bredaille pour bedaine, et bredailler, (qui est la même chose que beurdailler), pour désigner un homme à gros ventre. Or, une voiture lourdement chargée n'est pas sans analogie avec un gros homme marchant péniblement. - (15) |
| beurdôler : bousculer. Aussi : déplacer violemment. - (62) |
| beurdoler : faire grand bruit. (B. T IV) - S&L - (25) |
| beurdoler : remuer, secouer, - (66) |
| beurdoler : secouer très fort. - (31) |
| beurdoler : secouer, remuer dans tous les sens. (V. T IV) - A - (25) |
| beurdoler : tomber - (51) |
| beurdoler : marmonner - (39) |
| beurdoler, beurdauler. v. n. Radoter, déraisonner. - (10) |
| beurdôler, boûrdoûler : culbuter, tomber - (37) |
| beurdoler, bousculer. - (26) |
| beurdôler, faire un bruit sourd qui ressemble au tonnerre. - (38) |
| beurdoler, pousser violemment. - (28) |
| beurdoler, secouer avec force. - (27) |
| beurdôler, v. n. basculer. - (08) |
| beurdoler, v., bousculer, déplacer avec violence et bruit. - (40) |
| beurdoler. S'agiter en tout temps, faire du bruit comme si on remuait des beurdes. « Quoi que ç'ast don qu'an entend beurdôler su not’ guerné.» Il doit y avoir un radical Bed ou Berd qui signifie ventre. Les beurdes sont renflées à leur milieu ; une beurdouille est un gros ventre ; bedaine et beurdaine ont le même sens ; on appelait autrefois bedon une espèce de gros tambour. Le vieux refrain des sauteuses bourguignonnes, la beurdondaine, doit avoir la même origine. M. de Chambure dérive ce mot du bas-latin burdare et du vieux français burder , jouer bruyamment. Les Morvandaux disent bordouler : « lai v'iai de s'bordouler en las ronces et las répeunes. » (Le Trésor de Pâques fleuries : apud. Le Morvan, par l’abbè Baudiau). - (13) |
| beurdoler. v. Faire du bruit. (Chassignelles). - (10) |
| beurdollai : parler entre ses dents, grommeler. - (33) |
| beurdolle (n.f.) : petite prune noire - (50) |
| beurdolle, s. f. petite prune. - (08) |
| beurdollo : qui parle sans nécessité, dit n'importe quoi. - (33) |
| beurdolot : personne pas futé - (44) |
| beurdolot : petit chariot de foin - (39) |
| beurdolou : quelqu'un qui « beurdole » - (39) |
| beurdolou, le tonnerre. - (27) |
| beurdoloy. s. m. Bredouilleur. - (10) |
| beurdon, bordon n.m. Bourdon. - (63) |
| beurdonner, bordonner v. Bourdonner. - (63) |
| beurdonner. v. n. Maronner, gronder. - (10) |
| beurdonnier. s. m. Grondeur. T’es un beurdomier. (Pasilly). - (10) |
| beurdouaillai, beurdouaillou - bredouiller celui qui parle peu distinctement. - Ne beurdouille don pà queman cequi. - Quoi qu'ile beurdouaille don tan depeu deux heures qu'ile à qui ? - (18) |
| beurdouéiller : grommeler, parler indistinctement, bafouiller, bégayer, bredouiller - (48) |
| beurdouillé : v. t. Bafouiller. - (53) |
| beûrdouiller : bafouiller - (37) |
| beurdouiller : bafouiller - (44) |
| beurdouiller : remuer en faisant du bruit. (MM. T IV) - A - (25) |
| beurdouiller, v. intr., bredouiller, mais dans un sens presque contraire à l'accept. fr., qui est : causer avec difficulté. Chez nous, beurdouiller veut dire : trop causer : « Quand ô sort, ô n'rentre pu. — Je crès ben ; beùrdouille tout l'long d' son c'min ». - (14) |
| beurdouillou : adj. et n. Bègue. - (53) |
| beurdoulau, beurdaulau (n.m.) : celui qui grommelle entre ses dents mais aussi personne un peu niaise - (50) |
| beurdoulau, s. m. celui qui grommelle entre ses dents. - (08) |
| beurdoûle n.f. Terrain en forte pente. Voir garaudaiñne. - (63) |
| beurdoulée : forte descente - (44) |
| beurdouler : tomber en pirouettant. A - B - (41) |
| beurdouler : (vb) culbuter, tomber, - (35) |
| beurdoûler : tomber en roulant - (48) |
| beurdouler : tomber en roulant, rouler, rouler en tous sens. - (52) |
| beurdouler : tomber, bouler - (34) |
| beurdouler : tomber, bouler - (43) |
| beurdouler : (bœrdou:lè - v. tr.) faire rouler ; boerdou:lè oen' bâ:ch', « faire rouler un sac (trop tourd) ». - (45) |
| beurdouler, beurdauler (v.) : rouler, tomber, tourner dans tous les sens. - (50) |
| beurdoûler, beurdôler v. (de l'anc. fr. bredeler, qui a donné bredouiller et a pour racine berd, onomatopée imitant la difficulté de parler) Tonner au loin, faire du bruit, tomber à la renverse, tomber en roulant, secouer violemment. - (63) |
| beurdouler, rouler - (36) |
| beurdouler, v. a. rouler, tourner en différents sens : « quioque teu beurdoule dan l' gueurné ? » qu'est-ce que tu bouscules dans le grenier ? - (08) |
| beurdoulle, n. fém. ; vessie du porc. - (07) |
| beurdouller. v. n. Dégringoler. (Saint-Bris). - (10) |
| beurdoullotte. s. f. Râfle ; cylindre de bois plein. (Saint-Bris). - (10) |
| beurdoûlot : petit chariot de foin - (48) |
| beurdouner (verbe) : provoquer un bruit sourd. (J'entends beurdouner à la porte, va don voir c’que c’est). - (47) |
| beurdouner. v. - Bredouiller, ronchonner. Le sens premier était « murmurer » ; bordoner au Moyen-Âge est une onomatopée formée sur le bruit du bardon, bourdon. Le poyaudin ajoute à l'idée du murmure celui de bougonnement. - (42) |
| beurdouner. v. n. Bredouiller, bourdonner. — S’emploie quelquefois activement. Quoiqu’tu beurdonnes donc là ? J’n’entends pas ce que tu dis. - (10) |
| beurdouyé, bredouiller ; beurdouyou, celui qui va trop vite et dont la langue s'embarrasse, quand il dit ou lit à haute voix quelque chose. - (16) |
| beurdzî, -îre n.m. Berger, bergère. - (63) |
| beurdzi-beurdza, beurdi-beurda adv. et n. (cette expression se retrouve à l'identique dans le gallo, langue gallèse de HauteBretagne où on lui donne comme racine berdein ; voir beurdin). Pêle-mêle, méli-mélo. - (63) |
| beûré : baratte. (RDB. T III) - S&L - (25) |
| beure : Brune. (voir beurot). - (19) |
| beûré : s. f. : le babeurre. - (21) |
| beûré : s. m. : baratte. - (21) |
| beure, s, m., beurre. - (14) |
| beureau. Couleur naturelle de la laine de certaine brebis : on en faisait une étoffe commune, qui portait le même nom. Les femmes riches faisaient confectionner leurs robes avec de la brunette. Les capucins étaient vêtus de bureau : de là vient la légende du moine bourri, qui s'est transformé en moine bourru. Ce personnage fantastique remplit à Paris le rôle que la mère Lousine joue à Beaune ; il est l'épouvantail des petits enfants. Le nom de bureau a été donné à une couleur qui tire sur le jaune. Le gribouri, ou Eumolpe de la vigne, est un petit insecte d'un brun jaunâtre. On faisait autrefois en Bourgogne du vin bourru : il était fabriqué avec des raisins rouges, non cuvés. Le pineau gris est appelé beureau par tous nos vignerons : mélangé dans une certaine proportion avec le pineau noir, il donne un vin d'une finesse exquise. Quant à l'étymologie de Beureau, on pourrait la trouver dans le bas-latin burrus, roux. L'allemand Byrr et notre mot bourre, dans ses différentes acceptions, paraissent être de la même famille. Burard, fabricant d'étoffe de bure, est devenu un nom patronymique. - (13) |
| beurée : orage. A - B - (41) |
| beurée (n.f.) : pluie violente, grosse averse (du latin burra par le celtique brod = bouillon) - (50) |
| beurée : averse. (LCSS. T IV) - S&L - (25) |
| beurée : orage - (44) |
| beurée : Violent orage. « Eune beurée de grale » : un orage accompagné de grêle. - (19) |
| beûrée n.f. (de bure) 1. Averse d'orage. 2. Gros nuages noirs menaçants qui précèdent la pluie. - (63) |
| beurée s.f. orage. - (38) |
| beurée : averse et babeurre - (39) |
| beurée : s. f. gros nuage. - (21) |
| beurée, n.f. averse. Parfois nuage d'orage. - (65) |
| beurée, s. f. averse de pluie. - (08) |
| beurée, s. f., forte pluie, averse. - (14) |
| beurée, subst. féminin : averse brusque et violente. - (54) |
| beureille (nom féminin) : récipient à beurre. - (47) |
| beureille : (bœrèy’ - subst. f.) panier rond à deux anses. - (45) |
| beureille, s. f. panier de forme arrondie avec des anses. - (08) |
| beureilli : Tousser d'une toux caverneuse et profonde. - (19) |
| beureillo : (bœrèyo - subst. m.) terme de sens indéterminé, mais qui s'applique à quelque chose de petit. Dérivé de bœrèy’. - (45) |
| beurère : baratte. - (31) |
| beurgaillon. s. m. Ramassis. (Annay-la-Côte). - (10) |
| beurgeat, bargeat. n. m. - Troupeau de mouton. - (42) |
| beurgére, s. f. bergère, celle qui conduit aux champs non-seulement les moutons, mais les animaux de toute espèce, y compris les oies et les dindons. - (08) |
| beurgnaule : caisse à pèche - (44) |
| beurgnôle : pulvérisateur. A - B - (41) |
| beuriat (na) - batresse (na) - garrot (on) - pissiat (na) : averse - (57) |
| beuriauder : malmener - (44) |
| beurié (nom masculin) : berceau rustique. Sorte d'auge en bois. - (47) |
| beurié : berceau - (48) |
| beurié, s. m. berceau d'enfant. - (08) |
| beuriée : berceau - (39) |
| beurier, verbe transitif : broyer, écraser au pilon. - (54) |
| beurière (n.f.) : bruyère - (50) |
| beuriére, beurieure : bruyère - (48) |
| beurieure : (beurieû:r' - subst. f.), bruyère. - (45) |
| beurieure : bruyère - (39) |
| beurieure, s. f. bruyère. - (08) |
| beurillion, s. m, nombril - (22) |
| beurin, s, m. maquignon de bas étage, marchand de chèvres. - (22) |
| beurin, s. m. maquignon de bas étage, marchand de chèvres. - (24) |
| beurinette, burinette. n. f. - Pot en terre ou en fer blanc avec une anse, porte-dîner, gamelle. - (42) |
| beurinette. s. f. Pot en fer blanc où l’on met la cataurène (voyez ce mot). (Bléneau). - (10) |
| beurioç’e : brioche - (37) |
| beurioche (n.f.) : brioche - (50) |
| beurioche (na) : brioche - (57) |
| beurioche : brioche - (48) |
| beurioche : une brioche. - (56) |
| beurioche : n. f. Brioche. - (53) |
| beurioche, s. f, brioche. - (14) |
| beurioge, s. f. brioche, gâteau en général. - (08) |
| beuriolée, s. f. une pleine voiture, tout ce qu'une voiture peut contenir. - (08) |
| beurion (on) : nombril - (57) |
| beûrion : nombril - (43) |
| beurion : nombril - (51) |
| beurion n.m. (lointaine parenté latine avec ombilic). Nombril. - (63) |
| beûrion, beûrillon : (nm) nombril - (35) |
| beurion, s. m. nombril. - (24) |
| beuriotte (na) : brouette - (57) |
| beuriotter - beurouaitter : brouetter - (57) |
| beurjâter : chercher partout - (60) |
| beurjot (nom masculin) : raccommodage grossier consistant à rapprocher les parties d'un accroc. - (47) |
| beurjouée. s. f. Bruyère. (Montillot). - (10) |
| beurlaiser (v.) : aller et venir, perdre son temps à des futilités - (50) |
| beurlaiser : flâner, perdre son temps - (60) |
| beurlan : bruit intense - (48) |
| beurlan : gros bruit, tintamarre. - (33) |
| beurlan : (bœrlan - subst. m.) tapage, raffût. al en m'nan un boerlan ! « ils en font un raffût ! » - (45) |
| beurlan : grand bruit - (39) |
| beurland, s. m., salsifis sauvage, qui croît dans les prés, et dont les enfants mangent avidement les tiges et les feuilles. - (14) |
| beurlander, v. intr., courailler, perdre son temps, flâner. - (14) |
| beurlander, v. n. aller au beurlan ou brelan ; se réunir à un certain nombre de personnes pour causer, bavarder, faire du bruit, du tapage. - (08) |
| beurlaud : naïf - (60) |
| beurlaud, -aude adj. (mot du patois bourbonnais berlaud, diminutif gentil de beurdin qui a donné les verbes beurlauder, perdre son temps et embeurlauder, tromper en flattant). Simplet, gentil mais pas fûté. Voir beurdalaud. - (63) |
| beurlauder (ne pas confondre avec beurdauler) : Passer son temps à de menus travaux de peu d'utilité. Bricoler. - (19) |
| beurlauder : flâner. - (09) |
| beurle, s. f. bosse. Verbe beurler, bosseler un objet métallique. - (24) |
| beurlé, v. a. bosseler. - (22) |
| beurlette n.f. (de éberluer).1. Tournis, vapeurs, hébétude. 2. Sexe féminin. Voir bèrliche, beurliche, pendant masculin. - (63) |
| beûrleûquer : regarder de travers, loucher - (37) |
| beurleûyot (n.m.) : qui voit mal clair ou d'un seul œil - (50) |
| beurli : petit sac. A - B - (41) |
| beurli (satsso) : petit sac - (51) |
| beurli : petit sac - (34) |
| beurliche, bèrliche n.f. Verge, surtout dans le langage enfantin. - (63) |
| beurliche, s. f., attribut sexuel de la virilité. - (40) |
| beurlicher : (vb) battre des paupières - (35) |
| beurlier, v. n. briller ; au part. prés. « beurlian. » - (08) |
| beurlin : jeune tique plate (non gorgée de sang). A - B - (41) |
| beurlin : jeune tique plat - (34) |
| beurlin n.m. (or. inc.) Pou du mouton. - (63) |
| beurlin(e) : parasite, mouche qui s'accrochent sur le bétail - (39) |
| beurlin, s. m. pou des moutons. - (08) |
| beurlindiner (verbe) : faire tinter une sonnette. Par extension, faire du bruit pour manifester sa présence. - (47) |
| beurlingouére : objet bruyant - (48) |
| beurlingouére : objet en mauvais état qui fait du bruit - (39) |
| beurlingouére, s. f. trébuchet, piège à oiseaux. - (08) |
| beurlingouin, s. m. badaud, musard. Un grand beurlingouin, homme à grandes jambes qui flâne. - (08) |
| beurlisatsot n.m. (de berlichassot, mot du vocabulaire de la mine) Petit sac destiné à contenir des effets personnels. - (63) |
| beurlode : sexe masculin - (39) |
| beurloder (verbe) : paresser, perdre son temps. - (47) |
| beurloquai : cahoter. On est ben beurloquué dans la remorque : on est bien cahoté dans la remorque. - (33) |
| beurloque : montre, breloque - (48) |
| beurloque, s. f. berloque = breloque. - (08) |
| beurloquer : cahoter, remuer dans quelque chose - (48) |
| beurloquer : cahoter. - (52) |
| beûrloquer : s’entrechoquer - (37) |
| beurloquer : secouer quelque chose comme une breloque - (39) |
| beurloquer, v. a. remuer en tous sens, secouer rudement. - (08) |
| beurloquo : esprit peu développé. Tu causes coume un beurloquo : tu parles sans réfléchir. - (33) |
| beurlot : personne peu intelligente, pas futée. A - B - (41) |
| beurlot (nom masculin) : personne qui radote, qui parle beaucoup, de choses sans intérêt. - (47) |
| beûrlot : beurre brûlé - (37) |
| beurlot : commis, manœuvre - (51) |
| beurlot : pas très intelligent, pas futé - (34) |
| beurlot : voir berlot - (23) |
| beurlot, berlot : repas de baptême. - (32) |
| beurloter : radoter, dire des bêtises (beurloteux) - (60) |
| beurloteux, (toux) : qui dit des bêtises (beurloter) - (60) |
| beurlotte (verbe) : radoter. Se répéter. - (47) |
| beurlouaiché : v. pr. Se pourlécher. - (53) |
| beurlu - qui a la berlue qui ne voit pas bien clair. - Ma, te regairde drôlement ! Té don beurlu ? - A fait to ai lai lustuberlu. - (18) |
| beurlu (n.m.) : celui qui ne voit pas clair - (50) |
| beurlu : Myope. « Ol a toje été beurlu » : il est myope de naissance. « Vois tu ce miarle (merle) ? Non, t'as dan la beurlu es yeux ». - (19) |
| beurlu : qui voit mal ou parfois simplet - (48) |
| beurlu : qui voit mal. - (62) |
| beurlu : soleil - (48) |
| beurlü : qui louche. - (33) |
| beurlu et berlu : louche. Ce mot avait autrefois le sens d'ébloui : notre verbe patois éberluter a conservé cette signification. I vâs me cheurter ai l'ombre, le sulot m'éberlute. Les gens de l'Yonne disent aberlucoter. Les proclamations de la Mère-folle de Dijon contenaient, en guise de sanction, les mots Hurelu-Berlu qui sont restés dans le langage populaire avec la signification de toqué. - (13) |
| beurlu : adj. Qui voit mal au sens propre ou figuré. - (53) |
| beurlu : simplet - (39) |
| beurlu, , adj. qui voit mal. Peut être utilisé comme nom pour parler de toutes les infirmités de la vue (strabisme, cécité, etc.). - (65) |
| beurlu, adj., qui a mauvaise vue, louche, borgne, presque aveugle. Formé du subst. berlue. - (14) |
| beurlu, adj., qui louche ou qui regarde de travers. - (40) |
| beûrlu, beûrlue : celui, celle qui louche - (37) |
| beurlu, celui qui regarde de côté, et voit mal les choses. - (16) |
| beurlu, ébeurlu, e, adj. celui qui a la berlue, qui n'y voit pas clair, qui a des illusions de vue. - (08) |
| beurlu, qui a mauvaise vue. (Voir au mot brelue.) - (02) |
| beurlu, qui louche. - (38) |
| beurlu, subst. masculin : personne qui a une mauvaise vue. - (54) |
| beurlu, -ue n. et adj. (du v. fr. éberluer) Qui voit mal, avec une nuance de mépris. - (63) |
| beûrlue (avouair lai) : avoir cru voir une chose qui n’existe pas - (37) |
| beurlue (na) : berlue - (57) |
| beurlue (nom féminin) : (Avoir la) voir avec difficultés. - (47) |
| beurlue : n. f. Berlue. - (53) |
| beurlue, s. f. berlue. - (08) |
| beurlügai: voir sans distinguer, crépuscule, entre chiens et loups. - (33) |
| beurlujotte (n.f.) : petit lézard - (50) |
| beurlujotte, s. f. petit lézard. - (08) |
| beurlusotte, bourlusotte. s. f. Eblouissement.— Avoir une beurlusotte, être pris d’un éblouissement, d’une berlue momentanée. - (10) |
| beurluter : (vb) éclairer faiblement - (35) |
| beurluter v. Eclairer faiblement. - (63) |
| beurluton : (nm) lumignon - (35) |
| beurluton n.m. Lumignon. - (63) |
| beurluzon : (nm) ver luisant - (35) |
| beurnacher, verbe impersonnel : bruiner, brouillasser. - (54) |
| beurnachon : celui qui parle à tort et à travers. - (33) |
| beurnagöt, sm. burette à huile. (Bernardin, à cause du couvercle conique qui rappelle un capuchon de moine). - (17) |
| beûrnaiç’er : pleuvoir finement - (37) |
| beurnaicher (v.t.) : se dit des brouillards qui tombent en pluie fine (aussi beurnaisser) - (50) |
| beûrnaillou : brumeux. (F. T IV) - S&L - (25) |
| beurnaisse (nom masculin) : pluie légère. - (47) |
| beurnaisser (v.t.) : se dit des brouillards qui tombent en pluie fine (aussi beurnaicher) - (50) |
| beurnanciau (à), locution adverbiale : à profusion, à foison, en très grande quantité. - (54) |
| beurnanciau (ai beurnanciau) : adv. À foison. - (53) |
| beûrnanciau (ai) : beaucoup en quantité - (37) |
| beurnanciaux : quand il pleut beaucoup on dit il pleut à... - (44) |
| beurnanciô, adv., abondamment, à foison. - (40) |
| beurnansiau (à) loc. adv. (p.ê. la déformation de boire au seau). En abondance. - (63) |
| beurnanssio (à) : à profusion - (51) |
| beûrne : cavité, trou ou excavation (beurna en Savoie), d’où le qualificatif beûrnou pour un fruit, un tronc creux. - (62) |
| beurné : nuit noire - (43) |
| beûrne : Trou, caverne, terrier. « Le rena s'est foré dans sa beûrne » : le renard s'est terré. « Eune beûrne de taichon » : un terrier de blaireau. « Grillot, grillot, so de ta beûrne ! » : mélopée à laquelle les enfants attribuent la vertu de faire sortir le grillon de son trou. - (19) |
| beurne, adj. sombre, brun. - (08) |
| beurne, borne : s. f., cavité. - (20) |
| beurne, s. f. cavité dans un vieil arbre. - (22) |
| beurne, s.f. trou dans un tronc d'arbre, un mur, un rocher, etc… - (38) |
| beurnêchi : pluie fine, bruine. A - (41) |
| beurnêchi : pluie fine - (34) |
| beurnensio : (tr. lit. : à benne et à seau) à beurnensio : en grande quantité. A - B - (41) |
| beurneuilli v. (or. inc.). Manger du bout des lèvres, grignoter entre les repas. - (63) |
| beurneûyi : (vb) manger du bout des lèvres - (35) |
| beurniclâ n.m. (p.ê. de biscler, à moins de n'y voir bernique). Loucheur. - (63) |
| beurniclai ou beurniqué.- (Del.), loucher. – Un beurniclou ou une beurniclouse est une personne qui louche. - Un beurlu est celui qui a mauvaise vue. -L'exclamation beurnicle signifie qu'on ne voit goutte à une chose. Ce mot date sans doute de l'emploi des lunettes qu'on appela d'abord berniques ou bernicles (expressions corrompues vraisemblablement de vernicles, locution appropriée aux verres de ces lunettes) , plus tard besicles, du latin bis oculus. - (06) |
| beurnicler v. Loucher. Voir bicher, bitser. - (63) |
| Beurninchau : NL Burnanceau - (35) |
| beurnioule : (nf) panier à œufs - (35) |
| beurniqhie ! interj. qui équivaut à point, à rien, à une négation enfin. - (08) |
| beurnique : bernique, rien - (48) |
| beurnissé, ée. adj. Personne indifférente, qui ne s’occupe de rien, qui laisse tout aller. (Maligny). - (10) |
| beurnonsiau (à) : à seaux, à pleins seaux, en quantité, à profusion. - (32) |
| beurnonsiau (à) : pleuvoir à seaux. (PSS. T II) - B - (25) |
| beurnot : Brun, noir. Féminin : beurne. Nom qu'on donne aux bœufs et aux vaches qui ont le pelage noir. Du lait à la beurne, de l'eau. - (19) |
| Beurnot, nom de bœuf tiré de sa couleur brune. - (08) |
| beurnou (arbre) : creux. (F. T IV) - S&L - (25) |
| beurnou : adj. se dit des troncs pourris et creux. - (21) |
| beurnou, adj. (arbre) beurnou : dont le tronc est creux. - (38) |
| beurnou, adj. qui a une cavité intérieure ; se dit surtout d'un vieil arbre - (24) |
| beurnouciau (a) : à qui en veux-tu !(S. T IV) - B - (25) |
| beûrnoux : Creux. « In vieux pi de sauge to beûrnoux » : un vieux tronc de saule creux. - (19) |
| beurnoux, adj., flétri en son centre ; se dit surtout de la pomme de terre. - (40) |
| beurnoux, bornu : adj., vx fr. bornu, creux. Un chêne beurnoux. - (20) |
| beuro. Brun. - (03) |
| beuron : poussinière. (BD. T III) - VdS - (25) |
| beuron : poussinière. (CH. T II) - S&L - (25) |
| beuröre, sf. beurrière. - (17) |
| beurot - bruscié : basané - (57) |
| beurot - bruscié : bronzé - (57) |
| beurot - de couleur gris-rouge ou gris-jaune. - Pou les haibits d'homme i trouve que lai couleur beurot ne vai pâ mau. - (18) |
| beurot (adjectif) : de couleur sombre. - (47) |
| beurot (e) : personne à la peau sombre - (51) |
| beurot (on) : brun - (57) |
| beurot (otte) : brun (se dit surtout d'une vache) - (39) |
| beûrot (te): (adj) (lapin) foncé, (personne) à la peau mate - (35) |
| beûrot : couleur de peau ou de pelage foncé - (43) |
| beurot : Sombre, brun, noiraud. « Vincent le beurot » : Vincent aux cheveux noirs. Au féminin : beure. « La beure » la brune (en parlant d'une femme). - « A la beure », à la brune, à la tombée du jour. « Y est beurot né » il fait nuit noire. - (19) |
| beurot : adj. et n. Bronzé (e). - (53) |
| beurot(te) : brun, bronzé, basané - (48) |
| beurot, adj. qual. ; fém. beurote ; gris, noir. - (07) |
| beûrot, adj., brun. - (40) |
| beurot, beurote : adj., roux, brun, brun foncé. Se dit de la robe des animaux de l'espèce bovine. - (20) |
| beûrot, beûrotte : hâlé, hâlée par le soleil, qui a le teint de peau foncé - (37) |
| beurot, beurotte n. et adj. (de bure) De couleur mate, comme la bure. - (63) |
| beurôt, beûrôtte, beûreau (C.-d., Chal., Char.), beùrnòt (Morv.).- De couleur rousse, brune, comme l'étoffe appelée bure. Le mot beurre a certainement la même étymologie. En Bourgogne, le raisin beurot (beurré) est le produit rougeâtre du noir par le blanc ; les poires beurrées sont appelées ainsi en raison de leur peau qui est comme couverte de taches de rousseur. Dans le Charollais, une beurrée est un gros nuage orageux. Dans certaines localités se trouvent des bois plantés d'essènces à sombres feuillages qu'on appelle bois beurots. . En latin burrus, venant d'un mot grec qui signifie feu, s'emploie pour désigner la couleur rousse ; telle serait, selon Littré, l'étymologie du mot bure. - (15) |
| beurot, beurotte. Brun, brune. Etym. brun, brune, par alourdissement local, ou métathèse. - (12) |
| beurot, pineau gris, de couleur brune. - (38) |
| beurot, subst. masculin ou adjectif qualificatif : qui a le teint mat, brun ou bronzé. - (54) |
| beurot. adj., brun clair, couleur de beurre (?). Se dit des gens, des bestiaux, des fruits : « Un garçon beùrot, une vache beùrote, une poire beùrote ! » - (14) |
| beurotte (na) : brune - (57) |
| beurouaitai : conduire, vite et sans précaution. On a été beuroueté à une sacrée vitesse : on a été conduit à une sacrée vitesse. - (33) |
| beurouaité : v. t. Faire rouler une brouette. - (53) |
| beurouatte (n.f.) : brouette (aussi beurouette) - (50) |
| beurouette (nom féminin) : brouette. - (47) |
| beurouette : brouette - (44) |
| beurouette : brouette. - (52) |
| beurouette :brouette - (48) |
| beurouette n.f. Brouette. - (63) |
| beurouette : brouette - (39) |
| beurouette : n. f. Brouette. - (53) |
| beurouette, br’oette : brouette - (37) |
| beurouette, s. f. brouette. - (08) |
| beurouettée (nom féminin) : contenu d'une beurouette. - (47) |
| beurouetter : conduire vite - (48) |
| beurquiées (n.f.pl.) : perches placées dans le coin de la cheminée pour faire sécher le linge - (50) |
| beurquillou : boiteux - (44) |
| beurra, buidon, panier à crinoline. - (05) |
| beûrraiñne : (nf) écume de beurre fondu (on faisait fondre le beurre pour le conserver. Puis, une fois refroidi, une sorte de mousse se formait à la surface : la « beûraiñne »; on la raclait pour en faire des tartines - (35) |
| beûrraiñne n.f. Crasse de beurre fondu. - (63) |
| beurrain-ne. Crasse laissée par le beurre fondu. - (49) |
| beurràyé (se), v. r. se dit du ciel se couvrant avant l’orage. - (22) |
| beurràyer (se), v. r. se dit du ciel se couvrant avant l'orage. - (24) |
| beûrré : baratte. « J’n’ai ni foie ni courée, j’ai l’côrps fait c’ment un beûrré » ! - (62) |
| beûrré : Baratte, vaisseau de bois plus étroit par le haut que par le bas dans lequel on met la crème pour la transformer en beurre. - Nénuphar, nymphéa lutea. Le nom de beurré donné au nénuphar jaune paraît dû à la fois à la couleur de la fleur et à la forme de la feuille, assez large pour qu'on puisse y placer une motte de beurre. - (19) |
| beurre : Beurre dicton : « N'avoir pas affâre à Jean que bat le beurre » : n'avoir pas affaire à un sot. Le barattage étant, dans les exploitations importantes, donné au moins dégourdi. « Y n'i fa pas san beurre jaune » : cela ne fait pas son affaire, le beurre jaune étant le seul vendable. - (19) |
| beurre de bique (donner du). Dicton qui signifie qu'on ne donnera pas ce que l'autre demande ; qu'il n'est pas gêné ; mais qu'il en sera pour son indiscrétion. - (12) |
| beûrré : adj. Ivre. - (53) |
| beûrre : s. m. beurre. - (21) |
| beurre, s. m. Voir Liard de beurre - et Once de beurre, termes de comparaison pour indiquer un volume et un poids minimes. - (20) |
| beûrrée (aine) : (une) averse soudaine - (37) |
| beûrrée (n. f.) : babeurre, résidu liquide de la fabrication du beurre - (64) |
| beûrrée : (nf) averse d’orage - (35) |
| beûrrée : averse d'orage - (43) |
| beurrée : averse et rossée. - (62) |
| beurrée : averse violente - (51) |
| beurrée : cardamine des prés. VI, p. 17 et p. 37 - (23) |
| beurrée : grosse averse - (48) |
| beurrée : orage - (34) |
| beurrée : petit lait. VI, p. 17 - (23) |
| beurrée : une grosse averse. - (56) |
| beurrée : n. f. Averse subite, courte et abondante. - (53) |
| beurrée : voir bourrée. - (20) |
| beurrée, averse, giboulée. - (05) |
| beurrée. n. f. - Babeurre, résidu liquide de la fabrication du beurre. - (42) |
| beurrer : pouvait signifier aussi heurter, se cogner contre qqch. : sa voiture a dérapé et il a beurré contre un arbre. - (56) |
| beurrère : baratte. A - B - (41) |
| beurrére : baratte - (34) |
| beurrère : baratte. - (29) |
| beurrére. Baratte. - (49) |
| beurrié (-e) (le/la) (n.m. ou f.) : lit d’enfant en bois en forme d’auge (Morvan/Nivernais) - (50) |
| beurrié : berceau. On met le gosse dans le beurrié : on met le gosse dans le berceau. - (33) |
| beurriée : berceau. IV, p. 58-a - (23) |
| beûrriées : écrasées, moulinées (treûffes beûrriées) - (37) |
| beurrier. s. m. Berceau d’enfant, banne d’osier tressé. De ber , qu’on prononce quelquefois beur. - (10) |
| beurrier. s. m. Homme replet. (Etivey). - (10) |
| beurrière. s . f. Nénuphar. (Argenteuil). - (10) |
| beurrillon, nombril, ombilic. - (05) |
| beurrin : Nom masculin. Maquignon de bas étage. - (19) |
| beurriner ou beuriner : Palper le ventre des vaches pour reconnaître si elles portent un veau. « Le maguignan (maquignon) qu'a ageté ma vaiche a bin cognu (connu) qu'elle portait in viau, ol l'a beurinée, y est in ban beurin ». - (19) |
| beûrrire : (nf) baratte - (35) |
| beûrrire : baratte - (43) |
| beûrrîre n.f. Barratte. - (63) |
| beurrire, s. f. baratte à battre le beurre. - (22) |
| beurrire, s. f. baratte à battre le beurre. - (24) |
| beurrœ, adj. pâle, à teint maladif, jaunâtre comme du beurre. - (22) |
| beurrœ, adj. pâle, à teint maladif, jaunâtre comme du beurre. Féminin beurrœte. - (24) |
| beurron. s. m. Motte de beurre. - (10) |
| beurrot, -te, brun, brune. - (05) |
| beursaude : gratton - (48) |
| beursaude : résidu de panne fondue. (E. T IV) - S&L - (25) |
| beursaude : tranche de lard frite, synonyme « greille ». On fait fondre les beursaudes : on fait fondre les tranches de lard. - (33) |
| beursaude : (bœrsô:d’ - subst. f. pl.) rillons, menus résidus de graisse de porc qu'on fait griller à la poêle. - (45) |
| beursaude : n. f. Gratton. - (53) |
| beursaude. Dragées, anis de Flavigny, et généralement tout ce que l’on fait cuire en agitant le récipient. On nomme encore beursaude les résidus de saindoux appelés spécialement à Beaune des grétons. Le même mot s'applique aux grains de maïs sec que les enfants font griller sur une pelle rougie au feu : ces grains présentent, en éclatant, l'apparence de certaines fleurs, et leur saveur est fort agréable. Beursauder exprime l'action de vanner ou de bercer. - (13) |
| beursaude. s. f. Lardon, tranche de lard ou de jambon. - (10) |
| beursaudes - restes ou petits morceaux coupés du gras de cochon qu'on a fondu. - No, i n'eûmons pâ les beursaudes. - (18) |
| beursaudes (n.f. pl.) : déchet de la graisse de porc après la fonte - (50) |
| beursaudes : plat constitué de résidus de graisse de porc. - (56) |
| beursaudes : résidu de la graisse de porc fondue (cf. griblaude) - (39) |
| beursaudes, résidus de la graisse de porc fondue. - (27) |
| beursaudes, s. f. le déchet de la graisse de porc, après la fonte. On assaisonne quelquefois les beursaudes avec du vinaigre. - (08) |
| beurse : (nf) bêche - (35) |
| beurse n.f. (du lat. médiéval bessos, la bêche) Bêche. - (63) |
| beurseillo : rosier sauvage : églantier, fruit de l'églantier. Le beurseillo pousse dans les savées : l'églantier pousse dans les haies. - (33) |
| beursereut : Mélange de vin, sans sucre, et de pain émietté. Ce mot n'est plus employé, on dit maintenant « caneut », voir ce mot. - (19) |
| beursi : (vb) bêcher - (35) |
| beursi : Extrêmement sec. « Tan foin est-i prou so ? Je te cra, ol est so c 'ment beursi » : ton foin est-il assez sec ? Je te crois, il est extrêmement sec. - (19) |
| beursi v. Bêcher. - (63) |
| beursillai ou ebeursillai - casser en tout petits morceaux. - Le drossouais é venu ai lai volée, et jugez queman tôtes les aissiettes en étai ébeursillées. - (18) |
| beursillé (v. tr. ), griller, torréfier (se dit principalement des prés desséchés par la canicule). Dénominatif de brésil, dérivé de braise. - (45) |
| beursiller : broyer, bousiller. - (32) |
| beursilles : brindilles - (60) |
| beurso : n. m. Berceau. - (53) |
| beursode (ö), sf. petits lardons provenant de la fonte de la panne de porc. Voir chan. - (17) |
| beursôde, ce qui reste de petits morceaux de gras de pore fondus. - (16) |
| beursoiyé, faire mal un ouvrage. - (16) |
| beurson : (nm) bec verseur - (35) |
| beurson n.m. (du gaul. broccia, broccus). Bec verseur. - (63) |
| beurson : n. m. Bruit sourd et intense. - (53) |
| beursonnié, ére, s. habitant ou habitante de St-Brisson, commune du canton de Montsauche, dans le haut-Morvan. - (08) |
| beursons : jumeaux. A - B - (41) |
| beursons : jumeaux - (44) |
| beursoyer, remuer avec violence. - (28) |
| beurtailler. s. m. Personne violente, irascible, qui s’emporte à tout propos. C’est une forme assez fortement altérée du mot brutal. (Etivey). - (10) |
| beurtale, bretelle. - (16) |
| beurtaler : v. secouer. - (21) |
| beurtaler, v. int., bouillir trop longtemps: « Fais donc attention, Mariette ; ta sôpe beùrtale. All’ s'ra tout en pâte ». Comme sens, a de l'analogie avec Reûtonner. (V. ce dernier mot). - (14) |
| beurtaler. v. a . Brutaliser. - (10) |
| beurtalle : bretelle. La culotte s'écroche è beurtalles : la culotte s'accroche aux bretelles. - (33) |
| beurtalle. s. f. Bretelle. - (10) |
| beurtalles (des) - beurtelles (des) : bretelles - (57) |
| beurtalles : bretelles - (48) |
| beurtalles : bretelles. Exemple classique : inversion dans la première syllabe et altération de « é » en « a » dans la seconde. - (62) |
| beurtalot. s. m. Bretailleur, chercheur de querelles, de batailles. (Sermizelles). - (10) |
| beurtaloux. s. m . et adj. Brutal, qui agit avec grossièreté, avec méchanceté. - (10) |
| beurté : plafond à lames disjointes laissant passer des débris. A - B - (41) |
| beurte : (nf) carriole à deux roues et un manche - (35) |
| beurte n.f. (de bi-rota, deux roues). Carriole à deux roue et à un manche. Brouette, même avec une seule roue. - (63) |
| beurté. Blutée. - (49) |
| beurteau, s. m. blutoir, crible ou tamis pour séparer le son de la farine. - (08) |
| beurteille : haut de l'âtre de la cheminée. - (33) |
| beurteilles : brindilles, feu qui n'est pas alimenté - (39) |
| beurtèle : bretelle. - (52) |
| beurtelle (n.f.) : bretelle - (50) |
| beurtelle : bretelle - (51) |
| beurtelle : bride de cuir que l'on met sur les sabots de bois - (51) |
| beurtelle n.f. Bretelle. - (63) |
| beurtelle : n. f. Bretelle. - (53) |
| beurtelle, s. f., bretelle. - (14) |
| beurter (v.t.) : bluter passer la farine à travers un tamis - (50) |
| beurter : faire beaucoup de bruit, faire 'du vilain' - (51) |
| beûrter : secouer fortement - (37) |
| beurter v. 1.Transporter avec une beurte. 2. Secouer. - (63) |
| beurter : v. cribler la farine. - (21) |
| beurter, v. a. bluter, tamiser la farine au blutoir pour en ôter le gros son. - (08) |
| beurter. v. tr., tamiser, bluter : « J'ons beurté not’ farine ». - (14) |
| beurtiau : Blutoir, bluteau, sorte de tamis employé dans les moulins. - (19) |
| beurtiau, s, m., blutoir. - (14) |
| beurtoû (n.m) : grand tamis pour la farine - (50) |
| beurtoué, s. m. blutoir, tamis qui sépare la farine du gros son. - (08) |
| beurtse : (nf) fente dans un mur, brèche - (35) |
| beurtsée : (nf) cruche pour porter à boire dans les champs - (35) |
| beurtsi : cruche en poterie servant à porter à boire dans les champs. A - B - (41) |
| beurtsi v. Affûter dent par dent. Syn. fauçeuilli. - (63) |
| beurtsot adj. Edenté, ébréché. - (63) |
| beurvotte, beurvouotte. s. f. Brouette. (Argentenay, Béry). - (10) |
| beurvotter, beurvuotter. v. a. Brouetter. - (10) |
| beurzé : berger. - (52) |
| beurzelot, pain trempé dans du lait. - (38) |
| beurzer (n.m.) : berger (fém. bergère) - (50) |
| beûrzi, adj., sec (en parlant de la terre ou des haricots). - (40) |
| beurzie, s. f. bergerie. - (08) |
| beurzolot (adj. ou n.m) : pas très futé. Voir beûtiot et beuzenot. - (62) |
| beurzolot, adj., un peu détraqué, - (40) |
| beurzot n.m. (de braise). Miette de pain. - (63) |
| beûse (na) : buse - (57) |
| beuse. Bouse. - (49) |
| beuse. n. f. - Bouse des vaches. - (42) |
| beusenot : maladroit, pas très malin. - (66) |
| beusenot, adjectif qualificatif et subst. masculin : lourdaud, niais, simple d'esprit, malhabile. Employé au sens figuré pour personne stupide, imbécile. - (54) |
| beusenot. Pauvre d'esprit, peu dégourdi. - (49) |
| beuseron, sm. petit tas de fumier. - (17) |
| beusie. s. f. Vessie. (Annay-la-Côte). - (10) |
| beuskeûgnon n.m. (mot composé de bec et de coin, angle). Bec dans un vêtement, objet qui dépasse. - (63) |
| beûson, maussade, silencieux. - (16) |
| beûsqueugnyi : ergoter, chicaner - (43) |
| beûsqueûnion : (nm) bec dans un vêtement - (35) |
| beusquin, adj. qui n'avance pas au travail. Verbe beusquegni. - (22) |
| beusse (nom féminin) : bûche. On dit aussi beuche. - (47) |
| beûsse : bûche. - (52) |
| beusse : bûche - (39) |
| beûsse : s. f. fagot de chanvre. - (21) |
| beusse, bosse ; beussu, bossu. - (16) |
| beusse-cu : fruits de l'églantier. - (30) |
| beusseule (f), réserve à grain. - (26) |
| beûssi : endroit où sont empilées les bûches - (39) |
| beûsson : (nm) jumeau - (35) |
| beûsson : bec verseur - (43) |
| beusson : petite bûche - (39) |
| beusson, -onne n. et adj. (du lat. bis, deux fois). Jumeau, jumelle. - (63) |
| beussu, adj. bossu. - (17) |
| beust'in, adj. qui n'avance pas au travail. Verbe beusquegni. - (24) |
| beut : But, terme de jeu, point de départ. « Teni le pi au beut » : se dit au jeu de quilles, du joueur qui tient son pied à la place où il doit être. Au figuré : agir correctement. - Gros crapaud. « Etre ganflé c 'ment in beut » : être gonflé comme un beut, être gavé, bourré de mangeaille. - (19) |
| beutai : bouvier. (RDC. T III) - A - (25) |
| beutcher, beutier. Bouvier. Conducteur du bœuf au travail. Le beutier était, autrefois, généralement un « valet de ferme »... - (49) |
| beute : terrier, trou dans un arbre. A - B - (41) |
| beute (la) : terrier - (43) |
| beûté : Bûcheron, « In ban beûté » : un habile bûcheron. - (19) |
| beute : terrier, trou dans un arbre - (34) |
| beute : trou - (51) |
| beute : trou dans un arbre - (43) |
| beûté, adj., creux (se dit d'un arbre pourri au cœur). - (40) |
| beute, s. f. cavité dans un arbre ; terrier de renard. - (24) |
| beutée : meuglement - (51) |
| beuter : meugler. A - B - (41) |
| beûter : (vb) meugler - (35) |
| beuter : meugler - (34) |
| beûter : meugler - (43) |
| beuter : meugler - (51) |
| beuter, beugler. - (05) |
| beuter. Beugler. - (03) |
| beuter. v. n. Beugler. — Faire des riens. = v. a. Chercher, remuer, déplacer. Dans ce dernier sens, on dit, à Auxerre, rabeuter. - (10) |
| beuteune : viande avariée, odeur pestilentielle. A - B - (41) |
| beuteune : viande avariée, puanteur - (34) |
| beuteuner v. S'avarier. Plus le temps est lourd et moite, plus les aliments s'abîment. - (63) |
| beuteunerie : personne peu recommandable. A - B - (41) |
| beuteunerie : animal indocile - (43) |
| beuteunerie : personnage peu recommandable - (34) |
| beûteunerie n.f. (du gaul. buttuna, bête crevée, gonflée comme un tonneau). Chose sans valeur, saleté, fait ou chose désagréable. - (63) |
| beuteux : creux, en parlant d'un arbre. A - B - (41) |
| beuteux : arbre dont le cœur est pourri - (34) |
| beutié, s. m. celui qui conduit les bœufs, charretier. - (08) |
| beûtier (n. m.) : bouvier - (64) |
| beûtier (n.m.) : bouvier - (50) |
| beutier (nom masculin) : simple d'esprit. Ethym. : tout juste bon à conduire un attelage de bœufs. - (47) |
| beûtier : bouvier,lourdeau, personne brutale, peu intelligente - (48) |
| beutier : pauvre type. - (66) |
| beutier : sabot. (LS. T IV) - Y - (25) |
| beûtier : bouvier, conducteur d'un attelage de bœufs. Les beûtiers ont disparu. - (33) |
| beutier ou beutou, subst. masculin : personnage balourd, mal dégrossi. - (54) |
| beûtier : 1 n. m. Bouvier. - 2 adj. et n. m. Maladroit. - 3 adj. Rustre. - (53) |
| beûtier, s. m., être épais, ignare et inculte. - (40) |
| beutier, sm. marchand de bœufs ; meneur de bœufs ; par ext. homme grossier, lourdaud. - (17) |
| beûtier. n. m. - Sabot sans bride en cuir. - (42) |
| beûtiller (v. int.) : aller et venir, perdre son temps à des futilités (syn. arcander, berlaiser) - (64) |
| beutiller : lambiner. - (09) |
| beutiller : travailler lentement, à des riens - (60) |
| beutiller. v. n. Diminutif de Beuter. Faire des riens, s’occuper des minuties, de choses inutiles; ne pas travailler sérieusement ni assidûment. — Chercher un objet perdu en bouleversant et laissant en désordre ceux parmi lesquels on le cherche. (Essert). - (10) |
| beutin (butin) : linge - (51) |
| beutin : Bien, avoir propriété rurale. « Ol a un ban beutin » : il a une bonne propriété. - (19) |
| beutin : grande quantité - (43) |
| beutin, s. m. bien, fortune, mobilier. - (08) |
| beutin, s. m. propriété, héritage. - (22) |
| beutin, s. m. propriété, héritage. - (24) |
| beuting (n.m.) : bien, fortune - aussi habits, linge, vêtements - (50) |
| beûtiot : bête et buté. Voir beurzolot et beuzenot. - (62) |
| beutique, sf. boutique. - (17) |
| beutné, vt. boutonner (voir abeutné). Au fig. : beuteune tai gueule, ferme ta bouche. - (17) |
| beutœne, s. f. vieille vache. Vieille personne, en terme de mépris. - (22) |
| beutœne, s. f. vieille vache. vieille personne, en terme de mépris. - (24) |
| beuton, bouton. - (26) |
| beutonne : bête à envoyer à l'équarrissage — d'où : beutonire : bétaillère destinée à cet usage. - (30) |
| beutou (se) : creux - (51) |
| beûtou : (adj) (arbre) creux - (35) |
| beûtou : arbre creux - (43) |
| beutou : arbre creux. - (30) |
| beutré : (beutré - subst. m.) nombril. - (45) |
| beutse : (nf) fétu de paille - (35) |
| beûtse : fétu de paille - (43) |
| beûtse : tige de paille - (43) |
| beutse : tige d'herbe desséchée sur pied - (51) |
| beûtse n.f. (du lat. busca). 1. Bûche. 2. Fétu de paille. - (63) |
| beutsi : bûcler - (51) |
| beûtsi : ceuf fêlé par le poussin qui éclot - (43) |
| beutsou : qui contient des beutsses (tige d'herbe desséchée sur pied) - (51) |
| beutte : (nf) un creux - (35) |
| beutte : Botte. « Eune pare de beuttes, eune beutte de foin, eune beutte de radis ». « Avoir du foin dans ses beuttes » être riche. « Eune beutte d'amanbic » : la cuve pleine d'eau froide dans laquelle passe le serpentin. - (19) |
| beutte n.f. (la racine gauloise butt se rapporte à tout ce qui est concave ou convexe et à tout ce qui heurte ou ce qui pousse).Terrier, trou dans un arbre. - (63) |
| beutte. Trou, caverne à l'intérieur d'un arbre. - (49) |
| beutter v. Meugler longuement et puissamment. (Le taureau qui beutte creuse le sol avec son sabot). - (63) |
| beutteune : Individu brutal et sans éducation. « I est eune vra beutteun » : c'est une vraie brute. - (19) |
| beutteux adj. Creux. - (63) |
| beutteux. Creux, caverneux à l'intérieur. « Un arbre beutteux ». - (49) |
| beuva, beuvains - divers temps du verbe boire. - (18) |
| beuvè : v. t. Boire. - (53) |
| beuvée (n. f.) : buvée, breuvage pour les bestiaux - (64) |
| beuvée : buvée (boisson à base de vin chaud et de son pour les animaux malades) - (48) |
| beuvée : nourriture préparée pour le couchon (exclusivement). Confectionnée la plupart du temps avec une base d'eaux de vaisselle obligatoirement non savonneuse mises de côté. (Les détergents étaient inconnus). - (58) |
| beuvée, buvée. s. f. Eau mêlée de son, de battis, de petit lait, de légumes et de pommes de terre, pour être donnée aux bestiaux, aux cochons. - (10) |
| beuvée. n. f. - Aliment pour animaux. Mélange d'eau, de son, de petit lait et de légumes. Beuvée est une altération de buvée, indiquant au XIIe siècle un coup à boire, une rasade. À partir du XVIIe, il fut employé uniquement dans le domaine agricole : breuvage d'eau et de farine pour les animaux. La beuvée poyaudine, par sa riche composition, est plus un aliment qu'un breuvage. - (42) |
| beûver : boire - (37) |
| beuver : boire - (61) |
| beuveriau : Adonné à la boisson. Il y a une différence entre le beuveriau et l'ivrogne le beuveriau aime à boire, l'ivrogne se saoule. - (19) |
| beuveriaud n.m. Buveur invétéré. - (63) |
| beuveu'dlait : homme qui porte son châpeau en arrière - (61) |
| beûveur : buveur - (37) |
| beuvou - (39) |
| beuvoû : buveur - (48) |
| beuvou ou bevou : Buveur. « In ban bevou ne s'épante pas » : un bon buveur n'est jamais embarrassé, faute de vin il boit de l'eau. - (19) |
| beuvou, ouse, s. buveur, buveuse, celui ou celle qui aime à boire. - (08) |
| beuvre, boire ; el ai beuvu, il a bu... - (16) |
| beuvrocher, v., passer d'une cave à l'autre pour boire des canons. - (40) |
| beûvu : bu - (37) |
| beuyancerie : triperie. - (30) |
| beû-ye : ventre - (43) |
| beuye : ventre. - (30) |
| beûyé, regarder longuement et sottement une personne ou une chose ; beûyou, celui qui regarde ainsi. - (16) |
| beuyé, vt. regarder fixement, attentivement. - (17) |
| beuyon : lourdaud. (B. T IV) - D - (25) |
| beuyot. s. m. Petit bœuf. (Pasilly). - (10) |
| beuyou, adj. myope. - (17) |
| beûzain, beûzon : (adj) (individu ; travail) délicat ; difficile - (35) |
| beuze : bouse de vache - (44) |
| beuzela : paysan mal élevé. (S. T III) - D - (25) |
| beuzenô : l'idiot du village, un simplet - (46) |
| beuzenot : malhabile. - (31) |
| beuzenot : sot. Voir beurzolot et beûtiot. - (62) |
| beuzenot, adj., faible d'esprit, farfelu. - (40) |
| beuzighies, s. f. plur. besicles, lunettes à branches dont se servent les gens âgés. - (08) |
| beuzniau (adjectif) : naïf, demeuré. - (47) |
| beûzniau : simple d'esprit. - (52) |
| beûz'not : lourdeau, incapable - (48) |
| beûznot : tout bête - (37) |
| beûznot n.m. (du vieux verbe à l'or. inc. busier, penser, rêver). Demeuré, arriéré. Voir beurdin. - (63) |
| beuznot : (beuz'no: - subst. m.) homme plus ou moins demeuré, et de peu d'efficacité au travail. - (45) |
| beûz'not : n. m. Bêta. - (53) |
| beuznot, paresseux. - (38) |
| beuznotter : (beuz'notè - v. intr.) : mal travailler, avec peu d'efficacité, faire un travail de beuz'no. - (45) |
| beuznotter, paresser. - (38) |
| beûzon : homme lent au travail - (43) |
| beuzon : qui est lambin à réaliser - (51) |
| beuzonner, boreller : bricoler (sens péjoratif) - (43) |
| bevore, tasse ; du latin bibere. - (02) |
| bevore. :Tasse pour boire. - (06) |
| bey, bief, ruisseau. - (05) |
| béyé : bélier - (48) |
| bèyé, bayé, donner. - (16) |
| bèyer : donner - (48) |
| bèyer : donner. - (56) |
| bezai. A Chaumont-le-Bois, dans le Châtillonnais, on nomme ainsi les tiges sèches de la pomme de terre. En Bretagne, on appelle bezin ou bizin une espèce d'algue ou de varech. (Le Gon.) Le mot bezai est évidemment d'origine gauloise. - (02) |
| bezai. : Tiges sèches de pommes de terre ou autres légumes. - (06) |
| bezaiñne adj. La moutse bezaiñne, appelée aussi moutse pyate, moutse catharine, moutse cathrine et moutse canqueline, est une mouche dotée d'une carapace très dure, vivant sur le bétail. - (63) |
| bezer – draler : rôder - (57) |
| bezer, bezi : v. se dit des vaches qui courent, la queue en l'air, lorsqu'elles sont poursuivies par les taons. - (21) |
| bezeter : parler sur le bout de la langue. - (30) |
| bezillier, beusillier (pour brésiller). v. a. et v. n. Briser, mettre en petits morceaux. Se dit des plantes et particulièrement des céréales tellement sèches, qu’on ne peut y toucher sans qu’elles se brisent. Le blé, par exemple, beursiller, et ses épis se détachent de la tige lorsque, après après avoir été mouillé par la pluie, il est ensuite chauffé, saisi par un soleil ardent. (Etivey). — L’abbé Corblet fait dériver ce mot du celtique brisou , petit morceau. - (10) |
| bezin : Lent à faire une besogne. « Oh! que t'es bezin, te n'avances ren ». « Un travail bezin » : un travail qui n'avance guère, délicat à éxécuter. - (19) |
| bezin, adj., ennuyeux, fastidieux. - (40) |
| bezin. s. m. Insecte qui s’introduit dans les bourgeons de la vigne et détruit. A Auxerre, on l’appelle berdin. - (10) |
| beziner : Mettre beaucoup de temps à faire peu de besogne. - (19) |
| bezouille. s. f. Gros homme, lourdaud, niais. - (10) |
| Bfires n. Buffières. Les habitants sont les Bfirons. - (63) |
| bi (faire un) : embrasser. - (66) |
| bi (on) : bief - (57) |
| bi : ruisseau. (LCSS. T IV) - S&L - (25) |
| bi, s. m. petit ruisseau. - (24) |
| bi, s. m. réservoir d'eau, mare. - (22) |
| bi, s.f. bise ; la bi beaunoise ; la bi noire. - (38) |
| bi. n. m. - Bise, baiser : « Fais don' pas la tête ! Vins putoût faie un bi. » - (42) |
| biâ : adj. Beau. - (53) |
| biâ, adj. beau. - (38) |
| biâ, adj., beau. - (40) |
| biâ, beau ; bale, au féminin. - (16) |
| biaffe : pâle (en parlant du teint). - (33) |
| biailler : v. a., tiller. - (20) |
| biainche : blanche - (57) |
| biainchi : blanchir - (57) |
| biaintsi : blanchir - (51) |
| biaire, adj. se dit d'un mâle et surtout d'un taureau qui a été maladroitement châtré, ou dont la castration est incomplète. - (08) |
| bian : blanc - (43) |
| bian : blanc - (46) |
| bian : blanc - (48) |
| bian : blanc. - (66) |
| bian, ance, adj. blanc, blanche. - (08) |
| bian, bjinche, adj. blanc, blanche. - (17) |
| bian, blanc; biènche, au féminin. - (16) |
| bianc : blanc - (51) |
| bianc : blanc - (57) |
| bianc, bianche (adj.m. et f.) : blanc, blanche - (50) |
| bianc, tsavoniaud : chevenne - (43) |
| bianchi : blanchir - (48) |
| biande : grande blouse. - (66) |
| Biâne : le village voisin de Biarne dans le Jura - (46) |
| Biâné : un habitant de Biarne - (46) |
| Biane et Beane : Beaune. Le nom primitif était celui d'une divinité gallo-romaine : Belisana, ou mieux Belisama. Un clos de vigne, dans lequel on a trouvé des sépultures par incinération et divers objets d'antiquités, porte encore le nom de Bélisant. Au Moyen-âge on a dit Belna. - (13) |
| biâne, à biâne ; porter quelqu'un sur le dos. - (38) |
| bianmé, vt. blâmer. - (17) |
| biarle n.m. Barre de bois ronde servant à faire rouler les tonneaux pour les nettoyer ou pour les déplacer. - (63) |
| bias-frée. s. m. Beau-frère. (Domecy-sur-le-Vault). - (10) |
| biau - brâve : beau - (57) |
| biau (adj.) : beau - (50) |
| biau : beau - (48) |
| biau : beau, bien habillé. - (52) |
| biau : beau, joli - (51) |
| biau : beau, bien habillé, joli physique. Le dimanche on o biau : Le dimanche on est beau. - (33) |
| biau adj. Beau. - (63) |
| biau temps : beau temps. Par extension : longtemps - (51) |
| biau : beau - (39) |
| biau, ale, adj., beau, bien mis. - (14) |
| biau, biaute. adj. - Beau, belle. - (42) |
| biau, biaute. adj. Beau, Belle. Ail’ est propre, all’ est biaute , ta poupée ! - (10) |
| biau, biéle, adj. beau, belle. - (08) |
| biau, brave : beau - (43) |
| biau: (adj) beau - (35) |
| biau-bal (fem. balle) : Beau. Au féminin : balle (voir ce mot) « V'la in biau garçan » : voilà un beau garçon. « Le temps est biau ». - Paré, bien mis, « O s'est fait biau pa aller à la fête». Vieux français biau. « In bal homme » un bel homme. - (19) |
| biaude (n. f.) : blouse de paysan - (64) |
| biaude (n.f.) : blouse de foire - (50) |
| biaude (na) : robe - (57) |
| biaude (nom féminin) : blouse noire des paysans morvandiaux encore portée les jours de foire par les marchands de bestiaux. - (47) |
| biaude : (nf) robe ; blouse - (35) |
| biaude : blouse - (61) |
| biaude : blouse (bleue) - (48) |
| biaude : blouse. Blouse de maquignon, gaban…et plus généralement des vêtements très communs. - (62) |
| biaude : habit. - (59) |
| biaude : robe des femmes - (43) |
| biaude ou blaude : blouse froncée, marine portée dans le Morvan au début du siècle et tenue traditionnelle des maquignons que certains portent encore maintenant. - (33) |
| biaude : (blô:d’, biô:d’ - subst. f.) "biaude" blouse courte que portaient les paysans. Le mot s'est aussi employé pour les blouses de femme en matière synthétique. - (45) |
| biaude : blouse - (39) |
| biaude : blouse ample de couleur bleue, à manches, que l'on enfile par la tête et qui s'arrête à hauteur du genou. Ex : "L'pée Desriaux, quand il a marié la Lucie, il a mis sa biaude neue". - (58) |
| biaude : n. f. Blouse. - (53) |
| biaude*, s. f. blouse. - (22) |
| biaude, blouse. - (27) |
| biaude, n.f. blouse. La biaude est la blouse portée par les paysans qui se rendaient à la foire. Aujourd’hui, c'est le vêtement traditionnel des maquignons et des éleveurs ; le terme est également utilisé par dérision pour désigner un vêtement trop long ou trop ample. - (65) |
| biaûde, s. f., grande blouse de sortie, plissée. - (40) |
| biaude, sf. blaude, blouse. - (17) |
| biaude, subst. féminin : grande blouse bleue ou noire. - (54) |
| biaude, vêtement analogue à la saie gauloise, qui n'a fait que changer de nom. En vieux français, bliaut, bléaut, justaucorps. (Lac.) En latin barbare, bladum signifie blé. - La blaude est le costume universel de nos paysans, et son nom ne viendrait-il pas de bladum ? - (02) |
| biaude. Souquenille. L’ancien mot était bliaut, qu’on écrivait ordinairement bliaus, quelquefois bleaut, en latin blialdus, bliaudus, blisaudus, et même blidalis. Le bliaud n'était pas toujours une longue veste de grosse toile , il était plus court ; on le mettait sur ta chemise, et le manteau dessus. Il y en avait de chanvre, de futaine, de soie, de satin, d'étoffe riche et ornée, plus ou moins suivant la condition… - (01) |
| biaudes : habits - (44) |
| biaudes, s. f. pl. habits en général (du vieux français bliaud). - (24) |
| biaudes. Beaux habits ; habits du dimanche. S'emploie surtout au pluriel. - (49) |
| biau-frée. n. m. - Beau-frère. - (42) |
| biaugairçon, s. m. beau fils. Cette femme n'a pas d'enfants, elle n'a qu'un « biaugairçon. » - (08) |
| biauté : Beauté. « Alle est bin fière de sa biauté ! » - Proverbe : « An ne mije (mange) pas la biauté à la cullie (cuillère) » : la beauté ne suffit pas pour assurer le bonheur du ménage. - (19) |
| biaute : une betterave - (46) |
| biauté, s. f. beauté. - (08) |
| biauté, s. f., beauté, bel arrangement. - (14) |
| biaux : Atours, parure. « Alle a mis ses biaux ». - (19) |
| biaux t’tons : (nmpl) (humoristique) trayons - (35) |
| biber (v. tr.) : gober (biber enne oeu (gober un œuf, en absorber le contenu en l'aspirant à travers un trou pratiqué dans la coquille)) - (64) |
| biber : gober un oeuf - (60) |
| biber. Avaler un œuf non cuit, à même la coquille ; aspirer, boire. Le mot français est : ébiber. - (49) |
| biber. v. - Gober, synonyme de blotter : « Eh pa' te veux-ti biber eune oeu' d'passe ! » - (42) |
| bibi ! bibi ! : appel des brebis - (39) |
| bibi ! : - (39) |
| bîbi : diminutif enfantin pour dinde. IV, p. 62 - (23) |
| bibi : oison, mot utilisé pour les appeler - (48) |
| bibi, n.m. oison. - (65) |
| bibi, subst. masculin : oison. - (54) |
| bibi. Oison. Fig. Moi. (Argot). On dit : « y est bibi » pour c'est moi. - (49) |
| bibine : s. f., boisson de qualité très inférieure ou fortement étendue d'eau. - (20) |
| bibloquet, s. m., bilboquet. - (14) |
| bica : bélier. (LCSS. T IV) - S&L - (25) |
| bica, chevreau. v. belot. - (05) |
| bicagnon, bicron, bicnon. n. m. - Petit goulot, petit bec verseur sur un récipient : « Et le jus s'écoulait par le bicagnon de l'auge et emplissait la cuve. » (Fernand Clas, p.9) - (42) |
| bicane, bigane. s. f. Vieille bique ; mauvais cheval, rosse. - (10) |
| bicaner. v. n. Bancaler, marcher de travers, à la manière des canes. - (10) |
| bicanitier. n. m. - Truc, machin, bidule : « Passe moué don' l'bicanitier qu'est à ton couté ! » (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| bicarne, s. f. chassie, humeur séchée des yeux. - (24) |
| bicarner : vb regarder sournoisement - (35) |
| bicarner : v. n., être de travers. Une rue, un mur, qui bicarnent. - (20) |
| bicarner, lucarner v. 1. Loucher. 2. Jouer à cache-cache avec les nuages, en parlant du soleil. 3. Etre de travers en parlant d'une construction ou d'un habit. - (63) |
| bichabe (adj.) : qui se laisse embrasser (t'es pas bichabe (tu es de mauvais humeur, tu n'es pas aimable)) - (64) |
| bichade. n. f. - Embrassade. - (42) |
| bichai : embrasser. Ol é biché la gamine : Il a embrassé la fille. - (33) |
| bichè : adj. et n. Content, être ravi. - (53) |
| bichecone (aller à). - C'est-à-dire aller à califourchon. (Del.) - (06) |
| biche-cone, califourchon. - (02) |
| bicher (v. tr.) : embrasser - (64) |
| bicher (verbe) : embrasser. - (47) |
| bicher : embrasser - (37) |
| bicher : embrasser - (44) |
| bicher : embrasser - (60) |
| bicher : embrasser - (61) |
| bicher : embrasser - (48) |
| bicher : embrasser. - (52) |
| bicher : Mordre à l’hameçon. À la pêche, quand ça mord : ça « biche ». - (62) |
| bicher : embrasser - (39) |
| bicher : embrasser, hors toute arrière-pensée. Ex : "Vins don là que j'te biche !". - (58) |
| bicher, biner, biquer. v. a. Embrasser, donner un baiser. Biche- moi. Viens que j’te bique. - (10) |
| bicher, biner. v. - Embrasser : « Te vas ben m’bicher avant d’parti’ ! » - (42) |
| bicher, biser. Embrasser, donner un baiser. « Biser » vient du vieux français : bise. - (49) |
| bicher, bitser, bicler v. (de l'anc. fr. biscler). Loucher. Voir beurnicler. - (63) |
| bicher, embrasser - (36) |
| bicher, v. a. baiser, embrasser, caresser. - (08) |
| bichet : contenait de 20 à 40 litres. - (55) |
| bichet : s. m., ancienne mesure de capacité pour les grains. - (20) |
| bichet, ancienne mesure de grain. - (05) |
| bichet, s. m. mesure qui contient soixante litres. - (08) |
| bichet, s. m., mesure de grains, d'environ un double décalitre (20 litres), mais variable. - (14) |
| bichet. Ce mot, dans la Haute-Marne, signifie une petite mesure de graines sèches. Dans l'idiome breton, bychan répond au latin paucitas, petite quantité de ... - (02) |
| bichetêe, bicherée, bichonnée : s. f., ancienne mesure de surface pour les terres, correspondant à ce que l'on peut ensemencer avec un bichet de grains, et valant (du moins dans le ChafoUais et le Brionnais) 45 ares 584. - (20) |
| bichette. Baiser, embrassade. - (49) |
| bichllia, s. m. qui louche. Verbe bichllier. - (24) |
| bichllia, s. m. qui louche. Verbe bicxlliàyé. - (22) |
| bichon : tampon, houpette. - (30) |
| bichon : s. m., bichet. - (20) |
| bichon, bichette. Mots répétés avec accompagnement de musique, pour inviter cavaliers et cavalières à s'embrasser entre deux danses. - (49) |
| bichot : Bichet. Ancienne mesure de capacité. « In bichot de blié » (blé). Le bichet valait 2 sacs, le sac 10 coupes, la coupe 15 litres. Le bichot valait donc 300 litres. Le bichot contenant environ la quantité de blé nécessaire à la nourriture d'une personne pendant une année on disait, au lieu d'un bichet de blé, une année de blé. - (19) |
| bichouée (n. f.) : se dit d'une noix qui n'est qu’à moitié pleine – autrefois dans les veillées où l'on échalait les calons, celui qui trouvait une bichouée devait embrasser sa voisine - (64) |
| bichouée. n. f. - Joue : « Te vas t’prende une tape su’ la bichouée ! » (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| biclailler, biclayer : v. n., fréquentatif de bicler, regarder partout. - (20) |
| biclailloux, adj., fréq. de bicloux. - (20) |
| bicler : pincer, prendre, chiper - (60) |
| bicler : v. n., bigler, loucher. - (20) |
| biclou n.m. Vélo. - (63) |
| bicloute, sf. bique. - (17) |
| bicloux, biclouse et biclette : adj., loucheur, loucheuse. - (20) |
| bicloux, -ouse n. et adj. Qui louche. - (63) |
| bicnon (n. m.) : tout événement de petite dimension ayant une fonction mécanique ou décorative sur un ustensile, un appareil, ... - (64) |
| bicorne : s. f., bigorne, bigot, pioche à deux cornes ou branches parallèles. - (20) |
| bicot (nom masculin) : chevreau. - (47) |
| bicot : chevreau - (48) |
| bicot : Fromage de chèvre, sec. A noter que la chèvre est la bique… - (62) |
| bicot, bigou, bicou. n. m. - Chevreau. - (42) |
| bicot, biquot : n. m. Cabri. - (53) |
| bicot, cabri (de bique) - (38) |
| bicot, s. m., baiser, embrassement ; « Eh ! la p'tiote, fais-me ein bicot ». - (14) |
| bicot, subst. masculin : fromage de chèvre. - (54) |
| bicot. Fromage de chèvre. - (49) |
| bicou. s. m. Chevreau. — Bicou d' Avril, grésil. (Argenteuil.) - (10) |
| bicquailler : v. n., «becqueter » « boustifailler », Viens donc, j'ai acheté pour cinq sous de cassé : on va bien bicquailler. - (20) |
| bidai. Bidet, bidets. - (01) |
| bidamboche : s. f., salsifis des prés. - (20) |
| bidel, bidelle (de). loc. adv. - De travers : « T'as-ti vu l’échelle ? Alle est d’bidellel ! » - (42) |
| bider : v. n. vx fr., frotter. - (20) |
| bidet : Le numéro un au tirage au sort des conscrits. « Ol a amené le bidet ». - (19) |
| bidet, s. m., numéro un. Cette dénomination s'emploie dans les jeux à numéros, tels que le loto, etc. - (14) |
| bidette, s. f. petite jument de selle. - (08) |
| bidoche : viande - (44) |
| bidon : ventre, petit ventre - (48) |
| bidrouille. n. f. - Citrouille. (M. Jossier, p.l6) - (42) |
| bidrouille. s. f. Citrouille. (Puysaie.) - (10) |
| bié (du) : seigle - (57) |
| bie (n.f.) : bise, vent du nord-est (variante nivernaise bise) - (50) |
| bié (n.m.) : 1) bié nar sauvaize : sarrasin de Tartarie ; bié nar preuvé : sarrasin amélioré - 2) bief, petit fossé - (50) |
| bié : (adv) bien; beaucoup - (35) |
| bié : (nm) blé - (35) |
| bié : bien - (51) |
| bié : rigole (pour l'eau), bief - (48) |
| bié : seigle - (43) |
| bié : seigle (et non le blé). (C. T IV) - S&L - (25) |
| bié d’mar : (nm) blé de printemps - (35) |
| bié n.m. Propriété, capital, avoir. - (63) |
| bié nâ : (nm) sarrasin - (35) |
| bié na : sarrasin (botanique) - (51) |
| bié nar : sarrazin. VI, p. 4-8 - (23) |
| bié : (byé - subst. m.) canal de drainage, dans un pré très humide. Contrairement aux indications de Cl. Régnier, (c31), le type odeu est inconnu de tous les témoins. - (45) |
| bié : s. m. blé. - (21) |
| biè, bief, petit canal conduisant l'eau d'une rivière sur la roue d'un moulin. - (16) |
| bié, bin adj. et adv. Bien. J'ai effectivement (bin) beaucoup (bié) de sarrazin cette année. Beaucoup. Y'en a pyus bié. Il n'y en a plus beaucoup. - (63) |
| bié, blé. - (16) |
| bie, s. f. bise, vent du nord-est et de l'est. La « bie » est sur pied. - (08) |
| bié, s. m. bief, biez, petit fossé d'irrigation ou d'assainissement. - (08) |
| bié, s. m. blé, froment. - (08) |
| bié, s. m., blé. - (14) |
| bié. Blé. - (49) |
| bie. n. f. - Vent du nord, bise ; synonyme de abisoué. - (42) |
| bié. s. m. Blé. - (10) |
| bié’ nâr : sarrazin - (37) |
| biée : bief - (39) |
| biée. n. f. - Bière : « Veins don’ boué une biée. » - (42) |
| biélaize : action de faire les biefs - (39) |
| biélée, s. f. étendue de biez ou rigoles d'irrigation. - (08) |
| biéler : faire des rigoles dans un pré pour l'assainir. - (52) |
| biéler : faire des rigoles, des fossés - (48) |
| biéler : faire les biefs - (39) |
| biéler, v. a. creuser un biez, une rigole. Biéler les prés. On bièle au printemps et quelquefois à l'automne. - (08) |
| biélou, s. m. celui qui « bièle », qui creuse un biez, une rigole. - (08) |
| bien : adv. Etre bien, être bien de chez soi, être dans l'aisance. C'est des gens qui sont ben bien. Il a épousé une femme qu'est bien de chez elle, mais lui a non plus pas rien. - (20) |
| bier. s. m. Syncope de bélier. (Seignelay.) - (10) |
| biére (na) : bière - (57) |
| bièrles, s. m. pièces de bois rondes équipant un char pour le transport du vin. - (22) |
| bièrles, s. m. pièces de bois rondes équipant un char pour le transport du vin. - (24) |
| bierne, bierle : s. f., vx fr. bière, assemblage de deux madriers que, dans un char, on place sur les trèches pour transporter les gros matériaux. - (20) |
| biés (lâs) : (les) rigoles de dérivations d’eau dans les prés - (37) |
| biet : blé - (48) |
| biet, biot, bioche. Blet, trop mûr. Fém. « Biette, biote » ; « bioche » est des deux genres. - (49) |
| biétôt (dachtôt) : bientôt - (51) |
| bieû : bleu - (43) |
| bieû : bleu - (57) |
| bieû, bieûse, bleu, bleue. - (16) |
| bieu, euse, adj. bleu, bleue. - (08) |
| bieuche, adj. trop mûr, blet. - (24) |
| bieuson, sm. [blesson] fruit du poirier sauvage. - (17) |
| bieusse : blet - (57) |
| bieussenöt, sm. poirier sauvage. Qqf. pommier. - (17) |
| bieûssneil : le poirier qui donne les bieûssons (poires) - (46) |
| bieûsson : une poire destinée à faire une boisson - (46) |
| bieussons, fruits, poires surtout, qui blettissent vite. - (27) |
| bieute : betterave. - (66) |
| bieute : fruit trop mûr, blet - (43) |
| bieuyèche, s. f. mercuriale des champs. - (24) |
| bife, subst. féminin : gousse d'ail. - (54) |
| biffe, s. f., tranche de pain, largement frottée d'ail. - (40) |
| biffe. Caïeu ; on dit « une biffe d'ail ». - (49) |
| bigadou (à la). n. f. - Un jeu où l'on porte quelqu'un sur les épaules, on joue au cheval ; synonyme de cabadou. - (42) |
| bigageai - déranger quelqu'un de son occupation, ce qui l'a beaucoup contrarié. - Que ci m'é don bigageai, qu'a saint venu me chercher c't aifâre qui ! - (18) |
| bigain : crochet à fumier. (CLF. T II) - D - (25) |
| bigainne. s. m. Chevreau, qgneau de bique. - (10) |
| bigane. s. f. Petit escargot. Se dit sans doute pour bicorne ou bigorne. Il existe un coquillage bon à manger appelé bigorneau. - (10) |
| bigarroler. v. a. Barioler. - (10) |
| bigau, s. m. chevreau. Ne désigne que le mâle. - (08) |
| bige : vent très froid du nord-est. A - B - (41) |
| bige : Bise, vent du nord. « La bige est frade (froide) ». - Le nord : « Sa maison est en bige du chemin » : sa maison est située au nord du chemin. - Proverbe « Quand i pliô (pleut) de bige i mouille jeusqu 'à la chemige (chemise) ». - (19) |
| bige nère : vent très froid du nord-est avec brouillard. A - B - (41) |
| bîge : s. f. bise. - (21) |
| bige, bije (n.f.) : vent du nord-est ou de l'est - (50) |
| bige, s. f. bise, vent qui souffle de l'est. - (08) |
| bigeon : s. m., petite bigue, bâton, cheville. - (20) |
| bigeot : bovin légèrement roux. A - B - (41) |
| bigeot : bovin légèrement roux - (34) |
| bigeot : De couleur bise ou beige. Nom que l'on donne aux bœufs de cette couleur « le bigeot est pu feu (plus fort) que le fremoitin (fremoitin, autre nom du bœuf) ». - (19) |
| bigigi (n.m.) : rémouleur - (50) |
| bîgler : loucher, regarder - (48) |
| bigler. v. n. Loucher. - (10) |
| bigleux, biglou : celui qui a mauvaise vue, celui qui louche - (37) |
| bigleux. adj. Qui bigle, qui louche. - (10) |
| bîglou : personne qui louche - (48) |
| biglou : personne qui voit mal - (44) |
| bigne, bosse au front, beugne. - (04) |
| bigner : baigner - (48) |
| bigneut : Pâtisserie commune faite de pâte de froment cuite dans la graisse ou dans l'huile bouillante. Bigneut est employé dans le sens de friandises, chatteries, dans cet exemple qu'on cite aux gens qui sont trop portés sur leur bouche « Ma grand (grand-mère) ave ses bigneuts a to miji (mangé) san bataclan ». - (19) |
| bignon, s. m. eau qui jaillit du sol ; source avant sa sortie de terre, petite fondrière. - (08) |
| bignou. -.Prononcez biguenou. (Voir au mot beugne.) - (06) |
| bigo : engourdi - (46) |
| bigo, instrument de fer, à deux dents, … le fumier. - (16) |
| bigo. Fourche de fer, vient du latin biago, à deux pointes, ou de bicornis. - (03) |
| bigornais, s. m. amas, fouillis d'objets divers et principalement de rognures d'étoffe, de chiffons. - (08) |
| bigorne (nom masculin) : trépied utilisé pour travailler le bois. - (47) |
| bigorne, s. f. trépied sur lequel on travaille le bois et qui sert à divers autres usages. Une bigorne est une enclume à deux cornes comme le dit assez le mot formé de bis et de corne. - (08) |
| bigorne. Pioche ; houe à trois dents. - (49) |
| bigorner. Abîmer, détériorer ; rendre inutilisable. - (49) |
| bigornier (n. m.) : arbre servant à marquer la limite entre deux parcelles de bois - (64) |
| bigornotte. s. f. Petit escargot. - (10) |
| bigot - crochet à deux dents qui sert surtout à tirer le fumier de l'écurie, à le manier. - Aipote voué le bigot qui tirains le femé des vaiches. - (18) |
| bigot (adj) : gourd. Les doigts tout « bigots de froid » : engourdis. - (62) |
| bigot (n.m) : croc. Pioche-croc pour tirer la paille ou le fumier ; Du latin « bigornis » : à deux cornes - (62) |
| bigot (n.m.) : 1) chevreau (diminutif de bigue) - 2) croc à fumier (peut-être diminutif de bec à cause de la forme de l'outil) - (50) |
| bigot (nom masculin) : croc à fumier. - (47) |
| bigot : crochet à fumier - (48) |
| bigot : chevreau. La bigue neurrit son bigot : la chèvre nourrit son chevreau. - (33) |
| bigot : graisse fondue (mouton ou chèvre) dont les hommes s'enduisaient les mains pour éviter les gerçures en travaillant dehors l'hiver. - (33) |
| bigot : bouc - (39) |
| bigot : fourche. (CH. T II) - S&L - (25) |
| bigot : n. m. Croc à deux dents. - (53) |
| bigot, adj. engourdi par le froid. - (24) |
| bigot, adj., engourdi de froid : « Ah! man-man, j' peux pu t'ni l’boinon ; j'ai les dèts tout bigots ». - (14) |
| bigöt, bigot, sm. crochet à fumier ; sarcloir à chiendent. - (17) |
| bigot, engourdi par le froid. - (05) |
| bigöt, öte, adj. engourdi, paralysé par le froid. - (17) |
| bigot, outil de vigneron à deux dents. - (38) |
| bigot, s. m. fourche à deux ou trois pointes dont on se sert pour enlever les fumiers. - (08) |
| bigot, s. m., bigaut, fourche, instrument de fer à deux dents (bident), emmanché comme un râteau, pour enlever le trèfle en masses roulées. - (14) |
| bigôt, s. m., croc à fumier. - (40) |
| bigot, trident emmanché horizontal. - (05) |
| bigot. Instrument de culture, formé de deux dents en fer recourbé, qui sert à sortir le fumier de l’étable. Jusqu'en 1790, le clergé de Nuits a célébré la messe des bigotes en souvenir du massacre effectué, le 21 janvier 1576, par les reîtres allemands : on avait été obligé de tirer avec des bigots les cadavres des Nuitons carbonisés dans l'incendie d'une chapelle. (F. Neusille). - (13) |
| bigotes : désigne une race de vaches de petite taille. III, p. 27-i - (23) |
| bigotte : petit tas de blé noir (ou d'autres céréales) posé en forme de cône - (39) |
| bigotte, clef bigotte ; tige de fer recourbée qui sert à ouvrir un verrou de l'extérieur d'une porte de fenil, de grange, etc... - (38) |
| bigotte, mains bigottes : mains gourdes. - (38) |
| bigou (n. m.) : chevreau (syn. cabin, chiga) - (64) |
| bigounier : l'homme qui promène les bigues. Un gardien de troupeau. Ex : "Tin ! l'bigounier vint d'passer avec ses bigues. Euh ! Qu'y sent môvéé l'ourse !". - (58) |
| bigourdin. s. et adj. m. Maladroit, qui a les deux mains gourdes. De bis et gourd. - (10) |
| bigourdin. s. m. Très gros bâton, bâton double de la grosseur ordinaire. Des mots bis et gourdin. - (10) |
| bigouris. s. m. pl. Tout ce que mangent les enfants (baies, mûres sauvages, fruits sauvages, fruits verts, etc.), lorsqu’ils vagabondent par les champs. - (10) |
| bigue (aine) : (une) chèvre, (un) trépied pour trancher à la hache le bois « moyen » - (37) |
| bigue (grande) : jeune fille « montée en graine » - (37) |
| bigue (n. f.) : chèvre - (64) |
| bigue (n.f.) : chèvre - (50) |
| bigue : chèvre - (48) |
| bigue : chèvre. - (09) |
| bigue : chèvre. Désigne, comme chèvre en français, l'animal et l'outil du bûcheron, support où l'on pose les bûches à hauteur d'homme pour les scier. bigot : chevreau. - (52) |
| bigue : Etai, sorte de mât qui supporte les drapeaux, emblèmes ou oriflammes quand on pavoise dans les rues. - (19) |
| bigue : chèvre. Le fromage de bigue ç'o bon : le fromage de chèvre c'est bon. - (33) |
| bigue : outil façonné par le bûcheron, support à trois pattes pour mettre les perches à hauteur d'homme pour le façonnage du bois. - (33) |
| bigue écorchée (ai lai), loc. on met ses bas « à la bigue écorchée » lorsqu'on les retourne à l'envers pour les chausser plus aisément. - (08) |
| bigue : chèvre, morceau de bois à trois pieds utilisé par les bûcherons - (39) |
| bigue : chèvre, que l'on prononce : chieuve. Ex :"Si té veux un bon froumage de bigue té d'mande à la Mélie !" - (58) |
| bigue : s. f., vx fr., mât. perche. - (20) |
| bigue, s. f. bique, chèvre. Les petits sont appelées « biguets. » - (08) |
| bigue, s. f. mât. - (22) |
| bigue, s. f. mât. - (24) |
| bigue. Gourd, se dit exclusivement des doigts engourdis par le froid. Etym. bigot, mot très français qui désigne une pioche a deux becs recourbés (Littré) ou un instrument de cette forme avec lequel on manie le fumier. - (12) |
| bigue. n. f. - Bique, chèvre. - (42) |
| bigue. s. f. Bique, chèvre. — Bigue d’harnais, sorte de croisillons fixés au centre d’un bateau, en trois ou quatre places, d’un bout à l’autre, et qui sont destinés à supporter une longue traverse de sapin sur laquelle sont tendues les bâches servant a couvrir les marchandises. - (10) |
| biguebaie (ai lai), loc. porter quelqu'un « à la biguebaie », c'est prendre une personne sur le dos comme une hotte, ses jambes pendantes de chaque côté et ses mains entrelacées autour du cou. - (08) |
| biguenelle : grande fille un peu bête. - (09) |
| biguenou, ouse, adj. chassieux, à paupières rouges et pleurantes. - (17) |
| biguenou. Dans le Châtillonnais, avoir les yeux biguenoux, c'est avoir les yeux chassieux... - (02) |
| bigueriauche. s. f. Pie-grièche. (Chablis.) - (10) |
| bigues - se dit particulièrement des doigts qui sont saisis par le froid. - An ne fait vraiment pâ chau, lâvan à Roncey ; i ai les doigt tot bigues. - (18) |
| bigues (doigts), gourds, qui rendent maladroit. - (27) |
| biguette : voir chvau - (23) |
| bigueu : fourche à fumier, crochet pour arracher les pommes de terre par exemple. - (66) |
| bigueu : un crochet à 4 dents rondes pour tirer le fumier - (46) |
| bigueu, crochet à fumier. - (26) |
| bigueu, fourchet à dents recourbées pour tirer le fumier. - (27) |
| bigueûrne, enquieûme : enclume - (37) |
| bigueut : Bigot, personne d'une dévotion étroite et exagérée « Eune vieille bigueute ». - Engourdi : « J'ai les das bigueuts » : j'ai les doigts gourds. - Lambin, qui fait sa besogne avec lenteur : « dépôche te dan bigueut » : dépêche toi donc, lambin ! - (19) |
| bigueuter : Lambiner, « L'ovrage presse, i est pas le moment de bigueuter ». - (19) |
| bigueuterie : Bigoterie. « Alle est dans la bigueuterie » c'est une bigote. - Lenteur « Quèle bigueuterie ! » : quelle lenteur ! - (19) |
| biguot : adj., vx fr. bigot (s. m.), gourd, raidi comme bigue. J'ai les doigts biguots. - (20) |
| Bi'inche : Blanche (prénom) - (48) |
| bijâtre, adj. bizarre, extravagant, lunatique. - (08) |
| bije, bise n.f. Vent du Nord. - (63) |
| bijiji : acheteur de cuivre - (61) |
| bijiji. n. m. - Bricole, petite chose. - (42) |
| biké, baiser (enfantin). - (16) |
| bike, chèvre ; bikè, le petit de la chèvre. - (16) |
| bilaude : (nf) jeune chèvre - (35) |
| bilaude : jeune chèvre - (43) |
| bilaude n.f. Chèvre. - (63) |
| bilboquète, s. f., bibliothèque, ou simple rayon de livres. - (14) |
| biler (s') v. (fr. pop.) Se faire du souci : s'emploi surtout à la forme négative. Çhtu-là, ô s'bile pas ! - (63) |
| biler (se) : v. r., se faire de la bile. Ah ! je n’ veux pas m' biler pour si peu. - (20) |
| bilet, -ette n.m. Cabri. - (63) |
| bileux : adj.. qui est bilieux, qui se fait de la bile. - (20) |
| bileux, -euse n. et adj. Qui se fait du souci. Voir tracassin. - (63) |
| bili, agneau - (36) |
| biline, subst. féminin : jeune chèvre. - (54) |
| billa. Petit cochon. - (03) |
| billadai, boiter.- En roman français, bille est un bâton ; billader, c’est s'appuyer, comme les boiteux, sur un bâton... - (02) |
| billadai. - Boiter. - Billar, c'est-à-dire qui s'appuie sur une bille (du bas. latin billus, bâton). - (06) |
| billader : boiter. (G. T II) - D - (25) |
| billar. Boiteux. Le bâton appelé billard, avec lequel on pousse les billes dans les blouses, étant recourbé, je ne doute point que ce ne soit de là qu’on a dit à Dijon billard dans la signification de boiteux. Il semble même qu’on appelait autrefois billard tout bâton recourbé parle bas… - (01) |
| billard. s. m . Bâton recourbé ; homme qui s’appuie dessus pour marcher. - (10) |
| billarde. s. f. Sérénade, aubade donnée à un jeune marié étranger à la commune ; droit prélevé sur lui par les garçons de cette commune. (Percey.) — Cet usage se pratique dans plusieurs localités sous diverses dénominations. - (10) |
| billat : s. m. petit tronçon de sarment laissé sur le cep lorsqu'on taille. - (21) |
| bille, s. f. bile, humeur sécrétée par le foie. - (08) |
| bille, s. f. pièce de fer portative servant à serrer le tour d'une voiture. - (22) |
| bille, s. f. pièce de fer portative servant à serrer le tour d'une voiture. - (24) |
| billeman. Substantif du verbe biller, attacher, lier. - (01) |
| biller : (vb) serrer un nœud (avec un « beuil » ; voir plus haut) - (35) |
| biller : serrer (un nœud) - (43) |
| biller : serrer avec un treuil. (VDS. T IV) - VdS - (25) |
| biller. v. - Tourner, faire rouler : « On va faie biller l’tronc du grous chêne. » - (42) |
| biller. v. a . Tourner. Biller un morceau de bois. - (10) |
| billet, billot : s. m., fragment de branche d'arbre ou de vigne portant deux ou Irois bourgeons et que, au moment de la taille, on réserve pour la végétation de l »année. Voir Littré, chargeon. - (20) |
| billette : voir chvau - (23) |
| billette. n. f. - Champignon, russule rouge. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| billeut : Terme de viticulture, courson. « Le ban billeut » : le courson qui donnera du fruit. - (19) |
| billi v. Biller, serrer avec une bille (bobine) Bille don l'beuil. Serre donc la barre. - (63) |
| billier : v. n., vx fr., s'en aller, s'enfuir. - (20) |
| billon (pour billot). s. m. Rondin de bois suspendu au cou d’une vache pour l’empêcher de courir. - (10) |
| billon : (nm) botte de paille « billée » - (35) |
| billon : petit de l'oie. (P. T IV) - Y - (25) |
| billon n.m. (du gaul. bilia, tronc d'arbre). Groupe de 12 ou 13 raies (sillons) de labour. - (63) |
| billon, biron, bison. n. m. - Petite oie. - (42) |
| billon, s. m. dans quelques localités on donne ce nom à un arbre de forme élancée propre à la charpente ou à la menuiserie. - (08) |
| billon. n. m. - Rondin suspendu au coup d'une vache pour l'empêcher de courir. Se dit billot à (Sougères-en-Puisaye). - (42) |
| billon. s. m. Oisillon. (Sainpuits.) - (10) |
| billotouére, s. f. épinette, cage où l'on enferme les poulets pour les faire engraisser. - (08) |
| billotte. n. f. - Jaune d'œuf - (42) |
| billout. s. m . Sorte de panier qui s’accroche de chaque côté du bât d’un âne et dans lequel sont mises les provisions ou marchandises que l’on porte au marché. - (10) |
| bilô, s. m., jeune veau non sevré. - (40) |
| bilo. Petit veau. - (03) |
| bilot : Jeune veau. - (62) |
| bilot, billot. n. m. - Argent des paris déposé par les joueurs. (Villiers-Saint-Benoît, selon M. Jossier) - (42) |
| bilot, billot. s. m. Argent déposé par les joueurs pour leur enjeu. (Villiers-Saint-Benoît.) Vient probablement de biller, jouer, s’amuser. - (10) |
| bilot, petit veau. - (05) |
| bilot, s. m,, veau tout jeune. - (14) |
| bilou : Qui se fait de la bile, du souci « O n'est pas bilou ». - (19) |
| bimbrelatte, s.f. cloche de carillon. - (38) |
| bin : (forme d'insistance) « y é bin vrai! » - (35) |
| bin : bien - (48) |
| bin : bien, èl èm bin lé queusses de grebeusses, il aime bien les cuisses de grenouilles - (46) |
| bin ou bien : Bien. « Je veux bin » : je veux bien. « Ol est bin vieux » : il est bien vieux. « Y est bin prou mô » : c'est bien assez mouillé. - On emploie aussi « bien » « Y est bien mô » c'est bien mouillé. Dans le sens de « beaucoup », on emploie de préférence « bien » ; « Y avait bien du mande à la foire ». « Y a bien pliu, y serait bin prou » : il a beaucoup plu, ce serait bien assez. - (19) |
| bin : adj. inv. Bien. - (53) |
| bin : bien - (39) |
| bîn, adv., bien. - (40) |
| bin, bié adj. et adv. Bien. - (63) |
| binaile. s. f . Cigale. De bis et ala . — Se dit, au figuré, d’une femme, d’une jeune fille d’allures trop libres et trop hardies. Vois donc ç’tte grande binaile ! (Auxerre). - (10) |
| bin-brâment : exp. Très bien, parfait. - (53) |
| binchan : Petite binche. - (19) |
| binche : s. f. planches disposées de chaque côté de la voiture. - (21) |
| binches (nom féminin) : Ridelles de char en planches. Planche de char formant caisse. Elles sont au nombre de trois, l'une formant le fond, les deux autres formant les côtés et maintenues inclinées par les frainchis. - (19) |
| binchot : réhausse de ridelle de chariot, permet de bancher pour contenir davantage (la banche étant un panneau de coffrage en maçonnerie). « Y’en avo pour d’sus les binchots » : il y en avait par dessus les rehausses… (une belle récolte…surement). - (62) |
| bine, bene : s. f., cigale. - (20) |
| biner : labourer en profondeur. III, p. 28-n - (23) |
| biner : v. n., donner la deuxième façon a un champ ou à une vigne. Voir semarder et tiercer. - (20) |
| binet : s. m., vx fr., binage, action de bine r: vigne ou champ qui a reçu la deuxième façon. - (20) |
| binet. Bougeoir. Binet, dans son sens très correct désigne exclusivement un morceau de métal arme d'une pointe au milieu que l’on met dans le trou d'un bougeoir, pour pouvoir bruler les restes de bougie jusqu'au bout. Ici, nous appelons le tout du nom de la partie. Faire binet veut dire user toute la chandelle ; l'expression s'emploie m6me au figuré. - (12) |
| binettes. Les lieux d'aisances. Origine inconnue, altération possible et locale de tinette. - (12) |
| bineux : (bineur) aussi dans le sens de petit métier gagnant peu. Ex : "Mon garçon, j'vouré pas en fée un bineux d'blettes". - (58) |
| bineux. n. m. - Celui qui travaille la terre avec la binette. - (42) |
| bingneu : baigner. - (29) |
| binteut : Bientôt. « I sera binteut né » il sera bientôt nuit. - (19) |
| bintô : bientôt - (46) |
| bintô : bientôt - (48) |
| bin-tolé : adj. Bien abîmé. - (53) |
| bintôt (adv.) : bientôt (aussi baitôt) - (50) |
| bintôt : adv. Bientôt. - (53) |
| binveni (adj.) : bienvenu (adj. fém. : binvenie) - (50) |
| biô : beau - (48) |
| biochir, verbe intransitif : blettir. - (54) |
| bion : jeune pousse - (60) |
| bion, s. m. jeune pousse d'arbre ou d'arbuste et en général de toute espèce de végétaux - (08) |
| bion. n. m. - Bourgeon terminal ou cime d'un arbre. Autre sens : bourgeon, sur la pomme de terre. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| bion. s. m. Scion, tige, œilleton. Des bions d’artichaut. - (10) |
| biond, onde, adj. blond, onde. - (17) |
| bionde, blonde, et, par extension, maitresse... - (02) |
| biondi, vt. emonder, débarrasser une branche de ses brindilles - (17) |
| bionner, biouner. v. n. Rogner, couper les pousses de la vigne à la seconde sève. (Laduz). De bion, tige, pousse, œilleton. - (10) |
| biöque, biöquöte, sf. boucle. - (17) |
| bioquer (fâre) : enfoncer la tête de quelqu'un sous l’eau, alors qu’il boit à même le niveau du seau plein - (37) |
| bioquer (v.t.) (de bec) : se dit des poussins lorsqu'ils percent la coquille de l'oeuf pour sortir - (50) |
| bios, biosse : blet, blette - (48) |
| biosse : fruit trop mûr, blet. A - B - (41) |
| biosse (adj.f.) : blette - (adj.m. biot : blet) - (50) |
| biosse : fruit trop mur, blette - (34) |
| biosse : fruit trop mure - (44) |
| biosse : blette, se dit d'un fruit (au masculin : biot). - (33) |
| biosse. adj. f. Blosse, une poire biosse ; par conversion du bl en bi. - (10) |
| biosser. v. a. Blesser. Se prononce ainsi à Vassy-sous-Pisy. - (10) |
| biosson (n.m.) : petite pomme sauvage (aussi blosson) - (50) |
| biosson : blosson , pomme sauvage - (48) |
| biosson : petite poire sauvage. - (33) |
| biossonner(n.m.) : pommier sauvage - (50) |
| biossounier : poirier sauvage. - (33) |
| biot (biotte) : blet. - (56) |
| biot : blet. Les biossons sont bens biots : les petites poires sauvages sont bien blettes. - (33) |
| biöt, adj. blet. - (17) |
| biot, adjectif qualificatif : blet. - (54) |
| biot, bioç’e : blet, blette, peu intelligent - (37) |
| biot, biotte: blet, blette. - (52) |
| bioton. s. f. Petite bouteille à huile, en terre cuite ou en grès. - (10) |
| biotte (pour billotte). s. f. Jaune d’œuf. - (10) |
| biotte : betterave - (37) |
| biotte : betterave - (48) |
| biotte : betterave. - (52) |
| biotte : betterave. - (66) |
| biotte : betterave. (MM. T IV) - A - (25) |
| biotte : betterave. Les biottes servin è la nourriture des animaux : les betteraves servaient à la nourriture des animaux. - (33) |
| biotte : n. f. Betterave. - (53) |
| biotte, betterave - (36) |
| biotte, subst. féminin : betterave. - (54) |
| biotte. s. f. Bouteille à huile, en terre ou grès. - (10) |
| biotte. s. f. Poirée. (Argenteuil). - (10) |
| biou (on) : bouleau - (57) |
| biou. s. m. Drap de grosse toile sur lequel sont étendues les cendres d’une lessive, dans le cuvier ; ce qu’on appelle plus communément charroi, charrier, charroué. (Rugny). - (10) |
| biouque, blouque. s. f . Boucle. - (10) |
| bioux : grande pièce de toile ou même drap de lit usagé que l'on disposait au fond du cuveau à lessive, après y avoir disposé au préalable des sarments de vigne pour l'isoler du fond et favoriser l'écoulement du laissu. On y mettait les cendres de bois exclusivement. Elles servaient à cette époque de produit blanchissant. (R. T IV) - Y - (25) |
| biquai – baiser ; se dit ordinairement pour les enfants. - Bique-mouai, mon petiot chéri, et pu i te beillerai ine draigie. - T'é tojeur ai biquai tai petiote, te l'eume don bein ! – On dit quelquefois par minauderie : boquai, boque tai mémére, te seré bien gentil. - (18) |
| biquaisier. s. m. Marchand de chevreaux. - (10) |
| biquatte, biquette. s. f. Sauterelle. - (10) |
| bique - chèvre. - Mouai, i n'eume pâ le fremaige de bique. - T'é ine bique, vais ! te ne comprends jâre ran ! - (18) |
| bique (bik’ - subst. f.) 1- chèvre - 2- billot à trois pieds, sur lequel on débite du petit bois à la serpe. - (45) |
| bique (f), trépied sur lequel on coupe le bois. - (26) |
| bique (nom féminin) : chèvre. - (47) |
| bique (une) : une chèvre - (61) |
| bique : chèvre (outil de levage utilisé en particulier pour enlever les roues de chariot) - (48) |
| bique : chèvre - (48) |
| bique : mot désignant un levier servant à lever un chariot pour graisser l'axe de la roue - (46) |
| bique : support à 3 pattes, en bois, pour tailler des perches, du fagot - (48) |
| bique : voir chvau - (23) |
| bique n.f. Chèvre. - (63) |
| bique : 1 n. f. Chèvre.- 2 n. m. ou n. f. Ruminant à corne. - (53) |
| bique, adj. désobligeant qui s'adresse généralement à une fille ou à une femme pour dire qu'elle est simple, niaise : « Oh ! la Nan-nette, y et eùne grande bique ! » - (14) |
| bique, chèvre. - (27) |
| bique, s. f., chêvre : « ain-mes-tu l’froumag' de biquet » Un proverbe narquois dit : « J't'en ponds, du beûre de bique». - (14) |
| bique, s. f., chèvre. - (40) |
| bique, sf. sellette. - (17) |
| bique. Nom familier de la chèvre, usité dans toute la France, mais que nous employons, en Bourgogne, au figuré, pour désigner une femme un peu niaise, étourdie, maladroite. - (12) |
| bique. s. f. Chèvre. — Porter à la bique écorchée, jeu qui consiste à porter quelqu’un sur son dos en lui mettant la tête en bas et lui tenant les jarrets sur ses épaules. (Mont-Saint-Sulpice). = Pièce de bois montée sur trois pieds, qui sert de support aux voitures lorsqu’on veut leur donner une position horizontale. - (10) |
| bique. s. f. Moyette, petite meule faite dans les champs pour garantir le blé de la pluie. (Turny). - (10) |
| bique. : Je t'en pond du beurre de bique, bizarre locution répondant à celle-ci: « Va-t'en voir s'ils viennent. » - (06) |
| biqueler : loucher - (39) |
| biquelou : personne qui louche - (39) |
| biquené (nom masculin) : bahut. - (47) |
| biquené, s. m. huche, bahut. - (08) |
| biquenon, biqueron. s. m. Petit bec. Le biqueron d’une cruche, d’un pot à eau, etc. Cette cruche a le biqueron cassé. - (10) |
| biquer : Baiser, embrasser, caresser. « To le lang du beû j'ai biqué Na-nette » : tout le long du bois j'ai embrassé Jeannette (vieux refrain). - (19) |
| biquer : baiser. Aux différents sens du terme. Vient certainement de bic / bec pour bouche, radical celte. - (62) |
| biquer, exercer la copulation. - (05) |
| biquer, v. a. baiser, embrasser, caresser. - (08) |
| biquer, v. forniquer. - (38) |
| biquer, v. tr., baiser, embrasser : « Ces amoureux, ô n' font qu' se biquer ! » - (14) |
| biquer, v., faire l'amour. - (40) |
| biquer. Baiser, et in erotico sensu comme en français. - (03) |
| biquer. Embrasser, se dit aussi dans le Morvan. On dit quelquefois boquer. Le radical, probablement celtique, est bec, qui a formé le bocca des Italiens. - (13) |
| biqueron : bec d'une écuelle, d'un pot - (60) |
| biquet, biquette. Le chevreau, la chevrette. Sens local, au figuré, de petit sot, petite sotte ; diminutif un peu câlin de petit beta, petit maladroit. - (12) |
| biquet, s. m., chevreau. - (14) |
| biquetier, bitier. n. m. - Gardien d'un troupeau de biques, de chèvres. - (42) |
| biquette, s. f., petite chèvre. - (14) |
| biquier (v.) : regarder de ôté - (50) |
| bîquier : loucher - (48) |
| bîquier : (bî:kyé - v. intr.) loucher. - (45) |
| biquier, biquesuer, bitchier, bicaisier. n. m. - Commerçant qui passait autrefois dans les fermes, pour acheter les chèvres, les poules, les lapins ou les œufs. - (42) |
| biquièr, biquièrde : (bî:kyêr, bî:kyêrd’ – adj.) qui louche, atteint(e) de strabisme. - (45) |
| biquier, v. a. bigler, guigner, regarder de côté, du coin de l'œil, à la manière des chèvres ou biques. - (08) |
| biquier. s. f . Coquetier. - (10) |
| biquiet, adj. celui qui regarde du coin de l'œil ; au féminin « biquierde. » - (08) |
| biquignon (n.m.) : bec verseur d'une cafetière, d'un pot - (50) |
| biquignon : excroissance anormale - (37) |
| biquignon, s. m. l'extrémité d'une chose, la pointe, le faîte, le sommet. « le fin biquignon » = la fine pointe d'un toit, d'un clocher, d'une montagne, etc… - (08) |
| biquignon. s. m. Cîme, sommet. (Athie). - (10) |
| biquot : n. m. Chevreau. - (53) |
| biquot, biquout, biquet, s. m., fromage de chèvre. - (20) |
| biquot, s. m. chevreau, petit de la chèvre. Se dit d'un enfant qui a de la naïveté et même de la niaiserie - (08) |
| biquotière : s. f., femme qui apporte au marché les fromages de chèvre. - (20) |
| bire : (nf) bière - (35) |
| biré, s, m., cuvier pour faire la lessive. - (14) |
| birer. v. a. Embrasser. (Germignyi. — Suivant Jaubert, ce mot voudrait dire boiter. - (10) |
| birette. n. f. - Revenante : « C’t’apparition j’crais qu’c’est Pauline qu'est en birette sous sa houp’lande ; a douet v'ni vouer si on arcande. » (G. Chaînet, En chicotant les braisons, p.5l) - (42) |
| biri, cuvier à lessive. - (05) |
| birjon, sm. grognard, grincheux. - (17) |
| biröle, sf. ventre. Ventrée (d'une chèvre notamment). - (17) |
| biron (n. m.) : oison - (64) |
| biron : ouillon. (DC. T IV) - Y - (25) |
| bironnète, sf. girouette. - (17) |
| birouöte, sf. brouette. - (17) |
| birri (on) : baquet (très grand) - (57) |
| bis (bi) de raisin : s. m., bouquet de raisins ; branche de vigne portant plusieurs grappes, qu'on peut offrir comme un bouquet de fleurs et conserver suspendue au plafond. - (20) |
| bis : dérivation de rivière pour l'alimentation en eau des moulins - (51) |
| bisaiguë, s. f. besaiguë, outil de charpentier muni d'un taillant à chacun des deux bouts. - (08) |
| bisboche (En). adv. Bout-ci, Bout-là. - (10) |
| biscaïen. n. m. - Grosse bille. - (42) |
| biscancome (Porter à la). Porter un enfant à cheval sur son dos. L'enfant passe ses bras autour de votre cou, et vous tenez ses jambes sous vos bras. Etym. absolument introuvable. - (12) |
| biscancôrne (à la) ; porter quelqu'un ou quelque chose sur ses épaules. - (38) |
| biscancorne (à la), à califourchon. - (28) |
| biscancorne (à la), loc, à califourchon : « Oh! mon grand, porte-me à la biscancorne ? » - (14) |
| biscancorne (à la), locut. adv., porter sur le dos un enfant dont les bras enlacent le cou, et les jambes la ceinture du porteur. Ex. : porter à la biscancorne. - (11) |
| biscancòrne (Chal., Br.), biscancarre (C.-d., Morv.).- Ce mot, qui, dans le Morvan, s'applique à des personnes contrefaites, ne s'emploie dans la Bresse et le Chalonnais que pour signifier à califourchon (porter à la biscancorne). Pour l'étymologie, voir plus loin le mot cancoirne. - (15) |
| biscancorne (Portai ai lai) - porter un enfant à cheval sur le dos, à califourchon. - Daudi, pote ton petiot frère ai lai biscancorne ce qui l'aibuye to plain. - (18) |
| biscancorne (porter à la) : porter sur le dos (un enfant). - (31) |
| biscanquarre, adj. contrefait, tordu, de travers : un champ, un arbre, un toit « biscanquarre. » - (08) |
| biscareau, s, m., bissac, besace. - (14) |
| biscarlot. s. m. Rosse, double rosse, vieux cheval usé. De bis, deux fois, et carlot, cheval vieux et maigre. - (10) |
| biscayen : boulet de jeu de billes, aussi caye, et queune ; « Biscaye » était la balle du mousquet. - (62) |
| biscoin, adj., mou, lent. - (14) |
| biscornu : pas droit - (44) |
| biscouiner, v. intr., flâner, faire traîner sa besogne, passer sur un ouvrage plus de temps qu'il n'en faut. - (14) |
| bise (de) : nord. Orientation…et bien sur le vent du nord : la bise. - (62) |
| bise : vache rousse - (43) |
| bise : vent du nord - (34) |
| bise : vent du nord-est. III, p. 24-d - (23) |
| bise nère, Morvan : vent du nord-ouest - (43) |
| bise noire : s. f., vent du nord avec ciel couvert et pluie. Voir vent blanc. - (20) |
| bise : n. f. Vitesse. - (53) |
| bise : s. f., baiser. Fais-moi bise. - (20) |
| bise : s. f., nord. Quand i pleut d' bise, ça mouille jusqu'à, la chemise. Greffier de bise, greffier de la justice de paix du canton nord de Mâcon. - (20) |
| bise, bije n.f. Vent du Nord. - (63) |
| bise, s. f., vent du nord. - (40) |
| bise. s. f., vent du Nord. Acception absolue. La bise souffle parfois pendant des semaines avec une violence extrême. - (14) |
| biséca : bêche. - (21) |
| bisencorne (à la) : califourchon (à). - (62) |
| biser : v. a., embrasser. Bis' me donc. - (20) |
| biser, v. embrasser. - (38) |
| biser, v. tr. , embrasser. N'a rien de commun avec les violences de la bise. - (14) |
| bisette, s. f., dim, de bise (baiser). - (20) |
| bisette. s. f. Oie femelle. - (10) |
| bisiot : bovin légèrement roux - (43) |
| bisiot : morceau de bois taillé en biseau - (43) |
| biskè, avoir du dépit. - (16) |
| biskencorne. À califourchon sur les épaules. On dit aussi « à la chèvrecorne ». - (49) |
| bison, s. m. Oison, petite oie. - (10) |
| bisonnier. s. m. Gardeur d’oisons, de bisons. - (10) |
| bisou, s. m., qui aime à embrasser. - (14) |
| bisoux (-ouse) : adj., embrasseur. - (20) |
| bisquancorne. (Tenir un enfant à la) : c'est le porter sur son dos en lui tenant les jambes avec ses deux bras, les bras de l'enfant entourant le cou du porteur. Les Morvandeaux ont l'adjectif biscanquarre et le français a biscornu. - (13) |
| bisqué, éprouver de la vexation. - En Bretagne, goasqua (Rost.) ou gwaska signifie vexer. (Le Gon.) La seule différence, c'est que dans notre idiome bourguignon le mot bisqué a un sens neutre. - (02) |
| bisquencone (porter à la). Porter à califourchon. - (03) |
| bisquencorne (à la), bisquincorne (à la) : loc. adv., à califourchon sur les épaules. - (20) |
| bisqu'encorne, califourchon. - (05) |
| bisquer (faire) : taquiner - (60) |
| bisquer : être vexé. - (09) |
| bisquer : jalouser - (44) |
| bisquer, v. être fâché ; j'ai bisqué : j'étais fâché ; regretter : je bisque de n'avoir pas fait cela ; aul bisque : il enrage. - (38) |
| bisquer. Eprouver du dépit, être jaloux de la supériorité d'un rival. Bien que ce verbe familier soit accepté par l'Académie, je lui donne place dans ce dictionnaire, car il me parait spécial au centre de la France : à Beaune, ou en use... et ou en abuse. Bisquer est un terme du jeu de paume : la bisque était l'avantage que le plus fort rendait au plus faible. Nous dirions actuellement : « rendre des points. » - (13) |
| bisquer. v. n. Avoir du regret, du dépit, être contrarié, vexé. - (10) |
| bissa. n. f. - Besace. (Leugny, selon F. Clas) - (42) |
| bisse. Bêche. - (49) |
| bisser. Bêcher. - (49) |
| bissétre. Malheur. Vo me senongé bissétre, vous me présagez malheur… - (01) |
| bistancorne (à la ...), adv., n'importe comment. - (40) |
| bistaud : s. m., rustaud de magasin, garçon de boutique. - (20) |
| bisteau, s. m., saute-ruisseau : « L’bisteau ét en courses ». - (14) |
| bistencar (de), adv. de travers. - (17) |
| bistencoin (de) : loc., de bric et de broc, de pièces et de morceaux, de travers, de guingois. Voir carre en coin (de). - (20) |
| bistencoin (de), loc. en diagonale, asymétrique. - (24) |
| bistencoin (de), loc. en diagonale. - (22) |
| bistibri. s. m. Mot injurieux. Imbécile. - (10) |
| bistoquet. n. m. - Jouet : petit morceau de bois taillé en pointe à ses deux extrémités, qu'il faut lancer avec un ergipiau (une baguette) ; le jeu s'appelle le bistouri. - (42) |
| bistoquet. s. m. Jouet consistant en un petit morceau de bois aminci ou, plutôt, appointi aux doux bouts, qu’il faut faire sauter, qu’il faut lancer avec une baguette. (Saint-Sauveur). - (10) |
| bistouri : Jeu enfantin. « Juer au bistouri ». Le bistouri est un petit bâton court taillé en biseau à chaque bout. Le jeu consiste à faire sauter en l'air d'un coup de bâton le bistouri et à le lancer d'un second coup, avant qu'il soit retombé, dans une direction déterminée ; le geste s'accompagne de cette formule : « par ainsi, par deux et demi, par trois coups de bistouri ». - (19) |
| bistouri. n. m. - Jeu : voir bistoquet, et ergipiau. - (42) |
| bistouri. s. m. Sorte de jeu consistant à faire sauter avec une baguette un petit morceau de bois pointu par les deux bouts. (Soucy). Voyez bistoquet. — A Véron, ce jeu s’appelle bistinguet, et, dans d’autres localités, bisquinet. - (10) |
| bistre : s. m., formation de suie, tantôt liquide et tantôt compacte, engendrée surtout par le bois humide. - (20) |
| bistric, s. m. réunion d'objets (sens plaisant) : il a emporté tout son bistric. - (24) |
| bistric, s. m. réunion d'objets (sens plaisant) : il a emporté tout son bistric. - (22) |
| bistrouille, pistrouille n.f. Piquette, mauvais vin. - (63) |
| bistrouille. Mauvais vin, mauvaise boisson. - (49) |
| bitarne : bête imaginaire - (39) |
| bite : chassie et pénis. Donne bitou et bitouse : qui a les yeux sales de liquide visqueux : la chassie. - (62) |
| bite : Chassie. « Les métins ol a de la bite ès yeux ». - (19) |
| bite n.f. (du gaul. betu). Chassie. Voir mite, synonyme moins délicat d'emploi. - (63) |
| bite : (bit’ - subst. f.) chassie, dépôt d'humeur qui s'accumule aux commissures des paupières. - (45) |
| bite : s. f., chassie des yeux. - (20) |
| bite, humeur sortant des yeux. - (16) |
| bite, s. f. chassie des yeux, humeur qui se forme au bord des paupières. - (08) |
| bite, s. f., chassie, humeur visqueuse de l'œil. S'emploie souvent au fig. : « L'malin ! ô n'a pas d' bite aux œuyes ». - (14) |
| bite, subst. féminin : chassie, humeur des yeux. - (54) |
| bite. Chassie ; bitou, chassieux. Débitouser, ôter la chassie. - (03) |
| bite. Chassie, humeur visqueuse qui découle des yeux. - (49) |
| bite. La chassie des yeux. Etym. poix, résine, par extension pituite. - (12) |
| biter, v. n. avoir la chassie. « lé-z-euillos d'mon ch'vau bitan », les yeux de mon cheval sont chassieux. - (08) |
| bitioche, sm. bavard inconsidéré. - (17) |
| bitoniô : n. m. Objet indéfini. - (53) |
| bitou - qui a les yeux chassieux. - Al é les uillots bein bitoux ; i ne sai vraiment pas si cequi se guériré. - (18) |
| bitou (adj.m.pl.) : chassieux - se dit des yeux - (50) |
| bitou : (adj) chassieux - (35) |
| bitou : chassieux - (48) |
| bitou : Chassieux. « Ol a les yeux bitou ». Au figuré : « Ol n'est pas bitou ! » : signifie, il y voit clair, il ne se laisse pas duper. - (19) |
| bitou : fromage, fromage blanc - (48) |
| bitou : la saleté qui colle au coin des yeux - (46) |
| bitou : qui a les yeux chassieux, qui voit mal (au féminin, une bitouse) - (46) |
| bitou : saleté dans l'œil - (44) |
| bitou : chassieux. Yo tout bitou : des yeux tout chassieux. - (33) |
| bitou : fromage blanc à peine égoutté. - (33) |
| bitou : adj. Chassieux. - (53) |
| bitou : quelqu'un qui a les yeux sales - (39) |
| bitou, adj., qui a les yeux chassieux. Au fig. : « Ah ! c’té-ci n'é pas bitou, dà ! ôl y voit clâr ». - (14) |
| bitou, adj., qui voit mal, avec des yeux pleins de sécrétions. - (40) |
| bitou, bitouse : (bitou, bitouz’ - adj.) chassieux. Du kiak' (ou tiak') bitou : du fromage frais battu, sans doute parce que sa consistance rappelle celle de la chassie. - (45) |
| bitou, chassieux et celui qui ne voit pas bien. - (16) |
| bitou, ouse, adj. chassieux, atteint de la chassie. - (08) |
| bitou, qui a les yeux chassieux. - (27) |
| bitou, qui a les yeux cireux, aveugle. - (28) |
| bitou. Celui qui a mal aux yeux : c'est peut-être la syncope d'albitou dérivé d'albus, blanc, et synonyme d'albinos. De bitou est venu le substantif bite, humeur qui se dessèche au coin des yeux, et le verbe débitouser. On donne plaisamment le nom cliaque bitou au fromage blanc, que l’on applique parfois sur les yeux pour calmer l'irritation- — Les cachets d'oculistes gallo-romains ne font pas mention de ce collyre ! - (13) |
| bitous (z’ûots) : (yeux) chassieux - (37) |
| bitouse : petite lampe peu puissante - (48) |
| bitouse : une ampoule de faible lueur - (46) |
| bitouse : petite lampe éclairant très peu. Autrefois on ailmot la bitouse : autrefois on allumait la petite lampe. - (33) |
| bitoux (-ouse) : adj., chassieux. - (20) |
| bitoux : chassieux. - (32) |
| bitoux, adjectif qualificatif : qui a les yeux chassieux. - (54) |
| bitoux, affecté de la chassie. (Voir au mot b1guenou.) - (02) |
| bitoux, bitouse. Qui a des yeux chassieux. Au figuré malpropre, mal lavé, désagréable. - (12) |
| bitoux, bitouse. : Personne affectée de la chassie (Del.), d'où le verbe débitousai, se nettoyer les yeux. - (06) |
| bitoux, ciroux. Chassieux. Fig. Se dit d'une personne dont la figure est malpropre. - (49) |
| bitoux, -ouse adj. (du gaul. betu, bouleau, qui a donné béton et bitume ; les gaul. tiraient de cet arbre un goudron). Chassieux Voir mitoux. - (63) |
| bitoux, sale, malpropre - (36) |
| bitouze (nom féminin) : lampe à huile. - (47) |
| bitrou. Gros saucisson fait avec l'estomac du porc coupé en petits morceaux. On dit aussi « jésus ». D'après une ancienne coutume, à la campagne, le bitrou se mangeait le ler mai pour avoir de beaux taureaux. - (49) |
| bitse n.f. Biche. - (63) |
| bitso : airelle (thym dans la région de Montmelard). B - (41) |
| bitso : airelle - (43) |
| bitte, bittou, chassie, chassieux. - (05) |
| bitûre. Ivresse ; « avoir in-ne bonne bitûre » c'est être ivre. Fig. Vin de mauvaise qualité. On dit encore « pistrouille ». Ce mot est commun à toute la Bourgogne. - (49) |
| bivac (être au). Être exposé aux intempéries ; être sans abri. - (49) |
| bizègre, un peu aigre, se dit d'un vin qui tourne à l'aigre. - (16) |
| biziau. s. f. Pierre granitique. (Gy-l’Evêque). - (10) |
| bizingoin (adjectif) : (En) de travers. - (47) |
| bizoir : voir marcelot - (23) |
| bizoner, v. n. se dit du bruit produit par un objet lancé dans l'espace : ma pierre à bizoné. - (24) |
| bizouard : voir marcelot - (23) |
| bizouné, v. n. se dit du bruit produit par un objet lancé dans l'espace : ma pierre a bizouné. - (22) |
| blâ : Nigaud. « Couge te dan grand blâ » tais-toi donc grand nigaud. - (19) |
| bla, blé. - (38) |
| blafe. adj. - Blafard. Ne s'applique qu'au temps. (Mézilles, selon H. Chéry) - (42) |
| blagoû : blagueur - (48) |
| blagoû : blagueur - (39) |
| blailli : v. tiller. - (21) |
| blaimi. Blêmit, pâlit, devint pâle. - (01) |
| blainche : adj. Blanche. - (53) |
| blaireau : s. m., diable de camionneur. - (20) |
| blairie : terre à blé ; droit payé au seigneur par les habitants pour obtenir la permission de faire paître leurs bestiaux dans les champs après la récolte. - (55) |
| blaiser. v. n. Pleurer bêtement. - (10) |
| Blaizôte. C'était une très jolie fille de Dijon, née avec beaucoup de vivacité et de grands talents pour l'amour. Il est aisé de voir que le Gui, amant aimé de cette Blaizôte, n'est autre que le poète… - (01) |
| blan. Blanc. - (01) |
| blanc a bourre, s. m. mélange de poil de bœuf, de chaux et d'argile dont on se sert pour des plafonnages grossiers. On y ajoute souvent de la paille hachée. - (08) |
| blanc, blinche : (blan, blin:ch’ - adj.) blanc, blanche. - (45) |
| blanc, s. m., ancienne monnaie de la valeur de cinq deniers. Depuis longtemps ce mot n'était plus usité que dans la locution : six blancs (deux sous et demi), qui avait survécu à l'usage même de la monnaie. - (14) |
| blanchir. v. a. Dépouiller, écorcher une bête morte de maladie. - (10) |
| blanchissement. Blanchiment. - (49) |
| blanchuron. Blanchâtre, pâle. - (12) |
| blande : s. f., vx fr., flatterie, caresse. Aller aux blandes, vx fr. blander, cajoler, courtiser. - (20) |
| blandir et ablandir. : (Dial.), flatter, caresser, amadouer. - (06) |
| blanque : jeu de roulette - (39) |
| blanque : s. f., jeu de loterie foraine ; plateau tournant, plus connu sous le nom de « roulette », et portant généralement des objets mis en loterie. - (20) |
| blanque, s. f. jeu de hasard qui a la vogue dans les fêtes de village. - (08) |
| blanquer : v, n., tirer à la blanque. - (20) |
| blanquette, s. f., premier produit de la distillation du marc de raisin, Voir Eau (Petite). - (20) |
| blantée - (39) |
| blard. s. f. Une des nombreuses dénominations du bélier. — A Quincerot-les-Biques on dit blin. - (10) |
| blatcher. n. m. - Marchand de céréales. - (42) |
| blatte, bacole, bascole, balcoulade. s. f. Belette. (Vertilly, Villiers-Bonneux, etc.). - (10) |
| blaude : blouse. - (09) |
| blaude, biaude. n. f. - Blouse. La longue tunique portée par les hommes et les femmes au Moyen-Âge s'appelait un bliaud. Le français a transformé ce mot en blaude XVIe siècle, puis l'a assimilé à « blouse » au XVIIIe. - (42) |
| blaude, bliaude, biaude, s. f. blouse. - (08) |
| blaude. Blouse. Le vieux français avait blialt, bliaut, blaude. Nous avons conservé ce dernier. Etym. ancien haut. - (12) |
| blazir ou blezir. : (Dial. et pat.), meurtrir. Dans le patois, le mot blétir ou devenir blet se dit des fruits qui dépassent la maturité. Les paysans disent une poire blosse (prononcer bliosse), dé fru blo (blio). - (06) |
| blé (se faire) : douleur donnée par la vibration d'un manche - décharge électrique - (34) |
| bléger, v. a. accabler en frappant, surcharger, écraser. - (08) |
| blêmi, pâlir. - (16) |
| bler (éne u) : gober (un œuf). A - B - (41) |
| bler (se faire) : vibration dans un manche mal tenu (par extension prendre une décharge électrique) A - B - (41) |
| bler : surprendre - (51) |
| bler un u : gober un œuf - (43) |
| bler v. 1. Gober. Bler eun û, gober un œuf. 2. Supporter, sentir, blairer. - (63) |
| b'ler: (vb) gober (un œuf) - (35) |
| blés : céréales diverses. III, p. 23-4 - (23) |
| blésir : v. n., blettir. - (20) |
| blesse, adj. pâle, fade, flasque. - (08) |
| blessi, v. a. et n. pâlir, blanchir, devenir blême ou fade. Sa longue maladie l'a « blessi. » - (08) |
| blet : blé - (48) |
| blet n.m. (or. inc.) 1. Décharge électrique. 2. Secousse violente ressentie en coupant du petit bois lorsque le coup de serpe porte à faux. - (63) |
| blet nouère : sarrazin - (48) |
| blète, betterave. - (16) |
| bléterave et bléte, s. f., betterave, bette à racine. - (14) |
| bléton n.m. Béton. - (63) |
| bleton : s. m., béton. - (20) |
| blette (n. f.) : betterave - (64) |
| blette (nom féminin) : betterave. - (47) |
| blette : betterave - (60) |
| blette : betterave. (RDM. T IV) - B - (25) |
| blette : une betterave - (46) |
| blette n.f. Belette. - (63) |
| blette : betterave. Ex : "Fauras pas oublier d'pleucher tes blettes !" - (58) |
| blette : s. f., feuille de bette. On dit à Mâcon : des côtes de « blette » et : des bêles à côtes. - (20) |
| blette, biette. Poirée, bette à côte. - (49) |
| blette, blotte. Belette. - (49) |
| blette. n. f. - Betterave. - (42) |
| bletter : v. n., blettir (au fig). Elle blette de se marier (c'est-à-dire du désir de se marier). - (20) |
| bletterave carotte. Betterave ; et la carotte se nomme « pastonnade ». - (49) |
| blettes : betteraves - (39) |
| bletti v. (fr. blettir) Arriver à maturité avancée. Au sens figuré : avoir hâte de. - (63) |
| bletton : s. m., vx fr. bleteron, rejeton. Les officiers de justice de Château poursuivent des gens accusés d'avoir coupé quatre blettons dans le bois Billard, à Sainte-Cécile, en 1629. (Archives dép., G. 208, 2, f 210). - (20) |
| bleu, bleuse, adj. bleu, bleue. - (08) |
| bleuche : adj. blet, blette. - (21) |
| bleucir. v. a. Bleuir, rendre bleu. - (10) |
| bleugne : faire le difficile pour manger - (43) |
| bleugnia, déniaqué : quelqu'un qui trie, qui est difficile pour tout - (43) |
| bleugnon, bleugnat : sans appétit - (43) |
| bleuiasse, blouiasse, bluiasse : s. f., mercuriale annuelle. Voir foirotte. - (20) |
| bleuque : boucle. - (29) |
| bleussir, blussir. v. - Se dit d'un fruit qui devient blet. - (42) |
| bleute : belette - (43) |
| bleuzi, v. n. devenir bleu. - (08) |
| bléyé, vt. séparer le blé ou l'avoine de la menue paille, au sortir de la batteuse. - (17) |
| blguenette : s. f., bigote. - (20) |
| bli (faire le) : se cacher pour observer. A - B - (41) |
| blian : Blanc. « In varre de vin blian », « Blian d'û » blanc d'œuf. « Je te vois pas blian » : je te vois en mauvaise posture. « Blian c'ment eune pate » : blanc comme un linge, très pâle. Les bliancs, les royalistes. Au féminin : bli-ainche. - (19) |
| blianchissouse : Blanchisseuse. « Donner san linge à la blianchissouse ». - (19) |
| bliandiau : Rebouteur. « O s'est cassé in bré, ol est allé au bliandiau » : il s'est fracturé un bras, il est allé se faire soigner par le rebouteur. - (19) |
| bliandin : Blond, blondin. « San bon-ami est in p'tiet bliandin » : son amoureux est un petit blond. Nom qu'on donne aux bœufs. - (19) |
| bliatte : Bette, beta vulgaris. « Eune fricassée de c'eutes de bliattes » : un râgout de côtes de bettes. - (19) |
| bliaude : Sorte de blouse longue portée par les maquignons. - (19) |
| bliaude et bliaude-ronde - blouse. - Si t'aivà portant mis tai bliaude, tes habits ne seraint pâ aibimai queman qu'a sont. - Sarre tai bliaude-ronde des dimoinges. - (18) |
| bliaude, biaude, blaude : s. f., vx fr. bliaud, blouse. « Le bûcheron ne quittait guère sa blaude, une espèce de surtout bleu, et ses guêtres de toile. » (Jules Mary, Un Coup de Revolver). - (20) |
| bliaude, Biaude, blaude. Vêtement de toile ayant une ouverture pour passer la tête : c’est presque le sagum des Gaulois. Au moyen-âge, on écrivait bliaus. À la lin du XVI e siècle, les paysannes portaient encore ce vêtement, Tabourot des Accords en parle dans une de ses meilleures pièces de vers « sur une petite villageoise » qu'il appelle sa Gadrouille : - J'ayme mieux voir sa belle taille - Soubs sa biaude qui luy baille - Cent fois miaux façonné son corps - Qu'une robbe si resserrée - Qui par sa contraincte forcée - Fait ietter l'espaule dehors. Le synonyme blouse, usité dans le nord de la France, tend à se substituer au vieux mot bourguignon. - (13) |
| bliaude, n. fém. ; blouse ; l'ancien sarreau des Gaulois. - (07) |
| bliaude, s. f., blaude, blouse : « Ol é r'venu du marché, sa bliaude toule arrachée ». - (14) |
| bliaude. Blouse. Du vieux mot bliaut et bliaus. Nous appelons aussi la blouse rouyère, vêtement de roulier. - (03) |
| bliaut, robe de dessus, bliaude, blouse. - (04) |
| blie, v. ; bouillir. - (07) |
| blieu : Au féminin blieuche. Trop mûr, blet. « Des poires blieuches ». - (19) |
| blieû : Bleu. « Alle a mis san devanté blieû », « Mentre au blieû » : passer le linge au bleu. «An n'y voira que du blieû » : on ne s'en apercevra pas. - (19) |
| blimeuse (peau) :enflammée. (DC. T IV) - Y - (25) |
| blin : Ver qui se trouve dans les cerises, ce ver se nomme mouton dans certains pays, or blin est le nom familier du mouton - (19) |
| blin, belin, -ne n.m. Agneau. - (63) |
| blinche, blanche. - (38) |
| blinche. adj. f. Blanche. Une vèche blinche. (Pasilly). - (10) |
| Blinchote : Blanchette, nom de vache. - (45) |
| b'line : (nf) (jeune) chèvre - (35) |
| bline n.f. Chèvre. - (63) |
| blinette (na) : braguette - (57) |
| bliô, au féminin bliôse (prononcez blieuse), ce qui est mou ou talé. On dit une poire bliôse. - Dans l'idiome breton, blôd signifie mou (Le Gon.) : pér blot, poire molle. (Lep.)... - (02) |
| blion. s. m. Primevère des blés. (Argenteuil). - (10) |
| blioque - boucle. -Lai blioque de mai cravate â tote défaite. - Al é des jolies blioques, t'é vu… - (18) |
| bliossai - c'est le verbe, et les substantifs et adjectif sont Bliosse et Bliot se dit des fruits qui sont mûrs à un degré avoisinant la pourriture. - Les poires sont bliosses. - Te n'é pâ surveillé les fruts et pu voiqui qu'à sont bliots. - (18) |
| bliossére - tas ou petites provisions de poires sauvages que l'on fait blettir, et en général figurément une provision de choses quelconques. - Note André al é fait ine bliossére de petiotes poirottes su le fenau. - Chiche queman qu'al â, al en metai de côté des écus, vais ; i vourâ bein trouvai lai bliossére. - Voué, ç'â bon des bliossons. - (18) |
| bliter (v.t.) : regarder avec insistance et curiosité (en a.fr. beiter = guetter) - (50) |
| blliâmer, blâmer. - (05) |
| bllianc, blanc. - (05) |
| blliand, -de, blond, blonde. - (05) |
| blliande, fille qu'on courtise. - (05) |
| blliatte, blliaitte, betterave. - (05) |
| blliau large (à), loc. tout ouvert au grand large. - (22) |
| blliau large (à), loc. tout ouvert au grand large. - (24) |
| blliaude, robe, rouillère. - (05) |
| blliaudon, petite robe. - (05) |
| bllié, blé, seigle. - (05) |
| bllieu, bleu. - (05) |
| bllieute*, s. f. ivresse. - (22) |
| blliô, s. m. mercuriale des champs. - (22) |
| bllioc, adj. blet. Verbe bllioquer. - (24) |
| blliou se, rouillère. v. blliaude. - (05) |
| blliou, adj. bleu. - (22) |
| blliouc, adj. blet. Verbe blliouqué. - (22) |
| blliouzon, s. m. jacinthe à fleur bleue. - (22) |
| blô (ai) - (39) |
| blô (osse) : blet (ette) - (39) |
| blo, blos' : (adj.) blet, (déverbatif de blosser). - (45) |
| blo, blosse, blet, blette ; une poire blosse est une poire blette. - (16) |
| blo, sse et blot, te, adj., blet, talé, trop mûr : « All’a gardé trop longtemps ses pouéres ; àll’ sont venues toutes blosses ». - (14) |
| bloches : asticots - (44) |
| blôde, blouse, habit de dessus ; on dit aussi biôde. - (16) |
| bloé (pour blet), adj. Voyez blous. - (10) |
| bloncer. v. a. Ebrancher. (Chassignelles). - (10) |
| blonde (aller à la). loc. verb. - Aller à la fumelle, courir les filles. - (42) |
| blonde : la blonde, aussi la fiancée - (46) |
| blonde, jeune fille fréquentée en vue de l'épouser. - (16) |
| blonde, s. f. femme ou fille recherchée par un galant, bonne amie, maîtresse : « côri lai blonde. » - (08) |
| blonde, s. f., bonne amie, maîtresse, qu'elle soit, d'ailleurs, blonde ou brune : « Voui, voui, j' Ions vu avec ; àll' è sa blonde ». - (14) |
| blonde. Synonyme de maîtresse, amie. « Aller en blonde », c'est courtiser une fille. - (03) |
| Blondeau, nom de bœuf dans toute la région Morvandelle. - (08) |
| blondée : s. f., méteil, mélange de froment et de seigle. Syn. de conseau. - (20) |
| blondes, (aller aux), loc, faire sa cour aux filles, assez souvent pour le bon motif. J'ai aussi entendu dire : « Aller en blondes ». - (14) |
| blondie : grande herbe qui pousse dans les prés - (39) |
| blondie, s. f. houque laineuse, holcus lanatus. On lui donne ce nom à cause de la couleur blonde de ses panicules à l'époque de la maturité. - (08) |
| Blondin : nom de boeuf. III, p. 30-o - (23) |
| blondsi : boulanger - (43) |
| blondsire : boulangère - (43) |
| bloque (vente à la) n.f. Vente en bloc, sans estimation de poids. - (63) |
| bloque : Terme de jeu enfantin. Au jeu de billes, « fare san bloque » : signifie choquer de sa bille celle de son partenaire. - (19) |
| bloquer, v. a. mettre en bloc, réunir plusieurs choses ; compter en gros, à forfait. - (08) |
| blos (blô), blosse, blot, blotte : adj., blet, blette. Cette poire va être blosse ; elle est temps de manger. - (20) |
| blos, blosse, adj. blet, blette. Se dit d'un fruit trop mûr. Les nèfles sont bonnes à manger lorsqu'elles sont « blosses. » - (08) |
| bloshe : blet, blette. « Un’ne pouère bloshe » : une poire blette. Rappel : l’écriture « sh » a pour but d’indiquer « ch » ou « ss » sifflé ! - (62) |
| blosné, blosner (n.m.) : pommier sauvage - aussi crâyer. Fruits : blossons ou crâs - (50) |
| blosse (adjectif) : blet, blette. - (47) |
| blosse (fru) : fruit blet. - (29) |
| blosse : blette (pour une poire) - (61) |
| blosse : adj. Blette. - (53) |
| blosse : blet. On parle en général d'un fruit trop mûr. Ex : "Té vas pas m'fée manger des pouées blosses à c't'heu !" (Pouée = poire). - (58) |
| blosse, adj., se dit d'un fruit blet, non consommable. - (40) |
| blosser : (blosé - v. intr.) devenir blet, blessir. - (45) |
| blossir : v. n., blettir. - (20) |
| blossir, v. intr., blettir, devenir blet. - (14) |
| bloss'né, s. m. belossenier, poirier à fruits sauvages appelés dans le pays « blossons. » - (08) |
| bloss'ner, v. n. blettir, devenir blet. - (08) |
| blosson : (subst. m.) petite pomme sauvage au goût acide. - (45) |
| blosson : poire sauvage. - (09) |
| blosson : petit fruit sauvage - (39) |
| blosson, bleusson. n. m - Petite poire sauvage qui se mange blette. - (42) |
| blosson, fruit du poirier sauvage. - (16) |
| blosson, s. m. fruit sauvage en général, pommes, poires, prunes, etc. - (08) |
| blosson. s. m. Petite poire sauvage, qu’on laisse blossir pour la manger. - (10) |
| blossons : poires sauvages à manger blosses (blettes). III, p. 60-j. - (23) |
| blossougné, blossougner (n.m.) : poirier sauvage. Fruits : blossons - (50) |
| blossougnier : arbre produisant des blossons. III, p. 50-j. - (23) |
| blot (è) : (è blo - loc. adv.) (en parlant de la disposition des objets) tel quel, sans qu'on y ait touché, sans préparation, directement. - (45) |
| blot : mollet, meurtri. - (09) |
| blot : adj. Blet. - (53) |
| blot, blosse. adj. - Blet, blette : « Les pouées sont blattes, on pourra ren en fai'e ! » - (42) |
| blot, blosse. L’l se mouille quelquefois, biot, biosse, on dit aussi bleusse ou bieusse, mais non bleu ou bieu, blet, blette. Etym. blossir, devenir blet (Littré), qui a sa racine soit dans le breton blod, mou, soit dans l’allemand blültt, poire blette. - (12) |
| blot, blotte : blet, blette - (48) |
| blot, blotte, blet, blette. - (38) |
| Blot. Blosse. Synonyme de blet, blette. La balosse est une espèce de prune spéciale au nord de la France. Les Normands disent : une poire blèque. En patois wallon, blacbe signifie pâle, maladif. Cet adjectif me parait celtique : blet, en breton, signifie mou. - (13) |
| blot. s. m. Bélier. - (10) |
| blotte : betterave. - (62) |
| blotte. n. f. - Belette. - (42) |
| blotter. v. - Gober un œuf.; synonyme de biber. - (42) |
| blotter. v. a. Avaler, gober un œuf cru. - (10) |
| blou, blou, blou, ta-blou, ta Cri pour appeler les chèvres. - (63) |
| blou. s. m. Bloc. V’ià un biau blou. (Molesme). - (10) |
| blouque, boucle. - (27) |
| blouque, s. f., boucle. De cet ustensile nos pères attachaient leurs braies ; maintenant ils en ferment, sur la poitrine, leurs rudes chemises, sans que l'ardillon perce le linge. - (14) |
| blouque. n. f. - Boucle. - (42) |
| blouque. s. f. Boucle. - (10) |
| blouquer, v. tr., boucler. - (14) |
| blouquer. v. - Boucler. - (42) |
| blouquer. v. a. Boucler. - (10) |
| blous, blousse. adj. Blet, blette. Un abricot blous , une poire blousse. - (10) |
| blouseron, blouson. Blouse de travail courte, noire ou bleue ; (gilet de travail). - (49) |
| bloussognier, bloussonnier. s. m . Poirier sauvage, poirier à blossons. - (10) |
| blousteu : s. f. ciseaux. - (21) |
| bluache (pour pluache, pluvia). Pluie. (Saint-Sauveur). - (10) |
| blutchot. n. m. - Blutoir : tamis servant à séparer la farine du son. Appareil employé dans les moulins à meules. - (42) |
| bnâilles, s.f. pl. travaux de binage ; on dit aussi la bnâille. - (38) |
| Bnât, Bnâte n. Benoît, Benoîte. - (63) |
| bner, verbe ; travailler la terre pour la deuxième fois avec une pioche. - (38) |
| b'ni, bénir, bénit ; pèn b'ni, pain béni ; b'nitè, bénitier. - (16) |
| b'ni, te, adj., béni, bénit, consacré. - (14) |
| bnner v. Benner. - (63) |
| bnon n.m. (gaul. benna, panier d'osier). Baquet en bois, cerclé de fer. - (63) |
| bô : bois - (48) |
| bô : bois. - (66) |
| bo : bout - (43) |
| bô : crapaud - (48) |
| bô : le bois, la forêt - (46) |
| bô : Petite grenouille verte, espèce de rainette. - Dicton : « Quand le bô chante, la vigne pousse ». - (19) |
| bô d'bique : le bois de la chèvre, sorte de chèvrefeuille, de houblon, de liane grimpante - (46) |
| bô nouèr : bourdaine - (48) |
| bô : n. m. Bois. - (53) |
| bo(c)que-bois, n. masc. ; pivert. - (07) |
| bô, bois. - (16) |
| bo, crapaud (onomatopée). - (16) |
| bô, s. m., bois. - (40) |
| bö, sm. bouc. - (17) |
| bò. Bois. On a dit anciennement bos, témoin Bos-le-Duc et le nom propre Du Bos. - (01) |
| boainer, bouainer : v. a. et n., baigner. Faire boainer des haricots avant de les cuire. Mener bouainer les vaches. - (20) |
| boaire : boire - (43) |
| boaire à la golée : boire à la régalade - (43) |
| boauin, s. m., lièvre ou bouc, ou jeune enfant turbulent. - (40) |
| bôbance, s. f. régal, réjouissance qui sous-entend le plaisir de la bonne chère et de la bouteille. - (08) |
| bôbance. Magnificence, profusion, vieux mot… - (01) |
| bobancer, faire bonne chère, prodiguer. - (27) |
| bobane, boubane. adj. et s. Personne obèse, se mouvant lentement et lourdement. - (10) |
| bobansé, faire bombance. - (16) |
| bobe n.f. (de l'onom. bob, évoquant le gonflement des joues). Moue. Alle fayot la bobe. Elle faisait la moue. - (63) |
| bobe, s. f., robe. Terme dont on se sert avec les enfants : « La p'tiote a métu sa baie bobe des dimanches ». (V. Bobote). - (14) |
| bobêche. n. f. - Poupée que l'on trouvait dans les baraques de fête foraine ; et dont le jeu consistait à les viser avec une boule de chiffon et à les faire tomber. (Arquian) - (42) |
| bobèchon : de caboche, s fare r'monter le bobèchon se laisser influencer - (46) |
| bobèchon : tête - (48) |
| bobêchon : n. f. Tête, voir Téét'. - (53) |
| bobéchon : tête - (39) |
| bobêchon. n. f. - Cerveau, tête : « Pour c'té chouse, quelles simagrées ! V'là qu'ça y monte au bobéchon. » (G. Chaînet, En chicotant les braisons, p.56). Ce mot est dérivé du français familier bobèche, utilisé dans l'expression « se monter la bobèche, se monter le bourrichon. » - (42) |
| bobéille (n.f.) : bobine du rouet - (50) |
| bobeille (nom féminin) : bobine du rouet. - (47) |
| bôbeille, s. f. bobine pour dévider le fil, la bobine du rouet. - (08) |
| bobiner, boubiner. v. n. Mâchonner à la manière des vieillards qui, n’ayant plus de dents, roulent longtemps les aliments dans leur bouche. — Se boubiner. v.pron. Se rouler, se ramasser sur soi-même, se pelotonner comme font les chats. De bobine. - (10) |
| bobo : s. m., débile mental, ramollot. Il est tout bobo. C'est un vieux bobo. - (20) |
| bôbô, petit mal (enfantin). - (16) |
| bobote, s. f., dim. de Bobe, robe d'enfant : « Ah ! la Ninite, on va li mett' sa bobote ! » (V. Bobe) - (14) |
| bocain : bouc - (44) |
| bocaisse, s. f. bécasse. Se dit également de l'oiseau de passage au long bec et d'une personne trop naïve. Le « mâtre » fait taire sa fille en lui disant : « couye-té, bocaisse ! » - (08) |
| bocaissine, s. f. bécassine. - (08) |
| bocane, sorte de danse licencieuse... - (02) |
| bôcane. Bocane. Il est fait mention de deux danses au Noël 14, savoir, de la bocane et de la pavane. La première a tiré son nom de Bocan son inventeur, fameux maître de danse sous le règne de Louis XIII. La seconde, beaucoup plus ancienne, a été ainsi nommée de l’italien Pavana… - (01) |
| bocassée. s. f. Becquée. Du latin bucca, buccella. (Etivey). - (10) |
| bôce : (bô:s - subst. f.) bourse. - (45) |
| boce, n. masc. ; bec. - (07) |
| bocérot. s. m. Vacher. (Chassignelles). - (10) |
| boch' : s. f. boucle. - (21) |
| bochan : Buisson. « O s'est caichi darrè in bochan de bouis » : il s'est caché derrière un buisson de buis. « Caiche bochan prend ! » : cri d'avertissement à l'adresse d'une personne qui en cache une autre pour la prévenir qu'elle est exposée à recevoir des coups. - (19) |
| bocharde, s. f. fauvette. - (24) |
| bôché - sorte de fenil pour la paille, des fagots, etc. - En nô fau mette cequi su le boché, ce qui seré âtant de débaraissé. - Monte voué su le boché ces tas de boffe que voilai. - (18) |
| bôche, grosses et longues perches formant comme un plafond appelé bôché. - (16) |
| bochêche : n. f. Extrémité supérieur d'un objet, d'une chose. - (53) |
| bocher : butter. (E. T IV) - VdS - (25) |
| bôcher, v. boucher. - (38) |
| bôcher, v. tr., bêcher. - (14) |
| bocheton ou boucheton (tomber a). Tomber sur le ventre. Dans d'autres provinces on dit tomber à bouchon, c'est-à-dire tomber sur la bouche (Littré), comme on disait autrefois tomber adenz, c'est-à-dire tomber sur les dents. - (12) |
| bôcheure - haie, clôture quelconque se dit plus ordinairement pour une haie morte, c'est-à-dire faite de bois sec. - Les beu en démangonai lai bocheure. - (18) |
| bôcheure, bouchure : n. f. Haie. - (53) |
| bôcheure, s.f. haie. - (38) |
| boçhi v. (de boucler) Mettre des fers au groin du cochon en utilisant des pinces spéciales, afin de l'empêcher de défoncer le sol. Dans le mâconnais, au jeu de boules, réaliser un tir direct (un carreau), se disait bochi (ferrer). - (63) |
| bochi : s. m. : très large échelle disposée contre le mur et sur laquelle sèchent les épis de maïs. - (21) |
| bochie : haie. (C. T III) (RDM. T IV) - B - (25) |
| bôcho, couvercle, par exemple, d'une marmite. - (16) |
| bôchon - bouchon et buisson, et branche ou buisson de verdure que les cabaretiers pendent à leur maison pour enseigne. - Voiqui in bôchon de bouteille qui sent le meusi. - Malheureux ivrogne, en fau qu'à s'airétai ai tot les bôchons ! - (18) |
| bòchon (à), loc. appliqué face contre terre. Verbe abochi. - (24) |
| bôchon : buisson. - (29) |
| bôchon : n. m. Buisson. - (53) |
| bochon : s. m. buisson. - (21) |
| bôchon, bouchon de bouteille. - (16) |
| bôchon, s.m. bouchon. - (38) |
| bôchon, sm. buisson, très petit bois.au fig. : bourru ; adj. : malplaisant. - (17) |
| bochon. Enseigne d'auberge. Ton houmme ast un ivrogne et un gormand : a s'erreîte ai tos les bôchons. - (13) |
| bôchu : n. m. Bouchon. - (53) |
| bochvöté, vt. empiler en sens contraire, entrecroiser de la tête aux pieds. - (17) |
| boçhye : (nf) boucle - (35) |
| boch-ye : boucle - (43) |
| boçhyi : (vb) boucler - (35) |
| bochyi : mettre les boucles dans le groin du cochon grâce à une roulette, pour l'empêcher de remuer la terre (la roulette était fabriquée avec un fil de fer enroulé sur une pince ronde) - (43) |
| boc'lle (Il mouillées) : Boucle, anneau. « Eune boc'lle de ceinture ». - (19) |
| boc'llier : Boucler. « Boc'lle dan ta ceinture », « Boc'llier in cochan » : lui passer une boucle de fil de fer dans le groin pour l'empêcher de fouiller le terrain. « Y est boc'llié » : c'est bouclé, fini, plus rien à faire. - (19) |
| bocon n.m. (du v. fr. boucon désignant autrefois des mets ou des breuvages empoisonnés). Bouton, virus, infection, maladie. All'i'a foutu l'bocon ! Elle lui a transmis une infection. Voir - (63) |
| bocon : s. m., vx fr., boucon, bouchée empoisonnée ; cloaque, lieu sale et empesté. On donne le bocon à un chien dont on veut se débarrasser. La rue Tourniquet, à Mâcon, était un vrai bocon. Voir emboconner. - (20) |
| bocon, petite bouchée. - (16) |
| bocon, s. m., bouchée, morceau : « Ol a tôjor faim ; i faut tôjor li fourer l' bocon. » - (14) |
| bocon: (nm) puanteur - (35) |
| bocot : 1 n. f. Bouche. - 2 n. m. Bec. - (53) |
| bocote - petite bouche (se dit aux enfants). - Vions, mon enfant, euvre tai bocote, ç'â bein bon, vais. - Torchons lai petiote bocote. - (18) |
| bocote, petite bouche (enfantin). - (16) |
| bocote, s. f., bouche, bouchette : « Faire bocote », embrasser. - (14) |
| bocqué. Percé, troué. Se dit quand la coquille de l'œuf couvé est percée par le petit poussin qui demande à sortir. On dit « l'û (œuf) est bocqué ». - (49) |
| bocquée. Becquée. - (49) |
| bocquer v. Becquer. - (63) |
| bocquer, v. ; donner des coups de bec. - (07) |
| bocrôt, s. m., petite bonde en bois pour les fûts. - (40) |
| bocue. Panier sphérique en osier avec une petite ouverture carrée. Sert à mettre les noisettes. - (49) |
| bodai. Bordé, bordez, border. - (01) |
| bode. Bourde, conte, fable. Bode est tantôt singulier, tantôt pluriel. On dit aussi à Dijon, quand on voit un grand feu allumé, que ç’a dé bode, par allusion aux feux solennels qu'on allumait dans les rues le premier Dimanche de carême, nommé le Dimanche des brandons ou le Dimanche des bordes, parce qu'originairement les villageois, à pareil jour, faisaient des processions le long de leurs bordes, c'est-à-dire de leurs grandes, avec des flambeaux de paille tortillée, pour chasser, disaient-ils, le mauvais air de dessus la terre… - (01) |
| bode. : Ce mot a deux acceptions : celle du vieux français bourde que Nicot traduit par mendacium et nugoe, et celle de bord, frontière, limites d'une métairie et la métairie elle-même, d'où le mot bodelle, maisonnette.- Lamonnoye dit que le premier dimanche de carême, ou dimanche des brandons, les villageois promenaient le long de leurs bordes ou granges des flambeaux de paille tortilléepour chasser, disaient-ils, le mauvais air de dessus la terre. - (06) |
| bodére : (bô:dé:r’ – subst. f.) grand feu de joie. - (45) |
| bodère, boue, boudère. - (04) |
| bodes ou bordes, friches boisées.- En Bretagne, bôd, au pluriel bôden, signifie buissons, bosquets, touffes d'arbres. - (02) |
| bodi (n. m.) : veau, dans le langage enfantin - (64) |
| bodié, vt. border. - (17) |
| bodin : boudin - (43) |
| bodin n.m. Boudin. - (63) |
| bòdin, s. m. boudin - (24) |
| bôdin, s. m. boudin. - (08) |
| bodiö, sm. nuage isolé. - (17) |
| bodiot : le mal à un doigt, on dit aussi dogue. - (46) |
| bodofle : enflure, bosse. (MLV. T III) - A - (25) |
| bodogne, bodonne. n. f. - Vache, mot enfantin. - (42) |
| bodone (n. f.) : vache, dans le langage enfantin - (64) |
| bôdonme, s. m. caricature, personnage grotesque. - (08) |
| bodot. s.m. Ventre. (Saint-Valérien). - (10) |
| bôdou, ouse, adj. boudeur, celui qui fait la moue, la grimace. - (08) |
| bodru n.m. Gros saucisson, du genre jésus. - (63) |
| bodze : grand sac en toile. A - B - (41) |
| bodze : (nf) sac (de blé, de son) - (35) |
| bodze : grand sac de toile de jute destiné au conditionnement du grain ou de la farine - (51) |
| bodze : grand sac en toile - (34) |
| bodze : sac en toile de jute contenant 100 kg de blé - (43) |
| bodze n.f. (du gaul. bulga). Grand sac de toile pour le blé (capacité de 100 à 120 kg) ou le son. Il est amusant de relever que la même racine gauloise a donné le mot budget. - (63) |
| boe, bois (o long), - (26) |
| bœche (à), loc. à l'extrême bord. - (22) |
| bœche (a), loc. à l'extrême bord. - (24) |
| bœgne, s. f. coup : il a reçu une bonne bœgne. - (22) |
| boeille : ventre - (39) |
| boeiller, et qu’il serait formé de bis et œil (regarder des deux yeux). — Voyez beuclier. - (10) |
| boeillot : boyau, ventre - (39) |
| boeillou : qui a un gros ventre - (39) |
| boele, boêle, boyle. s. f. Petite fille. (La Belliole). — Dans Roquefort, chèvre, femelle du bouc. - (10) |
| boêle. n. f. - Petite fille. - (42) |
| boêles-de-Bouhy (aller aux). expr. - Aller à la fumelle, courir les filles. Pourquoi à Bouhy ? L'origine de cette expression s'est perdue dans le temps. Peut-être ce charmant petit village de Puisaye abritait-il pendant une époque de jolies filles aux mœurs légères ? Était-il prisé par tous les Poyaudins en manque d'affection ? ... (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| boëlle (fém.) : ventre rondelet. (M. T III) - B - (25) |
| bœllion, s. m. morceau. - (24) |
| bœllion, s. m. morceau. Verbe bœlliouné, morceler. - (22) |
| boême (boime), boêmier (boîmîer). boêmière, boêmien (boïmien), boêmienne : adj., bohême, bohémien ; faux, hypocrite, câlin dans un but intéressé. Faire son petit boêmien. - (20) |
| boêmerie (boimerie) : s. f., fausseté, hypocrisie. Je ne me laisse pas prendre a ses boêmeries. - (20) |
| bœne de mouches, s. f. ruche. Littéralement : vieille benne, utilisée pour y loger les mouches à miel. - (22) |
| bœne de mouches, s. f. ruche. Littéralement : vieille benne, utilisée pour y loger les mouches à miel. - (24) |
| bœri, s. m. cuvier, particulièrement à lessive. - (24) |
| bœri, s. m. cuvier. - (22) |
| bœrna*, s. m. crochet servant, du dehors, à faire glisser un verrou. - (22) |
| bœrna, s. m. crochet servant, du dehors, à faire glisser un verrou. - (24) |
| boéron, bouéron : s. m., bouvier, berger. - (20) |
| boésat, n. masc. ; petit tas de fumier dans les champs. - (07) |
| bœssons, s. m. pl. jumeaux. - (24) |
| boête, s. f., boisson, petit vin de tous les jours. - (40) |
| bœté, v. a. mettre. - (22) |
| boétoux, boiteux. - (05) |
| boette : boisson courante. - (32) |
| boeu (n.m.) : bouvreuil - aussi bôvreu - (50) |
| boeu : bœuf - (48) |
| bœu : bœuf - (39) |
| bœu : n. m. Bœuf - (53) |
| bœu, s. m. bœuf. Nous disons un « bœu, des bœus, acheter un bœu, manger du bœu. » - (08) |
| bœu, sm. bœuf. - (17) |
| boeu. n. m. - Bœuf - (42) |
| boeudre; v. n. bouillir. - (22) |
| bœuf : sorte de punaise. IV, p. 29 - (23) |
| bœuf de la Saint-Martin : voir bœuf - (23) |
| boeujon, s. m. barreau, [boujon.] - (22) |
| bœuquier, bœutier. s. m. Bouvier. — Sabot lourd et grossier emboîtant tout le pied, et qu’on chausse principalement dans le Morvand et les campagnes humides et boueuses. - (10) |
| boeutcher, boeutier. n. m. - Bouvier, conducteur de bœufs. - (42) |
| boeutier : domestique chargé de la conduite des bœufs. VI, p. 12. - (23) |
| boeuvarsé (en). loc. adv. - Écarquiller les yeux, comme un « bœuf.versé » : « Et Monsieur qui huche après toi, et qui regarde en bœuvarsé. » (Colette, Claudine en ménage, p.426) - (42) |
| bœzin, adj. mou au travail. Verbe bœziné. - (22) |
| bœzin, adj. mou au travail. Verbe bœziner : dépêche-toi, ne besines pas ainsi. - (24) |
| bœzou, s. m. ventre, en langage badin, enfantin. - (22) |
| bœzou, s. m. ventre, en langage badin, enfantin. - (24) |
| bœzvœlle (être en), loc. être en mésintelligence, en bisbille. - (22) |
| bœzvœye (être en), loc. être en mésintelligence, en bisbille. - (24) |
| bôfe, enflure. - (02) |
| bôfe. : Enflure. (Del.) Le mot bôraufle, enflé, appartient à la même famille de mots. - (06) |
| boff' : n. f. Enveloppe des graines et céréales après battage. - (53) |
| boffan : Bouffon, souffre-douleur. « Y est leu boffan » : c'est leur souffre-douleur, celui qui subit toutes leurs brimades. - (19) |
| boffe : balle des céréales récupérée lors des battages. A - B - (41) |
| boffe - tout petits débris de paille le premier tirage que rejette le van dans la grange. - Vos é lai de lai bonne boffe. - Les bêtes eumant bein lai boffe, cequi les raifraichit. - (18) |
| boffe (n.f.) : balle ou capsule des céréales (aussi bouffe, poussot) - (50) |
| boffe : (nf) son - (35) |
| boffe : balle (enveloppe du grain) - (51) |
| boffe : Balle d'avoine, on s'en sert quelquefois en guise de crin. « In c'euchin de boffe » : un coussin rempli avec de la balle d'avoine. - (19) |
| boffe : balle de céréales, récupérée lors des battages - (34) |
| boffe n.f. (du fr. bouffer, gonfler). Résidu de l'épi de blé ou d'avoine, bale (ou balle). Voir balou. - (63) |
| bôffe : (bôf' - subst. f.) balle des céréales. Par extension : « i é d'lè bôf' plin mé: poch'. » J'ai de la bouffe plein mes poches, c-à-d. « Mes poches sont pleines de débris divers ». - (45) |
| boffe. Balle de graminées, de blé en particulier. - (49) |
| boffer : souffler, gémir. A - B - (41) |
| boffer : (vb) souffler - (35) |
| boffer : Bouffer. « Ol a mis de la plieume dans san c'euchin pa le fare boffer » : il a mis de la plume dans son coussin pour le faire bouffer. - (19) |
| boffer : souffler - (34) |
| boffer : souffler - (44) |
| boffer : souffler - (51) |
| boffer : souffler - (48) |
| boffer : souffler, gémir - (43) |
| boffer les gaudes : (exp. humoristique) ronfler - (35) |
| boffer v. (de l'onom. buff, gonflé. Autrefois on soufflait en boffant (gonflant) les joues. On a là l'origine du nom de Buffières). 1. Souffler. 2. S'essouffler. 3. Faire triste mine. 4. Respirer difficilement, bruyamment. - (63) |
| boffer, v., tousser avec les joues gonflées, la main devant la bouche pour cacher un rire. - (40) |
| boffer. Souffler, respirer avec peine. « Ah ! mon pôvre Môssieu y boffe ». Ce qui veut dire : Je ne peux plus respirer. Expression courante : « au boffe c'ment un bû » (il souffle comme un bœuf). - (49) |
| boffiner : s'embrasser à pleine bouche. - (30) |
| boge : sac de toile fort, haut et étroit, pour le grain et la farine. - (30) |
| boge ou boëge. Nom d'une étoffe de laine, forte, épaisse et très rude, que l’on fabrique encore à la main dans beaucoup de villages bourguignons. L'aspect grossier de ce tissu a fait employer son nom au figuré dans l’expression tête de boge, appliquée à un homme inculte, rustique, ou bien obstiné, têtu. - (12) |
| bòge, adj. qui a une pointe courte, trapue, émoussée. - (24) |
| boge. : Etoffe commune au XVIe siècle. - (06) |
| boger, bouger, bovier, boyer. s. m. Valet de ferme, garçon qui soigne, qui conduit les bœufs. Du latin bos, boviarius. - (10) |
| bôgöre, sf. navet ou radis creux, par suite de dessèchement. - (17) |
| bôgrai. : Petit bougre. - (06) |
| bograis, bograle, s. et adj. bègue, celui qui bégaie ou parle avec difficulté. Son fils est « bograis » et sa fille « bograle. » - (08) |
| bograle (adj.m.ou f.) : bègue - celui ou celle qui parle avec difficulté - (50) |
| bograller. v. n. Bégayer. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| bogre, bougre, et son diminutif bôgrai, petit bougre... - (02) |
| bogrès. s. m . Bègue. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| boguebô (n.m.) : pivert - (50) |
| bôgu-ye : (bôky' - subst. f.) boucle. - (45) |
| bohémien : s. m., romanichel du type brun. Voir Hongrois. - (20) |
| boiche-coulas, s.m., petite lumière qui dansait dans les rues pendant les Avents (feu-follet) ; on dit aussi boriche-coulas. - (38) |
| boîcher : piocher. - (31) |
| boicher, v. n. se dit du coup do bec que le poussin donne à la coquille de l'œuf pour sortir. Les œufs « boichés « sont les œufs d'où les petits vont éclore. - (08) |
| boicheton (Ai), boicho (Ai) - renversé sens dessus dessous, la partie supérieure en bas sur le ventre ; etc. - Renverse ce cuvier qui ai boicheton pou le fâre aipeurai. - I étâ si lassai qui me seu étendu ai boicheton in manman. - (18) |
| boichevau (à la), loc, tête bêche, en sens opposé : « Quée rangeouse va ! Dans son ormoire tout et à la boichevau ! » - (14) |
| boichevau (ai lai), loc. a la tète-bêche, en sens contraire. - (08) |
| boichevauler, v. a. mettre à tête-bêche, en sens contraire. Le moissonneur « boichevaule » ses gerbes lorsque les épis des unes sont en l'air et les épis des autres touchent le sol. - (08) |
| boichie, s.f. becquée. - (38) |
| boichot, s. m. montant de cheminée, jambage ou console qui porte la bande de pierre ou de bois. - (08) |
| boichots (nom masculin) : montants de la cheminée qui supportent l'â. - (47) |
| boicrat (nom masculin) : enfant chétif. (C’te boicrat, y pousse pas pu qu'un oeu dans un panier). - (47) |
| bôIé : bûcheron. (RDM. T IV) - B - (25) |
| boige - drap de laine assez grossier pour les habitants de la campagne. - I ons fait fâre ine pièce de boige pour nos habiller torto l'hyver. - (18) |
| boige, beige, Étoffe grossière, fabriquée jadis à Beaune et reléguée maintenant chez les tisserands du Morvan et de L’Auxois. Très anciennement, les ménagères la tissaient dans leurs maisons. La beige des grands magasins de nouveautés est une étoffe à la mode qui ne ressemble guère à celle de nos montagnes. (V, Boigevau.) - (13) |
| boige, bouége, s. m. étoffe de laine et de coton fort grossière, mais très solide, qu'on employait beaucoup dans nos campagnes pour les rideaux de lit et pour les jupons de femme. Les couleurs ordinaires étaient le rouge, le jaune et le vert. - (08) |
| boigevau (à). Tête-bêche, bout ci, bout là. Cette expression me parait empruntés à l'art du drapier, ou plutôt du fabricant de boige. Boigevoler, c'était manœuvrer la navette qui chasse le fil dans un sens et qui le rechasse dans l'autre. - (13) |
| boignaude : petite ouverture dans un mur (bouinaude) - (60) |
| boijon : (bouâ:jon - subst. m.) gerbe mal liée ; le terme est plus vivant au sens de "grosse femme laide". - (45) |
| boijvolé : disposé en sens inverse, tête-bêche. - (33) |
| boile, boelle, subst. féminin : beuille, ventre. - (54) |
| boîle, s. f., ventre saillant. - (40) |
| boile, s.f. ventre. - (38) |
| boile. Maladie des lapins dont le signe extérieur est l'enflure du ventre. Ce mot vient probablement de Botellus, boyau et boudin, par extension ventre. On lit dans la chanson de Roland : « sun cors veit gésir la buèle. » - (13) |
| boiler, aspirer - (36) |
| boiler, v. ; gober un œuf. - (07) |
| boiler, v. a. avaler en aspirant, humer ; « boiler » un œuf. - (08) |
| boiler. v. a. Humer ce qu’il va dans un œuf dont on à percé le bout. (Domecy-sur-Cure). - (10) |
| boïllalou, beuillalou n. et adj. Gros, ventru, bedonnant, gonflé. - (63) |
| boille (boigle) : s. f., vx fr. baille, fille. - (20) |
| boille : ventre proéminent. « Ô l’a d’la boille » : il a du ventre (boil en celte). Désigne un gros bidon pour le lait en Suisse, Savoie, - (62) |
| boïller : bûcheron. Les boilléers travaillins dans le bois : les bûcherons travaillaient dans le bois. - (33) |
| boïllon n.m. (de bouvillon). Jeune veau. - (63) |
| boillots et bouyots. Doubles paniers en osier fixés à la sangle d'un âne ou d'un mulet. - (13) |
| boîloux, adj., qui a un gros ventre. - (40) |
| boine : benne. ou « balonge » (voir) pour le transport du raisin. - (62) |
| boine, s.f. benne à deux manettes pour recueillir le vin. - (38) |
| boinne, benne d'abeilles. - (05) |
| boinnon, bennon pour le pain. - (05) |
| boinon : banneton rond en osier. - (31) |
| boinon : banneton. (BD. T III) - VdS - (25) |
| boinon : banneton. Corbeille en osier et sans anse, où lève la pâte du pain. - (62) |
| boînon, s. m., corbeille avec une toile pour faire lever la pâte à pain. - (40) |
| boinon, s. m., petite benne, panier en osier, où l'on met la pâte du pain à enfourner. A l'heure du four, on voit les ménagères porter chez le boulanger leur boinon, où tremble la pâte levée et blanche. - (14) |
| boinon, s.m. panière ronde, demi-sphérique, pour contenir la pâte panifiable. - (38) |
| boinon. Panier hémisphérique en osier fin dans lequel on met lever la pâte. On voit dans l'inventaire de 1 501 à l'Hôtel-Dieu de Beaune : « Item. Eti une chambrote auprès desdits fors sont environ quatre- vingt benastes de sel de Salins. » Un compte du trésorier de la saunerie de Salins, pour l'année 142 1, porte que « les enfants de dame Clémence touchaient trois benastres de sel par semaine. » Le patois de Dijon dit menâton. Le changement de b en m est fréquent : dans le Hainaut une manne est un panier de fruits. Le même radical a formé mannequin, sorte de panier et mannequin statue d'osier, analogue au Gayant de Douai, et au Dondou de Mons. - (13) |
| boînotte. s . f. Fenêtre. (Essert). - (10) |
| boirbe - boue (synonyme de Gôîlle). - En ié ine boirbe dans les rues, qu'an ne peut pâ fâre in pas sans se crottai. - Voiqui mes saibots emborbai. - (18) |
| boire (se) : v. r., boire avec excès. Il est bien gentil garçon ; c'est dommage qu'i s' boit. - (20) |
| boire : Boisson. « Du boire de cherige » : boisson qu'on obtient en mettant macérer des cerises dans l'eau. Les années où le vin est rare, les pauvres gens font par le même procédé du boire de poulaches, du boire de gratte-cul, en mettant dans le fut des prunelles ou des gratte-culs au lieu des cerises. - (19) |
| boîre de cotson n.m. Brouet de pommes de terres, détritus et eaux grasses, servi aux porcs. - (63) |
| boîre la tâsse loc. Prendre le café. Cette expression peut prêter à confusion quand on boit son café au bord de l'eau. - (63) |
| boire le bon vin. Pour boire du bon vin. - (12) |
| Boire, nom de famille très répandu dans quelques localités du Morvan, dans le canton de Montsauche surtout. - (08) |
| boiri : Cuvier de bois dans lequel on fait la lessive. La « salle » de boiri est une sorte de trépied sur lequel on place le cuvier. - (19) |
| boirne. s. f. Petite fenêtre de grenier. - (10) |
| bois (bûche de), loc, redondante. Une bûche est toujours en bois. (V. Bas, Chaud, Froid, Haut). Notre patois a bôs. Bois n'est donné là que pour la formule fautive. - (14) |
| bois : bois - (48) |
| bois debout. n. m. - Billot. (Colette, Sida, p. 781) - (42) |
| bois nouèr : bourdaine - (48) |
| boisat. s. m . Gros ventre. (Saint-Martin-du-Tertre, Paron). - (10) |
| bois-doux. n. m. - Réglisse. - (42) |
| bois-doux. s. m. Réglisse. - (10) |
| boiséor. : (Dial.), fourbe, trompeur (de la basse latinité bausiare ou bosiare). - Boisdie ou voisdie signifie ruse, fourberie. - (06) |
| boissan. Baissant. - (01) |
| boisse, s. f. terrain en contre-bas. - (22) |
| boisse, s. f. vase qui sert à mesurer le lait et qui contient un demi-litre environ. - (08) |
| boisse. Baisse, baissent. - (01) |
| boissé. Baisser, baissé, baissez. - (01) |
| boisseau : ancienne mesure de capacité pour les grains. Environ 13 litres. - (55) |
| boisseau : Boisseau. Mesure de capacité pour les matières sèches et principalement pour les grains, à Mancey le boisseau vaut environ 25 litres, cette mesure est peu employée. - (19) |
| boisseau : voir coupe. - (20) |
| boisselée : s. f., ancienne mesure de surface pour les terres, correspondant à ce que l'on peut ensemencer avec un boisseau de grains, contenant 400 toises carrées (de 6 pieds), et valant 15 ares 195. - (20) |
| boisselée, s. f. mesure agraire. la boisselée est de 0 hectare, 12are, 5c. - (08) |
| boisselet, boisselot : s. m., vx fr., petit boisseau. - (20) |
| boisselon, s. m. petite pioche. - (22) |
| boissn, s. m. bouvreuil appelé vulgairement pive, pivet, pivane, pivoine, à cause sans doute de la belle couleur rouge de son ventre. - (08) |
| boissò. Baissais, baissait. - (01) |
| boisson, bisson, bouchon, busson. s. m. Buisson. Du latin boseus. - (10) |
| boisson, s. f., liquide fermenté, préparé avec des pommes, des poires, des prunelles, etc., mais surtout avec le marc de la vendange : « J'ons fait eûne feûillote de boisson, épeù brament j' tirons d'ssus ». C'est la provision populaire. - (14) |
| boisson. n. m. - Buisson. Diminutif.de boso, bois, le boisson est un mot d'origine gauloise, employé depuis le XIe siècle. - (42) |
| boistier. s . m. Bûcheron. - (10) |
| boitailler : v. n., vx fr. bottoiller, boitiller. - (20) |
| boitailler, bancaler : boiter - (43) |
| boitailler. Clopiner. - (49) |
| boite (la) : réserve de vin. Après la vendange : réserve faite pour sa consommation personnelle. Faire « sa boite» ou boate (?). - (62) |
| boite : La quantité de vin nécessaire à la consommation annuelle de la famille. « Les vignes ne sant pas balles (belles) c 't'an-née mâ an fara pt'ête bin tojo la boite ». - (19) |
| boite : voir bouette - (23) |
| boite n.f. (la boite désignait autrefois l'état du vin bon à boire). Consommation de l'année. Dz'ai ren qu'eune veugne p'ma boite. J'ai seulement une vigne pour ma consommation personnelle de l'année. - (63) |
| boite : s. f., vx fr., réserve de vin que le propriétaire garde pour sa consommation personnelle. - (20) |
| boîte, s. f., caisse aménagée pour aller au lavoir. - (40) |
| boite, s. f.. liquide à boire. .Jadis, les crieurs de vin, pour vanter leur marchandise, disaient, après avoir donné le nom du débitant : « Ah ! la boune boite au vin!... On s'endremirot su la feûillote ! » - (14) |
| boite, subst. féminin : boisson, quantité de boisson nécessaire dans une année. - (54) |
| boîte. s. f . Petite lucarne. (Etaules). - (10) |
| boite. s. f. Boisson, piquette, ordinairement faite avec des prunelles, des fruits sauvages ou de mauvais raisins. — Se dit aussi par les vignerons de la petite provision de vin qirils conservent pour leur usage. - (10) |
| boiteuser. v. - Boiter : « Il ne faut pas, entre les deux Noëls, c'est-à-dire entre le 25 décembre et le 1er janvier, enlever le fumier des étables, attendu que cela fait boiteuser les vaches. » (M Jossier, p.l8) - (42) |
| boiteuser. v. n. Boiter. « Il ne faut pas, entre les deux Noëls, c’est-à-dire entre le 25 décembre et le 1er janvier, enlever le fumier des étables, attendu que cela fait boiteuser les vaches. » (Puisaye). - (10) |
| boitou, adj., boiteux, qui marche à cloche-pied. - (14) |
| boitou, bancalou : boiteux - (43) |
| boitte - provision de vin ou autre boisson pour l'année. – En nô fau prée de deux pièces de vin pour note boitte. - (18) |
| boitte : boisson. - (09) |
| boitte : s. f. quantité de vin nécessaire pour la consommation de l'année. - (21) |
| boivau. Comme Despréaux, dans sa dixième Satire , a dit une Capanée pour dire une femme impie, à cause de Capanée fameux par son impiété, l'auteur des Noêls a dit de même une Boivau femelle pour dire une grande joueuse, à cause du président Boivault de la Chambre des Comptes de Dijon , l'un des plus grands joueurs de son temps… - (01) |
| boivu p.p. du v. boire. - (63) |
| boivu : part, pass., bu. - (20) |
| boizon, s. m. poignée de chanvre disposée en moyette. - (08) |
| bolâ, braillard. - (38) |
| bolai : beugler comme un taureau. - (33) |
| bolai, bolair - pleurer (se dit des enfants). - Le pôre enfant, al é don bolai tote lai neu ! – A bolle pou in ran ; c'â in vrai bolair. - (18) |
| bòlaise, s. f. terrain léger. - (24) |
| bolak, s. m. celui qui se plaint à tout propos ; qui gémit sans cesse, qui va toujours pleurant. Au féminin « bolarde. » - (08) |
| bolangi : Boulanger. « Du pain de bolangi », du pain blanc par opposition au pain de ménage cuit dans le four de la maison. - (19) |
| bolatte (n.f.) : belette - (50) |
| bolauder. v. n. Rouler. (Subligny). - (10) |
| bole : (nf) boule - (35) |
| bole : Boule. « Jû de bole », jeu très populaire dans nos campagnes. Le meilleur joueur est celui qui abat le plus grand nombre de quilles au moyen d'une lourde boule en buis ou d'un boulet de fonte qu'il lance de toute sa force. - (19) |
| bolé : bûcheron ; ouvrier qui travaille dans une coupe. (B. T II) - B - (25) |
| bolé : pleurer. (CT. T II) - S&L - (25) |
| bole de neudze n.f. Boule de neige. - (63) |
| bole n.f. Boule. - (63) |
| bôle : (bôl' - subst. f.) boule. - (45) |
| bôlé : n. m. Bûcheron. - (53) |
| bolè : v. i., v. t. Pleurer. - 2 v. pr. S'apitoyer. - (53) |
| bolé, crier, pleurer fort. - (16) |
| bole, s. f., boule, tout corps roulé en rond. - (14) |
| bölé, vt. rouler. Se bölé, se jeter à terre. - (17) |
| bolée : contenu d’un grand bol, forte inspiration dans les poumons - (37) |
| bolée : s. f., contenu d'un bol. Une bolée de bouillon. « Une bolée de cidre. » - (20) |
| boler (v.t.) : bêler - (50) |
| boler (verbe) : bêler. - (47) |
| boler : crier en pleurant avec intonation du cri de la vache - (37) |
| boler : pleurer, sanglotter - (48) |
| bôler : pleurer. - (29) |
| boler : pleurer. - (31) |
| boler : (bolè - v. intr.) pleurer. Le mot a bien sûr un péjoratif assez marqué (à peu près équivalent de celui de "chialer"), puisque, chez les Morvandiaux, pleurer est considéré comme un manquement aux règles de la pudeur la plus élémentaire. - (45) |
| boler : v. n., se dit du lait lorsqu'il se coagule par l'effet de la présure, en formant une masse rétractée dans le petit lait. - (20) |
| boler, brailler. - (38) |
| boler, pleurer. - (28) |
| boler, s. m. pleurer, pleurnicher, crier en pleurant. - (08) |
| boler, v., crier. - (40) |
| boler. Crier en pleurant, par comparaison avec le bêlement des moutons N’bolee don pas si fort, chéti polisson. Dans le Morvan le mot bauler s'applique aux taureaux. - (13) |
| bolet, s. m. pleureur, pleurnicheur. - (08) |
| bolette : Boulette, petite boule de viande hachée ou de tout autre comestible : « Eune bolette de tapine (pomme de terre) », « Eune bolette de fremage ( fromage)». - (19) |
| bolian ou boillan (Il mouillées) : Bouillon. « Si y a du boillan t'aras de la sope » : tu seras servi après les autres, s'il en reste. « In bollian d'anze heures » : un breuvage empoisonné. - (19) |
| bolie. s . f . Bouillie. - (10) |
| bolir. v. n. Bouillir. - (10) |
| bolle, s. f. balle de blé. - (08) |
| bollie, s. m. bélier, mâle de la brebis. - (08) |
| bolliot - meûle ou tas de foin. – Le temps menaice, mettons le foin en bolliots. - Le prai à Maire n'é pâ mau fourni, i veins d'y fâre di sept bolliots. - Se dit aussi des paniers que les ânes portent : Note âne à fort, ailé, al aiporte ses deux bolliots de ceries. - (18) |
| bollot (du) : balle de grain. Enveloppe des grains dans l’épi de céréales, récupérée au battage elle entre dans la nourriture (médiocre) des animaux. Du celte ballan : peau ou du bas-latin baleium : balayures…de grange. - (62) |
| bologne, n.f. betterave rouge. - (65) |
| bolomer. v. n . Carillonner. (Givry). - (10) |
| bolon : boule. Personne courte et trapue. A - B - (41) |
| bolon : boule - (43) |
| bolon : boule, personne courte et trapue - (34) |
| bolon n.m. 1.Enveloppe de la châtaigne et de la noix. Voir calofe et borru. 2. Boulon. 3. Bourrelet. - (63) |
| bölon, sm. personne grasse et courte. - (17) |
| boloner : tomber en roulant. A - B - (41) |
| boloner : tomber en roulant - (44) |
| bolonner : tomber en roulant - (34) |
| bolonner, boller : tomber en roulant - (43) |
| bolot, s. m. mon « bolot ». Nom d'amitié qu'on donne aux enfants. - (08) |
| bolot, s.m., son de la farine. - (38) |
| bolöt, sm. homme des bois, bûcheron, charbonnier. - (17) |
| bolottai: gober (bolotter un œuf : gober un œuf) ou manger vite. - (33) |
| bôlotte : belette - (48) |
| bolotte : belette. Une bolotte meuge les œufs : une belette mange les œufs. - (33) |
| bolotte : belette - (39) |
| bôlotte : n. f. Belette. - (53) |
| bolotte, s. f. belette. - (08) |
| bolotte, s.f. belette. - (38) |
| bolotte, subst. féminin : belette. - (54) |
| bolotte. s. f. Belette. - (10) |
| bolotter, v. a. sucer un œuf à la manière des belettes ou autres rongeurs qui le percent à l'extrémité et le hument ensuite. - (08) |
| bombance ou bobance - abondance, luxe à la table. - Quainne bonbance ! i ne sai pâ si cequi deureré, pair exempe ! – An y aivo ai lote fête ine vraie bobance. - (18) |
| bombarde, s. f. guimbarde, petit instrument de musique que les enfants fabriquent avec un peu de bois et de fer et dont ils se servent en le faisant vibrer entre leurs dents. - (08) |
| bombarde, trompe, grand cor de chasse. - (02) |
| bombarde. s. f. Julienne, fleur. (Argenteuil). — Se dit aussi pour guimbarde, petit instrument à languette dont on joue en le mettant entre les dents. - (10) |
| bomber : v. a., se dit au jeu de saute-mouton, lorsque les pieds du sauteur, ayant déjà quitté le sol, ses mains portent sur le dos du mouton. Bomber dix semelles (voir semelle). - (20) |
| bome : borne. (B. T IV) - S&L - (25) |
| bômi, v. a. vomir, avoir des nausées. - (08) |
| bômi. v. a. et n. Vomir. L’r ne se prononce pas ; conversion du v en b. - (10) |
| bomir, rebomir, vomir, revomir. - (05) |
| bomir. Vomir. - (49) |
| bomme - borne. - Le Rôse â terrible ! en fau tojeur qu'al anticipe su les bommes, quoi ! – I va laiborai note champ de lai grand-bomme. - (18) |
| bomme, bommé, borne, borné. - (05) |
| bomme, n. fém. ; borne. - (07) |
| bon (ne) aimi (e) : bon (ne) ami (e) - (51) |
| bon' : orvet. (LCSS. T IV) - S&L - (25) |
| bon d'I'an, anniversaire du jour de la mort. - (16) |
| bon djou ! Bon Dieu ! (Juron). - (49) |
| bon temps. Idiotisme employé par les bergers, pour dire que leurs troupeaux leur donnent peu de peine à garder. - (03) |
| bon : adj. Bon vin, vin de qualité supérieure au vin de table. - (20) |
| bon : s. m., bonbon. Si t'es bien sage, t'auras du bon. - (20) |
| bon*, s. m. viande de boucherie : une livre de bon. - (22) |
| bon, adj. solvable, riche, solide dans sa fortune : c'est un des « bons » du pays ; il est « bon » pour payer; prêtez-lui sans crainte, il est « bon. - (08) |
| bon, s. m. viande de boucherie : une livre de bon. - (24) |
| bon. Bon, bons, bond, bonds. Bon dans la signification de bonus se prononce bonne devant une voyelle, en bourguignon, au pluriel comme au singulier : ç’a de bon éfronteu, ce sont de bons affronteurs. Le Bourguignon dit souvent pu bon, et quelquefois pu muglieur pour meilleur… - (01) |
| bon. : Les villageois disent: Ça pu bon,- ça pu muglieu, sans distinguer les degrés. - (06) |
| bon-ami : Amoureux, amant. Féminin : bonne amie. « Ol est allé voir sa bonne amie ». - (19) |
| bon-ami n.m. Amant ou simple ami d'enfance. - (63) |
| bonat : 1° bonnet, 2° partie du fléau qui rejoint le manche à la verge. - (21) |
| bonbarde, guimbarde, petit Instrument de musique dont on obtient des sons en le passant sur les lèvres. - (16) |
| bonbon : pot au feu —bubon. - (30) |
| bond’nner : grommeler, ronchonner - (37) |
| bondé : bien plein. - (33) |
| bonde*, s. f. borne de séparation. - (22) |
| bonde, s. f. borne, pierre ordinairement taillée qui marque la limite de deux propriétés contiguës. - (08) |
| bonde, s.f. bouchon d'un tonneau, d'une tonne, d'une cuve. - (38) |
| bondenai, bondeunement - bourdonner, bourdonnement. - Ecoute don le bondeunement des môches ai miée ! – Tojeur ci bondeune. - (18) |
| bondener (v.) : faire un bruit sourd et continu - (50) |
| bondener : faire du bruit, et agiter. - (62) |
| bondener : (bon:d’nè - v. intr.) 1- bourdonner - 2- gronder (en parlant d'un taureau), être furieux (en parlant d'êtres humains). – 3 - vrombir (en parlant d'un moteur. ) - (45) |
| bondener, bourdonner comme les grosses mouches, les frelons. - (27) |
| bondener, v. n. se dit d'un bruit sourd continu. Un nuage chargé de grêle « bondeune » dans le ciel. - (08) |
| bondener, verbe intransitif : grommeler, rouspéter. - (54) |
| bondener. Mot qui exprime le bruit sifflant produit par une pierre lancée avec une fronde ou autre analogue. - (03) |
| bonder, v. n. remplir avec excès, combler en pressant, en foulant : la salle était « bondée » de monde. - (08) |
| Bon-Dieu de la Messe. s. m. Composé. Moment de la consécration et de l’élévation de l’hostie, qui est indiqué par le tintement de la cloche paroissiale. - (10) |
| bondissement, bruit, fracas, bondissement d'oreilles. - (04) |
| bond'na. Bourdon. - (49) |
| bond'nai : enrager, maugréer. - (33) |
| bond'nè : 1 v. i. Ronfler. - 2 v. i. Enrager, gronder, maugréer. - (53) |
| bond'né, fermer un fût avec une bonde. - (16) |
| bondné, vn. bourdonner. - (17) |
| bond'ner : bourdonner, ronfler, maugréer, enrager, ronchonner - (48) |
| bondner : meuglement caractéristique tout en longueur presque plaintif du taureau - (51) |
| bond'ner : bougonner. (E. T IV) - VdS - (25) |
| bondner, bourdonner. - (26) |
| bondner, v. bourdonner, être en colère. - (38) |
| bondner, viondner, vrondner v. Vrombir, bourdonner. - (63) |
| bond'ner. Bourdonner. Fig. S'emploie pour exprimer son mécontentement, sa colère. - (49) |
| bondniâ, s.m. bourdon (insecte). - (38) |
| bondnöre, sf. nid de bourdons. - (17) |
| bondon - bourdon, insecte. - Les bondons faisant pu de bru que d'ôvraige… queman bien des gens aipré tot. - (18) |
| bondon, bourdon. - (27) |
| bondon, s. m., bourdon, grosse mouche. - (14) |
| bondon, sm. bourdon. - (17) |
| bondonement, s. m., bourdonnement, bruit de bourdon, rumeur lointaine, ronflement de machines. - (14) |
| bondoner, v. intr., bourdonner : « Te m' fais mau à la tête ; te m’bondones tôjor aux orilles ». On entend aussi dire : bondoner, pour exprimer le sifflement d'une pierre lancée avec force. - (14) |
| bondonneman, s. m. bruit sourd et continu, bruit lointain d'une cloche, d'une manœuvre d'artillerie, d'un tambour qui circule de côtés et d'autres. Quelques-uns disent : « bondeun'man. » - (08) |
| bondrée : buse, oiseau. - (09) |
| bondree : buse. (DC. T IV) - Y - (25) |
| bondrée : voir raud - (23) |
| bondrée. n. f. - Buse. - (42) |
| bondzeû : bonjour - (43) |
| bondzo n.m. Bonjour. - (63) |
| bondzo. Bonjour. - (49) |
| bone : (nm) bonnet - (35) |
| bône : une borne de champ - (46) |
| bone de neit : (nm) bonnet de nuit - (35) |
| bòne de net, s. m. bonnet de nuit d'homme. - (24) |
| bône, borne. - (16) |
| bone. Bonne, bonnes. - (01) |
| bone. Borne et borgne. On appelle de ce dernier nom l'orvet, anguis fragilis, parce qu'on croit que ce reptile n'a qu'un oeil, d'où vient ce dicton : Si le borgne avait deux yeux il démonterait un cavalier. - (03) |
| bonette. n. f. - Boisson ; synonyme de bouesson : « T'as-ti pris d'la bouette ? I' va fai'e choud pa' l'champ ! » - (42) |
| bonheu : Bonheur, réussite. « Ol a ésu bien du bonheu », il a eu bien de la chance ; « Le bonheu li est veni en dremant » : se dit de quelqu'un qui a fait de bonnes affaires sans se donner beaucoup de peine. - (19) |
| bonhœur : n. m. Bonheur. - (53) |
| bonjeû, bonjour. - (05) |
| bonjo - bonjeu : bonjour - (57) |
| bonjo bonjour, si t'eû poli, t'eûte ton chapeau pou dire bonjo. Si tu es poli, tu ôtes ton chapeau pour dire bonjour - (46) |
| bonjor, s. m., bonjour : « Ben l’bonjor, vouésin ! » - (14) |
| bonjou : bonjour. - (33) |
| bonjou : bonjour, visière d'une casquette - (39) |
| bonjou, s. m. visière de casquette, par allusion à l'acte de politesse qui accompagne le salut ordinaire. - (08) |
| bonn' : adj. et n. f. Bonne. - (53) |
| bonne mère : sage-femme - (43) |
| bonne mère, n.f. sage-femme. - (65) |
| bonne, sf. borne. - (17) |
| bonne-amie n.f. Maîtresse ou simple amie d'enfance. - (63) |
| bonne-jean (adj.) : niais, nigaud (il est tout bonne-jean) - (64) |
| bonnemeire. Sage-femme : An ast temps d'ailler queri lai bonne meire. Les Berrichons prononcent bonne mére. - (13) |
| bonne-mère : (nf) sage-femme - (35) |
| bonne-mère n.f. Sage-femme. - (63) |
| bonne-mère : s. f., sage-femme. - (20) |
| bonne-mère, s. f. sage-femme. - (24) |
| Bonnes Gens ! Exclamation très-usitée dans les campagnes et qui se fait souvent d’un ton dolent, même à propos de choses insignifiantes. - (10) |
| bonnet carré, n.m. fusain. - (65) |
| bonnet de né : bonnet de nuit - (43) |
| bonnet d'évêque n.m. Fusain. - (63) |
| bonnet d'neit n.m. Bonnet de nuit. - (63) |
| bonnœte s. f. bonnet de nuit de femme. - (24) |
| bonnot : bonnet - (48) |
| bonnot : Bonnet. « Ol a san bonnot de coton ». « Bonnot carré » : fruit du fusain (evonymus europaeus) à cause de sa forme, en Bresse on dit bonnot de curé. - Dicton : « La St Bonnot vindra » : le temps viendra où la provision sera épuisée. - (19) |
| bonnot carrè : fusain - (48) |
| bonnöt, sm. bonnet. - (17) |
| bono, bonnet. Janviè ë kate bono, Janvier aux quatre bonnets. - (16) |
| bonô. Bonnet, bonnets… - (01) |
| bonot : n. m. Bonnet. - (53) |
| bonsa n.m. Bonsoir. - (63) |
| bonsai : bonsoir - (57) |
| bonsar (n.m.) : bonsoir - (50) |
| bonsdisseman, s. m. bruissement, bruit prolongé. Nos paysans disent « bondissement » pour bourdonnement d'oreilles - (08) |
| bonsome, s. m., pieu, gros piquet. - (14) |
| bonta, s.f. bonté. - (38) |
| bontai, s. f., bonté, bienveillance. - (14) |
| bontai. Bonté, bontés. - (01) |
| bonvêpre, bonsoir, - (05) |
| bonzome, gros poteau. - (16) |
| boquai - becquer. - Les ouyais sont enraigés pour boquer nos peurnes et nos pouaires ; c'en à autant de perdues. - Regairde don les pingeons quemant qu'à se boquant, â s'eumant gros. - (Voyez d'ailleurs Biquai). - (18) |
| boquai : cogner. O s'è boqué dans le noir : il s'est cogné dans le noir. - (33) |
| boquai, heurter. On dit encore à Châtillon se boquer, c.-à-d. se heurter soit contre un mur soit contre une personne.... Dans l'origine, le mot boquai avait de la gentillesse ; il signifiait se heurter tête contre tête. Dans l'idiome breton, boch signifie joue. (Le Gon.) D'après Lepelletier il signifie aussi un baiser... - (02) |
| bôquai. : Heurter, bousculer quelqu'un ou quelque chose, l'arrêter dans sa course. - (06) |
| boque : chèvre. Comme « cabre » : l’animal caprin et la grosse sauterelle. - (62) |
| boque : la moue, fère lè boque, faire la moue, on dit aussi fère lè reûe - (46) |
| boquè : (v. trans.) 1- donner des coups de bec (en parlant d'une poule agressive). 2 - embrasser, donner un baiser (cf. en fr. bécoter) - (45) |
| boque : moue - (39) |
| boqué, adj. grêlé, marqué de petite vérole. Le boqué, surnom d'un de mes voisins, fort endommagé par la variole. - (08) |
| boque, chèvre, sauterelle. - (05) |
| boque, s. f. baiser : donner une « boque », donner un baiser. - (08) |
| boque-bô, boque-bois : pivert - (48) |
| boquebô, s. m. pivert. - (08) |
| boque-bois. s. m. Pivert, oiseau de la famille des pies. - (10) |
| boquée - (39) |
| boquée : becquée - (48) |
| boquée : 1 n. f. Becquée. – 2 n. f. Bouchée. - (53) |
| boquée, s. f. becquée ou béquée, portion de nourriture qu'un oiseau prend avec son bec, et par extension, une très petite quantité, une bouchée. - (08) |
| boquée, s. f., becquée, petite portion de nourriture. - (14) |
| boqueingn' : n. m. Bouc. - (53) |
| boquer (se) : cogner (se) - (39) |
| boquer (v.t.) : becqueter - se dit des poussins qui donnent des coups de bec à la coquille pour sortir de l'œuf - (50) |
| boquer : becqueter. Et le boquot pour le bec. - (62) |
| boquer : cogner, becqueter - (48) |
| boquer : embrasser - (48) |
| boquer : frapper par rencontre. - (09) |
| boquer : picorer - (39) |
| boquer, heurter. - (04) |
| boquer, v. a. baiser, embrasser. Une mère dit à son enfant : « boque-moué », baise-moi. - (08) |
| boquer, v. tr., embrasser, caresser des lèvres. - (14) |
| boquer. v. a. Becqueter. - (10) |
| boquer. v. a. Choquer. Se dit ordinairement pour baiser , choquer sa bouche sur une autre ; d’où résulte que ce mot doit être une altération, une forme de becquer , d’autant plus qu’en certains endroits on dit donner la boquie , pour donner la becquée. - (10) |
| boquereau. Bonde, généralement en bois. - (49) |
| boqueriau : Broche, espèce de petite bonde dont on se sert pour boucher le trou d'où on a retiré le robinet. Le boqueriau de la « cue » est une broche qu'on place à l'intérieur de la cuve, devant le trou où on mettra « la fontaine » (gros robinet), et qu'on peut retirer au moyen d'une ficelle qu'on a eu soin d'y attacher. - (19) |
| boqueriau : s. m. gros bouchon du tonneau. - (21) |
| bòqueriau, s. m. bonde plate à futaille. - (24) |
| boqueriot, s. m., diminutif de bocrôt. - (40) |
| boquet : bouquet - (43) |
| boquet : bouquet - (51) |
| boquet : Bouquet. « In boquet de viôlettes ». Autrefois on donnait, par dérision un « bouquet de sauge » à l'amoureux évincé, le jour du mariage de son rival ; la plaisanterie était prise en bonne part par celui qui en était l'objet et il chantait : « Faites moi z'in bouquet, in beau bouquet de sauge, j'ai fait l'amour pour d'autres ! Adieu belle, je m'en va ». - (19) |
| boquet, heurter - (36) |
| bôquet, s. m. bouquet. se dit d'une fleur prise même isolément, mais surtout d'une fleur de jardin, c’est-à-dire cultivée. - (08) |
| boquie. s. f. Becquée. Donner la boquie. - (10) |
| boquier : boucler, fermer - (48) |
| boquin (chtit) n.m. Prétentieux. - (63) |
| boquin : (nm) bouc - (35) |
| boquîn : bouc - (37) |
| boquin : bouc - (51) |
| boquin : bouc et bouton de fièvre. - (62) |
| boquin : Bouc, bouquin, vieux mâle coureur, satyre. - (19) |
| boquin : bouton sur la lèvre des enfants. (VDS. T IV) - VdS - (25) |
| boquin : bouton sur la lèvre. - (31) |
| boquin n.m. 1. Bouc. 2. Lièvre. 3. Bouton (inflammation) ou fièvre éruptive. Alle a l'boquin. Voir bocon. - (63) |
| boquin, bouc, bouquin. - (05) |
| bôquin, s. m. bouquin, bouc, mâle de la chèvre. Le jeune bouc est appelé « biquot.» - (08) |
| boquin, s.m. bouc. - (38) |
| boquin, teuriau : taureau - (43) |
| boquin. - (63) |
| boquin. Bouc. Fig. Pédant. « Espèce de ch'ti boquin » s'emploie comme injure. - (49) |
| boquin. s. m., bouc, bouquin. - (14) |
| boquot : moue faite avec la bouche - (39) |
| boquotte, s. f. petite bouche, bouche d'enfant. - (08) |
| bôr : bourg - (39) |
| bôr, baurg (n.m.) : bourg - (50) |
| bôr, s. m. bourg. En Morvan, le bourg est le lieu où se trouve l'église paroissiale. Chaque commune a son bourg, son clocher : le « bôr » d'Alligny, le « bôr » de Montsauche , le « bôr » de Planchez, etc… - (08) |
| bor, s. m., bourg, bourgade : « Nout' farme n'é pas ben avant du bor ». - (14) |
| bor. s. m., bord, d'un champ, d'un bois, d'une route. - (14) |
| boradze : (nm) herbes sèches qui restent dans les prés en fin de saison - (35) |
| bôrais - boureau, méchant. - Quant an pense que le bôrais é trouvé à se mairiai ! - Qu'al â méchant c't-homme lai ! c'â in vrai bôrais pour les bêtes, pou les gens, pou tôt ! - (18) |
| boraisse : tignasse - (35) |
| boralé : remuer en désordre, travailler sans rendement. A - B - (41) |
| boraler : bricoler - (51) |
| borallé : remuer, travailler sans rendement - (34) |
| boranfle, enflé. - (02) |
| boratsou(se) : qui a de la bourre - (51) |
| borbaillou, gassoilla, patoilla : bourbeux - (43) |
| borbe (n.f.) : bourbe - (50) |
| borbé (nom) : Bourbier. - (19) |
| borbe : (nf) boue - (35) |
| borbe : boue - (43) |
| borbe : boue - (48) |
| borbe : Boue, crotte « Gaugi la borbe », piétiner dans la boue. - Proverbe : « An est tôjo souilli pa la borbe » : on est toujours sali par la boue. - (19) |
| borbe : la boue, on dit également gouillasse - (46) |
| borbe : s. f. boue. - (21) |
| borbe : boue. Des chemins pleins de borbe : des chemins pleins de boue. - (33) |
| borbe n.f. Boue. - (63) |
| borbe : boue - (39) |
| borbe, beurbe. Bourbe. - (49) |
| borbe, boue, bourbe. - (05) |
| borbe, boue. - (16) |
| borbe, boue. - (26) |
| borbe, n.f. boue. - (65) |
| bôrbe, s. f. bourbe, chassie des yeux, humeur en général. - (08) |
| borbe, s. f., boue, saleté: « J' veins des champs ; j'ai mes sabots pleins d' borbe ». — « I fait eûne borbe !... j'en ai jusqu'au c... ! ». - (14) |
| borbe, s.f. boue. - (38) |
| borbe, sf. boue. - (17) |
| borbe. Boue. - (03) |
| borbe. Bourbe. Il est assez étonnant que les Bourguignons, qui ont une tendance à remplacer certaines diphtongues par ou, aient supprimé celle-ci dans bourbe pour la remplacer par un o. - (12) |
| borbe. Mot primitif dont le français a fait boue. L’adjectif, bourbeux, est resté. Au siècle dernier on appelait borbessés les voituriers chargés par le maire de Beaune d'enlever la borbe et les immondices des rues. Antérieurement ces modestes employés portaient le nom de tombeliers : un règlement de 1665 enjoint aux habitants de garder les immondices chez eux et de les jeter, le samedi, dans le tombereau des tumbeliers. On appelle facétieusement borbessés les paysans de la plaine, en opposition à ceux de la montagne, aux beuquins. - (13) |
| borbi : (nm) bourbier - (35) |
| borbi : bourbier - (43) |
| borbi, beurbi n.m. Bourbier. Voir gasse. - (63) |
| bôrbié, s. m bourbier, marécage. - (08) |
| borbier. Bourbier. - (49) |
| borbis (n.f.) : brebis - (50) |
| borbis : brebis - (48) |
| borbis : brebis - (39) |
| borbis, beurbis : brebis. - (33) |
| borbis. s. f. Brebis. - (10) |
| bôrbou (-ouse) (adj.m. ou f.) : boueux (-ouse) - (50) |
| borbou, adj , bourbeux, sale, fangueux. - (14) |
| bòrbou, adj. bourbeux. Féminin bòrbouse. - (24) |
| bôrbou, ouse, adj. boueux, fangeux, marécageux. - (08) |
| borboyou, bourbeux. - (26) |
| borcer : bercer - (48) |
| borcheillè : travailler en dépit du bon sens - (46) |
| borcheilloux : un mauvais travailleur, un bon à rien, on dit aussi un argonnier, un bousillou - (46) |
| borchéyer : mal labourer. (A. T II) - D - (25) |
| bordaille, n.f. hanneton. - (65) |
| bordaize : bordure de nuages à l'horizon - bordure d'une pièce de couture - (39) |
| bordale : gros insecte bourdonnant. A - B - (41) |
| bordale : guêpe, insecte - (51) |
| bordale : hanneton, gros insecte volant - (34) |
| bordale, bordéli : hanneton, gros insecte volant - (43) |
| bordaler : bourdonner. A - B - (41) |
| bordaler : bourdonner - (51) |
| bordaller : bourdonner - (34) |
| bordaller, viouner, vronder : bourdonner - (43) |
| bordan : Bourdon, insecte de la famille des abeilles. « In nid de bordans ». - (19) |
| borde : feu de joie allumé le deuxième dimanche après carnaval. A - B - (41) |
| borde – on appelait le premier dimanche de Carême le dimanche des Bordes on avait ce jour là (et on l'a encore en quelques endroits) la coutume d'allumer des feux sur les hauteurs pour s'amuser. De là, on appelle Feu de Borde un grand feu qui flambe. - Voiqui qui ons bein froid, en vô fau fâre in feu de borde. - (18) |
| borde (n.f.) : grand feu qu'on allume sur les hauteurs le premier dimanche de Carême - (50) |
| borde : (nf) feu de joie ; feu de broussailles - (35) |
| borde : feu - (34) |
| bôrde : Petite cabane en pierres sèches construite dans un champ pour servir d'abri en cas de mauvais temps. « O s'est mis à la coi dans la bôrde » : il s'est mis à l'abri dans la cabane. - (19) |
| bôrde n.f. Tas de débris végétaux que l'on brûle. - (63) |
| borde : s. f., vx fr., brandon. Dimanche des bordes, dimanche des brandons. Feux de bordes, feux qu'on allume dans la campagne le soir du dimanche des brandons ou premier dimanche de carême. - (20) |
| borde : un vrai feu « de borde » : un feu intense, qui chauffe bien. - (56) |
| borde, maison de campagne, petite ferme, d'où bordelage, droit féodal si commun en Morvand, et feu de borde, feu de campagne, comme on n'en voit que dans les bordes, dimanche des bordes, des brandons. - (04) |
| borde, n.f. premier dimanche de carême, où l'on allumait un grand feu ; puis grand feu. - (65) |
| borde, s. f. grand feu de bois en plein air. Bordes, feu de joie du premier dimanche de carême. - (24) |
| bôrde, s. f. grand feu de fagots. - (22) |
| borde, s. f. grand feu qu'on allume dans les champs et principalement sur les hauteurs le premier dimanche de carême. - (08) |
| borde. Amas de paisseaux disposés symétriquement pour passer l'hiver au milieu des vignes. Al ai aiguyé (aiguisé) quat' bordes de paissiâs dans sai jornée. Une borde était, primitivement, une maisonnette de bûcheron au milieu des bois : de là vient qu'il y à un grand nombre de villages appelés la Borde ou les Bordes. Un feu de borde est un grand feu : de même que les soldats au corps de garde, les bûcherons ont le bois à discrétion... La plus ancienne signification est celle de Borde, branche d'arbre, qui a dû former le bourdon du pèlerin. - (13) |
| borde. n. f. - Ensemble de poignées de chanvre femelle, dressées les unes contre les autres, en moyette, afin de faciliter la maturité de la graine. - (42) |
| borde. s . f. Grand feu de bourrées allumé dans la campagne, le soir du dimanche des Brandons, et autour duquel dansent les ieunes gens. (Etivey). - (10) |
| borde. s. f. Ensemble des poignées de chanvre femelle mises en rond les unes contre les autres et la tête contre terre pour faire mûrir la graine. (Villiers-Saint-Benoît). - (10) |
| bordée : n. f. fam. Grosse charge. - (53) |
| bordelage : métairie ; droit perçu par les seigneurs dans certaines provinces sur le revenu des fermes et des métairies, et consistant en argent, grains et volailles, ou les deux à la fois. - (55) |
| bordelle : (nf) hanneton - (35) |
| bordelle, bourdelle : s. f., hanneton. C'est, au respect que j' vous dois, des bordelles. Dicton populaire : Année de bourdelles, Année de misère. - (20) |
| bòrdelle, s. f. hanneton. - (24) |
| bordener : Bourdonner. « Ou 'est-ce-que j'entends bordener ? Y est eune cancoirne » (hanneton). - (19) |
| bordes - (39) |
| Bordes (feù de), loc, grand feu : « T’veù donc mett' le feû à la ch'vinée, que t' nous fais eun feû d’bordes ! » - (14) |
| bordes (Les) : (lé: bord’ - subst. f .pl.) fête du premier dimanche de Carême. Ce jour-là, les enfants quêtaient des fagots parmi la population, les entassaient et y mettaient le feu. C'était là ce qu'on appelait une bô:dé:r'. Ensuite; les habitants se réunissaient autour et se divertissaient. - (45) |
| bordes (les) : feux allumés le 1er dimanche du Carême - (48) |
| Bordes (les), nom d'un village près Verdun-sur-Doubs. — Trop tranquille maintenant, il était, au commencement du siècle, envahi par le nombreux et bruyant personnel de la marine fluviale. - (14) |
| bôrdes : Les Bordes ou Brandons, premier dimanche de Carême. « Fû de bôrdes » : feu de joie qu'on allume sur les hauteurs, à la tombée de la nuit, le jour des bordes « Foire des bôrdes », foire de Tournus où se tient la louée des domestiques. - (19) |
| bordes : tas de branchages, provenant des élagages des haies (« dâs râpes d’ traisses ») destinés à être brûlés sur place - (37) |
| Bôrdes n.f.pl. (du francique bord, cabane en bois, hameau) Feu allumé le premier dimanche de Carême. - (63) |
| bordes, s. m., feux qu'on allume, le soir du premier dimanche de carême, dans les rues d'un grand nombre de communes. On danse à l'entour, en toute effervescence de joie. Ils ne flambent pas sans occasionner quelques accidents. - (14) |
| bôrdes, s.f. pl. Les brandons ; premier dimanche de Carême, où on allumait un grand feu. - (38) |
| bordeure : Bordure. « Ol a plianté eune bordeure de bouis (buis) to le lang de l'allée de san jardin. » - (19) |
| bordille : objet sans valeur. - (30) |
| bordinet : petite marmite pour emporter la soupe aux champs. - (30) |
| bordiô, s. m., paquetage du soldat. - (40) |
| bordjaîn-ne (na) : hanneton - (57) |
| bord'lo : groupé, serré. Le troupeau s'est mis en bord'lo : le troupeau s'est rassemblé. - (33) |
| bôrdogueigne : n. m. Gâteau raté. - (53) |
| bordon (on) : bourdon - (57) |
| bordon : (bordon: - subst. m.) bourdon (insecte); mais le mot en est venu à s'appliquer à toutes sortes de coléoptères. - (45) |
| bordon : bourdon - (43) |
| bordon : bourdon - (48) |
| bordon : derrière, cul - (48) |
| bordon, beurdon n.m. Bourdon. - (63) |
| bordon, s. m. bourdon, insecte, mouche bourdonnante en général. - (08) |
| bordon. Bourdon (insecte). Cornemuse, biniou. - (49) |
| bordonner : bourdonner - (57) |
| bordonner : bourdonner - (48) |
| bordonner, beurdonner v. Bourdonner. - (63) |
| bordons. s. m. pl. Feux qu’on allume dans les campagnes le 1er dimanche de Carême, ou dimanche des Brandons. (Savigny-en-Terre-Plaine). - (10) |
| bordouler : grommeler, parler entre ses dents. - (52) |
| bordouler (beurdouler) : rouler quelque chose, tomber en roulant, bruit de l'orage qui roule - (39) |
| bordoulot : tas de foin, roules - (39) |
| bordouner, v. n. bourdonner, murmurer tout bas d'une manière continue. - (08) |
| bordzon : bourgeon - (43) |
| bordzon:( nm) bourgeon - (35) |
| bore (ö), vt. boire. - (17) |
| bôré (s’) : (s’bô:rè) "se goinfrer, s'empiffrer". Bourrer signifiait à l'origine "garnir de bourre". On dit encore qu'on bourre un matelas (d'où bourrelier) ; c'est à partir de ce sens qu'a prévalu celui d'"introduire de force". C'est ainsi qu'en patois on dit d'une machine qu'elle "bourre" lorsqu'il s'y engage un corps qui en entrave le fonctionnement. - (45) |
| bôré : (bô:ré: - subst. f.) bouffée, effluve d'une odeur plus ou moins agréable. Le mot (qui, par son appartenance à la famille de bourrer, suggère la compacité) décrit une odeur lourde et volontiers nauséabonde qui s'impose à notre olfaction. - (45) |
| bôre : boire. - (66) |
| bôre : (bô:r’ - subst. f.) bourre de fusil. - (45) |
| bôré : (bô:rè - v. tr.) bourrer, remplir jusqu'aux limites de la saturation . - (45) |
| bore : s. f. buse. - (21) |
| bore, boire. - (26) |
| bôre, boure : (bô:r’, bou:r’ - v. intr.) bouillir. - (45) |
| borea. Bourreau, bourreaux. - (01) |
| borêche : filasse de chanvre. A - B - (41) |
| bôrèche : Bourrache, borrago officinalis, plante médicinale. « Eune infusian de bôrache » : une infusion de bourrache. - (19) |
| borêche : filasse de chanvre - (34) |
| borèche : s. f. grosse pèlerine faite en boret. - (21) |
| boréchère : pièce de toile de chanvre placée dans les darêches* d'un char pour transporter le colza (en B : borèchire). A - (41) |
| boréchie, s. f. herbe serrée dans un tablier dont on a noué les quatre coins. - (24) |
| bôrée : bourrée (danse populaire) - (39) |
| bôrée, bourée, s. f. broutilles, la partie menue du branchage des arbres. Le bois est enlevé, ramassons la « bourée. » — danse qui tombe en désuétude comme le branle et la sauteuse. Les « bourées quarrées » avaient autrefois la vogue. - (08) |
| bôrée, bourrée (n.f.) : 1) la partie menue du branchage des arbres - 2) étape, degré d'avancement - (50) |
| boreillou (se) : chevelu(e)(avec connotation d'échevelé(e)) allusion à la « borre », la bourre des animaux - (51) |
| borelé, tourmenté. - (02) |
| boreller : (vb) s’agiter, s'affairer - (35) |
| borellon: (nm) personne désordonnée, qui s’agite beaucoup ; pli, bourrelet - (35) |
| borelôt (ō), sm. bourrelier. - (17) |
| boremfle : boursouflé - (39) |
| borenfle : enflé. - (32) |
| borenflé, boranfié. Enflé, boursouflé. - (49) |
| bôrenflle (ll mouillées) : Enflé, boursouflé. « Ol a si bin mau es dents qu'ol en a la joe (joue) tote bârenflle ». - (19) |
| bôrer (se) : se gaver de nourriture ou se dit d'un temps qui devient nuageux - (39) |
| bôrer : bourrer - (48) |
| bôrer : bourrer, remplir - (39) |
| borêsse : filasse de chanvre - (43) |
| borèsse : tignasse - (43) |
| boresses : cheveux - (51) |
| boret : gros verrou. - (30) |
| boret : s. m. étoffe grossière faite avec le gros chanvre. - (21) |
| borfè : Poumon, en tant que viande de boucherie. - (19) |
| borg : bourg - (43) |
| borg: (nm) bourg - (35) |
| borgé : berger - (48) |
| borgé : v. i. Tomber. - (53) |
| borgé. Répandre, verser, du latin vergere… - (01) |
| borgé. : Répandre (du latin vergere qui a le même sens dans Lucrèce). - (06) |
| borgeai - verser, renverser. - Fai don aitention, te va borger lai casserôle. - Le molaidroit, al é tô borger sai soupe su lu. - (18) |
| borgean : Bourgeon. « Les pommés ant bien des borgeans à frû » : les pommiers ont beaucoup de bourgeons à fruits. - (19) |
| borgei. Berger, bergers. - (01) |
| borgeire. Bergère, bergères. - (01) |
| borgener, v. ; remuer le foin dans les prés pour le faire sécher. - (07) |
| borgeois, bourgeois. - (05) |
| borgeois, s. m., bourgeois, citadin. - (14) |
| borgeon : barreau d'échelle. (MLV. T III) - A - (25) |
| borgeon : orgelet à l'œil. Compère-loriot. - (33) |
| borgeon. s. m., bourgeon, bouton à la figure. - (14) |
| borgeonner : retourner le foin - (48) |
| borger : déborder, passer par-dessus bord. - (32) |
| borger : déborder. (S. T III) - D - (25) |
| borger : faire déborder, un seau... (V. T IV) - A - (25) |
| borger : verser, renverser, déborder - (48) |
| borger : verser. - (29) |
| borger : berger. Le borger garde les borbis : le berger garde les brebis. - (33) |
| borger : (borjé - v. intr.) déborder d'un réctptent. - (45) |
| borger, borgère (n.m. et f.) : berger, bergère - (50) |
| borger, couler par-dessus bord, en parlant par exemple d'un verre trop rempli de vin. - (27) |
| borger, renverser une petite quantité de liquide d'un vase trop plein. - (28) |
| borger, v. intr., déborder, se répandre d'un vase trop plein, mais en s'appliquant au vase lui-même : « T' remplis trop ta casserole ; àll' va bor'jer ». - (14) |
| borger, v. n., déborder. - (11) |
| borger, verbe intransitif : déborder. - (54) |
| borger. Couler par-dessus le bord d'un vase trop plein ou simplement couler. - (12) |
| borger. Se dit d'un liquide qui s'échappe d'un vase trop plein. Quand lai tine ast trop pleine, le vin borge par les airoueilles. (Oreilles : trous destinés à passer le bâton qui sert à porter la tinne.) - (13) |
| borgére, s. f. bergère. - (08) |
| borgère. s . f. Bergère. - (10) |
| borgerie (n.f.) : bergerie - (50) |
| borgerie, s. f. bergerie. - (08) |
| borgerie. Bergerie, bergeries. - (01) |
| borgi. s. m. Berger. (Athie,Coutarnoux). - (10) |
| borgnalon, s. m. bosse disgracieuse dans une étoffe mal cousue. - (24) |
| borgnasser : v. n., regarder à la manière d'un borgne. Voir bornayer. - (20) |
| borgnassi v. Regarder à la manière d'un borgne, fureter d'un œil vif. - (63) |
| borgnat. s. m. Petit enfant. - (10) |
| bôrgne : orvet. A - B - (41) |
| borgne : (nm) orvet - (35) |
| borgne : orvet - (60) |
| borgne : orvet. IV, p. 32 - (23) |
| bôrgne n.m. Orvet. Ce nom lui a été donné en raison de sa vue, réputée déficiente. - (63) |
| borgne, borgnat : orvet - (43) |
| borgne, n.m. orvet. - (65) |
| borgne. n. m. - Orvet. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| borgne. Nom donné à l'orvet parce que l'on croyait que cet animal n'avait pas d'yeux. - (49) |
| borgniole, bergniole, bergnioule, bergniule (br'niôle, br'nioule, br'niùle) : s. f., corbeille en osier ou en vigne blanche (clematis vitalba), de forme ovoïde, portant une ouverture en son milieu ou parfois à l'une de ses extrémités. On l'emploie pour ramasser les noix, sécher les fromages, etc. Comparer le fr. bourgne et le vx fr. borgnon. Au fig., esprit borné, ganache. - (20) |
| borgnon : s. m., lampe borgne, petite lampe peu éclairante. - (20) |
| bòrgnon, s. m. lumignon. Petite pièce très obscure. - (24) |
| borgnon, s. m., cuite (au sens argotique). Avoir son borgnon. - (20) |
| borgnote : petite fenêtre. Voir « bournerotte ». - (62) |
| borgnotte (ai lai) : pénombre (dans la), demi-jour (dans le) - (48) |
| bòrgnòtte (C.-d., Chal.), bornòtte (Chal., Morv.), bônòtte (C.-d.). - Lucarne que sa forme fait ressembler à un oeil ; étant généralement unique, comme l'oeil du borgne, on peut penser qu'elle en a pris le nom. On peut croire aussi que ce nom provient de ce qu'on ne voit dans ces lucarnes que d'un oeil ou du coin de l'oeil, à cause de leur petitesse. Par extension, borgnotte signifie aussi recoin, cachette. - (15) |
| borgnotte : petite niche dans un mur. - (31) |
| borgnotte : petite ouverture. (A. T IV) - S&L - (25) |
| borgnotte, bornotte (ai lai) (loc.) : à tatons, entre chiens et loups (de Chambure écrit : bornote) - (50) |
| borgnotte, s. f., petite ouverture dans les murs du cellier ou de la cave. - (40) |
| borgnotte. s. f. Œil-de-bœuf, petite lucarne par laquelle on ne peut voir que d’un œil. De borgne. - (10) |
| borgnotte. Très petite fenêtre par laquelle on ne peut voir que d'un œil : Lai veille, entendant fraipper ai lai porte regardit par sai borgnotte. L'expression de « cabaret borgne » se comprend facilement. - (13) |
| borguignon, adj., bourguignon : « Borguignon salé. » - (14) |
| Borguignon, Bourguignon. - (16) |
| Borguignon. Bourguignon, Bourguignons. - (01) |
| boriâ, s.m. bourreau. - (38) |
| boriaud : personne cruelle - (34) |
| boriaud : personne cruelle - (43) |
| boriaud n.m. Homme cruel. - (63) |
| boriaud. Bourreau. Celui qui fait mal son travail. - (49) |
| boriaudé : abîmé, gros bétail crevé - (34) |
| boriaudé : abîmé, gros bétail crevé - (43) |
| boriauder : (vb) gâter, abimer - (35) |
| boriauder v. Abîmer par maladresse, maltraiter. - (63) |
| boriauder. Mal s'acquitter de sa tâche. Abîmer. Fig. Faire souffrir, martyriser. - (49) |
| boriô : personne cruelle. A - B - (41) |
| borioder : abîmer. Cadavre de gros bétail. A - B - (41) |
| borioder : abîmer - (51) |
| borioder : détériorer. - (30) |
| boriot : personne peu précautionneuse - (51) |
| bôrique, s. f., âne, mulet ; adj., imbécile. - (40) |
| borjé, renverser, laisser tomber un excès de liquide ; un vase qu'on emplit trop borje. - (16) |
| bôrjillon, s. m. petit bourgeois. - (08) |
| borjiyon, bourgeois paysan, demi-bourgeois. - (16) |
| borjon, bourgeon d'arbre, de vigne. - (16) |
| bôrjon, s. m. bourgeon, bouton qui renferme les feuilles et le fruit. Les borjons sont « ébaumis » ou épanouis. - (08) |
| borjon. Bourgeon. - (01) |
| borjonné, vn. grommeler. - (17) |
| bôrjoué, s. m. bourgeois. - (08) |
| borlo’ : gendarme. - (62) |
| borlot ou borelot, s, m., bourrelet de porte, qu'on ne prodigue pas assez, l'hiver. - (14) |
| bòrmater, v. n. se dit lorsque la respiration est gênée, avec bruit intérieur. - (24) |
| bornager (v. tr.) : gêner la vue, obstruer le champ visuel - (64) |
| bornatte. s. f. Petite ouverture, petite lucarne. C’est une altération de borgnotte. - (10) |
| bornayer, bournayer : v. n., bornoyer, fureter de l'oeil. Voir borgnasser. - (20) |
| bòrnàyer, v. a. regarder en dessous, observer sournoisement (du vieux français borgnoyer). - (24) |
| bornayou, s. m., gros pieu, avec lequel les mariniers empêchent les grands bateaux de toucher le bord. Pour cela, ils placent la pointe en terre et la tête contre le côté du bateau. - (14) |
| bôrne : Borgne. « Chez les éveuilles (aveugles) les bôrnes sant rois ». « Changi (changer) san chevau (son cheval) borne cantre eun éveuille ». On appelle borne l'orvet, petit reptile. - (19) |
| borne : Borne. « Plianter les bomes » : délimiter un champ. - (19) |
| borne : orvet - (37) |
| borne : orvet - (51) |
| borne, adj. borgne. Nous disons d'un homme qui a fait un mauvais marché : « al é choingé son ch'vau borne por eun aiveughie », il a changé son cheval borgne pour un aveugle. - (08) |
| borniére : taon - (39) |
| borniotte - fenêtre, ouverture petite et isolée. - I les regairdâ pou lai borniotte ; à ne s'en doutaint dière. - En n'i é qu'ine borniotte ; âssi en n'y voit pas cliair du tot. - (18) |
| borniotte : n. f. Petite fenêtre. - (53) |
| bornote (ai lai), loc. a la borgnette, à tâtons, entre chien et loup. - (08) |
| bornote ou borgnote, s. f., coin, recoin, niche, cachette toute naturelle du paysan. C'est un des petits interstices qui se rencontrent à l'intérieur des murailles, entre les pierres mal jointes dont elles sont bâties. - (14) |
| bornotte, s.f. petite ouverture dans un grenier, un fenil ; gros trou dans un mur. - (38) |
| bornöyi: (adj) qui ne voit pas bien - (35) |
| bornure, creux d'arbre. - (05) |
| borô, plaisanterie grossière. - Les Bretons disent borod pour exprimer le radotage. (Le Gon.) - (02) |
| bôroillon - amas de plis ennuyeux et de mauvais effets, par exemple dans les vêtements, dans le lit. - Aipruchez don voué qui vos airaingeà in pecho, vos êtes des vrais boroillons. - (18) |
| boron : furoncle. A - B - (41) |
| boron (on) - borgeon (on) : épinier - (57) |
| boron : (nm) furoncle, fagot, botte de paille - (35) |
| boron : furoncle - (43) |
| boron : furoncle - (44) |
| borradze : herbe fournie et serrée dans le foin - (51) |
| borrâdze : herbe sèche qui reste dans les pâturages en fin de saison - (43) |
| borradze : seconde herbe d'un pré dont la première a été fauchée. - (30) |
| borradze n.f. Refus, herbe sèche qui reste dans les pâturages en fin de saison. - (63) |
| borraler, borrèler v. (de bourreler dans le sens de torturer). 1. Travailler sans efficacité. 2. S'agiter inutilement. 3. Emmêler, mélanger, chiffonner. - (63) |
| bòrrat, s. m. grosse étoffe à tablier, à « chari ». - (24) |
| borre : bourre des animaux - (51) |
| bôrre : Bourre. Ce mot a plusieurs sens bien distincts « bôrre de feusi » : bourre de fusil ; « Le jû de bôrre » : jeu de cartes ; « Eune bôrre » : une buse (oiseau). - (19) |
| borrèche n.f. 1. (lat. pop. burracea) Filasse de chanvre. 2.Tignasse. - (63) |
| borrèchon n.m. Cheveux ébouriffés ou personne mal peignée. - (63) |
| borrèler v. Voir borraler. - (63) |
| borrèlon n.m. 1. Personne désordonnée qui s'agite beaucoup. 2. Emmêlement de fils, ficelles, cordes, tissus. - (63) |
| borrer v. (de bourre) Ecumer. - (63) |
| bôrret : Tissu de toile grossière. «Eune culotte de bôrret ». - Proverbe : « La né la toile simble du bôrret », ce qui équivaut à la nuit tous les chats sont gris. Bourrée, « dansi in bôrret », le bôrret c'est la bourrée charollaise. - (19) |
| bôrriâ : n. m. Bourreau de travail, bûcheur. - (53) |
| borriau (-de), bourriau (-de) : s. et adj. m. et f., brutal, bourreau. - (20) |
| borriau : Bourreau, cruel. On dit de quelqu'un qui se tue au travail : « Ol est borriau de san c'eu » : il est bourreau de son corps. - (19) |
| borriau, adj. qui prend plaisir à faire souffrir, bourreau. Féminin borriaude. Verbe borriauder. - (24) |
| borriauder : Faire souffrir, faire du mal à un animal en s'amusant avec lui. - (19) |
| borriauder, bourriauder : v. a., bousculer, brutaliser. Ne m’borriaude donc pas comme ça. Te m'as toute bourriaudé c'te marchandise. - (20) |
| borrique : (nf) bourrique, mule - (35) |
| borrique : âne, ânesse - (51) |
| borrique : bourrique - (43) |
| borrique n.f. Ane. Voir baude. - (63) |
| borron : paquet de bourre ou de fil. - (30) |
| borron n.m. (de bourre). 1. Furoncle. 2. Fagot, botte de paille. 3. Paquet de fil, de ficelle. - (63) |
| borru : poilu - (34) |
| borru adj. Lait bourru, lait fraîchement tiré et mousseux. Vin bourru, vin blanc nouveau non fermenté et d'aspect trouble. - (63) |
| borru n.m. Bogue, enveloppe de la châtaigne. Borru de tsâteugne. Lait fraîchement tiré et mousseux. Vin non fermenté et d'aspect trouble. Avaler tot borru (sans mâcher). S'coutsi tot borru (tout habillé). - (63) |
| borse : Bourse. « Eune plieine borse d'écus ». « Sarrer les corjans (cordons) de la borse », réduire la dépense. On dit d'un malaise ou d'une chose embarassante : « Cen me gène pu que ma borse ». - (19) |
| borse roge : Rouge gorge. « In nid de borse roge ». - (19) |
| borse, s. f. bourse : « i n'é ran dan mai borse. » - (08) |
| bôrse, s. f., bourse. - (40) |
| borse, s.f. bourse. - (38) |
| borse. Bourse, bourses. - (01) |
| borse. s. f , bourse, petit sac. - (14) |
| borse-ruge, rouge-gorge. - (05) |
| borsonner, beûrsonner : résonner - (37) |
| bortié, bizarre diminutif de Barthélémy. - (08) |
| Bôrze, Bourges dans le langage des plaideurs du Morvan. - (08) |
| bos : (bô: - subst. m.) bois. 1 – matériau – 2 - forêt. - (45) |
| bôs : (nm) bois - (35) |
| bôs : bois. Un morceau de bois, et aussi la forêt. - (62) |
| bôs d'tsin n.m. Bourdaine. Ce nom de bois de chien semble venir non pas du fait que l'écorce est un laxatif mais de ce que le charbon de bois servait à fabriquer la poudre noire utilisée dans les fusils à chiens. - (63) |
| bôs n.m. Bois, forêt. - (63) |
| bôs pnâ, s.m. bois punais, cytise. - (38) |
| bôs : s. f. : grand portevoix dont se servait la maîtresse de maison dans les grandes fermes de Bresse, pour se faire entendre de tous les coins du « domaine ». - (21) |
| bos, bois. - (04) |
| bos, s. m. bois dans ses divers sens - (08) |
| bos, s. m., bois, forêt ; « N' t'en vas pas cori les bôs. » - (14) |
| bôs, s.m. bois. - (38) |
| bôs, sm. bois. - (17) |
| bos. Bois. - (03) |
| bosché, (bô:ché - v. tr.) boucher. Le sens premier de boucher est "obturer avec une bouche" (une touffe) ; et le patois ne s'en éloigne guère quand il dit : bô:ché oen' bros' "boucher une haie". - (45) |
| boschon, (subst. m.), buisson. - (45) |
| boschou, (bô:chou - subst. m.) bouchon et parfois bou:chou par dilation ou attraction du français. - (45) |
| boscot, adj., bossu : « As-tn vu passer l’boscot ? Ol é drôle : deux pouces de jambes, é pi l’c... tout d' suite ». - (14) |
| boscôt, adj., tordu, bossu. - (40) |
| boscot, boscotte. (n.m. et f.) : bossu, bossue - (50) |
| boscot, otte, adj. bossu, celui qui porte une bosse. - (08) |
| boscule : voir comblette - (23) |
| bôsculer, v., faire tomber, - (40) |
| bosculon. s. m. Dernier né d’une famille ou d’une nichée. Bos pour bas, prononciation picarde de basculon. — A Perrigny-lès-Auxerre, on dit Bas-Culot. - (10) |
| boskeuler v. Bousculer. - (63) |
| boslé : (subst. m.) bûcheron, dérivé de bos. - (45) |
| boslée (n. f.) : mesure de superficie égale environ à dix ares et correspondant à la surface ensemencée avec un boisseau de grains - (64) |
| bosqueler : renverser. (RDM. T IV) - B - (25) |
| bosqueuler (v.t.) : bousculer - (50) |
| bosqueuler : bousculer - (43) |
| bosqueuler, v. n. bousculer, rouler. De bosse et cul ? - (08) |
| bosqueulon, s. m. le dernier né d'une couvée d'oiseaux de basse-cour, celui qui ne pouvant suivre la troupe « bosqueule » sans cesse en chemin. - (08) |
| bossaudâdze n.m. Bricolage maladroit. - (63) |
| bossauder v. Bricoler maladroitement. - (63) |
| bòssàyer, v. a. produire des bosses. - (24) |
| bôsse : (nf) bourse - (35) |
| bossé : jeune veau, petit gamin - (43) |
| bosse n.f. Bourse. Voir gornaude. - (63) |
| bosse rodze : rouge-gorge. A - B - (41) |
| bosse rodze : rouge-gorge - (34) |
| bösse, sf. bosse. - (17) |
| bosse-cul : s. m., chute sur le ventre. On entend dire couramment quand on a fait un bosse-cul : « J'suis tombé sur le ventre, ça m'a répondu dans l’dos. » Rapprocher de passe-cul et plat-cul. - (20) |
| bosselée - boisselée : mesure de surface cultivée correspondant à environ 750 m2. C'est l'expression quasi-exclusivement utilisée. - (58) |
| bosser. Former une bosse. On dit « bosser du dos » pour être bossu. - (49) |
| bosseule. s. m. Petit panier. (Tronchoy). - (10) |
| bôsseure, nom propre. Région basse bordant les deux rives de la Saône. - (22) |
| bossiau - bouéssiau : boisseau, mesure à grains. Ex : "Doune moué don un bouéssiau d'avouène !" - (58) |
| bossicauder : bricoler avec les moyens du bord - (51) |
| bossicauder v. (du brionnais boussicauder, réparer grossièrement) Travailler sans goût, laisser s'abîmer. Voir boriauder. - (63) |
| bossiller, v. a. faire des bosses, déformer par des bosses, bosseler. Une cuiller, une casserole, une timbale « bossillées », plus souvent « bosseillées. » - (08) |
| bossiot (n. m.) : boisseau - (64) |
| bosson n.m. Barreau d'échelle plat et renflé en son milieu. Le beûdzon est rond. Voir ce mot. - (63) |
| bosson : n. m. Jumeau. - (53) |
| bosson, bossonne. Pour besson, bessonne, jumeau, jumelle. Etym. le bas latin bisso. - (12) |
| bosson. Échelon. - (49) |
| bossons (n.m. pl.) : jumeaux - (50) |
| bossons : jumeaux - (48) |
| bossons, s. m. plur. Jumeaux. Aux environ de Montsauche : « boussons ». - (08) |
| bost’ieulé, v. a. basculer. - (22) |
| bost'ieuler, v. n. basculer. - (24) |
| bostiqueule : 1 n. f. Gymnastique. - 2 n. f. Pirouette. - (53) |
| bôsure, sf. boiserie. - (17) |
| bot - une sorte de crapaud qui fait entendre son cri le soir surtout. - Ecoute don les bots ; i airon soingement de tems. - (18) |
| bot (n.m.) : crapaud - (50) |
| bot : (bo - subst. m.) gros crapaud. On dit aussi libo ; s'agit-il d'une agglutination de l'article ? - (45) |
| bot : s. m., vx f r., crapaud ; bossu. Un vieux bot (ne pas comprendre un vieux- beau) : homme bossu, au nez crochu, aux doigts... aussi, bref, difforme au physique et au moral. - (20) |
| bot, bô, s. m. crapaud. - (08) |
| bot, bô, tô, tou : crapaud - (48) |
| bot, crapaud - (36) |
| bot, crapaud. - (05) |
| bot, s. m., crapaud. - (14) |
| bot. Crapaud. - (12) |
| bot. Sorte de crapaud. Dans quelques pays on appelle botterelle un petit crapaud. Le bot jouait un grand rôle dans les sortilèges. Ce mot n'a aucune analogie avec pied-bot : le dernier vient d'une ressemblance avec le pied d'un bœuf. - (13) |
| bôtai. Botter, bottez. - (01) |
| botailli : Echanson. Aux noces le botaïlli est non seulement chargé d'apporter sur la table le vin à l'usage des convives mais il doit aussi accompagner le cortège à l'église et dans toutes ses pérégrinations à travers le village. Il porte un broc rempli de vin vieux et offre à boire à tout venant dans une petite tasse d'argent, un tâte-vin, tandis que le « panneté » offre du « cac'eu ou du flian ». - (19) |
| bôtale, s. f., bouteille. - (40) |
| botame: Bouteille. « Eune botaille de vin blian ». « Payer botaille » : offrir à boire. Ampoule d'eau que forme la pluie tombant sur une surface liquide. « Quand y fa des botailles y est signe que la plio va deurer », c'est signe que la pluie va durer. - (19) |
| botan : Bouton, «T'as dan point de botans dans tan gilet ? - Nan - A cause dan ? - Ma grand les pren dans le panetot à Mile à peu y en a plieu.» : Tu n'as donc pas de boutons à ton gilet ? - Non - Pourquoi donc ? - Ma grand-mère les prend dans le paletot d'Emile et il n'y en a plus. - Bouton de fleur : « T'es fraiche c 'ment in botau de rose ». - Eruption cutanée : « Aile a la figure plieine de botans ». - (19) |
| bôtan. Mettant. - (01) |
| botasse, boutasse : s. f., petite mare d'eau croupissante, - (20) |
| bot'chiau : résidu de paille après battage que l'on attachait en bottes - (39) |
| bôté, adj. gâté, avarié. Ne s'applique qu'au vin ayant le goût du bois, du fût. - (08) |
| bôtea de foin. Petite botte de foin. - (01) |
| bôtée, s. f. dépôt d'huile ou de tout autre liquide qui demeure au fond d'un vase, lie. - (08) |
| boteille, bouteille. - (04) |
| bôteille, s. f. bouteille. - (08) |
| botenchlle, adj. bouffi, par œdème particulièrement. - (24) |
| botener : Mettre le bouton dans la boutonnière. « Botene dan ma culotte ». - (19) |
| botenère : Boutonnière. « Ol a mis eune rose à sa botenère ». - Coupure : « O s'est copé d'ave sa sarpe (serpe) i l'y a fait eune balle (belle) botenère ». - (19) |
| boter : chasser (anc. franç. : bouter). - (32) |
| boter. Mettre, apporter : en vieux français bouter. Un boute-feu était un instrument servant à mettre le feu aux canons. Un boute-en-train est celui qui apporte la gaîté dans une réunion... - (13) |
| bôteret, s. m. crapaud. Le mot est un diminutif de bot. - (08) |
| boteri. Enfant gros et court... - (13) |
| bòteriau, s. m. gros crapaud (du vieux français botereau). - (24) |
| boteuill i: (vb) (en parlant de la pluie) faire des bulles en tombant dans l'eau - (35) |
| boteuille : (nf) bouteille ; grosse bulle se formant sur l'eau quand il pleut - (35) |
| boteuille : bouteille - (43) |
| boti : crapaud. - (33) |
| botin : s. m. essieu de la roue. - (21) |
| bôtin, s. m. moyeu : un « bôtin » de roue. - (08) |
| boting (n.m.) : moyeu - (50) |
| botint : Moyeu. « J'ins passé pa des chemins queva le chè enrotait jeusqu 'au botint » : nous sommes passés par des chemins où le char enfonçait dans la boue jusqu'au moyeu. - (19) |
| botique, s. f., boutique. Se dit, en mauvaise part, de tout groupe d'individus sans considération. - (14) |
| bot'ner. Boutonner. On dit aussi « abotner », aboutonner. - (49) |
| bôtnére : n. f. Boutonnière. - (53) |
| bot'nére. Boutonnière. - (49) |
| botnîre n.f. Boutonnière. - (63) |
| bötoïlle, sf. bouteille. - (17) |
| botoille. : (Dial. et pat.), bouteille. - (06) |
| bötoïllon, sm. petite bouteille. - (17) |
| boton : (nm) bouton - (35) |
| boton : bouton - (43) |
| boton : bouton - (51) |
| boton n.m. Bouton (de vêtement). - (63) |
| bôton, s. m. bouton d'habit. - (08) |
| boton, s. m., bâton. - (14) |
| boton. Bouton. - (49) |
| bòtonner, v. n. bouillir faiblement : la bouillie bòtonne. - (24) |
| botot, adj., homme de petite taille. - (11) |
| bôtré. Mettra, mettras ; je bôtrai, je mettrai ; tu bôtré, tu mettras ; ai bôtrai, il mettra ; vo bôtré, vous mettrez. L'infinitif c'est bôtre, de l'ancien verbe français bouter. En bourguignon, un bôtantrain se dit d'un homme qui anime les autres, soit au plaisir, soit au travail. Les tétons d'une belle, ses caresses, en ce langage-là, s'appellent des bôtantrain. Ce mot en français, lorsqu'on en use en riant, se doit écrire boute-en-train, et non pas bout-en-train. - (01) |
| bôtre. : Mettre, part. bottu (voir au Glossaire de Lamonnoye). - Le même mot est boteir et bouter dans le dialecte (du latin pulsare), celui qui excite ou anime une compagnie à quelque divertissement se nomme un bôtantrein (un boute-en-train). - (06) |
| botreau, botriau : s. m., vx fr, botrel, crapaud. Voir boutron. - (20) |
| botrée : (botré: - subst. f.) colostrum, premier lait d'une vache qui a vêlé. Ce lait, très gras et plus ou moins mêlé de sang, est parfaitement inconsommable : on le donne aux poules, mélangé à leur pâtée. Le mot ancien est béton, donné encore par Littré au sens de "lait trouble et épais contenu dans les mamelles au moment de l'accouchement." - (45) |
| botret (on) : crapaud - (57) |
| botriau ou botraie. Crapaud. Se dit aux enfants comme tenue injurieux. - (03) |
| botriau, s. m., crapaud. Dans les environs de Chalon-sur-Saône, on emploie volontiers l'abréviatif Bot. - (14) |
| botriller. v. n. Bien étriller, sorte d’antiphrase, pour dire : faire une chose sans soin. - (10) |
| botroe ou botte-roe : Bouteroue, grosse pierre placée à l'angle d'une porte cochère pour en préserver les montants du contact des roues d'un char qui tourne trop court. - (19) |
| botron : ruche - (37) |
| botse : (nf) bouche - (35) |
| botse : bouc - (43) |
| botsie : (nf) bouchée - (35) |
| botson : (nm) bouchon - (35) |
| bottacul : petit homme (par dérision, le haut de sa botte lui arrivant jusqu'aux fesses). A - B - (41) |
| bottacul : (nm) personne de petite taille - (35) |
| bottacul : par dérision, petit homme (auquel le haut de la botte arrive jusqu'aux fesses) - (34) |
| bottacul : petit homme (auquel le haut de la botte arrive jusqu'aux fesses) - (43) |
| bottacul n.m. Tout petit homme. - (63) |
| bottain : moyeu de roue - (60) |
| botté (pour bouté). adj. et part. p. Qui pousse, qui tourne au gras. Se dit en parlant du vin. J’beuvons du vin botté, qui n’est gué bon. - (10) |
| botte : Usité dans l'expression « Cavalier ma botte », nom d'un jeu enfantin qui consiste à faire deviner le nombre de menus objets que l'on cache dans sa main fermée : « Cavalier ma botte ? Si y en a trois je les emporte ». Si la réponse est juste les trois objets, billes, dragées etc… sont acquis au devineur, dans le cas contraire il paie la différence en plus ou en moins. - (19) |
| botte : (bot' - subst. f.) faux gîte où le lapin trouve refuge pendant la journée (à ne pas confondre avec son terrier). - (45) |
| botte : s. f. gros tonneau contenant deux pièces de vin. - (21) |
| botte : s. f., queue, ancienne mesure de capacité pour les liquides, valant deux tonneaux, c'est-à-dire 418 litres, 332. En Bourgogne, « la queue compose deux muids, ou autrement dit deux poinçons ; le muid deux feuillettes ; la feuillette, deux septiers ; le septier 8 pintes, par conséquent la queue 280 pintes. » (Almanach du Mâconnois, 1786, p. 136). - (20) |
| botté : se dit d'un fruit blet - (39) |
| botte, baril, tonneau, vin botté (Vin botté, littéralement vin qui a le goût de fût, et, par extension, vin piqué.) - (04) |
| botte, crapaud, bot. - (04) |
| botté. adj. - Mauvais, aigre ; se dit d'un vin qui a tourné. - (42) |
| botte. Ruche sans cadre, fabriquée avec des torons de paille. - (49) |
| botteriaud n.m. (du vx.fr. boutrel, crapaud) Garnement. - (63) |
| bottes : bottes de foin, nom donné aux ballots de foin ou de paille ronds ou carrés. - (59) |
| bottet. s. m. Nain, très-petit, haut comme une botte. (Percey). - (10) |
| bottiot (n. m.) : menu brun de paille qui tombe de la batteuse après avoir été broyé - (64) |
| bottre, v. ; mettre. - (07) |
| bottre, v. battre. - (38) |
| botzis. s. m. Nombril. (Pressis-Saint-Jean). - (10) |
| boü : le plus petit de la nichée - (60) |
| bou, bois. - (05) |
| bou, bouillu, boulu. Formes diverses du part. p. de bouillir. Le lait est bou. La soupe n’a pas boulu . Quaild la mat’ lote aura assez boullu , tu l’ôteras de dessus le feu ; faut pas qu’ all’ cuise trop. - (10) |
| bou, morceau ; bou de bô, morceau do bois ; bou d'pèn, morceau de pain. - (16) |
| bou. Bout. - (01) |
| bouaice, bouche - (36) |
| bouaiché : v. t. Casser la coquille au moment de l'éclosion. - (53) |
| bouaicho (Ai) - voyez Boicheton (Ai), qui a le même sens. - (18) |
| bouaill 'naude : n. f. Soupe du soir. - (53) |
| bouain-né : Macéré. « De la salade bouain-née ». - (19) |
| bouair' : v. t. Boire. - (53) |
| bouaîre (ailer) l’vârre : (se rendre) à l’auberge pour y boire - (37) |
| bouaire (v.t.) : boire - (50) |
| bouaîre : boire - (57) |
| bouais (n.m.) : bois - (50) |
| bouaîs d’ treûffes : fanes, « brous » de pommes de terre - (37) |
| bouais : bois - (39) |
| bouais. n. m. - Bois. - (42) |
| bouaiser : boiser - (57) |
| bouaisson (na) : boisson - (57) |
| bouaitailli - chambilli : boiter - (57) |
| bouaitcher (on) : boîtier - (57) |
| bouaite (na) : boîte - (57) |
| bouaitou (on) : boiteux - (57) |
| boualer (verbe) : mugir, meugler. - (47) |
| boualer : beugler (taureau) - (48) |
| boualer, (bouâ:lè - v.intr.) en parlant d'un taureau, émettre un cri grave et profond. Peut se dire au figuré d'un mauvais chanteur qui chante fort. - (45) |
| boualer, v. n. beugler, mugir. se dit pour les ruminants en général, mais principalement pour les bœufs. - (08) |
| bouame, boime : hypocrite, flatteur, intéressé et fourbe (peut-être dérivé de bohème). - (30) |
| bouanfle, s. f. vessie, lorsqu'elle est pleine de gaz. - (08) |
| bouârne (on) : borgne - (57) |
| bouârne (on) : orvet - (57) |
| bouarne. s . f. Sorte de niche pratiquée dans la cheminée, près de l’âtre, pour mettre une cruche. - (10) |
| bouayau (on) : boyau - (57) |
| boubiner (Se). v. pronom. Se ramasser sur soi-même, se peletonner comme font les chats. De bobine, petit cylindre de bois sur lequel on enroule le fil. - (10) |
| bouc, s. m. petit pied-de-chèvre qu'on emploie pour soulever des pièces de bois, pour les mettre en chantier. - (08) |
| bouc. s. m. Chèvre, bique, sorte de chevalet à l’usage des bûcherons. - (10) |
| bouç’eûre : « boûchûre », haie - (37) |
| boucajge, s. m. bocage, petit bois. - (08) |
| boucan, bruit, tapage. - (05) |
| boucan, s. m. Bruit, tapage, querelle ; par allusion à la vie bruyante et querelleuse des boucaniers. - (10) |
| boucan, s. m., gronderie, bruit, querelle, tapage : « Drès qu'ôl a levé l' coude, ô vous fait eun boucan d' tous les diâbes ». Signifie également : un lieu mal famé. - (14) |
| boucan. Bordel. Boucan n’est pas un terme bourguignon. Il est familier au menu peuple de Paris, et c’est pour cela qu'un cordelier de Dijon , nommé le P. Boucan, étant à Paris, fut obligé de changer son nom. Au lieu de Boucan, dont la signification n’était pas honnête, il se fit appeler le P. Beauchamp. - (01) |
| boucan. Tapage, Ces mandrin-lai ont fait du boucan tente lai neut. Ce mot n’est pas exclusivement bourguignon... - (13) |
| boucaner (s') (v. pr.) : se fâcher, se brouiller avec quelqu'un - (64) |
| boucaner, v. a. gronder avec vivacité, en se fâchant, faire du tapage. - (08) |
| boucaner, v. tr., gronder, querellerLes localités qui ont le substantif ont aussi le verbe. (V. Boucan). - (14) |
| boucard. s. m. Bouc. - (10) |
| boucarner v. (or. inc.) Regarder sournoisement. - (63) |
| boucasse. s. f. Bécasse. - (10) |
| Bouchar, nom de bœuf. - (08) |
| bouchard : s. m., plaque de tôle, qui sert à boucher la gueule du four. - (20) |
| boucharde : s. f., nom donné aux fauvettes et, par extension, à d'autres petits oiseaux. - (20) |
| boucharde, n.f. fauvette. - (65) |
| boucharde, s. f. fauvette. - (22) |
| boucharder (Se). v. pronom . Se débarbouiller. (Gisy-les-Nobles). - (10) |
| bouchas. s. m. Boisseau. - (10) |
| bouchau. Cligne-mussette , et par corruption climussette , jeu d'enfants, appelé en bourguignon bouchau, parce qu'un des joueurs s'y bouche les yeux, pendant que ses compagnons se cachent. Cligne-mussette formé de cligner et de musser, exprime mieux l'action entière du jeu… - (01) |
| bouche du pain. Je crois que cette expression peut se renvoyer au mot boquai. (Voir ce mot.) En effet, la bouche du pain se dit, dans nos campagnes, pour exprimer les parties où il y a un contact entre deux miches de manière à former ce qu'on nomme ailleurs la baisure du pain.... - (02) |
| bouche trou, n.m. dernier-né d'une famille ou d'une portée d'animaux. - (65) |
| bouché : s. m., vin bouché, vin conservé en bouteille. - (20) |
| bouche, s. f. Se dit indépendamment de bocote, et à un sens piquant dans cette loc. bien locale : « Etre sur sa bouche », pour : être gourmand. « Alle é ben gentite, mâ alle é trop su sa bouche ». (Voir Bocote). - (14) |
| boucheau, s. m. boisseau. - (08) |
| bouchée : s. f., conteru de la bouche. Une bouchée de vin. - (20) |
| bouche-four, s. m., plaque en tôle fermant, bouchant le four pendant la cuisson du pain. - (14) |
| boucheille, s. f. clôture en branchages. - (22) |
| bouchelée (n.f.) : boisselée (mesure agraire de 12,50 ares environ) - (50) |
| bouchelée, s. f. boisselée, mesure agraire très usitée dans le Morvan. - (08) |
| bouchener. Bouchonner, frotter, essuyer un cheval avec un bouchon de paille. - (49) |
| boucher : s. m. — Boucher de grosse viande, boucher ordinaire. — Boucher de cabri et boucher de cochon (ce dernier est toujours un Bressan), viennent vendre leurs viandes respectives au marché. - (20) |
| boucher, v. a. clore une entrée, fermer une ouverture de haie avec du bois vif ou mort, avec de la « boucheure. - (08) |
| boucher, v. couvrir. - (65) |
| boucher. Pris pour fermer. II y a encore un autre sens, mais au figuré, et loin de celui-ci : boucher la vue. - (12) |
| bouchet. s. m. Bichet. Un bouchet de blé. — Se dit aussi pour boisseau. - (10) |
| boucheton (à) : tourné à l'envers - (60) |
| boucheton (à), loc, exprimant la posture d'une personne accroupie : « O s'a couché à boucheton por jouer d'avou l’petiot ». - (14) |
| boucheton (à), placé sens dessus dessous. - (27) |
| boucheton (à). loc. adv. - À l'envers. Se coucher à boucheton : se coucher sur le ventre. Poser un récipient à boucheton : le poser à l'envers. - (42) |
| boucheton (ai), loc. a boucheton, sens dessus dessous. Être couché « à boucheton », à plat ventre, sur la bouche. - (08) |
| boucheton(A). locut. adv. Sens dessus dessous. Se coucher à boucheton , se coucher la bouche sur l’oreiller. Placer un vase à boucheton , le poser sur son ouverture. - (10) |
| boucheton. : Attitude d'une personne accroupie. (Del.) -Se bôtre ai boucheton, c'est-à-dire s'accroupir. (Voir dans Ducange le mot de basse latinité bucellus.) - (06) |
| bouchetons (ai), loc. adv. Sens dessus dessous. Se dit d'un verre ou d'une cuve, le pied ou le fond en l’air. - (17) |
| boucheûre (n.f.) : haie vive - (50) |
| boucheûre (na) - bouchure (na) : clôture (autour d'un champ) - (57) |
| boucheure : Haie vive. « Eune boucheure d'arbépin » une haie d'aubépine. - (19) |
| boûcheure : haie - (48) |
| boucheûre : haie. Viendrait de « embouche » : prairie (close parfois de haies) où les bestiaux sont mis pour engraisser. - (62) |
| boucheure : bouchure (haie). - (33) |
| boucheure, s. f. bouchure, haie vive, haie qui forme un enclos. Se dit aussi des branchages qu'on emploie pour clore les entrées, les ouvertures des champs. J’ai acheté de la « boucheure. » - (08) |
| bouchi (on) : boucher - (57) |
| boûchi : boucher (verbe) - (57) |
| boûchi : Boucher (verbe) « Ce vent est bien ennuant, va dan bouchi le partu queva o dessôt » : ce vent est bien ennuyeux, va donc boucher le trou par où il passe. « Du vin bouchi » : du vin vieux, « Donne no du vin bouchi ». - (19) |
| bouchi : Boucher. « Le bouchi a ageté man viau » : le boucher a acheté mon veau - (19) |
| bouchie, sf. bouchée. - (17) |
| boucho, s. m., bouchon, bouchon de cabaret, touffe de paille, de verdure ou de branchages pendue à la porte du débit pour renseigner le chaland... qui n'en a pas besoin. - (14) |
| bouchon (à) : Ioc. adv-, vx fr., face contre terre, sens dessus dessous. Mettre à bouchon. Voir aboucher. - (20) |
| bouchon (à), loc, sens dessus dessous, renversé : « O s'batteint, Liaude a fichu eùne torgnole à Cadet, qu’a roulé à bouchon ». - (14) |
| bouchon (à), loc. appliqué face contre terre. Verbe abouchi. - (22) |
| boûchon : buisson, bosquet (petit) - (48) |
| boûchon : genévrier suspendu à une potence signalant un débit de boisson. Signifie aussi : petit bosquet : un boûchon d'acacias. - (33) |
| bouchon : s. m., bouchure, haie vive. - (20) |
| bouchon : s. m., couvercle. Bouchon de latrine, terme méprisant pour désigner un individu de petite taille. - (20) |
| bouchon, beuchon (n.m.) : buisson - (50) |
| bouchon, buisson. - (26) |
| bouchon, n. masc. ; buisson. - (07) |
| bouchon, s. m. Buisson, ainsi appelé sans doute, parce que les buissons servent à clore, à boucher ; vient peut-être aussi du latin bosius. - (10) |
| bouchon, s. m. buisson, petit bois : « i é léché mai vaiche dan lé bouchons », j'ai laissé ma vache dans les buissons. - (08) |
| bouchon, s. m. clôture en branchages. - (24) |
| boüchon, s. m., couvercle de la marmite de fonte. - (40) |
| bouchon, subst. masculin : couvercle. - (54) |
| bouchon. Bouchoir. Porte de fer servant à la fermeture du four. - (49) |
| bouchon. Pris pour couvercle. - (12) |
| bouchonbordonner. Bourdonner. Marmotter par mécontentement ; chantonner faiblement ; grogner « au bordonne todzo ». - (49) |
| bouchonné. - Étrier un cheval, d'où le mot bouchon de paille qu'on employait faute d'étrille. Le dialecte emploie le mot boucheter. - (06) |
| bouchot, s. m., buisson, bouquet d'arbres : « Eun bouchot d’bois ». - (14) |
| bouchot. : Buisson. Un bouchot de bois, c'est-à-dire une agglomération d'arbres sur un point. En dialecte bourguignon, bouchet ; en dialecte picard, bouchel ; en basse latinité, boscus. (Duc.) - (06) |
| boûchoû : bouchon - (48) |
| bouchouée. n. m. - Couvercle de seau hygiénique. (Sougères-En-Puisaye) - (42) |
| bouch'ton (è): renversé. - (52) |
| bouchue (n. f.) : haie vive - (64) |
| boûchue : haie vive. III, p. 61-k - (23) |
| bouchue : (bouchure) haie vive de clôture de jardins, de prés, de surfaces de culture. - (58) |
| bouchue, bouchure. s. f. Clôture d’un champ faite de branches d’arbres ou d’épines fichées entre des pieux. Dans la Puysaie, les clôtures sont quelquefois de véritables forêts composées d’arbres entourés de broussailles ayant jusqu’à dix métrés d’épaisseur. - (10) |
| bouchure (Chal., Char., Y.), boucheure (Morv.).- Haie, buisson formant la clôture d'un champ. Dans la Puisaye, les bouchures forment parfois de véritables forêts, entourées de broussailles ayant jusqu'à dix mètres d'épaisseur. Ce mot semble venir simplement du verbe boucher, pris dans le sens de clore, bouchure pour clôture. Il pourrait cependant a voir la même origine que buisson, lequel vient du latin boscus, qui a formé également bosquet. Dans la Côte-d'Or, un buisson s'appelle un bouchot, terme qui se rapproche sensiblement de bouchure. - (15) |
| bouchure (verbe) : haie. - (47) |
| bouchure : haie (trace) - (60) |
| bouchure : haie - (48) |
| bouchure : buisson. (CH. T II) - S&L - (25) |
| bouchure, bôcheure : n. f. Haie. - (53) |
| bouchure, bouchue. m. f. - Haie. - (42) |
| bouchure, n.f. haie. - (65) |
| boûchure, s. f., haie vive séparant deux champs. - (40) |
| bouchure, s. f., haie vive, généralement celle qui clôt une propriété. - (14) |
| bouchure, sf. entrée dans une haie. - (17) |
| bouchure. Haie. - (49) |
| bouci, boula : pêle-mêle - (60) |
| bouci-boula (adjectif) : méli-mélo, désordre. - (47) |
| bouci-boula. expr. - Désordre, pagaille : « Te parles d'un bouci-boula dans c'tarmouée. » - (42) |
| boucle, ampoules aux pieds, aux mains. - (16) |
| bouclotte, s. f. bouclette, petite boucle, agrafe, crochet. En plusieurs lieux « bouquiotte. » - (08) |
| boucôte (prononcez bouceûte), petite bouche. - (02) |
| boucote, s. f., bouchette, petite bouche. Nous ne craignons pas les diminutifs. - (14) |
| boucôte. Petite bouche. - (01) |
| boucrelot. s. m. Vieillard marchant péniblement à l’aide d’un bâton. - (10) |
| bouculet : dernier-né, petit (bachois) - (60) |
| boudar, s. m. cavité fangeuse sous la roue d'un moulin. - (08) |
| boudeliner. v. - Rapetisser. (Merry-la-Vallée, selon M. Jossier) - (42) |
| boudeliner. v. a. Rapetasser. (Merry-la-Vallée). - (10) |
| bouder : v. n., se dit d'une rivière en crue au moment où elle est étale. - (20) |
| boudère (n.f.) : boue, gadoue - (50) |
| boudére : boue claire - (39) |
| boudère, boue - (36) |
| boudére, s. f. boue, limon, endroit marécageux, mouille. - (08) |
| boudeur : temps très chaud, orageux - (43) |
| boudeurant adj. Orageux. - (63) |
| boudeuré : canicule annonçant l'orage. A - B - (41) |
| boudeure n.f. (de bouder) Chaleur humide, moiteur. - (63) |
| boudeurer : temps très chaud, orageux - (34) |
| boudeurer v. Dégager une moiteur étouffante. I boudeure. L'air est moite, le temps est orageux. - (63) |
| boudeziot. s. m. Enfant boudeur. (Armeau). - (10) |
| boudi : diminutif enfantin pour veau. IV, p. 62 - (23) |
| boudi. s. m. Jeune veau. On appelle un veau en répétant coup sur coup : Boudi, boudi, boudi ! - (10) |
| boudin : Boudin. « Le temps est bien nâ (noir) i va nagi (neiger) du boudin ». Repas de boudin, festin auquel on convie ses amis quand on a tué le cochon. « La sope au boudin » l'eau où l'on a fait cuire le boudin On donne la soupe au boudin à quelque miséreux qui s'en régale. Eau de boudin : « Y a cheu en iau de boudin », cela s'est arrangé, cela s'est réduit à rien. - (19) |
| boudinet : s. m., boudinière, entonnoir à faire les boudins. - (20) |
| boudingne. s. m. Boudin. - (10) |
| boudinouére : entonnoir pour faire le boudin - (48) |
| boudinouére : entonnoir à faire le boudin - (39) |
| boudoie. s. m. Déchargeoir. - (10) |
| boudone : diminutif enfantin pour vache. IV, p. 62 - (23) |
| boudonne. s. f. Vache. (Sainpuits). - (10) |
| boudot : Jeu enfantin qui n'est autre que la tape. Un des joueurs se tenant au milieu de ses camarades rangés en cercle les touche les uns après les autres du bout du doigt en prononçant cette formulette « Boudot, lina, cruge de cala, cetu-là que t'ara môrra ». Le joueur sur qui se termine l'incantation a le boudot, il court après ses camarades, qui se sont empressés de se sauver, jusqu'à ce qu'il puisse mettre la main sur l'un deux et lui passer son rôle en disant : « T'as le boudot ! ». - (19) |
| boudre (part. pas boulu) : Bouillir. « La sope bout i est bien temps de l'ec'mer» : la soupe bout il est bien temps de l'écumer. - Fermenter en parlant du moût qui est dans la cuve, « La cue (cuve) commache (commence) à boudre ». - On dit d'une personne qui se flatte de bien recevoir ses invités : « Quand alla a du mande chez liune y est to à boudre » : quand il y a du monde chez elle tout est mis à bouillir, tous les plats sont sur le feu. - Dicton : « Café boulu, café foutu ». - (19) |
| boudre : bouillir - (57) |
| boudre : bouillir. « Fare boudre de yô » : faire bouillir de l’eau, …pour avoir de yô boulante (eau bouillante). - (62) |
| boudre, bouillir. - (05) |
| boudre, v. intr., bouillir, et au fig. s'emporter. - (14) |
| boudrére : s. f. grosse fumée faite surtout de vapeur d'eau. - (21) |
| boudri, bouilleri, sm. nombril. - (17) |
| boudzi (guegni) : bouger - (51) |
| boudzi v. Bouger. - (63) |
| boudzon n.m. Hyperactif, turbulent. - (63) |
| boué : conducteur d'attelage de bœufs. A - B - (41) |
| boué - bouvier, celui qui conduit et surtout qui garde les bœufs. - Vos é lai in bon boué vô pouvez le croire. - Note boué à ailai en champ de neu. - (18) |
| bouê : bois - (48) |
| bouè : Bouvier, conducteur d'un attelage de bœufs. « Je m'en va charchi (chercher) in ban morcieu de viau chez le bouchi pa fare à marande (faire à manger) à mes bouès ». Les cultivateurs se mettent assez volontiers, eux et leur attelage, à la disposition d'un voisin quand celui-ci a du vin à livrer ou des récoltes à rentrer, aussi on les traite en conséquence. - (19) |
| boué : conducteur d'attelage de bœufs - (34) |
| bouê : fanes de pommes de terre - (48) |
| boué : peut domestique qui conduit les troupeaux. (RDM. T IV) - B - (25) |
| boué blanc. Bois blanc, troène (Ligustrum vulgaris). - (49) |
| boué nouère. Bois noir, fusain (Euonymous europaeus). - (49) |
| boué p'né. Bourdaine (Rhamnus frangula). - (49) |
| boüé, s. m. bouvier, conducteur de bœufs, laboureur par extension. - (08) |
| boué. Bois - (49) |
| bouéç’é : bouché. se dit aussi du temps, lorsque l’horizon est très rétréci à la vue, par suite de nuages bas et de pluie - (37) |
| bouéç’u : bouchon, couvercle - (37) |
| bouéce (n.f.) : bouche - (50) |
| bouéce, s. f. bouche. - (08) |
| bouéceau, s. m. bouche, par métonymie = bouchon : « ain bouéceau d' for », une bouche de four, petite porte mobile en bois ou en métal avec laquelle on ferme le four lorsque le pain y est enfourné. - (08) |
| bouécer (v.t.) : boucher - (50) |
| bouécer, v. a. boucher, fermer un trou. - (08) |
| bouéçeue. s. f. Bouchure. (Ménades). - (10) |
| bouèchale : s. f. petite pioche plate. - (21) |
| bouèché : (v. intr.) éclore, en parlant des oeufs (cf. en fr. le doublet becquer, bécher.). - (45) |
| bouèché, piocher la vigne ; on ne dit pas bouèchè un jardin. - (16) |
| bouècher : faire une ouverture dans la coquille en parlant du petit poussin qui essaie de sortir de l'œuf. (G. T II) - D - (25) |
| bouècher : fêler, fendre la coquille (éclosion) - (48) |
| bouécher : piocher. - (32) |
| bouécher. v. a. Boucher. - (10) |
| bouech'ton : califourchon. Ai bouechon sur une branche : à califourchon sur une branche. - (33) |
| bouéchvau (ai) (loc.) : tête à queue - (50) |
| bouéçon. s. m. Bouchon. - (10) |
| bouée, bouïe et buée. : (Dial et pat.), lessive. - (06) |
| bouée. s. m. Bouvier, laboureur qui laboure avec ses bœufs. - (10) |
| bouège (n.f.) : 1) grosse étoffe de fil et de coton - 2) gros haricot tacheté - (50) |
| bouëge : étoffe. I, p. 26-1 ; V, p. 41 - (23) |
| bouège : tissu grossier - (48) |
| bouège : (bouèj': - adj. inv.) de couleur claire, fauve, blond ; (antonyme exact de beuro). - (45) |
| bouègevauder (s’) : (s'bouèjvô:dè - v. pronominal): être disposé tête-bêche. La formation du mot est - (45) |
| bouègevolée (ai) : tête-bêche - (48) |
| bouéillaird(e) bouéillous(e) : ventru(e) - (48) |
| bouéille : ventre - (48) |
| bouèille : (bouèy': - subst. f.) gros ventre, bedaine, panse. - (45) |
| bouèillère, bouèillèrde : (bouèyê:r, bouèyêrd' - adj.) ventripotent, qui a de la bouèy'. - (45) |
| bouèillot : petit tas de foin - (48) |
| bouële : le ventre. - (56) |
| bouéler : verbe utiliser pour parler d'un vent qui dessèche, d'un vent qui bouèlle - (39) |
| bouëlle : le ventre, avoir la bouëlle pleine. - (56) |
| bouelle : ventre bien arrondi, panne de porc - (37) |
| bouelle : n. f. Ventre. - (53) |
| bouéme, s. m. bohémien, vagabond, coureur de grand chemin. - (08) |
| bouémosse, s. f. bohémienne, sorcière. - (08) |
| bouene et bouenon. Panier en osier où l'on dépose le pain avant de le mettre au four. - (03) |
| bouene, s. f., corbeille, (Voir Benne). - (14) |
| bouenne : s. f. benne. - (21) |
| bouénon, s. m., panier. (V. Boinon). - (14) |
| bouer (se), v. pr., se crotter, marcher dans la boue : « O s’é boué tout du long des jambes ». - (14) |
| bouéran : Féminin, bouéronne. Berger, jeune domestique qui conduit le bétail au pâturage. « L'étoile du bouéran, ou du ban bouéran » : la planète Vénus. « In jû de bouéran » : un jeu de cartes enfantin, indigne de joueurs sérieux. - (19) |
| bouèrbe : boue - (48) |
| bouerbe : endroit boueux (gaulois : borvo, borbo même sens). - (32) |
| bouerbe, boue. - (27) |
| bouèrbe, n. fém. ; boue . - (07) |
| bouerbi : brebis. (B. T IV) - D - (25) |
| bouèrbis brebis - (48) |
| bouère : nourriture liquide du porc. A - B - (41) |
| Bouère (La), montagne qui domine Mercurey ; le m'lin d'la Bouère : le moulin sur la Bouère. - (38) |
| bouère : boire - (48) |
| bouère : boire - (51) |
| bouère : boire - vin don bouère eune goutte, viens donc boire une goutte [eau de vie] - (46) |
| bouère : boire - (39) |
| bouère, boire, piquette. - (16) |
| bouère, bouer. v. – Boire : « Vins don' à la cave, on va bouer un p'tit coup d'cid doux ! » - (42) |
| bouére, v. tr., boire, et pas toujours avec mesure. - (14) |
| bouére. Brouet de pomme de terre donné comme aliment aux porcs ; boire : « y é tôt c'que t'verse è bouére ». - (49) |
| bouérie : champ de foire - (43) |
| bouèrie : Mur qui sépare la grange de l'écurie et dans lequel sont pratiquées des ouvertures par lesquelles on pousse le fourrage dans le ratelier. « As-tu fremé la pôrte de la bouèrie ? » - (19) |
| bouèron : petit berger. - (21) |
| bouéron, s. m. petit berger. - (24) |
| bouerre (le), braillade : nourriture liquide donnée aux porcs - (43) |
| bouesse : bouche - (39) |
| bouèsse, s. f. terrain en contrebas. - (24) |
| bouésser : boucher - clôturer - (39) |
| bouesser : éclore, se dit quand un poussin casse sa coquille - (39) |
| bouessiau, bossiau. n. m. - Boisseau : mesure de capacité valant 12,5 litres, utilisée pour les matières sèches : blé, orge, etc. - (42) |
| bouess'lon (on) : sarcloir - (57) |
| bouesson bian : aubépine - (43) |
| bouesson na : prunellier sauvage - (43) |
| bouésson : bouchon - petite parcelle de bois ou friches - (39) |
| bouesson. n. f. - Boisson. - (42) |
| bouet (queurre-), s.m. petit-houx. - (38) |
| bouet, s.m. buis. - (38) |
| bouétàyer, v. n. boiter (du vieux français boitoiller). - (24) |
| bouète (n.f.) : boisson de qualité médiocre - (50) |
| bouète : boisson - (48) |
| bouète : Boîte. « Eune bouète de cirage », « Freme ta bouète » : tais toi. - (19) |
| bouéte : boite. L’objet, le coffret. - (62) |
| bouéte : caisse à laver - (48) |
| bouéte : n. f. Boîte. - (53) |
| bouéte, boéte (n.f.) : boîte - (50) |
| bouéte, s. f. boite, coffre. - (08) |
| bouète, s. f. boîte. - (24) |
| bouéte, s. f., boite, petit coffret. - (14) |
| bouète. s. f. Trou au bas d’une porte pour faire passer les chats. (Essert). - (10) |
| bouète: traverse reliant les ridelles - (48) |
| bouett' : n. f. Boisson. - (53) |
| bouette (n. f.) : piquette - (64) |
| bouette (nom féminin) : trou par lequel on faisait tomber le foin dans l'étable. - (47) |
| bouette : boisson, vin, piquette. I, p. 24-4 - (23) |
| bouette : soupirail. La bouette de la cave : le soupirail de la cave. - (33) |
| bouette, s. f. boisson, vin, cidre, bière, etc. un homme qui a sa « bouette » pour l'année est un homme à son aise. - (08) |
| bouette. Pour boite, qui signifie en français état du vin prêt à boire (ce vin est en boite, c'est le moment de le boire), ou petit vin fait en versant de l'eau sur le marc (Littré). Bouette veut dire encore autre chose, chez nous, ma bouette désigne le vin du propriétaire, celui qu'il fait d'une certaine façon à son usage. - (12) |
| bouetter les bu : conduire les bœufs attelés en les incitant de la voix. A - B - (41) |
| bouetter les bus : conduire les bœufs attelés en les excitant de la voix - (34) |
| boueux, subst. masculin : éboueur. - (54) |
| bouèyâ, boyaux ; et écorche l'bouéyâ se dit de quelqu'un qui estropie le français, en croyant le bien parler. - (16) |
| boufard, de, adj. terrain léger et que les gelées soulèvent facilement. Ex. : c'est une terre boufarde. - (11) |
| boufe, enveloppe des grains de blé, etc., que le van a séparée dos grains. - (16) |
| boufe, sf. balle de céréales ; menue paille. - (17) |
| boufer, v. tr., manger copieusement et gloutonnement, se gorger : « Le goinfre ! ôl a mingé tôte la jornée ; ô bouffe c’ment eun gouri ». - (14) |
| boufetons (ai), loc. la tête sur la table, appuyée contre le bras. - (17) |
| bouffaud (adj.) : trop meuble, en parlant d'une terre - (64) |
| bouffe : balle de céréales - (48) |
| bouffe : moue, bouderie - (60) |
| bouffe : s, f., syn, de balouffe. - (20) |
| bouffe, bôffe, s. f. balle ou capsule du blé et des autres céréales. - (08) |
| bouffe, Enveloppe du grain des céréales, menue paille qui s'envole quand on souffle dessus, quand on bouffe Ce mot a dû signifier joue : on disait autrefois « donner une buffe » pour : souffleter. Chez les Romains, les masques des bouffons avaient des joues énormes. Bouffer, manger à pleine bouche, bouffée de vent ou de tabac, me paraissent être de la même famille. - (13) |
| bouffe-la-balle. s. m. Qualification par laquelle, dans le langage familier, on désigne u,e personne joufflue et joviale, qui à toujours l’air de se gonfler les joues pour bouffer sur des balles de blé ou l’avoine qu’il veut chasser. - (10) |
| bouffer (v.t.) : souffler - (50) |
| bouffer : souffler - (60) |
| bouffer : souffler. IV, p. 29-i ; IV, p. 31 - (23) |
| bouffer : souffler. - (32) |
| bouffer, boffer : souffler des joues en dormant - (37) |
| bouffer, v. souffler. En parlant du vent. - (65) |
| bouffer. v. a. souffler avec la bouche et quelquefois souffler en général. - (08) |
| bouffer. v. n. Souffler fortement. — Manger beaucoup et vitement. - (10) |
| bouffeuiller : souffler légèrement à chaque expiration, en gonflant les joues. - (56) |
| bouffeur (-euse) : adj., bouffant (-ante). - (20) |
| bouffio, nuage épais qui présage le tonnerre. Cette expression est en usage dans le Châtillon nais, à Chaumont-le-Bois notamment. Dans la langue romane, boufois ou bufois signifie bruit, vacarme. En basse latinité, buffa a le même sens. - (02) |
| bouffio. : Nuage épais qui présage le tonnerre (expression du châtillonnais). - (06) |
| boufflotte. s. f. Boursouflure, bosse, beigne à la tête. (Champignelles). - (10) |
| bouflotte. n. f. - Boursouflure, ampoule, petit abcès. - (42) |
| boufre! excl., demi-juron, qui remplace le mot malsonnant bougre. - (14) |
| boufre, s. m., bougre ; goinfre. - (20) |
| bouge (adjectif) : Se dit d'un outil dont la lame est trop épaisse, donc plus coupante. « Ma cognée est treu bouge i faut la regugi (aiguiser) ». - (19) |
| bouge : adj., émoussé. - (20) |
| bouge. adj. - Se dit d'un vin qui a des difficultés à s'éclaircir. - (42) |
| bouge. adj. Qui s’éclaircit difficilement. Vin bouge, vin qui ne veut pas s’éclaircir. (Mouffy). — Linge bouge , linge mal lavé. (Migé). - (10) |
| bouge. s. m. Embonpoint. Sans doute par analogie avec le bouge , la partie la plus bombée d’une futaille. - (10) |
| bougeon (-eonne) : adj., bougillon, se dit d'une personne remuante, qui ne peut pas rester en place. Voir guignochon. - (20) |
| bougeon : n. m. Barreau. - (53) |
| bougeon, bâton d'échelle, de râtelier. - (05) |
| bougeot : moyette. (E. T IV) - VdS - (25) |
| bouger. s. m. Bouvier. - (10) |
| bouger. v. a. et n. Peigner le chanvre. (Chéu). - (10) |
| bougeur. s. m. Peigneur de chanvre. (Chéu). - (10) |
| bougeux. s. m. Cardeur. (Percey). - (10) |
| bougi (verbe) : Bouger « Bougis pas ! » : ne bougez pas. « O n 'arrâte pas de bougi ». - (19) |
| bougi : bouger - (57) |
| bougie (la) : s. f., fabrique de bougies, à Saint-Laurent, près de laquelle se trouve une pièce d'eau. En hiver on va patiner derrière ta Bougie. - (20) |
| bougin. n. m. bouginie. n. f. - Désordre, fouillis. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| bouginer (v. tr.) : froisser, chiffonner (des draps bouginés) - (64) |
| bouginer, boussiller. v. a. Emmêler, chiffonner. - (10) |
| bouginer. v. - Emmêler, chiffonner. - (42) |
| bougner : v, a., au prop. et au fig.. bourrer, bousculer. Il m'a bougné. Voir beugne. - (20) |
| bougner, v., tasser le linge dans un tiroir. - (40) |
| bougnette, bouniette : petite tache sur un vêtement. - (56) |
| bougni : bousculer - (57) |
| bougni, u. a. serrer, cogner, entasser. - (22) |
| bougni, v. a. serrer, cogner, entasser. - (24) |
| bougnier, v. tr., tasser, presser, serrer, frapper fort : « J"ai bougnié toutes mes afâres dans l'tirouér ». — « O t’li a bougnié des coups de poing su l’nazô ». - (14) |
| bougonnai, murmurer tout bas. - Dans l'idiome breton, buanégez signifie colère, courroux. - (02) |
| bougonnai. : Murmurer. Est-ce grincer comme un verrou qu'on ferme? - Le mot bougon, en effet, dans le dialecte, signifie verrou (voir Lacombe et Roquefort). - (06) |
| bougonner : rouspéter, grommeler - (48) |
| bougounner. v. - Bougonner, ronchonner. - (42) |
| bougrasser : détériorer, travailler sans soin. - (30) |
| bougrasser : Gâcher la besogne. « La coudrère m'a bougrassé ma reube » la couturière a gâché ma robe. - (19) |
| bougrasser : v. a., mal faire un ouvrage. Te m'as toute bougrassé c'te jupe ! - (20) |
| bougrassi v. 1. Tripoter, peloter (une femme). 2. Abîmer, froisser (un vêtement). - (63) |
| bougre : Au féminin : bougrasse. Terme de mépris. Cependant il peut se prendre en bonne part « Y est in ban bougre » ; « Ah ! la chetite bougrasse, aile n 'a pas sa langue dans sa peuche » : Ah la petite mâtine, elle n'a pas la langue dans sa poche. - Juron anodin : « Ah ! bougre ! » - « Le mande est bougre », cri d'admiration devant les inventions modernes « Paraît qu'an va pouya (pouvoir) voler en l'ar à présent, Ah ! Le mande est bougre ! » - (19) |
| bougre. Garçon, homme. Expressions courantes : « bon bougre », « mauvais bougre » ; espèce : « bougre d'imbécile », « bougre de malhonnête ». - (49) |
| bougréchi, v. a. abréger hâtivement un travail. - (24) |
| bougrement - mot dont le sens, dans l'usage actuel, n'est pas mauvais mais qui est d'un goût douteux. Il signifie beaucoup, fort, grandement. - Al à bougrement avare. - An ié bougrement de foin ceute année qui. - C'a in bon bougre. - (18) |
| bougrement : Beaucoup, « I fa bougrement fra » : il fait très froid. - (19) |
| bougrement. Beaucoup. - (49) |
| bougresse : femme qui n'a pas froid aux yeux - (60) |
| bougréssi, v. a. abréger hâtivement un travail. - (22) |
| bouguener, v. a. pousser, malmener. - (08) |
| bouhame, adj. hypocrite, mielleux, - (24) |
| bouhame, adj. hypocrite, mielleux. - (22) |
| bouhamien : Obséquieux, qui cherche à se faire bien venir par des flatteries. - (19) |
| bouhère : boue dans le ruisseau - (37) |
| bouhiner (pour bousiner). v. a. Faire mal un ouvrage, le faire maladroitement et sans soin. - (10) |
| bouhineux, euse. adj. Celui, celle qui travaille sans soin, qui a l’habitude de gâcher l’ouvrage par maladresse ou manque de soin. Voyez bouhiner. - (10) |
| bouhoume (nom masculin) : paysan. - (47) |
| boui : buis. On cherche du boui pou les Rameaux : on cherche du buis pour les Rameaux. - (33) |
| boui, amertume. - En latin, buxum signifie buis, et l'on voit que les Bourguignons ont pris la cause pour l'effet, car la feuille du buis est très-amère. - (02) |
| boui, bouè, buis. - (16) |
| bouidouis. s. m. Figure grotesque, marionnette, pantin, godenot. - (10) |
| bouîe (lé), la lessive, que l'on faisait autrefois avec des cendres de bois. - (27) |
| bouie, lessive. - (26) |
| bouie, lessive. (Voir buie.) - (02) |
| bouie, n. fém. ; lessive ; note bouie ost bonne. Vos laverez lai bouie ai l'erveire (rivière). - (07) |
| bouïé, s. m. pièce de bois qui entre dans une muraille et supporte les échafaudages des maçons, couvreurs, peintres, etc. - (08) |
| bouif (on) – r’semalou (on) : cordonnier - (57) |
| bouif. s. m. Cordonnier. (Germigny). - (10) |
| bouillaisse, goûillaîsse, gouille : boue fluide - (37) |
| bouillard. Peuplier d'Italie. - (49) |
| bouillasse, bouillasson. Noms qui désignent des endroits qui sont ou qui ont été fangeux, marécageux ou pleins de sources. - (08) |
| bouillasse, n.f. boue. - (65) |
| bouillasse, subst. féminin : boue liquide. - (54) |
| bouillausse. s. f. Femme déguenillée, malpropre. (Saint-Maurice-aux- Riches-Hommes). - (10) |
| bouille (na) : pulvérisateur - (57) |
| bouille ou boille : Bouleau, betula alba. « Des sabeuts de bouille » : des sabots en bois de bouleau. On dit aussi boïlle (ll mouillées). - (19) |
| bouille, bouleau. - (05) |
| bouilleau. : Panier où les bêtes asines portent leurs fardeaux. Le vieux frapçais a le mot bouille ou hotte de vendange. (Lac.) - (06) |
| boûiller : monceau d'ordures - (60) |
| bouiller. v. a. et n. Peigner le chanvre. (Saint-Florentin). — Voyez bouger. - (10) |
| bouilleur. s. m. Peigneur de chanvre. (Saint-Florentin et Beugnon). - (10) |
| bouilleure (pour bouillure). s. f. Grande chaleur. En v’là de la bouilleure aujourd’hui. (Villeneuve-les Genêts). - (10) |
| bouilleure, bouillure. n. f. - Canicule : « Après le fré d'la s'mane derniée, te parles d'eune bouillure, on a ben des arias ! » - (42) |
| bouilleux d'cru. n. m. -Distillateur, bouilleur de cru. - (42) |
| bouilli : pot-au-feu - (43) |
| bouilli : Sarment de vigne garni de ses raisins qu'on suspend au plafond. - (19) |
| bouilli n.m. Pot-au-feu. - (63) |
| bouilli : s. m. bouleau. - (21) |
| bouilli. Morceau de bœuf cuit dans le pot-au-feu. Mets très apprécié dans les campagnes où tout bon repas débute par le « bouilli ». - (49) |
| bouillie : s. f. Bouillie blanche, bouillie faite avec la farine de froment. Bouillie jaune, bouillie faite avec la farine de maïs. Voir gaude. - (20) |
| bouillier. Bouvier. - (49) |
| bouillo : tas (de foin). (C. T IV) (RDC. T III) - A - (25) |
| bouillon byanc n.m. (du gaulois bugillo). Molène officinale. Cette plante médicinale est employée en tisanes pectorales. Synonymes : cierge de Notre-Dame, fleur de grand chandelier, herbe de Saint-Fiacre. - (63) |
| bouillon, s. m. bouillonnement, les « bouillons » du lait sur le feu. - (08) |
| bouillot : panier. VI, p. 40-11. - (23) |
| bouillot : petit tas de foin. - (32) |
| bouillot : ruche - (60) |
| bouillot d'mouches : ruche de paille. IV, p. 25; VI, p. 40-11. - (23) |
| bouillot, s. m. panier que l'âne porte à droite et à gauche pour transporter le lait, les œufs, le beurre ou autres denrées ; poche, sac en général. - (08) |
| bouillot, s. m., bouleau. - (14) |
| bouillot. s. m. Panier pour emballer les fruits. - (10) |
| bouillots, « L » paniers que porte l'âne à droite et à gauche, de bullio (bas latin), mesure de sel, qui se prononçait boullio. - (04) |
| bouillouaîre (na) : bouilloire - (57) |
| bouillouère : bouilloire - (48) |
| bouillue. s. f. Femme sans soin, mal-propre. (Saint-Florentin). — Voyez bouillausse. - (10) |
| bouinaude : petite ouverture dans un mur (boignaude) - (60) |
| bouinaude : vieille maison. (LS. T IV) - Y - (25) |
| bouinaude : toute petite fenêtre, petite ouverture. Ex : "Oh ben ! j'tai ben vue darriée ta bouinaude !" - (58) |
| bouinaude. n. f. - Plusieurs usages : 1. Chatière, petit passage dans une porte, ou une haie. 2. Petite cavité aménagée dans un mur pour y déposer menus objets. On trouve également la bouinaude dans les piliers de la cheminée. 3. Porte du four sur la cuisinière à bois. (Arquian) - (42) |
| bouinaude. s. f. Petite ouverture. (Perreuse). - (10) |
| bouinaude. s. f. Trou, chatière, petit passage, ouverture, ordinairement de forme ronde. — Se dit, à Villiers-Saint-Benoît, d’une petite cavité pratiquée dans l’un des côtés d’une cheminée pour y placer de menus objets de ménage. - (10) |
| bouine. n. f. - Petite cavité dans un mur ; synonyme de bouinaude. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| bouin-ne, adj. trempé, imbibé à saturation. Verbe bouin-né. - (22) |
| bouin-ne, adj. trempé, imbibé à saturation. Verbe bouin-ner. - (24) |
| bouique, bouisse. s. f. Bouche. De bucca. (Sermizelles). - (10) |
| bouiron, s. m. berger. - (22) |
| bouis (n.m.) : buis - (50) |
| bouis : Buis, buxus sempervirens. « J'ai vu in nid dans ce bochan de bouis » - « Du bouis bénit » : du buis qui a été bénit le jour des Rameaux. - (19) |
| bouis : (boui - subst. m.) buis - (45) |
| bouis : buis - (39) |
| bouis : s. m., vx fr., buis {buxus sempervirens). - (20) |
| bouis, s. m. buis. - (08) |
| bouis, sm. buis. - (17) |
| bouitàyé, v. n. boiter. - (22) |
| bouîte*, s. f. boîte. - (22) |
| boujon - échelon d'une échelle, bâton d'une chaise. - In boujon é cassai et pu al é choué préque de tote l'échelle. - Ce n'â pas joli quand en â cheurté de mette les pieds su les boujons de lai chère. - (18) |
| boujon (C.-d., Chal., Morv.). – Traverse d’échelle, bâton de chaise ; du même mot vieux français. Actuellement, en français, un boujon est une cheville servant à relier les pièces de certaines machines. - (15) |
| boujon (nom masculin) : barreau de chaise. - (47) |
| boujon : barreau de chaise, d’échelle. Aussi une pièce de fixation en bois et une grosse flèche d’arbalète - (62) |
| boujon : barreau d'échelle, de barrière - (48) |
| boujon : barreau. (RDM. T III) - B - (25) |
| boujon : marche d'une échelle. - (31) |
| boujon : (boujon: - subst. m.) barreau (d'une chaise, d'une échelle ... ) - (45) |
| boujon, s. m. traverse de chaise, d'échelle, de râtelier. - (08) |
| boujon, s. m., bâton d'échelle, de râtelier ; barreau de chaise, petite traverse de bois qui en lie les pieds : « C'te chaire a eun boujon d'cassé. » - (14) |
| boujon. Petite traverse de bois arrondi : un boujon de chaise, d'échelle, de ridelle. - (13) |
| boujôte, petit sac à mettre des nippes. - (02) |
| boujôte. Bougette, bougettes, petit sac, petite valise à mettre quelques provisions, nippes, même de l'argent… - (01) |
| boulâ (n.m.) : bouleau - (50) |
| boulâ : bouleau - (48) |
| boula : bouleau - (39) |
| boula, s. m. bouleau, arbre très commun dans le Morvan. - (08) |
| boula. n. m. - Bouleau. - (42) |
| boula. n. m. - Bouleau. Autre sens : balais. (Arquian) - (42) |
| boulâb : n. m. Bouleau. - (53) |
| boulant : Bouillant, participe présent de boudre. « To chaud to boulant » : sans retard. - (19) |
| boularde. s. f. Noix dans sa coque verte. - (10) |
| boulas (botula), bouleau. - (04) |
| boulas : bouleau. VI, p. 40-16 - (23) |
| boulas : (boulâ: - subst. m.) bouleau. - (45) |
| boulas, boulais. Bouleau. - (49) |
| boulassiée, boulassière. n. m. - Boulaie. - (42) |
| boulassière. s. f. Terrain planté de bouleaux. - (10) |
| boulat : bouleau - (60) |
| boulat : bouleau. Balai de bouleau. - (33) |
| boulayer (v. tr.) : mélanger, malaxer, triturer (syn. rauger) - (64) |
| boûle ; on dit une boûle de lurquis pour un épi de maïs, une boûle de raisins, pour quelques raisins attachés ensemble avec les sarments qui les portent. - (16) |
| boulée. Bouquet de raisins tenant après le pampre, qu'on rapporte de la vendange. - (12) |
| bouler (verbe) : se dit de la taupe qui rejette la terre de ses galeries en petits monticules : des boulats. - (47) |
| bouler, v. n. former boule, se mettre en boule. On dit que la terre argileuse, la neige, « boulent » sous les pieds. - (08) |
| bouler. v. a. Terrasser son adversaire, le rouler par terre comme une boule. - (10) |
| bouleton. s . m. Pelote de fil. (Sermizelles). - (10) |
| boulevouchie (ai lai), loc. a la débandade, en désordre, pêle-mêle. - (08) |
| bouleyer, v. a. bousculer, rouler au propre et au figuré. - (08) |
| bouli : Bœuf bouilli, bœuf nature. « Vla in brave (beau) morciau de bû (bœuf) y a de qua fare in ban bouli (il y a de quoi faire un bon bouilli). » - (19) |
| bouli, boeuf cuit dans un pot-au-feu ; la soupe au bouli. - (16) |
| bouli, s. m., bouilli, morceau de bœuf qui a cuit pour le pot-au-feu : « Ah ! par ma li ! mérote, v'là eun fameux bouli ! » - (14) |
| boulie (n.f.) : bouillie - (50) |
| boulie : (nf) bouillie - (35) |
| boulie : Bouillie de farine de froment au lait. « Va dan fare miji (manger) la boulie à tan ptiet (à ton enfant) » « To cen y est de la boulie pa les chats » : tout cela est du temps perdu , des soins inutiles. - (19) |
| boulie : bouillie pour les veaux - (43) |
| boulie : bouillie - (48) |
| boulie de troqui n.f. Potage velouté de farine de maïs. - (63) |
| boulie n.f. Bouillie. Boulie byintse : bouillie faite avec la farine de froment. Boulie dzaune : bouillie faite avec la farine de maïs. - (63) |
| boulie : bouillie - (39) |
| boulie, n.f. bouillie. - (65) |
| boulie, s. f. bouillie. - (08) |
| bouliguai - remuer, agiter sans soins un liquide ou même remuer des objets. - Pourquoi que te bouligue don fàre quemant cequi ceute bouteille de cassis ? - Quand en é mis lai côlle dans le poinson en bouligue bein aivou in bâton. - (18) |
| bouligué, remuer, secouer fortement. - (16) |
| bouligué, v. a. 1. Altérer la santé par suite de soucis. 2. Laisser en désordre un travail gâché. - (22) |
| bouliguer (C.-d., Chal.), bouleyer (Morv.). - Bousculer, agiter un liquide en le remuant. Du vieux français bouler, même sens. Voir plus loin ébouler et rébouler. - (15) |
| bouliguer : remuer - (44) |
| bouliguer : Secouer, agiter maladroitement un fut dont on risque ainsi de troubler le contenu. - (19) |
| bouliguer v. Remuer, émouvoir, bouleverser, secouer. (de l'occitan bolegar) - (63) |
| bouliguer : v. a., bousculer, manier sans précaution. - (20) |
| bouliguer, brasser, brouiller, mêler. - (05) |
| bouliguer, remuer un liquide qui repose sur un dépôt. - (28) |
| bouliguer, secouer, agiter fortement. - (27) |
| bouliguer, v. a. 1. altérer la santé par suite de soucis. — 2. Laisser en désordre un travail gâché. - (24) |
| bouliguer, v. a. remuer vivement, secouer, déranger, mettre des objets en désordre. - (11) |
| bouliguer, v. agiter quelque chose en tous sens de telle façon que plus rien ne soit égal ; par extension, en parlant des liquides. - (38) |
| bouliguer, v. tr., remuer, agiter. S'applique peut-être trop indifféremment aux personnes et aux choses - (14) |
| bouliguer, v., remuer, secouer. - (40) |
| bouliguer. Agiter un liquide soit avec un objet comme une cuiller, soit en le secouant dans le récipient qui le con- - (12) |
| bouliguer. Remuer, troubler un liquide. Fig. Émouvoir. - (49) |
| boulin. n. m. - Nuage orageux ; synonyme de balin (Perreuse, selon M. Jossier) - (42) |
| boulin. s . m. Nuage orageux. (Perreuse). - (10) |
| boulir, v, intr., bouillir. - (14) |
| bouliste : s. m., vx fr. bouleur. Joueur de boules. - (20) |
| boulle. Bouillie. - (49) |
| boulli (du) : (du) bœuf au pot-au-feu - (37) |
| boulli (on) : pot-au-feu - (57) |
| boulli, subst. masculin : pot-au-feu, viande bouillie. - (54) |
| boullie (d’ lai) : (de la) bouillie - (37) |
| bouloir : s. m., boule de fleuriste (Nouv. Larousse illustré), servant au gaufrage des fleurs artificielles. - (20) |
| boulon : s. m., petite.boule, biscaïen, cochonnet. - (20) |
| boulonner (se). v. - Se serrer, se blottir. Se dit généralement des moutons lorsqu'ils se blottissent les uns contre les autres. - (42) |
| boulonner (Se). v. pronom. Se presser, se serrer. Se dit des moutons qui se rassemblent, qui se mettent les uns contre les autres par la chaleur. (Bléneau). - (10) |
| boulot : s. m., plantoir différent du planloir ordinaire en ce qu'il est renflé au milieu. - (20) |
| boulot, bouloir, espèce de rouable. - (05) |
| boulöt, sm. miette, petit morceau. - (17) |
| boulot. Tâche, travail. - (49) |
| bouloter, v. tr., manger. - (14) |
| boulotte - ce mot exprime l'idée de doucement, tranquillement, peu. - A ne fait dière mieux ses aifâres, vai a boulotte, voilai to. - Le bouilli se fait bein ; â boulotte tranquillement. - (18) |
| boulotte, s. f., femme courte et grasse. - (40) |
| boulotter. Manger. Ce terme n'est pas particulier à Montceau. - (49) |
| boulou : canard, appellation affectueuse donnée à un enfant - (37) |
| boulou. Canard. - (49) |
| bouloutre. n. m. - Personnage grotesque : « L'air d'un bouloutre avec son gros ventre, il court après moi, aussi à quatre pattes.» (Colette, Claudine à Paris, p.251) - (42) |
| boulòze, s. f. terrain léger. - (22) |
| boulu : Pain boulu panade, ou encore « sope mitonnée ». - (19) |
| boulu, adj. bouilli. - (22) |
| boulu, adj. bouilli. - (24) |
| boulu, bouilli. - (04) |
| boulu, part. pas. du v. boulir. - (14) |
| boulu, part. pass. du verbe bouillir. - (08) |
| boulu, ue. partic. p. du verbe Bouillir. Qui a bouilli. Du lait boulu. - (10) |
| boulue. s. f. Espèce de radis noir, sans saveur, ressemblant à une truffe. (Collan). - (10) |
| boulvari, s. m.,hourvari, confusion, désordre. - (14) |
| boume : borne. - (62) |
| boun' de nai*, s. m. bonnet de nuit. - (22) |
| boun, adj., bon : « Quant à c’qui é d' la Jaqueline, y ét eine boûne fonne », — « Tiénot épeû Dodiche, y ét eùn paire de boûn’émis ». - (14) |
| boun'. adj. f. - Bonne. - (42) |
| bounâ, s. m., bonnet de laine. - (40) |
| boûne (na) : borne - (57) |
| boune : bonne - (61) |
| boune : bonne - (48) |
| boune fonne, s. f. bonne femme, sage-femme, accoucheuse. - (08) |
| boune : bonne - (39) |
| boune, s.f. borne. - (38) |
| boune-mère*, s. f. sage-femme. - (22) |
| boûner : borner - (57) |
| bounes [être dans ses], loc, être de bonne humeur, d'humeur gracieuse, enjouée. - (14) |
| bounette, s. f. coiffe de femme ordinairement d'étoffe noire avec des ruches. - (08) |
| bouneure. Excavation dans un arbre. - (03) |
| bounheu (du) : bonheur - (57) |
| bounheu, s. m. bonheur. - (08) |
| bounhomme. Bonhomme. Ce mot désigne, en général, le campagnard et plus particulièrement le cultivateur. Plur. « Des bounhommes ». - (49) |
| bouniaude (nom féminin) : petite fenêtre. Egalement appentis ou débarras. - (47) |
| boûnne (sai) aimie : (sa) « fréquentation » - (37) |
| boûnnes (dâs) quaitr’ hûres : (un) bon goûter d’après-midi, pour un enfant - (37) |
| bounnet. n. m. - Bonnet. - (42) |
| bounnot (n.m.) : bonnet - (50) |
| bounnot d’nieût : bonnet de nuit - (37) |
| bounot (on) : bonnet - (57) |
| bounot (otte) : bonnet - (39) |
| bounot, bonnet. - (05) |
| bounot, s. m. bonnet. - (08) |
| bounot, s. m., bonnet, calotte. - (14) |
| bounot, s.m. bonnet. - (38) |
| bounoume (un) : un bonhomme - (61) |
| bouö, öre, sm. f. bouvier, ière. - (17) |
| bouon, s. m., buisson. - (40) |
| bouorbe : boue. Aussi bouillasse, gouille ; Du gaulois « borvo ». - (62) |
| bouorne : borne. (B. T IV) - D - (25) |
| bouorse : bourse. (B. T IV) - D - (25) |
| bouqhie, s. f. boucle, anneau, fil de fer tordu qui sert à boucler les porcs afin de les empêcher de fouiller la terre. - (08) |
| bouqhier, v. a. boucler, mettre une boucle, une attache de fil de fer. - (08) |
| bouqhiots, s. m. petites dettes, dettes criardes qui embarrassent, qui bouclent : « a n' s'rô pâ chu riche s'al aivô paie tô sé bouquiots », il ne serait pas si riche, s'il avait payé toutes ses petites dettes. - (08) |
| bouquaiche (nom masculin) : bouc. - (47) |
| bouquenon. s. m. Qui sent le bouc, qui est comme un bouc. C’est une qualification que certaines femmes de Joigny se plaisent à donner à leur mari ; elles prononcent bouquénon. - (10) |
| bouquer. v. a. Heurter, principalement la tête, comme fait un bouc. - (10) |
| bouqueriau*, s. m. bonde plate à futaille. - (22) |
| bouquet (m), fleur en pot. - (26) |
| bouquet : fleur (et non bouquet). VI, p. 37-2 - (23) |
| bouquet : quelques branches, ou quelques fleurs (si on en trouvait) plantées bien droit sur le dernier chariot de foin ou de moisson comme pour dire « Ouf, on a fini ! » (voir : paulée). - (33) |
| bouquet n.m. Fleur. Un bouquet byeu (bleuet), un bouquet dzaune (genêt). - (63) |
| bouquet, subst. masculin : plante en pot ou en parterre. - (54) |
| bouquet. Fleurs en général, prises en groupes, ou même isolement. - (12) |
| bouquetière : pouisinière. (E. T IV) - C - (25) |
| bouqui, boutchit. n. m. - Bouc. - (42) |
| bouqui. s. m. Bouc. — Sommet d’un arbre ; sans doute pour bouquet. (Bléneau). - (10) |
| bouquiè : boucler - (46) |
| bouquier : fermer - (48) |
| bouquignon. s. m. Partie extrême, point le plus élevé d’un objet. De bout et de quignon, qui, réunis, doivent signifier l’extrémité supérieure d’un croûton de pain. Ce serait alors par extension que ce mot serait appliqué à toute sorte d’objets. (Festigny). - (10) |
| bouquin n.m Voir boquin. - (63) |
| bouquin. n. m. - Bouc. (Sainte-Colombe-sur-Loing) - (42) |
| bouquiot : un bouquet. - (56) |
| bouquiote : une bouclette. - (56) |
| bouquiotte : bouclette - (48) |
| bouquiotte : une bouclette. - (56) |
| bouquye (n.f.) : boucle - (50) |
| bouradin : haricot blanc. Ex : "Ène boune assiette de bouradins, ça tint bin au côrps !" (Tenir au corps = être nourrissant, calorifique). - (58) |
| bouranfle, adj. enflé, gonflé, boursouflé, bouffi. - (08) |
| bouraquin. s. m. Homme gros et court. (Villiers-Bonneux). - (10) |
| bourasse. C'est le péjoratif de bourre, comme filasse est le péjoratif de fil. On dit bourasse de chanvre, de coton, de soie. De là bouracan, étoffe grossière. Bourassier, apprêteur de bourasse, est devenu un nom propre... - (13) |
| bourbancer. v. - Gronder fortement, malmener : « T'as déchiré ta ch'mi' ! Te vas p'têt ben t’fai'e bourbancer par ton pa’ !» - (42) |
| bourbouillon, source en plaine. - (05) |
| bourdàye, s. f. hanneton. - (22) |
| bourde , conte, plaisanterie, mensonge. - En Bretagne, bourda signifie tromper. (Le Gon.) - (02) |
| bourde, s. f. feu de joie, grand feu - (08) |
| bourdeilleau, bourdeyeau, bourdesiau. n. m. - Gros nuage noir. - (42) |
| bourdeilleau, bourdeyeau. s. m. Gros nuage noir. (Perreuse). - (10) |
| bourdiau, s. m. nuage épais, grosse nuée d'orage; en quelques iieux«bouriau.» - (08) |
| bourdifaille, beurbifaille : s. f., boustifaille. - (20) |
| bourdifaille, s. f . , bombance, grande chère. - (14) |
| bourd'lot : bourrelet . Une grosse cicatrice peut faire un bourd'lot. - (33) |
| bourdoudou : diminutif enfantin pour âne. IV, p. 62. - (23) |
| bourdouler : tomber en roulant. - (56) |
| boure - bouillir. - En fau de l'aie bein chaude, fais en don boure. - Si te faisâ in pecho pu de feu le pot bouro pu vite. - (18) |
| boure : (nf) buse - (35) |
| boure : bouillir - (48) |
| bouré quelqu'un : lui faire de durs reproches, le malmener ; s'bourè dans le travail : ne pas prendre un repos utile en travaillant ; s'bourè se dit aussi pour : manger avec excès. - (16) |
| boure, s. f. alevin, poisson du premier âge, plus petit que la feuille. - (08) |
| boure, s. f. buse, oiseau de proie. - (22) |
| boure, s. f. buse, oiseau de proie. - (24) |
| boûre, v. n. bouillir. « l'eai vai boûre, » l'eau va bouillir. - (08) |
| boure, vn. bouillir. - (17) |
| boure. v. n. Bouillir. Dans nos campagnes, boure est l’infinitif de je bous , tu bous y il bout. Tu feras attention quand le lait va boure. - (10) |
| boureisson, s. m. la partie la plus grossière du chanvre frotté. - (08) |
| bourenfe, borenfe, bouron, boron. Furoncle ; clou. - (49) |
| bourenfle - un peu enflé, et sur une étendue peu considérable. - En diro que vos airain lai figure bourenfle. - Regairdez vos mains, tenez, quemant qu'à sont bourenfles. - (18) |
| bourenflé (adj.) : boursouflé - (64) |
| bourenfle (adj.) : enflé, gonflé, bouffi (selon de Chambure : bouranfle) - (50) |
| bourenflé : enflé - (44) |
| bourenfle : n. f. Enflure importante. - (53) |
| bourenfle, adj., enflé, bouffi ; se dit d'une personne hydropique, ou qui aune fluxion. - (14) |
| bourenfle, adjectif qualificatif : enflé. - (54) |
| bourenfle, bouffi par enflure. - (05) |
| bourenfle. Synonyme patois de boursouflé. An dirot que tai joue ast bourenfle, t'ai don mau ès dents. - (13) |
| bourenfler. v. - Boursoufler. - (42) |
| bourengler. v. a. Bouffir, boursouffler. Ne s’emploie guère qu’au participe passé, comme adjectif. Il a la figure toute bourenflée. - (10) |
| bouréssie, s. f. herbe serrée dans un tablier dont on a noué les quatre coins. - (22) |
| bouret n.m. (de bure). Grosse toile servant à transporter l'herbe. - (63) |
| bourgeois : Patron, maître. Les vignerons, les fermiers, les métayers appellent leur propriétaire « Neut 'bourgeois ». « La bourgeoise » la maîtresse de maison. La servante : « Je peux-t-y aller à la fête, neut' maitre ? », Le patron : « Demande voir à la bourgeoise. » - (19) |
| bourgeon. Maladie de l'œil nommé aussi orgelot. Ce mot est usité dans la partie de l’Auxois qui confine au Morvan... - (13) |
| bourgeon. s. m. Bouton qui pousse sur les paupières ; synonyme de Loriot. — Signifie aussi fragment, flocon, surtout en parlant de la laine. - (10) |
| bourgeon. s. m. Perchée de vigne qui ne va pas d’un bout à l’autre de la pièce, mais s’engage entre deux perchées formant angle. — Planche ou hâte de terre plus large d’un bout que de l’autre, ou qui finit en pointe. - (10) |
| bourgeouaîs (on) : bourgeois - (57) |
| bourgeouais, e. n. - Bourgeois, bourgeoise. - (42) |
| bourger : renverser un liquide. (A. T IV) - S&L - (25) |
| bourger, v., déborder, se répandre. - (40) |
| bourgnalon, s. m. bosse disgracieuse dans une étoffe mal cousue. - (22) |
| bourgnotte (na) : fenêtre (petite) - (57) |
| bourguin. s. m. Bourrelet d’enfant. (Villiers-Saint-Benoit). - (10) |
| boûri - oie et canne en général cri pour les appeler. - Vos nô faisez rire d'aivou vos bouris ; vos eûmez don ces bêtes lai ! – Bouri, Bouri, Bouri !!! - (18) |
| bouri ! bouri ! appellat. exclamalive dont ou se sert pour faire venir à soi les canards. Les enfants disent bouri pour : ventre (v. Bourillot). - (14) |
| bouri : (bou:ri - subst. f.) dans un champ ou dans un pré, tas de pierres envahi par les ronces. - (45) |
| bouri, jeune canard. - (28) |
| bouri. Mot qui sert à appeler les canards. - (03) |
| bouriau, s. m., bourreau, tourmenteur. - (14) |
| bouriaud, adj., dur de son corps au travail. - (40) |
| bouriauder (verbe) : secouer quelqu'un violemment notamment un enfant. - (47) |
| bouriauder : bousculer. Et peut’être beuriauder. - (62) |
| bouriauder, v. tr., faire souffrir, tourmenter, torturer, martyriser ; malmener quelqu'un comme on malmène le bourri en le frappant. - (14) |
| bouriaux (n.m.pl.) : gros nuages orageux. - (50) |
| bouriée, s. f. feu de borde, grand feu qui flambe et qui est entretenu avec des fagots de menu bois appelés en plusieurs pays bourrées. - (08) |
| bouriller, v. a. emmêler, embrouiller : « mon fi ô bourillé », mon fil est emmêlé. - (08) |
| bourillo. Nombril. - (03) |
| bourillon. n. m. - Enchevêtrement de fils, de ficelles. - (42) |
| bourillot et lambouri, s. m., nombril. - (14) |
| bourilloux oubourrillon : emmêlé, ébouriffé; cheveux ou poils en désordre - (60) |
| bouriôdè : malmener, bousculer - è s'fezè bouriôdè passe què n'travaillè pas èssé vite, il se faisait malmener parce qu'il ne travaillait pas assez vite - (46) |
| bouriquot, s. m., bourriquet, ânon, au fig., enfant ignorant. - (14) |
| bouriquote, s. f., bourrique. Au fig., fille ou femme ignorante. - (14) |
| bourlauder : bousculer, tracasser. (REP T IV) - D - (25) |
| bourlin, bourrelier. - (26) |
| bourlot : n. m. Bourrelet. - (53) |
| bourmager, bournager. v. - Corriger, changer, améliorer (Bléneau, selon M. Jossier). Autre sens : bousculer, rudoyer une personne ; se dit également dans le sens de semer la pagaille. (F.P. Chapat, p.49) - (42) |
| bourmager. v. a. Corriger, changer en mieux, bouleverser. (Bléneau). - (10) |
| bourmaté, v. n. se dit lorsque la respiration est gênée, avec bruit intérieur. - (22) |
| bournager (verbe) : souffrir de maux intestinaux. - (47) |
| bournager : malmener physiquement ou moralement - (60) |
| bournaguer : embêter, asticoter - (61) |
| bournaillou, bournayou. s. m. Bâton de marine très-court et non ferré, servant aux mariniers des canaux pour bouter sur les perrés. - (10) |
| bournaïou, s. m., pieu servant à buter. - (14) |
| bournàyé, v. u. regarder en dessous, observer sournoisement. - (22) |
| bournayoux, brenayoux (br'nâyoux) (-ouse) : s. m. et f., habitant du quartier de Bourgneuf â Mâcon. - (20) |
| bourne. n. f. - Borne. - (42) |
| bournéger. v. a. Taquiner, vexer. - (10) |
| bournéron, s. m. pièce obscure. - (22) |
| bournerotte : trou de construction parfois de « boulin », peut être borgne (donnant borgnote) ; soupirail de cave, niche dans un mur. - (62) |
| bournu, adj. creux ; se dit surtout d'un vieil arbre. - (22) |
| bourò, s. m. grosse étoffe à tablier, à «chari ». - (22) |
| bouronchllié, v. n. se dit d'un liquide qui gargouille en s'échappant. - (22) |
| bourot, s. m., oreiller d'enfant tout petit. - (14) |
| bourote, s. f., brouette ! « O promenot son frérot dans la bourote, é pi ôl l’a chaviré ». - (14) |
| bourote. Brouette. - (03) |
| bouroter, v. tr., brouetter, transporter les terres des contours sur l’étendue du champ. - (14) |
| bourotte : brouette. - (62) |
| bourotte : brouette. - (31) |
| bourotte, bourouette, s.f. brouette. - (38) |
| bourou : âne - (61) |
| bourou : âne mâle - (48) |
| bourou : âne mâle - (39) |
| bourou, s. m. anon, petit âne ou bête asine de peu de valeur. Se dit quelquefois en plaisantant d'un jeune enfant. - (08) |
| bourouatte, s. f., brouette. - (40) |
| bourouète, brouette ; bourouété, brouetter. - (16) |
| bourouette : une brouette - eune bourouette à sac : un diable - (46) |
| bourque (on) : bourg - (57) |
| bourrache : 3e qualité de chanvre. IV, p. 15-1 - (23) |
| bourrache, borrèche. Débris de filasse de chanvre obtenus par peignage des étoupes. - (49) |
| bourrachon. s. m. Poignée de bourras, d’étoupe, de filasse grossière. - (10) |
| bourrade. s. f. Feu de bourrées, vif et clair. Synonyme de chalibaudée . (Saint-Florentin). - (10) |
| bourradin. n. m. - Haricot sec. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| Bourras : nom de cheval. VI, p. 16 - (23) |
| bourrasse, borreche : s. f., bourre, bourras ; vêtement de bure. - (20) |
| bourrassée : s, f., charge d'herbe enveloppée dans une toile et portée généralement sur la tête. - (20) |
| bourrasses. s. f. pl. Chanvre de la plus grossière qualité. Des lourasses de chanvre. (Lainsecq). - (10) |
| bourre : bouillir. - (29) |
| bourre : buse - (43) |
| bourre : étoupe - (48) |
| bourre doguin : étouffe chrétien, mets bourratif - (48) |
| bourre n.f. (Son nom viendrait-il de son plumage un peu ébouriffé ?) Buse. - (63) |
| bourre n.f. Ecume. - (63) |
| bourre : adj., bourré. - (20) |
| bourre : s. f., buse. - (20) |
| bourre : s. f., mousse, écume. De la bourre de savon. Du lait en bourre (qu'on vient de tirer). - (20) |
| bourre, bouillir. - (26) |
| bourre, n.f. écume. - (65) |
| bourrée : fagot - (60) |
| bourrée, beurrée, burrée : s. f., averse, Quelle burrée ! - (20) |
| bourrée. n. f. - Fagot tenu par deux liens, servant à l'alimentation du four des potiers et des boulangers. - (42) |
| bourréger. v. a. Botteler, faire des bourrées. - (10) |
| bourreler, borreler (C.-d.), bourriauder (Chal.), borriauder (Char.). - Tourmenter quelqu'un, faire souffrir comme un bourreau. Cette explication semble plus simple que celle donnée par Fertiault : malmener quelqu'un comme on malmène un bourri, un âne. Il s'agit là de bourreau, en patois bourriau, et non de bourrique. Ajoutons qu'en vieux français bourreau se disait bourrel et que le verbe bourreler était fréquemment employé au lieu de tourmenter. - (15) |
| bourrenfle (Chal.), borenfle (C.-d.), bouranfle (Morv.).- Excessivement bourré, boursouflé. Ce mot est probablement une combinaison de bourré et d'enflé. Il est inutile d'aller chercher, comme le fait Chambure, une étymologie latine dans bura et inftare, enfler comme de la bourre. Dans le Morvan, une vessie gonflée s'appelle bouanfle. Signalons encore l'analogie de ce vocable avec le nom du frère Gorenflot, imaginé par Rabelais. - (15) |
| bourrenfle, adj. (être) très enflé. - (65) |
| bourrenfle, adj. composé vraisemblablement des mots bourré et enflé. « Veux-tu encore des pomm’ terr’ ? — Ah ouat ! j' suis d'jà bourrenfl'. » - (20) |
| bourrenfle. Bourré au superlatif, bourré et enflé ! Le mot fait image d'ailleurs, et vient évidemment de la réunion de bourre avec enfle pris dans le sens de rempli. Ex. : « Merci, merci, je n'en prends plus, je suis bourrenfle! » - (12) |
| bourrer v. 1. Faire de la bourre, écumer. 2. Augmenter en quantité ou en intensité. - (63) |
| bourrer : v. n., faire de la bourre, écumer. Le vin bourre quand il sort du pressoir. — Se dit aussi d'une manière générale de l'intensité ou de l'accélération d'un phénomène : Le vin qu'on tire au robinet bourre quand le fût est plein; au contraire il moule quand le niveau en est bas. — La Saône bourre quand la crue commence. - (20) |
| bourrer : v. n., se dit au jeu de billes lorsque l'impulsion donnée par le pouce a la bille est augmentée par une projection de la main en avant. - (20) |
| bourrer, se dit de l'épi de maïs. - (05) |
| bourretinre, cage dite « mue ». - (26) |
| bourri (mot masculin) : ane. - (47) |
| bourri : bourru (âne) - (60) |
| bourri, borri, beurri, burri, beri (b'ri) : s. m., beurrier ; cuvier. - (20) |
| bourri, petit canard. - (05) |
| bourri, s. m., âne. - (40) |
| bourri, s. m., bourriquet, ânon. - (14) |
| bourri. Bourriquet. Par extension âne. Mot originaire du Berry, apporté par les mariniers. - (49) |
| bourri. n. m. - Âne. - (42) |
| bourriau, adj. qui prend plaisir à faire souffrir. Verbe bourriaudé. - (22) |
| bourriau. s. m. Prune de perdrigon. - (10) |
| bourriaud, boriaud. Bourreau, inhumain. Fig. Mauvais ouvrier. - (49) |
| bourriauder, boriauder. Martyriser, faire souffrir. Fig. Mal faire son travail. - (49) |
| bourriautier.s. m. Prunier qui produit les bourriaux. - (10) |
| bourricot : petit âne, mot utilisé comme insulte - (39) |
| bourrienne. s. f. Guirlande d'oignons. - (10) |
| bourrier. n. m. - Bourrelier. - (42) |
| bourriller : mettre les cheveux en désordre (embourriller) - (60) |
| bourrillon. s. m. Emmêlis de menus tissus, de fils de lin, de laine, de coton ou autres, pliés et repliés sur eux-mêmes, au hasard, en tapon, sans ordre. - (10) |
| bourrique (mot féminin) : anesse. (voir anosse). - (47) |
| bourrique : Ane, ânesse. « Eune voiture à bourrique » - « Saoul comme la bourrique à Robespierre » : ivre mort « La bourrique a tourné le cul au foin », locution employée par les joueurs pour dire que la guigne a succédé à la veine. Terme de dénigrement : « quèle veille bourrique ! » - (19) |
| bourrire, boerrire : s. f., beurrière, baratte. - (20) |
| bourron : adj. m. pris substantivement, ébouriffe. Un homme ou une femme est bourron quand ses cheveux ne sont pas peignés. - (20) |
| bourron : s. m., boulette. Un bourron de papier mâché. - (20) |
| bourron, n.m. débris de paille. - (65) |
| bourron, n.m. furoncle. - (65) |
| bourron, s. m. 1. fagot de paille. — 2. Personne bourrue. - (24) |
| bourron. s. m. Fagot d’épines. — Se dit, par extension, d’une personne grognon, bourrue, mal gracieuse. - (10) |
| bourrotte, brouette. - (05) |
| bourrou (n.m.) : ânon, petit âne - (50) |
| bourrou (tout) : (tout) « dans le même tas », revêche - (37) |
| bourrou : âne, animal à poils raides - (37) |
| bourrou : âne. - (52) |
| bourrou : Grossier, rugueux. « Du drap bourrou ». Au figuré : un caractère bourrou, un grossier caractère. « Du vin bourrou » : du vin blanc nouveau encore en fermentation. - (19) |
| bourrou : un pousse-devant, autrement dit un outil de jardin servant à désherber - (46) |
| bourroua. adj. - Mal coiffé, grognon. (Mézilles, selon H. Chéry) - (42) |
| bourrouate : Brouette. « Mener la belle au bé su eune bourrouate » : mener la lessive au lavoir sur une brouette. Par dénigrement : voiture, « O m'a emmené dans sa voiture, quèl bourrouate ! ». (voir aussi à chevire) - (19) |
| bourroux. Fém. Bourrousse. Bourru ; nouveau ; frais ; trouble. Couvert d'écume : « du vin blanc bourroux », « du lait bourroux ». - (49) |
| bourru : adj., en bourre, c'est-à-dire couvert d'écume. Lait bourru, lait en bourre (qu'on vient de tirer). Vin bourru (qui sort du pressoir). Ciel bourru (nuageux). - (20) |
| bourse-de-chien : s. f., aristoloche clématite (aristolochia clematitis). - (20) |
| bourse-rouge, s.f. rouge-gorge. - (38) |
| boursicot. n. m. - Porte-monnaie, bourse : « L'souer i' s'partageront l'boursicot. » (Fernand Clas, p.163) Le boursicot est un néologisme imagé dérivé de « boursicoter », mot récent du XIXe siècle. - (42) |
| boursion. s. m. Echelon. - (10) |
| bourson. s. m. Pelote consistant en une espèce de sac rempli de son, sur laquelle on pique les aiguilles et les épingles. (Percey). - (10) |
| boursouner : embêter, asticoter - (61) |
| boûs (on) : bois - (57) |
| bousak. : Expression usitée en Bourgogne pour désigner un enfant qui déchire ses vêtements. (Del.) - (06) |
| bousc'ille (na) - jausse (na) : boucle - (57) |
| bousc'iller : boucler - (57) |
| bouscognai, pousser violemment. C'est un assemblage du verbe boussai, pousser, et cognai, heurter ; en latin pulsare. Ce mot a été francisé en celui de bousculer, c.-à-d. renverser tout sur son passage... - (02) |
| bouscognai. : Pousser et repousser, ballotter. (Del.) - (06) |
| bousculier. s. m. Celui qui touche à tout, qui entreprend tout, qui bouscule tout et qui ne fait rien. (Saint-Florentin). - (10) |
| bouse, n. fém. ; fiente de bœuf. - (07) |
| bousée ou bouzées, fiente de bœuf. - Dans l'idiome breton, bouzellen signifie boyau, intestin. (Le Gon.) - (02) |
| bouserâ, s. m. petit tas de fumier dépose dans un champ. Avant le labourage il faut répandre les « bouseras », mettre son fumier en « bouseras. - (08) |
| bouserée, sf. bouse. - (17) |
| bouseux : s. m., jardinier maraîcher. - (20) |
| boushion : buisson. Vient de l’allemand busch. - (62) |
| bousillage. Ouvrage mal fait. I seus obligé ai lai d’ôter d’aipprentissaige ; elle ne fiot ran que de bousiller. C'était jadis une maison ou un mur construits en bois avec de la boue et de la paille hachée. Les habitants du nord de la France emploient le mot dans ce sens. - (13) |
| bousiller, v. a. travailler maladroitement et sans goût, sans attention. - (11) |
| bousiller. Faire un travail sans soin, sans goût ; gâcher son travail. - (49) |
| bousiller. v. a. Plier, replier, rouler de menus tissus, des cordonnets, des fils, sans soin, au hasard, en désordre. - (10) |
| bousillon : s. m., bousillage, ouvrage mal fait. - (20) |
| bousillon. s. m., petit travail de femme, de peu d'importance, fait à la hâte, et surtout mal exécuté (couture, broderie, ornement quelconque) : « Vô v'lez que j'li baille c'qui ? n'y é ran qu' des bousillons». - (14) |
| bousin, s. m,, vacarme, bruit excessif et discordant : « V’tu ben n’pas fâre tant d' bousin ! » - (14) |
| bousin, s. m., lieu de mauvaise vie. - (14) |
| bousin. s. m. Lieu de débauche ; bruit, vacarme que l’on y fait. - (10) |
| bousiner. v. tr., bousiller, mal faire sa besogne. - (14) |
| bousinerie, s. f., chose de médiocre importance, travail lâché et mal exécuté. - (14) |
| boussa. n. m. - Homme de petite taille. - (42) |
| boussàyé, v. a. produire des bosses. - (22) |
| boussenée. s . f. Buisson touffu. (Etivey). - (10) |
| bousserouge, s. m. rouge-gorge. - (22) |
| boussiau. s. m. Gros nuage qui crève sur la tête. (Saint-Bris). - (10) |
| boussicauder : faire un ouvrage sans goût, faire un raccommodage. - (30) |
| bousson (on) : buisson - (57) |
| bousson (on) : haie - (57) |
| bousson : broussailles. - (29) |
| bousson. Echelon. Roquefort donne boujon. - (10) |
| bousson. s. m. Buisson. - (10) |
| boussounotte. s. f. Fauvette, parce qu’elle niche dans les buissons, dans les boussons. - (10) |
| boussu : bossu - (57) |
| boussu : Bossu. « Rire c'ment des boussus » : se tordre de rire. - (19) |
| boussu, e, adj. bossu. - (08) |
| boustacul. n. m. - Homme de petite taille. Déformation probable de « bas du cul ». (Lainsecq, selon M. Jossier) - (42) |
| boustacul. s. m. Homme défaille courte et ramassée. (Lainsecq). — A Auxerre, on dit Bas-du-cul. - (10) |
| boustancule (la) : galipette. Ex : "Diab' don ben ta boustancule ! Té vas t'salie !" (Ça : le dimanche !) Ou bien "...té vas t'fée mal !" (En semaine). - (58) |
| boustancule (n. f.) : culbute, galipette - (64) |
| boustifaille : Mangeaille abondante. « Ol en caiche d'la boustifaille ! » - (19) |
| boustifaille, s. f., provisions de bouche, mangeaille pour bons diners. - (14) |
| boustifaille. Gros plat de viande : Vins don souper vez cheu neus : j’aivons tué not’ couchon, an y ai de lai boustifaille. Dans la Franche-Comté, le Beurdifaille est le réveillon de Noël. - (13) |
| boustifaille. s. f. Mangeaille, nourriture abondante. - (10) |
| boustifer. v. n. Manger avidement. (Gisy-les-Nobles). - (10) |
| boustourou, s. m., homme gros et court . - (11) |
| bousttifaille, s. f. mangeaille, ce qu'on peut manger ; provisions de bouche dans le style burlesque. - (08) |
| bout : Morceau. « Miji in bout » : manger un morceau, casser la croute. « Donner in bout ès bâtes » : donner une ration de fourrage au bétail. « Repose te in petiet bout » : repose toi un peu. - (19) |
| bout n.m. Morceau. - (63) |
| bout' : n. m. Bout. - (53) |
| bout : s. m., bouillon. Prendre le bout, commencer a bouillir. - (20) |
| bout. Ce mot est employé pour morceau. Ex. : « Donne-mé don un bout de pain ». - (49) |
| bout’ner : boutonner.. Ex : « Bout’ne ta biaude ! » : boutonne ta blouse. Certains disent aboutonner. - (62) |
| bout’nére : boutonnière. - (62) |
| boutain, moyeu de roue. - (05) |
| boutasse : (nf) trou d'eau - (35) |
| boutchet (on) : bouquet - (57) |
| boutchier, bouquier. n. m. - Bouquet. - (42) |
| boutchin (on) : bouc - bouquin (animal) - (57) |
| boutchin (on) : lièvre (mâle) - (57) |
| bout-ci bout-là (loc. adv.) : pêle-mêle - (64) |
| boûte : lucarne. - (33) |
| boûte : ouverture où l'on passe le foin pour l'engranger sur le fenil - (39) |
| boute*, s. f. mesure de vin de la contenance de deux pièces. - (22) |
| bouteille (n. f.) : poche des eaux qui apparaît chez une femelle en couches (a vint d'fée enne bouteille) - (64) |
| bouteille : s. f., effet de rejaillissement et d'ondulation produit par la chute d'une goutte sur un liquide, Les gouttes de pluie font des bouteilles à la surface de l'eau. - (20) |
| bouteillé, bôteillé, s. m. celui qui, dans les noces, dans les festins rustiques, est spécialement chargé de la distribution des liquides, distribution à laquelle il doit pourvoir sans parcimonie, s'il fonctionne dans une bonne maison. - (08) |
| bouteille, n.f. nénuphar. - (65) |
| bouteille, s. f.. grosseur au cou, goitre. - (14) |
| bouteille. n. f. - Plusieurs usages : 1. Placenta : « On va bintoût avouer nout' viau, la bouteille alle a percé ! » 2.Poterie en grès à deux anses, utilisée comme récipient à huile ; synonyme de taule. 3. Grosse bulle sur les flaques d'eau lors d'un orage. - (42) |
| bouteilles (faire des), loc, se dit des gouttes de pluies d'orage qui, tombant avec force, soulèvent des cloques sur les ruisseaux et les pavés. - (14) |
| bouteinchlle, adj. bouffi. - (22) |
| boutelot : petit oiseau, petit enfant - (39) |
| boutelot, bot : crapaud chanteur. - (33) |
| bouteneire ; s. f., boutonnière. - (14) |
| boutenére, s. f. boutonnière. - (08) |
| boutenère. s. f. Boutonnière. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| bouter (verbe) : mettre. - (47) |
| bouter : (boutè - v. tr.) mettre (désuet). - (45) |
| bouter, mettre. - (04) |
| bouter, v. tr., mettre, placer: « ôl a bouté son grand séchot su la charote». - (14) |
| bouteriolle (nom féminin) : corbeille en osier. - (47) |
| bouteriolle, s. f. panier de forme allongée. - (08) |
| bouterolle, subst. féminin : béret. - (54) |
| bouterolle. n. f. - Nid où pondent les poules. - (42) |
| bouterolle. s. f. Nid où pondent les poules. (Saint-Privé). — Panier de forme cylindrique, ordinairement sans anse, servant à contenir les provisions de fruits secs (noix, pruneaux, etc.) - (10) |
| bouteroue, s. m., borne placée à l'entrée des portes charretières, pour détourner le frottement des roues des voitures. - (14) |
| boûti. Assaisonnement, haut goût. - (01) |
| bouticle, boutique. - (04) |
| bouticle. - Ce mot appartient aussi au vieux français. (Voir Lac.) On entendait plus particulièrement par là ce que transportaient à dos les marchands colporteurs. En effet, dans l'idiome breton, boutecq signifie hotte. (Le Gon.) - (02) |
| boutifle : boursouflure de la peau (quétoufle) - (60) |
| boutikye, boutique. - (16) |
| boutiller. v. a. Bousculer, jeter par terre, rouler dans la boue, dans la poussière. — Se Boutiller. v. pronom. Se rouler, se vautrer dans la boue, dans la poussière. - (10) |
| boutillon : panier profond. - (09) |
| boutillon, s. m. panier avec un couvercle attaché à l'anse. - (08) |
| boutin : essieu - (39) |
| boutin, s. m. moyeu, centre de la roue ou s'emboîtent les rais d'une voiture. - (08) |
| boutiou - boiteux. C'est un mot des pays voisins nous ne l'employons que comme citation et par moquerie. - Ceute homme lai, queman qu'an dit ai Gergeux, al à tot boutiou. - (18) |
| boutiou, adj. boiteux. - (17) |
| boutiou, boiteux. - (26) |
| boutiqhie, bôtiqhie, s. f. boutique de marchand, atelier de travail pour les menuisiers principalement. - (08) |
| boutique : Magasin, atelier. « Ol est to le jo à beurlauder dans sa boutique » : il bricole tout le jour dans son atelier. Dans un sens péjoratif : « Quèle sale boutique ! » - « Fremer boutique » : cesser le commerce faute de ressources. - (19) |
| boutje, sf. pièce d'étoffe, morceau de toile. - (17) |
| boût'lot : crapaud - (48) |
| boût'lot : roitelet - (48) |
| bout'né ; un arbre bèn bout'nè est un arbre qui a beaucoup do bourgeons à fruits ; se dit aussi des fleurs. - (16) |
| bout'ner - about'ner : boutonner - (57) |
| bout'nire (na) : boutonnière - (57) |
| boutoeu, adj. marécageux, boueux. - (22) |
| boutoillon - petite bouteille ou vase quelconque un peu allongé qui sert surtout dans le ménage. - Le boutoillon n'â dière propre, vais ; en te faut le nettie. - In boutoillon bein prope, cé indique in bonne mannègére. - (18) |
| bouton de culotte : s. m., petit fromage de chèvre sec. - (20) |
| bouton d'or (on) : renoncule - (57) |
| boutonner : commencer à bouillir. Voir bout. - (20) |
| boutonnou : rempli de boutons - (44) |
| boutouné, v. n. bouillir faiblement. - (22) |
| boutounniée. n. f. - Boutonnière. - (42) |
| boutre ! boutre de Mater ! juron. - (38) |
| boutre, boute, bôte, v. a. bouter, mettre, placer. - (08) |
| boutre, bouter (v.) : mettre, placer - aussi bôter - (50) |
| boutre, v, mettre. - (38) |
| boutrenflé : boursouflé (?). - (33) |
| boutron (n.m.) : ruche (d'abeilles) - (50) |
| boutron (nom masculin) : ruche. - (47) |
| boutron : ruche, grand cabas de paille pour mettre les céréales - (39) |
| boutron : s. m., gros crapaud. Se dit par moquerie des Individus gros et courts, voir boireau. - (20) |
| boutron, « L » ruche, bouteriolle, panier, de butro (boutro), panier, en bas latin. - (04) |
| boutron, s. m. gros crapaud. [botereau.] - (22) |
| boutron, s. m. ruche d'abeilles. - (08) |
| Boutru (le), sobriquet assez fréquent. - (38) |
| boutru, adj. se dit d'un objet informe, court, aussi gros d'un bout que de l'autre ; par extension, se dit d'une personne massive et petite. - (38) |
| boutse : bouche - (43) |
| boutse n.f. Bouche. - (63) |
| boutsefaure : porte amovible placée devant la gueule du four - (43) |
| boutseure : (nf) haie - (35) |
| boûtseûre n.f. Bouchure, haie. - (63) |
| boutseûre, chieuzon : haie - (43) |
| boutsi : boucher - (43) |
| boutsi : boucher - (51) |
| boûtsi n.m. 1.Boucher. 2. Vin bouché. - (63) |
| boûtsî v. 1. Boucher. 2. Couvrir une marmite. - (63) |
| boutson (a) : à l'envers. - (30) |
| boutson : bouchon - (43) |
| boutsson : bouchon - (51) |
| boutte, s. f. ouverture par laquelle on fait descendre le foin du fenil, trou de sortie pour le fourrage. - (08) |
| bouyau : Boyau, intestin « Rendre tripe et bouyau » : vomir tout ce que l'on a dans le corps. « Ol a tojo in bouyau de vide au sarvice de ses amis » : il est toujours disposé à faire honneur à la table où on l'invite. - (19) |
| bouye, vase do bois ayant la forme d'une hotte et servant à transporter le vin. - (16) |
| bouzard, s.m. partie d'un foyer. - (38) |
| bouzèn, grand tapage. - (16) |
| boûzeon : barreau de chaise - (37) |
| bouziller (verbe) : tuer. Bâcler un travail. - (47) |
| bouziller, travailler peu sérieusement, sans suite ; faire un travail qui demande peu de soin. - (27) |
| bouziller, v. mal faire un travail, le gâcher. - (38) |
| bouzillou : un mauvais travailleur, on dit aussi un argonier, un borcheillou. - (46) |
| bouzillou, adj. celui qui travaille mal. - (38) |
| bouzin (nom masculin) : mauvais cheval. - (47) |
| bouziner (verbe) : gâcher un travail. Manquer de sérieux. - (47) |
| bôvreu, s. m. bouvreuil, oiseau. - (08) |
| bovru : (nm) bouvreuil - (35) |
| boxon. s. m. Brandon, tison allumé. Se dit, à Armeau, sans doute par métaphore, parce que les boxons et autres lieux de débauche sont bien souvent la source des querelles, des discordes qui troublent les familles et qu’ils doivent être considérés comme des torches qui allument les passions et détruisent la concorde entre parents et amis. Boxon, au reste, est un dérivé du mot anglais box, qui signifie cabinet particulier de café, d'auberge, de taverne , et aussi, soufflet , coup de poing. - (10) |
| boxonner. v. a. Bousculer, taper, battre, souffleter, comme on le fait dans les boxons. De l’anglais box. - (10) |
| böyalerie n.f. Viscères. - (63) |
| boyalier (iére), boyali (ire) : adj., qui a un gros ventre par distension des intestins. - (20) |
| boyard : tremble. - (30) |
| boyarne. s . f. Ouverture pratiquée dans les murs d’une étable pour y faire pénétrer l’air et la lumière. - (10) |
| boÿau : (nm) petite quantité (petit bout) - (35) |
| boÿau : boyau - (51) |
| bo-yau : grande quantité de neige - (43) |
| böyau n.m. Boyau. - (63) |
| bo-yauder, embo-yauder : grouper le foin en andain - (43) |
| boÿaudrie : viscères - (51) |
| boyer : bouvier - (60) |
| boyer : bouvier. - (32) |
| boyer : bouvier. III, p. 31 - (23) |
| boyer : voir réboler - (23) |
| boyer, bouvier. - (04) |
| boyer. s. m. Trou dans un mur. — Bouvier. - (10) |
| boÿon : (nm) jeune veau - (35) |
| boyotte. s. f. Lucarne. - (10) |
| boyotte. s. f. Petite fenêtre. - (10) |
| brâ : Broyer, triturer « An brâ les tapines pa fâre le boire ès cochons » : on broie les pommes de terre pour préparer la pâtée des porcs. Au figuré « Ou'est-ce que te brâs ? » : Qu'est-ce que tu fabriques ? - (19) |
| bra : tasser au pied - (51) |
| brabannette : charrue brabant - (43) |
| brachand : Bressan, au féminin : brachande. - (19) |
| braché (ā), vn. crier très fort, bestialement. - (17) |
| brâcher, beugler comme une vache, mugir comme un taureau. - (27) |
| braconner : v. n., vx fr. bracon (branche), déplacer et diriger un véhicule à l'aide des brancards, auxquels on imprime des mouvements alternatifs de droite et de gauche. C'est dans le recul que ces mouvements sont le plus accentués. - (20) |
| bracouné, v. a. manœuvrer une voiture pour la tourner sur place. - (22) |
| bracouner, v. a. manœuvrer une voiture pour la tourner sur place. - (24) |
| braguète : s. m., diseur de boniments, charlatan. A rapprocher du bas-lat. bragare. - (20) |
| braguette, brayette, s. f. culotte fendue sur le devant selon l'usage contemporain. La culotte « à braguette » n'a pas encore détrôné la culotte « à bavoire. » - (08) |
| brai : braire - (51) |
| braî p.p. de brâyi Broyé, tassé. - (63) |
| brai, s. m., bras : « D'avou e'coumarce, t’li as métu eùne peùte afâre su les brais ». - (14) |
| Brai. Ancien nom du hameau de Gigny. Je crois que c’est un mot celtique qui signifiait boue, terrain gras et humide : le sol de Gigny est dans ce cas.... - (13) |
| brai. Bras. - (01) |
| braî’llotte : braguette - (37) |
| braibant : charrue « brabant », à deux socs réversibles superposés, ce qui permet de labourer un sillon dans le sens inverse du précédent, sans avoir besoin de revenir « à vide » à son point de départ, ainsi que l’on est obligé de procéder avec la charrue « dombasle » à un seul soc - (37) |
| braichée : Brassée. « Donne voir eune braichée de foin à tes bûs (bœufs) ». « S'empogni à la braichée » : se prendre à bras le corps. « Se rembraichi à grandes braichées » : s'embrasser en entourant de ses bras, donc très fort, très affectueusement. - (19) |
| braichie : brassée - (39) |
| braichie. Brassée ; « se prende à la braichie ». - (49) |
| braicollou : maladroit, qui « n’avance pas » dans son travail - (37) |
| braige (n.f.) : braise - (50) |
| braige, s. f. braise, charbon allumé. - (08) |
| braiger, v. a. broyer. - (08) |
| brailai : rendre solidaire la flèche d'un chariot munie d'un vorpit avec les grumes, le serrage s'effectuait à l'aide d'un playon (ou playon ?). - (33) |
| brailla : braillard - (43) |
| braillai, crier à tue-tête. -Les Bretons disent breûgi. (Le Gon.) - (02) |
| braillasse. s. f. Femme criarde et braillarde. - (10) |
| braille. Crie, ou crient fort… - (01) |
| brâ'iller : crier, beugler - (48) |
| brailler : essentiellement pleurer. Ex : "Mais arréte don d'brailler !" - (58) |
| brâillette : braguette - (48) |
| brâilli - dgeuler : brailler - (57) |
| brailli : broyer - (57) |
| brailli : écraser - (57) |
| brâilli v.i. Braire, hennir, pleurer. - (63) |
| brâillote : (avoir une bonne brâillote) parler beaucoup et fort, avoir la langue bien pendue brâillou : quelqu'un qui crie fort, on utilise aussi le mot breuillou (brâillouse au féminin) - (46) |
| brâillote : n. f. Baguette. - (53) |
| bra-illou : Broyeur, outil en bois ou métallique servant à broyer les aliments des animaux après cuisson. - (19) |
| braîllou : celui qui crie souvent - (37) |
| braillou à treuffes : pilon à pommes de terre - (43) |
| braimai - demander sans cesse, jusqu'à ennuyer. – Qu'à nos embête don ! tojeur ai braimai ! – Voyez Quemandou. - (18) |
| braimai, crier. - Ce mot signifie, dans le Châtillon nais et à Aignay principalement, demander quelque chose avec obstination. Dans cette acception, il a de l'analogie avec l'italien bramare, désirer ardemment... - (02) |
| braimé : v. i. Bramer. - (53) |
| braime, adj. stérile, infécond. se dit quelquefois des poissons mâles qui ont peu ou point de laitance. - (08) |
| braime. Femme stérile… - (01) |
| braimer (v.) : pousser des beuglements en parlant du veau - (50) |
| braimer, v. intr., pleurer fort, crier, gémir : « Pauv' petiot ! ôl a mau ; ô n' fait qu’braimer ». - (14) |
| braimer, v. n. bramer. Se dit du mugissement des bêtes à cornes, mais plus particulièrement des veaux ou génisses. - (08) |
| braimer. Crier douloureusement. Not' pauv vaiche braime son viâ que le boucher vint d'emmener. On l'applique également aux personnes : voiqui un p'tiot qui braime lai faim. - (13) |
| braimer. Demander avec obstination, demander à satiété. C'est le mot bramer avec l’ai patois pour l’a, mais dont le sens est altéré, car régulièrement, bramer ne se doit dire que du cerf qui crie. Certains auteurs l'ont étendu au cri fortement poussé et répété d'autres animaux : nous l’avons appliqué à la personne qui réclame bruyamment. Etym. italien bramare. - (12) |
| brainche (n.f.) : branche - (50) |
| brainche (na) : branche - (57) |
| brainche : Branche. « Eune greusse brainche de noué (noyer). » - (19) |
| brainche : n. f. Branche. - (53) |
| brainche, s. f. branche d'arbre. - (08) |
| brainchi : brancher - (57) |
| brainchi : Etat du lait qui commence à cailler naturellement, sans qu'on y ait ajouté de la présure. « Je vas fare des fremages de cailli to man lait est brainchi » - (19) |
| braine ou brehaigne, stérile... - (02) |
| brai-né : v. i. Brailler. - (53) |
| brainne. : En patois ; brehaig dans le dialecte bourguignon ; brahaigne, braigne, brehagne et brehenne dans les autres dialectes de la langue d'oïl ; bréchan, dans l'idiome breton ; tous ces mots signifient stérile. - (06) |
| braiquer aine ail’mette : frotter, « craquer », une allumette - (37) |
| braiquire. Braquames, braquates, braquèrent. Lé Maige braiquire lo lugnôte, les Mages braquèrent leurs lunettes. - (01) |
| brais (on) : bras - (57) |
| brais, sm. bras. - (17) |
| brais. Bras. - (49) |
| braisaille, s. f., menue braise, braise de boulanger. - (20) |
| braîse n.f. Miette de pain. - (63) |
| braise : s. f., miette. De la braise de pain, des braises de biscuit. - (20) |
| braisé, s. m. brasier, amas de charbons ardents. - (08) |
| braise. Débris, miette, menu morceau. - (49) |
| braiser : v. a., morceler. Braiser du pain. Y est tout braisé. Voir ébraîser (S’) - (20) |
| braises : (nfpl) miettes - (35) |
| braises : miettes - (43) |
| braisil, s. m , résidu, poussière de braise. « Cliaique maitin, àll’ prend ein sou de braisil por sa couvette ». - (14) |
| braisil. Proprement : braise fine ; mais l'acception primitive a disparu. Le mot ne s'emploie que dans des phrases analogues à celle-ci : lai târre se façonne bin : elle ast tote en braisil. - (13) |
| braisiller (br'siller) : v. a., émietter, grignoter. - (20) |
| braisö, sm. brasier. - (17) |
| braisons. n. m. pl. - Braises. « En chicotant mes braisons. » (Arquian) - (42) |
| braisseire. Brassières. - (01) |
| braissia (na) : brassée - (57) |
| braissie (n.f.) : brassie - (50) |
| braissie : brassée - (48) |
| braissie : une brassée - (46) |
| braissie, braissée : brassée - (43) |
| braissie, s. f. brassée, ce que l'on peut prendre dans ses bras. Une « braissie » de paille, de foin, de bois, etc… - (08) |
| braissie, sf. brassée. - (17) |
| braissiére : brassière - (48) |
| braissiére : brassière - (39) |
| braive, brave : joli, seyant - (37) |
| braiverie. : (Dial. et pat.), dépense en habits et étalage. - (06) |
| braize, s. f. miette de pain. Verbe ébraizer. - (24) |
| braize; s, f. miette de pain. Verbe ébraizé. - (22) |
| bramai ou braimai. : Demander une chose avec obstination. - (06) |
| bramaingnoux, ouse. s. m. et f. Qui demande et qui se plaint sans cesse. De bramer et de main (maingne), se plaindre en tendant la main. Le bramaingnoux, conséquemment, est le mendiant ou celui qui, à l’exemple du mendiant, demande toujours d’un ton piteux et dolent. (Etivey). - (10) |
| brâman : bravement, avec courage et énergie, bien - (46) |
| braman : très bien. On ot braman : on est très bien. - (52) |
| braman : très bien. On est braman au chaud l'hiver : on est très bien au chaud l'hiver. - (33) |
| bràman, bien, beaucoup. S'â brâman fè, c'est bien fait ; vo m'an bayë bràman, vous m'en donnez beaucoup. - (16) |
| brâmant - bien, comme il faut ; et mot explétif ou euphonique dans la phrase. - I seu étai bein mailaide, ma ai c't-heure i vâs bramant. - Regairde don queman que c'a brâmant fai. - I pairlain de lé, et pu voiqui brâment qu'ile vaint. - (18) |
| brame (brâme) : s. f.. brème (poisson). - (20) |
| brâme (na) : brème - (57) |
| bramé, demander avec instance une chose que l'on désire. - (16) |
| brame. Brême. - (49) |
| brament (adv.) : bien - (64) |
| brâment (adv.) : bien, comme il faut - (50) |
| brâment (adverbe) : bien, parfaitement. (J'ons brâment mangé). - (47) |
| brâment (ailer) : (aller) bien - (37) |
| brâment : beaucoup - (37) |
| brament : bien (vient de bravement ou vraiment) - (61) |
| brâment : bien, beaucoup. Aussi : suffisamment, tranquillement ; C’est une ellipse ou syncope de « bravement ». - (62) |
| brâment : bien, très bien - (48) |
| brâment : bravement, gentiment, justement, carrément. - (32) |
| brament : très bien. - (09) |
| brâment : 1 adv. Bien. - 2 adv. Beaucoup. - (53) |
| brâment : bien, parfaitement - (39) |
| brament : vraiment, tout à fait. Ex : "C'pour Léon, il est brament imbicile !" - (58) |
| brâment, adv, bien (de "bravement"). - (38) |
| brâment, adv. ; bien, convenablement, doucement ; dreume brâment, peore pitiot. - (07) |
| brâment, adv. bravement, bien, comme il faut, à l'aise, heureusement. « aller brament », c'est se bien porter, être tranquille, voyager en paix, etc… - (08) |
| brâment, adv., convenablement, comme il faut. - (40) |
| brament, adv., ellipse de bravement, beaucoup, bien, convenablement : « J' seù été cheû la Mag'rite ; àll é bô brâment arrangée ! » — « T'ét iqui bé brament ». — « All’ m'en a brâment baillé, des cerises ». - (14) |
| brâment, adverbe : bien, justement, beaucoup. - (54) |
| brament, bien, excellemment. - (27) |
| brâment, bram'ment. adv. - Plusieurs usages : 1. Bravement, sérieusement, soigneusement : « Et j'l’ ai couché ben brament su' la civiée en attendant. » (Fernand Clas, p.118) 2. Complètement : « Il est d'venu brâment fou, il est dans l'grous calounier avec son bras en écharpe. » - (42) |
| brament, modérément. - (28) |
| brâment. adv . Contraction de bravement. Bien, commodément, doucement, sans embarras, sans gêne d’aucune sorte. J’ nous sons en allés ben brament par l’ chemin de fer. - (10) |
| brament. Adverbe très usité dans les environs de Beaune : c'est la syncope de bravement. « Comme te voilà brave. » dit-on dans certains pays à un homme endimanché. Chez nous l'adverbe brament a le sens de : convenablement : voiqui un ôvraîge quasi brament torné... - (13) |
| brâment. Bravement : « au s'est brâment conduit ». - (49) |
| brâmer (v.t.) : beugler (en parlant des bovins) - (50) |
| bramer : Réclamer à grands cris, demander avec insistance. « Ses ptiets sant to le temps à bramer après lline » : ses enfants ne cessent pas de la réclamer en criant. « Bramer la faim » : crier famine. - (19) |
| brâmer v. Beugler, crier. - (63) |
| bramer, crier de douleur. - (05) |
| bramer, v. n. protester bruyamment. - (24) |
| brâmer, v., crier comme le cerf en rut, pousser des cris pour peu de choses. - (40) |
| bramer. v. n. Beugler, imiter le cri du cerf. - (10) |
| bramullouée, s. f. balançoire. - (08) |
| bran : sciure de bois. A - B - (41) |
| bran : Son, partie du son la plus grossière (Littré). « In ea de bran » : un sac de son. - (19) |
| bran : sciure de bois (bran de scie). - (33) |
| bran de schie (n.m.) : sciure - (50) |
| bran de scie : sciure de bois - (48) |
| bran de scie. n. m. - Sciure de bois. - (42) |
| bran : s. m. son. - (21) |
| brancâ (on) : brancard - (57) |
| brancâ : Forte pièce de bois faisant partie d'un char servant à transporter le vin. Les fûts sont placés sur les « brancâs » comme ils le sont sur les « mâts » de la cave. Voir mâ. - (19) |
| brancad : brancard - (51) |
| brancher. v. n. Pousser des branches. Cet arbre branche bien. - (10) |
| branchères. Vesces fourragères. S'emploie surtout au pluriel. - (49) |
| branchiller. v. n. Pousser des petites branches. - (10) |
| brancin, s. m., crochet pour fixer le seau à la corde du puits. - (40) |
| brand'chie : sciure de bois - (39) |
| brande : La partie du branchage d'un arbre qui peut être mise en fagot ; ne pas confondre avec la « frâche », mot par lequel on désigne l'ensemble du branchage. - (19) |
| brande, s. f. branle, danse. Cette forme est usitée dans quelques parties du Morvan bourguignon. Elle n’est qu’une variété de branle. - (08) |
| Brandebour. Brandebourg. - (01) |
| brandes. n. f. pl. - Petits fagots. Les brandes, mot emprunté au XIIe siècle à l'allemand Brand, tison, signifiait flamme. Ce mot a désigné peu à peu le fagot destiné à être enflammé. - (42) |
| brandevigné, s. m. celui qui fabrique l'eau-de-vie. - (08) |
| brandevignier : distillateur d'alcool. - (58) |
| brandevin : eau de vie de vin. - (33) |
| brandevin. Eau-de-vie. On serait tenté de décomposer ainsi : bran-de-vin, résidu du vin ; mais la véritable étymologie est celle de vin brûlé : brand, en allemand signifie incendie. Notons en passant que le radical brand a formé le mot brandon, torche faite avec de la paille. Le dimanche des brandons, nos pères couraient dans les champs avec des torches allumées. Cet usage, sanctifié par le christianisme, avait une origine celtique. - (13) |
| brandevingn', s. m. eau-de-vie. Vin de feu. - (08) |
| brandevinier : Celui qui fabrique l'eau de vie de marc. Le bouilleur de cru. - (19) |
| brandevinier, n.m. distillateur. Artisan qui se déplace de village en village pour mettre en route (légalement) l'alambic. - (65) |
| brandevinier, s. m., marchand à la sauvette d'alcool de contrebande. - (40) |
| brandi (adj.) : tel quel (tout brandi) - (64) |
| brandi (tout), tout entier. - (04) |
| brandi, e, partie, passé. entier ; « tout brandi », tout entier, tout droit, sans être courbé, ployé. - (08) |
| brandi, tout entier - (36) |
| brandi,(-e) (adj.m. et f.) : en entier - tot brandi : tout entier - (50) |
| brandi. Jeté de force, lancé… - (01) |
| brandigouler : faire remuer - (37) |
| brandigouler : secouer les branches - (37) |
| brandillé, ée. part. p. de Brandiller. Mis en balance, mis en mouvement de ci, de là. — Soupe brandillée , soupe faite dans une marmite, dans un chaudron suspendu à la crémaillère, qu’on agite et qu’on brandillé suivant le besoin. - (10) |
| brandiller (Se). v. pronom. Se balancer. - (10) |
| brandiller : balancer. - (09) |
| brandiller, v. a. secouer de droite et de gauche, balancer. - (08) |
| brandilloire, balançoire. - (04) |
| brandilloire, bradilloie, brandillouée. s. f. Balançoire. - (10) |
| brandillouée (n.f.) : balançoire - (50) |
| brandillouée. n. f. - Balançoire. - (42) |
| brandiner, v. a. brandir, secouer, agiter en tous sens. - (08) |
| brandir. : (Dial.), brandi (pat.), jeter, lancer, agiter, faire tournoyer.- On appelle brandes, dans quelques terrains, certaines bruyères à balai (le comte Jaub.) - Brandir en l'air, le soir du premier dimanche de carême, ces brandes ou brandons est un usage conservé du paganisme. Les villageois de nos côtes bourguignonnes enflamment des paquets de sarments ou retirent des brasiers allumés sur les places des tisons qu'ils lancent ou brandissent en l'air. - (06) |
| brandler (v. int.) : chanceler, vaciller, manquer d'équilibre - (64) |
| brandonner. v. a. Se dit, à Villiers-Saint-Benoît, des honneurs rendus le jour du dimanche gras (ne serait-ce pas plutôt le jour des brandons?), à un nouvel habitant de la commune. - (10) |
| brandons (dimanche des). n. m. pl. - Premier dimanche carême. Anciennement, les jeunes parcouraient la campagne la nuit, avec des brandes allumées. - (42) |
| brandons (Dimanche des). Premier dimanche de Carême, ainsi appelé, parce qu’autrefois, ce jour-là, les jeunes gens, par ressouvenir des temps du paganisme, parcouraient le soir la campagne avec des tisons et de petits fagots de brande allumés, qu’ils agitent sous les arbres et dont ils formaient ensuite un grand feu autour duquel ils dansaient en rond. C’était sans doute aussi ce jour là qu’à Villiers-Saint-Benoit on souhaitait, par la même occasion, la bienvenue aux étrangers nouvellement établis dans la commune ; c’est également ce jour là que, dans certaines localités, les jeunes mariés sont obligés de distribuer la grolée aux jeunes gens. - (10) |
| brandons, s. m., feu de joie. La « fête des brandons » n'a pas encore disparu de tous les villages, et ce premier dimanche de carême s'appelle « dimanche des brandons ». (V. Bordes). - (14) |
| brandouille. Cuisinier brandouille, syn. de cuisinier à la barbote (voir ce mot). Formulette mâconnaise : Hôtel des Trois-Moineaux, Tout est prêt, rien n'est chaud. - (20) |
| brandouiller (d'lai tête) : branler la tête (marque la répétition). (V. T IV) - A - (25) |
| brandouiller : remuer, avoir du jeu - (48) |
| brandouiller, agiter assez violemment quelque chose. - (28) |
| brandvignin, distillateur. - (26) |
| brand'vinerie, brand'vignerie. n. f. - Installation du, bouilleur de cru, l'alambic. - (42) |
| brandvinier : distillateur - (48) |
| brandvinier : distillateur, celui qui fait la goutte. - (33) |
| brand'vinier, brand'vigner. n. m. - Bouilleur de cru. Celui qui passait de ferme en ferme, avec son cheval et son alambic, pour distiller. Mot français encore usité dans la première partie du XXe siècle. - (42) |
| branlasse, s. f. nom de loc. qui s'applique à des terrains mouvants, à un sol qui branle sous les pieds. - (08) |
| branl'cou : bergeronnette. (B. T II) - B - (25) |
| branle : Sorte de danse qu'on ne pratique plus guère. « I n'a plieu que les vieux qui saidrint (sauraient) enco à dansi in branle à huit ». « Sonner à grand branle » : sonner à toute volée. - (19) |
| branle quoûe : bergeronnette - (48) |
| branle, s. m. danse du pays généralement remplacée par la stupide contredanse ; l'air même que l'on chante pendant la danse. - (08) |
| branle, s. m. petite barrière mobile et souvent grillagée qui sert de porte pour donner de l'air ou du jour. - (08) |
| branle, s.m. ancienne danse, sorte de ronde ("branle des cocus"), danser un branle. - (38) |
| branle-cou : s, m., personne ou animal qui guigne de la tête. - (20) |
| branlecoue, s. m. bergeronnette, lavandière, oiseau dont la queue est toujours en mouvement. - (08) |
| branlecoue, s. m., hoche-queue, lavandière, bergeronnette. - (14) |
| branlée : volée - (44) |
| branlée. s. f. Forte charge. (Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes). - (10) |
| branle-queue, n.m. hoche-queue, bergeronnette. - (65) |
| branlequoue (n.f.) : bergeronnette, hochequeue - (50) |
| branlequoue : bergeronnette - (39) |
| branler (se) : v. n., vx fr., se balancer. - (20) |
| branler (se). Se dépêcher. On dit : « branle té don » pour dépêche-toi donc. - (49) |
| branler : Remuer, vaciller. « J'ai eune dent que veut pas tarder de cheu (tomber), alle branle bien. Oh ! to ce que branle ne cheut pas ! » - (19) |
| branlière, branlire : s, f., branloire, balançoire, escarpolette. - (20) |
| branlires (aller à les), loc. être vieux, usé, branlant. - (24) |
| branlires* (aller a les), loc. être vieux, usé, branlant. - (22) |
| branlou : personne qui veut rien faire - (44) |
| bran-man, bonnement. - (26) |
| brân-mant - brâmant - à beurnonsiau : beaucoup - (57) |
| branmant : tranquillement - (57) |
| branment, brament, adv. [bravement]. Bonnement, convenablement, parfaitement. - (17) |
| brannai, remuer, branler... D’où le mot branne, c.-à-d. branle, balancement. Dans certains pays on dit vranbir. A Châtillon l'on dit vrombir. Or, la racine de ces deux mots est dans le latin vibrare. Le dimanche des Brandons est le jour où l'on allume des feux et où se lancent et se brandissent des tisons... - (02) |
| brannai. : Remuer, agiter. - (06) |
| branne. Branle, branlent. - (01) |
| branquignole : en déséquilibre. - (30) |
| branquignoler : branler exagérément. - (30) |
| bransin : gros mousqueton où s'accroche le seau à la chaîne du puits. (BD. T III) - VdS - (25) |
| braque adj. Bizarre, imprévisible. - (63) |
| braquer, v. Ir.. monder le lin à la broie mécanique, après l'avoir laissé une nuit dans le four d’où l'on a retiré le pain. - (14) |
| brâse, s.f. braise. - (38) |
| brasse (nom fem) : Les deux bras. « La brasse m'en cheut » : j'en suis stupéfait, j'en suis découragé. - (19) |
| brasse. Mesure de longueur (environ l,60 rn). C'est la longueur des bras étendus. - (49) |
| brasse. s. f. Besace, ainsi appelée parce qu’on la porte suspendue sous le bras. - (10) |
| brassée, s. f., fardeau porté sur les bras. Ex. : une brassée de bois. - (11) |
| brasser, v. battre, tourner. Plus particulièrement battre l'eau. - (65) |
| brassi v. Brasser, battre, tourner. - (63) |
| brassie (à la) (loc. adv.) : (tnî quioqu'un ou quioque choue à la brassie (tenir quelqu'un ou quelque chose en le serrant dans ses bras)) - (64) |
| brassie : brassée. Une brassie d'herbe, de bois. - (33) |
| brassie, brassée, ce que les deux bras peuvent embrasser. - (16) |
| brassie, s. f., brassée, ce qu'on prend entre les bras. - (14) |
| brassie. n. f. - Brassée d'herbe, de paille. - (42) |
| brassiée. s. f. Brassée. Brassiée de copeaux, brassiée de sarments. - (10) |
| braster, brâter. v. n. Tourner court. De brast, tournant d’une rue, détour. - (10) |
| brâtai : changer de direction (attelage). - (33) |
| brâté : 1 v. t. Tourner. - 2 v. t. Broyer. - (53) |
| brater : faire changer un véhicule de direction. A - B - (41) |
| brâter (v.t.) : tourner, changer de direction en parlant d'une voiture - (50) |
| brâter (verbe) : dépasser, surclasser. (Eh ben mon p’tit gars, la Brigitte al t'a brâté en français c'te fois). - (47) |
| brater : (vb) tourner - (35) |
| brâter : braquer, tourner, changer de direction - (48) |
| brater : faire mieux, braquer un chariot - (60) |
| brater : tourner le volant - (44) |
| brater : tourner, changer de direction - (43) |
| brâter : tourner. (RDR. T III) - A - (25) |
| brater : tourner. (SS. T IV) - N - (25) |
| brâter : Tourner. « Brâte tan ché dans la co » tourne ton char dans la cour. « Brâter beurde » : tourner bride. Au figuré : rebrousser chemin. - (19) |
| brâter v. (du lat. pop. brachitare, tourner). Changer de direction, braquer. - (63) |
| brâter : (brâ:tè - v. intr.) orienter dans telle ou telle direction les roues d'un chariot, braquer. - (45) |
| brater : v. a., tourner, diriger vers. Voir rebrâter. - (20) |
| brater, tourner - (36) |
| brâter, v. ; tourner le train avant d'un chariot. - (07) |
| brater, v. a. changer de direction, particulièrement pour, la manœuvre d'une voiture. - (24) |
| brâter, v. a. tourner à bras une voiture, changer sa direction par un mouvement brusque. - (08) |
| brâter, v. braquer (vocabulaire agricole). Ne s'est pas imposé dans la langue des automobilistes. - (65) |
| brâter, verbe transitif : tourner, braquer, changer de direction. - (54) |
| brater. Changer de direction, tourner. - (49) |
| brâter. v. - Plusieurs usages : 1. Hésiter, tâtonner. (Mézilles, selon H. Chéry) 2. Se faire avoir, se laisser prendre. (Arquian) 3. Manier à pleins bras. (F.P. Chapat, p.51) - (42) |
| brâter. v. n. Demander sans besoin, à tout propos, en geignant, à la manière des mendiants et de ceux qui tendent le bras. - (10) |
| brâtet (n.m.) : organe de changement de direction des véhicules hippomobiles - (50) |
| brateure : partie du char sur laquelle l'avant train pivote sur l'arrière (en B : brati). A - (41) |
| brateûre n.f. Articulation d'un char. - (63) |
| brateux. adj. - Celui qui hésite, qui tâtonne. (H. Chéry, p.30). Autre sens : celui qui n'arrête pas de se plaindre de ne pas y arriver, de ne pas gagner assez. (M. Jossier, p.21) - (42) |
| brâteux. s. m. Celui qui demande toujours sur un ton pleurard, en se plaignant de ne pas gagner assez, et qui toujours a l’air de vous tendre le bras. - (10) |
| brâti : partie de l'avant-train d'un char - (43) |
| bratter : manoeuvrer une voiture - (61) |
| brau : fane de pommes de terre, de betteraves - (34) |
| braugne (adj.) : fragile, cassant - (64) |
| braut, brout. Jeune pousse, feuillage. On dit : « brauter » au lieu de brouter. - (49) |
| brauté*, v. a. changer de direction. - (22) |
| bravai. Braver. - (01) |
| brâve - balle : belle - (57) |
| brave (dzoli) : beau, joli - (51) |
| brave (n.et adj. m.et f.) : joli (-e), honnête - (50) |
| brâve (on) : joli - (57) |
| brâve : (adj) beau - (35) |
| brave : Beau, joli, élégant. « T'as dan mis ta brave reube neue ? » : tu as donc mis ta belle robe neuve, Vieille chanson : « J'en avais in brave chépiau, lang et pointu, que je mentais su man oraille, à lanturlu ». « Se fare brave » faire sa toilette. Ironiquement : « Y est cen qu'est brave ! » : voilà qui est beau. - (19) |
| brâve : joli - (57) |
| brave : joli(e), bien habillé(e). - (52) |
| brave : un berceau - (46) |
| brave : joli(e), bien habillé(e). T'es ben brave aujd'heu : tu es bien joli(e) aujourd'hui. - (33) |
| brâve adj. Beau, bien habillé. - (63) |
| brâve : beau - (39) |
| brave, adj. beau : une brave fleur. - (22) |
| brave, adj. beau : une brave fleur. - (24) |
| brave, adj. beau, honnête, de bonne foi, de bon compte, bien vêtu, bien portant. On dit d'une jolie fille qu'elle est brave. - (08) |
| brave, adj. quai. ; joli, convenable. - (07) |
| brave, adj., joli, beau, bien mis, endimanché, honnête, poli : « Oh ! ma p'tiote, coume te v'là brave ! ». - (14) |
| brave, beau, bien mis. - (04) |
| brave, biau : joli - (43) |
| brâve, sârvissant : personne gentille, « de bon service » - (37) |
| brave. adj. Qui est beau, propre, bien vêtu, bien attifé. Comme te v’là brave aujourd’hui. - (10) |
| brave. Beau et bien habillé. - (03) |
| brave. Joli. - (49) |
| bravement : Joliment, beaucoup. « y fiant bin bravement du bru » ils font beaucoup de bruit ! - (19) |
| bravoisies : dessins brodés. (DC. T IV) - Y - (25) |
| bravoisies. s. f. pl. Enjolivements. Les bravoisies d’une robe. Des sabots à bravoisies . De brave , beau, bien paré, bien arrangé. - (10) |
| bravoure, s. f. honnêteté, droiture, probité. - (08) |
| brâÿ, s. m., berceau. - (40) |
| brayé : v. t. Fatiguer, éreinter. - (53) |
| bràyé, v. a. broyer. - (22) |
| brayer, broyer. - (04) |
| brayer, v. a. broyer, gâcher, pétrir la terre grasse, l'argile. - (08) |
| bràyer, v. a. broyer, malaxer. - (24) |
| brayer: écraser. - (31) |
| brayes, s. f., braies, haut de chausses, culotte. - (14) |
| Brâ'yet : Brazey-en-Morvan - (48) |
| brayette : braguette - (44) |
| brayette : la braguette du pantalon - (46) |
| brayette, n.f. braguette. - (65) |
| bräyi : (vb) briser - (35) |
| bra-yi : crier - (43) |
| brâyi v. (du gaul. bracum, orge broyé). Gâcher le mortier, piétiner, broyer. - (63) |
| brayon : crécelle. (MLV. T III) - A - (25) |
| bràyon, s. m. pâtée pour des poules ou un porc. - (22) |
| bràyon, s. m. pâtée pour des poules ou un porc. - (24) |
| brayôte, pantalon. Dans l'idiome breton, bragez a la même signification... - (02) |
| brayôte. : Pantalon. (Del.) - (06) |
| brayotte : braguette. - (62) |
| brâ-yotte, s. f., braguette du pantalon , pantalon. - (40) |
| brâyou n.m. Broyeur à main. - (63) |
| brcedes, s. f. brides de bonnet. - (24) |
| bré - berceau. - Vai coucher ton petiot frère dans son bré. - (18) |
| bré : bras - (43) |
| bré : bras - (51) |
| bré : Bras. « O s'est cassé in bré » : il s'est cassé un bras. « Se teni par desseu bré » : aller bras dessus, bras dessous. « Regarde voir si man saillan (sillon) est bien dra (droit). - Oh ! bin oué, ol est dra c'ment man bré quand je me mouche ! ». - (19) |
| bré : partie du chariot située entre les ridelles - (48) |
| bré : (bré - subst. m.) volume compris entre les ridelles du chariot. Comme il n'est de bon "char" que bien "affaîté", ne rentrer qu'un bré de foin revient à dire que la récolte a été bien médiocre. - (45) |
| bré, berceau. - (05) |
| brè, berceau. - (16) |
| bré, s. m. berceau, lit d'enfant : « i é mettu l’p'tiô dan son bré. » - (08) |
| bréarde : voiture à foin. - (66) |
| brébis n.f. Brebis. - (63) |
| brècha : rouleau de toile. - (21) |
| bréché : égoutté (fromage). - (30) |
| bréchie (breuchie) : brassée - (51) |
| brèchie n.f. Brassée. Bras. - (63) |
| bréchie, cruche, pot à l'eau.- Les Bretons nomment brôked, diminutif de brôk, un vase de terre ou de grès, à anse. (Le Gon., Dict. fr.-br.) - (02) |
| brechie, cruche. - (05) |
| brechie. Cruche. Vase à mettre le vin. - (03) |
| brechie. Pot à l'eau, petite cruche à mettre de l'eau. Ces pots étant ordinairement de terre, on les a nommés brechies, parce qu'ils sont sujets à être ébréchés… - (01) |
| bréchie. : Pot à eau. (Del.) - (06) |
| brèchieu : s. f. brassée. - (21) |
| brechillotte, mésange à longue queue. - (05) |
| brechon, s. m. bec d'un pressoir, d'une fontaine. - (24) |
| bréchot : à qui il manque une dent incisive. - (31) |
| bréchot : édenté. (PSS. T II) - B - (VDS. T IV) - VdS - (25) |
| breçon : s. m. goulot. - (21) |
| brecot : bouc. - (30) |
| brecouler : v. n., bégayer. - (20) |
| breda : quelqu'un qui bâcle son travail, quelqu'un de brute, de violent, tête en l'air - (46) |
| bredalin (aline) (br'dalin, br'daline), adj. Dim. de bredin, bredine. - (20) |
| bredasser : v. n., brouillasser. - (20) |
| bredeau (br'dô). ébredeau (ébr'dô) : s. m., étourdi, écervelé. - (20) |
| bredeaulé (br'dôlé), ébredeaulé (ébr'dôlé) : s. et adj., m. et f., étourdi, écervelé. - (20) |
| bredi-bredo, sm. écervelé, trop pressé. - (17) |
| bredin (beurdin) : fou, esprit simple - (51) |
| bredin : idiot - (34) |
| bredin : idiot - (43) |
| bredin-(ine) (br'din, br'dïne) : s. et adj, m. et f., sot, niais, engourdi (au physique). Ce bredin-Ià, i n' trouverait pas d'os dans les pieds d' mouton. - (20) |
| bredin, adj. peu rusé. Diminutif bredalin. - (22) |
| bredin, adj. peu rusé. Diminutif bredalin. - (24) |
| bredindon, s. f. beignet. - (24) |
| brediner : agir sans utilité. - (30) |
| bredinerie (br'dinerie :, s. f., bêtise. Dire, faire des bredineries. - (20) |
| bredinerie, s. f. plaisanterie. - (22) |
| bredinerie, s. f. plaisanterie. - (24) |
| bredinoon : s. m. Voir retinton. - (20) |
| bredoché, vn. bredouiller. - (17) |
| bredoeudon, s. m. beignet. - (22) |
| bredôlè : agiter - (46) |
| bredondon, sm. tonnerre. Bruit sourd et intense. - (17) |
| bredouillai, parler d'une manière peu distinct... - (02) |
| bredouiller (br'doullier) : v. n, parler à tort et à travers, sans savoir ce qu'on dit. - (20) |
| bredouilli v. Bafouiller, bégayer. - (63) |
| bredouillon, -onne (br'douitlon, br'douillonne) : s. m. et f., qui parte à tort et à travers, sans savoir ce qu'il dit : « Qué bredouillon qu' ce vieux-là ! Son fusil commence rien à écarter ! » - (20) |
| bredouillou, -ouse n.m. Bafouilleur, bégayeur. - (63) |
| bredzère : bergère - (43) |
| bredzi : berger - (43) |
| brée : bruyère. - (52) |
| brée : rigole pour assainir un pré. - (33) |
| brée, berceau d'un enfant ; corps d'une voiture avec ses ridelles. - (27) |
| brée, n. masc ; berceau ; tire donc le brée. - (07) |
| brée, n. masc ; le berceau d'un char ; c'est l'espace entre les ridelles. - (07) |
| brée, s.m. berceau (avar in ptiot dans l'brée, avoir un enfant au berceau) ; à Buxy, on dit un grot. - (38) |
| brée. s.m. Brin. (Etais). - (10) |
| bréezes, bré'illes : braises - (48) |
| brégée. n. f. - Quantité de noix, de colza ou de chènevis placée sous la presse. - (42) |
| brégée. s. f. Quantité déterminée de noix, de chènevis ou autres graines oléagineuses mises sous la presse. Se dit pour broyée. - (10) |
| brégeotte et, par contraction, bréotte. s. f. Bruyère. - (10) |
| bréger : fouler aux pieds, piétiner. - (09) |
| bréger. v. - Briser, abîmer, faire un éclat sur la vaisselle : « Tu vas te bréger le portrait ! » (Colette, Claudine à l'école, p.220) - (42) |
| bréger. v. a. Briser, broyer. - (10) |
| bregnioule, farnire : panier en osier dont le couvercle est percé pour mettre les noisettes lors de la cueillette - (43) |
| bregnoule, adj. écervelé et gai. - (22) |
| bregnoule, adj. écervelé, gai pour avoir un peu bu. - (24) |
| Bregogne. Bourgogne. - (01) |
| brei, s. m., berceau : « Eproch' le brei d' la taule ». — « Porte donc l’petiot dans son brei ». - (14) |
| brei. Berceau… - (01) |
| breicole (aine) : (une) petite chose, (un) petit aliment, (un) « coussin » de sabot - (37) |
| breillé (éte) : être très fatigué - (39) |
| breille : une « échelle » en bois se mettant sur le côté d'un chariot servant au transport du foin - (46) |
| breille : n. f. Panier à poissons porté en bandoulière. - (53) |
| breille, beureille. Sorte de panier à anse. Lorsque les vendangeurs descendent de leurs montagnes, on reconnaît les Morvandeaux et les Beuquins à leurs breilles, qui sont plus larges et moins longues que les vendangerots de l'arrière-côte. - (13) |
| breiller - (39) |
| breiller (v.) : pousser des beuglements en parlant de la vache - (50) |
| breiller : abîmer, casser, briser - (48) |
| breiller : fatiguer - (48) |
| breiller : (brèyé - v. tr.) briser, abîmer, détériorer au point de rendre inutilisable. - (45) |
| breiller, v. tr., écraser. - (14) |
| brelache : partie du pantalon. - (30) |
| brelaigne, voiture. - Dans le pays de Vaud on dit brelingue, et, en style familier français, berlingot... - (02) |
| brelaigne. : Mauvaise voiture. - (06) |
| brelandai, courir les brelans, lieux où l'on joue... - (02) |
| brelandai. : Courir le brelan, lieu où l'on joue. - (06) |
| brelandeire. Brelandière, brelandières. - (01) |
| brelauder : v. n., baguenauder, musarder. - (20) |
| brêle mècle (en) (brele mêcle) : vx fr. brelle mesle, pêle-mêle. Voir mècle. - (20) |
| brèle, brême. adj. - Cassant, délicat, fragile. - (42) |
| brêle. adj. Cassant, fragile. (Bléneau). - (10) |
| brèler : attacher ensemble - (48) |
| brêler : serrer le chargement d'une voiture avec une corde ou chaîne. - (31) |
| breler, brûler. - (26) |
| brelettes : s. f. pl., organe femelle. - (20) |
| brelichon : s. m., petit brelot (ancien chapeau de la Mâconnaise). Voir plus loin brelot. - (20) |
| brelin, s. m. épidémie bénigne. - (22) |
| brelinguette : s. f., bredine. - (20) |
| brelion, brellion (br'lion) : s. m., vx fr. breuille, nombril ; organe mâle. - (20) |
| bréllhe, bréïe, brége, s. f. braise, charbon allumé. - (08) |
| brelot : jeune apprenti artisan ou commis de ferme - (43) |
| brelot et brerot, s. m. champignon en général et sans distinction d'espèce. - (11) |
| brelot : coiffe (étym.) ? - (32) |
| brelot, brelout : s. m., râteau à dents courtes et droites pour ratisser le sable. - (20) |
| brelot, brelout, s. m., ancien chapeau de la Mâconnaise. Dans le Morvan autunoïs (Mém. de la Soc. Eduenne, nouv. série, t. XX, 1892, p. 357). brelot est un des noms génériques au champignon. Or, il est curieux que le brelot maçonnais ait précisément la forme d'un champignon. - (20) |
| brelot, s.m. ancienne coiffure des femmes en Bourgogne. - (38) |
| brelouter v. (p.ê. du bourguignon brelot, coiffe) Aplanir, râtisser. Voir râtiauder. - (63) |
| brelue, barlue et berlue. C'est aussi un vieux mot donné par Nicot. - Avoir la berlue signifie avoir la vue obscurcie. Les Picards disent berlou et berlu ; et, chez eux, berluser signifie tromper. On dit encore ébrelue et éberlue. - (02) |
| brelue, berlue. - (05) |
| breluton : lumignon - (43) |
| breluzon :petite ouverture du poulailler ou de l'écurie de chèvre pour aérer — petite lampe à faible lumière. - (30) |
| brème : (brèm' - adj. inv.) friable. Se dit particulièrement du fromage et du bois trop secs. - (45) |
| brème : adj., cassant. Bois brème, bois tendre (par opposition au « bois dur »). - (20) |
| brême. adj. Synonyme de brêle. (Grand-Champ, Villeneuve-les-Genêts). - (10) |
| brème. Stérile. - (03) |
| bremer : quêter. - (66) |
| brémer : se plaindre en gémissant. - (31) |
| brêmer. Bramer ; mugir en parlant du bœuf. Fig. Pleurer en poussant des cris. - (49) |
| brémie, adj. sec, cassant, sans consistance. Une terre « brème » est un sol desséché. - (08) |
| brémont : variété de bruyère. (P. T IV) - Y - (25) |
| brêne. adj. Cassant. Le peuplier est un bois brêne. Voyez brêle et brême. - (10) |
| brenecher : v. a., fféq. de brener. - (20) |
| brener : v. a., embrener. Entendu dans celte phrase : « Elle m'a brené son peigne contre » qui voulait dire : « Elle m'a montré, les dents. » - (20) |
| brenesserie, feûmesserie : pluie fine - (43) |
| brene-yi : manger du bout des lèvres - (43) |
| brenicle. : Sorte de jeu. (Del.) - (06) |
| brenot, brenote : adj., brunet, brunette. - (20) |
| brenout, brienou : s. m., soupe au riz contenant de la noix pilée, très appréciée à Uchizy. - (20) |
| brenoux, brenouse : adj., breneux, breneuse. - (20) |
| bréote : coulemelle. - (52) |
| brequer : Faire craquer en mangeant avec avidité et avec de bonnes dents. « Acoute le dan brequer ces pommes vardes (vertes) ». - (19) |
| brequillè : bricoler - (46) |
| brequille : une chose insignifiante - (46) |
| brer v. Broyer. - (63) |
| brére. Bruyère. - (49) |
| brés : (nm) bras - (35) |
| brés n.m. Bras. - (63) |
| brés, s.m. bras. - (38) |
| brès. Bras. - (49) |
| brése (na) : braise - (57) |
| brése (na) : miette (de pain) - (57) |
| brése : s. f. braise. - (21) |
| brési. On dit proverbialement « Sec comme brési ». - (03) |
| brésillai, briser en petits fragments. - Dans le Berry, bresilles ou bretillcs, et, ailleurs, broutilles, signifient menus morceaux de bois. Au figuré, on nomme broutilles des riens, de petites choses. - (02) |
| bresillai. : Briser en petits fragments. (Del.) - Bressilles signifient de menus morceaux de bois. (Le comte Jaub.) - (06) |
| brésillant, foin, paille très secs et étant cassants. - (28) |
| bresillè : casser - (46) |
| brésillé, réduit en mille morceaux. - (28) |
| brésille, s. f., branchette, bribe, menu morceau de bois, miette de pain, de gâteau, etc. - (14) |
| brésiller, v. a. mettre en poussière, rompre, briser en miettes. - (08) |
| brésiller, v. tr., briser en petits fragments. - (14) |
| bresillou : celui qui casse tout et souvent - (46) |
| bressande adj. Bressanne. - (63) |
| bressande : s. f., bressane. - (20) |
| bressaudes : résidus de la fonte du lard. (REP T IV) - D - (25) |
| bressaudes, voir beursaudes. - (27) |
| bressie : (nf) brassée (eune bressie d’bô) - (35) |
| bressie : brassée. Ène bressie d'harbe : une brassée d'herbe. - (52) |
| bressore, berceau. Ce mot semble être un diminutif du languedocien brés, qui signifie berceau d'osier... - (02) |
| bretalé*, adj. pêle-mêle, traîné, versé. - (22) |
| breteau, bretaller, bluteau, bluter. - (05) |
| bretèille (n.f.) : broutille, menue branche - (50) |
| brêter : tourner un timon de chariot ou un volant à droite ou à gauche - (39) |
| brêter. v. n. Se dit, à Villiers-Saint-Benoît, pour brâter , par conversion de l’a en e. Voyez brâter. - (10) |
| bretille : petite branche. - (09) |
| breton, s. m. celui qui marmotte, qui grommelle. - (08) |
| bretouné*, v. n. balbutier par ivresse. - (22) |
| bretouner, v. a. marmotter, parler entre ses dents. - (08) |
| brette (br'te, beurte) : s. f., vx fr. birette, char ou charrette à deux roues. - (20) |
| bretteler (br'teler) : v. n. (fr. v. a.), être rugueux, raboteux. Inégal. Ne passons donc pas par ce chemin, I brettele trop. - (20) |
| brettou, ferrailleur, homme d'épée, querelleur, bretteur... - (02) |
| bretzi : égoutté (en parlant du linge et des fromages). - (30) |
| breu : Broc, grand vase de bois ou de métal en forme de pot ventru. Son contenu, « In breu de vin ». Le contenu d'un broc de type en usage dans le mâconnais est d'environ 14 litres. - (19) |
| breu : bruit - (51) |
| breu, s. m. Breuil, bois, taillis, buisson. Six hameaux ou habitations du canton de Montsauche portent le nom de Breuil que nous prononçons « breu » et quelquefois breul. - (08) |
| breû, s. m., bruit. - (40) |
| breucer et brisser, v. tr., bercer. - (14) |
| breûchaloux : Filandreux. « Eune pomme breûchalouse ». - (19) |
| breûche : Aiguille de bas. « In jû de breûches » : l'ensemble des quatre aiguilles nécessaires pour tricoter un bas. Les mailles que portent chaque aiguille: « Je vas fare eune breuche dans ma chausse ». - Nom de lieu : « Le beu de la Breûche ». - Aiguilles d'horloge : « La grande breûche, la petite breûche ». - (19) |
| breucher. v. n. et v. a. Donner des coups de cornes, en parlant des vaches. (Jussy). - (10) |
| breucheton. s. m. Biberon, petit vase à bec ou à tuyau pour faire boire un enfant. (Fresnes). — Se dit pour brocheton, petit brochet. - (10) |
| breûchi ou ebreûchi ou brochi : Tailler une vigne, qu'on veut arracher prochainement de façon à en tirer le plus de fruits possible, c'est à dire en se contentant de rogner tous les sarments qui deviennent autant de coursons fructifères. - (19) |
| breuchie (bréchie) : brassée - (51) |
| breuchon : petite corbeille ronde sans anse - (46) |
| breuchot (ote) : s. et adj., m. et f., brèche-dent. - (20) |
| breuçû (n.m.) : tarière du sabotier - (50) |
| breude, sf. grosse noix qui sert aux enfants de projectile pour atteindre d'autres noix. - (17) |
| breudenerie, breudinerie : gauloiserie - (43) |
| breuder : Broder, « Alle pa san temps à breuder ». - (19) |
| breuge : brouillard. - (30) |
| breûgnas (n.m.pl.) : gros nuages orageux qui se rapprochent du sol - (50) |
| breugnas (nom masculin) : nuages. - (47) |
| breugnas, s. m. brumes, nuages très rapprochés de la terre. - (08) |
| breugnasse : brouillard pluie fine. - (30) |
| breugne : brume (mot ancien) - (39) |
| breugne, feumée : brume - (36) |
| breugne. - Ce mot a deux acceptions : il signifie la bruine, le brouillard aussi bien que brune de couleur, dont breugnotte est le diminutif. (Del.) - (06) |
| breugner, v. ; se plaindre. - (07) |
| breugnes (n.f.pl.) : brumes, brouillards - (50) |
| breugnette, diminutif de brune. - (02) |
| breùgnette. Brunette, diminutif de breùgne, brune ; car en bourguignon brun se prononce breun… - (01) |
| breuil : petit bois humide. - (32) |
| breûillâ - brouillâ (on) : brouillard - (57) |
| breûillâ : le brouillard - (46) |
| breuillai : beugler. Les vaiches breuillont la soif : les vaches beuglent de soif. - (33) |
| breûillasse : le brouillard qui tombe, une petite pluie fine, èl a breûillassè tout'lè neû - (46) |
| breûillassi - brouillassa : brouillasser - (57) |
| breuillats : nappes de brouillard, légères ou aussi vrais brouillards (...question d'appréciation). Ex : "L'aut' ceux matins, n'avait ben des breuillats su' la Mardelle !" - (58) |
| breûillè : pleurer - (46) |
| breuille, s. f. brouillard peu épais, brume légère. - (08) |
| breûiller (v.t.) : brailler, beugler - (50) |
| breuiller (verbe) : pleurer. (Breuille tout ton saoul, coum ça tu pisseras moins). - (47) |
| breuiller : beugler. Les vaisses breuillont : les vaches beuglent. - (52) |
| breuiller : gargouiller du ventre - (61) |
| breûiller : meugler (vache) - (48) |
| breuiller : pleurer, brailler - (60) |
| breuiller : meugler - (39) |
| breuiller, breumer. v. - Beugler, meugler. Au figuré : pleurer bruyamment, en parlant d'un enfant. - (42) |
| breuiller, v. ; beugler. - (07) |
| breuiller, v. n. beugler, pousser des mugissements. - (08) |
| breuiller. v. n. Beugler, meugler. La vèche ne fait que breuiller ce matin ; qué qu’all’ a donc ? - (10) |
| breuilli : meugler, pleurer. A - B - (41) |
| breuilli : pleurer en criant, meuglement intense du veau - (51) |
| breuilli : pleurer, meugler - (34) |
| breuilli : pleurer, meugler - (43) |
| breuillon. s. m. Beuglement. (Villiers-Bonneux). - (10) |
| breuillonner. v. n. Beugler. (Ibid.) - (10) |
| breûillot, breuillou : nombril - (48) |
| breuillot, bruillot et même brullô. Nombril. Bien que ce mot soit fort en usage dans la ville, il est absolument patois. Etym. possible : brayer, bandage destiné à soutenir une hernie, qui lui-même vient de bracca, braie. - (12) |
| breuillot, nombril. - (28) |
| breuillou (nom masculin) : pleurnicheur. - (47) |
| breûillou : quelqu'un qui pleure souvent (au féminin breûillouse) - (46) |
| breuillou : un braillard, une personne qui parle fort, on dit également braillou. Ce mot quali- - (46) |
| breujöre, sf. bergère. - (17) |
| breujrie, sf. bergerie. - (17) |
| breulâyon – brûlement, grand échauffement. - I vâs voué le médecin, pace qui ai ine grande breulâyon dan l’estomâ. - I ai ine breulâyon dan les jambes que m'inquiéte très-bein. - (18) |
| breulè : brûler - (46) |
| breûle n.f. Brûlure interne. - (63) |
| breûlè : v. t. Brûler. - (53) |
| breûlé, brûler, incendier ; é san breulé, ils sont incendiés. - (16) |
| breulé, vt. brûler, pp. breulé, ie. - (17) |
| breûle-bourre : vite - (48) |
| breulée, s. f. brûlée, galette grossière dont la surface est frottée d'huile. - (08) |
| breuler (goriner) : brûler - (51) |
| breûler (v.t.) : brûler - (50) |
| breuler (verbe) : Brûler, « Sa maijan a breulé ». - (19) |
| breuler : brûler - (48) |
| breûler : brûler. - (52) |
| breûler v. Brûler. - (63) |
| breuler : (breu:lè - v. trans. et intr.) brûler. - (45) |
| breûler : brûler - (39) |
| breûler, v. ; brûler. - (07) |
| breuler, v. a. briiler, consumer par le feu. « que l’tounâre m' breule ! qu' lai fièvre m' breule ! » - (08) |
| breûler, v. brûler. - (38) |
| breuler, v. tr., brûler. - (14) |
| breûler, v., brûler. - (40) |
| breuler. Brûler. - (49) |
| breuleure : brûlure - (48) |
| breûleure : Brûlure. - (19) |
| breûleûre n.f. Brûlure. - (63) |
| breuleure : brûlure - (39) |
| breuleure, s. f. brûlure. - (08) |
| breuleure. Brûlure. - (49) |
| breuli, s. m. lieu où l'on a brûlé du bois, du gazon, des genêts, etc. ; terrain dont on a opéré le brûlement après l'avoir écobué. - (08) |
| breulin : jeune tique - (43) |
| breulin, s. m. un «breulin » est tout ce qui est susceptible de s'enflammer, de prendre feu. Les genêts secs servent ordinairement de « breulins » pour allumer. - (08) |
| breulllô, nombril. En roman des Trouvères, breuilles signifie boyaux, intestins (en latin infime, burbalia). - (02) |
| breulu, sm. ahuri. Personne atteinte de la berlue. - (17) |
| breumer (sans doute pour brâmer). v. n. Beugler. (Perreuse). - (10) |
| breunaisse (n.f.) : brune, petite pluie fine (aussi brenaisse) - (50) |
| breunaisse, s. f. brouillard qui tombe, petite pluie fine. - (08) |
| breunaisser, v. n. se dit des brouillards qui crèvent en pluie fine. - (08) |
| breunes, s. f. brouillards humides ou secs. - (08) |
| breunot, adj., synon. de beurot. (V. ce dernier mot). - (14) |
| Breunot, nom de bœuf, de couleur brune. - (08) |
| breuquöte, sf. faire sai breuquöte, faire des révérences en dormant sur une chaise. - (17) |
| breûsée : (nf) averse (d'orage) - (35) |
| breûsée n.f. (or. inc.) Averse, petite pluie. - (63) |
| breûsée, radée, ragasse : averse - (43) |
| breusillé, vt. réduire en miettes, en menus morceaux. - (17) |
| breusiller : mettre en morceaux. - (66) |
| breusse : bêche - (43) |
| breusse : Brosse. « Va voir donner in co de breusse à tes sulés, i sant to poussatous » : donne donc un coup de brosse à tes souliers, ils sont tout poussiéreux. - (19) |
| breusse, brosse. - (16) |
| breussé, vt. bercer. - (17) |
| breusse. Berce, berces, bercent. - (01) |
| breusseule, sf. grand panier à grains fait de paille tressée à la façon des ruches. - (17) |
| breusse-yi : faire du bruit en marchant dans une broussaille sur les feuilles mortes - (43) |
| breussi : bêcher - (43) |
| breussi : Brosser Au figuré : battre, « Ol a voulu fare le malin ma o s'est fait breussi c'ment i faut ». - (19) |
| breusson, s. m. bec d'un pressoir, d'une fontaine. - (22) |
| breût : (nm) bruit - (35) |
| breût : bruit - (43) |
| breut : bruit - (48) |
| breut : bruit. - (33) |
| breut n.m. Bruit. - (63) |
| breut : bruit - (39) |
| breuteille, s. f. broutille, menue branche de bois, brin. - (08) |
| breuteiller, v. a. broutiller, manger par petits morceaux. - (08) |
| breutins, s. m., brindilles pour allumer le feu. - (40) |
| breutse : fente dans un mur, brèche, écaille - (43) |
| breutse n.f. Brèche dans un mur. - (63) |
| breuvailler, buvotter. v. - Boire sans envie. - (42) |
| breuvaize (n.m.) : breuvage - (50) |
| breuvée (brevée, br'vée) : s. f., vx fr. breu, averse. Syn. de bourrée, brusée, radée, etc. - (20) |
| breûyasse, breûyesse : (nf) crachin - (35) |
| breûyi : (vb) braire - (35) |
| breûyi : braire, meugler - (43) |
| breûyo, nombril. - (16) |
| breuze. n. f. - Fougère. (Perreuse, selon M. Jossier) - (42) |
| breuze. s. f. Fougère. (Perreuse). - (10) |
| breuzi : sec, ce mot servait à qualifier les oignons - (46) |
| brevailler : boire plus que de raison. - (30) |
| bréye (n.f.) : braise (de Chambure écrit bréllhe, brée, brége) - (50) |
| brèyè : (ou breillè), piétiner, écraser, broyer - èl é brèyè mes plants d'choux, il a piétiné mes plants de choux. - (46) |
| brèyè : cassé, brisé, fatigué - (48) |
| bréyé : briser. On rentre bréyé après un dur travail. - (33) |
| brèyer : briser, broyer. I seu bréyé : je suis épuisé - (52) |
| bréyes : braises - (39) |
| brèyou : le pilon pour écraser la pâtée des animaux - èveû l'brèyou èl é préparé lè lèvure du couchon, avec le pilon, il a préparé la pâtée du cochon - (46) |
| brézes : n. f. Braise. - (53) |
| bri : s. m. berceau. - (21) |
| bri : s. m. cuvier où l'on faisait la lessive. - (21) |
| briaudé : s. et adj., m. et f., syn. de bredeaulé. - (20) |
| briaudi, s. m. homme peu sérieux, aventureux. - (22) |
| briaudi, s. m. homme peu sérieux, aventureux. - (24) |
| bribaulai. : Mendier. (Del.) - (06) |
| bribaullai, mendier. - En roman des Trouvères bribau signifie un gueux. - (02) |
| bricàyon, s. m. homme peu scrupuleux, hâbleur. - (22) |
| bricàyon, s. m. homme peu scrupuleux, hâbleur. - (24) |
| brichton, sm. morceau de pain. - (17) |
| bricoïer. n. m. - Bricoleur, mauvais ouvrier. - (42) |
| bricoillé, s. m. celui qui fait tous les métiers, qui est toujours en mouvement pour toutes sortes de petites besognes. - (08) |
| bricole (n.f.) : bride de sabot - (50) |
| bricole : bride (à sabot), bride (harnais) - (48) |
| bricole : personne sans intérêt - (61) |
| bricole, bricoule. n. f. - Bride en cuir sur un sabot. Autre sens : petite hotte portée par les femmes. - (42) |
| bricole, s. f. chose sans importance, objet de peu de valeur, tripotage. - (08) |
| bricole, s.f. bagatelle. - (38) |
| bricole, subst. féminin : patte en cuir sur le dessus du sabot. - (54) |
| bricole, subst. féminin : travail clandestin que l'on effectue à l'usine, travail en perruque. - (54) |
| bricole. Lanière de cuir placée sur les sabots des paysannes pour tenir le pied. Fig. Objet sans valeur. - (49) |
| bricole. s. f. Hotte de femme, à Jussy. On dit bricoule , à Lainsecq, et cependant, dans ce même pays, quand il s’agit de brides de sabots on dit des bricoles. - (10) |
| bricoler, v. a. s'occuper à des riens, aller et venir pour des niaiseries, tripoter. - (08) |
| bricoler, v. faire peu de choses. - (38) |
| bricoler, verbe transitif : fabriquer des bricoles. - (54) |
| bricoler. Travailler à petit profit, comme le voiturier, qui, ne pouvant avoir un cheval, traine sa voiture à bras avec une bricole. - (13) |
| bricollerie. n. f. - Petite ferme. « L 'Adrien, lui, agidait ses pée et mée à m'ner ène bricoll'rie anvec cinq vaches, pis un ch 'vau ... » (G. Chaînet, L'coustume dé vélours) - (42) |
| bricolou : mauvais bricoleur - (44) |
| bricolou, adj. celui qui fait peu de choses. - (38) |
| bricolou, subst. masculin : mauvais bricoleur. - (54) |
| bricot (on) : chevreau - (57) |
| bridaud : espèce de papillon qui vole sur les ruisseaux - (60) |
| bride ai veaa. - Bride à veau ; locution familière : une mauvaise corde ; un rien, une chose qu'on ne ramasserait pas. - (06) |
| bride bourre (à) loc. A bride abattue, à toute allure. - (63) |
| brider : attacher - (37) |
| bridon : œillère qu'on met aux chevaux pour leur boucher les yeux lorsqu'on les fait tourner sur place. - (21) |
| brier, verbe transitif : broyer, écraser au pilon. - (54) |
| brier. Marcher dessus, piétiner, écraser : « au m'ai brié sur le pid ». Se dit aussi pour préparer le mortier : « brier du mortier ». - (49) |
| brieuche : Brioche, « Mère, te m'apporteras eune brieuche » - (19) |
| brieûne : Cassant, peu flexible. « Les brinches de prenés sant brieûnes » : les branches de prunier sont cassantes - (19) |
| brifé, v. a. manger gloutonnement. - (22) |
| brifer, v. a. manger gloutonnement (du vieux français). - (24) |
| briffai, manger avec gloutonnerie... - (02) |
| briffer : v. a., friper. Elle a toute briffé sa robe. - (20) |
| brigade : Equipe. « Eune brigade de vendangeous », « Mener la brigade » : être en tête des ouvriers. « Y est in ban ovré, y est toje liune que mene la brigade ». - (19) |
| brigade, s. f. troupe en général : une brigade de gens, une brigade de monde, pour beaucoup de gens. - (08) |
| brigadier : voir raud - (23) |
| brigan. Brigand, larron. - (01) |
| brigander, v. n. faire le brigand, marauder en courant cà et là ? - (08) |
| brigander. v . a. Traiter sans ménagement, battre sans pitié. — Brigander du blé , le battre par poignées sur une feuillette pour faire que la paille ne soit pas brisée. (Mont-Samt-Sulpice , Seignelay). - (10) |
| brigands : Nom donné aux dévastateurs composant les Grandes Compagnies, et non point parce qu'ils dévastaient, mais parce qu'ils portaient un haubergeon ou cotte de mailles du nom de brigandine. Dans le dialecte, l'expression débrigandiner signifie débarrasser un chevalier de sa cuirasse. (Roq.) - (06) |
| brige. s. f. Braise. (Athie). - (10) |
| brigis. s. m. Brasier. (Ibid.) - (10) |
| Brigne, Bénigne. - (16) |
| brigolé, part. pass. bariolé, peint de diverses couleurs, marqué de dessins, d'arabesques, de raies. - (08) |
| brigolé, s. m. gendarme : « cor viâ, voiqui lé brigolés », cours vite, voici les gendarmes. - (08) |
| brigoler, v. a. faire un dessin sur un objet quelconque, y tracer des raies, le peindre en bandes de diverses couleurs. - (08) |
| brigoleure, s. f. étoffe de boge ou boige fabriquée par les tisserands du pays, et à raies de couleurs diverses. Le mot désigne en général une surface rayée ou bariolée. - (08) |
| briji : Briser. « Etre briji » : être extrêmement fatigué. « J'ai plieuchi tote la saint journée, je sus briji » : j'ai pioché toute la saint journée, je suis brisé de fatigue. - (19) |
| brike, morceau ; eune brike de pèn, un morceau de pain. - (16) |
| brîle (la), pour la bruyère. - (11) |
| brilli : briller - (57) |
| brimbelle : myrtille - (48) |
| brin d’chie : sciure de bois - (37) |
| brin su bord (loc. adv.) : avec minutie, en détail - (64) |
| brince, s. f. branche d'arbre. - (08) |
| brinche : branche - (48) |
| brinche : Branche, « Eune brinche de noué (noyer) ». - (19) |
| brinche : s. f. 1° branche ; 2° a souvent aussi le sens de perche ; 3° tronc des jeunes arbres. - (21) |
| brinche, s.f. branche. - (38) |
| brinche, sf. branche. - (17) |
| brincher (se), vt. se heurter à, s'empêtrer dans, culbuter. - (17) |
| brinchöge, sm. branchage. - (17) |
| brindelles : débris de bois, miettes - (37) |
| brindille. Petits morceaux ; casser « en brindelles ». - (49) |
| brind'zinc : adj. Enivré. - (53) |
| bring'baller : se déplacer en cahotant et avec bruit - (48) |
| bringuai, boire beaucoup... Bringuai est devenu le synonyme de trinquai et de chinquai. De ces trois mots le français n'a pris que celui de trinquer, c'est-à-dire choquer les verres avant de boire. - (02) |
| bringuai. : Heurter, choquer et jusqu'à les mettre en pièces (en bringue) les verres en signe de réjouissance et de confraternité de convives : d'où bringuai, c'est aussi boire avec excès. - (06) |
| bringue s. f. grand déhanché (langage plaisant) : quelle grande bringue ! - (24) |
| bringue s. f. grand déhanché (langage plaisant). - (22) |
| bringue, s. et adj. f. Femme stérile, qui ne peut avoir d’enfants. Se dit sans doute pour bragne, breine, brehaigne. —Bringue, au reste, est une injure que les femmes se disent entre elles, et qui a pour origine cette idée des anciens, que la stérilité est un déshonneur, une marque d’infériorité chez la femme qui en est atteinte. — Se dit aussi d’une mauvaise jument. - (10) |
| bringue, s.f. perche. - (38) |
| bringue, sf. vaurien, fainéant. - (17) |
| bringué. Bu largement : on voit bé qu’el é bringué, on voit bien qu'il a bu d'autant qu'il a trinqué, qu'il a chinqué… - (01) |
| bringue. n. f. - Plusieurs usages : 1. Une mauvaise jument (sens attesté depuis 1751). 2. Femme stérile. 3. Injure entre femmes. Encore au siècle passé, la stérilité était considérée comme un déshonneur, une infériorité : « Espèce de grande bringue, te vas avouèr de mes nouvelles ! J'vas t’faie goutter à mon reuillot ! » Il est intéressant de constater le glissement de sens mauvaise jument - stérilité - injure, caractéristique d'une société très rurale, où le nombre élevé d'enfants dans un foyer était valorisant pour la femme. - (42) |
| bringuebaler, dringuenaler : faire un bruit de ferraille - (43) |
| bringuer, v. tr., boire avec excès, faire débauche de cabaret. - (14) |
| bringues (mettre en), loc, détériorer, briser, mettre en morceaux, dépecer. - (14) |
| bringues, s. f., guenilles, fragments, morceaux : « C’pauvre houme ! avou sa culotte en bringues, a-t-i l'air minâbe ! » - (14) |
| brintse : (nf) branche - (35) |
| brintse : branche - (43) |
| brintse échiatée : branche éclatée - (43) |
| brintse n. f. Branche. Y'en a long sans brintses ! Il ou elle est très grand(e) et mince. - (63) |
| brintse. Branche. On dit encore : « brinche ». - (49) |
| briô. Pain briô. Pain broyé. Ou appelle ainsi une sorte de pain fait de fine fleur de farine broyée longtemps à tour de bras avec des bâtons ferrés. C'était le chef-d’œuvre des boulangers, quand on les recevait maîtres ; et comme il était fort friand, on a dit de là, par manière de proverbe, à Dijon, se faire pain briô d'une chose, pour s'en faire un grand plaisir. - (01) |
| briô. : Broyé. Pain briô, pain broyé et d'une facile mastication. D'après Delmasse, on dit par manière de proverbe à Dijon : Se faire pain briô d'une chose, c'est-à-dire s'en faire un grand plaisir. - (06) |
| briocher, briochier, briochi : s. m., pâtissier. - (20) |
| briotse n.f. Brioche. - (63) |
| briou, beûriou : pilon en bois pour la purée - (37) |
| briou, subst. masculin : pilon à pommes de terre. - (54) |
| briou. Outil du maçon pour préparer le mortier. - (49) |
| brique (Chal., Br., C.-d.).- Morceau, débris. Un objet cassé est tout en briques. Suivant Littré, le mot français brique, s'appliquant à la pierre factice de terre cuite, viendrait du bressan brique ou breque. Il cite, à ce propos, l'expression bressane: une breque de pan, pour : un morceau de pain. Ce mot mérite donc, à cet égard, de figurer ici. - (15) |
| brique (f), morceau. - (26) |
| brique : Nom féminin. Morceau, « Cheu en mille briques » : tomber en mille morceaux. - (19) |
| brique : s. f., vx fr., morceau. Une assiette qui s'est cassée en mille briques. Des briques de gâteau. Voir ebriquer. - (20) |
| brique, morceau. (Pas une brique de pain, vase en briques). - (27) |
| brique. Morceau, fragment. Brique de pain, pour morceau de pain est très usité. Etym. le provençal briga, miette, l'anglais brick, fragment. - (12) |
| brique. s. f. Tesson, débris de vaisselle. Faire des briques , casser de la vaisselle. - (10) |
| briques - morceaux cassés, débris. - Ile é fait choué le pot et al é étai en mille briques. - I ons reçu son joli pain d'épices, et pu malheureusement â s'à cassai, ma les briques en sont bonnes. - (18) |
| briques, s. f., débris, morceaux, brins : « L’gâtiau é cassé ; ma les briques en sont bounes ». — « Ol a métu, d' rage, son tonneau en mille briques ». - (14) |
| briquet. s. m. Homme sans caractère, qui se laisse mener, qu’on fait mouvoir comme un briquet . — Dans Roquefort, briquet signifie sot, stupide ; ce qui concorde avec notre acception. - (10) |
| brire : (nf) bruyère - (35) |
| brire : bruyère - (43) |
| brire : bruyère - (51) |
| brîre n.f. Bruyère. - (63) |
| brire : s. f., bruyère. « En pôssant pre les Grands Brires. (En passant par les Grandes Bruyères). « (Le P'teu, p. 385), Syn. aussi de vianche (voir ce mot). - (20) |
| brire : v. n., bruire, retentir. On voit ben qu'y a du gibier c’t’ année ; on entend brire des coups d' fusil d' partout. - (20) |
| brire*, v. n. détoner, claquer. - (22) |
| brire, s. f. bruyère. - (24) |
| brirre (na) : bruyère - (57) |
| brisac : Brise tout. « C't'enfant casse totes ses affâres, i est in vra brisac ». - (19) |
| brisac, celui qui brise ou déchire tout. - (16) |
| brisac, subst. masculin ou adjectif qualificatif : brise-tout. - (54) |
| brisai. Briser, brisé, brisés. - (01) |
| brisaqu' : n. m. Maladroit qui casse tout ce qu'il touche. - (53) |
| brisaque – étourdi, qui brise, qui casse par vivacité, par défaut d'attention. - Qu'al â don brisaque ce domestique lai ! - En i en é que sont pu brisaques les uns que les autes. - (18) |
| brisaque : brise tout - (44) |
| brisaque : brise-tout - (48) |
| brisaque, adj. qui a l'habitude de briser les objets. Se dit des enfants. - (17) |
| brisaque, adj. qui use beaucoup ses habits, ses chaussures. - (22) |
| brisaque, adj. qui use beaucoup ses habits, ses chaussures. - (24) |
| brisaque, s. m., qui fripe, qui use, qui brise : « Oh ! y et eun brisaque ; sa culotte, ses sabots, sa biaude, tout y ê tôjor en bringues ». - (14) |
| brisaque. Brise-tout. Se dit plus particulièrement des enfants qui brisent leurs jouets. Mot créé en Bourgogne, sans étymologie spéciale pour sa forme qui sort un peu des désinences locales. - (12) |
| brisaquer. v. a . Briser. (Roffey). - (10) |
| brisbaudes. s. f. pl. Petits morceaux de porc frits dans la poêle. — Crotons, résidus de suif fondu. Voyez beursaude. - (10) |
| brischer, v. bercer. - (38) |
| brischot, s.m. berceau. - (38) |
| brise bise. n. m. pl. - Rideaux. (Arquian) - (42) |
| brise-bis (être en) : être en désaccord (chercher des chicanes). - (30) |
| brisée : Sentier séparant deux coupes de bois. - (19) |
| brise-fâ (on) : brise-fer - (57) |
| brisi - débringuer : casser - (57) |
| brisi : briser - (57) |
| brissaude (n. m.) : lardon (galette aux brissaudes) - (64) |
| brissaudes. n. f. - Lardons frits dans la poêle. - (42) |
| brissi, v. a. assouplir le chanvre après qu'il a été teillé. - (22) |
| brissoire, table, support de berceau. - (05) |
| britchet (on) : briquet - (57) |
| britchier, britier. v. - Briquet. - (42) |
| brizé s. f. : petit chemin dans les bois. - (21) |
| bro salé, s.m. épine-vinette. - (38) |
| brö, sm. berceau. Intérieur d'une petite voiture à ridelles. - (17) |
| bro, vase en fer-blanc dont on se sert pour le vin. - (16) |
| bro. Jeune pousse de bois au printemps. - (03) |
| broa, s.m. bois. - (38) |
| broc : s. m., tonnelier. « Les ouvriers tonneliers, connus à Mâcon sous le nom de « Brocs »... » (L'Emeute du Port de Mâcon en 1841, p. E. Demaizière. Ann. de l'Académie, 3* série, t. XXII, 1920-21). - (20) |
| brôcar. Brocart. Quelques-uns écrivent brocar en français, d'autres brocard , et d'autres brocat… - (01) |
| broche : aiguille à tricoter — morceau de bois fin pour ranimer la flamme. - (30) |
| broche : anneau métallique agrafé à l'extrémité du groin du porc à l'aide d'une pince à gorge pour l'empêcher de fouir. (voir feugnot). - (33) |
| broche s. f. aiguille de montre, d'horloge ; aiguille à tricoter (du vieux français). - (24) |
| broche : s. f., cannelle, robinet de fort calibre; bouchon plat, en bois, dont on se sert pour boucher le Irou de bonde ou le trou de cannelle. - (20) |
| broche, n.f. aiguille à tricoter. - (65) |
| broche, sf. dent pointue de chien. Défense de sanglier. - (17) |
| broche. Dans le Châtillonnais, on nomme ainsi une tige creuse au moyen de laquelle on peut tirer le vin d'un muid... - (02) |
| brocher : v. a., vx fr., mettre en perce. - (20) |
| brocher, v. tr., tricoter : « C'te vieille, àll’ vous broche des bas, des bas, qu'y ét ein plâïi d' la vouér ! » - (14) |
| brocher. v. n. S’écouler, passer par la broche. Se dit, en général, d’un liquide qui coule, qui s’échappe en un mince filet. - (10) |
| broches (jouer aux), loc. tirer à la courte-paille. - (14) |
| broches de bas, s. f., aiguilles à tricoter. - (14) |
| brochet : s. m. Brochet d'Espagne. nom donne en Bresse à un type de petit chevaine à reflets dorés. Voir fretoux. - (20) |
| brochetai : poser une broche. - (33) |
| brochetogne (nom féminin) : hachette. - (47) |
| brochi : (voir bruchi) - (19) |
| brochon : s. m., brindille, branchette. - (20) |
| brochon : s. m., broc. - (20) |
| brochon : vx fr., brechon, goulot. Voir pressoir. - (20) |
| brochon, n.m. sarment de vigne coupé. - (65) |
| brochon, s. m. brindilles de sarments. Verbe brochonner, ramasser des brindilles. - (24) |
| brochonnée : s. f., contenance d'un brochon (broc). Nous avons bu des vraies brochonnées de vin blanc. - (20) |
| brochonner : v. n., ramasser les brochons (brindilles). - (20) |
| broclô, bonde placée à la partie inférieure d'un fût. Tîre broclô, instrument servant à extraire du fût le broclô. - (16) |
| brocot, s. m. bouchon de feuillette, bondon, cheville qui la ferme. - (08) |
| brôcréaa ou brôquerea. : Bondon ou bonde d'une barrique, d'un tonneau. (Del.) - (06) |
| brodé : v. t. Broder. - (53) |
| brœchœ, adj. à qui il manque des dents, qui a une brèche dans la dentition. - (22) |
| brœchœ, adj. à qui il manque des dents, qui a une brèche dans la dentition. - (24) |
| brœque, s. f. grosse tranche de pain. - (22) |
| brœque, s. f. grosse tranche de pain. - (24) |
| brœte, s. f. charrette à deux roues. - (24) |
| broeuji*, v. n. pulluler. - (22) |
| broiche, s. f. broche, grande aiguille à tricoter. - (08) |
| broiche, s.f. brèche. - (38) |
| broicher, v. a. mettre une broche. - (08) |
| broichot, adj. qui a une brèche à la lèvre (bec-de-lièvre), ce qui provoque des difficultés d'élocution. - (38) |
| broïlla : Brouillard. « Y avait des broïllas c'tu métin (ce matin) ». Petite pluie, « Le temps se covre i pourrait bin cheut in broïlla ». - (19) |
| broillan : Brouillon de lettre, « Corrige dan man broïllan ». - Raisin oublié sur le cep par les vendangeurs qui ont fait la cueillette. Ouvrier qui fait vite la besogne hâtivement mais qui la fait mal et qui brouille tout. - (19) |
| broïlle : Brouille, désaccord. « Y a de la broïlle dans le ménage ». - Tricherie Ironiquement : « Y n'y a qu 'ès cartes qu'y a point de broïlle». - (19) |
| broïlli : Brouiller, semer la brouille et la discordre, « Y a bin langtemps qu'i sant broïllis ». - Obscurcir : « Le temps se broïlle » le ciel s'obscurcit. - Embrouiller : « Broïlli la besogne », la faire mal et de plus embrouiller tout. - (19) |
| broïlliéchi : Bruiner, brouillasser. « Je n'ai pas pouyu sodre (pas pu sortir) i a broïlliéchi to le jo ». - (19) |
| brôillon - (outre le sens ordinaire du français) grosse tache d'encre sur le papier. - A n'écrit pâ proprement, â fait to plain de brôillons su ses pages. - (18) |
| broïlloux : Obscurci, couvert de brume. « Le temps est broïlloux » le ciel est brumeux. (voir aussi à Mornayoux). - (19) |
| brôler : serrer avec un treuil. (VDS. T IV) - VdS - (25) |
| brôleux. n. m. - Rôdeur. (Bléneau, selon M. Jossier) - (42) |
| brôleux. s. m . Rôdeur. (Bléneau). - (10) |
| bromer (v. int.) : meugler (la vache a brome dans son pré) - (64) |
| bronchi : broncher - (57) |
| bronde (na) : brindille - (57) |
| bronde (na) : ramure (branchage) - (57) |
| bronde : (nf) petit bois, brindilles - (35) |
| bronde : branche de feuillu, petit pois - (43) |
| bronde n.f. (p.ê. la même origine que brondie). Charmille, ramure. - (63) |
| bronde : s, f., bas-lat. bronda, bois à fagot. - (20) |
| bronde, brindilles, menus bois-taillis. - (05) |
| bronde, s. f. 1. Ramure, branches coupées. — 2. Crépuscule. - (22) |
| bronde, s. f. ramure, branches coupées. - (24) |
| bronde, s. f. rejeton, pousse, feuillage de certaines plantes que l'on cueille pour aliment. - (08) |
| bronde, s. f., petite branche. - (40) |
| brondener, v. n. bourdonner. - (24) |
| brondener, v., bourdonner. - (40) |
| brondi (-e) (adj.m. et f.) : brun (-e), bruni (-e) - (50) |
| brondi, adj. brun, bruni, de couleur sombre. - (08) |
| brondi, bruni, pain brondi, à la brondie de la nuit. - (04) |
| brondi, vn. gronder sourdement et au loin. - (17) |
| brondie (n.f.) : entrée de la nuit - à la brondie : à la tombée de la nuit - (50) |
| brondie : (nf) crépuscule (« à la brondie ») - (35) |
| brondie n.f. (lat. brunum diem, jour sombre). Crépuscule. - (63) |
| brondlet : petite branche d'extrémité - (51) |
| brondon : branches de choux verts (une soupe aux brondons). A la fabrication de l'écorce pour le tan, l'écorce longue séchée s'appelant brondon. - (33) |
| brondon : s. m., menue bronde. - (20) |
| brondon, s. m. partie supérieure de la tige de certaines plantes, extrémité qui porte les bourgeons ou fleurs; « brondons « de choux, de navettes, etc. la soupe « aux brondons » n'est pas sans mérite quoique à l'usage des pauvres. - (08) |
| brondonnée : s. f., fagot de bronde, flambée de bronde. - (20) |
| brondonner, bourdonner. - (05) |
| brondouné, v. n. bourdonner. - (22) |
| brone. Sec. Le bois brône se casse avec facilité. Je ne connais pas l'origine de cette expression qui est en usage dans les communes de la plaine. - (13) |
| bronquedaller, v., sonner comme les cloches des vaches. - (40) |
| bronquer : v. n.. broncher, heurter, buter. Termes de batellerie : bronquer de Pire, bronquer de Riaume (voir ces mots). - (20) |
| bronquer, cogner fort, heurter fortement (le bateau a bronqué contre une pile du pont). - (27) |
| bronquer, v. tr., buter, terme de batellerie : « Bronquer de pire », buter de gauche; « bronquer de riaume », buter de droite. (Voir Pire et Riaume). - (14) |
| bronquer, v. tr., heurter, toucher fortemcnt : « O m’a bronqué en passant ; ô m'a fait bé mau. » - (14) |
| bronquer. Se heurter la tête l'une contre l'autre ; dans un sens plus large, se heurter. - (49) |
| brontsîres n.f.pl. (de brintse). Vesces cultivées. - (63) |
| bronziner, v. intr., bourdonner. - (14) |
| broquer (v.t.) : roter - (50) |
| broquer, v. n. roter. - (08) |
| broquer, v., manger quelque chose de dur. - (40) |
| broquer. v. a. Choquer, heurter. (Rugny). - (10) |
| broquereau : s. m., vx fr., bondon. - (20) |
| broquereau. Petit tampon en bois qui bouche l'orifice inférieur ouvert dans le fond d'une futaille : c'est par là qu'on introduit le robinet, appelé quelquefois broche et broquette. On dit encore à Namur : du vin vendu al broke. - (13) |
| broqueriat. s. m. Bonde, broche, bondon. (Domecy-sur-le-Vault). - (10) |
| brossaûde : longue tige de bois, équipée à une extrémité d’un chiffon humide, pour retirer les braises incandescentes du four à pain, dès que l’on estime le degré de chauffe suffisant - (37) |
| brosse : haie - (48) |
| brosse : (bros' - subst. f.) haie vive. Bô:ché oen' bros', « boucher une haie », c-à-d. « réparer les trouées que les bestiaux ont pu faire dans une haie ». - (45) |
| brosse : haie - (39) |
| brosse, n. fém. ; bouchure, haie, cépée ; uniquement dans les champs ; petit canton de bois de petite futaie. - (07) |
| brosse, s. f. haie vive qui forme la clôture des héritages. - (08) |
| brosses, broussailles. - (04) |
| brosseuilli v. Bruisser. - (63) |
| brosseuyi : bruisser - (35) |
| brossi : brosser - (57) |
| brossi v. Bruisser. - (63) |
| brossilli : faire du bruit en marchant dans la broussaille ou sur des feuilles mortes. A - B - (41) |
| brossilli : faire du bruit en marchant dans une broussaille sur les feuilles mortes - (34) |
| brossillon : s. m., vx fr., broussaille. « Sautons pre dessus les bresselions (Sautons par dessus les buissons). » (Le P'teu, p. 393). - (20) |
| brot : berme de patate. Voir : « ébroter » pour dégermer. Les germes (comme les fanes) sont toxiques. - (62) |
| brot : Frondaison, feuilles des raves, des carottes etc. Des brots de raves « Mes carottes sant bin chetites, i ant to poussé en brot ». - (19) |
| brot, brout, jeune pousse du bois. - (05) |
| brote : pain. (RDC. T III) - A - (25) |
| bröte, sf. betterave. - (17) |
| brôter : Brouter. « O ne sâ pa san pré ol le fa brôter » : il ne fauche pas son pré, il le fait pâturer par son bétail. - (19) |
| brôter : broûter - (39) |
| broter, v, tr., brouter : « Drés l’maitin, all'va faire broter Noirote au long d'la l'vée ». - (14) |
| broter, v. a. brouetter, mener avec une brouette, voiturer - (08) |
| brôts, s. m., rejets d'un arbre. - (40) |
| brotse : aiguille à tricoter. A - B - (41) |
| brotse : aiguille à tricoter - (43) |
| brotse n.f. Aiguille à tricoter. - (63) |
| brotse : (nf) aiguille à tricoter - (35) |
| brotsi : tricoter. A - B - (41) |
| brotsi : (vb) tricoter - (35) |
| brotsi : tricoter - (34) |
| brotsi : tricoter - (43) |
| brotsi v. Tricoter. - (63) |
| brotte, n. fém. brouillard ; le temps est noi, a fait des brottes. - (07) |
| brotte. s. f. Brouette. - (10) |
| brotter, v. brouter. - (38) |
| brou : fanes de pomme de terre, de betterave, de carottes (syn. tseu*). A - B - (41) |
| brou (n.m.) : fane des pommes de terre - (50) |
| brou : (nm) tige, fâne - (35) |
| brou : fane de pomme de terre - (43) |
| brou : fane de pomme de terre - (44) |
| brou de beurre. s. m. Écume de beurre. - (10) |
| brou de bigue (n.m.) : chèvrefeuille - (50) |
| brou de bigue : chèvrefeuille. - (33) |
| brou de bique : chèvrefeuille - (48) |
| brou n.m (v. fr. bros, jeunes pousses). Fane de pomme de terre. - (63) |
| brou : s. f. trainée de joncs et de débris, laissée par les eaux qui se retirent. - (21) |
| brou : s. m. partie verte d'une plante. - (21) |
| brou : s. m., syn. de chevasse. - (20) |
| brou, bourgeon... - (02) |
| brou, brau. Fane ; tige de certains végétaux : pommes de terre, betteraves, etc. « Des brous de trèffe » : des fanes de pommes de terre. - (49) |
| brou, s. m. feuillage des betteraves, des carottes. - (22) |
| brou, s. m. feuillage des betteraves, des carottes. - (24) |
| brôu. n. m. - Orme. (Saints, selon D. Levienaise-Brunel) - (42) |
| brou. : Bourgeon. - (06) |
| broûche : s. f. grosse brosse à dents de fer sur laquelle on peignait les fibres du chanvre. - (21) |
| brouche, s. f. aiguille d'horloge, de montre ; aiguille à tricoter. - (22) |
| brouchon, s. m. brindille. Verbe brouchouné. Ramasser des brindilles. - (22) |
| brouchou : Peigneur de chanvre. « Les brouchous n'ant plieu ran à fare chez no, an ne fa plieu de chavenére » : les peigneurs de chanvre n'ont plus rien à faire chez nous, il n'y a plus de chenevière. - (19) |
| brou-de-bigue, s. m. chèvrefeuille ou broude-chèvre. - (08) |
| broué (adj.) : se dit du blé atteint de la maladie du charbon - (64) |
| broué : maladie du blé qui change la farine en charbon - (60) |
| brouetter : conduire vite - (48) |
| brouillâ : (nm) brume, crachin - (35) |
| brouillâ : brume, crachin, brouillard - (43) |
| brouillâ n.f. Brume, crachin, brouillard. - (63) |
| brouilla, s m. nuage : un joli brouilla. Brouillard. - (24) |
| brouillamini. - Désordre, chaos, confusion d'objets. - (06) |
| brouillarder, v. intr., brouillasser. - (14) |
| brouillards (être dans les), loc, être dans les vignes, être gris. Le cas est assez fréquent. - (14) |
| brouillasse : bruine - (44) |
| brouillasse, bruine, brouillard qui tombe en pluie fine. - (27) |
| brouillasse, n.f. bruine. - (65) |
| brouillasserie : bruine - (48) |
| brouillasserie n.f. Bruine. - (63) |
| brouillassou : se dit d' un temps pluvieux - (46) |
| brouillèce : crachin - (43) |
| brouillècerie : bruine - (43) |
| brouillèchi v. Bruiner. Voir beurdeuilli, beurdèchi. - (63) |
| brouiller, v. a. crotter, salir, tacher. Avoir des habits « brouillés », être tout « brouillé. » - (08) |
| brouiller. Tacher avec de la boue. Al ai brôié sai culotte. On prononce suivant les localités brouiller, brouller ou brôier... - (13) |
| brouilleshe : bruine, brume. - (62) |
| brouillessi : (vb) pleuviner - (35) |
| brouillessi : pluviner - (43) |
| brouilli : brouiller - (57) |
| brouillon. Tache d'encre. Le mot usuel brouillon veut dire : 1- « La personne qui embrouille quelque chose, les affaires par exemple ; 2 - « Le premier travail par opposition au second qui est corrigé ». - (12) |
| brouinte : brouette. (PLS. T II) - D - (25) |
| brou-inte, brouette. - (26) |
| brouquette (pour broquette). s. f. Petite cheville, petite pointe. A Auxerre, on dit : Patient comme un chat qui chie sur des brouquettes. - (10) |
| brouqueziot. s. m. Bondon. (Fresnes). - (10) |
| brouquié, e. n. - Se dit d'une personne qu'on a à charge, qu'il faut nourrir, qui « broute », et qui n'est pas productif, (la femme, les enfants, les grands-parents, etc.). Les animaux domestiques sont également des brouquiés. (M. Jossier, p.22) - (42) |
| brouquié, quiée (pour broutié, broutière). s. m. et f. Qui mange, qui broute. Terme familier usité à Perreuse et dans la Puysaie, pour indiquer les personnes qu’on est obligé de nourrir. Ainsi, un homme, en parlant de sa femme, dit : Ma brouquiée, et, en parlant de ses enfants : J’ai deux, trois brouquiés qu’avont boun’ appétit. Les animaux domestiques sont aussi des brouquiés. - (10) |
| brousse : brosse - (48) |
| brousse : (brous' - subst. f.) brosse. - (45) |
| brousse, petite étendue de vigne restant à cultiver ; on dit aussi : une brousse de pèn pour : un reste de morceau de pain. - (16) |
| brousse, s. f. brosse pour nettoyer les habits, les meubles, etc. - (08) |
| brouster. v. a. Faire à la hâte, vite et mal. Le matin, une ménagère paresseuse ou trop pressée brouste son ménage. - (10) |
| broustilles. s . f. pl. Broussailles, broutilles, menues branches de bois. - (10) |
| broustillon, s. m. repas de famille qui se donne à l'occasion de la naissance d'un enfant. - (08) |
| broûtat : repas de baptême. - (32) |
| broutcher. n. m. - Broutard, jeune bovin sevré et mis au pâturage. - (42) |
| broute : s. f., vx fr. broutis, ce qu'on broute. Vin de broute, celui qui coule du pressoir avant la première coupe (voir ce mot) ; autrefois, et même aujourd'hui encore, mais dans certaines régions seulement, celui qui coule après. Voir aussi Cul-de-dé. - (20) |
| broûter : braquer - (57) |
| brouter : v. a., couper pour la première fois le dé (voir ce mot) du raisin pressuré. Celle expression parait venir de ce que la première coupe, du dé se faisait autrefois â l'aide d'une bâche, ce qui donnait au genne l'apparence d'avoir été brouté. - (20) |
| brouter, v. n. se dit par assimilation d'un faucheur qui ne coupe que la pointe de l'herbe, laissant toute la fourrure. - (08) |
| broutie (nom masculin) : veau chétif. - (47) |
| broutié, s. m. veau qui est demeuré chétif à la suite d'un sevrage prématuré, avorton. - (08) |
| broutillai, manger, sans appétit, de légères bribes de pain. - (02) |
| broutiller, v. intr., s'occuper de choses minutieuses, manger sans appétit. - (14) |
| broutin : s. m., syn. de brette. - (20) |
| broutô, s. m. repas qui se donne le jour du baptême d'un enfant - (08) |
| brouton (ōū), sm. branches dénudées après le passage des moutons. - (17) |
| broutot - (39) |
| brouvé, vn. boire en aspirant bruyamment. - (17) |
| broûyâ : s. m. gros nuage ; brouillard. - (21) |
| bröyö, sm. nombril. - (17) |
| bru : y bru (tr. litt. = il bruit) : bruit sourd et continu de la grêle et du tonnerre pendant l'orage. A - B - (41) |
| bru (on) : bruit - (57) |
| bru : bruit. - (29) |
| bru : Bruit. « O fa pu de bru que d'ovrage » : il n'est pas aussi actif qu'il voudrait le faire croire. - Rumeur : « Sais tu s'y est vra que la Claudine se mairie ? Pt'êt bin, le bru en a coru » : sais-tu s'il est vrai que Claudine se marie ? Peut-être, la rumeur en a couru. - (19) |
| bru : un bruit - (46) |
| bru : y bru : bruit sourd et sans relâche de la grêle et du tonnerre pendant l'orage - (34) |
| brû n.f. Belle-fille. Voir dzendresse. - (63) |
| bru : n. m. Bruit. - (53) |
| brû, bruait (n.m.) : bruit - (50) |
| bru, bruit ; è core ein grô bru su lu, il court un vilain bruit contre lui. - (16) |
| bru, bruit. - (26) |
| brû, s. m. bruit, tapage, vacarme : «a n'moune pâ eun gran brû », il ne fait pas de bruit, il est d'humeur tranquille. - (08) |
| bru. Bruit, bruits. - (01) |
| bruant, sm. crécelle employée pendant la semaine sainte. - (17) |
| bruche (nom féminin) : sorte de corbeille en osier. - (47) |
| bruche, s. f. grosse corbeille ronde et faite avec de la paille tressée. Elle est ordinairement munie d'un couvercle. - (08) |
| bruchenée : contenu d'un bruchon (banneton). (B. T IV) - D - (25) |
| bruchon - panier rond ou oblong, peu profond, à mettre le pain avant qu'on l'enfourne, et dont on se sert encore pour bien des usages en un ménage. - Enfairainne don in pecho pu les bruchons ; lai pâte tainrot aipré. – A nos é beillé ine bruchenée de faivioles. - Ce mot commence à devenir français. - (18) |
| bruchon, banneton. - (26) |
| bruchon, corbeille ronde ou allongée dans laquelle on met lever le pain. - (27) |
| bruchon, s. m. corbeille en paille tressée. - (08) |
| bruchon, s. m., corbeille, petit récipient évasé, la plupart du temps en paille tressée. - (14) |
| bruchon, sm. panier où l'on dépose la pâte de pain. - (17) |
| bruchon, vase d'osier dans lequel on fait lever la farine pétrie. - (16) |
| bruchon. Panier à pâte ; c'est le synonyme de boinon. Bruchon me paraît être une variante de bourriche et bourrichon. - (13) |
| bruchon. Panier rond en osier sans anse, dans lequel on met le pain avant de le faire cuire, et que l’on renverse sur la pelle pour y faire tomber la miche. Etym. bersa, claie d'osier dans le bas latin, dont une métathèse a altéré la forme, comme il arrive fréquemment, témoin benaton qui vient de banneton. - (12) |
| bruchot : s. m. : ensemble de six tuiles plates dans le four. - (21) |
| brue : s. f., lessive. Voir buie. - (20) |
| bruein. Bruyaient, et les deux autres personnes de bruire au pluriel de l’imparfait. - (01) |
| bruéne. Bruine, bruines. - (01) |
| bruillat, taillis, Breuillard (bois de), nom de lieu. - (04) |
| bruine : s. f., grondement sourd et continu que produit la nuée orageuse qui s'approche. - (20) |
| brûle-bourre (A) : Ioc, à brûle-pourpoint, brusquement. - (20) |
| brulliot - nombril. - C'a dans lai perfection queman le nez â mutan du visage, quemant le brulliot à mutan du vente. - (18) |
| brulô, yeux. - (02) |
| brulô. : Yeux, au figuré. (Del.) - (06) |
| brûlon (le) : brûlure (d’estomac) - (57) |
| brûlot, eau-de-vie sucrée brûlée. - (05) |
| brûlot, inflammation du gosier. - (05) |
| brûlot, s. m., pyrosis, sensation de sécheresse, d'ardeur, d'acidité au gosier et à l'estomac, causée parfois par le pain de maïs blanc. Les paysans ne sont pas toujours fâchés de cette propriété, qui pousse à boire. - (14) |
| brûlou, vent du midi. - (16) |
| brumasser, v. imp., tomber, (en -parlant du brouillard matinal). - (40) |
| brunae, s.f. bruine. - (38) |
| brunarie, s.f. bruine. - (38) |
| brundir, abrundir (brondir, abrondir) : v. n., vx fr. abrunir, brunir, s'assombrir. Le soleil commence â brundir. A la brundie, Ioc, à la brune, au crépuscule. A la brundie nuit. Ioc, à la nuit close, à la grande nuit. - (20) |
| brune, s. f., soir. « A la brune » veut bien dire : le soir, mais plusieurs ne craignent pas d'amplifier en disant ; « A la brune du jour » pour : à la chute du jour. - (14) |
| brung (adj.) : brun - (50) |
| brunmé, vt et n. demander en pleurant. Chercher à apitoyer. - (17) |
| brure : Bruire. Dicton : « La Vannère brut, vlà le dégi » : lorsque le dégel arrive après un long quartier d'hiver, on entend dans le montagne, du côté du bois de La Vannère un bruit particulier produit par la chute du givre, le froissement des rameaux, courbés par le givre ou la neige, reprenant leur position normale , c'est ce qui a donné naissance au dicton. - (19) |
| brure v. n. détoner, claquer : faire brure son fouet. - (24) |
| brusée : s. f., averse. Syn. de breuvée, radée, etc. - (20) |
| brusine et brousine, s. m., bruine, pluie fine, brouillard. - (14) |
| brusine : s. f., bruine. - (20) |
| brusiner, et brousiner. v. intr., bruiner. - (14) |
| brusiner, v. n., bruiner. - (20) |
| brut de fonderie : niais, balourd. - (54) |
| brut, s. m., bruit, tapage. - (14) |
| brut, s.m. bruit. - (38) |
| brutaler. Brutaliser, faire souffrir. - (49) |
| bruyainnes - brouillards. - En i é bein des bruyainnes ai ce maitin. - Les bruyainnes traignant le Ion du Larrai ; i ne sai pâ ce que ci nos aimeneré. - (18) |
| bruyasse, brouillard ; è bruyasse, il tombe de la pluie fine. - (16) |
| bruyé (û), vn. mugir. Se dit des bœufs et des vaches. - (17) |
| bruyin: brouillard. - (29) |
| bruyo : nombril. - (29) |
| bruyotte : brouette. - (29) |
| b'sace (na) - carnier (on) : besace - (57) |
| bsace : besace, bissac. III, p. 31-t - (23) |
| b'sin : adj. Lancinant. - (53) |
| b'sout : pioche pour la vigne. - (32) |
| bu (être) : loc. avoir bu avec excès. Quand il est bu, i n’ s' connaît pus. - (20) |
| bû (on) : bœuf - (57) |
| bu : (nm) bœuf - (35) |
| bu : boeuf - (43) |
| bu : bœuf - (51) |
| bû : Bœuf. « Ol a ageté ses bûs à la foire de mai, à Sennecey ». - (19) |
| bû n.m. Bœuf. - (63) |
| bu : bœuf. - (21) |
| bû, bœuf. - (05) |
| bû, lessive. - (16) |
| bu, ue. adj. Se dit improprement partout pour ivre. - (10) |
| bü[y]e : lessive - (52) |
| bu’ye : buse (l’oiseau rapace). - (62) |
| buandière, s. f., lessiveuse. - (14) |
| bubu, bubune (fére), loc. boire dans le langage enfantin. - (08) |
| bubune. n. f. - Boisson, dans un sens péjoratif.: « C'est eune houmme qu'aime ben la bubune ! » Déformation du français familier « bibine ». - (42) |
| bubune. s. f. Synonyme ironique et atténuatif de vin, de boisson, de bouteille. Ainsi, pour ne pas dire d’un homme qu’il est ivrogne, on dit qu’il aime la bubune.-Précédé de faire , il signifie boire. Voyons, mon p’tit, fais bubune . Il y a des femmes qui aiment à faire la bubune. - (10) |
| buchaille : s. f., vx fr. bouchaille, clôture, bouchure. « I sautironl tieu pre dessus ine buchaille. (Ils sautèrent tous par dessus une bouchure). » (Le P'teu, p. 393). - (20) |
| buche (bûche) : s. f., tige, fétu. Tirer à la courte bûche (Nouv. Larousse illustré), tirer à la courte paille. - (20) |
| bûche de bô, bûche de bois (pléonasme). - (16) |
| bûché, so donner beaucoup de peine pour effectuer un travail difficile. - (16) |
| buché. : Ce mot a un double sens : frapper fort et travailler fort, rosser une personne et faire un gros ouvrage.- un bûcheux est un abatteur d'ouvrage. (Comte Jaub.) - (06) |
| bûcher, frapper. - (04) |
| bûcher, travailler fort. - (05) |
| bûcheton. s. f. Bûcheron. (Trucy). - (10) |
| buchette (bûchette) : s. f., jonchet. - (20) |
| bûchotte : n. f. Bûchette. - (53) |
| bûchotte. n. f. - Bûchette. - (42) |
| buclage : s. m., action de bucler. Comparer avec le bas-latin bucliamen. - (20) |
| bucler : flamber (v. beucler). - (30) |
| bucler : v. a., flamber un porc ou une volaille. - (20) |
| bucler, v. brûler. Désigne plus particulièrement l'action de brûler les soies du porc que l'on vient de tuer. - (65) |
| budzi, guegni : bouger - (43) |
| bue - lessive. – I ailons fàre lai bue c'te semaingne qui. – Mai bue é bein soiché. - (18) |
| bue (n.f.) : lessive - (50) |
| bûe : lessive - (48) |
| bue et buie. Lessive. I vas encuver mai bue aujed'heu ; an lai coulerai demain, et pus, mequerdi i lai laiverons... - (13) |
| bue : (bu: - subst. f.) lessive. - (45) |
| bue : lessive - (39) |
| bue : lessive (celt. bugad : lessive). - (32) |
| bue : n. f. Lessive. - (53) |
| büe, buer, lessive, lessiver. - (05) |
| bue, lessive - (36) |
| bue, lessive. - (28) |
| bue, n.f. lessive, grande lessive annuelle. - (65) |
| büe, s. f. buée, lessive. - (08) |
| bue, s. f. buse, oiseau de proie. - (08) |
| bue, s. f. lessive. Soupçonnait-on les cabaretiers d'allonger leur vin, on disait qu' « ô fesein la buë ». - (14) |
| bue, s.f. lessive. - (38) |
| bûe, subst. féminin : lessive. - (54) |
| bue. Boeuf. On a dit ainsi autrefois. - (03) |
| bue. Buée ; lessive. - (49) |
| bue. Lessive, en vieux français buée. - (03) |
| buée, lessive, bue. - (04) |
| buer (verbe) : faire la lessive. - (47) |
| buer, v. a. laver en lessivant, lessiver : « buer » du linge sale. - (08) |
| buer, v. tr., lessiver, faire la lessive. - (14) |
| buer. v. n. Faire la lessive. - (10) |
| buerbis, brebis. - (27) |
| buffa : buffet. (S. T IV) - B - (25) |
| buffe, soufflet, bouffer, souffler. - (04) |
| bûge (na) : étable - (57) |
| bûge (na) : vacherie (étable) - (57) |
| büge : lessive. Faire la buge : faire la lessive . La buge se faito deux fois l'an : la lessive se faisait deux fois dans l'année. - (33) |
| buge, écurie. - (05) |
| buge. s. f. Lessive. ( Saint-Germain-des-Champs). — Dans le Berry, on dit bugée; en Basse-Bretagne, buga. - (10) |
| bugeai : verser de l'eau chaude sur le sac de cendre au-dessus du linge à lessiver. On dit aussi coulai la buge. - (33) |
| bugeaux. s. m. pl. Papiers. (Saint-Brancher). - (10) |
| bugeon (pour buson). s. m. Qui est lourd d’esprit et très-lent dans ses mouvements, dans son travail, dans ses actions. (Germigny). - (10) |
| bugne : s. f., bête. Grande bugne, va ! - (20) |
| bugne, bugnet : beignet - (48) |
| bugne, bugnette, bugnotte : s. f., vx fr., beignet, pâtisserie de pâte frite ; petite gaufre mâconnaise. - (20) |
| bugne, n.f. beignet de mardi gras. - (65) |
| bugne. Chapeau à haute forme et par extension tous les chapeaux. Origine introuvable. - (12) |
| bugnes, s. f., beignets de mardi gras. - (40) |
| bugnot, beignet. - (05) |
| bugnots (les) : fiançailles - (57) |
| bugrivo : arôme sauvage. A - B - (41) |
| buhiant (pour bouillant). s. m. Qualification ironique donnée au musard qui regarde l’ouvrage, qui tourne autour plus ou moins longtemps avant d’y toucher. (Turny). - (10) |
| buidon, boidon. bedon : s. m., vx fr. buydon, mue, cage à poussins. Syn. de trion. - (20) |
| buie (faire ou couler la). n. f. - Lessive de draps. Ce mot est une altération de la buée employé au XIIIe siècle pour désigner une lessive. - (42) |
| buie (n. f.) : lessive (couler la buie (faire la lessive)) - (64) |
| buie : buée, lessive - (60) |
| buie : grande lessive de printemps - (61) |
| buie : lessive. - (29) |
| buie ou buée. : Lessive. On disait que les taverniers faisaient la buée quand on les soupçonnait de baptiser leur vin. - (06) |
| buie : lessive. Faire la " buie " : bouillir le linge en lessiveuse. - (58) |
| buie, bouie et buée. Ce mot est aussi du vieux français. Nicot pense qu'il vient du latin imbuo. « Entendîmes un bruit strident et divars comme si fussent femmes lavant la buée. » (Rabelais, Pantagruel, v, 31.) - (02) |
| buie, bue, boie, beuie, bouie : s. f., vx fr. buie, buée, lessive. Voir brue. - (20) |
| buie, sf. buée, lessive. - (17) |
| buie. Lessive. On dit en plusieurs provinces buée… - (01) |
| buie. s. f. Buée, lessive. (V. buer.) - (10) |
| bûillon : (bu:yon: - subst. m.) personne qui ne travaille pas efficacement ou qui fait semblant de travailler, lambin. - (45) |
| buillon : adj. et n. m. Pas sérieux. - (53) |
| buine, s. f., outil de cordonnier, qui servait autrefois à cambrer les semelles. - (11) |
| buïon, s. m. celui qui perd, qui gaspille son temps en bavardages ou amusements puérils ; flâneur, traînard, paresseux. - (08) |
| bujon, beujon, s. m. lambin, paresseux, traînard, comme le précédent. - (08) |
| bujon, s. m. barreau d'échelle, de barrière, de râtelier (du vieux français boujon). - (24) |
| bujouner. v. n. perdre son temps, muser. - (08) |
| buleton. s. m. Baril. (Quincerot). - (10) |
| bulgno. Beignet. Pour les accordailles, on mange toujours les bugnos. - (03) |
| bungne, beugne, sf. bosse provoquée par un coup. - (17) |
| bungnöt, sm. beignet. - (17) |
| bure : bidon à lait - (48) |
| bure : cruche pour l'huile. (B. T IV) - S&L - (25) |
| bure, beurre. - (05) |
| bûre, cruche. - (16) |
| bure, n.f. gros bidon de lait de 10 à 20 litres, qui était utilisé pour le ramassage du lait. - (65) |
| bure, s. f. buie, buire, vase muni d'un bec ou goulot dans lequel on renferme principalement l'huile. - (08) |
| bure. Pour buire. Le français a conservé burette. - (12) |
| bureau : s. m., bureau de bienfaisance. Il a son pain du bureau. - (20) |
| bureteau, s. m., bluteau, toile de tamis. - (20) |
| burin, beurin, bourln, boirin : s. m., habitant de Boz (Ain), et par extension marchand de bestiaux. - (20) |
| buriner. v. a. Frapper avec colère, en marquant ses coups, comme on le ferait avec un burin. - (10) |
| burinette, beurinette. s. f. Petit vase de grès ou de fer blanc, pouvant se fermer hermétiquement, dans lequel les ouvriers des champs et les gens de métier qui travaillent au dehors emportent leur pitance. - (10) |
| burnes, s. m. pl., testicules (homme ou animal). - (40) |
| buro : cuveau à lessive. (C. T III) (RDM. T III) - B - (25) |
| buro, pinot gris. - (16) |
| burôt, buron (C.-d., Chal.). – Désigne le cuveau ou cuvier, généralement appelé balonge (voir ce mot), dans lequel on met les raisins qui viennent d'être cueillis et vont être transportés au pressoir. Ce mot, qu'il ne faut pas confondre avec beurot, cité plus haut, vient du mot buire, venant du même mot vieux français, dont l'étymologie est inconnue. La bure est actuellement encore, en Bourgogne, une sorte de vase ou cruche en terre, à bec, servant à contenir de l'huile, spécialement appelée cholotte dans la Côte-d'Or. En français il n'existe que la burette, petit vase à goulot destiné à renfermer l'huile ou le vinaigre, et désignant par extension chacun des petits vases où l'on met l'eau et le vin pour dire la messe. - (15) |
| burôt, s. m., petite cuve à lessive. - (40) |
| burot, s.m. baquet pour la lessive, avec une bonde au fond ; le "burot" se place sur la "sallerote", sorte de trépied. - (38) |
| burtiot. s. m. Bluteau, blutoir. (Chassignelles). - (10) |
| busenai, muser, perdre son temps : d'où buzard et buson, personne triste et qui parle peu. Dans l'idiome breton, bouzard signifie sourd. (Le Gon.)... - (02) |
| busener et busoner. v. intr., musarder, flâner niaisement, lambiner, et aussi bouder. - (14) |
| busoche. n. f. - Fauvette. (Villiers-Saint-Benoit, selon M. Jossier) - (42) |
| busoche. s. f. Sorte de fauvette. (Villiers-Saint-Benoit). - (10) |
| buson, busonner, boudeur, stupide, bouder. - (05) |
| buson. s. m., musard, lambin, mou, mais plutôt niais et de mauvaise humeur. - (14) |
| buson. : Musard qui ne fait qu'aller et venir comme la buse tournoie sans cesse dans les airs pour guetter sa proie. Le verbe busenai signifie aussi musarder.- Dans d'autres patois un busaud est un niais qui ne sait se tenir en place. - (06) |
| busonner, busouner. v. n. Ne pas travailler sérieusement, s’occuper à des riens, lambiner, musarder, comme une buse. - (10) |
| busquin, -ine : adj., syn. de besin, -ine. - (20) |
| busson : un buisson - (46) |
| bûtai : lancer, jeter. On buto des ous au chien : on lançait des os au chien. - (33) |
| bütai : regarder fixement (?) (ol'buto = ?). - (33) |
| bûter (v.) : lancer - (50) |
| bûter : regarder, surveiller, épier - (48) |
| bûter : (bu:tè - v. trans.) épier, guetter. - (45) |
| bûter : viser un but - (39) |
| buter, v. a. prendre pour but. On « bute » un lièvre, un renard, un loup pour les tuer. Le chasseur qui « bute » sa proie se met à l'affût pour la surprendre au passage. - (08) |
| buter, v. intr., marquer le but, jeter son palet, sa boule pour servir de but. - (14) |
| butin (beutin) : linge - (51) |
| butin : (nm) linge de la lessive - (35) |
| butin : ensemble des biens que l’on possède - (37) |
| butin : propriété, bien - (48) |
| butin n.m. (or. germanique, dépouilles de guerre partagées). Linge, habillement, linge lavé. - (63) |
| butin : propriété, bien - (39) |
| butin, beutin : linge (de la lessive) - (43) |
| butin, bien, ce qu'on possède ; el ai du butin, il a de la fortune, des terres, etc. - (16) |
| butin, n.m. linge. - (65) |
| butin, s. m. 1° propriété, avoir. Ex : cet homme a beaucoup de butin ; 2° vêtements, linge, trousseau. Ex. : cette fille a un beau butin ; 3° décombres provenant de démolitions ; Ex. : deux voitures de butin. Dans ce dernier sens, butin a donné naissance au verbe débutiner. - (11) |
| butin, s. m., tout ce que l'on traîne avec soi (vêtements, outils, matériel). - (40) |
| butin, subst. masculin : vêtement, linge. - (54) |
| butin. Habit, linge. - (49) |
| butiner. v. n. Charrier des glaçons. Il a gelé fort cette nuit : voilà la rivière qui butine. (Auxerre). - (10) |
| butjin, sm. butin. Bien patrimonial, domaine, terrien. - (17) |
| butot, souche, limite de bois. - (05) |
| butouaîr (on) : butoir - (57) |
| bûtsron n.m. Bûcheron. - (63) |
| butte : s. f., vx fr., tonneau. - (20) |
| butte, s. f., monticule factice de terre, élevé dans le Jeu de l'Arc pour y planter le collet. Du temps de Montaigne, la cible s'appelait bute. - (14) |
| butter, v. tr. terrer, c’est-à-dire mettre de la terre au pied d'un arbre, d'un arbrisseau, d'une plante. - (14) |
| buvailler, v. tr. boire à toute heure. (V. Burecher.) - (14) |
| buvande : s. f., piquette. - (20) |
| buvocher. v. tr. passer son temps à boire : « O n' fait ran d' ses dix dèts ; ô buvoche tout l’long du jor ». Il y en avait, de ces « gueurnouilles de cabaret » quand florissait le culte de ce « gueux de p'tiot vin blanc ! « (V. Buvailler.) - (14) |
| buvochou, s. m., buveur, surtout buveur d'habitude. - (14) |
| bùye, 1. s. f. lessive (du vieux français buée). — 2. s. m. bœuf. - (24) |
| buye, s. f. buée, lessive. - (08) |
| bùye, s. f. lessive [buée]. - (22) |
| büyon (être) : nonchalant, long à agir, flemmasse, insouciant. - (56) |
| bûyon : lent - (48) |
| bûyon : lent (qui ne travaille pas vite) - (39) |
| bûze : s. f. écurie. - (21) |
| bûze, autobus. - (26) |
| buzon. Paresseux. Ce mot vient-il, comme on le croit généralement, de buse, l'oiseau de proie qui plane si longuement dans l'air et qui semble atteint d'immobilité ? - (13) |
| bwèj'ver : mettre, placer en désordre. (RDM. T III) - B - (25) |
| by. Fossé alimentant un étang. - (03) |
| bya, beau. - (26) |
| byan, blanc. - (26) |
| byanc, byintse : (adj) blanc (che) - (35) |
| byanc, byintse adj. Blanc, blanche. - (63) |
| byaude n.f. (du francique blidalt, en anc. fr. bliaut). Blouse, robe. - (63) |
| byaudes n.f.pl. Habits féminins. - (63) |
| bydon : l'entre-deux d'une âte - (60) |
| byé na n.m. Sarrasin. - (63) |
| byè, blé. - (26) |
| byettes n.f.pl. Blettes, cardes, poirée. - (63) |
| byeu, byeue, byeuse adj. Bleu, bleue. - (63) |
| byeû, byeûze : bleu(e) - (35) |
| byeusse: (adj) blet(te) - (35) |
| byeussnin, poirier sauvage. - (26) |
| byeusson, fruit du byeussnin. - (26) |
| by-inche, blanche. - (26) |
| byintse adj. Blanche. - (63) |
| byintsi: (vb) blanchir - (35) |
| byode, blouse. - (26) |
| byot, byosse adj. Blet, blette. - (63) |
| byotte, betterave. - (26) |
| bzin : fin. - (29) |
| bzin adj. (du francique bisunnia) Lent, mou, peu actif. Dans le charolais-brionnais l'adjectif beuzin ou beuzon qualifie plutôt une personne exigeante ou minutieuse, nous employons alors, à Sivignon, le mot bedion et le verbe bedionner. - (63) |
| bzin : (bzin: - adj. inv.) délicat, minutieux. - (45) |
| b'zin, chose d'un travail minutieux et celui qui apporte un soin excessif dans ce qu'il fait. - (16) |
| b'zin. Lent, mou, peu actif. - (49) |
| bzingue : bisaiguë (outil de charpentier), censée effrayer le diable. A - B - (41) |
| b'zin-ne. Qualificatif donné à l'hypoderme du bœuf qu'on appelle « mouche b'zin-ne » (Oestre). Genre d'insecte diptère dont les larves vivent sous la peau ou dans l'estomac des ruminants. - (49) |
| bzoin n.m. Besoin. - (63) |
| bzon, sm. besoin. - (17) |
| c : Troisième lettre de l'alphabet… Je me suis trouvé fort embarrassé quand il s'est agit d'orthographier certains mots qui ne sont autre chose qu'une prononciation différente d'un mot français dans lequel o ou u est remplacé par « eu ». Comment en effet écrire le mot « coche » si on remplace o par eu ? Ceuche se prononcherait seuche ; keuche queuche donnent à ce mot une physionomie tout à fait différente et qui m'a parue inadmissible. Aussi pour conserver à ce mot et à tous ceux qui offrent la même particularité, l'orthographe la mieux en rapport avec l'étymologie ai-je cru devoir conserver le C en indiquant par une apostrophe que cette lettre garde le son dur. - (19) |
| ç 'tel'laite : pron. dém. Celle-là. - (53) |
| ç' : adj. dém. Ce. - (53) |
| ç‘ambairder : chambarder, tout mettre sens dessus dessous - (37) |
| ç’a. C'est : ç’a devant une consonne, ç’a Iu, c’est lui ; ç’at devant une voyelle, ç'at un fô, c'est un fou. - (01) |
| ç’âgne (ain) : (un) chêne - (37) |
| ç’âgne (aine) : (une) chaîne - (37) |
| ç’âgne (l’) dâs hâirdes : (le) chêne des « hardes », chêne plusieurs fois centenaire dans la forêt de mouasse, près de la route de st léger-de-fougeret - (37) |
| ç’âgnon, ç’aîgnon : nuque - (37) |
| ç’aile : chaise - (37) |
| ç’aipiau : chapeau - (37) |
| ç’aipoûter : couper, taillader en petits morceaux inutilisables - (37) |
| Ç’airlot (l’) : (le) Charles - (37) |
| ç’ait ! (yot) : (c’est) bon ! (c’est) chat ! (c’est) très fin ! - (37) |
| ç’ambouler : changer de place - (37) |
| ç’ampîer : repousser - (37) |
| ç’ânin : odeur de l’air après l’orage - (37) |
| ç’arç’er : « chercher », exciter sournoisement - (37) |
| ç’arç’er choûs sâs pieds : rechercher intensément - (37) |
| ç’arc’er dâs poûx en lai paiye : chercher des « noises » - (37) |
| c’âteûre-ç’iens : couteau de poche - (37) |
| ç’âtîgne : châtaigne - (37) |
| ç’âtré : châtré, émasculé - (37) |
| ç’aûboulon, apogne : petit « reste » de la pâte à pain, mis à cuire pour les enfants - (37) |
| ç’aûdière, mairmitte : gros poêle de forme ronde à grande contenance, à cercles s’emboitant pour la cuisson de la nourriture des porcs - (37) |
| ç’aûffeû : chauffeur - (37) |
| ç’ausses : chaussettes - (37) |
| ç’âyion (a) : (l’) été - (37) |
| c’eu : Prononcez keu. - Corps, « Ol a le diable au c 'eû » : il a le diable au corps. - Corsage, « In c'eû baleiné » : un corset. - Cœur, « Avoi ban c'eû » : être généreux, « Prendre mau au c'eû » : s'évanouir. Au figuré : tomber, « San chevau d'heutte a pris mau au c'eû » : son cheval est tombé sans qu'on y ait touché. - (19) |
| c’eu : Prononcez keu. Coq. « In c’eu d'inde » : un dindon. - (19) |
| c’eûche : Cuisse. « Des c'eûches de dames » : des poires cuisses-madame. - « Eune c 'eûche de cala » : le quart de l'amande d'une noix. - (19) |
| ç’eûm’née : cheminée - (37) |
| ç’eûppe (aine) : (une) houppe de cheveux - (37) |
| c’eurer : Curer, nettoyer, « C'eure un fossé, c'eurer des sabeuts ». - (19) |
| ç’ez reux : chez eux - (37) |
| c’iâpper : manger rapidement, goulûment - (37) |
| ç’ien : avare - (37) |
| c’igouler, ç’igougner : remuer fortement, secouer - (37) |
| ç’iner : taquiner, « faire enrager », dérober - (37) |
| ç’iou-queûlottes : enfant sans retenue, peureux, groussard - (37) |
| ç’îrou : celui qui fait ses besoins partout - (37) |
| ç’itrelle : petit siège pour s’asseoir - (37) |
| c’la : (nm !) noix - (35) |
| ç’là ou ç’la-là : celle-là - (57) |
| ç’le-là : celui-là - (57) |
| c’mande (na) : commande - (57) |
| c’mander : commander - (43) |
| c’mander : commander - (57) |
| c’mander, v. tr., commander. - (14) |
| c’médien : comédien, menteur - (37) |
| c’menç’ment (on) : commencement - (57) |
| c’menci : commencer - (43) |
| c’ment : (conj) comme - (35) |
| c’ment : avec. (A. T IV) - S&L - (25) |
| c’ment : comme ! comment ! - (43) |
| c’ment : comme. Et :c’ment cen pour comme ça. - (62) |
| c’ment : comment - (57) |
| c’minci : (vb) commencer - (35) |
| c’mode : commode - (43) |
| c’moshi : commencer. - (62) |
| c’mou. adv. Comment. Du latin quomodò. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| c’nâssu ! (y l’aî ben) : (je l’ai bien) connu ! - (37) |
| c’neuchance. s. f. Connaissance. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| c’neutre v. a. Connaître. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| ç’nî : poussière dans l’œil - (37) |
| ç’opine : demi-litre de bistrot - (37) |
| ç’oûgner : pleurer en reniflant - (37) |
| ç’oûgnoux, ç’oûgnaissou : celui qui pleure à la moindre occasion - (37) |
| ç’oûratte : ruban dans les cheveux - (37) |
| ç’oûte, ç’oûtot : chouette, hibou - (37) |
| ç’pendant : cependant - (57) |
| c’qui, pronom dém., ça. - (40) |
| c’reûç’e (aine) : (une) cruche - (37) |
| ç’risi (on) : cerisier - (57) |
| ç’t : cet - (57) |
| c’té (adj. dém.) : ces - (50) |
| ç’te : cette - (57) |
| c’te, pronom démonstratif, celui. - (40) |
| c’té-là, pr. dém., celle-là. - (14) |
| ç’tel-ci, ç’tel-là, ç’tell’-ci, ç’tell’-là. Pron. démonstrat. Celui-ci, celui-là, celle-ci, celle-là. (Argentenay). - (10) |
| c’téqui, e, pr. dém., celui, celui-ci, celle, celle-ci : « Qu'é-c'quié que c'téqui ? » - (14) |
| c’teuquite, pronom démonstratif, celui-ci, celui-là. - (40) |
| c’ti-là, et c’tu-là, pron. dém., celui-là : « Oh! c'tulà ! vous a-t-i ein bagou ! » - (14) |
| ç’tit : malicieux, de mauvaise saveur - (37) |
| ç’tit’té : méchanceté, malice - (37) |
| c’vau (ain) : (un) cheval - (37) |
| ç’viyée : chevillée - (37) |
| c’yoc’e (aine) : (une) cloche - (37) |
| ça : pr. déni., cela, ce qui est. Ça mien, ça tien, ça sien : ce qui est à moi, à toi, à lui. - (20) |
| ca, cela ; s'â ça, c'est cela. On dit aussi : çai. - (16) |
| ç'a, pr, déni., cela. Ce mot s'emploie de bien des manières On dit d'abord : « Ça pleut, ça tonne, ça glisse » pour : il pleut, il tonne, etc. On dit aussi : « Ça chien ! ça diâbe ! » en maugréant contre quelque chose qui va au rebours de ce qu'on désire. - (14) |
| ca. Rencontre, cas. An ce ca, en ce cas. - (01) |
| caba, bruchon. - (16) |
| caba, s. m. grand panier rond, corbeille sans couvercle en paille tressée, dans laquelle on met en forme la pâte du pain avant de l'enfourner. - (08) |
| cabache : châtaigne d'eau. Dire de quelqu'un qu'il â des cabaches dans les poches, c'est dire (comme les cabaches sont piquantes) qu'il n'y met pas volontiers la main. (CH. T III) - S&L - (25) |
| cabache, s, f., un des noms de la châtaigne d'eau. - (14) |
| cabachon. s. m. Garde-genoux, auge à l’usage des laveuses. Du grec cabos. - (10) |
| cabadou, capadou (à la). exp. - Jeu d'enfants où l'on monte à cheval sur les épaules. - (42) |
| caban, s. m., gros vêtement de pluie. - (40) |
| cabane à lapins n.f. Clapier. - (63) |
| cabane au tsin n.f. Niche. - (63) |
| cabaner : mettre en cabane, fermer - (51) |
| cabaner v. Calfeutrer, isoler, boucher, protéger. - (63) |
| cabani, n.m. nomade, bohémien. - (65) |
| cabanier : s. m., nomade logeant dans une roulotte. - (20) |
| cabarat : Cabaret, auberge, café « Passer sa vie au cabarat » : être à l'auberge très souvent, être un pilier de cabaret. - (19) |
| cabardouche (faire) : basculer en arrière lorsqu'on est assis d'une manière instable. (VSLD. T II) - S&L - (25) |
| cabardouche (faire), tomber en arrière, quand le banc se renverse. - (40) |
| cabaret : s. m., syn. de paradis. - (20) |
| cabarne, s. f. cabane, chaumière, hutte. - (08) |
| cabas (nom masculin) : corbeille ronde faite de paille tressée. On s'en servait généralement pour déposer la pâte destinée à faire le pain. - (47) |
| cabas : corbeille (généralement en paille) - (48) |
| cabas : sac. - (52) |
| cabas : corbeille où est mise à lever la pâte à pain. - (33) |
| cabas : corbeille en paille - (39) |
| cabas : s. m., châtaigne d'eau (dont la forme rappelle vaguement.celle du cabas). - (20) |
| cabas. s. m. Auge, vaisseau de bois ou de pierre, dans lequel se met la pâture donnée aux pourceaux. Du grec cabos et du latin cabus. — Voiture ancienne, non suspendue, dans laquelle on était fortement cahoté; par extension, le cahot résultant de cette voiture. - (10) |
| cabasser. v. a. Secouer, cahoter, par assimilation avec les secousses, les cahots qu’on reçoit dans un cabas. - (10) |
| cabasson (n. m.) : sorte de panier en bois, utilisé notamment par les vendangeurs – sorte de caisse en bois dans laquelle les lavandières s'agenouillent - (64) |
| cabasson (n.m.) : caisse de bois où s'agenouillait la lavandière - (50) |
| cabasson (nom masculin) : sorte de caisse en bois où la laveuse s'agenouillait (Au temps de la Mère Denis). - (47) |
| cabasson : cagibi (cabasson) - (60) |
| cabasson : caisse en bois spéciale, ouverte dessus et dans sa partie arrière dans laquelle la laveuse s'agenouille à la fontaine (ou lavoir - on dit plus facilement fontaine que lavoir). Le fond est garni de paille. La partie haute du devant se termine par une planche étroite inclinée vers l'arrière de la caisse, sur laquelle la laveuse appuie son estomac. - (58) |
| cabasson. n. m. - Garde-genoux, caisse en bois sur laquelle s'agenouillaient les lavandières. - (42) |
| cabé : bœuf ou vache ayant les cornes recourbées vers le bas par la vieillesse. A - B - (41) |
| cabe, cabelle. Chèvre. On dit aussi « cheuvre, tseuvre ». - (49) |
| cabèche, s.f, cabache, châtaigne d'eau. - (38) |
| cabelin, sm. petit cabinet. Redent. Logette. - (17) |
| cabelôt, sm. voir cabelin. - (17) |
| caberiole. Cabriole. - (49) |
| caberiolet. n. m. - Cabriolet. - (42) |
| caberlot (le) : la tête - (61) |
| caberlot : le crâne. Pour certains gandoux, ce mot désignait aussi un chapeau ou un poêle - (46) |
| caberlot. n. m. - Tête. Mot dérivé de l'argot cabèche, issu de l'espagnol cabeza. - (42) |
| cabet (ette) : adj. et s., bœuf ou vache dont les cornes sont incurvées en avant et en bas. - (20) |
| cabet : (adj) bossu - (35) |
| cabet : bouf ou vache ayant les cornés recourbées vers le bas, dû à la vieillesse - (34) |
| cabet : plié - (43) |
| cabet, cabette adj. et n. Courbé vers le bas (homme courbé), vache dont les cornes baissent. - (63) |
| cabet. À cornes courtes et retournées vers le sol : « un bœuf cabet ». - (49) |
| cabette : (nf) vache dont les cornes sont tournées vers le bas - (35) |
| cabette : bœuf ou vache ayant les cornes recourbées vers le bas, phénomène dû à la vieillesse - (43) |
| cabeuche : Caboche, tête. « Forre te bien cen dans la cabeuche » : mets toi bien çà dans la tête. - Gros clou, « Ol a fait mentre (mettre) des cabeuches seu le talan de ses sulès (sous le talon de ses souliers) ». - (19) |
| cabeucher, v. n. pommer, faire une tête. - (08) |
| cabeugne et cabosse, s. f., bosse à la tête. - (14) |
| cabeugne : (subst. f.) bosse sur un objet. - (45) |
| cabeugner, v. tr., faire une bosse à la tête. - (14) |
| cabeurdouche ou cabardouche (faire), locution verbale : tomber. - (54) |
| cabeurdoûche : n. f. Pirouette, acrobatie qui consiste à faire un tour sur soi-même. - (53) |
| cabeurdouché : v. i. Tomber en roulant. - (53) |
| cabeuriole, s. f. cabriole, culbute. - (08) |
| cabeuriole, s. f. cabriole, culbute. - (14) |
| cabeurioler, v. intr., cabrioler, faire la culbute. - (14) |
| cabeurioler, v. n. cabrioler, faire des cabrioles, des culbutes. - (08) |
| cabeuriolet, s. m. cabriolet, voiture légère qui saute à la manière d'une petite chèvre. - (08) |
| cabeuriolet, s. m., cabriolet. - (14) |
| cabeurlô, s. m., tête. - (40) |
| cabeurlucher, v., tomber en avant, tête la première. - (40) |
| cabeûrne : Caverne. « O s'est caichi dans eune cabeûrne seu la reuche (sous la roche) ». - (19) |
| cabi. s. m. Lièvre. - (10) |
| cabibôle, s. f. ampoule, petite vessie qui pousse sur le corps humain, aux pieds le plus souvent. - (08) |
| cabin (n. m.) : chevreau (syn. bigou, chiga) - (64) |
| cabin. n. m. - Chevreau. - (42) |
| cabin. s. m . Taureau. (Percey). — Suivant Jaubert, ce nom serait, dans certains pays, donné au chevreau. - (10) |
| cabinet : Armoire. « Ses affâres sant rangies dans le cabinet ». - (19) |
| cabinet : s. m. armoire à linge. - (21) |
| cabinet : s. m., armoire à linge et à vêtements. - (20) |
| cabinet, s. m. armoire à linge. - (22) |
| cabinet, s. m. armoire à linge. - (24) |
| cabinette n.f. Petite alcôve. - (63) |
| cabion n.m. Cabanon. - (63) |
| cabion : s. m., syn. de tabagnon. - (20) |
| cabionne, sm. voir cabelin. - (17) |
| cabiote ou cabote - petite cabane, ou simplement un petit endroit écarté de la maison où l'on serre différentes choses. - Al é fait ine cabiote dans son jairdin. - Lo maillon n'â qu'ine Cabote. - (18) |
| cabioton : (nm) petite cabane - (35) |
| cabioton n.m. Petit cabanon. - (63) |
| cabioton : s. m., petit cabion. - (20) |
| cabiotte : n. f. Cabane. - (53) |
| cabioute : cabane. - (29) |
| cabioûte : une petite cabane dans les champs ou les jardins - (46) |
| cabioute et cabotte : cabane. Quant an ai pleuvu trop fort i nous soms caichés dans eune cabioute. Le radical cab, qui est probablement d'origine celtique, a formé un grand nombre de mots : cabaret, cabine et ses diminutifs. Au pays wallon, cahote est une barque couverte. En Angleterre un cab est une sorte de voiture. Citons encore à Rome, cabanna et camera. - (13) |
| cabioute, petite cabane. - (16) |
| cabioute, s. f. petite chambre. Diminutif cabiouton. - (22) |
| cablieute : Petit réduit où l'on peut s'abriter ou se cacher Dans un sens péjoratif masure. « Ol est leugi (logé) dans eune chetite cablieute ». - (19) |
| caboche (nom féminin) : tête dure. - (47) |
| caboche : tête - (48) |
| cabochon : personne qui n'en fait qu’à sa tête - (44) |
| cabochon : (subst. m.) sorte de clou à grosse tête. - (45) |
| cabochon, cabouèchon : partie supérieure d'une rûche en paille - (48) |
| cabochon. Cabochard, entêté. - (49) |
| caboiche, cabouéche, s. f. caboche, tète. - (08) |
| caboigne. s. f. Cabane. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| cabole : Petit panier rond, d'une forme particulière. - (19) |
| cabolot : Petit et trapu. « O n'est ren grand a peu ol est to cabolot ». - (19) |
| caborgneute. s. f. Lucarne. (Véron). - (10) |
| caborgnis. s. m. Mauvaise bicoque. (Plessis-Saint-Jean). - (10) |
| cabossé, bosseler ; un vase bosselé est un vase cabossé. - (16) |
| càbòsser (dans toute la Bourgogne), caibòsser (C.-d.) et cambôsser (Br., Morv.). - Bossuer, faire des bosses à la tête ou à un ustensile de cuisine, à un chapeau, etc. ; a produit le substantif cambôle (C.-d., Chal., Morv.), qui signifie bosse, ampoule. - (15) |
| cabosser (v.t.) : rendre bossu déformer par des bosses - (50) |
| cabosser : Bossuer. « San chépieu (chapeau) est to cabossé ». - (19) |
| cabosser, bossuer. - (04) |
| cabosser, camboisser, cambosser. v. a. Bossuer. Des vieilles casseroles camboissées. - (10) |
| cabosser, v. a. bossuer, rendre bossu, déformer. - (08) |
| cabosser, v. tr., meurtrir, surtout faire des beûgnes ; aussi bossuer : « O m'a tout cabossé la tête », — « J'ai cabossé mon cliapiau, ma montre ». (La gousse des amandes du cacao s'appelle cabosse). - (14) |
| cabosser. Bossuer ; faire des bosses à la vaisselle, l'argenterie, l'aluminium. - (49) |
| cabosser. Faire une bosse ou une blessure à la tête. Par extension, toute espèce de blessure légère. - (13) |
| cabot : chabot (poisson). - (62) |
| cabot. s. m. Toupie, sabot. — Chien de petite taille, ainsi appelé sans doute à cause de sa grosse tète, et par analogie avec le poisson du même nom appelé aussi chabot . Du latin caput. - (10) |
| cabote : cabane - (48) |
| cabote : (cabot' - subst. f.) cabane de bûcheron dans la forêt. - (45) |
| cabotin (m), partie supérieure d'une ruche en paille. - (26) |
| cabotin : partie supérieure de la ruche en paille (on dit aussi cabochon). On recolto le miée dans le cabotin : on récolte le miel dans le cabotin. - (33) |
| cabotin : (subst. m.) partie supérieure d'une ruche, généralement en glui. Le "cabotin" est amovible, afin de permettre la récolte du miel. Lorsqu'il y a un décès dans la maison, on fait porter le deuil aux abeilles, c'est-à-dire qu'on couronne le "cabotin" d'une étoffe noire. On le nomme ainsi par comparaison avec la tête, vu qu'il constitue le sommet de la ruche. - (45) |
| cabotse n.f. et adj. Caboche, têtu. - (63) |
| cabotson : (nm) (fam.) tête - (35) |
| cabouèche : tête - (48) |
| cabouèche. s. f. Caboche, clou à grosse tête. Du latin caput. - (10) |
| cabouérotte : pâtée claire pour les porcs - (39) |
| cabouillon : radier du perthuis. - (09) |
| cabouillon. s. m . Radier d’un pertuis. (Châtel-Censoir). - (10) |
| cabouin : n. m. Petit recoin. - (53) |
| caboulo : timbale avec couvercle. (CH. T III) - S&L - (25) |
| caboulot - quelque chose de moins encore qu'une Cabiote. - Le râtais, lai piaiche, mes saibots, i ai to serrai dan le Caboulot. - (18) |
| caboulot (nom masculin) : vase fermé par un couvercle. - (47) |
| caboulot : cagibi - (44) |
| caboulot : s. m. (terme enfantin), noyau de pêche. Quand on tire une agate, il est expressément, défendu de se servir de caboulots au lieu de billes. - (20) |
| caboulot, s. m. vase en bois avec couvercle. - (08) |
| caboulot, s. m., petit réduit, pauvre gîte. - (14) |
| caboulot, subst. masculin : réduit sombre, placard, cagibi. - (54) |
| cabour. n. m. - Vieille maison. (Grandchamp, selon M. Jossier) - (42) |
| cabour. s. m. Vieille maison. (Grand-Champ). - (10) |
| cabourlotte. s. f. Loge, cabane, maison délabrée. - (10) |
| cabre : (nf) (fam. et humoristique) chèvre - (35) |
| cabre : chèvre ou trépied,…. L’animal caprin, et aussi le trépied pour le support ou le levage (fonction de cric) et la menue paille (brisures) au battage. C’est également une grosse sauterelle. Voir « boque ». - (62) |
| cabre : Chèvre. « Du fremage de cabre », « du lait de cabre ». - Criquet, petite sauterelle, « Les cabres ant ravégi les prés c'te an-née ». - Sorte de jeu de bergers. La cabre est une branche fourchue à trois rameaux coupés d'égale longueur et qu'on place debout comme une sorte de trépied ; un des joueurs armé d'une baguette (peuchan) garde la cabre que les autres joueurs cherchent à renverser en lui lançant un bâton dans les jambes, c'est à dire dans ce qui lui en tient lieu. Quand la cabre est renversée son gardien se hâte de la relever et poursuit celui qui l'a renversée, quand il l'atteint, il le touche de son « peuchan » et l'oblige à aller à son tour garder la cabre. - (19) |
| cabre n.f. Chèvre. Uniquement employé au pluriel et beaucoup moins fréquemment que tseuvre. - (63) |
| cabre : s. f. chèvre. - (21) |
| cabre : s. f., cabri femelle. - (20) |
| cabré, cabrou (châgne), s.m. se dit des stratus lorsqu'ils prennent la forme de longues traînées dans la direction du vent. - (38) |
| cabre, n.f. chèvre. - (65) |
| câbre, s. f., trépied de bois, pour scier les bûches. - (40) |
| cabre, s.f. trépied en bois. - (38) |
| câbre, tige d'arbre, de vigne formant avec une autre un angle, à leur jonction ; d'où : fàr eune cabre est tailler une branche de manière à lui laisser deux tailles. - (16) |
| cabre. Sorte de trépied fabriqué avec trois branches sortant d'une même tige ; il sert à appuyer l'arrière d'une voiture que l'on charge. Par similitude on dit qu'un arbre, une plante, sont bien cabrés lorsqu'ils se ramifient avec vigueur. Le sens primitif est cabre, chèvre, dont les jambes s'écartent pour la maintenir en équilibre sur les rochers. Un pied de chèvre, sorte de grue à l'usage des charpentiers et des maçons, a précisément ses deux montants arc-boutés... - (13) |
| cabrer (se), v. se rebiffer. - (38) |
| câbrer. v. a. Élever, dresser. Câbrer des perches, des poteaux, pour faire une construction légère. Câbrer une échelle contre un mur. (Villeneuve-les-Genêts). - (10) |
| cabreuye : aigreur d'estomac. - (29) |
| cabri : (nm) agneau - (35) |
| cabri : chevreau - (48) |
| cabri : Chevreau. « Sauter c'ment in cabri ». Le mot cabri est français. - (19) |
| cabri : un chevreau. - (56) |
| cabri, cabrette n. Chevreau, chevrette. - (63) |
| cabri, cabrite (n.m. et f.) : chevreau, chevrette - (50) |
| cabri, chevreau - (36) |
| cabri, petit de ta chèvre. - (16) |
| cabri, s. m. chevreau. Surnom donné autrefois aux habitants de Montcenis, sans doute parce que le pays produisait beaucoup de cabris - (11) |
| cabri, s. m., chevreau : « O gingue tô c’ment eùn cabris. - (14) |
| cabri. s. m. Chevreau. De caper, bélier. - (10) |
| cabrion : sorte de fromage. - (30) |
| cabrion : s. m., fromage de chèvre. - (20) |
| cabris : chevreau - (51) |
| cabris. s. m. Appentis, hangar rustique. Jaubert donne cabrat, hangar. - (10) |
| cabrite : chevrette, jeune chèvre née dans l’année. - (59) |
| cabuché : pommé. Un chou cabuché : un chou pommé. - (33) |
| cabuché : (adj.) bien pommé (se dit d'un chou, d'une salade). - (45) |
| cabuché : adj. Pommé. - (53) |
| cabuché, adj. ; se dit d'un chou cabus, d'une salade. - (07) |
| cabucher, caibucher : pommer (chou), attendre un enfant - (48) |
| cabucher, v. tr., assaillir, et principalement à la tête, à coups de projectiles, pierres, boules de neige, etc. - (14) |
| cabuchi (verbe) : Devenir pommé « Ma salade a bien cabuché ». - (19) |
| cabus : Féminin : cabuche. « Des choux cabus, de la salade cabuche » : des choux pommés, de la salade pommée. - (19) |
| cabut, têtu, chou et chêne cabut. - (05) |
| cabutsi v. (de cabu). Pommer. - (63) |
| caca : voir caqui - (23) |
| cacaboson (A) : Ioc. adv., à croupeton. Se dit surtout des enfants lorsqu'ils glissent dans une, position accroupie. Voir le bas-latin cacabosus. - (20) |
| cacara : Appeau pour la perdrix. Le cacara est fait d'un goulot de bouteille sur lequel est tendu, comme une peau de tambour, un morceau de parchemin percé d'un trou très fin dans lequel on fait aller et venir un fil de crin. - (19) |
| caca-rouge (n.m.) : baie de houx - (50) |
| cacas. s. m. Noix. - (10) |
| cacater : Glousser. « Je na sais pas quevà est passée ma pouleille nare : Alle est darè la boucheure, je l'entends cacater ». - (19) |
| cacatois, catacois : s. m. et f., coiffure de nuit faite d'un mouchoir enroulé autour de la tête. - (20) |
| cac'eûche : Cac'eut de médiocre qualité. - (19) |
| cac'eut : Sorte de gâteau ou brioche, dans la pâte de ce gâteau il entre, avec de la farine de froment, des œufs, du beurre, un peu de fromage frais. A l'occasion de la fête patronale chaque ménage fait une fournée de cac'euts. « Du cac'eut de la Saint Geôrges ». - (19) |
| cache n.f. (du prov. casse). Poêle à frire. - (63) |
| câche, s. f. poêle à frire (du vieux français casse. Latin cattia). - (24) |
| cache, s.f. cime. - (38) |
| cache-guenilles : s. m., cache-misère (Nouv, Larousse illustré). - (20) |
| cacheron, s. m., tas de foin, prêt à être chargé. - (40) |
| cacherot : cachottier - (61) |
| cachet : s. m., vin cacheté. Goûtezmoi ça, ça fera un bon cachet. - (20) |
| cachetons (a), loc. jambe par-ci, jambe par- là. Monter un cheval à cachetons, c'est le monter à la manière des hommes par opposition avec la manière des femmes qui sont assises sur un côté. - (08) |
| cachette (jouer à la), locution verbale : jouer à cache-cache. - (54) |
| cachette, n.f. dans l'expression « jouer à la cachette » pour « jouer à cache-cache ». - (65) |
| cachi : cacher - (57) |
| cach'net (on) : cache-nez - (57) |
| cacho. Jeu des enfants ainsi nommé parce que l'un d'eux doit chercher les autres qui se sont cachés. On l'appelait jadis Jeu des réponailles. - (03) |
| cachon (n. m.) : petite meule de foin - (64) |
| cachon. s. m. Tas de foin dans les champs. (St-Denis-sur-Ouanne, Bléneau). - (10) |
| cachot, adj., cachottier, mystérieus : « Y ét ein cachot ; ô n’vous dit jamâ ran ». - (14) |
| cachot, s. m., cache-cache, jeu favori des enfants : « Allons, veins ! j'allons jouer au cachot ». Appelé jadis jeu des réponnailles. (V. Coù, Coui). - (14) |
| cachote, s. f. , cachette. - (14) |
| cachou. n. m. - Petit tas de foin au milieu d'un champ. - (42) |
| cachouquier, cachoutier. s. m. Cachottier, celui qui ne dit jamais rien de ce qu’il sait, de ce qu’il fait, qui met du mystère et du secret en toutes choses, même dans les plus insignifiantes. - (10) |
| cacnaté : Tatillon, homme qui se mêle des besognes qui ne regardent que les ménagères. - (19) |
| caconner : v, n., caqueter. - (20) |
| cacoter. v. n . Mûrir, en parlant des noix. V’là les noix qui cacotent. (Véron). - (10) |
| cacotte, s. f. narcisse, faux narcisse. Se nomme encore pain de coucou. - (08) |
| cacotte, s. f. petite dent dans le vocabulaire des enfants. - (08) |
| cacotte. s. f. Terme enfantin, dent, nicotte. - (10) |
| cacou : gâteau fait de cerises noires, de farine et de crème. - (30) |
| cacou : neuf. - (31) |
| cacou n.m. Clafoutis aromatisé et sucré, avec ou sans cerises. Ce mot est surtout employé du côté de Paray-le-Monial. Syn. de tartoyon. - (63) |
| cacou n.m. Prétentieux, frimeur. - (63) |
| cacou. adj. Très-malade. Du grec cacos, mauvais. - (10) |
| cacou. C'est le nom que les enfants donnent à un œuf. Dans l'Yonne, on appelle cacou une grosse noix. - (13) |
| cacou. s. f.. Grosse noix. - (10) |
| cacoue (faire la) : avoir l'air malade - (60) |
| câcoûe : bouderie, grimace, gros dos, air renfrogné - (48) |
| cacouée : hanneton. - (09) |
| cacouée : voir cancouelle - (23) |
| cacouée, cacouine. s. f. Hanneton. — A Montillot, on dit cacouille. - (10) |
| cacouet. s. m. Nuque. - (10) |
| cacoutis : voir caquetis. - (20) |
| cacoux (ouse), caqueux (euse) : adj. et s., vx fr. caqueux (lépreux), qui caque souvent, qui est barbouillé de m... Il a le derrière tout cacoux. - (20) |
| cacreau : voir quinqu'gneau - (23) |
| cacrou. s. m. Coquille de noix. - (10) |
| cacroue : renfrognement - (60) |
| cacuelle : voir cancouelle - (23) |
| cadabre : Cadavre, squelette. On dit d'un homme grand et maigre : « Y est in grand cadabre ». - (19) |
| cadet (ette) : s. m. et f., garçonnet, fillette. - (20) |
| cadet : (nm) garçonnet - (35) |
| cadet : garçonnet - (43) |
| cadet : Plus jeune. Cette qualification prend quelquefois la place du prénom : « Cadet Brainchi, Cadet Millot, Cadette Frérot ». - (19) |
| cadet : s. m., le dernier fils. Autrefois, dans les familles, on désignait l'aîné des fils par le nom patronymique, le deuxième par l'appellation de « Cadet » tout court, et les suivants par leurs prénoms respectifs. - (20) |
| cadet, petit domestique. - (05) |
| cadet, s. m., petit domestique, garçon de café ; également le plus jeune d'une famille, qui garde presque toujours ce nom : « Dis donc. Cadet, v'tu v'ni ! » - (14) |
| cadète, s. f. dalle de pierre blanche carrelant les anciennes maisons. - (22) |
| cadette : Dalle qui dans les anciennes constructions servait à paver les maisons. « C'te chambre est frade, alle a des cadettes, ou, alle est cadettée » - (19) |
| cadette : s. f., pierre de dallage ou de couverture. - (20) |
| cadette, s. f. pierre plate ou dalle qui recouvre un mur. Nos murs à sec ont quelquefois au faîte une rangée de « cadettes » - (08) |
| cadette, s. f., pierre plate, dalle dont on recouvre un mur, un trottoir, etc. - (14) |
| cadetter : v. a., paver ou couvrir de cadettes. - (20) |
| cadeule : cabane dans les vignes. (B. T IV) - S&L - (25) |
| cadeule : Sorte de hutte servant d'abri, comme la bôrde mais encore plus rudimentaire et parfois faite de branchages. - (19) |
| cadiau, s. m., cadeau, présent. - (14) |
| cadiche, adj. des deux genres. diminutif de cadet usité autrefois comme nom de fantaisie dans les familles. - (08) |
| càdòle (Y., Chal., Char.). - Cabane, baraque, maisonnette ; se dit principalement des cabanes ou cabines établies sur les bateaux qui naviguent sur la Saône. Vient du vieux français jayole, gaïole ou gaole, qui signifiait cage, prison, d'après le latin cavea, et a formé le mot français geôle. - (15) |
| cadole : (nf) cabane en pierres - (35) |
| cadole : cabane à outils, abri dans le pré - (43) |
| cadole : cabane. Abri de bergers et de vignerons (borie ou buron dans d’autres régions). Du provençal cadaulo. - (62) |
| cadole n.f. Petite cabane. - (63) |
| cadole : (cadol' - subst. f.) bicoque, vieille maison relativement délabrée. - (45) |
| cadole : s. f., maisonnette isolée, cabane servant d'abri dans la campagne et d'habitation sur les bateaux marchands. Noms de lieux : Les Cadoles, communes de Château et de Rornenay. « C'est un pauvre chiffonnier installé dans une cadolle et qui gagnait bien pauvrement sa vie. » (Républicain Maçonnais, 11 juil. 1909). - (20) |
| cadole, n.f. cabane sommaire, souvent avec murs et toiture en pierres, utilisée par les bergers et les vignerons. - (65) |
| cadole, s. f. petite cabane en pierres sèches, sans porte, isolée dans les vignes. - (24) |
| cadole, s. f., cabane en pierres au milieu des vignes. - (40) |
| cadole, s. f., cabane, maisonnette isolée, baraque, retrait de berger, de cantonnier : « O n'a pu ran qu' sa pauv, cadole ». - (14) |
| cadole, s.f. cabane dans les vignes (provençal "cadaule"). - (38) |
| cadole. Cabane ; pauvre maison. - (49) |
| cadole. s. f. Genre de cabane particulier aux bateaux de la Saône naviguant sur le canal de Bourgogne. (Laroche). - (10) |
| cadolle : s. f. petite cabane en pierres. - (21) |
| cadoue (faire sa ...) : bouder. Bouder avec un mouvement des lèvres. Ex. : "Aga la don fée sa cadoue !" - (58) |
| cadoule, s f. petite cabane en pierres sèches, sans porte, isolée dans les vignes. - (22) |
| cadouner, et parfois cadener, v. tr., poursuivre à coups de pierres, de boules de neige, etc. : « Ol avot bu ; les gamins l'ont cadouné à coups d’carreaus ». — « Y avot d' la nouége ; j' nous sons cadounés en sortant de l'école ». - (14) |
| cadrain (un) : récipient métallique servant à transporter des aliments - (61) |
| cadre : A le même sens qu'en français mais de plus désigne tout objet encadré : gravure, tableau, diplôme. - (19) |
| cadre, s. m., tableau, gravure : « T’as d'ben jolis cadres dans ta chambre ». - (14) |
| cadrette : partie d'un mur mise à la portée des grandes personnes afin de servir d'accoudoir pour regarder sur la route ou causer. - (30) |
| cadrette, s. f. dalle de pierre blanche carrelant les vieilles maisons. - (24) |
| cadrette, s.f. jeu de cartes que l'on joue à quatre ; la plus forte carte est le roi ; les enfants jouent beaucoup à la cadrette. - (38) |
| cadrin (nom masculin) : récipient en métal muni d'une anse destiné au transport des repas pour les personnes travaillant au dehors. - (47) |
| cadrin : récipient en fer blanc ou émaillé pour les repas ouvriers (imphy, les cadrins) - (60) |
| cadrin. n. m. - Gamelle métallique contenant le repas de midi, utilisée principalement par les bûcherons et les écoliers. (Voir F.P. Chapat, p.56) - (42) |
| cadu, adj. caduc : « le mau cadu ». - (08) |
| caduc : s. m., personne épuisée par l'âge ou par la maladie. - (20) |
| caduc, adj. qui a mauvaise santé, est sujet aux rechutes. - (24) |
| caduc, adj. qui a mauvaise santé. - (22) |
| cadze : cage - (51) |
| cadze à freumadze : cage à fromage en grillage fin pour la protection contre les mouches - (51) |
| cadze à freumâdze n.f. Cage à fromage. Voir tséjîre. - (63) |
| cadze à viaux n.f. Petite bétaillère tractée ou simplement posée sur un plateau. - (63) |
| câee, adj. impair, dépareillé. S’emploie en parlant d'une chose isolée d'une autre qui l'accompagne ordinairement. - (08) |
| caf : en nombre impair - (60) |
| caf’tchére (na) : cafetière - (57) |
| cafâ (on) : cafard - (57) |
| cafard : s. m., blatte. - (20) |
| câfè (du) : café - (57) |
| café des pauvres : loc, relations amoureuses. C'est au café des pauvres que pensait le pigeon du bon La Fontaine quand iI disait « Mon frère a-t-il font ce qu'il veut. Bon souper, bon gîte..., et le reste ? » - (20) |
| câfé n.m. Café. Voir jûs. - (63) |
| cafè : n. m. Café. - (53) |
| café, s m., prononciation aiguë de café. Plusieurs sons fermés subissent cette intonation ouverte : « Veins-tu au café ? ». - (14) |
| cafernaude. n. f. - Petit réduit très sombre, sans soupirail, sorte de débarras. - (42) |
| cafernaude. s. f. Cachette, retrait, cabinet noir. De capharnaüm. - (10) |
| cafeurniot (nom masculin) : petit local à usage de débarras. On dit aussi cafourgneau ou cafeurnon. - (47) |
| caffe : impair, dépareillé. Ol o caffe : il est seul . Le beu seul éto coffé : le bœuf seul est dépareillé. - (33) |
| caffe : s. f., bas-lal. caffa, poche (de vêtement). - (20) |
| caffe. n. m. - Élément d'une paire resté seul. Le jour de la communion, l'enfant qui n'a pas de frère ou de sœur de communion, est un caffe. Se dit également pour un bœuf.qui a perdu son compagnon de travail. - (42) |
| caffe. s. m. Nombre impair ; unité audelà du nombre nécessaire. — Se dit aussi adjectivement. Un bœuf café , bœuf qui a perdu son compagnon. - (10) |
| cafi v. (mot lyon. venant d'une contraction du lat. clavo figere, fixer avec un clou) Remplir. - (63) |
| cafiau, s. m , mauvais café, rinçure de marc. - (14) |
| cafignette (n. f.) : pièce de tissu épais servant protéger le cou-de-pied des personnes qui portent des sabots - (64) |
| cafignons. n. m. pl. - Chaussettes raccommodées. (Arquian) - (42) |
| cafite. adj. Joli. (Étais). - (10) |
| cafouillon (on) : flaque - (57) |
| cafouillou : une personne qui s'exprime mal - (46) |
| cafouin : s. m. mauvais chanvre. - (21) |
| cafouine, s. f. taudis en désordre. - (24) |
| cafourgnot : cagibi (cabasson) - (60) |
| cafourgnot. n. m. - Petit bâtiment, débarras, sombre comme le serait un four ; synonyme de cafernaude. - (42) |
| caftîre n.f. Cafetière. - (63) |
| cage. s. f. Plantain ; ainsi appelé sans doute, parce qu’il sert à alimenter les oiseaux en cage. (Argenteuil). - (10) |
| cagelöt, sm. bourse. Testicules des béliers. - (17) |
| cageron. s. m. Petite claie d’osier. (Gisy-les-Nobles). - (10) |
| cagesatte. s. f. Cage à fromages. (Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes). - (10) |
| cagibi. Petit réduit pour mettre les débarras, les cages à lapins. (Argot). - (49) |
| cagna (na) : chaleur (canicule) - (57) |
| cagnâ : Déconfit, désappointé. « O s'en est reveni to cagnâ ». - (19) |
| cagnagnou (n. m.) : romanichel - (64) |
| cagnais - douleur, ou plutôt raideur que l'on sent dans tout le corps, dans les jambes surtout, après une marche considérable ou un travail fatiguant. - I ai ben mairchai hier, ailé ma âssis i ai joliment les cagnais ajedeu. - (18) |
| cagnar, lâche, poltron. Les Bretons nomment caignard un fainéant. Avoir les cagniais (Châtillon), avoir les queignas (Champagne), c'est avoir les jambes enraidies par la fatigue. - (02) |
| cagnar. : Fainéant toujours couché comme un chien, ou poltron comme un chien qui fuit (italien, cagna; latin, canis). - (06) |
| cagnard, mendiant, chagnard, sournois, hypocrite (Les Cagnards appartenaient à la grande confrérie des mendiants, qui, au moyen-âge, vivaient de l'exploitation de la charité et de la crédulité publiques). - (04) |
| cagnards (Avoir les). Avoir les jambes fatiguées par un excès de marche ou de certains travaux... Notre mot vient du latin canis dont on a fait câgne. Celui qui souffre des cagnards a les jambes cagneuses et les muscles malades : al ast fatigué quemant un chien. - (13) |
| cagnas (avoir les...) : être courbatu. Se dit principalement des jambes lorsque la fatigue les a rendues raides. Ex : "Maint'nant qu'jai déraché toutes mes blettes, j'ai les cagnas !" - (58) |
| cagnas (n. m. pl.) : douleurs musculaires causées par un effort prolongé (avouèr les cagnas) - (64) |
| cagnâs : courbatures - (48) |
| cagnats : courbature. - (09) |
| cagnats : courbatures. On è les cagnats quand on n'o pas habituai : on a des courbatures quand on n'est pas habitué. - (33) |
| cagnats, cagnes (avoir les). n. m. pl. - Courbatures, douleurs ressenties dans tout le corps, principalement au niveau des articulations et des reins, après avoir effectué un travail épuisant. - (42) |
| cagnats. s. f. pl. Lassitude extrême, douleurs que l’on ressent dans les reins, dans les articulations des membres, à la suite d’une grande fatigue ou d'une longue marche. - (10) |
| câgne (C.-d., Chal., Morv., Br., Y.). - Lâche·, fainéant. C'est un vieux mot, encore usité au XVIIe siècle pour chienne et prostituée, venant de canis employé comme terme de mépris. A formé cagnard, encore usité en français familier pour désigner un homme indolent, et cagnarder ou s'accagnarder, qui veut dire vivre en paresseux. Cagneux a la même origine, d'après Ménage, parce que les chiens, surtout les bassets, sont cagneux. - (15) |
| càgne (du latin canis), mauvais chien. Le mot injurieux canaille dérive aussi de canis, chien. Avoir les càgne se dit pour : être courbaturé. - (16) |
| çagne (n.m.) : chêne - (50) |
| cagne , femme de mauvaises mœurs, (cagna , chienne). - (04) |
| cagne : fête de la moisson. (E. T IV) - C - (25) |
| câgne : mauvais chien. - (66) |
| cagne : Mauvais chien. « T'as in brave chin d'arret, est-ce qu'ol est ban ? Non y est eune cagne ». Avoir la cagne, avoir un accès de fainéantise, « T'm 'as bin l'ar d'avoi la cagne ». « O n'est ni chin ni cagne » : il n'est ni l'un ni l'autre. - (19) |
| câgne : un mauvais chien - (46) |
| cagne : vieux chien. - (09) |
| câgne : (câ:gn' - subst. f.) mauvais chien. - (45) |
| cagne : s. f., cagnardise. J'ai la cagne. - (20) |
| câgne, adj. cagnard, paresseux, impropre au travail. - (08) |
| cagne, s. f., mauvais chien, chienne paresseuse. Injure que l'on donne volontiers à un individu, mâle ou femelle, qui ne veut rien faire, à une prostituée. - (14) |
| câgne. Mauvais chien, chien engourdi, paresseux. Par extension fainéant, ou même individu désagréable. Comparez cagnard, indolent, qui a la fainéantise du chien (Littré), et cagne qui, encore au XVIIe e siècle, désignait au propre une chienne, et au figuré une femme de mauvaise vie. - (12) |
| cagne. Mauvais chien, et par extension fainéant. - (03) |
| câgne. s. m. Chien. — Se dit, flgurément, de toute personne lâche ou fainéante. - (10) |
| cagner, v. renoncer à se défendre, à attaquer ; peut-être de "canis", chien peureux qui rentre dans son chenil. - (38) |
| cagner. v. n. Flagorner, faire comme le chien qui remue la queue. - (10) |
| câgnet. Petit chien, quelquefois chien adulte. - (12) |
| cagnets, n.f. grande fatigue. Plus particulièrement les courbatures des jambes que l'on ressent le lendemain d'un travail important ou d'une longue marche. Toujours utilisé au pluriel (aujourd'hui, j'ai les cagnets). - (65) |
| cagneu (m), courbature. - (26) |
| cagneux. s. m. Flagorneur, flatteur bas et complaisant. - (10) |
| cagnias (les), s. m., douleur que l'on ressent aux jambes par suite de lassitude : « Avoir les câgnias ». - (14) |
| câgnias (Morv.), câgnats (Y.), càgnârs, écàgnârs (Chal.), écagnârds (Dij.). - Courbature, lassitude dans les articulations d'un membre, jambe, bras, ou dans les reins, résultant d'un travail plus fort ou d'une marche plus longue que de coutume. C'est le mot français cagnard dont on vient de parler ci-dessus, mais détourné de son sens habituel, et pris activement au lieu de l'être passivement. Au lieu de dire : être cagnard par suite de la fatigue, on dit : avoir le cagnard. Ce qui prouve que l'origine est la même, c'est que dans l'Yonne on emploie le mot chien dans le sens de cagnats, avoir les chiens pour : avoir les cagnats. Cette étymologie paraît plus vraisemblable que celle consistant à faire venir écàgnar de écâjer, vieux mot français signifiant écarter, disjoindre. - (15) |
| câgnias, s. m. pl. douleurs de jambes. Avoir les «câgnias, » c'est éprouver des douleurs aux jambes par suite d'une lassitude prolongée. - (08) |
| cagnieu : mot masculin désignant une personne souffreteuse - (46) |
| cagnoche. adj. Un peu cagne, un peu souffrant. (Étais). - (10) |
| câgnon, s. m. nuque du cou, chignon. - (08) |
| cagnon. s. m. Nuque, derrière du cou, chignon. Jaubert donne chagnon, d’où dérivent chaignon , chignon. (Puysaie). - (10) |
| cagnon. s. m. Petit chien. - (10) |
| cagnot. s. m. Petit coin. - (10) |
| cagnote. s. f. Petite masure, logis étroit, malpropre, bon pour un chien. De cagne, canis. - (10) |
| cago : personne très pratiquante. A - B - (41) |
| cago : personne très pratiquante - (44) |
| cagôte. Cagote, cagotes. - (01) |
| cagou. s. m. Escargot. (Collan). - (10) |
| caguenas, calnas, cannas. s. m. Cadenas. - (10) |
| caheurler : tousser. (F. T IV) - Y - (25) |
| caheurler, cahorler. v. n. Tousser. - (10) |
| cahié, s. m., cahier. Du groupe des sons ouverts, comme café, etc. - (14) |
| çai (adv.) : ça, ici - (50) |
| çai : cela, ça - (39) |
| çai, adv. çà, ici. - (08) |
| çai, ç'qui : pron. dém. Ça. - (53) |
| çai. Çà. O çai, or çà. Les crieuses de cerises, à Dijon , crient : Ai mes belles cerises, çai. A mes belles cerises, çà. - (01) |
| caibaine (n.f.) : cabane - (50) |
| caibas : sac à provisions en toile cirée - (37) |
| caïberdat, cailliberdat, caillé-berda. n. m. - Compote de prunes - (42) |
| caibet, sm. cabas. - (17) |
| caibeûc’e, caiboc’e : tête - (37) |
| caibeûc’er : tomber sur la tête - (37) |
| caibeûc’ir, caibeûc’er : pour un légume, croître en feuilles très serrées en s’arrondissant bien - (37) |
| caibeucher (v.t.) : (de chou cabus) : pommer, faire une tête pour les choux - (50) |
| caibeugnai – bosseler. - I l'ions prôtai note timbale et pu â nô lé raiportée tote caibeugnée. - Al â don si molaidroit, le pôre gairson, qu'â ne peut pâ tuchai in aillement sons le caibeugnai. - (18) |
| caibôche se dit d'une personne têtue et opiniâtre. Cette dénomination date de l'époque de Charles VI, où les mutins avaient à leur tête un chef du nom de Caboche. - (02) |
| caiboche, s. f., tête. Au fig. tête dure, où rien ne peut entrer : « Queue fichue caiboche que t'as ! On t'dit quête chouse, épeu du cou, là, y ét oblié ! » - (14) |
| caiboche. Grosse tête, mot burlesque formé de l'espagnol cabo par extension. - (01) |
| caibôche. : Têtu, opiniâtre, mauvaise tête. - (06) |
| caibossai. : Bossuer un objet en frappant dessus ou en le laissant tomber. Le dialecte disait cambouler et cabouler. (Roq.) - (06) |
| caibossé, tordre, bossuer. En langue romane on trouve cabouler et cambouler ; et, dans les vocabulaires bretons, kam signifie courbe, tortu. - (02) |
| caibottin , comédien. - (02) |
| caibri : chevreau - (37) |
| caibu, chou pommé, du latin caput, parce que le chou est comme une tête. - (02) |
| caibu. : Se dit d'une certaine espèce de chou très serré, très pommé et ayant la forme d'une tête, caput. - (06) |
| caibus, caibeûç’é : pommelé - (37) |
| caiç’e-miraûde : jeu de colin-maillard - (37) |
| caiçer (v.t.) : cacher - (50) |
| caichate : Cachette. « T'as troué la caichate » : tu as deviné. - (19) |
| caichè : cacher - è s'été caichè d'sou lè table, il s'était caché sous la table - (46) |
| caiche : Poêle à frire. Ce mot a vieilli, on dit plutôt aujourd'hui « casse ». Voir ce mot. - (19) |
| caiché : v. t. Cacher. - (53) |
| caiche, caisse, casse. Poêle à frire. Casse désigne spécialement une poêle à long manche pour faire cuire les crêpes. Fig. Niais : « ris don grand casse ». - (49) |
| caiche, s. f. cachette, lieu où l'on cache quelque chose. - (08) |
| caiché, vt. cacher. - (17) |
| caiché. Cacher, caché, cachez. - (01) |
| caiche-biote et cache-bioute. Jeu d'enfant où l'on est caché et blotti. Quand tous les joueurs sont placés, on crie biouti au chercheur, à « celui qui l'est. » Pour nous aibuyer (amuser), i aillons jue ai lai caicbe-biôte. On dit aussi caiche-môche, qui est la forme patoise de l'ancien mot cache-musse. II ne s'agit donc pas ici de mouche, mais bien de se musser, c'est-à-dire de se cacher. (V. Meusse). - (13) |
| caiche-caiche : à cache-cache - (46) |
| caiche-micheraude, loc. jeu de cache-cache, colin-maillard. - (08) |
| caichenôte. Cachette, cachettes. - (01) |
| caicher : cacher - (48) |
| caicher, cacher. - (04) |
| caicher, v. a. cacher. - (08) |
| caicher. v. a. Cacher. - (10) |
| caicheron, meule de foin à demi sec mettre le foin en caicheron pour le faire sécher. - (11) |
| caichi : Cacher. A quelqu'un qui a commis une action dont il devrait rougir : « T'as pas hante ? van dan te caichi ! ». A table, pour inciter les convives à bien faire : « Sarvites vo, to ce que vo viez n'est pas caichi ». - (19) |
| caichô. Cachot, cachots. - (01) |
| caichot : Jeu de cache-cache. « J'ins fait eune bonne partie de caichot dans le grené » : nous avons fait une bonne partie de cache-cache dans le grenier. - (19) |
| caichot, discret, mystérieux. - (05) |
| caichöte, sf. cachette. - (17) |
| caichotié, ére, adj. celui qui fait le mystérieux, qui cache ses pensées et ses actions. - (08) |
| caichotte : cachette - (48) |
| caichotte : la cachette - (46) |
| caichotte, s. f. cachette. - (08) |
| caichotte. s. f. Cachotte. - (10) |
| caichotterie, s. f. chose qui se dit ou se fait en cachette. Faire des « caichotteries », dissimuler. - (08) |
| caich'ron : n. m. Petit tas de foin dans un pré. - (53) |
| caidémie. Académie. Quand on joint l'article à ce mot, et qu'on dit l’Académie, les ignorants, dont l'oreille est trompée, prennent Cadémie pour le substantif, et l’A pour l'article féminin la… - (01) |
| caidrin : récipient portatif à anse et à couvercle, en fer blanc, cylindrique, large mais peu haut. il servait en particulier à porter de la nourriture à un homme qui travaillant dans un champ éloigné, et qui ne revenait pas pour « goûter » - (37) |
| çaie, s. f. chaise, siège. - (08) |
| caîen. n. m. - Grosse bille. - (42) |
| caïfa n.m. (du nom d'une marque de café). Epicier, marchand ambulant. - (63) |
| caïffa, s. m., marchand ambulant qui passait de village en village avec une charrette à âne, pour vendre du café de la dite marque. - (40) |
| caïffa. n. m. - Petit épicier ambulant se déplaçant avec une charrette tirée par des chiens. (Arquian) Ce mot très récent, du XIXe siècle, est en réalité le nom d'une marque d'épicerie ambulante. Le cheval puis la voiture automobile permettaient les déplacements du marchand, connu également sous ce nom en Auvergne. - (42) |
| caige : Cage. « Ol a appris à sublier (siffler) à in miarle qu'ol a élevé en caige ». Au figuré : maison « Quand la caige est prôte l'ujau s'envole » : se dit quand le propriétaire d'une maison qu'il vient de faire construire disparait au moment où la maison commence à être habitable. - Prison, « Y est in cheti, o s'est fait mentre en caige, y est bien fait ! ». - (19) |
| caige, s. f. cage d'oiseau. - (08) |
| caige, sf. cage. - (17) |
| caige. Cage, cages. - (01) |
| caigne, s. f. chienne, terme injurieux adresse à une femme dans le sens de paresseuse ou même de prostituée. - (08) |
| caignets, sm. fatigue extrême des jambes, après une longue course. J’è les caignets. - (17) |
| caigni : Pleurer peu bruyamment, pleurnicher. « Qu'est ce que ce petiet a dan aré qu'o caigne c'ment cen ? ». - (19) |
| caijau : Estomac du veau que l'on met macérer dans du vin blanc pour fabriquer la présure. - (19) |
| cailâbe (n.m.) : cadavre - (50) |
| cailâbre, s. m. cadavre ; corps d'un être vivant ou mort. On dit d'un homme, d'un animal qu'il a un bon « cailâbre » lorsqu'il est fortement charpenté. - (08) |
| caile : enveloppe de fruit, écorce - (37) |
| caile d’pain : quignon de pain - (37) |
| cailer : renoncer, s’arrêter - (37) |
| caileuche, s. f. tronc d'arbre, souche sèche ou verte. - (08) |
| caille (n. f.) : jaune d'œuf (enne oeu à deux cailles) - (64) |
| caille : (Prononcez ké'lle, Il mouillées) Caille. On traduit ainsi le chant de la caille « carcara, bien du blié, pount de sa, on carcara, point d'taba ». - « Piarre à caille » : caillasse. - (19) |
| caîlle n.f. (de gaille, or. inc.) Vieille truie. - (63) |
| caille : s. f., chaille. caillou. « ... La pierre caille est particulièrement recherchée pour les routes... Cette pierre contient aussi beaucoup de chaux... » (G. Jeanton. Les Carrières de Lucrost, dans la Presse Louhannaise, 1908). - (20) |
| caille. n. f. - Personne drôle, amusante : « J'ons rencontré l'Martial, te parles d'une caille qu'c'est qu'ça ' ! I' nous a ben fait rie ! » - (42) |
| caille-mouillée. s. f. Personne douillette, qui se plaint toujours, à qui tout est contraire, à qui tout fait mal, et qui voudrait que tout le monde lui dit : Prenez bien garde, faites attention, soignez-vous bien. - (10) |
| caillenne. n. f. - Sorte de bonnet au fond plat, porté par les femmes. - (42) |
| caillenne. s. f. Béguin, sorte de coiffe des vieilles paysannes, dont le fond large et carré se compose de deux morceaux de toile entre lesquels on met une couche d’étoupes ou de ouate que l’on pique à très-petits carreaux pour lui donner de la consistance. - (10) |
| cailler : avoir froid, geler. - (31) |
| caillerotte (n.f.) : têtard - (50) |
| cailleton (ai), loc. a califourchon, jambe deçà, jambe delà. - (08) |
| cailli - trinchi : cailler - (57) |
| cailli (du) : caillé - (57) |
| cailli : (nm) lait caillé - (35) |
| cailli : (Prononcez ké'lli, Il mouillées) Lait caillé spontanément sans l'intervention de la présure. - (19) |
| cailli : cailler (le lait), caillé (lait fermenté pour les fromages) - (51) |
| cailli : lait caillé - (43) |
| cailli n.m. Lait caillé. - (63) |
| cailli : le caillé. (CH. T II) - S&L - (25) |
| cailli : s. m., lait caillé. - (20) |
| cailli, s. m., lait caillé : « J'ai migé, à c' maitin, du bon cailli ». - (14) |
| cailli. Lait caillé sans présure. On dit aussi du lait « tourné ». - (49) |
| cailliberdat. s. m. Composé de prunes cuites. Doit être une altération de caliberdoule, qui en effet signifierait prune chaude, prune cuite, de calidus, chaud, et de berdoule, petite prune noire. - (10) |
| caillis, lait caillé non égoutté. - (05) |
| caillon (on) - pouâ (on) : cochon - (57) |
| caîllon n.m. Porcelet. - (63) |
| caillon : s. m. cochon. - (21) |
| caillon, n.m. porc. - (65) |
| çaillot, s. m. charriot. - (08) |
| caillotte : petite pierre. - (09) |
| caillotte, s. f. petit caillou plat. - (08) |
| caillotte. s. f. Caillé, lait caillé. - (10) |
| caillottes. n. f. pl. - Jeu d'enfants où l'on secoue dans les mains jointes des petits cailloux dont on doit deviner le nombre. En ancien français, une caillete est une petite pierre, un chaillo est un caillou. - (42) |
| cailloutchouc. Caoutchouc. - (49) |
| cailloute, s.f. cahute de pierres couvertes en laves (dalles). - (38) |
| cailote, s. f. calotte, toute coiffure qui couvre la tête. - (08) |
| cailotte : coup donné sur la tête - (37) |
| cailotter : frapper sur la tête - (37) |
| caimairade (n.m. et f.) : camarade - (50) |
| caiman, au féminin caimandouse, mendiant, mendiante. Dans l'idiome breton, keaz ou kez signifie indigent, et mennout, demander (Le Gon.) : d'où le vieux français quémander. - (02) |
| caiman. Caimand, caiman, gueux, mendiant. - (01) |
| caimand, caimandouse. : (Dial. et pat.), mendiant et mendiante. Rac. lat. mendicare. La préposition cum qui précède le vocable annonce des mendiants réunis. - (06) |
| caimander. v. n. Mendier. Se dit par interversion de mendicare. - (10) |
| caïment. adv. - Quasiment. - (42) |
| caiment. adv. Quasi, quasiment, presque. - (10) |
| caimijole : camisole. ample sous-vêtement de femme en toile - (37) |
| caimion : n. m. Camion. - (53) |
| caimus, adj. camus. - (17) |
| cainainée. La Cananée... - (01) |
| cainair, s. m. canard, oiseau de basse-cour. — Bûche que le flottage des bois dépose le long des ruisseaux. Ces bûches sont appelées canards par assimilation. - (08) |
| cainaird (n.m.) : canard - (50) |
| cainard : n. m. Canard. - (53) |
| caine (n.f.) : cane - (50) |
| caine (nom féminin) : cane. - (47) |
| caine : cane - (48) |
| caine ; faire la caine n'a point de rapport avec ce que nous avons vu du mot cagnar ; il signifie souper et a les plus grands rapports soit avec le latin cœnare, soit avec le mot breton koan, repas du soir, et koana, souper. (Le Gon.) - (02) |
| caine, cainot - cane et le petit de la cane. - Ne me pairlez pâ d'élevai des cainots sans aie : ai ces bêtes lai en fau des ruchais, des étangs, des aifâre queman cequi. – Menez don vos caines ai lai rivére. - (18) |
| caine, s. f. cane, femelle du canard. - (08) |
| caineter (verbe) : marcher à la manière des canards. - (47) |
| caineter, v. n. marcher à la manière des cannes en se dandinant sur une jambe et sur l'autre. - (08) |
| caingne, sf. cagne, chien. Fare lai caingne, tuer le chien, faire le banquet de clôture des grands travaux. - (17) |
| caini, cain’zi : petit canard - (37) |
| cainmion, sm. camion. - (17) |
| cainn’paittes : caleçon à jambes longues - (37) |
| cainot (nom masculin) : canard. - (47) |
| cainot, cani : n. m. Caneton. - (53) |
| caïoute, sf. cahute. - (17) |
| caipâbe : capable - (48) |
| caipable (adj.m. et f.) : capable - (50) |
| caipâble, adj. des deux genres. capable, de bonne qualité, de belle forme. - (08) |
| caipe, sf. [coupeau]. faîte, cime. - (17) |
| caipète, sf. diminutif de caipe. - (17) |
| çaipiau (n.m.) : chapeau - (50) |
| caipirotade pour capilotade. : Déchirure en mille morceaux. - (06) |
| caipirotade, pour capilotade. Mettre en capilotade, c.-à-d. mettre en pièces. Les Picards disent capilloter, pour lutter corps à corps. Lacombe donne le vieux mot capilha comme signifiant culbuter, tomber la tête la première, in capite labi. - (02) |
| caiquelle : marmite en fonte - (37) |
| cairaico (n.m.) : corsage à manches et à basques pour les femmes - (50) |
| cairaico : caraco. vêtement de femme en laine - (37) |
| cairâme : céréale de printemps - (48) |
| cairâme : (kèrâ:m' - subst. m. pl.) céréales de printemps (orge et avoine). Par extension, désigne également l'orge d'hiver. - (45) |
| cairâmes, n. fém. plur. ; on dit aussi les carêmages ; ce sont les semailles faites en Carême ; se dit aussi des graines ; les Cairâmes sont belles. - (07) |
| cairç’elle : carcasse - (37) |
| caircaingne, caircan - rosse, cheval, poulet, et en général toute bête bien maigre. - Quoi que t'é don aichetai lai !... ma c'â ine veille caircaingne que ne pourré pâ moinme portai ses airnouâ. - Ile nos é servi in poulo pou sai fête ; ce n'éto qu'in vrai caircan que n'aivo que les os. - (18) |
| caircaisse : carcasse - (48) |
| caircasse, s. f. espèce de grue à l'usage des charpentiers, servant à charger et à décharger les pièces de bois. - (08) |
| caircelle : carcassen, dans le sens : ensemble du corps humain - (37) |
| cairchîné : calciné - (37) |
| cairder : carder - (48) |
| cairder : peiner - (48) |
| cairemantràn. Carême-prenant, carnaval, en quelques provinces carême-entrant, à Dijon cairemantran, et plus souvent en trois syllabes, cairmantran… - (01) |
| çaireugne (n.f.) : charogne - (50) |
| caireûille : coquille - (48) |
| cairiaige, charroi, et, au figuré, embarras... - (02) |
| cairiaige. Cariage, vieux mot qui proprment signifie charroi, Voiture, conduite de bagage par charriot, mais qui, au figuré, se prend dans le langage familier pout tout le tracas, toute la suite d'une affaire… - (01) |
| cairibandêne pour calybandène. : Du mot latin calyba, signifiant treille, et calybita, signifiant celui qui hante le cabaret. (Quich.) - En patois bourguignon cori lai cairibandène c'est courir les cabarets (voir au mot guairibandène). - (06) |
| çairimonie. Cérémonie, cérémonies. - (01) |
| cairmantran – carnaval ; lequel a lieu en entrant dans le carème. Ceux qui prennent part à ses amusements burlesques. - Voiqui le cairmantran qu'aipruche ; qué bèties en fait don !... – T'é vû les cairmantrans ? Oh qu'al étaint peut ! - (18) |
| cairmantran, carême entrant, jours qui précèdent le carême, et, par extension, personnes qui fêtent ces jours de folie en prenant divers déguisements. - (02) |
| cairmentran (n.m.) : les trois jours qui précèdent le mercredi des Cendres - (50) |
| cairmentran : (kêrmentran - subst. m.), nom des trois jours qui précèdent le mercredi des Cendres. (Cf. en français, Carême-prenant). - (45) |
| cair'mentran, s. m. syncope de carême-entrant pour carême-prenant. On appelle ainsi les trois jours qui précédent le mercredi des cendres. - (08) |
| cairnai, cairnais - loucher, regarder de travers, être de travers. - C'a gros demaige qu'à cairne ; al à vraiment bein po to le résse. - Tai roingée d'arbres n'a pâ tot ai fait régulière ; ile é l'air de cairnai in pecho ai droite - (18) |
| cairnaie (de) : travers (de), penché - (48) |
| cairnaige, s. m. carnage. S’emploie souvent en parlant des dégâts causés par les animaux. - (08) |
| cairnâval, s. m. carnaval, masque, personne masquée ou déguisée. S’habiller en « cairnâval », se déguiser, se couvrir de vêtements ridicules ou effrayants. - (08) |
| cairne (aine) : (une) carne (méchante bête) - (37) |
| cairne : carne, animal méchant - (48) |
| cairner : pencher - (48) |
| cairniau, carneau. s. m. Lucarne, soupirail. (Domecy-sur-le-Vault). - (10) |
| cairo : dernier né d'une famille. - (30) |
| cairöte, sf. carotte. - (17) |
| çairotte : une carotte - lè cairottes sont ceutes ! les carottes sont cuites ! (c'en est fait !) - (46) |
| cairpe, s. f. carpe, poisson d'eau douce. - (08) |
| cairpigner (s’) : (se) tirer les cheveux mutuellement - (37) |
| cairpigner : tirer les cheveux - (37) |
| cairpigner de lai lâne : « carder » de la laine avec des planchettes à pointes - (37) |
| cairron, n. masc. ; le coin du feu. - (07) |
| çairrotte (n.f.) : charrette (aussi çarratte) - (50) |
| çairrue (n.f.) : charrue - (50) |
| caisse (prononcez quesse) - poêle, ustensile de cuisine. - Fai aitention de ne pâ aitraipai lai quoue de lai caisse. - Le crépais n'é pas réussi, lai caisse n'éto pâ aissé graichée. - (18) |
| caisse, casse : n. f. Poêle à frire. - (53) |
| caissè, câssè : v. t. Casser. - (53) |
| caisse, sf. poêle à frire. - (17) |
| caisser : cacher - (39) |
| caissi, durci (pain). - (28) |
| caissi, ie, adj. se dit du pain compact et mal levé. - (17) |
| caissi, se dit en parlant d'un gâteau peu levé. - (27) |
| caissie, sf. poêlée. Crêpe ou omelette maigre. - (17) |
| caissô. : Poêlon. On qualifiait de traine-caissô le soldat inactif des garnisons. - (06) |
| caisson : matière agglomérée (par ex. paille moisie), grumeaux - (48) |
| caissot, cassot. Poêlon. - (49) |
| caissotte (n.f.) : cassette - (50) |
| caissotte : cachette - (39) |
| caissotte. : Religieuse nonain. (Del.)- Casse, du latin capsa, signifie reliquaire (voir Lacombe). - (06) |
| çaissû (n.m.) : chasseur - (50) |
| caitaistreuphe (n.m.) : catastrophe - (50) |
| caiton : noeud dans les cheveux dû au fait qu'ils sont collés - (46) |
| caive (n.f.) : cave - (50) |
| caiyé (du) : (du) lait caillé - (37) |
| çaiyô : adv. Sitôt. - (53) |
| cajatte. s. f. Cachette. (Mâlay-le- Vicomte). - (10) |
| cajiau. s. m. Présure. (Rugny). - (10) |
| cala : noix. A - B - (41) |
| càlâ (C.-d., Morv., Br., Chal., Char.), càlàt (Y.). - Noix, à cause de l'écale (brou de la noix), mot dérivé d'écaille. La partie a été prise ici pour le tout. Voir plus loin écale. - (15) |
| cala (noÿe) : noix - (51) |
| cala : noix - (34) |
| calâ : noix - (48) |
| cala : Noix, fruit du noyer (juglans regia). « Chaplier des cala » : gauler des noix. On dit d'une chose maladroitement faite, d'une œuvre qui ne tient pas debout : « Y est arrangi c'ment des calas su in batan ». - « Freugi c'ment quat'calas dans in sa » : se dit d'un enfant qui ne grandit pas - (19) |
| cala : noix. - (52) |
| calâ : voir talon - (23) |
| cala : noix. On f'to de l'huile quand les calats : on faisait de l'huile avec les noix. - (33) |
| calâ n.m. (du francique skala, coquille). Noix. - (63) |
| cala : s. m. noix. - (21) |
| cala : s. m., noix. Voir chaille. - (20) |
| calâ, colâr : n. f. Noix. - (53) |
| cala, essalon : noix - (36) |
| cala, noix. - (05) |
| cala, s. m. noix, le fruit du noyer : il y aura beaucoup de « calas » cette année. - (08) |
| cala, s. m., nois : « Vein-tu goûter ? J'avons des râïins, des calas, épi du vin blanc ». - (14) |
| calâ, s. m., noix. - (40) |
| cala, s.m. noix. - (38) |
| cala. Noix. - (49) |
| cala. Noix. Ce mot vient de ce qu'on écale les noix. - (03) |
| calâbe (n. m.) : cadavre, corps - (64) |
| calâbre, calâbe. n. m. - Ossature, constitution : « L'gamin il a eune bounne calabre pour soun âge. » tilisation imagée du mot calabre (d'origine obscure) désignant un battant de porte, en ancien français du XIIe siècle. On utilise une comparaison identique pour évoquer une personne bien « charpentée. » - (42) |
| calâbre. Type extravagant, extraordinaire, de peu de valeur morale. On dit : « y est un calâbre ». - (49) |
| calai : céder, abandonner la lutte. - (33) |
| calainge ou cailinge , en langue d'oïl calengier, réprimander, corriger, punir.Dans l'idiome breton, kelenna (Le Gon.) a le même sens... - (02) |
| calandot. s. m. Qui se dandine en marchant. (Rugny). - (10) |
| calaneu ou cananeû : Salsifis des prés (tragopogum pratense). La calaneu est comestible ; les gamins en croquent volontiers les jeunes pousses sans aucune préparation. - (19) |
| calaneue, calanoe : s. f., salsifis des prés (tragopogon pratensis). Dans la Bresse louhannaïse, la calaneue s'appelle carnabeau ; dans le Chalonnaîs. carbonade. Voir bibamboche et lait. - (20) |
| calaneux : salsifis sauvage. - (21) |
| calaplame, cataplasme. - (16) |
| calard. s. m. Celui qui n’est pas de parole, qui ne tient pas sa promesse. - (10) |
| calâs : noix - (37) |
| calâs : noix - (39) |
| calât : noix. Fruit à écaler. Du francique « skala » : écaille. - (62) |
| calât : une noix. - (56) |
| calat, n.m. noix. - (65) |
| calât, subst. masculin : noix. - (54) |
| calat. s. m. Noix. - (10) |
| calaté, s. m., noyer, vient sans doute de cala, noix, donné clans le Glossaire du Morvan, p. 140. - (11) |
| calâter : noyer. On dit aussi un nouer. - (62) |
| calâtier : noyer - (37) |
| calâtier : un noyer. - (56) |
| calatier : noyer (ou nouger). - (33) |
| calâtier, s. m., noyer planté et exploité. - (40) |
| calatier, subst. masculin : noyer. - (54) |
| calatier. s. m. Noyer. - (10) |
| calau, s. m. os d'animal dépouillé de chair, os en général. - (08) |
| câlaud : difforme - (37) |
| câlaud, adjectif qualificatif : irrégulier. - (54) |
| calaud. s. m. Câlin, flatteur. - (10) |
| calayé : noyer (cala : noix). (MM. T IV) - A - (25) |
| calâ'yé : noyer - (48) |
| calâyer - (39) |
| cal'beusi : adj. Étourdi. - (53) |
| cale (la), abri. - (05) |
| cale (n.f.) : bonnet d'étoffe que les femmes portaient sous la coiffe - (50) |
| câle : l'abri du vent - lè bise a fôtch, y vè m'mettre è lè câle, la bise est forte, je vais me mettre à l'abri - (46) |
| cale : (cal' - subst. f.) coiffe, bonnet de femme. - (45) |
| cale : adj., calé. - (20) |
| cale : s. f., abri. se mettre à la cale du vent. - (20) |
| câlé : v. t. Caler. - (53) |
| cale : voir pressoir. - (20) |
| cale, abri : se mettre à la cale est se mettre à l'abri du vent. Cale se dit aussi pour bonnet de femme. - (16) |
| calé, adj., à son aise, riche, à son affaire ; signifie aussi : beau, bien mis : « C'ment te v'là calé ! T'vas donc à la noce ? » - (14) |
| cale, bonnet de linge blanc ou noir dont se servaient les femmes pour se couvrir la tête pendant la nuit. - (27) |
| càle, càlòt (C.-d., Chal., Char., Y.), côle ou caule (Dij.). - Calot, masculin de calotte, désigne un petit bonnet, coiffure de bonne femme. Cunisset et Fertiault citent caler dans le sens de coiffer. On dit dans la Côte-d'Or : elle est mal calée, pour être mal coiffée, avoir son bonnet de travers. Littré parle de la cale, autrefois coiffure des filles et des grisettes. - (15) |
| calé, ée. adj . Riche, cossu, bien vêtu, bien habillé. — Maison calée , maison bien pourvue de linge et do mobilier, où rien ne manque de ce qui est nécessaire pour vivre confortablement. - (10) |
| cale, n.f. enveloppe de fruit ou de légume. - (65) |
| cale, s. f. , le brou de la nois qu'on enlève en écalant. - (14) |
| cale, s. f. bonnet d'étoffe que les femmes portent sous leur coiffe, bonnet de jeune enfant. - (08) |
| cale, s. f., bonnet porté sous la coiffe, ancienne coiffure de quelques vieilles femmes. Jadis « on appelait cale une fille de basse condition, à cause de la cale qui lui servait de coiffure ». - (14) |
| cale, s. f.. abri : « I pleùvo ; i m'seù métu à la cale ». - (14) |
| cale, sf. bonnet, coiffe. - (17) |
| cale, subst. féminin : enveloppe d'un fruit ou d'un légume. - (54) |
| cale, subst. féminin : gros morceau, quignon de pain. - (54) |
| cale, subst. féminin : planchette soigneusement découpée servant à allumer le feu. - (54) |
| calé, v. n. glisser. - (22) |
| cale. Coiffure de femme. En hiver, on la confectionnait avec de l'indienne piquée : les cales de nuit étaient en étoffes plus chaudes. Lai bise ast rude : y vâs mette mai cale de neut. Un calot est un diminutif de cale : les vieilles femmes s'en servent comme d'un bonnet de dessous. Les Jurassiens disent une câline. Le français a fait calotte. En langage vulgaire, une calotte est un coup donne avec la main sur cette partie de la tête où l'on ajuste la cale. - (13) |
| calé. : Beau. Bé ou mau calé, bien ou mal mis. Les villageois disent encore à ceux qu'ils voient en toilette : Vo veci ben recalai. - (06) |
| calebasser (Se). v . pron. Se troubler, se bouleverser, en parlant du temps. V’là le temps qui se calebasse. C’est une allusion à cette circonstance, que la calebasse, par sa forme, difficile à mettre d’aplomb, est sujette, à cause de cela, à se renverser, à faire la culbute. - (10) |
| calé-bé ou mau-calé, bien ou mal mis... - (02) |
| calebourbe : lampe. (BD. T III) - VdS - (25) |
| calemande, s. f. étoffe de laine à grosses rayures tissée autrefois dans le pays et jadis très en vogue. - (08) |
| calembeurdaine : propos peu sérieux - (39) |
| calembeurdon. s. m. Mets composé d’un mélange de fromage, de beurre et de farine délayé dans du lait. (Percey). - (10) |
| calenbredaine. Ce mot, avec cairibandène et pretentaille sont trois synonymes... - (02) |
| calenchetelle. n. f. - Plaisanterie lourde. (M. Jossier, p.24) - (42) |
| calenchetelle. s. f. Plaisanterie ; bourde, conte pour rire. (Puysaie). —L’abbé Corblet donne calenger, chicaner, tromper dans un marché ; du bas latin calengia, et du roman chalenger. - (10) |
| calendot. s. m. Nonchalant. (Rebourseaux). De calender, perdre son temps à des balivernes. — Voyez calandot. - (10) |
| calénée. s. f. Sarbacane. (Sénonais). - (10) |
| calener (n.m.) : noyer (arbre) - (50) |
| câler – carrochi : lancer (jeter) - (57) |
| caler : caler, céder, abandonner - (48) |
| caler : céder - (44) |
| caler : céder, abandonner la lutte. - (52) |
| caler : même sens qu'en français mais signifie parfois céder, s' avouer vaincu - (39) |
| caler, calcher : vx fr. chauchier, v. n., marcher, avancer, glisser. Un gamin s'amusant à faire des ricochets sur Saône, dit à son camarade : Tiens. Vis’- moi c'te pierre ; ell' va rien calchi - (20) |
| caler, céder à. - (04) |
| caler, v. a. coiffer, mettre un bonnet, une cale sur la tête. - (08) |
| caler, v. glisser. - (65) |
| caler, v. n. glisser : j'ai calé sur la glace, ou dans la boue. - (24) |
| caler, v. n. reculer, céder par crainte, faiblir. - (08) |
| caler, v. tr., coiffer, mettre une cale : « Eh! ma pauv' Jeannette, coume te v'là brave ! T’é, ma fi ! jouliment càlée ! » - (14) |
| caler, verbe transitif : rassasier. - (54) |
| caler. Coiffer, mettre une cale (Littré). - (12) |
| caler. v. a . Coiffer, couvrir la tête d’un bonnet, d’une cale. — Se caler. v. pron. Se coiffer. — Femme mal calée, femme mal peignée, mal coiffée. - (10) |
| caler. v. n. Se désister, reculer, ne pas oser, se cacher, se taire quand il faudrait parler. - (10) |
| calètse n.f. Calèche. - (63) |
| caleu, noix. - (27) |
| caleufre : Ecaflote, peau des légumes qui reste dans la passoire. On dit aussi « Eune caleufre de raijin » : la peau d'un grain de raisin. - (19) |
| caleûrette n.f. Femme curieuse, toujours à guetter à son caleûron. - (63) |
| caleûron : (nm) trou dans un mur, lucarne - (35) |
| caleûron n.m. 1. Petite fenêtre, lucarne, soupirail. 2. Curieux, guettant à sa fenêtre. - (63) |
| caleute : Calotte. « Le mait'd'école no fare mantre nu-tête mâ o garde sa caleute ». « La caleute » le parti clérical. - Soufflet : « Fous li dan eune caleute, si o ne te la rends pas je te la rendra ». - (19) |
| caleuter (verbe) : Gifler, calotter, « O s'est fait caleuter ». - Cuiter, enivrer, « Ol a bu quéques vârres de vin, peu la goutte, y l'a caleuté ». - (19) |
| caleutin : Clérical. Se prend en mauvaise part. - (19) |
| calève : la noix. (CST. T II) - D - (25) |
| calibeurdaine, s. f. calembredaine, grosse plaisanterie, conte en l'air, propos plaisant ou burlesque. La « calibeurdaine » a été chez nous, ce semble, une danse un peu échevelée du bon vieux temps. - (08) |
| calibeurdaine, s. f., calembredaine. - (14) |
| calibo, châtaigne d'eau. - (16) |
| calibo. Châtaigne d'eau. Dans quelques lieux on les appelle cabasse. - (03) |
| caliborgnat, borgne. - (28) |
| caliborgnot et caliborgnon, adj., borgne, louche, qui a la vue basse. - (14) |
| caliborgnotte : maison mal tenue. (B. T IV) - Y - (25) |
| calibot - salsifis des prés, dont les enfants aiment manger les tiges jeunes. - Veins don aivou mouai dan lai prée chercher du calibot. - Calibot, te n'é pâ sot… - (18) |
| calibot (n.m.) : alsifis sauvage - (50) |
| calibot, corps dur comme mâcre. - (05) |
| calibot, s. m. salsifis sauvage, barbe de bouc. - (08) |
| calicot : Commis de nouveauté. « Ol a mairié sa fille d'ave in mossieu qu'est dans le commerce. - Ah oué, d'ave in cheti calicot ». - (19) |
| califeriot. s. m. Enveloppe de la châtaigne. - (10) |
| câlin, celui qui flatte pour obtenir ce qu'il désire ou pour plaire. - (16) |
| calin, noix. - (26) |
| câline, s. f,, bonnet de femme noué sous le menton. - (14) |
| câline. s. f. Bonnet plat, tout uni. - (10) |
| calingé, calangé. : (Pat.), chalongier et calangier (dial.), ce qui rapproche davantage le mot du latin calumniare, contester, disputer, reprendre quelqu'un. - (06) |
| calire, s. f. glissade sur la glace. - (24) |
| callanché : v. i. Mourir. - (53) |
| callât (on) - robignolles (des) - claouis (des) - glaouis (des) : testicule - (57) |
| calle, et calot - coiffe de femme très simple. - Lai mère Catiche, d'aivou sai calle noire, n'a pâ peute, vais, lai pôre vieille. - En me faut métenant in calo sô mai coiffe. - (18) |
| calle, s. f . , choc d'une bille contre une autre, dans le jeu des écoliers. - (14) |
| callope : épluchures de pommes de terre pour les lapins - (61) |
| callots : yeux. Vient certainement du même nom des grosses billes en verres. - (62) |
| calo : noix. - (29) |
| calô : os - (48) |
| calô, noix ; d'où calôlei, noyer... Décaloter ou échaler des noix se dit, dans le Châtillonnais, pour exprimer qu'on sépare le fruit de son brou... - (02) |
| calo, noix et petit bonnet de femme qui se met sous la cale. - (16) |
| calo, noix. - (28) |
| calô, s. m., grosse bille en terre cuite. - (40) |
| calo. Coiffe; tiré de cale, vieux mot. Bonnet qui couvre les oreilles et est aplati par devant, dit le Dictionnaire de Trévoux. - (03) |
| calo. Œil. S'emploie au singulier et au pluriel. - (49) |
| calo. s. m. Esclave, mercenaire, homme accablé par la peine, le travail, la misère. — Por'Calo, pauvre homme. Por'Calate, pauvre femme. (Plessis-Saint-Jean). — Du latin calo et du grec câlon, qui ont l’un et l’autre la même signification. - (10) |
| calô. : Noix, etcalôtei, noyer. (Del.)- Ce nom vient du brou ou écale, partie enveloppante du fruit. Aussi dit-on échaillai et ailleurs challer (comte Jaubert) des noix, de même qu'on appelle échalas les perches servant à les abattre. - On dit échaller les coques dures, comme on dit écosser les enveloppes tendres, les cosses de pois, par exemple. - (06) |
| calœte, s. f. glissade sur la glace. Verbe calté. - (22) |
| calofe : cosse des haricots, des petits pois. - (52) |
| calofe n.f. (de skala, coquille). Enveloppe des châtaignes et des noix. Voir calâ. On dit aussi les bolons. - (63) |
| calofe, s.f. peau du haricot, de la fève, etc... - (38) |
| caloffe (n.f.) : enveloppe des légumes et de certains fruits (châtaignes, noix) - (50) |
| caloffe : (nf) écale de noix - (35) |
| caloffe : enveloppe de noix - (44) |
| caloffe : enveloppe des châtaignes, noix, noisettes. - (30) |
| caloffe, s. f. enveloppe des pois, des légumes secs en général. Se dit aussi du brou des noix. - (08) |
| caloffe, s. f., cuticule non consommable d'un fruit ou d' une graine. - (40) |
| caloffe. Enveloppe de certains fruits : « in-ne caloffe de châtigne ». - (49) |
| calogné, canonnier. - (16) |
| caloire : s. f., glissoire - (20) |
| calon (n. m.) : noix - (64) |
| calon (n.m.) : noix (Nivernais) - cala (n.m.) noix (Morvan) - (50) |
| calon : noix. (P. T IV) - Y - (25) |
| calon : noix. IV, p. 21-5 - (23) |
| calon jauge. n. m. - Grosse noix. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| calon, s. m. noix. - (22) |
| calon. n. m. - Noix. - (42) |
| calon. s. m. Noix dans son brou, dans son écale. - (10) |
| calonier (n. m.) : noyer - (64) |
| calonier, s. m., canonnier. - (14) |
| calonîre n.f. (dérivé du lat. callem, le sentier). Drain, conduit, rigole de drainage. - (63) |
| calonnier, calognier, calounier. s. m. Noyer, arbre aux calons. - (10) |
| calonnier, calounier, calognier. n. m. - Noyer. - (42) |
| calorgne, caliborgne. s. m. et adj. Borgne, louche, qui voit de travers, qui voit mal. - (10) |
| calôs : os - (39) |
| calot (n. m.) : sorte de grande jatte en terre cuite - (64) |
| calot (un) : une noix - (61) |
| calot : béret - (51) |
| calot : Coiffure de femme, bonnet de linge avec brides nouées sous le menton ; le calot, qui cache les oreilles et le chignon, est froncé par derrière et orné par devant d'une bande tuyautée ou d'une dentelle. Le calot n'est plus en usage depuis la guerre. - (19) |
| calot : mot masculin désignant une noix - (46) |
| calot et ecalas. Nom patois de la noix (V. Echoler). - (13) |
| calot : s. m., bonnet de paysanne. - (20) |
| calot, adj., câlin, caressant : « Ce p'tiot, ôl é calot ç'ment tout ». - (14) |
| calot, borgne. - (11) |
| calot, et calotté - noix et noyer. - En i é tré-bein de calots c't-année. - Al é choué en baitant in calotté. - (18) |
| calot, s. m. serre-tête en toile ou en étoffe de soie. Dans quelques lieux le « calot » est l'enveloppe des grains, du sarrasin notamment. - (08) |
| calot, s. m., bonnet de femme, coiffe à barbes tombantes. - (14) |
| calot, s.m. bonnet blanc en lin ou tulle, garni ou non de dentelles. - (38) |
| calöt, sm. noix. Qqfois noyer. - (17) |
| calot, subst. masculin : béret en général. - (54) |
| calot, subst. masculin : œil. - (54) |
| calot. s. m. Grosse bille de bois. (Armeau). - (10) |
| calot. s. m. Petit bonnet, coiffe de bonne femme. - (10) |
| calöte, caillöte, sf. calotte. - (17) |
| caloteil : un noyer - y éllons greûlè l'caloteil, nous allons secouer le noyer - (46) |
| calots : les yeux - (44) |
| calotte (n.f.) : giffle - (50) |
| calotte : gifle. Et donc « calotter » pour gifler. - (62) |
| calotte, n.m. rotule. - (65) |
| calotte. n. f. - Petite écuelle creuse en grès, dans laquelle on servait la soupe. - (42) |
| calotte. s. f. Petite écuelle. Il y a une forte ressemblance entre ce mot, calotte, et calatte, qui veut dire jatte, du latin calathus ; cependant il pourrait se faire que ce genre d’écuelle fût appelé ainsi à cause de sa ressemblance avec la petite calotte des ecclésiastiques. (Merry-la-Vallée). - (10) |
| calotter (un capucin) : tuer un lièvre. - (66) |
| calou : poltron - (60) |
| calou, adj., qui cale, poltron, capon. - (14) |
| calou, ouse, adj. et s. celui qui cale, qui met les pouces ; capon, poltron. - (08) |
| calouche. adj . Qui a l’habitude de fermer un œil pour regarder. - (10) |
| caloue (faire la). n. f. - Poule malade, dos rond et ailes basses. Au fig : personne voûtée, triste, pas dans son état normal : « La Jacqueline ça va pas, alle est en train d'jai'e la caloue pa' la cour ! » - (42) |
| caloue (n. f.) : attitude de prostration, d'abattement, qu'on observe chez un malade (fée la caloue) - (64) |
| caloue. s. f. Volaille malade, qui laisse tomber ses plumes. (Sommecaise). - (10) |
| calougnier : noyer. IV, p. 21-5 - (23) |
| calougnier. s. m. canonnier. — Bois noir dont on fiait le charbon pour la poudre à canon. (Andryes). - (10) |
| calouner. v. a. Jeter des pierres, lancer des projectiles quelconques. Voyez acalouner. - (10) |
| calounier : noyer - son fruit : la noix, est le calon. - (58) |
| caloux : s. m., glisseur. - (20) |
| caluchon. s. m. Petit bonnet, petite cale. (Plessis-Saint-Jean). - (10) |
| calvanier, calvarnier, cavarnier, cavernier. s. m. Valet de ferme, berger, laboureur, batteur en grange. - (10) |
| calvarnier : domestique de ferme. (DC. T IV) - Y - (25) |
| camâ : Epaté. « O a le nez camâ », « Des sabeuts camâs » : des sabots dont l'extrémité antérieure est large au lieu d'être pointue. - (19) |
| camasse. adj. Sournois. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| cambe : Combe, petite vallée, dépression de terrain. Nom de lieu : « La cambe de Vau ». - (19) |
| cambert : fruit de l'églantier. - (30) |
| cambeûle : une cloque, la boursouflure provoquée par une piqûre d'insecte - (46) |
| cambeûle ou cambélle : cornouille. (CST. T II) - D - (25) |
| cambeule ou cambole. Ampoule. - (12) |
| cambeule, bosse par piqûre d'insecte. - (26) |
| cambeûle, cambôle, tumeur provenant d'un coup reçu, d'une piqûre d'insecte. - (16) |
| cambeule, cloque causée par la piqûre d'un insecte. - (27) |
| cambeûlèye ou cambéllèye : cornouiller. (CST. T II) - D - (25) |
| çambière (n.f.) : servante ; femme de chambre - (50) |
| cambillot - morceau de bois tout tordu, inutile. - Quoi que te veu qui faisâ aivou in cambillot peireil ? - Ote tai don, teins ! chien de cambillot que t'ée ! - (18) |
| camblian : Partie du contenu d'un vase qui en dépasse les bords. « O fa des ras qu'ant de bans camblians » : il remplit les bennes plus haut que les bords. - (19) |
| camblier : Donner plus que le compte. « Si o n'est pas cantant, ce qu'ol a l'habitude de me camblier o m'y radera » : s'il n'est pas content, il ne me donnera que mon compte au lieu de me faire bonne mesure comme il en a l'habitude. Voir rader. - (19) |
| cambôle – enflure causée par une contusion quelconque. - A s'é encore fait bein mau, vais ; voiqui ine cambôle ! - Ine cambôle ! a geingne pu que ci ne fait mau. - (18) |
| cambôle (n.f.) : ampoule, cloque (aussi camboule) - ampoule qui vient sur le corps après des coups ou des brûlures - (50) |
| cambôle : n. m. Bouton, enflure provoqué par piqûre ou par ortie. - (53) |
| cambôle, ampoule, élevure... - (02) |
| cambole, s. f., enflure causée par contusion, ampoule qui se forme sur le corps. - (14) |
| cambôle, s. f., enflure cuisante et donnant une ampoule (aux pieds ou aux mains). - (40) |
| cambôle. - Ampoule, élevure. Le mot patois caibossai, se disait cambouler dans le dialecte et signifiait bossuer, en s'appliquant plus particulièrement à la vaisselle. - (06) |
| cambôle. Elevure causée par quelques contusions… - (01) |
| cambolle - bâton recourbé en forme de crosse à sa partie intérieure pour jouer aux boules, aux balles. - Les patons jouaint ai lai treue, et en passant un m'é aitraipai aivou sai cambolle. - (18) |
| cambosse, camboule : enflure suite à une piqûre d'insecte - (48) |
| cambosser : faire des bosses. - (31) |
| cambosser, v. n. faire des bosses, bossuer. - (08) |
| cambosser. Meurtrir la tête. On prononce à Chalon cabosser, comme qui dirait bossuer le chef. - (03) |
| cambou : Cambouis. « T'as mis du cambou après ta culotte » : ton pantalon est taché de cambouis. - (19) |
| cambouais (du) : cambouis - (57) |
| cambouis. Graisse qui s'est noircie dans les rouages d'une voiture ou d'une machine. Littéralement : boue de cheminée, du latin caminus. La vieille locution bailler du cambouis, signifiait tromper quelqu'un, se moquer de quelqu'un, comme on le voit dans « La farce du meunier de qui le diable emporte l'âme : » - Ah, très-orde vieille truande, - Vous me baillez du cambouys. - (13) |
| camboule : ampoule, enflure provoquée par une piqûre d'insecte ou le maniement d'un outil. - (52) |
| camboule : petite enflure - (60) |
| camboule : enflure provoquée par une piqûre d'insecte, ou après une partie de chasse faire la camboule : manger les foies du gros gibier. - (33) |
| camboule : ampoule dans une main - (39) |
| camboule, ampoule - (36) |
| camboule, s. f. omelette au sang de lièvre ou de tout autre animal ; omelette au sang en général. - (08) |
| camboule, subst. féminin : bouton, ampoule, cloque. - (54) |
| cambré, position droite et raide. Les paysans de Bourgogne appellent arbre mau-cambré (mal cambré) un arbre dont le tronc est bossu. Ils donnent aussi ce nom à certains amas de nuages blanchâtres simulant les ramifications d'un arbre et pronostiquant la pluie. - (02) |
| cambré. : (Dial.), voûté comme certains édifices (du latin camera). Les villageois appellent mau cambré un arbre dont le tronc est bossu. - (06) |
| cambron, s. m. cambouis. - (24) |
| cambrouche. s. m. Homme très-grand, très-fort. — Se dit aussi de celui qui traîne la jambe en marchant. (Rugny). - (10) |
| cambrouse, s. f. dépouille d'un animal tué et particulièrement du gibier. La « cambrouse » d'un sanglier, d'un chevreuil. - (08) |
| cameau. s. m. Souche à grosse tète. (Armeau). - (10) |
| camer (se) : se cacher, passer inaperçu. A - B - (41) |
| câmer (se) : se blottir - (35) |
| camer (se) : se blottir, s'abriter. - (30) |
| camer (se) v. (or. inc.). Se cacher. Voir musser. - (63) |
| camer (se). Se tapir ; se cacher en se rapetissant. On dit encore : « se capir ». - (49) |
| camias. s. m. pl. Manières de parler et de regarder qui semblent dire aux gens : Tenez-vous à distance. — Faire des camias, se donner de grands airs, faire l’homme important. — Faiseur de camias, faiseur de manières, faiseur d’embarras. - (10) |
| camillée. s. f. Ecuelle d’eau, plante aquatique. (Coulours). - (10) |
| caminâ (on) : travailleur de force - (57) |
| caminer (se) : se cacher, passer inaperçu - (43) |
| caminer : travailler dur - (57) |
| camiouler : gémir (pour un chien) - (57) |
| cammer (se) : se cacher, passer inaperçu - (34) |
| camou. s. m Gros tison. Voyez cameau. — Joubert donne camochon, qui, évidemment, doit avoir la même origine. (Perrigny-lès- Auxerre). - (10) |
| camouar, s. m. camard, celui qui a le nez écrasé, au figuré : sournois, hypocrite, traître. - (08) |
| camoufle, s. f., lumignon ou lanterne à bougie. - (40) |
| camouin : caractère renfermé - (39) |
| çamp (n.m.) : champ - (50) |
| campagne : s. f., maison de campagne. j'ai une campagne dans les bas de Leynes (sans calembour). - (20) |
| campai - camper, avec tous les sens de ce mot français. Ne citons ici que celui de bien habillé. - Eh bein, nô voiqui campai queman qu'an fau pou l'hyver. - Là, mon gairson, culotte, juperonde et soulé neu, te voilai campai ; te peux ailai aivou les autes. - (18) |
| campai. Campé, placé avantageusement : c’est aussi l’infinitif camper, poster. - (01) |
| campaignie : Compagnie, réunion de personnes ou d'animaux. « Eune campaignie de chaichoux, eune campaignie de padrix ». - Formules de salutation « Banjo la campaignie » : bonjour à tous. « Bansa la campaignie » : bonsoir à tous. On disait autrefois : « banjo (ou bansa) teurto peu la campaignie ». « Padre sa campaignie » : perdre sa femme ou son mari. « Alle ne se plieu dépeu qu 'elle a pardu sa campaignie » : on ne la voie plus depuis qu'elle est veuve. - (19) |
| campaîn’ne : cloche au cou des bêtes. Le nom vient du latin campana : cloche. On dit aussi sonnaille ou clarine. - (62) |
| campaine (en), loc. au dehors, en voyage. Être en campagne, c'est n'être pas chez soi ; aller on campagne, c'est partir pour une excursion, pour un voyage. - (08) |
| campaine, adj ,bigotte, dévote exagérée : « Eh ! lass'-me donc ; y ét eùne vieille campaine, qui quitte son chez eus po d'meurer dans les églises ». - (14) |
| campaine, campeune. s. f. Clochette qu’on suspend au cou des béliers. Du latin campana. - (10) |
| campaine, clochette de bestiaux. - (05) |
| campaine, n.f. petite cloche. Désigne surtout les cloches pendues au cou des ruminants et, ensuite de façon plus imagée des fleurs qui ressemblent à une cloche (jonquille, liseron des haies, fritillaire pintade). - (65) |
| campaine, s. f. campane, clochette qu'on attache au cou des animaux lorsqu'ils vont dans les bois ou aux champs. - (08) |
| campaine, s. f., cloche, clochette que ‘Ion suspent au cou des vaches et qu'elles font tinter en marchant. - (14) |
| campaine. Clochette qu'on met au cou des vaches, des vieux mots campane et campanelle, dérivés du latin campana. - (03) |
| campaiñne n.f. Cloche fixée au cou des vaches pour détecter leur présence. - (63) |
| campane : s. f., vx fr., cloche qu'on met au cou des bestiaux en pâturage. - (20) |
| campane, cloche (campana), campène. - (04) |
| campe (être tout), loc. etre raide et immobile. - (22) |
| campe. n. f. - Posture, attitude. Tenir bonne campe, être sérieux ; dans son travail, ne pas se laisser impressionner ou divertir par quoi que ce soit. - (42) |
| campe. s. f. Posture, assiette, attitude ferme.— Tenir bonne campe, être assidu, tenir pied à son ouvrage, ne pas se laisser déranger, détourner par quoi que ce soit. De camper. - (10) |
| campène (C.-d., Br.), campaine (Y., Morv., Chal.), campenne (Y.). - Clochette suspendue au cou du bétail ; de campana, cloche. En vieux français on disait même campane ; le français actuel a campanile. - (15) |
| campène : une vieille bavarde - çà eune veille campène, c'est une vieille bavarde - (46) |
| campène : (Dial. et pat.), religieuse dévote, du latin campana, cloche, parce que les religieuses règlent toutes leurs pratiques quotidiennes sur l'appel de la cloche. - (06) |
| campène, bigotte. Du latin campana, cloche, parce que les dévots vont à toutes les messes. - (02) |
| campéne. Bigotte et aussi religieuse, parce que les gens du monde traitent de bigottes toutes les religieuses… - (01) |
| campenne. Cloche, plus souvent clochette ; au figure femme bavarde, dont la langue va comme un battant de sonnette. Autre sens figuré, bigotte ; sans doute à cause des religieuses dont tous les exercices sont régis au son de la clochette. Etym. campana latin, cloche. - (12) |
| camper. v. a. Appliquer, flanquer, jeter, lancer. Son cheval l’a campé par terre. Je lui ai campé un soufflet sur le nez. — Se camper, v . pronom. Se poser, se mettre. Je me suis campé devant lui. Il s'est enfin campé à l’ouvrage. - (10) |
| campet. Individu de petite taille, principalement à jambes courtes. - (49) |
| campeune - clochette qu'on attache au cou des vaches, du bétail en général. - Ine campeune c'â bein utile pâ ran que dan les bôs, dan les prai aito. - (18) |
| campeune (n.f.) : clochette - (50) |
| campeûne : clochette au cou des vaches, signifie aussi une vieille vache. Les vèches étin des campeunes : les vaches étaient des vieilles vaches. - (33) |
| campeune : (can:peun' - subst. f.) cloche qu'on accroche au cou des animaux pour éviter de les perdre. Cette cloche était en tôle, et son battant formé d'un clou de fer à cheval. Au figuré : bagout. - (45) |
| campeune : insulte utilisée dans l'expression « vieille campeune » (vieille cloche) - (39) |
| campeune, s. f. cloche, clochette. - (08) |
| campeurnate : Intelligence, compréhension. « Je campends ren à ct'affâre », « T'as dan guère de campeurnate » - (19) |
| campigneulée, grosse quantité. - (26) |
| campin, qui ne marche pas droit. Dans l'idiome breton, kam signifie courbe, et penn tête. (Le Gon.) - (02) |
| campin, s, et adj., qui marche de travers, boiteus, bancal (comme une campaine, qui oscille pour sonner). - (14) |
| campin. : Qui ne marche pas droit. (Del.) Dans l'idiome breton, kampen signifie tête courbée. - (06) |
| campinhne : clochette placée sur le collier du cheval du meunier et annonçant son arrivée. A - B - (41) |
| campin-ne (na) : cloche (de vache) - (57) |
| campin-ne, s. f., sonnaille ou grelots. - (40) |
| campin-ne, s.f. prononcer cam-pin-ne. Faire la campin-ne ; se dit du raisin lorsque les graines commencent à grossir et que la grappe sous le poids se courbe vers la terre ; de "canpaine", petite cloche. - (38) |
| campo. Congé, liberté, parce que les écoliers vont « ad campos » quand ils ont congé… - (01) |
| campoin : petite quantité (voir : miotte). On lécho un campoin dans certains endroits : on laisse une petite quantité dans certains endroits. - (33) |
| camp-volant : bohémien. - (62) |
| camp-volant : nomade, bohémien - (37) |
| campvolant : nomade, bohémien, romanichel - (48) |
| camp-volant, n.m. nomade. - (65) |
| camp-volant, s. m., nomade, gitan, vagabond. - (40) |
| camp-volant, subst. masculin : bohémien, nomade. - (54) |
| Camu, nom de bœuf. Ce nom est-il tiré de la forme du nez ou de la direction des cornes sur la tête de l'animal ? - (08) |
| çan : (dém.) ça - (35) |
| çan : ça - (43) |
| çan minhne : (exp) ce qui est à moi - (35) |
| çan min-ne : ce qui est à moi - (43) |
| çan miñne, çan tiñne, çan lu ou çan li, çan nôte, çan vôte, - (63) |
| can ot, caneton, petit canard. - (05) |
| can otter, marcher comme les canards. - (05) |
| çan pron. dém. Cela, ça. - (63) |
| çan yeu pron. poss. le mien, le tien, le sien ou la sienne, le nôtre, le vôtre, le leur. Au pluriel il serait logique d'ajouter un s terminal. - (63) |
| çan, p. dém., ce, cela, toujours uni aus pr. poss. mien, tien, sien, en sous-entendant qui est. Çan mien, çan tien, çan sien, çan not', çan vot', çan leur : ce qui est à moi, à toi, à lui, à nous, à vous, à eus. « J'ai pris çan mien ; t'as çan tien ; ôl emporte çan sien ». - (14) |
| can’çon (on) : caleçon - (57) |
| can’çon. n. m. - Caleçon. - (42) |
| canâ (on) : canard - (57) |
| canâ : Canal, fossé pour l'écoulement des eaux. - Canard, « Plieumer in canâ » : plumer un canard. - (19) |
| cana : canard - (43) |
| canâ : le canard - (46) |
| cana’ : canard. Syncope (classique) de canard. - (62) |
| canadâ : perche soleil. Parce que ce poisson est originaire d’Amérique du Nord. - (62) |
| canai (se). : Se heurter contre un obstacle qu'on ne voit pas, contre un angle, contre la carne ou les carneaux (Nicot) d'une muraille, par exemple. - (06) |
| canai, heurter, rencontrer une carne ou un angle. Par une singulière extension , l'on dit qu'un individu est canné (Châtillon) quand il ne regarde pas droit devant lui ou quand il louche. - (02) |
| canaille. f. s. Marmaille, bande de petits enfants, de gamins turbulents et criards. — Littéralement parlant, troupe de petits chiens. - (10) |
| canaillon (on) : rafle (maïs) - (57) |
| canaillon, canaillou. s. m. Terme injurieux. Canaille, personne malhonnête et méprisable. - (10) |
| canaird : canard - (48) |
| canalou : marinier - (44) |
| canalou, subst. masculin : marinier du Canal du Centre. - (54) |
| canalous. Mariniers d'eau douce. Fém. « Canalouse ». - (49) |
| canard, bois submergé. - (04) |
| canard. Porte-eau attaché à la chaîne d'un puits, à fermeture à ressort. - (49) |
| canard. s. m. Bois de flottage tombé au fond de l'eau. - (10) |
| canardouée. n. f. - Fusil de chasse. - (42) |
| canasson. Vieux cheval. Fig. Cheval de peu de valeur. - (49) |
| canau: (nm) caneton (« mon pt'iet canau ») - (35) |
| canbrenöte, sf. cabine ; maisonnette ; petite chambre ; hutte. - (17) |
| cancaillot : voir sauteriau - (23) |
| cancan, s. m., canard : « Hé! p'tiot, vois les cancans qui vont boire ». - (14) |
| cancanai : parler, médire. Les laveuses cancanin : les laveuses parlaient. - (33) |
| cancaner : parler, médire (rapprocher de cancan) - (48) |
| cance. - Voir : Quance. - (15) |
| cance. Semblant. Al ai fait cance d'aillemer sai pipe, mâ i crois ben qu’a voulot mette le feu ai note meule de peille. - (13) |
| cancline : mouche jaune qui vit sous la queue des bovins. (C. T IV) - S&L - (25) |
| cancoaille, sf. hanneton. - (17) |
| cancoelle, hanneton. - (04) |
| cancoéne : hanneton - (44) |
| cancoêne, s. f., hanneton, - (40) |
| cancoillotte. Préparation nationale faite avec du fromage blanc séché, fermenté et fondu dans du beurre. Le pays d'origine de la cancoillotte semble être l’est du département, le canton de Selongey, peut-être la Haute-Saône. - (12) |
| cancoin, anémone des montagnes. - (16) |
| cancoin, s. m., lent. - (40) |
| cancoin. C'est l'ancien nom du hanneton . Au Moyen-âge on exorcisait les écrivains et les cancouanes. Les enfants de Beaune disent cancoise : Tâchons don voi de grouler (secouer) les tios (tilleuls) pour fare choué (choir) les cancoises... - (13) |
| Cancoin. Nom d’un marchand drapier de Dijon, si gros, pendant un certain temps, et si pesant, qu’il en avait peine à marcher… - (01) |
| cancoine : hanneton. (RDM. T IV) - B - (25) |
| cancoine, cancoirne, cancouire : s. f., vx fr. cancoile, hanneton : personne cancanière, indiscrète et maligne. On rencontre beaucoup de cancouires aux abords des sacristies. - (20) |
| cancoine, hanneton. - (16) |
| cancoine, n.f. hanneton. - (65) |
| cancoingné, vn. faire des cancans. - (17) |
| cancoire et cancouelle. : Hanneton. - (06) |
| cancoire ou cancoirne. Hanneton. - (03) |
| cancoirne (n.f.) : hanneton (aussi cancouélle) - (50) |
| cancoirne : hanneton. - (62) |
| cancoirne : Hanneton. « Fare in melin de cancoirne », passe-temps enfantin des plus cruels ; il consiste à briser des pattes du hanneton et à fixer dans le moignon une grosse épingle qui devient une sorte de pivot autour duquel le malheureux insecte qui cherche à s'envoler tourne comme les ailes d'un moulin à vent. - (19) |
| cancoirne : voir cancouelle - (23) |
| cancoirne, s. f. hanneton. - (08) |
| cancoirne, s. f., hanneton. Dans la saison, les gamins en ramassent par tas, par sacs, et s'amusent parfois, le soir, à en jeter plein les boutiques. - (14) |
| cancoirne, s.f. hanneton. - (38) |
| cancoirre (C.-d., Br., Char.), cancoirne (Morv., Chal.), cancouelle (Morv.), cancouenne (Y.). - Hanneton, probablement de cancer (écrevisse), à cause des pinces du hanneton. - (15) |
| cancoiyote, fromage fondu. - (16) |
| çançon (n.f.) : chanson - (50) |
| cancorne : hanneton. - (29) |
| cancorne, cancoine, cancoille (ll non mouillées), cancouenne, cancouelle. Le hanneton. Au figuré on appelle cancoine une personne étourdie. Etym. hanneton vient de antenna. - (12) |
| cancouâgne – hanneton. – Tein, Tiennot mon anfant, aibuye tai ai fâre vôlai ceute cancouâgne qui. - Vôle, vôle, mai cancouâgne jeuque é nuages… - (18) |
| cancouaile : hanneton - (37) |
| cancouane (nom féminin) : hanneton. - (47) |
| cancouâne : n. m. Hanneton. - (53) |
| cancouanne : hanneton. - (30) |
| cancouârne (na) : lucane (cerf-volant) - (57) |
| cancouarne : hanneton. - (31) |
| cancouarne : s. f. hanneton. - (21) |
| cancouarne, cancouanne, subst. féminin : hanneton. - (54) |
| cancouarne: hanneton. (A. T IV) (B. T IV) - S&L - (25) |
| cancouégneau : voir quinqu'gneau - (23) |
| cancouelle (cancouarne) : hanneton, ce mot - (39) |
| cancouelle (n. f.) : hanneton - (64) |
| cancouélle (n.f.) : hanneton (aussi cancoirne) - (50) |
| cancouelle (une) : un hanneton - (61) |
| cancouelle : hanneton - (60) |
| cancouelle : hanneton. - (52) |
| cancouelle : hanneton. III, p. 42 ; IV, p. 26 - (23) |
| cancouelle, cancouenne. s. f. Hanneton. - (10) |
| cancouelle, hanneton - (36) |
| cancouelle, s. f. hanneton. - (08) |
| cancouène : hanneton - (48) |
| cancouène : mot féminin désignant un hanneton - (46) |
| cancouenne : hanneton, vieille fille, bigote. - (32) |
| cancouenne : voir cancouelle - (23) |
| cancouère : hanneton. A - B - (41) |
| cancouère (n.f.) : hanneton (Morvan-sud) - cancoine (n.f.) (Haut-Morvan) - (50) |
| cancouère (une) : un hanneton (voir : cancoire). - (56) |
| cancouerne : (can:couèrn’ - subst. f.) hanneton. - (45) |
| cancouérne, cancoirne. Hanneton. - (49) |
| cancouerre : hanneton, volant le tour des arbres à l'abrondi - (34) |
| cancouignai - demander en se plaignant, en flattant, en flagornant. - Tein, voiqui le père Colas quoi qu'a vein don cancouignai, arré!... Lai Pierrette m'embête ; câ ine cancouine. - (18) |
| cancouin : anémone qui sert encore à teindre les œufs le lundi de Pâques. (E. T II) - B - (25) |
| cancouin ine, adj., lent dans les mouvements et la démarche. - (11) |
| cancouine : voir cancouelle - (23) |
| cancouine, femme qui se plaint trop et chanteuse d'église dont le chant est langoureux et semble larmoyant, - (16) |
| cancoyau. n. m. - Personne à la voix nasillarde. (Toucy, selon M. Jossier) - (42) |
| cancoyau. s. m. Homme qui nasille en parlant, à la manière de polichinelle. (Toncy). - (10) |
| cancuelle : hanneton. Leur vol lourd et maladroit faisait peur aux filles car ces gros insectes se prenaient quelquefois dans leurs cheveux. Les petits garçons leur mettaient un fil à une patte pour les faire voler comme un rustique cerf-volant. - (58) |
| candot. Étourdissement, syncope. An me r’semble qui vâs fâre le candot, signifie : il me semble que je vais me trouver mal. Cette expression est usitée dans les villages de la plaine. - (13) |
| candute : Conduite, « Mauvase candute » : mauvaise conduite, débauche. « Ageter eune candute » : renoncer à ses mauvaises habitudes, se ranger. - « Candute ou recandute de Grenoble », mauvais procédé qui consiste à poursuivre à coups de pierres des gens avec lesquels on s'est chicané ou battu et qu'on chasse du pays. - (19) |
| cane : « Fare la cane » : s'évanouir. « Alle ne vaudrait ren pa soigni les blessés, acheteu qu'alle voit du mau alle fa la cane ». - (19) |
| cane, s. f. échalas usagé et raccourci par de successifs épointages. - (22) |
| caneçon : caleçon - (43) |
| caneçon : un caleçon - (46) |
| caneçon, caleçon. - (16) |
| caneçon, s. m , caleçon. - (14) |
| caneçon. Caleçon. - (49) |
| canelli (se), v. r. se glisser frileusement dans le lit. - (22) |
| canellion (aller de), loc. aller en se dissimulant et en se courbant. - (22) |
| canepin : Calepin, « J'y ai marqué su man canepin » : j'en ai pris bonne note, je m'en souviendrai. - (19) |
| caner, vn. loucher. Caponner. - (17) |
| caner, vt. tuer en le « claquant » contre un mur un animal, agneau double, chien ou chat nouveau-né. - (17) |
| caner. Loucher. Etym. Caner, faire la cane (Littré£), signifie marcher comme une cane ; on aura, par une transposition hardie du propre au figuré, comparé la direction oblique du regard louche à la marche oscillante de la cane. - (12) |
| caner. v. n. Errer comme un chien. — Par extension et similitude, vagabonder, faire l’école buissonnière, la fûtaine, en parlant des enfants. Du latin canis. - (10) |
| caneter, marcher comme une cane. - (04) |
| canette : bonnet de femme - (60) |
| canette : coiffe. V, p. 15-5 - (23) |
| caneule. Cornouille, fruit du cornouiller. Caneule est le mot patois devenu citoyen de Dijon avec beaucoup d'autres. - (12) |
| caneut : Mélange de vin, sans sucre, et de pain coupé en petits morceaux (On disait autrefois beurseureut). - (19) |
| caneyi (se), v. r. se glisser frileusement dans le lit ; se glisser en se dissimulant : se caneyi le long d'une haie. - (24) |
| canezas. s. m. Cadenas. (Percey). - (10) |
| canfasser : Confesser On dit d'une chose extrêment difficile à exécuter « y est le diabe à canfasser ! », c'est à dire il n'y a pas moyen d'en venir à bout. - (19) |
| canfassian : Confession. « An li arait donné le Ban Dieu sans canfassion », se dit d'une personne qui a toutes les apparences de l'honnêteté, mais n'en a que les apparences, d'une personne hypocrite. - (19) |
| canfiteure : Raisiné, confiture faite avec du moût de raisin « Eune reute de canfiteure, une tartine de raisiné ». Les confitures qui ont pour éléments tout autre fruit que le raisin ne sont pas des « canfiteures », ce sont des gelées. Voir ce mot. - (19) |
| canfouine : vieille maison. (LS. T IV) - Y - (25) |
| canfouine, cambouise. n. f. - Cambuse, réduit sombre, sordide, mal entretenu. - (42) |
| canfouine, s. f. taudis en désordre. - (22) |
| canfouiner (se) : se cacher. - (56) |
| canfouire : maison mal tenue. (B. T IV) - Y - (25) |
| çanger (se), v. pr., changer de linge, de vêtements. - (14) |
| çanger, v. tr., changer, remplacer, modifier. - (14) |
| cangi : Congé. « Y est in vieux sordat (soldat), ol a fait deux cangis ». - (19) |
| cangraingne, s. f. gangrène. - (08) |
| cangrène (lai) : (la) gangrène - (37) |
| cangrène : Gangrène. « I li est veni du mau dans la chambe, la cangrène s'y est mis, i va pt 'èt falla li coper » : il est venu du mal à la jambe, la gangrène s'y est mise, il va peut-être falloir la lui couper. - (19) |
| cani (n.m.) : caneton - (50) |
| cani : caneton - (48) |
| cani : Chenil, niche à chien. Au figuré : lit. « Allons les ptiets, au cani ! » : allons les enfants, au lit ! - (19) |
| cani, s. m. lit en désordre, grabat ; niche à chien. - (22) |
| cani, s. m. lit en désordre, grabat ; niche à chien. - (24) |
| cani, s. m. petit canard qui n'a pas encore de plumes. - (08) |
| cani, s. m., chenil : « Rentre Médor dans son cani. » - (14) |
| cani, s.m. chenil. - (38) |
| cani. Chien. Ce mot est composé directement du latin canis. - (03) |
| cani. n. m. - Caneton. - (42) |
| cani. s. m. Caneton, petit canard. Fait canas, au pluriel. Un cani, des canas. (Athie). - (10) |
| cania : dormeur, fainéant - (43) |
| cânias (n.f.pl.) : douleurs des jambes - (50) |
| caniche : Viande de mauvaise qualité. « J'ins marandé dans eune gargeute queva an nos a fait miji de la caniche » : nous avons mangé dans une gargote où on nous a fait manger de la viande de mauvaise qualité. - (19) |
| canichou : Petit boucher qui ne tue que des vaches maigres, des caniches. - (19) |
| caniforchon (à), loc. adv., à califourchon. - (14) |
| canigot n. m. - Escargot. (Saint-Sauveur-en-Puisaye, selon M. Jossier) - (42) |
| canigot. s. m. Escargot. (St-Sauveur). - (10) |
| canil (cani) : s. m., chenil, niche à chiens ; logement sale, lit mal fait. - (20) |
| caniquet. s. m. Toit à canes. (Villiers-Saint-Benoît). - (10) |
| çaniqui, loc, cela, ce qui est ici. - (14) |
| caniquiée. s. f. Chaumière, cabane en ruine ou de peu de valeur. — Se dit aussi, par analogie, d’une personne mal portante. - (10) |
| canire (na) : nid (pour les poules) - (57) |
| canit (on) - lapiniére (na) : clapier - (57) |
| canit (on) : gîte (du lièvre) - (57) |
| canivelle. n. f. - Membre, le bras ou la jambe : « Il est tombé les quat'e canivelles en l'air. » - (42) |
| canivelle. s. m. Un des membres du corps humain. Il est tombé les quatre canivelles en l’air. Si je ne me retenais pas, je te briserais les quatre canivelles. - (10) |
| cankeûgni v. Cancaner, perdre son temps, commérer. - (63) |
| cankouâne : hanneton. (RDF. T III) - A - (25) |
| can-nai : crier (s'agissant de l'oie). - (33) |
| canne (faire) : embêter. - (66) |
| canne : s. f.. vx fr. cane, échalas. - (20) |
| canne, s. f. roseau, masse d'eau ou massette à larges feuilles, typha latifolia. - (08) |
| canne, sf. couenne. - (17) |
| canne, sf. surface d'un pré. - (17) |
| canneçon : caleçon - (61) |
| cannelle : petit robinet de bois. (A. T IV) - S&L - (25) |
| canne-major, s. f., tambour-major, militaire et civil. La canne joue un tel rôle dans les fonctions de cet homme grand, qu'elle a servi à le dénommer. La canne-major civile est de toutes les noces, de toutes les fêtes, surtout de toutes les promenades de cérémonie ; elle précède le tambour et le fifre, et livre son bâton enrubanné aus plus excentriques audaces de sa gymnastique. - (14) |
| canner (prononcez can-ner). v. n. Crier comme un canard. - (10) |
| canner, v. n. Plier sous le poids d’un ferdeau. Se dit ainsi peut-être, parce que, dans ce cas, on éprouve le besoin de s'appuyer sur un bâton, sur une canne. - (10) |
| cannesson, caleçon. - (26) |
| cannetée. n. f. - Bande de petits oiseaux. (Mézilles, selon H. Chéry) - (42) |
| cannetilles. : Fils d'or ou d'argent tortillés sur du laiton. - Ornement interdit à certaine classe, et surtout aux servantes, par édit somptuaire de la municipalité de Dijon de 1580. - (06) |
| canneton. s. m. Hanneton. (Courgis, Auxerre, etc.). - (10) |
| cannette n.f. (de canner). Tresse de cheveux. - (63) |
| cann'son : (nm) caleçon - (35) |
| cano’ : caneton. - (62) |
| canolle. : Fruit du cornouiller, et canolai, cornouiller. (Del.) - (06) |
| canon : verre de vin - (48) |
| canon n.m. Verre de vin. Le canon est une ancienne mesure de capacité des vins et spiritueux valant 1/8 de pinte et contenant 0,18925 litre. - (63) |
| canon : s. m., ancienne mesure de capacité pour les liquides, valant 1/8 de pinte, et contenant 0 litre 18925. - (20) |
| canon : un verre, ou une fillette de vin (blanc ou rouge). Ex : "Eh Léon ! Té payes-t-y un canon ?" - (58) |
| canon : verre de vin, fond d'un chariot de foin - (39) |
| canon, canonnier. s. m. Prunier de Sainte-Lucie. - (10) |
| canon, s. m. jambe de pantalon. - (22) |
| canon, s. m. jambe de pantalon. - (24) |
| canonner : repasser des coiffes, des guimpes et des manchettes avec des fers spéciaux. - (30) |
| canot (on) : caneton - (57) |
| canot, cani, subst. masculin : caneton. - (54) |
| canot, mouillé comme canant. - (05) |
| canot, s. m., petit canard, caneton. - (14) |
| canot. Caneton. On dit encore : « petit boulou ». - (49) |
| canoter, v. intr., aller de ci et de là, marcher à la manière des canards : « Alle é prou gentite de figoure ; mâ, mon Dieu ! c'ment all' canote! » - (14) |
| canoter. Marcher comme les canards. - (03) |
| canots : canetons - (43) |
| canotte : grand roseau. - (31) |
| canottes, joncs creux croissant sur les bords des étangs. - (28) |
| canouche. s. f. et canouchon. s. m. Souche. - (10) |
| canoués. s. m. pl. Lieux d’aisances. De caner, chier, foirer comme les canes. (Courgis). - (10) |
| canouter. v. a. Synonyme de calouner. (Seignelay). - (10) |
| canoux, canouse. Celui, celle qui louchent. - (12) |
| canpagne, récolte d'une année ; faire une bonne ou une mauvaise campagne est faire une bonne ou une mauvaise année. - (16) |
| canpaingne, sf. campagne. - (17) |
| canpène, canpeune, clochette que l'on attache au cou des vaches, pour indiquer le lieu où elles paissent dans les bois. Il en est qui suspendent des canpène aux arbres de leurs vergers, pour les avertir de la présence des maraudeurs. - (16) |
| canquanter, v. n. se dit du cri des oiseaux de basse-cour, des oies particulièrement, mais aussi des canards, etc… - (08) |
| canqueillot, s. m. petite racine de genêt ou de tout autre arbuste. Lorsqu’un champ de genêts a été mis en culture, on ramasse les « canqueillots » après le premier labour. Ces racines donnent un feu de peu de durée, mais vif et clair. - (08) |
| canquène (sans doute pour quantième). s. f. Laps de temps écoulé. Il y a une belle canquène, pour il y a longtemps, il y a très longtemps. (Percey). - (10) |
| canquener, v. n. se dit du cri des oies. - (08) |
| canqueneuter, marcher difficilement en se balançant à droite et à gauche comme une cane. - (27) |
| canquessé : v. i. Marcher en canard. - (53) |
| canqueugne : personne qui gémit de tout. - (30) |
| canqueugni : agir avec paresse, perdre son temps. A - B - (41) |
| canqueusse (être) : exp. Avoir mal aux jambes. - (53) |
| canquoin. Paresseux, lent. De canquoin on a fait le verbe canquouiner. - (03) |
| canquoirne, hanneton. - (05) |
| canquouin : Paresseux, lent à faire sa besogne. «T'as pas encore fini ? Què canquouin te no fa ! ». - (19) |
| canquouin, adj., lent, trainard, paresseus. - (14) |
| canquouine (na) : cancanière - (57) |
| canquouiner : Traînasser. « Causer en canquoumant» : parler lentement et d'un ton pleurard. - (19) |
| canquouiner, v. intr., paresser, traîner dans son travail : « O n' fait ran d' ben brave ; ô canquouine tout l' temps ». (V. Canquouin, p. l'orthogr.). - (14) |
| cansaïlle : Conseil. « J'ai pas faute (besoin) de cansaïlle ! ». - (19) |
| cansarver : Conserver. « Tiens v'la eune pièce de vingt sous pa fare la fête, seurement (seulement) tâche de la cansarver ». - (19) |
| cansio : conceau. (RDM. T IV) - C - (25) |
| canstrure : Construire. « Ol est bien chez liune dépeu qu'al a fait canstrure » : il est bien chez lui depuis qu'il a fait construire. - (19) |
| cansulte : Consultation, ordonnance du médecin. « Le madecin li a donné eune cansulte » : le médecin lui a donné une ordonnance. - (19) |
| çant an banneîre, çant an ceveire. Cent ans bannière, cent ans civière. Proverbe pour donner à entendre qu'avec le temps on peut déchoir de la plus haute noblesse, dont la bannière est une marque, comme la civière est une marque de roture et de pauvreté… - (01) |
| çant. Cent. On écrit çant devant une voyelle, çant écu, cent écus ; çan devant une consonne, çan fran, cents francs. - (01) |
| cante : Contre. On dit aussi cantre. - (19) |
| çanter (v.t.) : chanter - (50) |
| çantiau (n.m.) : échantillon - (50) |
| cantibouèle, sf. culbute. - (17) |
| canticle. Cantique, cantiques. A Paris, comme à bijon, le menu peuple change ique en icle… - (01) |
| cantine : s. f., bocal. - (20) |
| cantine, s. f. on dit les mouches « cantines. » - (08) |
| cantineau : s. m., petite cantine de chantier. - (20) |
| canton : partie d'un bois communal réservée à chaque famille - (61) |
| canton : n. m. Canton, portion de bois attribuée par tirage au sort à chaque ayant-droit. - (53) |
| cantonnai - fréquenter, venir souvent dans le même lieu. - Quoi qu'à venant don tôjeur cantonnai qui ? – To le monde cantonne por qui. - (18) |
| cantons : coupes de bois. Droit d'affouage. Permet à chaque foyer de la commune de cuisiner et de se chauffer sans contrainte. Les bénéficiaires pouvaient sous-traiter l'abattage et se faire livrer leur lot contre paiement ou autre service. Ex : "A c't'hiver, faut qu'j'allint aux cantons !" - (58) |
| cantou : Partie d'un champ clos de haies ou de murs où il n'est pas possible de faire avancer la charrue et qu'on doit cultiver à la pioche ou à la bêche. - (19) |
| cantougnier, cantounnier. n. m. - Cantonnier. - (42) |
| cantra (se) : Se disputer, « I se sant cantra tote la vaillée ». - (19) |
| cantre : Contre. - (19) |
| cantredanse : Quadrille, danse très populaire dans nos villages. « Je vins danser eune cantredanse, fa me vis à vis ». - (19) |
| cantuelle, cancuelle, cancouelle, cancouenne, carcancouelle. n. f. - Hanneton. - (42) |
| canuche. n. f. - Souche. - (42) |
| canuche. s. f. Souche de bois. - (10) |
| canuler. v. a. Ennuyer, fatiguer, harceler, asticoter. Voyons, est-ce que t’as, entrepris de me canuler ? Laisse-me tranquille. De canule, petit tuyau servant à divers usages. - (10) |
| canvartille : Rougeole des blés (melampyrum arvense). Plante qui croît dans les blés et dont la graine quand elle reste mêlée au froment donne une mauvaise qualité de farine. - (19) |
| canveni (verbe) : Convenir, « Y est conveni ». - (19) |
| canvoulant : qui n'a a pas de domicile fixe. Les canvoulants faitin les paniers : les « romanichels » faisaient des paniers. Origine probable du mot : les « camps volants ». - (33) |
| çanzeman (n.m.) : changement - (50) |
| çanzer (v.t.) : changer - (50) |
| cao, s.m. coup. - (38) |
| cap’té, v. n. action pour un oiseau d'abandonner ses œufs et son nid. - (22) |
| capaline : s. f. capeline. - (21) |
| capan : Couard, capon. « Je te périe (parie) que je mante à la cuche (sommet) de ce peup 'lIe (peuplier). - Capan qui s'en dédit » : tu es un capon si tu ne le fais pas. - (19) |
| capaudis. s. m. Copeaux de menuiserie. (Vertilly). - (10) |
| câpe (n. f.) : tache, couche de saleté d'une certaine épaisseur (syn. câpiot) - (64) |
| cape : Manteau de femme non ajusté et dont on ne rabat pas le capuchon. - (19) |
| cape n.f. Chapeau de la gerbière. - (63) |
| cape, chape, s. f. espèce de coussin en paille tressée ou tordue qu'on place sous le joug des bœufs pour protéger leur tête. - (08) |
| cape, chape, s. f. petite couverture en paille dont on recouvre le chanvre, les javelles, que l'on dresse sur le terrain pour les faire sécher en moyettes. - (08) |
| cape, chape, s. f. vêtement de femme qui couvre la tête et tombe sur les épaules. Aussi prononcé « caipe ». - (08) |
| capeline : Capeline. Coiffure que portent les femmes pour se garantir du soleil ; elle est faite de percale doublée, soit de carton recouvert de percale, elle est garnie d'un bavolet qui protège la nuque. - (19) |
| capeline : s. f., coiffure en étoffe légère et de couleur généralement claire que les femmes de la campagne mettent pour travailler aux champs. Elle est surtout en usage au nord et à l'ouest de .Mâcon. - (20) |
| caper (se) v. pr. se cacher. - (11) |
| caper v. Recouvrir, bâcher. - (63) |
| capeter (cap'ter) : v. a., abandonner, renoncer à. Il a capeté sa promise. Voir dépeter. - (20) |
| caphar, « L » blatte , insecte commun dans les cuisines, dont la tête est cachée sous le corselet ; on appelait autrefois, selon Du Cange, caphardum une sorte de capuchon couvrant la tête. - (04) |
| capien ene, adj., flatteur, calin. Ex.: faire son capien. - (11) |
| capine (ai lai), loc. aller « à la capine » c'est marcher les pieds nus ou sur ses bas. - (08) |
| capines. n. f. - Vieilles pantoufles. (Saint-Privé, selon M. Jossier) - (42) |
| capines. s. f. pl. Vieilles pantoufles. (Saint-Privé). — Voyez écapine. - (10) |
| câpiot (n. m.) : tache, couche de saleté d'une certaine épaisseur (syn. câpe) - (64) |
| capir (se), camer (se). Se tapir. - (49) |
| capitau, s. m. capital, argent comptant, cheptel surtout. - (08) |
| capitau, s. m., capital. - (14) |
| capon : penaud - (48) |
| capon : penaud. Ol ai fait des bétises, ol o tout capon : il a fait des bêtises il est tout penaud. - (33) |
| capon, s.m. homme peureux. - (38) |
| caponer : Reculer devant le danger. - (19) |
| capot, s. m., mantelet à capuchon, volontiers de couleur lilas, ample, capitonné, élégant, que portaient jadis les laitières. Comme toutes les parties du costume traditionnel, le capot tent à disparaître. - (14) |
| capou : s. m. creux. - (21) |
| capouillon : s. m. flaque d'eau. Diminutif de capou. - (21) |
| câpre, s. f. chèvre. - (08) |
| capuche, s. f. capuchon, manteau à capuchon, vêtement de femme. - (08) |
| capucher, v. n. pommer, « chou capuche », chou cabus, chou pommé. - (08) |
| capuchon : s. m., capuchon de lampe, abat-jour. - (20) |
| capucin : s. m., lièvre. - (20) |
| caputse n.f. Capuche. - (63) |
| caquais, caquin, coquand. s. m. Œuf de poule. Dérivé de coque. - (10) |
| caque n.f. Excrément. - (63) |
| caque : s. f., excrément d'homme ou d'animal. Ça sent la caque de chat, ici. - (20) |
| caque. n. m. - Petit fût en bois dans lequel étaient entassés les harengs. - (42) |
| caqueillau : voir quinqu'gneau - (23) |
| caqueillot (n. m.) : moustique - (64) |
| caqueline Voir moutse bezaiñne. - (63) |
| caquelli, caqueuilli v. (d'une vieille racine expressive kak,que l'on trouve aussi dans caqueter). Décortiquer et croquer (une châtaigne cuite à l'eau) - (63) |
| caquellion, s. m. petit fût. - (22) |
| caquelon n.m. Casserole, marmite en terre cuite. - (63) |
| câquelorde, canqouère : hanneton. - (33) |
| caquelot. s. m. Personne qui se dandine, qui se berce en marchant. - (10) |
| caquelotter, caquenotter. v. n. Se bercer, se dandiner en marchant. (Etivey). - (10) |
| caque-nano : s. m., individu qui caque au nano (nono. dodo, etc.), chie-en-lit, personnage timide et niais, qui fait sous lui, gâteux au physique et au moral. - (20) |
| caque-navette : (être) très petit, rabougri. (S. T IV) - S&L - (25) |
| caquer : aller à la selle - (44) |
| caquer v. Déféquer, chier. Voir tsier. - (63) |
| caquer : v. n., aller à la selle. Votre fille est une merveille, — c'est entendu: mais tout' même, elle fait comme les autres, elle caque... - (20) |
| caquer, v. se dit d'un fond de pantalon qui tombe sur les jambes. - (38) |
| caquerau (pour caqueral) : s. m., pot à çaquer. On dit habituellement un pot caquerau. - (20) |
| caquereau, caqueriau, cacuzeau. s. m. Coque de noix. - (10) |
| caquériau : sorte de fromage. (F. T IV) - Y - (25) |
| caqueriau : voir quinqu'gneau - (23) |
| caqueriot (n.m.) : moustique - (50) |
| caquériot, caquésiot, caquéyot. s. m. Cousin, insecte ailé fort incommode par son bourdonnement et ses piqûres. Joubert donne caqueriau. - (10) |
| caquerot : moucheron, insecte - (60) |
| caquerote : tête - (60) |
| caquesiau : insecte imaginaire. D'une femme : elle a été piquée par un caquesiau : elle est enceinte. - (33) |
| caquésiot. n. m. - Gros moustique : le cousin. - (42) |
| caqueti, s. m. cabinet d'aisances. - (24) |
| caquetis, cacoutis : s. m., lieux d'aisances rudimentaires et mal tenus. - (20) |
| caquetore. Caquetoire, fauteuil où l’on caqueté à son aise… - (01) |
| caquetore. : Sorte de fauteuil où l'on caquetait. - On dit aujourd'hui une causeuse, mais on ne caquette pas moins qu'autrefois. - (06) |
| caqueu : s. m. gâteau qu'on faisait autrefois dans les villages de la Montagne. - (21) |
| caqueu, coqueu : s. m., espèce de tartouillat au fromage blanc, qui se fait, à l'occasion de la fête patronale, dans les communes du nord du Maçonnais. En Charollais, le cacou (farine, lait, oeufs) est un matefaim au four, aromatisé et sucré, avec ou sans cerises. Voir tartouiltat. - (20) |
| caqueugnon n.m. Fruit ou individu resté nain. - (63) |
| caqueugnon : s. m., fruit ou individu resté nain. - (20) |
| caqueuille n.f. Coquille. - (63) |
| caqueux : voir cacoux. - (20) |
| caque-yi des tsâtagnes : manger des châtaignes sans les éplucher et cracher l'écorce - (43) |
| caquéziau : voir quinqu'gneau - (23) |
| caqui : diminutif enfantin pour un oeuf. IV, p. 62 - (23) |
| caqui : petit œuf. - (09) |
| câqui, s. m. œuf, terme enfantin. - (08) |
| çaquiau, s. m. château. - (08) |
| caquie. s. m. et caquiou. s. m. Chassie, matière gluante qui transpire des yeux, surtout pendant le sommeil. - (10) |
| caquien : œuf. (P. T IV) - Y - (25) |
| caquieux, euse. adj. Qui a les yeux chassieux. — S’emploie aussi substantivement. C’est un caquieux. - (10) |
| caquillan : Petit fût de contenance indéterminée, inférieure à celle du quartaut « In caquillan de vin blian ». - (19) |
| caquille : feuillette, tonneau d'une contenance de 114 à 136 litres - (43) |
| caquille, caquillon : (nf.nm) quarteau de vin - (35) |
| caquiller : v. a., chatouiller : mangeotter, grignoter. Voir recaquiller. - (20) |
| caquilli : caquilli des tsateugnes = manger des châtaignes sans les éplucher et en recrachant l'écorce. A - B - (41) |
| caquillon : quartaut de vin (moins de 60 litres) - (43) |
| caquillon n.m. Petite caque, fût d'une contenance supérieur à celle du barlot (tonnelet contenant la boisson d'une journée) et inférieure à celle du quartaut (57 litres). Au figuré, personne de petite taille. - (63) |
| caquillon : s. m., petite caque, fût de contenance égale ou inférieure à celle du quartaut, mais supérieure à celle du barelot. Au flg., personne de petite taille. - (20) |
| caquillot : Grappe composée de plusieurs fruits dont le pédoncule s'attache au même point d'un rameau. « In caquillot de cheriges ». - (19) |
| caquin (n. m.) : œuf, dans le langage enfantin (avouèr l'caquin (être ivre)) - (64) |
| caquin : œuf. (F. T IV) - Y - (25) |
| caquin, catchien. n. m. - Œuf venant d'être pondu. - (42) |
| caqu'naune : voir carcoue - (23) |
| caquœyion, s. m. petit fût. - (24) |
| caquot, caquotte n. et adj. 1.Bavard. 2. Bigot, cagot. - (63) |
| caquot. s. m. Noix. (Villechétive). - (10) |
| caquou (nom féminin) : (Faire la) attitude maladive. Amorphe. - (47) |
| caquoux, -ouse adj. et n. Qui caque souvent, qui est barbouillé de merde. - (63) |
| çar : chariot à quatre roues. VI, p. 6 - (23) |
| cara, s. m. très jeune domestique. - (22) |
| cara, s. m. très jeune domestique. - (24) |
| carabi. n. m. - Gros morceau de pain. (M. Jossier, p.25) - (42) |
| carabi. s. m. Gros morceau de pain. (Puysaie.) - (10) |
| carabitoué, s. m. cas rédhibitoire par syncope et corruption. On achète un cheval en réservant les « carabitoués. » - (08) |
| caraco n.m. Corsage ample à manches longues. - (63) |
| caraco : petit gilet, vêtement léger et court. - (58) |
| caracola : horizon au soleil couchant dont l'aspect permet de prévoir le temps du lendemain. A - B - (41) |
| caractée, s. m. caractère. - (08) |
| carafé, giroflée - (36) |
| carafé, giroflée. - (16) |
| carafée. s. m. Giroflée couleur de terre brûlée. ( Villeneuve-les-Genêts). — Ailleurs, ce nom se donne aux jalousies, à l’œillet-de-poète. - (10) |
| carailler, v. remuer des cailloux avec un pic, une pioche. - (38) |
| caraiyon : petite parcelle - (51) |
| caralé, v. n. réciter la formule commençant certains jeux d'enfants. - (22) |
| caraousse. n. f. - Viande dure. (Chastenay, selon M. Jossier) - (42) |
| caraousse. s. f. Mauvaise viande, viande osseuse. De caro et os, ossa. (Chastenay). - (10) |
| carapater (se). Se sauver. (Argot). Fig. Se tirer d'affaire. - (49) |
| caratte : Carotte. On dit plutôt careute ou carette. (Voir pastonnade). Carotte désigne plutôt la betterave fourragère ou à sucre. - (19) |
| caràyé, v. a. jeter une pierre au loin. - (22) |
| carayer : voir carrailler. - (20) |
| caràyer, v. a. jeter une pierre au loin. - (24) |
| caraÿon : petite parcelle - (51) |
| carbalin, s. m. sarrasin ou blé noir de tartarie. - (08) |
| carbaling : sarrazin - (39) |
| carbon : furoncle - (39) |
| carbon, furoncle - (36) |
| carbonade, s. f., tranche de porc, à griller ou grillée sur les charbons. Ce mets, très goûté, fait, avec le boudin, la base des réveillons. - (14) |
| carboulô (en), loc. se mettre en « carboulô », c'est se replier sur soi-même, se pelotonner. - (08) |
| carboulotte : voir comblette - (23) |
| carbounade : grillades de porc. - (62) |
| carcabia, s.m. pilori élevé sur la place publique pour l'exposition d'un délinquant ; le carcabia du Bourgneuf avait été démoli au début de la Révolution en 1792 ; la municipalité contraignit les auteurs du délit à le relever et à le repeindre à neuf. - (38) |
| carcailla. Mot formé par l'imitation du chant de la caille. On appelait jadis carcaillet des appeaux de caille. - (03) |
| carcaillet, s. m., appeau pour attirer les cailles. - (14) |
| carcaillote, s. f., caille. - (14) |
| carcan : Rosse, vieux cheval maigre. - (19) |
| carcancouelle. s. f. Hanneton. (Sainpuits). - (10) |
| carcangnier, carcagnier. n. m. - Équarrisseur. - (42) |
| carcari. n. m. - Escargot. (Champignelle, selon M. Jossier) - (42) |
| carcari. s. m. Escargot. (Champignelles, Argenteuil). - (10) |
| carcassan : escargot. (VC. T II) - A - (25) |
| carcasser : v. n., se dit d'une personne qui tousse, râle et crache bruyamment. Ça carcasse dans ma poitrine. - (20) |
| carcasser, v. tr., fatiguer, exténuer : « Par la nouége qu'i fait, v’là l’piéton qui nous éporte les lett' ; ôl é tout carcassé. » - (14) |
| carcasser. v. - Parler beaucoup, de manière futile, « comme une pie. » (Chevillon, selon M. Jossier) - (42) |
| carcasser. v. n. Babiller, caqueter à tort et à travers, comme une pie. (Chevillon). - (10) |
| carcassi v. Tousser, râler, cracher bruyamment. - (63) |
| carcasson. s. m. Escargot. (Savigny-en-Tèrre-Plaine). - (10) |
| carcelat : épervier mâle. Altération de « tiercelet » qui est le mâle, plus petit d’un tiers chez certains oiseaux de proie. - (62) |
| carcèle n.f. Vache de réforme. - (63) |
| carcelle : (nf) vieille vache - (35) |
| carcelle : vieille vache - (43) |
| carcelle, crecelle, crechaule : s. f., croquant (cartilage). - (20) |
| çarcer (v.t.) : chercher - (50) |
| çarcer, v. a. chercher, poursuivre quelqu'un ou quelque chose. - (08) |
| çarcher son pain, sa vie, loc , mendier. (V. Aller aux portes). - (14) |
| çarcher, v. tr., chercher. - (14) |
| carciau. s. m. Carcasse. Un dindon maigre comme un carciau. - (10) |
| carciné : Calciné. « La cuisenière a laichi carciner san reuti ». - Halé par le soleil, « Ol a les brés carcinés ». - (19) |
| carciner. Calciner, brûler. - (49) |
| çârcle n.m. Cercle. - (63) |
| çarcle, s. m., cercle : « Thouma a bouté tous ses gardes à ses touneaus ». - (14) |
| carcois, charcois, charcouet. Creux à la base de l’occiput, nuque du cou. - (10) |
| çarçou, charchou (-ouse) (n.m. ou f.) : chercheur (-euse) - (50) |
| carcoucheux. Râteau de jardin. - (49) |
| carcoue (faire la) : rentrer le cou dans le corps, faire le gros dos (en parlant d'un poulet malade). - (52) |
| carcoue : une poule malade fait la carcoue. III, p. 63-p - (23) |
| carcoue : grimace, gros dos. Ol o m'lade, o fait lo carcoue : il est malade, il fait la grimace. - (33) |
| carcoue : se dit d'une personne ou d'un animal qui semble malade et qui fait lai carcoue - (39) |
| carcoue, s. f. on dit d'une poule et de tous les animaux en général qu'ils font la « carcoue » lorsqu'ils rentrent le cou dans leur corps comme dans l'affaissement de la maladie. - (08) |
| carcouiner. v. - Nasiller. (Merry-la-Vallée, selon M. Jossier) - (42) |
| carcouiner. v. n. Nasiller. (Merry-la-Vallée). - (10) |
| carcuchot, s.m. sorte de petit pain fait avec les raclures de la maie. - (38) |
| çarcueil (n.m.) : cercueil - (50) |
| carcul : Arithmétique. « Ol est le premé en carcul » : il est le premier de sa classe en arithmétique. - Suppositions, prévisions, « Ol a fait in mauvâ carcul » : il s'est trompé dans ses prévisions. - (19) |
| carcuyöt, sm. docteur de village ; faiseur d'embarras. - (17) |
| carder (en), verbe intransitif : avoir du mal, de la peine à faire quelque chose. - (54) |
| carder : peigner, démêler la laine - peiner à faire quelque chose - (39) |
| carder, v. n. avoir de la peine, de la difficulté à fatiguer, peiner, pour faire une chose. - (08) |
| cardinau : Cardinal. « Ol est roge c'ment in cardinau ». - (19) |
| çàrdon (n.m.) : chardon - (50) |
| cardoux, cardeur de laine. - (05) |
| cardze n.m. Variante charolaise de carge, caruge, carrouge ou carron. Tous ces termes dérivent du vx.fr. carroge, du bas latin quadri ruga, (ruga = chemin bordé de maisons) carrefour, croisée de quatre chemins, place. On doit y rattacher l'acardzi. - (63) |
| cardzot n.m. Groupe de personnes rassemblées sur le cardze ou ailleurs. Ce mot a été forgé par l'Atelier de Patois de Sivignon et adopté aussitôt par ses membres. Il peut avantageusement remplacer forum, chat, réunion, atelier, séminaire, assemblée. - (63) |
| cardzotâdze n.m. Action de discuter. - (63) |
| cardzotâilli v. Discuter sans efficacité, vainement. - (63) |
| cardzoter v. Discuter, débattre. - (63) |
| cardzoteux, -euse n. Personne qui aime les discussions, les débats. Participant à un cardzot. - (63) |
| cardzotrie n.f. Discussion, conversation, débat. - (63) |
| care. : (Dial.), chair (du latin caro). Dans le vieux français, care signifiait visage (Lac.), d'où l'expression se carrer, c'est-à-dire se regarder avec complaisance. - (06) |
| carefor. Carrefour, carrefours. - (01) |
| carein-me, s. f. , le carême. Carein-me a été dit dans un autre sens: « Pro feminariun fluxu pêriodico dicitur. » On comprent l’allusion à ce moment d'abstinence. - (14) |
| careler, v. raccommoder les souliers. - (38) |
| careloux, s.m. savetier. - (38) |
| carëmage, céréales que l'on sème vers l'époque du Carême. - (16) |
| carémages. En effet, ils se font à l'époque du Carême. - (14) |
| carêmes (Les), s. f. pl. Les semailles des orges et des avoines, sans doute parce qu’elles coïncident avec le carême. (Savigny-en-Terre-PIaine). - (10) |
| caressi v. Caresser. - (63) |
| çarf, sm. cerf. - (17) |
| çarfö, sm. cerfeuil. - (17) |
| carge, carget, cargeat, cargeot : s. m., groupe de personnes caquetant sur le carge (le forum maçonnais !) et, d'une manière générale, n'importe où. - (20) |
| carge, carrage, carrouge, carruge : s. m., vx fr., carroge, croisée de quatre chemins, carrefour, place. Ces noms désignent plusieurs hameaux du département de Saône-et-Loire. Voir truge. - (20) |
| çarger, v. tr. charger, couvrir. - (14) |
| cargœ ou carge, s. m. petite place : s'assembler sur le cargœ. - (22) |
| cargœ, s. m. petite place : s'assembler sur le cargœ. - (24) |
| caribôdu : se dit de quelqu'un qui a le corps déformé, bossu, tordu - (39) |
| cariboyat : n. m. drôle de chantier. - (53) |
| carillon (n.m.) : petite campanule (par analogie avec la clochette de la fleur) - (50) |
| carillon : cœur du fruit. En parlant de la pomme ou de la poire : « Mordre jusqu’au carillon ». Certains disent « creûillon ». - (62) |
| carillon, s. m. nom vulgaire d'une plante de la famille des campanulacées, ainsi appelée par assimilation de ses clochettes avec la série de cloches qui produit un carillon. - (08) |
| carillon, sm. bavardage, potin. - (17) |
| carimentran, s. m., carême-entrant, fin du carnaval. - (14) |
| carimentran. Carnaval. Vieux mot carêmentrant, comme qui dirait entrée en carême. - (03) |
| carimentrant, carnaval. - (05) |
| çarimonie, s. f., cérémonie. - (14) |
| çarimonies. s. m. pl. Façons, manières, cérémonies. Un faiseux de çarimonies. - (10) |
| caristade. s. f. Aumône. — Mauvaise farce, danse malséante. Il y a évidemment entre cette dernière acception et la première une relation nécessaire, le métier de farceur, de bateleur, de danseur, étant une des mille manières de mendier, de provoquer la caristade. Voyez caristaud. - (10) |
| caristaud. s. m. Homme de peu de consistance, de peu de valeur, qui mendie, qui demande la charité, la caristade. Du latin charitas. - (10) |
| carkhuelle : voir cancouelle - (23) |
| carlé*, v. a. tresser d'une manière spéciale un fouet de chanvre. - (22) |
| carlet et carelet, s. m., petite mesure d’eau-de-vie servie dans les hôtels et les cafés. - (14) |
| carlot : noix. - (31) |
| carlot : noix. (BD. T III) - VdS - (25) |
| carlot. n. m. - Vieux cheval maigre, ne travaillant plus. - (42) |
| carlot. s. m. Cheval vieux et maigre. (Saint-Sauveur). - (10) |
| carlottier : noyer. - (31) |
| carmai. Carmel. Le Mont-Carmel dans la Palestine. - (01) |
| carmantran*, s. m. carnaval. Coure carmantran, se déguiser à carnaval. - (22) |
| carmantrant n.m. (de Carême entrant) Mannequin de paille trimballé pour Carnaval et brûlé ensuite. - (63) |
| çarme (n.m.) : charme (arbre) - (50) |
| carmentran (abréviation de carême entrant) : mardi gras - (43) |
| carmentran, cairmentran (C.-d.), carimentran (Br.), carimentran ou galimentran (Chal.). - Pour carême entrant (commençant), c'est -à-dire fin du carnaval. Carmentran est un personnage populaire en Bourgogne ; c'est une personnification du carnaval représenté par un mannequin bourré de paille et revêtu d'un costume quelconque, de vieux habits couverts d'oripeaux, principalement accusé de toutes sortes de crime imaginaires. Après avoir été promené le jour du mardi gras dans toutes les rues de la ville, le lendemain on lui met le feu au... dos et on le jette à l'eau. Littré cite Carême-prenant ; à comparer aussi avec levieux français galimafré. - (15) |
| carmentran, m. Carnaval (littéralement carême entrant, début du carême). Coure carmentran, se déguiser à Carnaval. - (24) |
| Carmentrant : (NP) Mardi-Gras - (35) |
| carmentrant : s. m., carême-entrant, syn. de carnaval et de tracassin. Noms de famille : Carimantrand, Carmantrand. - (20) |
| carmouche (na) : éternuement - (57) |
| carnage, sm. putréfaction. - (17) |
| carnansiaud. Gros rhume de cerveau. - (49) |
| carnasser, carnécher : v. n., rendre un son de fêlé ; tousser. - (20) |
| carnassi, carnéchi v. Rendre un son de fêlé en toussant. - (63) |
| carnassier (ière) : adj., avide de. Les truffes, j'en suis pas pus carnassier que d' la messe. - (20) |
| carnaval : Masque, personne masquée. « Core carnaval » : se déguiser le Mardi-Gras. - (19) |
| carnaval, adj., terme de mépris, péjoratif. - (40) |
| carnaval, au pluriel carnavals. Masques, gens déguisés au moment du carnaval. - (12) |
| carnaval, carnavau : s. m., mannequin du carnaval qu'on brûlait sur le pont de Mâcon et qu'on jetait ensuite en Saône ; individu déguisé ou masqué. Au flg., personne bizarrement accoutrée. - (20) |
| carnavau n.m. Personnage déguisé pour Carnaval. - (63) |
| carnavau, s. m., carnaval. S'applique également à une personne masquée : « Oh! c'ment ôl é gôné ! Y é, ma fi ! eun biau carnavau !» - (14) |
| carnaviau (un) : ridiculement accoutré. « Gôné c’ment un carnaviau » : mal habillé, déguisé comme au Carnaval - (62) |
| carnaviau : une personne déguisée pour carnaval - (46) |
| carne : charogne. - (09) |
| carne n.f. Vache maigre. - (63) |
| carné, carnot (de)(loc.) : de quart, de travers - (50) |
| carne, s. f. terme de mépris, injure. - (08) |
| carne, s.f. vieux cheval. - (38) |
| carne. Animal rétif, méchant. Se dit aussi de la viande coriace. - (49) |
| carne. Mauvaise viande. Ton bout de bœu ast dur quement de lai carne. - (13) |
| carnéchi v. Voir carnassi. - (63) |
| carnechon : partie de l'essieu avant d'un char sur laquelle pivote l'aiguille. A - B - (41) |
| carnette : s. f., tresse de cheveux. - (20) |
| carneuté : tirer à soi, resquiller. (RDM. T IV) - C - (25) |
| carneuté, vt. n. faire manger indûment à son bétail, principalement aux moutons, le pâturage ou la récolte d'autrui. - (17) |
| carnia. C'était un petit lavoir couvert, d'une construction fort ancienne, situé sur la Bouzaize, dans la partie actuellement couverte qu'on appelle « avenue de la République. » On y accédait par la rue du Lieu-Dieu... - (13) |
| carniau (n.m.) : gros nuage d'orage - pluriel : carniaux - (50) |
| carniau n.m. (du v. fr. carnel, créneau). Gros nuage sombre et menaçant. - (63) |
| carniau. s. m . Soupirail de cave. (Vertilly). - (10) |
| carniaud : cumulo-nimbus, nuage orageux - (34) |
| carniaud. Gros nuage noir, annonçant généralement l'orage ou la pluie. - (49) |
| carnicher. v. n. Jouer aux billes. (Armeau). - (10) |
| carnié, carnassière, gibecière. - (16) |
| carnier (on) : cartable - (57) |
| carnio : gros cumulus d'orage. A - B - (41) |
| carofée, sf. giroflée. - (17) |
| carogne : (nf) (dans les jurons) charogne - (35) |
| carogne n.f. Charogne : insulte lancée à une bête rétive ou agressive. Une bête crevée se dit tsarogne. - (63) |
| caroiche, cabouèche. s. f. Caboche, tête, cervelle. (Sermizelles). - (10) |
| caroler, v. n. réciter la formule commençant certains jeux d'enfants. - (24) |
| carölou, sm. [carreleur]. cordonnier. - (17) |
| câron, côgnon. n. m. - Morceau de pain : « Coupe moué don' un caron de pain » (Fernand Clas, p.232) - (42) |
| câron, sm. coin du feu. - (17) |
| carosse : caisse en bois, rembourrée de paille, chiffon, coussin, ouverte en haut et sur une longueur, utilisée par les laveuses pour se mettre à genoux au lavoir. - (33) |
| carotte : betterave A - B - (41) |
| carotte : (nf) betterave - (35) |
| carotte : betterave - (43) |
| çarotte : petite voiture à deux roues. VI, p. 6 - (23) |
| carotte n.f. Betterave fourragère. - (63) |
| carotte rodze n.f. Betterave rouge. - (63) |
| carotte rouge : s. f., betterave potagère. - (20) |
| carotte, s. f. betterave à salade. - (24) |
| carotte. Betterave fourragère. Par contre, la carotte s'appelle « pastonnade ». On désigne encore la betterave fourragère sous le nom de« blette». - (49) |
| caroute, s. f. betterave à salade. - (22) |
| carpaille, petits poissons. - (05) |
| carpaille. Petite carpe d'empoissonnement. - (03) |
| carpalin : chapeau. O soulo on métin le carpalin : au soleil on mettait le chapeau. - (33) |
| cârpe (na) : carpe - (57) |
| carpe à l'éperon : voir picasse - (23) |
| carpé, adj. se dit des animaux qui ont des épis dans le poil, des touffes qui se hérissent. - (08) |
| carpenion : capitule de la bardane - (43) |
| çarpentier (n.m.) : charpentier - (50) |
| carpeter (Se) (carp'ter) : v. r., se démener en parlant, faire de grands gestes, s'agiter. - (20) |
| carpiot : carpe - (44) |
| carpiter. v. Crépiter : « Y'a lard qui carpite dans la pouél ! » (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| carquelin : civet préparé avec la fressure du cochon. (A. T II) - D - (25) |
| carquelin : Craquelin, espèce de gâteau sec. « La manman est au moulin, elle apportera in carquelin… ». Vieille chanson. Voir au mot bardolé. - (19) |
| carquelin : les abats ensanglantés du cochon destinés à être cuisinés - (46) |
| carquelin : s. m., craquelin. Des carquelins farcis (fourrés). - (20) |
| carquelin, s. m., craquelin, sorte d'échaudé sec, que certains trempent dans leur café au lait. - (14) |
| carquelin. s. m. Cartilage des oreilles. (Bagneaux). - (10) |
| carquelle : hanneton. (P. T IV) - Y - (25) |
| carquelle. s. f. Hanneton. - (10) |
| carquesse, s. f. on donne ce nom, je crois, à la petite ciguë qu'on appelle aussi faux persil. La carquesse est vénéneuse. - (08) |
| carqueuille. s. f. Personne sans probité. - (10) |
| carquille, feuillette à porter l'eau. - (05) |
| carquillon, 1/2 feuillette à porter l'eau. - (05) |
| carraco : genre de veste féminine, portée autrefois - (34) |
| carradeau, carradou : s. m., coecum, premlère partie du gros intestin (chez les animaux) ; saucisse ayant cette membrane pour enveloppe. - (20) |
| carrai (se), se carrer, c.-à-d. s'admirer dans sa tournure ou dans ses habits. - (02) |
| carrailler, carayer : v. a., lancer avec force. Carayer une pierre. — Nous préférons l'orthographe carrailler, qui rappelle l'origine vraisemblable de ce mot : lancer des carreaux d'arbalète. Voir carrocher, carocher. - (20) |
| carrailli v. Lancer avec force (une pierre). Ce verbe pourrait avoir un rapport avec les carreaux d'arbalète. - (63) |
| carre - coin, retrait, angle d'une chambre, de travers. – Ci nos embaraisse cequi mets le don voué lâvan dan le carre. - En met cequi dan in carre, to bonnement. - De carre en coin. - (18) |
| carre (de), loc. adv., de côté, de travers. Paroles de carre ; regarder quelqu'un de carre : « Je n' vas pu l’vouer ; ô m'a métu d' carre » (mis de côté). - (14) |
| carre (du feu), s.m. caisse (de forme carrée) pour mettre le bois destiné à être brûlé. - (38) |
| carre (faire la), loc. regarder sournoisement, méchamment, en coin. - (24) |
| carré (faire le), locution verbale : ne pas venir travailler le lundi. - (54) |
| carre : Coin. « Va te siter au carre du fu » : vas t'asseoir au coin du feu. « De carre en coin » en diagonale. - (19) |
| carre : s. m. (fr.. férn.), angle, coin. Mets-y donc dans c' carre. De carre, d'angle, de côté. De carre en coin, qui se présente par l'angle et non par la face, de guingois, de travers. - (20) |
| carré : s. m., oreiller. - (20) |
| carre, coin ou refuge anguleux. - (05) |
| carre, coin. Tô po le carre de lai velle. (Dial. franç. et borg. ) - (02) |
| carre, n.m. coin (au carre du feu). - (65) |
| carre, s. m. coin. Espace réservé. - (22) |
| carre, s. m. coin. Espace réservé. De carre en coin, en diagonale. - (24) |
| carre, s. m., coin, angle, foyer. Nous disons : le jeu des quat carres pour : le jeu des quatre coins. - (14) |
| çarre. Cendre, cendres… - (01) |
| carre. Coin. - (03) |
| carre. s. f. Angle, côté, face terminée carrément. La carre d’une rue. La carre d’un bois. Les quatre carres d’une table. Se coiffer de carre. Du latin quadra. - (10) |
| carré. Terme pour désigner des plantes aquatiques. Du latin carex qui spécifie l'une d'elles. - (03) |
| çarre. : Cendre, et çarrier, cendrier. – Le patois redoublait volontiers la consonne finale en faisant disparaître la consonne précédente ; Il substituait .volontiers aussi à la syllabe en la voyelle a, comme on le voit ici et comme on peut l'observer dans les verbes prarre ou parre, pour prendre, et éprarre, pour apprendre. - (06) |
| carreau (on) : vitre - (57) |
| carreau n.m. Vitre. - (63) |
| carreau, s. m., pierre. Sens absolu. Ce n'est pas sans surprise qu'on entend dire : « Ol a jeté des carreaus dans mes vitres ». Nous avons recueilli : « va à la ruine du châtiau ; ma y é por y prendre des carreaus por son mur. » - (14) |
| carrée (la), s. f., tente, logette en toile, parfois en planches, construite pour abri sur le bateau et le radeau. - (14) |
| carrée (lai), la, principale, voire la seule pièce d'une habitation ; maison où il y a un peu de désordre. - (27) |
| cârrée : pièce principale de la maison - (48) |
| carrée : (câ:ré: - subst. f.) dallage d'une pièce ; la pièce elle-même. - (45) |
| carrée, s. f., pièce où l'on se tient le plus souvent. - (40) |
| carrée, subst. féminin : maison, logement ou cuisine. - (54) |
| carrée. Ce mot désigne dans la langue correcte la couronne ou s'attachent les draperies d'un lit (Littré) ; nous l'avons étendu a la chambre, puis à la chambrée, enfin à la maison et à la maisonnée. - (12) |
| carrée. s. f. Nom donné par les mariniers de l’Yonne à la cabane de leurs bateaux, à cause de sa forme quadrangulaire et de sa couverture plate ou légèrement bombée. - (10) |
| carréger, v. a. charroyer, transporter sur une voiture. - (08) |
| carrenô. Petit coin. Voyez Quarre, dont carrenô, qu'on pourrait écrire quarrenô, est un diminutif. - (01) |
| carrenô. : Petit coin, diminutif de carre. - (06) |
| carrer (se), v. pr., se ranger, se mettre de coté. - (14) |
| cârrer (se). v. - Se placer : « On s’fourra dans l'lit ens' carrant coumme on put. » (M. Cornevin, Contes Patoisants, p.23) - (42) |
| carrer v. Enfoncer, placer solidement. - (63) |
| carrer : v. a., acculer, pousser dans un carre. - (20) |
| carreuchi (se) : Se lancer des pierres, des mottes de terre ou tout autre objet. - (19) |
| carreyeur. Carrier. - (49) |
| carriât, s. m., charrette à quatre roues. - (40) |
| carrieau. n. m. - Beignet. (Saints, selon G. Pimoulle) - (42) |
| carriére : n. f. Carrière. - (53) |
| carrillon n.m. Très petite parcelle de terre. A Suin, on dit cacrellon. - (63) |
| carrillon : s. m., vx fr. carillon, petit carré, angle. Dans tous les coins carrillons, jusque dans les plus petits coins. - (20) |
| carrocher, carocher : v. a., lancer une pierre contre quelqu'un ou quelque chose, lapider. Voir carrailler, carayer. - (20) |
| carrochi – câler : jeter - (57) |
| carroge : croisement de chemins. Pour Carrouge, de carrum : lieu où passent les charrettes. Et chez nous un quartier. - (62) |
| carroir. n. m. - Friche en bordure d'une route ou d'un chemin. (Diges, selon M. Jossier) - (42) |
| carroir. s. m. Terrain vague au bord d’un chemin. (Diges). — On dit aussi carroi, carroué. Dans une foule de communes, il existe des climats portant une de ces dénominations. - (10) |
| carron (on) : brique - (57) |
| carron : s. m., vx fr., carreau, brique de carrelage. - (20) |
| carron*, s. m. vitre, carreau de verre. - (22) |
| carron, s. m. vitre, carreau de verre. - (24) |
| carron. s. m. Coin, fragment de carre. — Carron de pain, morceau du chanteau, dans lequel il y a plus de croûte que de mie. Voyez carre. - (10) |
| carronage : s. m., carrelage. - (20) |
| carroner : v. a., vx fr., carreler. - (20) |
| carronier : s. m., fabricant de carrons. - (20) |
| carronière : s. f., briqueterie. La Carronnière, hameau de la commune de Romenay. - (20) |
| carrosse. s. m. Garde -genoux d’une laveuse. Se dit par ironie, par antiphrase. - (10) |
| çarrotte, charrette - (36) |
| carrouaize (n.m.) :carrefour (du lat. quadruvivm , carrefour ; a.fr. carroge) - aussi carrouaige - (50) |
| cârroué (n. m.) : carrefour - (64) |
| carrouge : carrefour. III, p. 16-i - (23) |
| carrouge. n. m. - Carrefour. Mot employé en français depuis le XIVe siècle ; carroge ou carrouge est issu du latin quadruvium : quatre voies, carrefour. - (42) |
| carrouge. s. m. Carrefour, endroit où plusieurs rues, plusieurs chemins viennent aboutir. - (10) |
| carruge, place vague, plâtre. - (05) |
| càrtâble (C.-d., Chal.).- Gibecière, portefeuille en carton ou en cuir, dans lequel les écoliers placent leurs livres et leurs cahiers et qu'ils suspendent à leur cou par une courroie, comme un baudrier…. - (15) |
| cartable : Sac d'écolier. « Mens totes tes affâres dans tan cartable ». - (19) |
| cartable, s. m., sorte de grand portefeuille en carton, dans lequel l'écolier met ses cahiers et ses livres. - (14) |
| cartager (v. int.) : cartayer, conduire une voiture de façon qu'une des ornières soit placée entre les roues, pour éviter les cahots - (64) |
| çartain : Certain, sûr, « Je n'en sus pas çartain » : je n'en suis pas sûr. - (19) |
| çartaln. Certain, certains. - (01) |
| cârte (na) : carte - (57) |
| carteau V. quarteau. - (05) |
| cartée, s. f., quartier, gros morceau : « Y ét eun fameus goulu ; ô vous mainge des cartées d' pain !... » - (14) |
| carteger : monter une côte en zigzaguant. (LS. T IV) - Y - (25) |
| cartelot, quartelot. s. m. Quartier de pain. (Courgis). — Dans le commerce de bois, on appelle quartelot , une sorte de planche de bois blanc ayant trois fois épaisseur d’une volige champagne. - (10) |
| carter : quartier, morceau - (39) |
| cartheranche. : Partie équivalant à la quartemesure d'un tout. Franchises de Rouvres, 1357. - (06) |
| cartiballe (a la), catibale (A la) : Ioc. adv., à califourchon sur les épaules. Il portait son enfant à la cartiballe. - (20) |
| cartille, cartelle. n. f. - Quartier, morceau, tranche : « Dounne moué une cartille de pain ! » - (42) |
| cartille. s. f. Morceau, tranche. Une cartille de pain. - (10) |
| cartin, quartain. s. m. Petite corbeille d’une contenance déterminée, dans laquelle on donne l’avoine aux chevaux. - (10) |
| cartin. n. m. - Petite corbeille en osier, dans laquelle on donne l'avoine aux chevaux. - (42) |
| cartotse n.f. Cartouche. - (63) |
| cartouchlle, s. f. pomme de terre. - (22) |
| caruge. Pâturage communal. - (03) |
| cârûse (l’) : lieu constitué essentiellement par une friche de genêts, de genévriers et de fougères, entre « le village de l’homme » et la forêt de mouasse - (37) |
| çarvalle : cervelle - (37) |
| çarvèle, sf. cervelle. - (17) |
| çarvelle (n.f.) : cervelle - (50) |
| çarvelle, s. f., cervelle, intellect. - (14) |
| carvelle. n. f. - Cervelle. (Arquian) - (42) |
| çarviau (n.m.) : cerveau - (50) |
| carviau. n. m. - Cerveau. - (42) |
| çarzer (v.) : charger - (50) |
| çarzer (v.t.) : charger - (50) |
| çarzer, v. a. charger, mettre une charge sur... confier une mission à quelqu'un, etc. - (08) |
| câs (faire) loc. prêter attention à. - (63) |
| casaquin, habillement de femme. Les Bretons disent keseghen (Lep.) pour jupe. - (02) |
| casaquin, s. m., camisole, courte et sans manches Se prent fréquemment, au fig., pour le clos : « Attens ! j' vas t'en flanquer su l' casaquin ! » - (14) |
| casavé : caraco. - (30) |
| Cascaret : nom de mulet. VI, p. 16 - (23) |
| cascaret. Jeu de cartes national dans lequel le valet de trèfle, qui est la figure principale se nomme cascaret. Etym. cascaret, vieux mot désignant un homme de mine chétive (Littré). - (12) |
| caseau, caiseau, casiau, caisiau : s. m., caillette, quatrième estomac des ruminants, qui sert à faire la présure. Le commerce des caisiaux est exercé dans certaines localités par des individus désignés sous le nom de « marchands de ventres de veaux ». - (20) |
| caser. v. n. Terme du jeu de billes. Action d’envoyer sa bille au but ou contre celle de son partenaire, et de l’atteindre, de la choquer, de la frapper plus ou moins raide. - (10) |
| casias et câsis. Présure : lait caillé renfermé dans l'estomac d'un veau. On le conservait dans des vessies suspendues, jusqu'au moment où l’on devait s’en servir pour faire prendre le lait dans la fromagerie. Ce mot patois vient en droite ligue du latin caseus. - (13) |
| casiau, s, m., vessie. Celle de veau sert à la confection de la pressure pour faire prendre nos bons fromages blancs des Bordes. - (14) |
| casiau. Pressure pour faire coaguler le fromage ; du latin caseus, fromage. - (03) |
| casiau. s. m. Membrane de la caillette du veau, présure, qui sert à faire cailler le lait. Du latin caseus, fromage. - (10) |
| casieau, présure. - (05) |
| casière : s.ff., vx fr. chasier, cage à fromages. - (20) |
| caso. Terme injurieux, de l'italien cazzo. - (03) |
| cass’roule : casserole - (43) |
| cassaule, adj. sujet à être cassé. le verre a été très « cassaule » jusqu'à ce jour. - (08) |
| casse (a bref), adj. Durci. Pain casse. Terre casse. - (10) |
| càsse (C.-d., Morv., Br., Chal., Char.), caisse ou quesse (C.-d., Y.). - Poêle à frire, du bas latin cassa, poêlon. Désigne aussi un bassin à longue tige servant à puiser de l'eau. A rapprocher de fricasser, qui semble une contraction de l'expression : frire dans la casse, et de casserolle qui en est un diminutif. En Bourgogne, les tétards de batracien sont appelés aussi queues de casse, en raison de leur forme (quouquaisse en patois de la Côte et de l'Yonne, où casse se prononce également caisse ou quaisse). Voir plus loin ce mot. - (15) |
| casse (cuesse) : poêle à frire - (51) |
| cassé (être). Avoir une hernie. L'expression ne s'explique que par les connaissances fantastiques que les gens du - (12) |
| casse (la vatse se) : (vb) la vache est prête à vêler - (35) |
| casse (na) : poêle (casserole) - (57) |
| casse (queue de), têtard de grenouille. - (05) |
| casse : (nf) poêle à frire - (35) |
| câsse : Caisse, boîte. « Eune câsse de savan » : une caisse de savon. - (19) |
| câsse : Cassé. « Ce varre est câssé » : ce verre est cassé - (19) |
| cassè : casser - (46) |
| casse : poêle - (34) |
| casse : poêle à frire - (43) |
| casse : poêle à frire - (44) |
| casse : poêle à frire. - (62) |
| casse : Poêle à frire. « Teni la quoue de la casse » : avoir la responsabilité de l'affaire, par allusion à celui qui prend la queue de la poêle pour tourner l'omelette. - « Coue de casse » : têtard, jeune grenouille. - (19) |
| casse : s. f., bas-lat. cassa, casserole. Casse fritoire, poêle à frire. - (20) |
| casse : petit récipient en cuivre à longue queue. - (33) |
| casse et caisse est le synonyme de poêle à frire et l'augmentatif de casserolle. Les casses en fer battu servaient à faire des omelettes et les casses en cuivre jaune, a confectionner la bouillie... Dans le Morvan, une casse est un bassin à puiser de l'eau. Queue de casse est le nom patois du petit batracien appelé têtard : il ressemble en effet à un poëlon. - (13) |
| casse : gros morceau de terre, de neige, de pain - (39) |
| cassé : s. m., gâteaux qui, s'élant brisés ou n'étant plus frais, sont mis au rebut pour être vendus à vil prix. - (20) |
| casse, adj. des deux genres. cassé, courbé, rompu, fatigué, affaibli : « c'te fonne n'ô pâ veille, mâ ile ô diji casse », cette femme n'est pas vieille mais elle est déjà courbée. - (08) |
| casse, caisse : n. f. Poêle à frire. - (53) |
| câssè, caissè : v. t. Casser. - (53) |
| casse, lèchefrite, plat, casse, bassin à queue dans lequel on boit. - (04) |
| casse, n.f. poêle à frire. - (38) |
| casse, n.f. poêle à frire. - (65) |
| casse, poêle à frire. - (05) |
| casse, poêle à frire. - (16) |
| casse, s. f. bassin à queue dont on se sert pour boire. - (08) |
| casse, s. f., poêle à frire : « T'as breûlé ma casse en f'sant ton om'lette. » On trouve ce mot dans une partie du v. fricasser, et le verbe entier semble contenir la contraction de frire dans la casse. - (14) |
| casse, s. f., poêle à frire, à long manche. - (40) |
| casse, subst. féminin : poêle à frire. - (54) |
| casse. L'endroit où, parlant des irrévérences à la messe, il est dit que ceux qui les commettent « airon de lai casse », donne à entendre que le Seigneur les « cassera » aux gages, les privera de ses grâces. - (01) |
| casse. Poêle à frire, de capsa. Nous appelons « queue de casse », la grenouille à l'état de tétard, à cause de sa ressemblance avec une poêle. - (03) |
| casse. Poêle à frire. - (49) |
| casse’roule : (nf) casserole - (35) |
| casse-croute : s. m., petit repas, goûter. - (20) |
| casse-croûte. s. m . Gourmand, fainéant, qui mange plus qu’il ne gagne. - (10) |
| cassée (la vatse est) : vache prête à vêler - (43) |
| cassemeusse, sm. f. individu sournois, roublard. - (17) |
| cassemindien. s. f. Câlin, flatteur, hypocrite, qui parle autrement qu’il ne pense, qui parait ce qu’il n’est pas. C’est sans doute une altération de comédien. (Poilly-sur-Serein). - (10) |
| casser - r'lichi : glisser - (57) |
| câsser : casser, briser. « Ol a cassé eune assiètte ». - Faire mal, « J'ai cheu, i m 'a bien câssé » : je suis tombé, cela m'a bien fait mal. - (19) |
| casseure : Fracture d'un membre. « O s'est déteurdu le pi, an ne sait pas si o s'est fait eune entôrse ou eune casseure » : le pied lui a tourné, on ne sait pas s'il s'est fait une fracture ou une entorse. Au figuré grande fatigue. « Reposer la casseure » : c'est rester longtemps au lit après un travail fatiguant. - (19) |
| cassi, e, adj. se dit des terres grasses qui, par suite de la sécheresse, se ramassent en petites mottes compactes. - (08) |
| cassie, s. f. la quantité de liquide que peut contenir une casse : une pleine « cassie. » - (08) |
| cassie. s. f. Sachée, plein sac. (Rogny). - (10) |
| cassiette (n. f.) : casquette - (64) |
| cassiette (une) : une casquette - (61) |
| cassiette. n. f. - Casquette. - (42) |
| cassine : petite pièce à l'arrière des granges qui pouvait servir d'écurie - (51) |
| cassine, maison mal tenue. - (27) |
| cassine, s. f. rosse, haridelle. - (08) |
| cassine. n. f. - Brebis. - (42) |
| cassine. s. f. Masure, cabane tombant en ruine ; vieille brebis, brebis maigre et malade. - (10) |
| casso : tête. - (30) |
| cassôle : n. f. Casse ou se casse facilement. - (53) |
| casson : (nm) petit tas - (35) |
| casson : matière agglomérée (par ex. paille moisie), grumeaux - (48) |
| casson : petit tas (en particulier de fumier que l'on dépose dans les prés avant de l'étalé) - (51) |
| casson : petit tas de foin - (43) |
| casson : gros morceau de terre, de neige, de pain - (39) |
| casson : s. m., syn. de cuchon. Voir cuche. - (20) |
| casson, catson n.m. (anc. fr. quacier, compacter). Petit tas (de fumier). - (63) |
| casson, n.m. tesson de verre. - (65) |
| casson, s. m. on dit des matières farineuses qu'elles sont « en cassons » lorsqu'elles se ramassent par l'effet de l'humidité et s'agglutinent en grumeaux isolés. - (08) |
| câsson. n. m. - Tesson, débris. - (42) |
| cassonner : v. n., mettre en cassons. - (20) |
| cassot : casserole - (34) |
| cassroûlade n.f. Action consistant à casser les pieds à son interlocuteur. - (63) |
| cassroûler v. Casser les pieds. En français familier on trouve le verbe bassiner, parfait équivalent. - (63) |
| cassûre, fracture, hernie. - (16) |
| castafouine : s. f., matière fécale. - (20) |
| castafoure, sf. prison ; bouge ; fond de cave. - (17) |
| castagne. s. f. Brebis, moutons réunis en certain nombre. (Percey). — Voyez bergasse. - (10) |
| castille : pierre servant de fondant pour le minerai de fer. VI, p. 15-3 - (23) |
| castille, s. f. fragment de pierre à chaux qui éclate dans le feu en soulevant la cendre. - (08) |
| castiller. v. a. Quereller, chercher noise, chercher castille. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| castonade, cassonade, sucre brut de canne. - (16) |
| castonade, s. f., cassonade. - (14) |
| castrer, v. a. châtrer. - (08) |
| casuel - fragile.- En fau fâre bein aitention cair c'â tot ai fait casuel ; c'â de lai vaisselle, et pu de porcelaigne encore !... – Te sai, c'â en verre, qu'en n'é ran de pu casuel. - (18) |
| casuel, adj., cassant, fragile : « O li a baillé des bagues. N'empôche ; y et eun amoureus ben casuel. » - (14) |
| casuel. adj. - Fragile. Au XIVe siècle, casuel signifiait accidentel, fortuit, hasardeux. Le poyaudin pourrait avoir effectué un glissement de sens de l'abstrait vers le concret, de hasardeux, peu sûr, à fragile. - (42) |
| cat (terrain), argileux, compact. - (05) |
| cat. Qui est comme la terre glaise, compact. Pour terre glaise, nous disons terre grasse. - (03) |
| cat’yi, s. m. cabinet d'aisance. - (22) |
| catacois : voir cacatois. - (20) |
| catailogue (n.m.) : catalogue - (50) |
| çâtaingne (n.f.) : châtaigne - (50) |
| çâtaingnier (n.m.) : châtaignier - (50) |
| catale : (nf) crotte de chèvre - (35) |
| catale : Crotte. « Des catales de lapin ». - (19) |
| catale : crotte. En particulier les crottes sèches restées à l’arrière-train des bovins, caprins. Catole en Suisse. - (62) |
| catale : denrée de petite taille - (51) |
| catale, n.f. crotte de chèvre. Désigne aussi familièrement la chassie des yeux (il a les yeux catalous). - (65) |
| catale, s. f. crotte de chèvre, de lapin. - (22) |
| catale, s. f. crotte de chèvre, de lapin. - (24) |
| catalé, v, n. se dit d'objets tombant en cascade et en crépitant. - (22) |
| cataler : (vb) crotter - (35) |
| cataler, v. n. se dit d'objets tombant en cascade et en crépitant : le vent fait cataler les prunes. - (24) |
| catales, fientes de mouton. - (05) |
| catales, s. f., crottes de chèvres. - (40) |
| catalle n.f. Crotte de chèvre ou de lapin. On dit plus souvent keurtelle. - (63) |
| catalle, catelle : s. f., crotte ronde, telle que celle de la chèvre, du lapin, du rat ; mucosité desséchée du nez de l'homme. Lyonnais : catolle. - (20) |
| cataller v. Faire des petites crottes rondes comme celles des chèvres ou des lapins. Alle avance autant à causer qu'eune tseuvre à cataller. Elle parle très vite. - (63) |
| cataller : v. n., faire des catattes. Elle avance autant à parler qu'une chèvre à cataller (c'est-à-dire elle parle très vite). - (20) |
| catallon : s, m., dim. de catalle. - (20) |
| catalloux adj. Crotté. - (63) |
| catalloux, (ouse) : adj., crotté. Regarde donc ton nez, il est tout catalloux. - (20) |
| catalon, s. m. petite pomme avortée. - (22) |
| catalon, s. m. petite pomme avortée. - (24) |
| catalou : crotté. L’option de terminaisons en « ou », au masculin, n’interdit pas d’admettre le féminin en « ouse » - (62) |
| catalou(ze) : (adj) crotté(e) - (35) |
| catalou, crotou : crotté - (43) |
| catamoise, catamouèse. n. f. - Jeune fille désagréable, hautaine et prétentieuse. Se dit également d'une jeune fille peu sérieuse. « Allez tous et tertous, enl'vez les catamoises, fait' claquer les peutoises, galoupez coumm' des fous, démantibulez-vous. » (F. Clas, p.l22) - (42) |
| catamoise. s. f. Fille. Se dit le plus souvent en mauvaise part. Ainsi , à Auxerre, il y a quelque 80 ans, il n’était pas rare d’entendre une mère irritée traiter sa fille de catamoise. - (10) |
| catan : Grumeau. « T'as pas bien démôlé ta boulie, aile est tote en catans » : tu n'as pas bien délayé ta bouillie, elle est toute en grumeaux. Vieux français, caton. - (19) |
| cataplâme : Cataplasme. « In cataplâme de pain mâchi (mâché) », remède de bonne femme contre les meurtrissures. - (19) |
| cataplame, s. m., cataplasme. - (14) |
| cataplame. s. m. cataplasme. - (08) |
| catareu, euse, adj. sujet à se gâter, à se corrompre, à perdre en qualité, chanceux : ce commerce est « catareux », cette affaire est « catareuse. » - (08) |
| catarine, beûzaiñne (moutse) : (nf) cantharide, mouche « plate » - (35) |
| catarine, s. f., cantharide : « O li a métu des mouches catarines ». A mettre à côté des mouches catholiques des Berrichons. - (14) |
| catarrhe : s. m., inflammation chronique de l'intestin chez les jeunes enfants. - (20) |
| catau, s. f., fille de mauvaise vie. Est aussi, comme catin, le nom de la poupée d'enfant. Diminut. de Catherine. - (14) |
| cataud : marchand de chèvres qu'on voyait surtout l'hiver vêtu de leur peau de loup et qui allait de marché en marché pour acquérir les chèvres trop vieilles. - (30) |
| cataurelle crômée (n. f.) : tartine de beurre recouvert de confiture ou de chocolat - (64) |
| Cataut : none de mule. VI, p. 16 - (23) |
| câtch : une carte à jouer - (46) |
| catchi. n. m. - Châssis. (Mézilles, selon H. Chéry) - (42) |
| catchin, caquin. n. m. – Œuf. Terme enfantin. - (42) |
| catéchime, s. m., catéchisme. - (14) |
| catéchime. Catéchisme. - (49) |
| catécime, catéchisme. - (05) |
| catécime, s. m. catéchisme. - (08) |
| catégorie, s. f. grand nombre, grand choix. - (22) |
| catégorie, s. f. grand nombre, grand choix. - (24) |
| Cateigna. Le maréchal de Catinat. - (01) |
| Câteline, nom de femme pour Catherine. - (08) |
| catelle : Redingote. « Ol a mis sa catalle de noce ». - (19) |
| catelogne : s. f. couverture piquée. - (21) |
| cater, v. tr., jeter, lancer, pousser. - (14) |
| catère (n.f.) : convulsion du nourrisson - (50) |
| catère : épilepsie, convulsion - (60) |
| caterre, catarrhe, cautère. - (04) |
| catessime : Cathéchisme. « As-tu-bien appris tan catessime ? ». Au figuré, dire à quelqu'un son « catessime », c'est lui dire son fait. « Attends voir y est ma que va li dire san catessime ! » - (19) |
| çateur-cien (n.m.) : châtre-chien - mauvais couteau qui coupe mal - (50) |
| catharine Voir moutse pyate. - (63) |
| catharneux. Catharreux. - (49) |
| catharreux, aléatoire, qui ne réussit pas toujours. - (27) |
| catherinette. s. f. Couturière, fille qui a coiffé sainte Catherine. - (10) |
| catherme. Convulsion. - (49) |
| çatiau (n.m.) : château - (50) |
| catiau, s. m. château. On donne par courtoisie ce nom à toutes les maisons bourgeoises attachées à un domaine d'une certaine importance. Le château en Morvan est le principal « châ » du pays, voilà tout. - (08) |
| catiche, catin : poupée, femme de mauvaise vie - (48) |
| catîche, s.f., poupée de chiffons. - (40) |
| catichimeux. s. f. Enfant qui fréquente le catéchisme. - (10) |
| catifère : en mauvaise santé - (60) |
| catin (n. f.) : extrémité supérieure d'un sac de grain, au-dessus du lien - (64) |
| catin, cataut. s. f. Poupée ; femme de mauvaise vie. A Saligny, le nom de catin se donne aussi quelquefois à un petit agneau, sans doute parce qu’on joue avec lui comme avec une poupée. - (10) |
| Catin, nom propre, Catherine. - (38) |
| catin, s. f. poupée d'enfant. - (08) |
| catin. n. f. - Poupée, se dit également d'un pansement au doigt. - (42) |
| câtine (câtiche) : pansement à un doigt, poupée - (39) |
| catine. n. f. - Coiffe poyaudine portée par les femmes : sorte de bonnet plat de couleur blanche, bordé de dentelle, et noué sous le menton. - (42) |
| catiner. v. - Jouer à la poupée. - (42) |
| catiner. v. n. Jouer à la poupée, faire, habiller des poupées. - (10) |
| catinier. s. f. Petit garçon qui aime à jouer avec les filles, à la poupée. - (10) |
| catio, s. m., plat, pot, vase. - (14) |
| catio. Plat. - (03) |
| catissime (le) : catéchisme - (57) |
| çatje, sm. cercle. - (17) |
| catoles n.f.pl. (de caton). Excréments secs qui pendent au derrière des vaches. - (63) |
| catôlicle pour catholique. : Le peuple parlait ainsi chez les Parisiens comme chez les Bourguignons. Il en était de même pour nombre de terminaisons en ique: bouticle, canticle, musicle, etc. - (06) |
| catôlicle. Catholique, catholiques. - (01) |
| caton (à), loc. adv., à quatre pattes, à la manière d'un chat ; « L'boun houme, ô marche à caton pour obuyer son p'tiot ». - (14) |
| càton (Br., C.-d., Chal.), casson, quiaisson (Morv.). - Portion de matière agglomérée, caillot de sang, de lait, ou grumeau de farine ; vient du même mot en vieux français, lequel avait la même signification et venait du latin coactus, pressé, resserré. - (15) |
| caton (on) - gremeau (on) : grumeau - (57) |
| caton : (nm) grumeau - (35) |
| caton : grumeau - (34) |
| caton : grumeau - (43) |
| caton : grumeau de farine. - (30) |
| caton n.m. Grumeau. - (63) |
| caton : boulette que l’on trouve dans une pâte mal délayée. (CH. T II) - S&L - (25) |
| caton : s. m., vx fr., grumeau, agglomérat. Ma sauce a tourné, elle est tout en catons. Que donc qu' vous avez fait c'te nuit dans vot' lit qu' vos draps sont tout en catons ? Morvan : casson. - (20) |
| caton, grumeau de farine, - (16) |
| caton, n.m. grumeau. - (65) |
| caton, s. m. grumeau (vieux français) ; personne grosse et malhabile. - (24) |
| caton, s. m. grumeau ; personne grosse et malhabile. - (22) |
| catonné : (p.passé) en grumeaux - (35) |
| catonné : en grumeaux - (43) |
| catonner v. Faire des grumeaux. - (63) |
| catonner : v. n., vx fr., se mettre en catons. Ne mets pas tant d'eau à la fois dans c'te farine, elle va catonner. Voir décatonner. - (20) |
| catons (en). Emmêlé ; formant comme un bourrelet : « cheveux en catons ». - (49) |
| catons, s. m., grumeaux qui se forment dans toute farine par suite d'humidité, ou parce qu'elle est mal délayée. - (14) |
| catons. Grumeaux qui se forment dans la farine ou dans le plâtre. Ecafouille (écrase) ben lai fareune ; sans celai an y aîrot des catons dans lai bouillie. À Autun, l’on dit cassons ; à Valenciennes on dit mâtons, d'où le verbe matonner, appliqué à la bière dans laquelle il se forme des caillots. Les Berrichons emploient comme nous le verbe catonner... - (13) |
| catoue : voir carcoue - (23) |
| çatrer (v.t.) : castrer - (50) |
| catrôchye, s. m. pomme de terre (allemand kartoffel. Italien tartufolo. Latin terrae tuferem, truffe de terre). - (24) |
| catrofle. Pomme de terre. - (03) |
| çatrou (n.m.) : hongreur (aussi châtrou) - (50) |
| catrouille : pomme de terre. (A. T IV) - S&L - (25) |
| catrouille, catrouçhye : pomme de terre (rare) - (35) |
| catrouille, pomme de terre. - (05) |
| catse-col n.m. Cache-col, écharpe. - (63) |
| catsette n.f. Cachette. Dzuer à la catsette : jouer à cachecache. - (63) |
| catsi (se) : cacher (se) - (43) |
| catsi : cacher - (51) |
| catsi v. Cacher, musser. - (63) |
| catson (à) : (loc adv) en cachette - (35) |
| catson (à) : en cachette - (43) |
| catson d’iau (à) : avec très peu d’eau - (35) |
| catson, casson n.m. (a.fr. quacier, compacter) Petit tas (de fumier). A Suin on dit feumron. - (63) |
| catsottî n. et adj. Cachottier. - (63) |
| catssette : cachette - (51) |
| cattale. Fiente de mouton. - (03) |
| catte, carte. - (26) |
| câtu, s. m. pays lointain, au dehors, à l'étranger; « voir du câtu », c'est voir du pays. - (08) |
| cau : coq ; se dit aussi, selon les endroits, zau ou pouilleau. - (52) |
| caublin (A). Locut. adverb. A califourchon. Porter un enfant à caublin. (Migé). - (10) |
| caucluche : Cabriole. « Fâre la caucluche » : faire la cabriole, cul par-dessus tête. - (19) |
| çaud (adj.) : chaud - (50) |
| caud : sans queue - (60) |
| caud, caude : dont la queue a été rognée. II, p. 12-15 ; III, p. 35-2 - (23) |
| çaud-laipin : coureur de jupons - (37) |
| caue (d’à). Locut. interrogat. D’à cause ? Pourquoi ? C'est un synonyme du qu' avis de la Puysaie. - (10) |
| cau'e. n. f. - Cause. - (42) |
| çauffaize (n.m.) : chauffage - (50) |
| çauffer (v.t.) : chauffer - (50) |
| cauger (se), couger (se) : y. r., se taire. voir coisir (se). - (20) |
| caugnon. s. m. Petit souchon de bois. Du latin cauda. - (10) |
| caule, bonnet. Abrégé du latin cuculla, sorte de capuchon. - (02) |
| çaumine (n.f.) : chaumière - (50) |
| caupe (n.f.) : coupe - (50) |
| cauper (v.t.) : couper - (50) |
| caur (n.f.) : cour - (50) |
| cauraize (n.m.) : courage - (50) |
| caurrouaie (n.f.) : courroie - (50) |
| caurt, caurte (adj.m. et f.) : court, courte - (50) |
| caurze (n.f.) : articulation en cuir du fléau (pour de Chambure : courze) - (50) |
| causé (s') : adv. Se fréquenter pour des amoureux. - (53) |
| causer (se), v. se fréquenter. - (65) |
| causer : parler - (57) |
| causer : parler - (48) |
| causer v. Parler. Dz'vos en cause pas ! Je ne vous en parle pas ! - (63) |
| causer, verbe intransitif : flirter, fréquenter quelqu'un. - (54) |
| causer. Bourguignon dans l’expression suivante : « Venez me causer un de ces jours, je vous expliquerai toute l’affaire. » Nous devrions dire : « Venez causer avec moi. » - (12) |
| causette : Conversation, causerie dans l'intimité. Aux veillées lorsque les garçons vont « voir les filles » (leur faire la cour). La fille de la maison admet à tour de rôle chacun de ses amoureux à lui faire la « causette » à l'écart. Cet usage est toléré par les parents. - (19) |
| causou (ze) : (adj) bavard (e) - (35) |
| causou : Bavard. « Causou à la jornée » : bavard qui cause sans s'arrêter, comme s'il était payé à la journée pour le faire. - (19) |
| causou, adj., causeur, bavard. - (14) |
| causou, ouse, s. m. et f. causeur, bavard, musard : « un causou, une causouse. » - (08) |
| caussai et cossai (se). : Se heurter. - (06) |
| çausse (n.f.) : chausse - (50) |
| caussée, s. f. ouvrage fait à bâtons rompus, à moments perdus : « i l'é fé ai caussées », c’est-à-dire à plusieurs reprises. - (08) |
| caustiqus : s. m., encaustique. - (20) |
| causû (n.m.) : bavard celui qui parle beaucoup - (50) |
| causu ou quausu : Quasi, presque « I est causu né » : il est presque nuit. - Bientôt, « T'as pas causu fini ? » : Tu n'as pas bientôt fini ? - (19) |
| caut, couaut (du latin caulus). s. m. Abri. Se mettre caut, à caut, à couaut, à la caut, à la cauïaut, se mettre à l’abri. Les formes couaut, cauïaut et mieux, selon nous, cauïau, semblent préciser davantage qu’on se met à l’abri de la pluie, de l’eau, de ïau. - (10) |
| caute (au) : se mettre à l'abri de la pluie - (34) |
| cautère : emplâtre (ç'ai pas pu d'aution qu'un cautère su eune jambe de bois) - (48) |
| cautère n.m. Lierre (jadis considéré comme un cautérisant). - (63) |
| cautère, n.m. lierre. - (65) |
| cautériser (se) : v. r., se cicatriser. Se dit en parlant d'une plaie en voie de guérison. - (20) |
| cautériser. Cicatriser. À la voix active, s'emploie pour dire soigner une plaie. - (49) |
| cauti : tresse de noisetier servant à faire des paniers, de la vannerie - (34) |
| cauti ne, s. f. femme câline, enjôleuse, qui flatte par intérêt. - (08) |
| cautin. adj. Cauteleux. (Vassy-sous-Pisy.) - (10) |
| cautires (les) : coussins frontaux qui sont placés sur les têtes des bœufs attelés - (43) |
| cauver. v. n. Causer. - (10) |
| cauyer (se), (se) taire - (36) |
| cavailler, ée. n. m. - Cavalier, cavalière. - (42) |
| cavale (à), à califourchon. - (27) |
| cavalerie. s. f . Race, espèce chevaline. La Puysaie élève, nourrit une belle cavalerie. - (10) |
| caveron. n. m. - Petite cave semi-enterrée dont l'accès se fait généralement par l'intérieur de l'habitation. - (42) |
| cavet (ette) : adj., bête. Il a l'air cavet. - (20) |
| caveûlant : le camp volant, les gens du voyage, les gitans - (46) |
| cavidon. conj. - Pourquoi. - (42) |
| caviron. : Petit caveau. (Del.) - (06) |
| cavo : un épis de maïs égréné - (46) |
| cavolant : n. m. Nomade. - (53) |
| cavon, caveron. s. m. Petit caveau en contrebas d’une cave. - (10) |
| cavoué. n. m. - Grand panier d'osier. - (42) |
| cavran : Caveau, coin de la cave où sont les vieilles bouteilles. - (19) |
| câvre, s. f. cave, lieu souterrain : « voiqui lai quié d'lai câvre », voici la clef de la cave. - (08) |
| cayan ou caillan: Porcelet, jeune porc. - (19) |
| caye (caïe) : s. f., truie. - (20) |
| caye (caïe), adj., avare. Qu' t'es donc caye ! On dit aussi d'un avare qu'il est « cochon ». - (20) |
| cäye : (nf) truie - (35) |
| caye caya, chant de la caille (onomatopée). - (16) |
| càye, adj. avare, égoïste. Ne s'emploie qu'au féminin : ah ! quelle est càye ! - (24) |
| càye, adj. avare. Ne s'emploie qu'au féminin : ah ! Qu’elle est càye ! - (22) |
| caye. Truie. - (49) |
| cayen. Terme injurieux, analogue au vieux mot pied plat. Il faut le rapprocher de cayement, employée dans un acte bourguignon de 1392 avec le sens de gordia, « d'homme quérant et demandant l'aumône. » Cayement a formé caymender, mendier, d'où nous sont venus quémander et ses dérivés. On a appelé cayemende et calemende, une grossière étoffe, rayée de couleurs vives, comme les vêtements des cayements et des bohémiens. (V. Coire et Gordiâ.) - (13) |
| cayenne (à) : dépotoir - (57) |
| càyi, s. m. lait caillé. - (24) |
| câyiot (éte) : avoir les jambes tordues, déformées, écartées - (39) |
| cayon (caïon) : s. m., vx fr. caion, porc. - (20) |
| cayon (cayonne) (caïon, caïonne) : adj., cochon, cochonne. Se dit des personnes. - (20) |
| cäyon : (nm) porcelet - (35) |
| ça-yon : porcelet - (43) |
| càyon, s. m. porc, en langage plaisant. - (22) |
| càyon, s. m. porc, en langage plaisant. - (24) |
| cayouté quelqu'un, lui jeter des pierres. - (16) |
| cazavet. Sorte de caraco un peu long et ample. - (49) |
| cazuel, fragile, qui se casse facilement. - (16) |
| cbàpouter (C.-d., Chal., Char.), cbapoter (Br., Y.), chaipouter (Morv.). - Couper un objet maladroitement, le morceler, le tailler à tort et à travers. En menuiserie, cbapoter signifie dégrossir une pièce de bois avec une plane. Ce mot peut se rapprocher de chaponner, dérivé probablement de castrare... D'autre part, le vieux français possédait le verbe cbaploier signifiant frapper rudement, sabrer, tailler en pièces, et cbaploteis, massacre, carnage. Quant au cbapoutou ou cbapouteur, c'est celui qui chapoute, et le cbapoutoir est le billot sur lequel on chapoute. - (15) |
| cCombaisson, petite combe. - (27) |
| cé (prép.) : chez - (50) |
| cé : Cerf, lucane (coléoptère). - (19) |
| ce qu’y en vout dère, loc. n'importe quoi : il répondit ce qu'y en vout dère. - (22) |
| ce qu'y en vout dœre, loc. n'importe quoi : il répond ce qu'y en vout dœre. - (24) |
| ce, prép. chez. « a n'ô pâ ce lu », il n'est pas chez lui. - (08) |
| cé. Ces, pluriel du pronom démonstratif ce. En bourguignon comme en français, on écrit ces devant une voyelle, « ces anfan », qu'on prononce « cez anfan », ces enfants. - (01) |
| cecle. : Cercle. Cecles és cues, cercles aux cuves. (Franchises de Salmaise, 1265.) - (06) |
| cée cent diables : exp. Beaucoup plus tard, à une heure ou une date très éloignée et imprécise. - (53) |
| cée : 1 pron. dém. Ceux. - 2 n. m. inv. Cinq. - (53) |
| céequante : adj. num. card. Cinquante. - (53) |
| cégüe : Cigüe. (cicuta virosa). « Eune trope de cegüe » : une touffe de ciguë. - (19) |
| cégueri : céleri. (F. T IV) - Y - (25) |
| céguéri. s. m. Céleri. (Coulours). - (10) |
| ceindre (d’la) : cendre - (57) |
| celai (pr.dém.inv.) : cela - (50) |
| celai, pron. démonst. cela. On prononce ç'lai. - (08) |
| celai. Cela. - (01) |
| celé (En) locut. adv. A l’abri. Etre en celé, se mettre en celé, être à l’abri, être à couvert, se mettre à l’abri, se mettre à couvert, être caché. Du latin celari . — Voyez encelé. - (10) |
| célébrale, adj., Cérébrale : « Ol é parti d'eune fieûve cèlèbrale. » - (14) |
| cellâte, pronom démonstratif, celle-ci, celle-là. - (40) |
| celles-lai (pr.dém.) : celles-là - (50) |
| cemenère (n.f.) : chènevière - (50) |
| cemenére, s. f. chenevière. - (08) |
| cemenot (n.m.) : petit chemin - (50) |
| cemenot, s. m. petit chemin, sentier dans les champs. - (08) |
| cemenotte (n.f.) : chanvre teillé - (50) |
| cemenotte, s. f. chanvre qui a été tillé. - (08) |
| cemet'chère. Cimetière. - (49) |
| cemetére (cemetchére) : cimetière - (39) |
| cemetière, s. m., cimetière. - (14) |
| cemie (n.f.) : chemise (aussi c'mie) - (50) |
| cemie, s. f. chemise. - (08) |
| ceming (n.m.) : chemin - (50) |
| ceming : chemin - (39) |
| cemingn', s. m. chemin, sentier, voie. - (08) |
| cemnée : voir chamiée - (23) |
| cemnée, cheminée - (36) |
| cen - çan : ça - (57) |
| cen : Cela. « Veux-tu laichi cen » : veux-tu laisser cela. « Ça, c'ment ci c 'ment cen » : comme ci, comme çà. - Ainsi, « Y est bin c 'ment cen » : c'est bien ainsi. - « Cen minne » (pronnocez min-ne) : ce qui est à moi ; « Cen tin-ne » : ce qui est à toi ; « Cen sin-ne », ce qui est à soi. « Chéquin cen sin-ne » : chacun ce qui lui appartient. - (19) |
| cen, çan ; cinqui, cintii ; cela, ceci (du latin "ecce-hoc"). - (38) |
| cenale (n.f.) : fruit de l'aubépinier - (50) |
| cenale, s. f. cenelle, fruit de l'aubépine et non du houx. - (08) |
| cenalé, s. m. cenellier, aubépine ou épine blanche ; arbuste qui produit les cenelles. - (08) |
| cenaler (n.m.) : aubépinier ; arbuste de l'épine blanche - (50) |
| cenchaubin-cenchaupâ, loc. il importe peu ; cela est ou n'est pas ; il est possible que oui ou que non. - (08) |
| cencitrou. s. f. Sorte de pâtisserie grossière. (Armeau). - (10) |
| cend' : n. f. Cendre. - (53) |
| cendré : Marchand de cendres. Autrefois, le « cendré » faisait régulièrement sa tournée dans les villages pour acheter les cendres de bois destinées à la fabrication de la soude et de la potasse. - (19) |
| cendre : cendre. - (21) |
| cendrei, s. m., cendrier, drap qu'on étend sur la cendre dans le cuvier à lessive. - (14) |
| cendrère. (Fém. La cendrère). Cendrier placé dans le mur à côté de la cheminée où l'on conserve les cendres de bois pour la lessive. Se voit dans toutes les vieilles maisons. - (49) |
| cendrou : éboueur - (44) |
| cendrou, subst. masculin : éboueur. - (54) |
| cendrou. Boueur. - (49) |
| cenelle et cinelle. : (Dial.), baie rouge de l'aubépine. - (06) |
| cenelles, senelles, cynelles ou sinelles, baies du houx ou de l'aubépine. Ce mot, très-employé dans le Châtillonnais, vient du latin coccinellus, à cause du rouge éclatant de ces fruits. - (02) |
| céneviau, s. m. filet de pêche. - (08) |
| ceni, c’ni (n.m.) : saleté petit débris (aussi cheni) - (50) |
| cenie (n.f.) : cendre chaude sous laquelle il y a encore du feu - (50) |
| cenie, s. f. cendre chaude, sous laquelle il y a encore du feu. - (08) |
| cenise, cendres. Les Bourguignons disent encore carre. - (02) |
| cenise, s. f., cendre encore chaude. - (14) |
| cenise. Braise fine, cendres chaudes que l'on met dans une chaufferette pour faire un couvot. En espagnol ceniza ; en wallon cenez. Du latin cinis. - (13) |
| cenise. s . f. Cendre rouge d’un foyer ardent. De cinis. (Perrigny-les-Auxerre). - (10) |
| cenre (n.f.) : cendre - (50) |
| cenre : cendre - (48) |
| cènre, cendre ; cènrë, cendre lessivée. - (16) |
| cen-re, cendre. - (26) |
| cenre, s. f. cendre, poussière des matières brûlées. - (08) |
| cenré, s. m. linge qu'on étend sur la cendre du cuvier où se fait la lessive. - (08) |
| cenre, sf. cendre. - (17) |
| cenrer, v. a. cendrer, mettre de la cendre. « cenrer » un champ. Une terre bien « cenrée » donne une bonne récolte. - (08) |
| cenres - cendres. - Voiqui des cenres que serant joliment bonnes pour fâre lai bue. - (18) |
| cenrou (adj.) : couleur de la cendre - (50) |
| cenrou, ouse, adj. cendreux, couleur de cendre ; rempli de cendre, couvert de cendre. - (08) |
| cens : s. m., terme de certains jeux d'enfants, qui 'établit la situation du joueur cessant volontairement et provisoirement de prendre part au jeu. Aux barres, par exemple. le joueur, quand II a dit le mot : Cens !, circule entre les doux camps sans pouvoir prendre ni être pris. - (20) |
| censé, censée : adj., qui a pris le cens. On crie indifféremment : Cens! ou Censé! pour quitter le jeu. - (20) |
| cent coups (être és), loc. être sous le coup de l'émotion et de l'anxiété. - (24) |
| cent coups l’un (A) : Ioc, une fois sur cent. Etre adroit à cent coups l'un. Réussir à cent coups l'un. - (20) |
| centaiñne n.f. Centaine. - (63) |
| cent-côs : Voir à cô - (19) |
| centiau - (39) |
| centime : s. f.. Une centime. - (20) |
| centime, s. f., centime : « Ta ch'tite afàre, à n' vaut pas tant seulement eune centime ». - (14) |
| cêoclle, cercle. - (05) |
| cepandan. Cependant… - (01) |
| cêqhie, s. m. cercle. Se dit principalement des cercles de futailles : « eun cêqhie de châgne », un cercle de chêne. - (08) |
| céqhier, v. a. mettre un cercle à un tonneau. - (08) |
| cêque (n.m.) : cercle - (50) |
| cèque, ceiquïe. s. m. Cercle. (Menades). - (10) |
| cequi - ceci, ça. - Vô fairâ cequi demain. - (18) |
| cequi (pr.dém.inv.) : ceci - (50) |
| cequi, pr. dém., ceci, cela, ça : « Y é c'ment c’qui que t’ t'éranges?... » - (14) |
| céqui, pr. dém., ceus-ci, ceus-là. - (14) |
| cequi, pron. démonstr. ceci ; en opposition avec celai = cela : « c'qui ô ai moue, c'lai ô ai toué » ; ceci est à moi, cela est à toi. - (08) |
| cer, cère (adj.m. ou f.) : cher, chère - (50) |
| cerce. Roue horizontale du pressoir, qui fait corps avec la vis ; c'est sur elle que s'enroule la grosse corde dévidée par la grue. - (13) |
| cercher, chercher. - (04) |
| cercifis : voir sersifis. - (20) |
| cerclot, sarclot. Sarcloir. - (49) |
| cercoeur. n. m. - Cercueil. - (42) |
| cercœur. s. m. Cercueil. - (10) |
| cerège. s. f. Cerise. - (10) |
| cerégier. s. m. Cerisier. (St-Germain-des-Champs). - (10) |
| cerfeû (n.m.) : cerfeuil - (50) |
| cerfeu, s. m. cerfeuil, plante potagère. - (08) |
| cerfu, s. m. cerfeuil. - (24) |
| cerie (n.f.) : cerise - (50) |
| cerie, s. f. cerise, fruit du cerisier : « eune c'rie meure. - (08) |
| cerïé, s. m. cerisier, arbre qui porte les cerises : « eun ç'rié sauvaige «, un cerisier sauvage, un griottier. - (08) |
| cerïer (n.m.) : cerisier - (50) |
| ceries, et cerillier - cerises et cerisier. - Ces ceries qui daivant éte bonnes ; â côtant deux so lai live. - Les cerilliers sont to blian de fleurs ; i pourons fâre du flian to note content. - (18) |
| cerige. Cerise. - (49) |
| cerigi. Cerisier. - (49) |
| ceriseil : un cerisier - (46) |
| cerisi, s. m. cerisier. - (24) |
| cerizi, s. m. cerisier. - (22) |
| cerkiè : cercler une roue, on dit aussi châtré - è fô qu’jièl chez l'maréchô fère cerkiè eune roue, il faut que j'aille chez le maréchal-ferrant faire cercler une roue. - (46) |
| cèrner : (vb) prendre le repas du soir - (35) |
| cerner : manger le soir après la veillée - (43) |
| cerner, v. a. châtrer. - (08) |
| cernon : petit repas terminant une veillée. - (30) |
| cerqueu (n.m.) : cercueil - (50) |
| cerson. s. m. Cresson. (Ghigy). - (10) |
| certain et çartain. Se dit d'un fruit intact, dont la conservation est assurée. I m'en vâs trier nos poueires : an mettrai dans lai meureire cettées-qui qui sont çartaines. - (13) |
| certain, e, adj. assuré, digne de confiance, d'une qualité reconnue. On dit d'un remède éprouvé qu'il est «certain », d'une vache prise à l'essai qu'elle n'est pas « certaine. » - (08) |
| certèn, se dit d'un fruit intact, surtout à l'intérieur ; un fruit n'est pas certèn quand il recèle un ver, de la pourriture. - (16) |
| cérusiau : sureau. (F. T IV) - Y - (25) |
| cérusien. s. f. Médecin, chirurgien. - (10) |
| cervalle : cervelle - (48) |
| ces qui - ceux-ci et celles-ci. - Ces qui vô servirant bein mieux que ces lai. - Ces qui ou ces lai, ci ne me fait ran du to. - (18) |
| ces-les, ceux-ci, ceux-là. - (38) |
| cesse, sf. utilisé dans l'expression töt sans cesse, tout de suite. Voir maintenant. - (17) |
| c'est le bruit que fait un ronfleur et surtout un agonisant. Il a formé le verbe patois rancoter. Ronc : ronfler, en gaëlic ; roncar en espagnol. N'y a-t-il pas quelque relation entre rancot et ancou ? Emile Souvestre a parlé de l’ancou, fantôme de la mort chez les Bretons. (V. Lousine). - (13) |
| cestuy-ci, celui-ci, c'tu-ki. - (04) |
| cete pour cette. : Pron. démonst. - On s'occupait assez peu des genres dans le patois. Aussi prononçait-on s'te soit pour le masculin, soit pour le féminin. - (06) |
| cetele-qui (pr.dém.f.) : celle-ci - (50) |
| cetele-qui, pron. démonst. celle-ci. on prononce souvent « c'tel-quite». - (08) |
| ceti-lai (pr.dém.m. et f.) : celui-là, celle-là - (50) |
| ceti-lai, pron. démonst. des deux genres. celui-là, celle-là par opposition avec « cetu-qui » et a « cetele-qui », celui-ci, celle-ci, au pluriel «cé-qui», ceux-ci et celles-ci ; « cé-lai » pour ceux-ci et celles-là. - (08) |
| cetine : Celle-là. Voir au mot : S'te. - (19) |
| cetit, cetite (adj.m. et f.) : petit, petite - mauvais, mauvaise - (50) |
| cetiteman (adv.) : de mauvaise manière - (50) |
| c'étoo. C'était, c'étaient…. - (01) |
| cetu qui, cetée lai - celui-ci, celle-là. On dit également Cetu qu. - C'â cetu qui qu'en vô fau prenre, tenez. - Vô m'aiporterâ cetu lai : a me pliai bein. - (18) |
| cetu-la : Prononcez stu. Celui-là, voir au mot S'te. - (19) |
| cetu-lai. Celui-là… - (01) |
| cetu-qui (pr.dém.m.) : celui-ci - (50) |
| cetu-qui, pron. démonst. celui-ci. - (08) |
| ceu (pr.dém.) : ce - (50) |
| ceu, ceute, ceus, cé, adj. démonst. ce, cette, ces : « çô l'ceu qui vô-z-é s'coru », c'est celui qui vous a secouru ; « ceute fonne-laite », cette femme-là ; « i veu i aller ceus ou ce jors-qui », je veux y aller ces jours-ci. - (08) |
| ceû, çu : (nm) ciel - (35) |
| c'eucarde : Cocarde. « Eune c'eucarde de canscrit». « Cen li va mieux qu 'eune c 'eucarde » : c'est pour lui une bonne aubaine. - (19) |
| c'eucbelin : Porter quelqu'un à « c'eucbelin » : le porter sur son dos, à califourchon. - (19) |
| c'euche : Coche, entaille. « Fare eune c’euche su l'ouche » : faire une coche à la taille du boulanger. - Petite armature en métal garnissant la pointe du fuseau, « Feler à la c 'euche ». - Cosse de pois. - (19) |
| c'euchin : Coussin, oreiller. - (19) |
| c'eûc'lle : Couvercle. « Le c'euc'lle de la marmite ». On dit maintenant le bouchon. - (19) |
| ceue. pro. dém. - Celle : « Gade don la chienne à Nonon, la ceue qu'a mangé ses p'tits ! » - (42) |
| c'euffre : Coffre. « In c'euffre à avouène » : un coffre à avoine. - Caisson de voiture, « As-tu mis le licou (licol) dans le c'euffre ? ». - Poitrine, « Ol a in ban c'euffre ». - (19) |
| ceugnat : qui discute pour ménager ses intérêts lors d'une transaction - (51) |
| ceul. pron. dém. - Celui : « Et ceul-la ! D'où i' sort-ti ? D'la cave marche ! » - (42) |
| ceula : dernier d'une portée - (51) |
| c'eulaire ou c'eulère : Culière. Pièce du harnais d'un cheval. Au figuré : courbature dont sont atteints les travailleurs longtemps courbés vers le sol, en particulier les moissonneurs. « Porté à ac'eulère ». - (19) |
| c'eulat : Jeune oiseau le plus chétif de la couvée, le dernier éclos, le dernier né d'une famille nombreuse, « Y est Jean qu'est le c'eulat ». - (19) |
| ceule (pr.dém.f.) : celle - (50) |
| ceule, pronom. celle : « ceule-quite », celle-ci. - (08) |
| ceule-lai (pf.dém.f.) : celle-là - pl.: ceules-lai, celles-là - (50) |
| c'eulique : Colique. « Ol a treu miji de melan, cen li a foutu la c'eulique » : il a trop mangé de melon, cela lui a donné la colique. - (19) |
| ceulle(s) lai (ceulle(s) laîte) : celle(s)-là - (39) |
| ceulle(s) : celle(s) - (39) |
| ceulle(s)-tchie - (39) |
| ceulotte : culotte - (51) |
| ceum’tire (on) : cimetière - (57) |
| ceume, cheume : sommet - (43) |
| ceumenée (n.f.) : cheminée - (50) |
| c'eûmer : Sommeiller. « Van dan te couchi puteu (plutôt) que de c’eûmer au carre du fû (au coin du feu ) ». - (19) |
| ceumetère (n.m.) : cimetière - (50) |
| ceumetére, s. m. cimetière. - (08) |
| ceumnée : cheminée. - (52) |
| ceum'née : cheminée - (39) |
| ceumtée : cimetière - (52) |
| ceum'tére : cimetière - (48) |
| ceumtére : le cimetière, on dit aussi cemtére - (46) |
| ceum'tére : n. m. Cimetière. - (53) |
| ceum'tié : cimetière - (61) |
| ceumtöre, sm. cimetière. - (17) |
| ceupe : (nf!) cep de vigne - (35) |
| ceupe : cep de vigne - (43) |
| ceupe, s. f. cep. Diminutif ceupellion. - (22) |
| c'eupie : Assignation, « L'ussier (huissier) li a foutu eune c'eupie ». - (19) |
| ceupon, s. m. lourde souche ; personne grosse et maladroite. - (22) |
| c'euqmâlâ : Nom patois du jeu de colin-maillard. Le jeu s'ouvre par cette formulette « C 'euqmâlâ d'vins'tu ?- de Rome. - Qu 'apportes-tu. - In plien sa de pommes. - Queva ce qu 'est ma pa ? - Au cu du rena, étrape ce que te pourras ». - (19) |
| c'euquâle : Soupière, « Eune c'euquâle de faïence ». - (19) |
| c'euquin : Coquin, « Ol a la mine d'in c'euquin » : il a la mine d'un malfaiteur. - Adressé aux enfants, c'euquin devient un terme d'amitiés. « Donne-moi voir cinq sous, ptiet c'euquin » : donne-moi la main petit coquin. - (19) |
| c'eurate : Curette, espèce de palette en forme de spatule faite le plus souvent d'un mince morceau de bois et dont se servent les ouvriers agricoles pour nettoyer leurs outils et détacher la terre collée à leurs chaussures. - (19) |
| ceurde : courge - (51) |
| c'eûre : Cuire, « Fare c’eûre eune marmite de tapines » : faire cuire une marmite de pommes de terre. - Cuire une fournée de pain : « Si an ne veut pas miji du pain treu deu (trop dur) i faut c’eûre totes les semain-nes ». - « Charchi à c’eûre » : chercher aventure, chercher bonne fortune. - (19) |
| c'eure : Cure, presbytère. « La c'eure est to près de l'égllige ». - (19) |
| c'eurieux : Curieux, « Eune c 'eurieuse histoire » : une histoire extraordinaire. - Désireux, « Je n'en su pas c’eurieux » : cela ne me fait pas envie, je n'en ai cure. - (19) |
| ceurvalle (na) : cervelle - (57) |
| ceus (adj.dém.) : ces - (50) |
| ceus. pro. dém. – Ceux : « Les gamins d'Sougères ! Ceus que f'sont des bêti'es ! » - (42) |
| ceusse (les), pr. dém., ceus : « J’vouerons ben les ceûsse qui veinront ». - (14) |
| c'eutan : On dit d'une vache qu'elle a « le c'eutan » quand une de ses côtes, la dernière ne vient qu'à moitié des autres. - (19) |
| c'eutare : Cautère, « Fare l'effet d'in c'eutare su eune chambe de beu » : ne faire aucun effet. - (19) |
| ceute - cet et cette. - Ceute homme que vos é vu m'è aipri bein des nouvelles. - Al an entrepris ceute ovraige pour deux jors. – Devant un nom masculin commençant par une consonne on dit ce. Très souvent on abrége ceute en disant c'te, ou c't' ; ainsi c'te robe, c't'autel. - (18) |
| c'eûte : Côte. « Avoi les c'eûtes en lang » : être paresseux, se plier difficilement au travail. - Monticule, « La c’eûte des Roleux (nom de lieu) ». - (19) |
| c'eute : Fournée de pain, « Je vins avoi des ovrés (ouvriers) c'te semain-ne i faudra fare eune greusse c'eute ». - (19) |
| ceûtes (lâs) : ceux - (37) |
| c'eutillan : Cotillon, jupon, «Alle a égailli (déchiré) san c'eutillan ». - (19) |
| c'eûtis : Côtelettes de porc. Quand on tue le cochon, il est d'usage de donner à ses proches voisins « In c'eûtis, in noud a peu in treu de boudin ». Voir ces mots - (19) |
| ceutte (adj.dém.) : cette - (50) |
| ceux tchie (ceux tchîte) : ceux-ci - (39) |
| ceux. adj. dém. – Ces : « Ceux gars là, y sont pas prêts dé r'veni' » - (42) |
| ceux-lai (ceux-laîte) : ceux-là - (39) |
| ceveire. Civière. - (01) |
| ceviée. s. f. Civière. (Menades). - (10) |
| cevire, s. f. brouette. - (22) |
| cevire, s. f. brouette. - (24) |
| cevrosse, s. f. la partie d'un grenier, d'un fenil, qui se trouve le long des murailles, sous le toit, sous les chevrons. - (08) |
| cez : chez - (39) |
| ch' lu, s. m., bougeoir de cave en fer torsadé. - (40) |
| ch' ni : s. m. poussière - (21) |
| ch' tit : mauvais. Egalement : avare. Ex : "C't'houmme-là, c'est du ch'tit !" On peut même ajouter : "Ch'tit, fini ch'tit !". C'est en quelque sorte un superlatif. Il peut aussi arriver (et ça s'est vu), que la femme soit ch'tite. - (58) |
| ch' vau : cheval. Quoique le plus souvent on élevait et attelait les "j’mens". Ces animaux, quand ils devaient être plusieurs pour un charroi étaient attelés en flèche (jamais en couple). Un homme spécialisé promenait l'étalon dans la campagne, pour la bonne cause. - (58) |
| ch’cou, s. m. hoquet. - (22) |
| ch’euré : drap destiné à recevoir les cendres lors de la lessive. - (21) |
| ch’line. s. f. Chenille. (Poilly-sur-Serein). - (10) |
| ch’mi de far : chemin de fer. - (32) |
| ch’min (on) : chemin - (57) |
| ch’ni (s) : poussière, balayures. - (62) |
| ch’nille (na) : chenille - (57) |
| ch’not, chenot. s. m. Chenet. - (10) |
| ch’nôve (du) : chanvre - (57) |
| ch’o : petite barrière. - (21) |
| ch’tel. s. m. Cheptel, qu’on devrait prononcer chetel , mais que partout on prononce ch' tel. - (10) |
| ch’ti (on) – ch’tchia (na) – ch’tia (na) : crapule (petite) - (57) |
| ch’ti : chétif ou coquin. - (62) |
| ch’ti lait, p’tit lait : petit-lait, sérum - (43) |
| ch’ti, ch’tite : petit, petite - (43) |
| ch’tit, ch’tite (pour chétif, chétive). adj. Qui est dans un état de maigreur et de santé à faire pitié. — Au figure, avare, ingrat, méchant. - (10) |
| ch’tit’té : mauvaise manière, sottise, malice, « crasse ». - (62) |
| ch’tivité (d’la) : crapulerie - (57) |
| ch’vau (on) : cheval - (57) |
| ch’vaûchi : chevaucher - (57) |
| ch’vet (on) : chevet - (57) |
| ch’veu (on) - pouet (du) : cheveu - (57) |
| ch’ville (na) : cheville - (57) |
| ch’villi : cheviller - (57) |
| ch’vinée. Cheminée. - (49) |
| châ (d’la) : chair - (57) |
| châ (d'la) : viande - (57) |
| châ (n.m.) : corps de bâtiment pris isolément (maison, écurie, grange = 3 châs), de l'a.fr. chatz, du lat. casa = maison - (50) |
| châ (on) : char - (57) |
| châ (on) : voiturée - (57) |
| châ : Espèce de colle dont faisaient usage les tisserands. - (19) |
| cha : prép., lat. cala. A cha un, à cha deux, à cha trois, etc., un à un, deux à deux, trois à trois, etc. A cha peu, peu à peu. - (20) |
| châ : s. f. : viande. - (21) |
| cha(i)pouter : tailler irrégulièrement ou d'une façon grossière, sans soin. - (56) |
| châ, s. m. colle de farine à l'usage des tisserands. - (08) |
| châ, s. m. corps de bâtiment pris isolément. Une maison, une grange, une écurie, forment trois « châs » distincts. - (08) |
| châ, s.m. char. - (38) |
| cha. n. m. - Apprêt utilisé par les tisserands, pour les fils dressés sur le métier avant le tissage. (Mézilles, selon H. Chéry) - (42) |
| châa ! interj. dont on se sert pour faire avancer les bœufs attelés. - (08) |
| châa : chariot. (TSO. T III) - D - (25) |
| chaate, sm. poutre de charpente. - (17) |
| chabanée : grande quantité - (39) |
| chabanée, grande quantité - (36) |
| chabat : Sabbat. La croyance aux sorcières et à leurs rendez-vous nocturnes existait encore dans nos villages il n'y a pas très longtemps. - (19) |
| chabert, subst. masculin ou adjectif qualificatif : galéjeur, vantard. - (54) |
| chabine. s. f. Housse de collier en peau de mouton. De chabin, mouton. - (10) |
| chabler. v. - Gauler les fruits. Chabler ou achabler est employé depuis le XIVe siècle pour abattre à terre, écraser sous une masse (l'origine gréco-latine que du mot évoquait une catapulte) ; il s'est spécialisé dans le sens de faire tomber les fruits. Au XVIIe siècle, un bois chablis désignait des arbres abattus par le vent... - (42) |
| chabler. v. a. Abattre des fruits à coups de perche, à coups de gaule. (Bléneau). - (10) |
| chabou*, s. m. petit hangar. - (22) |
| chabouéchi, chatbouécheri. subs. m. Chauve-souris. (Domecy - sur-le - Vault, Etivey). - (10) |
| chabouiller. v. a. Emmêler. Chabouiller les cheveux. (Vertilly).— Jaubert donne chaboulé , ébouriffé. - (10) |
| chabrake, extravagant. - (16) |
| chabraque : adj. Tout "foufou". - (53) |
| chabraque, adj. d'esprit changeant, aventureux. - (24) |
| châbre (n.m.) : sabre - (50) |
| châbre, s. m. sabre. - (08) |
| chabrô (faire), ajouter du vin rouge au bouillon de viande. - (40) |
| chabro (faire), exp. ajouter du vin rouge à un bouillon de viande. - (65) |
| chabrot (faire) : mettre du vin dans le potage - (48) |
| chac (faire), s. intr., rater : « Y ét eun fameus chassou ; à tôs les cops son fusil fait chac. » - (14) |
| chacagnat (nom masculin) : lit mal fait... ou pas fait du tout. - (47) |
| chacane. s. f. Viande. (Arcy-sur-Cure). - (10) |
| chacharougne : qui a un caractère désobligeant, contredisant tout. - (30) |
| chacignon, s. m. chignon, le derrière du cou, la nuque. - (08) |
| chacnugî : Déchiqueter un objet, le couper maladroitement en morceaux informes. - (19) |
| chacon. s. m. Enveloppe épineuse de la châtaigne. - (10) |
| chacou. s. m. Gros couteau. Du bas latin chicia hache, cognée. (Tronchoy). - (10) |
| chacouéner, chacoiner, chagoiner. v. a. Chapoter, enlever des copeaux d’un morceau de bois. De chacou, gros couteau, ou de chacia , hache, cognée. - (10) |
| chacueugne. pron. ind. m. et f. Chacun, chacune. (Athie). - (10) |
| chadelle. n. f. - Chandelle. - (42) |
| chadjon, sm. chardon. - (17) |
| chadon, chardon. - (27) |
| châdougnerà, s. m. chardonneret, oiseau. - (08) |
| chadrat, ate. adj. des 2 genres. Grand et fluet, sec, maigre. (Percey). - (10) |
| châdron, chaiseron. s. m. Ustensile en terre percé de trous pour faire égoutter les fromages. (Armeau). - (10) |
| chadron. s. m. Chardon. (Argentenay). - (10) |
| chadronnet. s. m. Chardonneret. - (10) |
| chael. : (Dial.), dérivation du latin catulus et signifiant le petit d'un animal. - (06) |
| chaesdre, v. prononcer cha-es-dre ; tomber (latin "cadere") ; chaesdre en Artevalde, peut-être en souvenir de la défaite d'Artevelde à Saint-Omer en 1340. - (38) |
| chaesre, s.f. prononcer cha-es-re ; chaise ; la chaise à sel est la chaesre à sao. - (38) |
| chafau : (chafau: - subst. m.) plancher qui couvre la grange sur la moitié de sa surface. L'espace laissé libre permet de poser une échelle pour y accéder. - (45) |
| chafau, s. m. échafaudage pour faciliter un travail. - (24) |
| chafau, s. m. échafaudage. - (22) |
| chafaud : grenier à foin. Ill, p. 31-r - (23) |
| chafaud : s. m., vx fr., échafaudage. - (20) |
| chafaud, s. m., grenier au-dessus de la grange. - (14) |
| chafaud. n. m. - Échafaud, grenier où l' on entasse le fourrage. - (42) |
| chafauder (v. tr.) : agacer, exciter un animal au moyen d'un bâton ou d'un objet quelconque, afin de le déloger - (64) |
| chafauder : battre un arbre avec une perche pour faire tomber les fruits (les noix). Mais aussi, plus malicieusement lutiner, secouer, battre. Usage large. Ex : "Si té continues, té vas t'fée chafauder vieux lougaïon !" - (58) |
| chafauder. s. m. Harceler, tourmenter. (Villeneuve-les-Genêts). - (10) |
| chafaut : plancher partiel dans la grange (voir voûlin), grenier à fourrage - (48) |
| chafaut, échafaud. - (04) |
| chaffaud : fenil. - (52) |
| chaffaud : grenier à fourrage. On meto le foin sur le chaffaud : on mettait le foin dans le fenil. - (33) |
| chaffaut : lucarne au-dessus d'une grange (utilisé aussi à Nicey). - (66) |
| chafô, échafaudage, - (16) |
| chafoïn, grêle, menu. En italien eaffo, moindre, impair, plus petit que les autres... - (02) |
| chafoin. : Petit, frêle. lDel.)- Lacombe donne à ce mot le sens de laid et de mine maigre et repoussante. - A Genève, chafouiller signifie manger sâlement comme un petit enfant. – Chafoin répond à l'italien cattivo, qui signifie chétif, à moins qu'on ne préfère le mélange de chat et fouin, c'est-à-dire d'apparence sournoise et grêle. - (06) |
| chafrignard, chafougnard, chafignard, chagnard. n. m. - Se dit d'une personne désagréable, susceptible, d'un mauvais coucheur. - (42) |
| chafrignard. adj. Déplaisant, grognon, peu endurant, ce qu’on appelle un mauvais coucheur. - (10) |
| chafrignat : d'un appétit délicat. (F. T IV) - Y - (25) |
| chafrignier. s. m. Difficile dans le manger. (Plessis-St-Jean). — Voyez Poqueux. - (10) |
| chagnan : Centaurée jacée (centaurea jacea) « Le chagnan est in ban fourrage ». - (19) |
| chagnar, s. m. sournois, cafard, un homme en dessous comme on dit vulgairement. - (08) |
| châgnard (adj.) : dur coriace, en parlant d'une viande - (64) |
| chagnard (n.m.) : sournois, "en-dessous" - (50) |
| chagnard : grincheux, pas franc - (60) |
| châgnard : personnage incommode, dur (comme le chêne), entêté. Ex : "Toun' houme, ma fille, c'est du châgnard ! N'a rin à lui die." - (58) |
| chagnard, changnard. adj. - Bois revêche, difficile à travailler. - (42) |
| chagnard. adj . Dur, coriace (Etais). — A Villiers-Saint-Benoît, s’emploie substantiellement et signifie bois revêche, homme rechigné, d’un caractère difficile. - (10) |
| châgne (nom masculin) : chêne. - (47) |
| châgne (petiet) : Petit chêne. Germandrée Macéré dans le vin, on en fait une sorte d'apéritif. - (19) |
| châgne : chêne - (60) |
| châgne : Chêne (quercus) « Le châgne des Reppes », chêne colossal de la forêt de Bragny. « Le châgne corbe », chêne penche qu'on voit au bord du chemin qui va de Mancey à Etrigny. - (19) |
| châgne : chêne - (48) |
| châgne : chêne. - (62) |
| châgne : le chêne - yè d'beaux châgnes dans not'bô des Creûchères, il y a de beaux chênes dans notre forêt des Crochères - (46) |
| châgne : un chêne. - (56) |
| châgne : chêne. Ç'o biau un grou châgne : c'est beau un gros chêne. - (33) |
| châgne : (châ:gn' - subst. m.) chêne. - (45) |
| châgne : chêne. Arbre royal et respecté. - (58) |
| châgne : n. m. Chêne. - (53) |
| châgne : s. m. chêne. - (21) |
| châgne, châne. n. m. – Chêne. - (42) |
| chagne, chégne. Chêne. - (49) |
| châgne, chêne. - (16) |
| châgne, n. masc. ; chêne. - (07) |
| châgne, n.m. chêne. - (65) |
| châgne, s. m. chêne. Morvan prononce çâgne : « miçante rouette de çâgne i va t'quiorde », mauvaise branche de chêne je vais te tordre. - (08) |
| chagne, s. m., chêne. - (14) |
| châgne, s.m. chêne. - (38) |
| châgne. s. f. Chêne. Ç’t’ année, gna ben de l’égland su les châgnes. - (10) |
| châgneai, s. m. bois de chênes. Ne s'emploie guère qu'au pluriel : « les châgneais. » - (08) |
| châgneau, s. m. bois de chênes. - (08) |
| châgne-forchat, faire le châgne-forchat, se tenir le corps droit, la tête en bas et les jambes écartées en l'air. - (07) |
| châgne-forché, loc. chêne-fourchu. Le jeu de « châgne-forché » consiste à se maintenir, en s'appuyant sur les mains, la tête contre terre et les jambes dressées en l'air avec un certain écartement. - (08) |
| châgniau. s. m. Petit chien. - (10) |
| châgnon (n.m.) : nuque - (50) |
| chagnon (nom masculin) : partie arrière du cou, là où l'on dépose une charge à porter. - (47) |
| chagnon : gros cou. - (31) |
| châgnon : nuque. Attribué aussi à l’articulation de l’âge de la charrue sur l’essieu. - (62) |
| châgnon de cou, s.m., nuque. - (40) |
| chagnon, chaignon. La nuque, le dessus du cou : « avoir un bon châgnon de cou ». - (49) |
| châgnon, subst. masculin : nuque, peau flasque du cou. - (54) |
| chagoiller. v. a. Chatouiller. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| chagreigne. s. m. Chagrin. (Ménades). - (10) |
| chagreillot : chatouille. - (33) |
| chagrillot : chatouille - (48) |
| chagrillot, chagriot, chastouillot. s. m. Action de Chatouiller, chatouillement. — On dit faire Chatouillot , faire chagrillot, pour chatouiller. - (10) |
| chagrin (être), loc. avoir du chagrin : il était tellement chagrin qu'il faisait peine à voir. - (24) |
| chagrin (être), loc. avoir du chagrin. - (22) |
| chagriot (n.m.) : chatouillement - (50) |
| chagriot, s. m. chatouillement: « faire le chagriot », chatouiller. - (08) |
| chagriot, subst. masculin : chatouille. - (54) |
| chagrognat. adj. Difficile. (Bagneaux). - (10) |
| chagroulé, e, part. passé d'un verbe chagrouler inusité à l'infinitif. Fendillé, crevassé. Se dit surtout de la terre soumise à l'action de la gelée. - (08) |
| chagrouleman, s. m. action de la gelée sur la terre qui se désagrège, se crevasse, se fend. Le « chagrouleman » est très nuisible aux récoltes, parce que les plantes d'un sol « chagroulé » se trouvant déchaussées sont exposées sans abri aux intempéries de la saison. - (08) |
| chahuter, v. a. tracasser, harceler, quereller. - (08) |
| chai (ê), sm. chat. S’emploie comme adjectif avec le sens d'envieux, désireux, gourmand. El a chai de peu de chöse. - (17) |
| chaî : Chair, viande. « Ce poulot est bien en chaî ». - (19) |
| chai : chat. - (66) |
| chai ou ché : Char, voiture à roue, hauteur d'un char, « In ban chai de foin. - Y est bin greu, cras tu qu'i passera ? Oh in chai de foin y passe bin ! ». - Le chai au roi David ou le chariot » : la Grande Ourse. - (19) |
| chai, chat. - (27) |
| chai, v. n. tomber, choir. Chai à bas, loc. tomber à terre. - (24) |
| chaibôtte, danse usitée en Bourgogne. C'est sans doute la javotte. - (02) |
| chaibotte. : Espèce de danse, la javotte. (Del.) - (06) |
| chaiche : Chasse, « Ol est to le temps à la chaiche, padant qu'o co (court) après le fricot le pain se caiche » : pendant qu'il perd son temps à la chasse la misère s'installe chez lui. - (19) |
| chaichi : Chasser, « Padant les vendanges an n 'a pas le temps de chaichi ». - (19) |
| chaichot, chéchot (pour fachot). s. m. Petit sac. (Girolles). - (10) |
| chaichou : Chasseur, « Y est in ban chaichou ». « J'ame autant le lièvre au chin qu 'au chaichou » : cela m'est bien égal, je m'en désintéresse. - (19) |
| chaïcle. s. f. Chasuble. (Ménades). - (10) |
| chaîcon - chaîncon : chacun - (57) |
| chaicun, pronom distributif. chacun, chaque personne, toute personne, qui que ce soit. On dit en Morvan comme en bourgogne : « un chaicun plieure, un chaicun grogne. » - (08) |
| chaide (s’) : (s’) asseoir - (37) |
| chaidion : un chardon - (46) |
| chaidion : un gamin qui remue, qui embête - (46) |
| chaidon : siège - (37) |
| chaîdon. s. m. Chardon. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| chaidu (ât’e) : (être) assis - (37) |
| chaie (n. f.) : chaise - (64) |
| chaie, chaire. n. f. - Chaise. - (42) |
| chaifaud, sm. échafaud. - (17) |
| chaifaudé, vt. échafauder. - (17) |
| chaignon. n. m. - Chaînon. - (42) |
| chaigrelöt, öte, adj. maigrichon ; sans force. - (17) |
| chailemie. Flûte champêtre… - (01) |
| chailemie. : Flûte (du latin calamus, roseau). - (06) |
| chailla : paille de maïs. - (31) |
| chaillard, dur, filandreux. Ce mot s’applique aux légumes. (Y. Cbeillas et écholer.) - (13) |
| chaillâs, cheillâs, s. m. tiges de chanvre et en plusieurs lieux de lentilles, de pois, lorsqu'elles sont dépouillées et réduites à l'état de paille sèche. - (08) |
| chaillé : lait caillé. Ex : "Té doun’ras l’chaillé au couchon". - (58) |
| chaille : s. f. écale des noix, des amandes, des châtaignes, etc. Mettre en chaille, foutre en chaille, mettre au rebut. A rapprocher du vx fr. chaillons, bardes, guenilles. Voir cala et échailler. - (20) |
| chaillée, cherriée, charriée. n. f. - Plateau à fromages en bois, suspendu aux solives, dans lequel séchaient les fromages, sur une fine couche de paille. - (42) |
| chaillot, s. m. petite pierre qui se trouve par bancs dans certains terrains. Lorsque le « chaillot » se désagrège, il forme une espèce de gros sable qu'on appelle « cran. » - (08) |
| chaillot. s. m. Chaseron, moule à fromage. (Accolay). - (10) |
| chailloter : lancer des pierres. (F. T IV) - Y - (25) |
| chaillotière, chailloutiée. n. f. - Amas de petits cailloux dans un champ. - (42) |
| chaillotte. s. f. Caillotte, menu caillou, menue pierre. - (10) |
| chaillottière. s. f. Amas de menues pierrailles dans un champ. De chaillotte, petit caillou, et du latin calculus. (Saint-Denis-sur-Ouanne). - (10) |
| chaillou, caillou, pierre, roche. Ne figure plus que dans les noms de lieu : le moulin de chaillou près de Saulieu. - (08) |
| chaillou, s. m. Caillou. - (10) |
| chaillou. n. m. - Caillou. En ancien français du XIIe siècle, on employait chaillo ou chail, formes dérivées du gaulois caljo. Le mot caillou, utilisé aujourd'hui en français, est en fait la forme du dialecte de Normandie chaillo. - (42) |
| chaillouter. v. - Jeter des cailloux. - (42) |
| chaillouter. v. a. et n. Jeter des pierres, des cailloux. (Villeneuve-les-Genèts). - (10) |
| chailmineman, s. m. action de la gelée qui soulève la terre, qui la désagrège et la fait tomber en poussière. - (08) |
| chailminer, v. n. se dit de la terre que l'action de la gelée soulève et réduit en poussière. - (08) |
| chaimainge. : Chemise. - (06) |
| chaiminge, chemise. Dans le latin du moyen-âge on trouve camisia, id est tunica interior. (Ducange.) - (02) |
| chaimiô (ai), loc. a quatre pattes. - (17) |
| chainde, cheindre : chanvre se cultivant en début du siècle pour faire des draps, des cordes. Tu mettos le cheindre aigé dans le rû : tu mettais le chanvre rouir dans le ru. - (33) |
| chaîneau : chéneau - (48) |
| chaineau, s. m. chenal, chéneau, gouttière qui reçoit les eaux du toit. - (08) |
| chainette, s. f. échenal, gouttière. - (08) |
| chainge. Change, changes, changent. - (01) |
| chaingé. Changé, changez, changer. - (01) |
| Chaingenai. Nom propre corrompu de Saint-Genès, San-Genesius… - (01) |
| chaingisse. Changeasse, changeasses, changeât. - (01) |
| chaingne, sm. chêne. - (17) |
| chaingnon. s. m. Chaînon. (Sommecaise). - (10) |
| chaîn-ne (na) : chaîne - (57) |
| chain-ne : n. f. Chaine. - (53) |
| chain-ne, s. f., chaîne. - (14) |
| chaintéa, en français chanteau, morceau réservé d'une chose. —Dans la distribution du pain bénit, une part était toujours réservée au seigneur... - (02) |
| chaintea. : Portion réservée de pain ou de gâteau - La chante ou jante est une partie, une fraction de la roue. - (06) |
| chaintre : s. f. (fr., masc). fossé d'écoulement d'eau en bordure d'un champ ; extrémité d'une terre labourée où l'attelage tourne, par conséquent ne trace pas de sillons. - (20) |
| chaintre, n.f. terrain. Genre variable, le plus souvent féminin. - (65) |
| chaintre, pré proche la maison. - (05) |
| chaintre, s. f., chemin autour d'une pièce de terre, ceinture. - (14) |
| chaintre. Nous avons beaucoup de champs portant ce nom. Il désigne des terres placées autour de la maison, et vient de cinctura, comme formant une ceinture. - (03) |
| chaintrer. v. - Faire des chaintres. Voir achainte. - (42) |
| chaintres, champs - (36) |
| chaipaie : chapeau - (48) |
| chaipais - chapeau. - En li é beillé in joli chaipai pou ses étreunes. – Mouai, i me contente de mon chaipais de peille. - (18) |
| chaipé : un chapeau, on dit aussi châpiô. - (46) |
| chaipeai, s. m. chapeau. Morvan. «chapiau». - (08) |
| chaipechô. : Coupe-chou. Couperet à hacher les herbages. (Del.) - (06) |
| chaipecô (prononcez chépecheu), coupe-chou, couperet à hacher les herbages. - (02) |
| chaipelet, s. m. chapelet. - (08) |
| chaipia rond. Vaste chapeau de femme à bords très développés. II était ordinairement de feutre gris mais il y en avait de blancs pour les riches vigneronnes. Un proverbe très ancien avait cours à Vignolles, Gigny, Chorey et autres villages : quand an fait du brouillard su Corton, prends ton chaipia rond. Le chapeau rond, dont le prix était assez élevé, remplaçait le parapluie lorsqu'on allait travailler dans les vignes : on s'en servait encore communément il y a un demi-siècle. - (13) |
| chaipiâ : n. m. Chapeau. - (53) |
| chaipiâ, chapeau. - (16) |
| chaipiau (on) : chapeau - (57) |
| chaîpifô, bonnet de fou. - (02) |
| chaipifô. : Bonnet de fou. (Del.) - (06) |
| chaipite, s. m. chapitre. - (08) |
| chaipouter, v. a. tailler, hacher le bois avec la cognée, la serpe ou tout autre instrument tranchant. Tous nos paysans « chaipoutent » plus ou moins, mais assez grossièrement. - (08) |
| chaipoutou, s. m. celui qui hache, qui coupe, qui travaille le bois plus ou moins adroitement. - (08) |
| chaippe - espèce de hangar au dessus duquel il y a un fenil où l'on serre paille, fagots, etc. - Vos raingerâ l'orche et lai charrue sô lai chaipe, et pu vos monterâs les cheillots de faivioles â dessus. - (18) |
| chaip'tiais, n.masc. ; chapiteau ; espèce de porche, porté par des colonnes, devant une grange. - (07) |
| chaique (adj.ind.) : chaque - (50) |
| chaîque : chaque - (57) |
| chaique : adj. indéf. Chaque. - (53) |
| chaique, adj. des deux genres. chaque. - (08) |
| chaiqueu : pron. indéf. Chacun. - (53) |
| chaîqueune - chaînqueune : chacune - (57) |
| chair (n.m.) : char - (50) |
| chair : char, chariot - (48) |
| chair, s. m. char, chariot ; longue voiture à quatre roues qui sert à divers usages et qui est d'un emploi général dans une grande partie du Morvan. - (08) |
| chairboiller, v. a. noircir, salir, rendre terne ; au figuré assombrir. - (08) |
| chairboliai - sâlir, tacher, la figure surtout.- Ma n'ailé pâ sorti queman cequi, vos ête to chairboliai. - Oh, le petiot chairboliou ! - (18) |
| chairbonette, chairbounette, s. f. menu bois façonné régulièrement comme le bois de moule pour être converti en charbon. - (08) |
| chairbonnette : charbonnette - (48) |
| chairbouéiller : barbouiller (couleur ou digestion) - (48) |
| chairbouiller ou charboiller ; v. ; salir de boue ; ne s'applique qu'à la figure. - (07) |
| chaircuitier, chertuquier. s. m. Charcutier. - (10) |
| chairdonneri (n.m.) : chardonneret - (50) |
| chaire : Chaise, « Site te, vla eune chaire » : assieds-toi, voilà une chaise. - « Chaire à Ban Dieu », espèce de siège que forment en s'entrecroisant les mains de deux personnes pour en porter une troisième. - « Entrem 'deux chaires le cu à bas », se dit d'une jeune fille qui n'a pas su choisir entre deux prétendants ou de toute circonstance où on a manqué de décision. - (19) |
| chaire : chaise. - (32) |
| chaire : s. f., vx fr., chaise. - (20) |
| chaire. s. f. Chaise. C’est l’ancienne prononciation conservée dans plusieurs de nos campagnes, dans celles de la Puysaye notamment, et l’on dit d’ailleurs, quelquefois, l’un pour l’autre. - (10) |
| chaire. : (Dial. et pat.), du latin cathedra. Lamonnoye écrit cheire. Le mot chaise est le résultat d'une fausse prononciation et n'est point admis chez nos paysans. - (06) |
| chaireter (se) : s'asseoir. - (32) |
| chairetin, s. m. charretin, carcasse de charrette, la charrette sans les roues. Se compose de l'aiguille, des deux gouttereaux et des épares. - (08) |
| chairger : charger - (48) |
| chairgi, e, part. passé. chargé. - (08) |
| chairiot (n.m.) : chariot - (50) |
| chairité, aumône. - (16) |
| chairme : charme - (48) |
| chairmer, v. a. charmer, exercer une action extranaturelle à l'aide de la magie, fasciner. - (08) |
| chairogne : charogne, mauvaise bête - (48) |
| chairoi, s. m. charroi, transport d'un lieu à un autre au moyen de bœufs ou de chevaux attelés : être en bon « charroi », au figuré, être en bonne voie, en bon chemin, dans une entreprise. - (08) |
| chaironé, charoné, vt. charrier. - (17) |
| chairotte : charrette, carriole - (48) |
| chairotte, s. f. charrette, voiture à deux roues attelée de bœufs ou de vaches. Morvan. : « çarotte, çairotte. » - (08) |
| chairpaigne, grande corbeille où le bois de charme entrait plus particulièrement sans doute, car le mot charpe signifie charme dans la langue des Trouvères. (Roquefort.)... - (02) |
| chairpaingne – espèce de corbeille grossière, généralement pour les travaux de la terre. - Mets totes ces pierres qui dan lai chairpaingne. - Pote su le femé c'teu chairpaingne de poumes peuries. - (18) |
| chairpentier : charpentier - (48) |
| chairrére : charrière, chemin forestier - (48) |
| chairrire (na) - charrire (na) : desserte (chemin de terre) - (57) |
| chairrotte, n. fém. ; charrette. - (07) |
| chairrue (na) : charrue - (57) |
| chairrûe : charrue - (48) |
| chairtie, sf. charretée. - (17) |
| chair'tier : charretier - (48) |
| chairue, s. f. charrue, inslrument de labourage. - (08) |
| chaise, s. f. maison, chaumière, cabane. - (08) |
| chaisière, n.f. cage à fromages souvent suspendue. - (65) |
| chaisière. s. f. Grand panier en osier pour faire sécher les fromages. (Armeau). - (10) |
| chaissavent, chassavent, sm. fouet de grandes dimensions pour la charrue. - (17) |
| chaisse : chasse - (48) |
| chaisse, sf. chasse. - (17) |
| chaisse. Chasse venatio, et chasse expello ; tu chasses, il chasse, ils chassent. Le bourguignon « chaisse » signifie tout cela. - (01) |
| chaisseu : lange. (S. T III) - D - (25) |
| chaisshou, chasseur. - (05) |
| chaisso, drapeau dont on enveloppe les enfants au berceau. - (16) |
| chaissô, maillot d'enfant. On devrait l'écrire sechô, car ce mot vient de ce qu'il faut toujours faire sécher le linge des enfants. Le vieux mot français chainse signifie jupe. (Lac.) - (02) |
| chaissö, sm. langes d'enfants. - (17) |
| chaissô. C'est le linge appelé « couche », qu'on met aux enfants pour recevoir leurs excréments. Chaissô a été dit par corruptioh pour sèchô, parce que quand ces linges sont sales on les lave et puis on les sèche. - (01) |
| chaisso. Lange, a été dit, selon Lamonnoye, pour secho, parce que, quand ces linges sont sales, on les lave et on les sèche, ce qui me semble au moins spécieux. - (03) |
| chaissô. : Maillot d'enfant (Del.), employé pour sechô, dit Lamonnoye, parce qu'on fait sécher constamment les linges d'enfant. - (06) |
| chaissôre – petit fouet. - Pou menai les vais es champs prends ine chaissôre : ine baguette ci ne sero pâ aissez. - (18) |
| chaissot - sachet, petit sac. - I ai pris mon chaisso pour ailai à mairché. - Cherche voué dans le chaissot si n'y ai pas laiché des botons pour ton gilet. - (18) |
| chaissot : petit sac, sachet. On meto les résidus dans un chaissot : on mettait les résidus dans un sachet. - (33) |
| chaissot, lange, drapeau d'enfant. - (05) |
| chaissot. Inversion de séchot : linge d'enfant que l'on met choicher sur les haies. - (13) |
| chaissoû : chasseur - (48) |
| chaissou : ou chessou, un chasseur - l'chessou été èdret, èl é tchuè un singuiè, le chasseur était adroit, il a tué un sanglier - (46) |
| chaissoure,chassoire, sf. fouet ordinaire. - (17) |
| chaissoure. On dit encore à Châtillon une chassoire pour exprimer un fouet de charretier... - (02) |
| chaissoure. : Fouet des charretiers pour chasser ou faire avancer les chevaux. - (06) |
| chaissu : n. m. Chasseur. - (53) |
| chait (n.m.) : chat - (50) |
| chait (on) : chat - (57) |
| chaîtcheau (on) : château - (57) |
| chaiteneires. Petites ouvertures pour le passage des chats, pratiquées dans les toits ou dans les portes des greniers. - (13) |
| chaitèngne, châtaigne. - (16) |
| chaiterie. Friandise… - (01) |
| chaiteries - friandises, petites gourmandises.- Les enfants et les vieux eumant bein les chaiteries ; et pu to le monde, quoi !.. ne beillez don pâ queman cequi des chaiteries ai vos enfants. Ine bonne soupe vaut mieux. - (18) |
| chaithiâ, château. - (16) |
| chaitnöre, sf. chatenière. - (17) |
| chaitognai. : Attirer un enfant par des friandises, des chateries, comme on dit encore dans le langage familier, en assimilant la gourmandise d'un enfant à celle d'un chat. - (06) |
| chaitogné, attirer par des friandises, des chateries, comme on dit encore dans le langage familier. - (02) |
| chaîtrer - chautrer : castrer - (57) |
| chaîtrer – couper : émasculer - (57) |
| chaive-ceri : morceau de lard fris. (SB. T IV) - C - (25) |
| chaiveusri, sm. chauve-souris. Lard cuit sous la cendre. Petit morceau de lard. - (17) |
| chaiveusseri - chauve-souris. - I eume bein regairdai les chaiveusseri que volant queman cequi le soeir ai l'entrée de lai neu. - In chaiveusseri â entrai dan note chambre i ons aivu ine pô effrayante. - (18) |
| chaivi ou chaivousri. : Chauve-souris. (Del.) - (06) |
| chaivognia : chevesne. (E. T IV) - S&L - (25) |
| chaivousri, chauve-souris. - (02) |
| chaiyot : chariot, char, véhicule à 4 roues et à timon indépendant, utilisé pour transporter le foin et les céréales - (37) |
| chala : On donne ce nom aux tiges de fèves après qu'elles ont été dépouillées de leurs grains par le battage, cette paille grossière peut servir de litière au bétail. - Allée ou sentier que l'on fait dans la neige avec un balai ou un petit traineau, « Fare la chala ». - (19) |
| chala, s. f. 1. Chalée, chemin tracé dans la neige. —2. Enveloppe verte des noix. Verbe echalé, enlever le brou des noix. - (22) |
| châlait, n. masc ; bois de lit. - (07) |
| chalande, chalende : s. f., bas-lat. festum Calendarum, Noël. De là le patronyme « Chalandon ». - (20) |
| chalande. n. f. - Réunion d'amis. (Fernand. Clas, p.368) - (42) |
| chalante, chalanton. s. m. Charançon. - (10) |
| chalbrun, ciel d'été légèrement voilé par un brouillard élevé : signe de sécheresse. - (16) |
| châlé – bois de lit.- Note châlé â bein vieux ; des fouais lai neu i l'entendons craquai. - (18) |
| chale, s. f. siège en bois à trois pieds pour l'étable. Diminutif chalon, petit banc pour les pieds (de selle). - (24) |
| chalée : s. f., bas-lat. catata, allée ; spécialement passage qu'on a pratiqué dans la neige en la rejetant sur les côtés. - (20) |
| chalée, s. f. chemin tracé dans la neige (du latin callala). - (24) |
| chaleil (nom masculin) : lampe à huile. (voir bitouze). - (47) |
| châler : (châ:lè) 1- (v. tr.) crier : « châ: ! » pour faire avancer les bœufs ; les exhorter à ce cri. 2- (v. intr.) avancer très lentement, en parlant des escargots et des limaces ; puis en parlant des êtres humains. - (45) |
| chaler. v. n. Etre essouflé, haleter, perdre haleine par suite d’une course rapide ou de grands efforts. - (10) |
| chaleu (na) : chaleur - (57) |
| chaleu : lampe à huile. III, p. 32-x - (23) |
| chalibaude : flambée de bois. (P. T IV) - Y - (25) |
| chalibaude, chalibaudée, charibaude. s. f. Sorte de flambée, vive, pétillante, qui passe vite, mais qui réchauffe et ragaillardit. Ces trois mots, croyons-nous, doivent être des formes ou, plutôt, des altérations de chaliborde. - (10) |
| chalibaude, charibaude. n. f. - Flambée vive pour réchauffer l’atmosphère et ragaillardir le corps. - (42) |
| chaliborde. s. f. Feu de la Saint-Jean, feu de joie. Du latin calere , chauffer, et de borde, lieu de débauche, endroit où l’on s’amuse. - (10) |
| chalibourne : grand feu de joie du dimanche gras. (AS. T II) - S&L - (25) |
| chalier, écholet : échelle double installée en permanence pour favoriser le passage d'une haie. - (33) |
| chalit, bois de lit. - (05) |
| châlit, s. m. châlit, bois de lit, très usité pour désigner la carcasse entière d'un lit qui se compose du châ et du coucher. - (08) |
| chalivoili. s. m. Charivari. (Ménades). - (10) |
| challion, s. m., la nuque. - (14) |
| chalmais. s. m. Chalumeau. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| chalô, v. imp. inusité. chaloir. N'i chaut bé [n'y chaut bien], n'importe. - (17) |
| chalofrou (ouse) : (chalôfrou - ouse adj.) friand de quelque chose. - (45) |
| chalofrou (ouz') (adj.) gourmand (e), friand (e). (voir aussi cha). Mouè, lé: gô:d', y en seu: chalofrou. "moi, les gaudes, j'en suis friand". - (45) |
| châloin. s. m. Moule à fromage. (Girolles). - (10) |
| chalon : voir calon - (23) |
| chalote. n. f. - Échalote. - (42) |
| chalou : Chaleur, « Demorins voir à l'ambre padant la grande chalou » : demeurons à l'ombre pendant la grande chaleur. - (19) |
| chaloupe : s. f., bateau de plaisance à quille. - (20) |
| chaloupée : danse - (39) |
| chalumiau, s. m., chalumeau. - (14) |
| chalûreu, euse, adj. la chaleur atmosphérique : « le temps est trop « chalûreu », — la journée a été bien « chalûreuse ». « céléreu ». - (08) |
| chalureus, adj., chaleureus. - (14) |
| chalû-yer, v., couper au ras du sol, très proprement. - (40) |
| chamâille. Chamaille. - (01) |
| chamailler (se) : v. r. Le temps se chamaille, est en lutte entre le beau et le mauvais. - (20) |
| chamailler, v. ; disputer. - (07) |
| chamailler. Mal couper, déchiqueter. Ex. : « un morceau de viande chamaillé ». Fig. « Se chamailler » c'est se disputer, se battre. - (49) |
| chamâilli (s') - érigni (s) : chamailler (se) - (57) |
| chambalère : Sorte de support dans lequel la fileuse place sa quenouille, à la partie supérieure de ce petit meuble se trouve une petite tablette munie d'une coupe qui contient les « moillots » qui sont ordinairement des cerises sechées au four (voir moillots). Il y avait aussi la chambalère de la lampe, elle se composait simplement d'un bloc de bois servant de socle et d'une tige destinés à recevoir l'extrémité de la tige de la « lampe à coue ». - (19) |
| chambalére : s. f. plusieurs sens suivant les villages : 1° instrument pendu à la crémaillère pour soutenir la marmite ; 2° support en bois où la fileuse déposait sa quenouille ; 3° support en bois où l'on accrochait la petite lampe à huile ; 4° poignée à crochets pour prendre l'anse trop chaude de la marmite. - (21) |
| chambali, s. m. qui est tout en jambes. Féminin chambalire : quelle grande chambalire ! - (24) |
| chamballère : s. f.. chambrière. Syn. aussi de donzelle et servante. - (20) |
| chambarder, v. tr. et intr., lancer au loin avec colère vaciller, tituber : « J'ai chambardé c' chaudron au mitan d’ la rue ». — Ol a trop bu, l'ivrougne ; ô chambarde. » (Pour ce dernier mot, v. Chambiller). - (14) |
| Cham-Batin. Chambertin, vignoble célèbre dans le voisinage de Dijon. - (01) |
| chambe (na) : jambe - (57) |
| chambe : Jambe, « Quand on n'a pas de mémoire i faut avoi de bonnes chambes » : quand on oublie de prendre ce qu'on devait emporter on en est quitte pour retourner sur ses pas. - Quand après un premier verre de vin on en offre un second on insiste en disant : « An ne s'en vas pas su eune chambe ». - (19) |
| chambe, jambe. - (05) |
| chambe, n.f. jambe. - (65) |
| chambe. Jambe. Nous appelons le mollet « ventre de chambe ». - (03) |
| chambellan : gentilhomme chargé du service de la chambre d'un monarque. - (55) |
| chamberiée. s. f. Chambrière, petite pièce de bois servant à soutenir une voiture horizontalement. (Bléneau). - (10) |
| chambeurte (na) : cellier - (57) |
| chambeurte (na) : chambre à lait - (57) |
| chambière : servante dans les maisons bourgeoises. - (33) |
| chambieux. s. m. Cordon pour soutenir la quenouille à l’épaule. De châble, châbleau, châbiau, chambiau. - (10) |
| chambiller, v. intr., aller de travers, tituber : « Voui, l’boun houme, ôl a trop pinté ; quau ô r'veint cheù lu, faut vouer c'ment ô chambille ! » (V. Chambarder). - (14) |
| chambilli : Tituber, chanceler, « Est-ce que t'es en ribotte ? an dirait que te chambilles ». - (19) |
| chambillote, s. f., croc en jambe. - (14) |
| chambleire, s. f. chambrière, femme attachée au service d'une maison bourgeoise, qui ne travaille pas aux champs, mais à l'intérieur. « çambière, çambiée. » - (08) |
| chambleire, s. f., chambrière, servante. - (14) |
| chambleire, servante , femme de chambre... - (02) |
| chambleire. Chambrière, servante... On appelle aussi chambleire une suspension en fer que l'on accroche à la crémaillère pour porter une poêle, une casserolle ou un gaufrier. - (13) |
| chambleire. : Petite servante. On disait aussi chambrillon. - (06) |
| chambr'aute, s. f. chambre haute ; chambre des étages placés au-dessus du rez-de-chaussée. C’est presque un château en Morvan qu'une maison ayant des « chambr'autes. » - (08) |
| chambr'aute, s. f., chambre haute, pièce située au premier ou au deuzième étage d'une maison. Elle est haute relativ. au rez-de chaussée : « Pâre et mâre coucheint au bas ; moi, j' coucho dans la chambr'aute ». - (14) |
| chambre ai for : pièce dans laquelle se trouve le four - (48) |
| chambre. n. m. - Chanvre. - (42) |
| chambrer : v. a., placer un objet dans une chambre pour lui en donner la température. Chambrer du vin, placer du vin dans une chambre à température suffisante pour en développer le bouquet. On chambre le vin rouge, mais pas le vin blanc. Le vin chambré, qui reste en vidange quelques heures, n'en a que plus d'arôme. - (20) |
| chambreux. adj. - Fruit ou légume à la chair fibreuse, comme le chanvre. - (42) |
| chambr'haute : Premier étage, chambre à coucher supplémentaire, située parfois au-dessus de la cuisine, qui la plupart du temps était la pièce unique habitable. - (19) |
| chambrier : grand officier qui était chargé du service de la chambre du roi. - (55) |
| chambrier. s. m. Locataire, qui occupe une ou deux chambres. - (10) |
| chambrière, chamberiée, chambriée, chambrée. n. f. – Sous une charrette, petit poteau en bois servant à la maintenir horizontale à l'arrêt lorsqu'il n'y a plus de cheval. - (42) |
| chambrière, porte-poêle. - (05) |
| chambrière, s. f., pièce de bois qui supporte le tombereau non attelé. - (40) |
| chambron, s. m. petite chambre. - (22) |
| chambron, s. m. petite chambre. - (24) |
| chambroté, adj. se dit d'un blé dont les tiges sont affaissées et mélangées. - (24) |
| chambrôte. Chambrette, chambrettes, petites chambres. - (01) |
| chambrotte : une cuisine d'été, une dépendance qui sert à tout, surtout à cuisiner - (46) |
| chambruer, à demi chaud, à demi sec, en parlant du pain grillé. - (38) |
| chamfô : partie des bâtiments où on met la moisson - (39) |
| chamiée : chénevière (pièce de terre plantée de chanvre) - (61) |
| chamiée : chenevière. IV, p. 28-g - (23) |
| chamiée : chanvrière. - (58) |
| chamiée, chemiée, caimiée. s. f . Chènevière. - (10) |
| chamipier, v. a. conduire aux champs, mener paître. - (08) |
| chamique : s. f., syn. de chamoure. - (20) |
| chammiée, chamnée, cemnée : chenevière. - (32) |
| chamnée : voir chamiée - (23) |
| chamnottes : chèvenottes. IV, p. 15-1 - (23) |
| chamoiser, chamoiller : v. a., vx fr. chamoisier, frapper, meurtrir, écraser, triturer. - (20) |
| Chamoué : nom de bœuf. Ill, p. 29-o - (23) |
| chamoure : s. f., flan de courge, autrefois mets classique des vendangeurs. - (20) |
| chamourier : s. m., vendangeur, parce que mangeur de chamoure. - (20) |
| champ (en), loc. au pâturage : mettre les vaches en champ ; aller en champ aux chèvres. - (24) |
| champ (en), loc. au pâturage : mettre les vaches en champ. - (22) |
| champ : « Aller en champs », mener paître le bétail ; à Mancey où il n'y a presque pas de prés on conduit le bétail paître dans les champ, sur des teppes Quand il y a un complément direct on dit « mener en champs ». - (19) |
| champ : (chan - subst. m.) champ. - (45) |
| champ : s. m., aller en champ, mener paître le bétail. Aller sur les champs, aller à la selle. Etre sur les champs, être sur les routes, voyager pour faire son apprentissage ou se perfectionner dans l'exercice d'un métier, trimarder. - (20) |
| champ, nom de loc. nous avons en nivernais et particulièrement en Morvan près de deux cents noms de lieu qui sont tirés de champ avec ou sans qualification. - (08) |
| champai, jeter... - (02) |
| champai. : Jeter(Del.). - (06) |
| Champaie : Champeau - (48) |
| champaigne, s. f. plaine, endroit plat relativement aux terrains qui l'environnent. - (08) |
| champailli : paître - (57) |
| champayage, champoyage : s. m., champéage, pâturage. Pré de champayage, pré affecté exclusivement au pâturage. - (20) |
| champàyé, v. a. mettre en pâture. - (22) |
| champayer, champoyer : v. a. ; au prop., faire paître, mettre en pâturage ; au fig., dorloter, choyer. - (20) |
| champàyer, v. a. mettre en pâture : faire champàyer un pré. - (24) |
| champ-de-chaudron (le), jeu de la marelle ; jeu d'enfant qui consiste à faire sauter une pierre d'un champ circonscrit, en sautant sur un pied. - (08) |
| champè : jeter - (46) |
| champein. Jetions, jetiez, jetaient. L'infinitif champai, jeter, vient du mot champ, comme qui dirait jeter au champ… - (01) |
| champer, v. tr., camper, placer, mettre, et jeter, laisser là. - (14) |
| champero. Jetterais, jetterait. - (01) |
| champie - jeter là une chose qui embarasse ou encore éparpiller. En te fau champie cequi, vais ci ne vau ran du tot. Champie moi don cequi à mutan de lai rue. - (18) |
| champié : 1 v. t. Éparpiller. - 2 v. i. Virer. - 3 v. t. Envoyer balader. - (53) |
| champié : te voilà installé ici - (39) |
| champier (verbe) : conduire le bétail aux champs pour le faire paître. - (47) |
| champier : envoyer ailleurs, chasser - (48) |
| champier : (chan:pié - v .trans.) : chasser, évacuer, éconduire. - (45) |
| champier, combattre en champ clos, champier, corriger. - (04) |
| champier, v., repousser un objet avec son pied. - (40) |
| champier. Chasser un importun d'une maison, l'envoyer aux champs, ou mieux : l'envoyer paître. C'est l'abréviation du vieux mot champoyer admis par quelques lexicographes. - (13) |
| champier. Disperser, jeter de côté et d'autre, jeter par les champs, jeter à travers champs. On dit volontiers en Bourgogne : jeter en champ, pour jeter un objet dont on ne veut plus. Etym. champ, qui est la racine du verbe créé par nous. - (12) |
| champier. Éparpiller, disperser, jeter ça et là ; mettre dehors. « Aul ait, (aul y ait) tot champié ». - (49) |
| champier. v. - Geler Employé uniquement pour la vigne. - (42) |
| champignot , champouègnot : champignon - (48) |
| champignot : champignon. - (33) |
| champignot, s. m. champignon. - (08) |
| champignot, s. m., champignon. - (14) |
| champlain, s. m. quelques parties du Morvan donnent ce nom à un espace libre, à une place publique où se tiennent les foires, apports ou marchés. Sur le champlain de Château-Chinon s'élevait le gibet seigneurial. - (08) |
| champler. v. a. et n. Geler, être saisi par la gelée. Se dit du bois de la vigne. - (10) |
| chamployage, champoiance : droit de faire paître les bestiaux dans les bois seigneuriaux. - (55) |
| champlure. n. f. - Gelée sur la vigne. - (42) |
| champlure. s . f. Action de la gelée sur la vigne. - (10) |
| champnettes de murs. : Coutumes de Châtillon, 1371, d'où, plus tard, channettes et chanates, tuyaux de conduite d'eau pluviale. - (06) |
| champoi - pâturage ; ce qui le regarde.- A vouraint aiboli le champoi ma quoi qu'i fairains des bêtes ? Le champoi aivou Painbliain et Cuchey â ine mine de disputes ; c'â demaige cair al â précieux. - (18) |
| champoro : faire champoro, c'est ajouter du vin dans la soupe du pot au feu - (46) |
| champôrô, s. m,, mélange (2/3 de café ; 1/3 de vin rouge). - (40) |
| champoué. s. m. pacage, pâturage. On dit aussi « champiaige » = champiage : « al é eun bon champoué ai l'entor de lu », il a un bon pacage dans ses environs. - (08) |
| champouéyer, v. a. pâturer, faire paître les animaux. S’emploie absolument : « champouéyer» dans les bois. - (08) |
| champoyè : faire paître les animaux dans les pâtis, (voir paquié), tondre superficiellement - (46) |
| champoyer, promener dans les champs. - (26) |
| champoyer, v. tr.. conduire aus champs les différents troupeaus. - (14) |
| champtiant (en). loc. verb. - Sans se presser, en prenant son temps, en plusieurs fois. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| chan, s. m. côté, tranche. Mettre « de chan, sur chan » = de côté, sur le côté. Être « sur chan » est l'opposé d'être à plat. - (08) |
| chan, sm. lardon provenant de la fonte de la panne de porc. - (17) |
| chanau, s. f. chéneau d'un toit ou son tuyau de descente. - (22) |
| chanau, s. f. chéneau d'un toit ou son tuyau de descente. - (24) |
| chanbe, chande, chanble et chambre. s. m. Chanvre. - (10) |
| chanblëre, femme de chambre. - (16) |
| chanblöre, sf. servante pour maintenir les voitures en équilibre. - (17) |
| chanbr'ôte, chambre haute au-dessus du rez-de-chaussée. - (16) |
| chancelé, adj. se dit du linge lorsqu'il est taché par le séjour à l'humidité. - (24) |
| chanceler (se) : v. r., vx. fr., se canceller. Le linge neuf est dit chancelé lorsqu'il est tacheté par l'effet de l'humidité. Voir piper (Se). - (20) |
| chanchounette(s) : petites mèches ébouriffées - (39) |
| chanchounette, s. f. tresse de cheveux que les femmes ramènent sur la tête lorsqu'elles se coiffent : « une chanchounette bionde. » « chonette, chounette ». - (08) |
| chanchue, s. f. sangsue. - (08) |
| chanci (du pain) : moisi ou rance. (LS. T IV) - Y - (25) |
| chançou, adj. chanceux. - (17) |
| chancre : s. m., cancer ; muguet des enfants. - (20) |
| chancre, ulcère cancéreux ; se dit aussi pour plaie d'arbre, de vigne, etc. - (16) |
| chandâle : Chandelle, « Allome dan la chandâle » : allume la chandelle. « Fare la chandâle » se tenir droit, en équilibre sur la tête, les pieds en l'air, c'est ce qu'on appelle en d'autres pays, faire le poirier fourchu. - Mucosité qui sort du nez, « Ce ptiet a eune balle chandâle seu le nez ». - (19) |
| chandalle, s.f. chandelle. - (38) |
| chande : Chanvre (cannabis sativa), « Eune mâche de chande » : une poignée de chanvre. Voir mâche. - (19) |
| chande : chanvre —être marié en chande, c'est lorsque la femme est plus grande que le mari. - (30) |
| chande : filaments (du chanvre). IV, p. 15-1 - (23) |
| chande. Chanvre. - (49) |
| chandeille, s. f. chandelle. - (08) |
| chandelage, s. m. action de la gelée qui soulève les terres en formant à la surface une forêt de petites aiguilles ou chandelles de glace. Le « chandelage » est souvent funeste aux récoltes en déracinant les céréales qui restent, pour ainsi dire, suspendues en l'air. - (08) |
| chandeler, v. n. se dit des terres arénacées qui se soulèvent par l'effet de la gelée en formant une multitude de petites chandelles ou aiguilles de glace, lesquelles supportent une légère croûte de terrain. - (08) |
| Chandeleur : A la Chandeleur (2 Février) on portait autrefois bénir un cierge que l'on allumait en certaines circonstances : au cours d'un orage, au chevet d'un mourant quand on l'administrait - (19) |
| chandeleuse (la), la chandeleur, fête de la présentation de Notre-Seigneur au temple. - (08) |
| chandelle : chandelle. Mais aussi lampe à pétrole mobile, sur pied, pour l'éclairage domestique. Pour l'éteindre : "On tuait la chandelle". Le pétrole était dit, techniquement : pétrole lampant. - (58) |
| chandelle : s. f., mucosité, ordinairement purulente, qui coule des narines sur la lèvre supérieure. - (20) |
| chandelle : voir pressoir. - (20) |
| chandelle. n. f. - Tout ce qui éclaire : bougie, huile, lampe à pétrole, ampoule, etc. En ancien français, la chandoile, du latin candela, indique uniquement le sens de chandelle, flambeau de suif.utilisé au quotidien. La Chandeleur au XIIe siècle était la Fête des chandelles. Le poyaudin élargit le sens de ce mot à tout type d'éclairage. - (42) |
| chandelle. s. f. Tout ce qui éclaire artificiellement. Chandelle de suif. Chandelle de cire (cierge, bougie). Chandelle d’huile (lampe). Du latin candela. - (10) |
| chandelö, sm. chandelier. - (17) |
| chandelour, chandelouze, sf. chandeleur (2 février). - (17) |
| chandelouse. Fête de la Chandeleur. On a dit autrefois Chandeleuse. - (03) |
| chandelouze. - (05) |
| chandi (adj.) : moisi - (64) |
| chandié, s. m. syncope de chandelier. - (08) |
| chandier, chand’lé, changlé, changuier. s. m. Chandelier. - (10) |
| chandier, s. m., chandelier. - (14) |
| chandlouse : s. f. chandeleure. - (21) |
| chane : Entonnoir en fer blanc, dont on se sert pour remplir les fûts et les bouteilles. - (19) |
| chane : s. f., vx fr., cannelle, robinet de fort calibre. - (20) |
| chane, s. f. entonnoir de fer. - (22) |
| chane, s. f. entonnoir de fer. Diminutif chanœte (du vieux français chane, pot). - (24) |
| chane, sf. cruche en terre. - (17) |
| chane. Chêne. Vieux mot. Nous avons beaucoup de lieux dits « La chanée », lieu planté de chênes. - (03) |
| chanée : s. f., chéneau. gouttière. I pleuvait si tellement fort que la raie du c... me servait d' chanée. - (20) |
| chanée. s. f., chênaie. - (14) |
| chanei. Charnier, charniers. En français charnier, est un lieu à mettre les ossements des morts. En bourguignon, c'est un caveau où les particuliers de quelque famille ont droit de se faire enterrer... - (01) |
| châner. v. n. Braire. - (10) |
| chanet : s. m., tuyau de descente par où s'écoule l'eau de la chanée. - (20) |
| chanette, chanlatte. Conduit de ferblanc destine à recevoir les eaux de pluie qui descendent du toit et a les conduire sur le sol. Etym. canalis, d'où chenal, cheneau, dont chanette et chanlatte ne sont qu'une forme dialectique. - (12) |
| chanevière : Chénevière, terre plantée en chanvre, puis terre propre à la culture du chanvre, « Y est du tarrain de chavenère », c'est du terrain très fertile. - (19) |
| chanfaud : grenier de grange. On dit aussi chafaud ; Ce chanfaud se présente généralement comme une mezzanine. - (62) |
| chanfleur. Forme gracieuse de chante-pleure. Tube tronc conique en métal ou en verre qu'on obture par en haut avec le pouce après l’avoir plongé dans un liquide qu'on veut tirer d'un récipient sans l’agiter, et dans lequel le liquide demeure en suspens par la pression atmosphérique. - (12) |
| chanfrier, v. parler français. - (38) |
| chanfriller, v. intr., se dit des paysans qui veulent faire montre de parler français : « Aga, c'tu-là ; l'entends-tu ? ô chanfrille ». Pris en mauvaise part. - (14) |
| changhassier, changeoquer, changottier s. m. Qui aime le changement, qui change souvent, particulièrement les ouvriers, les domestiques. - (10) |
| changi : Changer, « T'es to trempe, va vite te changi » : tu es trempé, va vite te changer. - (19) |
| changuelle. s. f. Chandelle. (Poilly-sur-Serein). - (10) |
| changuier. s. m. Sanglier. — Se dit aussi, dans quelques localités, pour chandelier. - (10) |
| chani : se prononce : chan - ni. Moisi, solides comme liquides. Impropre à la consommation. Ex : "Tin ! ar'gade don nout' pain, il est tout chani !" - (58) |
| chani, adj., chanci, rance, moisi. - (14) |
| chanille : Chenille, « Les feuilles des abres sant mijis des chanilles ». - (19) |
| chanin : brume - (44) |
| chanin : brume légère. (SB. T III) - S&L - (25) |
| chanin, adj. brumeux : le ciel est chanin. - (22) |
| chanin, adj. brumeux : le ciel est chanin. - (24) |
| chanin, n.m. brouillard. - (65) |
| chanin, subst. masculin : brume. - (54) |
| chanin. chanine : adj., vx fr. chienin, de chien, désagréable. Se dit du temps quand le ciel est couvert, gris, incertain. Lyonnais. : temps de chien (caninus). - (20) |
| chanin. Léger brouillard à l'horizon. « Le chanin » indique, dit-on, le beau temps. - (49) |
| chanion (chânion) : s. m., vx tr.chaaignon, chaînon. Chânion du cou, nuque. - (20) |
| chanlit, s. m., châlit. bois de lit. - (14) |
| channage, sm. [charnage]. alimentation, entretien. Bon channage, bonne nourriture. - (17) |
| chan-natte, chanlatte. - (26) |
| channatte, chennate : chêneau. - (66) |
| channe : s. f. : « fontaine » du tonneau. - (21) |
| channe. s . m. Chanvre. (Rugny). - (10) |
| chan-ner. Achever un animal blessé, malade. « Channe-le don ! ». - (49) |
| channer. v. a. et n . Ouvrir la bouche en écartant les lèvres et montrant les dents, ainsi que fait l’âne quand il veut braire. — Voir châner. — Se dit, à Auxerre, pour avaler, pour boire. - (10) |
| chan-ni : moisi - (60) |
| channi, ie. adj. Chanci, moisi. Du pain channi. - (10) |
| channi, v. n. chancir, moisir, couvrir de moisissures : du pain « channi », du fromage « channi. » - (08) |
| chânnir : se moisir. - (09) |
| channir. v. n. Chanier. Du latin canere, canescere , blanchir, être blanc de moisissure. - (10) |
| channöte, sf. [chénette, chanlatte]. chéneau. - (17) |
| chanon : s. m., étui â aiguilles. - (20) |
| chanöt, sm. petit broc. Pot à eau. - (17) |
| chanpleure, s. f. robinet de tonneau, cannelle par où s'écoule le vin, la bière, etc… - (08) |
| chanpoi, espace ou paît le bétail. - (16) |
| chanquiau : part de pain. - (09) |
| chanran : Charron, « La boutique du chanran est fremée (fermée) ». - (19) |
| chanron. Charron. - (49) |
| chanronner, v. n. travailler le bois en amateur, imiter le charron ou le menuisier. - (24) |
| chanrouné, v. n. travailler le bois en amateur, imiter le charron ou le menuisier. - (22) |
| chansenôte. Chansonnette, dhansonnettes… - (01) |
| chansonnet. n. m. - Sansonnet. - (42) |
| chansonnet. s. m. Sansonnet, oiseau. - (10) |
| chant : (chan - subst. m.) chant, côté étroit d'une pièce de bois. - (45) |
| chantâgne. n. f. - Châtaigne. - (42) |
| chantai : (chantê: - subst. m.) : entamure du pain béni au cours de la dernière messe, que les fidèles se transmettaient à tour de rôle d'un dimanche sur l'autre. A la famille qui recevait le chanteau incombait de fournir le pain qui devait être béni le dimanche suivant. - (45) |
| chantai. Chanter. « Chantai Salvé » se dit par manière de proverbe, pour marquer qu'on est perdu sans ressource, la coutume étant de chanter pour les criminels le « Salve Regina » sur le point de leur exécution. - (01) |
| chantain. s. m. et chantagne. s. f. Châtaigne. - (10) |
| chantan. Chantant. - (01) |
| chantchau. Chanteau. - (49) |
| chantcheau, chantiau. n. m. - Entame d'un gros pain ; H. Chéry explique : « Morceau de pain conservé par une personne qui a offert le pain bénit à la messe et qu'elle passe ensuite à une autre personne : celle-ci devra, à son tour, offrir le pain le dimanche suivant : passer l'chantcheau. » - (42) |
| chanteai, s. m. chanteau, morceau, quartier de pain. « chantiau, chanquiau. » - (08) |
| chante-fleute, s.f. chante-flûte ; patois moderne. - (38) |
| chantelle : perdrix servant de piège pour attirer les mâles. - (30) |
| chanter (un), service funèbre de 15ne. - (05) |
| chanter : v. a. Chanter le coq, chanter le poulet, se dit de la poule qui imite le chant et l'attitude du coq, fait considéré comme un mauvais présage. - (20) |
| chanteré. Chanterez, chantera. - (01) |
| chantia, s.m. objet ou souhait que l'on envoyait à quelqu'un dans l'espoir d'une réciprocité ; morceau ou partie de quelque chose ; "recevoir le chantiâ", morceau de pain bénit qui était donné par la personne qui l'avait offert à celui qui devait l'offrir la prochaine fois. Première pièce d'un fond de fût. - (38) |
| chantiau (nom masculin) : entame du pain. - (47) |
| chantiau : Chanteau, petite pièce arrondie du fond d'un tonneau ayant la forme d'un segment de cercle. - Gros morceau de pain coupé, « Cope me voir in chantiau » : coupe moi un bon morceau de pain. - (19) |
| chantiau : partie d'une miche de pain, le quignon. - (33) |
| chantiau : morceau (principalement de pain). Ex : "Coupe moué don un chantiau d’pain pour fini mon froumage !" - (58) |
| chantié, s. m. sentier, chemin de traverse, - (08) |
| chantille. s. f. A Auxerre, on entend par ce mot un contre-mur de briques sur plat élevé dans la cheminée de fond en faîte. - (10) |
| chantire. Chantâmes, chantâtes, chantèrent. - (01) |
| chantoiyé, chanter à demi-voix. - (16) |
| chanton. Chantons. - (01) |
| chantoo. Chantais, chantait. - (01) |
| chantou (on) : chanteur - (57) |
| chantou (-ouse) (n.m. ou f.) : chanteur (-euse) - aussi çantou - (50) |
| chantou : Chanteur, chantre d'église, « Le jo quasimodo le curé paye à marande (à manger) à ses chantous ». - (19) |
| chantou : s. m. nom donné au coq. - (21) |
| chantou, chanteur. - (05) |
| chantou, ouse, s. chanteur, chanteuse. « çantou, çantoure. » - (08) |
| chantou, s. m. et adj ., chanteur. - (14) |
| chantre, s. f. jante de roue. - (08) |
| chantre, s. f. Jante de roue. (Argentenay). - (10) |
| chantroïlli : Chantonner un peu ou chanter mal. - (19) |
| chantrouiller. v. tf.et intr., chantonner, fredonner, mais de façon peu remarquable. - (14) |
| chantrouyi, v. n. chantonner. - (22) |
| chantroyi, v. n. chantonner. - (24) |
| chanu, s.m. brume, brouillard (l'année du grand chanu, en 1859). - (38) |
| chanvrotté : adj., syn. de chevenotté. - (20) |
| chao, adj. chaud. - (38) |
| chaot, chaon (prononcez chahot, chahon). s. m. Se dit par contraction de chaillot et chaseron, moule à fromage. - (10) |
| chapais, chaipiau, chépias. s. m. Chapeau. - (10) |
| chapaloux, chapalouse : s. m. et f., chapelier, chapelière. - (20) |
| chapan : Plant de vigne non raciné ni greffé. « Trier des chapans » : choisir les brins de sarments les plus propres à faire de bons plants, pour faciliter cette sélection on a soin de « marquer » les ceps les plus productifs - (19) |
| chapau, s. m., crasse, croûte qui se trouve sur le sommet de la tête des nouveau-nés et que les mères ont la maladresse de respecter en vue de la santé de l'enfant. Ce mot n'a pas la mouillure comme chapiau. - (14) |
| Chapé : nom de bœuf. III, p. 29-o - (23) |
| chape*, s. f. petit hangar. - (22) |
| Chapé, e. nom de bœuf ou de vache. Désigne plus particulièrement les bêtes à cornes qui ont la tête blanche ou blonde. « Çaipé ». - (08) |
| chapé, ée. adj. - Se dit d'un bœuf.ou d'une vache à la tête mouchetée. - (42) |
| chape, ér. adj. Se dit d’une bête à cornes mouchetée de blanc et d’autres couleurs à la tête. De caput , tête, ou capeline, chapeau. - (10) |
| chape, f. petit hangar (du latin cappa). - (24) |
| chape, s.f. gerbier. - (38) |
| chapeau : s. m. chapeau de lampe, abat-jour. - (20) |
| chapeler des calots : faire tomber des noix. (PSS. T II) - B - (25) |
| chapeler des pommes ou des noix ; les abattre avec une gaule. En patois de l'Yonne, on dit châbler. - (13) |
| chapeler : briser, casser, mettre en miettes - (39) |
| chapeler, gauler des fruits. - (28) |
| chapen, s. m. sapin. - (08) |
| chapiâ, s. m., chapeau - (40) |
| chapiâ, s.m. chapeau. - (38) |
| chapiau (un) : un chapeau - (61) |
| chapiau, s. m. chapeau. - (08) |
| chapiau, s. m., chapeau. - (14) |
| chapiau. n. m. - Chapeau. - (42) |
| chapié : s. m. débris ou éclats de pierre, qui s'accumulent au fond des carrières. - (21) |
| chapier : v. 1° hacher (en parlant de l'effet de la grêle sur les plantes) ; 2° gauler les noyers. - (21) |
| chapier. s. m. Chapelier. (Massangy). - (10) |
| chapigner. v. - Quereller, disputer, chercher des histoires. (Bléneau, selon M. Josier) - (42) |
| chapigner. v. a. Quereller, injurier, houspiller. — Se chapigner. v . pronom. Se quereller, se prendre aux cheveux. De caput. (Bléneau, Saint-Florentin, Percey). — On dit aussi chapiner. - (10) |
| chapiot : chapeau - (44) |
| chapitchau, chapiquiau, chapiteau. s. m. Hançar. (Béru). — En Puysaie, on appelle chapiteau une sorte d’appentis qui abrite la porte d’entrée de quelques églises. - (10) |
| chapitchau, chapiteau, chapiquiau. n. m. - Auvent. - (42) |
| chapite (n.m.) : chapitre - (50) |
| chapiteau : s. m., vx fr. chapitel, auvent, porche. - (20) |
| chapitre : assemblée de chanoines. - (55) |
| chapler : affuter et gauler. Repiquer une meule usée, reformer le fil d’une lame de faux. Aussi rechapler ou enchapler ; également gauler les noix : « chapler les calâts ». - (62) |
| chapler, v. tr., abattre à coups de gaule, surtout les nois : « Ol a chaplé les calas de ses grands neùyers. Y en a tant, qu'ô n' sarot les compter ». - (14) |
| chapler, v. tr., tailler, couper, mais surtout hacher : « As-tu chaplé tes harbes ? la sôpe va boudre ». - (14) |
| chaplier : Battre, abattre, gauler. « Chaplier des calas » : gauler des noix. On réservait autrefois les œufs du Vendredi saint aux « chaplioux » de calas pour les préserver du risque de se casser le cou en tombant du noyer…. - Hâcher des herbes pour le boudin Vieux français, chaplier battre. - Chabler battre à coups de gaule (Larousse), expression : « La grale (grêle) a bien chaplié les bliés ». - (19) |
| chaplliò, s. m. fins débris de pierre dans une carrière. - (22) |
| chaplou, s. m., petite enclume portative pour battre la faux. - (40) |
| chaplu, adj. chappé. Se dit du grain lorsqu'il n'est pas encore sorti de son enveloppe ou balle : « du blé chaplu. » - (08) |
| chapon : s. f. façon de planter la vigne : planter des rejets et non des jeunes plants. - (21) |
| ch'apon : s. m. sabot des animaux à cornes. - (21) |
| chapon, n.m. bouture. - (65) |
| chapon, s. m. grain qui ne s'est pas dépouillé sous le fléau, qui est demeuré dans la balle. - (08) |
| chapon, s. m. jeune plant de vigne (vieux français). - (24) |
| chapon, s. m. jeune plant de vigne. - (22) |
| chapon. Croûte de pain frottée d'ail. Ce mot me semble avoir été formé ironiquement et par contre-sens : la frottée d'ail était souvent le plat principal, le chapon du pauvre paysan. On lit dans le a dictionnaire des proverbes français : » - Si tu te trouves sans chapon, - Sois content de pain et d'oignon. - (13) |
| chapon. n. m. - Plan de vigne, petit sarment coupé sur une branche mère, pour être replanté. - (42) |
| chapon. s. m. Brin de sarment qui, au moment de la taille de la vigne, est coupé dans une mère-branche, pour être planté. (Auxerrois). - (10) |
| chaponnière : cage à poussins. (LCSS. T IV) - S&L - (25) |
| chapote : s. f., plat de viande chapotée. De la chapote de poulet. - (20) |
| chapoter (v. tr.) : tripoter, toucher sans cesse (syn. chicoter) - (64) |
| chapoter : tailler - (34) |
| chapoter : (chapotè - v. trans.) couper en menus morceaux, sans ordre ni méthode. - (45) |
| chapoter : v. a., vx fr., taillader, couper en menus morceaux. S’emploie le plus souvent en mauvaise part. - (20) |
| chapoter, chapouter. v . a. Couper, tailler une pièce de bois maladroitement, grossièrement, avec un mauvais instrument ; coupasser un morceau de bois pour faire de menus copeaux. - (10) |
| chapoter, couper, tailler. - (04) |
| chapoter, v. a. 1. couper en morceaux. — 2. Bavarder. - (24) |
| chapoteur, chapoteuse, chapotoux, chapotouse : s. m. et f., celui ou celle qui chapote. - (20) |
| chapouner, se dit des incisions qu'on fait dans l'écorce d'une branche et à distances plus ou moins régulières. Après une opération de ce genre, on a un bâton « chapouné ». - (08) |
| chapouni (on) – bouet (on) : épinette - (57) |
| chapouron, s.m. anneau de cuir fixant la verge du fléau. - (38) |
| chapoutai : couper du bois à la hache. L'hiver on vé chapouter du bois : l'hiver on va couper du bois. - (33) |
| chapouté, v. a. 1. Couper en morceaux. — 2. Bavarder. - (22) |
| chapouter (v.t.) : tailler du bois (de l'a. fr. chapuiser) - (50) |
| chapouter (verbe) : tailler du bois, généralement pour fabriquer un petit objet utilitaire. - (47) |
| chapouter : boulot mal effectué - (44) |
| chapouter : Couper à petits morceaux, déchiqueter, « Ne chapoute pas tan pain ». Au figuré : « La grale a bien fait du mau, les bliés sont hachés » : la grêle a fait beaucoup de mal, les blés sont hâchés. Vieux français, chapoter : tailler. - (19) |
| chapouter : couper comme un goujat, couper en petits morceaux - (48) |
| chapouter : couper du bois avec un couteau - (60) |
| chapouter : déchiqueter, couper négligemment. De « capputiare » : tailler ou de « chapuis » : charpentier. - (62) |
| chapouter, chapoter. Tailler grossièrement un morceau de bois ; taillader. - (49) |
| chapouter, chapoter. v. - Taillader avec un couteau, faire des éclats dans un morceau de bois. Chapeler signifiait au XIe siècle : frapper rudement, couper, tailler en pièces, notamment un ennemi armé. Le sens s'est ensuite appliqué aux arbres et au pain ; d'où le mot chapelure, dès le XIIe siècle, pour miettes de pain. Il subsiste dans chapouter l'idée de couper un objet tenu dans la main. - (42) |
| chapouter, couper du bois menu. - (05) |
| chapouter, v. mal couper, couper en petit morceaux. - (65) |
| chapouter, v. tr., couper à tout petits bouts, morceler, avec hache, couteau, ciseaus : « La couturière m'a chapouté ma robe » — « Voyons, drôlet, n' chapoute pas mon bâton... » - (14) |
| chapouter, verbe transitif : déchirer ou couper sans déchiqueter. - (54) |
| chapouter. Couper du bois en petits morceaux. A rapprocher de chapuis, qui signifiait autrefois charpentier et qui est devenu un nom propre. (V. Chappe.) - (13) |
| chapouter. Couper en petits morceaux. - (03) |
| chapouteur, adj., chapardeur, voleur. - (40) |
| chapouteux, chapoteux. n. m. - Celui qui chapoute. - (42) |
| chapoutoir, chapotoir. s. m. Billot de bois monté sur trois pieds, qui sert pour chapouter. - (10) |
| chapoutoir. n. m. - Billot de bois qui sert à chapouter. - (42) |
| chapoutou (n.m.) : celui qui travaille le bois avec la cognée ou la plane - (50) |
| chappe (châpe) : s. f., bas-lat. chappa, appentis. « Un baptiment couvert à paille concistant en une grange, une chappe de chacque cotté, avec deux écuries attenantes auxdiltes chappes... » (Archives dép.. F. 1294, 5 mars 1741). - (20) |
| chappe : Lien de cuir qui relie l'échot (manche) à la varge (battant) de l'écousson (fléau). - (19) |
| chappe : partie d'un bâtiment réservé aux céréales. - (31) |
| chappé : nom d'un bœuf d'attelage moucheté de blanc sur la tête. - (33) |
| chappe : s. f. partie du fléau qui relie le manche à la verge. - (21) |
| chappe. Bâtiment de ferme, écurie, grange. Les Morvandiaux disent châ. M. Pelletier de Chambure dérive ce mot de casa ou de castrum : J'aime mieux le faire venir, comme chapouter, de notre vieux mot chapuis. Dans certains pays on écrit chapt, qui a formé cheptel, location d'animaux avec moitié des produits. En basse latinité, chappa était la remise des chars et des charrues... - (13) |
| chapple, partie de la grange à gerbes. - (05) |
| chapple, s.f. anneau de cuir fixé au manche du fléau. - (38) |
| chapplié, v. a. frapper. - (22) |
| chapter : marcher bruyamment. A - B - (41) |
| chapter : marcher bruyamment - (34) |
| chapter v. (de clapoter). Marcher bruyamment (surtout dans la boue). - (63) |
| chapter, patrassi : marcher bruyamment - (43) |
| chapu. adj. Couvert, enveloppe d’une chape. — Blé chapu , blé tellement serré dans sa balle, dans sa chape , qu’un premier tour de tarare ne suffit pas pour l’en débarrasser et qu’il faut lui donner pour cela un second tour. - (10) |
| chapuzer : couper de petits morceaux de bois. (REP T IV) - D - (25) |
| chaqueigne. Pron. indéfini. Chacun. (Ménades). - (10) |
| chaquin, chacun. - (38) |
| char : s. m. Plusieurs pièces du char ont des dénominations qui nous paraissent purement locales. - (20) |
| char, adj. cher. - (38) |
| char, s. f. chair. - (08) |
| char, s. f., chair, viande. - (14) |
| char. Chair. Char pour chair était, il y a 250 ans, le mot d’usage. - (01) |
| charabaté, v. a. charrier en cahotant. - (22) |
| charabater, v. a. charrier en cahotant. - (24) |
| charabotter : v. a., farfouiller, mettre en désordre. - (20) |
| charaçon, charasson : s. m., barre métallique, armée de dents puissantes, à laquelle on accroche les quartiers de viande dans les boucheries, etc. - (20) |
| char-a-glace, s. m., sorte de traîneau plus ou moins rudimentaire, boîte longue en planches sur laquelle s'assiet le promeneur, et qu'il pousse à l'aide de deus bâtons à clous. - (14) |
| charatte : Charette. Dans le vignoble on désigne particulièrement sous le nom de charatte la voiture à quatre roues spécialement construite pour servir à transporter la vendange de la vigne à la cuve. - (19) |
| charban : Furoncle, clou. « Il li est veni in charban à la cliate » : il lui est venu un gros bouton à la nuque. S'il s'agit effectivement d'un furoncle, on dit : « in farrang'lle». - (19) |
| charbeuchlle, s. m. charbon du blé. - (22) |
| charboïlli : Barbouillé, « Hou les cornes ! charboïlli c'ment in cochan » : fi le vilain qui est barbouillé comme un cochon. - (19) |
| charbon de pierre, s. m., charbon de terre. - (14) |
| charbonète. s. f , petit charbon, braise qu'on retire du four, qu'on éteint et qu'on vent aus ménagères pour allumer le feu. - (14) |
| charbonnette : petit bois ou charbon. Petit bois et brisures bons à faire de la charbonnette, aussi braises retirées du feu. - (62) |
| charbonnette, charbounnette. n. f. - Dans la coupe d'un bois, désigne le plus petit, la première grosseur utilisée pour alimenter la cheminée ou le four. - (42) |
| charbouillai. : Noirci par le charbon. Tel est aussi le sens donné à ce mot par M. le comte Jaubert. Les villageois disent d'un enfant dont la figure est malpropre : « S'tu lai a tô chairbouillai, ai fau le déchairbouillai. » - (06) |
| charbouillé : barbouillé (de charbon) - (60) |
| charbouillé. Dans le Châtillonnais, on parle ainsi d'un enfant qui a la figure sale et noircie, et décharbouiller signifie nettoyer la figure.Le Dictionnaire de l'Académie (1855) donne le mot charbouillé comme exprimant l'effet de rouille produit par la nielle sur les blés... - (02) |
| chàrbouiller (C.-d., Chal.).- Noircir, salir. Ce mot semble composé des deux verbes charbonner et barbouiller, comme pour exprimer l'action de barbouiller de charbon. Charbouiller est, en français, un terme d'agriculture servant à désigner les blés gâtés par la nielle, maladie qui transforme les substances farineuses en une poussière noire. Ce mot viendrait, suivant Bescherelle et Littré, du bas latin carbunculare. - (15) |
| charbouiller, v. tr., barbouiller, salir, noircir par le charbon, etc : « Que v' tu que j' bise ton p'tiot ; ô s'é tout charbouillé la figure en migeant sa rôtie ». - (14) |
| charbouiller. Noircir, mâchurer. Charbouiller est français, mais signifie exclusivement « gater, en parlant de l’action de la nielle sur les blés (Littré).» Etym. bas latin, carbunculare, noircir au charbon (carbo). - (12) |
| charbouiller. Salir le visage ou les mains. L'antonyme patois est décharbouiller : Vins don iqui, petit ramonâ, qu’te déchairbouille. À Dijon, on prononçait chabrouiller... - (13) |
| charbouillon, malpropre. - (28) |
| charbounette : charbonnette - (39) |
| charbounner : charbonner - (57) |
| charbouyé, barbouiller d'encre, de suie, de charbon. - (16) |
| charbucle : s. f., vx fr. charboucle, poussière de couleur foncée, telle que suie, dépôt du vin, etc.; charbon, maladie cryptogamique des céréales qui rend le grain friable et noir comme de la poussière de charbon. - (20) |
| charchè : chercher - (46) |
| charche : Perquisition, « Fare la charche » perquisitionner. - (19) |
| charché : v. t. Chercher. - (53) |
| charché, sarché, chercher. - (16) |
| charché, vt. chercher. - (17) |
| charche. Cherche, cherches, cherchent. - (01) |
| charché. Chercher, cherché, cherchez. - (01) |
| charcher, chorcher. v. - Chercher. - (42) |
| charcher, chorcher. v. a. Chercher. - (10) |
| charcher, v. chercher. - (38) |
| charcher, verbe tr., chercher. - (14) |
| charcheux. s. m. Qui cherche. — Charcheux de pain , mendiant. - (10) |
| charchi : Chercher, « Charchi san pain » : mendier. « Charchi des pôs dans la peille » : chercher des poux dans la paille, chercher la petite bête. - (19) |
| charchî : chercher. - (62) |
| charchir, chercher. - (05) |
| charchou, mendiant, quêteur. - (05) |
| charcoué, cagnon, châgnon. n. m. - Nuque. - (42) |
| chardan : Chardon. En parlant d'une personne excessivement hargneuse : « Qué chardan pignolot ! ». Le chardon pignolot est le chardon à foulon (dipsacum fullonum). - (19) |
| charder, v. n. pleurnicher. se dit d'une personne qui pleure ou grogne à tout propos et sans motif. - (08) |
| chardonet, s. m., chardonneret. - (14) |
| chardonnet : s. m., chardonneret. - (20) |
| chardougnot. s. m. Chardonneret. - (10) |
| charé : s. m. bâche qu'on dispose sur une voiture. - (21) |
| charé, charrié. Grosse toile que l'on met sur le cuvier entre le linge et les cendres, quand on fait la lessive à la campagne. Sorte de grande pèlerine d'étoffe grossière, endossée par le berger pour se préserver du froid et de la pluie, en gardant son troupeau. - (49) |
| chareire, s. f. charrière, chemin, sentier réservé dans les bois pour le passage des voitures. Morvan «çareire». - (08) |
| charenton, chérenton. s. m. Charançon. - (10) |
| charére : petit chemin. - (21) |
| charfé, v. a. chauffer. - (22) |
| charfe-llieu, s. m. bassinoire, chauffe-lit. - (22) |
| charfe-llieu, s. m. bassinoire, chauffe-lit. - (24) |
| charfer : v. a., chauffer. - (20) |
| charfer, v. a. chauffer. - (24) |
| charfeu. n. m. - Cerfeuil. (Diges, selon M. Jossier) - (42) |
| charfeu. s. m. Cerfeuil. (Diges). - (10) |
| charge : s. f., réjouissance (os ajoutés à la viande par le boucher). - (20) |
| chargean : Quantité de vin contenu dans le « banneut » que l'on porte de la cuve à la futaille que l'on veut remplir. On marque sur le fond de la futaille, par un trait à la craie, chaque chargean versé de façon à toujours savoir approximativement quel est le niveau du liquide dans le fut et éviter ainsi que le fut déborde. - (19) |
| chargeon : s. m., vx fr. charchon, petite charge ; quantité de cinq quartes, soit 35 litres de vin, que l'on transporte du pressoir au fût au moyen d'une benne. II faut trois chargeons pour une feuillette ou demi-pièce et six pour une pièce entière ou tonneau. - (20) |
| chargeon. s. m. Poignée de tiges de chanvre. — Se dit plus particulièrement de l’un des douze paquets de chanvre qui forment la masse ou bargée qu’on met baigner dans l’eau pour le rouissage. - (10) |
| chargeou : Avant-train de la charrue sur lequel l'ae (âge) vient s'appuyer. - (19) |
| chargeou, s. m., trépied articulé pour poser la hotte dans les vignes. - (40) |
| chârgeou, s.m. trépied pour charger une hotte. - (38) |
| charger, v. a. prendre, au figuré, et s'applique surtout aux maladies. - (11) |
| chargi : Charger. « Chargi in chai de foin » - « Chargi des ras au coude » : mettre sur la charette les ras (voir ce mot) en soulevant la benne avec le bras replié que chacun des deux hommes qui exécutent cette manœuvre passe sous la corne de la benne. - « Le temps se charge » : le ciel devient nuageux. - (19) |
| chargi : v. charger. - (21) |
| chargire. Chargeâmes, chargeâtes, chargèrent. - (01) |
| chargot : arracheur de dents (profession exercée autrefois par le maréchal-ferrant). A - B - (41) |
| chargot : arracheur de dents, professé autrefois par le maréchal-ferrant - (34) |
| charguet, chargueter, surveillance. - (05) |
| chari, s. m. grande pièce d'étoffe grossière pour transporter le fourrage, les feuilles, contenir les cendres de la lessive. - (24) |
| chari, s. m. grande pièce d'étoffe grossière pour transporter le fourrage, les feuilles. - (22) |
| charier (se), v. réfl. aller en voiture : « i m'seu chârié ai Sauleu », je suis allé en voiture à Saulieu. - (08) |
| charinre (f), chemin. - (26) |
| charinte, Charette. - (26) |
| chariot : Chariot. Appareil à roulettes dans lequel on place les jeunes enfants pour leur apprendre à marcher. - Chariot : la Grand Ourse; voir également à Chai. - (19) |
| châriot : n. m. Chariot. - (53) |
| chariöt, sm. chariot. - (17) |
| chariote, charrette, çarotte. - (04) |
| charippe : s. f., charogne (au flg.). Sacrée grande charippe, va ! - (20) |
| charita, s.f. charité. - (38) |
| charité : Aumône. Demander la charité, mendier. « Y est l'hôpital que se moque de la charité ! » dit-on quand on entend calomnier une personne qui vaut mieux que son détracteur. La charité est le nom sous lequel on désigne l'hospice de Tournus. - (19) |
| charivari, tapage contre les veuves qui se remarient... - (02) |
| charju. Avant-train de la charrue. - (49) |
| charjùye*, s. m. avant-train de charrue. - (22) |
| charlette, chourlette, chourlotte : s. f., charlotte, gâteau de pâte fourrée ou garnie de fruits. « On verra de petits enfants venir manger mes chourlottes aux pommes et mon pain chaud. » (B. de Buxy. Le Mari de ta Veuve). - (20) |
| Charlette, nom propre de Charlette. - (08) |
| charleût : Charles. Expression : « Charleût, les poires ant-i des piqueuts ? ». - (19) |
| Charli, nom propre, diminutif de Charles. - (08) |
| charlot (le), loc. « avoir le charlot, » être d'humeur flegmatique, molle, paresseuse. - (08) |
| charme, charmée : s. f., charmoie. Cinq hameaux ou écarts du département de Saône-et-Loire portent le nom de La Charme, d'où les patronymes Lacharme et Detacharme. D'autre part, une commune s'appelle La Charmée. - (20) |
| charmèche : Charme (carpinus betulus), « Eune rieute de charmèche » : un brin de charme tordu pour faire un lien de fagot. - (19) |
| charmer, v. a. avoir en germe, couver une maladie : il y a longtemps qu'il « charmait » ces fièvres-là. - (08) |
| charmetiau. Charme, arbre. - (03) |
| charmeuzi, v. a. se dit d'un linge taché par le séjour à l'humidité. - (22) |
| charmille : s. f., charme. - (20) |
| charmille, n.f. charme (arbre). - (65) |
| charmogne (f), rhume de poitrine. - (26) |
| charmouaise : une allergie (rhume des foing)-- - (46) |
| charmouaise : une allergie (rhume des foins) - (46) |
| charmouge, sf. commencement de rhume. Encharmougé, enchiffrené. - (17) |
| charmû (n.m.) : charmeur - (50) |
| charnat, charnin, charnon. s. m. Bourbillon, chair corrompue sortant d’une plaie. Du latin caro. - (10) |
| charnateux. s. m. Terre forte, caillouteuse. (Saligny). - (10) |
| charneure, carnation. - (05) |
| charnié, s. m. échalas, pau de vigne. - (08) |
| charnier (n. m.) : échalas - (64) |
| charnier : échalas - (60) |
| charniole : plante : ortie royale on dit aussi « chaveniole ». La charniole salissot les blés : l'ortie royale salissait les blés. - (33) |
| charnon, chargniot. s. m. Voyez charnat. - (10) |
| charognage : s. m., commerce de charogne. - (20) |
| charognard : s. m., individu qui met en vente de la viande avariée. Voir boucher. - (20) |
| charogner : v. à., mal couper, hâcher. Ce couteau ne coupe pas, j’y charogne tout. Voir écharogner. - (20) |
| charote : une charrette - (46) |
| charote. s. f., charette. - (14) |
| charotte : n. f. Charrette. - (53) |
| charotte, s.f. charrette. - (38) |
| charotte. s. f. Petit charrette. Montaigne parle quelque part des chariottes. (Argenteuil). - (10) |
| charoué : drap pour filtrer les cendres lors de la lessive. (F. T IV) - Y - (25) |
| charpaigne. : Grande corbeille pour la confection de laquelle le bois de charme entrait plus particulièrement sans doute, car tel est le sens du mot charpe. (Roq.) - (06) |
| charpaingne, sf. corbeille en forme de van. - (17) |
| charpe, adj. se dit d'un pain bien levé, à larges trous. - (22) |
| charpe, adj. se dit d'un pain bien levé, à larges trous. - (24) |
| charpe, charpé : adj., levé. Du pain charpe, du pain bien levé. De la pâte charpée, de la pâte bien levée. - (20) |
| charpeigne : grand panier. - (66) |
| charpeigne, sorte de corbeille ronde faite grossièrement avec de la viorne. - (27) |
| charpeigne. Grand panier sans anse destiné à recevoir des objets encombrants et grossiers. Pour être plus résistant, il est généralement tressé en coudrier ou en charme. De là son nom, car charme est appelé charpe dans certains patois, notamment dans le Berry ; latin carpinus ; italien carpino. - (12) |
| charpène : corbeille. - (66) |
| charpene, charpine, charmille. - (05) |
| charpéne, s. f,, panier à provisions, à mettre la chair et le pain. - (14) |
| charper : v. a., vx fr., carder. - (20) |
| charpi (verbe) : Carder. « Alle a fait charpi ses matelas ». - (19) |
| charpigner (s') (v. pr.) : se quereller, se chamailler - (64) |
| charpiller : v. a., vx fr. escharpiller et charpigner, mettre en charpie, mettre en pièces. Voir écharpiller. - (20) |
| charpiller, v. tr., couper, mettre en morceaux. - (14) |
| charpiller, v., réduire les draps en charpie pour en faire des pansements. - (40) |
| charpillère, s. f., grosse toile d'emballage, d'un tissu très lâche, spongieux, et servant aux ménagères pour laver les carrelages des chambres. - (14) |
| charpillière. Toile d'emballage. C'est peut-être à tort que le français a adopté le mot serpillère. À rapprocher de charpie et d’écharper. - (13) |
| charpingne, corbeille. - (26) |
| charpion : petite serpe. - (09) |
| charpion. s. m. Se dit pour sarpion, sarpillon, petite serpe. - (10) |
| charpir. v. a. Emmêler. (Étivey). - (10) |
| charpœlli, v. a. éparpiller avec une fourche. - (22) |
| charpœne, s. f. charmille des bois. - (22) |
| charpœyi, v. a. eparpiller avec une fourche ; emmêler (du vieux français escharpiller, mettre en charpie). - (24) |
| char'quié, char'tchier. n. m. - Charretier. - (42) |
| charrâ : Charrier, « Faut charrâ le femé (fumier) padant que la tarre est sache (pendant que la terre est sèche) ». - (19) |
| charràyé, v. a. charrier, charroyer. - (22) |
| charràye-mârde, s. m. gros insecte vivant dans la bouse et le crottin. - (22) |
| charràye-mârde, s. m. gros insecte vivant dans la bouse et le crottin. - (24) |
| charraye-merde (charraille-merde) : s. m., bousier. Voir vire-merde. - (20) |
| charrayer (charrailler) : v. a., charroyer. - (20) |
| charràyer, v. a. charrier, charroyer. - (24) |
| charrayot : s. m., chariot d'enfant. Voir tins-le-ben. - (20) |
| charreau, charrée, charrier, charroi, charroué. Voyez cherroux. - (10) |
| charrée : pièce de toile portée sur l'épaule qui contenait le grain à semer à la volée de l'autre main. - (33) |
| charrée : pièce de toile sur laquelle on mettait la cendre sur le cuvier à lessive (début 20ème siècle). - (33) |
| charrée : s. f., vx fr., charge d'un char. - (20) |
| charreiger. v. a. Charroyer. - (10) |
| charreire, voie où passent les chars. Ailleurs on dit charrière. - (02) |
| charreire. : Voie où passent les chars, les voitures. - (06) |
| charret : Grand linge de toile grossière dont on se servait pour les grosses lessives d'autrefois et sur lequel on mettait la cendre quand on « coulait la beue ». Etym. vieux français charrier. - Grande bande de toile dont on recouvrait les râs, pour le charriage des raisins, de la vigne à la cuve. - (19) |
| charretée d'injures. : Sottises débitées du haut d'un char par les compagnons de la Mère folle, de 1454 à 1630. - (06) |
| charretier de bât : conducteurs de mulets. VI, p. 15 - (23) |
| charretis, hangar. - (05) |
| charrette : voir chvau - (23) |
| charrette : s. f., personne, qui en ayant rencontré une autre, lui a tenu des propos frivoles et l'a, par suite, retardée ; par extension, toute personne qui fait perdre son temps à une autre. Je suis bien en retard, c'est la faute à une sacrée charrette ! Voir jambe. - (20) |
| charreyer. Charrier. Rentrer le foin et le blé. - (49) |
| charri : s. m., charrier, drap sur lequel on met la cendre dans une lessive, que l'on tend devant une cheminée qu'on ramone, etc. - (20) |
| charrie - charrier, trainer. Outre le sens français ordinaire, on emploie ce mot, par exemple, en disant : I crouai qui vê éte mailaide en ; i ai lontemps qui charrie ce qui. - I chârirons celai pendant l'hyver pour nos occupai. - (18) |
| charrié, charrére. Passage à charrettes laissé dans un bois, un champ, pour permettre d'enlever les récoltes. - (49) |
| charriée (pour charrière). s. f. Voie, passage tracé par une charrette dans une forêt, dans un pâturage ou dans un champ. - (10) |
| charriée : panier de séchage de fromage (principalement) à anse et claire-voie de planchettes que l'on accrochait au plafond. Le crochet était souvent constitué d'une branche coupée, avec sa sous-branche, en forme d'hameçon, pointe en bas. Comme l'ensemble était assez haut, on appelait un homme de haute taille un grand "dépand'leux d'charriée", avec assez souvent une connotation péjorative, au sens de pas trop malin... - (58) |
| charriée. n. f. - Passage formé de traces laissées par les roues d'une charrette, dans un champ ou dans un bois. Se dit également pour la claie, plateau à fromages en bois suspendu aux solives, dans lequel on faisait sécher les fromages ; synonyme de chaillée. - (42) |
| charrier, se dit d'un malade qui se traine péniblement (la mort le charrie). - (27) |
| charrire, s. f. mauvais chemin creux. Diminutif charriron (du vieux français charrière). - (24) |
| charrire, s. f. mauvais chemin creux. Diminutif charriron. - (22) |
| charronnette. s. f. Chardonneret. - (10) |
| charroué, cherroux. n. m. - Plusieurs usages : 1. Toile placée entre le linge et les cendres, sur laquelle on versait l' eau bouillante pour faire la buie, la lessive. 2. Grande bâche confectionnée avec quatre sacs cousus entre eux, servant à l'enlèvement des balles, sur l'aire de battage. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| Charroune : nom de mule. VI, p. 16 - (23) |
| charrue, synonyme d'aria. - (27) |
| charte : s. f. voiture spéciale pour transporter les bennes. - (21) |
| charte : s. f., charrette longue, employée spécialement, dans la région de Tournus, pour transporter la vendange. - (20) |
| charté, s. f., cherté. - (14) |
| charteaux, s.m. parties du pressoir. - (38) |
| charter (se) (v.pr.) : s'asseoir (aussi se chiter) - (50) |
| charter, v. n. couper avec peine comme on le ferait avec une très mauvaise scie. - (24) |
| charti, s. m , hangar où l'on range les chars. - (14) |
| charti. Hangar à ranger les chars. - (03) |
| chartillon (n. m.) : aide-charretier - (64) |
| chartillon : apprenti charretier. VI, p. 15 - (23) |
| chartingne. s. m. Chariot, Charretin. (Poilly-sur-Serein). - (10) |
| chârtis, s. m., appentis, abri couvert où l'on range matériel et bois. - (40) |
| chartre. n. f. - Friche. (Sainpuits, selon M. Jossier) - (42) |
| chartre. s. f. Friche. (Sainpuits). — Dans un sens qui semble tout à fait analogue, on dit, à Auxerre, d’une personne qui est dans un état considérable de maigreur et d’étisie, qu’elle est en chartre. - (10) |
| chartu (-e) (p.p. du v. asseoir) : assis - chartue = assise - (50) |
| charvi. n. f. - Carotte sauvage. - (42) |
| charvis, chervis. s. m. Carotte sauvage. - (10) |
| chasére : cage à fromages. - (21) |
| chaseron : égouttoir à fromages frais en terre ou en fer blanc étamé. (R. T IV) - Y - (25) |
| chaseron. s. m . Vase de terre cuite percé de petits trous, dans lequel on met égoutter les fromages mous. - (10) |
| chasez. : Vassaux logés par leur seigneur (du latin rasati). Franch. de Saulx-le-Duc, XIIIe siècle. - (06) |
| chasne, chêne, châgne. - (04) |
| chassagne : s. f., chênaie. Quinze hameaux ou écarts du département de Saône-et-Loire portent le nom de La Chassagne, d'où les patronymes Chassagne et Lachassagne. - (20) |
| chassis : (châ:si - subst. m.) (sens désuet) : seuil de la porte, perron. - (45) |
| chassoie : mèche de fouet. - (09) |
| chassou, s. m , chasseur. - (14) |
| châssou, s. m., outil de tonnelier (pour cercler les fûts). - (40) |
| chassou, s.m. outil de tonnelier pour serrer les cercles sur un tonneau. - (38) |
| chassoué, chassoi, chassoir. s. m. Instrument de bois à l’usage des tonneliers pour enfoncer les cercles sur les tonneaux. - (10) |
| chassouée, chassoie, chassoire. s. f. Fouet, mèche de fouet. - (10) |
| chassoure, petite houppe de chanvre à l'extrémité d'une corde de fouet. - (16) |
| chassoux : s. m., chasseur. - (20) |
| chastece. : (Dial.), se trouve dans saint Ber nard pour chasteté comme chetitesse pour indiquer ce qui est chétif. - (06) |
| chastron. : Mouton. Le bélier se nommait coillart. Coutumes de Châtillon de 1371. - (06) |
| chat ! (hou), excl. pour faire déguerpir un chat : « hou chat ! hou chat ! J' vas t' faire mainger ma crein-me ! attend ! ». - (14) |
| chat (éte) : difficile (être) - (48) |
| chat (éte) : difficile pour la nourriture - (39) |
| chat (on) - chait (on) : poisson-chat - (57) |
| chat : Chat, « De la boulie pa les chats » : de la marchandise perdue, des soins inutiles. Quand un amoureux prend congé de sa bonne amie sans l'avoir embrassée, on dit qu'il « emporte le chat ». - « Chat de gueule », difficile pour la nourriture, « Ol est bin chat de gueule! » - (19) |
| chat : s. m. chat. - (21) |
| chat : gros crochet à trois branches comme un hameçon, fixé à une corde et permettant d'accrocher et récupérer les seaux tombés accidentellement dans un puits. - (33) |
| chat chipoton (à) : petit à petit - (60) |
| chat : (cha) 1- (subst. m.) chat. On dit aussi mê:rkô: pour le matou. . 2- (adj.) délicat, raffiné à l'excès (en particulier en ce qui concerne la nourriture). - (45) |
| chat : s. m. bouillie faite de farine de sarrasin et d'eau, où l'on trempait la toile nouvelle pour lui donner un apprêt. - (21) |
| chat, adj., friand : « Alle é chate » se dit d'une personne qui est « sur sa bouche » On a le vieux sobriquet : « chats de Chalon ». - (14) |
| chat, adjectif qualificatif : goûteux, bon. - (54) |
| chat, chaite, adj. gourmand, friand. L’avare est toujours « chat » d'argent, la femme toujours « chaite » de chiffons ou de rubans. - (08) |
| chat, chatte et chataud, chataude. adj. Friand, friande. - (10) |
| chat, friand, gourmet. - (05) |
| chat. Friand. - (03) |
| chat. Gourmand, friand de bonnes choses, qui n'aime que des mets délicats. - (49) |
| chat. s. m. Crochet à quatre griffes pour retirer un seau du fond d’un puits. (Saint-Germain-des-Champs). - (10) |
| chât’nets d’hoûyiottes : réunion sur un même pédoncule de plusieurs noisettes - (37) |
| châtagnaÿ, s. m., châtaignier. - (40) |
| chatagne (châfagne) : s. f., châtaigne. Au fig. : 1 - tête (voir crouler) ; 2 - coup de poing (voir marron). Il est fort sur la châtagne. - (20) |
| châtagne, s.f. châtaigne. - (38) |
| châtaie : château - (48) |
| châtaie. s. m . Château (Athie). - (10) |
| châtain. s. m. Châtaigne. - (10) |
| chataingne, s. f. châtaigne. - (08) |
| chataingne, s. f., châtaigne. - (14) |
| chat-d’gueule : Fin gourmet. Qui n’aime manger que ce qui est bon à en être exagérément « difficile » ; être chat : gourmand, être achati : habitué à la gourmandise. - (62) |
| chaté. : Plus tard chastel, chaptel et cheptel. - Ce mot s'appliquait d'abord à la totalité du bien d'un redevable, et, par suite, au bétail ou aux baux le concernant. (Franch. de Molesmes, 1260.) Il vient de castellum parce que tous les biens, le troupeau comme autre chose, revenaient au château du seigneur et en dépendaient. - (06) |
| château, n.m. nuage d'orage. - (65) |
| chatel (nom masculin) : cheptel. - (47) |
| chatelicot, s. m. petit bouquet de noisettes, de glands, de fruits enchaînés. - (08) |
| châtellenie : manoir, seigneurie, et juridiction d’un seigneur châtelain. - (55) |
| chatelot : Petit tas de noix formé de trois « calas » disposés en triangle et servant de support à un quatrième. « Le jû du chatelot » consiste à démolir cette petite pyramide en laissant tomber dessus une autre noix. - (19) |
| châtelot, s. m. bouquet de noix, de châtaignes, etc… - (08) |
| châtelot. s. m. Groupe de trois objets, posés deux et un. (Béru). - (10) |
| chatenére, s. f. chatière, ouverture ménagée dans le toit pour le passage des chats. - (08) |
| chatenet, s. m. gourmand, friand, celui qui aime la bonne chère et recherche les morceaux délicats. - (08) |
| chatère : Chatière, trou pratiqué au bas d'une porte pour laisser passer les chats. - « Mentre la clié seu la chatère », c'est déménager à la cloche de bois. - (19) |
| chaterie (n.f.) : friandise - (50) |
| chaterie, s. f. friandise, sucrerie, mets délicat. - (08) |
| chaterie, s. f., sucrerie, friandise, entremets. - (14) |
| châteugnerie, gâterie - (36) |
| chat-fouirou. Chat-huant. Ainsi nommé à cause de son cri qui imite le mot « chat-fouirou ». - (49) |
| châtias. s. m. Château. (Domecy-sur-te-Vault). - (10) |
| chatiau (un) : un château - (61) |
| chatiau, s. m., château ; « Voui, voui, j'ainme meù ma maïion qu' sou châtiau ! » - (14) |
| chatifou. Méchant ; endiablé ; disposé à mal faire. - (49) |
| châtigne. Châtaigne. - (49) |
| châtignier : châtaignier - (39) |
| chatillo. Chatouillement. - (03) |
| Châtillon : nom de bœuf. 111, p. 30-o - (23) |
| Chatillon : voir pain de Châtillon. - (20) |
| Châtillon, nom de bœuf très connu dans notre contrée. Ce nom est peut-être tiré de la couleur de l'animal plutôt que de son origine. Dans le berry et le nivernais beaucoup de bœufs sont appelés Châtain. - (08) |
| châtillons, chatouillements. - (05) |
| chatillots : Chatouillements, « O craint les chatillots », « Fare les chatillots », chatouiller. - (19) |
| châtine : châtaigne - (39) |
| châ'tlot : petit château - (48) |
| chat-minô, s. m., primevère. - (40) |
| chatoïlli : Chatouiller, « Y ne fa pas ban le chatoïlli » : il n'est pas endurant. - (19) |
| chaton, s. m., ce qui reste de la grappe de maïs, quand on l'a dépouillé de tous ses grains. - (14) |
| chatougnée. n. f. - Chatière. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| chatougniée. s. f. Chatière, chatonnière, ouverture pour les chats au bas d’une porte. - (10) |
| chatouil, s- m., chatouillement. Aux apports, les fillettes disent sans gêne à leurs amoureux : « Oh ! j' crains pas l’chatouil, moi! » C'est presque une invite aux témérités. - (14) |
| chatouille, subst. féminin : larve de la lamproie de rivière. - (54) |
| chatouilli : chatouiller - (57) |
| chatouillot, guerli, jaillet, jaquiot. Chatouillement ; attouchement léger. - (49) |
| chatouillot, s. m., dim. de Chatouil. (V. ce mot). - (14) |
| chat-qui-fou (nom masculin) : expression qui désigne un enfant remuant, qui ne tient pas en place. (Comme un chat qui est fou). - (47) |
| châtr'à chien. n. m. - Vieux couteau ne coupant plus, et tout juste bon à châtrer les chiens. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| châtran : Jeune bœuf hongre, « Ol a ageté deux bans châtrans à la foire ». - (19) |
| châtre (en) : malade. - (09) |
| châtrè : cercler une roue, on dit aussi cerkiè - (46) |
| châtre, s. f. châtrure ; action de châtrer. Un porc subit « la châtre » avant d'être mis à l'engrais. - (08) |
| châtre-bique, châtre-chien : couteau (mauvais) - (48) |
| châtre-bique, n.m. mauvais couteau. - (65) |
| châtre-bique, s. m., couteau pliant. - (40) |
| châtre-chien. Mauvais couteau, mal emmanché. - (49) |
| chatrer (châtrer) : v. a., pincer, couper les bourgeons ou l'extrémité des jeunes branches d'un végétal, d'un arbre à fruits, de la vigne, etc. Syn. de côleter. Châtrer des osiers. - (20) |
| châtrer : castrer - (48) |
| châtrer, v. a. raccommoder grossièrement sans y mettre de goût ou de soin. - (08) |
| Chatreu. Chartreux. - (01) |
| châtreure, s. f. raccommodage grossièrement fait. - (08) |
| châtreure. s. f. Reprise grossièrement faite dans une étoffe, à l’imitation de celle exécutée par les Châtreux, quand ils rapprochent et cousent les deux lèvres de la plaie faite à l’animal qu’ils ont opéré. - (10) |
| châtreux (nom masculin) : hongreur. - (47) |
| chatron (châtron) : s. m., jeune animal récemment châtré. - (20) |
| châtron : jeune boeuf - (61) |
| châtron : jeune bœuf (jeune taureau castré) - (48) |
| chatron : taureau castré - (44) |
| chatron : jeune taureau n'ayant pas eu de chance pour sa future vie sexuelle. Non sélectionné pour la reproduction. Animal châtré. Agé, il deviendra un beu. Ex : "J'ons mis les châtrons au pré avec les taures." - (58) |
| châtron, n. masc. ; jeune bœuf récemment attelé. - (07) |
| châtron, s. m. taureau récemment châtré, jeune bœuf qui n'a pas encore été soumis au joug ou qui ne l'a été que depuis peu de temps. « çâtron. » - (08) |
| châtron, tsétron. Jeune bœuf émasculé. « Châtron » est en vieux français, « tsétron » est le mot patois. - (49) |
| châtron. n. m. - Jeune taureau nouvellement châtré, et qui n'a pas encore travaillé. - (42) |
| châtron. s. m. Jeune boeuf nouvellement châtré et qui, pour cette raison, n’a pas encore travaillé. - (10) |
| châtrons, jeunes bœufs. - (05) |
| châtrou : Hongreur. - (19) |
| chatrou, châtreur de cochons. - (05) |
| châtrou, s. m. châtreur, celui qui châtre les animaux dans nos campagnes. - (08) |
| châtrou, s. m., hongreur itinérant. - (40) |
| châtrou, sm. châtreur. - (17) |
| chatrou, tsétrou. Hongreur. - (49) |
| chat-rouanne. s. m. Chat-huant. - (10) |
| chatroux (châtroux) : s. m., châtreur. - (20) |
| chatrue : ennui, malheur - (61) |
| chat-souris. s. m. Chauve-souris. - (10) |
| chatte : s. f. (terme enfantin), langue. - (20) |
| chattegueule : Voir à chat. - (19) |
| chatterie. Friandise, sucrerie. - (49) |
| chat-vant. s. m. Chat-huant. - (10) |
| chau (il'en chau bin) : qu'est-ce que cela peut bien faire. (V. T IV) - A - (25) |
| chau, du vieux verbe français chaloir, importer. Ai ni chau commun, peu importe comment. D'autres écrivent cho. E li cho bé, il importe bien. - (02) |
| chau. Chaud, chauds : c'est aussi de la chaux, calex. - (01) |
| chaubard. s. m . Nuque, partie postérieure du cou. - (10) |
| chauboulé, ée. adj. Se dit d’un morceau de bœuf ou de viande quelconque mangé à moitié cuit, parce qu’on ne l’a pas laissé bouillir suffisamment dans le daubier ou la marmite. De chaud et de bouillir . — Il y a cette différence entre chauboulé et chaugrouillé, que le second de ces qualificatifs s’applique à la viande mise à la broche ou sur le gril, et l’autre à la viande mise dans un pot ou dans une casserole pour cuire en bouillant. - (10) |
| chaûché, adj., bête et peu chanceux. - (40) |
| chauchebouête : Mâche, ou vulgairement doucette (valerianella pubescens). Plante qu'on mange en salade, on l'appelle aussi pômâche en patois. - (19) |
| chaucher : v. a., vx fr., appuyer, presser, fouler, accabler (au prop. et au fig.) Etre chauché du coucou, avoir de la guigne, des malheurs conjugaux ou autres. - (20) |
| chaucher, v. côcher (en parlant du coq). - (65) |
| chaucher, v. piétiner (tasser le foin). - (65) |
| chaucher, v. tr., chausser. A Châlon, l'ancien nom de la rue aux Prêtres était : Chauche-chien (chausse-chien). On a le nom Chauchefoin. - (14) |
| chaucher, v., monter, jucher en hauteur. - (40) |
| chauchéte, s. f. , chaussette. - (14) |
| chauchette, s. f. chaussette, demi-bas, diminutif de « chauche » = chausse. - (08) |
| chauchi : Appuyer, presser, « Ol a fait des bans râs, ol les a bien chauchis », il a fait des bonnes bennes, il y a bien pressé le raisin. Vieux français, chauchir fouler aux pieds, presser. - (19) |
| chauchi, v. a. faire effort sur un pieu pour l'enfoncer davantage (du vieux français chaucher). - (24) |
| chauchi, v. a. faire effort sur un pieu pour l'enfoncer davantage. - (22) |
| chaucrué : A moitié cuit, « De la viande chaucruée ». - (19) |
| chaucruer : v. a., ébouillanter, faire cuire légèrement dans l'eau bouillante. - (20) |
| chaud (breûder de), redond. fautive. - (14) |
| chaud (la) : la chaleur - (61) |
| chaud : Beau temps, « Vlà le chaud », voilà le beau temps. « San ovrage n'a pas pris le chaud », il n'a pas réussi. Cette locution tire son origine d'une comparaison qu'on établit entre l'ouvrage dont on parle et le travail de la culture qui n'est bon que quand la température est favorable, quand il « prend le chaud ». - (19) |
| chaud du lit, loc, saut du lit. - (14) |
| chaude : s. f., flambée, petit feu. - (20) |
| chaudena : Chardonnay, cépage blanc. - (19) |
| chaudeur. s. f., chaleur. - (14) |
| chaud-feurdi (nom, masculin) : coup de froid qui annonce un rhume ou une grippe. - (47) |
| chaud-frèd, s. m., pleurésie. La population a une grande prédilection pour ce mot. Il n'est pas d'affection de poitrine qu'elle ne désigne sous le nom de chaud-froid. - (14) |
| chaudier : s. m., chaufournier. - (20) |
| chaudiére : fourneau pour la cuisson des pommes de terre pour la pâtée - (48) |
| chaudiorée. s. f. Chaudronnée. (Saint-Martin-des-Champs). - (10) |
| chaudjére (na) : chaudière - (57) |
| chaudöre, sf. chaudière. - (17) |
| chaudot : un endroit douillet - (46) |
| chaudöt, sm. place chaude au lit. « Fa mö mon chaudö ». - (17) |
| chaud-raferdi. n. m.- Chaud et froid : « Couve-toi don', te vas attraper un chaud-raferdi ! » - (42) |
| chaudran : Ce mot a servi à désigner la locomobile, la machine à vapeur, qui servait à entraîner la batteuse, jusqu'à l'entrée en service des tracteurs. - (19) |
| chaudrin. n. m. - Chaudron. - (42) |
| chaudrin. s. m. Chaudron. (St-Aubin-Châteauneuf). - (10) |
| chaudron, s. m. vase de fer blanc avec couvercle et dont on se sert pour transporter la soupe ou autres aliments lorsque les ouvriers sont répandus dans les champs. - (08) |
| chaudrote. n. f. - Petite gamelle avec son couvercle. (Saints, selon G. Pimoulle) - (42) |
| chaudrotte. s. f. Petite chaudière. — A Collan, se dit d’une sorte de mollusque enfermé dans une écaille pierreuse et ressemblant à une sauterelle. - (10) |
| chaudrounée. n. f. - Quantité équivalente à un chaudron. - (42) |
| chaudru, ue. adj. Souffreteux, malingre. Jaubert donne chaudré , brûlé, desséché par la chaleur. - (10) |
| chauduran : Chaudron. Au figuré on dit d'une personne dont on suppose la conscience passablement noire que, lorsqu'elle va à confesse elle va « récurer son chaudron ». - (19) |
| chaufai. Chauffer, chauffé, chauffez. - (01) |
| chaufan. Chauffant. - (01) |
| chaufau, s. m. échafaud, appareil composé de poteaux et de claies qui permet de s'élever plus ou moins haut au-dessus du sol. - (08) |
| chaufauder, v. n. échafauder, construire un appareil en bois pour s'élever au-dessus du sol. - (08) |
| chaufauder. v. - Harceler, tourmenter. (Villeneuve-les-Genêts, selon M. Jossier) - (42) |
| chaufelé (à), loc. rempli à l'excès, en forme de pyramide instable. - (22) |
| chaufelé (a), loc. rempli à l'excès, en forme de pyramide instable. - (24) |
| chaufe-panse, (pron. tchô) sm. cheminée (Sacquenay). - (17) |
| chauféte, s. f., chaufferette. - (14) |
| chaufeuse, s. f., lemme qui chauffe la lessive. (V. Lissiveuse Laveuse). - (14) |
| chauffe : charbon - (44) |
| chauffe, subst. féminin : quantité de charbon fournie gratuitement par l'usine. - (54) |
| chauffe. Terme minier employé pour désigner le charbon donné aux mineurs par la compagnie des mines, pour servir à leur usage personnel. S'emploie aussi pour désigner une voiture de mauvais charbon. - (49) |
| chauffeu, s. m. chauffoir, lieu où se trouve la cheminée ; chambre à feu. - (08) |
| chauffouée. n. f. - Toute pièce équipée d'une cheminée. (Villiers-Saint-Benoît, selon M. Jossier) - (42) |
| chauffoyé. s . m . Toute chambre pourvue d’une cheminée. (Villiers-Saint-Benoit). - (10) |
| chauffrette : n. f. Chaufferette. - (53) |
| chauffure : s. f., vx St. chaufeor (m.), chauffolr, local où l'on fait du feu. Maison chauffure, maison d'habitation. Chambre chauffure, chambre à feu. - (20) |
| chaufonnö, sm. chaufournier. - (17) |
| chaufredi : chaud et froid. - (33) |
| chaugnon, s. m. anneau qui réunit l'avant et l'arrière-train d'une charrue. « chaugnon » = chaînon. - (08) |
| chaugrue, chauboulue, chaubouillure. s. f. Echauboulure, éruption de boutons de cbaleur sur la peau. De calida bulla. - (10) |
| chaugruer voir chanbruer. - (38) |
| chaugrullé : peu grillé. (S. T III) - D - (25) |
| chauledru. n. m. - Rusé, malin. - (42) |
| chauledru. s. m . et adj . Rusé. (Saint-Martin-Sur-Ouanne). - (10) |
| chauler. v. n. Pousser des tiges, des rejeton. Du latin caulis . Se dit surtout des plantes herbacées. - (10) |
| chaumâ, s. m. petite chaume, terre inculte et engazonnée. - (08) |
| chaume : lande communale, pâtis - (48) |
| chaume, s. f. terrain engazonné, ordinairement de peu de valeur, lande, espace vague et livré au pacage des animaux. - (08) |
| chaume, s.f. montagne, colline aride où est un maigre pâturage. - (38) |
| chaume. n. f. - Eau de vie, petit verre de goutte : « Eh Pinon ! Te veux-ti une chaume ? - C'est pas de r’fus, aveuc ce fré, ça va nous réchouffer! » (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| chaume. Plateau de montagne... Le mot chaume, appliqué à des tiges de graminées, semble dérivé de calamus ; il a formé chaumière et chalumeau. L'origine première de tous ces mots pourrait être la même. Les terres peu fertiles des sommets devaient être en jachères pendant plusieurs années, rester en chaume avant de les cultiver de nouveau. Chômer et ses dérivés exprime cet état de repos. - (13) |
| chaumeire. Chaumière. - (01) |
| chaumeu, s.m. pâquier. - (38) |
| chaumia (masc.), petite chaume (friche). - (27) |
| chaupet'ion (a), loc. un par un, par fraction : vendre sa récolte à chaupet'ion. - (24) |
| chaupiquet, s. m. saupiquet, sauce piquante où il entre beaucoup de vinaigre. - (08) |
| chaupoulon (à), loc. un par un, par fraction : vendre sa récolte à chaupoulon. - (22) |
| chaurd-miot (n.m.) : sourd-muet - (50) |
| chaurée : bouffée de chaleur. (S. T III) - D - (25) |
| chaurfredis : chaud et froid. - (32) |
| chaurie. s. f. Four à chaux. - (10) |
| chaurier. s. m. Chaufournier. (Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes). - (10) |
| chausse (na) : bas (chaussette) - (57) |
| chausse (une) : une chaussette - (61) |
| chausse : Bas, « Fare des chausses », tricoter des bas. En plaisantant on dit à quelqu'un qui vous fatigue par son bavardage : « Te nos en fa bien, y est demage qui est pas des chausses ! ». - (19) |
| chausse : bas, chaussette - (48) |
| chausse : chaussette. Ex : "Si t'as fré aux pieds, mets don des chausses !" - (58) |
| chausse : s. f. bas. - (21) |
| chausse : s. f., bas. - (20) |
| chausse, n.f. désigne aussi bien les chaussettes de l'homme que les bas de la femme (vêtements tricotés à la maison et non achetés dans le commerce). - (65) |
| chausse, s. f. , bas, chaussette (Mervans). - (14) |
| chausse, s. f. bas : tricoter des chausses ; une paire de chausses (vieux français). - (24) |
| chausse, s. f. bas. - (22) |
| chausse, s. f. chausse, bas, vêtement de la jambe et du pied. « çausse. » - (08) |
| chausse. Bas, chaussettes. Etym. C'est le mot ancien chausses avec un autre sens, et admettant le singulier. - (12) |
| chausse. Chaussette, bas. - (49) |
| chaussemente, s. f. désignation générale de la chaussure : un placard à ranger la chaussemente. - (22) |
| chaussements, s. m. pl. désignation générale de la chaussure : un placard à ranger les chaussements. - (24) |
| chausse-motte : bergeronnette. - (30) |
| chausse-motte. Bergeronnette, lavandière. Ces oiseaux sont ainsi nommés parce qu'ils sautent de motte en motte dans les champs labourés pour becqueter les vers. - (49) |
| chausse-moute. Bergeronnette, par corruption pour « saute motte », parce que cet oiseau est très-leste. - (03) |
| chausser. Corriger : « te vais te faire chausser » ; se battre : « se chausser ». Fig. Se faire grimper dessus. Se dit du coq quand il couvre les poules pour féconder les œufs. « Le coq est c'tu-là que chausse les poules » : réponse d'un jeune écolier de la campagne à une question de l'inspecteur primaire. On dit aussi « chaucher » pour appuyer, presser. - (49) |
| chausses : (chô:s' - subst. f. pl.) bas. Le mot a rapidement pris le sens de « guêtre, vêtement qui couvre les pieds et les jambes ». - (45) |
| chausses, bas. - (05) |
| chausses. n. f. pl. - Paire de bas épais en laine ou en coton. Les chausses s'inscrivent dans l'histoire mouvementée du costume. Le calceus latin désignait à l'origine le soulier ouvert sur les orteils. Au XIVe siècle, la chausse était une chaussure fermée, puis une guêtre. Au XVIe siècle, les chausses, au pluriel, deviennent un vêtement que l'on chausse (enfile) par les pieds. Le haut-de-chausse fut le pantalon collant jusqu'aux genoux, qui remplaçait l'ample braie ; le bas-de-chausses, couvrant le pied et la jambe, fut simplement nommé le bas. Du soulier au bas, en passant par la culotte, les chausses sont restées bien vivantes en dialecte poyaudin. - (42) |
| chausseûre : Chaussure. Au figuré : « à cause dan qu'o ne se marie pas ? Y est qu' o ne troue pas chausseûre a san pi ». - (19) |
| chaussi : Chausser. On effraie les enfants en leur disant : « via la né, les loups se chaussant », on laisse supposer aux enfants que les loups se chaussent pour sortir du bois la nuit. Proverbe : « Y est les cordan-niers que sant les pu mau chaussis » - (19) |
| chaussie, s. f. chaussée, levée d'étang, barrage qui retient les eaux. - (08) |
| chaussinette (na) : socquette - (57) |
| chaut (il ne m'en). Il ne m'importe. - (03) |
| chaut. s. m. Sorte de ressort fixé au bout de la chaîne d’un puits et dans lequel on accroche le seau pour puiser de l’eau. (Soucy). - (10) |
| chautrer - chaîtrer : hongrer - (57) |
| chautrou (on) - chaîtrou (on) - porchou (on) - coupou de pouâ (on) : hongreur - (57) |
| chauûcher : appuyer, tasser - (37) |
| chauveau (n.m.) : boeuf à poil ras - (50) |
| Chauveau : nom de bœuf. III, p. 29-o - (23) |
| chauveau et choveau, s. m., mesure de liquide, contenant environ le demi litre : « J’ons ben prou cori ; veins-tu boire èun chauveau ? » - (14) |
| chauveau : s. m., ancienne mesure de capacité pour les liquidés, valant 1/4 de pinte et contenant 0 litre 3795. - (20) |
| chauveau, chôveau (Chal., Morv.), chôvia (C.-d.). - Sorte de mesure pour les liquides contenant le quart de la pinte, soit environ un demi-litre, usitée principalement pour le lait. L'étymologie se trouve dans le même mot en vieux français, venant du bas latin calvea, mesure pour les grains. - (15) |
| Chauveau, nom de bœuf ; bœuf dont le poil est ras, non frisé. - (08) |
| chauveau, s. m. mesure de capacité ayant la forme tubulaire et contenant environ un litre. On dit d'une personne craintive qu'elle se ramasse, se resserre comme un « chauveau » d'huile. - (08) |
| chauvessi : voir chavouchi. - (23) |
| chaûvoûc’ie : chauve-souris - (37) |
| chauvoucheri, s. f. chauve-souris. - (08) |
| chaux (je n') : je ne peux. - (09) |
| chauyée. n. f. - Chaudière - (42) |
| chavan : chouette et autres oiseaux nocturnes. IV, p. 23-6 - (23) |
| Chavan : nom de bœuf. III, p. 29-o ; V1, p. 7 - (23) |
| chavan, s. m. chat-huant. - (24) |
| chavance, chavanche. n. f. - Viande très dure, coriace. (Bléneau, selon M. Jossier) - (42) |
| chavange, chavanche. s. f. Viande coriace très-dure. (Bléneau). - (10) |
| chavant (n. m.) : chat-huant - (64) |
| chavant : chat-huant. - (32) |
| chavant, chavouant. n. m. - Chat-huant. - (42) |
| chavasse : voir chevasse. - (20) |
| chavasson : s. m., vx fr. chavessot, petit chevaine. - (20) |
| chavé, ée. adj. Flatteur, rusé. - (10) |
| Chaveau : nom de bœuf. III, p. 29-o - (23) |
| chavein, s. m. chat-huant. - (22) |
| chavené : Chenevis, graine de chanvre. - (19) |
| chaveneau, chavoniau : s. m., petit chevaine. - (20) |
| chavenère. s. f. Chènevière. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| chaveneute : Chenevote, partie ligneuse de la tige du chanvre dépouillé de son écorce. Autrefois on se servait de chaveneutes soufrées en guise d'allumettes. - (19) |
| chaveneuter : Marquer le terrain avec des baguettes pour indiquer la place où devront être plantés les ceps. Pour marquer on employait autrefois des chaneveutes, d'où le verbe chaveneuter. - (19) |
| chavenière, chevenière : s. f., chénevière. Etre marié en chavenière, se dit d'un couple dans lequel la femme est plus grande que le mari, par assimilation au chanvre (cannabis saliva), espèce dioïque dans laquelle les individus femelles sont plus grands que les individus mâles. - (20) |
| chavenot : s. m. Syn. de chenevotte. - (20) |
| chavenotte, s.f. petit morceau de bois de peuplier, soufré des deux bouts, long de 20 cm et servant à allumer le feu. Après les avoir trempés dans du soufre, on les mettait dans un sabot pendu près de la cheminée. - (38) |
| chavenotter, s.m. bois de la vigne qui n'est pas mûr à l'automne. - (38) |
| chavenottes, s.f. vrilles de la vigne. - (38) |
| châver : enlever l' écorce d'une tige de noisetier en tapant pour faire un sifflet - (39) |
| chavi, v. finir, terminer un travail. - (38) |
| chavir et chévir, v. tr. et intr., conduire, gouverner, jouir de. S'emploie surtout négativement dans le sens de faire obéir, diriger : « Ces drôles sont si dissipés que j' peux pas en chavir ». - (14) |
| chavir, chevir. v. n. Venir à bout d’une chose, être le maître, jouir, posséder, diriger, gouverner, dompter. Du bas latin cheviare , et de chef (Caput). - (10) |
| chavir. Achever un ouvrage. I ne pourrai jaimâs en chavi. En vieux français, chevir signifiait travailler, d'où chevance, ferme, exploitation... - (13) |
| chavir. Venir à bout de. Etym. c'est le très vieux mot français chevir. Racine, chef, bout, et virer, littéralement venir à bout. - (12) |
| chavire, v. a., jouir, user. Ex. : mon propriétaire m'a loué un grenier qui est en si mauvais état que je ne puis en chavire. - (11) |
| chav'née (nom féminin) : cheminée. - (47) |
| chavoceris. s. f. et chavoicheri et chavoichi. s. m. Chauve-souris. (Guillon, Girolles, Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| chavoche (n. f.) : chouette - (64) |
| chavoche : voir chavan - (23) |
| chavognau : Chevesne, poisson « Eune friture de chavognaux». - (19) |
| chavogne, s. m., poisson blanc, que prennent journellement les pêcheurs. Dim., Chavorgnot. - (14) |
| chavogne. Poisson blanc, appelé à Chalon chavène, à Dijon chevaneau. - (03) |
| chavogniâ : n. m. Chevesne. - (53) |
| chavognot, subst. masculin : chevesne. - (54) |
| chavoigne, sorte de poisson commun. - (16) |
| chavoix. s. m. p. Menues tiges de chanvre laissées dans les champs comme inutiles et sans valeur. - (10) |
| chavon : s. m., vx fr., bout, fin, extrémité. Tant qu'au chavon, jusqu'au bout, jusqu'au dernier. - (20) |
| chavonniau. Chevenne. - (49) |
| chavons, têtes de bétail. - (05) |
| chavoseris, n. masc. ; chauve-souris. - (07) |
| chavotte, n.f. chouette. - (65) |
| chavoucheri : voir chavouchi - (23) |
| chavouchi : chauve-souris. IV, p. 33 - (23) |
| chavouchie (n.f.) : chauve-souris (aussi savouchi) - pour de Chambure : chavouchie - (50) |
| chavouchie, s. f. chauve-souris. - (08) |
| chavouin-ne (o) : chevesne - (57) |
| chavouné, v. n. tourner un attelage de labour à l'extrémité d'un champ. - (22) |
| chaya : cosse de pois, haricots. - (29) |
| chàye, s. f. enveloppe verte des noix, ou de tout fruit ; cosses de pois, haricots, colza. - (24) |
| chayo : chariot. (SS. T IV) - N - (25) |
| chazedatte. s. f. Petite claie d’osier, de forme ronde, pour faire sécher les fromages. On dit aussi chazelatte. - (10) |
| chazère : Sorte de cage en bois où l'on met sécher les fromages et que l'on suspend généralement sous l'auvent de la maison. - (19) |
| chè : Char, voir à Chai. - (19) |
| ch'é : s. f. clef. - (21) |
| chè d'mochon : fête de fin de moisson (employé de préférence à caingne). (RDM. T IV) - C - (25) |
| ché : (ché - subst. m.) n'est usité que dans l'expression injurieuse : qu'in ché d' neu:rin ! "quelle tête de cochon!", insulte de sens plus ou moins vague, et qui s'adapte à des contextes très divers : cela signifiera tantôt "contrariant", tantôt "imbécile", etc .. - (45) |
| chê : s. m. voiture. - (21) |
| ché, cé (n.m.) : chef, tête - ex. : un ché de neurin : une tête de bétail - (50) |
| ché, chien. - (26) |
| ché, s. m. char. - (22) |
| ché, s. m. char. - (24) |
| ché, s. m. chef, tête. S’applique seulement aux animaux. Autant de bœufs, de vaches, autant de « chés de neurin. » on compte aussi les chevaux, les moutons et même les volailles par « ché. » « cé. » - (08) |
| chè, sm. chien. Chè mailaide, chien enragé. - (17) |
| ché. Chez. Ché no, chez nous. - (01) |
| chebole : Ciboule, « Eune sope à la che-bole ». - (19) |
| chécher, chéchïr. v. n. Sécher. - (10) |
| chéchon, chéchot. s. m. Petit sac. Se dit par corruption de séchot, sachot. - (10) |
| chechot : petit sac, sachet. Ex : "Le Marcel m'a douné un chéchot de pois à c'matin....Ca va fée un bon fricot. J'vas lui die de v'ni les gouter. Ah ! Le boun' houme !" - (58) |
| chéchot. n. m. - Petit sac en papier ou en toile de jute dans lequel étaient placés les billets de banque. (Arquian) - (42) |
| chécon, pron. chacun. - (22) |
| chécun et eun chécun, pr. ind., chacun : « V'Ià les marioûs qui vont j'ter les dragées. Allons, p'tiots, corez ! eùn chécun en àra ». - (14) |
| chècun, pr. chacun. - (17) |
| chécun. Chacun. - (01) |
| chécun. : Chacun. - Chécun di sai chéquène, c'est-à-dire chacun raconte sa nouvelle. - (06) |
| chèdre, cheudre, cheure, cheoir. - (05) |
| chèdre, s. f., viande fraîche. - (40) |
| chée, chat (é long). - (26) |
| chée, s. f. chaise, siège. Syncope de chaire ou chère, ancienne forme pour chaise. - (08) |
| chéé, vn. choir. Voir chô. - (17) |
| cheffre, s. m. chef, celui qui commande. - (08) |
| chéhiot, chéïôt. s. m. Chariot. (Montillot). - (10) |
| chehot, cheneton. s. m. Chenet, petit chenet. (Argenteuil). - (10) |
| chéias (Y). Imparf. de l’indic. du verbe choir. Je tombais. (Coutarnoux). - (10) |
| cheilla (des), fanes de haricots. - (28) |
| cheillâs (n.m.pl.) : bottes de débris de paille - (50) |
| chèillâs : désordre - (48) |
| cheillas : objets ou choses en désordre. Faut pas lécher les denrées en cheillas : il ne faut pas laisser le matériel en désordre. - (33) |
| cheillas. Tiges séchées de certaines plantes légumineuses, principalement des pois et des pommes de terre. Ce mot a formé l'adjectif cheillard, filandreux, dur à cuire : ces faiviôles (haricots) sont cheillardes. — An te faut fâre un gros tas de tous ces cheillas pour les breuler, (V. Echoler.) - (13) |
| chêillée (n. f.) : petite claie faite de lattes de bois et munie d'une anse, servant à faire sécher les fromages - (64) |
| cheillot - paille de pois, de fèves. – N'ailez pâ perde ce cheillot qui, â moins ! les bêtes ne le mégeant pâ mau du tot. - (18) |
| cheillot : (chèyo - subst. m .) roche granitique en décomposition, qu'on utilise pour le ballast des routes, des voies ferrées, ainsi que pour toutes sortes de remblai. - (45) |
| cheillots. s. m. pl . Tiges sèches de pois et de haricots écossés. (Etivey). - (10) |
| chein (on) : chien - (57) |
| chein-loup (on) : chien-loup - (57) |
| cheinte, cheintre et chintre. s. f. Lisière de terrain inculte, ménagée autour d’une propriété pour ne pas aboutir sur celles des voisins ou pour toute autre cause. Du latin cinctorium, ceinture. - (10) |
| cheintre : sentir - (51) |
| cheire, s. f., chaire, chaise. - (14) |
| cheire. Chaire de prédicateur ou de professeur, et chaise ou chaises. - (01) |
| cheitéa. Château, châteaux. - (01) |
| chéke, chaque ; chékun, chacun ; teu chékun, tous, sans exception. - (16) |
| chèlbrun (l’) : la brume des vallées, signe de sécheresse. (B. T II) - B - (25) |
| chéle (n.f.) : chaise - (50) |
| chéle, s. f. chaise, siége où l'on s'assied, petit banc. - (08) |
| chéle. s. f. Chaise. Ce mot est usité dans beaucoup de communes. - (10) |
| chèlée (ë), sf. [lat. calala]. traces, sentier, vestiges de pas. - (17) |
| chêler. Se trainer, ramper, par extension marcher lentement, flâner. Etym. tortue. - (12) |
| chelle n.f. Planche à laver. - (63) |
| chellon : petit banc à trois pieds utilisé pour traire les vaches - (51) |
| chêlon : siège trépied utilisé pour traire les vaches. A - B - (41) |
| chêlon : siège trépied pour traire les vaches - (34) |
| chêlon n.m. (du lat. sellam, siège sans dossier). Trépied pour traire les vaches, petit banc. - (63) |
| chem’nére : cheminée. - (62) |
| chem’nia (na) - chemia (na) : cheminée - (57) |
| cheme : cime. A - B - (41) |
| chemê : chemin. (B. T IV) - D - (25) |
| chemenai son train. : Locution familière signifiant continuer ce qu'on faisait. - (06) |
| chèmeneux, cheum'neux. n. m. - Chènevis, graine du chanvre. (Bléneau, selon M. Jossier) - (42) |
| chèmeneux. s. m. Chènevis. On dit aussi cheum'neux. (Anneau, Bléneau, etc.). - (10) |
| chêmer. v. n. Chômer, être privé, manquer. - (10) |
| chemetire : Cimetière. « Des marguites de cimetire », des cheveux blancs ; « Te m'as pris ma plièche (place), te va me la rendre. - Ta plièche alle est au chemetire ». - (19) |
| chemeut : Lisière d'une pièce de drap. On en fait un lien pour attacher un bébé dans son berceau. - (19) |
| chemi, s. m. chemin. « c'mingn', cemingn'. » - (08) |
| chemie - chemise. On dit aussi Chemin, mais la dernière syllabe avec le ton bien nasale et en trainant. - Note Mairguite, sai marraine l'i é beillé douze chemies pour son troussais. - En vou ai des chemies en couleur, aivou des lignes, des dessins ; quée drole de mode en aimeune lai ! - (18) |
| chémie : chemise. Ex : "Si té monte au bourg, mé don ène chémie prop'. Tin, mets don la neue." (Mets donc une chemise propre....la neuve). - (58) |
| chemie, s. f. chemise, vêtement. - (08) |
| chemiée : voir chamiée - (23) |
| chemiée. s. f. Chènevière. - (10) |
| chemige : Chemise, « Mouilli sa chemige », transpirer abondamment. « I sant c'ment cu et chemige » : ils sont inséparables. - (19) |
| chemillole, ch'miyotte (n.f.) : sorte de veste portée par les hommes. De Chambure écrit chemillole - (50) |
| chemillole, s. f. veste ronde en boge. « chemillole » est une forme locale pour camisole. On sait que ce dernier vêtement était une sorte de veste portée par les hommes. - (08) |
| chemillot, s. m. brassière d'enfant. - (08) |
| chemin à talon : petits sentiers pour piétons qui coupent à travers champs. - (21) |
| chemin à talon. Sentier à travers champs et bois ne livrant passage qu'à une seule personne à la fois. - (49) |
| chemin de fer : s. m., coulisseau de lit. - (20) |
| chemin de fer : s. m., employé de chemin de fer. Elle a épousé un chemin de fer. - (20) |
| chemineau, rouleur, martselot : colporteur - (43) |
| cheminée, s. f., cheminée de salle commune. - (40) |
| chemini. Cheminai, cheminas, chemina. - (01) |
| Chemin-neuf (Le) : nom qu'on a donné pendant longtemps à Mâcon, au cours Moreau, qui venait d'être créé. - (20) |
| cheminze : chemise. (PLS. T II) - D - (25) |
| cheminze. Chemise, chemises. - (01) |
| chemïotte (pour chemisotte). s. f. Sorte de veste ou, plutôt, demi-blouse, bourgeron qui en tient lieu. - (10) |
| chemisole. Camisole. La chemisôle dont il est question dans une jolie sauteuse de l'Auxois est une chemise d’homme... - (13) |
| chemison. s. m . Corset d’été. (Maillot). - (10) |
| chemnai, s.f. cheminée. - (38) |
| chem'nale : lamier pourpre, ortie royale - (48) |
| chem'në, chev'në, cheminée. - (16) |
| che'mnée : cheminée - (48) |
| chem'née : cheminée. On o ben vé la chem'née : on est bien vers la cheminée. - (33) |
| chemnée : s. f. cheminée. - (21) |
| chem'née, s. f. cheminée, foyer. - (08) |
| chemneuille : tiges de chanvre servant à allumer le feu. (VDS. T IV) - VdS - (25) |
| chem'non, s. m. petit chemin, sentier. - (08) |
| chemnoter, v. a. se dit des rameaux d'arbres ou d'arbustes qui sèchent et meurent, peut-être par assimilation avec la «chenevote » que l'on prononce « chemenote » dans une partie du Morvan. - (08) |
| chemnotte. s . f. Chénevotte. - (10) |
| chemoiller : (chœmouèyé - v. intr.) dormir légèrement, somnoler. - (45) |
| chemotter, v. n. murmurer en protestant. Émettre des spasmes après avoir pleuré. - (24) |
| chemouté, v. n. murmurer en protestant. - (22) |
| chemtire : s. m. cimetière. - (21) |
| chemy, chemin, de l'italien cammino. - (02) |
| chenaille : chenille. (C. T III) - B - (25) |
| chenaille. Chenille. - (49) |
| chenailler. v. tr., battre à coup de fouet, comme on fouette les chiens (chienailler). - (14) |
| chêne-drait, châgne-drait. s. m. Arbre fourchu, jeu d’enfant. - (10) |
| chêne-dret, châne-dret (faire le). n. m. - Faire le « poirier » : se tenir sur la tête et les mains, jambes en l' air, non pas comme un poirier mais comme un chêne droit ! - (42) |
| chenée ou echenée - Voyez Aichenée. - (18) |
| cheneille, s. f. chenille. - (08) |
| chénerie : s. f., chênaie. - (20) |
| chêneteau : s. m., jeune chêne. - (20) |
| chenevé (n.m.) : chènevis - (50) |
| chenéve et chenove. Chanvre, du latin cannabum. Une tige de chanvre s'appelle dègne, comme dans le Mâconnais. La malére est la tige de chanvre mâle. - (03) |
| chenevé, s. m., chenevis. - (14) |
| cheneveâye, chenevote, fragment de tige de chanvre. - (16) |
| chenevére - chenevière, chanvre sur pied, champ où il est semé. - Les chenevéres sont jolies c't année. - Voiqui le temps que veint qu'en fauré tiré les chenevéres. - (18) |
| chenevëre, chenevière. - (16) |
| cheneveuille. Chenevote, chenevotes. - (01) |
| cheneveuille. : Tiges sèches du chanvre dépouillées de leur écorce. A Semur et dans le Châtillonnais on dit chenevotte. - (06) |
| cheneveuilles, tiges sèches de chanvre dépouillées de leur écorce... - (02) |
| chenevey (bounot), s. m., bonnet épais que portaient jadis nos mariniers. Cette coiffure, excellente contre l’humidité, était ornée de trois glands ronds à gauche, et se serrait à volonté du côté des glands. - (14) |
| chenevote, s. f., allumette faite avec la tige du chanvre, qu'on a dépouillée de son filament par l'opération du teillage. - (14) |
| chenevotte : s. f., allumette de chenevotte, soufrée aux deux extrémités. - (20) |
| chenevotte. Tige de chanvre dépouillée de son écorce. On s'en servait pour faire des allumettes soufrées. Les paysans se réunissaient, pendant les veillées d'hiver, pour teiller le chenôve après qu'il avait été nasé. (V. ce mot.)... - (13) |
| cheni - balayures, poussière. - Raimasse don to ces cheni qui, que ce n'a pâ propre.- I ai in cheni dans l'uillot. - (18) |
| cheni (prononcez : ch'ni) (C.-d., Chal., Br., Morv.). - Balayure, poussière, ordure. On pourrait croire, comme l'ont fait Cunisset-Carnot et beaucoup d'autres, que ce mot vient de chenil, ce logement des chiens de chasse, en général mal tenu, plein de poussière et d'ordures… . Sa véritable étymologie est cinis, cendre, qui se prononce chéne, dans certains patois (en rouchi, notamment, suivant Chambure). Dans l'Yonne, on appelle cbenise ou cenise la cendre rouge d'un foyer ardent (Jossier). - (15) |
| cheni : grain de poussière - (44) |
| cheni : Poussière, balayures, « J'ai in cheni dans l'yeu » , j'ai une poussière, un corps étranger dans l'œil. - (19) |
| cheni, ch'ni. Poussière : « avoir un ch'ni dans le zieu ». Fig. balayures. - (49) |
| cheni, cni (n.m.) : poussière ; corps étrange sous la paupière - (50) |
| cheni, n.m. grain de poussière, balayures. - (65) |
| cheni, s. m. le rebut, la plus mauvaise qualité des choses, poussière, ordure : ôtez ce « ch'ni » qui est sur la soupe. - (08) |
| cheni, s. m. miette, balayure, poussière : j'ai un cheni dans l'œil (du vieux français chenille au masculin. latin caniculus). - (24) |
| cheni, s. m. miette, balayure, poussière : j'ai un cheni dans l'ail. - (22) |
| cheni, s. m., ordure, petit corps étranger, balayure : « J'ai un cheni dans l’ûyot ». — « Y a des chenis dans l’coin de ta chambre ». - (14) |
| cheni. Balayure, atome. - (03) |
| chenichon : senneçon. - (30) |
| chenil ou chnil, peut-être chenit ou chnit. Grain de poussière ; au pluriel tas de poussière, débris malpropres et menus résidus du balayage. Etym. dans les patois des Flandres, du Berry, de la Saintonge, on dit chen, chein ou chin pour chien ; de la chenil, habitation des chiens ; après cela, chenil a désigné une maison mal tenue, un taudis. - (12) |
| chenil. A Châtillon l'on dit : avoir un chenil dans l'œil, pour exprimer que quelque ordure ou parcelle de poussière s'est introduite dans les yeux... - (02) |
| chenil. : Lieu où l'on enferme les chiens (en latin canile) et où s'accumulent les ordures et la poussière. - (06) |
| chenille : s. f. chenille, - (21) |
| chenille : s. f., taquin, moqueur, malin. - (20) |
| chenillère. s. f . Poulailler. C’est une altération de genillère, qui lui-même se dit par corruption de gelinière , le vrai mot. - (10) |
| chenillon : s. m. Dim. de chenille. - (20) |
| chenils (ch'nis) ; n. masc. plur. ; balayures, poussières. - (07) |
| chenin, cheni, sm. [lat. caniculus]. fétu, grain de poussière. Avorton. - (17) |
| chenine : s. f., vx fr. chenln (m.), voiture qui sert au transport des chiens capturés sur la voie publique. « Hier la chenine a amené en fourrière un certain nombre de cabots. » (Union Rép., 28 mars 1906). - (20) |
| chenis (ch'ni) : s. m., vx fr. cenis (fém.), balayure, poussière. T' n'as pas enlevé les chenis ce matin. Sors-me donc ce chenis que j'ai dans l'oeil. A Mâcon, les boueurs sont dits « ramasseurs de chenis ». Voir équevilleur. - (20) |
| chenis, malpropretés qu'on ramasse en balayant. - (27) |
| chenis. Ordures, balayures. Ce terme local est écrit schenis dans un acte du Moyen-âge relatif à la rue du Bourg, à Dijon. Il n'a rien de commun avec un chenil à loger les chiens, et vient probablement, comme cenize, du latin cinis, cendre... - (13) |
| chenise. s. f. Voyez cenise. - (10) |
| chenne et chin-ne. s. f., chienne. - (14) |
| chènne, chêne (prononcer chin-ne). - (16) |
| chenö, öte, s. m. f. petit chien, petite chienne. Chenet. - (17) |
| chenoichai - rechercher, être menacé. – A n'a pâ queman qu'à vouro, â chenoiche bien sur quéque mailaidie. - A sont couchés to les deux ; i crains bein qu'a chenoichaint quéque misère. - (18) |
| chenoillai - dormir d'un demi sommeil ; un instant pour se reposer. - Al éto si lâssai qu'al é chenoillai in quairt d'heure dans lai groinge. - I ne dreume pâ queman qu'en faut ; i chenoille par moment, voilai to. - (18) |
| chenot, s. m. chenet de foyer. - (08) |
| chenot, s. m., chenet. Chenot est le dim. dé chen (chien). Les premiers chenets représentaient volontiers des chiens ou des têtes de chiens. - (14) |
| chenôve - chanvre. - I ons étendu note chenôve. - En no fau portai note chenôve â fortou. - (18) |
| chenove, chanvre. - (05) |
| chenove, s. m., chanvre. La plante même, et la filasse que l'on retire de son écorce. - (14) |
| chenu, adj., bon, fort, cossu, solide, excellent : « I m'en a fait goter ; oh ! y é du ch'nu ! » - (14) |
| chenu, chenuse (ch'nu, ch'nuse), chenu, chenue : au prop., fort, gros, épais ; au fîg., riche. « Oh ! Mam'zelle Vincelette, vous êtes ben trop chenuse ; j' sais ben qu' vous n'êtes pas pour moi. » - (20) |
| chenucher. v. n. Pleurer comme un enfant. - (10) |
| chènvöille, sf. chenevotte. - (17) |
| chènvöre, sf. chenevière. - (17) |
| chéon. s. f. Vase au-dessus duquel se met la fescelle remplie de fromage mou, et dans lequel s’égoutte le petit lait. Voyez d 'escelle. - (10) |
| chepale : Chapelle. « La Chepale de Bragny », nom de pays, la Chapelle de Bragny. - Aux cartes : « - Qu'est-ce que t'as dans ta chepale ? », qu'as-tu dans ton jeu ? - Les Chepalas, les habitants de la Chapelle de Bragny. - (19) |
| chepan : Souche, « Alle ne bouge pas pu qu'un chepan », elle ne bouge pas plus qu'une souche de bois. Personne peu dégourdie, sans esprit, « S 'te fille est in brave chepan ». - (19) |
| chèpè : (chèpê: - subst. m.) 1- chapeau - 2- une pièce de charrue. Le "chapeau" est une traverse qui relie les deux montants de l'avant-train de rouelles, et dont le rôle est de soutenir l'age. Les deux montants étant percés de trous réguliers, on peut, en réglant la hauteur du "chapeau" régler l'inclinaison de l'age, et ainsi la profondeur de pénétration du soc dans la terre. - (45) |
| chèpè, sm. chapeau. - (17) |
| chépeais : chapeau. - (32) |
| cheper, appeler de loin. - (05) |
| chépiae, chapeau. - (26) |
| chépiau : Chapeau, « I fa chaud prends tan chépiau de peille » ; le « chépiau » de l'alambic, la partie supérieure de l'alambic qui couvre la chaudière et porte le serpentin. - Vieille chanson : « O m'avins mis des plieumes d'ujau su man chépiau ». - (19) |
| chèpiau : s. m. chapeau. - (21) |
| chèpiau. Chapeau. - (49) |
| chépiau. s. m. Chapeau. (Montillot). - (10) |
| chèpllier, v. a. frapper à coups répétés (du vieux français chapler). - (24) |
| chepper : v. n., chopper, buter contre quelque chose en marchant. - (20) |
| chepran (on) : hibou - (57) |
| chépuzè : couper du bois pour le mettre en charpie - (46) |
| chéque : Chaque, « Chéque ujau troue san nid biau ». - (19) |
| chèque, adj. ind. chaque. - (17) |
| chéquin : Chacun, « Chéquin a bin ses en-nus », chacun a ses peines. - (19) |
| chér, tomber. - (26) |
| cher. s. m. Chariot, char. — Droit de cher, droit que possède un propriétaire de pouvoir passer librement avec une voiture dans une propriété contiguë à la sienne, soit pour les besoins de la culture, soit pour l’enlèvement de ses récoltes. Du latin carrela , carrus. - (10) |
| chérantie, s. f. cherté, prix élevé des denrées. Nous sommes dans un siècle de « chérantie. » - (08) |
| chèrantise. Cherté : « la chèrantise est dans les cotsons ». - (49) |
| cherbeuchlle, s. m. charbon des épis du blé et du maïs. (Latin rarbuculus). - (24) |
| cherbouèiller : (chêrbouèyé: - v. trans.) 1- noircir au charbon. 2- é:t cbêrbouèyé : mal digérer, éprouver des troubles digestifs. On dit dans le même sens: é:t bêrbouèyé. - (45) |
| cherche, s. f. recherche, poursuite : il est en « cherche » de sa vache. « serche. » - (08) |
| chercher son pain, loc, mendier. Le Morvan a comme type le cherche-pain (cherchou d' pain). (V. Aller aux portes). - (14) |
| chercher : v. a., atteindre approximativement (comme prix). S'emploie avec le verbe aller. « Qu'est-ce que ça peut bien valoir ? Peuh ! ça va chercher une pièce de cent sous. » - (20) |
| chercheux de pain. Mendiant. - (49) |
| cherchou, cherchouse de pain, s. m. et féminin celui ou celle qui cherche, qui quête, qui demande l'aumône, mendiant ou mendiante pris dans un sens favorable. « sarçou, sarçouse » ou « sarçoure. » en quelques lieux « serchou, serchoure, serchouse. - (08) |
| chère - chaise. - Peurnez ine chère et cheurtez vo qui causain in rnanmant. - Ne mets don pâ queman cequi tes pieds su les boujons de lai chère. - (18) |
| chère (ou chaire) : une chaise - prend eune chère pe écheut te, prends une chaise puis assieds-toi - (46) |
| chère : tomber. - (66) |
| chère âme du bon Dieu. Cette locution est très usitée pour désigner les personnes défuntes. Une veuve ne parle presque jamais de son mari décédé que dans ces termes à la fois tendres et religieux. - (08) |
| chère an-née (la), s. f., l'année de la grande cherté (1816). — Petit, j'entendais toujours parler du pris exorbitant des denrées en ce triste moment. Je me souviens du pris du sucre, qui valait 6 fr. la livre, et tout à l’avenant. - (14) |
| chêre : s. f. chaise. - (21) |
| chêre : v. tomber. - (21) |
| chère, s. f., chaise. - (40) |
| chêrére : (chê:ré:r' - subst. f.) charrière, voie étroite ménagée dans une forêt pour y permettre le passage de chars à bœufs. - (45) |
| ch'erére : s. f. niche pratiquée de chaque côté de l’entrée du four, destinée à recevoir les cendres chaudes. - (21) |
| chéresse, s. f. dérivation d'eau pour le service d'un moulin, d'une usine. - (08) |
| cherige : Cerise, « In pané de cheriges », un panier de cerises. « Fare la cherige », grimace qui consiste à avancer la lèvre inférieure en cherchant à lui donner l'aspect d'une cerise. - Dicton : « Si i pliô pa la Saint Geôrges les cheriges de madame sant feurlores (perdues) ». - (19) |
| cherigi : Cerisier (cerasus), « Pa troué les cheriges bonnes i faut les miji su le cherigi ». - (19) |
| cherigi ou colamb : Cerisier Ste Lucie. - (19) |
| cheriot : chariot. Ils étaient longs, à 4 roues dont 2 directrices. Les 2 plus petites roues à l'avant. - (58) |
| c'herizhe, cerise. - (05) |
| cherjûye, s. m. avant-train de charrue. - (24) |
| cherpeigne. s. f. Panier, corbeille. (Étivey). - (10) |
| cherpeune (d’la) : charmille - (57) |
| cherpignier. s. m. Vannier, faiseur de corbeilles et de paniers. - (10) |
| cherpingne : (chêrpin:gn' - subst. f.) sorte de grosse corbeille à deux anses. - (45) |
| cherpœne, s. f. charmille des bois. - (24) |
| cherriée. s . f. Cage en bois dans laquelle on fait sécher les fromages. (Chastenay). - (10) |
| cherroux. s. m. Grosse toile qui se met entre le linge et les cendres dans une lessive. (Guillon). - (10) |
| chertance : s. f., cherté. En 1920, la cher tance de toutes choses ne cessait d'augmenter. - (20) |
| chêrtin: ( subst. m.) sorte de petite charrette utilitaire de faible charge. - (45) |
| chérubîn. Chérubin, chérubins. - (01) |
| chès de neurin : tête de bétail, unité. - (33) |
| chése : chaise - (48) |
| chésit, tomba, parf. du v. cheûdre. - (14) |
| chessè : chasser - (46) |
| chesser, v. tr., sécher : « J' veins d' laver mes draps ; j' les ai métu chesser ». - (14) |
| chesser, verbe (in)transitif : sécher. - (54) |
| chésser. Sécher. - (49) |
| chesser. v. - Sécher. - (42) |
| chésseresse. Sécheresse. - (49) |
| chesse-veri : chauve-souris. - (29) |
| chessir : sécher le linge - (46) |
| chessore. Les Dijonnais prononcent chessoure. Ficelle nouée qui forme l'extrémité du fouet. Petite branche d'arbre avec laquelle on chasse les animaux de basse-cour et même les mouches. On dit aussi évaire-moche. En Picardie cachoire... - (13) |
| chessot : drap de lit. (E. T II) - B - (25) |
| chessot, s. m., lange pour les besoins des enfants. Parce qu'ils servent à essuyer, à chesser le petit. - (14) |
| chèssoure (f), fouet. - (26) |
| chestiâ, s.m. prononcé ches-tiâ, château. - (38) |
| chêt. s. m. Chat. (Argenteuil). - (10) |
| chetailai - jeter là, jeter pour se débarrasser. On prononce à peu près toujours Ch'tailai. - Ch'taile moi don cequi, ci ne vau ran du to. - Si vô li beillez vos ète sûr qu'à le ch'tellerai, sans pu de faiçon. - (18) |
| chetel, ch'tel, ç'tel, s. m. cheptel, capital en bestiaux que le propriétaire confie au fermier ou au métayer ; contrat passé entre un propriétaire et un cheptelier. - (08) |
| chetelié, chtélié, ç'télié, s. m. cheptelier, celui qui prend du bétail à cheptel. Il y avait autrefois beaucoup de « ch'téliés » en Morvan. - (08) |
| chételot. Le jeu du chételot consiste à abattre avec une noix lancée ou roulée, une rangée de petits châteaux formés chacun de quatre noix. Par extension, assemblage de fruits placés à l'extrémité d'une branche : An y évot tant de chételots d'aipreis que not' poiré s'ast éluchê (cassé.) - (13) |
| cheter(se), v. r. s'asseoir. - (24) |
| chéti - chétif, faible, méchant. - Al à bein chéti ceute homme lai ; à dai éte mailaide. - A nos aivaint premi ine moitié de lapin, et à nos en an envie in cheti bou de ran. - Ne t'y fie pâ, al à cheti en diabe. - (18) |
| cheti (C.-d., Chal.), ch'tit ou ch'ti (Y.), c'ti (Morv.), au féminin chetite. - Ce mot signifie chétif, mais possède en patois un sens beaucoup plus étendu qu'en français, car, si on l'emploie en Bourgogne pour souffreteux, malingre, il est usité également pour dire malicieux, malfaisant. Il s'applique aussi aux objets, dans le sens de mauvais : « Un ch'ti repas », en mauvais état : « Une ch'tite robe. » Le mot chétif a la même origine que le mot captif (captivus). En français du moyen âge, c'était ainsi qu'on désignait les prisonniers ; ceux-ci étant, en général, mal portants, cbétif finit par signifier faible, misérable. Cbeti a produit cbetiteté, cb'titeté, cb'titerie, qui signifient méchanceté, mauvaiseté, malice, gaminerie. - (15) |
| cheti (fem. chetite) : Mauvais, « Y est bin cheti », c'est bien mauvais. « Je ne sais pas ce que t'as mis dans ta sope mâ alle est bien chetite ». - Polisson, « In cheti dreule », un petit garçon polisson. - Petit, chétif, « In cheti bout de mande », un petit enfant chétif. - Coquin, « I est in cheti », les chetis les malhonnêtes gens. - (19) |
| cheti, adj. 1. mauvais, vicieux : du cheti pain, un cheti homme. — 2. Chétif : depuis sa maladie il est resté bien cheti. Féminin chetite. - (24) |
| cheti, adj. 1. Mauvais, vicieux : du cheti pain, un cheti homme. — 2. Chétif : depuis sa maladie il est resté bien cheti. Féminin, chetite ou chetœve. - (22) |
| cheti, chetite, chti, chtite. Chétif avec toutes les acceptions de ce mot ; de plus, un sens tout diffèrent au figuré, mauvais, malin, malfaisant. Etym. forme altérée du mot chétif, qui vient de captivus, parce que le misérable captif devient maigre et malingre (Littré). - (12) |
| chêti, ch'ti, ç'ti (au féminin ite), adj. chétif, faible, malingre, mauvais, méchant, malheureux, misérable, de mauvaise qualité. - (08) |
| cheti, -ite, fripon, coquin, maladif. - (05) |
| cheti, te, adj., pâle, maigre, chétif : « Vlià des ch’tis morciaux! » — « T'é donc bé mau ? T'as eùne ch'tite figure ». Au fig., mauvais, méchant, vaurien : « Y ét eun ch'ti vouésin ». D'un petit polisson on dira : « Ol é ben prou ch'ti ». - (14) |
| cheti. Ancienne prononciation de l'adjectif chétif. On emploie ce mot au propre et au figuré : Al ai eune chetite santé. — Çast un cheti gas qu'ai tot dévalisé not’ cortil... Le ch'ti, c’est le diable en langage morvandeau. - (13) |
| cheti. Chétif, chétifs. Au féminin, en bourguignon, chetite. - (01) |
| chêtiâ, s. m., château. - (40) |
| chétiau : Château. « Le chétiau de Brancion ». « In chétiau de paneuillans », construction que s'amusent à bâtir les enfants. Voir à paneuillans. - (19) |
| chétif, adj. petit, petite (se prononce ch'ti, ch'tite). - (65) |
| chetiot - diminutif de cheti voyez ce mot. Chetiot ou Ch'tiot ne s'emploie guère que pour exprimer la faible santé, rarement pour exprimer la malice. - (18) |
| chetiot, chetiote (ch'tiot, ch'tiote) : adj., dim, de chetit, chetite, au propre seulement. Il a bien profité depuis un mois ; il est moins ch'tiot qu'i n'était pas. - (20) |
| chetit, chetite (ch'tit, ch'tite) : adj., au prop., chétif, faible, petit, mince ; au fig., mauvais, méchant, vaurien. « Le vin de l'année passée (1922), il est fin ch'tit. » - (20) |
| chetit. Chetif. Chetit devant une voyelle, cheti devant une consonne. - (01) |
| cheti-te. Chétif a un sens beaucoup plus étendu qu'en français. On dit d'un enfant qu'il est cheti, s'il est mal portant ou polisson. Un homme cheti, c'est un coquin, de chetis habits sont des habits en mauvais état. Nous disons chetiveté pour chose de peu de valeur. - (03) |
| chetitement (ch'tit'ment) : adv., chétivement, méchamment, mauvaisernent. C'est de la besogne chetitement faite. - (20) |
| chetitement, adv., chétivement, médiocrement, misérablement. - (14) |
| chetitetai - malice, méchanceté. - En i en é de lai chetitetai chez lu, ailé ! - Il à remplie de chetitetai, lai fonne â Bochot. - (18) |
| chetiteté (ch'tit’té) : s, f., méchanceté, malice. Quelle ch'tit’té y a dans c'te tête. Il m'en a fait, des ch'tit'tés ! - (20) |
| chetiteté : Coquinerie, « Y est in cheti dreule, si o fa des seutijes y est pas de la maladrache y est bin de la chetiteté », c'est un petit coquin, s'il fait des sottises ce n'est pas par maladresse, c'est par vice. - (19) |
| chetiteté, ch'tit'té, ç'tit'té, s. f. malice, méchanceté. - (08) |
| chetiteté, s. f. vice, méchanceté : il a de la chetiteté à revendre. - (24) |
| chetiteté, s. f. vice, méchanceté. - (22) |
| chétiveté. s. f. Etat de ce qui est maigre, faible, souffrant, chétif. — Avarice, méchanceté, vilénie. - (10) |
| chetiz, chétif. - (04) |
| chetré : mauvais lit. (SY. T II) - B - (25) |
| chètré : (chètré - subst. m.) lit, couche (terme péjoratif). - (45) |
| cheu (en y — ben), il importe peu, peu me chaut. - (27) |
| cheu (n.m.) : seuil de la porte - (50) |
| cheû (prép.) : chez - (64) |
| cheu : Tomber, « Y va cheut de l'iau », il va pleuvoir. « O penche du côté qu 'o va cheut », on devine à son attitude le parti qu'il va prendre. - « Les deux brés m'en cheut», les bras m'en sont tombés. - En parlant de quelqu'un qui a fait un bon maraige « Ol a bien cheut sans se casser (sans se faire mal) ». - « Y cheurait des gouets démangis (des serpes démanchées) que j'y arai quand mouin-me » ; rien ne m'arrête. - (19) |
| cheu : s. f. suie. - (21) |
| cheu, prép., chez : « Qu' veins-tu fàre iqui ? Va-t'en cheù vous ». - (14) |
| chéu. s. m . Crochet de fer à l’extrémité de la chaîne d’un puits, pour suspendre le seau avec lequel on veut tirer de l’eau. (Armeau). — Voyez chaüt. - (10) |
| cheuche - souche. - Ces cheuches lai ne sont vraiment pas asilles ai airoiché. - Al é lai tête dure queman ine cheuche. - (18) |
| cheuche (n.f.) : souche - (50) |
| cheuche : souche - (48) |
| cheuche : tête - (48) |
| cheuche : (cheuch' - subst. f.) souche. - (45) |
| cheuche : souche. - (32) |
| cheuche, s. f. souche, tronc d'arbre vivant ou mort. - (08) |
| cheuchô, s. m., cervelle, cerveau. - (40) |
| cheuchon, s. m. petite souche d'arbre, diminutif de « cheuche. » - (08) |
| cheûdre : tomber, choir. Je cheu’, je cheudrai, j’ai chezu, je cheuzo…vient du latin cadere. - (62) |
| cheudre, v. intr., tomber, choir : « Prens donc garde ; t' vas m' fâre cheudre ». - (14) |
| cheudre. Tomber, du latin cadere, et du vieux mot choir. Nous disons écheudre pour se lever, et encheudre pour aider quelqu'un à se lever. - (03) |
| cheufé, v. n. pousser des cris bruyants à l'occasion d'une réjouissance. - (22) |
| cheufer, v. n. pousser des cris joyeux à l'occasion d'une réjouissance. - (24) |
| cheuffer, cheuffri, chupper : appeler du dehors. - (30) |
| cheugne. s. f. Crottin qu’on ramasse sur les chemins, ce qu’on appelle à Auxerre une érangée. - (10) |
| cheugner : donner un coup, prendre - (60) |
| cheugni : Pleurnicher, « T'as pas binteut fini de cheugni ? ». - (19) |
| cheuillat : Celui qui écoute, en ouvrant la bouche, ce que disent les autres. - (19) |
| cheuiller : pleuvoir faiblement. « Il en cheuille ». - (56) |
| cheuiller, chouiller. v. a. Froisser, gâter, salir, gaspiller. (Pourrain). - (10) |
| cheuiller. v. - Abîmer, gaspiller, gâcher. - (42) |
| cheuilli : Bayer, faire acte de curiosité indiscrète. « Ou 'est-ce que te vins cheuilli itié sacré euvre gueule ? ». - (19) |
| cheul, e, adj. seul : « aine parsonne cheule. » - (08) |
| cheulai, se dit des enfants sevrés qui sucent leur pouce... - (02) |
| cheulaî. Boire… - (01) |
| cheulai. : Tetter. Se dit aussi des enfants sevrés et qui tettent leur pouce. (Del). - (06) |
| cheûlavey : Olivier, hameau de Boyer. Etym. chez Olivier ; le moulin Olivier le Mauvais, terrier de Venière. - (19) |
| cheulè : sucer - (46) |
| cheulé, v. t. téter à vide. V. beulé. - (17) |
| cheuler : téter d'ou cheulotte : tétine. - (66) |
| cheuler : têter. (M. T III) - D - (25) |
| cheuler, sucrer, comme un enfant au biberon. - (27) |
| cheuler, v. téter, boire. - (65) |
| cheuler, v. tr., trop boire, s'enivrer, se saouler. - (14) |
| cheuler. Téter son pouce, par extension, téter un objet quelconque. Etym. onomatopée. - (12) |
| cheûlotte : une tétine - (46) |
| cheulotte : tétine. - (66) |
| cheum’née. s. f. Cheminée. (Etaules). - (10) |
| cheume : (nf) cime, sommet - (35) |
| cheume : cime - (34) |
| cheume : cime - (43) |
| cheume : cime, sommet - (51) |
| cheume n.f. Cîme d'arbre, de maison, sommet d'une montagne. - (63) |
| cheumenotte. n. f. - Chènevotte : tige de chanvre dépouillée de son écorce, utilisée comme combustible. - (42) |
| cheumiée, chomiée. n. f. - Chènevière, champ de chanvre. - (42) |
| cheune : taie d'oreiller. A - B - (41) |
| cheune (na) : chienne - (57) |
| ch'eune : s. f. taie d'oreiller. - (21) |
| cheunevée : cheminée. - (29) |
| cheu-nous, loc. employée substantivement, le groupe qui forme la maisonnée ; « Cheû-nous sont sortis. Cheû les François vont li fâre la conduite ». - (14) |
| cheun'viére : chenevière (lieu planté de chanvre) - (48) |
| cheupais. s. m. Chapeau. (Vassy-s-Pisy). - (10) |
| cheupe (n.f.) : touffe de cheveux - (50) |
| cheupe (na) : touffe (de cheveux) - (57) |
| cheupe : Souche, grosse bûche de bois, « La cheupe de Noué », la bûche de Noël. - (19) |
| cheupe : touffe de cheveux - (48) |
| cheupe : (cheup' - subst. f.) touffe de cheveux. - (45) |
| cheupe : touffe de cheveux - (39) |
| cheupé, part. pass. d'un verbe « cheupper » inusité à l'infinitif. Celui qui a une huppe ou une houppe sur la tête. Les poules crèvecœur sont bien « cheuppées. » - (08) |
| cheupe, s. f. cep. Diminutif cheupllion. - (24) |
| cheupe, s. f. chupe est pour huppe, houppe, touffe de plumes sur la tête d'un oiseau, de crins, de poils, sur la tête d'un cheval, d'un âne, etc. se dit même d'une mèche de cheveux sur la tête d'un homme. - (08) |
| cheupener : Butter, trébucher. - (19) |
| cheuper. Crier ou appeler en criant. On dit en termes de chasse houper, quand le veneur avertit son compagnon par un ou deux mots longs qu'il a trouvé une bête courable qui sort de sa quête et entre dans celle de son compagnon. - (03) |
| cheupine : Chopine. Un jour de marché à Tournus une bonne femme qui a bien vendu son beurre et ses œufs entre dans une auberge et demande une chopine, une fois servie elle tire de son panier une brioche qu'elle trempe dans son verre. Le vin absorbé et la brioche sucée, elle appelle l'aubergiste et lui montrant son verre vide : « Ma brieuche a bu sa cheupine, je boirais bin ato la minne », ce qui fut fait. La cheupine contient environ 0 litre 24. - (19) |
| cheupingne, sf. chopine. - (17) |
| cheupon, s. m. lourde souche. Personne grosse et maladroite. - (24) |
| cheuppe (na) : épi (cheveu) - (57) |
| cheuppe (na) : mèche - (57) |
| cheuppe : n. f. Mèche de cheveux sur le front. - (53) |
| cheuppe : s. f. souche. - (21) |
| cheuppé. Huppé. Fig. Riche, de haut rang. - (49) |
| cheuppe. Huppes, touffes de plumes ou de poils sur la tête. - (49) |
| cheupper (se). Se tirer la huppe les cheveux ; se battre. - (49) |
| cheupran. Chat huant. - (03) |
| cheuquer : Choquer, blesser la modestie de quelqu'un. « Ol est bin mau endeurant, in ren le cheuque ». - (19) |
| cheuquou : Qui se choque facilement. - (19) |
| cheûr - s'étarni : tomber - (57) |
| cheûr : choir - (57) |
| cheûr : sûr - (37) |
| cheur, s. f. sœur. - (08) |
| cheur. s. f. Sœur. (Ménades). - (10) |
| cheurant : indiscret. A - B - (41) |
| cheurbi : (nm) sorbier - (35) |
| cheurbi : sorbier - (43) |
| cheurde adj. Sourde. Au masculin on utilise plutôt sordiaud. - (63) |
| cheure : cendre, poussière. A - B - (41) |
| cheûre : tomber - èl é chu, il est tombé - è vè cheûre, il va tomber - è cheû, il tombe - è cheuzè des côdjes, il pleuvait des cordes - cs'è cheu, ça tombe - (46) |
| cheûré, cheuté : v. i. Tomber. - (53) |
| cheurère : loge (feuron*) sous le four à pain servant à stocker la cendre (en B : cheurtire). A - (41) |
| cheurger, v., choir, tomber. - (40) |
| cheurlatte : s. f. tarte à la courge. - (21) |
| cheurler. v. a. Flagorner. (Rugny). - (10) |
| cheurotte, s. f. sœur, petite sœur, terme d'amitié. « seurotte. » - (08) |
| cheûrou (ze) : curieux (se) - (35) |
| cheurrant : indiscret - (34) |
| cheurre : cendre, poussière - (34) |
| cheurre, v. tomber ; Lili (Louis), prends gaidie, tu vais cheurre ; al ost cheut de la grêle. - (07) |
| cheurrère : feuron, sous le four à pain pour stocker la cheurre ou cendre de bois - (34) |
| cheurtai (et Se) - assis et s'asseoir. - Aipruchez vo du feu et pu chertez vo brâmant. - Al étaint cheurtai su le ban, ai l'ombre qu'a causaint tranquillement. - Voyez Echetai. - (18) |
| cheurtal : banc. - (29) |
| cheurtaul : (chœrtô:l - subst. f.) siège. - (45) |
| cheurte : saleté poussiéreuse - (51) |
| cheurte : une chaise. - (56) |
| cheurte : n. m. Endroit pour s'asseoir, siège en bois. - (53) |
| cheurté, s'cheurté : v. t. Asseoir, v. pr. S'asseoir. - (53) |
| cheurté, s'cheurté, s'asseoir ; cheurtë vo, asseyez-vous. - (16) |
| cheurter (è) : ((è)chœrtè - v. tr.) asseoir. choet'tè ! "assied-toi !". On emploie aussi èchœrtè, mais dans un sens plus déterminé : quand on dit à quelqu'un ècheut'tè, on lui désigne un siège du doigt. - (45) |
| cheurter (se) : s'asseoir. - (29) |
| cheurter (se) : s'asseoir. - (31) |
| cheurter (se) : s'asseoir. - (56) |
| cheurter (se), v., s'asseoir. - (40) |
| cheurter (se), verbe pronominal : s'asseoir. - (54) |
| cheurter : (vb) se montrer curieux - (35) |
| cheurter : asseoir - (48) |
| cheurter : s'intéresser à ce qui ne vous regarde pas - (43) |
| cheurter, s'asseoir. - (27) |
| cheurter, s'asseoir. - (28) |
| cheurter, v. a. asseoir. « cheurté-lu » ; asseyez-le ; « ile ô cheurtée », elle est assise. - (08) |
| cheurter, v. tr., asseoir : « Eh ! bràve houme, cheùrtez-vous donc eun brin su l’ban ». - (14) |
| cheurtire : voir cheurère*. B - (41) |
| cheurtire : (nf) cuve à cendres - (35) |
| cheurtire : cendrier dans le mur à côté de la cheminée - (51) |
| cheûrtîre n.f. (dérivé de cheure, cendre). Cendrier, dans le mur à côté de la cheminée. La cheure, à Suin, désigne les débris et les miettes que l'on trouve au fond d'un sac, d'un tiroir, d'un local quelconque une fois vidé. - (63) |
| cheurtole : siège. (RDT. T III) - B - (25) |
| cheurtôle : n. m. Siège. - (53) |
| cheurtot (nom masculin) : tabouret sur lequel on prend place pour traire les vaches. Un dit aussi chitot. - (47) |
| cheurtoû : siège, chaise - (48) |
| cheurtoûre, chaise. - (16) |
| cheurtoure, chaise. - (27) |
| cheurtrelle : siège. - (59) |
| cheurt'tai : exp. Assieds-toi. - (53) |
| cheûsé : v. i. Chuter, tomber. - (53) |
| cheusé, enleuvé : v. t. Enlever. - (53) |
| cheutai : aider. - (33) |
| cheûtè, cheûré, borgé : v. i. Tomber. - (53) |
| cheute, s. f. chute, action de tomber. - (08) |
| cheùte. Chute. - (01) |
| cheûtnâ, choûtnâ, tsoûtnâ n.m. (onom.) Curieux, indiscret, qui vient renifler comme un chien. - (63) |
| cheûtrin. n. m. - Résidu, reste. Autre sens : le tout petit, dernier né. - (42) |
| cheutrin. s. m. Rebut. (Etais). - (10) |
| cheût'te (è) : assieds-toi - (46) |
| cheuv’nire (na) - cheun’vire (na) : chenevière - (57) |
| cheûv’nîs d’vaicanç’es : souvenirs de vacances - (37) |
| cheuv’notte (d’la) : chènevotte - (57) |
| cheuve : chèvre - (44) |
| cheuvenée. s. f. Cheminée. ( Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| cheuv'né : n. f. Cheminée. - (53) |
| cheuv'nette. Chènevotte. - (49) |
| cheuvre (na) - beuque (na) : chèvre - (57) |
| cheuvre, s. f., chèvre. - (14) |
| cheuvre, tseuvre. Chèvre ; support à trois pieds... - (49) |
| cheuvre. Chèvre, et grosse sauterelle. Pour chèvre, nous disons bique et boque ; pour chevreau, chevru et bica, et pour bouc, boquin. - (03) |
| cheuvreu, s. m., chevreuil. - (14) |
| cheuvreu, sm. chevreuil. - (17) |
| cheux nous : chez nous - (61) |
| cheux nous. Chez nous. - (49) |
| cheux, chez. - (05) |
| cheux. prép - Chez : « On est ben mieux cheux nous, à Chauminet, qu’à Paris ! » - (42) |
| cheuz, prép. chez. - (08) |
| chev’nére : chènevière. Lieu où on cultive le chanvre. - (62) |
| cheval, chevalet : s. m., appareil destiné à porter des bottes de fourrage ou autres fardeaux analogues, composé de deux longues perches dont les extrémités inférieures, en contact, sont fixées ensemble, et dont les supérieures sont maintenues écartées en V par une traverse placée un peu au-dessous d'elles. A la hauteur de cette traverse, chacune des perches porte un barreau formant angle droit en avant. C'est dans cet angle qu'on place le faix. On porte le tout sur les épaules en passant la tête entre les perches au-dessous de la traverse. - (20) |
| chevaler : v. n., faire des allées et venues. - (20) |
| chevalière. s. f. Pas-d’Ane, tussilage. (Argenteuil). - (10) |
| chevalœne, s. f. prêle des champs, dont le feuillage ressemble à une queue de cheval. - (24) |
| chevance, tout le bien qu'on a... - (02) |
| chevanton. : Tison (rac. lat. candescere). - (06) |
| chevasse, chavasse : s. f., fane, feuillage des plantes potagères, distinct de la "partie comestible. - (20) |
| chevasse, s. f. partie feuillue d'une betterave, d'une rave. - (24) |
| chevau : Cheval. « O mante bien à chevau », il monte bien à cheval, c'est un bon cavalier. « Y est in ban chevau de trampette » c'est une personne qui n'a pas peur, que rien ne déconcerte. - (19) |
| chevau : s. m., gros cheval de peine. Il a vendu son cheval pour acheter un chevau. - (20) |
| chevau, cheval. - (27) |
| chevau, ch'vau, g'vau, z'vau, s. m. cheval. Nous disons comme le vieux français un chevau, des chevals. - (08) |
| chevau, s. m. cheval : mon chevau est attelé. - (24) |
| chevau, s. m. cheval : mon chevau. - (22) |
| chevau, s. m., cheval : « A c' maitin, j'ai m’né mon ch'vau au marché ». - (14) |
| chevau, sm. cheval. - (17) |
| chevau. Cheval. - (49) |
| chevau. Nos paysans ne disent jamais autrement que un chevau, au lieu de dire un cheval. C'est un des exemples les plus singuliers de l'emploi ou confusion du pluriel pour le singulier... - (02) |
| chevaulée, chevolée. s. f. Voyez chevelée. - (10) |
| chevaux-de-bron*, s. m. pl. chevaux-de-bois. - (22) |
| chevaux-de-bronde, s. m. pl. chevaux-de-bois. - (24) |
| chevayié, s. m. cavalier, dans un mariage. Féminin : chevayière. - (24) |
| chevayié, s. m. cavalier, dans un mariage. Féminin : chevayière - (22) |
| chevelée. s. f. Plant de vigne, chapon qui, avant d’être planté, ayant été mis quelque temps dans l’eau ou dans une jauge de terre fraîche, y a poussé des brindilles de racines ressemblant à des cheveux. Voyez chapon. - (10) |
| chevenale, s. f. plante parasite des champs ; œillette sauvage. Elle produit une huile de médiocre qualité. - (08) |
| chevené, s. m. chenevis, graine du chanvre. « chamené. » - (08) |
| chevenée – cheminée. – I ne pouvons pâ empouachai note chevenée de feumai. - Etends cepui sô lai chevenée pou le fâre soichai. - (18) |
| chevenée : Cheminée. « La chevenée feume (fume) », « In rac'chevenée » : un ramoneur. - (19) |
| chevenée : chènevière (petite parcelle de bonne terre où on cultivait le chanvre). Les paysans ainmont ben leur chévenée : les paysans aiment bien leur chènevière. - (33) |
| chevenière : voir chavenière. - (20) |
| chevenotte (n.f.) : tige de chanvre dépouillée de son écorce - (50) |
| chevenotté : part, pass., se dit du bois vert qui n'ayant pas mûri, est devenu sec et cassant comme des chevenottes. - (20) |
| chevenotte : s. f., métathèse de chenevotte. - (20) |
| chevenotte, s. f. tige de chanvre dépouillée de son écorce. - (08) |
| chevenotte, s. f., tiges de chanvre, servant d'allumette. - (40) |
| chevenottes - chenevottes, ce qui reste de la tige du chanvre quand elle est tillée. - En voiqui des chevenotes ! i ons de quoi ailemai note feu. - (18) |
| cheveriot : chevalet – support en croix pour scier. Ex : "Oublie pas ton cheveriot si té vins pou' m' scier mon bois." - (58) |
| cheverneau. n. m. - Petit champ. (Champignelles, selon M. Jossier) - (42) |
| cheverneau. s. m . Petit champ. (Champignelles). - (10) |
| chevertcheau, chevertiau, cheverquiau. n. m. - Chevreau. - (42) |
| chevertchier, chieuvertier. n. m. - Chevrier. - (42) |
| chevertiau, cheverquiau. s. m. Chevreau. - (10) |
| chevertier (pour chévretier). s. m. Chévrier. - (10) |
| chevestre. : (Du latin caput stringerfi).-« Licol pour avaler (ad vehere) au croct des fourches patibulaires et pour mettre à gehaine (torture) les malfaicteurs. » (Coutumes de Chasteillon, 1317.) - (06) |
| chevet : s. m., partie supérieure d'une chose. Le chevet d'un champ. On remonte, à l'aide de la bachoule, au chevet d'une vigne, la terre que les pluies ont fait glisser à sa partie inférieure. - (20) |
| chevet, s. m. bordure du haut d'un champ, d'une vigne. - (24) |
| chevet. s. m. Tas de terre déposé en tête d’une vigne, et qui forme comme une espèce de traversin. - (10) |
| chevêtre : adj.. capricieux, turbulent, difficile à tenir. Les chèvres sont chevêtres. Un enfant chevêtre. - (20) |
| cheveurtier : joueur de cornemuse. II, p. 20-3 - (23) |
| chévi (v.t.) : venir à bout, achever - (50) |
| chèvi ou chaivi - finir, en venir à bout. - Câ in ovraige difficile ; i ne sai pâ si en chévirai bein. - Quand ce sero le malheur ! côte que côte, en fau qui en chaivissain. - Est-ce que vos en chaivirâ ?... - (18) |
| chévi, v. n. venir à bout, mener à bonne fin, achever, se rendre maitre de… - (08) |
| chévi, venir à bout d'un travail ; i n'an peu pâ chévi, je ne puis en venir à bout. - (16) |
| chevi, vn. [chevir]. Venir à bout. On en serot chevi, on en serait venu à bout. - (17) |
| cheviâs : chevaux ; masculin : i ch'vau. - (32) |
| cheviée, s. f. civière qui sert à transporter le fumier des étables. - (08) |
| cheville : en cheville = au milieu. III, p. 31-s - (23) |
| cheville : voir pressoir. - (20) |
| cheviller, chevelier : v. n., heurter les chevilles l'une contre l'autre en marchant. - (20) |
| chevillière : Large cordon en fil. - (19) |
| chevillière, chevilière : s. f., ruban de fil. (Nouv. Larousse illustré). - (20) |
| chevir : se sortir (ou pas) d'une difficulté ou d'un situation, en finir avec qqch. Tu n'en chevis point !... Ne point « en chevir ». - (56) |
| chévir : venir à bout - (48) |
| chèvir : (chèvi - v. trans. ind.) venir à bout de quelque chose, en finir avec quelque chose. - (45) |
| chevir, v. ; achever ; c'est eun breule-cire ; a ne chourrot en chevir (employé uniquement à l'infinitif). - (07) |
| chevire : Brouette, « Mener une chevire de linge au bé » : conduire une brouette de linge au lavoir. « Y est eune vrâ chevire à roe, o va à meseure qu'an le pousse », c'est un paresseux, il ne travaille qu'autant qu'il est contraint. - « Chevire à brés », civière, instrument pour le transport de la paille, du fumier, etc… Il est formé de deux brancards réunis par des traverses. - (19) |
| chev'lée. n. m. - Plan de vigne ; synonyme de chapon. - (42) |
| chev'née : la cheminée. - (56) |
| chevnére : s. f. chènevière. - (21) |
| chevnotte : s. f. chènevotte. - (21) |
| chevò, s. m. bordure des extrémités d'un champ, d'une vigne. - (22) |
| chevœne, s. m. chanvre. - (22) |
| chevœne, s. m. chanvre. Chœvnire, terre à ou de chanvre, chènevière. - (24) |
| chevolé - celui qui est chargé des chevaux, surtout pour les garder, les conduire aux champs. - I veins de voué vote chevolé ; a ne gairde diére bein ses bêtes. - (18) |
| chevolée ou cnivolée : Plant raciné de toutes boutures. « J'ai plianté ma vigne d'ave des chevollées ». - (19) |
| chevoneau, s. m. filet de pêche. Ce filet par métonymie tire son nom du petit poisson appelé chevanne et aussi, ce semble, cheveneau. - (08) |
| chevòsse, s. f. partie feuillue d'une betterave, d'une rave. On dit aussi ravòsse. - (22) |
| chevrate : Chevalet à l'usage des scieurs de bois. Vrilles des plantes sarmenteuses ou grimpantes et en particulier de la vigne. - (19) |
| chèvre (cheu) : Chèvre, appareil servant à élever des fardeaux. On appelle aussi chevre la chèvre (animal) mais on dit de préférence « cabre ». On nomme aussi chevre la menue paille qui reste dans l'aire après le battage, quand on a enlevé la paille proprement dite. - (19) |
| chèvre (f), robinet. - (26) |
| chévre : robinet de tonneau - (48) |
| chevre : chèvre. - (21) |
| chèvre : s. f. Ramoner la chèvre, ramasser la balouffe de blé en tas avec un rateau fin après le battage au fléau. — Passer à la chèvre, faire passer cette balouffe avec un râteau fin par-dessus une planche disposée en plan Incliné, pour diminuer d'autant la matière à vanner. - (20) |
| chèvre : s. f., chevalet pour scier le. bols. - (20) |
| chèvre : s. f., vrille de la vigne. - (20) |
| chèvre, musette, sauterelle. - (05) |
| chèvre, n.f. trépied pour fendre le bois. - (65) |
| chèvre. Robinet que l’on adapte aux tonneaux. - (12) |
| chèvrecorne (A la) : Ioc. adv., à califourchon sur les épaules. « Je vous porterai à la chèvremorte... » écrit Mistral dans Mes Origines. - (20) |
| chevret : s. m., fromage de chèvre, particulièrement le fromage sec. - (20) |
| chevretié, s. m. joueur de cornemuse, musicien de village. En quelques lieux « cheveurtié. » - (08) |
| chevreton : s. m., petit chevret. - (20) |
| chevrette : s. f., faisceau d'échalas, dont l'une des extrémités repose sur le sol et l'autre sur deux paisseaux fichés en terre et croisés en X. La mise en chevrettes se fait dans les vignes à l'entrée de l'hiver. - (20) |
| chevreu, chevreuil. - (26) |
| chevreu, chevreuil. - (27) |
| chevreu, s. m. chevreuil. - (08) |
| chevreutine : Chevrotine, plomb de fort calibre employé pour chasser le gros gibier. - (19) |
| chèvrin, chèvri, chèvretin. s. m. Chèvre-feuille. (Sommecaise). - (10) |
| chèvrin, chèvri. n. m. - Chèvrefeuille. (Sommecaise, selon M. Jossier) - (42) |
| chevriotte, petite herbe à salade. - (16) |
| chevrœte, s. f. 1. Sauterelle. — 2. Faisceau d'échalas rangés pour l'hiver. - (22) |
| chevrœte, s. f. faisceau d'échalas rangés pour l'hiver ; chevalet léger. - (24) |
| chevrotin, chèvrefeuille. - (05) |
| chevrotte, s. f. moyette de sarrasin ou blé noir. On met le sarrasin en petites « chevrottes » pour le garantir des mauvais effets de la pluie. - (08) |
| chevrottes : moyettes, tiges de sarrasins dressées pour le séchage. - (33) |
| chevru, chevreuil. - (05) |
| chevrule : s. f., mante religieuse (mantis religiosa). Syn. de vigneronne. - (20) |
| ché-ya, cariboyat : n. m. Drôle de chantier. - (53) |
| chéyà, feuillage du haricot, de la pomme de terre. - (16) |
| chèyes, s. f. cosses vides de pois, haricots, colza. - (22) |
| chéyeû, chailleux, filandreux. Les haricots sont dits chéyeû quand leurs cosses sont devenues dures et non mangeables. - (16) |
| chéyo, caillou do silex. - (16) |
| chez : Chez, entre dans la composition du nom d'un assez grand nombre de hameaux et semble indiquer que ce nom n'est autre que celui de nos anciens habitants, chez Patot, chez Meutin. - (19) |
| chez, nom de loc. nous avons dans le nivernais, Morvan compris, cinquante-quatre hameaux, fermes, habitations, désignés par le mot chez, très souvent accompagné d'un nom d'homme : chez Baret, chez Baron, chez Briot, chez Genty. - (08) |
| chez, prép. employée dans les loc. chez nous, chez nos gens = notre maison, nos parents. Chez nos gens ont un bon butin. Chez nos gens ont rendu visite à chez Mignard. - (17) |
| chez. Se dit d'un ménage, d'une famille, d'une maison; le contenu est pris pour le contenant ! - (12) |
| chez. : Ce mot qui n'est partout ailleurs qu'une préposition, tient la place d'un substantif comportant l'idée de tous les hôtes d'une maison. « Ché mosieu ein tei aitein defeur quan j'i fu. - Ché mon peire vo fon bé dé compliman. » - On s'étonnera peu de cette façon de parler quand on saura que la préposition ché, qui s'écrivait ainsi, dérive du substantif latin casa, signifiant la maison ou la chaumière des personnes dont on parle. - (06) |
| chezai, choir... - (02) |
| chezal. : Cheoir (du latin cadere). - (06) |
| chéze : chaise - (39) |
| chezi. Tombai, tomba , tomba. « Ai Chezi », il tomba ou chût… - (01) |
| ch'fô, ch'vo : n. m. Cheval, chevaux. - (53) |
| chgne, chaigne, chêne, arbre. - (05) |
| chi - six. Voyez Chisse. - (18) |
| chi (conj., adv.) : si - paur chi, paur ichi = par ici - (50) |
| chi , si. - (04) |
| chi ou chis : Six, « Tra peû tra fiant chi », trois et trois font six. « O s'est levé à chis heures » (prononcez chiz eures) - (19) |
| chi, adv. si, tellement, autant que… - (08) |
| chi, chiz' : adj. num. card. Six. - (53) |
| chi, prép. chez. - (22) |
| chiâ (on) : orgelet - (57) |
| chiagne, s.m. chien. - (38) |
| chiainte : bande de terre à chaque extrémité de la parcelle qui permet de manœuvrer avec le tracteur. - (59) |
| chiairaigne, s. f. charogne, carcasse d'un animal mort. Se dit en parlant d'un mauvais chien et quelquefois des personnes comme terme injurieux. - (08) |
| chiaissaule, s. m. fouet, courroie, lanière. - (08) |
| chiaisse, s. f. chasse : « i va ai lai chiaisse », je vais à la chasse. - (08) |
| chiaisser, v. a. chasser, aller à la chasse. - (08) |
| chiaissot (n.m.) : petit sac en toile - (50) |
| chiaissot : petit sac, sachet - (48) |
| chiaissot, s. m. petit sac en toile ou en peau. - (08) |
| chiaissou, s. m. chasseur, celui qui va à la chasse. - (08) |
| chiâler : pleurer - (48) |
| chiâner (chiâler, chionner) : pleurer - (39) |
| chianleizai (se), courir les rues et les bals avec un costume et un masque pendant les jours gras... - (02) |
| chianleizai. : Courir les rues et les bals avec un costume et un masque pendant les jours gras. - (06) |
| chianner, v. n. pleurnicher, pleurer à tout propos, sans motif. On prononce « chian-ner. » - (08) |
| chiânou (chiâlou, chionnou) : se dit de quelqu'un qui pleure - (39) |
| chianton. s. m. Charançon. (Étais). - (10) |
| chiaper : jeter du mortier, cogner, envoyer brutalement - (43) |
| chiapon : éclat de bois en taillant des piquets - (43) |
| chiappée : fessée. - (30) |
| chiapper : remuer de l'eau quand on lave du linge avec un battoir. - (30) |
| chiar (adj.) : clair - (50) |
| chiâr : n. m. Char. - (53) |
| chiarbauder, v. a. agacer, lutiner. - (24) |
| chiasse (na) - fouire (na) - fouiron (on) - droille (na) : diarrhée - (57) |
| chiassi, râchi : sarcler - (43) |
| chiassou : quelqu'un qui a la diarrhée, la chiasse - (46) |
| chiatseure : feu à l'extérieur - (43) |
| chiattes : Lieux d'aisance. - (19) |
| chiau, chiou. s. m. Petit chien. - (10) |
| chiau, s. m. seau pour puiser de l'eau. - (08) |
| chiauler, chiouler. v. n. Piailler, pleurnicher. (Vallery). - (10) |
| chiauler, chouiner : pleurer. - (09) |
| chiautsson : souche - (43) |
| chibeurli : danse - (39) |
| chibeurli, chibeurla, s.m. ancienne danse bourguignonne. - (38) |
| chicanou : Chicaneur, procédurier. « I ne fa pas ben à avoi affâre es chicanous ». Etym. vieux français; chicanou. - (19) |
| chicanoû : chicanier - (48) |
| chicanou : personne qui cherche la chicane - (39) |
| chicanou, adj., chicaneur, chicanier. - (14) |
| chicanou, ouse, s. et adj. chicaneur, celui qui chicane. - (08) |
| chicard. adj. Fin, beau, recherché. — Chicocandard semble être comme une sorte de superlatif de chicard. — Dérivé de Chic. - (10) |
| chicatouèe, chirouée. s. f. Lieux d'aisances. (Charentenay, Diges). - (10) |
| chiccli. Fit jaillir. Ces petites canonières ou seringues de bois, dont se servent les enfants pour jeter quelque liqueur que ce soit, s’appellent en bourguignon « chiccle », du bruit qu’elIes font lorsque cette liqueur est poussée. De là l’infinitif « chicclai » pour faire jaillir et le nom « chicclo » pour jet. - (01) |
| chic'eut : Chicot, « O s'est fait arrégi (arracher) eune dent à peu in chic'eut ». - (19) |
| chiche ! Exclamation. C’est un terme de défi par lequel on provoque, on excite quelqu’un à faire une chose, le plus souvent repréhensible. Ainsi, dites à un jeune garçon porteur d’un panier d’œufs : Chiche d'œufs! Si c’est un écervelé, il prendra ses œufs et vous les lancera par la figure. Il en est d’autres plus écervelés encore, qui font, en quelque sorte, la provocation eux-mêmes ; un ivrogne un peu surexcité vous criera, par exemple : Dis-moi chiche ! et i’te fich’ la bouteill’ pa l’bê. - (10) |
| chiche se dit pour sèche (du latin sicca), dans poire chiche. - (16) |
| chiche. : (Dial et pat.), avare. - (06) |
| chichin' : n. f. Viande. - (53) |
| chichine : s. f., viande. Veux-tu manger de la chichine ? - (20) |
| chichine, s. f. mauvaise viande, chair de rebut. - (08) |
| chichine. Viande médiocre, viande quelconque, viande. - (12) |
| chichmin : un orgelet - (46) |
| chiclai et jiclai, faire jaillir... Les enfants, après avoir chassé la moelle des branches de sureau à l'aide d'un manche, s'en servent ensuite comme d'une pompe qu'ils appellent chicle, et nomment chicclo le jet qu'ils produisent. Dans le Berry on dit zigler. - (02) |
| chicleu : morceau de charbonnette. - (66) |
| chico - hoquet. - I ai le chico depeu ce maitin ; ma c'â que ci fatigue bein. - Pour guéri le chico beuvez in baissin d'aie froide. - (18) |
| chico : hoquet. - (29) |
| chicorée : fillette malicieuse. Remplace quelquefois le prénom. Plutôt affectueux. Ex : "Eh chicorée ! Vins don vé moué". - (58) |
| chicot (le) : hoquet - (57) |
| chicot : dent cassée - (44) |
| chicot : dent cassée - (48) |
| chicot : hoquet - (48) |
| chicot : (chico - subst. m.) hoquet (sens désuet) - (45) |
| chicot, chicoter, hoquet, avoir le hoquet. - (05) |
| chicot, s. m. hoquet. - (24) |
| chicot, s. m. hoquet. « avoir le chicot », avoir le hoquet. - (08) |
| chicot. Sanglot. - (49) |
| chicoter (v. tr.) : taquiner, agacer (syn. chig-niller) - (64) |
| chicoter (v. tr.) : tripoter, toucher sans cesse (syn. chapoter) - (64) |
| chicoter : hoqueter - (57) |
| chicoter, chicouter. v. a. Déchiqueter. - (10) |
| chicoter. Sangloter. - (49) |
| chicoter. v. - Attiser le feu : chicoter les braisons. Dans chicoter la braise, on trouve l'idée de couper en petits morceaux, en chicots. Depuis la Renaissance, un chicot (mot formé sur le radical onomatopéique tchi exprimant la petitesse) désigne le reste d'une branche ou d'un tronc coupé, ou le reste d'une dent. Le français a gardé le nom chicot, et le poyaudin le verbe chicoter en l'appliquant au feu : remuer les braises pour les séparer, les réduire en les dissociant. (Arquian) - (42) |
| chicotin : pissenlit - (48) |
| chicotin : pissenlit. « Amer comme chicotin ». - (56) |
| chicotouée. n. f. - Sucette. (Arquian) - (42) |
| chicousée. s. f. Chicorée. (Fléys). - (10) |
| chicracra. s. m. Oiseau qüi prononce à peu près ces trois syllabes et qu’on suppose être la fauvette des roseaux. (Saint-Florentin). - (10) |
| chicrille, s. f., pissenlit. - (40) |
| chicrotte, chacrotte. n. f. - Pomme ou poire trop petite pour être ramassée. - (42) |
| chicrottes. n. f. pl. - Petits gâteaux, bonbons, amuse-gueule. (Arquian) - (42) |
| chidrille, s. f. avorton, terme de dénigrement qui s'applique plutôt aux filles qu'aux garçons. - (08) |
| chie - chier. - C'a demaige que les vaiches chiaint queman cequi le long des rues ; çâ don sâle !... - En parlant des gens il est grossier d'employer ce mot on dit : Fâre se besoins,… Ailai diôre,… etc. - (18) |
| chie : Chier, « Chie ne chie pas te payeras la madecine », s'emploie pour dire qu'à la table d'hôte, que vous mangiez peu ou beaucoup c'est le même prix. - (19) |
| chié : clé - (43) |
| chie : scie - (39) |
| chïe, s. f. scie, instrument pour scier le bois. - (08) |
| chie, scie : scie - (48) |
| chiée : n. f. Multitude. - (53) |
| chiée. Grande quantité ; terme bas, grossier. Contrarier, se moquer. - (49) |
| chieindre, s. m. chanvre, plante qui porte le chenevis. « cindre, cinde. » - (08) |
| chien fou, loc. chien enragé. - (08) |
| chien mairin - exclamation de mécontentement de surprise en général. - Chien mairin ! les poules an tot aibimai lai plianche de salade. - Chien mairin ! que t'è don jolie mon enfant ! - (18) |
| chien : voir pressoir. - (20) |
| chiendre : (chyin:dr' - subst. m.) chanvre. La culture en a cessé au début du XXème siècle. - (45) |
| chiendre, n. masc. ; chanvre. - (07) |
| chien-fou (nom masculin) : enfant insupportable. - (47) |
| chiennasser : pleuvoir menu, brouillasser. Ex : "Déd'pis c'matin, ça chiennasse !" - (58) |
| chiennis. n. m. - Chenil. (Villeneuve-les-Genêts, selon M. Jossier) - (42) |
| chiennis. s. m. Chenil. (Vill.-les-Genêts). - (10) |
| chiens de feu, s.m. chenets. - (38) |
| chiens. s. m. pl. Synonyme de cagnats. Tous les jours, on entend des gens dire : J'ai les chiens. - (10) |
| chienvert. s. m. Chiendent. (Argenteuil). - (10) |
| chièr : char. (RDT. T III) - B - (25) |
| chier : (chyé - v. intr.) 1- déféquer. 2- fig. se déstabiliser, se déséquilibrer, en parlant d'une grosse charge mal arrimée qui glisse sur sa base. - (45) |
| chiêr : (chyê:r - subst. m.) chariot, char à foin. - (45) |
| chier. v. - Tomber, glisser : « Serge i' vient d' die qu'la r'morque alle a chié pa' l' ch'min d'Druyes ! » (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| chiére, ciére, s. f. chèvre. - (08) |
| chiesse : chasse - (48) |
| chiesser : (chyèssé - v. trans.) chasser, aller à la chasse. - (45) |
| chiessot : petit sac, sachet - (48) |
| chiessot : (chyèsso - subst. m.) petit sac, sachet. - (45) |
| chiessot. Gibecière, sac.... - (13) |
| chiessoû : chasseur - (48) |
| chieube : sifflet - (43) |
| chieubi, seub-yi : siffler - (43) |
| chieure, chèvre, chière, cière. - (04) |
| chieures : cendres - (43) |
| chieurrant : indiscret - (43) |
| chieurtire : cendrier sous la fenêtre - (43) |
| chieuve (n. f.) : chèvre – sorte de chevalet sur lequel on scie le bois - (64) |
| chieuve : chèvre (animal) - (48) |
| chieuve : chèvre (outil de levage utilisé en particulier pour enlever les roues de chariot) - (48) |
| chieuve : chèvre. - (59) |
| chieuve : voir chvau - (23) |
| chieuve : n. f. Chèvre. - (53) |
| chieuve, subst. féminin : chèvre. - (54) |
| chieuve. n. f. - Chèvre. Autre sens : sorte de trépied en bois, utilisé par le bûcheron pour couper les charbounnettes, les petites branches. - (42) |
| chieuverquiau. s. m. Chevreau qui vient de naître ; sans doute pour chevrottiau, chevrotteau. - (10) |
| chieuvre (n.f.) : chèvre - aussi bigue, bique - (50) |
| chieuvre : chèvre. Il, p. 29-3 - (23) |
| chieuz, chez, cheux. - (04) |
| chièvre, chieuvre. s. f. Chèvre. A Sens, il existe sur le chemin dit la Rue-de-la-Chièvre une légende qu’on peut lire dans l’Almanach Tarbé de 1832-33 ou 34. - (10) |
| chiffonné, inquiet, mécontent. Dans l'idiome breton, chéfuz signifie triste , mélancolique, et chéfa veut dire attrister... - (02) |
| chiffre : L'arithmétique, le calcul. « O cougnait la chiffre », c'est un bon calculateur. - (19) |
| chiffre : s. f., toute espèce de calculs. - (20) |
| chifon, chifoneau, chifonète, noms familiers et d'amitié donnés à une petite fille. - (14) |
| chifon, s. m. se dit amicalement d'une petite fille dans le langage des villes voisines. - (08) |
| chifon, s. m., morceau : « J'ai opetit ; baille-me eun bon chifon de pain ». - (14) |
| chifouner, v. a. importuner, tourmenter, tracasser. - (08) |
| chifre (la), s. f., l'arithmétique : « Mon p'tiot va déjà à l'école ; ôl éprend la chifre ». - (14) |
| chifre, opération quelconque de calcul ; j'è fini mai chifre. - (16) |
| chiga (n. m.) : chevreau (syn. bigou, cabin) - (64) |
| chignarde. s. f. Viande dure et de mauvaise qualité. (Auxerre). - (10) |
| chigne (faire la), loc. faire la moue, rechigner. - (24) |
| chigne (fare la), loc. faire la moue, rechigner. - (22) |
| chigne. s. f. Echine. - (10) |
| chigner. v. n. Montrer les dents avec colère. - (10) |
| chig-niller (v. tr.) : taquiner, agacer (syn. chicoter) - (64) |
| chignole : manivelle - (48) |
| chignole : Manivelle, « Torner la chignole, croquer le marmot ». Celui qui tourne la chignole joue le rôle de Fortunio dans le Chandelier d'Alfred de Musset. - (19) |
| chignôle, s.f. vielle, manivelle. - (38) |
| chignon, chiffon. s. m. Gros morceau de pain. (Guy). - (10) |
| chignon, en roman des Trouvères, quignon, lopin, morceau de pain ou de viande. Nos paysans disent un chignon de pain... - (02) |
| chignoter : v. a., faire le chignon. Se chignoter, se coiffer. - (20) |
| chigot, chigout. s. m. Chevreau. — Chevalet, bique à l’usage des scieurs de bois. - (10) |
| chigros, m. fil ciré de cordonnier ou de bourrelier. - (24) |
| chikè, manger fortement. - (16) |
| chiler (v.t.) : scier - (50) |
| chiler : bruit de l'huile qui grésille dans une poële - (61) |
| chiler : être pingre - (60) |
| chîler : scier - (48) |
| chîler : scier - (39) |
| chiler, v. a. scier, se servir de la scie. - (08) |
| chileu, euse. s. m. et f. egoïste, avare ou avide, qui ne songe qu'à ses intérêts, qui en toute affaire, tire à soi la couverture. - (08) |
| chilot, s. m., scie. Le Glossaire du Morvan donne chiler, scier, p. 181. - (11) |
| chimailler, se chamailler. - (27) |
| chimbi : sembler - (51) |
| chimbyi : (vb) sembler - (35) |
| chimbyi : sembler - (43) |
| chimbyi v. Sembler, ressembler. Qui qu'y chimbye ! A quoî cela ressemble, qu'est-ce que cela signifie. I’m chimbyot bin. Il me semblait bien. - (63) |
| chime, diminutif de simon. - (08) |
| chîmer. v. - Pleurnicher sans faire de bruit. - (42) |
| chimer. v. n . Pleurnicher. (Saint-Privé). — Se trouve aussi dans Jaubert. - (10) |
| chîmeux. n. m. - Celui qui chîme. - (42) |
| chimicoux, chimicouse : s. m. et f., fabricant d'allumettes chimiques. - (20) |
| chin : Chien, au féminin cheune. « In ban chin de chaiche » : un bon chien de chasse. - Proverbes : « Les chins ne fiant pas des chats », variante de tel père tel fils. - (19) |
| chin : s. m. chien et part. : pièces de bois employées dans les pressoirs. - (21) |
| chin, chenne, chien, chienne. - (05) |
| chin, s. m. chien. - (22) |
| chin, s. m. chien. Féminin chœne. - (24) |
| chin, s. m., chien, au fig., avare : « Chin d' matin ! » est un juron familier à nos paysans. - (14) |
| chinade, s. f. prise de tabac, terme burlesque. - (08) |
| chinchelotée, petite quantité - (36) |
| chinchelotte, chinchenotte, chichenotte, chinchée, chicrotte. n. f. - Petite quantité, petite goutte. « Queq' foué eune chinchenotte de goutte, un coup d'rapé qui n'a pas d'iau. » (Fernand Clas, p.88). Ces mots sont dérivés de chiche par ajout d'un suffixe diminutif.; l'adjectif.chiche, employé au XIIe siècle, signifiait avare, parcimonieux ; la chincheté était alors l' avarice. - (42) |
| chinchenotte. s. f. Petite quantité. — Boire une chinchenotte, boire la goutte, boire un petit coup d’eau-de-vie. Jaubert donne chinchin dans le même sens. - (10) |
| chinde. s. m. Chanvre. - (10) |
| chine : s. f. Passer à la chine, chiner quelqu'un. - (20) |
| chiner : v. a., taquiner quelqu'un, le plaisanter. - (20) |
| chiner. Vendre sa marchandise dans la rue, de porte à porte en appelant les ménagères ; manquer sa classe. - (49) |
| chineur : s. m., qui chine. - (20) |
| chineur. Moqueur, railleur. (Argot). - (49) |
| chineur. s. m. Qui voyage beaucoup. (Vertilly). - (10) |
| chingi : changer - (57) |
| chingi : modifier - (57) |
| chingue, chêne. - (26) |
| chinguie. s. f. Chanvre. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| chin'nè : couvert de fruits - (48) |
| chin-ne ed poué, s. f., chaîne de puits. - (40) |
| chinouaîs (on) : chinois - (57) |
| chinouaîserie : chinoiserie - (57) |
| chinre, chaise. - (26) |
| chîns (les) : lie (dépôt) - (57) |
| chint (y) : (vb) ça pue - (35) |
| chint (y) : ça sent - (43) |
| chint-bon n.m. Parfum, eau de toilette. - (63) |
| chintre : sentir. A - B - (41) |
| chintre (n.f.) : espace de terre au bout du champ où l'on retourne la charrue - (50) |
| chintre : bande de terrain où l'on retourne la charrue à chaque extrémité du champ. - (21) |
| chintre : l'extrémité du champ, ou son contour, difficile à labourer - (46) |
| chintre : sentir - (34) |
| chintre v. Sentir. - (63) |
| chintre, chieintre, cintre, cinte, s. f. chaintre, nom de loc. qui s'applique à un grand nombre de pièces de terre, closes ou non, dans les domaines ruraux. - (08) |
| chintre, sintre : sentir - (43) |
| chintre. Contour de champ, du latin cinctura. C'est le nom de plusieurs Lieux-dits des environs de Beaune. - (13) |
| chintu p.p. de chintre 1. Senti. 2. Dans le sens d'entendre : Te vlà, dz't'ai pas chintu vni. - (63) |
| chinze, chose. - (26) |
| chiotse : cloche - (43) |
| chiotsi : clocher - (43) |
| chiotte. s. f. Chouette. - (10) |
| chiottrie : une bricole - (46) |
| chiou : clou - (43) |
| chiou d'héroi, n. masc. ; fabricant d'huile. - (07) |
| chioude, sale , dégouttant... - (02) |
| chioude. : Sale, dégoûtant. - (06) |
| chioue. s. f. Petite fille coureuse, mal élevée, petite chienne . (Michery, Viilechétive). - (10) |
| chiouler, chiouner. v. n. Pleurer bêtement, pleurnicher. - (10) |
| chioux : s. m., chieur ; avare. - (20) |
| chipai, dérober subtilement. En Irlandais, kippa signifie dérober. - (02) |
| chipé, dérober. - (16) |
| chiper, choper. v. a . Prendre de menus objets, les attraper subtilement, les voler avec adresse. De l’Islandais kippa, voler, dérober. - (10) |
| chipie, s. f. une chipie en Morvan n'est pas comme à paris une personne dédaigneuse, une bégueule ; c'est une femme sans franchise, sournoise. - (08) |
| chipotai, disputer minutieusement sur le prix d'une chose. Ce mot peut bien être originaire du Languedocien. - (02) |
| chipotai. : Taquiner quelqu'un, être minutieux, vétilleux, marchandeur. - Signifie aussi manger avec dégoût et du bout des dents. - (06) |
| chipote, s. f. Petit paquet, poignée, petite botte. Une chipote d’ails, d’oignons, d’échalottes, de pieds de haricots. - (10) |
| chipote, s. f., chicane, subtilité, procès. - (14) |
| chipoté, s'chipoté, être en contestation avec quelqu'un pour peu de chose. - (16) |
| chipôte. Chicane. « Faut-i qu'on vo chipôte ? » Faut-il qu'on vous chicane?.. - (01) |
| chipoter (se), verbe pronominal : se chamailler. - (54) |
| chipoter (se). Se quereller ; se taquiner. - (49) |
| chipoter : manger du bout des dents. - (66) |
| chipoter, v. a. disputer pour rien, marchander à tort et à travers, s'occuper de bagatelles. - (08) |
| chipoter, v. tr., chicaner, marchander, tirailler, asticoter : « Y ét eun tire-yards ; ô chipote su tout. » - (14) |
| chipoter. v. a. Trouver à redire à tout, quereller à propos de rien. - (10) |
| chipotié, s. m. celui qui chipote, qui marchande minutieusement. - (08) |
| chipotier. s. m. Celui qui chipote, qui trouve à redire à tout. - (10) |
| chipotou, s. et adj., chipotier. - (14) |
| chipouta, chicaner. Le vieux français a étendu le sens de ce mot ; car, d'après Lacombe, il signifie encore manger avec délicatesse ou dédain. - (02) |
| chipoute. n. f. - Grande quantité de fruits sur une branche. - (42) |
| chipoute. s. f. Bouquet de fruits tenant à la branche. (Merry-la-Vallée). — Voyez chipote. - (10) |
| chiquailer : v. n., bicquailler. - (20) |
| chique - gros morceau de pain, de viande. - I liô z-ai beillé ai chécun ine grosse chique de pain pou lô quaitre heures. - (18) |
| chique de pèn, gros morceau de pain. - (16) |
| chique et chuque, s. f., bille à jouer. - (14) |
| chiqué, manger de la chair. Dans l'idiome breton, kîk ou kîg signifie viande, chair. (Le Gon.) Ce n'est que par une extension abusive qu'on a pu dire, à une époque plus moderne, chiquer du tabac. - (02) |
| chique, s. f., quignon, gros morceau de pain ou de viande : « Ol avot faim ; j' te li ai baillé eùne chique !... » - (14) |
| chique. Ce mot, pour signifier mine, est tout à fait bourguignon. Le chique d'une chose (style d'artiste), c'est la véritable manière de faire ou de présenter cette chose. Dans l'idiome breton, chik signifie menton. (Le Gon.) ... - (02) |
| chiquelöt, chicnöt, sm. petit morceau de pain, de bois, de pierre, etc. - (17) |
| chiqueloter : découper en petits morceaux. - (66) |
| chiquenaude : étincelle - (48) |
| chiquer, manger de grand appétit. - (05) |
| chiquer, v. intr., jouer aus billes, lancer la bille, mais plutôt être malheureus à ce jeu, et, par extension, à tout autre. - (14) |
| chirais, s. m. se dit d'un enfant qui a souvent la diarrhée et qui est malpropre. - (08) |
| chirater : Traîner les pieds, « Ne chirate dan pas c'ment cen ». - (19) |
| chirater v. Scier à la main. - (63) |
| chiraule : Glissade - (19) |
| chire, s. f. chaise. - (22) |
| chire, s. f. chaise. Chire-à-sau. Chaise à couvercle dans laquelle on conservait autrefois le sel. - (24) |
| chiri : Glisser. « Ma chaire (chaise) a chiri su le parquet, j'ai manqué de cheut. Y chire bravement c'tu métin ». - (19) |
| chirias, petits ruisseaux qui se forment à la sortie de l'hiver après la fonte des neiges ou de fortes pluies et qui coulent en cascades sur la pente de la colline. - (27) |
| chirlicouée : grand nombre, grande quantité - (48) |
| chiroué. n. m. - Toilettes. Altération du mot chiouere (pour en faciliter sa prononciation quotidienne...), ce mot est directement issu de l'ancien français ; au XIIIe siècle, chiouere signifie latrine, et chier faire ses besoins, par dérivation du latin cacare. Une curieuse évolution de ce mot le fait glisser, en français des années 2000, vers le sens de réussi, incroyable : « C'était vraiment une chiée soirée ! » - (42) |
| chisse : six - (48) |
| chisse ou chi - six. - I ai demandai des œus, en m'en é envie chisse. - D'iqui ai Beaune en é cin ou chi lieues. - En i é chise hommes et chi fonnes, (selon que c'est devant une consonne ou une voyelle.) - (18) |
| chisse : six - (39) |
| chisse, adj. num. six. - (08) |
| chitau : siège. - (52) |
| chite : cidre. Aveuque des poumes on féto du chite : avec des pommes on fait du cidre. - (33) |
| chité, s. f. cité, ville. - (08) |
| chiter (se) (v.pr.) : s'asseoir - (50) |
| chiter (se) v. (lat. pop. sitare, mettre en place). S'asseoir. On dit aussi s'achiter. - (63) |
| chiter, v. a. asseoir, « chité l'p'tiô », asseyez l'enfant - (08) |
| chitôt (adv.) : aussitôt - (50) |
| chitot (nom masculin) : voir cheutrot. - (47) |
| chitot : siège - (39) |
| chitouère (nom féminin) : siège rustique. - (47) |
| chitre (n.m.) : boisson aux fruits sauvages (pommes, poires) - (50) |
| chitre : cidre - (48) |
| chitre : cidre. - (52) |
| chitré : lit - (48) |
| chitre : (chitr' - subst. m.) cidre. - (45) |
| chitre : cidre - (39) |
| chitre, s. m. cidre, boisson fabriquée avec les fruits sauvages du pays et principalement les « blossons. » le c doux = ch donne « citre » au Morvan et à quelques autres patois. - (08) |
| chître, v. a. asseoir, faire asseoir. Une mère disait de son enfant malade : « al ô chu vaigne qu'î n'peu ne l'vitre ne l'chître » ; il est si faible que je ne puis ni le vêtir ni l'asseoir. - (08) |
| chitrer : déborder, fuir (sous l'effet de la pression) - (48) |
| chitrer : laisser échapper un liquide - (48) |
| chitrer : (chitrè - v. intr.) gicler avec bruit. en parlant de quelque chose de juteux qu'on presse ou qu'on écrase ; se dit, par exemple, d'un abcès qu'on crève, d'une limace qu'on écrase violemment... - (45) |
| chitrer : couler, suinter - (39) |
| chitrer, v. a. couler. Se dit en parlant du coulage des liquides. - (08) |
| chitrouille. n. f. - Citrouille. - (42) |
| chitte (deu) : (du) cidre - (37) |
| chitu (-e) : participe passé du verbe asseoir (assis) (-e) - (50) |
| chitu, part, passé du verbe chitre. assis : « a s’ô chitu » ; il s'est assis. - (08) |
| chivaulé : certaine façon de planter la vigne (en plants et non en rejets). - (21) |
| chivolée, s. f., ensemble des chapons dans une pépinière. - (40) |
| chivouler, échivouler, v. se dit d'une plante qui pousse en tous sens de longues branches ; "chivouler", c'est aussi reprendre par la racine ; se dit des plantes qui se reproduisent par la racine ; on dit aussi cette plante "chivole" de tous côtés. - (38) |
| chivouler, v. marcotter. - (65) |
| chivoulue. s. f. Synonyme de chevelée. - (10) |
| chix (adj.num.) : six - (50) |
| chizas, s. m. ciseaux des couturières. - (08) |
| chizième : Sixième, « Ol a sarvi dans le chizième dragan » : il a fait son service dans le sixième régiment de dragons. - (19) |
| chlam, schlam : n. f. Boue, résultat du lavage du charbon. - (53) |
| ch'le, ch'lu : chez eux, chez lui - (46) |
| chlieue : s . f. cendres. - (21) |
| chligne, chenille. - (16) |
| chlingne, chenille. - (26) |
| chlingne, sf. chenille. - (17) |
| chlinguer. v. n. Sentir un mauvais goût. (Sens). - (10) |
| chlliacbourné, v. a. agacer, lutiner. - (22) |
| chlliâche, adj. se dit d'un tissu peu serré, à larges mailles. - (22) |
| chlliâche, adj. se dit d'un tissu peu serré, à larges mailles. - (24) |
| chllian (en), loc. à côté. - (22) |
| chllian (en), loc. à côté. - (24) |
| chllianche, s. f. long crochet de bois pour tirer l'eau d'un puits. - (24) |
| chlliape, s. f. jarret maigre et long. Diminutif chlliapon. - (24) |
| chlliape, s. f. jarret maigre et long. Diminutif : chlliapon. - (22) |
| chlliapoter, v. n. piétiner dans l'eau avec clapotement. - (24) |
| chlliapouté, v. n. piétiner dans l'eau avec clapotement. - (22) |
| chlliàye, s. f. portillon de branchages, claie. Diminutif : chlliàyot. - (22) |
| chllié, 1. s. f. clef. — 2. adj. clair. - (22) |
| chllié, n. s. f. 1. clef. — 2. adj. clair. - (24) |
| chlli-einche, s. f. long crochet de bois pour puiser l'eau. - (22) |
| chlli-einmeusse, s. f. gâteau spécial à la fête patronale de Clessé. Diminutif : chlli-einmeusson. - (22) |
| chlliémeusse, s. f. gâteau de brioche. Diminutif chlliémeusson. - (24) |
| chllieuche, s.f. mère poule conduisant ses poussins. - (24) |
| chllieune, s. f. enveloppe d'oreiller. - (22) |
| chllieunœt (fare la), loc. cligner de l'œil sous l'effet d'une lumière vive. - (22) |
| chllieure*, s. f. vrille à percer les fûts. - (22) |
| chllieure, s. f. vrille à percer les fûts. - (24) |
| chllieuri, s. m. caisse, coffre à déposer les cendres ou « chllious ». - (22) |
| chllieuste, s. f. poule conduisant ses poussins. - (22) |
| chllièye, s. f. portillon de branchages, claie. Diminutif chllièyau. - (24) |
| chlliòche, s. f. cloche. Chlliòchi, clocher. - (24) |
| chlliòqueter, v. n. glousser (poule appelant ses poussins). - (24) |
| chlliòrti, s. m. caisse, coffre à déposer les cendres. - (24) |
| chlliôs, s. f. pl. cendres. - (24) |
| chlliote, s. f. écheveau. - (24) |
| chlliou, s. m. clou. Verbe : chllioulé. - (22) |
| chlliouche, s. f. cloche. Chlliouchi, clocher. - (22) |
| chlliouqué, v. n. 1. Se dit d'un bruit sourd analogue à celui produit par une vessie pleine qui crève. — 2. Pour une poule, appeler ses poussins. - (22) |
| chllious, s. f. pl. cendres. - (22) |
| ch'loff : Employé dans l'expression « aller à ch'loff», aller au lit, aller se coucher ; allemand, schlaffen (dormir) - (19) |
| chloffe (aller), loc, aller se coucher. Un des restes des premières invasions. - (14) |
| ch'magne, s.m. chemin. - (38) |
| chmentîre n.m. Cimetière. - (63) |
| ch'mi : chemin - (48) |
| ch'mi : n. m. Chemin. - (53) |
| ch'mi, s. f., chemise. - (40) |
| ch'mie : n. f. Chemise. - (53) |
| ch'mie, s.f. chemise. - (38) |
| ch'mie. n. f. - Chemise. - (42) |
| ch'mino : n. m. Cheminot, employé des Chemin de Fer. - (53) |
| chminse, sf. chemise. Voir pan, cul-paniche. - (17) |
| ch'min-talons - ch'min à talons (on) : sentier - (57) |
| ch'minze, chemise. - (26) |
| ch'mise (na) : chemise - (57) |
| ch'mise : chemise - (48) |
| ch'mise drolée : blouse bleue que portaient les paysans. - (21) |
| chmo : s. m. ruban rouge dont on entourait la quenouille. - (21) |
| ch'naipan, s. m. chenapan, vaurien, maraudeur. - (08) |
| ch'nau : chéneau - (48) |
| ch'nau : chéneau - (39) |
| ch'neau : chéneau - (43) |
| chnékyo : laiteron. (S. T IV) - B - (25) |
| ch'ner, v. a. châtrer, opérer la castration. Se dit principalement en parlant des truies - (08) |
| chnève : s. m. chanvre. - (21) |
| chni : boulette de poussière par extension vieillerie - (51) |
| ch'ni : chenil - (48) |
| ch'ni : grain de poussière, balayure,petite saleté - (48) |
| ch'ni : mot masculin désignant une poussière, une balayure - prend lè pôle pou ramassé les ch'nis, prends la pelle pour ramasser les saletés - è lai un ch'ni dans l'eûil, il a une poussière dans l' oeil - (46) |
| chni n.m. Chassie, balayure. - (63) |
| ch'ni : n. f. Poussière. - (53) |
| ch'ni, subst. masculin : poussière, balayure. - (54) |
| chni, grain de poussière ; se dit aussi des balayures. - (16) |
| ch'ni. Poussière : « avoir un ch'ni dans le zieu ». - (49) |
| ch'nillou : un végétal couvert de chenilles - (46) |
| ch'nillou, adj., malingre, frêle. - (40) |
| ch'nis (des) : balayures - (57) |
| ch'nis : les moutons, les minons de poussière qu'on trouve sous les meubles. - (66) |
| ch'nis, s. m., poussière. - (40) |
| ch'nobote : n. f. Bottes de neige - tiré du mot anglais "snow boot". - (53) |
| chnobotte n.f Bottine cirée se fermant avec des pressions sur le côté externe de la cheville. Snow-botte. - (63) |
| ch'nous : chez nous - (46) |
| chnôve, chnôvre, chanvre. - (16) |
| ch'nôvre, s.m, chanvre. - (38) |
| ch'noyé : v. i. Somnoler. - (53) |
| ch'nu, mince, tout petit, maigrelet. - (16) |
| chô : fléau (en B : ecossou). A - (41) |
| cho : cabane à lapins ou à cochons. (B. T IV) - S&L - (25) |
| chô : Chou : « Des chôs cabus ». Chô-gras (rumex attriplex) : plante qui croît dans les prés et qu'on désigne également, en patois sous le nom de « rointe ». - (19) |
| cho : chou. - (32) |
| chô : n. m. Choux. - (53) |
| cho : s. f. cep de vigne. - (21) |
| cho : s. f. étable des porcs. - (21) |
| chô : si, mais si - (39) |
| chô, chiô, partic. d'affirmation usitée dans le Morvan bourguignon. Oui. On prononce souvent «aichô » comme dans le « aissiô » - (08) |
| chô, v, n. tomber, choir. Chô bas, tomber à terre. - (22) |
| chô, vn. choir, tomber. Voir chéé. - (17) |
| choche, sèche. - (26) |
| chocolât : n. m. Chocolat - (53) |
| chôdée : une chaudière - (46) |
| chôdëre, chaudière. - (16) |
| chodo, çhodote, quelque peu, suffisamment chaud. - (16) |
| chodotes, adj., chaudes. Qualification des châtaignes cuites, que le marchand crie : « Toutes chàdôtes ! toutes frigolotes ! (V. Frigolotes). - (14) |
| chodre : Soulever, « Y est treu lourd, je peux pas y chodre. Pa bin chodre in râ (une benne de raisins) su san épaule i faut déjà êt feu (il faut avoir une assez grande force) ». - (19) |
| chòdre, v. a. soulever : chòdre une lourde pierre (du latin surgere). - (24) |
| chœvenée, s. f. cheminée. - (24) |
| chœvnée, s. f. cheminée. - (22) |
| chœvnot, s. m. chènevotte ; toute brindille. - (24) |
| chœvnou, s. f. chènevotte. - (22) |
| chœvre, s. f. 1. chèvre. 2. débris de battage contenant encore des épis. - (24) |
| chœvre-corne (à la), loc. manière de porter un enfant en le plaçant à cheval sur ses épaules. - (24) |
| chofloter, boire plus que de raison. - (27) |
| chogi, vt. choisir. - (17) |
| chogne (d'la) : merde - (57) |
| chogne : crottin. De cheval, de mulet ou d’âne. - (62) |
| chogne : fiente de vache. - (31) |
| chogne, bouse de vache. - (28) |
| chogne, fiente, ordure. - (05) |
| chogne, s. f., bouse de bœuf, de vache, et surtout excrément de cheval : « Ben marci ! y en a-t-i des chognes dans c'te rue! » - (14) |
| chogne. Bouse de vache. - (03) |
| chogne. Crottin de cheval. I me seus laissé dire que les pauv’ gens fieint choicher (sécher) les chognes et les bouzes de vaiche pour se chauffer pendant l’hivar. - (13) |
| chogniot, s. m., le derrière de la tête, occiput. - (14) |
| chôgriyure, inflammation de là peau, sous l'action d'un fort soleil. - (16) |
| choichai, choiche - sécher, sèche. - I vourains bein qu'en faiseu in joli temps pour ailai laiborai. - lle éto tote moillée ; i l'ai trouvée qu'ile se choicho. - Voyez soicher. - (18) |
| choichê, sécher ; on dit d'une personne très maigre qu'elle est choiche. - (16) |
| choicher : (chouâ:ché - v. intr.) 1- presser, appuyer fortement sur quelque chose. 2- boiter, claudiquer. - (45) |
| choicheron. s. m. Paisseau de vigne usé. (Guillon). - (10) |
| choichi, ie. adj . Séché. - (10) |
| choichon : échalas mis au rebut. - (31) |
| choichon, paisseau usé qui n'est plus bon qu'à être brûlé. - (16) |
| choichons. Paisseaux hors de service. Echalas devenus trop courts par les aiguisements successifs, et destinés à être brûlés. Validon queri eune braissée de choichons : j'aillons fâre des gaufres. En 1385, un Dijonnais fut condamné pour avoir dit en public « qu'il ne prisait le duc un choichon. » - (13) |
| choillot : (chouèyot' - subst. f., terme récent ? ) petite voiture à bras qu'on peut benner : d'où, par extension, brouette à deux roues. [mais un fabricant dijonnais s'appelant Choillot, ce nom propre n'a-t-il pas inspiré le nom commun?]. - (45) |
| choillot, n.f. petite charrette. - (65) |
| choinge et choinger - change et changer. Voyez Soinge. - (18) |
| choingement, s. m. changement, transition d'un état à un autre, mutation. - (08) |
| choinger (v.t.) : changer - choinger d'aidrouet : changer de côté - (50) |
| choinger, v. a. changer avec les diverses significations. - (08) |
| choisant. Participe présent du verbe choir, tomber. En choisant i s’ot éblégé, en tombant il s’est brisé. (Poilly-sur-Serein). - (10) |
| choisir (Se) : v. r., se distinguer, se séparer, se diviser, se grouper. La vraie cuisinière mâconnaise dira d'une sauce qui tourne, et prend un aspect grumeleux qu'elle « se choisit ». Le jardinier dira que les fruits « se choisissent » au moment où les uns avortent tandis que les autres se développent normalement. - (20) |
| choisir : v. a., éplucher (des légumes). Choisir de la salade, des haricots, etc. - (20) |
| choître, chuêtre. s. m. Chevêtre, têtière des bêtes de somme. - (10) |
| chôlai ! interjection dont se servent nos charretiers pour arrêter leurs bœufs. - (08) |
| cholât : personne maigre (comme un échalas). - (56) |
| chôlliot, choileussaint. - Divers temps du verbe chouai. - (18) |
| chômai, ne pas travailler... - (02) |
| chômer d'une chose, en manquer. - (04) |
| chômer : v. n., vx fr., suspendre une action. Chôme donc tranquille, reste donc tranquille. Chôme donc ici, reste donc Ici. - (20) |
| chòmer, v. n. demeurer, rester chòmer le dernier ; habiter : chòmer à paris (vieux français). - (24) |
| chomiée (n. f.) : chenevière - (64) |
| chomiée : voir chamiée - (23) |
| chomiller (pour sommeiller, par conversion d’s en ch). Roupiller, sommeiller à demi. (Rugny, Etivey). - (10) |
| chonchon*, s. m. mot plaisant désignant un homme dans le langage enfantin. Une femme se dit tatan. - (22) |
| chonchon, s. m. mot plaisant désignant un homme dans le langage enfantin. Une femme se dit tatan. - (24) |
| chône (on) : chêne - (57) |
| chonégne, bouse de vache, etc. - (16) |
| chonna. adj. Honteux. - (10) |
| chonne, honteux, timide... - (02) |
| chonne. : Se dit d'une personne par trop timide ou montrant une honte puérile. - (06) |
| chonner, v. n. pleurnicher, grogner en pleurnichant. Se dit principalement des petits enfants. On prononce chon-ner. choquar, nom de loc. un des faubourgs de Château-Chinon mentionné en 1671. - (08) |
| choper : cttraper. Généralement : saisir vivement. - (62) |
| choper, chiparder. Prendre ; dérober avec adresse. - (49) |
| chopignot : gros pichet de terre. (P. T IV) - Y - (25) |
| chopine : bouteille de 1/2 litre - (48) |
| chopine : petite bouteille de vin. - (56) |
| chopine : verre de vin - (61) |
| chopine : s. f., ancienne mesure de capacité pour les liquides, valant 1/2 pinte et contenant 0 litre 757. - (20) |
| chopine, Ancienne mesure de liquide contenant environ un demi-litre... - (13) |
| chopine. s. f. et chopinot, choupignot. s. m. Pot à eau de la contenance d’une chopine. - (10) |
| chopiner v. Boire beaucoup de chopines. On dit aussi tsopiner. - (63) |
| chopinette : s. f., burette d'église. - (20) |
| chopper : appréhender, « mettre la main au collet », attraper - (37) |
| choqué, part. pass. du v. choquer. celui qui boude par suite de mécontentement : « léche-lu, al ô choqué » ; laisse-le, il est choqué, il boude. - (08) |
| choque, s. f. chose qui choque, qui contrarie, procédé blessant, offensant. Il y a de la « choque » dans cette affaire. - (08) |
| chôr : tomber - (48) |
| chorcher (v. tr.) : chercher (ete à pain chorché (être réduit à la mendicité)) - (64) |
| chorcher. v. a. Chercher. — Chorcher gatille agaée , chercher querelle sans raison. Locut. proverb. usitée dans la Puysaie. - (10) |
| chorcheux. n. m. - Vagabond, mendiant : « Vite, farme la pourte, v'la un chorcheux d'pain ! » - (42) |
| chorcheux. s. m. Celui qui cherche, qui quête de porte en porte. Chorcheux de pain , mendiant. - (10) |
| chorchi - qu'ri : chercher - (57) |
| chorchou (on) : chercheur - (57) |
| chord (-e) (n.ou adj.m. ou f.) : sourd (-e) - (50) |
| chordiau : Sourd, « Je cra bin que je commache à deveni chordiau », je crois bien que je commence à devenir sourd Au figuré : « Ces calas sant chordiaux » veut dire que la coque verte ne s'enlève pas. - (19) |
| chordiau : sourd. (S. T IV) - S&L - (25) |
| chordiau, s. m. et adj. sourd. Féminin chordiaude. - (24) |
| chordio : sourd. (B. T IV) - S&L - (25) |
| chorée, entrailles. - (04) |
| chorlatte : Sorte de gâteau à la courge, « Eune bonne fornée de chorlattes ». - (19) |
| chorler : Boire avidement, « Y est in pliaiji (plaisir) de li voir chorler in varre de vin ». - (19) |
| Chôrme : Charmes, hameau de la commune de Mancey. - (19) |
| chôrme : Friche, « La tope de la Chôrme », la grande friche située sur le territoire de Vers ; autrefois à la fête patronale de cette commune, la Saint Félix, on dansait « su la Chôrme ». - (19) |
| chôrmillan : Habitant de Chôrmes. - (19) |
| chorter et cheurter : Asseoir. Cheurtôle : chaise. C’t’houmme ilai ç’ast un vrai botri : a n’ast pas pus haut qu'un chien chorté. Dans l'Yonne on dit s'achiter. - (13) |
| chortoure : siège. (B. T IV) - D - (25) |
| chôse : chose - (48) |
| chöse, sf. chose. tact, intelligence. El é bé d'tai chöse, il est débrouillard. - (17) |
| chôse. Chose, choses. - (01) |
| chôse. : Locution familière à ceux qui parlent d'une personne dont le nom ne vient pas à leur mémoire. - (06) |
| chosemenz. : (Dial.), blâme. On trouve dans le livre de Job parole de chosement, c'est-à-dire parole de remontrance. Ce mot vient du verbe choseir, gronder, lequel dérive lui-même du verbe déponent latin causari, ou caussari, alléguer, accuser, plaider. - (06) |
| choser, v. a. faire quelque chose, s'occuper de..., travaillera... - (08) |
| chôsse, bas ; s'chôssé, mettre ses bas. - (16) |
| chosse. s. f. Souche. Une chosse de bois. ( Villechetive). - (10) |
| chot - il importe. – En n'-chot bein, ma fouai ! –Ailez brament mon pôre homme, ailez ; en n'-chot ran du tot. - Voyez Siot - (18) |
| chot : Cep, pied de vigne. « In ban chot » : un cep bien productif. « In chot de ban grain » : un cep qui donne de beaux raisins. « In chot de millerets » : un cep dont les raisins sont « millerets ». Voir ce mot. - (19) |
| chot ou cho : Soue, tect à porcs. « Y n'y a quausi plieu ran dans le salou mâ y a ban lâ dans la chot » : il n'y a presque rien dans le saloir, mais il y a un bon cochon à tuer. - (19) |
| chot : s. m., cep de vigne. - (20) |
| chòt, s. f. logement du porc (du vieux français sou, seu. Latin (loi salique) sutem). - (24) |
| chotaler : Déchausser les ceps de vigne au printemps avant de tailler. - (19) |
| chotaler : v. découvrir le pied du cep pour y couper les racines superficielles. - (21) |
| chotaloux : Petite pioche à chotaler. Ouvrier qui fait ce travail. - (19) |
| choteler : v. a., creuser un trou en forme de cuvette au pied d'un cep de vigne. - (20) |
| chotelou, s. m., pioche à « déhotteler » (cf. ce mot) au printemps. - (40) |
| choter : travailler (mal) - (48) |
| choter : (chotè - v. intr.) muser, ne pas travailler ou faire semblant. - (45) |
| chôtler, v. a. retrancher les racines du collet d'un jeune plant de vigne (du latin subtelare). - (24) |
| chotté, tomber. - (16) |
| chou ! : Exclamation pour chasser les volailles. « Mâs chou don ! » : mais fichez donc le camp ! - (62) |
| chou ! cri pour chasser les poules : chou poulaille ! - (38) |
| chou ! interj. cri pour chasser les poules. - (24) |
| chou !, interj. cri pour chasser les poules. - (22) |
| chou gras (on) : rumex - (57) |
| ch'ou : s. m. clou. - (21) |
| chou! chou! excl. adressée aus poules que l'on veut chasser d'auprès de soi. - (14) |
| chouâché : v. t. Presser, appuyer fortement. - (53) |
| chouâche, souâge : n. m. Saule. - (53) |
| chouâcher : appuyer, tasser - (48) |
| chouacher, entasser ; du latin calcare. Une mesure chauche est celle dont le grain a été pressé. En 1444, les redevances d'avoine de la châtellenie de Chaussin devaient être livrées au receveur à mesure chaulche. - (13) |
| chouâcher, v. a. presser fortement avec la main ou avec le pied, appuyer sur quelque chose en pesant. « souacer, souacher. » - (08) |
| chouai - tomber. - Dètorne c'te pierre qui, ile fairo chouai. - Si te ne prends pa ton bâton te chorée, çâ sûr. - Ile à si faible qu'ile chôillot ai chèque pâ. - (18) |
| chouaiché, souaiché : v. t. Sécher. - (53) |
| chouaingé : v. t. Changer. - (53) |
| chouaingeai (se) : se changer de vêtements. O s'o r'chouaingé pou allai ai la fouère : il s'est rechangé pour aller à la foire. Vais don te r'changeai : va donc te changer. - (33) |
| chouaîsi : choisir - (57) |
| chouaisse : chapeau en paille, placé sur le sommet du gerbier pour le protéger de la pluie - (43) |
| chouaîx (on) : choix - (57) |
| chôuâssai : tasser. Sur le chaffaud feillot chôuâssai le foin : dans le fenil il fallait tasser le foin. - (33) |
| choucard. n. m. - Choucas. - (42) |
| chôucarde : s. f., brouette. - (20) |
| choucaser. v. n. Pousser des soupirs, des sanglots entrecoupés comme un enfant qui vient de pleurer ; autrement, faire comme une chouette, comme un choucas . (Courgis). - (10) |
| chouchi, souch-yi : souffler - (43) |
| chouchire : s. f. araignée. - (21) |
| chouconninte, petite chouette. - (26) |
| choue - chouette. - C'teu neu, t'é entendu les choues su les voûtes de l'église ; c'a mauvais signe. - Les choues c'a des ouyais que ne manquant pa encore d'ête jolis, vais ! - Les fonnes sont curieuses queman des choues. - (18) |
| choûe ! : Exclamation pour chasser les poules. - (19) |
| choue (n. f.) : chose (autre choue, grand choue, quioque choue) - (64) |
| choue (n.f.) : chouette - (50) |
| choue : chouette - (48) |
| choue : chouette. - (29) |
| choue : une cuite - (46) |
| choue : voir chavan - (23) |
| choue : (chou: - subst. f.) chouette - (45) |
| choue : chouette - (39) |
| choué, chouére : (choué:(r) - v. intr.) tomber, choir. - te vâ: choué:r : "tu vas tomber !" - (45) |
| choue, chouette. - (26) |
| choue, chouse. n. f. - Chose. - (42) |
| choüe, s. f. chouette, chat-huant. - (08) |
| choue. s. f. Chose. J’ai ben des choues à li dire. S’il a queuque chou à m’ die, qui veune me treuver. - (10) |
| choue. s. f. Chouette. - (10) |
| chouèche. s. f. Chouette. - (10) |
| chouée, s. f. chouette, hibou. - (08) |
| chouée. s. f. Chute. Chuée d'iau mal (du haut-mal) : épilepsie. - (10) |
| chouer (pour choyer). v. a. Caresser, mitonner, gâter, en parlant des parents qui dorlotent et prennent trop de soin de leurs enfants. - (10) |
| chouer : clouer - (43) |
| chouer, v. n. cheoir, tomber, faire une chute. - (08) |
| chouer. v. a. et v. n . Faire quelque chose, s’occuper, ranger. Se dit par syncope du chousser, choser ; du latin causare. - (10) |
| chouer. v. n. Choir, tomber. {Guillon). - (10) |
| chouére (v.t.) : tomber - (50) |
| chouére : choir, tomber - (48) |
| chouésir. v. - Choisir. - (42) |
| chouet : s. m. 1er rang de l'aire. - (21) |
| chouêter (prononcez chouête ). v. n. Tomber, choir. A Montillot, on dit chouêtre. - (10) |
| chouézir : choisir - (46) |
| chougnâ, subst. masculin : pleurnicheur. - (54) |
| choûgnai : pleurnicher. Le gosse choûgnot pou partir : Le gosse pleurnichait pour partir. - (33) |
| chougnard, adj., enfant qui pleure tout le temps - (40) |
| chougnard, chougnarde : adj., chignard. - (20) |
| chougnard, chougnon. n. m. - Grognon, en parlant d'un enfant. - (42) |
| chougné : v. i. Pleurnicher. - (53) |
| chougner (C.-d., Chal., Char., Y.), chouigner (C.-d.), cbouiner, chouner (Morv.). -Gémir, pleurer, pleurnicher ; peut se rapprocher du mot couiner ou couigner, pousser de petits cris, crier d'une façon aigre, comme un porc qu'on égorge, lequel a probablement la même origine : canere. Un petit chien couine, une roue mal graissée couine également. A rapprocher de l'argot : chialer, qui signifie pleurer. Peut-être est-ce aussi une onomatopée? - (15) |
| chougner (v.t.) : pleurer - aussi chongner - (50) |
| chougner : pleurer fort - (44) |
| chougner : pleurer. - (56) |
| chougner : pleurnicher. Et « chougnou » : pleurnicheur. - (62) |
| chougner v. pleurer. - (38) |
| chougner : gémir en faisant la grimace, pleurnicher. Ex : "Te vas t’y ben arrêter d’chougner ? Quion qu’tas ?" - (58) |
| chougner, chialer. Pleurnicher. (Argot). - (49) |
| chougner, chouiner : v. n., chigner, grogner, pleurnicher. Que qu' t'a donc à toujours chougner comme ça ? - (20) |
| chougner, v. pleurnicher. - (65) |
| chougner, v., pleunicher tout le temps - (40) |
| chougner, verbe intransitif : pleurnicher. - (54) |
| chougner. v. - Pleurnicher. Ce mot est également employé en français familier ; de même que le verbe chouiner, il est formé à partir d'une onomatopée proche de couiner. - (42) |
| chougner. v. n. Pleurnicher. - (10) |
| chougni, v. n. pleurnicher. - (22) |
| chougni, v. n. pleurnicher. - (24) |
| chougnier, v. intr., pleurnicher : « Qu'ol é donc désagueùriabe ! ô chougne tôjor. » - (14) |
| chougnon, chougnard. s. m. Enfant grognon, pleurnicheur. Mais, tais-te donc, chougnard ! - (10) |
| chougnon, chougnat. Pleurnicheur. - (49) |
| chougnou (adjectif) : qualifie un enfant pleurnicheur. - (47) |
| chougnou, -se, pleureur, pleureuse. - (38) |
| chougnoux, adjectif qualificatif ou subst. masculin : grognon, pleurnicheur. - (54) |
| chou-grâ, sorte d'oseille sauvage. - (16) |
| chougras : chenopode (plante). Faire ses choux gras : tirer profit de… - (33) |
| chouignai - affecter de pleurer, comme les enfants. - Les petiots chouignant pou des ran. - C'à in chouignou, ceute homme lai. - (18) |
| chouignè : pleurnicher, pleurer - (46) |
| chouigné, pleurnicher. - (16) |
| chouigner : pleurer. - (32) |
| chouigner, pleurer (larmoyer). - (26) |
| chouigner, pleurnicher. - (28) |
| chouigniou, larmoyant. - (26) |
| chouignou : un pleurnichard - (46) |
| chouinai et coinnai , affecter de pleurer comme font les enfants, ou crier comme les petits des animaux. Souin veut dire jeune porc (voir Le Gon.), et chwyn signifie plainte, lamentation, d'après Davies. Dans le Jura on dit coinner, en Bourgogne on dit encore couiner ; et, pour exprimer qu'une personne désire ardemment une chose, on dit qu'elle en récouine. - (02) |
| chouinai. : (Pat.), couinner (dial.), pleurer. Il y a le réduplicatif récouiner dont on se sert aussi bien en Bourgogne qu'en Champagne pour exprimer la vive appétition d'une chose. - Le verbe latin grunnire rend fidèlement le sens de ces mots. - (06) |
| chouinais, s. m. pleurnicheur, celui qui se plaint, qui grogne et qui gémit à tout propos. - (08) |
| chouiner (verbe) : pleurnicher. - (47) |
| chouiner : pleurnicher - (48) |
| chouiner : pleurnicher. - (52) |
| chouiner, v. intr., pleurer sans motif, faire semblant de pleurer : « Qu'é-ce qui t’fait chouiner c'ment c' qui ? » - (14) |
| chouiner, v. n. pleurer sans raison, pleurnicher. « Chouler », en Morvan, signifie imiter le cri de la chouette. - (08) |
| chouiner. (V, Couiner). - (13) |
| chouiner. Pleurer. Onomatopée. - (12) |
| chouinger : changer - (48) |
| chouingné, vn. pleurnicher. - (17) |
| chouinoux. Qui pleure. - (12) |
| choulan : toujours en quête de quelque chose. (C. T IV) - A - (25) |
| choulée. s. f. Se dit, à Argentenay, pour chevelée. Voyez ce mot. - (10) |
| chouler (v.) : imiter le cri de la chouette - (50) |
| chouler : sentir (odeur), humer - (48) |
| chouler : téter. (V. T IV) - A - (25) |
| chouler : (choulè - v. trans.) flairer, renifler attentivement. - (45) |
| chouler, v. ; chercher en furetant. - (07) |
| chouler, v. n. chuinter, imiter le cri de la chouette. - (08) |
| choulette, choulotte. s. f. Petit chou, rejet d’un tronc de choux resté en terre. - (10) |
| choumac. s. m. Cordonnier. - (10) |
| choumé, v. a. demeurer, rester. Habiter : il choume à Paris. - (22) |
| choûnis, s. m., pleur (péjoratif). - (40) |
| chouöre, sf. maison sordide ; cahute misérable, ruines. [chouère, repaire des choues.] - (17) |
| choupée, touffe - (36) |
| chouper : appeler, héler de loin - (62) |
| chouper : Appeler. « Choupe ta mère ». Crier « Ne choupe dan pa si feu ». - « Chouper des you you » pousser des huchements très forts, comme le font les conscrits et les bergers. - (19) |
| chouper et cheuper, v. tr., hèler de loin, appeler fort pour faire venir quelqu'un. - (14) |
| chouper, v. appeler. - (38) |
| choûper, v., appeler, héler. - (40) |
| chouperan : Hibou, chat-huant. - (19) |
| choupète, s. f., boucle, mèche de cheveus. - (14) |
| choupette - petite houppe, petit gland. - Al à fier aivou sai choupette aipré sai calotte. – A gairnissant de choupettes les colliers de lô chevaux. - (18) |
| choupette : boucle de cheveux. Mèche de cheveux. - (62) |
| choupette : ruban à cheveux, rouleau de cheveux au sommet du crâne - (48) |
| choupette, s. f. mèche, touffe ou boucle de cheveux. - (08) |
| choupignot, chopignot. n. m. - Pot en grès ayant la contenance d'une petite chopine. - (42) |
| choupignot. s. m. Pot à eau, ainsi appelé parce que sa contenance habituelle est d’une chopine. - (10) |
| choupper : voir chuffer. - (20) |
| choupperon : s. m., chat-huant. - (20) |
| choupran : s. m. hibou. - (21) |
| chour(r)os, v. ; pouvoir (conditionnel Ière p.) : employé uniquement au futur et au conditionnel : mas, ébécilles, ost-ce que vous ne chourrains vos entendre ? ; Y ne chouros comprenre le jairgon des maigniens. - (07) |
| chour, s. sourd. - (08) |
| chourattes, n. fém. plur. ; arrangement des cheveux sur les tempes ; al ai fait ses chourattes. - (07) |
| chourdiau, s. m. sourdaud, celui qui a l'oreille dure. - (08) |
| chourée : Injure que les ménagères adressent volontiers à leurs poules quand celles-ci se mêlent de sarcler les plates-bandes du jardin. « Cous choue ! Veux-tu t'en aller, vilaine chourée ! ». - (19) |
| chourer. v. a. et v. n . Plaisanter. (Domecy-sur-le-Vault). - (10) |
| chouréte, s. f., mèche de cheveus temporale, tournée en virgule, et qu'affectionnaient fort les jeunes gens du premier quart du siècle. (V. Choupéte). - (14) |
| chourette : ruban noué dans les cheveux. A - B - (41) |
| chourette (na) : un nœud (ruban dans les cheveux) - (57) |
| chourette : ruban dans les cheveux - (44) |
| chourette : ruban dans les cheveux. - (62) |
| chourette n.f. Ruban placé dans les cheveux d'une fillette. - (63) |
| chourette : n. f. Ruban noué dans les cheveux. - (53) |
| chourette, n.f. ruban de cheveux. - (65) |
| chourette, subst. féminin : chou, nœud de ruban ornant les cheveux des fillettes. - (54) |
| chourette. Accroche-cœur, petite mèche de cheveux aplatie sur les tempes. - (12) |
| chouriner : chercher quelque chose. A - B - (41) |
| chouriner : chercher quelque chose - (34) |
| chouse (na) - machin (on) : chose - (57) |
| choûse : chose - (48) |
| choûse : chose. Les gens instruits savont de chouses : les gens instruits savent des choses. - (33) |
| chouse : chose, mais pas dans le sens d'objet. Remplace un nom oublié. Ex : "Oh ben...la mée Chouse, te sais ben ..!" - (58) |
| chouse, s. f., chose, être. S'applique à nombre de substances. - (14) |
| chouser : "lacher un gaz" - (61) |
| choûtai - aller regarder, comme des curieux ennuyeux. - Ces gens qui ailant choùtai chez le monde : ç'â embétant. - Quoi qu'à venant don choùtait qui ? - (18) |
| choute ! (à un chien) : cherche ! - (35) |
| choute : cherche ! sent ! (se dit à un chien) - (43) |
| choute : chouette - (44) |
| choûte : chouette. (E. T IV) - S&L - (25) |
| choute : n. f. Chouette. - (53) |
| choûte, subst. féminin : chouette. - (54) |
| choute. Chouette. - (49) |
| chouteau, s. m. chouette sur la frontière du Morvan bourguignon. - (08) |
| chouter : v. n., chercher en furetant. - (20) |
| chouter. Chercher. - (49) |
| choûtnâ, cheûtnâ, tsoûtnâ n.m. Curieux, indiscret, qui vient renifler comme un chien. - (63) |
| choûtner, tsoûtner v. Flairer, renifler, chercher. - (63) |
| choûto : n. m. Hibou. - (53) |
| choûto, s. m., oiseau de nuit (chouette, hibou). - (40) |
| choûto, subst. masculin : rapace nocturne. - (54) |
| choutot (n.m.) : chat-huant - (50) |
| choutot : petite chouette - (44) |
| choutot, s.m. chouette. - (38) |
| choutte (n.f.) : chouette - (50) |
| choûze : une chose - (46) |
| choveau et chôvia. Petite mesure pour les liquides et spécialement pour le lait ; il y en avait quatre dans une pinte... - (13) |
| chôvo, choviâ, ancienne mesure pour les liquides. - (16) |
| chô-yi, v. choisir. - (38) |
| chôze (prononcez cheuze), chose... - (02) |
| chpugrouillé, ée (pour chaugrouillé). adj. A peine grillé, à peine rissolé. Manger de la viande chouarouillée, manger de la viande non cuite, a peine saisie par le feu, grillée à la surface seulement. De chaud et de groler , vieux mot qui signifie, rissoler, griller. - (10) |
| chrême. n. m. - Crâne. Se dit par allusion au baptême ; partie du crâne ointe du saint chrême. (Perreuse, selon M. Jossier) - (42) |
| chrême. s. m. Crâne. Se dit par allusion à cette partie de la tête qui, au baptême, a été ointe du saint chrême. C’est une métonymie. (Perreuse). - (10) |
| chretiantai. Chrétienté… - (01) |
| chrétienneté : s. f., chrétienté. Marcher sur ta chrétienneté, marcher pieds nus ou avec des chaussures trouées. - (20) |
| chrîyier : cerisier - (37) |
| çhte démonstr. Ce, cet, cette - (63) |
| çhte démonstr. Ce, cet, cette. - (63) |
| ch'tel : cheptel - (48) |
| ch'tel : cheptel - (39) |
| chter (se) : asseoir (s’) - (51) |
| chter, v. n. asseoir : chtez vous. De chton, dans la position assise. - (24) |
| çhtés démonstr. Ces, celles, ceux. - (63) |
| çhtés-ci démonstr. Ceux-ci, celles-ci. - (63) |
| çhtés-là démonstr. Ceux-là, celles-là. - (63) |
| cht'hure (ai) (loc.) : à cette heure, à présent, maintenant - (50) |
| ch'ti (te) ou sti : 1. chétif, amaigri et pâle ; El ot été m'lède, el ot ch'ti : il a été malade, il est chétif. 2. méchant, agressif, hargneux ; Elle ot ch'tite : elle est méchante. Voir latin cautivus et français captif et chétif ou ch'tif dans certaines régions (le méchant étant celui qui mal choit, qui tombe mal). - (52) |
| ch'ti : méchant, petit - (61) |
| ch'ti : méchant. - (29) |
| ch'ti : petit, chétif, faible - (48) |
| ch'ti : un petit, un malin (féminin, eune ch’tite) - (46) |
| çhti démonstr. Celle, celle-ci. Y'est bin çhti la pyus chtite ! - (63) |
| ch'ti : 1 adj. Chétif, n. m. espiègle. - 2 adj. et n. m. Mauvais. - (53) |
| ch'ti(te) : chétif, amaigri et pâle. Ol o été m'lade, ol o ch'ti : il a été malade, il est chétif. Se dit aussi pour : méchant, agressif, hargneux. - (33) |
| ch'ti, chiite, adj. mauvais(e), rusé(e), maigre (fr. chétif). - (38) |
| ch'ti, petit, mauvais, méchant - (36) |
| ch'ti, te. adj. - Plusieurs significations, toujours négatives : 1. Malin, mauvais, sournois : un ch'ti gamin. 2. Petit, petite : « C'te ch'tit' maison est la pus gente que j'counnaissins tout à l'entour. » (Fernand Clas, p.ll3) 3. Avare, pingre : « sa mée est ben pus ch 'tite que li, a les lâche pas coumme ça ! » 4. Mauvais ou fort, en parlant d'un liquide. - (42) |
| chtiet, chtiot n. et adj. Petit. - (63) |
| çhti-là démonstr. Celle-là. - (63) |
| ch'tin, j'tin, s.m. branche de vigne. - (38) |
| ch'tin, s. m., rameau de vigne (1ère année). - (40) |
| ch'tiot : un petiôt (petit enfant). - (56) |
| chtit (adj.) : de petite taille – de mauvaise qualité (en parlant d'une marchandise) de mauvais goût (en parlant d'un aliment qui manque de bonté, de générosité (en parlant d'une personne) - (64) |
| ch'tit (adjectif) : mauvais, méchant. De peu de valeur. - (47) |
| ch'tit (adjectif) : petit. - (47) |
| ch'tit (e): (adj) malin, coquin (en parlant d'un enfant) - (35) |
| chtit (ptchet) : petit - (51) |
| ch'tit : petit, mesquin. - (32) |
| ch'tit : polisson - (57) |
| ch'tit : rusé - (57) |
| chtit n. et adj. Petit, mauvais, méchant. - (63) |
| ch'tit nom. Prénom. - (49) |
| ch'tit, ch'tite : méchant, méchante - (48) |
| ch'tit, chtite : petit garçon, petite fille - (48) |
| chtit, chtite : adj. mauvais, méchant. - (21) |
| ch'tit, petit, mauvais. - (27) |
| ch'tit, subst. masculin ou adjectif qualificatif : petit. - (54) |
| ch'tit. Petit ; avec sens péjoratif, « un ch’tit morceau de pain »... - (49) |
| ch'titeté : méchanceté, malice - (48) |
| ch'titeté : mesquinerie, malice. « Avoir de la ch'titeté dans la tête ». - (56) |
| ch'titeté, subst. féminin : méchanceté, mauvais caractère. - (54) |
| ch'titetée. Polissonnerie. - (49) |
| chtitté (n.f.) : méchanceté - (50) |
| chtitté n.f. Polissonnerie, espièglerie, méchanceté. - (63) |
| chtit'té : 1 n. f. Coquinerie. - 2 n. f. Méchanceté. - (53) |
| chtit'tée : bêtise - (44) |
| ch'ton : s. m. essaim. - (21) |
| ch'tot : siège. - (33) |
| çhtôt adv. Sitôt, tantôt. Çhtôt l'un, chtôt l'aute. Voir achtôt et dachtôt. - (63) |
| chtourbe, adj., mort. Nous vient des premières invasions. - (14) |
| chtourber, v. n. mourir, rendre l'âme ; il est mourant, il va « chtourber » ; un homme « chtourbé », un homme mort. - (08) |
| çhtu démonstr. Celui. - (63) |
| çhtu-ci démonstr. Celui-ci. - (63) |
| çhtu-là démonstr. Celui-là. - (63) |
| chu (adj.m.) seul - féminin : chule, seule - (50) |
| chu (prép.) : sur - (50) |
| chu : sur - (37) |
| chu : sur. Les poules sont zeussées chu l'âbre : les poules sont perchées sur l'arbre. - (52) |
| chu de grandze : aire de la grange. A - B - (41) |
| chu de grandze : aire de la grange - (34) |
| chu : sur - (39) |
| chu, adj. seul. « i seu tô chu, » je suis tout seul. - (08) |
| chu, adv. si, aussi. « al ô chu béte qu'ai ô michan, » il est aussi bête qu'il est méchant. - (08) |
| chu, prép. de lieu. sur ; « al ô choué chu lu », il est tombé sur lui. - (08) |
| chu, s. m., aire. Dans les cantons mérid. du dép. on bat à l'aire, ou chû, en plein soleil, et non en grange. - (14) |
| chu. Part. prés, de choir, tomber. - (10) |
| chuatte : s. f. chouette. - (21) |
| chubsister, v. n. subsister : « i n'é ran pô chubsister », c’est-à-direpour vivre. - (08) |
| chuchate : La corolle du lamier (lamium album) que les enfants se plaisent à sucer, parce-qu'elle est sucrée. - (19) |
| chuche : souche. Quand on cope du bois o reste la chuche : quand on coupe du bois il reste la souche. - (33) |
| chuche et suchas. Souche, grosse bûche de bois. Au siècle dernier, on voyait dans la commune de Vignolles, un petit bois appelé suchas. Le hasard des semis naturels y avait fait croître un poirier d'une espèce particulière : cette bonne variété, appelée Suchas, fut beaucoup multipliée par la greffe... - (13) |
| chuché : v. t. Sucer. - (53) |
| chuche, s.f. bûche : la chuche de Nouée, "la bûche de Noël" qui brûlait du soir de la messe de minuit et les quatre jours qui suivaient. - (38) |
| chuche. n. f. - Souche. - (42) |
| chuche. s. f. Souche. — Source, origine. Il faut remonter à la chuche. (Lainsecq). - (10) |
| chucher (v.t.) : sucer - (50) |
| chucher, v. a. sucer, aspirer avec les lèvres. - (08) |
| chucher, v., sucer. - (40) |
| chuchi : Sucer. « Si ol a le nez roge y est pas de chuchi de la glièche » : s'il a le nez rouge ce n'est pas de sucer de la glace. Au figuré : boire. « O s'est foutu le baril su le nez à peu ol a chuchi eune bonne gotte (goutte) ». - (19) |
| chuchon, s. m., échalas recoupé, marcot. - (40) |
| chuchoter, v. a. sucer, suçotter, aspirer avec les lèvres. - (08) |
| chuchrotte : 1 n. f. Sucette. - 2 n. m. Glaçon tombant des toits. - (53) |
| chûe (lai) : (la) sueur - (37) |
| chue (n.f.) : suie - (50) |
| chûe : suie - (37) |
| chûe : suie. - (52) |
| chue, s. f. suie de cheminée. - (08) |
| chuer, v. a. suer, être en sueur. - (08) |
| chuet : touffe. - (30) |
| chueu (x) (n.m.pl.) : cheveu(x) - (50) |
| chueur (n.f.) : sueur - (50) |
| chueur, s. f. sueur, transpiration. - (08) |
| chuffé : adj., qui a une huppe. Oiseau chuffé. - (20) |
| chuffe : s. f., huppe (oiseau) ; huppe (touffe de plumes) ; houppe (touffe de cheveux). - (20) |
| chuffer, chupper, choupper : v. n., vx fr. juper, appeler, chuinter, hucher. - (20) |
| chui : sureau. - (52) |
| chuif : (nm) suif - (35) |
| chuille. Cheville. - (49) |
| chuite, s. f. suite. - (08) |
| chuitre, chutre, v. a. suivre. Se prend dans une acception particulière et non pas pour aller, venir après. « Chuitre » signifie aller aussi vite que... - (08) |
| chujau : Cucubale (cucubalus baccifer); le calice de la fleur cucubale est très renflé, les enfants s'amusent à le faire éclater en le tenant par l'orifice et en le frappant sur leur front ou le dos de leurs main, comme si c'était un petit sac gonflé d'air. - (19) |
| chûleman (adv.) : seulement - (50) |
| chuler (verbe) : siffler. - (47) |
| chûler : siffler - (48) |
| chuler : boire - (39) |
| chûler, flûter, tûtter : siffler - (37) |
| chûler, siffler - (36) |
| chuler, suler. Siffler. - (49) |
| chuler, v. n. siffler, siffloter. Signifie aussi boire en aspirant, humer. - (08) |
| chûlot (n.m.) : sifflet - (50) |
| chûlot : pomme d'Adam, gosier. VI, p. 50-2 - (23) |
| chûlot : sifflet - (37) |
| chulot : gosier - (39) |
| chûlot, gosier - (36) |
| chulot, s. m. sifflet ; gorge, gosier. - (08) |
| chulot. Sifflet. - (49) |
| chulou, s. m. siffleur, celui qui siffle. - (08) |
| chumin, s. m., chemin, route, sol et parcours. - (14) |
| chuminée, chuinée et chvinée, s. f., cheminée. - (14) |
| chuminer. v. intr., cheminer : « Lasse-le, ce p'tiot ; n' li dis ran ; ô chumine son train ». - (14) |
| chumise. s. f., chemise. - (14) |
| chûn : un chien - le chûn l'è modju, le chien l'a mordu - (46) |
| chunmé, vn. se dit d'un troupeau de moutons qui, sous l'influence d'une grande chaleur, se met en tas, le nez à terre, refusant de brouter. - (17) |
| chupe. s. f., huppe, oiseau, et aussi touffe de plumes, de fleurs sur la tête. - (14) |
| chuplicaition, s. f. supplication. - (08) |
| chuplier, v. a. supplier. - (08) |
| chuppe - huppe. - Regairde don ceute ouyais, quée jolie chuppe qu'al é ! - Mouai, i eume bein les poules chuppées. - (18) |
| chuppe, touffe de plumes sur la tête. - (05) |
| chupperan, chat-huant. - (05) |
| churter : (vb) s’intéresser à ce qui ne nous regarde pas - (35) |
| chuté, tomber en faute. - (16) |
| chuter. v. n. Tomber. - (10) |
| chutôt, adv. et propos. aussitôt : « i vinré chutô qu'teu vourâ, » je viendrai aussitôt que tu le voudras. - (08) |
| chùye, 1. s. f. sœur. — 2. s. m. aire à battre le blé (du latin solium). - (24) |
| ch'vasse (nom féminin) : partie ligneuse et sèche de la pomme de terre. - (47) |
| ch'vau : cheval - (48) |
| ch'vau : cheval. - (52) |
| chvau : faucheur (sorte d'araignée). IV, p. 29 - (23) |
| ch'vau : un cheval - (46) |
| ch'vau : cheval. On attelo le ch'vau : On attelait le cheval. - (33) |
| ch'vau du Bon - (39) |
| ch'vau : s. m. 1° cheval, 2° support. - (21) |
| ch'vau(x) : cheval (aux) - (39) |
| ch'veau. n. m. - Cheval : « Le ch'veau du pée Billard. » - (42) |
| ch'veux : n. m. Cheveux. - (53) |
| ch'vez, ch'v'ez (contr.) : contraction de : chi vôs ez = si vous avez - (50) |
| çhvîre n.f. Civière, brouette. Voir tsvîre. - (63) |
| chvire : s. f. brouette, à bras ou avec roue. - (21) |
| ch'vô, cheval, au singulier comme au pluriel. - (16) |
| ch'vo, cheval. - (26) |
| ch'vo, s. m., cheval. - (40) |
| ch'volë, tige de vigne couchée en terre, pour qu'elle y devienne un cep. - (16) |
| ch'volot : n. m. Chevalet. - (53) |
| ch'vous : chez vous - (46) |
| çhyé : (adv) clair « ol entend pas çhé » - (35) |
| çhyé : (nf) clef - (35) |
| Çhyeûni : NL Cluny - (35) |
| çhyotse : (nf) cloche - (35) |
| çhyotsi : (nm) clocher - (35) |
| çhyou : (nm) clou - (35) |
| çhyouter : (nm) clouer - (35) |
| ci - ceci, celà, c'est. - Ci nô vai tot ai fai bein. - Ci à bon. - Queman cequi, ci airaingero to le monde. - (18) |
| cià - bonde pour boucher le trou supérieur d'une futaille. - Tappe bein su le cià pour que le poinson ne s'évante pa. - En fau tôjeur mette ine piéce àtor du ciâ. - (18) |
| cïais, s. m. ciseaux de couturière. « cîaux. » - (08) |
| ciarge : Cierge. « Ol est dra c'ment in ciarge ». - (19) |
| ciarge, s. m., cierge. - (14) |
| ciarge. n. m. - Cierge. - (42) |
| cibje, sf. cible. - (17) |
| ciblerie : s, f., installation de cibles. - (20) |
| ciboule, ciboulot. Tête. - (49) |
| cice, adj. chiche, économe jusqu'à l'avarice. - (08) |
| cicot. s. m. Chicot. - (10) |
| cid, cit, citre. n. m. - Cidre. - (42) |
| cidrier, citrier. n. m. - Personne qui fabrique du cidre. - (42) |
| cidrier, citrier. s. m. Celui qui fait le cidre. (Villiers-Saint-Benoît). - (10) |
| cidule, s. f. cédule, sommation pour comparaître devant un tribunal, un juge de paix « : it’beillerai eune cidule », est une menace de procès. - (08) |
| cié (n.m.) : ciel - (50) |
| cié : clair - (43) |
| cié n.m. Ciel. - (63) |
| cié, s. m. ciel. - (08) |
| cieaux, cihiaux, cilleaux. n. m. pl. - Ciseaux. - (42) |
| cien (n.m.) : chien - (50) |
| cien : chien - (52) |
| cien : chien - (39) |
| cien, s. m. chien. « être cien », être avare. - (08) |
| cier. Ciel, comme mier pour miel. On ne dit pourtant pas fier pour fiel… - (01) |
| cier. : Ciel. C'est parce que les Bourguignons trouvaient la consonne l trop sourde qu'ils lui ont substitué la consonne r. - (06) |
| cière, chèvre - (36) |
| ciére, s. f. chevalet sur lequel on scie le bois. « chiévre » = chèvre par assimilation ? - (08) |
| cierte : cercle. - (29) |
| cies. Pronom démonst. m. et f. pl. Ceux, celles. Les cies qui v'roni me voi, ceux ou celles qui voudront me voir. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| cifar, diminutif de Lucifer. - (02) |
| cifar. : Diminutif de Lucifer. - (06) |
| cignau, s. m. raie dans un labour, rigole creusée par la charrue pour l'écoulement des eaux pluviales. « cignau ». - (08) |
| cignöle, sf. manivelle. - (17) |
| cignon : quartier de quelque chose. (SB. T IV) - C - (25) |
| cignoule : s . f. manivelle (du puits, du vannoir. - (21) |
| cigogner, sigogner : v. a., secouer. Ne m’ cigogne done pas comme ça ! - (20) |
| cigouler, verbe transitif : secouer. - (54) |
| cihé, adj. ciré. se dit du pain mal cuit dont la mie ressemble à une pâte de cire par son brillant et sa densité. Pain « taqué » et pain « cihé » sont deux termes à peu près identiques. - (08) |
| cihiaux. s.m. pl. Ciseaux. - (10) |
| ciiantoux, ciiantouse : s. m. et f., chanteur, chanteuse. - (20) |
| cijas, cijais, cirias, cisias. s. m. pl. Ciseaux. (Ménades, Vassy-sous-Pisy, Domecy-sur-le-Vault). - (10) |
| ciler, v. n. remuer, frémir, s'émouvoir. Se dit principalement de l'eau lorsqu'elle commence à bouillir. - (08) |
| ciller ou, plutôt, siller. v. a. Couper insensiblement avec un fil ; blesser légèrement avec la pointe d’un objet aigu, en traçant un léger sillon. Il arrive souvent qu’on se sille avec une épingle. (Mouffy). - (10) |
| cimai - couler, suinter, en parlant des plaies. - Le trou qu'al é ai lai jambe cime bein. - Des gottes cimant de sai plaie. - (18) |
| cimai - remuer, en parlant des sourcils et des yeux cligner. - A nos é fait signe en cimant des ulliots. - (18) |
| cimai : bouger. Il n'a pas cimé d'un poil : il n'a pas bougé. Pou guettai faut pas cimai : pour guetter il ne faut pas bouger. - (33) |
| cimber. v. n. Cimer, filtrer, transsuder. L’été, l’huile enfermée dans des fûts cimbe à travers les pores du bois. (Beugnon). - (10) |
| cime : baguette. (RDM. T IV) - B - (25) |
| cime, s. f. jeune pousse végétale, brin de bois, extrémité des branches. Dans la fabrication du bois de moule, la cime ne sert qu'à former des petits fagots ou bourrées de peu de valeur. - (08) |
| cime, s. f., jeune pousse végétale. - (14) |
| cimer (v.) : 1) bouger - 2) se dit de l'eau lorsqu'elle commence à bouillir - (50) |
| cimer : bouger - (48) |
| cimer : répondre, remuer - (60) |
| cimer le mout (ne pas), loc. rester silencieux, ne pas prononcer un seul mot. - (24) |
| cimer ou simer. Action d'un liquide qui s'épanche par les fissures d'un vase. Te ferai ben aittention : les poinçons (tonneaux) ne veillant ran, le vin vai cimer pou dessôs. En architecture la cymaise est la partie d'une corniche qui forme revers d'eau. - (13) |
| cimer : bouger - (39) |
| cimer, v. n. remuer par le faite, par la cime. - (08) |
| cimer. Remuer. « Cimer » ne s'emploie que négativement. - (49) |
| cimot, lisière d'étoffe. - (05) |
| cimot, s. m. cimosse, lisière, bordure du drap ou autre étoffe. - (08) |
| cimot, s. m., lisière du drap. Dans la Bresse, on fait des chaussons en cimot ; c'est ce qu'en français on appelle : chaussons de lisière. - (14) |
| cimot. Lisière de drap. J'ons aicheté des chaussons en cimot. - (13) |
| cimotter. v. n. Ciller, clignoter. (Ménades). - (10) |
| cim'tiée. n. m. - Cimetière. - (42) |
| cin - cinq. - Presque toujours : cin chevaux.. cin œufs, cin oraiges… Rarement cinq avec la liaison française ; cinq ans, cinq heures. (prononciation nasale très accentuée). - (18) |
| cin : cinq - (57) |
| cin : Cinq. « Eune girof'llée à cin feuilles » : un soufflet. - Dans le langage enfantin : « donner cin sous » toucher dans la main. - (19) |
| cin(q)-pierres, subst. masculin ou féminin : osselet. - (54) |
| cin, cinq adj. num. Cinq. Les cin dagts d'la main. - (63) |
| cin. Cinq. Cin devant une consonne, mais cinq devant une voyelle, comme en français. - (01) |
| cin. : Devant une consonne : cin sols ; - cinq devant une voyelle ou une h muette : cinq hommes. - (06) |
| cinaillier. s. m. Aubépine, cinellier. - (10) |
| cincle (n.m.) : chanvre - (50) |
| cincôte : petites plantes sauvages, feuilles allongées nervurées - (39) |
| cinde : chanvre - (39) |
| cinde, chanvre - (36) |
| cinde, cindre, s. m. chanvre. - (08) |
| cinelle : fruit de l'aubépine. - (09) |
| cinelle. n. f. - Cenelle, fruit de l'aubépine. - (42) |
| cinelle. s. f. Fruit de l’aubépine, du cinellier. - (10) |
| cinellier, cinaillier. n. m. - Aubépine. - (42) |
| cinghie, s. f. ceinture, sangle. - (08) |
| cinghier, v. a. ceindre avec force, serrer une ceinture, sangler. « cinghier » a aussi la signifie, de cingler : « cinguier un coup de fouet. » - (08) |
| cingihion, s. m. ceinturon, sangle. - (08) |
| cinglon (mouillez le gl et prononcez cin-yon). s . m. Baguette, houssine propre à cingler. (Sainpuits). - (10) |
| cinglon. n. m. - Baguette, badine pour cingler. (Sainpuits, selon M. Jossier) - (42) |
| cingne. adj. numéral. Cinq. - (10) |
| cinguiè : cinglé - (48) |
| cinguiè : cinglé, on remarque que la consonance « gl » en français devient « guieu » en patois. Par exemple : - (46) |
| cinguier. v. a . Sangler. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| cinguier. v. a. Cingler. Dans ce mot, nous trouvons encore un exemple de l’usage où l’on est, dans nos campagnes, de mouiller le gl. - (10) |
| cing'ye : Petite baguette de bois flexible. - (19) |
| cing'yer : Frapper avec quelque chose de pliant. - (19) |
| ciniagra : suie. - (29) |
| cinq sous : Ioc. enfantine. Donner cinq sous, faire cinq sous, donner la main. - (20) |
| cinq sous, loc. : « Là, mon Diou ! qu' t' é donc belle! T' é gentite, voué-tu, c'ment cinq sous ! » - (14) |
| cinquantaîn-ne (na) : cinquantaine - (57) |
| cinquantaiñne n.f. Cinquantaine. - (63) |
| cinqui : ceci. Comme on dit iqui pour ici. - (62) |
| cinqui, cintii, ceci, cela. - (38) |
| cinquplé : part, pass., quintuplé. De 1914 à 1921, la vie a cinquplé. - (20) |
| cinre : cendre. - (29) |
| cinre : cendre - (39) |
| cinte, s. f. voir : chintre. - (08) |
| cintième : Cinquième. « Y est le cintième roe d'in chai » : c'est une personne inutile et plutôt encombrante, le char n'ayant besoin que de quatre roues. - (19) |
| cintième. Cinquième. - (49) |
| cintre. s. m . Centre. (Percey). - (10) |
| cIô. Clo , en particulier clos de vignes. Clô signifie aussi un clou, des clous. - (01) |
| ciole. s. f. Fiole. Se dit de ces longues et étroites petites bouteilles de verre, dans lesquelles les pharmaciens renferment les sirops et potions qu’ils vendent par petite quantité. J’viens de charcher un’ ciole cheu le pharmacien. - (10) |
| ciot : cep de vigne. - (62) |
| ciot, s. m., cep de vigne: « N’m'en parle pas ; la mâtine de p'tiote béte va piquer tous nos ciots. Je n' pourons ran pu j'ter dans nos cuves ». - (14) |
| ciot, s.m. cep de vigne (bourguignon moderne). - (38) |
| cirai - égrapper, égrainer, mais d'un seul coup en glissant la main sur la grappe, l'épi… - Les raisins ant colai quemant si en lai aivo cirai. - En i en é qu'ant ine béte d'habitude, quan à passant le long des bliets de cirai les épi entre lô doigts. - (18) |
| circu : (nm) attache du fléau - (35) |
| ciré un raisin, une branche de cerisier, de groseillier, est en détacher les fruits en bloc, en les passant vivement entre les doigts. - (16) |
| cirer : enlever la peau de l'osier pour le blanchir. (G. T II) - D - (25) |
| cirer, égrener (un épi). - (26) |
| cirer, v. a. presser fortement en glissant, en lissant. - (08) |
| ciroux, bitouse. Chassieux. Fig. Malpropre. Fém. « Cirouse, bitouse ». - (49) |
| cirtale, s. f., chaise. - (40) |
| cirugien, s. m., chirurgien. - (14) |
| ciruzerie, s. f. salle d'hôpital où se font les opérations de chirurgie. - (08) |
| ciruzien, s. m. chirurgien. - (08) |
| ciset, sm. ciseau. - (17) |
| cisiâ, s.m. ciseaux. - (38) |
| cisiâs, s. m., ciseaux. - (40) |
| cisiau : Ciseau. « Les cisiaux de la coudrère (de la couturière) ». - (19) |
| cisiau n.m. Ciseau. - (63) |
| cisiaus, s. m., ciseaus. - (14) |
| cisiaux n.m.pl. Silène latifolia ou compagnon blanc. - (63) |
| cisio : ciseaux - (43) |
| citai. Cité, ville, cités, villes. - (01) |
| citarne : Citerne. « L'iau de citarne vaut autant que l'iau de pouit », pour un vigneron, buveur de vin, elles ne valent pas mieux l'une que l'autre. - (19) |
| citouayen (on) : citoyen - (57) |
| citrauille (n.f.) : citrouille - (50) |
| citre, sm. cidre. - (17) |
| citre. s. m. Cidre. Dans quelques endroits, on prononce cite. - (10) |
| citrer. v. - Faire du cidre. (Villiers-Saint-Benoît, selon M. Jossier). - (42) |
| citrer. v. n. Faire du cidre. — Faire découler le jus d’une pomme ou d’une poire, en en râclant la pulpe avec un couteau. (Viliers-Saint-Benoît, Villechétive). - (10) |
| civadou (à la) ! appel : au dîner ! Cri des mariniers de la Saône et du Doubs pour faire venir à table leurs camarades. La terminaison de ce mot vient des contrées méridionales, où pénétraient nos gens, vite faits à une accentuation familière. - (14) |
| cive, s.f. ciboule. - (38) |
| cive. Petit oignon vert. Ciboule, ciboulette, que les Parisiens nomment civette. Ce légume était autrefois le principal ingrédient du civet de lièvre. Ce mot n'est plus usité en Bourgogne que dans cette phrase : vert comme cive. - (13) |
| civet, sm. oignon dont le bulbe ne s'est pas développé et qui n'a poussé qu'en tige. - (17) |
| civiée, s. f. civière à bras avec laquelle deux hommes transportent le fumier dans la fosse. - (08) |
| civiée. n. f. - Grosse barre à mine, utilisée pour former un avant trou dans la terre afin d'y planter un piquet ; synonyme de pince. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| civière : s. f., brouette. - (20) |
| civière, n.f. brouette. - (65) |
| civiérée : s. f., contenu d'une civière. - (20) |
| civot (n.m.) : ciboule, ciboulette (a.fr. civet = ciboulette) - (50) |
| civot, s. m. ciboule ou civette et par analogie les petits oignons qui ont poussé l'hiver en terre et qui poussent au printemps. - (08) |
| ciyais ou clliais - ciseaux. - Pote les ciyais à raiguyou : teins à ne copan pu. - Beille mouai voué les petiots ciyais. - (18) |
| ciziau : (nm) ciseau - (35) |
| cizière. s. f. Civière. (Soucy). - (10) |
| cla : noix - (43) |
| cla, s. m. noix. - (24) |
| cla, s. m., feu follet : « Voui, ô s’é pardu. Ol a éporçu des clas, é pi ôl a été, ôl a été. . . é pi ô n'é pas r'veindu ». La croyance persiste encore. - (14) |
| clâ, kià, feu follet, gaz enflammé, suivant parfois, dans la nuit, ceux qui marchent. On prenait, jadis, un clâ pour l'âme d'un défunt ; d'où l'on ne le voyait qu'avec effroi. - (16) |
| clabaud, clabaudeux. n. m. - Braillard, criard. Au XVe siècle, un clabaud désignait un chien aboyant beaucoup et mal à propos, ainsi qu'une personne criant fort sans motif. Le poyaudin a conservé le second sens, attribué à une personne braillarde, alors que le français a gardé l'idée du chien, en déformant clabaud en cabot. - (42) |
| clabaud, clabaudeux. s. m. Braillard, criard. (Saint-Martin-sur-Ouanne). - (10) |
| clabauder. v. - Brailler, crier. - (42) |
| clacoter. v. - Faire du bruit avec des sabots trop grands. (Villiers-Saint-Benoît, selon M. Jossier) - (42) |
| clacoter. v. n. Faire du bruit avec des sabots trop grands. (Villiers-Saint- Benoit). - (10) |
| clafouti, s. m., sorte de gâteau. - (14) |
| clagneau : cage à poulets. - (09) |
| clagneau. s. m. Cage à poulets. (Châtel-Censoir). - (10) |
| clai, dernier-né d'une couvée. - (28) |
| claibassin (n. m.) : bouton d'or - (64) |
| claie (claïe) : s. f., petite claie, syn. de claleau. - (20) |
| claieau (claïeau) : s. m., vx fr. claïet, petite claie, portillon de clôlure, fait soit de barreaux verticaux, soit de branches sèches ou de ronces. Se dit aussi par extension de l'ouverture elle-même. - (20) |
| clailler. v. a. Fouetter. - (10) |
| claimpant. s. et adj . Vaniteux, fanfaron, vantard, qui crie, qui publie tout ce ui le concerne. Du vieux français claim, du latin clamare, et du grec pan. (Percey). - (10) |
| clair : quièr - (48) |
| clair. Feu follet. Dans Y ancien temps, an croyot que les clairs vous corint d'aipreis. - (13) |
| clairai (prononcez quiéré) . On dit dans le Châtillonnais : le feu claire (en latin clarescit), la chandelle claire... - (02) |
| clairai.- (Prononcez quierai), flamber, briller. On dit en Bourgogne le feu claire, la lampe claire. - (06) |
| clair-bassin. n. m. - Renoncule, bouton d'or. - (42) |
| clair-bassin. s. m. Hémérocalle des champs, des prés. - (10) |
| clairdir. v. n . Donner de la clarté, briller. Se dit d’un feu de menu bois, qui brille, qui éclaire en flambant. — Faire clairdir, faire flamber. - (10) |
| clairé. Flamber. - (01) |
| clairer (C.-d., Chal., Morv., Br.), clairdir (Y.). - Cette charmante expression a plutôt le sens de flamber, de luire, que celui d'éclairer. La chandelle claire, mais le feu claire aussi dès qu'il est bien allumé. Faire clairer une allumette, c'est l'allumer. Ce mot vient du latin clarere ou clarescere, qui avait le mème sens. - (15) |
| clairer (v.) : briller, luire - (50) |
| clairer : donner de la lumière. - (66) |
| clairer : v. a. et n., allumer, éclairer. Clairer le feu. La chandelle claire. Voir éclairer. - (20) |
| clairer, v. brûler, en parlant du feu (le feu claire). - (65) |
| clairer, v. être allumé, en parlant d'une lampe (ca claire partout - toutes les lampes sont allumées). - (65) |
| clairer, v. n. briller, luire. faire « clairer » la chandelle, c'est l'allumer; faire « clairer » le feu c'est le faire briller, lui faire jeter de la flamme. - (08) |
| clairer, v. tr., éclairer, luire, allumer, faire flamber : « J'vas clairer l’feû ». — « La chandelle claire ». — « I fait noir dans l'escayé ; claire-me donc ». - (14) |
| clairer, v., briller, éclairer. - (40) |
| clairer, verbe transitif : éclairer. - (54) |
| clairer. Flamber. - (03) |
| clairer. Flamber. Jeute don voi dans lai chemenée des panouillots de troquai (blé de Turquie) pour fare cliarer le feu. C'est le latin clarere. - (13) |
| clairer. Intraduisible, mot exclusivement bourguignon, pour designer l’état d'un foyer qui brille bien, d'une lampe qui éclaire à souhait, d'une lumière qui se répand brillamment. Etym. clairer est venu directement de clarescere dans le bourguignon. - (12) |
| clairevue : imposte vitrée au-dessus de la porte - (48) |
| clairiette, clairiotte, clairieute. n. f. - Clairette, variété de mâche. - (42) |
| clairin. n. m. - Clochette suspendue au cou des vaches. - (42) |
| clairin. s. m. Sonnette suspendue au cou d’un bélier, d’une vache. - (10) |
| clairinéte, s. f., clarinette. - (14) |
| clairiotte, clairieute. s . f. Mâche, doucette. (Véron). - (10) |
| clairîre n.f. Clairière. - (63) |
| clairkhu : voir verluhant - (23) |
| Clairon. Petite fille nommée Claire. - (01) |
| clairté, s. f., clarté, lumière. - (14) |
| clairté. Clarté. - (49) |
| clairvoir : s. m., claire-voie. - (20) |
| clamentie. : Plainte faite à l'autorité (du latin clamare). Clamer un larron c'était dénoncer un voleur à la justice. - Un fau clain était une plainte mal fondée. (Franchises de Salmaise, 1265.) - (06) |
| clampin, adj., lent, musard, négligent : « Quand ô va quête part, ce clampin, ô ne r'vein pu ». - (14) |
| clampin. s. m. Peureux. - (10) |
| clampoing. s. m. Poignée de chanvre triée brin à brin, qu’on lie quand elle emplit la main fermée. - (10) |
| clanchi v. (de clamser, calancher). Mourir. - (63) |
| clancir, crancir, crincir : v. n., vx fr. crincier, se rider, se racornir, se ratatiner. Cette année, les poires clancissent toutes. - (20) |
| clao, adj. fermé, clos. - (38) |
| clao, s.m, clou. - (38) |
| claoler, v. clouer. - (38) |
| clape (clâpe) : s. f., vx fr. clappe, pieu, pal ; jambe. - (20) |
| clape-de-chat : s. f., pied-de-chat, nom vulgaire de différentes plantes du genre gnaphalium, et notamment du gnaphalium dioicum. - (20) |
| clapon : ongle de pied de porc. Déclapouner : retirer les ongles à l’abattage. En Beaujolais : la fête des clapons : plat de pieds de cochons servis aux conscrits dans la maison des conscrites. - (62) |
| clapon : s. m., ételle, éclat de bois ; jambe. Voir ectapon. - (20) |
| clapon, n.m. copeau de hache. - (65) |
| claque. n. f. - Sabot plat avec bride. - (42) |
| claque-bitou : fromage blanc. Qui claque dans l’assiette et bitou pour les petites bites formées par la faisselle ou pour l’impression de chassie ? Voir les définitions précédentes. Henri Vincenot dit « tiaque-bitou ». - (62) |
| claque-bitou, s. m., fromage blanc, de qualité inférieure, mou, maigre, que certains mangent, mais que l'on mélange généralement avec de la farine de maïs pour les volailles. - (14) |
| claque-bitou, subst. masculin : fromage blanc, caillé. - (54) |
| claque-bitoux. Fromage blanc frais. - (49) |
| claquedent. : Remède qu'on ne peut prendre sans claquer des dents. - (06) |
| claquéziau. s. m. Fromage. - (10) |
| claquin, s. m., fromage blanc médiocre. - (40) |
| claquò dé dan. Claquait des dents, grelotait de froid… - (01) |
| clar : s. m., bas-lat. clarum, glas. - (20) |
| clar, adj. clair. - (38) |
| clar, adj., clair, luisant, lumineus. - (14) |
| clar. Tantôt c'est l'adjectif clair, tantôt le substantif féminin clef, et tantôt le substantif masculin clerc… - (01) |
| clar. : Mot à trois significations : 1e clair, du latin clarus ; 2° clerc, du latin clericus ; 3° clair, pour clé ou clef, du latin clavis. - Le dialecte, comme le patois, adoptait l'r final dans certains mots, comme cler pour clé. - (06) |
| clarcelaire, celui qui est le gardien des clefs... - (02) |
| clarceleire. Clavier, d'où peadent les clefs que les femmes d’artisans, et les paysannes portent à leur côté. - (01) |
| clarceleire. : (Dial.), celui qui tient le trousseau de clés, le cellérier, claustri cellarius en latin. - (06) |
| clardir, clairdir. v. - Éclairer : « Sa femme qui l’faisait clairdi' eveuc la lantarne. » (Fernand Clas, p.223) - (42) |
| clardir. v. a. et v. n. Eclairer. Fais-me clardir, éclaire-moi. (Sommecaise). - (10) |
| clarer, v. brûler. - (38) |
| clartè : n. f. Clarté. - (53) |
| class' : n. f. Classe d'école. - (53) |
| clâsse (n. f.) : (renvouéyer la clâsse (vomir)) - (64) |
| clâsse (na) : école - (57) |
| clatai. Clarté. - (01) |
| clatte : grosse noix - (43) |
| claucé. Glousser… - (01) |
| claus, claud : s. m., vx fr. clas. tocsin. - (20) |
| clavau, s. m. hameçon. - (24) |
| claveau : s. m., vx fr, clavel, hameçon. - (20) |
| claveliere, clavelire : s. f., syn. de percerette. - (20) |
| claviette, kiavette. Clavette. - (49) |
| claviot, cramiot : s. m., gros crachat. - (20) |
| clayau : Prononcer : cla--i-o. Claie, sorte de porte à claire voie. « Frame le clayau ». - (19) |
| clayon. s. m. Porte de jardin faite d’une claie de menues branches. (Villechétive). - (10) |
| clée, s. f., clef. - (14) |
| clef des champs (A la) : loc., à la misère. Etre à la clef des champs. Mettre quelqu'un à la clef des champs. - (20) |
| clef-de-montre : s. f., petit poisson plat. Voir feuille-de-saule. - (20) |
| cleignôte. Clignote, clignotes, clignotent. - (01) |
| Clémentine : s. f., nom que dans certains milieux on donne aux paroissiennes de Saint-Clément. Voir Pierrette et Vincentine. - (20) |
| clemisôtte, cligne-musette, jeu. - (02) |
| clèque, cleuque, cléquot. s. m. Couvercle. - (10) |
| clèque, s. m., feuille de tôle, avec laquelle on ferme le four dans les campagnes. (V. Bouche-four). - (14) |
| cléquot, s. m., couvercle. - (11) |
| clére : l'avaloire (harnais du cheval) - (46) |
| cléricau : s. m., clérical. - (20) |
| clertai, clarté, abréviation du latin claritas. - (02) |
| cleu. s. m., clou. - (14) |
| cleuche, s. f. cloche. « clieuce.» - (08) |
| cleûche, s. f., cloche de l'église. - (40) |
| cleuché, s. m. clocher. « clieucé. » - (08) |
| cleuche. s. f. Cloche. - (10) |
| cleucher. s. m. Clocher. - (10) |
| cleuque, s.m. couvercle. - (38) |
| cleuquer, v. fermer avec un couvercle. - (38) |
| cléyo : loquet. (RDB. T III) - S&L - (25) |
| cléyre : avaloir, pièce du harnais de cheval. (CST. T II) - D - (25) |
| cliâ - claie avec tous ses sens français. - Al ant renversai lai cliâ, et pu les poules en entrai dans le jairdin. - Lai cliâ pour fâre soichai les peurnes é besoin d'ète raiquemaudée. - (18) |
| clia, feu follet, que les paysans prennent pour l'âme d'un mort... - (02) |
| clia, s. f., claie, porte basse contre l'invasion de la basse-cour. - (14) |
| cliaiché, cliaiche - clocher, cloche. - Le cliaiché de Sainte-Saibine à bein haut. - En ié deux cliaiches. - (18) |
| cliaiquai – jeter quelque choseavec colère, avec dédain, outre le sens de faire claquer avec un fouet. - Cliaique mouai don cequi diôre. - Al â si faible qu'en le cliaquero conte le mur al y restero. - (18) |
| cliairé - éclairer, brûler. - Le feu cliaire bein lai chambe vai ête beintot chaude. - Cliairez mouai voué qui. - Aituyez don in pecho lai lampe, ile ne cliaire dièrè bein. - (18) |
| cliaire : Entre en composition dans « harbe à la cliaire », nom patois de l'éclaire ou chélidoine (chelidonium majus) ; autrefois on croyait que la sève de cette plante guérissait les maladies des yeux, donc faisait voir clair, d'où son nom cliaire. - (19) |
| cliairtai - clarté. - Ceute lampe qui ne beille dière de cliairtai. - Mouai, i li tré bein â cliair de lune. - (18) |
| cliampter : Avoir une vilaine marche, boiter un peu. - (19) |
| cliaquai - Outre le sens donné ci-devant, punir, fouetter un enfant pour le corriger. - Cliaque moi don ce petiot gamain lai. - S'a cliaquaint quement qu'en fant lote enfant, â choingero, i vo le dis, mouai. - (18) |
| cliaque bitou, Nom vulgaire et facétieux du fromage blanc. Quand on a les yeux enflammés et bitoux, il faut y claquer, non : y appliquer un cataplasme de fromage blanc. Dans l’Yonne on dit : du claque-ziaux. - (13) |
| cliar ou cliâ : Clair, « S't'affâre (affaire) n'est pas cliare ». « In cliâ de leune ». - (19) |
| cliar, cliair, e, adj. clair. « fère cliar », éclairer au propre, donner de la clarté. - (08) |
| cliarer : Luire. « An est cantant (content) de voir cliarer le sola ». « Est ce que tan fû cliare ? » est-ce que ton feu est allumé ? - (19) |
| cliarté : Clarté. « Vla in lurot (un lumignon) que ne donne guère de cliarté ». - (19) |
| cliarté, cliairté, s. f. clarté, ce qui éclaire. - (08) |
| cliate : Nuque. « Le sola est bin ardent, je va mentre (mettre) man grand chépiau que me garantit bien la cliate ». « Teudre la cliate » : avoir le cou tordu, déjeté. - (19) |
| cliaudaine, chaudeur : s. f., vx fr. chaudain (adj.), chaleur. - (20) |
| cliavalée : Clavelée. « Tes moutans ant ésu (ont eu) la cliavalée ». - (19) |
| cliavette : Clavette. « Freme bien le volet a peu mens (mets) la cliavette ». - (19) |
| cliclicou (A) : Ioc. adv., à califourchon sur les épaules. - (20) |
| clié - clé. - Vo mettez vote clié dan le trou des poules ; ce n'à dière caiché, ailé. - Le pore gairson al eume bein lai clié des champs ! - (18) |
| clié : Clef « La porte est fremée à clié ». - « Avoi pardu sa clié » avoir la diarrhée. - (19) |
| clié ou cliai : Clair. « Je t'y prouverai clié c'ment le jo ». - Clairsemé. « Le blié est bin clié c 't'an-née». - (19) |
| clièque, n. masc. ; couvercle. - (07) |
| clieuchatte : « Si tocetés qu'ant des défauts caichis avint des clieuchattes cen farait in biau carillan » : si tous ceux qui ont des défauts cachés portaient une clochette cela ferait un beau carillon. - Clochette, ancolie (aquilegia vulgaris) - (19) |
| clieûche : Cloche Dictons : « An ne peut pas être à la procession à peu sonner les clieuches ». « Qui n'entend qu'eune clieuche n'entend qu'in san ». « Aller à clieuche pid » : marcher en sautant sur un seul pied. - (19) |
| clieuche-pid (à) : Aller à clieuche-pid : marcher en sautant sur un seul pied. - (19) |
| clieûchi : Clocher. « Manter au clieûchi » : monter dans la tour du clocher jusqu'à l'étage où est la cloche. « Y est méde au clieûchi » : l'horloge du clocher marque midi. A Mancey il n'y a pas d'horloge au clocher, cependant les cultivateurs qui sont dans les champs connaissent tout de même l'heure de midi par l'ombre du clocher. - (19) |
| clieunai - pencher. - Lai perche n'a pâ bein pliantée, te vouais ; ile clieune ai droite. - Regairdez don, tenez ces deux enfants lai clieunant ine épaule. - (18) |
| cligni : cligner - (57) |
| clincher. v. - Pencher, incliner. - (42) |
| clincher. v. n. Pencher. - (10) |
| clin-clin : auriculaire - (37) |
| clinpan : Ongle du sabot des ruminants. « Ma vaiche a eune gravalle (un gravier) entreme (entre) les cliapans ». - (19) |
| clio, cliolai - clou, clouer. - I ai aichetai des clio ai saibots. - Retappe don voué ce clio lai que crôle. - A lai cliolerant, et pu ci teinré. - (18) |
| cliôche. : (Prononcez clieuche), cloche, - et clioché (prononcez quyauché), clocher. - (06) |
| cliôt : Clou. « In cliôt de sabeut ». « Ol est gras c'ment in cent de cliôt » : il est extrêmement maigre. « O charche des cliôts » : il marche la tête baissée comme quelqu'un qui cherche un objet perdu. « Ol a campté les cliôts à la porte » : il a trouvé la porte fermée ; autrefois les portes étaient faites de fortes planches assemblées par de gros clous à large tête. - Nom de lieu : « la Fontaine du Cliôt ». - (19) |
| clioté : Cloutier. « La rue des cliotés », nom d'une rue du village de Mancey. - (19) |
| cliôter : Clouter, clouer. « Cliôte me dan mes courroies (brides) de sabeuts ». - (19) |
| cliquart. s. m. Boiteux. - (10) |
| cliques. s. f. pl. Jambes. — Prendre ses cliques et ses claques, s’échapper, s’esquiver. - (10) |
| cliquot. Loquet de porte. Al ast trop petit pour œuvre le cliquot. — Cliquette, instrument composé de morceaux de bois que l »on frappe l'un contre l'autre : les anciens règlements enjoignaient aux ladres ou lépreux de s'en servir pour avertir les passants de leur approche. Cliquer ai lai pôrte, c'est essayer d'ouvrir. C'est la même onomatopée que claque. - (13) |
| clishe : diarrhée. On dit aussi : fouire. - (62) |
| clivai, cliveures, clive, (on mouille l’l) - cribler, criblures, crible. - Prôtez mouai vote clive, i vourâ clivai nos vosses. - Tenez, voiqui des bonnes cliveures pou vos poules. - (18) |
| clivai. : Éplucher, rechercher. (Del.) - (06) |
| clivasse. s. f. Criblure. - (10) |
| clivay, éplucher, rechercher. - (02) |
| clive, crible ; clivé, passer au crible. - (16) |
| clive, s. m. gros tamis qui sert à séparer le sable fin des pierres ou du gravier. - (08) |
| clive. Crible. Du suivant. - (12) |
| clive. s. m. Crible. - (10) |
| cliver, v. a. se servir du « clive » pour trier les arènes, les sables, les terres. - (08) |
| cliver. Pour cribler. Déformation par l'usage populaire. - (12) |
| cliver. v. a. Cribler. - (10) |
| clivûre, criblure, les mauvaises graines que le crible sépare des bonnes. - (16) |
| clivure. s. f. Criblure. - (10) |
| clliousieau, pré clos près la maison. - (05) |
| clo : le plus petit d'une nichée ou couvée. (BD. T III) - VdS - (25) |
| clô, clou (n.m.) : clos,enclos - (50) |
| clô, s. m. claie, ouvrage de menu bois entrelacé et à claire voie; « clô de chaufau », claie dont se servent les maçons. - (08) |
| clô, s. m., racine d'arbre affleurant le sol. - (40) |
| cloa s. m. Clou, furoncle. - (10) |
| cloche de bois : s. f., commission arbitrale des loyers, juridiction créée pendant la guerre de 1914-1918 pour solutionner les litiges entre propriétaires et locataires. - (20) |
| cloche. Sonnette de la maison que le visiteur fait mouvoir du dehors à la porte d'entrée. - (12) |
| clochemiau. s. m. Primevère des prés. - (10) |
| clocheron : tas de foin en forme de cloche. (M. T III) - B - (25) |
| clochôte. Clocbette. - (01) |
| cloficher. : (Dial.), attacher avec des clous (en latin clavum figere). - (06) |
| cloiche, s. f., cloche. - (14) |
| cloicher, s. m., clocher. - (14) |
| cloie. s . f. - (10) |
| Cloiseau (le), nom de localité assez commun dans la toponomastique rurale. - (08) |
| clombé - colombier. - En i aivo es aute fouai in grand clombé â châtais, qui en ai vu mouai-mainme les résses. – Métenant en fait des clombé de ran, pou i mette deux ou trois pingeons, voilà to. - (18) |
| clon. n. m. - Grand panier. - (42) |
| clon. s. m. Grand panier pour ramasser le charbon dans les bois. (Puysaie). - (10) |
| clop et quelot. C'est le dernier venu d'une couvée : il est souvent écloppé. Les jeunes poussins et surtout le clop, marchent clopin-clopant. - (13) |
| cloquer v. Glousser. - (63) |
| cloquer : v. n., glousser. - (20) |
| cloquer, v. glousser. - (65) |
| cloquer, v., se dit des poules qui vont pondre. - (40) |
| cloquer. Glousser. - (03) |
| cloquer. Glousser. Ce mot vient de « cloc ! » cri poussé par une poule couveuse. - (49) |
| cloquer. v. n. Glousser. Les poules cloquent. Du latin glocire , et du provençal clouco. (Argenteuil). - (10) |
| clore, cliore, clioure : s. f., cendre. On dit peut-être du clore, de même qu'on écrit : « Lessive au cendre » (lu sur la porte d'une laveuse). - (20) |
| cloretier, cloreti (clor'ti) : s. m., cendrier. - (20) |
| closse. s. f. Poule couveuse. (Dillo). - (10) |
| closser : poule demandant à couver - (39) |
| closser. v. - Glousser. - (42) |
| clotè : clore - (46) |
| clôté : v. t. Clôturer. - (53) |
| cloter : boucher les trous des fonds des feuillettes. - (09) |
| cloter : clore - (48) |
| clôter : clore avec des pieux - (39) |
| clôter, v. a. clore, fermer par un obstacle quelconque; on « clôte » un champ en l'entourant de fossés ; on plante une haie pour « clôter » un pré. - (08) |
| cloter. v. a. Boucher avec des faussets les trous des douves et des fonds des vieilles futailles. (Châtel-Censoir). - (10) |
| clotsse : cloche - (51) |
| clou : furoncle. - (62) |
| clou, s. m. clos, enclos, lieu clos de murs ou de haies. - (08) |
| clouaison (na) : cloison - (57) |
| clouch'e : s. f. poule couveuse. - (21) |
| cloucloute, sf. chèvre. Voir bicloute. - (17) |
| clouer. : Enclore (du latin claudere), clouer sa vigne, c'est-à-dire l'entourer de quelque palissade ou la clore de murs. (Cout. de Beaune, 1270.) - (06) |
| clouier, v., mettre des clous dans un sabot. - (40) |
| clouriot. s. m. Verrou. Du roman cloure, et du latin claudere. - (10) |
| clous. s. m. Clôture de bourrées, de branches entrelacées dans des piquets, dans des pieux. Se dit, par un vice de prononciation, pour clos. - (10) |
| clousiau. s. m. Clos, ( Villiers-Saint-Benoît). - (10) |
| cloux, s.m. clos (verger). - (38) |
| cluchater : Glousser comme une poule qui conduit ses poussins. - (19) |
| cluche : Poule couveuse. « La cluche défend ses p'sins (poussins) ». - (19) |
| clune : enveloppe d'édredon, d'oreiller. - (30) |
| clune : s. f., édredon, et toute couverture garnie de bourre (laine, crin, glume). Voir bourrasse. - (20) |
| cman (adv.) : comment - (50) |
| cman é fô ; l'on dit de quelqu'un qui est bon et sans reproche : él â bén cman é fô. - (16) |
| c'man, adv. comment. « C’man qu'vô dié » ? Comment dites-vous ? « C’man qu'a fiô ? » comment faisait-il ? - (08) |
| cman, comme et comment ; fè cman s'ki, fais comme cela ; cman k'te di ? comment dis-tu ? - (16) |
| cmandé, commander ; cmand'man, commandement, ordre donné. - (16) |
| cmandé, vt. commander. - (17) |
| c'mandeman, s. m. commandement. - (08) |
| cmander v. Commander. - (63) |
| c'mander, v. a. commander. « C’mandé moué s' vô v'lé ; — i veu bin qu'a m'c'mande », donnez-moi des ordres si vous voulez ; je veux bien qu'il me donne des ordres. - (08) |
| c'mander. Commander. - (49) |
| cmandeux, euse n. Organisateur, coordinateur. A aussi un sens péjoratif. - (63) |
| cmansé, commencer ; cmans'man, commencement. - (16) |
| c'mencè : v. t. Commencer. - (53) |
| c'mencer, v. a. commencer : « por en défini, a fau c'mencer », pour en finir il faut commencer. - (08) |
| c'mencer, v. tr., commencer. - (14) |
| cmenchi v. Commencer. - (63) |
| c'ment : Comme, comment. « I fa ne c'ment poivre », il fait nuit comme poivre. « Ah bin Liaude t'as été à la comédie, y as tu troué brave, t'es tu bien amusé ? - Oh c'ment ci, c'ment cen » : Eh bien Claude tu as été au spectacle, était-ce beau, t'es-tu bien amusé ? Oh comme ci comme ça, pas beaucoup. - « Je sais pas c'ment fare » : je ne sais pas comment faire. - (19) |
| cment adv. 1.Comment. 2. Comme. - (63) |
| c'ment c' que..., loc, comment est-ce que ?« C'ment c' qu'on dit? » — « C'ment c'que t'as fait pour cheûdre ? » - (14) |
| cment çan adv. Comme ça, ainsi. - (63) |
| c'ment c'qui dans c'temps lai : exp. Encore appelée ainsi en ce temps-là. - (53) |
| c'ment : 1 conj. Comme. - 2 adv. Comment. - (53) |
| c'ment, conj., comment, comme. La prononciation élide absolument om : « C'ment c’qui s’fait-i ? » — Certains l'écrivent Quement. - (14) |
| çmentire : cimetière - (51) |
| c'meude : Aisé, facile. « Y est pas c'meude à savoir ce qu'ol a dans le ventre » : il n'est pas facile de savoir son opinion. « Y est in gâs qu'est pas c'meude » : c'est un individu qui n'est pas d'humeur agréable. - (19) |
| c'meude : Commode, meuble où l'on sert le linge. « T'as dan ageté eune c'meude ». - (19) |
| cmeude, commode, facile. - (16) |
| c'min : Cumin (seseli montanum) plante aromatique. - (19) |
| cmode adj. Commode, aisé, facile. - (63) |
| cmöde, adj. commode. - (17) |
| c'modité. Commodité. - (49) |
| ç'nale : cenelle (baie de l'aubépine) - (48) |
| c'nales : baies de l'aubépine. Les oujats m'jont les c'nales l'hiver : Les oiseaux mangent les cenelles. - (33) |
| c'neuchu : connu - (48) |
| c'neûte : connaître - (48) |
| cneutre, sm. connaître ; pp. cneussu. - (17) |
| cô : dindon (en A : codinde*). B - (41) |
| co - cou et coup, dans tous les sens de ces mots. - I ai mau à co ; in rumatisme, i pense. - Mets ine cravate âtor de ton co, cair en fait froid. - En i é des co que ci ne réussit pâ ma ç'â rare. Voyez Cot. - (18) |
| cô (C.-d.), cot (Chal.), coi, coite (Y.), côte (Char.), couau, coyau (Morv.), sote (Br.), (Être à la). - Être à l'abri, se tenir caché, tranquille ; mot formé du vieux verbe français : coiter, coiser, qui a la mème signification et duquel est restée l'expression: « se tenir coi, sans mot dire. » Coïter vient du latin quietus, tranquille, ou quietare, donner le repos à… - (15) |
| cô (n.m.) : ver blanc - (50) |
| co (na) : cour - (57) |
| co , cou , coup, cour, court. - (05) |
| cô : (nf) cour ; « à la cô » : dehors - (35) |
| cô : Cou. « Teudre le cô à in poulot » : étrangler un poulet. - Proverbe : « I vaut mieux tendre le bré que le cô » : il vaut mieux demander à boire que de se laisser avoir soif. - Goulot : « In cô de botaille ». - (19) |
| cô : Coup. « In cô de bâtan, un cô de feusi ». « Le premé cô de la masse » : la première sonnerie annonçant la messe. « Prendre in cô de sola à l'ambre » : prendre une cuite, se griser. « Etre aux cents côs » : être trés inquiet, ne pas savoir quelle détermination prendre. - (19) |
| co : Cour. « Le portau de la co » : le portail de la cour. Le pluriel cos, entre dans la composition des noms de quartiers : les Cos Bry (à Mancey), Les Cos Bôchey (à Boyer), les cos Duriaud (à Jugy), les cos Desbois (à Bray). - Expression « T'es cent côs » : être très inquiet, ne pas savoir qu'elle détermination prendre. - (19) |
| co : court (cotch au féminin) - (46) |
| co : Court, au féminin corte. « Des manges (manches) treu cortes ». « Y est le pu co chemin » : c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Plaisamment : « Y est teu co d'in bout ». - (19) |
| cô : dindon - (61) |
| co : dindon - (48) |
| co : fois, coup - (43) |
| co : la cour de ferme - (46) |
| co : ver blanc - (48) |
| co ; ein co, une fois ; deû co, deux fois, etc. - (16) |
| co byanc n.m. Larve de hanneton ou de cétoine. On dit aussi coteriau. - (63) |
| co de cu - Dans un chemin montée peu considérable qui ne demande qu'un effort un peu plus grand du cheval. - C'a ine route bein âsille ; en ié deux petiots co de cu, et le résse ç'à pliainne. - (18) |
| co d'inde, subst. masculin : dindon, coq d'Inde. - (54) |
| cô n.f. Cour de ferme. - (63) |
| co n.m. 1. Cou. 2. Gros ver, larve. - (63) |
| cô : (cô - subst. m.) 1 – coup. 2- fois. - (45) |
| co : (co - subst. m.) 1- turc, ver blanc. Pour d'autres, il s'agit de la mite. 2- dindon - (45) |
| co : n. m. Ver blanc. - (53) |
| çô : v. t. Coup. - (53) |
| cô, 1. s. f. cour. — 2. Adj. court. Féminin côrte. - (24) |
| co, coup ; é m'ai béyé dë co, il m'a frappé plusieurs fois. - (16) |
| co, insecte parasite de la laine. - (16) |
| co, n.m. ver blanc, larve de mite. - (65) |
| cô, s. m. ver qui se met dans les étoffes de laine et qui les ronge. - (08) |
| co, s. m., cou. - (14) |
| co, s. m., coup, fois : « Y a des cô que j' vas prou ben ; épeû des cô qu' la gigue me fâ prou mau ». - (14) |
| cô, s. m., ver blanc (larve de hanneton). - (40) |
| co, s.m. aristoloche. - (38) |
| co, s.m. larve du hanneton ; ver de mite. - (38) |
| cö, sm. cou. - (17) |
| cö, sm. coup. Tö po n'è cö, lö por è cö, tout à coup. - (17) |
| cô, sm. fond de la grange. Le revenu inférieur au reste. - (17) |
| co, subst. masculin : ver blanc ou ver gris. - (54) |
| cô. Coup, coups, ou cou, collum. - (01) |
| co. n. m - Coq. - (42) |
| co. Ver.« Cte poutre est tote migi des cos ». Ce mot se retrouve dans d'autres patois. - (49) |
| co’dinde : coq d’Inde…. Pour d’autres le dindon (pourtant non originaire de l’Inde), pour nous le cou d’Inde : un poulet au cou nu (sans plume), et par dérision : personne maigre et au long cou. - (62) |
| coanner : crier comme l'oie ou le canard - (51) |
| cobin : Combien. - (19) |
| cobin adv. Combien. - (63) |
| cobin. Combien. « Cobin que t'en ais ? ». - (49) |
| cobi-yi, acabessi, coubyi : courbé, plié - (43) |
| coblanc, cobianc. Ver blanc à hanneton. - (49) |
| coç’er (l’) : (la) toute petite étoile, placée au-dessus de la deuxième des trois constituant la queue de la grande ourse (ou plus prosaïquement du « timon » du « chariot ») - (37) |
| coca : (cocâ: - subst. m.) récipient de cuisine (chaudron, cocotte, casserole, poêle, etc.). - (45) |
| cocaisse(n.f.) : pot pour traire les vaches (aussi coquâ = marmite). - (50) |
| cocalle, s.f. coquelle, cocotte ; récipient en fonte à deux oreilles. - (38) |
| cocard (ain) : (un) œil poché - (37) |
| cocardeau, cocardiau : s. m., cocarde et spécialement rosette de ruban fixée au sommet du brelot. - (20) |
| cocâs : ustensiles usagés, vieux récipients - (39) |
| cocassons : débris de verrerie ou poterie. - (33) |
| cocep, coucep (prononcez cosset, cousset). s. m. Tronc de vigne. De coue, queue, souche, et de cep. (Gourgis). - (10) |
| cocha : s. m. au sommet. - (21) |
| cochan : Cochon, porc. « Donner de la canfiteure à des cochans », traduction libre de « margaritas ante porcos ». « Repas de cochan » : festin qu'on donne quand on tue le cochon. « Cochan de cave » : cloporte. - (19) |
| coche : truie - (61) |
| coche : s. f. cosse. - (21) |
| coche : s. f., cône de métal qui coiffe l'extrémité supérieure du fuseau et qui a une rainure hélicoïdale sur laquelle s'enroule le fil. - (20) |
| coche : s. f., cosse. - (20) |
| còche, s. f. 1. cosse de haricots, pois, fève, colza - 2. Entaille destinée à servir de remarque. - (24) |
| coche. Gousse de légumineuses. - (49) |
| coche. n. f. - Truie n'ayant pas encore eu de petits. Coche était employé en ancien français comme féminin logique du cochon, parallèlement au mot truie. Ce néologisme était encore en usage en français dans la première moitie du XXe siècle. - (42) |
| cocheri, cochet. s.m. Broche, robinet. - (10) |
| cochette. Femelle du cochon. On dit aussi« cotsette ». - (49) |
| cochon : s . m. cochon. - (21) |
| cochon : s. m. Dîner de cochon, repas composé exclusivement de cochon, qu'on fait à l'occasion du « sacrifice » de cet animal. - (20) |
| cochon, n.m. porc. - (65) |
| cochon. n. m. - Cloporte. - (42) |
| cochon. s. m. Cloporte, insecte. - (10) |
| cochon-de-cave, s. m., cloporte. - (14) |
| còcmache, s. f. nom plaisant de la pirouette : faire la còcmache. - (24) |
| cocmale, s. f. large champignon ; par dérision, coiffure trop large. - (24) |
| coco : voir caqui - (23) |
| coco : s. m., gobelet en cuir. - (20) |
| coco, oeuf (terme enfantin), Coco se dit aussi pour Jacques. - (16) |
| coco, s. m. œuf dans le vocabulaire enfantin. - (08) |
| coco, s. m., œuf. - (14) |
| coco, terme dérisoire, pris adjectivement : « T'ét encore eun joli coco ! » — Dans une localité voisine, un vieil avare, qui était borgne, avait reçu des gamins le surnom de « Coco-bel-œil ». - (14) |
| cocodète, onomat. enfantine, imitant le cri de la poule qui pont. Parfois on multiplie les premières syllabes : « Co-co-co-codète ! » - (14) |
| cocodrille, s. m., crocodile. - (14) |
| cocon n.m. (prov. coco, coque, coquille). Œuf. - (63) |
| cocon : s. m. œuf. Voir u. - (21) |
| cocon : s. m., œuf. Faire cocon dîner, faire cocon dinette, faire la dinette. - (20) |
| cocon, n.m. œuf. - (65) |
| cocon, s. m. nom plaisant de l'œuf. - (24) |
| coconer, v. a. embrasser, caresser tendrement, en langage badin. - (24) |
| coconner v. Embrasser, caresser. - (63) |
| coconner : v. a embrasser, caresser, menailler. Voir coquer. - (20) |
| coconnier, coconnière : s. m. et f., embrasseur. - (20) |
| cocote : fièvre aphteuse - colchique d'automne ou veilleuse. A - B - (41) |
| cocoter (verbe) : caqueter. - (47) |
| cocotte (nom féminin) : fièvre aphteuse. - (47) |
| cocotte : fièvre aphteuse - (43) |
| cocotte : fièvre aphteuse - (48) |
| cocotte : fièvre aphteuse colchique d'automne ou veilleuse - (34) |
| cocotte : fièvre aphteuse du bétail. - (62) |
| cocotte : Fièvre aphteuse, maladie du bétail que l'on appelle aussi « lemaicheure », voir ce mot. - (19) |
| cocotte : fièvre aphteuse, maladie très contagieuse chez les porcs et les ruminants. - (33) |
| cocotte n.f. Fièvre aphteuse. - (63) |
| cocotte. Poule. - (49) |
| cocotte. s. f. Ustensile de cuisine, ordinairement en fonte, dans lequel on fait cuire de la viande, des pommes de terre, etc. Du latin coculum. - (10) |
| cocrillai - Se dit des feuilles qui se roulent, se contournent par suite de maladie ou de sécheresse. - Les âbres sont mailaides ceute année ; des vers se mettant dan les feuilles, et pu â se cocrillant. C'â quemant l'année passée qu'à se cocrillaint déjà ; seulement, c'éto lai saicheresse. - (18) |
| cocu (n. m.) : se dit d'un remède inefficace, d'une action sans résultat (ça yi fait autant qu'du cocu aux canes) - (64) |
| cocu : coucou (oiseau), primevère (botanique) - (51) |
| cocu aux canes (du) : très exactement : un emplâtre sur une jambe de bois. Totalement inefficace. Ex : "La barriée qu't'as mise là, c'est coumme du cocu aux canes !" - (58) |
| cocu : s. m., coucou, primevère jaune (primula officinalis). - (20) |
| cocu, cornat ou cornard. Mari trompé par son épouse. Ces termes sont populaires dans bien des régions. - (49) |
| cocu, coucu, couquiu. s. m. Nom donné vulgairement, à cause de sa couleur, à la gomme blonde et quelquefois jaune, qui écoule de certains arbres. — C’est aussi un des noms du coucou. - (10) |
| cocu, s. m. primevère officinale, primula officinalis. « cocu » = coucou, nom de la plante en plusieurs pays. - (08) |
| cocu. s. m. Fruit de l’églantier, gratte-cul. (Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes). - (10) |
| cocuasse : ciguë - (60) |
| cocue, n. fém. ; ciguë. - (07) |
| cocue. s. f. Ciguë. - (10) |
| cocuée, s. f. ciguë. - (08) |
| cocuesse, cocuée (n.f.) : ciguë - (50) |
| cocufier. Faire « cocu », rendre « cocu ». - (49) |
| codât. s. m. Nuque du cou. (Percey). - (10) |
| code : (nm) coude - (35) |
| code : coude - (43) |
| code n.m. Coude. - (63) |
| code, charbonnette. - (26) |
| codééd' : n. f. Dinde. - (53) |
| codelei. Cordelier, cordeliers… - (01) |
| codelle, corde... On dit à Châtillon codeler, c.-à-d. faire de la corde, et une ficelle mal codelée, pour exprimer que le chanvre qui la compose est mal tressé... - (02) |
| codelle. : Petite corde. On dit une ficelle mal codelée, pour exprimer que le chanvre est mal tressé. - (06) |
| coder, queuder. Caler, s'appuyer contre un mur, un arbre. Fig. Être arrêté par une difficulté. - (49) |
| codinde : dindon (en B : co*). A - (41) |
| codinde : (nm) dindon - (35) |
| codinde : dindon - (44) |
| codinde : dindon (coq d'Inde) - (48) |
| codinde : volaille n'ayant pas de plume sur le cou - (43) |
| codinde n.m. Dindon. - (63) |
| codinde : dindon. Ex : "Ce loufou d’codinde, y vas bin fougaler les poules ..!" - (58) |
| codinde : n. m. Dindon. - (53) |
| codinde, n.m. dindon. - (65) |
| codinde, s. m., dindon mâle, vieux mâle. - (40) |
| côdje : la corde - v'lai l'temps qu'se gâte, è vè cheur des côdjes, voilà le temps qui se gâte, il va tomber des cordes - (46) |
| codje, sf. corde. - (17) |
| codjelö, sm. cordier. - (17) |
| codjre, vt. coudre. ; pp. coudu. - (17) |
| codon. Cordon, cordons. - (01) |
| codot : lièvre. - (31) |
| côdre : Courge (fruit). « De la sope à la côdre » : de la soupe à la courge. « La misâre n'est pas tote su les côdres » : il y a beaucoup de malheureux. - (19) |
| côdré : Courge (plante), cucurbita maxima. Côdré sauvage : bryone. - (19) |
| codre, courge. Codrier, sa tige. - (05) |
| codre, s. f., courge, potiron. - (40) |
| côdre, s. f., courge. - (14) |
| codre. Courge. Nous appelons codron une petite courge. - (03) |
| côdrée : couturière - (39) |
| côdron, s. m. petite courge. Dim. de côdre. - (14) |
| coèche. s. f. Grande cuillère avec laquelle on sert ordinairement la soupe. (Perrigny-lès-Auxerre). - (10) |
| coéger, v. ; se coéger ; se taire ; coège-toi donc baibillaire. - (07) |
| coeiffai. Coiffe, coiffer… - (01) |
| coerre, v. ; courir. - (07) |
| cœu. Cœur. On dit aussi cœur en bourguignon, comme en français. Le choix en poésie dépend de l’oreille. - (01) |
| coeudeure, s. f. couture. Verbe : coeudre. - (22) |
| coeudre : coudrier, noisetier. III, p. 31 - (23) |
| coeur (nom masculin) : cerise bigarreau. Fruit du coeurier. - (47) |
| cœur de la ville (le) : loc.. se disait couramment, au milieu du XIXe siècle, du point central de Mâcon, plus anciennement connu sous le nom de la Cour au Prévôt, situé à la jonction des rues de la Barre, Philibert-Laguiche, Lamartine et Sigorgne. - (20) |
| coeûr n.m. Cœur. Alle a maîs d'cul que d'coeûr. Elle est plus grosse que bonne. Voir corée. - (63) |
| cœur : s. m., petit baquet de bois, en forme de cœur, qu'on met sous la bouteille quand on tire le vin. - (20) |
| coeur. n. m. - Grosses cerises. - (42) |
| cœuraille, s.f. intérieur d'un fruit ; partie qui enveloppe les pépins. - (38) |
| coeurer : vider, dépouiller, « plumer » (curer), (voir : équeurer), sens élargi de « coeuré » : fatigué, épuisé, vidé (de ses forces). - (56) |
| cœurlaieux (cœurlaïeux) : s. m., individu qui plait aux dames, qui enchaîne les cœurs. Voir laieure. - (20) |
| coeur-sanni (adjectif) : trop cuit, brûlé Jusqu'au cœur. - (47) |
| coeuteure, s. f. terrain fraîchement travaillé. - (22) |
| coffer. v. n. boursouffler, faire un vide, former un creux. Un enduit de mortier qui se lève « coffe » ; un navet « coffe » lorsqu'il est creux à l'intérieur, etc... - (08) |
| cöfre, sm. coffre. - (17) |
| cogbeuille : corbeille en osier - (43) |
| cogé (se), se taire.On dit à un enfant coge teu, c.-à-d. tais-toi ; c'est le latin même coge te. (Voir au mot coyser.) - (02) |
| cogé (se), vt. se taire. Voir cosé. - (17) |
| cogé (se). : Se contraindre, cesser de faire une chose (en latin cogere se, se violenter). Les villageois disent à un enfant qui pleure ou s'agite trop : Coge te, c'est-à-dire apaise-toi ou cesse de remuer ; mais cette forme serait peut-être plutôt une sorte de contraction du mot acoiser, comme acoise te, coise te, coge te. - (06) |
| côger (se), v. pr., se taire, se calmer, s'apaiser : « Côge-te, vou ben je !... » Ce fragment de phrase est tout bonnement un Quos ego de village. - (14) |
| coget. s. m. Goulet. (Percey). - (10) |
| cognai (se), se heurter contre quelque chose. Dans le vieux français, cogne signifie coin, angle, exprimé en bas latin par cognus. (Roquefort.) Se heurter se disait en vieux français se coigner. (Voir Nicot. ) - (02) |
| cognaîte v. 1.Connaître. 2. Voir, remarquer. Y s'cognaît pas. Ça ne se remarque pas. - (63) |
| cognaître (pers. du pl.: nous cognaitsan, vous cognatsi) : connaître - (43) |
| cognaître : (vb) connaître (personnes du pl : nous cognaitsans, vous cognaitsiz) - (35) |
| cognaitsance n.f. Connaissance, amant, maîtresse. - (63) |
| cogne, s. f. coin, angle retiré : « J'lai métu dans la cogne de la ch’vinée. » - (14) |
| cogne, s. m., gendarme. - (40) |
| cogne. Gendarme. - (49) |
| côgne. s. m. Gendarme. (Argenteuil). - (10) |
| cogne. : Angle et coin (en bas latin cognus. (Roq.) - Ce mot a pour diminutif cognôle, petit coin. - (06) |
| cogne-doux : s. m., ouvrier paresseux, qui travaille mollement. - (20) |
| cogne-doux, subst. masculin : fainéant, paresseux. - (54) |
| cogne-dur : s, m., ouvrier laborieux, qui travaille activement. - (20) |
| cogner les pau : avoir la tête qui tombe (endormissement incontrôlé) - (60) |
| cogner, gougner, regougner, recogner. Remettre en place par des moyens empiriques (massages avec signes cabalistiques). - (49) |
| cogner, v. tr., battre, flanquer une correction : « Attens, matou ! j’m’en vas t'cogner po t'éprende à miger mon beûre ! » - (14) |
| cogneu, pain blanc d'un kilo qu'une marraine offre à son filleul en étrennes pour le jour de l'an (coutume perdue depuis longtemps). - (27) |
| cogneu, sm. cadeau, pot de vin. Gâteau de noël. Etrennes de pâques. Voir roulée. - (17) |
| cogni : (vb) cogner, s’assoupir, somnoler - (35) |
| cogni : cognée - (43) |
| cogni : cogner - (51) |
| cogni : cogner, enfoncer un piquet - (43) |
| cogni : s'assoupir, somnoler - (43) |
| cogni v. (du lat. cuneus, coin) Cogner, frapper. - (63) |
| cognie : cognée - (51) |
| cognie n.f. (du lat. cuneus, coin) Hache à fendre ou à abattre, à fer étroit. - (63) |
| cognie, coignie, cougnie. n. f. - Cognée. - (42) |
| cognie. Cognée. - (49) |
| cognier : s. m., vx fr. coignier, cognassier. - (20) |
| cognin : cognée. (PLS. T II) - D - (25) |
| côgnon (n. m.) : croûton de pain - (64) |
| cognon. n. m. - Pain, petite couronne. - (42) |
| cognotte, petit pain. Diminutif de cogne, coin, angle de quelque chose. - (02) |
| cognotte. s. f. Bosse à la tête. - (10) |
| coi (à la) : A l'abri de la pluie : « O s'est mis à la coi seu in noué ». - (19) |
| coi (être a la), loc. être à l'abri, à couvert. - (08) |
| coi : mettre à la coi, à l'abri de la pluie. - (21) |
| coiche, s. f. coche, femelle du porc. Lorsque la coche a porté plusieurs fois, on la nomme plus ordinairement « treue » = truie. - (08) |
| coichon, s. m. cochon, porc. - (08) |
| coichot. s. m. Cochon. - (10) |
| coie (A la), quoie (A la) : loc, à l'abri. Se mettre à la coie. - (20) |
| côié, s. m. collier. - (08) |
| coïé, sm. crier. - (17) |
| coïer (se), se taire - (36) |
| coier (Se). Autrefois : se coiser. Se taire, se tenir coi, avoir peur. Ce verbe est de la même famille que couard, poltron, et que coïon, dont le sens est le même. Ma ! reiste don tranquille : coïe-tai teut de suite... Le patois Dijonnais écrit se couzer. - (13) |
| coïer, s. m. collier. (Prononcez có-ïer). - (14) |
| coiffe, n.f. péritoine du porc. - (65) |
| coiffe, s. f., péritoine du porc. - (40) |
| coiffe. Ce mot est dérivé du vieux français scoffion, escoffion, en basse latinité scafio... Le scoffion du Moyen-âge ressemblait à la coiffe des hospitalières de Beaune. Les coiffes tuyautées se portaient jadis dans les villages de la plaine et les coiffes plissées dans ceux de la montagne. En ville, on avait adopté les bonnets, ou plutôt les chapeaux de bonnet, car c'est le nom d'une étoffe. Un vieux poète a écrit : « un chapelet de bonnet en sa tête. » Dans les environs de Beaune, les coiffes ont presque disparu : on en découvre encore quelques-unes dans les villages du fond de l’Auxois. - (13) |
| coiffe-a-bras. : Sorte de coiffure des servantes du XVIe siècle. - (06) |
| coiffeûre : Coiffure. « Eune coiffeure de brachande (de bressane) ». - (19) |
| coigne - bouse de vache ou de bœuf, surtout quand elle est très large.- Que les rues sont don sâles, tote pliainnes des choignes de lai vaicherie ! - Quand en met les vaiches dans les prais les choignes les salissant bein. - (18) |
| coigné ; s'coigné, se mettre dans un coin. - (16) |
| coigné, coigner (n.m.) : cognassier - (50) |
| coignée, couégnée : cognée. On cope du bois aveuque une coignée : on coupe du bois avec une cognée. - (33) |
| coigner : cognassier - (44) |
| coigniay, s. m., cognassier. - (40) |
| coignie (n.f.) : cognée, hache - (50) |
| coignie : cognée = hache. Ex : "Au bois, tins bin ta coignie !" - (58) |
| coignot, couignot. s. m. Coing. - (10) |
| coiji (se) : (vb) se taire (« couje-te » ! tais-toi !) - (35) |
| coïllâ n.m. (couillard). Bélier. - (63) |
| co'illé : collier - (48) |
| coïlle n.f. Couille. - (63) |
| coiller (on) : collier - (57) |
| cô'iller (se) : taire (se) - (48) |
| côiller : n. m. Collier. - (53) |
| coiller, pousser de cris aigus. - (28) |
| coiller. v. n . Glisser. (Sénonais). - (10) |
| coïllier n.m. Collier. - (63) |
| coïllon n.m. Couillon, crétin. - (63) |
| coimelle. s. f. Espèce de champignon ayant la forme d’un parapluie. (Villiers-Saint-Benoît). - (10) |
| coin(g)ni : cognassier - (51) |
| coinche (nom féminin) : lavoir en béton. - (47) |
| coinche : bassin pour mettre de l'eau - (60) |
| coinchi v. Coincer, acculer dans un coin. - (63) |
| coinchir : v. a., coincer, acculer dans un coin, Coinchi, syn. de cuiné. - (20) |
| coinchotte (du latin congium et du vieux français coinche). s. f. Sorte de tine, de petit cuvier fait d’une moitié de pièce ou de feuillette. Sciez une feuillette par le milieu, vous aurez deux coinchottes. - (10) |
| coinchotte : vaisseau pour la lessive. - (09) |
| coindre (être) : personne qui est bien « trempée » par la pluie - (43) |
| coindre : mouillé, détrempé en parlant d’un animal, d’une personne - (51) |
| coinger (se), se taire. V. cong'hir. - (05) |
| coingner (pour couiner). v. n. Grogner, crier de la gorge. - (10) |
| coingner, v. a. cogner, frapper à coups redoublés. - (08) |
| coingnie, cognée, cougnie. - (04) |
| coingnie, s. f. cognée, espèce de hache à marteau dont se servent les bûcherons. - (08) |
| coingnié, s. m. cognassier, arbre qui produit des coings. - (08) |
| coingnie. s. f. Cognée. (Étivey). - (10) |
| coingnier. n. m. - Cognassier. - (42) |
| coingnier. s. m. Cognassier. - (10) |
| coin-né : n. m. Cognassier. - (53) |
| coinner. v. n. Terme usité dans le charonnage et qui signifie mettre un coin, enfoncer des coins. - (10) |
| coin-ni : cognassier - (43) |
| cointé : cognassier. (E. T II) - B - (25) |
| cointi : (nm) cognassier - (35) |
| cointî n.m. Cognassier. - (63) |
| cointier. s. m. Cognassier. ( Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes). - (10) |
| coîque. s. m. Coq. - (10) |
| coiré, couré. s. m. Courson de vigne. (Argentenil). - (10) |
| Coire. Le grand Coire était un personnage fantastique très populaire à Beaune, Une fois par an, le jour de la Saint-Aubin, cet illustre seigneur faisait, monté sur son char, une entrée triomphale dans notre ville, distribuant, a tous ceux qui couraient à sa rencontre, des échaudés et des brioches. Tous les gamins âgés de moins de dix ans croyaient fermement au grand Coire et dévoraient ce jour-la force pâtisseries, il n'y a plus maintenant ni chuche de Noël, ni Grand Coire, ni père Janvier aux quatre bonnots : nos cloches, libres sonneuses, ne vont plus à Rome le Jeudi-saint. La science a chassé la poésie ; le progrès a tué les naïves croyances. II n'y a plus d'enfants ! - (13) |
| coirée (les) : le ventre, s'utilise surtout dans l'expression : se chauffer les coirées - (39) |
| coiréjoux. adj. Courageux. - (10) |
| coiret. s. m. Branche de vigne comptant plusieurs années. - (10) |
| coiser (se), se taire se coïer. - (04) |
| coisir (Se) : v. r., vx fr. se coisier, se taire. Voir cauger (Se). - (20) |
| coisse (adjectif) : dépourvu d'énergie, fatigué. - (47) |
| coisson, coissot, s. m. cochon. - (08) |
| coissot (pour couéçot, couéchot). s. m. Homme ivre. C’est une atténuation du mot cochon. (Ménades). - (10) |
| coissot, cochon - (36) |
| coit (à la) : abri (à l’). Se mettre à la coit : sous couvert. En Bresse : à l’achote - en Côte d’Or : à l’assoute - dans la Loire : au coute. - (62) |
| coit : s. m., lat. cos, queux, pierre à aiguiser. - (20) |
| coite (à la). Locut . adverb . A l’étroit. — Être à la coite, se tenir coi, se cacher, n’oser se remuer. Du latin quietus, et du vieux français collier, serrer, enfermer, mettre à couvert. (Poilly-sur-Serein). - (10) |
| coite : s. f., vx fr., hâte, besoin pressant. J'ai coite de pisser. - (20) |
| coite, s. f. couverture de lit, mais plus souvent lit de plume. - (08) |
| coiter (Se) : v. r., se presser, se hâter. - (20) |
| coitier : s. m., gaine en bois, en corne ou en fer-blanc que le faucheur attache à sa ceinture pour y mettre le coit. - (20) |
| coitoux, coitouse : adj., bossu, courbé. A Tournus. la rue du Commandan tCarré, qui est d'ailleurs courbe, s'appelait autrefois rue du Coitoux et aussi rue des Coitoux. - (20) |
| coiuère : une croupière - (46) |
| coji : v. se taire. - (21) |
| cokél, petit vase de fonte, avec queue, servant à faire cuire les aliments. - (16) |
| cokriye, coquille ; cokryé, boursouflé. - (16) |
| colâche : Lien de chanvre qui sert à attacher par le cou un veau qui vient de naître. Le mot est masculin. - (19) |
| colâche : lien pour attacher, longe - (48) |
| colâche : collier pour attache. On met une colâche au chien : on met un collier au chien. - (33) |
| colache : (colâ:ch' - subst. f.) collier de cuir (anciennement en corde) qu'on passe à un veau. - (45) |
| colache, s. m. collier à attacher un jeune veau. - (24) |
| cölache, sf. collier pour mettre à l'attache un cheval ou une bête à cornes. - (17) |
| colafane, s. f., colophane : « Voui dà ! l'crincrin n'a jar gros usé d’colafane ; po la danse, ça n'va pas. » - (14) |
| colagne, n. fém. ; quenouille. - (07) |
| colai - Outre le sens français, il a en patois celui de glisser. - Le paivai éto moillé, mon pié é colai et pu i me seu flianquai en bas ! - Te collerez lai clié sô lai porte. - (18) |
| côlai. Couler, ou colet, colets. - (01) |
| colair : noix. (RDM. T III) - B - (25) |
| côlaire. Colère. - (01) |
| colamb : Entre en composition dans le mot « colamb ramier » sorte de pigeon sauvage. - (19) |
| côlan, ante, part, présent du verbe côler, glissant. Les chemins sont « côlans » lorsqu'il gèle. - (08) |
| colar : noix. (C. T III) - B - (25) |
| colâr, calâ : n. f. Noix. - (53) |
| colard, sm. chapeau. - (17) |
| colare : Colère. « Se mentre en colare », se fâcher. « T'emporte pas, la colare ne vaut ren ». - (19) |
| colâré : n. m. Noyer (arbre). - (53) |
| Colas, adj., dim. de Nicolas ; sot, niais. - (14) |
| colâs. n. m. - Geai ; dans l'expression bâiller comme un colâs , évoque d'une personne qui n'arrête pas de bâiller. - (42) |
| colation : Repas que l'on prend à la fin de la veillée. - (19) |
| colationner : Gôuter, prendre une collation. Après la veillée on offre à ses hôtes (invités) un verre de vin blanc et une rotie (tartine) de fromage fort, c'est la collation. - (19) |
| colé (ö), vn. couler. - (17) |
| côle ou caule. Mauvaise coiffure, toute espèce de coiffure avec un sens de moquerie. Etym. prononciation bourguignonne de cale (3ème sens de Littré), avec un sens plus étendu ; on trouve dans le bas latin du XIIIème siècle calotta, pour calotte, bonnet. - (12) |
| côle. Coule, coules, coulent. C'est aussi de la colle. - (01) |
| côlee, s. f. glissoire. - (08) |
| colée. s. f. Contraction de colère. J’seus en colée. - (10) |
| coler : (vb) couler, suinter - (35) |
| coler v. (de accoler) Accoler la vigne. - (63) |
| coler v. (de couler). Passer, en parlant du lait qui vient d'être trait. - (63) |
| côler, v. n. couler comme en fr. et glisser. Une anguille « côle » entre les mains. - (08) |
| coler. Filtrer avec une « coleure ». Se dit du filtrage du lait fraîchement trait, en particulier. - (49) |
| colérine. n. f. - Diarrhée. (Arquian) - (42) |
| colette, nom propre pour nicolette. - (08) |
| coleu : Couleur. « Les vins de s't'an-née n'ant guère de coleu ». Le mot a vieilli, on dit aujourd'hui couleur. - (19) |
| coleûr n.f. Couleur. - (63) |
| coleûre n.f. Passoire à lait en fer blanc. - (63) |
| coleure. Couloire, passoire. - (49) |
| coleure. n. f. - Couleuvre. - (42) |
| coleure. s. f. Couleuvre. La bise siffle comme une coleure. - (10) |
| colibi (n. m.) : dindon - (64) |
| colibi (pour colibri). Nom donné au dindon dans la Puysaie, sans doute par ironie, lorsqu’il fait le beau. - (10) |
| colibi. n. m. - Dindon. - (42) |
| Coliche : Nicolas - (48) |
| Coliche : prénom : Nicolas. - (33) |
| coliche, nom d'homme, diminutif de nicolas. - (08) |
| colidor (on) : corridor - (57) |
| colidor : Corridor. - (19) |
| colidor, corridor. - (16) |
| coline, colire : (nf) vallée, vallon - (35) |
| colinettes. s. f. pl. Copeaux de sabotier. (Nailly). - (10) |
| colique de miserere n.f. Douleur abdominale violente due à une occlusion intestinale. - (63) |
| coliques n.f.pl. (autrefois, la colique désignait une douleur intense siégeant dans les entrailles. Cf. Littré). Contraction de l'accouchement. - (63) |
| colire : vallée, vallon - (43) |
| colleron. s. m. Bourrelier, fabricant de colliers pour les chevaux. (Argenteuil). - (10) |
| collet rodze n.m. Rutabaga. - (63) |
| collet vert n.m. Carotte fouragère. - (63) |
| collet, s. m. col de femme. diminutif de col pour cou. - (08) |
| collet, s. m., espèce de cible rembourrée, formant un rectangle élevé, et qu'on plante sur la butte pour recevoir les flèches dans le tir à l'arc. Las! où est le beau Jeu d'arc d'antan ! - (14) |
| colleter (se) v. (fr.) Se battre. - (63) |
| collidor, corridor. - (27) |
| collidor. Corridor. - (49) |
| collier : s. m. Colliers de char, pièces de bois qui, dans un char, réunissent les ridelles au-dessus des planches d'avant et d'arrière. Les petits colliers sont à l'écartement des ridelles, tandis que les grands colliers, dépassant d'environ 0,20 centimètres de chaque côté, y ont un orifice pour l'adaptation des dames. - (20) |
| colline. (Villeneuve-les-Genêts). - (10) |
| colloure : filtre pour coller le lait - (51) |
| Côlogne. L'électeur de Cologne en 1701. - (01) |
| coloise. s. f. Couloire pour passer le lait. (Lasson). - (10) |
| colombe, s. f., rabot en forme de banc pour planir. - (40) |
| çolon (n.m.) : noix - (50) |
| colon, s. m. noix. usité aux environ de Château-Chinon. - (08) |
| côlon. Coulons. - (01) |
| colonne : voir pressoir. - (20) |
| coloure : (nf) grand entonnoir pour passer le lait - (35) |
| coloure : grand entonnoir servant à passer le lait - (43) |
| coloure, couloire : égouttoir (pour les fromages). - (32) |
| coloure, s. f. petit tamis pour passer le lait après la traite. Moule à fromage blanc. - (24) |
| cöloure, sf. couloire. - (17) |
| coloure. s. m. Couloir. - (10) |
| colpaule. : (Dial. et pat.), coupable. Dérivation naturelle du latin culpabilis par la suppression de la voyelle brève i et le changement de la liquide l en u. - (06) |
| coltin : veste de travail - (51) |
| coltin n.m. (de coltin, chapeau de portefaix).Veste de travail. - (63) |
| coltiner. v. a . Porter, soulever à deux un fardeau, un fût de vin, par exemple, en se croisant la tête et se mettant col contre col, pour se servir mutuellement de point d'appui. — Par extension, se dit du déplacement, du transport de toute sorte d’objets, particulièrement des sacs de grains, de farine, qui se portent à dos. Il y avait dans le temps, au port de Bercy, une compagnie de dérouleurs et déchargeurs qu’on appelait les petits coltins. - (10) |
| comâ : Voir comeau. - (19) |
| comâche : crémaillère - (43) |
| comach'e : s. m. crémaillère à crochets ou à boucles. - (21) |
| comâçhye : (nf) crémaillère - (35) |
| comacle n.f. (v.fr. quemaicle, crémaillère). - (63) |
| comacle : s. f., vx. fr. quemaicle, crémaillère. - (20) |
| comâcle, s. f., crémaillère de foyer. - (40) |
| comaille: Crémaillère. - (19) |
| combattre, v. n. lutter, disputer, livrer un combat. - (08) |
| combe ou comme, vallon étroit. D'après Davies, cumm ou comm, dans le Gallois, signifie vallée. - (02) |
| combe, s. f. vallon, gorge plus ou moins étroite, enfoncement. - (08) |
| combé. Combien. - (01) |
| combe. Petite vallée peu profonde et sans ruisseau. Nous avons dans les environs de Beaune la combe de Pernand, la combe à la Vieille, la combe au Prieur, celle de Bouze, celle de Gamay.... - (13) |
| combein. adv. - Combien - (42) |
| comben, adv., combien. - (14) |
| combèn, combien ? quelle quantité ? quel prix ? - (16) |
| combier. v. a. Combler. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| combïllon n.m. Dernières fourchées de foin lancées au sommet du char pour combler les trous avant de planter le mat. - (63) |
| combin : (adv) combien - (35) |
| combin : combien - (57) |
| combin ? : combien ? - (46) |
| combin : adv. interr ou excl. Combien. - (53) |
| combine, s. f. petit vallon, terrain creux, diminutif de combe. - (08) |
| comble, s. m. dans nos campagnes le comble d'une maison n'est pas la toiture, mais le plancher qui sépare la chambre unique du grenier. - (08) |
| comblette : faire la comblette = faire la culbute. III, p. 42-j - (23) |
| combllion, s. m. surplus bombé d'un récipient plein, comblé. - (24) |
| combllion, s. m. surplus bombé d'un récipient très plein, comblé. - (22) |
| comblon : s. m., comble d'un boisseau ; dôme formé sous l'influence de la fermentation, par le soulèvement du raisin, dans la cuve, quand elle est pleine. - (20) |
| combote : mettre en combote : disposer les tuiles à sécher sur les berges de la Saône. - (21) |
| Combre, nom de localité qui n'est pas rare dans la toponomastique rurale. - (08) |
| combye adj. Comble, rempli, plein. - (63) |
| côme (faire la), sévanouir. - (40) |
| côme ; "faire la côme", c'est courber la tête, s'abaisser, se faner. - (38) |
| come, s. f. courbe, creux, pli de terrain, petit vallon. - (08) |
| come. Comme. - (01) |
| comeau : Petit tas. Comeau de fêves, petits tas composé de deux javelles dressées l'une contre l'autre la racine en l'air. Comeau de flan, pâte molle que l'on met sur la croûte formée d'un disque de pâte dure dont on a relevé les bords. - (19) |
| comeau et coumeau. Sorte de crème, ou plutôt de bouillie sucrée et parfumée, composée de riz de semoule ou de farine. Elle était destinée à garnir les flans. (V. ce mot.) - (13) |
| cômeau, s. m., semoule cuite pour tartes et flans. - (40) |
| comédie : Tout espèce de spectacle théâtre, cirque, etc. « Vins tu à la comédie ? ». - (19) |
| comédien - coméïens : nomades, manouches et tsiganes....tous ceux qui circulent en roulotte. Méfiance et peur ! Ex : "Si té continues à lucher coumme ça j'vas t'douner aux coméïens." - (58) |
| cômer (v. int.) : paresser, fainéanter - (64) |
| cômer : somnoler. - (62) |
| comer, sommeiller, dormir. - (05) |
| comer. Sommeiller. - (03) |
| comesseu : cheville servant d'articulation entre la partie avant et arrière du char. A - B - (41) |
| comeyein, coumeyein, eine. n. - Bohémien ou comédien. Au figuré : pas sérieux, menteur, enjôleur. - (42) |
| cômia bonus , qui "fait la côme". - (38) |
| comiau : (nm) paquet de huit javelles - (35) |
| comiau : tas de gerbes, avant de les mettre en grou - (34) |
| comiau n.m. (du lat. comam, la chevelure). Tas de céréales en plein champ. Voir miau. - (63) |
| comiaux : tas de gerbes, avant de les mettre en meule - (43) |
| comice agricole : réunion, association de cultivateurs, d'éleveurs, de responsables locaux, en vue de favoriser le développement de l'agriculture. - (55) |
| comio : tas de gerbes avant la mise en grou*. B - (41) |
| cômisseure, s. f. commissure ; corps de chariot sans les roues, comprenant l'avant et l'arrière-train. - (08) |
| commachement : Commencement. « C't'écolier n'est pas encore bin savant mâ ol a in ban commachement ». - (19) |
| commachi : Commencer. « Pa bien fini i faut bien commachi » : réflexion d'un narrateur pour s'excuser de prendre son récit ab ovo. - (19) |
| commandement : s. m. Etre d'un bon commandement, se dit de quelqu'un qui a bon caractère ct qui obéit avec empressement. Lyonnais : être de bon command. - (20) |
| commarce : Commerce. « Se retiri du commarce » : se retirer des affaires. A propos d'une dépense inutile : « Cen fa aller le commarce ». - (19) |
| commarce. n. m. - Commerce. - (42) |
| comme : comment (comme don ?) - (51) |
| comme tout. Locut. comparative indéfinie, qui généralement signifie : beaucoup, très-fort, profondément. Elle est en usage depuis les temps les plus reculés, car on la trouve dans la Vulgate, au livre de Job, chap. xxiv, v. 24… - (10) |
| comme. : Combe, vallon étroit. - (06) |
| commeau, pâte faite avec de la semoule et du lait, pour faire une tarte. - (27) |
| commenzailhes. : (Dial.), commencements. - (06) |
| commerce : activité quelconque - (61) |
| commère : Commère se dit particulièrement d'une jeune femme récemment accouchée : « aller voir la commère » : aller prendre des nouvelles de l'accouchée. - « Fare la commère » : se dorloter, garder le lit au moindre malaise. - Le parrain et la marraine d'un enfant sont compère et commère, si le compère n'embrasse pas sa commère, l'enfant serait « bavou ». - « Remède de commère » remède de bonne femme. - (19) |
| commère, marraine. - (05) |
| commis n.m. Employé de ferme. - (63) |
| commis, n.m. ouvrier agricole. - (65) |
| commissaire : s. m., sergent de ville. Attends, ch'tit galopin, je vas te faire prendre par le commissaire ! - (20) |
| commissaire, subst. masculin : agent de police. - (54) |
| commissaire. Nom générique de tous les agents de police en uniforme. - (12) |
| commissions. Emplettes faites, objets achetés. - (12) |
| commoinceman (n.m.) : commencement - (50) |
| commoincer (v.t.) : commencer - (50) |
| comm-seure : cheville ouvrière, reliant l'avant-train à l'arrière-train d'un char ; chenet - (43) |
| communau n.m. Terrain communal. - (63) |
| communau : s. m., terrain communal. - (20) |
| comoincement, s. m. commencement. On prononce « c'moins'man. » - (08) |
| comoincer, v. a. commencer : « a c'moinsan lai m'noinge », ils commencent la vendange. - (08) |
| compa. Compas. - (01) |
| compaignon (n.m.) : compagnon - (50) |
| compaingnaule, adj. des deux genres. Qui aime la compagnie, sociable, bon camarade. - (08) |
| compaingnie, s. f. compagnie, société. - (08) |
| compaingnon, s. m. compagnon, celui qui accompagne. - (08) |
| companie, s, f., compagnie. - (14) |
| comparâïon, s. f. comparaison : « c'bœu ô l’mouéillou san comparâïon », ce bœuf est le meilleur sans comparaison. - (08) |
| comparâïon, s. f., comparaison. - (14) |
| comparaitre : v. a., comparer. - (20) |
| compâre, s. m., compère, pour un baptème ; camarade de parties fines. - (14) |
| compassion : s. f. Faire compassion, faire pitié. - (20) |
| compèrative. Coopérative. - (49) |
| compère, parrain. - (05) |
| compernouée (n. f.) : faculté de comprendre (t'as la compernouée lente) - (64) |
| compernouère. s. f. Faculté de comprendre. T’as la compemouère ben dure auj’d’heu. - (10) |
| compeurnâbye adj. Compréhensible. - (63) |
| compeurne, part., de comprendre, compris. - (14) |
| compeurnette (nom féminin) : intelligence, vivacité d'esprit. - (47) |
| compeurnette n.f. Intelligence, compréhension, vivacité d'esprit. - (63) |
| compeurnote, s. f., compréhension, facilité d'esprit, intelligence. - (14) |
| compeurnotte : compréhension, vivacité d’esprit. «Compeurnu » : compris. - (62) |
| compeurnotte : n. f. Compréhension. - (53) |
| compeurnouére : compréhension - (48) |
| compeurnouère : compréhension. - (52) |
| compeurnouère : compréhension. Ol é la compeurnouère dure : il comprend mal. - (33) |
| compeurnouère : compréhension - (39) |
| compire, s. f. pomme de terre. Usité aux environ d'Avallon, de Quarré-Les-Tombes, etc… - (08) |
| complàïance, s. f. complaisance. Voir plâï. - (08) |
| compléete. s. f. Complainte. (Étais). - (10) |
| complet d'bos n.m. Cercueil. - (63) |
| complet, complet de bois : s. m., cercueil. Voir paletot sans manches. - (20) |
| compliment : s. m. Mauvais compliment, parole désagréable, impertinence, injure. - (20) |
| composai. Composé, composez, composer. - (01) |
| comprenable : adj., vx fr„ compréhensible. - (20) |
| comprenette, comprenotte : s. f., intelligence, esprit, entendement. T'as donc ben la comprenette dure. - (20) |
| comprenouée, compernouée, compernouère, compeurnouée. n. f. - Compréhension : « T'as la compemouée ben difficile c'matin, faudra p't'éte te ravouiller ! » - (42) |
| comprenouére, s. f. compréhension, intelligence. - (08) |
| comprenre, v. ; comprendre. - (07) |
| comprenre, v. a. comprendre. Voir prenre. - (08) |
| comprenre, vt. comprendre. - (17) |
| comptè : v. t. Compter. - (53) |
| comptouaîr (on) : comptoir - (57) |
| comtouaîs (on) : comtois - (57) |
| comunau, s. m. terrain communal, qui appartient à une commune. Nous disons un comunau et des comunaux. - (08) |
| cômuns (les), s. m., les cabinets d'aisance, les anciens retraits. Toujours placés assez loin de l'appartement. On a, pour s'y rendre, à traverser au moins une cour, ou un jardin... - (14) |
| con. Niais, imbécile. (Argot). - (49) |
| con’neu : gorge. - (66) |
| cônâ : pièce en bois du chariot, graissée, où est attaché le brancard - (46) |
| conai. Corner, sonner du cor. Corner est ici mis pour publier. Voyez plus bas Cone. - (01) |
| conaïlle : Quenouille. « Les jeunes fannes (femmes) d'aujord'heu ne savant pas ce que y est qu'eune conaïlle ». « Avoi de l'ovre à sa conaïlle » : avoir fort à faire. - (19) |
| conaîlle n.f. (du lat. canna, tuyau, roseau, trachée artère). Carotide, tendon du cou. - (63) |
| conâte, connaissu, conaissâ - connaître, et divers temps de ce verbe. - Ce n'â pâ si âsille qu'en le croirot de bein conâte son monde. - I ai connaissu ceute homme lai quemant qui étà ai Airnai. - (18) |
| conbié, vt. combler. - (17) |
| concarne : s. f., sorte de trompe faite avec de l'écorce de saule roulée en spirale et à l'extrémité de laquelle on adapte une pinette. Prêt' me donc ton coutiau pour faire une concarne. - (20) |
| concès. s. m. Seigle. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| concevi. Conçus, conçut. - (01) |
| conchausser, v. a. fouler aux pieds, écraser. - (08) |
| conchise, et concire, s. m. , chemin creus et plus étroit que le contour (un mètre au plus) et servant à l'assainissement de la pièce de terre. - (14) |
| conchise. Chemin creux le long des haies des champs. - (03) |
| conchllié, v. a. gonfler. - (22) |
| conchyliologie : étude des coquilles. - (55) |
| conciau. s. m. Méteil, seigle et blé mélangés. — Dans un sens plus général, mélange d’une chose médiocre avec une meilleure. Du vieux français concilier, concier, et du latin coinquinare , corrompre, altérer, gâter, souillé. (Étivey). - (10) |
| concie, concise. n. f. - Verger clos. - (42) |
| concie, concise. s. f. Verger clos. - (10) |
| concombrée. s. f. Compote. - (10) |
| concranter. v. a. et n. Écornifler. - (10) |
| concranteux. adj. et s. m. Écornifleux. - (10) |
| condannai. Condamné, condamnez, condamner. - (01) |
| condanner, v. a. condamner. - (08) |
| condemine : s. f., bas-lat. condamina, terre arable, champ.Plusieurs hameaux et écarts du département de Saône-et-Loire portent les noms de Condemine, La Condemine, Les Condemines. - (20) |
| condeu, s. m. conduit, rigole, canal à ciel ouvert ou couvert qui sert à conduire les eaux. - (08) |
| condeure n.f. (du lat. condire, assaisonner) Corps gras. - (63) |
| condeure, v. a. conduire, part, passé « condeut », qui est le mot précédent. - (08) |
| condeurre : matière grasse, beurre, graisse - (43) |
| condeut. s. m. Conduit. (Domecy-sur-le-Vault). - (10) |
| condition (être en), loc. Un garçon, une fille sont « en condition » chez leurs maîtres. On dit logiquement aussi « Entrer en condition ». - (14) |
| condômé (éte) : bosselé, cabossé - (39) |
| condômé, part, passé. contourné, contrefait, déformé. Un objet « condômé » est une chose qui a perdu sa forme régulière, qui est tordue, bossuée, à demi rompue. - (08) |
| condômer, abîmer, mettre à mal - (36) |
| condômer, v. a. dompter, frapper, terrasser, déformer. - (08) |
| condoure : matière grasse (beurre, graisse). A - B - (41) |
| condoure : matière grasse beurre graisse - (34) |
| condoure : matière grasse pour la cuisine - (51) |
| condure : conduire. - (29) |
| condûre, conduire ; se condûre, se conduire, diriger sa vie. - (16) |
| condure, v. tr., conduire. - (14) |
| condure, vt. conduire. - (17) |
| conduzo. Conduisais, conduisait. - (01) |
| condzire : (nf) congère - (35) |
| cone. Corne, cornes… - (01) |
| cone. : Cornes. Boisé deu chévre entre lé cone, se disait d'une figure maigre et effilée. - (06) |
| conée. Pièce de lard mince et allongée, qui n'a que la couenne. Par extension, grand garçon, bête et laid, celui que Rabelais aurait appelé « un grand dépendeur d'andouilles. ».... - (13) |
| coneille : (conéy' - subst. f.) jalon naturel dans une haie. Il s'agit d'un arbre de peu de valeur qu'on coupe à hauteur de la haie, et qui sert à soutenir le plessis. - (45) |
| coneille : s. f. quenouille. - (21) |
| coneille, s. f. quenouille. - (08) |
| coneille. Qyenouille ; colonne : « un lit à coneilles », vieux lit à colonnes. Les « coneilles du cou » désignent la partie du cou qui s'étend de l'oreille à l'épaule. - (49) |
| coneuille : (nf) tendon du cou - (35) |
| côneuille : tendon du cou - (43) |
| còneuille, s. f. quenouille. - (24) |
| confesser : v. n., se dit du vendangeur qui, placé dans une raie de séparation, cueille alternativement les raisins de la dernière rangée d'une rase et ceux de la première rangée de la rase suivante. - (20) |
| confesseu. Confesseur… - (01) |
| confeusion, s. f. confusion, une quantité indéterminée. - (08) |
| confeussoîr n.m. Confessionnal. - (63) |
| confi : confier - (57) |
| confitiure, vt. confiture. - (17) |
| confitue : (nf) confiture - (35) |
| confitue. n. f. - Confiture. - (42) |
| confonde v. Confondre. - (63) |
| confondre (se), v. r. prendre beaucoup de peine, se dévouer : se confondre pour ses enfants. - (24) |
| confondre (se), v. r. prendre beaucoup de peine, se dévouer. - (22) |
| confondre : v. a., vx fr., abîmer, bouleverser, détruire. - (20) |
| confondre, gâter, souiller ; l'on dit d'un vêtement détérioré : el â confondu. - (16) |
| confondre. Détruire, abîmer. - (03) |
| confonre, v. a. confondre, salir, souiller. Un homme qui a les vêtements couverts de boue dit qu'il est « confondu « de boue. - (08) |
| confouine : habitation sordide. (CLB. T II) - C - (25) |
| cônfréries : Nom de lieu. Ce nom vient de la Confrérie des chevaliers de Saint-Georges ; les chevaliers d'armes avaient à Mancey une confrérie de Saint-Georges depuis le XVe siècle. (Courtépée). - (19) |
| confri : ridé - (43) |
| confssi v. Confesser. - (63) |
| confusiôner, v. tr., donner de la confusion, de la honte, rendre timide : « Vrâ, mâre Michaud, d'avou toutes vos chateries, vous me confusiònez. » - (14) |
| congé : service militaire - (48) |
| congé, s. m., service militaire. - (40) |
| conge, subst. féminin : benne à copeaux ou à ordures. - (54) |
| congère : s. f., lat. congeries, amas de neige entassée par le vent. - (20) |
| congéssion, congestion ; congéssionè, celui qui a un coup de sang dans la tête. - (16) |
| congiê, s. m. congé, besoin, nécessité : « i é congié d'fére ç'lai », j'ai le besoin, le devoir, l'obligation de faire cela. - (08) |
| congrée (se) - se propage, se communique, se produit. - Ci se congrée dans lai graingne, dan le corps, en ne sait queman, et pu ci ronge to. - En fau fâre aitention, ces mailaidies se congrée ç'â ine poison. - (18) |
| congruer (se), v. réfl. s'amasser par la fermentation comme des vers dans le fumier, avec le même sens à peu près que dans le français grouiller : le fromage grouille de vers, c'est-à-dire fourmille de vers. - (08) |
| conieûtre, v., connaître. - (40) |
| connaitre : v. a., s'apercevoir de quelque chose, s'en rendre compté. Il y a pas seulement connu. C’te bïaude est déchirée ; j'y vas mettre un pelas, ça veut pas se connaître. - (20) |
| connâssè : v. t. Connaître. - (53) |
| connâte : connaître - (48) |
| connate : (conâ:t' - v. trans.) 1- connaître (une personne). 2- reconnaître (une personne) . - (45) |
| conne, cogne, sf. corne. - (17) |
| conné, vt. corner. - (17) |
| conneule : cornouille. (CLF. T II) - D - (25) |
| conneulö, sm. cornouiller. - (17) |
| conniaissance : connaissance - (51) |
| conniaite : connaître - (51) |
| connö, sm. croquant, cartilage, nerfs de la viande. Viande inférieure. - (17) |
| connoïlle, sf. corneille, corbeau. - (17) |
| connuron, sm. petite corne; protubérance. - (17) |
| conot : n. m. Imbécile, n. m. fam. con. - (53) |
| conpiet, adj. complet. - (17) |
| conquéri p.p. de conquérir, conquis - (63) |
| conrayé (adj.) : hors d'usage ; démoli - (50) |
| conrayer. Corroyer, adoucir. Ex. : « la gelée conraye le terrain ». - (49) |
| conreilli, v. a. disposer en ordre, avec soin ; ranger, mettre en place. Le foin est bien « conreilli » sur le plancher lorsqu'il est étendu avec soin et tassé. - (08) |
| conrier, v. tr., broyer, travailler la terre destinée à faire de la brique. - (14) |
| conroi - terre glaise. - Ces champs lai ne veillant pâ grand-chose ; ce n'a dière que de lai terre de conroi. - L'aute des jors â diaint qu'en des endroits vé lai seigne en i é du conroi qu'en pourro fâre des pots aivou. - (18) |
| conroi, s. m. corroi, terre argileuse qu'on emploie pour divers usages, pour arrêter notamment les infiltrations dans une levée d'étang, dans une conduite d'eau, etc… - (08) |
| conroi. s. m. Corroi, couche de terrain argileuse imperméable. - (10) |
| conroiller : (con:rouèyé - v. trans.) étanchéifier la digue d'un étang avec de l'argile. - (45) |
| conroué : (con:rouè - subst. m.) sorte d'argile qui sert à corroyer. - (45) |
| conroy, terre glaise. - (04) |
| conroyer, v. a. corroyer, employer le conroi, c’est-à-direla terre argileuse ; le plus souvent pour arrêter les infiltrations, en la broyant, en la tassaut avec force. - (08) |
| consan. Consens, consent. - (01) |
| consarvé, vt. conserver. - (17) |
| consarver : conserver - (57) |
| consarver. v. - Conserver. - (42) |
| conscience, plastron de cerclier. - (05) |
| conscience, s. f., plastron en bois, que s'applique le fabricant de cercles, pour éviter les coupures à sa veste. - (14) |
| conscier – écoure : corriger (battre) - (57) |
| conscrit : s. m., petit grappillon de raisin qui vient sur une pousse tardive. Voir agret. - (20) |
| conscrit, n.m. raisin verjus. - (65) |
| conscrits, s. m,, raisins de deuxième floraison. - (40) |
| conscrits, verjus, raisins encore verts poussés tardivement. - (27) |
| consê : (cons:ê: - subst. m.) méteil, mélange de blé et de seigle, couseau. - (45) |
| conseai, conseau, s. m. conseigle, mélange de froment et de seigle, méteil. « conseai » est la forme du Morvan bourguignon. - (08) |
| conseau : s. m., bas-lat. consegallum (Du Cange considère à tort le vx fr. conseel comme latin), méteil, mélange de froment et de seigle. Syn. de blondée. - (20) |
| consékan, important ; s'nâ pâ consèkan, c'est peu de chose. - (16) |
| consentu, part. pass. du verbe consentir. - (08) |
| consentu, part., consenti, accepté. - (14) |
| conséquent (mâ) : (plus) important - (37) |
| conservez-vous. Souhait poli qu'on fait à la personne que l’on quitte. Ex. : « Allons, à bientôt, conservez-vous ! » - (12) |
| conseulter. v. a. consulter, prendre une consultation. - (08) |
| consiâ, seigle. - (27) |
| consiévir et consiewir. : (Dial.), poursuivre ardemment un but. - (06) |
| consillé, s. m. conseiller ; « eun consillé meunicipal. » - (08) |
| consire, jet de terre le long de haie. - (05) |
| consô, mélange de froment et de seigle. - (16) |
| consœû (na) : consœur - (57) |
| consolante : s. f., se dit au jeu, d'une « partie de consolation ». - (20) |
| console majore : s. f., grande consoude (symphytum officinale). - (20) |
| consôle. Console, consoles, consolent. - (01) |
| consôlein. Consolions, consoliez, consolaient. - (01) |
| consommer v. Ce verbe intransitif est utilisé pour la consommation du mariage. - (63) |
| constreure, v. a. construire, bâtir. part, passé constreut : « eune mâïon bin constreute. » voir estreure. - (08) |
| constreure, v. tr., construire. - (14) |
| constrûre, construire ; constru, construit. - (16) |
| construre, vt. construire. - (17) |
| consulte, s. f. , consultation d'un avocat, d'un médecin ou de plusieurs : « ôl é bé mau ; va y avoúer, à c'maitin, eùne consulte. » - (14) |
| consulter (Se) : v. r., prendre une consultation. J'ai été me consulter à l'occulisse ; i m'a mis dans l’œil un caluire (collyre) qui m'a fait cuire (Caluire et Cuire !!!) - (20) |
| consulter vers (se). Pour consulter quelqu'un. Ex. : « II se croit perdu, il est allé se consulter vers le docteur F.» - (12) |
| consulter : v, a., donner une consultation, - (20) |
| contai. Conter ou compter. Conter un fait, une fable, une histoire. Compter de l'argent. Contai peut aussi être un participe passif, tant singulier que pluriel. « Velai un fai bé conté » , voilà un fait bien conté : « Velai dé fai bé contai », voilà des faits bien contés. « De l’arjan bé contai », de l’argent bien compté ; « dés écu bé contai », des écus bien comptés. - (01) |
| contan (tô), tout comptant, tout de suite, à l'instant : « payer tô contan », payer sur-le-champ. - (08) |
| contan ; son contan ; mîngé teu son contan, manger selon sa faim ; mingé teu son sou a la même signification, mais est plus familier. - (16) |
| contan. Content, contents, contentus vel contenti. Quelquefois c'est contant, narrans, ou comptant numerans. - (01) |
| contanti. Contentai, contentas, contenta. - (01) |
| contaur (n.m.) : contour - (50) |
| conte - contre (on fait souvent précéder de l'article de). - Al éto couché conte le mur ai l'ombre. - Le Nino, al é passai de conte note porte. - (18) |
| conte (de) (loc.) : contre, près de - (50) |
| conte : contre - (48) |
| conte prép. et n. Contre. - (63) |
| conte prép. près de, vers, vis-à-vis, contre. - (63) |
| conteîgne. Contienne, contiennes, contiennent. - (01) |
| contens. : Dérivation du latin contentionem, rixe, querelle. Franchises de Flagey, 1332. - (06) |
| content (son) , sa suffisance. - (04) |
| content, s. m. s'emploie avec l'adj. possessif mon, ton, son. « avoir son content d'une chose », c'est en avoir à suffisance, jusqu'au contentement. - (08) |
| contenter : v. a. Contenter quelqu'un, lui payer ce qu'on lui doit. - (20) |
| conteunuance, s. f. continuité ; action de continuer, de prolonger la durée des choses : il est bon de boire, mais il ne faut pas en faire une « conteunuance. » - (08) |
| conteunuer, v. a. continuer. - (08) |
| conteur (prép.) : contre - (50) |
| conteur, prép. contre : « al ô en coulére conteur lu », il est en colère contre lui. - (08) |
| conthiyon, keuthiyon, cotillon, vêtement de femme. - (16) |
| continence. s. f. Contenance, superficie d’un terrain. Du latin continentia, continere. - (10) |
| contnin, vt. contenir ; pp. contnun. - (17) |
| conto (on) : chemin (de terre en bout d'un champ) - (57) |
| conto (on) : contour (chemin en bout de champ) - (57) |
| contor : extrémité du champ où on tourne la charrue et labourée en travers - (48) |
| contor, s. m. contour, le tour d'une chose, les extrémités d'une cour, d'une pièce de terre, d'un bois. - (08) |
| contorner : contourner - (57) |
| contorner, v. a. contourner, faire le tour de, circuler autour. la route « contorne » la rivière. - (08) |
| contôrner, v. contourner. - (38) |
| contou (-ouse) (n.m. ou f.) : conteur, raconteur (-euse) - (50) |
| contou : s. m. bande de terrain non cultivée autour du champ. - (21) |
| contour : chemin de champ. (CH. T II) - S&L - (25) |
| contour, lisière de terrain pour retourner la charrue. - (05) |
| contour, s. m., sorte de plate-bande ou chemin, de trois mèt. environ de large, entourant la pièce de terre, et donnant au laboureur l'espace nécessaire pour retourner sa charrue lorsqu'il est au bout d'un sillon. - (14) |
| contra. Contrat, contrats. - (01) |
| contrahier, contréïër. v. a. Contrarier. - (10) |
| contrailli - érigni - érégni : contrarier - (57) |
| contrailli : bouleversé (émotion) - (57) |
| contraint, contrainte : part. pass. Temps contraint, temps lourd, orageux. - (20) |
| contralier. v. a. contrarier, taquiner, tourmenter. - (08) |
| contraliou, ouse, adj. contrariant, taquin. - (08) |
| contranchoi. s. m. Contranchoir (qui tranche contre), serpe avec laquelle les tonneliers coupent leurs osiers et taillent les cercles qu’ils veulent relier. - (10) |
| contrare, s. m. Ie contraire, et adj. - (14) |
| contrarier : v. a., se dit d'un repas ou d'un mets qui se digère mal. Mon dîner m'a contrarié. - (20) |
| contre de mauvais traitements. - (17) |
| contre : prép. Au prop., près, vers. Il demeure contre l'église. Nous allons contre les beaux jours. Au fig.. marque la manifestation extérieure d'un état psychique, manifestation dirigée contre la personne ou la chose qui a provoqué cet état. I m'a ri contre. I m'a piqué un fard contre. I m'a tiré la langue contre. - (20) |
| contre, conte (de), prép. il est venu « de contre » moi : je me suis assis « de contre » ce mur. - (08) |
| contréïé, ée .adj. Contrarié. (Ménades). - (10) |
| contréier, contrahier. v. - Contrarier. - (42) |
| contreiller : contrarier - (39) |
| contre-jo (on) : contre-jour - (57) |
| contrelatte, latte entre chevrons. - (05) |
| contre-pi (on) : contre-pied - (57) |
| contrepouaîds (on) : contrepoids - (57) |
| contrepouaison (on) : contrepoison - (57) |
| contrester. -(Di al.), résister (du latin contrastare). - (06) |
| contretenail. - (Dial.) Nous n'avons point en français d'expression aussi énergique ; la préposition contra exprimant la résistance et tenaculum (d'où tenail), exprimant l'acte de maintenir ou comprimer. - (06) |
| contrévent, contervent. n. m. - Contrevent, volet. (Arquian) - (42) |
| contre-vers : s. m., vermifuge. Du sirop de contre-vers. - (20) |
| contre-vouaîe (na) : contre-voie - (57) |
| contrivler. : (Dial.), pour contribler. Ecraser, marcher sur (du latin tribulare avec la préposition). - (06) |
| contrôle : s. m., enregistremeni. Bureaux du contrôle des actes, nom des bureaux d'enregistrement sous l'ancien régime. Y a l’ coût d'acte et l’ contrôle... - (20) |
| convanter. v. a. Offrir. Convanter une marchandise, l’offrir en la vantant. - (10) |
| convarsion. Conversion. - (01) |
| convenance, s. f. convention : je paierai plus ou moins, suivant nos « convenances. » - (08) |
| convenant, e, adj. qui convient bien, qui est de bonne qualité. S’emploie en parlant des personnes et des choses. - (08) |
| convenaule (adj.) : convenable - (50) |
| convenaule, adj. convenable, qui convient bien, qui satisfait. Une maison, un cheval, un marché « convenaules. » - (08) |
| conveni : convenir - (57) |
| convier : (vb) accompagner ; (en parlant d’une vache) faire le veau après terme - (35) |
| convier : faire le veau après terme - (43) |
| convive. : (Dial.), s'employait aussi bien que convivie (du latin convivium), pour festin. - Le simple repas s'exprimait par li mangiers. - (06) |
| convni : convenir - (51) |
| convni v. Convenir. - (63) |
| convoi, se disait autrefois du train de chemin de fer. - (27) |
| convouaî (on) : convoi - (57) |
| convouaiter : convoiter - (57) |
| convouaitise (d’la) : convoitise - (57) |
| convouayer : convoyer - (57) |
| convouè : n. m. Convoi. - (53) |
| convulsion : s. f., conversion. Les enfants sujets aux convulsions sont conduits dans certains sanctuaires le jour de la fête des Convulsions de Saint Paul (25 janvier). Voir Jeanton, Le Maçonnais traditionaliste. - (20) |
| convyi v. (du v. fr. convivre, vivre avec). Passer le terme. Ma vatse convie. (Elle vit avec son veau). Se disait aussi pour un vieux qui "refusait de mourir" : L'pére Dzean-Marie, woilà bin eun' an qu'ô convie. (Il vit avec la mort à ses côtés). - (63) |
| conzeûrer (fâre) : (faire) effacer le « mauvais sort » par des prières secrètes - (37) |
| conzeûreux : celui qui a ce pouvoir - (37) |
| côôiller (se) : taire (se) - (48) |
| cop : (nm) coup, fois « to p’un cop » : tout d’un coup - (35) |
| cop n.m. (du lat. colpus et de l'anc. fr. colp au sens de choc) Coup. Un cop : une fois. Des cops : des fois. Quéques cops : parfois. Doux-quate cops : quelques fois. Ôl est vni su l'cop d'midi. Il est venu à midi. Tot pr'un cop. Soudain. - (63) |
| cop' : n. f. Coupe. - (53) |
| côp, s. m. coup. On prononce cô. - (08) |
| côp, s. m., coup, choc, blessure. Le p est muet : « Ah ben ! por cep'tiot côp, t'cries tôjor. N’y é ran que c' qui. » - (14) |
| cop. Coup. Pour cou, nous disons cô, de collum. - (03) |
| copai, copoû – couper, coupeur. - L'aute des jors los enfants copaint de l'herbe le long de lai route. - Les copoû de bô, les mâtins a nos en airouaiché chi pieds de treuffes. - (18) |
| côpaî. Couper, coupé, coupez. - (01) |
| copaie : copeau - (48) |
| copaing : copain - (39) |
| copais. s. m. Copeau. - (10) |
| copau : (nm) capitule de la bardane - (35) |
| cope : coupe - (51) |
| cope : Coupe. Ancienne mesure de capacité pour les grains, elle contenait environ 15 litres. « Eune cope de blié ». - (19) |
| cope à freumadze : faisselle. A - B - (41) |
| cope à freumadze : faiscelle - (51) |
| cope à freumâdze n.f. Faisselle. - (63) |
| cope à fromadze : (nf) faisselle - (35) |
| cope à fromadze : faisselle - (43) |
| cope n.f. Ancienne mesure de capacité pour les grains ; on dit aussi mzeure. - (63) |
| copê : (copê: - subst. f.) 1-copeau de bois. 2- rayon de miel. - (45) |
| copé : v. t. Couper. - (53) |
| cope, fouchelle. Moule à fromage percé de trous pour faire écouler le petit lait. - (49) |
| cope, s. f. coupe : une « cope » de bois. - (08) |
| còpe, s. m. partie du chapeau qui enserre la tête. - (24) |
| copeaux, éclats de bois.. - (02) |
| coper : (vb) couper - (35) |
| côper : couper - (43) |
| coper : couper - (51) |
| coper : couper - (48) |
| coper : Couper. « O s'est fait coper les cheveux ». « Coper la sope », coupe le pain pour la soupe. - Terme de jeu : coper à carreau. - Terme de viticulture : côper le dâ, trancher à l'aide d'une hache de forme spéciale (cognée de pressoi) une partie de la « gène » (marc de raisin) qui a été pressée une première fois ; on détache ainsi sur tout le pourtour du dâ une bande de « gène » qu'on rejette sur la partie centrale pour être pressée une seconde fois. - (19) |
| coper v. Couper. Alle a eune langue que cope des quate coûtés. Elle est médisante et bavarde. Coper la sope : couper du pain en morceaux pour "tremper la soupe". Il y a bien longtemps on désignait par soupe le pain, ce qui explique plusieurs expressions obscures aujourd'hui. - (63) |
| côper : (côpè - v. trans.) couper, c-à-d à l'origine"diviser d'un coup". - (45) |
| coper, v. a. couper, trancher. - (08) |
| côper, v. tr., couper, séparer. - (14) |
| cope-racines n.m. Coupe-racines. - (63) |
| copère : Compère, voir à « babillà ». - (19) |
| copereau. s. m. Couperet. (Givry). - (10) |
| coperet : couperet - (43) |
| coperiau n.m. Gros couteau de boucher, destiné à couper, couperet, fendoir. - (63) |
| côperô, large couteau de cuisine, couperet. (Voir au mot réguzai.) - (02) |
| côperot, s. m., couperet, couteau de cuisine. - (14) |
| copeure : Coupure, plaie faite par un instrument tranchant. On donne le nom d « arbe à la copeure » à certaines plantes auxquelles on attribue la vertu de guérir les plaies. - (19) |
| copeûre n.f. Coupure. - (63) |
| copeux d'veurtiaux n.m. Laboureur, paysan. - (63) |
| copeux n.m. Coupeur. - (63) |
| copiâ : n. m. Copeau. - (53) |
| copiain-e. Quémandeur, qui demande pour ainsi dire cum planctu, ou plutôt con pianto. - (03) |
| copian. Capon. Fare son copian, c'est faire le bon apôtre : c'est flatter et caresser quelqu'un dans un but égoïste et personnel. Ce mot appartient au patois de la plaine. - (13) |
| copiau n.m. (du v. fr. cospel, pointe, épine) 1. Copeau. 2. Capitule de la bardane. - (63) |
| copiaux : Copeaux. « Des copiaux de sapin ». On dit aussi des écopiaux. Copiaux est aussi le nom patois des graines de la grande bardane (lappa major). - (19) |
| copie, s. f. terme de procédure. Se dit absolument en parlant d'un acte judiciaire signifié par un huissier. Quand une « évitation » n'aboutit pas, la « copie » ne tarde pas de se mettre en campagne. - (08) |
| côplai. Couplet, couplets. - (01) |
| côple, adj. couplé, qui forme la paire, qui vont deux à deux, et, par extension, qui vont bien ensemble, qui sont bien pareils, soit d'allure, soit de couleurs, etc. s'emploie surtout en parlant des animaux : ces bœufs sont bien « côples ». - (08) |
| côple, s. m., couple. - (14) |
| côple. Couple, couples. - (01) |
| côpler, v. a. rendre couple, former un couple, une paire. On couple un bœuf, un cheval pour composer un attelage de charrue, de voiture. - (08) |
| côpler, v. tr., accoupler, mettre au joug, atteler. - (14) |
| copô : bardane qui s'accroche aux vêtements, moi je dis "pignolo". - (66) |
| copois : Taillis. - (19) |
| copon : pot à traire en métal. A - B - (41) |
| copon : (nm) petit seau à traire muni d’une anse - (35) |
| copon : coupon, pot à traite - (51) |
| copon : petit seau à traire, en fer blanc, muni d'une anse sur le côté - (43) |
| copon n.m. Pot à traire en fer blanc. - (63) |
| coponer : prélever frauduleusement des céréales (se dit pour le meunier). A - B - (41) |
| coponner : prélèvement frauduleuse de céréales par le meunier - (34) |
| copot. n. m. - Chardon, grande bardane. (Mézilles, selon H. Chéry) - (42) |
| copou d’bô : (nm) bûcheron - (35) |
| copou d'beû : bûcheron - (43) |
| cöpou, sm. coupeur, bûcheron. - (17) |
| coppe â fromadze : faisselle - (34) |
| coppis, bois taillis de 1 ou 2 ans. - (05) |
| coppon : pot à traire en fer blanc - (34) |
| copreuyau : (nm) couperet - (35) |
| cop'rot : Couperet. « Alle a copé le cô de san cana (canard) dave in cop' rot». - (19) |
| côpure, s. f. coupure, toutes sortes d'incisions. - (14) |
| coqlutse n.f. Coqueluche. - (63) |
| coqlutson n.m. Bouton placé à la partie supérieure d'un couvercle. - (63) |
| coqtî n.m. Coquetier. - (63) |
| coquâ : vieux récipient de cuisine - (48) |
| coquâ, coquelle : cocote en fonte - (48) |
| coquabec. n. m. - Bâton courbé à une extrémité, utilisé comme canne. (Mézilles, selon H. Chéry) - (42) |
| côquaî. Heurter… - (01) |
| côquai. : Heurter en se servant du talon (du latin calcare). Il n'a pas toujours existé aux portes soit un râcloir pour gratter (l'usage de gratter aux portes nous est encore attesté par les écrivains du XVIIe siècle), soit un marteau, comme on en voit encore dans les anciens hôtels, soit une cloche, ce qui est l'usage commun aujourd'hui. - (06) |
| coquairdiau (n.m.) : giroflée (aussi coquardiau) - (50) |
| coquâler : brûler au soleil - (39) |
| coqualle : marmite, cocotte. Du latin : cucuma ou plus près du latin médiéval coquere: cuisiner. - (62) |
| coquardiau, s. m. giroflée, violier double, nom vulgaire de la mathiole fenestrale. - (08) |
| coquardiau, s. m., giroflée. - (14) |
| coquas, s. m. plur. débris, déchets, fragments de poterie, tout ce qu'on jette comme objets brisés et de rebut. - (08) |
| coquasse (nom féminin) : pot en grès. - (47) |
| coquasse, s. f. vase, pot dont on se sert pour mettre de l'eau ou pour traire les vaches - (08) |
| coquasse. s. f. Pot de terre très-élevé, coquemard. Du latin coquere. - (10) |
| coquati : coquetier (acheteur d'œufs, chevreaux, beurres et lapins) - (51) |
| coquatié, s. m. homme qui s'occupe aux ouvrages de femme, qui flâne volontiers dans la cuisine. - (08) |
| coquatier (n.m.) : commerçant ambulant qui achète les oeufs et les volailles - (50) |
| coquatier : acheteur d'oeufs - (61) |
| coquâtier, raicottier : ramasseur dans les fermes des œufs et des volailles - (37) |
| coqué (ât’e) : (être) « assommé » - (37) |
| coque (n. f.) : souche d'arbre ou de vigne (syn. coxon) - (64) |
| coque (n.f.) : grosse racine d'arbre : souche - (50) |
| coque : nom donné à une vieille souche. (voir : chuche). - (33) |
| coque : s. f., pâtisserie de pâte frite. Syn. de bugne. - (20) |
| coqué : v. t. Assommer, v. pr. Se cogner la tête. - (53) |
| coque, cocon : vieille souche. - (09) |
| còque, s. f. beignet. - (24) |
| coque, s. f. petite souche, grosse racine d'arbre. - (08) |
| coque. n. f. - Souche. - (42) |
| coque. s. f. Souche de bois. - (10) |
| coquecigrue. Personne d'un caractère bizarre, revêche et avaricieux. Ou a dit que ce mot était, dans l'origine, le nom d'un animal imaginaire : je le considère simplement comme l'anagramme de croque-cigüe. - (13) |
| côquefredouille. Mot emprunté à la langue romane et qui signifie sot, fat, niais, paresseux, malotru, sans esprit... - (02) |
| coquefredouille. : Sot, fat, niais. - (06) |
| côqueigne. Coquine. « Lai char a côqueigne », la cbair est coquine, la chair s'habitue aisément au plaisir. - (01) |
| coquelarder. v. n. Rôder, flâner, lanterner. - (10) |
| coquelariau. s. m. Voir coqueluriau. - (10) |
| coquèle n.f. Marmite en terre cuite. - (63) |
| coquéle. Casserolle en fonte. Ce mot parait venir du latin çoquere, cuire, qui a formé coction et maître queux. Je ne partage pas l'opinion de M. de Chambure qui fait venir coquéle du substantif latin coucha, une coquille. - (13) |
| coqueliau : s. m., bouquet de fruits. - (20) |
| coquelion : s. m., bas-lat. quoquilum, faite, cime, sommet. - (20) |
| côquelle (C.-d., Chal., Br., Morv., Y.). - Ustensile de cuisine, sorte de marmite ou daubière en fonte; de coquela (coquere, cuire), plutôt que de coquille ou concha, comme le croit Chambure, à cause de sa forme. - (15) |
| coquelle : marmite en fonte - (43) |
| coquelle : une marmite - (46) |
| coquelle : faitout en fonte souvent avec pattes - (39) |
| coquelle : marmite en fonte noire, galbée, avec une queue ronde. Ex : "Dans ma coquelle, j'met d'abord le saindoux." - (58) |
| coquelle : n. f. Cocotte enfante. - (53) |
| coquelle : s. f., cocotte, casserole de fonte à cuire les rôtis. - (20) |
| coquelle, caquelle : récipient en fonte pour la cuisson des aliments - (37) |
| coquelle, n.f. marmite en fonte. - (65) |
| coquelle, s. f. vase en fonte avec une queue et monté sur trois pieds - (08) |
| coquelle, s. f., marmite en fonte. - (40) |
| coquelle. Cocotte, casserole. - (49) |
| coquelle. Cocotte, sorte de casserole en fonte, à pieds (Littré). Etym. coquere. - (12) |
| coquelle. s. f. Daubière, marmite, vase servant à faire la cuisine. Du latin coquela. - (10) |
| coquellée : n. f. Contenu d'une cocotte. - (53) |
| coquelourder : dormir à moitié - (60) |
| coqueluché, plein jusqu'en haut. - (27) |
| coqueluche, s. f. tronc d'arbre, vieille souche à demi morte, sans végétation. On donnait jadis le nom de coqueluche au capuchon des moines. - (08) |
| coquelucho - sommet, dessus, bien élevé. - Monte jeusqu'â coquelucho. - Tenez, regairdez don su c't-àbre qui, le chairdonneret â perché â fin coquelucho. - (18) |
| côqueluchô (prononcez queuquelucheu), capuchon... - (02) |
| côqueluchô.- (Prononcez quequelucheu), capuchon. Ce mot date vraisemblablement de 1510 à '1557, espace de temps ou la coqueluche, cucullus morbus, faisait un grand nombre de victimes. (Roq.) - (06) |
| coqueluchon : s. m., bouton placé à la partie supérieure d'un objet quelconque, d'un couvercle, d'une fiarde, etc. Le coqueluchon de la soupière. - (20) |
| coqueluchon, s. m. petite souche de bois, petit tronc d'arbre à demi sec, gros éclat détaché d'une souche. « coqueluchon » est un diminutif de coqueluche comme capuchon est un diminutif de capuche. - (08) |
| coqueluchon. s. m. Capuchon, partie d’un vêtement qui recouvre la tète. — Éteignoir ; feuilles intérieures de l’artichaut de couleur violacée, disposées en forme d’entonnoir. — Primevère officinale, coucou. — Du latin cucullus. - (10) |
| coqueluchon. Sorte d'ancienne coiffure, de cuculus, cagoule. - (03) |
| côqueluchot, s. m. capuchon. - (14) |
| coqueluriau. s. m. Anémone pulsatile, vulgairement coquelourde. (Saligny). - (10) |
| coquelusette, s. f., petit escargot jaune et noir. - (40) |
| coquemele : champignon. - (30) |
| coqueniche : s. f., cabriole. - (20) |
| coquenuchon, coqueson. s. m . Petite souche. (Puysaie). - (10) |
| coque-penâ, s. f., plante (très probablement l'anémone Pulsatille). - (40) |
| coquer (s’) : (s’) entrechoquer, « (s’) assommer » mutuellement, s’enivrer - (37) |
| coquer (se), verbe pronominal ou transitif : (se) cogner. - (54) |
| coquer : v. a., embrasser. Voir coconner. - (20) |
| coquer, v. assommer. - (65) |
| côquer, v. tr., choquer, heurter, frapper du talon ; briser la coque d'un fruit. - (14) |
| côquer, v., côcher (en parlant du coq). - (40) |
| coquériaux ou caquésiaux : moustiques. (DC. T IV) - Y - (25) |
| côquerille, s. f., coquille : « De c'qui ? J’t’en beillerô pas tant s'ment eùne coq’rille d'û. » - (14) |
| côqueriller {se), v. pr., se recroqueviller : « C'te côrde s'déroule mau ; âll' se coquerille tôjor. » - (14) |
| coquerillou, fâché comme un coq... - (02) |
| coquerillou. : Fâché comme un coq.- On dit encore être rouge comme un coq, monter sur ses ergots pour exprimer le courroux d'une personne. - (06) |
| coques : (nfpl) sorte de pain perdu frit - (35) |
| coques, « L » souches, racines, de cocha, ceoca (bas latin). - (04) |
| côquesimargouin, s. m., vieus galantin de campagne, viens « coq de village ». - (14) |
| coqueson : vieille souche. (P. T IV) - Y - (25) |
| coqueson, coquenuchon. n. m. - Petite souche, petite coque. - (42) |
| coqueter, v. n. se dit de la poule appelant ses poussins en gloussant se dit aussi lorsque par ces mêmes gloussements elle indique son désir de couver. - (24) |
| coquetier : Marchand forain allant acheter à la campagne les produits de la ferme : œufs, beurre, volailles, etc… Il est aussi appelé « revendoux ». - (19) |
| coquetier. n. m. - Marchand de volailles et d'œufs. (Sougères-En-Puisaye) - (42) |
| coqueu : voir caqueu. - (20) |
| coqueuille : (nf) coquille (d'œuf) - (35) |
| coqueuille : coquille de noix - (43) |
| coqui. s. m. Animal familier, mouton qui suit sa maîtresse. - (10) |
| coquigna (n. m.) : cotignac, confiture de coings – se dit d'un mélange formant une masse épaisse et pâteuse (dur coumme du coquigna) - (64) |
| coquignat : mélasse - (60) |
| coquignat. s. m. Mélasse dans laquelle on fait cuire des amandes. Se dit sans doute pour cotignac, et par analogie avec celui qui se fait au vin doux, dans lequel on fait cuire des coings ou des poires. (Puysaie). - (10) |
| Coquillon. Nom de famille dans le pays. - (08) |
| coquillot : grappe de cerises avec les feuilles qui y sont souvent attachées. - (62) |
| côquin. Coquin, coquins. - (01) |
| coquin. couquingn', s. m. coquin. - (08) |
| coquingne. s. m. Coquin. (Plessis-Saint-Jean). - (10) |
| còquion, s. m. pompon ; bouquet naturel de fruits : un coquion de cerises. Verbe coquioner, couvrir de coquions. - (24) |
| còquœye, s. f. coquille. - (24) |
| cor (ö). sf. cour. - (17) |
| cor : cour - (48) |
| cor, cour. - (16) |
| cor, s, f., cour. - (40) |
| côr, s. f., cour, espace devant ou derrière la maison. - (14) |
| côr, s. m., cours d'eau, cours des choses : « Que v'tu ? J 'pouvons pas empêcher l’cor du temps. » - (14) |
| côr, s. m., siphon à futaille. - (40) |
| cor. C'est tantôt court, curtus, tantôt cours, cursus, tantôt cour, chors ou cors, tantôt cour, curia, quoique cour en ce second sens comme dans le premier, vienne également du latin barbare cortis ou curtis, et que, soit pour cour de maison, soit pour cour de de prince ou de justice, on dût écrire court, comme on faisait autrefois. Cor est aussi, en bourguignon, le singulier des trois personnes du présent de l’indicatif du verbe courir, c'est encore l'impératif cor, cours, cor tant que tu poré, cours tant que tu pourras. Cor, de plus, signifie corps. - (01) |
| coradze : courage - (51) |
| corâdze n.m. Courage. - (63) |
| coradzeux adj. Courageux. - (63) |
| coradzou (se) : courageux (se) - (51) |
| côrage, s. m., courage, persévérance. - (14) |
| coraîge. Courage. Il n'y a pas deux cents ans que les mots terminés aujourd'hui en âge avaient tous leur terminaison en aige. - (01) |
| coraigeou, rasé de frais, qui a le visage propre et net. - (28) |
| coraijou - bien portant, bien arrangé, frais de figure. - Al à coraijou queman to ! – Vos é ine jeune feille qu'à coraijouse queman tot. - (18) |
| coraman, couramment ; un enfant lit teu coraman, quand il lit sans hésiter, sans se répéter. - (16) |
| coramman. Couramment, ou comme on dit plus élégamment encore en bourguignon, fuamman. Voyez Fuamman. - (01) |
| coran. Courant. - (01) |
| corande : Vieille danse. « Dansi eune corande ». « La corande du dragan », voir à « dragan ». - (19) |
| côrande, s. f., courante, danse du cru, qui a été fort en vogue, — et aussi diarrhée. - (14) |
| corande. Danse indigène, qui est, je suppose, l'ancienne courante, qui fit la fortune du chevalier Chabot. - (03) |
| coransö, sm. bois sec en fagots. - (17) |
| corater : (vb) courir les filles - (35) |
| corater : courir (après quelqu'un) - (57) |
| corater : courir les filles - (43) |
| corater : courir les filles. - (30) |
| corater : poursuivre - (57) |
| coratire : coureuse. - (30) |
| coratou (on) : coureur (de jupon) - (57) |
| corau : s. m., corail ; branche sèche. - (20) |
| corayer : voir crouiller. - (20) |
| corbaie. s. f. Versoir de charrue. (GuilIon). - (10) |
| corbaïllan : Petite corbeille où l'on met la pâte de l'épogne. Voir épogne. - (19) |
| corbaïlle : Corbeille où l'on met la pâte du pain avant de la faire cuire. « Poudre les corbaïlles », en saupoudrer l'intérieur de farine de blé ou de maïs pour empêcher que la pâte y adhère. - (19) |
| corbaille. n. f. - Corbeille. - (42) |
| corbasse. n. m. - Corbeau. (Sainte-Colombe-sur-Loing) - (42) |
| corbe (n.f.) : fruit du corbier des oiseleurs - (50) |
| corbe : Courbe (nom et adjectif). - Nom : pièce de l'attelage qui sert à relier le joug au timon du char par le moyen d'un anneau appelé cordot. C'est une sorte de cheville plate coudée à angle droit. - Adjectif : « Les Tilles corbes », nom de lieu ; « Le châgne corbe (voir à châgne ) ». - (19) |
| corbe, adj. courbe. - (17) |
| côrbe, adj., courbe. - (14) |
| corbe, courbe. - (05) |
| corbe, s. f. corme, fruit du sorbier des oiseleurs par extension. - (08) |
| corbe, s. m. courbe, courbure, coude. Le chemin fait un « corbe » à cet endroit-là. - (08) |
| côrbe, s. m., corme, fruit du sorbier ou cormier. - (14) |
| corbe. Courbé. Nez corbe, c'est un nez à corbin. - (03) |
| corbe. s. f. et adj. des deux genres. Courbe. Du bois corbe. - (10) |
| corbe. s. f. Pour corme, fruit du cormier, du sorbier. Les corbes se cueillent vertes et mûrissent ou, plutôt, blossissent sur la paille. - (10) |
| corbeau, n.m. montant de cheminée. - (65) |
| corbeille : s. f. corbeille. - (21) |
| corbe-ion, corbiyon : corbeille à œufs en baguettes de noisetier - (43) |
| côrber, v. tr., courber. - (14) |
| corbeuille n.f. Corbeille. - (63) |
| corbi - courbe, tordu. – An ne peut ran fâre de ce bout de bô, al à trop corbi. – Lai pôre fonne, ile â tote corbie d'infirmitai. - (18) |
| corbi : courbé. - (29) |
| corbi, courbe. - (27) |
| côrbiau, s. m., corbeau. - (14) |
| corbié, corbier (n.m.) : sorbier des oiseaux - (50) |
| corbié, s. m. sorbier des oiseaux. - (08) |
| corbier : sorbier. - (09) |
| côrbier, s. m., cormier, ou sorbier domestique. - (14) |
| corbillard a bétail, corbillard a bestiau : loc, voiture très basse servant au transport du bétail sur pied. - (20) |
| corbillon : (nm) corbeille - (35) |
| corbillon : tonneau de la contenance d'un quart de pièce. (V. T III) - B - (25) |
| corbillon n.m. Corbeille réalisée avec 5 ou 6 tiges savamment entrelacées. - (63) |
| corbillon. Petite corbeille en osier pour mettre les œufs, ou bien pour servir les crêpes. - (49) |
| corbin : bœuf - (48) |
| Corbin : nom de bœuf. III, p. 29-o ; VI, p.3-5 ; VI, p. 7 - (23) |
| corbin. n. m. - Bœuf.à la robe noire, de la couleur du corbeau. Se dit également d'un bœuf.aux cornes basses. (Villiers-Saint-Benoît, selon M. Jossier) - (42) |
| corbin. s. m. Dans certains endroits, bœuf noir, de la couleur du corbeau ; dans d’autres, bœuf dont les cornes courbes ont la pointe assez fortement abaissée. (Villiers-Saint- Benoit). - (10) |
| Corbingn'. Nom de bœuf. - (08) |
| corböte, sf. terme de boucherie : bois recourbé et crochu aux deux extrémités pour suspendre un porc. - (17) |
| corbotte : poignée courbe du manche de la faux - (48) |
| corbotte : (corbot' - subst. f.) poignée courbe de la faux, située au milieu du manche, et qu'on empoigne de la main droite. - (45) |
| corbotte : poignée située au milieu du manche de la faux - (39) |
| corbotte, s. f. manche de forme courbe qui sert de poignée à une faux. Diminutif de « corbe », bois courbé. - (08) |
| corbu, e, adj. courbe, courbé : un homme, un arbre « corbus. » - (08) |
| corce : (cors' - subst. f.) écorce. - (45) |
| corce : s. f., vx fr. corcer (v. a.), écorce. De la corce d'orange. - (20) |
| corcelin : s, m., cornouille. - (20) |
| corcia. s. m. Colza. (Cudot). - (10) |
| cordaillère, s.f. osier cordé formant bretelle pour porter la hotte. - (38) |
| cordaillon, s. m. corde de rivière, c’est-à-dire environ cinq stères de bois (4 s. 8oo) appartenant à un petit propriétaire. - (08) |
| cordamné, cordamner (n.m.) : cordonnier - (50) |
| cordamner (n.m.) : cordonnier - (50) |
| cordangnié, cordonnier. - (16) |
| cordangnier. n. m. - Cordonnier. - (42) |
| cordañni n.m. Cordonnier. - (63) |
| cordannié, s. m. cordonnier. On prononce cor-dan-nié. - (08) |
| cordat : s. m. anneau d'osier servant à rattacher la benne au « pau ». Diminutif de corde. - (21) |
| cordat, s. m. ne s'emploie guère que dans cette locution : « mettre sur le cordât », pour mettre sur la sellette, médire d'une personne, en mal parler. - (08) |
| cordé : anneau de cuir ou de bois torsadé servant à fixer le joug (dzeu*) au timon (tchan*). A - B - (41) |
| cordé : (nm) lanière de cuir épaisse servant à maintenir le joug en place - (35) |
| corde n.f. Bois coupé de petite section. - (63) |
| corde n.f. Mesure de volume pour le bois de chauffage, valant 2 moules, soit 4,426 stères métriques ou 3,372 stères non métriques. - (63) |
| côrde : s. f. corde. - (21) |
| corde : s. f., ancienne mesure de longueur pour les chemins, valant le 1/12e la portée, ou 25 pieds, c'est-à-dire 8 m. 121. - (20) |
| corde : s. f., ancienne mesure de volume pour le bois de chauffage, valant 2 moules, par conséquent 4 stères métriques 386 décimètres cubes, ou 3 stères non métriques 372 millièmes. - (20) |
| corde(s) : unité de mesure des bois (3 x 1,14 x 1,5 m) - (39) |
| cordé, cordeau, cordiau : s. m., anneau d'osier, de cuir ou de nerf de boeuf tressé, au moyen duquel on relie le joug des bœufs au timon d'un char, on suspend la benne au pal, etc. - (20) |
| corde, n.f. mesure de volume du bois. - (65) |
| corde, s. f. cube de bois de moule formant à peu près cinq stères (4 s. 800). Il y a la corde de rivière qui est celle dont nous parlons et la «corde» de grand bois qui n'est que de quatre stères environ (4 s. 400). - (08) |
| corde, s.f. courge, potiron. - (38) |
| cordée (colique). Colique de miséréré. S'employait pour désigner toute autre colique un peu forte. - (49) |
| corder (v. int.) : s'accorder, s'entendre bien - (64) |
| corder : Faire une corde. « Corder à trois » faire une tresse. - (19) |
| corder : sympathiser avec. (P. T IV) - Y - (25) |
| corder, encorder, v. a. disposer le bois en « corde ». On « corde « le bois de moule, la charbonnette, etc. - (08) |
| corder, v. a. Courber. - (10) |
| corder. v.- S'accorder, s'entendre :« Pourquoi son fils n'pas l'air de corder avec lui ? » (Colette, Claudine à Paris, p.216). Le poyaudin a conservé le mot corder du XIIIe siècle, qui signifiait déjà s'accorder, par dérivation du latin cor-cordis, cœur. - (42) |
| cordet (n.m.) : anneau d'attelage : lien avec lequel on attache une barrière à un poteau - (50) |
| cordet : grand anneau de bois torsadé ou de cuir qui fixe le timon au joug - (43) |
| cordet n.m. Boucle de cuir très épaisse soutenant le timon, maintenue en place par des chevilles, dans les attelages de bœufs. - (63) |
| cordet, s. m. cordeau, lien de bois tordu avec lequel on attache une barrière à son poteau ou son « équarrie » ; lien en général, hart. - (08) |
| cordet. Anneau fabriqué avec une branche de bois tordue et cordée adapté au « je » (joug) et où passe le « tchon » (timon) retenu par une cheville. - (49) |
| cordiau : Cordeau. « Cordiau de vendange », cordeau avec lequel on attache les bennes sur la charette et qui tient aussi en place la « covarte » (couverture) posée sur les ras (bennes remplies) - (19) |
| cordiau n.m. Cordeau de jardinier. - (63) |
| côrdiau, s. m., cordeau, cordon. - (14) |
| cordiaux. n. m. pl. - Guides pour diriger le cheval, employés uniquement avec une charrue. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| còrdiou, s. m. corde de joug. - (24) |
| cordjeau (on) : cordeau - (57) |
| cordoler, v. a. cordeler, tresser en forme de corde. se dit d'une haie, d'une claie, dont le bois flexible est entrelacé. Les cordeliers ont pris leur nom de la petite corde qui leur sert de ceinture. - (08) |
| cordon n.m. Sensation de constriction, localisée au front, que produit le vin blanc. - (63) |
| cordon : s. m., sensation de constriction, localisée au front, avec ou sans ivresse, que produit le vin blanc du Maçonnais. Cet effet est dû vraisemblablement aux composés volatils du bouquet et non à l'alcool. Avoir le cordon. Dicton vergissonnais : « Y a eu trois grands hommes en France : Napoléon pour la guerre, Lamartine pour les vers, et le grand Mouéroux pour le vin blanc. » - (20) |
| cordonni : cordonnier - (51) |
| cordot : Anneau qui sert à attacher le joug des bœufs au timon du char. - Anneau qu'on emploie pour suspendre la benne de vendange au « pau » que les porteurs placent sur leur épaule. Le cordot est habituellement fait de tiges d'osier tressées en corde. - (19) |
| cordounier, s. m., cordonnier. - (14) |
| core - patarer : courir - (57) |
| çore (n.f.) : chose - (50) |
| core (ö), vn. [courre]. courir. - (17) |
| côre : cour - (43) |
| core : Courir. « Core les chemins » : vagabonder. « Cobin s'qu'il a itié Tôrneu ? - A po prè eune lieue. - Oué eune lieue de chin à toje core. » : Combien y a t'-il d'ici à Tournus ? A peu près une lieue.- Ouais, une lieue de chien qui court toujours. Il y a en effet de Mancey à Tournus non pas une lieue mais une lieue et demie. - Souffler, en parlant du vent : « La bije co ». - (19) |
| côre : n. f. Cour. - (53) |
| côre, adv., encore, de nouveau. - (14) |
| coré, coret. s. m. Grosse et vieille souche de vigne arrachée. (Percey). - (10) |
| corë, on désigne par ce mot le coeur, le foie et les poumons du porc. - (16) |
| çore, s. f. chose. ço = cho, re = se. - (08) |
| core. Courent, ou coure. - (01) |
| cöre. vt. cuire ; pp. cöt, cöte. - (17) |
| coreau, coureau : s. m., coureur, chemineau, vagabond. S'emploie surtout en mauvaise part. - (20) |
| corée - les poumons ou le foie. - I veins aichetai in bout de corée pou fàre in ragout. - Ne m'en pairlez pâ de ces gens lai ; ci n'é ni cœur ni corée ! - (18) |
| corée (lai) : tout le corps humain - (37) |
| corée (na) : poumon - (57) |
| corée : (nf) (collectif) poumons, gorge - (35) |
| corée : abats du porc - (43) |
| corée : foie - (44) |
| corée : poumon. - (31) |
| corée : Poumon. « La corée de cochan fa in ban pliat (fait un bon plat) ». - Ventre, estomac. J'ai faim : « La corée m’en guigne ». - (19) |
| corée bihintse : (tr. litt. abats blancs) poumons. A - B - (41) |
| corée byintse n.f. (du lat. tardif coratam, fressure). Poumons (du porc surtout). - (63) |
| corée d’taupe : viande de taupe, de haute senteur - (37) |
| corée n.f. 1. Abats, notamment les poumons, le cœur et le foie. 2. Péj. Cœur. - (63) |
| corée nère : (tr. litt. abats noirs) foie. A - B - (41) |
| corée nère n.f. Foie (du porc surtout). - (63) |
| côrée ou courée (C.-d.), corée {Chal., Y.), couérée (Morv.). - Terme de boucherie, synonyme de fressure, et désignant en même temps le coeur, le foie, la rate et les poumons, mais de préférence le poumon, c'est-à·dire le mou, avec lequel on nourrit les chats… - (15) |
| corée : s. f., cœur et autres viscères. La corée m'en guigne (le cœur me bat). - (20) |
| corée, cœréé, s.f. poumons (dérivé de cœur). - (38) |
| corée, couairée : n. f. Ensemble intérieur du thorax : cœur, poumons, foie. - (53) |
| corée, n.f. repas organisé par les chasseurs qui viennent de tuer un sanglier. - (65) |
| corée, s. f., cœur, au propre et au figuré. - (14) |
| corée, s. f., ensemble cœur-poumons. - (40) |
| còrée, s. m. mou de porc, de bœuf ou de veau. - (24) |
| corée, subst. féminin : poumons, cœur ou foie. - (54) |
| corée. Cœur d'un animal. - (13) |
| corée. Cœur et les parties qui l'entourent. On dit courée de mouton, pour frésure (Ménage). - (03) |
| corée. Corée, corées. Proprement fressure, intestins autour du cœur et le cœur ensemble. Aussi « se regaudi lai corée », c'est se réjouir le cœur… - (01) |
| corée. Désigne à la fois le foie et les poumons connus sous les noms de foie noir et foie blanc. « Avoir in-ne bonne corée » c'est avoir les poumons sains et par extension, jouir d'une bonne, d'une solide santé. - (49) |
| corée. Les poumons d'un animal. Etym. courée, corée, vieux mots français qui viennent de cor (cœur), et désignaient les viscères de la poitrine groupes ensemble avec le cœur. - (12) |
| corée. s. f. Synonyme de fressure, cœur, foie, mou et poumons d’un animal. - (10) |
| coreire et scoreire. Baguette de coudrier. On s'en sert pour battre les habits, pour éloigner les animaux et même pour corriger les enfants. À rapprocher de scorgie, fouet. - (13) |
| corèjou (ouse) : (adj.) beau, bien pris de sa personne. El' lo: bin: corèjouse, sè bon'èmi: "elle est bien jolie, la jeune fille qu'il fréquente." - (45) |
| coréjou : aimable, obligeant. - (29) |
| coréjou : bel enfant, bien portant. (B. T II) - B - (25) |
| coréjou, courageux, bien portant, qui a bonne mine. - (27) |
| coréjouse : jolie (en parlant d'une jeune fille). (S. T III) - D - (25) |
| coréjoux : Courageux. - (19) |
| côrére : (cô:ré:r' - subst. f.) noisetier, coudrier. Ce mot désigne le matériau, et ne fait donc pas double emploi avec nouyoté, qui s'applique à l'arbre en tant que végétal. œn' ousin' de cô:ré:r', "une houssine de coudrier". - (45) |
| corge : courge. - (32) |
| corge ou corje : Longue perche pourvue d'un crochet destiné à recevoir l'anse du seau ; la corge sert à puiser l'eau dans un puits peu profond. - (19) |
| côrge, s. f., courge. - (14) |
| corgeallé. s. m. Cornouiller. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| corgelé : cornouiller. (MLV. T III) - A - (25) |
| corgelinier : s. m., cornouiller. A rapprocher du vx fr. corge, sorte de bâton. - (20) |
| corgeon, courgeon : s. m., vx fr. corgie, courgeois, corjon, courroie, lanière, cordon. - (20) |
| corgî (n. m.) : bâton recourbé aux extrémités duquel étaient suspendus des seaux que l'on portait sur l'épaule (palanche) - (64) |
| corgie (Br., Morv.), courgie (Morv., C.-d.), écourgie (C.-d.), courjon (Chal.). - Fouet ; de corrigia, lanières, dérivé de corium, qui a fait cuir et courroie. Courjon, dans le Chalonnais, est le nom donné aux tresses de jonc ou d'osier dont on fait des liens. - (15) |
| corgie : fouet à manche court et à grosse lanière. - (31) |
| corgie : fouet en cordes tressées. (V. T IV) - A - (25) |
| corgie : (corji: - subst. f.) grand fouet pour exciter les chevaux. - (45) |
| corgié, corgi.e (n.f.) : courroie, laniére de cuir - (50) |
| corgie, courgie, s. m. fouet, lanière de cuir, corde de chanvre, cordon. - (08) |
| corgie, n. fém. ; fouet. - (07) |
| côrgie, s. f., fouet pour les chevaux, et autre sorte de fouet pour corriger (?) les enfants : « Tâche d'êt'e sage, polisson ! Si te n'te tiens pas tranquille, j'vas t'flanquer d'la corgie ». - (14) |
| corgie. Fouet. - (03) |
| corgneau. s. m. Espèce de pâté. (Tronchoy). - (10) |
| corgner, cornier. s. m. Coin, angle d’un champ qu’on ne peut labourer. - (10) |
| corgniolle : voir chûlot - (23) |
| còrgnioule, s. f. œsophage, dans la région du cou. On dit aussi corgnolon, s. m. - (24) |
| corgnolot, subst. masculin : gorge, gosier. - (54) |
| corgnon : les corgnons de la charrue = les mancherons. III, p. 31 - (23) |
| corgnuelle, cornuelle. s. f. Châtaigne d’eau. - (10) |
| corguette, s. f., palonnier de charrue à vignes. - (40) |
| cori : (vb) courir - (35) |
| cori : courir - (43) |
| cori lai poste s'emploie fïgurément pour : aller trop vite, faire de mauvais ouvrage. Si te veux ben traiveiller, an ne faut jaimâs cori lai poste... - (13) |
| cori, v. a. courir, aller avec vitesse. - (08) |
| côri, v. intr., courir. S'emploie aussi fréquemment que couri : « V'tu còri ! » dit-on, pour renvoyer un enfant qui vous importune. - (14) |
| cori, v., courir. - (40) |
| cori. Courus, courut, courir. - (01) |
| corier : Coureur, qui aime à fréquenter les fêtes, les réunions. - (19) |
| corjan : Cordon. « Alle a cassé le corjan de san devanté (tablier) ». « Sarrer les corjans de la borse » : ne rien dépenser, lésiner. - (19) |
| corjie, sf. attache du fouet à son manche. - (17) |
| còrjon, s. m. cordon. - (24) |
| còrjon, s. m., cordon qui sert à tenir les tabliers, les jupons, etc. - (14) |
| corjon, sm. écheveau. - (17) |
| còrjòner, v. tr., attacher les cordons de son tablier, de ses jupes : « Oh ! l'anguigne! áll' ne còrjone pas tant seul’ment son d'vantei ! » - (14) |
| cornâ : (nm) cocu, escargot - (35) |
| cornailler, corniller. v. - Donner des coups de cornes. Autre sens : corner, klaxonner. - (42) |
| cornailler. v. a. Donner des coups de cornes. - (10) |
| cornaïlli v. 1. Donner des coups de corne. 2. Regarder en coin en baissant la tête, pour une vache ou un taureau. - (63) |
| cornair : cocu - (48) |
| cornair : cornichon - (48) |
| cornaline : s. f., bille de cornaline ou de toute autre espèce d'agate. Agate désignait autrefois la bille de verre. - (20) |
| cornard : un cornichon. - (56) |
| corne : coin d'un chariot de foin en vrac - (48) |
| corne : Corne. « Les cornes d'in bû ». - Chausse-pieds : « Passe ma dan la corne que je vête mes sulés », passe moi donc le chausse-pieds que je mette mes souliers. - Calus, « j'ai de la corne es mains ». - Branche d'un pied de vigne, « J'ai laichi trois cornes à ce chot », j'ai laissé trois branches à ce cep de vigne. - Poignée de banne, « Prendre eune banne pa la corne ». - (19) |
| corne : mancheron de la charrue - (48) |
| corne : s. f. corne. - (21) |
| corne : même sens qu'en français mais désigne aussi les 4 coins d'un chariot de foin - (39) |
| corne : s. f., branche de ramification du cep de la vigne ; poignée naturelle de la benne. - (20) |
| corné, adj. se dit des bêtes à cornes. Un bœuf bien « corné », une vache mal « cornée ». - (08) |
| corne, s. f. cor, durillon, « la corne du pied. » - (08) |
| corne, s. f. corne d'animal, partie saillante ou pointue, angle, coin, quartier. Nous disons la « corne » d'un champ, la « corne » d'une table, la « corne » d'une pierre, la « corne » d'une maison, d'un drap, etc. - (08) |
| corne, s. f., cor, durillon : « Mon esclot m'a fait v’ni eùne corne. » - (14) |
| corneille, n.f. petite corneille des clochers, corbeau. - (65) |
| cornelie. Frontail du bœuf ou de la vache, surmonté de ses deux cornes : cornes liées. Au Moyen-âge le trompette de la ville de Beaune avait droit aux cornélies de toutes les bêtes tuées par les bouchers... - (13) |
| cornemuse, s. f. nom de l'instrument essentiellement Morvandeau que nous appelons aussi « panse» à cause de l'espèce de vessie ou ballon qui renferme le vent. - (08) |
| cornemuseu, s. m. joueur de cornemuse. - (08) |
| corner : Souffler dans une corne. On dit d'un homme excessivement prudent en affaires : « Stu-là ne lâche pas devant que le vaichi corne». Il y avait autrefois à Mancey un vacher qui rassemblait les bêtes du village pour les mener « en champ ». « Les orailles ant du li corner » on a beaucoup parlé de lui. - (19) |
| corner : action qui consiste à placer le foin aux 4 coins d'un chariot - (39) |
| corner : v. n., ronfler. - (20) |
| corner, v. intr., souffler, bourdonner. Employé dans cette locution : « Les oreilles me cornent » pour : J'ai un bourdonnement d'oreilles. « Le vent corne dans la ch'vinée. » - (14) |
| corner. v. n. Sucer son pouce ou l’un de ses doigts à la manière des petits enfants qu’on sèvre. - (10) |
| cornes (faire les) : Ioc., faire un geste qui consiste à présenter la main avec l'index et l'auriculaire seuls étendus et les trois autres doigts fléchis, de manière à simuler deux cornes. Ce geste s'adresse aux enfants ou aux gens à qui on veut faire honte ou injure. - (20) |
| côrnes, s.f. "tirer aux côrnes" se dit du soleil quand il se couche dans une barrière de nuages et lance des rayons dans le ciel comme de longues cornes. - (38) |
| cornes. Mancherons de la charrue. S'emploie au pluriel. - (49) |
| cornes. n. m. - Mancherons de la charrue. - (42) |
| cornet n.m. Tuyau de poêle. - (63) |
| cornet : s. m., tuyau. Des cornets de poêle. - (20) |
| cornet. s. m. et cornuche, cornuelle. S. f. Sorte de tourte aux poireaux. - (10) |
| cornet. Tuyau : les cornets du poêle par exemple. - (49) |
| cornette : a) Aumône que l'on fait aux enfants pauvres qui viennent à la porte des maisons le 31 Décembre demander : « La cornette, ma tante s'y vo pliât » - b) Petite corne ou cornot, « J'ai entendu la cornette du bolangi ». - (19) |
| cornette : étendard de cavalerie. Compagnie de cavalerie. - (55) |
| cornette : Pierre qui sert de but au jeu de palet. Voir Paleut. - (19) |
| cornette : s. f., syn. de sansauvette. - (20) |
| corneuille n.f. Corneille. - (63) |
| corniales, n. fém. plur. ; châtaignes d'eau. - (07) |
| corniau, s. m. chêne étêté, arbre dont on a coupé la tige principale ; arbre ébranché ou rabougri. — corniau, chien bâtard qui tient du chien de chasse et d'une race vulgaire. Le terme s'applique quelquefois aux personnes dans un sens injurieux. - (08) |
| corniaud : Mâtiné. « Est-y in chin d'arrêt ? Mâ nan y est in corniaud ». - (19) |
| corniaud. Gorge, larynx, voix. « Avoir un bon corniaud » c'est avoir une gorge solide, une forte voix. Fig. Désigne une personne criarde. En temps d'élection, on désigne ainsi les électeurs qui accompagnent les candidats dans leurs conférences pour les applaudir, les acclamer. - (49) |
| còrniaus, s. m., gros nuages noirs, que l’on voit avant l'orage : « I va faire un bigre de temps ; v'là ben des corniaus qui v'nont. » - (14) |
| cornibale, se retourne tête en bas, dos en avant. - (28) |
| cornichale: pirouette - (48) |
| cornichère (porter à la). Exactement le même sens que porter à la biscancorne (Voyez ce mot). Etym. corniche, appliqué à la saillie des épaules. - (12) |
| cornie, s. m. coin, angle : le « cornié » d'un toit, l'angle où deux pans de toiture se rejoignent. - (08) |
| corniflons (pour écorniflons). s. m. pl. Bribes d’un repas de noces distribuées à ceux qui viennent tendre la main à la porte du local où mangent les invités. - (10) |
| cornille (na) : corneille - (57) |
| cornille : (nf) corbeau - (35) |
| cornille : corbeau. III, p. 42 - (23) |
| cornille : Corneille, corbeau. « Les cornilles sant veni de bonne heure c 't 'hivé (cet hiver) ». - (19) |
| cornille : corneille. - (52) |
| cornille, s. f. corneille, corbeau. - (08) |
| còrnille, s. f., corneille. - (14) |
| cornille, s.f. corneille. - (38) |
| cornille. n. f. - Corneille. - (42) |
| cornille. s. f. et cornillat. s.m. Bluet. - (10) |
| cornillée est aussi un terme de boucherie qui n'a aucun rapport avec le mot précédent. La cornillée est le faux-filet du bœuf ou de la vache. - (13) |
| corniole, cornioule, corniolon : s. f. et m., gosier, gorge ; passage souterrain. - (20) |
| corniolon : gosier. Œsophage ! - (62) |
| corniolon : trachée artère. (CH. T II) - S&L - (25) |
| corniolon, s. m., ensemble larynx et trachée. - (40) |
| corniote, petit gâteau triangulaire. - (16) |
| còrniote, s. f., sorte de petit gâteau aus œufs, ainsi nommé parce qu'il est à plusieurs cornes. - (14) |
| corniote, s.f. sorte de gâteau en forme de chapeau à cornes. - (38) |
| corniots. s. m. pl. Ridelles du devant et du derrière d’une voiture. (Percey). - (10) |
| corniotte - petit gâteau à plusieurs cornes et en général petit gâteau fait avec un reste de pâte. - Main mère, vô me fairâ ine corniotte dans le for. - Ceute année i beillerons des corniottes es enfants pour étreunes. - (18) |
| corniotte : s. f., pâtisserie aux amandes et en forme de tricorne, analogue à la pâte des choux sans crème. - (20) |
| corniotte. Coiffure d'homme ressemblant au tricorne. Pâtisserie bourguignonne dont l'intérieur est rempli de fromage et les bords relevés comme ceux d'un chapeau à trois cornes... - (13) |
| corniotte. Met national, gâteau de pâte avec du fromage blanc à l'intérieur. - (12) |
| cornioule : (nf) gosier - (35) |
| cornioule, courniôle n.f. (du lat. corneolam, qui a la forme d'une corne, d'un cor) 1. Gosier, appétit, voix. 2. Fanon de la vache. 3. Oesophage. Voir gordzenioule. - (63) |
| cornioule, golaillon : gosier, pomme d’Adam - (43) |
| cornioulon (on) : cou (d'oiseau) - (57) |
| cornioulon (on) : pomme d'Adam - (57) |
| cornioute : s. f., couloir étroit, gorge resserrée. Voir corniole, cornioule. - (20) |
| cornœye, s. f. corbeau, corneille. - (24) |
| còrnœyi, v. n. pousser et frotter avec les cornes. - (24) |
| cornot (n.m.) : cornet, tuyau - (50) |
| cornot (on) : épi (de maïs) - (57) |
| cornot (on) : tuyau (de poêle) - (57) |
| cornot : conduit de cheminée, goser, « grande gueule » - (37) |
| cornot : Tuyau « in cornot de poile », un tuyau de poêle. - Corne, « Le cornot du vaichi », la corne du vacher. - Voix, « ol a in ban cornot » , il a une voix puissante. - (19) |
| cornot d’sarpent : trou dans la terre ou gîte un serpent - (37) |
| cornot, s. m. cornet, étui à aiguilles. « Cornot » = cornet, dont le féminin cornette est souvent pris dans le sens de chose pointue. - (08) |
| còrnòt, s. m., cornet. - (14) |
| cornot. s. m. Etui pour les épingles et les aiguilles. (Ménades, Étivey). - (10) |
| cornotte. s. f. Corne dans laquelle les vignerons portent aux vignes le sel nécessaire pour leurs repas. - (10) |
| cornouèille : corneille - (48) |
| cornoueille : corbeau - (39) |
| cornue (n.f.) : macre des étangs - aussi çatigne d'yau - (50) |
| cornue : châtaigne des étangs. - (30) |
| cornue. Fruit de la mâcre, autrement dit, la châtaigne d'eau. - (49) |
| cornuelle : châtaigne d'eau. - (09) |
| cornuelle, corgnuelle, cornouelle. n. f. - Macre, châtaigne d'eau : « Vous savez aussi ce que c'est, des cornuelles ? Un jour, j'ai voulu en pêcher moi-même, dans l'étang des Barres ... » (Colette, Claudine à Paris, p.281) - (42) |
| cornûre. Ce mot s'emploie pour désigner l'ensemble des cornes du bœuf. « C'te bû a in-ne jolie cornûre ». - (49) |
| cornus : 4e qualité de chanvre. IV, p. 15-1 - (23) |
| cornuziot. s. m. Sorte de chardon. (Saint-Bris). - (10) |
| coron. Courons. - (01) |
| corone. Couronne, couronnes... - (01) |
| coröte, sf. curette. - (17) |
| corou : coureur (courou d'mai) - (51) |
| corou : Coureur. « In Corou de chemin », un vagabond. « San homme est in corou », son mari est un coureur de femmes, un débauché. - (19) |
| còrou, adj., coureur, mauvais sujet, vagabond. - (14) |
| corou, ouse, s. coureur, coureuse, celui ou celle qui aime à vagabonder. - (08) |
| corpelé, corporé. adj. Corpulent. Un homme bien corporé, un homme bien bâti, bien fait. - (10) |
| corpiâ, subst. masculin : personne malhonnête ou déloyale. - (54) |
| corpiotons :"se coucher en corpiotons", se ramasser en boule. - (38) |
| corpointer : (corpoin:tè - v. intr.) se dépêcher, se hâter dans son travail. - (45) |
| corporance, s. f., corpulence : « Pad i! c'qu'ô dèt mainger d'avou c'te corporance ! » - (14) |
| corporé ; bèn corporé, bien bâti de sa personne. - (16) |
| corporé : adj., vx fr. corporu, corpulent. - (20) |
| corporé. adj. - Corpulent, costaud. On a employé corporer au XIIe siècle dans le sens de donner un corps à, par dérivation du latin corpus-corps. À la Renaissance, un homme corporu est une personne de grande taille, qui a de la corpulence. - (42) |
| corporence. Corpulence. - (49) |
| corporence. s. f. Corpulence. - (10) |
| corrailler : voir crouiller. - (20) |
| corrandier, n. masc. ; garçon coureur de rues, de filles ; garçon qui court les filles et qui ne s'attache à aucune. Vote Dandy (Claude) est un corrandier ; vos n'enferez rien. - (07) |
| corrandjer, corrier, cossard. Têtu. - (49) |
| còrrat ou còrrati, s. m. coureur, libertin. - (24) |
| corrater v. Courir les filles, aller d'une maison à l'autre pour bavarder. Voir corre. - (63) |
| corrateux, corrateuse n. Personne plus souvent chez les autres que chez elle. - (63) |
| corratî, corratîre n. Celui ou celle qui court après une personne de l'autre sexe. - (63) |
| côrre - courir. Pour les raitraipai en fauro qu'i correussains bein. - Pour jue les enfants côrant les uns aipré les autres. – Aivou lu, ce n'a pâ mairehai, en fau côrre. - (18) |
| corre la moutse loc. Galoper en levant la queue, harcelée par les mouches, en parlant d'une vache. - (63) |
| corre la pole loc. Coutume en usage chez les conscrits : ils allaient d'une maison à l'autre, à pied, et en traînant à leur suite, attachée à une ficelle, une malheureuse poule qui arrivait en piteux état dans son poulailler à la fin de la tournée. - (63) |
| corre le mai loc. Coutume en usage chez les jeunes du village : dans la nuit du 30 avril au 1er mai, ils se rendaient de maison en maison et chantaient une petite chanson ; les paysans qui le voulaient bien leur donnaient un œuf et le soir, avec tous les œufs récoltés, ils faisaient une grande omelette. - (63) |
| corre su v. Ô corre su ses vingt ans. Il est dans sa vingtième année. - (63) |
| corre v. (v. fr. courre) 1. Courir. 2. Fréquenter. Is s'corrant aprés: ils se fréquentent. 3. Dans le sens de souffler : Quand la bise corre nos reste pas pyanté à l'hiveurnodze. 4. Dans le sens d'apprécier : Dz'y corre pas d'aprés. Je n'y tiens pas, ce n'est pas ce que je préfère. - (63) |
| corre, courir. - (05) |
| corre, v. n. courir, aller vite : « léche-lu corre », laisse-le courir. - (08) |
| corre. Courrir. Nous appelons corriers, les Bohémiens, gens courant les pays. - (03) |
| correau, coureau, couraut, courriot. s. m. Verrou. - (10) |
| corrée, coeur et poumons. - (05) |
| côrrére – coudre ou coudrier. - Ne peurnez pâ de lai côrrére pou fâre des chevilles, ç'â du bô trop tenre. - Lai côrrére â bonne pou fàre des painés. - (18) |
| correux d'feunnes n.m. Coureur de jupons, coq de village, Dom Juan. - (63) |
| corri : courir - (51) |
| corri la preutenteine : courir les chemins avec une connotation péjorative - (51) |
| corri les feuilles (geurioder) (corri l'guilledou) : courir les filles - (51) |
| corri l'guilledou (geurioder) (corri les feuilles) : courir les filles, mener une vie de débauche - (51) |
| corri, v. courir. - (38) |
| corrier, coureur, vagabond. - (05) |
| corrigeable : adj., vx fr., corrigible. - (20) |
| corrigeante : s. f., correctionnelle. - (20) |
| corrigi : corriger - (57) |
| corroie n.f. Courroie. - (63) |
| corrompe, v. a. modifier la nature d'une substance par un mélange. On corrompt la crudité de l'eau en y mettant du vinaigre ; on corrompt une mauvaise odeur en brillant des grains de genévrier, etc… - (08) |
| corsâ : Poursuivre en courant. « I l'atit bin corsâ mâ i ant pa pouyn l'étraper (mais ils n'ont pas pu l'attraper) ». - (19) |
| corse : Course. « San chin prend les lièvres à la corse ». - (19) |
| corse, s. f. course. - (08) |
| còrse, s. f., course. - (14) |
| corsé. Vin corsé, c.-à-d. qui a du corps, qui est vineux, et non encore dépouillé... - (02) |
| corseai, s. m. fragment d'écorce, morceau de l'enveloppe du chêne après l'écorçage. Les bottes d'écorce telles qu'on les livre au commerce sont un faisceau de « corseais. » - (08) |
| corser, v. a. écorcer, enlever l'écorce d'un arbre : « corser eun châgne. » - (08) |
| corset : s. m., tricot à manches. - (20) |
| corset, s. m. corsage en étoffe qui accompagnait le cotillon des femmes. Le vêtement complet se composait ainsi du « corset » et du « cotillon. » le tout s'appelait : « les habits. » - (08) |
| cors-fétu. : Courte-paille (du latin curtus fustis), court bâton. - (06) |
| corsöt, sm. corset. - (17) |
| corssins, : prestans. -Banquiers, prêteurs sur gage. (Franch. de Seurre, 1278.) - (06) |
| cort, e, adj. court, qui n'est pas long, petit, bas sur jambes. - (08) |
| cort, s. f. cour, espace libre autour d'une habitation. - (08) |
| cort, tje, adj. court, courte. - (17) |
| cortaud : Court de taille. « In greu cortaud ». - (19) |
| corte : Courte. « Sa reube est treu corte ». « Ol a la mémoire corte » : il oublie vite les services qu'on lui rend. - (19) |
| côrte, adj. court : « J 'avons tiré à la carte bûche, é pis y é lu qu'a gagné. » - (14) |
| corte, courge. - (16) |
| corte, courge. - (28) |
| corti, courti, s. m. courtil, jardin. - (08) |
| cortil, s.m. curtil. - (38) |
| cortil. Jardin : en basse latinité curtile. - (13) |
| cortine, s. f. rideau de lit, surtout des anciens lits à baldaquin. - (08) |
| cortiser, v. courtiser. - (38) |
| còrtisou, s. m., garçon qui fait sa cour à la fille qu'il veut épouser. - (14) |
| cor-ton-ton. : (Onomatopée), cor de chasse. - (06) |
| cortors : rayons de labour plus courts que les autres - (39) |
| cort-pendu (pour carpendu). s. m. Pomme douce, fort rouge, à queue très courte. Selon Boiste, la véritable dénomination de cette pomme serait court-pendu ; ce qui démontre une fois de plus que le patois est souvent plus exact et plus français que les mots admis par les dictionnaires puristes. - (10) |
| çôs : n. f. Fois. - (53) |
| cösant, sm. souci, inquiétude. - (17) |
| cosé (se), cousé, vn. se taire. Voir cogé. - (17) |
| cosiment. Quasi, formé de l'italien cosi. - (03) |
| cosin n.m. Cousin. I' étint cosins d'la feusse gautse. (très éloignés, voire pas du tout). - (63) |
| cosin : s. m., cousin. Voir cousin. - (20) |
| côsin, e, s. m. et f., cousin, e. On dit, en Bourgogne : « Aler vouér les côsines » pour : Aller voir les filles. - (14) |
| côsin, ine, s. cousin, cousine. - (08) |
| côsinage, s. m., cousinage, en parenté et en amitié : « Bénédi et José sont prou d'côsinage ». - (14) |
| cössart, sm. jambières de drap ou de toile grossière destinées à protéger la pantalon. - (17) |
| cosse : laps de temps. Etat maladif passager. A - B - (41) |
| côsse - tâche, un certain temps de travail. - Ah pair exemple voiqui in bonne côsse qui traiveille ! – Te ne sais pâ,…. i ailons encore fâre c'te côsse qui. - (18) |
| cosse (à) loc. Parfois, par moments. - (63) |
| cosse : état maladif passager, flemme, fatigue - (43) |
| cosse : laps de temps - (34) |
| cosse : quinte de toux, averses. - (30) |
| cosse, cotse n.f. 1. Laps de temps, moment. D'eune seule cosse, en doux-trois cosses (d'une seule traite, en deux ou trois fois). A chtés cotses (à un de ces jours). 2. Enveloppe du pois ou du haricot. - (63) |
| cosse, enveloppe des fruits de la famille des légumineuses... Dans le Châtillonnais on dit écosser des pois ; on dit encore d'un champ de pois bien pourvu de cosses, et par conséquent fertile et productif, que c'est un champ cossu ; bien plus, on a transporté au figuré cette expression à une personne qui est dans l'abondance, c'at ein paysan cossu, c.-à-d. qui a de bonnes récoltes et beaucoup de biens. - (02) |
| còsse, s. f. casse, poêle à frire. - (22) |
| cösse, sf. cuisse. La jambe du genou au pied. Mollet. - (17) |
| cosse. Coup : « in-ne cosse de vent » pour un coup de vent. - (49) |
| cosson, cousson. s. m. Bruche, genre de coléoptère granivore. Du latin cossus. - (10) |
| cossonnier. s. m. Revendeur de beurre, de fruits, d’œufs, etc., qui achète sur les marchés pour revendre en gros. - (10) |
| cossu, élégamment vêtu. - (16) |
| cossu. : Riche. On dit cela d'un champ qui présente une abondante récolte en fruits à siliques ou à cosses. (Del.)- Selon - (06) |
| costemens et dépars. : Frais et déboursés. (Charte de commune de Seurre, 1278.) Le mot costoinge signifiait aussi dépens, frais, coût. (ls-surTille, 1310.) Ces expressions dérivent du bas latin custamentum. (Roq.) - (06) |
| costume : s. m., uniforme. Le Sous-Préfet, en costume, présidait la cérémonie. - (20) |
| cot - insecte qui ronge le linge, la laine surtout. On dit quelquefois Airtoillon. - To mes pliotons de laingne sont mégés des cots. - Sarrons bein nos haibits pour que les cots ne s'y mettaint pâ. - (18) |
| ç'ot (exp.) : (3ème p. du v. éte) : c'est au nord d'une ligne Brazey-en-Morvan – Montreuillon - y'ot au sud de cette ligne - (50) |
| cot (fém. : court - (57) |
| cot : mite, larve. Et asticot fréquemment présent dans les écoulements de purin. Du latin cossus : larve, chenille… - (62) |
| cot : ver blanc de mite ou de hanneton - (37) |
| cot, acour. Cour. Acour est formé de l'agglutination de « a » (article la) avec cour. - (49) |
| cot, cote, couet, couette adj. Court, courte. - (63) |
| cot, larve d'insecte, gros ver. - (05) |
| còt, s. m. mite, insecte qui ronge les laines : « Rang'ben tout çan tien, s'coue tes lain –nages ; t'sais qu'y a gros des cots cheû nous. » - (14) |
| cot. Larve d'un petit papillon de nuit qui ronge les étoffes de laine : c'est le synonyme du français mite. Les cochons ou cossons, appelés garguchons dans certains villages sont les larves qui pénétrent dans les cosses de pois et qui en rongent les grains. - (13) |
| cot. s. m. Coquelicot. - (10) |
| côtaines : Côtés. « Si les côtaines en voulant qu 'i s'appreuchint ». Voir au mot « s'appreuchi ». - (19) |
| cotain-ne (co-tin-ne), côté, "de cotain-ne" : de côté. - (38) |
| cotaison : s. f., marcotte, provin. - (20) |
| còtaison, s. f. marcotte de vigne, c'est-à-dire sarment « côté ». - (24) |
| cotche : une courge - (46) |
| cotchin. s. m. Jardin. (Rugny). - (10) |
| côtchon : la partie dure, serrée, d'une salade par exemple - (46) |
| cot-dinde : dindon - (37) |
| côte : se mettre au côte = s'abriter de la pluie. A - B - (41) |
| côte : tresse de noisetier servant à faire des paniers ou de la vannerie (en B : côti). A - (41) |
| côte (à ou d'à), loc. adv., à côté. - (14) |
| cote (à ou d'à). A côté. - (03) |
| côté (A) : Ioc., presque, à peu près. « S'il n'est pas un honnête homme, c'est tout de suite à côté. » (Républicain Maçonnais, 11 juil. 1909). Voir Après et Suite (A la). - (20) |
| côte (à), proche, à côté. - (05) |
| Côte (la), s. f., la Côte-d'Or. Dans le pays, pour désigner ce départ., dont nous sommes limitrophes, on dit « La Côte » tout court. - (14) |
| côté (Par) : loc. adv., de côté. - (20) |
| cotè : (participe passé pris comme adjectif) mité. - (45) |
| côte : bande d'écorce et de bois levée sur un coûti (branche de noisetier) - (48) |
| côté : Petit rassemblement pour causer entre voisins. « Aller au côté », voisiner. - (19) |
| còté et couté, s. m., côté, bord. - (14) |
| côte : (cô:t' - subst. f.) côte, bande d'écorce qu'on lève sur une tige de coudrier, et qu'on emploie à divers travaux de vannerie. - (45) |
| côte : écorce de noisetier utilisée pour faire des paniers - (39) |
| côtè : n.m. Côté. - (53) |
| cote, courge. Le mot côtignar signifie confitures de coings. - (02) |
| côté, sm. côté. - (17) |
| côté, vn. couter. - (17) |
| cote. : Courge. (Del.). - (06) |
| cotéjou : On appelle cotéjou, cotéjouses, les voisins qui sont venus en visite, au côté, dans la journée, le soir se sont les vaïlloux (les veilleurs). - (19) |
| côteler (les ambres) v. Enlever le cœur des osiers pour ne garder qu'un peu d'aubier avec l'écorce. - (63) |
| côteler : v. a. Côteler des osiers, en enlever le cœur pour ne laisser qu'une portion de l'aubier recouverte d'écorce, ce qui les rend plus souples. II faut, pour cela, que chaque branche ait été au préalable divisée longitudinalement en trois ou quatre parties. - (20) |
| cotelie : s. f., cruche. - (20) |
| cote-paille. Courte-paille. Jouer à la courte-paille , d'autres dissent aux buchettes, d'autres au court-fétu... - (01) |
| côter : Côuter. « Ses deux bûs (bœufs) li ant côté char ». - (19) |
| côter : enlever l' écorce d'une branche de noisetier - (39) |
| còter, v. a. casser légèrement un rameau pour le plier à angle droit sans le détacher. - (24) |
| côter, v. coûter. - (38) |
| cotère : lierre (en A : gravitso*). B - (41) |
| coteret, bois en fragment... - (02) |
| coteriau : Ver blanc, larve du hanneton. « Les coteriaux fant enco pu de mau que les cancoirnes (que les hannetons) ». - (19) |
| coteriau n.m. Ver blanc, larve du hanneton. Ce mot est bien moins employé que co ou co byanc. - (63) |
| côterie, ou coturie - morceau de fil à coudre pour enfiler dans l'aiguille. - Beille mouai voué ine côturie de fi. - De lai longueur d'ine côterie de fi, ci seré aissez. - Ine coturie de souaie. - (18) |
| còterie, s. f. longueur de fil préparée pour coudre, aiguillée. - (24) |
| coterot (chevaux de) : deux chevaux attelés l'un à côté de l'autre pour tirer une charrue. (VDS. T IV) - VdS - (25) |
| côtes de byettes n.f.pl. Blettes, cardes, poirée, surtout lorsqu'elles sont cuisinées. - (63) |
| côteume, et couteume, s. f . , coutume. - (14) |
| côteume, s. f. coutume, habitude. - (08) |
| côteunes (les) : désigne, péjorativement, les côtes sur les légumes qui sont anormalement développées, donc non consommables, car trop dures (chou, salade, bettes...), (voir : côton). - (56) |
| coteûre n.f. Couture. - (63) |
| cothère : lierre - (34) |
| cothère : lierre - (43) |
| côti : tresse de noisetier servant à faire des paniers ou de la vannerie (en A : côte*). B - (41) |
| côti n.m. (de côte). Tresse de noisetier pour la vannerie. Voir bansseron. - (63) |
| côti, côtes de porc dont on a enlevé la plus grande partie de la chair. - (16) |
| côti, n.m. ensemble des côtes du porc. - (65) |
| côti, s. m., morceau de viande taillé dans les côtes de l'animal, et que prennent souvent les ménagères. - (14) |
| coti. adj. et partic. p. du verbe Cotir. Froissé, meurtri, débilité. (Sénonais). - (10) |
| coti. Cotetetles de porc. - (01) |
| cotiau : coteau. - (66) |
| côtiau : un terrain étroit - (46) |
| cotiau,coutiau (n.m.) : couteau - (50) |
| cotignac (cotigna) : s. m., gelée de coings et de groseilles conservée dans une boite ronde en sapin, qui était très en honneur à Mâcon autrefois, et que la ville offrait aux personnages de marque lorsqu'elle voulait leur faire un gracieux. (Archives mun., CC. 81 à 143). - (20) |
| côtignar. : Confitures de coings. (Del.) - (06) |
| cotillon (on) : jupon - (57) |
| cotillon, s. m. jupon de femme sans corsage, ordinairement en boge et de couleur vive. - (08) |
| cötillon, sm. cotillon, jupe. - (17) |
| côtion : une côte de chou - (46) |
| còt'ion, s. m. nuque. - (24) |
| cotis : (cô:ti: - subst. m.) tige de noisetier sur laquelle on prélève des "côtes", de cinq à six. - (45) |
| côtis, sm. côte de porc ou de veau. - (17) |
| côtis. Côte de porc que l’on fait griller. Par extension, les côtes, le côté. - (12) |
| còt'iu, s. m. 1. coucou. — 2. Primevère. — 3. Cocu : c'est un fameux còt'iu. - (24) |
| cotivaie. adj. f. Elégante. ( Grand-champ). - (10) |
| cotivaie. n. f. - Femme élégante (Grandchamp, selon M. Jossier). Ce nom est dérivé de l'ancien français cotiver (issu du latin cultivare), utilisé dans plusieurs sens : 1. Adresser un culte à. 2. Parer, décorer. 3. Cultiver, labourer. Le poyaudin a conservé le second sens. - (42) |
| còtllion, s. m. jupon, cotillon. - (24) |
| coton, n.m. nervure de feuille. - (65) |
| côton, s. m. côte, nervure médiane de la feuille de la carde, poirée, et autres légumes, diminutif de côte. - (08) |
| còtòne, s. f., cotonnade : « J'm'é écheté eùne bàle robe de còtòne. » - (14) |
| cotonne : Cotonnade. « Eune reube de cotonne ». - (19) |
| cotou : boule de graisse sur la nuque. - (30) |
| côtouayi : côtoyer - (57) |
| côtrére : couturière - (48) |
| cötret, sm. ver blanc, larve du hanneton. - (17) |
| cotriâ : ver blanc. - (31) |
| cot'rîe, bande de vendangeurs. - (16) |
| côtron, habitant de la Côte, - (16) |
| cots (épis), épis dont la tige est cassée, épis courts. - (27) |
| cotse : gousse, silique. A - B - (41) |
| cotse : (nf) cosse de pois - (35) |
| cotse : gousse, silique - (43) |
| cotse n.f. (coche). Truie. - (63) |
| cotse, cosse n.f. Voir cosse. - (63) |
| cotsete : truie jeune - (43) |
| cotsette n.f. Jeune truie. - (63) |
| cotsette, cochette. Femelle du porc, du « cotson ». - (49) |
| cotson : (nm) porc - (35) |
| cotson : cochon - (51) |
| cotson de mer : cobaye, cochon d'inde. A - B - (41) |
| cotson de mère : cobaye - (43) |
| cotson d'mer n.m. Cobaye, cochon d'Inde. Voir couinât. - (63) |
| cotson gras : cloporte - (43) |
| cotson n.m. Cochon. - (63) |
| cotson. Cochon. - (49) |
| cotsonnrie : cochonnerie - (51) |
| cotsons : cochons - (43) |
| cotsse : cosse, haricots blancs - (43) |
| cottai, cotterant - soutenir, appuyer, mettre contre. – Cotte don le sai de treufes, â vai chouer. - Vô cotteras l'heurloge pour le mette d'aiplion. - (18) |
| cotte : s. f. petite boule de terre dont on se sert pour caler les tuiles. - (21) |
| cotte, s.f. jupe qui traîne. - (38) |
| cottereau, en patois cotteria, est l'augmentatif de cot : ce sont les grosses larves du hanneton. Les cottereaux sont aussi redoutables pour les jardiniers que les cotteraux, paysans révoltés., ont été, dans le XIIe siècle, redoutables au clergé de la Bourgogne. Ce mot Cottereau est devenu le nom d'une famille beaunoise qui vivait au XIVe siècle et aussi le nom d'une rue, appelée plus tard rue des Tonneliers. - (13) |
| cottiére, cottire (côtîre) : s. f., coussinet de paille tressée qui se place sur le front des bêtes à cornes et sur lequel passe la laleure ou corde qui les lie au joug. - (20) |
| cottis, cueûtis : épaisseur de ronces ou de noisetiers, servant à faire des paniers - (43) |
| cotton, cottion : cotillon, jupon. - (33) |
| cotton. s. m. Jupon, petite cotte. - (10) |
| çou (n.m.) : chou - (50) |
| cou de queurneuil : bleuet - (43) |
| cou, adj., caché, couvert. Ce mot, redoublé, est une des exclamations les plus populaires parmi nos nourrices jouant avec l'enfant : « Cou-cou !... ah ! le voilà ! » - (14) |
| çou, s. m. chou. « çou bian, çou var » = chou blanc, chou vert. - (08) |
| cou, sf. pierre à aiguiser la faux. - (17) |
| cou. : Couvert, caché. - (06) |
| couâ : n. m. Serrure en bois. - (53) |
| couà, s. m., corbeau. Onomatopée. - (14) |
| coûa. n. m. - Corbeau. - (42) |
| couâ. s. m. Corbeau. - (10) |
| couache. s. m. Sorte de longue prune noire, très-agréable au goût, qui sert tout particulièrement à faire des pruneaux. - (10) |
| couâchlle, s, m. couvercle. - (22) |
| couai : couver. La poule coue : la poule couve. - (33) |
| couaiç’ot (l’) : (le) cochon, (le) porc - (37) |
| couaiche (nom féminin) : truie. (On dit également treue). - (47) |
| couaichlle, s. m. couvercle. - (24) |
| couaichon (nom masculin) : cochon. (On dit également couaisso). - (47) |
| couaiffe (na) : coiffe - (57) |
| couaiffer - pigni : coiffer - (57) |
| couaiffeur (on) : coiffeur - (57) |
| couaiffeûse (na) : coiffeuse - (57) |
| couâillai - jeter de gros cris de plainte, de surprise. - Quand à m'é vu entrai al é couâillai in co que ci m'é fait tressautai. - C't enfant lai couâillot, ai fâre pô. - (18) |
| couaillè : crier très fort comme un cochon qu'on égorge - (46) |
| couâillé, queuriè : v. i. Crier. - (53) |
| couailler (verbe) : crier, en parlant des volailles. - (47) |
| couailler : crier - (44) |
| couâiller : crier, avec l’intonation du cri du corbeau : couâ ! couâ ! - (37) |
| couaîller : crier, émettre un son aigu - (48) |
| couailler : crier. (V. T IV) - A - (25) |
| couailler, crier, comme une bête de bassecour qu'on va tuer. - (27) |
| couailler, v. a., crier fortement par suite d'une brusque douleur. N'a pas le même sens que couiner, qui se trouve dans le Glossaire du Morvan, p. 219, qui signifie crier en pleurant ou rendre un son aigu et qui se dit des choses aussi bien que des personnes, comme d'une porte qui couine quand les ferrures ne sont pas graissées. - (11) |
| couailler. Se dit des cris poussés par une poule qu'on prend. Fig. Pousser des cris rappelant ceux de la poule. - (49) |
| couâiller. v. - Crier, pour une poule que l'on vient de saisir. S'emploie aussi au figuré pour une personne: « L'Évelyne, a s'est brûlée su’ l'fourniau, te l'aurais entendu couailler ! Y f'sait pas bon tourner autour ! » - (42) |
| couailler. v. n. Crier. (Bléneau). — En général, imiter le cri du corbeau. - (10) |
| couaïlli : Crier fort. « C 'te pouleille couaïllait quand j’l’ai prise ». - (19) |
| couaillon. n. m. - Gros poussin, petit coq. - (42) |
| couain. s. m. Contraction pour couvain, larves de mouches ou d’insectes. - (10) |
| couairée, corée : n. f. Ensemble intérieur du thorax : cœur, poumons, foie. - (53) |
| couairi : v. i. Courir. - (53) |
| couairne, couarne. s. f. Couenne. (Girolles). - (10) |
| couaissot (n.m.) : cochon - (50) |
| couâle (n. f.) : corbeau - (64) |
| couale (nom féminin) : corbeau. - (47) |
| couale (une) : un corbeau - (61) |
| couale : corbeau - (60) |
| couâle : voir cornille - (23) |
| couâler : (vb) brailler - (35) |
| couâler (couailler) : pleurer fort - (39) |
| coualer : rouspéter en pleurnichant. Pleurnicher. Le verbe est utilisé dans un sens mineur. Ex : "Lésse-don ta gamine, te vas encore la fée couâler !" - (58) |
| couâler, crier - (36) |
| couâlli v. Crier. - (63) |
| couâner : brailler - (43) |
| couâner v. Coasser, crier, hurler de douleur. - (63) |
| couanne : Couenne. « Eune couanne de lâ (lard) ». Au figuré : imbécile, naïf « T'as bin l'ar couanne ». - (19) |
| couanne n.f. Couenne. - (63) |
| couânné : 1 v. i. Crier, gueuler. - 2 v. i. Parler avec des sons aigus. - (53) |
| couânote : 1 n. f. Genre de klaxon. - 2 n. f. Crie facilement pour rien. - (53) |
| couard. s. m. Nuque. - (10) |
| couârde (na) : corde - (57) |
| couarder. v. - Couper la queue d'un cheval. (Sougères-en-Puisaye). Verbe formé sur coe, queue en ancien français (de cauda en latin). Le français couard, lâche, est issu de l'expression imagée « avoir la queue basse ». - (42) |
| couârne (na) : corne - (57) |
| couarne, s. f. couenne, peau, cuir d'un animal. Quelques parties du Morvan prononcent « couane ». - (08) |
| couârne, s. f., couenne, peau du cochon. - (14) |
| couârner : corner - (57) |
| couarner : Pleurer fort. Voir aussi cheugni. - (19) |
| couarner, v. a. gazonner. Cette prairie est nouvelle, mais elle est déjà bien « couarnée. » - (08) |
| couârte (na) - tchouârte (na) : couverture - (57) |
| couârte, s. f. couverture. - (22) |
| couasse, couisse : couveuse - (60) |
| couasse, couisse. s. f. Poule couveuse. (Arcy-sur-Cure). — Petite fille. Se dit en mauvaise part. (Soucy). - (10) |
| couasser, couesser. v. - Chanter : chant particulier émis par la couisse, la poule qui couve, ou qui appelle ses poussins. - (42) |
| couasser. v. n. Appeler ses petits, en parlant d’une poule qui a des poussins. (Percey). - (10) |
| couassio : cou. I vas te torde le couassio : je vais te tordre le cou. - (33) |
| couassio : n. m. Cou. - (53) |
| couasson, s. m. partie postérieure du cou. - (08) |
| couasson, s. m. tronçon de corde de grosseur moyenne. - (22) |
| couasson. s. m. Dernere du cou. (Eitvey). - (10) |
| couate, coutre. Couette, matelas de plumes. - (49) |
| couati, s. m. étui où le faucheur met sa pierre à aiguiser. - (22) |
| couati, s. m. étui où le faucheur met sa pierre à aiguiser. - (24) |
| couatron, coutron. Petite couette pour enfant. - (49) |
| couau - qui n'a pas de queue - In chien couau ce n'a pà joli. - Vote poule à couade, ç'â les chiens que l'ant aitraipée. - (On peut voir à quoue) - (18) |
| couau, aude, adj. qui a la queue coupée ou rognée. Dans le Morvan bourguignon « couau » signifie seulement écourté et se prend plutôt au figuré un habit « couau » est un vêtement trop court. - (08) |
| couaucaude, adj. écaudé, qui n'a pas de queue, qui l'a perdue. - (08) |
| couaude : sans queue, à la queue coupée - (48) |
| couayé, crier, pleurnicher à grand bruit. - (16) |
| cou-badoue (A). Locut. adv. usitée dans i cette expression : Porter à coubadoue, porter sur son dos quelqu’un qui vous tient par le cou. (Villeneuve-les-Genôts.) - (10) |
| coubasse. s. f. Femme plaignarde. - (10) |
| couberdin, coubardoue (à). loc. adv. - Jeu d'enfants : porter quelqu'un sur son dos, jouer au cheval, synonyme de cahadoue. - (42) |
| coubilli : lier les pattes d'un petit animal. A - B - (41) |
| coubilli : lier les pattes d'un cabri, d'une volaille - (34) |
| coubyi v. (de coupler). Lier ensemble les pattes d'une volaille, d'un chevreau. Voir empji. - (63) |
| couç’ant (l’) : (l’) ouest - (37) |
| coûch’tri : mortier de mauvaise qualité, mélange - (37) |
| couche : voir pressoir. - (20) |
| couche, s. f. 1. Cosse de haricot pois, colza, fève. - 2. Entaille destinée à servir de remarque. - (22) |
| couche, s. f. maie du pressoir. - (24) |
| couchettes, s. f., langes : « Alle a bon entortillé l’petiot dans ses couchettes. » - (14) |
| couchi (se) : se coucher. (MLB. T II) - S&L - (25) |
| couchi : Coucher. « Te m'ennue, va dan te couchi ». « Couchi à padre (perdre) », découcher. - « In nam à couchi defô », un nom à coucher dehors, un nom baroque. - Verser, « La plio a to couchi les bliés », la pluie a complètement versé les blés. - (19) |
| couchi, v. tr. , coucher. - (14) |
| couchin, cuchin, s. m. coussin, sac bourré de paille, de foin, de plume, etc. - (08) |
| couchœ, s. m. sommet d'un arbre, d'une montagne. - (22) |
| couchon (un) : un cochon - (61) |
| couchon : bruche du pois. IV, p. 29 - (23) |
| couchon : cloporte. IV, p. 29 - (23) |
| couchon : un cochon (voir gouri) - (46) |
| couchon : n. m. Cochon. - (53) |
| couchon : porc. On l'élève dans un "toit" obscur. Pour qu'il soit gras, on le sort peu. - (58) |
| couchon, cochon. - (27) |
| couchon, porc ; le cochon, pour ceux qui n'osent pas prononcer ce nom, est un abiyé d'soîe, les plus libres dans leur langage disent : not' mossieu. - (16) |
| coûchon, s. m., sanglier. - (40) |
| couchon, s.m. cochon (patois moderne) ; en dit aussi tiatia, varra. - (38) |
| couchon, sm. cochon. Voir gouri. - (17) |
| couchon. n. m. - Cochon. - (42) |
| couchot (i) (u) - cuchot (i) (u) : dessus (tout en haut) - (57) |
| couchot (on) - cûchot (on) : faîte - (57) |
| couchot (on) - cuchot (on) : sommet - (57) |
| coucmale, s. f. large champignon ; par dérision, coiffure trop large. - (22) |
| coucmalon, s. m. petit tas de regain. - (22) |
| coucon, s. m. nom plaisant de l'œuf. - (22) |
| coucou (faire), v. n. se cacher, se coucher. Ne s'emploie qu'en parlant aux enfants. - (08) |
| coucou (m... de), s. f., gomme des pruniers, cerisiers, etc. - (14) |
| coucou : Coucou, oiseau. « A la saint Benoit (21 mars) le coucou vint ». - Coucou, fleur, voyez Barjale. - Coucou, exclamation que pousse une personne qui se montre subitement, me voilà, coucou ! - Jeu enfantin qui consiste à se cacher et à se montrer alternativement en disant : coucou pédu (perdu). - Il faut avoir de l'argent sur soi la première fois que l'on entend chanter le coucou si on veut en avoir toute l'année. Dicton. - (19) |
| coucou : primevère sauvage - (37) |
| coucou : primevère, jonquille - (48) |
| coucou ; merde d'coucou, sorte de gomme qui suinte de certains arbres, par exemple, du cerisier, du pêcher et dont les enfants sont friands. - (16) |
| coucou ? — Àh ! le voilà ! Sorte de jeu pour amuser les petits enfants... - (13) |
| coucou (ain) : (un) papier collant, attrape-mouches - (37) |
| coucou, n.m. jonquille. - (65) |
| coucou, s. m. petite mouche noire et de forme allongée qui s'attache aux animaux pendant l'été. - (08) |
| coucou, s. m. primevère des prés, primula officinalis, connue aussi sous le nom de paquotte ainsi que sous celui de Mirliguet que nous avons précédemment signalé. - (11) |
| coucou, s.m. primevère. - (38) |
| coucou. n. m. - Gomme des arbres fruitiers. - (42) |
| coucoulëcou, chant du coq (onomatopée). - (16) |
| coucouné, v. a. embrasser, caresser tendrement, en langage badin. - (22) |
| coucu, s. m. coucou, oiseau. environ de Château-Chinon. - (08) |
| coude : coudre - (48) |
| coude : (coud' - v. trans.) coudre. - (45) |
| coude : s. m. Gagner derrière le coude, perdre au jeu. - (20) |
| coudée : s. f., ancienne mesure de longueur pour les chemins. La coudée simple ou coudée commune valait 1 pied 1/2, c'est-à-dire 0,487 m. La coudée géométrique valait 6 coudées simples. La grande coudée en valait 9. - (20) |
| coûdeleûre : Corde qui sert à fixer le joug sur la tête des bœufs. Voir leûre. - (19) |
| cou-de-pi (on) : cou-de-pied - (57) |
| coudeure : Couture, cicatrice. « Ol a eune coudeure su la joe », il a une cicatrice à la joue. - (19) |
| coudeure, s. f. couture. - (24) |
| coudouer. v. a. Coudoyer. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| coudré : tailleur d'habits (en B : coudri). A - (41) |
| coudre (na) : courge - (57) |
| coudre : v. courge. - (21) |
| coudré, coudrère : tailleur, couturière - (36) |
| coudre, coudrier. - (16) |
| coudré, cousou : tailleur et confectionneur d’habits « à façon » à son domicile - (37) |
| coudré, libellule - (36) |
| coudre, n.f. courge. - (65) |
| coudré, s. m. tailleur d'habits. - (08) |
| coudre. s. m. Coutre, partie tranchante de la charrue. — Instrument à l’usage des fendeurs de bois. C’est avec le coudre qu’ils fendent les lattes, les paisseaux, les échalas. Du latin cutter. - (10) |
| coudré. Tailleur d'habits. Autrefois on allait à domicile. Araignée à très longues pattes dont le nom est faucheux. - (49) |
| coudrée : couturière. - (52) |
| coudrée, couturière - (36) |
| coudrer (n.m.) : couturier, tailleur d'habits (aussi coudré) - (50) |
| coudrer. v. n. Sécher à demi, tourner du verre au feu, mûrir, en parlant du bois. - (10) |
| coudrère : couturière (en B : coudrire). A - (41) |
| coudrère : Couturière. « De la miche de coudrère » des piqûres d'aiguille. « Finis dan voir, si te me laiche pas tranquille t'aras de la miche de coudrère », je te piquerai avec mon aiguille. - (19) |
| coudret : tailleur - (60) |
| coudrette : coudrier, noisetier - (60) |
| coudri : (nm) coudrier - (35) |
| coudri : couturier tailleur - (51) |
| coudrî, coudrire n. Couturier, couturière. - (63) |
| coudrie : grande aiguillée de fil. (S. T III) - D - (25) |
| coudrire : (nf) couturière - (35) |
| coudrou : coq d'Inde. (F. T IV) - Y - (25) |
| coudrou : dindon. - (66) |
| coudrou. s. m. Coq-d’Inde. (Coulours). - (10) |
| coudroué. Se dit d'une chose qui n'est pas encore en point de maturité, qui est encore verte. - (08) |
| coudu, participe passé du verbe coudre. - (16) |
| couduriére, s. f. noisetier. - (08) |
| coue (n.f.) : queue - (50) |
| coué (n.m.) : étui où l'on place la pierre à aiguiser du faucheur - (50) |
| coué (nom masculin) : étui en bois ou en corne où se plaçait la pierre à aiguiser du faucheur. - (47) |
| coue : (nf) queue, mancheron de la charrue - (35) |
| coué : coffin (pour mettre la pierre à aiguiser) - (48) |
| coue : mancheron de la charrue - (43) |
| coue : queue - (43) |
| coue : Queue. « Quand an parle du loup an en voit la coue », se dit lorsqu'on voit entrer la personne dont on est en train de parler. - Dicton : « Y est tojo la coue qu 'est le pu maulagi à écorchi », l'achévement d'une besogne présente plus de difficultés que le reste. - « Coue de caiche », larve de grenouille, têtard. - « Coue de rate » prèle (equisetum arvense) - (19) |
| coué : sabot - (48) |
| coué : coffin, petit récipient pour mettre la pierre à aiguiser porté à l'arrière de la culotte. Pou l'aigujouere faut le coué : pour la pierre à aiguiser il faut le coffin. - (33) |
| coue d’casse : (nf) têtard - (35) |
| coue d'casse : têtard - (43) |
| coué : (coué - subst. m.) coffin, coyer, sorte d'étui rempli d'eau où baigne la pierre à aiguiser du faucheur au figuré, par assimilation de forme : sabot sans bride. - (45) |
| couè : n. m. Coffin, étui contenant de l'eau pour pierre à aiguiser les faux. - (53) |
| coué : s. f. couvée. - (21) |
| couë, queue. - (05) |
| coûe, queue. - (16) |
| coue, s. f. queue d'animal ou par analogie tout ce qui en rappelle la forme. - (08) |
| coué, s. m. étui cylindrique où les faucheurs placent leur pierre à aiguiser, godet en forme de queue qu'ils attachent à leur ceinture et qui renferme l'aiguisoir aussi appelé coue dans l'ancienne langue. - (08) |
| coue, s.f. queue, - (38) |
| coue, sf. queue. - (17) |
| coué. n. m. - Coq. - (42) |
| coue. Queue. - (03) |
| coué. s. m. Coq. - (10) |
| coué. s. m. Vieux tronc, vieille branche, vieille souche de vigne. Du latin cauda. - (10) |
| couèche : truie - (48) |
| coueche : jeune femelle du porc n'ayant jamais eu de petits. - (33) |
| couèche : (couèch' - subst. f.) jeune truie qui n'a pas encore porté. - (45) |
| coueche : n. f. Jeune femelle du porc n'ayant jamais eu de petit. - (53) |
| couèche, cuèche n.m. Couvercle. - (63) |
| couécheu, sommet. - (27) |
| couèchi : v. couver. - (21) |
| couèchon : (subst. m.) cochon. - (45) |
| couèchon, couèchot : cochon, porc - (48) |
| couechot : porc. Autrefois dans toutes les majons y évot un couéchot : autrefois dans toutes les maisons il y avait un cochon. - (33) |
| couechot : n. m. Porc. - (53) |
| couéchot. s. f. Cochon. (Avallonnais). - (10) |
| couée (eau) : eau croupie. (S. T III) - D - (25) |
| couée (féminin) : couvée - (39) |
| couée (masculin) : coffin, gros sabot - (39) |
| couée : couvée - (48) |
| couée : couvée, abri - (61) |
| couée : couvée, nichée. - (52) |
| couée : Couvée. « Eune couée de p 'sins (poussins) ». - (19) |
| couée : grand nombre. (RDB. T III) - S&L - (25) |
| couée : multitude. Grand nombre. - (62) |
| couée : une couvée, une nichée. Une couée de pitots : une couvée de poussins. - (33) |
| couée : n. f. Abondance excessive. - 2 n. f. Couvée. - (53) |
| couée, grand nombre d'enfants... - (02) |
| couée, prolongement d'un champ en pointe, souvent inculte ; de l’ia — ; eau stagnante qui demeure longtemps dans un vase sans être renouvelée et qui prend une mauvaise odeur. - (27) |
| couée, s. f. couvée, nichée : « eune couée d'ouillais, eune couée de p'sins, eune couée de p'tiots », couvée d'oiseaux, de poussins, d'enfants. - (08) |
| coûée, s. f., grand nombre d'enfants. - (40) |
| couée, s. f., suite, nichée, ribambelle, queue : « Ah ! c'te Bertiaude, álle a eùne couée d'enfants. » - (14) |
| couée, s.f. couvée ; ine couée de p'ssins : une couvée de poussins. - (38) |
| couée, suite, multitude, robe crottée. - (05) |
| couée. s. f. Contraction de couvée. Une couée de canards. — Se dit, par extension et par mépris, pour race, famille, séquelle. La pouv' femme, all' a une fichue couée. J'n'ai peur ni de lui, ni de sa couée. - (10) |
| couée. s. f. Souche de vigne arrachée. J’ai arraché ma vieille vigne, j’avons des couées pour nous chauffer tout l’hiver. - (10) |
| couée. s. f. Viande de porc près de la saignée. De cou. (Montillot). - (10) |
| couée. : Grand nombre d'enfants. (Del.) - (06) |
| couéfé, part, passé du verbe coiffer inusité dans le sens d'accommoder les cheveux. Être né « couéfé » est chez nous comme partout d'un bon augure. - (08) |
| couéfe, s. f. bonnet de femme. - (08) |
| coueffe : s . f. coiffe. - (21) |
| coueffe. Coiffe. - (49) |
| couégnée : n. f. Cognée. - (53) |
| couégner (cougnier) : cogner - (39) |
| couègnie : cognée, hache - (48) |
| couégnie (cougnie) : cognée - (39) |
| couégnie, coignie. s. f. Cognée. (Montillot). - (10) |
| couégnon. n. m. - Repas du baptême. (Saint-Martin-des-Champs, selon M. Jossier) - (42) |
| couégnon. s. m. Repas de baptême. (Saint-Martin-des-Champs). - (10) |
| çouéhi, v. a. choisir. - (08) |
| couèigner : cogner - (48) |
| couèle, sf. gamine mal tenue. - (17) |
| couelle : jeune fille. - (66) |
| couèmelle, coimelle. n. f. - Champignon, la coulemelle. - (42) |
| couéne, adj., niais, imbécile : « T'li as lassé prende tes gobilles ? Oh ! qu'té couéne, va! » - (14) |
| couenn’ries : bêtises - (37) |
| couenne (ai l’ot) : s’agissant d’une femme, « elle est bête, bornée » - (37) |
| couenne (être) : honteux, consterné. - (29) |
| couenne (être) : se trouver désemparé devant une situation imprévue - (46) |
| couênne (être), être surpris. - (40) |
| couenne (lai) : (l’) épaisseur de la terre herbeuse d’une pâture - (37) |
| couenne (lai) : (la) peau du porc (par extension, la peau humaine du visage) - (37) |
| couenne, adj. capon, honteux. - (17) |
| couenne, adj., 2 genres, bête, timide, qui hésite à agir. Ex. : t’ôs couenne ! pour : que tu es donc bête ! - (11) |
| couenne, couanne. n. f. - Peau. Au XIIIe siècle, l'ancien français couenne signifiait la peau (du latin populaire cutinna). Puis le sens s'élargit pour désigner la croûte dure d'une terre, ou la peau du cochon raclée. Dans la première moitié du XXe siècle, le français utilisait l'expression « se racler la couenne » pour dire se raser. - (42) |
| couênnerie, s. f., bêtise, ânerie. - (40) |
| couer (v. tr.) : couver (œufs couis (œufs couvés sans avoir été fécondés)) - (64) |
| couer : (vb) enlever le tête des épis - (35) |
| couer : couver - (48) |
| couer : couver. Lè poule coue en parte : la poule couve en perte, hors du nid. - (52) |
| couer : (couè - v. trans.) couver (au propre et au figuré). 1 - sens propre: (en parlant d'une poule) el' cou: sé: pat', "elle couve ses pattes", autrement dit, elle ne couve rien, elle n'a pas d'œuf. 2 - sens figuré (en parlant d'une maladie) a non: cou:ro bin: qué:qu' cho:z' de chti. On dirait bien qu'il nous couve qqch. de grave, autrement dit : " il a le cancer". - (45) |
| couer : couver - (39) |
| couer, n.m. coffin de la faux. - (65) |
| couer, v. ; couver. - (07) |
| couer, v. a. couver. - (08) |
| couer. v. - Couver. - (42) |
| couer. v. a. Par syncope de couver. - (10) |
| couéraige, s. m. courage, force, vigueur, bonne volonté, santé physique et morale. - (08) |
| couéraigeou, ouse, adj. courageux, qui est en bonne santé. - (08) |
| couérandier. s. m. Coureur. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| couérandiou : n. m. Qui court les rues. - (53) |
| couérée : mou de porc - (48) |
| couêrée : foie du porc ou du sanglier (se dit aussi camboule). En cas de succès à la chasse on m'geot la couérée entre chassuers : en cas de succès à la chasse on mangeait le foie de sanglier entre chasseurs. - (33) |
| couèrée : (couèré: - subst. f.) foie de volaille. Se dit aussi du foie humain, avec une intention dépréciative. - (45) |
| couêrée : n. m. Foie de porc ou de sanglier. - (53) |
| couérée : poumon. - (32) |
| couérée, s. f. corée, le foie, le mou, les entrailles d'un animal. « chorée. » - (08) |
| couerie, sf. série interminable. Quantité excessive. - (17) |
| coues d'vatses: (nfpl) cirrus, longs nuages annonciateurs de pluie - (35) |
| couéssan. n. m. - Sorte de gojard. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| couessaut : porc. Ailleurs, on dit couessot. - (52) |
| couesson. n. m. - Creux à la base de l'occiput. (Diges, selon M. Jossier) - (42) |
| couessot : cochon, porc - (48) |
| couessot : un cochon (voir : coissot). - (56) |
| couessot : cochon - (39) |
| couessot : porc. - (32) |
| couessot, porc - (36) |
| couessot-gras : sorte de cloporte qui devient rouge dans l'eau bouillante - (39) |
| couessotte : truie, femme très sale (cf gaille, gamelle, treue) - (39) |
| couet : (nm) petit bout de queue - (35) |
| couet, couette : épi de céréale sans la paille - (43) |
| couet, couette adj. Court, courte. Voir cot, cote. - (63) |
| couet, teube : petit bout de queue - (43) |
| couet. s. m. Poulet, coq. (Sénonais). - (10) |
| couéte et coite, lit de plumes. - (14) |
| couete, couâtre : matelas de plumes que l'on met en plus du matelas pour tenir chaud en hiver. - (30) |
| couéte, s. f. le besoin ou le vif désir d'une chose. « Avoir couéte », avoir faute de quelque chose, manquer de... « i é couéte d'paingn' », j'ai besoin de pain. - (08) |
| couete, s. f. lit de plume et quelquefois couverture de lit. - (08) |
| couete. Couverture, du latin culcitra. Pour oreiller nous disons coutrote, qui en est dérivé. - (03) |
| couète. s. f. Besoin, désir, envie, convoitise. — Avoir couète, convoiter, désirer ; ce que les chiens manifestent en remuant la queue, la coue (cauda). (Domecy-sur-le-Vault). - (10) |
| couèter. v. a. et n . Convoiter, avoir besoin, avoir envie. - (10) |
| couèti (se) v. Se mettre à l'abri (au coûte). - (63) |
| couèti : s. m. coyer du faucheur. - (21) |
| couètron, coutron : coussin de plumes servant à coucher les petits. - (30) |
| couette (en avoir) : en avoir assez (mangé), signifie l'inverse selon le dictionnaire : manquer de qqch. - (56) |
| couette : lit de plumes. I, p. 24-5 ; V, p. 41 - (23) |
| couette, couotte, s. f. couveuse. - (08) |
| couette, natte courte des cheveux d'une petite fille ; graminée sauvage qui envahit les terres qu'elle dessèche. - (27) |
| couettes : nattes des cheveux d’une petite fille, lit de plumes - (37) |
| couettot, couettou, privé de queue, court. - (05) |
| couettre, coitre : s. f., couette. Lit de plume ou quelquefois de balouffe. - (20) |
| couey, couet, n. masc. coffin, étui pour la pierre à aiguiser la faux. - (07) |
| couézi (se) : se taire - (43) |
| couger. Se taire. Du vieux mot quoisier, du latin quiescere. - (03) |
| cougère. s. f. Fougère. (Percey). - (10) |
| cougi (se) : se taire. A - B - (41) |
| cougi (se) : Se taire. « Couge te dan, bavou », tais-toi donc, bavard ! - (19) |
| cougi : se taire - (34) |
| cougnaichance : Connaissance. « Ol a pardu cougnaichance», il s'est évanoui. « J'ai rencontré eune vieille cougnaichance ». - (19) |
| cougnaître : Connaître. « Te n'il cougnais ren » : tu n'y connais rien. - (19) |
| cougnâtre : connaître. Donne« cougnu » ou « cougnaishi » : connu (suivant la formulation). - (62) |
| cougné, s. m., cognassier. - (14) |
| cougner (verbe) : cogner, frapper. - (47) |
| cougner, v. cogner. - (38) |
| cougni - beûgni - doguer : cogner - (57) |
| cougni (na) : cognée - (57) |
| cougni (na) : hâche - (57) |
| cougnie (nom féminin) : hache. - (47) |
| coûgnie : cognée - (37) |
| cougnie : cognée. - (52) |
| cougnie, s. f., cognée. - (14) |
| cougnie, s.f. cognée. - (38) |
| cougnier. s. m. Coignassier. - (10) |
| cougnieutre, v. connaître. - (38) |
| cougnot. n. m. - Petit coin, petit emplacement. - (42) |
| cougnot. s. m. Petit coin. - (10) |
| cougnu - cognu : connu - (57) |
| cougnu : Connu « J'ai bin cougnu san grand-père ». - (19) |
| couhi, v. a. courir. - (08) |
| couhin fréeux (pour cousin fréreux). s. m. Cousin germain. (Puysaie). - (10) |
| couhin fréeux. n. m. - Cousin germain. - (42) |
| couhin. n. m. - Cousin. - (42) |
| coui ! excl. Les enfants, en jouant, jettent ce cri pour faire savoir qu'ils sont cachés. (V. Coù, Cachot.) - (14) |
| coui : coffin. - (31) |
| coui : couffin - (60) |
| coui : étui pour la pierre à aiguiser que le faucheur accrochait à sa ceinture - (46) |
| coui : s. m. coyer du faucheur. Petit étui de bois, de corne, ou de fer, dans lequel on suspend la pierre à aiguiser. - (21) |
| coui, coffi. n. m. - Coffin étui en corne, en bois ou en fer blanc, fixé par une patte à la ceinture du faucheur, dans lequel était placé la pierre à aiguiser. - (42) |
| coui, couhi. v. a . Se dit, à Trucy, par syncope pour courir. - (10) |
| coui, étui de la pierre à aiguiser. - (28) |
| coui. adj. - Couvé, pourri ; se dit d'un œuf.non consommable. - (42) |
| coui. Fourreau dans lequel les faucheurs mettent leur queu ou pierre à aiguiser. En vieux français cout et coz, du latin cos, pierre à aiguiser. - (03) |
| coui. Œuf dans lequel le poulet commence à se former. Nous disons qu'une poule est couiche quand elle demande à couver. Dégouicher une poule, c'est l'empêcher de couver. - (03) |
| coui. Partic. prés. du verbe couir (pour couvi, couvir). Couvé, pourri, gâté. — Œuf coui, œuf corrompu par un commencement d’incubation ou par quelque circonstance atmosphérique. — Nez coui , se dit, par assimilation, du nez puant d’un enfant morveux. - (10) |
| coui. s. m . Etui de corne ou de ferblanc, que les faucheurs suspendent à leur ceinture, et dans lequel ils mettent leur queux ou pierre à repasser. - (10) |
| coui. s. m. Coffin. (Sermizelles). - (10) |
| coui. Terme dont se servent les enfants dans leurs jeux pour faire entendre qu'ils sont cachés. - (03) |
| couicer (se) (v.pr.) : se coucher - (50) |
| couicer : coucher. - (52) |
| couicer, v. a. coucher, étendre. - (08) |
| couicer. v. a. Coucher. (Ménades). - (10) |
| couics. n. m. pl. - Genre de chaussons en caoutchouc, appelés ainsi par onomatopée avec le bruit produit en marchant. (Arquian) - (42) |
| couie (n. f.) : coffin, étui contenant de l'eau dans lequel le faucheur met sa pierre à aiguiser - (64) |
| couiffai. : Coiffé. I ne seu pas venun couiffai, c'est-à-dire je ne suis pas venu au monde riche et heureux. - (06) |
| couignai - faire un léger bruit, un peu aigu, choses ou bêtes. - Te n'entends pâ ? en me semble que le petiot chien couigne ai lai porte. - Ce maitin lai noige couignot bein sô les pieds. – Ile à fière, en fau voué, que ses soulé couignan queman cequi ! - (18) |
| couignard, couignousse – qui se plaint en pleurnichant. - Ne fais pâ entrai ce couignair lai ! Des gens queman cequi me fairaint deveni bête. - Vote petiote à bein couignouse corrigez don c'te misère lai. - (18) |
| couignè : geindre, se plaindre - (46) |
| couigné, pleurnicher ; se dit aussi du craquement des souliers neufs. - (16) |
| couigner : faire un bruit désagréable, grincer. - (66) |
| couigner, couiner (C.-d., Br., Morv., Y.). -Voir cbougner, plus haut. - (15) |
| couigner, émettre un petit bruit qui rappelle une plainte, se dit en parlant d'un petit chien, d'une brouette, d'une porte mal graissée, etc. - (27) |
| couigner, grincer. - (26) |
| couigner, pousser de cris plaintifs. - (28) |
| couigner, v. pousser de petits cris aigus. - (65) |
| couîgni v. Couiner, crier. Voir kîgni. - (63) |
| couignou : quelqu'un qui se plaint - (46) |
| couillard, s. m., mâle (lapin, bélier). - (40) |
| couiller (se) - se taire. – Veux-tu bein te couiller. - Couillez-vo don, baivairde vos ne saivez pâ ce que vô disez. - A liô z-é dit lai vritai en é bein faillu qu'à se couilleussaint. - (18) |
| couiller (se), v. pr., se taire, se tenir coi. Ex. : couille-toi donc. - (11) |
| couilleris. s. m. Courlis, oiseau. (Rugny). - (10) |
| couillî (se) : taire (se), se tenir coi. « Mâ couille te don ! » : mais tais toi donc ! ou : ne m’en dis pas plus ! - (62) |
| couinar, arde, s. m. celui qui crie, qui grogne, qui pleurniche avec bruit et sans motif : « taise toué, couinarde », tais-toi, pleurnicheuse, criarde. - (08) |
| couinard, adj., pleurard, qui geint. - (14) |
| couinât n.m. Cochon d'Inde. Voir cotson d'mer. - (63) |
| couinat, couin-nat. On désigne ainsi celui qui a une voix criarde. - (49) |
| couincouin, onomat., sorte de crépitement que font entendre les souliers neufs. Les jeunes villageoises mettent ceus-ci au rang de la plus attrayante parure. Elles en sont toutes fières lorsqu'elles entrent à l'église, vont à l'offrande, emportent le pain bénit. Toutes font la cour à leur cordonnier pour en obtenir le couin-couin dans leurs souliers. Coquetterie des campagnes. - (14) |
| couine : la couenne - (46) |
| couine : s. f., bruit que font les souliers de cuir neuf quand on marche. Par métonymie, on dit en plaisantant qu'on a mis de Ja couine dans les souliers, c'est-à-dire une substance qui les fait couiner. Voir craque. - (20) |
| couine, couin-ne. Couenne. Ce mot désigne aussi la partie superficielle d'un pré. On dit : « la couin-ne du pré ». - (49) |
| couiné, recroquevillé, par exemple en parlant des feuilles de vigne atteintes par la maladie. - (27) |
| couiné, v. n. pousser de petits cris stridents ; grincer faute de graissage. - (22) |
| couinèche n.f. Femme ayant une nette propension à parler à la fois aigü et fort. Voir kignèche. - (63) |
| couïner (couâner) : crier - (39) |
| couîner (v.t.) : crier comme un cochon - (50) |
| couîner : crier, émettre un son aigu, grincer - (48) |
| couiner : crier. - (09) |
| couîner : émettre un bruit aigü - (37) |
| couiner : grincer - (44) |
| couiner : Grincer faute de graissage, pousser des petits cris. - (19) |
| couiner : parler en pleurant. - (31) |
| couiner : pleurer. Et bien sur : grincer. - (62) |
| couiner : pousser le cri du porc - (60) |
| couiner : v. n., pousser des cris brefs et aigus, comme ceux d'un enfant qu'on corrige ou d'un chien sur la queue duquel on marche. - (20) |
| couiner, couin-ner. Se dit du cri du porc. Fig. Pousser des cris aigus. - (49) |
| couiner, v. crier comme un cochon, avec un son sifflant qui sort d'une poitrine oppressée. - (38) |
| couiner, v. intr., pleurer avec affectation et en criant. Un chien couine quand ou le frappe. Se dit du cri plaintif de plus, animaus et, d'une façon triviale, du cri des enfants que l'on corrige : « C'bigre de p'tiot, ô n'fait qu'couiner ! » - (14) |
| couiner, v. n. crier en pleurant. Se dit d'une personne et aussi d'un animal. Un porc qu'on tue « couine « jusqu'à son dernier souffle. « couiner » et « chouiner » sont des formes différentes du même mot. - (08) |
| couiner, v. n. pousser de petits cris stridents ; grincer faute de graissage. - (24) |
| couiner, v., crier (en parlant du lapin que l'on tue). - (40) |
| couiner. Comme chouiner, pleurer. Mais couiner qui est aussi une simple, onomatopée, s'applique plutôt aux gémissements des animaux et en particulier à ceux du chien, qu'aux pleurs de l’homme. - (12) |
| couîner. v. n. Pousser des cris perçants, comme le cochon qu’on égorge. - (10) |
| couiner. Verbe imitatif qui exprime le cri de certains animaux. I crois ben qu'an vai fare lai feîte chez monsieur le maire : an entendot teut ai l'heure couiner un couchon de lait. Chouiner est une variante qui s'applique aux enfants pleureurs. Dans les environs de Beaune, l'augmentatif récouiner signifie pleurer en criant : en patois lingon, ce même verbe récouiner a un sens bien différent, il signifie désirer avec ardeur. - (13) |
| couingné, vn. gémir ; craquer. Se dit du bruit que font les souliers neufs. Aivo ses souyers qui couingnent, avoir ses souliers neufs, être de fête. - (17) |
| couînis. s. m.pl. Cris perçants. - (10) |
| couinouse, adj., se dit d'une fille qui crie quand on la pince. - (40) |
| couis : couvi - (60) |
| couis de la meule du faucheur. - (05) |
| couis, s.m. petit récipient conique dans lequel on met la pierre à aiguiser "le dard" (la faux). - (38) |
| couisse (n. f.) : poule couveuse - (64) |
| couisse : poule couveuse. I, p. 24-5 - (23) |
| couisse : poule couveuse, puis éleveuse de ses poussins. Ensuite le gallinacé redevient poule, comme tout le monde. - (58) |
| couisse, adj. fém., plaignarde. (V. Couissou.) - (14) |
| couisse, conasse. n. f. - Poule couveuse ou accompagnée de ses poussins. - (42) |
| couisse, couasse (n.f.) : poule couveuse - (50) |
| couisse, poule qui couve. - (05) |
| couisse, s. f., poule qui couve. Pour le verbe, nous l'avons. - (14) |
| couisse. s. f. Poule couveuse. - (10) |
| couisser (se) : coucher - (39) |
| couisser, v. intr., se dit du cri de la poule couveuse, et signifie aussi : grogner, se croire malade, se plaindre sans motif, geindre : « Côge-te donc ; te couisses tôjor. » - (14) |
| couissou, adj., celui qui couisse, femme qui geint, plaignarde. A aussi parfois l'acception de gauche : « Voui, d'avou Jacôte, j'évô ben eùne brave fille ; ma allé étô si couissouse !... » (V. Couisse, Couliche.) - (14) |
| couite. Hâte. « Aivoi couite », c'est avoir hâte… - (01) |
| couïte. : Hâte. Brocher à cuite d'éperon est une expression du poète Perceval. - Elle signifie appuyer l'éperon au flanc du cheval de manière à ce qu'il lui en cuise. Couite est une figure de mots : c'est la cause prise pour l'effet, puisque l'effet est la course plus active du cheval. - (06) |
| couizi (se), v. r. se taire. - (22) |
| coujeu (se) : se taire. - (29) |
| coûji (se) v. (v. fr. s'accoiser, rester coi). Se taire. - (63) |
| couji (se), v. r. se taire (du latin quetiare). - (24) |
| coujotte. s. f. Serpette. (Mont-Saint-Sulpice). - (10) |
| Coulâ, Nicolas. - (16) |
| coulâche : lien par nœud coulant. Ex : longe permettant d’enserrer les cornes puis le museau du bovin qu’on veut guider. - (62) |
| coulache, s. m. collier à attacher un jeune veau. - (22) |
| coulaillon. s. m. Petit coq. - (10) |
| coulâre, colère, substantif et adjectif. - (16) |
| coulâre, s. f., colère, irritation. - (14) |
| coulasse. s . f. Glissoire. - (10) |
| coulatter : lutter - (57) |
| coulavre. s. f. Couleuvre. - (10) |
| coulayé, v. a. intervertir, sous le joug, les bœufs ou vaches. - (22) |
| coule (À la). Locut. adv. Au courant de. Être à la coule d'une chose, savoir la manière de s’y prendre pour la faire. - (10) |
| couler (v.) : glisser - (50) |
| couler : Couler, a le sens habituel de ce verbe ; de plus se dit des fleurs qui par la suite du froid ou de la pluie ne donnent pas de fruits, « S 't'an-née les fleurs ant coulé ». - (19) |
| couler : passer, tamiser - (48) |
| couler, v. faire la lessive. - (65) |
| couler. v. - Glisser. - (42) |
| couler. v. n. Glisser accidentellement. — Couler (se), v. pronom. Faire des glissades, se laisser couler sur la glace. - (10) |
| coulére (n.f.) : colère - (50) |
| coulère : colère - (48) |
| coulère : n. f. Colère. - (53) |
| coulère, s. f. colère. - (08) |
| couléreu, euse, adj. colérique, enclin à la colère. - (08) |
| couleu (na) : couleur - (57) |
| couleune, s. f. colonne. - (08) |
| couleûrer : Colorier. « Ol a bin couleûré san image (son dessin) ». - (19) |
| couleurer : v. a, et n., colorier, peindre. Il a couleuré une image. - (20) |
| couleurer, v. tr., mettre en couleur, colorier. - (14) |
| couleurer, v., colorer. - (40) |
| couleurer. Colorer. - (49) |
| couleûrés : coloriés - (37) |
| coulibin, adj., lent, maladroit. - (14) |
| couliche, adj., tatillon, niais, pas pressé. (V. Couisse, Coulibin.) - (14) |
| coulidor : Corridor! « As tu fremé la pôrte du coulidor ? ». (Coulidor est une forme plus ancienne que colidor). - (19) |
| coulinai (se), se glisser furtivement quelque part... - (02) |
| couline, s. f. coulée, série de prés situés dans les vallées ou le long des rivières. - (08) |
| couline. s. f. Longueur de pré ordinairement de peu d’étendue en largeur, située dans une vallée ou au pied d’une - (10) |
| couliner (Se), v . pronom. S'échapper furtivement, disparaître en se faisant petit, en s’effaçant, en profitant d’une circonstance qui favorise votre évasion. - (10) |
| couliner (se), v. réfl. se couler, se glisser sans bruit et comme en se couchant, se faufiler. - (08) |
| couliner (se). v. - Se glisser, se faufiler, disparaître sans se faire remarquer : « L 'un d'eux pourte un grand sac en touèle et se couline en tapinois. » (Fernand Clas, p.157) - (42) |
| couliner. : Se glisser comme en rampant à la façon d'une couleuvre (en latin coluber). - (06) |
| coulisse : s. f., coulisseau de lit. - (20) |
| coulmeau, poteau de maison en bois. - (05) |
| coulo ou coulot : Petite passoire dans laquelle on filtre sommairement ou on coule le lait qu'on vient de traire. - (19) |
| couloir : égoutoir à fromages. - (66) |
| couloir : passoire à lait. III, p. 49-5 - (23) |
| couloir : moule à fromages. (CH. T II) - S&L - (25) |
| couloir : s. m., couloire : s. f., pelle à main, avec ou sans manche, qu’emploient les ménagères pour le charbon, et les détaillants pour les denrées en grains ou en poudre ; syn. aussi d'écuelle. - (20) |
| couloire : faisselle, égouttoir. Connu mais peu utilisé chez nous. - (62) |
| couloire, coulire, couloure, couleure : s. f., couloir, vallée, flanc d'une colline. - (20) |
| coulon : bleu (cendré) - (57) |
| coulon, blanc jaunâtre. - (05) |
| coulon, coulotte. s. m. et f. Petite lessive. - (10) |
| coulon. Bœuf de couleur entre le blanc, le jaune et le gris, comme les colombes. On appelait autrefois le pigeon coulon. - (03) |
| coulore. Couloire, ustensile destiné à filtrer le lait. On disait autrefois colleure : « Item quatre colleures telles quelles, une petite quassotte et un petit croiseton, pour clairer » (Inventaire de 1501 à l'Hôtel-Dieu.) Je pense que clairer veut dire : clarifier, et que le croiseton est une petite pièce d’étoffe ; quant à la quassotte, c'est le diminutif de casse. (V. ce mot.) - (13) |
| coulotte : (cou:lot' - subst. f.) sorte de casserole en terre cuite. - (45) |
| coulou (n.m.) : passoire à lait - (50) |
| coulou (nom masculin) : passoire pour le lait. - (47) |
| coûlou (on) : filtre (à lait) - (57) |
| coulou : entonnoir - (37) |
| coulou : entonnoir-passoire. Pour verser le lait frais dans le bidon ; « Blanc c’ment un’ patte à coulou » : blanc comme le chiffon mis dans l’entonnoir pour filtrer le lait. « Coulou bien lavé-fumier bien relevé : indiquent fille à marier ». - (62) |
| couloû : filtre à lait - (48) |
| coulou : mot masculin désignant une pièce en tissu servant à filtrer le lait - (46) |
| coulou : entonnoir. (CH. T II) - S&L - (25) |
| coulou : s. m. filtre pour passer le lait. - (21) |
| coûlou, couloir pour passer le lait. - (16) |
| coulou, s. m. passoire pour le lait lorsque l'on trait les vaches. - (08) |
| coulou, s. m., petit vase de bois troué, filtre n'ayant pour fond qu'un linge fin, à travers lequel on passe le lait, qui tombe dans le grielot. - (14) |
| coulou, s.m. filtre. - (38) |
| coulouair (n.m.) : couloir, corridor - (50) |
| coulouaîr (on) - corridor (on) : couloir - (57) |
| couloué, couloir. n. m. - Entonnoir dont le fond, garni d'une toile, faisait office de filtre pour passer le lait. - (42) |
| couloué. s. m. Grand panier, mannequin pour porter les légumes au marché. - (10) |
| coulouée (n. f.) : passoire à lait - (64) |
| coulouée : passoire à lait. - (52) |
| coulouée : voir couloir - (23) |
| coulouée : passoire à lait. - (33) |
| coulouère : n. m. Couloir. - (53) |
| coulourer, écoulourer, v. a. colorier, couvrir de couleur. « Coulourer » une fenêtre, une porte... - (08) |
| coulû : n. m. Passe-lait. - (53) |
| coulurio : petit ruisseau - (60) |
| coum', coummé. conj. et adv. - Comme. - (42) |
| coum’nà. Locut. adv. et conj., suivant le cas. Comme çà. - (10) |
| coumacle, crémaillère. - (05) |
| coumâcle, s.m. la crémaillère. - (38) |
| coumacle. Crémaillère, du bas latin cramaculus. - (03) |
| couman, adv. de comparaison, comme : « i n'é pâ b'zoin d'un vâlô couman lu », je n'ai pas besoin d'un domestique comme lui. - (08) |
| coumander, v. a. commander, donner des ordres. - (08) |
| coumarce, s. m. commerce, négoce. - (08) |
| coumarcer, faire le commerce, commercer. - (08) |
| coumàre, s. f. , commère, voisine camarade. - (14) |
| coume (pour coumbe). s. f. Combe, petite vallée, ravin, lieu bas entouré de collines. Du grec houmbos. - (10) |
| coume : comme - (60) |
| coume tout, loc. adv., beaucoup : « Alle é brâve coume tout. » « Ol a de l'argent coume tout. » - (14) |
| coume : comme - (39) |
| coume, adv. de comp. comme : « coume chai », loc. adv. comme cela, comme çà : « i n'eume poin aine fonne coume chai », je n'aime pas une femme comme cela. - (08) |
| coume, adv., en même temps que... : « Ol ét érivé coume son p'tiot ». (V. C'ment.) - (14) |
| coume, conj., comme, de même que. - (14) |
| coumeau : mélange à base d'œufs, de lait, de sucre et de farine. (C'est une sorte de millet, le millet ayant en plus de la semoule.) On dit également goumeau. - (46) |
| coumeau, s. m., couche de bouillie laitée, œuvée, sucrée, qu'on étent sur la croûte des flans, et qui fait le régal des gourmets locaus. - (14) |
| coumédie. n. f. - Comédie. - (42) |
| coumencer : commencer - (39) |
| coumencer, v. tr., commencer. - (14) |
| coument : comment - (39) |
| coumesoeur : devant de chariot à quatre roues. - (33) |
| coumidie (n.f.) : comédie - (50) |
| couminion : communion - (39) |
| coumme (conj.) : comme - (50) |
| coumme : comme - (61) |
| counaille : quenouille - (60) |
| counaille, s.f. colonne ; lit à quatre "counailles" ; lit à quatre colonnes ; pièce de bois que l'on mettait pour bloquer l'arbre du pressoir. Quenouille pour filer. - (38) |
| counaïlles, s. f. pl., vertèbres du cou. - (40) |
| counaissance, s. f., connaissance. - (14) |
| counaissu, part, de connaitre, connu. - (14) |
| counaitre, et counàtre, v. tr., connaître. - (14) |
| counâtre, connaître ; counâssance, savoir et personne que l'on connaît intimement. - (16) |
| couneille*, s. f. quenouille. - (22) |
| couneille. Quenouille, du vieux mot counoille, tiré du latin conucula. - (03) |
| counessu (p.p.) : p.p. du verbe connaître - (50) |
| counessu, partie, passé du verbe connaître. Connu, reconnu. - (08) |
| couniagne, couniaille, s.m. cognassier. - (38) |
| couniaichance (na) : connaissance - (57) |
| couniaitre : connaître - (57) |
| counnaître. v. - Connaître. - (42) |
| cou'nnerie. n. f. - Bêtise, « connerie ». - (42) |
| counôt, s. m., coin : « Le coûnot du feù. » — « J'ons métu l’siau dans l'coûnot. » - (14) |
| couo ; à la couo ; à l'abri ; il y avait toujours une possibilité de trouver un abri dans la cour d'une habitation, surtout dans les cours fortifiées. Aujourd'hui on se met à la couo de la pluie. - (38) |
| couo : n. m. Abri. - (53) |
| couo, s.f. cour ; les anciens disaient "l'poué, l'fouo, l’corti, tout dans la moinme couo". - (38) |
| couö, sm. porte « cou » qui s'attache à la ceinture. - (17) |
| couorde : corde. (B. T IV) - D - (25) |
| couorde : courge. - (62) |
| couore : courir. D’autres disent parfois corî. - (62) |
| couorge : courge. (B. T IV) - D - (25) |
| couorner : klaxonner. Sonner avec la corne. - (62) |
| couosse : n. f. Poule couveuse. - (53) |
| couossè : v. t. Appeler ses poussins. - (53) |
| couöt, öte adj. dépourvu de queue. - (17) |
| couotte : poule couveuse. - (52) |
| couotte : poule couveuse. La couotte meune sa couée : la couveuse conduit sa couvée. - (33) |
| couotte : poule qui couve - (39) |
| couotter : appeler ses poussins. - (52) |
| coup d’cul (ain) : (une) côte courte mais très ardue - (37) |
| coup d’piang (on) : coup de poing - (57) |
| coup d’yieûx (ain) : (une) étape marquante dans le vieillissement - (37) |
| coup, s. m., fois. N'est guère usité que dans quelques locutions : « Por eùn coup. » — « Ah ! pou l’coup. » (V. Còp.) - (14) |
| coupau. Cocu… - (01) |
| coup-de-poing. s. m. Sorte de poinçon à manche transversal, avec lequel on peut, en frappant vivement, percer d’un seul coup un tonneau de vin ou d’eau-de-vie, qu’on veut déguster. Le trou est ensuite bouché avec un fausset, un petit dousil. - (10) |
| coupe : s. f., action de couper. - (20) |
| coupe : s. f., ancienne mesure de capacité pour les grains. - (20) |
| coupe : s. f., syn, d’écuelle. - (20) |
| coupe, n.f. faisselle. - (65) |
| coupe, s. m. partie du chapeau qui enserre la tête. - (22) |
| coupe-ç’oux : rasoir à main, ancien modèle - (37) |
| coupe-chiasse, sobriquet du pharmacien. - (40) |
| coupée, coupe, coupetée : s. f., ancienne mesure de surface pour les terres, correspondant à ce que l'on peut ensemencer avec une coupe de grain. - (20) |
| coupée, n.f. mesure de superficie de 3,96 ares. - (65) |
| coupée. s. f. et Couhais, coupias, Coupiau. s. m. Copeau. - (10) |
| coupe-fu (on) : coupe-feu - (57) |
| coupe-gouârge (on) : coupe-gorge - (57) |
| coupement. Terme minier. Entaille dans la paroi du chantier. - (49) |
| coupe-on’illes (on) : coupe-ongles - (57) |
| couper : v. a., remuer à la pioche et à la fourche le dé du raisin pressuré. - (20) |
| coupe-rigole: outil ancien servant à découper de façon très nette les bords des rigoles, composé d’une lame fixée à un manche. - (59) |
| couperot : couperet. - (62) |
| coupez-y-du-pain. s. composé des deux genres. Synonyme de mendiant. C’est une locution usitée, notamment à Laduz, pour désigner un de ces mendiants inconnus, un de ces vagabonds suspects qu’on voit arriver de loin, et à qui l’on se hâte de couper d’avance un morceau de pain, afin qu’il n’ait point de prétexte pour rester à la porte. C’est un Coupez-y-du-pain, dépêchez-vous. - (10) |
| coupiau (cout'cheau) : couteau - (39) |
| coupiau (n.m.) : 1) copeau - 2) bardane (plante) - (50) |
| coûpiau : copeau. La couégnie faito des coûpiaux : la cognée faisait des copeaux. - (33) |
| coupiau : copeau - (39) |
| coupiau, s. m. copeau ou rognure de bois. - (08) |
| coupiau. n. m. - Copeau. - (42) |
| coûpiaux d’bouais (dâs) : (des) copeaux de bois - (37) |
| couple : s. f., tuile couple, tuile creuse, ainsi appelée parce que la tuile supérieure accouple deux tuiles inférieures. - (20) |
| coupon, s. m. petite coupe. Un « coupon » de bois est un lot pris dans une masse. - (08) |
| coupro, keupro, couperet. - (16) |
| coupû : n. m. Coupeur. - (53) |
| couquande. s. f. Petite galette, morceau de pâte détaché d’un pain et plus ou moins beurré, qu’on met cuire à l’entrée du four. Du latin coquere. - (10) |
| couque : prononcer coukyeu. Merde ! (de dépit). Peu usité. Probablement très fort. - (58) |
| couque, s. f. beignet. - (22) |
| couquellcon, s, m. pompon ; bouquet naturel de fruits : un couquellion de cerises. Verbe : couquelliouné, couvrir de couquellions. - (22) |
| couquenille. s. f. Personne sans probité. (Villechétive). - (10) |
| couquess : tétard. - (66) |
| coûquess' : n. m. Têtard. - (53) |
| couquesse : (cou:kès' - subst. m.) têtard (littéralement « queue de poêle », par assimilation de forme). - (45) |
| couqueté, v. n. se dit de la poule poussant le cri de la couveuse. - (22) |
| couquiau, coutiais, coutiàs, coutiau. s. m. Couteau. - (10) |
| couquion, s. m. trognon, débris, déchet : un « couquion » de chou, de salade, de plume, etc. - (08) |
| couquœll’e, s. f. coquille, - (22) |
| courage : s. m., de courage, très, beaucoup. Pleurer de courage. La neige tombait de courage. - (20) |
| courage. Expression revenant à celle-ci : Si le cœur vous en dit. Faire a son courage, c'est agir de toutes ses forces. - (03) |
| couraige : courage - (48) |
| couraigeou : courageux - (48) |
| courailler (verbe) : courir la prétentaine. (y travaille pu, y pense qu’à courailler). - (47) |
| couraillou : celui qui court les filles - (46) |
| courande, danse, diarrhée. - (05) |
| courandelle : s. f., femme couratière. - (20) |
| courandié, enfant qui sort trop souvent de la maison paternelle. - (16) |
| courandié, ére, adj. et subst. coureur, vagabond, vaurien : un « courandié », une « courandiére. » au féminin le mot sous-entend une conduite débauchée. - (08) |
| courandier (-ière) (n.m. et f.) : coureur, coureuse, débauché, débauchée - (50) |
| courandier : coureur - (48) |
| courandier : courir le jupon. (RDV. T III) - A - (25) |
| courandier, se dit d'un enfant qui aime à sortir, à courir, à se promener. - (27) |
| courandier. Coureur; s'applique a ceux qui ne peuvent se tenir à la maison ; quelque peu en mauvaise part, coureur d'aventures, voire d'aventures galantes. Etym. altération de coureur. - (12) |
| courandier. n. m. - Personne en quête d'aventure, dans tous les sens du terme. (F.P. Chapat, p.74). Autre sens : mendiant sans domicile. (M. Lachiver, p.534) - (42) |
| courant : s. m., branche d'arbre fruitier attachée, après la taille, sur fil de fer, échalas, palissade, etc. - (20) |
| courante : diarrhée - (37) |
| courante : s. f., main courante, main coulante. - (20) |
| courante. Diarrhée. Pas particulier à Montceau. (Français familier). - (49) |
| courate : s. f., personne qui est souvent hors de chez elle. - (20) |
| couratier : prononcer : couraquier. Quelqu'un qui court, qui ne tient pas en place. Par extension : volage. Ex : "Le Gaston à la fumelle ? Un vrai couraquier !" - (58) |
| couratier, couratière : adj. et s., m. et f., celui ou celle qui court après une personne de l'autre sexe. — Fiarde couratlère, celle qui au lieu de tourner sur place court sur le sol. - (20) |
| courau, s. f., courroie. L'écolier attache ses livres avec sa courau. - (14) |
| couraud, e, adj., coureur, coureuse ; garçon qui court après les filles, fille qui court après les garçons : « L'bestiâ ! v'lá-t-i pas qu'ô va parler à c'te couraude!... » - (14) |
| couràyé, sortir souvent de ta maison paternelle, pour aller çà et là, sans motif que celui de se récréer. - (16) |
| courbe : s. m., courbe, courbure, contour. Un courbe. - (20) |
| courbe, adj., courbé : « L'pauvre houme ! ô marche tout courbe. » - (14) |
| courbe, s. m. courbe, coude, détour d'un chemin. Dans cet endroit-là, le chemin fait un « courbe. » - (08) |
| courbins, sn. bœufs de trait (s'emploie au pluriel). - (17) |
| courcillée (pour courcillière). s. f. Courtillière, infecte destructeur des légumes, qui ravage les jardins, les courtils. - (10) |
| courdaïlle, s. f., bretelle en osier pour les hottes. - (40) |
| courde : carde - (43) |
| courdioeu, s. m. corde de joug. - (22) |
| coûre : un noisetier - (46) |
| coureau : bois mort. Plus précisément : branche de bois mort, très sèche ; On dit « Sô c’ment un coureau » : sec comme… - (62) |
| coureau, couriau, courail, coureil. s. m. Verrou. Fermer une porte à couriau, la fermer au verrou. - (10) |
| coureau, s. f. courroie, lien de cuir, lanière, ceinture. - (08) |
| coureauter, v. a. verrouiller, barrer, fermer par un obstacle. Nous disons aussi « fromer le coureau », « fermer le coreil. » - (08) |
| courée : poumons du porc et parfois le cœur, ou avec le cœur. Du latin coratum : tripes. - (62) |
| courée, s. f. mou de porc, de bœuf ou de veau. - (22) |
| courége, corége, courage. - (16) |
| couréjou, se dit d'un enfant qui a la mine fraîche et se porte bien. - (16) |
| courére, s. f. noisetier, coudrier. - (08) |
| courère. s. m. Coudrier. (Vassy sous-Pisy). - (10) |
| courge : bâton pour porter des seaux sur l'épaule. - (09) |
| courge, courze, s. f. appareil composé d'un bâton, quelquefois d'un cerceau, et d'une courroie qu'on charge sur les épaules et dont on se sert pour le transport de deux seaux ou autres vases. - (08) |
| courge. s. f. Sorte de bâton un peu courbe dans son milieu, ayant une entaille en dessus de ses deux extrémités, et qui sert aux porteurs d’eau pour porter d’un seul coup deux sceaux pleins sur leur épaule. - (10) |
| courgeailler : rrbuste : cornouiller. Le courgeailler pousse difficilement en Morvan : Le cornouiller pousse difficilement en Morvan. - (33) |
| courgée. s. f. Charge de deux seaux d’eau portée par une personne sur son épaule à l’aide d’une courge, ou de toute autre manière : par exemple, à l’aide d’une bricole et d’un cerceau, ou d’une bricole et d’un cadre de bois. - (10) |
| courgeiller. n. m. - Cornouiller. - (42) |
| courgelle. n. f. - Fruit du cornouiller. - (42) |
| courgelle. s. f. Fruit du courgellier, du cornouiller. - (10) |
| courgellier : cornouiller. - (09) |
| courgellier. s. m. Cornouiller. - (10) |
| courgeon, côrgeon, s. m. tresse de chanvre, de jonc, de paille, d'osier, et en général tout ce qui se prête à l'industrie du vannier. - (08) |
| courgeonner, côrgeonner, v. a. tresser en général. Les vanniers « courgeonnent » l'osier pour faire des vans, des paniers ; les fabricants de chaises « courgeonnent» la paille ou glui, les joncs, les roseaux appelés « laumes » dans le pays. - (08) |
| courgette, courge-bouteille : s. f., calebasse commune, lagenaria vulgaris (variété gourda). - (20) |
| courgie : badine - (48) |
| courgie et écourgie. : Fouet (du latin corrigia, lanière). - (06) |
| courgie, fouet ; en latin corrigia, lanières. - (02) |
| courgnioule, s. f. œsophàge, dans la région du cou. On dit aussi courgnoulon, s. m. - (22) |
| courgouner. v. attacher (une coiffe). - (38) |
| couri (v.t.) : courir - (50) |
| couri : courir - (48) |
| couri : Courir. Employé seulement dans cette injonction adressée à un chien qu'on veut chasser : « Veux tu couri ». Voir core. - (19) |
| courî chu l’hairicot : énerver - (37) |
| couri lai jâdoure, couri lai peurtantaine : courir les filles - (48) |
| couri, cori. Courir. - (49) |
| couri, courir, s'enfuir ; ve tu couri ! manière de chasser un chien ou un enfant ennuyeux. - (16) |
| couri, v. intr., entrer dans, en parlant des années : « Ol é d'eùne bâle âge! ô court ses 95 ans. » (V. Còri.) - (14) |
| coûrie - quantité considérable de choses, non en tas, mais qui se suivent. - Combein de poules !… ma c'â tote ine courie que vos és. - Viez don to ces enfants que sortant du catésime ! en voilai ine courie ai n'en pâ fini ! – (Voyez girlicouée.) - (18) |
| couringne. s. m. Cousin, par conversion d’s en r. (Domecy-sur Ie’Vault). - (10) |
| couriot, coureau. n. m. - Grosse serrure « Va don’ farmer l'couriot d'la pourte. » - (42) |
| courir sur : loc, courir (accomplir une certaine année de son âge). Il court sur ses vingt ans, (pour il court ses vingt ans), c'est-à-dire il est dans sa vingtième année. - (20) |
| courir. S'emploie dans le sens de souffler. Ex. : « le vent cort » pour le vent souffle. « Y cort un grand vent ». - (49) |
| courjalé : cornouiller (courjale : le fruit). (MM. T IV) - A - (25) |
| courjon*, s. m. cordon. - (22) |
| courjon, s. m., branche d'arbre, baguette, tresse de jonc, d'osier, dont on fait des liens. - (14) |
| courlic, courlu, curlui. s. m. Courlis, oiseau. - (10) |
| courlus. n. m. - Courlis. - (42) |
| courne du bouais (lai) : (l’) orée de la forêt - (37) |
| courniôle, cornioûle Voir cornioûle. - (63) |
| cournœlli, v. n. pousser, frotter avec les cornes. - (22) |
| cournot : tuyau de poêle. Déformation de cornet. « Emmanchî c’ment des cournots de poêle » : emmanché comme des tuyaux. - (62) |
| courò, s. f. perche longue et souple. - (22) |
| couronne. Plafond de chantier dans la mine. Terme de mineur. - (49) |
| courosse (n.f.) : poule couveuse - aussi grouesse, crousse - (50) |
| courosse : mère poule. - (62) |
| courosse : mère poule. - (31) |
| coûrosse : poule couveuse - (48) |
| courosse : poule couveuse. (VDS. T IV) - VdS - (25) |
| courosse : poule qui couve (avec un sens péjoratif) - (39) |
| courosse, n.f. poule qui couve ou qui a des poussins. - (38) |
| courosse, poule conduisant ses poussins. - (28) |
| courosse, s. f. couveuse. Se dit d'une poule qui couve ou qui a des poussins, et des femelles d'oiseaux en général. - (08) |
| courosse, s. f., poule qui conduit des poussins. - (11) |
| courosse. s. f. Poule qui a des petits. - (10) |
| couroûe : coureur de jupons - (48) |
| cou-rouge. s. m. Rouge-gorge. (Bessy). - (10) |
| courrat ou courrati, s. m. libertin, coureur. - (22) |
| courre : v. n., vx fr., courir. Te f’rais mieux d' rester cheuz nous à la veillie et d' fendre des osiers, non pas que d’ courre les chemins. - (20) |
| courre, v. a. courir : « léche-lu courre », laisse-le courir. - (08) |
| courre. v. n. Courir. N'est plus guère en usage que dans cette locution, la chasse à courre, mais s’est maintenu dans beaucoup de nos campagnes avec le sens ordinaire de courir. Attends-me, j’vas courre. Si j’v’lais courre après toi , j’aurais bentoût fait de t’rétrapper. - (10) |
| courreau : verrou. - (09) |
| courri : courir - (39) |
| courriau. s. m. Voyez coureau. - (10) |
| courrier. Personne qui aime courir, se promener, voyager. - (49) |
| courrière, s. f., fille qui se dévergonde. - (40) |
| courriller : verrouiller - (60) |
| courroie : Courroie, bride « Des courroies de sabeuts ». - (19) |
| courroie, subst. féminin : ceinture en cuir. - (54) |
| courrosse, s. f., poule qui cache ses œufs pour couver. - (40) |
| courrou : verrou - (60) |
| courrou : coureur - (39) |
| courrouaîe (na) : courroie - (57) |
| courrouaie : courroie - (48) |
| courrouais : courroies - (39) |
| coursière : chemin de traverse, raccourci dans les champs - (43) |
| coursière : s, f., chemin de traverse. - (20) |
| coursière, n.m. raccourci. - (65) |
| coursillée, courtillée. n. f.– Courtillière. - (42) |
| coursire : (nf) chemin de traverse - (35) |
| coursîre n.f. Raccourci. - (63) |
| courti : jardin attenant à la maison - (48) |
| courtiau (adjectif) : petit, bas du cul. - (47) |
| courtiau. n. m. - Vieux paisseau trop court, échalas. - (42) |
| courtiau. s. m. Vieux paisseau devenu trop court à force d’avoir été rappointé. - (10) |
| courtié, s. m. courtil, jardin potager. - (08) |
| courtier. s . m. Courtil, jardin. (Savigny-en-Terre-Plaine). - (10) |
| courtil (n.m.) : jardin (du lat. = cortis = cour de ferme) - (50) |
| Courtin : nom de bœuf. III, p. 30-o - (23) |
| coûryé, couryëre, coureur, coureuse ; se dit en mauvaise part. - (16) |
| courze (nom féminin) : solide bâton reposant sur les épaules et muni, à chacune des extrémités, de courroies destinées à accrocher les seaux à transporter. - (47) |
| couse (d'à) : à cause - (51) |
| cousé. s. m. Tronc de vigne. Se dit sans doute pour coué, par interposition de l’s euphonique entre l’u et l’é. - (10) |
| couséé : n. m. Cousin. - (53) |
| couser (se), se taire. - (27) |
| couse-te, tais-toi. - (28) |
| cousi (se) : taire (se) - (57) |
| cousin premier, second, troisième, etc : s. m., cousin au premier, au second, au troisième degré. On dit de même cousine première, etc. - (20) |
| cousinaille (la). n. f. - Ensemble des cousins. - (42) |
| cousingne. s. m. Cousin. (Fléys). - (10) |
| cousoux : s. m., couturier, tailleur. - (20) |
| coussée. s. f. Temps pendant lequel on travaille ou l’on a travaillé. C’est une altération de course, coursée. (Montillot). - (10) |
| coussi. s. m. Cochon, goret. Terme usité dans la Forterre. - (10) |
| coussoz. : (Du latin culcita), chausses. (Coutumes de Châtillon, 1371.) - (06) |
| coût’e (a) : (le) coutre (de la charrue) - (37) |
| cout’ion, s. m. nuque. - (22) |
| couta, s. m. coteau, colline, éminence de terrain. - (08) |
| coutai. Coûté. « Ai t’é coutai », il t'a coûté. C'est aussi l’infinitif de coûter, et le substantif côté, tant au pluriel qu'au singulier. - (01) |
| coutaie, coutiau : couteau - (48) |
| coutaison, s. f. marcotte de vigne, c'est-à-dire sarment « couté ». - (22) |
| coûtaison. s. f. Assolement, partage de terres labourables en portions ou soles, pour y faire succéder les récoltes suivant un certain ordre. Du latin cultura. —Voyez couteue. - (10) |
| coutance, prix d’une chose. - (16) |
| coutance, s. f. coût, prix d'une chose, dépense. - (08) |
| coutance, sf. dépense, prix de revient. - (17) |
| coutance. Prix. - (49) |
| coutances*, s. f. pl. dépenses. - (22) |
| coûtances, s. f. pl. dépenses : des grandes coûtances. - (24) |
| coûtange , dépense. - (05) |
| coutas : verger en côte. - (09) |
| coutât. n. m. - Coteau, versant ensoleillé d'une colline. - (42) |
| coûtat. s. m. Côte, coteau, montée rapide. - (10) |
| coutchau. Couteau. - (49) |
| coutchu. n. m. - Oiseau, le coucou. - (42) |
| couté (ai) (loc.) : à côté - (50) |
| coûté (ai) : (à ) côté - (37) |
| coûte (au) loc. (p.ê. de cahute) A l'abri de la pluie. Vlà la beûrée, faut s'mette au coûte. - (63) |
| couté (en). loc. prép. - En face ou contre : « Pose ton vélo en couté du mur ! » - (42) |
| coûte (na) : côte (os) - (57) |
| couté : (nm) côté - (35) |
| couté : côté - (43) |
| couté : côté - (51) |
| coûte de blette (na) : bette - (57) |
| coûté n.m. Côté. - (63) |
| coutè : n. m. Coté. - (53) |
| couté, kouté, côté. - (16) |
| coûté, s. m. côté. - (08) |
| coutè, sm. couteau. - (17) |
| couté, v. a. casser légèrement un rameau pour le plier à angle droit. - (22) |
| couté. n. m. - Côté. - (42) |
| coûte. s. f. Côte. - (10) |
| couteai, s. m. côte, côte de laitue, de cardon, ou autre - (08) |
| couteau, coutchau. Ces deux mots s'emploient pour désigner un rayon de cire, de miel. - (49) |
| coutéger. v. - Côtoyer. (Bléneau, selon M. Jossier) - (42) |
| coutéger. v. a. Côtoyer. (Bléneau). - (10) |
| coutein. Coûtions, coûtiez, coûtaient. - (01) |
| couteler : v. repasser le linge encore mouillé. - (21) |
| couteler, v. tr., étendre, étirer et plier les draps, le linge après la lessive. - (14) |
| couteler. Couteler les draps, c'est les étendre pour les plier après la lessive. - (03) |
| coutelions : s. m. pi., ensemble des vêtements spéciaux à la région du cou et des épaules, tels que cache-nez, fichus, collets, écharpes, boas, etc. - (20) |
| coutellion, s. m. jupon, cotillon. - (22) |
| couter (se), s'accouder. On a dit autrefois coute. - (03) |
| coûter, appuyer, soutenir. - (05) |
| coutereau, couteriau : s. m., ver blanc, larve du hanneton. - (20) |
| couterée, couterie : s. f., vx fr. cousterie, aiguillée de fil, coton, laine, etc. Couterée de paresseuse, longue aiguillée. - (20) |
| couterey, couturier, tailleur. - (05) |
| couteria : s. f. aiguillée. - (21) |
| couterie de fil, aiguillée à coudre. - (05) |
| coutérie, s. f. longueur de fil préparée pour coudre. - (22) |
| couterie, s. f., aiguillée de fil. - (14) |
| couterotte (n.f.) : oreiller de plume - (50) |
| couteue (altération et contraction de couture). s. f. Ensemencement de l’orge et de l’avoine. (Ménades). — Ce mot, qu’on trouve en usage dans plusieurs départements, se dit pour culture. La rue Culture-Sainte-Catherine, à Paris, s’appelait, originairement, Couture- Sainte-Catherine. - (10) |
| couteure (n.f.) : terre labourée, non close - (50) |
| couteure : champ non clos - (48) |
| couteure : ensemble des sillons - (43) |
| couteure : Etat d'une terre qui vient d'être labourée. « Ses fands sant bien en couteure », ses champs sont en bon état de culture. - (19) |
| couteuré : v. labourer la terre en août avant les semailles (blé). - (21) |
| couteure, couture : Champ après la moisson, chaume où reste l'éteule après la moisson. - (33) |
| couteure, s. f. couture, grande pièce de terre labourable qui n'est pas close. - (08) |
| couteure, s. f. terrain fraîchement travaillé (du vieux français couture, latin culturel). - (24) |
| couteurére, s. f . , coccinelle, bête à bon Dieu. - (14) |
| couteurére, s. f., couturière, ouvrière en robes. - (14) |
| couteuria (n’) : aiguillée - (57) |
| couthiâ, couteau ; couthiâ d'mié, rayon de miel. - (16) |
| couthyi, n. masc. ; courtil, jardin. - (07) |
| coûti : branche de noisetier utilisée en vannerie - (48) |
| coutiâ : couteau. - (32) |
| coutia : n. m. Couteau. - (53) |
| coutiâ, s. m. couteau. Cette forme est répandue à Anost. - (08) |
| coutiâ, s. m., couteau. - (40) |
| coutiau : couteau - (43) |
| coutiau : couteau. - (52) |
| coutiau : un couteau - (46) |
| coutiau : un couteau. - (56) |
| coutiau : couteau. Le coutiau sert à tout : le couteau sert à tout. - (33) |
| coutiau, coutchiot. n. m. - Couteau. - (42) |
| coutiau, s. m. couteau. - (08) |
| coutiau, s. m., couteau. - (14) |
| coutieau, couteau. - (05) |
| coûtier : branche de noisetier en bandelettes pour faire les paniers, de la vannerie. - (33) |
| coutignat. n. m. - Sorte de compote de prunes. Au XIVe siècle, on parlait de coudignac, cotignat ou cotoniat pour désigner une confiture de coings, utilisée contre la toux et contre le mal de ventre. Selon Ambroise Paré, célèbre médecin du XVIe siècle, la cotignat pris avant le repas, resserre le ventre (la cotignat pris devant le past astraint le ventre). Aujourd'hui encore le sirop de coings est indiqué pour soigner les coliques légères. Ces noms sont un emprunt au dialecte provençal coudounhat, issu du latin cotoneum, coing. Le cotignac est toujours utilisé en français, pour désigner une confiture ou une pâte de coings. Le glissement de sens du poyaudin, de confiture de coings à confiture de prunes, ne s'explique-t-il pas par le fait que la prune est également bien connue pour provoquer les dérangements intestinaux ? - (42) |
| coutillo. Petit jardin, du vieux mot curtil, d'où l'on a tiré notre diminutif. - (03) |
| coutillon. n. m. - Cotillon. - (42) |
| coution : s. m., nuque, que les Maçonnais appellent volontiers aussi « nuque du cou ». - (20) |
| coutiu, coutchu. n. m. - Gomme des arbres fruitiers. (Sougères-En-Puisaye) - (42) |
| cout'iu, s. m. 1. Gourou. — 2. Primevère. - (22) |
| coutje, sf. peur intense. Aivo coûtje. - (17) |
| couto. Coûtais, coûtait. - (01) |
| coûton (n. m.) : partie dure et immangeable de la tige d'une plante fourragère ou d'un légume - (64) |
| couton (n.m.) : coton - (50) |
| coûton : nervure principale, partie dure des légumes - (48) |
| coûton : plume naissante chez les volailles - (48) |
| coûton : partie dure d'un objet. Ou coution : un coution de salade. - (33) |
| coûton : côte. Pétiole. Ex : "Si té m'fait ène salad' mets pas les coûtons !" - (58) |
| coûton. n. m. - Plusieurs usages : 1. Aile déplumée d'un oisillon ou d'une volaille, avant de la passer à la flamme. (Sougères-en-Puisaye) 2. Petite côte, peu longue, et facile à monter. 3. Grosse nervure d'une feuille de chou ou de betterave. - (42) |
| coûton. s. m. Bas de la tige d’un végétal herbacé ; grosse nervure d’une feuille de chou, de betterave, etc. Du latin costa. - (10) |
| coutraie : un ver blanc - (46) |
| coutre (au) : (loc adv) à l’abri de la pluie - (35) |
| coutre : (nf) édredon - (35) |
| coutre : Lit de plume. Désigne aussi, comme en français la partie coupante de la charrue - (19) |
| coutre : matelas de plumes - (43) |
| coutre : oreiller. (PSS. T II) - B - (25) |
| coutre n.f. (v. fr. cotre, lit de plume). Généralement en plume, elle se plaçait entre le sommier et le matelas alors que l'édredon, en duvet, lui, se plaçait par dessus la couverture. - (63) |
| coutre : s. f. lit de plume. - (21) |
| coutre, « L » instrument tranchant pour tailler les bardeaux, n'est français que dans le sens de fer de charrue, culter, couteau. - (04) |
| coutre, coude. - (16) |
| coutre, n.f. couette. - (65) |
| coutre, s. f. matelas de plumes. Diminutif coutreton et coutrœte (du vieux français coite. Latin culcita). - (24) |
| coutre, s. f., oreiller. - (14) |
| coutre, s. m. coude, tour, détour. Le chemin, la rivière fait un « contre », c'est-à-dire un détour, un coude. - (08) |
| coutre. : (Du latin culcitra), matelas. (Coutumes de Châtillon, 1371.) - (06) |
| coutrée : Aiguillée « Eune coutrée de fi (fil) ». - (19) |
| coutrée : couturière. - (33) |
| coutrére (n.f.) : couturière - (50) |
| coûtrére : couturière - (48) |
| coutrére : (cô:t'ré:r' - subst. f.) couturière. - (45) |
| coutrére, s. f. couturière. En Morvan la « coutrére » n'est pas une ouvrière en robes comme à paris. Elle travaille en linge et confectionne les vêtements d'homme aussi bien que ceux de femme. - (08) |
| coûtrère, s. f., couturière à domicile. - (40) |
| coutreton, coutrette : s. f., petite couette pour nouveau-né. - (20) |
| coutreuille : s. f. aiguillée. - (21) |
| coutreute (na) : oreiller - (57) |
| coutrie (de fil). Aiguille, longueur de fil que l’on casse pour coudre. Etym. coudre. - (12) |
| coutrie (n.f.) : aiguillée de fil - (50) |
| coutrie (une … de fil) : une aiguillée. (RDB. T III) - S&L - (25) |
| coutrie : (nf) aiguillée « coutrie d'feignante » : longue aiguillée - (35) |
| coutrie d'fî n.f. Aiguillée de fil. - (63) |
| coutrie d'fi, aiguillée de fil. - (16) |
| coutrie d'fi, n.f. aiguillée de fil. - (38) |
| coutrie, n.f. aiguillée de fil. - (65) |
| coutrie, s. f. aiguillée de fil à coudre. - (08) |
| coutrie, s. f., aiguillée de fil. - (40) |
| coutrie. Aiguillée de fil, du verbe coudre. On appelle couturière la coccinelle. On l'appelle aussi bête au bon Dieu. - (03) |
| coutrilleau : courtilière. Ou taupe-grillon : (La proie favorite de la huppe : la « poupoute »). - (62) |
| coutrire : charrue en bois à un versoir basculant - (43) |
| coutro (chevaux de), chevaux de front. - (03) |
| coutron : oreiller servant à langer les bébés. A - B - (41) |
| coutron : (nm) petite coutre servant à envelopper un nourrisson - (35) |
| coutron : oreiller où sont langés les bébés - (34) |
| coutron : petite couverture servant à envelopper un nourrisson, matelas où sont langés les bébés - (43) |
| coutron n.m. Grand oreiller servant de table à langer et de berceau. - (63) |
| coutrot (de), de front et à côté. - (05) |
| coutrot : dessus du mur destiné à recevoir la sablière - (48) |
| coutrot : dessus du mur sur lequel repose la sablière - (39) |
| coutrotte, coussinet, carré de plumes. - (05) |
| coutsi : (vb) coucher - (35) |
| coutsi : coucher - (51) |
| coutsi v. Coucher. Cment nos fait son yit nos s'coutse. - (63) |
| couture, couturer, culture, labourer trois fois la jachère. - (05) |
| couturëre, couturière. - (16) |
| couturiée : crabe doré. IV, p. 29 - (23) |
| couturier : libellule. IV, p. 29 - (23) |
| couturier, tailleur, coudré. - (04) |
| couturière : s. f,. courtilière, nom donné par erreur au carabe doré. - (20) |
| coutya : couteau. (B. T IV) - D - (25) |
| couva, s. m. toit. - (22) |
| couvan. Couvent… - (01) |
| couvante : couverture de lit - (39) |
| couvanter, v. a. faire valoir, vanter avec excès : « couvanter » sa marchandise, ses denrées. - (08) |
| couvâr, s. m., sous-bois. - (40) |
| couvar. Couvert, couverts. - (01) |
| couvart : toit. - (62) |
| couvart : toiture - (39) |
| couvart, n.m. couvert - (38) |
| couvarte : n. f. Couverture. - (53) |
| couvarte, n.f. couverture. - (38) |
| couvarteure, s. f. couverture, toiture en chaume. Aller « à la couvarteure », est une des meilleures industries du pays. couveau, s. m. chauffrette. - (08) |
| couvas, covas. s. f. Poule couveuse. (Coulours). - (10) |
| couvature. Couverture, couvertures. - (01) |
| couve : s. f., vx fr. escouve (balai), queue. - (20) |
| couve, s. f. queue. - (24) |
| couvècle (couècle) : s. m., couvercle. - (20) |
| couvèclion (couèclion) : s. m., petit couvercle. - (20) |
| couvèquie : un couvercle - n'eubie pas d'mettre l'couvêquie su lè casserole, n'oublie pas de mettre le couvercle sur la casserole - (46) |
| couver le feu, rester au coin du feu au lieu de sortir et de prendre de l'exercice. - (27) |
| couverson, couveurson. s. m . Couverture de livre. (Courgis, Poilly-sur-Serein). - (10) |
| couvert (m), toiture. - (26) |
| couvert : toit - (48) |
| couvert : s. m., vx fr., toit. - (20) |
| couvert, n.m. toit. - (65) |
| couvert, s. m. toit, toiture. Un « couvert » en ardoises, en tuiles, en paille ; on répare les « couverts ». - (08) |
| couvert, s. m., toit, couvercle : « Ol a fait ranger l’couvert de sa mâïon. » Le couvert d'une tabatière, d'une boîte, d'une marmite. - (14) |
| couvèrt, toiture de maison. - (16) |
| couvert. Toit d'une maison. Etym. masculin local de couverture. - (12) |
| couverte : (nf) couverture - (35) |
| couverte : couverture de lit ou dalle supérieure d'un aqueduc - (48) |
| couverte : une couverture - (46) |
| couvèrte n.f. Couverture de lit. - (63) |
| couverte, couvarte, s. f. pierre ordinairement plate qui recouvre les murs à sec, c’est-à-direconstruits sans mortier. - (08) |
| couvèrte, couverture de lit. - (16) |
| couverte, s. f. 1. Couverture de lit. — 2. Linteau. - (24) |
| couverte, s. f., couverture : « I fait frèd ; faut m'méte ma couverte d’lain-ne. » - (14) |
| couverte, subst. féminin : couverture. - (54) |
| couvéte, s. f., chaufferette. - (14) |
| couveu, vase de grès ou de terre dans lequel on mettait des charbons ardents recouverts d'un peu de cendres et qui remplaçait une chaufferette. - (27) |
| couveux : se dit d'un oeuf pourri - (46) |
| couvin. Miel gâté dans une ruche. - (03) |
| couvo, marmite qu'on emplit de braise et de cendre et sur laquelle on tient ses pieds pour n'y avoir pas froid. Les femmes d'un quartier s'assemblaient, il y a peu de temps encore, les soirées d'hiver, dans des celliers ou dans des caves où chacune apportait son couvo. - (16) |
| couvòt, s. m., couvet, vase en terre tenant lieu de chaufferette : « Tout l'temps álle a son couvòt sous ses jupes. » - (14) |
| couvot. Couvet, petit pot de terre ou de cuivre qui sert de chaufferette aux marchandes se tenant en plein air (Littré). Par extension chaufferette. - (12) |
| couvot. n. m. - Chaufferette. - (42) |
| couvouse : une poule qui couve tout le temps - (46) |
| couvre-fu (on) : couvre-feu - (57) |
| couvre-pis (on) : couvre-pieds - (57) |
| couvre-yet (on) – d’sus d’yet (on) : couvre-lit - (57) |
| couvri – tcheurvi : couvrir - (57) |
| couvri (adjectif) : couvert, en parlant du ciel. - (47) |
| couvri : couvrir - (48) |
| couvri : couvrir, couvert - (43) |
| couvri v. Couvrir. I faut t'couvri p'euvri l'portau. - (63) |
| couvri : 1 n. m. Couvert. - 2 v. t. Ouvrir. - (53) |
| couvri : part, pass., couvert. Voir découvri et recouvri. - (20) |
| couvri, v. couvrir. - (38) |
| couvri, v. tr., couvrir. Le part, est également couvri, comme ouvri pour : ouvert. - (14) |
| couvrou, s. m. couvreur en paille, celui qui fait ou qui répare les toitures de chaume. - (08) |
| couvroûe : couvreur - (48) |
| couvrue, couvrure. s. f. Couvrure. (Plessis-Saint-Jean). - (10) |
| couyé (s') : v. pr. Se taire. - (53) |
| coûye-iaidon ! : « tais-toi donc ! » - (37) |
| couyon : s. m., coïon. - (20) |
| couzaigne. Cousine. A Dijon, le nom de couzaigne s’est donné aux blanchisseuses, aux couturières, couzaigne Mairie, couzaigne Jaiquette. On y entend aussi par couzaigne une débauchée. « Ai vai voi lé couzaigne », il va voir les cousines… - (01) |
| couzaigne. : Cousine. On appelait aussi cousines les filles de joie. Ai vai voi lé couzaigne était un propos moins cru que: Il va voir les filles. - (06) |
| couzé ; s'couzé, se taire. - (16) |
| couzein. Se couzein, s'apaisaient, se taisaient. - (01) |
| couzé-vo. Apaisez-vous… - (01) |
| covâ : Toit. « In covâ à tielles creuses (à tuiles creuses) ». - (19) |
| còvait, s. m. toit. - (24) |
| covarte : Couverture de lit. « I fa fra, forre te bien seu les covartes », il fait froid, fourre toi bien sous les couvertures. - (19) |
| covarte : s. f. couverture. - (21) |
| côve : s. f. cave. - (21) |
| covêque. s. m. Couvercle. (Plessis-Saint-Jean). - (10) |
| covercle, covarcle, convêque. n. m. - Couvercle. Covercle est un mot déjà usité en ancien français sous cette forme issue du latin coperculum. - (42) |
| coviner. v. n. Tramer, comploter, conspirer sourdement. (Soucy). - (10) |
| covire : s. f. courroie. - (21) |
| côvò, couvet, chaufferette... - (02) |
| côvô. : (Prononcez queveu), chaufferette. Se servir d'une chaufferette se dit couver. (Del.) - (06) |
| cövre, sf. coudre, tige du noisetier. - (17) |
| covre. Couvre, couvres , couvrent. - (01) |
| covrée, couvrée. s. f. Corvée. - (10) |
| cövtiou, sm. [couvertoir]. Couverture de laine blanche servant à envelopper le maillot d'un poupon. - (17) |
| cowe. : (Dial.), cuve. - (06) |
| coxfessoir : s. m., confessionnal. - (20) |
| coxon (n. m.) : souche d'arbre ou de vigne (syn. coque) - (64) |
| coxquéri : part, pass., conquis. Entendu en 1918 : « Quand on aura conquéri l'Alsace et la Lorraine... » - (20) |
| coya : bélier. A - B - (41) |
| coÿâ : (nm) bélier - (35) |
| coya : bélier - (34) |
| coya : bélier - (43) |
| coyard (n. m.) : cheville en fer qui sert à attacher l'avant-train d'une charrue - (64) |
| coyard. Pièce de bois que l’on place sur le pressoir, entre les mares et l’abrot. En morvandeau le coyau est un chevron qui dépasse le toit. - (13) |
| coyau : cassure de la pente du bas des toits (français) - (51) |
| coyau, s. m. coyer, bout de chevron qui soutient la saillie d'une toiture. - (08) |
| cöyé : (nm) collier - (35) |
| co-yé : collier - (43) |
| coyé : le collier des chevaux - (46) |
| coyèin (Ai lai) : à labri du vent. (CLF. T II) - D - (25) |
| côyer (se) (v.pr.) : se taire - (50) |
| côyer (se) : taire (se) - (48) |
| côyer (se) : se taire - (39) |
| co-yer (se), v., s’apaiser, se calmer. - (40) |
| coÿer : collier - (51) |
| coyer, couger et cozer (C.-d.), couyer (Chal. et Morv.), couger, coger et coiser (Br.), (se). - Se taire, garder le silence. A la même origine et un peu la même signification que le vocable à la cot; c'est se tenir coi, se coiser, de quietus (tranquille) ou quietare (donner le repos à). Ce mot s'emploie aussi impérativement dans cette interjection: « coye-toi, coyez-vous. » Coisier, dans le sens de se taire, était très usité en vieux français. - (15) |
| côyer, couter, v. a. taire. l'interj. « côye-té, couye-té », tais-toi ! taisez-vous ! - (08) |
| coyer. n. m. - Collier. - (42) |
| coyez-vo : taisez-vous. (C. T III) - B - (25) |
| co'yin (m), corne évidée dans laquelle le faucheur place sa pierre à aiguiser. - (26) |
| cô-yon, s. m., étui pour pierre à faux. - (40) |
| coysé ou cousé (se), se tenir tranquille, se tenir coi. (Voir au mot gogé.) ... - (02) |
| coza : Colza (brassica oleifera), plante oléagineuse. L'huile de colza ne vaut pas l'huile de noix - (19) |
| côze, motif, le pourquoi ; ai côze ? pourquoi ? Un enfant à qui l'on demande le motif d'une mauvaise action qu'il a commise et qui hésite de le faire connaître, se contente de répondre : ai côze ! - (16) |
| côzé, parler ; côzou, celui qui parle trop et mal à propos ; côzête, conversation récréative. - (16) |
| ç'qui : 1 adv. Ainsi. - 2 pron. dém. Ça, Ceci ou Cela. - (53) |
| crâ - corbeau. - Ecoute les crâ les voilà que venant, le froid n'â pas loin. - I ons vu passai in nuée de crâs. - (18) |
| crâ : corbeau - (48) |
| crâ : corbeau. - (32) |
| crâ : Craie. « As tu de la crâ pa marquer les chargeans su le fand de la tonne ? ». Tartre qui se dépose dans les fûts. - (19) |
| crâ : (crâ: - subst. m.) corbeau. - (45) |
| crâ, corbeau (onomatopée) et cri des mal élevés au passage d'un prêtre. Saint Augustin, qui vivait au quatrième siècle, explique ainsi ce cri injurieux : quand un prêtre invitait quelqu'un à se convertir, souvent celui-ci, qui n'était pas pressé de le faire, lui répondait : cras ! mot latin voulant dire : demain, pour : je me convertirai demain. Ce cri n'est donc pas nouveau, pas plus qu'il n'est compris de ceux qui le profèrent. - (16) |
| crâ, corbeau. - (26) |
| cra, corbeau. - (27) |
| crâ, n.m. corbeau. - (38) |
| crâ, s. m. crachat, salive que l'on rejette avec bruit de la bouche. - (08) |
| crà, s. m., corbeau. (V. Corbiau. Couà, Crau.) - (14) |
| crâ, s. m., corneille noire ; curé. - (40) |
| crâa : un corbeau - (46) |
| crabot. s. m. Toupie à fouet, sabot. (Cuy). - (10) |
| craç’ter : cracher - (37) |
| cracasson. s. m. Escargot. (Athiey). - (10) |
| crachard. n. m. - Crachat. - (42) |
| crachard. s. m. Crachat. (Rogny). - (10) |
| crache : Crèche, mangeoire pour les bœufs. Au figuré : « Torner le cu à la crache » : refuser la nourriture. - (19) |
| crache, s. f. salive. - (24) |
| crache. Crachat. - (49) |
| crachée, crachie : s. f., résidu du beurre que l'on cuit et qui s'accumule au fond de la marmite ; gorgée de vin que l'on crache après avoir dégusté. - (20) |
| crachée, écume de beurre fondu. - (05) |
| crachée. Résidu, écume de beurre après qu'il a fondu ; au figuré, les mêmes acceptions que celle de lie. - (12) |
| cracher : v. n. Cracher aux cendres, être enceinte (parce qu'il existe souvent de la salivation au début de la grossesse). - (20) |
| crache-sang : s. m., timarche (timarcha tenebricosa), coléoptère qui exsude un liquide rougeâtre comme moyen de défense. - (20) |
| crâchie - écume, résidu du beurre que l'on a fondu, les fruits dont on a fait de la gelée. - En i en é qu'eumant bein lai crâchie de beurre. - Teins, mon enfant, voiqui ine dorée de crâchie de greusalles. - (18) |
| crâchie (Chal., Br.), crachée (Dij.), creuchie (Morv.). - Dans les première et deuxième acceptions désigne l'écume du beurre que l'on fait fondre et, dans la troisième, le dépôt d'huile qui se forme au fond d'une cruche ou d'un vase quelconque, c'est-à-dire soit ce que le beurre crache, soit un résidu de cruche, une creuchie… - (15) |
| crachie : écume de confiture ou de beurre. (S. T III) - D - (25) |
| crâchie, écume do beurre. - (16) |
| crachie, résidu de la fonte du beurre. - (27) |
| crachie, s. f., écume produite par le beurre fondu et qui entre dans la nourriture du peuple, et qui se dit aussi du résidu de l'huile de friture. - (11) |
| cràchie, s. f., résidu du beurre que l'on vient de fondre. Les enfants, friands de ce produit, le demandent beaucoup en rôties (tartines). - (14) |
| crachie. Ecume et résidu du beurre soumis à une longue ébullition. Littéralement : ce que le beurre crache. - (13) |
| crachie. Résidu du beurre que l'on fait fondre. Crachier, marchand de graisse. - (03) |
| crachis, s. m., écume sur la bassine de confiture. - (40) |
| crachouaire : 1 n. m. Parloir. - 2 n. m. Crachoir. - (53) |
| crachouiller : v. n., crachoter. - (20) |
| cracueilles. s. f. pl. Coquilles d’œufs ou de noix. (Etivey). - (10) |
| crafe. Croûte qui s'élève sur une écorchure. - (03) |
| craffe (na) : croûte (sang séché sur une plaie) - (57) |
| craffe, s. f. croûte dartreuse. - (22) |
| cragueillon : (crâkèyon: - subst.m.) voix très puissante. - (45) |
| crai, n.m. plateau pierreux, sommet. - (65) |
| crai. Sous-sol pierreux de la Champagne de Beaune. Il est formé par une agglomération de cailloux roulés, posés sur une couche argileuse. C'est le produit des alluvions et des dépôts du lac immense qui remplissait, à l'époque glaciaire, toute la vallée de la Saône. La vigne prospère dans ce terrain, lorsque le crai est recouvert d'une couche assez épaisse de terre végétale... - (13) |
| craïan ou crayan : Crayon, « J'ai cassé man craïan d'ardoise ». - (19) |
| craice (n.f.) : crèche - (50) |
| craiche : Salive - (19) |
| craiché, cracher. On dit d'un enfant qui ressemble à son père : s'â son përe teu craiché, c'est son père tout craché ; mais, dans cette locution, craiché voulant dire semblable doit n'avoir rien de commun avec craiché, craché. É no craiche dessu, il nous méprise. - (16) |
| craiche, s. f. salive. - (22) |
| craiché, vn. cracher. - (17) |
| craichée : Ecume et résidu provenant de la cuisson du beurre. « Eune reutie de craichée ». - (19) |
| craicher (v.t.) : cracher - (50) |
| craicher, v. intr., cracher. - (14) |
| craichi : cracher - (57) |
| craichi : Cracher « Y est défendu de craichi su le parquet ». « Ma fillette de vin blian a bien craichi » : ma fillette de vin blanc a évacué par la bonde quantité d'écume produite par la fermentation. « De la craiche de bavou » de la salive - (19) |
| craichot : Crachat. « O se naerait dan in craichot ». - (19) |
| craichou (on) : cracheur - (57) |
| craichouaîr (on) : crachoir - (57) |
| craichouilli : crachoter - (57) |
| craie (n.f.) : croûte - (50) |
| craïer (orthographe de Jaubert). v. n. Cracher salement. — On pourrait écrire aussi crailler. - (10) |
| craigneaux (Je). Pour je craignais, imparfait du verbe craindre. - (10) |
| craignu, ue. - Participe présent du verbe craindre. - (42) |
| craignu, ue. Partic. prés. du verbe craindre. Crain, ainte. - (10) |
| crâiller (v. int.) : produire un grincement désagréable - (64) |
| crailler, v. a. cracher grossièrement, avec bruit. - (08) |
| crâiller. v. - Chant particulier émis par la poule, lorsqu'elle recherche un emplacement pour pondre. Autre sens : se racler la gorge. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| craillon, subst. masculin : crachat gras. - (54) |
| craillon. Gros crachat. - (49) |
| craimaille, sf. crémaillère. - (17) |
| craimoisie. Cramoisie. - (01) |
| craimpiau, cêrpiau. s. m. Crêpe. - (10) |
| crainces - les grossières et mauvaises criblures. - Oh ma vos faisez des bonnes crainces, vo ! les bêtes les mégeant tré bein. - (18) |
| crainces. s. f. pl. Menues graines, déchets, résidus provenant de grains (froment, seigle, orge et avoine) qui viennent d’être criblés ou vannés. Jaubert donne crançures dans le même sens, mot qu’il fait dériver de crancer, cribler. - (10) |
| crainde v. Craindre, ne pas aimer, être intimidé, avoir peur de. - (63) |
| crainde, craindâ, craindeussaint - divers temps du verbe craindre. - En fau se fâre crainde aivou les domestiques. - C'a vrai que te craindâ qui te laiche ? … Ci ne sero pà in mau qu'à craindeussaint in pecho pu. - (18) |
| crainde. Craigne, craignent. - (01) |
| craindre : (vb) ne pas aimer, trouver désagréable - (35) |
| craindre : v. a., ne pas aimer, avoir de l'antipathie pour, être gêné par, souffrir de. Craindre (Se). Se craindre avec quelqu'un, être gêné avec lui. - (20) |
| crainon, s. m. cage à poulets, grand panier sous lequel on abrite les poussins. - (08) |
| crainran, s. m. risque-tout : « ç'o eun crainran. » de craindre et ran pour rien. - (08) |
| crainre (crainde) : craindre - (39) |
| crainson, craisson. s. m. Croissant, instrument de jardinier pour tailler les arbres, élaguer et barder les haies. - (10) |
| crainti : Craintif, timide. « Ses enfants sant craintis, an voit qu'i n'ant jamâ seurti (on voit qu'ils ne sont jamais sortis). - Féminin : craintie - (19) |
| craïon. s. m. Crachat épais, gluant. — On pourrait écrire aussi craillon. - (10) |
| craipau – crapaud. - Nous ne citons que le sens adressé à peu près uniquement aux enfants. - T'es in petiot craipau, vais. - Ote-tai don de lai, petiot craipau. - (18) |
| craipaud : gamin polisson - (37) |
| craipaut, sm. crapaud. - (17) |
| craipeûç’er : toussailler - (37) |
| craipeuchot : n. f. Butte. - (53) |
| craîpiaud : crêpe - (37) |
| craipoua : endroit raide. (RDM. T III) - B - (25) |
| craiqu’ter, caiqu’ter : bavarder à outrance - (37) |
| craique (aine) : (une) fente - (37) |
| craiquîllé : craqué, fendillé - (37) |
| craire (crouère) : croire - (39) |
| craire : croire - (57) |
| craire : croire - faut pas craire... faut pas croire... - (46) |
| craire. v. a. Croire. Je crayais, je crairais, que je craie, que nous craiyons, qu’ils craient. - (10) |
| crais, sm. terrain assis sur la roche plate qui sert de base aux argiles bleues du Fuller's Earthe. - (17) |
| craisse, crösse, sf. crasse. - (17) |
| craissot. s. m. Crachat. (Ménades). - (10) |
| craissou : sale - (37) |
| craivaite, sf. cravate. - (17) |
| craiyôle : crédule - (39) |
| crâle, crâ (n.m.) : pomme sauvage très acide - (50) |
| crâle, s. m. pomme sauvage très acide avec laquelle on fait du vinaigre. - (08) |
| crâler. v. n. Se vanter, se dire plus riche qu’on ne l’est. (Cuy). — Se dit, à Laduz, pour crier fort, crier à s’enrouer. - (10) |
| crâloire, cràou. s. f. et s. m. Crécelle. (Armeau, Rugny). - (10) |
| cramalière : Crémaillère. Pendre la crémaillère, donner un grand diner pour fêter son installation dans un nouveau logement. - (19) |
| cramayère, s. f., crémaillère : « Quand qu'la mâïon sera finite, j’planterons la cramayère. » - (14) |
| cramboulis (être) : de mauvaise humeur, ronchon. - (56) |
| crâme (n.f.) : crème - (50) |
| crâme : Crème « Eune reutie de crâme ». « In tepin de crâme » : grand pot dans lequel on conserve la crème avant de la mettre dans la baratte pour en faire du beurre ; ce pot est percé à sa partie inférieure d'un petit trou par lequel on fait écouler une sorte de petit lait qu'on nomme agrî ou agrie. (aigre). - (19) |
| crâme : crème - (48) |
| crâme : crême - (39) |
| crâme, s. f. crème. - (08) |
| crâmer :flamber, roussir. - (30) |
| cramillée. s. f. Crémaillère. - (10) |
| cramiot n.m. Crachat. - (63) |
| cramiot : voir claviot. - (20) |
| cramoue : renfrognement - (60) |
| cramoue : voir carcoue - (23) |
| crampai (Se) ou Se crampi - s'accrocher fortement à une chose pour s'aider ; se redresser fièrement. - In homme qui se née, si an veu le sauvai â se crampi aipré vo san pouvoir le fâre lâcher. - Ma ne te crampi don pas queman cequi d'aipré mouai. - (18) |
| crampé (se), v. r. se raidir, se tenir bon. - (22) |
| cramper - c’menci : commencer - (57) |
| cramper (s’) : se mettre au travail. « Attaquer le boulot », s’y atteler. - (62) |
| cramper (se) (après) : se cramponner, s’atteler à une tâche - (35) |
| cramper (se) : Se tenir bon, se raidir cran : Sable grossier et compact. - (19) |
| cramper (se) : commencer un travail. (CH. T II) - S&L - (25) |
| cramper (se), v. r. se raidir, se tenir bon. - (24) |
| cramper (se), v. réfl., se cramponner, s'attacher avec force : « Le p’tiot é ben genti ; drès qu'jérive, ô s'crampe après moi, » A aussi parfois le sens de : se raidir, se révolter. - (14) |
| cramper (se), v., se mettre au travail. - (40) |
| cramper (se). S'attacher fortement, employer toute sa force à un ouvrage. Se cramper avec quelqu'un, c'est lutter. - (03) |
| crampillon : (nm) crampon que l'on fixe sous les sabots - (35) |
| crampillox : s. m., petit crampon, cramponnet. - (20) |
| crampin, s. m. crochet de bois pour attirer à soi les branches d'un arbre fruitier. - (22) |
| crampir (se), s'arc-bouter. - (28) |
| crampir, se mettre au travail. - (26) |
| cramponniée (n. f.) : boulet du cheval - (64) |
| crampoûner : cramponner - (39) |
| crampounner : cramponner - (48) |
| cran (n.m.) : gros sable argileux - (50) |
| cran : petit enclos, stalle - (48) |
| cran n.m. (or. inc.). Granit décomposé, substitut du sable dans les constructions anciennes ; plus ou moins argileux il sert à l'entretien des chemins, des cours de ferme. - (63) |
| cran : petit enclos - (39) |
| cran : s. m. Etre de cran, être en querelle, s'agripper. - (20) |
| cran : s. m., sable granitique. - (20) |
| cran, n.m. argile friable. - (38) |
| cran, n.m. roche en décomposition, en générale granitique, et, par suite, sable grossier que l'on répand sur les chemins et dans les cours de ferme. - (65) |
| cran, s. m. coin, compartiment réservé dans un lieu pour enfermer un animal ou un objet qu'on veut isoler ; petit parc construit avec des claies ou des planches. - (08) |
| cran, s. m. gros sable, gravier, arène : un terrain de « cran. » on extrait du « cran » pour bâtir. - (08) |
| cran, s. m. sable grossier et compact. - (22) |
| cran, s. m. sable grossier et compact. - (24) |
| cran, subst. masculin : sable grossier et compact. - (54) |
| crance, creux, desséché, vide... - (02) |
| cranchi : Ridé en se desséchant. « Des pommes cranchies ». - (19) |
| crancir : voir clancir. - (20) |
| crâne. Ce mot a, chez les Bourguignons, plusieurs acception s; il signifie tout à la fois bien mis, tapageur et avare, ou homme dur... C'est un crane signifie le plus ordinairement, dans le Châtillonnais, c'est un ladre, un avare. - (02) |
| crane. : Ce mot signifie à la fois fier, tapageur et avare.- On dit c'est cranement beau. - (06) |
| crâne; du crâne vin, du vin solide, excellent. On dit d'un malade : è n'â pâ crâne, et d'un acte de ladrerie ; s' n'â pâ crâne. - (16) |
| crâner. v. n. Crier, en parlant de la poule. (Percey). — En beaucoup d’autres endroits, on dit crâler. - (10) |
| cran-mire : s. f. pot à crème. - (21) |
| cranpi (se), vr. se cramponner. - (17) |
| crapai. Crêpes qu'on fait dans la poêle, et par corruption de ce mot. - (03) |
| crapaud-volant. Engoulevent. - (49) |
| crape (crâpe) : s., f., râpe, rafle ; grappe dépourvue de ses fruits ; grappe dont les fruits sont desséchés par la chaleur ou par la maladie ; grappe qui ne porte que très peu de grains ; mare de raisin d'où l'on extrait le cul-de-dé. - (20) |
| crape (na) - cosse (na) : gousse - (57) |
| crape : Rafle, grappe de raisin dépouillée de ses grains. « N'y a ren demoré dans les vignes, la nialle a fait cheu les greumes, i n'y a plieu que les crapes ». - (19) |
| crape, s. f. 1. Raisin égrappé. — 2. Vieux balai usé. - (22) |
| crape, s.f. 1. Raisin égrappé. — 2. Vieux balai usé. - (24) |
| crapeûç’er : toussailler - (37) |
| crapeûç’ot : faîte, dessus, butte - (37) |
| crapeûcher, verbe intransitif : toussoter pour se nettoyer la gorge. - (54) |
| crapiâ, s. m., gros crapaud femelle. - (40) |
| crâpiat : voir crâpiau - (23) |
| crapiau - (39) |
| crapiau (Brassy) ou grapiau (Mhère) : crêpe au lard. - (52) |
| crâpiau (n.m.) : crêpe (aussi craipiau) - (50) |
| crapiau (un) : crêpe, galette, gâteau - (61) |
| crapiau (yeux) : chassieux. - (30) |
| crapiau : (nm) crapaud - (35) |
| crâpiau : crêpe (celt.. krampouez ; kram : grillé ; pouez lourd). - (32) |
| crâpiau : crêpe au blé noir. V1, p. 4-8 - (23) |
| crâpiau : crêpe au lard - (48) |
| crâpiau : crèpe. - (59) |
| crâpiau : une crêpe. - (56) |
| crâpiau, s. m. crêpe, petite galette très mince et un peu frisée sur les bords. - (08) |
| crapiau, s. m., crapaud. - (14) |
| crâpiau, subst. masculin : crêpe - (54) |
| crapiaud : crêpe - (44) |
| crapiaud n.m. Crapaud. Voir tou. - (63) |
| crâpiaud. Crêpe. - (49) |
| crapiaud. n. m. - Crapaud. - (42) |
| crapigner. Peigner, carder. Se dit surtout du chanvre, de la laine. Fig. Se battre, se tirer par les cheveux. - (49) |
| crapignon. Peigneur de chanvre. Venait d'Auvergne en hiver pour peigner, assouplir la filasse de chanvre. - (49) |
| crapissot. s. m. Chemin, sentier pratiqué dans une butte raide et de peu de longueur. - (10) |
| crapoucher : crachoter. - (56) |
| crapouchou : qui crapouche fréquemment. - (56) |
| crapouet (on) : pépin (de fruit) - (57) |
| crapouet (on) : trognon (de fruit) - (57) |
| crappe (d’la) : coque (enveloppe de certains fruits secs) - (57) |
| crappe : moût de raisin sortant de la cuve. - (30) |
| crappe n.f. (francique krappan, résidu de râclage) Moût de raisin, jus non fermenté. - (63) |
| crappe : s. f. feuille du maïs. - (21) |
| crappet n.m. (de crappe). 1. Déchets végétaux divers (entre balle et paille avec des herbes) tombant sous la batteuse, mis en bottes liées, stockés et donnés comme complément alimentaire aux vaches. 2. Débris de foin du fenil. - (63) |
| crappeton {à) : marcher à quatre pattes. - (30) |
| crapuchot ou crapeuchot, subst. masculin : montée, butte, sommet arrondi. - (54) |
| crapuchot, s. m., partie raide et escarpée d'un chemin. - (11) |
| craquant n.m. Cartilage. - (63) |
| craque, craquant : s. m., syn. de couine. - (20) |
| craque, s. f., mensonge, hâblerie :« Vouah ! c'qu'ô m'dit, j'n'y creis guâre ; y é tôjor des cràques. » - (14) |
| craque, subst. féminin : lézarde, fissure. - (54) |
| craquelin : (nm) pli (dans un bas) - (35) |
| cràquer, v. intr., mentir : « T'airas biau dire, va, on n'te creira pus ; t.'nous cràques du maitin au souér. » - (14) |
| cràquer, v. tr., déchirer, faire craquer : « T'as craqué ton pantalon. » - (14) |
| craqui (n. m.) : fibres coriaces dans un morceau de viande - (64) |
| cràquiller, v. intr., produire un petit bruit : « Y a eùn grain de sâbe dans ta sôpe ; ô m’craquille sô la dent. » - (14) |
| craquiller, v. n. se dit du bruit que fait une chose qui se brise ou qui s'écrase. Un grain de sable « craquille » sous la dent. craquiller est un diminutif de craquer. - (08) |
| craquillon : bruit, jacasserie - (48) |
| cràquou, s. m. et adj., menteur, qui dit des « cràques ». - (14) |
| crare : (vb) croire - (35) |
| crare : croire - (43) |
| crare : Croire. « An li fa crare to ce qu'an veut ». Part passé, crayu. - (19) |
| crâre v. Croire. p.p. créju. - (63) |
| cras : Nom de lieu. « Les vignes des Cras ». Les terrains des Cras sont généralement pierreux. - (19) |
| crase : s. f., petite combe. Voir creuse. - (20) |
| crasse (na) : vacherie (farce) - (57) |
| crasse : Mauvais procédé. « O m'a fait eune crasse ». - (19) |
| cràsse, adj. crasseus, avare, malpropre : « Ol ê cràsse ; ô n'donne jamâ ran. » - (14) |
| crasse, crasseux, avare ; el â crasse, il est avare. - (16) |
| cràsse, s. f., ladrerie, et mauvais tour : « Non, je n’li parle pus ; ô m'a fait eùne cràsse. » - (14) |
| crassè. s. f. Avarice, épargne sordide. - (10) |
| crassier : déchèterie - (44) |
| crasson. s. m. Chiche, avare, intéressé. Un vieux crasson. - (10) |
| crassou (n.m.) : crasseux (féminin, crassouse = crasseuse) - (50) |
| crassou : crasseux. - (62) |
| crassou : Crasseux. « In col d'habit crassou ». Avare, « Qu'est-ce qu'o t'a donné pa tan jo de l'an (pour ton jour de l'an) ? Ren du to, ol est bin treu crassou ». - (19) |
| crassou : très sale - (44) |
| crassou, craissou, ouse, adj. crasseux, malpropre. - (08) |
| crassou. adj. Crasseux, malpropre ; peu généreux. (Etivey). - (10) |
| crassous (on) - crassouse (na) - embeucassi – catalous : sale - (57) |
| crassous, quertous. Crasseux, crasseuse, malpropre. - (49) |
| crassoux, adjectif qualificatif ou subst. masculin : sale, malpropre. - (54) |
| crassoux, crassouse : adj., crasseux, crasseuse. Nom de famille : Crassouse. - (20) |
| crassoux, ouse adj et n. Crasseux. - (63) |
| cratsi : (vb) cracher - (35) |
| cratsi : cracher - (51) |
| cratsi v. Cracher. - (63) |
| crau : creux, mare. Au Pont de Planchereau, il s'agissait d'un lavoir soigneusement cimenté, mais sans toit. - (52) |
| crau : mare - (34) |
| crau : pomme sauvage. (P. T IV) - Y - (25) |
| crau, corbeau. - (14) |
| crau, s. . f., partie de la graisse du porc adhérente à la peau et qui produit le lard, distincte de l'oing, graisse plus fine qui recouvre le péritoine. - (11) |
| crau. Corbeau. - (03) |
| crau. s. m. Craie. - (10) |
| craulai ou crôlai, trembler, et, par extension, remuer quelque chose, un arbre, par exemple, pour en faire tomber les fruits. (C'est l'acception reçue dans le Châtillonnais.) ... - (02) |
| crauler : secouer les noix. - (66) |
| crauler. v. a. Marquer avec de la craie. - (10) |
| craupe (n.f.) : 1) espèce de pissenlit (selon de Chambure : crôpe) - 2) craupe de queurneille : bleuet - (50) |
| craupe : pissenlit - (44) |
| craupe. Pissenlit. - (49) |
| craupe. s. f. Crête. (Athie). - (10) |
| craûper (aine fonne) : baiser (une femme) rapidement - (37) |
| crauper (se). Se battre. - (49) |
| cravaijan : Crevaison, maladie mortelle. « J'ins ésu la pliô su le deu to le jo i avait de qua étraper la cravaijan », nous avons eu la pluie sur le dos toute la journée il y avait de quoi attraper la mort. - (19) |
| cravèche : Crevasse, fente, lézarde. « Y a eune cravèche dans la meureille (dans la muraille) ». - (19) |
| cravéchi : Crevasser. « Ces planches ant été treu langtemps au sola i sant totes cravéchies », ces planches ont été trop longtemps au soleil, elles sont toutes crevassées. - (19) |
| craver : Crever, périr. « La vaiche nare (noire) est cravée ». - (19) |
| cravet : Crevasse aux mains. « Ol a les mains plieines de cravets ». - (19) |
| cravéure. : (Dial.), crevasse. - (06) |
| crâyance, créyance, s. f. croyance. - (08) |
| crayant. adj. Croyant ; simple, crédule. - (10) |
| crayaule (adj.) : crédule, croyable - (50) |
| crâyeux n. et adj. Crédule, naïf. - (63) |
| cré - avare, parcimonieux. - Qu'à sont don cré, ces gens lai ! A ne beilleraint pâ lai paie d'in pôille écorché. - Qu'al a cré, le Toinot !... â ne reçoit jaimà, oh mâ jaimâ, les pôres que lli demandant. - (18) |
| cré ! juron ; sacrée ! - (38) |
| cré (-e) (adj.m. ou f.) : acre, âpre - (50) |
| cré : Mauvais, qui a mauvais goût, amer. « Mâtin, qu'y est cré ! ». Féminin : crère, « J'ai la bouche crère », j'ai mauvaise bouche. - (19) |
| cré m'en : crois-moi ou crois m'en. Ex : "Si te v'lais Margot cré m'en ben, J'frin ça l'jour de la Saint-Martin J'quurint nout' grous couchon J'rigol'rint pour dé bon Te peut pas m'die non-on !" (Chanson). - (58) |
| cré, ée, adj. acre, âpre. Les raisins verts sont « crés » ; une pomme sauvage est « crée. - (08) |
| créas. s. m. et créasse. s. f. Craie. - (10) |
| créaule. : (Dial. et pat.), croyable. Vraie dérivation du latin credibilis. - (06) |
| crèbeusson, enfant peu développé physiquement pour son âge. - (27) |
| crebillot (en crebillot) : en chien de fusil (celt. krabo : recroquevillé). - (32) |
| creboton : accroupi - (46) |
| crebucho : endroit raide. (SY. T II) - B - (25) |
| crécelle : voir carcelle. - (20) |
| crèche : mangeoire à laquelle sont attachés les bovins pendant l’hiver. - (59) |
| créche, s. f., crêche. - (14) |
| crécher. v. a. et n. Cracher. - (10) |
| créchî : cracher. - (62) |
| crèchi : v. cracher. - (21) |
| créchon (n.m.) : cresson (plante) - (50) |
| crechon : s. m., orifice ouvert dans le plancher du fenil et par lequel on fait tomber le foin dans le râtelier de l'étable. - (20) |
| créchon, créchot, creuchon. s. mi. Crachat, salive qu’on rejette. - (10) |
| créchon, s. m. cresson. - (08) |
| crechot : un crochet - (46) |
| créchöt, sm. crochet. - (17) |
| créchot. s. m. Crochet. - (10) |
| créci, cressi. s. m. Mélange de poussier de charbon, de poussière et de petite braise. (Viliiers-Saint-Benoît). - (10) |
| créci, querci. n. m. - Scorie du minerai de fer. (Voir F.P. Chapat, p. 77) - (42) |
| crée : teint jaunâtre, gris - (39) |
| crèe, adj. : du sable crèe, du sable sans mélange. - (17) |
| crée, au féminin crète ; d'où le français crétin. Quel a crée ! c.-à-d. qu'il est chétif ! Ce mot signifie aussi ladre, vilain. - (02) |
| crée, médiocre. - (38) |
| créépiâ : n. f. Crêpe très épaisse. - (53) |
| crégeon, Créjon. s. m. Crayon. - (10) |
| crégouis (n. m. pl.) : absolument rien (des crégouis) - (64) |
| crei, et croué s. f., crois. - (14) |
| creiché. Cracher, craché, crachez… - (01) |
| creiche. Crèche. - (01) |
| crein-me, s. f., crême, ce délicieus produit qui nous donne le beurre, mais qui le remplace fréquemment dans les préparations culinaires. - (14) |
| créïole. adj. Crédule. (Percey). - (10) |
| creire (s'en), loc, se croire quelque chose, s'enorgueillir : « Diou de Diou ! dêpeù qu'ôl a été noumé gard'champéte, ô s'en creit prou !... » - (14) |
| creire (v.t.) : croire (aussi crére) - (50) |
| creire, v. a. croire : « i cré bin », je crois bien. - (08) |
| creire, v. intr., croire, s'imaginer. - (14) |
| creire. v. - Croire : « Oué mon gars, cré-moi ben ! Te vas t'en rappeler ! » Creire est la première forme, du Xe siècle, du verbe croire, issu du latin credere. - (42) |
| créju p. passé de croire. Cru. Ôl l'a pas créju. - (63) |
| crêle. s. f. Fauvette. (Laffon). - (10) |
| crèlze : coquille d'œuf, de noix, d'escargot. (CST. T II) - D - (25) |
| cremale, creumâle. s. f. Crémaillère. (Athie, Civry). - (10) |
| cremente : Couverture de livre d'écolier. « Eune cremente en parchemin ». « J'ai taichi (taché) la cremente de man récimoraux (du livre qui s'appelle « les récits moraux ». - (19) |
| cremet. s. m. Croc, grappin pour retirer les seaux tombés dans les puits.(Souey). - (10) |
| crèmette. n. f. - Désigne une fermière qui a le talent de produire plus de crème avec la même quantité de lait que les autres fermières. (Saint-Martin-sur-Ouanne, selon M. Jossier) - (42) |
| crèmette. s. f. Ménagère qui a le talent mystérieux de faire produire à son laitage une plus grande quantité de crème que les autres. (Saint-Martin-sur-Ouanne). - (10) |
| crémire : (nf) pot à crème - (35) |
| crémîre n.f. Jarre de terre cuite vernissée dotée d'une petite évacuation dans sa partie basse, destinée à recueillir la crème fraîche avant sa transformation en beurre. Un quillon de bois fermait le trou d'évacuation du petit lait qui descendait au fond de la jarre. - (63) |
| crémire, crin-mire : pot de grès utilisé pour conserver la crème - (43) |
| cremmoir. : (Dial.), craindre, et cremmor ou cremor, crainte (du latin tremere). - (06) |
| crène ou, plutôt, craîne s. f. Se dit par contraction de crainte. — De craîne que. Locut. conjonct. De peur que, de crainte que. (Goulours). - (10) |
| crenet : abri en fil de fer ou en lattes pour donner à manger aux poussins sans que la grosse volaille ne vienne les déranger. - (30) |
| creni (linge), froissé, malpropre à force d'être resté longtemps sans être lavé. - (27) |
| creni : (linge) gris. (A. T II) - D - (25) |
| creni : défraîchi, altéré, difficile à nettoyer - (46) |
| créni : ridé. (S. T III) - D - (25) |
| creni Rugueux. Au vai jaler : i ai lai piâ des mains tote crenie. (ïl va geler : j'ai la peau des mains toute grenue ) Encrené avait autrefois le sens de blessé et meurtri... - (13) |
| creni, adj. en parlant d'une étoffe tachée, jaunie par le fer. - (38) |
| créni, adj., linge roussi par un fer trop chaud. - (40) |
| creni, encrassé. - (26) |
| créni, qui a la peau malpropre. - (28) |
| creniaule, corniaule : trachée ou œsophage d'une volaille. - (30) |
| crènme, crème. - (16) |
| crénon : enclos grillagé pour les poules - (61) |
| crènse, criblures du blé. - (16) |
| crépais - crêpe, pâte qui tient de l'omelette et du beignet. - Lai soupe et in crépais, cequi seré aissez pou note soupai. - Ai ce sair i veu me régalai aivou in crépais, et encore mieux aivou deux. - (18) |
| crêpe : (nf) crête du coq - (35) |
| crepé : enfant rablé. - (30) |
| crêpê : (crê:pê: - subst. m.) sorte de crêpe lourde et épaisse. On y peut mêler des fleurs d'acacia pour lui donner du goût. - (45) |
| crêpe : s. m., pissenlit. - (20) |
| crêpe, crête de montagne. - (16) |
| crêpe. Crête de gallinacée. - (49) |
| créper le chignon : tirer les cheveux - (44) |
| crêper. v. a. Prendre par les cheveux. - (10) |
| crépet, crèpelöt, sm. omelette au maigre ; crêpe. - (17) |
| crépia : grosse crêpe bien nourrissante. - (66) |
| crépiâ : mot masculin désignant une crêpe - (46) |
| crepiâ, omelette faite avec de la farine, des œufs, du lait. - (27) |
| crépiâ, s. m., omelette épaisse à la farine. - (40) |
| crépia. Sorte d'omelette : c'est le diminutif de crèpe... - (13) |
| crêpiat : voir crâpiau - (23) |
| crêpiau. n. m. - Crêpe épaisse : synonyme de roubigneau. - (42) |
| crépiaud : crêpe. - (33) |
| crèpiaud. Crapaud. - (49) |
| crepieu : omelette lait farine. - (66) |
| crépine : s. f., filet pour cheveux. - (20) |
| crêpiot (n. m.) : sorte de galette épaisse et salée, de consistance pâteuse, cuite à la poêle (syn. sansiot) - (64) |
| crépissot - petite montée un peu longue. - En n'y é in petiot crépissotai montai, ma ce n'â ran pou note chevau. – Jl’ai rencontrai à dessus du crépissot des Luas, qu'al éto essoffliai ran que pou cequi. - (18) |
| crépiter. v. n. Faire du bruit, s’agiter, remuer les pieds, ne pas tenir en place, comme font ceux qui s’impatientent, qui s’ennuient d’attendre. Du latin crepitare. - (10) |
| crèpo, crapaud. - (26) |
| crépousser, v. n. tousser avec continuité : « i é crépoussé tote lai neu », j'ai toussé toute cette nuit. - (08) |
| crepton (Se mettre à). S'accroupir, Littéralement s'asseoir sur ses talons. Du latin crepida, sandale. - (13) |
| crëpyâ, sorte d'aliment de farine frite à l'huile. - (16) |
| créquenotte. s. f. Petite pomme. (Cuy). - (10) |
| crequouis : morceau de cartilage (de couleur blanche) support-attaché à la viande du porc. Ex : "Ton fricot d’couchon il est ben bon, mais té m’a douné ben du créquouis !" - (58) |
| crer. v. a. Croire Je ne peux pas crer ça. - (10) |
| crère : croire - (51) |
| crère, croire. - (04) |
| crésalle : crécelle. (B. T IV) - D - (25) |
| crésieu, cresieu, creusieu, crusieu, cresu, crésiau, cresiau, creusiau, crusiau : s. m., vx fr. croisel ct croiseul, petite lampe de métal formée d'un récipient généralement non couvert et à fond plat, muni d'un bec à l'avant, et à l'arrière d'une tige articulée portant un crochet de suspension. - (20) |
| cresse : crêche, mangeoire pour le bétail - (39) |
| cressiller, kersiller. v. n. Frémir, frissonner, éprouver dans tout son être une sorte d’ébranlement à la vue d’un accident ou d’un spectacle qui vous impressionne, qui vous saisit fortement et soudainement. — Frémir d’impatience. — Craquer, en parlant d’un morceau de bois qui se rompt. —Cressiller des dents , grincer des dents. - (10) |
| cresson, cressol : s. m., vx fr. cresson, excroissance et spécialement kyste synovial. Les personnes qui emploient ce mot ignorent sa signification ancienne d'excroissance, et disent non pas un cresson, mais du cresson, une boule de cresson, comme s'il s'agissait du cresson de fontaine. - (20) |
| cret n.m. Croissance. Ôl a fait son cret. Il a terminé sa croissance, il est adulte. - (63) |
| cretaine et quertaine. Rideau de lit, courtine. - (13) |
| crête (n. f.) : trogne, visage rebondi - (64) |
| créte. Crète… - (01) |
| cretelle : crotte. - (30) |
| cretelle, catale : crotte de lapin, de chèvre - (43) |
| cretelle, creteille, cretille : s. f., bas-lat. cristilia, capitule de la bardane commune (lappa major, lappa minor), dont les écailles de l'involucre, recourbées en hameçon au sommet, s'accrochent aux vêtements, aux poils des animaux, etc. - (20) |
| cretelle, s. f. crête, sommet de colline ou de montagne. - (08) |
| creteloux : enflammé (en parlant des yeux). - (30) |
| creteu, cretot, crotot. Le sommet de la tête par derrière. Etym. crête, de crista. - (12) |
| creteu, occiput. - (26) |
| crétiquer, v. a. critiquer. « Crétique » = critique. - (08) |
| cretou : arrière crâne. - (66) |
| cretou : avare - (43) |
| cretouilli : froisser - (51) |
| Cretoule (St), St-Christophe. - (05) |
| cretoux : voir crottoux. - (20) |
| crètse, keurtse n.f. Crèche, mangeoire. - (63) |
| crétsi : croitre, grandir - (51) |
| crètsi. Cracher. - (49) |
| crétsu : p.passé de croître - (35) |
| crétsu p.p. de croîte. Alle a bié crétsu. Elle a bien grandi. - (63) |
| creuboche : s. m. rideaux du berceau - couvre-bouche (tête) ; bouche-berceau. - (21) |
| creuche, creuge, creuille et creuse. s. f. Coquille. Une creug d’œuf, une écreuse de noix. - (10) |
| creuche, s. f., cruche. - (14) |
| creuché, s. m. nappe en mousseline bordée de tulle ou de dentelle dont on se sert pour présenter le pain bénit à l'offrande et pour quelques autres usages du culte. - (08) |
| creuche-pid : Croche-pied, croc enjambe. - (19) |
| creuchi v. Craquer, grésiller. - (63) |
| creuchi, v. n. se dit du crissement produit lorsqu'on coupe certains objets à la fois mous et résistants. - (24) |
| creuchie, s. f. dépôt d'huile qui se trouve au fond d'une cruche ou d'un vase quelconque. - (08) |
| creuchie, substantif féminin : crasse, dépôt au fond d'une bouteille ou d'un récipient. - (54) |
| creuel. Cruel. - (01) |
| creuge : coquille de noix. (F. T IV) - Y - (25) |
| creuge, s. f. écale de noix, de noisette, amande, coquille d'œuf. Aux environs d'Avallon, « cruge. » - (08) |
| creûgner, creûiller, croûgner : creuser dans un aliment avec ses dents - (37) |
| creûgnon,croûgnon (n.m.) : croûton - (50) |
| creuher, v. a. creuser, fouiller. - (08) |
| creûiIIon, s. m., noix fraîche, cerneau. - (40) |
| creûille : coquille d'œuf, de noisette ou de noix. - (52) |
| creuille(s) : coquille(s) - (39) |
| creuille, coquille - (36) |
| creuille, n.f. coquille de noix : creuille de cala. - (38) |
| creuille, s. f. coquille d'œuf, écaille, débris, déchet de toute sorte - (08) |
| creûille, s. f., coquille de noix ou d'escargot (vide). - (40) |
| creuillée (na) : criée - (57) |
| creuiller - breûilli : crier - (57) |
| creuiller, crô-yer, v. sortir la noix de sa coquille. - (38) |
| creuiller, v, tr., creuser, surtout enlever le milieu d'un fruit, poire ou pomme, pour une préparation culinaire, beignets, compote, etc. - (14) |
| creuiller, v. creuser. - (65) |
| creûilli : creuser - (57) |
| creûillon : contenu de la noix, cerneau. - (52) |
| creûillon : petit enfant maigre, malingre, petit dernier - (48) |
| creuillon : petit dernier - (39) |
| creuillon, s. m., cœur de pomme, de poire, non lorsque le fruit est entier, mais quand ce dernier vient d'être croqué à belles dents jusqu'au centre : « Ol a maingé sa poume, épi ô m'beillòt l'creùillon ! » - (14) |
| creuillon. Éclat de bois qu'on enlève en fabriquant les sabots, en les creuillant, creusant. On nomme frisons les rubans de bois qu'on enlève aussi, parce qu'ils sont frisés. - (03) |
| creuillons de sabotier. - (05) |
| creuillou (on) - gueulâ (on) : crieur - (57) |
| creuje : coquille. - (29) |
| creuje, s. f. coquille de noix, d'œuf. - (24) |
| creujon (pour crayon). s. m. Œuf de pierre, de craie, qu’on laisse dans le nid des poules pour les faire pondre. (Armeau). — Synonyme de gniaud. - (10) |
| creulâme : crémaillère. - (29) |
| creumâyére : crémaillère - (39) |
| creume. n. f. - Crème. - (42) |
| creume. s. f. Crème. - (10) |
| crêumer : être atteint d'une langueur maladive. (CLB. T II) - C - (25) |
| creumu p.p. de crainde (p.ê. une déformation de craignu, plus classique) Craint. Alle 'to bin sévère mas nos l'a pas creumu bié longtemps. Dans l'expression "Ôl a trop creumu", craint s'entend comme changé en mal, maigri. - (63) |
| creupeton ou croupeton (à). Du vieux mot se croper. Nous disons aussi pour s'accroupir, s'acabécher, s’aqueuler et s’aroufer. - (03) |
| creupi (pour crépir). v. a. Emmêler. — Finis, tu m’creupis les cheveux. (Argentenay). - (10) |
| creûpire : (nf) croupière - (35) |
| creupire : croupière - (43) |
| creup'ton (à), assis sur les talons. - (28) |
| creupton (à). Pour à croupeton, dans une position accroupie. Etym. croupe. - (12) |
| creupton, ai creupton, baissé sur ses genoux ployês. - (16) |
| creuquer : Croquer, « Creuquer des pommes vardes (vertes) ». « Je veux bin que le crique me creuque si.. ». Locution qui correspond à je veux bien être pendu si… - (19) |
| creus, s. m., mare, dont le lit a été creusé accidentellement ; le « Creux-Carillon », par exemple, qui se trouve à remplacement même d'une tuilerie emportée par une violente inondation. (V. Crot.) - (14) |
| creuse - voyez crue, qui est plus employé. - (18) |
| creuse : coquille de noix. - (09) |
| creuse : coquille d'œuf - (43) |
| creuse : vallée, partie basse - (48) |
| creuse : s. f., dépression de terrain en forme de ravin. Noms de lieux : Creuse-Noire (commune de Leynes) ; Les Creuzes (commune de Pruzilly) ; etc. Voir crase. - (20) |
| creuse : s. f.. coquille. Creuse de cala, coquille de noix (petit bateau). - (20) |
| creuse, coquille d'œuf ou de noix. - (05) |
| creuse, coquille. - (02) |
| creuse, cruse, cruge. Coquille. Les formes cruse et cruge sont évidemment des corruptions de creuse ; le mot, qui est un adjectif régulier, est pris substantivement pour dire une chose creuse, une chose ou il n'y a plus rien, vidée. Aussi, creuse, cruse ne désignent jamais la coquille pleine, mais la coquille à l’état de débris. - (12) |
| creuse, s. f. coquille de noix, d’œuf. - (22) |
| creuse, s. f. petit vallon, ravin, pli de terrain. - (08) |
| creuse, s. f., coque, coquille. Une « creuse » de cala ; une « creûse d’ù. » Le mot contient une image de concavité. - (14) |
| creuse. Coquille de noix ou de noisettes. An n'y ai ran de tel que des creuses pour fare clairer le feu. - (13) |
| creuse. : Coquille. (Del.) - (06) |
| creuset, s. m. vase en poterie de forme arrondie comme l'écuelle, moins grande que la trape. - (08) |
| creuset. Petit vase en terre quelconque, qu'il ait ou non de l’analogie avec le creuset « destiné à être mis au milieu du feu pour obtenir la fusion des corps réfractaires (Littré). » Etym. probable, le bas latin crusellus. - (12) |
| creuseur, s. f. profondeur. - (08) |
| creusiou, cresu, lampe à queue. - (05) |
| creusir. v. a. Creuser. L’ ne se prononce pas. J’ons fait creusi une cave. - (10) |
| creûsot, s. m., petit pot en terre. - (40) |
| creusse : Crosse. « Eune creusse de feusi », une crosse de fusil. - (19) |
| creusse: moue, grimace, gros dos, air renfrogné - (48) |
| creussegnoûle (la) - cueursegnoûle (la) : cartilage - (57) |
| creûssi : (vb) craquer - (35) |
| creussi : craquer - (43) |
| creussi : crisser - (57) |
| creussi, v. n. se dit du crépitement produit lorsqu'on coupe certains objets à la fois mous et résistants. - (22) |
| creussie : dépôt dans un liquide - (39) |
| creussôle, s. f. cartilage dans la viande de boucherie. - (24) |
| creussôle, s. f. cartilage. - (22) |
| creusson n.m. (du francique kriskjan et du vieux fr. crisner ou cressiner, grincer) Arthrose. - (63) |
| creussonnette n.f. Petit cresson poussant dans les raies. - (63) |
| creusû (n.m.) : celui qui creuse, terrassier - (50) |
| creusu : lampe à huile - (43) |
| creut : Trou, fosse, creux. « Ol a fait in creut dans san jardin ». - Petite mare, « Le creut es peus (porc, sanglier) , en Navoie ». - (19) |
| creut : voir greut. - (20) |
| creuter : Faire des creuts. Creuter signifiait autrefois planter de la vigne parce qu'alors il suffisait de faire des creuts dans lesquels on plaçait le chapan (plant) ; depuis qu'on pratique le greffe sur plant américain au lieu de creuter on défonce le terrain et on plante au « fichan ». Voir « fichan ». - (19) |
| creutes. s. m . Écuelle de terre. - (10) |
| creuteu : nuque. (REP T IV) - D - (25) |
| creuteu, nuque. - (28) |
| creutôt : le crâne ou l'arrière du crâne - (46) |
| creûtot : 1 n. f. Cordes vocales. - 2 n. f. Gorge. - (53) |
| creutöt, sm. nuque. - (17) |
| creutou : Ouvrier qui plante de la vigne. « Miji c'ment in creutou », manger beaucoup, avoir un gros appétit. - (19) |
| creûtou(ze) : avare - (35) |
| creutse : (nf) mangeoire - (35) |
| creutse : crèche - (51) |
| creutse : mangeoire, crèche - (43) |
| creûtson : (nm) cruche - (35) |
| creuvâ (n.m.) : gerçure des mains - (50) |
| creuvâ, s. m. crevasse, fente, gerçure. On dit d'une main couverte d'engelures qu'elle est pleine de « creuvâs. » - (08) |
| creuvé, adj. se dit d'un individu atteint d'une hernie ou de quelque maladie analogue. - (08) |
| creûvesse : (nf) crevasse - (35) |
| creuve-tête : Ancienne coiffure de femme qui n'est plus en usage. C'était un bonnet de couleur, même noire, qui n'enserrait que le chignon et se portait sous le « calot » (bonnet blanc), il garantissait celui-ci du contact des cheveux. - (19) |
| creuveteure (n.f.) : couverture - (50) |
| creûvézon, mort d'un animal. - (16) |
| creuvi : v. couvrir. - (21) |
| creuvû (n.m.) : couvreur - (50) |
| creux (n. f.) : coquille d'œuf, de noix (des creux d'calons) - (64) |
| creux : s. m., creux d'eau, mare. Il parait qu'on patine déjà au creux Bouchacourt. - (20) |
| creûye,creûge (n.f.) : coquille d'oeuf ou de noix - (50) |
| creûyi : (vb) crier - (35) |
| creuyoure (n.f.) : croyance - (50) |
| creuze, coquille d'oeuf, de noix, etc. - (16) |
| creûze, creûje : (nf) coquille (de noix) - (35) |
| creuzé, creuzo, petite vaisselle profonde, petite soupière. - (16) |
| creûzu : (nm) ancienne lampe à huile - (35) |
| creuzùye*, s. m. ancienne lampe à huile. - (22) |
| crevâ : crevasse, gerçure - (48) |
| crevâ : n. f. Crevasse (plaie). - (53) |
| creva. Crevasse, gerçure de la peau produite par le froid. - (49) |
| crevaison, crevation. s. f. Action de mourir. Faire sa crevaison , faire sa crevation , rendre le dernier soupir, être en train de mourir. - (10) |
| crevaison. n. f. - Mort ; faire sa crevaison, rendre son dernier soupir : « Faura ben qu'la crevaison vienne, i' f'ront coumme moué, eune ch'tite mort. » (Fernand Clas, p.86) - (42) |
| crevaisse (féminin) : crevasses dans les doigts - (39) |
| crevance. Personne ou animal maladif. - (49) |
| crevante : s. f., crevaison ; état d'un homme ou d'un animal qui est après mourir. - (20) |
| crevas - (39) |
| crevâs (ain) : (une) gerçure - (37) |
| crevas : gerçure - (44) |
| crevas : gerçures, crevasses aux mains (évitées ou atténuées avec du bigot). - (33) |
| crevas, subst. masculin : gerçure, crevasse, engelure. - (54) |
| crévate. n. f. - Cravate. Au figuré : collet pour attraper les animaux. - (42) |
| crevé (un) : crevasse - (43) |
| crève : adj., crevé. - (20) |
| crève-cœur : s. m. Prendre le crève-cœur, avoir le moral affecté d'une façon excessive. - (20) |
| crever : périr (animal) - (57) |
| crevi : Couvrir. « Eune maijan (maison) crevie en lâves (pierres plates) ». « Le temps se creve », le ciel se couvre de nuages. - (19) |
| creville : salade sauvage. - (09) |
| crevouai (on) : crevasse (gerçure) - (57) |
| crevouai (on) : gerçure (crevasse) - (57) |
| crevoux : Couvreur. « Y a des gottères su le cova de la grange i faudra fare veni le crevou », il y a des trous dans la toiture de la grange, il faudra faire venir le couvreur. - (19) |
| crèyance, croyance. - (14) |
| créyôle : crédule. - (33) |
| créyôle, crédule. - (16) |
| creyu, part, de croire : « Vrâ ! j'I'aurô pas créyu. » - (14) |
| cri - chercher (pour amener, pour prendre), c'est le vieux mot querir. - Al â venu cri ses petiots, en i é aipruchant ine heure. - En fau ailai cri une voiture de luzerne. - (18) |
| crî (ain) : (un) cric - (37) |
| cri (altération et contraction de quérir). v. a. Chercher. Va vite cri l’médecingne, mon pouv’ enfant. Du latin quœrere. - (10) |
| crî (v. tr.) : quérir (aller crî (aller chercher)) - (64) |
| cri, v. quérir, aller chercher. - (38) |
| cri. Altération contractée du verbe quérir, chercher : « Va cri ton pa', la vache a va fai'e viau ! » - (42) |
| cri. Cris. - (01) |
| criai. Crier. - (01) |
| criarde : s. f., robe ou jupe de dessus, distincte du « cotillon » qui est le jupon ou jupe de dessous. - (20) |
| crib’illeures (des) : criblures (déchets de graines) - (57) |
| crib'lle (crib'ille) : Crible. « Passer du blié au crib'lle », cribler du blé. - (19) |
| crib'lleures : Criblures, mauvais grain qui tombe du crible. - (19) |
| cri-cri : 1. grillon du foyer ou des champs ; 2. manège où ne tournent que des balançoires. - (52) |
| cricri : grillon - (48) |
| cri-cri : grillon - (39) |
| cri-cri : s. m., nom donné à différentes espèces d'insectes bruisseurs, notamment au grillon et à l'ephippigère de la vigne. - (20) |
| cricri, s.m., grillon du foyer. - (40) |
| cricri, subst. masculin : grillon. - (54) |
| crié, v, a. appeler : j'ai crié Jean, il vient. - (22) |
| c'rie. n. f. - Cerise. - (42) |
| criein. Criaient. - (01) |
| crier - crire (?) : chercher. Rapporter. Ex : "Eh ! Pétit ! Vas don m'crie un siau y'au !" (Sous-entendu : au puits) - (58) |
| crier : v. a., vx fr., appeler. - (20) |
| crier, v. a. appeler : j'ai crié jean, il vient. - (24) |
| criî v. Crier. - (63) |
| crîlé (adj.) : se dit d'un tissu rendu clair par l'usure, et sur le point de se trouer - (64) |
| crile (n.m.) : crible - (50) |
| crile, s. m. crible. « Crile » pour crible. - (08) |
| crîle. s. m. Crible. - (10) |
| criler, v. a. cribler, passer au crible. - (08) |
| crîler. v. a. Cribler. - (10) |
| crime, action criminelle ; mais, à Nuits, crime n'a pas toujours cette signification ; par exemple, on veut boire d'un vin délicieux, mais encore nouveau ; comme on croit que ce vin sera meilleur, quand il aura plus d'âge, on dit que le boire jeune est un crime, c'est-à-dire, un acte déraisonnable ; ainsi encore, que briser une jolie pièce de confiserie est un crime. - (16) |
| crincer. v. a. Cribler, nettoyer du blé, le passer au tarare, le vanner. - (10) |
| crinces (n. f. pl.) : grains cassés ou trop petits que la batteuse rejette séparément - (64) |
| crinces : mauvaises graines tombant des céréales après battage - (39) |
| crinces. n. f. pl. - Résidus de graines et de grains divers, le passage au trieur. Synonyme de autons. Au XIIe siècle, crincer signifiait tamiser. - (42) |
| crinces. s. m. pl. Poils et barbes des épis d’orge et des céréales de même espèce. — Par extension, grenailles et issues séparées des grains par le vannage. — Du latin crinis , faisant au pluriel crines. — Voyez crainces, qui nous semble être le même mot. - (10) |
| crinchener : rendre (être rendu) rugueux au toucher. - (56) |
| crinchi, adj. (fruit) ridé, ratatiné, desséché. - (38) |
| crincir : voir clancir. - (20) |
| cringée, crignère, crignée. n. f. - Crinière. - (42) |
| cringniée. s. f. Crinière. - (10) |
| criniére (na) : crinière - (57) |
| crin-me (d’la) : crème - (57) |
| crin-me : crème - (43) |
| crinme n.f. Crême. - (63) |
| crin-me : s. f. crème. - (21) |
| crin-me. Crème. - (49) |
| crin-m'rie (na) : crêmerie - (57) |
| crinquailler. s. m. Quincaillier. (Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes). - (10) |
| crinse : brin d'herbe sèche (celt. Krin : sec). - (32) |
| crinses (n.f.pl.) : déchet des grains après le vannage - ex. : "panner l’gueurné et dôter les crinses" (de Chambure) - (50) |
| crinses : déchets après vannage du grain, grenaille - (48) |
| crinses : déchets de grains après le vannage. - (33) |
| crinses : (crin:s’ - subst. f. pl.) saletés mêlées au grain avant qu'il ne soit vanné. - (45) |
| crinses, mauvaises graines mêlées au froment, espèce de cangrène, comme l'ivraie pour le froment... - (02) |
| crinses, s. f. plur. déchet des grains après le vannage. Ne s'emploie qu'au pluriel. - (08) |
| crinses. : Mauvaises graines mêlées au froment. Le mot latin incretum signifie qui n'a point passé au tamis. (Quich.) - (06) |
| crinshî : fripé. « Un’ne poume crinshie » : une pomme sèche, fripée. - (62) |
| crins'nalè (éte) : transi (de froid) - (48) |
| crinsnaler : (crin:snalè - v. intr.) « trembler de tous ses membres ». - (45) |
| crinssi, v. a. jaunir superficiellement une étoffe par début de brûlure. - (22) |
| crinssi, v. a. jaunir superficiellement une étoffe par début de brûlure. - (24) |
| crintance (n.f.) : mauvais grain que l'on met à part en criblant les céréales. - (50) |
| crintance : mauvaise graine, chose inutile, peut être utilisé comme insulte - (39) |
| crintanse, s. f. mauvais grain qu'on met à part en criblant les céréales. - (08) |
| crinze (f), coquille d'œuf. - (26) |
| criquet. : Un petit cheval, et, par extension, une personne de petite taille. - (06) |
| çrise n.f. Cerise. - (63) |
| çrisi : cerisier - (51) |
| çrîsî n.m. Cerisier. - (63) |
| crispine, grispine : s. f., personne nerveuse, rageuse. - (20) |
| cristau : Carbonate de soude du commerce. « Mentre du cristau dans la beûe ». - (19) |
| cristau : s. m., carbonate de soude. Du cristau (pour du cristal). La blanchisseuse y a tellement mis du cristau, qu'elle a toutes brûlé mes chemises. - (20) |
| cristau, subst. masculin singulier : des cristaux de soude. - (54) |
| cristau. Potasse. - (49) |
| cristille, gristille : s. f., croustille (petit repas). Casser une cristille. Payer une cristille. - (20) |
| crô : mare. A - B - (41) |
| crô (n. m.) : pomme sauvage - (64) |
| crô : corbeau. - (62) |
| cro : faire le cro, c'est faire un double sillon dans un champ afin de le drainer - (46) |
| cro de tsé : contenu de l'intérieur des daraises - (43) |
| cro, (ö), sf. croix. - (17) |
| cro, creux. On disait aussi jadis, cro, pour croix; un finage de Nuits se nomme Crovitre, pour : la croix d'un propriétaire appelé Vitre. - (16) |
| crô, s. m. creux, trou, fosse, souterrain, cave. - (08) |
| crô, s. m., trou plein d'eau sur la route. - (40) |
| crô. Creux à enterrer un mort, fossé et généralement un creux… - (01) |
| cro. Trou, creux plein d'eau, petite mare. Le « cro de bonde » est un petit réservoir a la bonde d’un étang. - (49) |
| croa. : Corbeau. Onomatopée. - (06) |
| croâche, s. f., crèche. - (40) |
| croai : croix - (61) |
| croc (nom masculin) : mare. Petit trou d'eau où barbotent les canards. - (47) |
| croc : bâton ferré en crochet. - (09) |
| croc n.m. Grappin. - (63) |
| croç’et (ain) : (un) crochet - (37) |
| crochale : morceau de bois noueux - (51) |
| crochalou : noueux - (51) |
| crochat : s. m. crochet. - (21) |
| crôche : crèche, mangeoire. « Tor’ne jamâs l’cul à la crôche ! » : ne méprise jamais ce qui t’est offert ! On y sous-entend la valeur de la nourriture….et le besoin qu’on risque d’en avoir. - (62) |
| croche : s. f., vx fr., crochet à peser, romaine. - (20) |
| croche, crotse. Poule couveuse, cloqueuse, qui a des petits poulets. - (49) |
| croche, sf. crèche. - (17) |
| croche-pi (on) : croche-pied - croque-en-jambe - (57) |
| croche-pied. s. m. Croc-en-Jambe. - (10) |
| crocher, v. tr., agrafer : « Croche me donc ma broche ; j'peus pas en v'ni à bout. » - (14) |
| crochet : tisonnier - (48) |
| crochet, s. m. fourchette de l'estomac, brechet. - (08) |
| crochet, s. m., appendice xiphoïde. - (40) |
| crocheter, v. a. travailler la terre en la binant, en piochant avec soin autour des plantes. - (08) |
| crochot (on) : crochet - (57) |
| crochot : crochet. - (62) |
| crochot, s. m., crochet, objet recourbé. - (14) |
| crocornille. s. m. Bleuet. (Etivey). - (10) |
| crôdiau, s. m. creux rempli d'eau, petite mare. De « crô », trou, et « iau » pour eau. Les deux mots sont soudés par un son guttural qui donnerait à peu près « crô-gdiau. » Morvan nivernais. - (08) |
| croè, croix. On appelait, jadis, croè d'par Dieu la croix qu'on imprimait en tète de l'alphabet et l'alphabet lui-même… - (16) |
| crœpœgnon, s. m. partie du dos correspondant aux reins : avoir mal au crepegnon. - (24) |
| crœpœgnon, s. m. partie du dos correspondant aux reins. - (22) |
| croesson, couesson. s. m. Creux à la base de l’occiput. (Courgis, Diges). - (10) |
| crœte, s, f. crasse. Adjectif : crœroeu. - (22) |
| crœte, s. f. crasse. adj. crœtou, crasseux. Avare. - (24) |
| crognon, croûgnon. s. m. Quignon de pain, croûton. Le crognon est un morceau de choix. Le croûgnon du pain bénit s’offre à la personne qui doit le rendre à la grand’messe du dimanche suivant. - (10) |
| croi. Croix, crux ou cruces : c'est aussi le singulier des trois personnes de croire au présent de l'indicatif et croi à l'impératif. - (01) |
| croiche, crouéche, s. f. crèche d'une étable ou d'une écurie, mangeoire, c’est-à-dire l'espèce d'auge qui se trouve sous le râtelier. - (08) |
| croiche. s. f. Aire, fumier, tire-fient. (Bléneau). - (10) |
| croicher, v. cracher. - (38) |
| croichie, crouéchie, s. f. ensemble, série de crèches pour le bétail. Il y a une belle longueur de « croichies » dans cette étable. - (08) |
| croichot - crachat et crochet. - A croiche bein souvent i ne sai pâ ce qui veut dire ; et pu ses croichots en ié queman du san dedan. - En fau désarrai les croichots de ton corset en voit que ci te pince trop fort. - (18) |
| croicifix. n. m. - Crucifix. Autre sens : grande souffrance. « La poure femme, ded'pis qu'son houmme est parti, alle ben des croicifix. » - (42) |
| croicifix. s. m. Crucifix ; grandes peines, croix, tourment. Le pouv’ cher houme, il a ben des peines, des croicifix. (Puysaie). - (10) |
| croicignier. v. - Crucifier. - (42) |
| croicinier. v. a. Crucifier, tourmenter, causer des peines. (Puysaie). - (10) |
| croillan : Cerneau, moitié d'une noix fraîche extraite de sa coque. Partie de la noix dont on extrait l'huile. « In sa (sac) de croillans ». - (19) |
| croïlli: Extraire les noix de leur coque. « Je me sus nargi (noirci) les mains en croïllant des calas ». - (19) |
| croinchie : dépôt d'huile dans le fond de la toule, lie de vin dans le fond du fût. O y é de la croinchie dans le fond : il y a du dépôt au fond. - (33) |
| croindre, v. a. craindre, avoir delà crainte. - (08) |
| croinre (v.t.) : craindre - (50) |
| croint (-e) (p.p.) : participe passé du verbe craindre - (50) |
| crointe (n.f.) : crainte - (50) |
| crointe (n.m.) : crainte - (50) |
| crointe, s. f. crainte, peur : « a fau beiller lai crointe ai sè-z-ann'mis », il faut se faire craindre de ses ennemis. - (08) |
| crointif, adj. timide, honteux, qui manque d'énergie, qui prend peur. Un enfant « crointif » est un enfant timide. - (08) |
| croire de : voir de. - (20) |
| croire. : (Du latin crescere), ajouter. Croire les denrées, augmenter le prix des denrées. – Ce mot signifiait aussi faire crédit. (Franchises de Pontailler, 1257.) - (06) |
| croisée : fenêtre - (44) |
| croisée : fenêtre. - (62) |
| croisée n.f. Fenêtre. - (63) |
| croisée - crouésée : fenêtre. Plus utilisé que f'néte (= fenêtre). - (58) |
| croisée : s. f. croisée. - (21) |
| croisée, fenêtre. - (26) |
| croisée, n.f. fenêtre. - (65) |
| croisée, s. f., châssis de fenêtre en bois. - (40) |
| croisette : croix bénies. VI, p. 44 - (23) |
| croisie (nom féminin) : fenêtre. - (47) |
| croisie : fenêtre (on dit aussi : crouairie), croisée. Quand o fait frè on frome les croisies : quand il fait froid on ferme les fenêtres. - (33) |
| croisie, crouésie, s. f. croisée, fenêtre de maison. - (08) |
| croison : s. m., vx fr., croisillon, traverse de la croix. - (20) |
| croissant (nom masculin) : sorte de serpe à long manche dont on se sert pour élaguer les haies. - (47) |
| croissant : faucille à long manche - (61) |
| croissant : s. m., petite faucille â long manche, qui sert à tailler les buissons. - (20) |
| croîte v. Croître. p.p. crétsu. - (63) |
| croix de par dieu : loc., vx fr. croison. Désignait autrefois les alphabets mis entre les mains des enfants, parce que sur leur couverture était figurée la croix. « L'oncle Pamphile avait parmi ses livres un vieil alphabet. C'était une « croix de par Dieu », c'est-à-dire qu'à la première ligne de la première page la lettre A était précédée d'une croix pour rappeler à l'enfant qu'avant de lire il devait déjà commencer par se signer et par donner dévotement une pensée à Dieu. » (J. Nesmy, Pour marier Colette). - (20) |
| croix de part dieu, s.f. alphabet. - (38) |
| croix de per Dieu - ainsi autrefois nous appelions l'alphabet des petits enfants parce que, au commencement, était marquée une croix, et qu'avant toute leçon on faisait faire à l'enfant le signe de la croix. - Voiqui l'école que seune, emporte tai Croix de per Dieu. - Main mère, i ai perdu ma Croix de per Dieu, et pu mossieu le maître a m'é mis en pénitence. - (18) |
| croix de Saint-Serniberna. Arc-en-ciel. - (49) |
| croi'yôle : crédule, qui croit - (48) |
| crokèchi : v. glousser. - (21) |
| crôlai - remuer, secouer. - Les peurnes sont meûres, en fau ailai les crôlai. - I ai deux dents que crôlant, i irai demain les fâre airoichai. - (18) |
| crôlai. :S'emploie comme verbe actif et comme verbe neutre. Trembler de la tête ou des mains, c'est l'accaption du neutre. On dit en efTet, en Franche-Comté, crolai de la tête et grûlai des mains. (Tiss.) Crôlai un arbre pour en faire tomber les fruits, c'est l'acception de l'actif.- D'après Dufouilloux, crouler la queue (remuer la queue), se dit du cerf quand il fuit. - (06) |
| crolé (ö), vt. n. secouer, agiter. Trembler. - (17) |
| crôlé : secouer fortement. (RDT. T III) - B - (25) |
| crôle-cuyotte (un) : sobriquet du tisserand. (V. T IV) - A - (25) |
| crôler : trembler. - (66) |
| crôler : (crô:lè - v. trans.) secouer, gauler. - (45) |
| crôler, v. a. crouler, secouer, ébranler par secousses. On « croie » un arbre pour faire tomber les fruits ; on « croie » un mur miné pour en précipiter la chute ; on « croie » la tête pour faire un signe, etc - (08) |
| crôler. v. - Crisser. (Mézilles, selon H. Chéry) - (42) |
| crôler. v. tr., agiter, remuer, secouer un arbre pour en faire tomber les fruits : « On a crôlé l’peùrnei. » - (14) |
| crôlis. n. m. - Crissement. (Mézilles, selon H. Chéry) - (42) |
| croller, croûler, remuer, ébranler. - (04) |
| crömai : se dit d'un humain ou d'un bête qui ne mange pas parce qu'il attend sa nourriture. Se dit aussi d'un animal ou d'un végétal qui ne profite pas, qui ne grossit pas. - (33) |
| cromale, n. genre non précisé (masc. sans doute) ; var. crolame ; crémaillère. - (07) |
| crome (fére lai) : être abattu, malade - (39) |
| cromer : végéter - (48) |
| crômer, v. ; se dit des bêtes qui se reposent au pâturage sans manger ; a fait trop chaud ; nous vaiches croment. - (07) |
| cromer, v. n. souffrir, pâtir, languir. Se dit des personnes et des choses. Un petit enfant maladif « crome » comme un semis de blé dans la terre. - (08) |
| cromiare. s. f. Mare. De crot (creux, trou) et mare, amas d’eau dans une excavation, dans un trou. (Arcy-sur-Cure). - (10) |
| crompire, s. f., pomme de terre. - (14) |
| crôpaie : crêpe au lard - (48) |
| crôpais : voir crâpiau - (23) |
| crôpe - crêpe. - Regardez don ce poulot, lai jolie crôpe qu'al é ! - Vos poules al ant lai crôpe joliment fraîche ; c'â qu'à sont bien neûries. - (18) |
| crôpe (n.f.) : crête - (50) |
| crôpe : (nf) sorte de pissenlit à larges feuilles - (35) |
| crôpe : a) Crête. « Ce poulet a eune balle crôpe », ce poulet a une belle crête. - b) Pissenlit (taraxacum dens leonis) « Eune salade de crôpe » (sans s car on dit de la crôpe et non des crôpes). - (19) |
| crôpe de poulot, s.f. crête de coq. - (38) |
| crôpe n.f. (de croupe). Crête du coq ou de la poule. - (63) |
| crôpe : (crô:p’ - subst. f.) crête du coq ; au figuré, clitoris. - (45) |
| crôpe : crête - (39) |
| crôpe : s. f. pissenlit, dent de lion. - (21) |
| crôpe, « L » copeaux produits par le rabot, crispus, frisé, (Cropi, sobriquet). - (04) |
| cropé, ée. adj. Bien habillé. (Bussy-en-Othe). - (10) |
| crôpe, n.f. nom de divers plantes (chicorée sauvage, pissenlit). - (65) |
| crôpe, s. f. crête de coq. Crête fait allusion à l'excroissance charnue qui orne la tête des gallinacés, tandis que « crôpe » pour crêpe s'applique à la frisure ou à la dentelure de la crête de l'oiseau. - (08) |
| crôpe, s.f. pissenlit. - (38) |
| crôpe. s. f. Ecorce de bois ; copeau de tonnelier, de cerclier ; copeau d’une certaine dimension, en général. - (10) |
| crôpeai, s. m. crêpe, galette très mince qui se fait avec des œufs et de la farine. - (08) |
| crôper (le chignon) : se battre, prendre par les cheveux - (48) |
| crôper : acte sexuel du coq - (48) |
| crôper : côcher, couvrir la femelle en parlant des oiseaux et parfois de l'homme - (48) |
| crôper : côcher. Couvrir la femelle en parlant d’un oiseau. Du latin calcare et de l’ancien français caucher : presser. - (62) |
| crôper : Crêper. « Te va te fare crôper le chignan ». - (19) |
| crôper v. (de croupe). Couvrir la poule (et pas seulement), côcher. - (63) |
| crôper : acte sexuel du coq - (39) |
| croper : v. a., vx fr., monter sur la croupe (se dit surtout de l'accouplement des oiseaux). Se croper, s'accroupir. - (20) |
| croper, monter sur le croupion. - (05) |
| crôper, v. a. cocher. Se dit des volailles et en général des oiseaux qui s'accouplent : « l' poulot é crôpé mai poule. » - (08) |
| crôper, v., côcher, saillir, baiser. - (40) |
| croper. Se dit du coq qui couvre la poule. - (03) |
| crôpes n.m.pl. Pissenlits. Ce nom vient de la forme dentelée des feuilles, semblables à la crête des coqs. - (63) |
| cropeton (ai) - accroupi, bien baissé. - A se met ai cropeton pou traiveiller ; ne m'en paile pâ, cequi indique in pôre ovré. - I nô sons mis ai cropeton derré l'aie vive pendant le gairôt. - (18) |
| cröpetons (ai), loc. [a croupetons]. accroupi. - (17) |
| cropi. Cropie. Gelé superficiellement. An ai fait bin froid lai neut : lai tarre ast un p'chot cropie. - (13) |
| cropiau. s. m. Copeau. (Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes). - (10) |
| cropiller : froisser - (61) |
| cropton (à) : accroupi. - (30) |
| croptons (à) loc. (du francipe kruppa, croupe. V. fr. croper : s'accroupir.) A croupetons. - (63) |
| croquant (du) : (du) cartilage - (37) |
| croque : poule couveuse (en B : grouèche) A - (41) |
| croque (na) - mére-croque (na) : poule (qui couve ou est suivie par ses poussins) - (57) |
| croque- aivoigne, loc. croque-avoine, celui qui sert d'entremetteur pour un mariage, qui fait les premières démarches auprès des parents de la jeune fille. - (08) |
| croque avouene : celui qui accompagne un jeune homme fréquentant une jeune fille pour les premières visites dans la famille de celle-ci. - (33) |
| croque, s. f. mauvais rhume : attraper une croque. - (24) |
| croque-aivouègne : marieur, personne accompagnant le futur marié lors de la première rencontre - (48) |
| croque-avouène : marieur traditionnel - (39) |
| croquenau. Vieux soulier. Mot très employé. Pas particulier a Montceau. (Argot). - (49) |
| croquet (on) - croquignolle (on) : gâteau sec (petit) - (57) |
| croquet, gâteau sec. - (26) |
| croquignole : beignet - (48) |
| crore (ö), vt. croire. - (17) |
| cros, « L » crotot, trou, creux de la nuque, de crota (antrum, specus), d'où grotte ou crotte, crypte. - (04) |
| crôs. n. m. - Pomme sauvage. - (42) |
| cros. s. f. Pomme sauvage. - (10) |
| cröse, sf. coquille d'œuf. - (17) |
| crôsier (n. m.) : pommier sauvage - (64) |
| crosier. n. m. - Pommier sauvage. - (42) |
| crosier. s. m. Pommier sauvage. Synonyme d’aigrasseau. - (10) |
| crosse : grande pointe, mangeoire - (37) |
| crosse n.f. Gros clou. - (63) |
| crosse : n. m. Clou, pointe de charpentier. - (53) |
| crosse, béquille. - (16) |
| crösse, sf. crosse. - (17) |
| crosser, v. tr., malmener, maltraiter. - (14) |
| crot (n. m.) : mare - (64) |
| crot (n.m.) : creux, trou : petite mare - (50) |
| crôt : (nm) trou d’eau, petite mare - (35) |
| crot : mare - (44) |
| crot : mare, trou plein d'eau - (48) |
| crot : mare, trou. - (32) |
| crot : mare. Du gaulois klotton : creux. - (62) |
| crot : trou d’eau, lavoir - (37) |
| crôt : trou d'eau, petite mare - (43) |
| crot : trou d'eau. Ill, p. 32 - (23) |
| crot : trou, mare - (60) |
| crot : trou. - (09) |
| crot : mare. Yé des gueurnouilles dans le crot : Il y a des grenouilles dans la mare. - (33) |
| crôt n.m. (anc. fr. crot désignant un trou, un creux, une grotte) Mare, creux d'eau. Le verbe encrotter, enterrer, dérive de ce mot. - (63) |
| crot : (cro - subst. m.) 1 - dans un pré, petite mare où s'abreuvent les animaux. 2· (désuet) fosse où l'on enterre un mort. - (45) |
| crot : mare, en général assez vaste. Ex : "Pour aller ché Robére, tu prends à drouètte, au croc d'Chamery." - (58) |
| crot : s. m., vx fr., creux. Tout le monde connaît le lieudit le Crot du Charnier, à Solutré. - (20) |
| crot : trou d'eau, petite mare - (39) |
| crôt, beté : n. m. Creux. - (53) |
| crot, creux, trou, fosse. - (05) |
| crot, crou. n. m. - Petite mare, trou d'eau. Mot déjà usité au XIIe siècle (issu du latin crypta), avec le sens de grotte, avant celui de creux dans la terre. - (42) |
| crot, crou. s. m. Trou, fosse, mare où l’on abreuve les bestiaux. A Pasilly, on meune boire les vèches au crou. - (10) |
| crot, n. masc. ; creux. - (07) |
| crôt, s. m. trou creusé dans le terrain ; creux rempli d'eau. Verbe encroter, enfouir en terre. - (24) |
| crot, s. m., creus, trou, fosse : « J't'l'ai fichu dans l’crot. » - (14) |
| crot, s.m. creux, mare. - (38) |
| crot, subst. masculin : mare. - (54) |
| crot. Creux, trou, du bas latin crotum. Il existe à Mervans un étang des Crots et un bois des grands Crots. - (03) |
| crôte : crête (volaille) - (48) |
| crôte : Croûte. « Ce pain a la crôte bien deure ». « Casser la crôte », manger un morceau, casser une croûte. - (19) |
| crôte du pouilleau (lai) : (la) crête du coq - (37) |
| crôte : n. f. Croûte - (53) |
| crôte, croûte ; crôte de pèn. Crùte se dit aussi pour le corps dur qui se forme sur une plaie en voie de guêrison. - (16) |
| crôte, s. f., croûte. Les enfants emploient entre eus ce mot comme terme d'amitié. - (14) |
| cröte, sf. crotte. Petite fille malpropre ou mal élevée. - (17) |
| croteau. s. m. Petite fosse, petite mare, petit trou. Diminutif de crot. - (10) |
| crotin (sans doute pour crétin). s. m. Berger. (Coulours). - (10) |
| crôtô (prononcez creuteu), creux de la nuque. Diminutif de crô, creux, comme si l'on disait petit creux. - (02) |
| croto, creux entre la tète et le cou. - (16) |
| crôtô. : (Prononcez creuteu), creux de la nuque derrière la tête (Del.) ; diminutif de crô, creux. - (06) |
| crôton : croûton - (39) |
| crôton : quignon (de pain) - (39) |
| cròton, s. m., crotte, crotin, boue sèche. - (14) |
| crotot - la nuque, le petit creux derrière le cou. - A m'é beillé in co pour derré, que ci me fait vraiment mau à crotot. - Ile é bein maigri, si vô lai viains ; an voit son pôre crotot to nu. - (18) |
| cròtot, s. m., creux de la nuque. Dim. de crot. - (14) |
| crotot. Petit creux, spécialement : celui qui est à la base de l'occiput. - (13) |
| crotou - qui a la figure ridée, rugueuse par suite de la petite vérole ; tout ce qui est chargé de durillons, comme fruits, etc. - Que le colas â don crotou ! al é aivu lai vérole queman qu'en faut. - C't année les fruts sont to crotou. - (18) |
| crotou, adj., boueux, crotté, barbouillé. Se dit des personnes et des choses salies dans la boue, mais surtout des vaches et des moutons qui ont ramassé aux jambes et au train de derrière une couche granuleuse de crottes en se couchant dans l’étable. Les paysans leur laissent complaisamment cette couche comme preuve d'une bonne litière !... - (14) |
| crotou, ouse, adj. barbouillé, sali, souillé, couvert d'ordure. - (08) |
| crotou. Marqué de la petite vérole. - (13) |
| crotse : (nf) peson - (35) |
| crotse : balance romaine - (43) |
| crotse : peson, balance romaine - (43) |
| crotsot n.m. 1. Crochet. 2. Petite balance romaine. - (63) |
| crotte : s. f. monticule. - (21) |
| crotte : s. f., vx fr-, grand creux, carrière. On désigne, à Lacrost, les carrières blanches et les carrières rouges par les noms de les Crottes blanches et les Crottes rouges. - (20) |
| crotter (v. tr.) : creuser - (64) |
| crotter. v. a. et n. Fouiller la terre, faire une fosse, un crot. — Crotter un puits , le creuser. - (10) |
| crottes - petites poires des bois que l'on fait sécher. – Des poires crottes ç'â bon ; et pu en beille cequi es enfants qui les eûmant bein. - I ons fait, ceute année, to par les bô ine provision de poires crottes ; ci fait encore plâilli l'hiver. - (18) |
| cròttò ou Crottòt (C.-d., Y.). - Occiput, creux de la nuque, diminutif de crot ou crou (creu, trou, par extension mare). - (15) |
| crottot. s. m. Nuque. (Pcrcey). — Voir croteau. - (10) |
| crottou. s. m. Petit garçon sale crotté, déguenillé. (Etivey). - (10) |
| crottoux, adjectif qualificatif : crotté, couvert de boue. - (54) |
| crottoux, crottouse, cretoux, cretouse : adj., crotté ; avare. - (20) |
| crou. s. m. Mare. — Voyez crot. - (10) |
| crouâ, s.f. craie. - (38) |
| crouaiché : v. t. Cracher. - (53) |
| crouair' : v. t. Croire. - (53) |
| crouaîs’ment (on) : croisement - (57) |
| crouaîsé (on) : croisé - (57) |
| crouaisè : v. t. Croiser. - (53) |
| crouaîsée (na) : croisée - (57) |
| crouaisée : n. f. Croisée. - (53) |
| crouaisée, croisie (n.f.) : fenêtre - (50) |
| crouaîser : croiser - (57) |
| crouaîsiére (na) : croisière - (57) |
| crouaissant (on) : croissant - (57) |
| crouaîx (na) : croix - (57) |
| crouaix de par Dieu (n.f.) : alphabet des enfants (une croix est placée en tête du livre) - (50) |
| crouchou, s. m., chanteau, morceau de pain bénit que l'on portait à la famille qui devait le fournir la semaine suivante. - (40) |
| crouè : s. f. croix. - (21) |
| croué, s. f. croix. - (08) |
| croué. n. f. - Croix. - (42) |
| crouèche (nom féminin) : crèche. - (47) |
| crouèche : crèche - (48) |
| crouèche : (crouèch' - subst. f.) crèche, mangeoire des bovins dans l'étable, que surplombe le râtelier. - (45) |
| crouée : croix - (48) |
| crouée : croix. - (33) |
| crouée : (croué: - subst. f.) croix. Il y en avait à peu près à tous les carrefoursen bordure des champs, au centre des hameaux,témoignade l'époque où la pratique des Rogations était encore vivante.On a pu dire que leur espacement correspondait aux relais observés par ceux qui portaient les cercueils sur une civière jusqu'à l'église, en des temps anciens. - (45) |
| crouée : n. f. Croix. - (53) |
| crouée. s. f. Coquille. — Crouée de queca , coquille de noix sèche. Du latin curva , chose creuse. (Diges). - (10) |
| crouée. s. f. Craie. (Plessis-du-Mée). - (10) |
| crouée. s. f. Croix. - (10) |
| crouère : croire - (48) |
| crouère. v. - Croire. - (42) |
| crouèsée : fenêtre (croisée). - (52) |
| crouèsée. n. f. - Croisée, fenêtre. - (42) |
| crouèser : croiser. - (52) |
| crouésie : fenêtre, petite fenêtre - (48) |
| crouèsie : fenêtre - (39) |
| crouéyu (p.p.) : p.p. du verbe croire - (50) |
| crouéyu, part, passé du verbe croire. Cru. - (08) |
| crougai : croiser (aussi : franchir). On s'o crougé à la Roche Coupée : on s'est croisée à la Roche Coupée. - (33) |
| crougeon : morceau de pain - (34) |
| crougeottes : petites croix (50 cm) en noisetier bénies à la messe le 1er dimanche de mai et plantées dans les champs de céréales pour demander une bonne récolte. - (33) |
| crougnion (un) : une croûte de pain - (61) |
| croûgnon (n. m.) : croûton de pain - (64) |
| crougnon : croûte de pain (crouton) - (60) |
| croûgnon : extrémité d’un pain long - (37) |
| crougnon : part de croûte de pain. - (09) |
| crougnon, s. m. croûton de pain coupé sur la tourte, morceau détaché sur la circonférence. - (08) |
| crougnon. n. m. - Croûton. - (42) |
| croûgnon. s. m. Croûton. Un croûton de pain. - (10) |
| crouher, v. a. croiser. - (08) |
| crouiller, corrailler, corayer : v. a., vx fr. coroillier, écraser, broyer. Corrailler le beurre, le presser pour en exprimer l’eau et le lait. - (20) |
| crouiller, v., faire des trous dans un champ. - (40) |
| crouiller, verbe transitif : creuser à la main. - (54) |
| crouilli : v. creuser des noix, des sabots. - (21) |
| crouillis, creux, mare. - (05) |
| crouillon : s. m. copeaux du sabotier quand il creuse les sabots. - (21) |
| croûillote (lai) : (la) croisette, ferme proche de saint léger-de-fougeret - (37) |
| croûillotte (aine) : (une) petite croix que l’on emportait sur soi en pèlerinage - (37) |
| crouillotte : (crou:yot' - subst. f. ) : croisette. D'après Chambure,les croujottes sont de petites croix bénies le premier dimanchede mai, et qu'on place dans les champs ensemencés pour leur apporter la fécondité. A Liernais, le terme ne subsiste plus actuellement qu'en topoymie : lè crou:yot' est le nom d'un carrefour entre les routes de Liernais, Brazey, Baroillier-laBorde et le chemin de Champeau sur l'ancienne voie d'Agrippa. croinde : (crouin:d’ – v. trans.) craindre. - (45) |
| croûillotte, croûjotte : petite croix - (48) |
| crouillottes : petites croix de bois que l'on mettait dans les champs aux Rogations - (39) |
| crouinde : craindre - (48) |
| croujotte, s. f. petite croix bénite le jour de l'invention de la sainte croix et qu'on plante dans les chenevières ou dans les champs ensemencés. Le premier dimanche de mai est souvent appelé le dimanche des croisettes ou plutôt des « croujottes, croïottes, crouiottes. » - (08) |
| croulailler : v. a., fréquentatif de crouler. A force de croulailler c'bouchon, j’ finirai ben par l'avoir. - (20) |
| croulé (un arbre), v. a. le secouer pour en faire tomber les fruits. - (22) |
| croule : (crô:l' - subst. m.) allure la plus lente du cheval (encore plus lente que le pas : il s'agit proprement de l'ébranlement.) â: crô:l' : "au croule", c-à-d très lentement. - (45) |
| croule. s. f. Chasse à la bécasse. (Sainpuits). - (10) |
| croulement. s. m. Action de trembler, de frissonner. - (10) |
| crouler (un arbre), v. a. le secouer pour en faire tomber les fruits. - (24) |
| crouler (Y.), grouler (Chal., Br., Char.), grôler (C.-d.), crôler (Morv.). - Remuer, agiter, mouvoir ; secouer, par exemple, un arbre, pour en faire tomber les fruits (grouler les noix, les pommes) ; se dit aussi, par extension, pour trembler, frissonner. Du vieux français croller, crôler, venant du bas latin co-rotulare (rouler avec). Le mot crouler avec cette origine, mais portant la signification de s'effondrer, de s'affaisser avec fracas, se trouve dans Littré. C'est plutôt alors la signification du verbe s'écrouler. - (15) |
| crouler : bercer. - (32) |
| croûler :secouer - (48) |
| croûler : secouer - (39) |
| croûler, groûler (v.t.) : 1) faire tomber les fruits d'un arbre en le secouant (pour de Chambure : crôler) - 2) secouer fortement (du lat. pop.: corrotulare = faire rouler, a.fr. croller = remuer (aussi groûler) - (50) |
| croûler, groûler v. Secouer (un arbre), écrouler, ébranler, trembler. - (63) |
| crouler, grouler : v. a., vx fr. crouler. Secouer, ébranler, trembler. Crouler des noix. - (20) |
| crouler, secouer, ébranler (écrouler). - (05) |
| croûler, v. secouer un arbre fruitier. - (65) |
| crouler. Secouer un arbre. - (03) |
| crouler. v. n. Trembler de froid ou par l’eftet d’une autre cause. - (10) |
| croullhi, v. a. croiser : « ile aivô croullhi lé bras », elle avait croisé les bras. - (08) |
| croulon. s. m. Frisson. (Plessis-Saint-Jean). - (10) |
| croumer : (croumè - v. intr.) se dit des chevaux au repos qui s'engourdisse ; puis, au figuré, des personne qui, par paresse de reprendre le travail, sombrent dans la torpeur des fins de repas. - (45) |
| croumi. adj. - Croupi. - (42) |
| croumi. adj. Croupi. (Moufly). - (10) |
| crôuni : être très fatigué - (39) |
| croupeton (à) et A grepton, loc, accroupi, à genoux et assis sur ses talons : « J'mé métu à croupeton por cuyer mes fraises. » — « Pou s'chaufer, ô s'met à croupeton d'vant l'feù. » - (14) |
| croupeton (se mettre à), c.-à-d. s'accroupir. A Lyon, l'on dit se mettre en graboton. - (02) |
| croupeton. : Se mettre à croupeton, c'est-àdire s'accroupir. A Lyon, on dit se mettre en graboton. - (06) |
| croupiller. v. - Chiffonner. (Mézilles, selon H. Chéry) - (42) |
| croupîre n.f. Croupière, longe de cuir attachée à la sellette ou au mantelet passant sur le dos et la croupe du cheval, terminée par une boucle appelée culeron. - (63) |
| croupton (adjectif) : (à) en position accroupie. - (47) |
| crouque, s. f. mauvais rhume. - (22) |
| croustiller (verbe) : manger peu, de petites choses. - (47) |
| crouston (faire sonner l’s). s. m. Croûton. Du latin crustum, d’où aussi croustiller. - (10) |
| crout, s. m. trou creusé dans le terrain ; creux rempli d'eau. Verbe : encrouté, enfouir en terre. - (22) |
| croute (croûte) : s. f. Etre aux croûtes de quelqu'un, être à sa charge. Voir pain. - (20) |
| croûte : dosse - (48) |
| croûte : s. f. croute. - (21) |
| croution, s. f., croûton : « Quand l'pauv' vieux qui va aux portes li dit qu'ôl a faim, áll' li beille eùn fameux croution. » - (14) |
| crouton (croûton) : s. m. prendre le croûton, prendre la suite de quelqu'un pour une chose plus ou moins désirable, plutôt moins que plus. Pour le pain bénit, on porte le croûton à la personne qui doit le donner le dimanche suivant. La première femme qui va voir une nouvelle accouchée prend le croûton et est sûre de devenir enceinte. C'est une mauvaise plaisanterie, quand on va mourir, de dire à un ami qu'on va lui passer le croûton. - (20) |
| croûton (prende le) loc. Prendre la suite de quelqu'un pour une chose plus ou moins agréable. La première femme qui rendait visite à l'accouchée prenait le croûton, elle était sûre de devenir rapidement enceinte. Les conscrits invitaient les sous-conscrits à manger le croûton, ce qui consistait en un repas très arrosé. Un moribond qui disait à un ami qu'il allait lui passer le croûton, lui disait en fait que ce serait lui le prochain. - (63) |
| croutonnier (croûtonnier) : s. m., amateur de casse-croûte. - (20) |
| croutson : (nm) croûton - (35) |
| croûtson : croûton des sous-conscrits - (43) |
| croutsonni : sous-conscrit ayant mangé le croûton - (43) |
| crouvi : couvert - (48) |
| crouvi : (crouvi - v. trans.) couvrir, recouvrir. - (45) |
| crouvi : couvrir - (39) |
| crouvi, v. a. couvrir, mettre une couverture, une toiture : « sai maîon ô crouvie », sa maison est couverte. - (08) |
| crouvou : couvreur - (39) |
| crouvoûe : couvreur - (48) |
| croûvri, creûvi. (p.p.) participe passé du verbe couvrir - (50) |
| croux, crozet : s. m., grouse, crouze, croze : s. f.. creux. Ces noms se retrouvent dans l'onomastique (lieux et familles) du déparlement de Saône-et-Loire. - (20) |
| croûyottes : voir croisettes - (23) |
| crouzô, s. m., petite lampe à huile en cuivre avec un crochet de suspension. - (40) |
| crox : mare (creux) - (51) |
| croyau : naïf - (43) |
| croyaule, crouéyaule, adj. crédule. « Crégaule. » - (08) |
| crô-yon, s.m. fruit de la noix, extrait de la coquille. - (38) |
| croyoo ou croyò. Croyais, croyait. - (01) |
| crôyotte (n.f.) : petite croix de bois que l'on piquait dans les champs pour rendre la récolte abondante (pour de Chambure : croujotte) - (50) |
| crû : coquille d'œuf. (RDM. T IV) - B - (25) |
| crucelle, oiseau du genre chouette, hibou, grand-duc, effraie, etc. - (27) |
| cruchan : Boule d'eau chaude. « Mentre in cruchan dans san lit pa se teni chaud es pids (pour se tenir chaud aux pieds) ». - Cresson de fontaine (sisymbrium nasturtium). - (19) |
| cruchi : Craquer, produire un bruit analogue à celui qui résulte de la mastication d'un cartilage. « Se fare cruchi les dents », grincer des dents. - (19) |
| cruchô, s. m., crochet. - (40) |
| cruchôle : Partie cartilagineuse de la viande cuite, ce qui craque sous la dent. - (19) |
| cruchon (nom masculin) : bouillotte. - (47) |
| cruchot : Crochet, croc, sorte de grapin attaché à une corde et dont on se sert pour retirer du puits un seau qu'on y a laissé tomber. - Peson, « J'ai manqué un biau lièvre, o pesait bin sat (sept) livres. - Te l'as pas pesé au cruchot ». - « Le cruchot de l'estomac », selon la croyance des bonnes femmes la plupart des maladies d'estomac sont dues à ce que l'on s'est « démangi le cruchot » (démi le crochet), crochet qui n'existe que dans leur imagination. - (19) |
| crucifié, faire souffrir quelqu'un, le fatiguer, l'ennuyer à l'excès, sans toutefois l'attacher à une croix. - (16) |
| crucifix : s, m. Faire un crucifix dans la neige, tomber les bras en croix dans la neige. - (20) |
| crue - coquille - Ces œufs qu'ant lai crue tendre, en an trouve tojeur des cassai. - Les gremais de pêche, c'â d'ine crue joliment dure et ci n'empouâche pâ de fâre d'aivou ine bonne liqueur - (on dit aussi creuse.) - (18) |
| crue d'eu : coquille d'œuf. (C. T III) - B - (25) |
| crue : (cru: - subst. f. pl.) coquille d'oeuf au figuré toute espèce de coquille (de noix, etc.) - (45) |
| crûe : n. f. Coquille d'œuf. - (53) |
| cruge : coquille (d'œuf, de noix, etc.). A - B - (41) |
| cruge : coquille d'œuf, de noix - (34) |
| cruge : Coquille. « Eune cruge d'û», une coquille d'œuf. « Eune cruge de calas », une coquille de noix. - (19) |
| cruge : gouge, outil de sabotier (cuillère). - (33) |
| cruge : n. f. Gouge, outil de sabotier. - (53) |
| cruge : s. f. coquille. - (21) |
| cruge. Coquille de noix, de noisette, d'œuf. - (49) |
| crûille : coquille - (48) |
| crûje n.f. (de creuse). Coquille d'œuf. - (63) |
| cruju : lampe à huile. A - B - (41) |
| cruju : lampe à huile - (34) |
| crûju n.m. (du vx.fr. croisel, croiseul). Lampe à huile (coupelle). - (63) |
| crûle. n. f. - Crasse épaisse : « Lave-toué don' les artaux ! Te parles d'une crûle ! » - (42) |
| crumé (se). : Courber. Se mettre en deux. - (06) |
| crumé, être en deux , n'avoir pas la force de se soutenir. Cette expression est usitée du côté de Bar-sur-Seine. - (02) |
| cruse : coquille d'œuf. - (30) |
| crusu, n.m. lampe à huile. - (65) |
| crutse n.f. Cruche. - (63) |
| crûtson, beurtsée : cruche - (43) |
| cruyèl, cruel ; sâ cruyel ! dit une mère, en parlant de la mort d'un des siens ; s'a cruyel de s'voé mômné eman s'ki ! c'est cruel de se voir ainsi malmener ! dit une femme, en parlant des mauvais traitements qu'elle endure. - (16) |
| cruyères. : (Dial.), cruel. - (06) |
| cruzeu : s. m. petite lampe à huile. On l'appelle en bien des villages aussi lampe à queue. - (21) |
| cruzu : lampe à huile - (51) |
| cruzùye, s. m. ancienne lampe à huile à crochet de suspension. - (24) |
| c't', c'te : adj. dém. Cet, cette. - (53) |
| c't'… (devant une voyelle) ; c'te... (devant une consonne) : cet, cette - C't'homme lai. - C't'ovré qui traiveille fort. - C'te fonne qui. - C'te flieur lai sent bon. - Voyez ceute ; et les c'tu.. ; c'tée qui suivent. - (18) |
| ç'tantoût - la sêrnia : tantôt (après-midi) - (57) |
| c'tchi : ceci - (39) |
| cté là : ceux là - (44) |
| c'te, c'té. adj. dém. - Cet, cette. - (42) |
| c'te, pr. démonstr., cette : « C’te foune ! » - (14) |
| c't'ella. pron. dém. - Celle-là. - (42) |
| c'téqui : pron. dém. Celui-là. - (53) |
| ç'téquite : pron. dém. Celle-ci. - (53) |
| c't'ici. pron. dém. - Celui-ci. - (42) |
| c'tit(e) : méchant(e), mauvais(e) - (39) |
| c'tu (pron. dém.) : ce, cet (aussi c’te) - (50) |
| ctu : ce - (51) |
| c'tu lai - (39) |
| c'tu tchie (c'tu tchîte) : celui-ci - (39) |
| ç'tu, pron. déni. celui : « i parlerc ai ç'tu qu'vô m'é indicté », je parlerai à celui que vous m'avez indiqué. - (08) |
| c'tu... c'tée - celui, celle. - Son petiot Jean à mailaide, et c'à c'tu qu'al eûme le pu. - Ceute casquette â jolie et c'â c'tée que me vet le mieux. - (18) |
| ctu-là : celui-là, celui-ci - (51) |
| c'tulai : celui-là (cestui-là). - (32) |
| c'tulai, c'tulâvant, c'telai - celui-là, celle-là. - Ce n'â pâ c'tuqui, c'a c'tulavant. - Prend don putot c'tulai, a te fairé pu de profit. - C'â c'telle lai qu'à lai bonne. - (18) |
| c'tuqui, c'téqui, c'tucu - celui-ci, celle-ci. - C'â ai c'tuqui qu'en fau beiller lai commission, al â aidroit. Non, ce n'a pâ c'tucu, c'en à in aute. - Quad t'és en champ nos vaiches, surveille surto c'tée qui. - (18) |
| cu : Cul, derrière. « Ce qu'ol a à la tête ol y a pas au cu », c'est un entêté. « In cu d'heutte », le fond d'une hotte. « Cu blian » roitelet, petit oiseau. Nom de lieu, « Le Cu de Vau », le fond de la vallée. - (19) |
| cu de caibet, cu de fondron, .sm. cul-de-jatte. - (17) |
| cu de fannöt, sm. homme qui s'occupe des travaux des femmes. - (17) |
| cu de michöt, sm. grosse femme fessue. Tisserand. - (17) |
| cu de paitin, sm. jeu de petite filles. - (17) |
| cu de singe, cu de chè, sm. nèfle. - (17) |
| cu de singé, néflier. - (26) |
| cu d'singe, nèfle. - (16) |
| cu so : Voir assachi (jeu de carte). - (19) |
| cu su beurdouille, loc. sens dessus dessous : « fére eu su beurdouille », faire la culbute. - (08) |
| cu. Je ne mets pas ici « cu » comme un mot bourguignon, mais pour avoir occasion de remarquer, premièrement, que ceux qui ont dit que bien peu de gens écrivaient « cul », ne devaient pas eux-mêmes récrire ainsi. Secondement, que dans le troisième Noël, quand le poète dit : « Le diale at ai cu », le diable est à cu, c'est comme s'il disait : Le diable est poussé à bout, il est réduit à demeurer pour toute défense le cu rangé contre un mur, il est acculé. On appelle « accul » le lieu où l’on est acculé. - (01) |
| cua (masc.) : une petite barrière. (RDT. T III) - B - (25) |
| cuâ : n. f. Fermeture de porte, de barrière, de ridelles. - (53) |
| cuant - au verbe cuire, voyez à cueùrre. - (18) |
| cuau. s. m. Cuveau, petite cuve. A Argenteuil, on dit cuïau. - (10) |
| cubêcho. Faire la culbute, bourguignon cutimblo, - (03) |
| cuchain, ou cuchin - coussin, ou même oreiller. – Mettez lli don su sai chère in bon cuchain. - Ai cause de ses rhumatisses en sero bon qu'al eu tojour un cuchain sô les pieds. - (18) |
| cuchan : s. m. gros tas, spécialement de foin. - (21) |
| cuchan : s. m. oreiller, coussin. - (21) |
| cuche : Cime, « Ol a été dépichi in nid de jaquettes à la fine cuche d'in peup'lle », il a été prendre et détruire un nid de pie à la cime d'un peuplier. - (19) |
| cuche : cime, sommet. « la cuche d’un âbre » : cime d’un arbre. On dit la cuche et le cuchot. - (62) |
| cuche : s. f., cuchon, cuchot : s. m., vx fr, cuchet el cuchon, cime, sommet, pointe, tas de forme conique, et, par extension, tas quelconque. La cuche d'un peuplier. Le cuchot d'une maison. Un cuchon de foin. - (20) |
| cuché, coucher; s'euehé kan lë poule, se coucher trop tôt, à l'heure où se couchent les poules. - (16) |
| cuche, n.f. cime de l'arbre et, en général, sommet. - (65) |
| cuche. s. f. Cuisse. - (10) |
| cûchi - tchûchi : coucher - (57) |
| cûchi : aliter - (57) |
| cuchi, v. a. coucher. - (24) |
| cuchin : oreiller, coussin - (39) |
| cuchin. s. m. Coussin. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| cuchlerer : emplir par-dessus bords. (E. T IV) - VdS - (25) |
| cucho : petit tas de foin. (T. T IV) - S&L - (25) |
| cucho. Tas de foin. Bugey, cuchon. Encuchaler, mettre en cuchos. - (03) |
| cuchon, s. m. tas de fourrage ; tas d'objets. Verbe acuchoner, mettre du fourrage à tas (du vieux français cuchet, cuchon). - (24) |
| cuchon, s. m., petit tas de gerbes non battues. - (40) |
| cuchôt (C.-d., Chal., Br.), ceuche (Char.), guche, guchot (Y.).- Sommet d'un toit, d'un édifice, d'un arbre ; pointe d'un clocher. Dans la Bresse et le département de l'Ain, cette expression désigne plutôt un tas de foin. Cunisset Carnot donne de ce nom une étymologie assez ingénieuse : chef (tête, sommet), mais la véritable origine, plus prosaïque, paraît devoir être tout simplement le huchoir ou juchoir (de jucher, percher), endroit où l'on fait percher les poules, toujours situé dans un endroit élevé et que, dans le Morvan, on appelle jeuche. Cuchet et cuchon étaient usités en vieux français dans le sens de tas de foin. - (15) |
| cuchot : petit tas de fourrage. - (31) |
| cuchot : Sommet, cime. « Au cuchot d'un châgne », au sommet d'un chêne. - Tas, « In cuchot de foin ». « Mentre en cuchot », mettre le foin en tas quand on juge qu'il est assez sec. - A cuchot, plein à déborder. « Man pané (panier) est plien à cuchot ». - (19) |
| cuchot et quiéchot. Sommet d'un arbre, d'une maison, d'une montagne aiguë. C’te peutte de chouette s'étot parchée su le fin cuchot de not' mason. - (13) |
| cuchot, n.m. tas de foin. - (65) |
| cuchot, s. m., extrémité supérieure, sommet, faîte, cime, tas. Le cuchot de la tête ; le cuchot d'un arbre ; un cuchot de blé, de trèfle : « C't'agasse a fait son nid au fin cuchot du peûpier, » — « L'foin étôt sec ; les foineuses l'ont métu en cuchot. » Un petit tas de fourrage est un cuchot ; un gros tas est une mate. - (14) |
| cuchot, s.m. le haut, la cime. - (38) |
| cuchot, sommet, comble, monceau. - (05) |
| cuchot, tas de foin — faîte d'un arbre. - (28) |
| cuchot. Le haut, le sommet de la tête ; par extension la pointe de tout ce qui est élevé. Etym. alteration du vieux français chés ou chiés, chef. - (12) |
| cu-de-jaite. Cul-de-jatte, homme qui ne pouvant se servir de ses jambes, se traîne comme il peut, assis sur une grande écuelle de bois nommée jatte, du latin gabata. - (01) |
| cudre : cueillir. (B. T IV) - S&L - (25) |
| cudre: Cueillir. « Ces pommes sant temps de cudre », il est temps de cueillir ces pommes. Au figuré, on dit d'une fille bonne à marier : « Alle est temps de cudre ». - (19) |
| cué : (nm) toit (à Matour) - (35) |
| cûe : Cuve. « Tiri la cûe », décuver. « Pigi la cûe », fouler le raisin dans la cuve. - Ravin profond, la cûe de Chatena, nom de lieu. - Part passé cu'illé, « J'ai cu-illé in pané de cherijes ». - (19) |
| cue, interrogatif, cue st'i ol ? qui est-ce ? ; qu'usqui,ôt qu'ôl ôt ? qui est-il ? - (38) |
| cûe, s. f., cuve. - (40) |
| cue, s.f. cuve. - (38) |
| cuéche : couvercle - (43) |
| cuèche n.m. Couvercle. - (63) |
| cuêçhye (nm), cuêçhyon : couvercle de la marmite - (35) |
| cuêçhyi : (vb) couvrir (un toit) - (35) |
| cuée. s. f. Contraction de cuvée. (Domecy-sur-le-VauIt). - (10) |
| cueillâr, v., cueillir. - (40) |
| cueiller, cueillir, couper (de l'herbe). - (27) |
| cueillire : cuillère - (43) |
| cueillot : s. m., vx fr. cueillete, bouquet de branches. J’vas t’fesser avec un cueillot d'épines. - (20) |
| cuer (v. tr.) : curer un fossé, une citerne, ... - (64) |
| cueraïlle, s. f., milieu du fruit. - (40) |
| cuerbèce. : (Dial.), inclination basse, en latin curvatio. - (06) |
| cuére (v.t.) : cuire (pour de Chambure : queurre) - (50) |
| cu-erte : couverture - (43) |
| cuèsse (casse) : poêle à frire - (51) |
| cuét (p.p.) : cuit – féminin cuète : cuite - (50) |
| cuet : toit - (43) |
| cueûche, queuchotte (saitai ai lai) - cuisse ou jambe. - A traingne in pecho lai queûche. – Tenez, mégez ceute cueûche de poulot. - Ci ne me fait dière lai cueûche, cequi, ailé. - I ailons jue ai lai cueûchotte. - (18) |
| cueucueute, s. f., bouillie que l'on prépare pour les enfants. Mot bizarrement composé du masc. et du fém. de l'adj. cueùt, e. - (14) |
| cueude (pour cueudre, par élision de l’r). v. a. Coudre. - (10) |
| cueude, s. m., coude. - (14) |
| cueùde. Crois, croit, croient… - (01) |
| cueudé. : Croire, dans le sens d'espérer. - (06) |
| cueùdò. Croyais, croyait. - (01) |
| cueudre, coudrier. - (14) |
| cueudre, cueillir. - (05) |
| cueudre, v. tr., coudre. - (14) |
| cueudre, v. tr., cueillir : « N'y a qu'çà d'neuzilles ; y é tout c'que j'ai pouvu cueùdre. » - (14) |
| cueudu. Part. passé de cueudre. Une robe mal cueudue. - (10) |
| cueuelle, couvercle. - (05) |
| cueugne. n. f. - Bosse, beigne. (Sommecaise, selon M. Jossier) - (42) |
| cueugne. s. f. Altération de cogne, synonyme de beugne. (Sommecaise). - (10) |
| cueugnînte (v.) : connaître (utilisé par Déchard) - (50) |
| cueuïer, v. tr., cueuillir : « J'ons cueùïé tous nos râïns. » - (14) |
| cueula, cula, culot. - (05) |
| cueule - souche, gros morceau de bois à brûler. - Voiqui des bonnes cueules, teins, bein soiches. - En me fauro des coins pu fort que ceux qui pou fende ces grosses cueules. - (18) |
| cueulon (A) (akeulon) : loc, à cul, à croupeton, sur les talons. Voir accueuter (S'). - (20) |
| cueupé, couper. - (16) |
| cueupesse, sf. artichaut de murailles (sedum telephium, ou acre ?). - (17) |
| cueupö, sm. [copeau]. Bardane (lappa communis). - (17) |
| cueure : cuire - (51) |
| cueure : cuire. - (32) |
| cueure : cure - (51) |
| cueuré : curé - (51) |
| cueûre, cueu, cueûro - divers temps du verbe cuire. - En â temps de fàre cueûre le soupai. - Pendant que les treufes cuant en fau veni m'aidié. - Les faivioles sont dures, en fauro qu'a cueussaint bien lon temps. - Ce pain qui n'a pâ tot ai fait aissez cueu. - (18) |
| cueure, cuire. - (05) |
| cueure, v. cuire. - (38) |
| cueure, v. tr., cuire. Acception générale de cuisson pour tout ce qu'on met sur le feu : « Mes faviôles ne voulont pas cueùre. » — « Mon fricot n'é pas cueùt. » - (14) |
| cueure, v. tr., cuire. Acception restreinte et spécialisée s'appliquant, chez nous, à toute la manipulation du pain. Quand on dit qu'une ménagère cuit, cela comprent depuis le pétrissage jusqu'au retour du four, en un mot, l'opération complète : « Ah! vous v'là, Nan-néte ! Làvoù portez-vous c'boinon ? — J’cueùs cheû l'grand Michan. » Certaines disent : « Je fais au for ». - (14) |
| cueurée, s. f., curée. - (14) |
| cueurer : curer - (51) |
| cueurer, v. tr., écurer. Fig., mettre à sec, dépouiller quelqu'un. Terme de jeu employé par les enfants de nos contrées, qui ne manquent jamais de dire, lorsqu'ils ont gagné toutes les gobilles d'un camarade : « Oh! j'iai cueûré ! » Les gamins de Chalon disent : cueùsser. - (14) |
| cueurlâme – crémaillère. – Mets to de suite lai mairmite à cueurlâme. – Recliôle le cueurlâme ; â ne parait pas solide. - Ma laive tai don lai figure, il â noire queman note cueurlâme. - (18) |
| cueurnache – diminutif de cueurni. - (18) |
| cueurnailli : lorsqu'un animal refuse d'obéir ou s'énerve il présente la tête : il cueurnaille, par extension faire la tête par désaccord - (51) |
| cueurnales – cornouilles. – En i é ben des cueurnales, les petiots ailant se régalai. - I veins de copai une jolie brainche de cueurnalé ; ci fait des bons moinges de fouet. - Cueurnales et mairgots ! - (18) |
| cueurni, cueurnache - ridé, amaigri par défaut de santé. - Pôre gairson qu'ai â don cueurnache. - C'te petiote feille ne vai pâ bein, viez don quée figure cueurnie ! - Se dit aussi par dédain de quelqu'un qui veut faire l'important. - Ce cueurni lai ! queman qu'à vô pairle ! –Se dit également des fruits. - Ces poumes qui sont tote cueurnies ; en les é cueillées qu'à n'étaint pas aissez meures. - (18) |
| cueurtelle : petite crotte (rat, chèvre, lapin) - (51) |
| cueusan - souci, préoccupation.- Al é gros de cueusan, le pôre homme, aivou ces enfants lai ! - I ne sai pas, ma, ile n'é diére de cueusan pou ine fone qu'é de lai famille. - (18) |
| cueusan, souci, soin. - (05) |
| cueuse. v. a. Cuire. (Avallonnais). - (10) |
| cueusenier, s. m., cuisinier. - (14) |
| cueusine, s. f., cuisine. - (14) |
| cueusse, cueutche. s. f. Cuisse. - (10) |
| cueusse, et cueuche, s. f., cuisse. - (14) |
| cueùsse. Cuisse, cuisses. - (01) |
| cueusser, v. tr., dépouiller. Syn. chalonnais de cueùrer. (V. ce mot.) - (14) |
| cueussére - voyez queuchère. - (18) |
| cueusshes, cuisses. V. ecueussher. - (05) |
| cueut (e) : cuit (e) - (51) |
| cueut, adj., cuit. - (14) |
| cueut, queûte - cuit, cuite ; du verbe cuire. - Poume queute. - (18) |
| cueute, cuite. - (05) |
| cueute, s. f., cuite, cuisson : « Tant d'miches que ça ! boufre ! y et eùne bâle cueùte ! » - (14) |
| cueuvrir, couvrir. - (04) |
| cugenater: Rester à la cuisine sans beaucoup cuisiner. « Qu'est dan que te fa à cugenater itié to le métin (tout le matin) ». - (19) |
| cugener. Cuisiner, activer le feu avec un tisonnier. - (49) |
| cugni - bougni - brailli : tasser - (57) |
| cugnot, ad., mou, engourdi, un peu niais, qui manque d'énergie, ou se remue sans rien faire : « T'n'as donc pas fini ? Que qu'te fais là? Rau du tout. Va, t'n'é qu'un pauv' cugnot. » - (14) |
| cugnoter : perdre son temps en s'attardant à des détails inutiles. (VSLD. T II) - S&L - (25) |
| cugnoter, v. intr., tourner sur place sans rien faire, mettre longtemps pour n'arriver à rien, ne pas sortir d'une besogne. - (14) |
| cuhaut. n. m. - Grattoir, pour dépatter la charrue. (Sougères-En-Puisaye) - (42) |
| cuhé, s. m. curé, prêtre pourvu d'une Cure . - (08) |
| cuhé. s. m . Curé. (Maligny). - (10) |
| cuiâ (à) (être) à cuiâ, à quiâ, être mort de fatigue. - (38) |
| cuiàye, s.f. cuiller. - (38) |
| cuicer, coucher - (36) |
| cuïé. s. f. cuillère. - (08) |
| cuièque. s. m. Porte de four, couvercle. - (10) |
| cuïer. v. a. cueillir : « a cuïan dé ponmes dan l’courti », ils cueillent des pommes dans le jardin. - (08) |
| cuigné : cognassier. (BEP. T II) - D - (25) |
| cuillar (prononcez killar). s. f. Cuiller. (Domecy-sur-le-Vault). - (10) |
| cu'illé : cuillère - (48) |
| cuillé, sm. cuillère. - (17) |
| cuillée (n.f.) : cuillère - (50) |
| cuïller, cuïllî n.m. Cuillère. - (63) |
| cuïllerö (pron. cu-ye), sm. faiseur d'embarras. - (17) |
| cuïlleron(pron. cu-ye), sm. langes d'enfant au berceau. - (17) |
| cuilleu : s. f. cuiller. - (21) |
| cuilli (na) : cuillère - (57) |
| cuilli : cueillir - (57) |
| cuilli : v. cueillir. - (21) |
| cuillie (cu-illie) : Cuiller. « An ne mije pas la biauté à la cuillie », en ménage la beauté ne suffit pas à faire le bonheur. - (19) |
| cuillon, cueillon. s. m. Serpette en forme de sape, qui sert pour couper l’herbe. - (10) |
| cuïllöte (pron. cu-ye), sf. culotte. - (17) |
| cuin : Coing, fruit du cognassier. Dicton « quand i pliô le premé de mai les cuins de madame sant cuillés », quand il pleut le premier Mai les coings de madame sont cueuillis, c'est à dire il n'y a pas de coings. - (19) |
| cuiné : adj., ruiné. Se dit surtout au jeu de billes quand on a tout perdu. - (20) |
| cuiner. Grincer, couiner « la brouette cuine ». - (49) |
| cuingni : Cognassier (pyrus cydonia). « Les cuingnis sant bien flieuris ». - (19) |
| cuir de beurouette loc. péj. désignant le bois quand il remplace le cuir. - (63) |
| cuir de brouette : s. m., bois. Des souliers en cuir de brouette (sabots). - (20) |
| cuir se distend. - (63) |
| cuirassier : voir guîchard - (23) |
| cuiriou, sm. cordonnier. - (17) |
| cuisante. s. f. Partie de la clientèle d’un boulanger qui se contente d’apporter son pain à cuire. - (10) |
| cuisine (Latin de). C'est ce qu'on appelle une macaronée, un français grotesquement affublé de terminaisonslatines, ou bien le thème, rempli de fautes d'un mauvais écolier. En un mot c'est un latin dans lequel on a mis toutes espèces d'ingrédients. L'un des plus célèbres morceaux de latin de cuisine est la narration de la mort tragique de Michel Morin : « De brancâ in brancam dégringolavit at que fecit pouf ! »... - (13) |
| cuisiniére : n. f. Cuisinière - (53) |
| cuisse, cuite, s. f. Fournée de pain. - (10) |
| cuissin. s. m. Amas de terre transporté du bas d’une vigne dans le haut, où il forme comme une espèce de traversin, de coussin, par la forme arrondie qui lui est donnée à sa partie supérieure. Du latin culcitra. - (10) |
| cuissin. s. m. Oreiller, sans doute pour coussin ; du latin culcitra. - (10) |
| cuitier. : Rôtisseur. (Coutumes de Chasteillon, 1371.) - (06) |
| cul (aller à), verser un tombereau. - (40) |
| cul d’ p’yomb : lourdaud, pas souple - (37) |
| cul d’ singe : nèfle. Fruit du néflier. - (62) |
| cul d'chien : n. m. Fruit du néflier. - (53) |
| cul de chien : fruit du néflier: la nèfle. Le cul de chien se meuge biot : la nèfle se mange blette. - (33) |
| cul de chien. n. m. - Nèfle. - (42) |
| cul de chin : mot masculin désignant une nèfle - (46) |
| cul de la lune : Ioc., le dernier quartier de la lune. - (20) |
| cul de singe : nèfle - (48) |
| cul de singe, mépié. Nèfle. - (49) |
| cul de singe, s. m., nèfle. - (40) |
| cul de singe, subst. masculin : nèfle. - (54) |
| cul de singe. Nèfle. Ce nom étrange lui a été donné à cause de sa forme, a cela rien d'étonnant. Mais ce qui l’est absolument c'est que nous appelons bravement cul de singer le néflier ! - (12) |
| cul n.m. A relever, quelques expressions imagées : L'hôtel du cul tôrné. Le lit conjugal lorsque la femme tourne le dos à son mari et le boude. Dzapper du cul. Péter bruyamment. A la fmire d'mon cul. A la noix. Tôrner le cul au râtiau. Refuser la nourriture (en parlant d'une vache). L'cul d'la leune. Le dernier quartier de la lune. - (63) |
| cul polo : n. f. Chute, pirouette. - (53) |
| cul : s. m. En 1916, au joli mois de mai. le tribunal correctionnel de Mâcon avait à juger un naturel de R..., braconnier de pêche, qui, au cours d'une altercation avec un garde, avait porté à celui-ci le défi suivant : « Le bon Dieu m'a fait un trou au cul, mais toi, tu ne me feras pas le second. » - Etre tout cul nul, les manches pareilles, n'avoir plus le sou, être dans la misère. - Baiser le cul de ta vieille, ne pas faire un seul point dans une partie de jeu (voir Fanny). Dans certains villages, peut-être dans tous, on disait jadis à ceux qui allaient à « la ville » pour la première fois, qu'ils seraient arrêtés aux barrières pour « baiser le cul de la vieille », et qu'ils ne pourraient entrer qu'après avoir rempli cette formalité. - Japper du cul, péter (en parlant des chiens). - Faire cul-sec, vider complètement une bouteille. - Boire à coupe-cul, boire plusieurs verres ou plusieurs bouteilles coup sur coup. - Etre soûl à traine-cul, être ivre à tomber. - Tourner le cul au foin, refuser la nourriture. - Le jeu a tourné le cul à la bourrique, la chance a tourné au Jeu. - (20) |
| culâner. v. a. Ralentir, laisser aller doucement. Culâner un cheval. — Naturellement signifie lambiner. Cet homme culâne toujours. - (10) |
| culaneux. adj. Lambin, fainéant, paresseux. (Percey). - (10) |
| culard (nom masculin) : veau en viande après engraissement. - (47) |
| culard n.m. Jeune bovin à gros cul. - (63) |
| culard, n.m. jeune bovin à gros arrière-train. - (65) |
| culard. s. m. Feu follet. — Ame d’un enfant mort sans baptême. - (10) |
| cul-d'ail : s. m., imbécile. Oh ! sacré cul-d'ail ! - (20) |
| cul-de-casse : voir queue-de-casse. - (20) |
| cul-de-chien. s. m. Nèfle. - (10) |
| cul-de-dé : s. m., partie du vin qui sort du pressoir après la dernière coupe. Voir broute. - (20) |
| cul-de-poulot, s. m., pomme de terre. (V. Crompire.) - (14) |
| cul-de-singe, fruit du néflier. - (11) |
| cul-de-singe, s. m., nèfle. - (14) |
| culeton, s. m., coffret situé à l'arrière d’une fourquette. - (14) |
| culjaune : n. m. Frelon. - (53) |
| cullhie, ll mouillés, s. f. petite botte de paille. il y a ordinairement deux « cullhies » dans un fagot. - (08) |
| culnis. s. m. Herbes et menues pailles qui se détachent du pied de la gerbe, lorsqu’on la secoue en la tenant par le haut. - (10) |
| culoron. Fond du pantalon, partie ronde de la culotte. - (12) |
| culoron. Fonds de culotte. - (13) |
| culot : abri du bûcheron. A - B - (41) |
| culot : abri de bûcheron - (34) |
| culot : cabane dans les bois. - (30) |
| culot n.m. Râclures de casserole. Abri. Fond. - (63) |
| culot. s. m. Souchon, petite trogne. (Soucy). - (10) |
| culot. Vieille pipe en terre à tuyau court, noircie par l’usage ; hutte en bois dans la forêt pour abriter le bûcheron, le charbonnier ; le plus jeune enfant d’une famille ; le plus petit d'une nichée. Dans ce cas on dit souvent « kelot ». Fig. Toupet, effronté. On dit : « avoir du culot ». - (49) |
| culotte : s. f., jeu de la marelle à cloche-pied. - (20) |
| culotte, n.f. pantalon. - (65) |
| culotté. Noirci par l’usage. Se dit surtout d'une pipe. Fig. Hardi, effronté. (Argot moderne). - (49) |
| cul-pelé (eu p'lé) : s. m., singe dont les fesses sont saillantes et dépourvues de poils. - (20) |
| cul-pe-singe : m., espèce de melon dont la partie inférieure est ronde et saillante comme le postérieur d'un cul-pelé. - (20) |
| cul-tarrou : vigneron. - (30) |
| cul-tarroux n.m. Paysan, cul-terreux. Voir copeux d'veurtiaux. - (63) |
| cultivâtœur : n. m. Cultivateur. - (53) |
| cultivé : v. t. Cultiver. - (53) |
| cume, sf. écume. - (17) |
| cumé, vt. écumer. - (17) |
| cumoir (m), écumoire. - (26) |
| cuot (n. m.) : instrument à long manche servant à débarrasser les socs des charrues de la terre qui s'y est collée - (64) |
| cu-paniche (en), loc. en chemise. - (17) |
| curâ, s. m., curé. - (40) |
| curasse : Cuirasse. - (19) |
| curasse, cuirasse ; curassié, cuirassier. - (16) |
| curassier : Cuirassier. - (19) |
| curè : curé - (48) |
| curé : Curé. Dicton : « Y va cheu des curés », le ciel est très noir, il va pleuvoir abondamment. - Expression : « Autant qu'in curé peut en béni » une grande quantité. - (19) |
| curé, ée. Partic. prés. de Curer. Qui a tout perdu, qui est dépouillé, ruiné. - (10) |
| curé. Libellule ou demoiselle grosse et noirâtre, sans doute à cause de sa couleur. - (03) |
| curé. Traquet (oiseau). - (49) |
| curée, gourme des enfants. - (27) |
| curer, v. a. nettoyer, émonder. - (08) |
| curer, v., enlever le fumier d'une étable. - (40) |
| curie, s. f., éruption de boutons fréquente chez les enfants du premier âge. - (14) |
| curieux adj. Désireux. - (63) |
| curieux : adj., désireux. Etes-vous curieux de goûter d'un bon cachet ? - (20) |
| curiou, adj. curieux. - (17) |
| curon : s. m., débris de fruit résultant du curage. Voir rongeon. - (20) |
| curotte : petite raclette. - (31) |
| curotte : une curette avec manche - (46) |
| curotte, chien. - (05) |
| curti, corti, et courti, s. m., jardin. A la campagne, c'était un champ entouré de haies ; à la ville, un jardin clos de murs. - (14) |
| curtil, jardin. - (05) |
| curtil. Enclos. Une foule de champs de nos localités portent ce nom. - (03) |
| curtils et cultilz. : Jardin, et curtilaige, jardinage. (Chartes du XIIIe siècle.) - (06) |
| curton : religieux - (44) |
| cusainne, sf. cuisine. - (17) |
| cuschin, s.m. coussin. - (38) |
| cusencenaule. : (Dial.), ardeur à faire une chose, et cusencenols, ardent à cette même chose. - (06) |
| cuséne. Cuisine. - (01) |
| cusenier : Cuisinier. - (19) |
| cusenö, sm. cuisinier. - (17) |
| cussin, cuissin, cuchin. - (04) |
| cussin, coussin. - (16) |
| cutcheaû (on) : couteau - (57) |
| cutcheau : couteau - (51) |
| cutcheau à deux mantses : plane (outil de menuisier et de charron) - (51) |
| cute toué don'. exp. verb. - Assieds-toi. (Sainte-Colombe-sur-Loing) - (42) |
| cutiau : (nm) couteau - (35) |
| cutiau à deux mandzes n.m. Plane. - (63) |
| cutiau à deux mantzes : plane - (43) |
| cutiau de mie : rayon de miel - (43) |
| cutiau n.m. Couteau. - (63) |
| cut'iau, s. m. couteau. - (24) |
| cutimblô, culbute. A Châtillon on dit cutumario ; en Lorraine on dit quicambôle. - (02) |
| cutimblô. Culebute ou culbute. Faire le cutimblô, c'est faire la culbute… - (01) |
| cutimblô. : Culbute. - Dans le Châtillonnais, cutumario ; en Lorraine, quicambole. - (06) |
| cutsi : coucher - (43) |
| cutyau : s. m. couteau. - (21) |
| cuvage, n.m. cellier. - (65) |
| cuvier, cuivier. n. m. - Petit bac en bois. - (42) |
| cuyé : cuve. (S. T IV) - B - (25) |
| cuyé, cuillère. - (26) |
| cû-yer (s'), v. se taire. - (38) |
| cu-yer, v. cueillir. - (38) |
| cuyer, v. tr., cueillir. - (14) |
| cu'yëre, cuillère ; cu'yerë ; ce que contient une cuillère. - (16) |
| cuyère, s. f., cuillère. - (14) |
| cuyeuté, homme portant une culotte à pont, qui se boutonnait sur le côté ; qui remplit bien son fond de culotte. - (27) |
| cuyinte : culotte. (PLS. T II) - D - (25) |
| cuy-inte, culotte. - (26) |
| çuziaux (des) : ciseaux - (57) |
| cuzine, cuisine ; cuz'gnié, cuisinier. - (16) |
| cuzné : s. m. tablier de cuisine. - (21) |
| çvau (n.m.) : cheval (aussi cevau) - (50) |
| ç'vau, s. m. cheval. - (08) |
| cygnole et signole. Manivelle adaptée à un puits, à un orgue de Barbarie, à un moulin à café. Ce mot semble dérivé de cygne, à raison de la forme de l'instrument... - (13) |
| d' bîntoût : bientôt - (57) |
| d' vantin, s.m. tablier. - (38) |
| d’ : prép. De. - (53) |
| d’abord que, conj., puisque : « D'abord que t'fâs c'qui, j’seû pas content d'toi. » - (14) |
| d’abord, adv., vite, bientôt : « Alle é d'abord érivée. » — « O pousse ; ô s'ra d'abord grand. » - (14) |
| d’ache’tôt : (loc adv) bientôt, aussi tôt - (35) |
| d’aibord. D’abord. - (01) |
| d’aibourd. adv. D’abord. - (10) |
| d’aivô. C'est la même chose qu’aivô, avec. - (01) |
| d’aû-d’choûs : dans le lointain, plus bas - (37) |
| d’avant, loc. adv., en avant, de devant : « Arra doù d'avant! » Vite en avant! — De notre marine fluviale. (V. Arra et D'arrié.) - (14) |
| d’avant, prép., devant. - (14) |
| d’bout, adv., droit, sans s'arrêter. - (40) |
| d’chûs : dessus - (37) |
| d’dans - en d’dans : dedans - (57) |
| d’géét’es (dâs) : (des) guêpes - (37) |
| d’hiaûrré (ât’e) : (être) mis dehors - (37) |
| d’hiaûrrer : mettre dehors, faire enlever de la place qu’il occupe - (37) |
| d’hiors : dehors - (37) |
| d’hors, adv. Dehors. Il existait naguère encore, à Auxerre, une rue du nom de Notre- Dame-la- D'hors, laquelle conduisait de la rue de la Croix-de-Pierre (maintenant rue de Paris) à l’église du même nom, détruite pendant la révolution et qui s’élevait sur l’emplacement actuel du Palais de Justice. - (10) |
| d’ici-n’avant. adv. Dorénavant. (Mont-Saint-Sulpice, Seignelay). - (10) |
| d’jà : déjà - (57) |
| d’là : de là - (57) |
| d’layer (pour délayer). v. a. Enlever la partie gâtée ou pourrie d’un fruit. Du latin deligere. - (10) |
| d’layon. s. m . Ce qui reste d’un fruit après l’enlèvement de la partie gâtée. - (10) |
| d’lire, choisir, trier ; d'lire dë faivieûle, trier des haricots. - (16) |
| d’main : demain - (57) |
| d’mande (na) : demande - (57) |
| d’mander : demander - (57) |
| d’mi (on) : demi - (57) |
| d’mi : demi - (57) |
| d’mi-cainon : demi-verre de vin en principe… en réalité, lorsqu’on est attablé, la « chopine » y passe ! - (37) |
| d’mi-frére (on) : demi-frère - (57) |
| d’mi-groûs (on) : demi-gros - (57) |
| d’mi-jo (on) : demi-jour - (57) |
| d’mi-maû : demi-mal - (57) |
| d’mi-pièce (na) : demi-place - (57) |
| d’mi-s’tier (ain) : (un) demi-setier, mesure de capacité de matières sèches (6 boisseaux - 76 litres) - (37) |
| d’mi-s’tier (ain) : (un) demi-setier, un petit verre de vin - (37) |
| d’mi-sœû (na) : demi-sœur - (57) |
| d’mi-to (on) : demi-tour - (57) |
| d’moirer. v. n. Tomber en syncope, perdre connaissance. (Guillon). - (10) |
| d’morer : demeurer - (57) |
| d’mouaiselle (na) : demoiselle - (57) |
| d’o. D'où. « D'ô vén », d'où vient… - (01) |
| d’ol’ temps-lai : de ce temps là - (37) |
| d’oûter (s’) : (s’) enlever, (se) retirer - (37) |
| d’oûter : ôte, sortir quelqu’un ou quelque chose de la place qu’il occupe - (37) |
| d’oûte-tai ! : enlève-toi ! - (37) |
| d’rer, deurer. v. n . Durer. - (10) |
| d’ri : (nm ; prép) derrière - (35) |
| d’v’ni (en) : (en) venir, (en) revenir (« v’ailez ai crot ? … ben, mouai, y en d’vint ! ») - (37) |
| d’van, devant et avant : d'vanzière, avant-hier. - (16) |
| d’vant que : (conj) avant que - (35) |
| d’vanté : tablier à bavette. - (62) |
| d’vanter, taib’ier : tablier de femme - (37) |
| d’vanti : (nm) tablier - (35) |
| d’vanti : tablier - (43) |
| d’vantier, d'vantcher, d'vantchiot. n. m. - Tablier. Au XVe siècle, on employait devanté ou devantail pour désigner un tablier d'homme. Au XVIe, une devantière était unejupe de femme ouverte devant et derrière pour monter à cheval comme les hommes ; une devantière désignait aussi un tablier. Le poyaudin a masculinisé le nom par rapprochement avec le nom tablier, lui-même masculin. - (42) |
| d’vant-t-haiyâr : avant-hier - (37) |
| d’vidot. s. m. Dévidoir. (Fléys). - (10) |
| d’vint d’airvint (dâs) : (des) allers et retours - (37) |
| d’volée : pente, descente - (37) |
| d’voler : descendre - (37) |
| d’vouère. n. m. - Devoir : « J'vas fai'e mon d'vouère, j'vas vouter ! » - (42) |
| D’zize : Decize, ville située entre Cercy-la-Tour et Nevers - (37) |
| da : faux (outil servant à faucher). A - B - (41) |
| da - outre le sens explétif francisé, comme dans oui-da notre patois emploie ce mot seul pour exprimer l'étonnement, la surprise dans la conversation : - Da ! - Oh da ! - (18) |
| da ! int. dia ! (à droite pour les bœufs). Exclamation employée à la fin ou au cours d'une phrase. - (17) |
| dà ! particule excl., qui donne de la force à l'expression : « Voui dà ! » — S'emploie souvent seule, et surtout dans un sens interrogatif, dà ? voulant dire : vraiment ? - (14) |
| dâ (le) : faux (la) - (43) |
| dâ (on) : faux (outil) - (57) |
| dâ (un) : faux (une). C’est le dard du faucheur. Le mot francique : dard désignait une espèce de lance. - (62) |
| dâ : (nm) faux - (35) |
| da : « Da banjo », je vous donne le bonjour. - (19) |
| dâ : a) Faux, outil du faucheur. « Enchaplier in dâ », mettre une faux en affût. Voir enchaplier. - b) Bloc en forme de dé aplati fait avec le marc de raisin sortant de la cuve et mis sous le pressoir. « La gène d'eune cûe de vingt pièces fa in greu dâ », le marc de raisin d'une cuvée de vingt pièces fait un gros dâ. - (19) |
| da : Doigt. « Ol y a pris d'ave les quat' das peu le pôge (pouce) ». « O se mant le da dans l'yau (dans l'oeil) ». « A lache da », à lèche doigt, parcimonieusement. - (19) |
| da : faux - (34) |
| da : faux (outil) - (51) |
| dâ à arçon n.m. Faux à blé. - (63) |
| dâ n.m. (lat. pop. dardum, aiguillon, v.fr. dâr, faux). Faux. - (63) |
| da s'adjoint souvent à voui (oui) ; vouidà, vraiment. - (16) |
| da ! : Exclamation qui s'unit souvent à la particule affirmative oui. - C'est le dea ! des Latins. Cette exclamation s'est perpétuée chez nous par le mot dame ! que nous proférons sans cesse. - (06) |
| da : doigt - (43) |
| dâ : s. m. fer de la faux, d'où : faux. - (21) |
| dâ : s. m. quantité de raisin placée sur la « ma » du pressoir. - (21) |
| dâ, interj. explétive très usitée dans quelques parties du Morvan, dans les environs d'Avallon notamment : « oui-dà ! si-dâ ! non-dâ ! » - (08) |
| da, pour â ; s'â da lu, c'est à lui ; s'â da lai, c'est à elle. - (16) |
| da, s. m. 1. Faulx, avec ou sans sa monture. — 2. Pressée de raisin dans un pressoir, ayant, une fois sèche, la forme d'un gros dé. - (22) |
| da, s. m. 1. faulx, avec ou sans son manche (du vieux français dail). - (24) |
| dâ, s.m. faulx. - (38) |
| dâ’zarbeû : dégerbeur à l’intérieur de la grange sur le gerbier, le jour de la machine à battre - (37) |
| dâbâiller (pâs) : ne rien dire du tout - (37) |
| dâbairboûiller : débarbouiller - (37) |
| dâbairder : sortir de la forêt les troncs des arbres coupés - (37) |
| dabarbauiller (v.t.) : débarbouiller - (50) |
| dâbârboûler : débouler, surgir brusquement, tomber en quantité - (37) |
| dabarraisser (v.t.) : débarrasser - (50) |
| dâbârrer : déverrouiller - (37) |
| dâbârrer : ouvrir le verrou - (37) |
| d'abas. n. m. - Vent du sud, celui qui « vient d'en bas ». Synonyme de dret. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| dâbeûiller : démolir, jeter à bas - (37) |
| dâbeûrneé (ât’e) : (être) débordé, (être) dépassé - (37) |
| dâbeurner : déborder - (37) |
| dâbiaûder : déshabiller, enlever les vêtements de quelqu'un - (37) |
| dabièveure (n.f.) : désemblavure - (50) |
| dâbitoûser : laver les yeux - (37) |
| dabonjò, s. m. visière d'une casquette. - (24) |
| dabonjou, s. m. visière d'une casquette. - (22) |
| dabord : Bientôt. « Y sera dabord fait », ce sera bientôt fait. - (19) |
| daborer : enduire, mal peindre, barbouiller. (MLV. T III) - A - (25) |
| daborque, conj. et adv. puisque. Aussitôt. - (24) |
| dabouairder : déborder - (37) |
| dabouécer (v.t.) : déboucher - (50) |
| dabouque, conj. et adv. puisque. Aussitôt. - (22) |
| dabourriller : déchevêtrer - (60) |
| dâboûtner : déboutonner - (37) |
| dâcaircaisser (s’) : faire tous ses efforts possibles afin de parvenir au résultat recherché - (37) |
| dâcaiti : vieilli, usagé - (37) |
| dacas. s. m. Noix. (Annay-la-Côte). - (10) |
| dacause : pourquoi - (44) |
| dachairter (v.t.) : essarter, défricher - (50) |
| dachteû : aussitôt, bientôt - (43) |
| dachtôt (biétôt) : bientôt - (51) |
| dachtôt, achtôt adv. Aussitôt. - (63) |
| dacliarer, v. a. déclarer. - (08) |
| dâcouenner : dire des bêtises - (37) |
| dâcraissaize : opération de nettoyage familiale et « poussée » - (37) |
| dâcraisser : décrasser, laver vigoureusement - (37) |
| dacreucer (v.t.) : décrocher - (50) |
| dâcrotter : déterrer quelque chose d’enfoui - (37) |
| dâcrotter sâs saibots : enlever la terre qui alourdit les sabots - (37) |
| dactyle : graminée fourragère entrant dans la composition des prairies qui convient bien en terre légère et séchante. - (59) |
| dadée. s. f. Niaiserie. (Michery). De dadais, niais, sot, nigaud. - (10) |
| dadet : nigaud - (44) |
| dàdiner, dôdiner, v. a. dorlotter, balancer un enfant dans les bras ou dans son berceau. - (08) |
| dadion, loc. adv. en haut, le lieu placé à un niveau plus élevé que celui où l'on est. - (08) |
| dâdo - sommeil des petits enfants : leur lit ; mot pour les endormir. - Dâdo, mon petiot ! dâdo ! mon ange chéri, embraisse tai mémére. – Dâdo, mon chéri !... Dâdo ! - (18) |
| dàdô (fàre), loc. enfantine, dormir. - (14) |
| dado : Lit, dans le langage enfantin. « Va au dado man p'tiet ». - Vieille berceuse : « Dado papan dado ! Faites le dado, que le papan s'endo ! Le papan ne peut pas dromi que la sansan ne soit venie. Faites le dado, lire, lire, faites le dado que le papan do ». - (19) |
| dàdô, et dôdô, s. m., lit, berceau, et aussi sommeil : « Où, c'qu'é le p'tiot ? — Ol é dans son dàdô. » - (14) |
| dâdo, petit lit d'enfant ; fâr son dâdo, dormir (enfantin). - (16) |
| dàdo, répond au français dodo : « fé ton dâdo, p'tiô, fé ton dâdô ! » - (08) |
| daême, ée. adj. - Dément, qui est possédé du diable. (Perreuse, selon M. Jossier) - (42) |
| daêmé, ée. adj. Qui a perdu la raison, qui est possédé du diable. (Perreuse). Le comte Jaubert donne déâme y qui n’a point d’âme, qui a le diable au corps. - (10) |
| dafende (v.t.) : défendre - (50) |
| dâg’linguer : désassembler - (37) |
| dag’nales : petites poires séchées au four. (VC. T II) - A - (25) |
| dâghner : énerver quelqu'un. A - B - (41) |
| daghner : énerver quelqu'un - (34) |
| dagnalle, s.f. cerise sèche. - (38) |
| dagnellé, dagueneté. adj - Ridé, desséché, comme une dagnelle, une poire : « J'a vu la mée Comeau, alle est ben dagnellée la poure vieuille ! » - (42) |
| dagnelle. n. f. - Poire pour la conservation, qui a été séchée au four ou au soleil. - (42) |
| dagnettes : poires séchées. (B. T IV) - Y - (25) |
| dagobert (A la) : loc, à l'envers. T'as donc mis tes sulés à gobet, tu t'es donc trompé de pied en mettant tes souliers. - (20) |
| dagonner. v. n. Faire des choses peu utiles, de peu d’importance. (Laflon). - (10) |
| dagonner. v. n. Gronder. (Soucy). - (10) |
| dâgot. n. m. - Se dit d'une personne maladroite, peu active, qui tâtonne. - (42) |
| dagot. s. m. Homme maladroit, peu actif, qui fait tout en hésitant, en tâtonnant. — On dit aussi dagotier y dagoquier. - (10) |
| dagotai : hésiter avant de prendre une décision. Quand on ne sait pas que faire on dagote. - (33) |
| dagoter. v. - Tâtonner hésiter. - (42) |
| dagoter. v. n. Tâtonner, hésiter, se mettre à un ouvrage, et puis l'abandonner pour un autre, sans rien terminer. - (10) |
| dagraicher (v.t.) : dégraisser - (50) |
| dâgreûiller (s’) : (se) dépêcher, (se) hâter - (37) |
| dagt : (nm) doigt ; « le gros dagt »: le pouce - (35) |
| dagt : doigt - (51) |
| dagt d’mô : (nm) salsifis (mot à mot : « doigt de mort ») - (35) |
| dagt d'veuche, dagt d'laiñne adj. Maladroit. Litt. doigt de vesse (lycoperdon), doigt de laine. - (63) |
| dagt n.m. Doigt. - (63) |
| dagtllot n.m. (de dagt) Dé à coudre. - (63) |
| dagts de la mô n.f.pl. Nom donné parfois aux scorsonères qui se présentent souvent sous forme de racines multiples évoquant une main aux longs doigts noirs. - (63) |
| dâgu’lingué : « branlant » - (37) |
| dâgu’nillé, dâp’naillé : mal vêtu, en loques - (37) |
| dâgu’nîller (s’) : déchirer sans précautions - (37) |
| dagué, v. n. élancer, en parlant d'un abcès, d'une tumeur : mon panaris me dague. - (22) |
| dague. s. f. Très petite faux, plus petite que la sape, pour couper de l’herbe, sarcler des chardons. (Beugnon). - (10) |
| dague. s. f. Vase en ferblanc pour traire les vaches. (Armeau). - (10) |
| daguenalai : la cuisson du pain terminé, dans le four encore chaud on mettait daguenalai (sécher) les pommes, les poires… - (33) |
| daguenale : se dit d'un fruit mûr tombant terre. (BY. T IV) - S&L - (25) |
| daguenalé : tout ridé, transi de froid. - (33) |
| daguenales : poires séchées au four pour une consommation ultérieure (cf. les pruneaux). Aptès le pain on féto des daguenales : après le pain on faisait des poires séchées. - (33) |
| daguenélle (n.f.) : poire séchée au four (aussi guenélle) - (50) |
| daguenelle : poire séchée (déquenelle) - (60) |
| daguenelle : poire sèche - (39) |
| daguenelle : s. f., vx fr., poire, pomme et tout autre fruit, séché au soleil ou au four, ou même desséché sur l'arbre. - (20) |
| daguenelle, daguenette. s. f. Poire séchée au four ou au soleil. - (10) |
| daguenelle, s. f. poire séchée au four, qu'on désigne en français sous le nom de poire tapée. - (08) |
| dagueneller (dagu'neler) (Se) : v.t., se dessécher (en parlant des fruits). - (20) |
| dagueneller : sécher progressivement des fruits du four où l'on vient de cuire du pain. (P. T IV) - Y - (25) |
| dagueneller : friper, ratatiner, dessécher (cf raigni) - (39) |
| daguener : aller de droite à gauche. - (30) |
| daguenoler, v., se dessécher (en parlant des fruits sur l'arbre). - (40) |
| daguer : v. n., élancer, causer des élancements douloureux. Le doigt me dague. - (20) |
| daguer, v. n. action d'élancer, pour un abcès, une tumeur : mon panaris me dague (A rapprocher de dague, variété d'épée). - (24) |
| daguer. v. a. Donner un coup de coude à quelqu’un pour appeler son attention, pour l’avertir. (Percey). - (10) |
| dahoûler : avoir grand faim - (60) |
| dahu : animal imaginaire que l'on chasse - (48) |
| dahu. s. m. Être fantastique, imaginaire ; chose impossible à trouver. Chercher le dahu. Aller à la chasse au dahu. (Bléneau, Rogny, Champcevrais, Sommecaise). — Ce mot, par l’idée qu’il exprime, par sa consonnance et son orthographe presque identique, nous semble être le même que dâlu, employé dans le Berry, et qui est la personnification de l'onglée, dont on fait peur, l’hiver, aux enfants. V’là le dâlu qui vient, cachez ben vous mains ; pernez garde au dâlu ! - (10) |
| dai, prép. tient lieu de la préposition à devant le pronom et marque ordinairement la possession : « c' chan-lai n'ô pâ dai lu », ce champ-là n'est pas à lui. - (08) |
| dai, s. m. doigt. - (24) |
| daïau : Dé à coudre. « J'ai pardu man daïau », j'ai perdu mon dé. - (19) |
| daicrouvi. (L’r ne se prononce pas). v. a. Découvrir. (Ménades). - (10) |
| daidoumaizement. s. m. Dédommagement. (Ménades). - (10) |
| daidoumaizer. v. a. Dédommager. (Ménades). - (10) |
| d'aidrouet : exp. À l'endroit. - (53) |
| daig'nale : fruit désséché - (48) |
| daigne : Brin de chanvre roui et prêt à être dépouillé de son écorce. « Je va tilli eune daigne », je vais teiller un brin de chanvre. - (19) |
| daigne*, s. f. pied de chanvre roui. - (22) |
| daigne, brin de chanvre, pilon d'étang. - (05) |
| daigne, n. fém. ; tige de chanvre. - (07) |
| daigne, tige de chanvre non dépouillée de son écorce : « eune pougnie d'daignes », une poignée de chanvre. - (08) |
| daigne. Digne, dignes : c'est aussi le verbe je dîne, ai daigne, il dîne… - (01) |
| daignée. Dînée. - (01) |
| daignes (n.f.pl.) : tiges de chanvre brut - (50) |
| daignes ou degnes. - En Franche-Comté dagnes (Tiss.), tiges de chanvre (Del.) - (06) |
| daignes, tige de chanvre... - (02) |
| daigni : Daigner. « Je li ai écrit eune grande lattre, o n'a pas daigni me répandre ». - (19) |
| daignon, s. m. écorce de la tige de chanvre, appelée « daigne » en patois. - (08) |
| daigt (on) : doigt - (57) |
| daiguenâlé, adj. desséché, flétri. - (08) |
| daillant. s. m. Qui court fort, qu’on ne peut pas arrêter. Se dit, par ironie, d’un musard, d’un individu lambin, paresseux. De dailler. (Perreuse). - (10) |
| daille : s. f., dail, faux. - (20) |
| dailleau (on) : dé (à coudre) - (57) |
| dâiller (v. int.) : courir en tous sens dans les prés, en parlant des bovins, pour échapper aux mouches ou aux moustiques par temps d'orage - (64) |
| dailler : se dit des vaches qui courent de tous côtés par temps d'orage. (P. T IV) - Y - (25) |
| dailler : v. a., faucher. - (20) |
| dailler. v. - S'enfuir d'une manière désordonnée, en parlant du comportement d'un animal qui s'est fait piquer ou mordre. Se dit également pour l'homme : « L'Jean Louis i' s'est foutu un coup de martieau su' l'pouce, te l'aurais vu dailler ! Il enf'sait eune vie ! » - (42) |
| dailler. v. n. S’enfuir, courir d une manière folie, désordonnée, en parlant des bêtes à cornes piquées par les taons. — Précédé du verbe faire , Dailler signifie mettre en marche, faire partir, exciter, presser. — Il est formé du d duphonique et du présent du subjonctif du verbe aller : que faille, que tu ailles, etc. ; en sorte qu’au lieu de dire : aller, faire aller, faire daller, on dit : dailler, faire dailler. (Puysaie). - (10) |
| daillette : s. f., glane, poignée d'épis ramassée dans le champ après l'enlèvement des gerbes. Voir jevalle. - (20) |
| daillot : dé à coudre - (51) |
| daimannézer. v. a. et n . Déménager. (Menades). - (10) |
| daime. Dame, dames… - (01) |
| daimegeoizon. s. f . Démangeaison. (Ménades). - (10) |
| daimerotte (n.f.) : mésange (damerette = petite dame) - (50) |
| daimerotte, s. f. damerette ; mésange ou petite dame. - (08) |
| daimezer. v. a. Démanger. (Menades). - (10) |
| daimoinge. v. a. Démancher. (Id). - (10) |
| daimôler. v. a . Démêler. (Id). - (10) |
| daimou (loc.adv.) : en haut - (50) |
| daimouaiche, damouaiche : n. f. Mésange. - (53) |
| daimouèç’e (lai) : (la) mésange - (37) |
| daingé. Danger, dangers. - (01) |
| dainger, s. m., danger : « Gare donc ! gare donc, l'émi ! — Bah ! y a pas d’dainger ! » - (14) |
| daingne - tige de chanvre. - Ine daingne queman cequi, ma regairdez don ! pourro préque servi d'aiguillon. - (18) |
| dainme, sf. dame. - (17) |
| daipeurer : être en sueur, finir de traire une vache, faire égoutter un fromage - (39) |
| d'aiquan : avec. (MM. T IV) - A - (25) |
| daiquand : avec - (48) |
| daiquand : avec - (39) |
| dair (n.m.) : faux (aussi dar) - (50) |
| dair, s. m. dard, faux à faucher les prairies : un bon « dair » ; aiguiser son « dair. » - (08) |
| dairaint, dairo, etc. - divers temps du verbe daivoir. - (18) |
| dairape : accapareur, courageux. Ol o dairape : il ne craint pas l'ouvrage. - (33) |
| daird - faulx. - Voiqui les foins q'aipruchant, en fau qui aichetâ un daird. - Aipote moi voué l'enclieume qui embettâ le daird, cair â ne coppe pu. - (18) |
| daird : faux (outil), dard d'insecte - (48) |
| d'airé de r'veun : n. m. Aller-retour. - (53) |
| dairé, adv. derrière, en arrière. - (08) |
| dairé, dairére. s. m. et f. celui ou celle qui est en arrière, qui est le dernier ou la dernière : « voiqui l’dairé d'mé p'tiôs », voici le dernier de mes enfants; « ç'ô mai feille lai dairére », c'est ma fille la dernière. - (08) |
| dairérement, adv. de temps. dernièrement, il n'y a pas longtemps. - (08) |
| dairien, dairienne. : (Dial.), dernier, dernière. (S. B.) - En patois, darei, dernier ; darèrement, dernièrement. - (06) |
| dairoguer. v. a. Désenrouer. (Id). - (10) |
| daisqueûtaîyer : discuter pour rien - (37) |
| daissorcler. v. a. Désensorceler. (Ménades). - (10) |
| daitou : avec - (39) |
| daivantaige. Davantage. - (01) |
| daivarse ! (ai l’ot) : (elle est) changeante, d’humeur et de caractère ! (elle est) instable ! - (37) |
| daivau (loc.adv.) : en bas (d'aval) - (50) |
| daivau, loc. adv. en bas, le lieu situé à un niveau inférieur à celui où l'on se trouve. - (08) |
| daivö, prép. avec. - (17) |
| daivoir : v. t. Devoir. - (53) |
| daivoir, daivu, daira, etc. - divers temps du verbe devoir. - Vô dairains mieux gardai vos bêtes. - Nos pairents daivant veni nos voué. - Voyez doir. - (18) |
| daivou (prép.) : avec - (50) |
| daivou : avec - (48) |
| daivou : avec - (39) |
| daivou, aivou : prép. Avec. - (53) |
| daivou, prép. avec : « i m'en vé daivou lu », je m'en vais avec lui. - (08) |
| daix, n. masc. ; faux ; langue du serpent. - (07) |
| daiyat. daihiat. s. m. doigtlot, doigtier de peau, ordinairement détaché d’un vieux gant. - (10) |
| daizaler. v. a. et n. Degeler. (Ménades). - (10) |
| dâler (se) (v.pr.) : se sauver, s'enfuir en ruant, en parlant des animaux - (50) |
| daler (verbe) : comportement des bêtes à cornes lorsqu'elles courent en ruant et dressant la queue en l'air. - (47) |
| dâler : gambader, danser, sauter - (60) |
| daler : courir vite, se sauver à toutes jambes. Ex : "Eh ! Si t'avais vu la gamine coum' al a dâlé !" - (58) |
| dâler, v. n. aller de côtés et d'autres, flâner ; se sauver précipitamment, en parlant des animaux. - (08) |
| Dalô. Il y avait, depuis environ 1650 jusqu’à i660, à Dijon, une fameuse sage-femme nommée madame Dalot, qui avait la pratique de toutes les femmes de qualité de la ville, avant que les chirurgiens, avides du gain, se mêlassent de les accoucher. On entend donc ici par « lé Dalô », les sages-femmes en général, comme par les « Jobins » on entendrait à Pans les devineresses… - (01) |
| daluré (-e) (adj.m. et f.) : déluré (-e) - (50) |
| dâmairrer (pas) : (ne pas) quitter d’une semelle - (37) |
| dâmairrer : partir très vite - (37) |
| dame (la bonne). La Sainte Vierge, la Mère de Dieu. - (08) |
| dame : Dame, bourgeoise, personne au-dessus du commun. « Les dames de Tomeu». « Fare la dame », se donner du genre, prendre un air prétentieux. « Parler la dame », parler français. « Neut'dame », nom que les ouvriers, les vignerons, les domestiques donnent à la femme du patron, du propriétaire, du maître. « La dame bli-ainche » la dame bli-ainche apparaissait la nuit aux abords du lavoir de Vers ; il y a bien longtemps que personne ne l'a vue. - Grain de maïs qui a éclaté sur un poêle chaud. - (19) |
| dame de paris, n.f. libellule. - (65) |
| dame : s. f. perches transversales de la voiture montée en « chê ». - (21) |
| dame : s. f., grain de maïs qui a éclaté au feu ; gouey ou pied-de-veau, arum maculatum (à cause de son spadice floral enfermé dans une spathe foliacée, ce qui figure assez bien une statuette dans sa niche). - (20) |
| dame : s. f., perche de la longueur d'une ridelle, que, dans un char de foin ou de paille et pour en élargir le cadre, on introduit dans l'orifice spécial des grands colliers. L'ensemble des dames ct des grands colliers porte le nom de jeu de dames. - (20) |
| dame, bédame.- Interjection insistant sur l'idée énoncée : « A ! dame oui, les blés sortiront de bonne heure, et aussi les avouénes ! » (Colette, Claudine en ménage, p.354). Dès le XIVe siècle, cette interjection fut employée pour signifier « Par Dieu ! » Dame est issu du latin dominum, seigneur. Dame ! était également l' ellipse d'un ancien juron : par Nostre Dame ! - (42) |
| dame. Grains de maïs qu'on fait rissoler dans. la poêle et qui éclatent, nommés ainsi par métaphore de la robe blanche dont se revêtent ces grains sous l'action du feu. Ceux qui se gonflent et s'excorient moins s'appellent des monsieurs. Par extension , le verbe damer signifie se fendre. - (03) |
| dameloche. Mésange. - (49) |
| dame-lotse : bergeronnette. A - B - (41) |
| dame-ritsse : mésange - (51) |
| dames, s. f., même sens que Dragées (V. ce mot.) - (14) |
| dâmeûler : écarter ce qui était en tas - (37) |
| dam-ner (faire) : embêter, enrager ; è m'fé dam-ner : il me fait enrager. - (52) |
| dâmôler : démêler - (37) |
| damoutsu : (adv) là-haut - (35) |
| dan : Donc. « Y est dan vrâ ? », c'est donc vrai ? Dan en patois, comme donc en français, a pour effet de rendre plus pressante une injonction, mais avec moins d'énergie que donc, aussi s'emploie-t-il beaucoup plus fréquemment ; ainsi quand on dit : « Vins dan te siter », cela correspond simplement à viens t'asseoir. - « Dan in temps » (l'n se lie et on prononce dan-nin temps) , jadis. - (19) |
| dan, prép. dans (liaison avec n : dan-n'ène majon). - (17) |
| dan. Dans, préposition, et dents, substantif. « Su lé dents », sur les dents. - (01) |
| dandan : Dondon; grosse femme. « Eune dandan ». - (19) |
| dandelai, adv. au delà, de l'autre côté. - (24) |
| dandelai, adv. au-delà, de l'autre côté. - (22) |
| dandi, libertin. - (16) |
| dandingn', s. m. paresseux, flâneur, musard. - (08) |
| dandze : (nm) agacement de dents - (35) |
| dandze : agacement des dents par des fruits acides - (43) |
| dandzi n.m. Danger. - (63) |
| dangéreu, dangereu ; daugéreu vaut mieux que dangereux, puisque l'un et l'autre dérivent de danger. - (16) |
| dangeroux : Dangereux, redoutable (féminin : dangerouse) « O n'est pas bien dangeroux », il n'est pas bien à redouter. - (19) |
| dangi : Substantif Danger, risque. « Y a pas dangi que j'y alle », je me garderai bien d'y aller. - Verbe, importer. « Veux tu du roge ou du blianc ? Oh ! y ne dange pas », veux tu du rouge ou du blanc ? Oh peu importe. - (19) |
| dangraignar. Gondeur… - (01) |
| dangreignar. C'est comme si l'on disait avec un respect ironique : M. le greigne, M. le fâcheux, M. le bourru, M. l'homme insociable. On dit encore, dans certains pays, Jean-grognon et Marie-grognon. - (02) |
| dangreignar. : Façon comique de signaler une personne de mauvaise humeur. - (06) |
| danjeureu, euse, adj. dangereux, difficile, terrible. - (08) |
| dan-né : Damné « Ol est dan-né à tos les diabes», il est damné à tous les diables. - (19) |
| danné, damné (prononcer dan-né) ;s'danné, vivre mal. - (16) |
| danner, v. a. damner. On prononce dan-ner. - (08) |
| dan-ner, v. tr., damner : « V'tu ben te t'ni, qu'te m'fâs dan-ner! » - (14) |
| dan-nhaut, d'vélo, yamon, yamou : en haut - (43) |
| danouaîs (on) : danois - (57) |
| danouer (v.t.) : dénouer - (50) |
| dans : Dans. Le S ne se prononce jamais et l'n ne se lie pas sauf dans l'expression : « Dans in temps » qui se prononce « Dan nin temps ». - (19) |
| dans son pan : dans son tablier. (A. T II) - D - (25) |
| danseron. Danseront. - (01) |
| danseux. n. m. - Danseur. - (42) |
| dansi : (vb) danser - (35) |
| dansi : danser - (51) |
| dansi : danser - (57) |
| dansi v. Danser. - (63) |
| danson. Dansons. - (01) |
| dansou (féminin dansouse) : Danseur, cavalier « San dansou l'a ramenée », son cavalier l'a ramenée, l'a accompagnée. - (19) |
| dansou (on) : danseur - (57) |
| dansou, ouse, adj. et s. danseur, danseuse. « Dansoure » au féminin. - (08) |
| danssie, s. f. agacement des dents produit par l'oseille et les fruits verts. - (24) |
| danssue, s. f. agacement des dents produit par l'oseille et les fruits verts. - (22) |
| danvec : avec. IV, p. 1-2 - (23) |
| danzale : Fille d'honneur qui sert de chaperon aux futurs époux pendant toute la durée des fiançailles, elle les accompagne dans toutes leurs pérégrinations et porte le panier qui contient les sacs de dragées. - Ustensile qu'on suspend à la crémaillère et qui sert de support à la poêle à frire. - (19) |
| dâp’naîllé, dâgu’nîllé : mal vêtu, en loques - (37) |
| dâp’naîller : déshabiller de force - (37) |
| dâpairt’ment (l’) d’lai niâv’e : (le) département de la nièvre - (37) |
| dapaitouiller (s’) : (se) tirer comme l’on peut d’une situation difficile - (37) |
| dapaitouiller : trier, démêler, classer, aider - (37) |
| dapiaicer (v.t.) : déplacer - (50) |
| dapicasser (v.t.) : désensorceler - (50) |
| daplouner. v. - Remettre d'aplomb. Se dit également d'une personne qui retrouve la santé. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| dapouècer (se) (v.pr.) : se dépêcher - (50) |
| d'après, prép., après. Deux gamins jouaient sur l'herbe. L'un s'arrête, dit à l'autre : « Y é toi qui vas m'côri d'après » et se sauve. (V. Après.) - (14) |
| daquan (prép.) : avec (aussi daiquan) - (50) |
| daquan, daiquan, prép. avec, en même temps que : « i beuvô daquan lu », je buvais en même temps que lui, avec lui. - (08) |
| dâquiairer (s’) : pour un jeune homme, demander officiellement en mariage une jeune fille à ses parents - (37) |
| dâquîller : renverser, abattre à terre, faire perdre l’équilibre - (37) |
| dar : faux. - (29) |
| dar : faux - (39) |
| dâr, s. m., faux à maux ; lame de rasoir. - (40) |
| daraise : (nf) ridelle du char - (35) |
| daraise : ridelle d'un char à fourrage - (43) |
| daraise : s. f., ridelle pleine. - (20) |
| daraise, n.f. ridelle de char. - (65) |
| daranger (v.t.) : déranger - (50) |
| dâranzé : qui n’a pas tous ses esprits - (37) |
| dâranzer (s’en) : (s’en) occuper, (s’en) renseigner - (37) |
| daraÿ, adv., derrière. - (40) |
| daraze, s. f. ridelle de char à claire-voie. - (22) |
| darbon : s. m., taupe, et, par analogie avec le travail de cet animal, talus de terre qu'on élève entre deux rangées de ceps lorsqu'on donne la première façon à la vigne. Nom fréquent de lieux-dits dans la campagne. - (20) |
| darbon, n.m. taupe. - (65) |
| darbonner : v. a., mettre la terre en darbons. - (20) |
| darbonnie : s. m., taupier. - (20) |
| darbonnière : s. f., taupinière. - (20) |
| dard (nom masculin) : faux. - (47) |
| dard (un) : une faux - (61) |
| dard : faux - (44) |
| dard : FAUX - (60) |
| dard : faux emmanchée pour couper le foin, les céréales - (37) |
| dard : faux. - (52) |
| dard : une faux. - (33) |
| dard : la lame de la faux. Battre le dard, c'est aiguiser la lame de faux en la frappant sur la partie tranchante (un rasoir !) au marteau biseauté sur une petite enclume en forme de coin fiché en terre. L'opération, assez longue, et minutieuse, se faisait assis sur le sol, jambes ouvertes, de part et d'autre de l'enclume "pour être à soun' adrèt". Ex : "N’y tomberait ben des dards !…" Qui signifie que l’on sortirait ou que l’on irait ici ou là si on l’a décidé et quoi qu’il se passe et/ou advienne. - (58) |
| dard : n. f. Faux. - (53) |
| dard : s. m., grande faux. - (20) |
| dard, derd. s. m. Faux; ainsi appelée peut-être, parce que, suivant Jaubert, la faux, emmanchée à rebours, ressemble à une sorte de dard, à une lance. - (10) |
| dard, faulx. - (05) |
| dard, n.m. faux (outil). - (65) |
| dard. Faulx. Ce mot, qui désigne toute arme de trait, s'applique par extension à cet instrument à cause de sa forme. - (03) |
| dard. Faux. - (49) |
| dard. Faux. II est vrai que l’on a quelques exemples du mot dard pour désigner une faux étroite à jardin. Mais nous l'appliquons à toutes les faux quelles qu'elles soient. - (12) |
| dard. n. m. -Faux. - (42) |
| darde, faulx à lame étroite. - (05) |
| dardée. n. f. - Laps de temps non régulier, discontinu, généralement assez court ; exécuter un travail par dardée ; le faire en plusieurs fois, irrégulièrement. « Je n'travaille que par dardée, eprés j'm'eurpose je n’fais pus ren. » (Fernand Clas, p.86) - (42) |
| dardée. s. f. Laps de temps non régulier, intermittent, capricieux, et généralement assez court, que l’on met à faire une chose. — A dardée, par dardée, loc. adv. De temps en temps, par échappée soudaine, intermittente, ainsi que, par un temps couvert, se produisent tout à coup ces rayonnements, ces échappées lumineuses, que de temps à autre darde le soleil à travers les nuages. — Faire un travail par dardées, le faire irrégulièrement, à plusieurs reprises. — Travailler par dardées, travailler par soubresauts. - (10) |
| dardenne : un liard. - (09) |
| dardenne. n. f. - Ancienne monnaie de deux liards. - (42) |
| darder, v. n. se dit d'une roue de voiture qui glisse sur un plan incliné et ne tourne pas d'aplomb avec l'autre. Plusieurs prononcent « barder. » - (08) |
| dardes : dartres. IV, p. 28 - (23) |
| daré : derrière (préposition), dernier (en B : déri). A - (41) |
| daré (nom) : fesses, derrière - (39) |
| dâré : derrière - (48) |
| dâré : derrière. - (66) |
| darè : Derrière. « Ol était caichi darè la pôrte », il était caché derrière la porte. « Devant le porteau, darè la grange, darè la grange, devant le porteau » vieux refrain qui se répète indéfiniment en manière de scie. - « Le darè », le dernier. « Les pains les darès anfornés sant tiris les premés ». - (19) |
| daré : Partie inférieure et postérieure du corps humain. « Ol a cheut su san daré », il est tombé sur ses fesses. - (19) |
| daré (préposition) : derrière - (39) |
| dâré : adj. et n. Dernier - (53) |
| daré : derrière. - (32) |
| daré, adv. derrière. - (17) |
| daré, derrière. - (27) |
| daré, postérieur. - (26) |
| darêche : ridelle d'un chariot à fourrage (en B : dérèse). A - (41) |
| dârée. s. f. Denrée, objet de peu de valeur. - (10) |
| darège, s. f. ridelle de char à claire-voie. - (24) |
| darèges, darèches n.f.pl. (du gaul. doratia, dérivé de dor, la porte). Ridelles de char. - (63) |
| dàrei, prép., derrière : « V'là l'char à Toinot qui veint ; j'vas gravicher dàrei. » — « Y a eùn grô-t-âbre pô dàrei cheû nous. » - (14) |
| dàrei, s. m., le derrière : « Alle a chù su son dàrei, » ce qu'on appelle : casser le verre de sa montre. - (14) |
| dàreirement, adv., dernièrement. - (14) |
| daresse. Ridelle. - (49) |
| dargnasse : s. f., femme ou fille paresseuse et trainarde. « Sacrée grande dargnasse, te n' peux donc pas venir... On voit ben que t’es née deux heures en retard ; te n’les rattraperas jamais... » - (20) |
| dargnier. n. m. - Dernier. - (42) |
| dargnole. n. f. - Gifle, déformation du mot familier torgnole. (Perreuse, selon M. Jossier) - (42) |
| dargnole. s. f. Grand coup du revers de la main. (Ferreuse). - (10) |
| darié (adverbe) : derrière. - (47) |
| dâriè : derrière. On trouve ce terme au Moyen Age avec la rue Darriez le Castel - (46) |
| dàrié, et dàrei, adj., dernier. - (14) |
| darin, dernier. - (26) |
| dariner. v. a. Faucher. De dard, faux. - (10) |
| darinre, dernière. - (26) |
| darlionier, darliouni : s, m., instrument tranchant, couteau (généralement déguillemanché). Dans I'Autunois, le mauvais couteau s'appelle « armelle ». Il a changé son couteau en armelle, veut dire : il a quitté une bonne situation pour en prendre une mauvaise. - (20) |
| darné(re) : dernier(e) - (39) |
| darne. adj. Qui est lourd, endormi, fatigué, sujet aux étourdissements, aux vertiges. — Mouton darne, mouton atteint du tournis. - (10) |
| darne. s. f. Tranche, portion, morceau de viande coupé dans le sens de la longueur. - (10) |
| darner (adj.) : dernier - féminin darnére : dernière - (50) |
| darnéyer. v. n. Etre darne, avoir la tète lourde, des étourdissements, des vertiges. Voyez darne. - (10) |
| dârnier : dernier (dârnière au féminin) - (46) |
| darniot. adj. A qui la tète fait défaut, qui est idiot, fou, imbécile. Voyez darne. - (10) |
| darö, öre, adj. dernier, dernière. - (17) |
| darörement, adv. dernièrement. - (17) |
| darrai,adj. dernier ; adv. derrière. - (38) |
| dârré (l’) : (le) derrière (arrière-train, animal ou humain) - (37) |
| dârré (pair) : (par) derrière (lieu) - (37) |
| darré : derrière. - (62) |
| darré : derrière. Por darré : par derrière (la maison). Ma tante n'admettait pas qu'une fille coure « au darré » d'un garçon ! - (52) |
| darré ée, adj., dernier. Ex. : cet enfant est le tout darré, on m'a placé le tout darré, pour au dernier rang. - (11) |
| darré signifie encore la partie postérieure d'une personne ou d'un animal : not’ Médor ast souvent chorté su son darré. - (13) |
| darré : dernier. - (32) |
| darré, derré, même derre - dernier et derrière. Al à venu le darré queman son habitude. - Passe don derré lai voiture. - Mairche darré lu. - (18) |
| darré, derrière - (36) |
| darré. Derrière, pour lequel on a dit : darrière, autrefois. - (03) |
| darré. Derrière, préposition. Quand un homme a peiné beaucoup à quelque travail de corps ou d'esprit, on dit qu' « el an suë darré les oraille », qu'il en sue derrière les oreilles. - (01) |
| darré. Derrière. Darrè chez neus est une façon de désigner la cour et le cortil. - (13) |
| darrei, derrière. Darei, dernier. Darérement, dernièrement. - (02) |
| darrei. Dernier, derniers… - (01) |
| darrer (prép.,adv.) : derrière (aussi daré, dairé = derrière) - (50) |
| dârrer, dârnier : dernier (contraire de « preûmer » : premier) - (37) |
| darrer. Derrière. - (49) |
| darret. s. m. Derrière. — All’ a chuté su son darret un fichu coup. — (Quincerot). - (10) |
| darri, derri adv. Derrière, en arrière, à l'arrière. - (63) |
| darri, derri n.m. Derrière, fesses. - (63) |
| dârriar’ment : dernièrement - (37) |
| d'arrié, loc. adv., en arrière, de derrière : « Arra doû d’arrié ! » Vite en arrière ! — Langage de nos mariniers. (V. Arra, et D'avant.) - (14) |
| darrié. n. et prép. - Derrière. - (42) |
| darrier : derrière. On marcho lentement darrier : on marchait lentement derrière. - (33) |
| darrier, dârger, dôrée. s. m. Derrière. Le darrier de la maihon. Siète-te su ton dârger. Le dôrger de la tête. — S’emploie aussi comme adverbe et comme préposition. Va-t-en dârger. Il vient darrier moi. - (10) |
| dârrniâr’ment : dernièrement - (37) |
| darte, dartre. - (16) |
| darte, s. f., dartre, et presque toute maladie de peau. - (14) |
| darte, s. f., dartre. - (20) |
| dâryé, dêryé, derrière et dernier. On dit aussi dâré, dans les deux sens. - (16) |
| das (art.déf.cont.) : des - (50) |
| das, pron. des : « das houmes, das fonnes. » - (08) |
| dâscié (du bouais) : (du bois) scié dans le sens de la longueur - (37) |
| dâs-coûté (l’) : (le) côté - (37) |
| dassabre : "t'es t'y dassabre" en s'adressant à un enfant : "tu es insupportable, tu n'arrêtes pas de t'agiter" - (60) |
| dasseingn', s. m. dessein, projet. - (08) |
| dasseu (la) : agacement des dents. - (21) |
| dâssiâler : démolir, abattre, jeter à bas - (37) |
| dassoler : ebranler, affaiblir (dessgnôler) - (60) |
| dassolu : gourmand - (60) |
| dâssouaiffer (s’) : boire, étancher sa soif - (37) |
| dassouayer (v.t.) (v.pr.) : désaltérer, se désaltérer - (50) |
| dataicher (v.t.) : détacher - (50) |
| dataurner (v.t.) : détourner - (50) |
| dâteûrnant : tournant sur la route, virage - (37) |
| dâteûrnant : virage sur la route - (37) |
| datôler (v.t.) : dételer ; arrêter le travail - (50) |
| dâtoler : dételer, s’arrêter de faire un travail - (37) |
| dâtor, s. m. détour, circuit, au propre et au figuré. - (08) |
| dâtorber : « déprendre » d’une occupation - (37) |
| datte : Dette. « Qui paye ses dattes s'enrichit ». « Ol a payé sa datte », il est mort. - (19) |
| dau (n.m.) : dé à coudre - (50) |
| dau- Dé à coudre. - Me voiqui fraiche ; i ai perdu mon dau !! Quemant don qui vas fâre pou coudre ? - (18) |
| dau, s. m. dé à coudre. - (08) |
| daûbé, adj., altéré, fatigué, en mauvais état. - (40) |
| daubée. s. f. Volée de coups de poing ou bâton. (Athie, Nitry). - (10) |
| daubrè : idiot - (48) |
| dauchouére. Casserole. - (49) |
| d'au-dechus (loc.adv. et prép.) : en haut - (50) |
| d'au-dessaus (loc.adv. et prép.) : en bas - (50) |
| Daudiche, nom propre, Claudine. - (38) |
| Daûdit (l’) : sobriquet, en 1934, du sabotier henri de st léger-de-fougeret - (37) |
| daûdit : (grosse) atténuation de dadais, homme simple très gentil - (37) |
| Daudo, nom propre, Claude. - (38) |
| Daudon : Claudine. « La mère Daudon ». Peu usité, vieux. - (19) |
| Daudon, Daudonne, Daudine, nom de femme ; diminutif de Claudine. - (08) |
| Daudon, nom propre, Claudine. - (38) |
| Daudy : diminutifs de Claude - (48) |
| dauge, s. f., pourriture, maladie qui attaque les troupeaux de moutons. On l'appelle aussi : limace du foie. C'est, dans le ventre, à peu près le même mal que le tournis dans le cerveau. - (14) |
| daugnot (adj.) : douillet, en parlant d'une personne - (64) |
| daumaie (n. f.) : longue veste que l'on portait autrefois – par extension, désigne un vêtement long et enveloppant - (64) |
| daumère (?) : veste longue. - (33) |
| dauphinés : colporteurs venus du Dauphiné. VI, p. 73 - (23) |
| dauqueune, adj. des deux genres. quelque, quelqu'un = aucun. - (08) |
| dausse. Surnom. - (49) |
| davanz-hiâ : avant-hier - (57) |
| dave ou daveu : Avec. « Mère qu'est ce que tu me donne pa miji dave man pain ? In bout de fremage, ma fa bien attentian de bien miji tan pain daveu ». Dave s'emploie dans le cours de la phrase et daveu à la fin. - (19) |
| dave ou daveu, prép. avec. - (22) |
| d'ave, d'aveû: (prep) avec - (35) |
| dave, davo, davto adv. Avec. - (63) |
| dave, ou daveu, prép. avec. - (24) |
| davedoué. s. m. Petit cylindre de bois sur lequel s’enroule le fil que l’on dévidé. (Sainpuits). - (10) |
| daventer : v. a., aventer. - (20) |
| davère. Oui vraiment - Je ne connais qu'un seul village où cette locution soit usitée : c'est celui de Savigny. Les Picards disent dam vere. Du latin vere. (V. voire.) - (13) |
| davider (v.t.) : dévider - (50) |
| dâvideûre : difficile à contenter, qui ne mange pas n’importe quoi - (37) |
| davie : pourquoi ? - (09) |
| davô, d’vèl-bas, yavô : en bas - (43) |
| davoir : Devoir (au participe passé : davu). « Ol ame mieux davoir que de fare teut », il ne paye pas ses dettes. - (19) |
| davou : (adv) où, d’où : « davou qu’te vins ? » (d’où viens-tu ?) - (35) |
| davou : avec. - (62) |
| davou, daveu, avec ; davou, daveu lu, avec lui. - (16) |
| d'avòu, prép., avec : « V'tu v'ni d’avou moi ? J'vons còri les champs. » - (14) |
| dâvouaîrant (ain), (ain) vorâillant : (un) homme actif, « dur au travail » - (37) |
| davouérer (v.t.) dévorer (aussi davouairer) - (50) |
| dayard, daiard (daîard), dayot, daiot (daïot) : s. m., dé à coudre ; digitale (digitalis purpurea). - (20) |
| däyau : (nm) dé à coudre - (35) |
| da-yau : dé à coudre, dé en fer que l'on mettait pour se protéger les doigts des épines - (43) |
| dayau, n.m. dé à coudre. - (65) |
| dâyeû d’zarbes : délieur de gerbes, au sommet de la « batteuse » - (37) |
| dàyô, s. m. dé à coudre. - (22) |
| dàyô, s. m. dé à coudre. - (24) |
| dâz’lée : correction corporelle - (37) |
| dâzai : déjà - (37) |
| dâzigaûder : démonter sans classer - (37) |
| dâzoler : dégeler - (37) |
| d'biter (verbe) : (Se) perdre, se détériorer. Se dit surtout en parlant de la nourriture. - (47) |
| d'biter : gâcher, briser - (60) |
| dbout : debout - (51) |
| d'Breu : n. pr. De Breuil, petit bois près de La Forêt. - (53) |
| d'conte. prép. - Contre : « Mets don' l'ratiau d'conte le mur avant qu'on s'empige. » - (42) |
| ddans prép., adv. et n. Dedans. Le ddans vaut pas l'djhô ! L'intérieur ne vaut pas l'extérieur. - (63) |
| dè : doigt. - (21) |
| de bidel. loc. adv. - De travers. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| de cafe : Impair, ou plutôt le reste de la division par deux d'un nombre impair. « Le premé va dave le segand, le troisième dave la quatrième, le cintieme est de cafe ». - (19) |
| de ces : loc,. des. S'emploie avec « plus » ou « moins ». Mon mari peut pourtant pas travailler tant qu’ça ; i n'est pas de ces plus solides. Dites donc, c'te maison, elle n'est pas de ces mieux bâties. La Mère X... n'est pas non plus de ces moins diseuses. - (20) |
| de che de lé : De ci de là, par ci par là. Peu usité. - (19) |
| de contre, prép., contre: « Voui, allé étôt drè d’contre moi. » - (14) |
| de cosse : (adv) subitement, d’un coup - (35) |
| de cosse : subitement, d'un seul coup - (43) |
| de d’là. Préposit. adverb. Un peu plus loin, au-delà. La Vierge de d'là l’eau, ancienne fête patronale d’Auxerre. - (10) |
| de d’puis, dett’pis. adv. Depuis. - (10) |
| de depeu, prép., depuis : « Comme álle a poussé, de d'peù l'an dârei ! álle é ben gentite ! » - (14) |
| de d'là. prép. - Au-delà. - (42) |
| de l’aute couté, de védlé : de l'autre côté - (43) |
| de les, art. des, mais seulement au féminin : de les vaches. - (22) |
| de n. Noble, bourgeois, riche. Y'est des "de". Ce sont des nobles, des riches en général. - (63) |
| de pointe, loc. debout. - (22) |
| de pointye, loc. debout. - (24) |
| de prép. à. Y serve de ren. Ça ne sert à rien. - (63) |
| de qua : Fortune, richesses, moyens. « Y est les riches qu'ant le de qua (sousentendu : vivre heureux) ». - (19) |
| de quoi (le) - argent, moyen d'acheter, de se procurer quelque chose. - A sont heureux, ceux lai, al an le de quoi. - Ah si ai va le de quoi ! - (18) |
| de quoi, s. m., bonne position, fortune. Se prend dans le sens absolu. Avoir « de quoi », avoir de l'aisance, être riche : « O vout marier sa fille ; ôl a d'quoi. » - (14) |
| de r’vin-de r’va : aller – retour. - (62) |
| de sé quand (Dieu sait quand !) Locution dubitative par laquelle, dans la conversation, on exprime qu’un temps, une époque, un fait dont on parle, est tellement reculé, que Dieu seul en connaît la date. (Grandchamp). - (10) |
| de : prép. S'emploie irrégulièrement entre deux verbes dont le second est le complément direct du premier. Croire de, croire. Quand i croit de mâcher, il avale. - Remplace également la préposition à entre deux verbes. - (20) |
| dé : s. m., quantité de vendange contenue dans le pressoir. - (20) |
| dé(s)honter, verbe transitif : faire honte, faire des reproches. - (54) |
| de, prép. entre clans la composition de certaines prépositions. Dà = à (dà c'teure), d'après = après (d'après c'temps-lai), daivö = avec. - (17) |
| de, prép. parasite : « Que qu'te vôu que j'te dise? — J'n'en sais ma fi, de ran. » - (14) |
| dé. Des, tantôt préposition, tantôt article pluriel, servant à divers cas. - (01) |
| de. Notre patois supprime la préposition dans un grand nombre de cas. Nous disons la fille Grand-Pierre se marie avec Jean. - (08) |
| dé. prép. - De : « On va ben s'bouère un p'tit verre dé cide ! » - (42) |
| déambler. : (Dial.), promener, dans le sens de faire mouvoir, et, par conséquent, dans le sens actif. (Du latin deambulare.) - (06) |
| déanger. v. - Détruire, enlever les mauvaises herbes. (Villiers-Saint-Benoît, selon M. Jossier) - (42) |
| déanger. v. a. Détruire les mauvaises herbes d’un champ. J’ai eu beau labourer, je n’ai pas pu déanger l’herbe. (Villiers-Saint-Benoit). - (10) |
| déargoter (pour désergoter). v. a. Enlever un orteil, un ongle, un ergot. (Villeneuve-les-Genêts). - (10) |
| déargoter. v. - Plusieurs usages : 1. Enlever les ergots, les ongles. 2. Faire le maximum, s'efforcer de faire plaisir sans en être remercié. 3. Se déshabiller. - (42) |
| déaste, s. m. désastre. - (08) |
| déauberner. v. - Perdre ses plumes, en parlant des volailles. - (42) |
| déauberner. v. n. Muer, perdre ses plumes, en parlant des poules et des voailles. (Villiers-Saint-Benoît). - (10) |
| déb’sonnés, débessonnés. adj. m. pl. Se dit, à Villiers-Saint-Benoit, d’un chien et d’une chienne qui ne sont plus embessonnés , qui viennent de se désaccoupler. De de, particule extractive, et de bisso. - (10) |
| débadigouinche (ça). exp. - Ça se décroche, ça se démanche. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| débagagi, v. a. déménager. - (22) |
| débagagi, v. a. déménager. - (24) |
| débagoèsser : dire des âneries - (39) |
| débagouler, v. n. tomber en coulant, en débordant. L’eau « débagoule « d'un vase trop plein. - (08) |
| débagouler, v. tr., raconter, parler avec abondance, laisser couler le bagou : « Ah ben! si t’l’écoutes, ô va t'en débagouler, voui ! » - (14) |
| débaigôlai. : Dire des gueulées, vomir des injures, des sottises. (Del.) - Quel bagout! signifie quel verbiage de mauvais aloi. - (06) |
| débaigolay, parler vite et beaucoup... - (02) |
| débaillai : parler. Ne pas débaillai : ne pas parler. - (33) |
| débâillè : 1 v. t. Parler, déballer. - 2 v. i. Déblatérer - (53) |
| débâiller (ne pas), verbe transitif : ouvrir la bouche pour parler. - (54) |
| débâiller (s') (v. pr.) : ouvrir la bouche pour parler (té peux pas t'débâiller ?) - (64) |
| débailler. v. - Ouvrir la bouche : « l' n'a pas dé baillé d'la soirée l'pour vieux ! » Le préfixe d'insistance de s'ajoute au verbe baîller. - (42) |
| débâiller. v. n. et v. a. Se décider à parler, ouvrir la bouche pour parler. Voyons, débâilleras-tu aujourd’hui ? — S’emploie souvent avec la négation. Il ne veut pas, il ne sait pas débâiller, il ne veut pas parler, il ne sait rien dire. Il est si bête, qu’il ne peut pas débâiller un mot. - (10) |
| débairboiller, v. a. débarbouiller, laver la figure ou le corps. - (08) |
| déballoter. v. - Déménager. (Sommecaise, selon M. Jossier) - (42) |
| déballoter. v. a. Déménager. (Sommecaise). - (10) |
| débandener : Enlever la bonde. « Le bandan avait été treu chauchi, j'ai trapi pa débandener s'te feute », la bonde avait été trop enfoncée j'ai eu du mal à l'enlever de cette futaille - (19) |
| débâquie : la débâcle - (46) |
| débaquié. Débâcle. - (49) |
| débarâ ; s'àt ein bon dèbarâ se dit quand une personne à charge quitte uno maison. - (16) |
| débaranclié : Débraillé. « Rentre voir à la maijan, an ne va pas les chemins c'ment cen to débaranclié », rentre à la maison, on ne sort pas ainsi tout débraillé. - (19) |
| débaraté, adj. débraillé. - (22) |
| débarboïlli v. Débarbouiller. Va t'débarboïlli, t'es na cment la cache ! Va te débarbouiller, tu es noir comme la poêle. - (63) |
| débarboïlli: Débarbouiller. « Va dan débarboïlli tes ptiets (tes enfants) ». Au figuré : « Le temps se débarboïlle », le ciel s'éclaircit. - (19) |
| débarboillou : Linge de toilette. - (19) |
| débarbouilli : débarbouiller - (57) |
| débarbouilloir : s. m., serviette de toilette. - (20) |
| débarbouilloir. n. m. - Gant et serviette pour la toilette. - (42) |
| débarder : enlever et transporter le bois hors de la forêt. - (59) |
| débarder. v. a. Déblavar, enlever la récolte d’un champ, les bois d’une coupe. — Signifie aussi, tirer une voiture d’un mauvais pas. - (10) |
| débardouyi, v. a. débarbouiller. - (22) |
| débarenflé. Débraillé, mot expressif dont j'ignore l'étymologie. D'une personne qui a une fluxion, nous disons qu'elle est bourenfle. - (03) |
| dé-Barôsoo. De Barôzai, qu’on dit avoir été un vigneron fort éloquent dans son langage bourguignon, le poëte a fait le verbe dé-barôzai , dont débarôzoo est l'imparfait, pour donner à entendre que la famille des Barôzai perdrait peu à peu cette naïveté de patois , conservée si longtemps par leurs prédécesseurs… - (01) |
| débarouiller : déguerpir. - (30) |
| débarouler : tomber (déberdouler) - (60) |
| débarouler : tomber en roulant - (51) |
| débarouler v. Tomber en roulant. Fig. Arriver bruyamment et à l'improviste. - (63) |
| débarouler : v. n., dégringoler, rouler en bas. - (20) |
| débàrouler, v. intr., rouler en bas, dégringoler : « Ol a débaroulé tous les escaliers de sa cave. » - (14) |
| debarôzai (se). - C'est se défaire de la naïveté du patois de sa famille de vignerons, pour parler un langage choisi. (Voir au mot bai.) - (06) |
| débarréchi v. Débarrasser. - (63) |
| débarrer (v.t.) : laisser sorti, ouvrir (enlever la barre) - (50) |
| débarressi : débarrasser - (43) |
| débarressi : débarrasser - (51) |
| débarressi : délivré du placenta après la naissance des animaux uniquement - (51) |
| débarressoure : placenta après l’expulsion post natal (se dit pour les animaux uniquement) - (51) |
| débarrouler : dégringoler - (43) |
| débau, s, m., suspension, temps d'arrêt, repos. - (14) |
| débaubir. v. a. Dégourdir. — Voyez abaubir. - (10) |
| débauchi : débaucher - (57) |
| débauchi : Débaucher, empêcher de travailler. « Ne vins pas bavarder dave mes ovrès (ouvriers) pa les débauchi ». - (19) |
| débaujé, (débô:jé - v. tr.) faire sortir (un lièvre) de son gîte. - (45) |
| débecqueter : vomir, mais aussi détester quelqu'un. - (66) |
| débeloise : cafetière. - (30) |
| déberboiller. v. a. Débarbouiller. - (10) |
| déberdailler. v. n. Tomber avec fracas. (Merry-la-Vallée). - (10) |
| déberdiner. v. - Dégourdir, rendre moins berdin, moins bête. - (42) |
| déberdouler : tomber (débarouler) - (60) |
| déberlouir. (Se). v. a. Sortir de l’état d’éblouissement où l’on se trouve. Quand on a travaillé, marché, lu ou écrit au soleil ou par une lumière trop vive, et qu’ensuite on passe dans un endroit un peu sombre, les yeux, dont la pupille se trouve rétréci, ne voient plus qu imparfaitement, il leur faut quelques instants pour se déberlouir, c'est-à- dire pour que leur pupille se dilate et permette aux rayons lumineux qui la traversent d’aller se réfléchir sur la ratine. - (10) |
| débernacler : débarrasser - (61) |
| débernacler : faire du désordre - (60) |
| débernâcler, débeurnâcler. v. a. Débarrasser, démolir, briser. Être débernâclé, être débarrassé. (Argentenay). - (10) |
| déberner (pour débrener). v. a. Nettoyer, démerder ; délivrer, débarrasser. — Me voilà enfin déberné de lui ; ce n’est pas dommage. - (10) |
| déberner, débeurner. v. - Nettoyer, débarrasser. Au figuré : se débarrasser de quelqu'un. - (42) |
| déberteller. Tomber de tous côtés, par morceaux. Se défaire, s'effondrer. - (49) |
| débêter. v. - Dégourdir, donner son savoir, son expérience à quelqu'un afin de le rendre moins bête. - (42) |
| débêter. v. a. Donner un peu d’expérience, faire qu’on soit moins naïf ou moins niais. — Se débêter, v. pron. Se décrasser, se dégourdir un peu d’esprit, se déniaiser. (Perreuse). - (10) |
| débeuiller : v. a., ébouler. Voir ébeuiller. - (20) |
| débeurdandler v. Démolir, démonter en cassant. - (63) |
| debeurdé : v. t. Débarrasser, dégager. - (53) |
| débeurder : Débrider, faire une halte. « Je venins de fare tra lieues sans débeurder », nous venons de faire trois lieues tout d'une traite. - (19) |
| débeurdiner v. Ramener à la raison, rendre moins bête. Voir beurdin. - (63) |
| débeurdiner, verbe transitif: dégrossir, rendre plus intelligent. - (54) |
| débeuriaudé : 1 adj. Débraillé. - 2 Démonté (en désordre). - (53) |
| debeurnaclé se dit d'un vêtement qui ne tient plus au corps, d'un meuble disjoint, d'un outil démanché. Au faut l’aippeler pour recoude ses brettelles : al ast tot débeurnaclé. Il y a là peut- être quel qu’allusion à un ivrogne qui sort de la taverne, en latin taberna. - (13) |
| débeurnâclé, débeurnaquié : 1 adj. Démonté. - 2 Démoli (en désordre). - (53) |
| débeurnacler : 1. démolir, démantibuler (mes souvenirs concordent avec Chambure) 2. nettoyer, débarrasser, débroussailler (selon mes informateurs) Je suppose que le glissement s'est produit dans les années 60, par confusion avec débeurner (vieux français débrenner : démerder) aujourd'hui oublié. - (52) |
| débeurnacler : abîmer. (EDSEA. T II) - A - (25) |
| débeurnai : débarrasser (contraire : embeurnai). - (33) |
| débeurnaillè, f'naillè : v. t. Démolir. - (53) |
| débeurnaquai : démolir. Tout est débeurnaqué : tout est démoli. Temps instable : le temps est tout débeurnaqué. - (33) |
| débeurnâquier : démolir, désassembler - (48) |
| dèbeurnatié (ā), vt. déchirer, démonter, disloquer. - (17) |
| débeurner (verbe) : débarrasser les choses encombrantes. - (47) |
| débeurtaller v. Perdre une bretelle de sabot. Fig. Perdre la tête. - (63) |
| débeurteler. v. n. Tituber, chanceler. (Percey). - (10) |
| débeuser. v. - Retirer la beuse, la bouse. - (42) |
| débeutiner, v. a. démeubler, dégarnir un lieu des objets qui le meublent, qui l'approvisionnent. Un homme qui déménage « débeutine » sa maison. Un ouvrier qui emporte ses outils « délieutine » son atelier. - (08) |
| dèbeutné, vt. déboutonner. - (17) |
| débeutter v. Sortir d'une beutte. - (63) |
| debiauder (se). v. - Se changer, enlever ses « vêtements du dimanche. » (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| débiauder : déshabiller - (48) |
| débiauder v. Enlever la biaude. - (63) |
| débieue, s. f. récolte d'un champ. - (08) |
| débifer, v. a. dégoûter d'une chose, détourner de. - (08) |
| débigocher : perdre la tête, délirer - (39) |
| dèbigoné, vt. dévider, dérouler. Emettre un flux de paroles. - (17) |
| débigouiller. v. - Dévaler : « Je ne traîne pas, et je débigouille lestement l'escalier sans le secours de l'ascenseur ». (Colette, Claudine à Paris, p.242) - (42) |
| débillai - déshabiller. -En ne dait pas se débillai quand en â en sueur. - (18) |
| débillé : v. t. et v. i. Déshabiller. - (53) |
| débille. Débile. Débille se prononce comme bille, fille, etc. - (01) |
| débiller (pour déshabiller). v. a. et n. En navigation, détacher la cincenelle nouée par le milieu de la courbe ou du palonnier dont est garni le derrière d’un cheval qui hale un bateau. - (10) |
| débiller (se) (v.pr.) : se déshabiller - (50) |
| debiller (se) : se déshabiller. (E. T IV) - C - (25) |
| débiller : déshabiller - (48) |
| débiller : déshabiller. III, p. 5-2 - (23) |
| débiller : (débiyé – v. trans.) déshabiller, dévêtir. - (45) |
| débiller : déshabiller - (39) |
| débiller, v. a. déshabiller, dépouiller. - (08) |
| débiller, v. tr., déshabiller. - (14) |
| débiller. Déshabiller, par contraction. - (03) |
| débiller. Déshabiller. - (49) |
| débiller. v. - Déshabiller. Forme contractée de déshabiller, utilisée en moyen français de la Renaissance : desbiller. - (42) |
| débine. s. a. État de celui qui doit beaucoup, ruine, misère. Du latin debere. - (10) |
| débiner. v. a. Décrier. — Débiner une personne, essayer de la discréditer en disant du mal d’elle par derrière, en dessous. Ce mot s’emploie sans doute par allusion à l’opération faite par nos vignerons pour débiner les vignes. - (10) |
| debinteu, adv. bientôt. - (24) |
| debintu, adv. bientôt. - (22) |
| dèbiondé, vt. enlever à la serpe les brindilles d'une branche. - (17) |
| débitarner. v. a. Se dit, à Bussy-en-Othe, de la première façon qu’on donne à une jeune vigne. - (10) |
| débiter, v. a. consommer, dépenser. Un bœuf « débite » deux fois plus de foin qu'une vache. - (08) |
| débitouiller. v. a. Frotter, dégluer, décoller. Se débitouiller les oeils, se frotter les yeux en s’éveillant pour dégluer ses paupières. De bitou, qui a les yeux chassieux. - (10) |
| débitouser (se), v. pr., rendre net, se nettoyer les yeux. S'emploie au propre et au figuré. (V. Bitou.) - (14) |
| débitouser (se), verbe pronominal : ôter la chassie des yeux. - (54) |
| débitouser : nettoyer les yeux. Retirer la chassie des yeux bitous. - (62) |
| débitouser : v. a., enlever la bite des yeux. - (20) |
| debitouser. Oter la bite qu'on a aux yeux. (V. Bitou.) Par extension, on emploie ce verbe dans le sens de débarbouiller : P'tiot mâchuron, cors don vitement te débitouser. - (13) |
| débitouzay, nettoyer ses yeux obscurcis parla chassie. Je debitouzon nos eüille, c.-à-d. nous nous frottons les yeux. - (02) |
| débituer. v. - Déshabituer. - (42) |
| débituer. v. a. Déshabituer. - (10) |
| débiyé, déshabiller; s'débiyé, se déshabiller. - (16) |
| déblaive, s. f. récolte en général, les fruits extraits de la terre, l'action de prendre, d'enlever cette récolte. - (08) |
| déblaiver, v. a. enlever la récolte d'un champ, d'un pré, en général ramasser. - (08) |
| déblatré : mal boutonné, débraillé. A - B - (41) |
| déblatré : mal boutonné - (44) |
| déblatré, adj. débraillé. - (24) |
| déblâtré, désablâtré : (p.passé) déshabillé, avec ses vêtements en désordre - (35) |
| déblâtrer : déshabiller, mettre ses vêtements en désordre - (43) |
| déblayer. v. - S'emploie pour évoquer le trop rapide d'un cheval. (Mézilles, selon H. Chéry). Autre sens : vite fait. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| déblliondé, v. a. couper en tronçons les branches d'un arbre abattu, les mettre en « bœllions ». - (22) |
| déblosser, v., nettoyer sous les arbres avant l'abattage. - (40) |
| débobiner : v. a„ dérouler, développer, égrener. - (20) |
| débode. Déborde, débordes, débordent. - (01) |
| dèbodié, vn. déborder. - (17) |
| débodzi v. Vider une bodze. - (63) |
| déboillaller : s’ouvrir et tomber (pour un char de foin) - (51) |
| déboïllanci v. (de beuille). 1. Eviscérer. 2. Déculotter. - (63) |
| débondener (C.-d., Chal.). - Oter la bonde ou bondon d'un tonneau, en français débonder ou débondonner. Cette locution est naturellement souvent employée dans un pays de vignes. Dans l'ancien français, bondonner, qui signifie à proprement parler mettre une bonde ou bondon, tenait au mot bondir et s'employait aussi pour : faire sonner, retentir(Littré). Dans le Chalonnais et la Bresse, le mot bondener a conservé cette acception ; il exprime un bruit sifflant, par exemple : l'espèce de ronflement causé par une pierre lancée par une fronde, ou tout autre bruit analogue. Il se trouve alors avoir beaucoup d'analogie avec le verbe bourdonner. - (15) |
| débondener, v. a. débondonner, ôter le bondon, déboucher. (Voir : bonde.) - (08) |
| débondener, v. tr., débonder, ôter la bonde d'un tonneau. - (14) |
| débond'né, enlever ta bondo d'un fût. - (16) |
| débondner : agir furieusement. Au propre : faire sauter la bonde d’un tonneau. Au figuré : éclater, éjecter de manière brutale. - (62) |
| débond'ner : déféquer - (48) |
| débond'ner. Débonder, enlever la bonde. - (49) |
| déboquer, v. vomir. - (38) |
| débor. Fluxion, débordement d'humeurs, de bile ou de pituite. - (01) |
| débord, n.m. inondation. - (65) |
| débordeai, s. m. débordement d'eau ; inondation. - (08) |
| débordzi v. (de borrèche). Démêler (de la laine, des cheveux). - (63) |
| débordzi, déméchi : démêler - (43) |
| déborser : Débourser. « Si y a de l'argent à déborser je n'en sus pas ». - (19) |
| débôtai. Débotter… - (01) |
| débotener : Déboutonner. « T'as treu chaud débotene tan gilet ». - (19) |
| déboter. v. - Aboutir. - (42) |
| déboter. v. n. Aboutir. (Villiers-Saint-Benoit). Voyez aboter. - (10) |
| débotné, déboutné : v. t. Déboutonner. - (53) |
| débotner v. Déboutonner. - (63) |
| débouagener, v. a., défaire les meules de blé ou de foin, que l'on nomme borgeons, pour les étendre et les faire sécher ou pour les rentrer. - (11) |
| débouaîre (on) : déboire - (57) |
| débouaiter : déboîter - (57) |
| déboûchi : déboucher - (57) |
| déboudrillai (se). : Sortir d'un état d'assoupissement ou d'ennui. Ce mot se dit encore d'un enfant dont l'intelligence se forme, d'une jeune fille dont les grâces commencent à naître. - (06) |
| déboudrillay et se déboudrillai, sortir d'un état d'assoupissement ou d'ennui , se secouer. Ce mot se dit encore soit de l'esprit ou de l'intelligence qui s'ouvre, soit, d'une jeune fille qui se développe... - (02) |
| déboudriller (se) , v. pr., sortir d'ennui ou d'assoupissement, et aussi se former : « Auparavant que d'se l'ver, ô s'déboudrille dans son lit. » — « J'seù en r'pos ; le p'tiot s'déboudrillera prou. » - (14) |
| déboudriller (se). Se débrouiller, s'éveiller au figuré, se déniaiser. Etym. altération de débrouiller. - (12) |
| déboudriller, v. tr., produire, jeter à profusion ; parler, chanter, jouer avec volubilité et sans fin. Un orgue de Barbarie « déboudrille un air », etc. - (14) |
| débouécer. v. a. Déboucher, déclore. (Menades). - (10) |
| débouéiller : démêler - (48) |
| débouger, v. intr., bouger. Superfétation d'un préfixe, comme, un peu partout, décesser pour : cesser, etc. - (14) |
| déboulée, s. f., sortie précipitée ; grande quantité, amas, affluence : « Y en v'nòt, d'ces gas à la foire ; y en v'nòt... Queue déboulée ! ... » (V. Trâlée.) - (14) |
| débouler, v. a. démêler, mettre en ordre des choses mêlées ensemble. - (08) |
| débouler, v. intr., décamper, partir rapidement, fuir ; dégringoler, s'abattre sur : « Allons, ch'ti drôle, déboule me vite d'iqui ! » — « Ol a graviché su l'mur, é pi l'mur li a déboulé su l'dos. » - (14) |
| débouler. v. n. Partir brusquement, en parlant d’un lièvre. Cette plaine est giboyeuse ; les lièvres y déboulent de tous côtés. — Signifie aussi démêler, débrouiller. - (10) |
| débouliguer : v. a., bouliguer. - (20) |
| débouloué, s. m. démêloir, peigne qui sert à démêler les cheveux ou à nettoyer le poil des animaux. - (08) |
| débouloué. s. m. Démêloir. (Montillot). De débouler. - (10) |
| débounoter, découvrir, mettre à nu. - (05) |
| débourdement, s. m. débordement d'un ruisseau, d'une rivière. Le terme inondation n'existe pas dans notre patois. On dit un « débourdement d'eaies » ou « d'iaux », suivant les localités. - (08) |
| débourdiau (nom masculin) : grosse averse. - (47) |
| débourdiau, s. m. grosse averse de pluie, en français ondée. (Voir : débordeai.) - (08) |
| débourdiller, v., pousser, grandir. - (40) |
| débourré, ée. adj. Vif, éveillé, en parlant des petits enfants. (Villeneuve-les-Genêts). - (10) |
| débourré. adj. - Vif, éveillé, intelligent, en parlant d'un enfant. - (42) |
| débourré. adj. Dont l’intelligence commence à s’éveiller, qui commence à marcher. Se dit en parlant d’un enfant, par assimilation avec les bourgeons des végétaux qui, au printemps, se débourrent, sortent de leur enveloppe. - (10) |
| débourrer, v. bourgeonner (en parlant de la vigne). - (65) |
| débourrer, v., dresser un cheval pour l'atteler ; déféquer. - (40) |
| débout’ner : déboutonner - (57) |
| débout'ner : déboutonner - (48) |
| débout'ner : déboutonner - (39) |
| déboutsi : déboucher - (43) |
| déboutsi v. Déboucher. - (63) |
| déboutsi. Déboucher. Ce mot s'emploie à la fois à l'infinitif présent et au participe passé. - (49) |
| déböyaler : (vb) vider (un lapin, etc…) - (35) |
| débo-yaler : vider, enlever les boyaux - (43) |
| débraîlé (adj.) : débraillé (syn. dégalvâtré) - (64) |
| débraillai (se). : Se déboutonner, se mettre à l'aise, ôter ses haut-de-chausses ou braies, mot d'origine gauloise et que le latin avait traduit par braccoe. - (06) |
| débrâilli : débrailler - (57) |
| débrâilli adj. Débraillé. - (63) |
| débraïlli: Débraillé. - (19) |
| debraillouné. adj. - Débraillé. - (42) |
| débranché. Homme grand et sans tournure, comme semblable à un arbre ébranché. On dit de même en français un échalas. - (03) |
| débrandiller. v. – Balancer : «Les gamines sont en train de se débrandiller sous l'noyer. » - (42) |
| débrandiller. v. a. Balancer. — Se débrandiller. v. pron. Se balancer. - (10) |
| débrandillouée. n. f. - Balançoire. - (42) |
| débrandillouée. s. f. Balançoire. - (10) |
| débraqué, v. n. changer de travail. - (22) |
| débraquer, v. n. changer de travail ou le quitter. - (24) |
| débreilli : débrayer - (57) |
| débrené, v. a. désencombrer. - (22) |
| débrener, v. a. désencombrer. - (24) |
| débricolai - défait, cassé. – Côrre aipré ! voiqui portant to les airnouas débricolai !! - (18) |
| debricôlai. : Manger goulûment. Dans l'idiome breton, debri signifie manger. (Leg.) - (06) |
| débricolay. Ce mot est un assemblage évident de ces deux expressions de l'idiome breton, debri, manger, et goulloi, vider, ôter ce qu'il y a dans une chose, c.-à-d. boire à plein verre. (Le Gon.) ... - (02) |
| débridai. : Délacer, dans le vieux français.- Un débrideur de nones signifie un cajoleur de filles. (Lac.) - (06) |
| débriday, délacer... - (02) |
| débringué, ée. adj. et partic. p. Mal accoutre, débraillé ; rompre, brisé. Femme débringuée. Machine débringuée. - (10) |
| débringué. adj. - Mal habillé, débraillé. - (42) |
| débringuer : détraquer - (57) |
| débringuer v. Briser, démantibuler. - (63) |
| débringuer. v. - Démancher, briser. - (42) |
| débringuer. v. a. Rompre, briser, démantibuler. Se dit surtout en parlant d’une machine. - (10) |
| débrintsi v. Ebrancher, tailler les têtards. - (63) |
| débrôder : nettoyer - (48) |
| débroïlli: Débrouiller. « San père avait fait des mauvases affares ma liune a bin savu à se débroïlli (mais lui a bien su se débrouiller) ». - (19) |
| débrollé : quelque chose qui se détraque. Le temps au beau qui se met au mauvais - (39) |
| débronder : emonder - (57) |
| débronder : v. a., émonder, ébrancher, enlever la bronde. Voir ébronder. - (20) |
| débronder, v. a. dépouiller de ses branches un arbre abattu. - (24) |
| débroudriller, savoir se débrouiller. - (27) |
| débrouillâ (on) : débrouillard - (57) |
| débrouilli : débrouiller - (57) |
| débroussailli : débroussailler - (57) |
| déb'sonnés, débessonnés. adj. - Se dit pour des chiens qui viennent de se désaccoupler. Mot formé sur besson, jumeau. - (42) |
| dèbu, sm. ronde enfantine ancienne. - (17) |
| débucher. v. - Débusquer. (Fernand Clas, p.314) - (42) |
| débuer : Sortir le linge du cuvier de lessive. « Faudra débuer du ban métin pa êt' saur d'avoi de la plièche au bé », il faudra sortir le linge de bon matin pour être sûr d'avoir de la place au lavoir. - (19) |
| débutiner, v. a. enlever le butin ou décombres provenant des démolitions. V. Butin. S'emploie aussi dans le sens plus général de déménager. - (11) |
| débutiner. Oter le butin, nettoyer, enlever les immondices. En 1569, la municipalité de Beaune acheta un tombereau et chargea l'exécuteur des hautes-œuvres « de débutiner la ville tous les jours. » - (13) |
| débyer, déshabiller. - (26) |
| déc’mander : décommander - (57) |
| déç’vouair : décevoir - (57) |
| décabaner v. Déguerpir. - (63) |
| décabaner : v. n., déménager, et au flg. déraisonner. - (20) |
| décaclourder (Se). v. pronom. Reprendre ses sens après un étourdissement, s’éveiller, s’agiter. De de, particule extractive, et alourder, alourdir, rendre pesant, rendre lourd. - (10) |
| decacoiller. v. a. Disloquer. (Saint-Martin-du-Terlre, Paron, etc.). - (10) |
| dècafreuyé, sm. ecosser (des pois, des haricots). - (17) |
| décaicher, v. a. découvrir, sortir d'un trou, d'une « cache », trouver un objet caché. - (08) |
| décaissi : décaisser - (57) |
| décaiti : décati - (46) |
| décâlé : v. t. Décaler. - (53) |
| décaler : Diminuer de poids et de volume en séchant. « Ol a sâ treu d'houre san foin s'est bin bravement décalé », il a fauché trop tôt, son foin a beaucoup diminué en séchant. On dit aussi d'une personne qui maigrit beaucoup qu'elle décale. - (19) |
| décaler, v. a. décoiffer, ôter le bonnet ou la « cale » d'une femme. - (08) |
| décaler, v. tr., décoiflfer une femme, lui ôter sa cale. - (14) |
| décalofer, v. enlever la peau du haricot, de la fève, etc... - (38) |
| décaloffer. Enlever l'enveloppe d'un fruit, la « caloffe ». - (49) |
| décalofrer (v.t.) : écaler, enlever l'écorce des noix ou l'enveloppe-des châtaignes - (50) |
| décalofrer, v. a. enlever l'écorce des noix. - (08) |
| décalonner, décalouner. v. - Écaler, retirer la noix de sa coquille. - (42) |
| décalonneux, décalouneux. n. m. - Dans les veillées, se disait des personnes qui écalaient les calons, les noix. - (42) |
| decalvatré (être) : être débraillé. Ex : "Aga don coum' ton gamin il est décalvatré !" - (58) |
| décamoté : (p.passé) (gâteau) démoli, pas présentable - (35) |
| décamoter : enlever quelque chose - (43) |
| décamoter v. (or. inc.). Démolir, afaisser. - (63) |
| décamotter : v. a., désagréger, dissocier, désunir. Décamotter (carder) de la laine à matelas. Au flg. : Tiens, entre les Y... et les Z... ça se décamotterait donc ! - (20) |
| décanailler (se) : se débarrasser - (61) |
| décancher (v. tr.) : débarrasser d'un excès de charge (ant. encancher) - (64) |
| décancher. v. a. Extraire, enlever un objet du milieu de plusieurs autres entre lesquels il est enserré et qu’à cette fin il faut déranger tout d’abord. - (10) |
| décanillè : déloger, ce verbe était utilisé pendant les parties de billes - (46) |
| décaniller : fuir. A l’origine : faire sortir les chiens (cani). - (62) |
| décaniller : se sauver, fuir - (60) |
| décaniller, v. intr., au propre, faire sortir les chiens du chenil ; mais employé chez nous au figuré : « Te n'te leùves jàmâ. Attends, j'm'en vas t'fâre décaniller du lit. » Fuir comme un chien. - (14) |
| décaniller. v. - Ôter, retirer ; « J'vas m'décaniller la tête », signifie que l'on va retirer son chapeau. (Sainte-Colombe-sur-Loing). - (42) |
| décanilli : décaniller - (57) |
| décanilli v. Partir rapidement. - (63) |
| décantonner. v. - Quitter un endroit précipitamment. (Bléneau, selon M. Jossier) - (42) |
| décapilli : Demêler, débrouiller. « Viens dan m'aidyi à décapilli ma lainne ». Se décapilli : s'ébrouer, se depêtrer. - (19) |
| décapiter (Se), v. pronom. Se hâter, se dépêcher, se donner de la peine jusqu’à en perdre la tête. De de privatif et de caput. - (10) |
| décaquelorder (se) : désengourdir (se) - (48) |
| décaqueuilli v. Décortiquer. Voir caquelli, caqueuilli. - (63) |
| décarcafeugner (verbe) : abîmer. - (47) |
| décarcasser (se) (verbe) : faire de gros efforts pour aboutir à un résultat. - (47) |
| décarcasser (Se). v. pron. S’exténuer, s’échiner, s’éreinter, s’arracher la carcasse, en quelque sorte, pour l’exécution d’un travail, la réalisation d’un projet, d’une entreprise quelconque. - (10) |
| décarcassi (se) v. Se décarcasser, se donner du mal. - (63) |
| décarpionner(se) (v.pr.) : faire tout son possible pour faire plaisir - (50) |
| décarrer, décarrocher : v. n., décamper. - (20) |
| décarté. s. m. Écarté, jeu de cartes. (Saint-Martin-sur-Ouanne). - (10) |
| décassener : étendre et démêler les gerbes après les avoir détachées - (48) |
| décati : cheveux coupés au ras - (44) |
| décati : qui a perdu son lustre d'antan (français) - (51) |
| décati : Usé, vieilli, cassé par l'âge. « Alle est bien décatie ». - (19) |
| décati adj. Décrépi, fatigué. - (63) |
| décati. Ridé, vieilli. - (49) |
| dèçatié, vt. décercler. - (17) |
| décatigner, v. tr., démêler les cheveux. La fin du mot est un visible fragment de tignasse. (V. Décatimèler, Décharbouler.) - (14) |
| décatiméler, v. tr., manger goulûment : « Oh ! y é d'main la fête ; j'vons-t-i décatiméler ! » — « Faut l'vouér à table ; y é ça qui décatiméle! » On voit le goinfre opérer. Celui qui mange ainsi ne doit pas regarder à y mettre les mains et à démêler les morceaux avec les doigts. - (14) |
| décatoner, v. a. ecraser les grumeaux ou « catons ». - (24) |
| décatonner v. Enlever les catons, délayer. - (63) |
| décatonner : v. a., vx fr., défaire des calons. - (20) |
| décatouné, v. a. écraser les grumeaux ou «catons ». - (22) |
| décavaillonner, v., débutter la vigne au printemps. - (40) |
| décenellé : v. t. Dépouiller. - (53) |
| décensé : adj., qui a renoncé au cens. - (20) |
| décêssé, avec une négation : n'décêssé, ne cesser ; é n'décêssan d'côzé se dit en parlant d'enfants qui, au lieu de travailler à leurs devoirs de classe, ne cessent de parler ensemble. - (16) |
| décessé, vn. finir. S’emploie avec la négation : É n'decesse pas de... - (17) |
| décesser : Cesser « Y a pliu tote la semain-ne sans décesser ». - (19) |
| décesser v. Arrêter, cesser. - (63) |
| décesser : v. n., .cesser. Ne s'emploie qu'avec la négation. I n'a pas décessé de tousser pendant toute l'hiver. - (20) |
| décesser, v. a. s'emploie toujours avec une particule négative, cesser. Ex. il ne décesse de parler. - (11) |
| décesser. Cesser. « O décesse pas de se pi-indre » (plaindre). - (49) |
| déceu (p.p.) : p.p. du verbe décevoir - (50) |
| déceu, part. passé du verbe décevoir. déçu, trompé. S’emploie adject. « deceu, deceute. » - (08) |
| décevable : adj., vx fr., décevant, déplaisant, désagréable. - (20) |
| déchabuter. v. - Parler longuement, avec insistance, sur un sujet de peu d'importance. - (42) |
| déchabuter. v. n. Parler beaucoup, raconter longuement, avec complaisance, une chose de peu d'importance. (Saint-Martin-sur-Ouanne, Villiers-Saint Benoit). - (10) |
| déchairboiller, v. a. débarbouiller ; laver le visage et par extension laver en général. (Voir : chairboiller.) - (08) |
| déchairboliai - nettoyer, laver surtout la figure des enfants. - Vai don déchairboliai ton frère. – Ma veins don qui te déchairboliai in pecho : te fâs pô. - (18) |
| déchairbouéiller : débarbouiller - (48) |
| déchairbouillé. (Voir au mot chairbouillé.) ... - (02) |
| déchairger : décharger - (48) |
| déchairter, v. a. défricher, arracher des racines d'arbres. Dans le « déchartir », qui est le même mot non mouillé, signifie déchirer, arracher avec les ongles et aussi défricher. - (08) |
| déchaler : v. a., vx fr., écaler. - (20) |
| déchambrer : v. a., déchirer. Voir essambrer. - (20) |
| dècharbeuté, vt. démêler, décrasser. - (17) |
| décharboïlli : Débarbouiller. « Va te décharboïlli, t'es to macheuré ». - (19) |
| décharboœûyer : débarbouiller. (V. T IV) - A - (25) |
| décharbôtai. Débarrasser. Encharbôtai, embarrasser… - (01) |
| décharbôtai. : Démêlerun tissu emmêlé, débarrasser un lieu, une personne. (Voir au mot encharbôtai).- En latin de carpere signifierait diviser, désentortiller ou séparer une chose d'une autre.Décharger a dû être le mot patois originaire et décharpoter en provenir comme diminutif. - (06) |
| décharboter, et décharbouter, v. tr., débarrasser, débrouiller, désenchevêtrer, démêler le fil d'un écheveau : « Pôrra-t-i jamâ décharboter c't'afâre ? » - (14) |
| décharboter. v. a. Déshabiller. (Fléys). - (10) |
| décharbouillè : se laver le visage - (46) |
| décharbouiller : débarbouiller. - (29) |
| décharbouiller, débarbouiller. - (26) |
| décharbouiller, v. ; laver la figure. - (07) |
| décharbouiller, v. tr., nettoyer la figure, débarbouiller : « La Mag'rite ? All'se décharbouille tous les trente-si du moué. » - (14) |
| décharbouiller. Décrasser le visage et les mains. C'est le contraire de charbouiller. (V. ce mot.) On disait anciennement escarbouiller. Dans le Hainaut, on nomme escarbilles les résidus de la houille brûlée. - (13) |
| décharbouiller. Nettoyer, mais plus spécialement faire la toilette du visage. Etym. : dé et charbouiller (Voyez ce mot). - (12) |
| décharbouter : Débrouiller, le contraire de écharbouter. - (19) |
| décharbouter : démêler - (57) |
| décharbouter. Démêler, plus particulièrement du fil. - (03) |
| décharbouyé, débarbouiller ; s'décharbouyé, se débarbouiller soi-même la figure ; on ne dit pas : se décharbouyé les mains. - (16) |
| déchargeou (on) : déchargeoir - (57) |
| déchargeou (on) : déversoir - (57) |
| déchargeou : Vanne de moulin. - (19) |
| déchargi : décharger - (57) |
| déchargi : Décharger. « Déchargi eune voiture de foin ». - (19) |
| décharpillai (se), se débarrasser de, se dépouiller de, (en latin de carne pellere), ôter ses vêtements... - (02) |
| décharpillai (se). : Se dépouiller d'un vêtement, s'alléger de quelque chose (du latin de carne pellere). - (06) |
| déchaumis, défrichis. n. m. - Défrichement. - (42) |
| déchaumis. s. m. Défrichement. (Sommecaise). - (10) |
| dèchaus, sm. mendiant. Expr. : E n'i en airé point po lés dèchaus, il n'y aura que tout juste. - (17) |
| déchaûssi : déchausser - (57) |
| déchauter. v. a. Décrocher, sortir un sean du chaüt. (Soucy). - (10) |
| déchaux, déchaussé, de calceo ponere pedem. - (02) |
| déchaux. : Pied déchaux, c'est-à-dire sorti de la chaussure, de calceo. (Del.) - (06) |
| dèche. s. f. Perte, déficit. Être en dèche, éprouver des pertes, être dans la débine. (Mailly-la-Vilie). - (10) |
| déchenoché, adj., peu stable (en parlant d'un piquet mal planté). - (40) |
| déchepiller, débarrasser les noisettes non mûres de leur enveloppe verte. - (26) |
| décherbotai - démêler surtout du fil. - Ma queman fâre pou déchairbotai ceute échevais de fi qui ? - Voiqui lai choupette de mai calotte bein emmaulée ; déchairbotte lai. - (18) |
| déchevalé, v. a. 1. Dépouiller des raves ou betteraves de leurs feuilles. — 2. Critiques avec malveillance. - (22) |
| déchevasser : v. a., échevasser. - (20) |
| déchevassi, v. a. dépouiller des raves ou betteraves de leurs feuilles. - (24) |
| déchianner : déchirer - (43) |
| déchier, scier - (36) |
| déchiffrai. : La véritable orthographe du patois est déchifrai. Déchiffrer quelqu'un, c'est-à-dire le faire connaître par l'énumération de ses défauts. (Del.) - (06) |
| déchifrai quelqu'un, c'est le faire connaître avec tous ses défauts. - (02) |
| déchiré, déchirée : part, pass., flétri, flétrie (en parlant des personnes). Elle n'est déjà pas tant déchirée... - (20) |
| déchiri - déniaper – dévorer : déchirer - (57) |
| déchiri : Déchirer. - (19) |
| déch'nocher, v. panteler. - (38) |
| décho (pieds), pieds nus. - (26) |
| déchouair : déchoir - (57) |
| déchoué : décloué - (43) |
| déchrêmer. v. - Menacer une personne de lui ôter la peau du crâne ; « rappel de l'onction du saint-chrême le jour du baptême ». (M. Jossier, p.42) - (42) |
| déchrêmer. v. a. Menacer quelqu’un de lui enlever le chrême, c’est-à-dire la peau de la tête, la partie de sa tête qui, au baptême, a été ointe du saint-chrême. (Puysaie). — Dans certains endroits, on dit : Je vas t’enlever, je vas te laver le baptême; c’est, en d’autres termes, absolument la même chose. - (10) |
| déchteu, adv. aussitôt. - (24) |
| dechu : dessus - (39) |
| deci bein ou d'cibein - se soucier peu, s'en peu occuper. - Ile s'en deci bein, vais, si en lai gronde ou non. - Et pu ai vo aito, en vos deci bien ! - (18) |
| decié : Deçà. En decié : en deçà. « Ol a sa maijan en decié du chemin ». - (19) |
| décier : étancher (la soif) - (57) |
| décimateur : personne qui levait la dîme. - (55) |
| décinguier. v. a. Dessangler. - (10) |
| décirer, v. a. déchirer, mettre en pièces. - (08) |
| décirer, v. tr., déchirer : « Allons, bon! v'ià qu'ôl a déciré sa chumise ! » - (14) |
| décize, s. f., le cours de l'eau. « Aller en décize, » descendre le cours de la rivière. Les mariniers qui conduisent un train de bois ou un bateau à Lyon « font une décize », « vont en décize » . - (14) |
| déclacourdir, décaclourder (se). v. - Avoir du mal à se réveiller, à reprendre ses esprits : « C 'malin j'arrive pas à m 'déclacourdir. » - (42) |
| déclaration, s. f., trou, fente, découture dans un vêtement : « Lèuve vouér le bras. Ah ben ! y a eùne bâle déclaration à ta manche ! » - (14) |
| déclenchi : déclencher - (57) |
| dec'nailler, v. n. décamper, s'en aller sans bruit et honteusement. - (08) |
| décoclarder (se) : se mettre en train - (39) |
| décoconner : v. n., décamper, déraisonner. - (20) |
| décoconner. Perdre la raison, parler à tort et à travers. (Argot). - (49) |
| décoiter. v. - Faire des bêtises, « déconner ». (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| dècolé (õ), vn. découler. - (17) |
| décoler, v. n. ne s'emploie guère que dans cette locution : « i n'en s'rô décoler », je ne saurais en venir à bout, je ne puis y parvenir. - (08) |
| décolérer v. S'apaiser après une colère. - (63) |
| décompote : s. f., déconfiture. Tomber en décompote. - (20) |
| déconfends. C'est l'indicatif présent du verbe inusité déconfendre. « Je m'en déconfends » signifie, en terme d'écolier : je ne veux plus jouer, je quitte la partie (de barres ou d'autres jeux ) - (13) |
| décontinuer : v. n., discontinuer. - (20) |
| decontre, prép. contre, à côté de : « al ô en raige d'contre lu », il est furieux contre lui. - (08) |
| dècöpé, vt. découper. - (17) |
| décoper : Découper. « Décoper in poulot ». - (19) |
| décoper v. Découper. - (63) |
| dècöpou, sm. découpeur. - (17) |
| décoquelarder (se), v. réfl. se divertir, s'amuser, s'en donner à coeur joie. - (08) |
| décoradzi : décourager - (51) |
| décoraigi : Décourager. « Faut pas se décoraigi pa eune mauvase an-née, an en voit bin deux de sute ». - (19) |
| décordeûilli v. Délier, détacher, enlever les cordes. - (63) |
| décordeûyi : (vb) enlever les chaînes de fixation pour faire basculer le tombereau - (35) |
| décorde-yi : enlever la fixation pour faire basculer le tombereau - (43) |
| décorè : v. t. Décorer. - (53) |
| décoti : déméler - (51) |
| découanner v. Enlever la couenne. - (63) |
| découer : empêcher la poule de couver. - (52) |
| découragi : décourager - (57) |
| découtsi v. Découcher. - (63) |
| découver : v. a., employer les moyens nécessaires pour enlever à un volatile l'envie de couver. Découver une poule. - (20) |
| découvert : s. m., vx fr. descovert, découverte. - (20) |
| découvert, s. m. lieu, endroit, dont la surlace est découverte. - (08) |
| découvri : découvert - (43) |
| découvri : découvert - (57) |
| découvri : découvrir - (57) |
| découvri : part, pass., découvert. Voir couvri. - (20) |
| dècovè : ôter la couche de terre végétale qui se trouve au-dessus de la carrière. - (21) |
| décraicer. v. a. Décrocher. (Ménades). - (10) |
| dècraissé, vt. décrasser. - (17) |
| décrai-yeux : Ouvrier dont la spécialité est de nettoyer les fûts en y enlevant la craie, le tartre. - (19) |
| décraper : v. a., écraper. - (20) |
| décrassi : décrasser - (57) |
| décrassoir : s. m.; serviette de toilette. - (20) |
| decrayer : Enlever le tartre qui s'est déposé sur les parois des fûts. On dit aussi radier. - (19) |
| décrenir, v., nettoyer grossièrement. - (40) |
| décreuiller. v. a. Se dit, au jeu de billes, de l’action de faire sortir une bille d’un creux, d’une cavité, en la choquant fortement avec une autre bille. (Bagneaux). - (10) |
| décreuilli : décrier - (57) |
| décreuter : Décrotter. « Y a de la borbe après tes sulés, va les décreuter ». - (19) |
| décreutsi v. Décrocher. - (63) |
| décrevi : Découvrir. « Décrevi Saint-Piarre pa creuvi Saint Paul » : emprunter à Pierre pour payer Paul, prendre une mesure qui n'avance à rien. - (19) |
| décrochi : décrocher - (57) |
| décrœpœlli, v. a. démêler, trier avec peine. - (22) |
| décroire. v. - Ne plus croire. Mot employé dès le XIIe siècle, et utilisant le préfixe privatif.latin dis- (dé-), évoquant l'éloignement, la séparation. - (42) |
| décroire. v. a. et n. Cesser de croire. — Faire décroire, dissuader. (Saint-Martin-sur-Ouanne). - (10) |
| décrotè (v.intr.) fouir, gratter la terre ( se dit notamment des chiens qui cherchent à attraper une proie souterraine). - (45) |
| décroter (v.t.) : déterrer ; tirer d'un trou - (50) |
| decroter, v. a. déterrer, tirer hors d'un trou, d'un creux. - (08) |
| décroter, v. tr., manger avec vif appétit : « O n's'é pas putôt métu à table, qu'ôl a décroté son diner. » - (14) |
| décrotsi : décrocher - (43) |
| décrotter (v. tr.) : déterrer - (64) |
| décrotter : déterrer - (48) |
| décrotter v. Déterrer une dépouille animale. - (63) |
| décrotter : v. n., manger goulûment. I décrotte ferme. - (20) |
| décrouaîser : décroiser - (57) |
| décruchi : Décrocher. « Ol a to de mouinme fini pa y décruchi », il est enfin parvenu à obtenir ce qu'il désirait. Avoir fait un violent effort qui a produit une douleur à l'estomac. Voir cruchot. - (19) |
| décrulé, ée. adj. Fortifié, remis en état, en parlant d’une chose qui s’écroulait. (Étais). Se dit pour décroulé. - (10) |
| décruler. v. - Plusieurs usages : l. Ne pas se décider à partir, ne pas « bouger son cul » : « l'va-ti s'décruler, depuis le temps qu'il est là ? » (Sougères-en-Puisaye) 2. Éveiller, dégourdir, ouvrir les yeux d'un enfant, le rendre moins « cul » : « Et puis j'avais mûri, je m'étais décrulée comme on dit en poyaude. » (D. Levienaise Brunei, Ninise, p.157) 3. Décrasser, réparer, remettre en état. - (42) |
| décruler. v. a. Dégourdir l’esprit d’un enfant, lui enlever sa crudité. De de ablatif ou extractif, et de cru. (Perreuse). - (10) |
| décûchi : découcher - (57) |
| dêcuchonner : v. a., étaler un cuchon. - (20) |
| décueudre, v. tr., découdre. - (14) |
| dècuillöté (eu-yo), vt. déculotter. - (17) |
| dédaingni - méprisi : dédaigner - (57) |
| dédaingnou, celui qui fait mépris d'une personne, d'un mets. - (16) |
| dedan. Dedans. - (01) |
| dedelai, loc. adv. là-bas, de l'autre côté, delà. On prononce dans une partie de la contrée « deud'lai. » - (08) |
| dedevant. Auparavant. Al ai maingé eune aissiettée de soupe dedevant de parti... - (13) |
| dedevé, prép. de devers ; de auprès de : « dôte-toué de d'vé lu », ôte-toi d'auprès de lui, éloigne-toi de lui. - (08) |
| dédite, s. f., dédit : « J'ons fait eùn marché ; si ô n'tient pas, y a eùne dédite d'un écu de cinq francs. » - (14) |
| dédoitter (Se). v. pron. Payer ses dettes. - (10) |
| dédommagi : dédommager - (57) |
| dédoub’illement : dédoublement - (57) |
| dédoub’iller : dédoubler - (57) |
| dédoublier : Dédoubler. « Dédoublier de l’iau de vie », l'étendre d'eau pour la ramener au degré voulu. - (19) |
| ded'peu, prép. de depuis, depuis : « ded'peu qui seu iqui », depuis que je suis ici. - (08) |
| ded'peue, dépeue : depuis - (39) |
| ded'pis. prép. - Depuis. - (42) |
| ded'quoué, déquoué. pron. rel. - De quoi. - (42) |
| dédrouler, v. a. dérouler, défaire ce qui est enroulé. Le d est une lettre de renfort. - (08) |
| ded'vers. prép.- Vers: « Va don' ded'vers les viaux, avant qui sauvons. » Dedevers, renforcement de vers, est utilisé en ancien français depuis le XIIe siècle, pour indiquer un lieu ou une direction. - (42) |
| déd'veuder : dévider - (48) |
| déd'veuder : dévider - (39) |
| déd'veudot : dévidoir - (48) |
| ded'veudot : dévidoir - (39) |
| ded'veudou : quelqu'un qui dévide - (39) |
| dédza (dza) : déjà - (51) |
| dédzà, dzà, djà adv. Déjà. - (63) |
| dédzal, dédzeul n.m. Dégel. - (63) |
| dédzaler : (vb) dégeler - (35) |
| dédzarner, dédzardonner : (vb) enlever les germes des pommes de terre - (35) |
| dédzarner, dédzarnonner v. Enlever les germes. - (63) |
| dédzarnoner : dégermer - (51) |
| dédzau : dégel - (34) |
| dédzermer : enlever les germes des pommes de terre - (43) |
| dédzeul : (nm) dégel - (35) |
| dédzeule : dégel - (43) |
| dédzeuler : dégeler - (43) |
| dédzeûner v. Déjeuner. - (63) |
| dédzler v. Dégeler. - (63) |
| dédzo : dégel. A - B - (41) |
| dée, déée. s. f. Ce que le doigt majeur peut contenir de chanvre, quand on le teille à la main. (Perreuse). - (10) |
| dée. s. f. Doigtée, quantité de chanvre tillé que peut tenir le doigt médius. (Lainsecq). - (10) |
| déede. s. des 2 genres . Dinde. (Étais), où l’on prononce ée pour ain, in, un, ien, im. - (10) |
| dééfunt mon pépère P’hlipp’ : mon grand-père Philippe décédé - (37) |
| dééji : adv. Déjà. - (53) |
| déemplir. v. - Désemplir. - (42) |
| déépeu, dépeu : prép. Depuis. - (53) |
| défacher (défâcher) : v. a. Se défâcher, cesser d'être fâché. - (20) |
| défaire, v. tr., s'emploie, dans un sens détourné, à exprimer maintes actions, maints travaux : « Défaire (écosser) des pois ; défaire (éteindre) le feu ; se défaire (se casser) le bras, » etc. - (14) |
| défaires, s. f., défroques, vieux habits, objets hors d'usage : « Alle é prou minabe ; j'vas li beiller mes défaires. » - (14) |
| défanfeurionner v. (de fanfreluche). Dégueniller. - (63) |
| défar. : (Dial.), faillir, en patois défaure (du latin fallere). - (06) |
| défarcer (v. tr.) : griffer profondément (syn. défarcî) - (64) |
| défarcî (v. tr.) : griffer profondément (syn. défarcer – i s'est fait défarci par son chat) - (64) |
| défare : Défaire. « Eune fois que le marché est fait an ne peut pas le défare ». Au figuré : « Je n'ai pas pouyu me défare de liune », je n'ai pas pu me défaire de lui. - (19) |
| dèfare, vt. défaire. - (17) |
| défarrer : Déferrer. « Man chevau est défarré, je le mene (prononcer meune) chez le marichaud », mon cheval est déferré, je le mène chez le maréchal. - (19) |
| défatimer, défigurer. - (05) |
| défatimer. Déformer, défigurer, origine inconnue. - (03) |
| defau : dehors. - (21) |
| défau. Défaut, défauts. - (01) |
| défée. v. - Défaire. - (42) |
| défenaigé : découragé. (C. T IV) - A - (25) |
| défenaiger - faire sortir du finage, dépayser, chasser, égarer. - A ne s'y reconnâ pu de to ; al â défenaiger complètement.- Aitendez voué qui vo défénaigeâ ce qui ! - (18) |
| défende v. Défendre. - (63) |
| défendre de : loc., empêcher de, défier de. - (20) |
| défenéger, v. a. déranger, déplacer. Prononcez def-né-gé. On « défenége » une couvée de perdrix en fauchant. - (08) |
| déféni, v. a. finir, achever, terminer : « i n'en peu pâ déféni », je ne puis en finir. - (08) |
| défense : s. f., obstacle, empêchement, mise au défi. - (20) |
| défernouiller. v. - Éclaircir le bois avant la coupe. (Sougères-En-Puisaye) - (42) |
| défersuer. v. a . Chercher querelle à quelqu’un, le battre, lui arracher la fersue (la fressure) ; dépecer, déchirer de la viande, ou plutôt, couper, mettre séparément les diverses, parties d’une fressure. - (10) |
| défertiner. v. - Désherber, nettoyer. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| défeuille : s, f., défeuillaison. - (20) |
| défeuilli : défeuiller - (51) |
| defeûilli : défeuiller - (57) |
| défeûilli v. Défeuiller, effeuiller. - (63) |
| defeur, adj. [defors]. dehors. Voir dors. - (17) |
| defeur. : (Dial. Pt pat.), dehors (en latin de foras), hors des portes. - (06) |
| défeurdzi : démêler - enlever les entraves. A - B - (41) |
| défeurdzi : démêler - (44) |
| défeurdzi : démêler, enlever les entraves - (34) |
| défeurdzi v. Démêler, désentraver, dépêtrer. - (63) |
| défeuri : décordé - effrangé. A - B - (41) |
| défeurnailli v. Déchirer. - (63) |
| défeurné, ée. adj. Mal peigné. (Massangy). - (10) |
| défeursalé : demi déshabillé, déchiré (vêtement) après un travail intensif, une lutte. - (33) |
| défeury : décordé, effrangé - (34) |
| défeuyi : défeuiller - (43) |
| deffracter : v. a., effracter. - (20) |
| déficile, adj., difficile. - (14) |
| défigneman (le). : La fin du monde. (Del.) - (06) |
| défigurer : v, a., dévisager. - (20) |
| défilée, s. f., file, longueur, grand nombre de personnes ou d'objets : « Voui, y en évòt eùne fameuse défilée. » (V. Afilée.) - (14) |
| défiler, v. tr., effiler : « Alle a défilé tous ses morciaux d'vieilles robes, tous ses bouts d'vieux pan-nias. » - (14) |
| définagé. adj. - Désorienté, affolé. - (42) |
| définer, détruire, tuer. - (05) |
| définer, v. tr., chasser, expulser du finage, du territoire de la maison, détruire, user : « C'gueùrdin d'petiot, ô m'défine tous ses hébits ! » - (14) |
| définer. Perdre, faire mourir, du latin finis. On trouve défin pour fin. - (03) |
| défini, définir, pour : finir ; i n'peu pâ an défini, j'ai de la peine à finir telle chose ; por an défini, pour en finir, pour achever une histoire qu'on raconte. - (16) |
| définir : v. a., vx fr. définer, finir, terminer, mourir. - (20) |
| définitre, v. a. terminer, finir tout à fait, complètement : « dion ç'iai por en définitre », disons cela pour en terminer. - (08) |
| défler : enlever le fil (couture) - (51) |
| defô : Dehors « Y fa in temps à ne pas mentre in chin defô » : il fait un temps à ne pas mettre un chien dehors. - « Etre fremé defô » : être à la porte, ne pouvoir entrer. - « In nam à couchi defô », un nom qui n'inspire pas la confiance. - « Couchi defô », coucher à la belle étoile. - Locution : en defô, en dehors. Vieux français : defors, dehors , des fuer, hors de. - (19) |
| défochaller v. (de fochalle, faisselle) 1.Sortir les fromages des faisselles. 2. Fig. Mettre du désordre, démonter, détruire. - (63) |
| défoindre (v. int.) : se dit d'une personne ou d'un animal qui souffre d'une blessure ou d'un mal quelconque et qui craint de réveiller sa douleur par un mouvement, un contact intempestifs - (64) |
| défonci : défoncer - (51) |
| defonci : défoncer - (57) |
| défonéger, v. a. changer de place, de lieu. - (08) |
| déforain ou déforien. : (Dial. ), chose mondaine, par opposition à céleste (rac. lat. de foras, de l'extérieur). On lit: La déforienne bealteit, au livre de Job, c'est-à-dire la beauté mondaine. - (06) |
| déforci (v. tr.) : éclaircir un semis en arrachant les pousses superflues (déforcî des blettes) - (64) |
| deforcir : sélectionner en cours de pousse. Retirer des plants pour aérer les mieux-venant. Ex : "Il est temps d'déforcie nout' persil au jardin". - (58) |
| déforcir. v. - Éclaircir les semis. - (42) |
| déforcir. v. a. Éclaircirde jeunes plants de légumes, lorsqu’ils sont trop serrés. (Villiers-Saint-Benoît). - (10) |
| déforé : v. t. Déferrer un cheval. - (53) |
| déforiaudé : sortir du fourreau - (34) |
| déforiauder v. Sortir du fourreau. - (63) |
| déforiller, démonter, mettre en pièces - (36) |
| déforiôdé : sortir du four. A - B - (41) |
| dèforné : défourner. - (21) |
| déforner : défourner - (51) |
| déforner v. Défourner. - (63) |
| déforner. Défourner. - (49) |
| defors (vx fr.), defours : adv., dehors. - (20) |
| defors, dehors. - (04) |
| defou, adv. dehors. - (22) |
| defou, adv. dehors. - (24) |
| defou, dehors. - (05) |
| défouèré : v. t. Terminer la foire. - (53) |
| défouiner. v. n. S’enfuir. (Quennes). - (10) |
| défourner. v. - Décharger. - (42) |
| défourrager. v. a. Laisser une ferme, une métairie ; se désapprovisionner de fourrage. (Villiers-Saint-Benoît). - (10) |
| défoussaler (se), v. se remuer, très vite, se démener, se dépêcher sur un travail, s'escrimer. - (38) |
| defoutraillé, disloqué, en mauvais état. - (27) |
| défra : Défrayé. « Ol est défra de to », tous ses frais lui sont remboursés. - (19) |
| défrâchî : élaguer. «Les bâlles suÿint, y’en défrâcho les châgnes »:les balles sifflaient coupant les branches des chênes. - (62) |
| dèfrâchi : émonder un arbre. - (21) |
| défraîchi : défraîchir - (57) |
| déframer, détériorer - (36) |
| déframer. v. - Démolir, détruire, déchirer. Autre sens : manger goulûment, être affamé. - (42) |
| déframer. v. a. Mettre en pièces. Ce vieux mot très-joli et très-savant (où la science va-t-elle se nicher?) vient de framer, détruire, hacher, exterminer avec la framée , cette arme terrible des anciens Francs. Déframer, c’est donc lancer la framée contre, la lancer de loin, car c’était aussi une arme de jet. (Perreuse). - (10) |
| défrâmer. v. n. Dévorer, être affamé. J’défrâme, j’seus défrâmé . (Étais, Sainpuits). - (10) |
| defrâque : abats du porc - (39) |
| défraque, s. f. dépouille d'un animal tué à la chasse plus particulièrement, morceaux dépecés d'une pièce de gros gibier. - (08) |
| défraquer : déchirer, briser - (60) |
| défresurè : déchirer - (46) |
| défreuche, s. f. racine, tronc d'arbre, ce qui provient d'un défrichement. - (08) |
| défreuchement, s. m. action de défricher. - (08) |
| défreucher, v. a. défricher. « Défrucher » - (08) |
| défreucheu, s. f. défrichement, lieu défriché. Labourer un « défreucheu. » les « défreucheus » donnent de bonnes récoltes. - (08) |
| défreuilli : effranger - (51) |
| défreuquer : Défroquer. « In curé défreuqué ». - (19) |
| défreûtsi : (vb) défricher - (35) |
| défre-yoder : sortir du fourreau - (43) |
| défricha : Terrain qui vient d'être défriché. « Y vint des balles denrées dans les défrichas » : il vient de belles récoltes dans les terrains nouvellement défrichés. - (19) |
| défriche n.f. Prairie retournée par le labour. - (63) |
| défrichi : défricher - (57) |
| défrichi : Défricher, essarter. « Ol a fait défrichi san beû (son bois) » - (19) |
| défrichis. s. m. Défrichement d’une prairie artificielle. (Villiers-Saint-Benoît). - (10) |
| défriser v. Désappointer, contrarier. - (63) |
| défrisi : défriser - (57) |
| défrontue (n. f.) : chacune des deux extrémités d'un champ, qu'on laboure transversalement (syn. achinte) - (64) |
| défrouaisser : défroisser - (57) |
| défrouiller, défernouiller. v. a. Éclaircir les bois, en retranchant les branches inutiles. C’est un diminutif ou une variante de défrouer, rompre, briser. Du latin frangere . (Mailly-la-Ville). - (10) |
| défrucher, v. tr., défricher. - (14) |
| defructu. s. m. Terme usité pour signifier un bon repas, et dont l’origine remonte à une cérémonie qui s’ooservait encore à Auxerre et dans son diocèse au commencement du XVIIIe siècle. - (10) |
| défunt, adj. se place toujours avant le subst. comme le mot feu : « mon poure défunt père, mai poure défunte mère. » - (08) |
| défunter : mourir - (48) |
| défunter, v. mourir. - (65) |
| défuter (défûter) : v. a., vx fr., vider le contenu d'un fût. Se défûter, vider sa vessie. - (20) |
| défûter : donner un autre ton, modifier la routine alimentaire, en parlant d'un plat. - (56) |
| dég’neûyi : (vb) déchirer (un vêtement) - (35) |
| dégabade : s. f., vomissement - (20) |
| dégaber : Vomir. Se dit surtout pour une personne qui a bu. - (19) |
| dégaber : v. n., vomir. - (20) |
| dégabi, dégabé : se dit d'une encolure de robe ou de manteau, d'un corsage trop échancré. - (30) |
| dégâcher. v. - Éclaircir les semis ; synonyme de déforcir. (Villiers-Saint-Benoit, selon M. Jossier) - (42) |
| dégâcher. v. a. Synonyme de Déforcir. (Villiers-Saint-Benoît). - (10) |
| dégadzi : dégager - (51) |
| dégagé, adj., prompt, vif, intelligent : « J'pens'ben qu'ôl érivera ; ôl é prou dégagé. » - (14) |
| dégager (se), v. réfl., se hâter, faire vivement : « Allons, v'là l'heure ; dégage-te. » - (14) |
| dégagi : dégager - (57) |
| dégaigé : v. t. Dégager. - (53) |
| dègaigé, vt. dégager. - (17) |
| dégaigi : Dégager, se hâter. « degaigins nos » : hâtons-nous. - (19) |
| dégaillade : s. f., vomissement. - (20) |
| dégâiller : déborder, ne pas tomber d'aplomb, ne pas bien ajuster (voir : dégoueiller). - (56) |
| dégailler : v. n., vomir. - (20) |
| dégaiñne n.f. Dégaine, allure. - (63) |
| dégaîn-ner : dégainer - (57) |
| dégaivâtré (adj.) : débraillé (syn. débraîlé) - (64) |
| dégali (adj.) : découvert (avouèr l'cou dégali) - (64) |
| dégali (aller au ....) : affaires ou choses abandonnées ou en voie d'abandon - à vau l'eau - Ex : "Y range pas ses affées, tout va au dégali..." Ou encore : "Y v'lont r'fée yeu touéture qui va au dégali..." - (58) |
| dègalice, adj. dissipé, remuant, dévergondé. - (17) |
| dégalisse, polisson. - (26) |
| dégalochai. : Quelqu'un qui n'a point de chaussures ou dans les pieds duquel elles ne tiennent point. Tel est le sens que donne à ce mot le parler vulgaire. Une autre expression, dégarrochat, que Delmasse signale avec la signification de désassembler, décrocher, me semble une corruption de la première. - (06) |
| dégamber. v. - Faire marcher ses jambes. Voir gambe, jambe : « Te vas-ti dégamber ? A c'te vitesse là on n'est pas ja arrivé ! » - (42) |
| dégamber. v. n. Enjamber, faire mouvoir ses jambes, marcher. I n’peut pas dégamber . (Perreuse). - (10) |
| déganf'lli : Dégonfler. Au figuré : « se déganf'lli » se soulager par des cris en disant son fait à quelqu'un. « Y a langtemps que j’avais envie de ma déganf'lli, ma cetu co je li ai bien dit san fretillan ». Voir fretillan. - (19) |
| deganivelée : désarticulée. - (30) |
| dégantonner. v. n. Quitter un endroit, l’abandonner précipitamment. (Bléneau). - (10) |
| dégaraillé, adj., sale, déchiré, en mauvais état. - (40) |
| dégaraillé, adjectif qualificatif : déchiré, en lambeaux. - (54) |
| dégarailler, v. déchirer. - (38) |
| dégareillé. Déchiré, en lambeaux. - (49) |
| dégarni : dégarnir - (57) |
| dégarnir, v., enlever les harnais d'un cheval. - (40) |
| dégarocher, tomber. - (05) |
| dégaroucher. Tomber, du vieux mot dérocher , allongé. - (03) |
| dégarrochay, dérouter. Une personne dégarrochée est celle qui ne sait plus comment retrouver le fil d'un discours ou la suite d'une chose commencée. En vieux français, garro signifie jambe, jarret. (Lac) - (02) |
| dégarrouècher, entraîner quelqu'un au mal, à la débauche. - (27) |
| dégarrucher, dégager la base d'un arbre, d'un mur envahis par les ronces, les épines, ou encombrés de pierrailles. - (27) |
| dègasigné, vt. enlever les décombres, les gazins (voir ce mot). - (17) |
| dégauche. Faux-fuyant, excuse pour dégager sa responsabilité. - (49) |
| dégauchi : Dresser. « Eune piarre de taille bien dégauchie ». Eduquer, déniaiser. « O s'est bien dégauchi au régiment ». - (19) |
| dégazunier : dégager. (S. T III) - D - (25) |
| dègé, sm. dégel. - (17) |
| dégeârner : dégermer - (57) |
| dégeau, daizau. s. m . Dégel. (Athie, Ménades). - (10) |
| dégeau, s. m., dégel. - (40) |
| dégeau. Dégel. - (49) |
| dégelé, ée. adj . Fondu, mort. Il est dégelé, il est mort. - (10) |
| dégelé. adj. - Décédé. - (42) |
| dégelée. s. f. Volée de coups appliquée à quelqu’un. J’y ai fichu un’ dégelée dont i s’souvienra. - (10) |
| dégelot. n. m. - Dégel. - (42) |
| dégelot. s. m. Dégel. (Perreuse). - (10) |
| dégêner (Se). a. pronom . Ne pas se gêner, se mettre à son aise. Dégênez-vous. (Bléneau). - (10) |
| dégêner (se). v. - Se gêner : « Faut pas s'dégêner, fais coumme chez toué ! » (Bléneau, selon M. Jossier) - (42) |
| dégêner : v. a., diminuer ou supprimer l'état de gêne, mettre à l'aise. - (20) |
| dégerber : v. a., descendre des tonneaux gerbés. - (20) |
| dégi : Dégel. « Vla le dégi, la Vanère brut ». Voir brure - (19) |
| dégier, v. chasser, dégÎter. - (38) |
| dégier, v., se débarrasser de quelque chose. - (40) |
| dégigandé, déguingandé. - (28) |
| dégigougner, v. tr., disloquer, disjoindre. Malgré le préfixe, simplement euphonique, ce verbe est à peu près synonyme de gigougner, qu'il ne fait qu'accentuer : « C'te taule é pis c'te cheire sont toutes dégigougnées. » - (14) |
| dégingandé. Démis, déboîté, déhanché. - (49) |
| dégin-ner - singi : imiter - (57) |
| déglacer : v. n., dégeler. - (20) |
| déglice. Délices. La syllabe gli se mouille dans le bourguignon déglice. - (01) |
| déglice. : Manière d'écrire le mot délice, afin de montrer qu'en patois la lettre l est toujours mouillée. - (06) |
| dégliéchi : Débarrasser de la glace. « Appreuche te du fu, te feras dégliéchi tes moustaches ». - (19) |
| déglingué : bancal - (57) |
| déglinguer : démolir, mettre en panne - (48) |
| déglinguer, v., empêcher le fonctionnement régulier d'un mécanisme. - (40) |
| dégnafrer : abîmer, déchiqueter - (60) |
| dégnagarguer. v. a. Déchirer avec les dents. (Domecy-sur-Cure). - (10) |
| dégnâiller (dé-gnâ-ier), v. déchirer. - (38) |
| dèg'nalè : désséché - (48) |
| dèg'nales : petit fruit désséché - (48) |
| dégnaper, déchirer - (36) |
| dégnaper. v. - Nettoyer les dents. (Arquian) - (42) |
| dégnaqué : difficile dans ses goûts culinaires - (51) |
| dégnavrer : abîmer - (61) |
| dègne : s. f. tige de chanvre. - (21) |
| dègne, petit paquet de tiges do chanvre. - (16) |
| dègne, s. f., tige de chanvre. - (14) |
| dégneiller : deguenillé - (39) |
| dég-netté (adj.) : décharné, d'une très grande maigreur (syn. acnî) - (64) |
| dégnon. s. m. Quantité de filasse retirée d’une tige de chanvre. (Lainsecq). Voyez dée. - (10) |
| dégnuer : dénouer - (57) |
| dégobéiller (v.t.) : vomir (du v. pop., dégobiller = vomir) - (50) |
| dégobillai - Même sens que revoguillai. - Note pôre petiot toutou et le minon dégobillant deu le maitin. - (18) |
| degobillar, s. m. vomissement, ce qui a été vomi. - (08) |
| dégobiller : déborder - (48) |
| dégobiller : vomir - (48) |
| dégobiller : vomir. - (09) |
| dégobiller : vomir. On devine que c’est l’action contraire de gober. - (62) |
| dégobiller : vomir - (39) |
| dégobiller, dégoubiller, dégueuler. v. a. et n. Vomir. Il a dégoubillé tout ce qu’il avait dans le corps. - (10) |
| dégobiller, v., vomir, - (40) |
| dégobiller, vomir. - (04) |
| dégobiller. Le contraire de gober. Al étot si tellement saoul quai ai dégobillé au mitan de lai route. - (13) |
| dégobiller. Vomir, vieux mot. Pour vomir, nous disons aussi : dégueuler, rejailler et rebômir. - (03) |
| dégobilli v. (du gaulois golbo, bouche) Régurgiter, vomir. - (63) |
| dégoêner. v. a. et n. Vomir. (Plessis-Saint-Jean). - (10) |
| dégôgni v. (de la racine gon, qui a donné de nombreux mots évoquant la truie, la saleté, l'aspect extérieur). Démettre, déboîter une articulation. Voir rgogni. - (63) |
| dégogni, dégueugni : entorse, foulure - (43) |
| dégoguiller. Dégobiller, vomir. - (49) |
| dégoisé. adj. Avisé, rusé, mais qui parle trop. Dérivé de gosier. - (10) |
| dégoiser (Se) : v. r., parler d'une façon inconsidérée. Syn. de barbouiller. - (20) |
| dégoiser (verbe) : parler à tort et à travers. - (47) |
| dégoiser : parler à tort et à travers - (60) |
| dégoiser v. (du lat. gueusia, gosier) Parler à tort et à travers. - (63) |
| dégomiter. v. a. et n . Vomir. - (10) |
| dégonchi : dégonfler - (51) |
| dégonchi v. Dégonfler. - (63) |
| dégôniché, adj., habillé de mauvaises hardes, à moitié dévêtu. - (14) |
| dégon-ner (v. tr.) : dégonder (dégon-ner la porte) - (64) |
| dégonner, dégounner. v. - Dégonder, retirer la porte ou la fenêtre de ses gonds. - (42) |
| dégonner. v. a. Dégonder. — Neutralement, sortir de ses gonds. - (10) |
| dégordi(e) : dégourdi(e), tiède (dans le cas d'un liquide) - (39) |
| dégôrdi, adj., dégourdi. - (14) |
| dégordi, e, adj. dégourdi, vif, éveillé, bien portant : « qu'ai ô dégordi c' p'tiô laite », qu'il est éveillé cet enfant-là. - (08) |
| dégordir. v. - Dégourdir. - (42) |
| dégorge. n. f. - Dans la partie basse de la vigne, endroit où s'amassent les terres entraînées par les pluies. - (42) |
| dégorge. s. f. Endroit où s’amasse à l’extrémité inférieure d'une vigne la terre que la culture et les eaux font descendre, et où l’on dépose aussi dans certains cas les terres enlevées de la vigne pour faciliter l’écoulement des eaux. - (10) |
| dégorgeouaîr (on) : dégorgeoir - (57) |
| dégorger. v. - Relever les terres amassées dans la dégorge. - (42) |
| dégorger. v. a. Action de relever, de disposer les terres de façon à ce que les eaux s’en dégorgent facilement. - (10) |
| dégorgi : dégorger - (57) |
| dégorgie. n. f. - Coulée de terre entraînée par de violents orages. - (42) |
| dégorgis. s. m. Terres amassées dans la dégorge ménagée au bas d’une vigne en pente, et que de temps en temps le vigneron est obligé de remonter à la hotte. - (10) |
| dégorgni, dégueurgni v. Distraire, dérider, litt. rendre moins grognon. - (63) |
| dégornaler v. Démonter, désassembler. - (63) |
| degornaudé : matériel en panne - (34) |
| dégornaudé, dégonialé : matériel en panne, avec des pièces désaccouplées - (43) |
| dégornôdé : matériel en panne, avec les pièces désaccouplées. A - B - (41) |
| dégôtai. Dégoûter, rebuter : « Éne dé chose qui m'é le pû dégôtai », une des choses qui m'a le plus dégoûté… - (01) |
| dégôter : Dégôuter. « La politique me dégôte ». « Te fa bien le dégôté », tu fais bien le difficile. - (19) |
| dégoter.v. a. L’emporter sur quelqu’un, le supplanter. Eh ben, mon petit, c’est p’encore toi qui me dégoteras ! - (10) |
| dégots (les) : chute (d'eau d'un toit) - (57) |
| dégotter : Dégoutter. « Tan parapliu dégotte, porte le dégotter defô ». - (19) |
| dégouailler, v. tr., dégoiser, parler beaucoup. - (14) |
| dégouâyé, celui dont les vêtements sont en désordre et dont la gorge est à nu. - (16) |
| dégouâyer : dégraisser - (48) |
| dégouâzé, vomir et dire à quelqu'un de longues injures. - (16) |
| dégoueiller, v. a. déchirer, dégueniller : « a m'é dégoueillé mai biaude », il m'a mis ma blouse en loques. - (08) |
| dégouéser. v. - Dégoiser : « Aga don', alle est encore en train d 'dégouéser aveuc le facteu'. » En ancien français du Xllle siècle, desgoiser est la forme insistante du verbe gosier ou gosiller signifiant à la fois vomir, chanter, et parler rapidement - jacasser. Ces mots sont issus du gaulois josier, gorge. - (42) |
| dégougnancer : v. a., mettre en désordre. - (20) |
| dégougné : décousu, démanché, dérangé. - (30) |
| degougner (se) : se déboîter un membre. - (30) |
| dégougni : déboiter - (51) |
| dégougni : entorse, foulure - (34) |
| dégougnie : entorse, foulure. A - B - (41) |
| dégouille : s. f., descente de gosier. - (20) |
| dégouiller (Se) : v. r., se débarrasser de ses vêtements. Voir engouiller. - (20) |
| dégouilli : ouvrir un colis, enlever un pansement. A - B - (41) |
| dégouilli : développer un paquet, une plaie - (34) |
| dégoûilli v. (du lat. gulam, gorge). Développer, désemballer, démailloter, déballer, déshabiller. - (63) |
| dégouliner (C.-d., Chal., Br., Y.). – Couler doucement, lentement, en un filet mince ; gracieux diminutif du verbe découler, venant du vieux français goliner, dont la racine est coluber, couleuvre, et qui a produit également le mot rigole. Le mot degoult (égout), cité par CunissetCarnot, vient plutôt de égoutter, racine : gutta… Dans l'Yonne, on emploie aussi la charmante expression se couliner pour : disparaître furtivement. - (15) |
| dégouliner : faire écouler un liquide. - (09) |
| dégouliner, v. intr., découler. Se dit d'un liquide qui coule, plutôt lentement que rapidement : « Quand ô bouét, l'vin li dégouline dans sa moustache, jeûsque d'su l'menton. » - (14) |
| dégouliner. Couler en abondance, du haut en bas. De la pluie tombant à flots, on dit « il en dégouline ». - (49) |
| dégouliner. Découler, dont il est un fréquentatif. - (03) |
| dégouliner. Dévaler, mais avec un sens plus spécial, s'appliquant moins aux personnes qu'aux choses, surtout aux liquides. - (12) |
| dégouliner. v. a. Dégoutter, couler lentement, goutte à goutte, le long de quelque chose. J’sentais que ça me dégoulinait dans le dous. - (10) |
| dégourrer (Se) : v. r., se déshabiller. Voir gourrer (Se). - (20) |
| dégoutant (dégoûtant), dégoutante : adj., dégoûté, difficile pour la nourriture. - (20) |
| dégoûtant, adj. insupportable : un enfant dégoûtant. - (24) |
| dégoutâssion, action ou chose repoussante. - (16) |
| dégouyi : (vb) déballer - (35) |
| dégouyi, v. a. dégager un outil de la terre humide qui s'y est collée. - (22) |
| dégouyi, v. a. dégager un outil de la terre humide qui s'y est collée. - (24) |
| dégoyer, dégoiller, dégouailler. v. a. Dégueniller, déchirer. (Avallonnais). - (10) |
| dégraichi : Dégraisser. « A présent que t'as fait deux jos la noce mije voir des tapines (pommes de terre) pa te dégraichi les dents ». « Dégraichi de la lain- ne » : la débarrasser du suint. - (19) |
| dégraichoux : Personnage imaginaire à qui on attribue le pouvoir de faire maigrir et dont le nom trouve place dans cette phrase adressée à une jeune femme qui relève de couches : « Dis dan Glaudine an voit que le dégraichoux a passé ! ». - (19) |
| dégraissi : dégraisser - (43) |
| dégraissi v. Dégraisser. - (63) |
| dégraponner : gratter vivement le sol - (48) |
| dégrasser, v. dégraisser. - (38) |
| dégré, s. m. marche d'escalier. - (08) |
| dégrenè : désamorcer une pompe - (46) |
| dégrener : v. a., désengrener (une pompe). - (20) |
| dégrener : v. a., vx fr.f égrener, écosser. - (20) |
| dégreuber, v. tr., remuer, dégourdir, réveiller, tirer d'un endroit : « S'ô n'vein pas, l'drôle, j’m’en va dégrejuber. » — « Ma, vein donc, ch'tite panosse ; te n'peux donc pas t’dégreuber d'iqui ? » (V. Dégueugner.) - (14) |
| dégreussi : Dégrossir, styler. « T'as eune sarvante que n'est guère au courant de san ovrage, t'aras bin des maux pa la dégreussi ». - (19) |
| dégréver, v. a. détacher quelque chose qui n'est pas à sa place, un bateau échoué, une épave quelconque, et par extension, tout objet qui est arrêté hors de son lieu naturel. - (08) |
| dégrevonner, gratter le sol. - (26) |
| dégrigné : v. t. Démêler. - (53) |
| dégrigner : médire. (F. T IV) - Y - (25) |
| dégrigner, v. tr., détirer du linge, mais imparfaitement, car dégrigner veut aussi dire : le mal repasser (V. Couteler.) - (14) |
| dégrigner. v. a. Dédaigner, rejeter, mépriser. (Soucy, Mont-Saint-Sulpice). - (10) |
| dégrimonai - arracher ou détruire le grimon, le chiendent, etc., ce qui n'est pas facile ; se hâter, s'efforcer après un ouvrage difficile. - Dégrimonez don vote champ al â vraiment empaistai. - I me seu dégrimonai aipré vote mur. - (18) |
| dègrimoné, vt. enlever le grimon (chiendent) d'une terre, d'une allée. Blâmer, déchiqueter (au moral). - (17) |
| dégrimoner : déchiré. - (66) |
| dégrimoner : griffer, écorcher. (R. T IV) - Y - (25) |
| dégrimoner, v. intr., geindre, marmotler, murmurer. — Sens tr., tirailler, chagriner quelqu'un, le malmener. - (14) |
| dégrimoner. v. a. Déchirer, égratigner, (Argentenay). — A Pasilly, on dit dégrimouner. J’ma dégrimouné la figure. - (10) |
| dégrimonner (se), s'acharner à un ouvrage pénible. - (27) |
| dégringolé, descendre d'une hauteur plus vite qu'on ne lo voudrait. Un homme dégringole quand sa santé, ses forces diminuent ; un élève a dégringolé quand il a perdu les bonnes places qu'il avait d'abord obtenues. - (16) |
| dégrinié : mal repassé. (S. T III) - D - (25) |
| dégrisi – dessoûler : dégriser - (57) |
| dégro : s. m. escalier. - (21) |
| dégrôler, v. secouer sur ses bases une colonne, un édifice, un objet situé à gêne dans une surface pour l'en arracher. - (38) |
| dégroué : v. t. Enlever l'envie de couver à une poule. - (53) |
| dégrouer : découver, empêcher les poules de couver - (43) |
| dégrouer v. Empêcher une poule de couver en l'enfermant sous un peurson ou dans un réduit obscur, les ailes attachées, pendant un jour ou deux. - (63) |
| dégrouilli (s') v. Se dégrouiller, se grouiller, se dépêcher. Voir grouilli. - (63) |
| degroulé : transi(F. T IV) - Y - (25) |
| dégroûssi : dégrossir - (57) |
| dégrumer : v. a, égrumer. - (20) |
| déguaster. : (Dial.) [S. B.], ravager, détruire. Du latin devastare. - (06) |
| déguegnouler, v. a. disloquer par usure. - (24) |
| dégueneiller, v. a. dégueniller, déchirer. - (08) |
| déguener. Agacer, taquiner. - (49) |
| dégueneuilli v. Dégueniller. - (63) |
| déguene-yi : déguenillé - (43) |
| déguenillé (éte) : avoir des vêtements en guenille - (48) |
| dégueniller : déchirer - (60) |
| dégueniller, v. n. abonder, affluer. Ne s'emploie guère qu'en parlant des fruits, lorsqu'ils sont en grande quantité. - (08) |
| déguerpi - foutre l’camp : déguerpir - (57) |
| dégueubilli : Vomir. « Ol a to dégueubilli sa marande ». Au figuré se dit d'un sac dont le contenu se déverse. - (19) |
| dégueugnalé, v. a. disloquer par usure. - (22) |
| dégueugner : faire sortir un insecte ou un poisson caché. (VDS. T IV) - VdS - (25) |
| dégueugner, v. tr., battre, donner des coups, dégourdir, faire marcher, activer, pourchasser : « Attends! attends ! j'm'en vas t’déguegner! » (V. Dégreùber.) - (14) |
| dégueulé : débordé - (44) |
| dègueulé, vn. dégueuler, vomir. - (17) |
| dégueuleau, dégueuliau : s. m., dégueulée, masse alimentaire rendue par vomissement. - (20) |
| dégueuler : déborder - (48) |
| dégueuler, crier, disputer, vomir. - (05) |
| dégueuler, démamer : vomir - (48) |
| dégueuler. v. n. et v. a. Voyez dégobiller. - (10) |
| dégueulon (du) : vomissure - (57) |
| dégueurgni, dégorgni v. Distraire, dérider, litt. rendre moins grognon. - (63) |
| dégueurnaillé : objet insevable - (44) |
| dégueurner : désamorcer (une pompe) - (48) |
| dégueurner : Désamorcer. « Lapampe est dégueurnée ». - (19) |
| dégueurni v. Désamorcer une pompe. - (63) |
| dégueurnoder : démêler, défaire - (51) |
| dègueuté, vt. dégoûter. - (17) |
| déguillemanché, déguillemanchée : adj., démantibulé, dégingandé. Table déguillemanchée. Ce grand déguillemanché ! - (20) |
| déguillemanchi : Dégingandé. « In grand déguillemanchi ». Démantibulé. - « S'tu chaire (chaise) n'est pas solide, alla est tote déguillemanchie ». - (19) |
| déguiller : v. n., vx fr. déguier, tirer au sort entre enfants qui jouent, pour savoir celui qui aura a faire telle ou telle chose. - (20) |
| déguisi - dédjisi : déguiser - (57) |
| dégun (adj.,pron.ind.) : aucun, pas un (à rapprocher de l'espagnol ninguno) - (50) |
| dégun, eune, adj. aucun, pas un : « en degun leu », en aucun lieu. - (08) |
| degun, negun, aucun, degun leu, aucun lieu. - (04) |
| dégu'néillè : déchiré - (48) |
| dégunÿilli : dégueniller, déchiqueter, dévorer - (51) |
| degy. : Déjà. (Del.) - (06) |
| déhantsi v. Déhancher. - (63) |
| déharnicher, désharnicher. v. a. Déharnacher. (Villiers-Saint-Benoît). - (10) |
| déharnicher. v. - Déharnacher. - (42) |
| déhinch’ment (on) : déhanchement - (57) |
| déhinchi : déhanché - déhancher - (57) |
| déhiôle, s.f. mise négligée. - (38) |
| dehorer (dihorer) : mettre à la porte, mettre dehors. - (32) |
| dehors, adv., dehors. Employé dans ces locutions bien locales : Entrer dehors ; fremer déhors. « Tatigué ! j'ai pardu ma cléë; j'sus fremé dehors. » (V. Diors.) - (14) |
| déhors, adv., dehors. Je suis fermé déhors, se dit couramment quand on ne peut pas ouvrir la porte de son logement. - (20) |
| déhurter. : (Dial.), presser, pousser vivement. - Expression de tournoi qui semble empruntée à l'expression anglo-normande to hurt. - (06) |
| Dei. Dieu. Le bourguignon dit aussi Dieu. - (01) |
| déïaut. Mal vêtu, de tenue négligée. « Va i don grand déïaut ! », dit-on, d'un homme mis sans goût. - (49) |
| deibler. n. m. - Bourreau de justice : « Ah c'est vous l'deibler. Et ben, j'suis ben sûr que vous vourez itou pas avouer à faire à moué. » (Fernand Clas, p.353) - (42) |
| deigne, n. fém. ; tige de chanvre ; var. graphique de daigne. - (07) |
| deigne. s. f. Tige de chanvre. J’navons pas récolté une seule Deigne. (Druyes). — Voyez degnon. - (10) |
| deijai. Déjà. - (01) |
| deillau : dé. - (21) |
| deillot : personne grande et nonchalante - (44) |
| deillot. adj. Douillet. (Guy). - (10) |
| déjai (adv.) : déjà - (50) |
| déjai, d'jai : déjà - (48) |
| déjainer. Se moquer de quelqu'un en Je contrefaisant. Les Bourguignons disent dans le même sens rejenner. - (03) |
| déjamber. v. - Faire un croche-pied. - (42) |
| déjau (n.m.) : dégel ; fonte de la glace - (50) |
| dejau (nom masculin) : dégel. - (47) |
| déjau, s. m. dégel, fonte de la glace ou de la neige. « Dézau. » - (08) |
| déjaul, s. m., dégel. - (14) |
| déjauler, v. tr. et intr., dégeler. - (14) |
| déjeter. .Mépriser. - (03) |
| déjeunai. Déjeuner, déjeuné. - (01) |
| déjeuner, employé passivement, je suis déjeuné. - (04) |
| déjeunon, s. m. déjeuner. - (24) |
| deji - déjà. - Ile ai déji fini sai tâche. - Oh ! al y sont déji arrivai. - (18) |
| déji : déjà. - (29) |
| dëji, déjà ; t'voiki dëji ! te voilà déjà, sitôt ! - (16) |
| déjier : se débarrasser de quelqu'un de gênant. (RDM. T IV) - B - (25) |
| déjler (v. int.) : mourir - (64) |
| déjouter, v. a. crever, arracher les yeux. - (08) |
| dékernir. Assouplir, nettoyer. - (49) |
| dékiérer. v. a. Déclarer. (Vassy-sous-Pisy, où cl se change en ki et l’é en a, dans les mots du même genre). - (10) |
| dékiouler. v. a. Déclouer, par changement de cl en ki et interposition de l’l euphonique entre l’u et l’e. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| délâ : Délier. « délâ des jârbes (gerbes) ». - (19) |
| déladé : vache ayant perdu ses repères - (43) |
| delai, adv. là-bas. - (22) |
| delai, adv. là-bas. - (24) |
| délailli : délier - (57) |
| délaissi - laissi d’côté : délaisser - (57) |
| délaissi : délaisser - (51) |
| délaper, v. n. quitter, lâcher, abandonner : « i aivô enteurpri d'fére ç'lai, ma i m'en seu délapé », j'avais entrepris de faire cela, mais j'y ai renoncé. « déiaper », détacher, décoller. (Voir : laper.) - (08) |
| delaque. adj. Coûteux. (Plessis-Saint-Jean). - (10) |
| délaser : intervertir la place des bêtes dans un attelage (chaque bête a sa place à droite ou à gauche, intervertir les perturbe mais au bout de quelque temps elles peuvent travailler des deux côtés) - (43) |
| délaser, v. a. intervertir sous le joug, une paire de bœufs, de vaches. - (24) |
| délaûss’ment (on) : délassement - (57) |
| délaûsser : délasser - (57) |
| délavé : Décoloré par des lavages successifs. « In davanté blieu to délavé » : un tablier bleu tout décoloré. - (19) |
| délavé ; un mets cuit dans uno trop grande quantité d'eau et qui y a perdu de sa saveur est dit délavé. - (16) |
| délécher, délicher (se). v. pron. Se lécher les lèvres, les babines. (Villiers-Saint-Benoît). - (10) |
| déleire, choisir, supprimer. En latin, delere signifie effacer. - (02) |
| deleire. : (Dial.), choisir (du latin deligere.) - (06) |
| déleitaule. : (Dial.), délectable (du latin delectabilis). - (06) |
| déleugi : Déloger, chasser. « Attends voir je vas bin te déleugi d'itié ». - (19) |
| délevé, adj. se dit d'un enfant qui ne peut digérer la nourriture et qui a des vomissements. - (08) |
| delez, dilez, delaie : prép,, vx fr. deles, à côté de. - (20) |
| deli ou délir : Choisir, préparer une salade. « Ol est après à delir eune salade de crôpe (une salade de pissenlits) ». - (19) |
| déli, d’lé : (adv) là-bas, plus loin - (35) |
| délibérer : v. a., libérer. Entendu en 1917 : « Mon mari a été pris prisonnier en 1914, mais il est malade, j' pense qu'on va bientôt l’ délibérer. » - (20) |
| délibérer, v. tr., débarrasser : « C't'afâre m'ostinôt ;... j'en seû délibéré. » - (14) |
| délicat : Délicat, difficile. « Ol est bin délicat, an ne sait pas ce qu'an veut li fare à marande ». - (19) |
| délicoter, déligoter. v. a. Délier, rendre alerte, donner de l’agilité. La peur lui délicote les jambes. — Délicoter un cheval, le débarrasser de son licou. — Se délicoter. v. pronom. Se secouer, s’étirer, se dégourdir. - (10) |
| delicoter, déranger, déclouer. - (05) |
| delie : prononcer : délie (e sans accent). Peler, éplucher, décortiquer (verbe délier ?) Se disait notamment (et peut-être même exclusivement ?) de la préparation du calon, avant de presser les cerneaux dont on retirait l'enveloppe pour faire l'huile. Ce travail se faisait souvent à la veillée en famille. Ex : "A s'souèr', j'vons délie des calons." - (58) |
| délier (verbe) : dételer les bœufs. Les débarrasser du joug. - (47) |
| délier, v. a. détacher les courroies qui fixent le joug des bœufs ou des vaches. - (08) |
| délieux. n. m. - Celui qui coupe la ficelle pour délier les gerbes. - (42) |
| délijanté, presser quelqu'un pour qu'il se mette à l'ouvrage; s'délijantè, se hâter de travailler et en travaillant. - (16) |
| délinquer, délinquier. v. n. Baisser, décliner, perdre de sa fortune, de son crédit. Du latin de relingere. - (10) |
| délinquer, v. a. laisser, quitter, abandonner. - (08) |
| délioqué : disloqué. Ça llioquo : ça a du jeu. - (33) |
| déliou : pièce avant du chariot - (39) |
| délire : eplucher - (60) |
| délire : trier (des grains) - (57) |
| délire, choisir, trier. - (05) |
| délire, v. délier, trier des haricots, des pois, etc... - (38) |
| délire, v. tr., choisir, trier le bon parmi les légumes qu'on épluche : « All’délit les harbes por sa sôpe. » - (14) |
| délire. Choisit· parmi des légumes, en les épluchant. - (03) |
| délire. v. - Délier, éclaircir, décortiquer, éplucher ; on délit les bois avant la coupe, et à la veillée, on délit les noix autour de la cheminée. - (42) |
| délire. v. a. Éplucher, sarcler, trier, choisir. Du latin deligere. - (10) |
| delissi. : Choisir. (Del.) Rac. du latin deligere. - (06) |
| délissure. n. f. - Épluchure. - (42) |
| délissures. s. f. pl. Epluchures. (Villiers-Saint-Benoit). - (10) |
| déliter, v. rendre friable. - (38) |
| délitieux. adj. Délictueux, défendu et puni par la loi. - (10) |
| délivre, délire. n. m. - Placenta chez la vache. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| délivrô. Délivrais, délivrait. - (01) |
| délochi, adj. détraqué, maladif. - (24) |
| délogi : déloger - (57) |
| déloigé, part. passé du verbe déloger. - (08) |
| délouchi*, adj. détraqué, maladif. - (22) |
| dèloué, vt. délier. - (17) |
| délouper, v. a. développer. - (08) |
| délouper. v. - Développer. - (42) |
| délouper. v. a. Pour Déloper, contraction euphonique de Développer. (Cravant). - (10) |
| déloyal, adj. indiscipliné, désobéissant, fantasque. - (08) |
| déluge : déluge, pluie diluvienne. « Mâ y en cheut-i ? y est in vra déluge ». - (19) |
| délugeant. adj. Très-coûteux, ruineux comme le déluge. (Plessis Saint-Jean). - (10) |
| délumer. v. a. Éteindre le feu. - (10) |
| déluré : très vif. - (09) |
| déluré. v. a. Voyez délire. (Soucy). - (10) |
| dem’hieûre (na) : demi-heure - (57) |
| dém’ner (se) : démener (se) - (57) |
| démàdeu, adv. dès aujourd'hui, dès à présent, dans la journée. (Voir : mâdeu.) - (08) |
| demadze : dommage - (43) |
| demage : Dommage « O s'est euffri à payer le demage ». « Y est bien demage » signifie c'est fâcheux, tandis que « Y est bin demage » a un sens ironique et veut dire : cela n'en vaut pas la peine. - (19) |
| demaigne, demaingne. s. m. Demain, Aipré-demaingne, après demain. (Ménades). - (10) |
| demaing (n.m.) : demain - (50) |
| demaing : demain - (39) |
| demaingn’ : demain - (52) |
| démairier : démarier - (57) |
| démaiser. Délayer : « démaiser la farine pour obtenir de la pâte ». - (49) |
| dèmajojon, sf. démangeaison. - (17) |
| démalaiser (Se). v. pronom. Se tirer de peine, se tirer d’embarras. — Se démalaiser d'une affaire, se presser de s’en occuper, pour être plus tôt sorti, plus tôt débarrassé du mal qu’elle vous donne. (Chaumot). - (10) |
| démalfiant, ante. adj. Défiant. — Jaubert donne démaufiant. - (10) |
| demâmé : v. t. Vomir. - (53) |
| démamer (v. tr.) : vomir (syn. renvouéyer la clâsse) - (64) |
| démâmer : vomir - (39) |
| démamer. v.- Vomir (Sougères-en-Puisaye). Ce mot pourrait être le contraire de mamer, néologisme fictif.signifiant manger. - (42) |
| demâmeure : n. m. Vomissure. - (53) |
| démandraler (se), v., tomber en douelles (tonneau). - (40) |
| démandriller : v. a., mettre en mandrilles. En 1710, les religieuses de l'hôpital de Chalon certifient qu'elles ont recueilli le curé Demaizière « vieillard de 86 ans, tout émandiilé [sic], mourant de faim, sans un sol. » (Archives hosp. de Chalon, série B. Dossier de la fondation Demaizière). - (20) |
| démandrœlli, adj. dépenaillé, comme un « mandrineau ». - (22) |
| démandrœyi, adj. dépenaillé, comme un « mandrineau ». - (24) |
| démandzi v. 1.Démanger. 2. Démancher. - (63) |
| démangi : Démancher. « J'ai démangi ma plieuche (pioche) ». Luxer, « O s'est démangi eune épaule ». - (19) |
| démangonai - défaire, disloquer, déranger. - Lai voiture â tote démangonée. – Ne me secoue don pâ queman cequi les bras, te vas me les démangonai. - (18) |
| démangonai, démantibuler. A Genève on dit : Cette serrure est démangonnée. Les Picards disent démagandé... - (02) |
| démangonai. : Démantibuler. - Ce mot est un terme de guerre pour exprimer la démolition ou la mise hors de service d'une machine de jet ou mangoneau. - (06) |
| démangoné, dépenaillé, dont les vêtements sont décousus, en loques. - (16) |
| démangôner (C.-d., Chal.), démantigôner (C.-d.). - Démantibuler, démancher, déchirer, disloquer. Nous trouvons là le mot gêner, qui sera cité plus loin, mais la première syllabe de ce mot est devenue brève, par suite de la règle que nous avons énoncée dans la préface. - (15) |
| démangôner, v. tr., déchirer, démancher, mal habiller. - (14) |
| démangoner: Détraquer, disloquer, ne se dit que des personnes. « J'ai été si bin secoué dans s'te carriôle que j'en sus to démangoné ». Démangoné a à peu près la même signification que démangi avec cette différence que démangi ne se dit que d'un membre tandis que démangoné se dit de tout le corps. - (19) |
| démangonné : (p.passé) démanché - (35) |
| démangonner : démonter, désosser - (51) |
| démangoñner v. Démonter. - (63) |
| démangonner : v. a., démancher, démonter, déchirer. Ohl tiens, tu m'as toute démangonnée ! - (20) |
| démangouner, v. démolir ; certainement dérivé de "mangoneau", machine de guerre qui lançait des pierres. - (38) |
| démanjòner, v. a. démancher, retirer le « manje », le laisser échapper. - (24) |
| démanjouné, v. a. démancher, retirer le « manje ». - (22) |
| démansnellé : v. t. Démanteler, "disjointer", débrancher. - (53) |
| démantigoner et démangoner. Déshabiller et par extension, disloquer. Not' reloige ast démantigoné. On retrouve dans ce verbe baroque, les deux mots mante et gonelle ; (V. Gonot), ce qui couvre les épaules et ce qui vêtit le corps. - (13) |
| démantigoner : (démantigonè - v. tr.) démantibuler, mettre en pièces, disloquer. - (45) |
| démantigoner, v. a. démantibuler, disloquer, briser, détruire. - (08) |
| démantigouègner : disloquer - (48) |
| démantsi v. Démancher. - (63) |
| démantssi : démancher - (51) |
| démarche : s. f., ancienne mesure de longueur pour les chemins, équivalente au pas de Mâcon (2 pieds 1/2, soit 0 m. 812). - (20) |
| démarcher (Se), faire des démarches pour obtenir quelque chose. - (20) |
| démarcher (Se). v. pronom. Faire des démarches pour une affaire. - (10) |
| démarchi : démarcher - (57) |
| démarchou : démarcheur - (57) |
| démârè : v. i. Démarrer. - (53) |
| démàrer, v. intr., bouger, quitter un endroit : « Bon sens ! J'ons-t-i évu du mau à l’fâre démàrer ! » - (14) |
| démarier v. Eclaircir (les semis). - (63) |
| démarné; v. a. débrailler, déboutonner le pantalon : cet ivrogne est démarné. - (22) |
| démarner, v. a. débrailler, déboutonner le pantalon : cet ivrogne est démarné. - (24) |
| démarner. v. a. Labourer profondément. (Etivey). - (10) |
| démarrer. v. n. Bouger de place, se mettre en mouvement pour aller et venir, pour travailler. Est-ce que tu ne vas pas démarrer bientoût ? - (10) |
| démauger, v. tr., ôter la mauvaise chance, enlever un sort. (V. Mauger.) - (14) |
| démauger. Oter la mauvaise chance. - (03) |
| demauroge, remuant , qui ne peut se contenir ; il signifie aussi qui se dérange... - (02) |
| demauroge. : Remuant, qui ne peut se contenir (du latin de mala rabie). Il signifie aussi qui se dérange. - (06) |
| démauvertir : dévergonder - (61) |
| demé : Demi. « In demé litre de vin », « Deux heures à demé » - (19) |
| dème. Dame. - (49) |
| démêfier (s') (v. pr.) : se méfier - (64) |
| déméfier (se). v. - Se méfier. « Aussi ça m'sembe pas mal étrange, et j'f'rai pas mal de m'déméfier. » (Fernand Clas, p.96) - (42) |
| déméger, démanger. - (27) |
| démêler : v. a., syn. de décatonner. Démêler la pâte. - (20) |
| démêloir : s. m., peigne Imaginaire, qui servirait à mettre de l'ordre et de la clarté dans le langage ou les idées d'une personne qui « bafouille ». - (20) |
| déménagi - saintmartener - fére la Saint-Martin : déménager - (57) |
| démenai – gronder, semoncer. - Ces pôres petiots, ne les démenez don pa tant, vo les dégouterain. - Al â tojeur ai demenai son monde ! qué mauvais genre !! - (18) |
| démenai. Démener, démené. - (01) |
| démené, v. a. délayer. - (22) |
| démener, v. a. délayer en remuant. - (24) |
| demeneure. : Territoire d'un seigneur, terra indominicata dans les anciennes coutumes. (Franchises de Salmaise, 1265.) - (06) |
| démenti : démentir - (57) |
| demenuer : Diminuer, baisser en parlant des prix. « Le blié a bien demenué » : le prix du blé a bien baissé. - (19) |
| démenùyé, v. a. diminuer. - (22) |
| démenùyer, v. a. diminuer. - (24) |
| démépriser. v. - Mépriser. (Arquian) - (42) |
| dêmer. v. a. Diminuer. (Soucy). - (10) |
| démeub’iller : démeubler - (57) |
| démeublier : Démeubler. « Ol a la gueule tote démeubliée » : il a perdu toutes ses dents. - (19) |
| démeudre : Démordre. « Quand ol a dit quèque chose o n'en démeut pas ». - (19) |
| demeurai. Demeuré. - (01) |
| demeurance, s. f. lieu où l'on demeure, résidence. On montre la maison d'une personne en disant : « ç'ô lai qu'ô sai d'meurance. » - (08) |
| démeureiller. v. a. Démurer. - (10) |
| demeurer. v. - Être embourbé ou arrêté, pour différentes raisons. - (42) |
| demeurer. v. n. Être arrêté, entravé dans sa marche par une circonstance de force majeure ou par un accident. Se dit surtout, en navigation, d’un bateau échoué sur les sables, ou arrêté quelque part faute d’eau. Tous les bateaux sont demeurés à la Belle-Avoine (entre Saint-Cydroine et Joigny). - (10) |
| démeurgé : v. i. Sortir (du lit et se hâter). - (53) |
| démeurger : partir, faire partir rapidement - (48) |
| démeurger, v., fuir, changer de lieu. - (40) |
| démeurgiller, démolir un pierrier. - (26) |
| dém'gi. Démanger. - (49) |
| demiatter : faire du bruit en mangeant quelque chose de bon. - (30) |
| démigé, démoingé : v. i. Démanger. - (53) |
| démigeaison. s. f. Démangeaison. (Avallonnais). - (10) |
| démiger : débuter au jeu. - (09) |
| demiger, démanger. - (05) |
| demiger, v. ; démanger. - (07) |
| démiger. v. a. Démanger. (Id.). - (10) |
| demigi : Démanger. « Te le gratte queva y le demige » : tu lui fais des compliments qui lui plaisent. - (19) |
| déminchi – démingi : démancher - (57) |
| démingeaison (na) - gratte (la) : démangeaison - (57) |
| demingeoillon, s. f. démangeaison. - (08) |
| déminger, v. a. cesser de manger. - (08) |
| deminger, v. a. démanger. «Deminzer » ou plutôt « d'minzer. » - (08) |
| déminger, v. intr., démanger: « Dis, dis ! on vouét prou que la langue te déminge. » - (14) |
| démingi : démanger - (57) |
| déminuer, v. tr., diminuer, amoindrir. - (14) |
| démiôler, v. a. défaire, désorganiser, démonter. - (08) |
| demi-queue. s. f. Fût de 204 litres. (Mailly-la— Ville). - (10) |
| demi-tasse. Une tasse de café archi-pleine, avec bain de pied. Double tasse serait plus exact, mais la gourmandise y met une sorte de pudeur coquette. - (12) |
| démôdre : insister, maintenir…. Ne rien lâcher, le têtu môrd à peu ô n’démôrd pas. - (62) |
| démoinché, démoingé : v. t. Démancher, enlever un manche. - (53) |
| démoingè : v. t. Démettre. - (53) |
| démoingeai : démolir, démettre. Un manche démoingé ; se démoingeai une épaule. - (33) |
| démoinger : démancher - (48) |
| démoinger : démanger - (48) |
| démoinger, v. a. démancher, ôter le manche d'un outil, d'un instrument. Suivant les localités, on prononce « démoincher, démoinger, démoinzer.» (Voir : moinge.) - (08) |
| démoinger. v. a. Démancher. (Avallonnais). - (10) |
| demoirer, demouérer, v. n. demeurer, habiter, séjourner : « i vé d'moirer en c'païs quite », je vais demeurer en ce pays-ci. - (08) |
| demoiselle : voir chvau - (23) |
| demoiselôtte , petite demoiselle. - (02) |
| demoiselôtte. : Diminutif de demoiselle. (Del.) - (06) |
| démôlan : Démolir, quelque chose que l'on vient de demêler, de delayer. A plutôt un sens péjoratif. « Qua dan qu 'y est que ce démôlan ? ». - (19) |
| dèmôlè : démêler - (46) |
| démôlé, démêler, par exemple, du fil enchevêtré. - (16) |
| dèmôlé, vt. démêler. - (17) |
| démôler : démêler - (48) |
| démôler : Démêler. « T'as les cheveux bien emmôlés, j'ai de la poin-ne à les démôler ». - Délayer. « Vo vla-t-y? Oh que sus cantante de vo voir, je vas vitement démôler des gaufres ». - (19) |
| démoli : démolir - (57) |
| démolissures. s. f. pl. Démolitions. - (10) |
| dèmôlou, sm. démêloir. - (17) |
| démoloye. s. m. Démêloir. (Saint-Germain-des-Ghamps). - (10) |
| démon maitin, adv. Demain matin. - (17) |
| démon, s. m., enfant vif, turbulent, lutin, mauvais sujet, qui remue sans cesse. - (14) |
| démonacle. Enfant méchant, tapageur. Le p'tiot de not’ Louis ast un vrai démonacle. Par assimilation à un démoniaque... - (13) |
| démônaqhi', s. m. démon, mauvais sujet, libertin. Aux environs de Château-Chinon, « démouna. » - (08) |
| démoniâcle, et démounâcle, adj., démoniaque. Mêmes acceptions que Démon. - (14) |
| démorceler. v. a. Morceler, mettre en morceaux. - (10) |
| demorer : Demeurer, habiter. « Ma tante demore à Etrigny». - Rester, « Te demoreras bin jeusqu 'à demain ». - (19) |
| démornachi (s') v. Pour un cheval, perdre son mors à force de secouer la tête à cause des mouches. - (63) |
| démortir : v. n., vx fr., dégourdir (un liquide). De l'eau démortie. - (20) |
| demortir, tiédir l'eau. - (05) |
| démortir, v. tr., faire tiédir de l'eau (l'eau froide étant considérée comme morte). - (14) |
| démortir. Faire tiédir de l'eau, par une espèce de métaphore, comme si l'on supposait que l'eau froide est morte. - (03) |
| démortsailli (se) : bouger les mâchoires dans tous les sens - (51) |
| démouâdre : démordre - (57) |
| démouli, v. a. démolir, détruire. - (08) |
| démounâcle, adj. démoniaque. - (38) |
| démouner (se) : démener (se). - (62) |
| démouner (se), v. pron., se démener, se donner du mouvement. - (14) |
| démouner (se), v. réfl. se démener, s'agiter vivement : « a s' deumoune c'man eun guiabe », il se démène comme un diable. - (08) |
| demourer. Demeurer, du latin morari et demorari. - (03) |
| démûler. v. a. Dépiler, démolir une meule de foin. - (10) |
| démuni : démunir - (57) |
| démurgè : v. t. Faire partir. - (53) |
| démurgeai : faire partir. - (33) |
| démuteler. v. a. Démuseler. - (10) |
| démzer (v.t.) : démanger - (50) |
| dendze n.m. (du vx.fr. dentée). Agacement des dents, des gencives quand on a mangé un fruit acide ou quand on entend un crissement strident. - (63) |
| dené : Denier. « As tu donné quèque chose pa le dené à Saint-Piarre ? ». - (19) |
| déneuri : Dégoûter, difficile, « O ne troue ren a san gout, y est in déneuri ». - (19) |
| deneuri, adj. dégoûté par excès de bonne nourriture : c'est un déneuri. - (24) |
| déneuri, adj. dégoûté par excès de bonne nourriture. - (22) |
| déneûrri : (adj) dégoûté, difficile sur la nourriture - (35) |
| déneurri adj. Difficile, exigeant quant à la nourriture. - (63) |
| denia. Paquet composé de dix grandes tiges de cheneviére. C'est du latin presque pur : denaria, une dizaine. - (13) |
| déniai : enlever à une poule l'envie de couver. On la trempait dans une bassine d'eau froide. - (33) |
| déniaisé : part, pass., qui a perdu sa gaieté. - (20) |
| dèniapai : déchirer, dépenaillé. Un jeune chiot déniape tout ce qu'il trouve en jouant : un jeune chiot déchire tout ce qu'il trouve en jouant. - (33) |
| déniapè : déchirer (moralement bouleverser) - (46) |
| déniâpé : mal vêtu. En haillons, déchiré. - (62) |
| déniapé : v. t. Déchirer (en lambeau). - (53) |
| déniâpé, adj., vêtu de haillons. (V. Dégòniché, Dépanelé). - (14) |
| déniapé, mal vêtu. - (26) |
| déniapé, très usé (en parlant de vêtements) . - (28) |
| déniaper : déchirer grossièrement. Mettre en petits morceaux. Être déniapé : vêtu en désordre ou de bric et de broc. Voir « chapouter ». - (62) |
| déniaper : déchirer - (48) |
| dèniaper : déchirer. El ot tout déniapé : il est tout dépenaillé, déguenillé. - (52) |
| déniaper v. Déchirer, déchiqueter, mettre en pièces. - (63) |
| déniaper, v., enlever ce qui recouvre, déshabiller. - (40) |
| déniâper, verbe transitif: déchirer sans soin, mettre en pièces. - (54) |
| déniaqué : syn. de dévidère*. A - B - (41) |
| déniaqué : (adj) synonyme de déneûrri - (35) |
| déniaqué : dégoûté, difficile sur la nourriture - (43) |
| déniaqué : gourmand - (34) |
| déniaqué adj. Difficile, exigeant, en matière d'aliments. Voir dévidaire. - (63) |
| déniauter. Enlever, faire perdre à une poule le besoin, l'habitude de couver. - (49) |
| déniavouérer : (dényavouèrè - v. trans.) lacérer, mettre en lambeaux. - (45) |
| dénichi : dénicher - (57) |
| dénichi : Dénicher, chasser. « Attends voir, je va bin te dénichi ». - Trouver, « Queva ce que t'as dénichi s'te veille assiette ». - (19) |
| dénier : enlever du nid (se dit en parlant d'une volaille qui s'arrête de couver) - (39) |
| denier : s. m., ancienne mesure de poids, correspondant au 1/3 du gros et valant, comme le scrupule, 1 gramme 274. - (20) |
| déniger (pour dénicher). v. a. Terme de jeu. Supplanter un partenaire près du but, le faire sauter du nid, de la niche, pour s'y mettre à sa place. (Moufiy). - (10) |
| déniger. v. - Dénicher. (Mouffy, selon M. Jossier) - (42) |
| dénigri : dénigrer - (57) |
| déniper, v. a. déchirer, mettre en loques, et littéralement arracher les nippes, c’est-à-direle linge, les habits. - (08) |
| dénippé, ée. adj. Déguenillé. (Cravant). - (10) |
| dénipper. v. a. Déchirer, dégueniller. - (10) |
| déniqué, qui a reçu un coup sur la nuque. - (26) |
| déniquer, souffrir d'une douleur dans la nuque à force d'avoir tourné la tête de tous les côtés et dans une position fatigante. - (27) |
| denner. v. a. Donner. (Percey). - (10) |
| denoier. : (Dial.), dénier. - Ces mots dénoiersa foid (livre de Job), sont peu différents du latin denegare suam fidem. - (06) |
| dénonci : dénoncer - (57) |
| dénouèilli – décaillouter : dénoyauter - (57) |
| dénourri : pass., dégoûté. Oh ! ch'tit dénourri ! Voir trop-soûl. - (20) |
| dénoyautage : s. m., action de dénoyauter. - (20) |
| dénoyauter : v. a., enlever le noyau d'un fruit. - (20) |
| dénô-yer, v. sortir un noyau de son alvéole. - (38) |
| denrée (bonne), loc, eau-de-vie, liqueur, eau-de noyaux, dont on boit un petit verre après le repas : « Votre père est arrivé à bon port, et déjà le bon vin et la bonne denrée lui rendent un peu de gaieté...» (Correspondance de 1816). - (14) |
| denrée (n.f.) : marchandise de toute espèce - (50) |
| denrée (une) : une chose, une personne (péjoratif) - (61) |
| denrée : ce mot était constamment employé en patois, au sens de marchandises, d'affaires. - (52) |
| denrée : de piètre valeur. A l’origine chose de la valeur d’un denier. Mais aussi : personne méprisable. - (62) |
| denrée : Récolte de n'importe quelle nature. « Vla de la balle denrée ». On dit aussi, en mauvaise part, d'une femme : « Y est eune brave denrée ». - (19) |
| denrée n.f. Objet ou matériau de très mauvaise qualité, être vivant malfaisant. - (63) |
| denrée : ce mot est utilisé dans un sens beaucoup plus large qu'en français. On peut l'utiliser en parlant de choses, d'animaux ou de personnes et il peut avoir une nuance péjorative - (39) |
| denrée : personnage détestable, ou méprisable. S'emploie de préférence à propos de la femme. Superlatif : vilaine denrée. Ex : "C'est ène denrée ! Ou bien : J'vas pas m'laisser m'ner par ène denrée coum' elle !" - (58) |
| denrée : s. f., s'emploie en mauvaise part en parlant des personnes. Ch'tite denrée, va ! - (20) |
| denrée, n.f. chose de mauvaise qualité. Personne peu commode. - (65) |
| denrée, s. f. marchandise de toute espèce, comestibles, étoffes, bien, propriété. - (08) |
| denrée, s. f., objet de peu de valeur. - (40) |
| denrée. s. f. Mesure agraire usitée avant l’application du système métrique. Elle contenait 17 carreaux, et il en fallait 6 environ pour faire un arpent. Du latin denarium. - (10) |
| dent scieu : « Fare la dent scieu » : agacer les dents. « Mije dan pas ces granzales (groseilles) i ne sant pas meures, i vant te fare la dent scieu ». - (19) |
| dent : s. f. Avoir les grands dents, avoir la dentie. - Parler des grosses dents, faire la grosse voix. - (20) |
| dentau, s. m. sep ou dental, morceau de bois adhérent au coutre de la charrue dans sa partie antérieure. - (08) |
| denteron s. m. Chicot de dent. (Athie). - (10) |
| dentie (dancie) : s. f., vx fr, dentée, sensation d'agacement des dents provoquée par une cause directe, telle que la mastication de fruits verts, ou par une cause indirecte, telle qu'un bruit suraîgu. Avoir la dentie. - (20) |
| dentô : crémaillère de la charrue - (39) |
| dénuité (se), v. r. se démunir. - (22) |
| dénuter (se), v. r. se démunir. - (24) |
| déonghier, v. a. enlever les ongles. « déonhier. « (Voir : onghie.) - (08) |
| déorler, v. a. oter, couper, arracher les ailes. (Voir : ole, orle.) - (08) |
| déousser. v. - Désosser. - (42) |
| déousser. v. a. Désosser. Un bon gigot déoussé. - (10) |
| dép’ci : dépecer - (57) |
| dép’illeumer : déplumer - (57) |
| dépachi : dépêcher - (57) |
| dépaillai. : Déguerpir. Se disait de gens qui sortaient du lieu où ils étaient couchés sur la paille, ou c'était une allusion à la paillasse qui fait partie d'un lit. - (06) |
| dépaillé, déguerpir. Les Bourguignons disent, dans le langage familier, sortir de sa paille, pour sortir de son lit, se lever. - (02) |
| dépàiller, v. tr., déguerpir, se lever en toute hâte. En Bourgogne, on dit familièrement : « Sortir de sa paille » pour : sortir de sa paillasse, de son lit. (V. Epailler.) - (14) |
| dépailler. Se dépailler signifie sortir de la paille, quitter sa paillasse, donc se lever. Activement dépailler veut dire faire lever, ou même faire partir, faire sortir de la torpeur. Ex. : « Attendez, je vais aller vous dépailler, moi ! » - (12) |
| dépaislai - ôter la peau, écorcher. - Veins voué qui dépaislà ce lapin qu'en nos é aiportai. - Vos le dépaislerain vraiment, i crouai. - Voyez paislai. - (18) |
| dépaitné (se), vr. s'efforcer. Se dépêcher. - (17) |
| dépâler, v. enlever les échalas. - (38) |
| depandeler : prononcer : dépand' ler. Décrocher quelque chose de suspendu, d'accroché haut. - (58) |
| depand'leu d'charriée : un homme très grand. Un échalas. Ex : "L'Antouène, c'est un grand dépand'leux d'charriée." (Pour que ce soit plus clair, on peut ajouter l'adjectif " grand " afin d'éliminer le plus petit doute). - (58) |
| dépané. : (Dial.), déchiré. Part. passé du verbe dépaneir (du latin de, marquant la séparation, et du substantif pannus, étoffe). - (06) |
| dépanelé, adj., qui a sa toilette en mauvais état, presque en lambeaux. (V. Déniàpé, Dégòniché.) - (14) |
| dépanoïlli v. Enlever les feuilles de l'épi de maïs. - (63) |
| dépanoyi : enlever les feuilles de l'épi de maïs. A - B - (41) |
| dépanoyi : enlever les feuilles de l'épi de maïs - (43) |
| dépanoyi : enlever les feuilles de l'épi de maïs, des panoyes - (34) |
| dépantaiñné adj. Dépenaillé. - (63) |
| déparcher. v. - En labourant : ne pas aller droit, s'écarter de sa direction, laisser un âne. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| déparèilli : dépareiller - (57) |
| déparler (se) : s'efforcer de parler le français correct au lieu du patois - (61) |
| déparler : tenter de parler sans accent. Comme un "parisien". En somme : faire des manières. Ex : "T’as-t-y vu coum’ elle déparle, la Lucienne ? On voué ben qu’soun’houme est un Mon-sieu." - (58) |
| déparler. v. n. Parler à tort et à travers, déraisonner. (Chigy). - (10) |
| déparpiller. v. - Démêler. (Saint-Martin-sur-Ouanne, selon M. Jossier) - (42) |
| déparpiller. v. a. Démêler. (Saint-Martin-sur-Ouanne). - (10) |
| déparre ou déprarre. Déprendre, détacber. - (01) |
| départagi : départager - (57) |
| départiau (la), s. f., la Chanson de la Mariée, ainsi nommée parce qu'elle a pour sujet le départ de la fiancée de chez ses parents. — Ce titre doit se donner à plus d'une chanson, car nos chansons de noces sont assez nombreuses. - (14) |
| départir : v. n., vx fr., partir. - (20) |
| départoir, s. m., forte lame emmanchée pour fabriquer les paisseaux. - (40) |
| dépassi v. Dépasser. - (63) |
| dépatenailler (se), v., se déshabiller. - (40) |
| dépater : enlever ce qui fait la pâte, ce qui colle - (51) |
| dépatoïlli v. Dépêtrer, dépatouiller. - (63) |
| dépatoueiller (se) (s'en) : se débrouiller, enlever la boue - (39) |
| dépatouéiller (se) : débrouiller (se) - (48) |
| dépatouillai : dépêtrer une affaire embrouillée. - (33) |
| dépatouiller (se). Se sortir de la boue ; se nettoyer. Fig. Se tirer d’affaire, se débrouiller. - (49) |
| dépatouiller (Se). v. pronom. Secouer, enlever la boue de ses pieds. — Par extension, se débarrasser, se dépêtrer. - (10) |
| dépatouiller : dépêtrer - (48) |
| dépatouilli : dépatouiller - (57) |
| dépatroïlli : Dépêtrer. « Eune fois qu'an est dans le goliet (dans la boue) y est pas c'meude de s'en dépatroïlli ». - (19) |
| dépatter (v. tr.) : débarrasser ses semelles de la terre qui s'y est collée - (64) |
| dépatter. v. - Retirer la boue, la patouille, collée aux chaussures ou à la charrue. - (42) |
| dépatter. v. a. Enlever la boue de ses pieds. — Se dépatter, se décrotter les pieds. - (10) |
| dépattoué, dépattoir. s. m. Décrottoir. - (10) |
| dépattoué. n. m. - Décrottoir, placé à l' entrée de la maison. - (42) |
| dépattouée (n. f.) : décrottoir, instrument servant à dépatter les chaussures - (64) |
| dépattue, Dépatture. s. f. Terre grasse et boueuse dont on s’est débarrassé les pieds. On montre, à Châlillon-sur-lndre, deux monticules formés des dépattures de Gargantua. - (10) |
| dépatues. n. f. pl. - Mottes de terre tombées des roues d'une charrette, que l'on trouve sur les chemins ; synonyme de gualippe. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| dépchi : oiseau qui abandonne son nid. A - B - (41) |
| dépchi : oiseau qui abandonne son nid - (34) |
| depé, prépos. depuis. - (17) |
| dépeailer, v. a. peler, enlever la peau, écorcher. - (08) |
| dépecoulé, v. a. enlever la queue, ou « pecquoeu », d'un fruit, spécialement de la cerise. - (22) |
| dépeger : v. a., « dépoisser ». Voir peger. - (20) |
| dépeint : s. m., vx f r. dépeindre (v.), peinture, portrait. Y a mes enfants qui me tourmentent pour que je fasse faire mon dépeint. - (20) |
| dépeintrer. v. a. Dépeindre. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| dépèler : (dépê:lé - v. trans.) écorcher, dépiauter (par extension un lapin). - (45) |
| dépêler, dépiauler, dépiauter : enlever la peau - (48) |
| dépenaillé, qui porte des vêtements en loques. - (28) |
| dépenaillé. Déchirer, du simple dépané qui s'est dit - (03) |
| dépenailler : vêtements en lambeaux - (44) |
| dépenailli adj. (fr. dépenaillé) Déguenillé, mal vêtu. - (63) |
| dépendaine : s. f., vx fr. dépendance, terrain en pente. Voir pendaine. - (20) |
| dépendeu d'andouilles, loc, homme mince et grand, se tenant mal, dégingandé. Ce dépendeù n'empêche pas dépondre. (V. ce mot.) - (14) |
| dépendeu, s. m. celui qui dépend, qui décroche. Un grand « dépendeu » d'andouilles est quelque chose comme une grande bête, un grand imbécile. - (08) |
| dépendeux, dépend'leux. n. m. - Celui qui décroche un objet suspendu. Se dit également dans un sens péjoratif.: « Aga-lu, s'grand dépendeux d'andouilles ! l'sait p'us quoué fai'e pou' s'rende intéressant ! » - (42) |
| dépendiller (Se). v. pronom. Se suspendre à une branche d’arbre en se balançant. (Sainpuits). - (10) |
| dépendiller, dépendeler (se). v. - Dépendre, décrocher. Autre sens : se suspendre à une échelle, à une branche. - (42) |
| dépendler (v. tr.) : dépendre, détacher ce qui est pendu - (64) |
| dépendou d'andouilles, s.m. se disait des coureurs, des buveurs, des débauchés toujours prêts à improviser une ripaille en dépendant les andouilles du plafond. - (38) |
| dépendre : décrocher (un jambon) - (61) |
| dépener : v. a., vx fr. despencer, dépenailler, dépouiller. Os dépené, os dépouillé de la plus grande partie de sa chair, et spécialement portion de colonne vertébrale à laquelle adhère encore l'extrémité dorsale des côtes. - (20) |
| dépens : s. m., dépense. Ben sûr qu'on peut y arranger, mais y va vous faire faire « de » dépens. - (20) |
| dépens, s. m. lieu autrefois interdit à la vaine pâture. - (08) |
| depens, s. m. ne s'emploie qu'au pluriel : les « dépens » c’est-à-direles frais, le coût, la dépense. - (08) |
| déperlicher. v. a. Allécher. (Saint-Martin-sur-Ouanne). - (10) |
| dépernucher (v. tr.) : regarder avec insistance ou indiscrétion - (64) |
| dépeter (dép'ter) : v. a. et n., vx fr. despiter, abandonner, renoncer à. Se dit surtout des oiseaux qui laissent leur couvée et des femelles qui quittent leurs petits. Veux-t’ ben n’ pas grimper aux arbres, t’ vas fair’ dépeter toutes les marlasses. - (20) |
| dépétsi (s') v. Se dépêcher. - (63) |
| dépétsi : dépêcher - (51) |
| dépeu (prép.) : depuis - (50) |
| dépeu : depuis - (51) |
| dépeu : Depuis. « Dépeu le métin jeusqu 'au sa », du matin au soir. - (19) |
| dépeù, det'peu : depuis. Pas vu dépeu deux jours : pas vu depuis deux jours. - (33) |
| depeu, prép. depuis : « al ô hûreu d'peu qu'ai ô mairie » ; il est heureux depuis qu'il est marié. - (08) |
| dépeu, prép. depuis. - (24) |
| dépeu, prép. et adv., depuis. S'emploie fautivement pour de : « On l'entend bauler dépeù iqui. » - (14) |
| depeù. Depuis. - (01) |
| dépeu’ : depuis. - (62) |
| dépeuchi : Vider. « Dépeuchi in sa de calas », vider un sac de noix. C'est le contraire de empeuchi. - (19) |
| dépeugni : dépeigner - (51) |
| depeune, depuis. - (38) |
| dépeurer, v. n. découler, descendre goutte à goutte. Les toits « dépeurent » après la pluie. - (08) |
| dépeurer. Suppurer. Même composition, à peu près. - (03) |
| dépeurpeuler (se) (or. inc.) v. S'activer, s'agiter. - (63) |
| dépeûsè : déposer - (46) |
| dépeus'ner : déchirer, mettre en pièces - (48) |
| dépeusner : (dépœsnè - v. trans.) déchirer, détruire, mettre en pièces. - (45) |
| dépeuter : Transvaser. « Man pansau coule, je va charchi eune feute pa le dépeuter » : ma pièce coule je vais chercher un fût pour la transvaser. - (19) |
| dépi (prép.) : depuis - (64) |
| de-pi : depuis - (43) |
| dépiaire : déplaire - (51) |
| dépiaire : déplaire - (57) |
| dèpiaire, vn. déplaire. - (17) |
| dépiaisant : déplaisant - (51) |
| dépiaisant : déplaisant - (57) |
| dépiâlé, enlever sa peau à un animal. - (16) |
| dépialer, enlever la peau. - (26) |
| dépiâler, v. enlever la peau du lapin, du lièvre. - (38) |
| dépiàler. v. a. Synonyme de dépiauter. - (10) |
| dépianter : déplanter - (57) |
| dépiâtrer (se) : (vb) se dépêtrer - (35) |
| dépiâtrer (se) : dépêtrer (se) - (43) |
| dépiauler : (vb) dépecer, dépouiller (un lapin) - (35) |
| dépiauler : dépecer, dépouiller - (43) |
| dépiauler : enlever la peau. Aussi : dépiauter. - (62) |
| dépiauler : enlever la peau - (39) |
| dépiautai : enlever la peau. Dépiauter un lapin. - (33) |
| dèpiauté, vt. dépiauter. - (17) |
| dépiauter (v.t.) : dépouiller, enlever la peau - (50) |
| dépiauter : enlever la peau. Dépiauter un lapingn'. - (52) |
| dépiauter, dépiauler v. Enlever la peau, dépecer, dépouiller, éplucher, déshabiller. - (63) |
| dépiauter, et dépiauler, v. tr., écorcher, enlever la peau : « All't'a pris l'lapin, é pi d'eùn tor de main, all’te vous l'a dépiauté. » - (14) |
| dépiauter, v. a. dépouiller, enlever la peau. (Voir : piau.) - (08) |
| dépiauter, v. enlever la peau du lapin, du lièvre. - (38) |
| dépiauter. Écorcher, enlever la peau. - (49) |
| dépiauter. v. - Dépiauter, retirer la peau, la piau. - (42) |
| dépiauter. v. a. Ecorcher, arracher, enlever Ja peau, la piau. - (10) |
| dépicassai : enlever un mauvais sort jeté par un sorcier (contraire : empicasser). - (33) |
| dépicasser (v. tr.) : désensorceler - (64) |
| dépicasser : exhorciser - (48) |
| dépicasser : se débarrasser de quelque chose - (39) |
| dépicasser. v. - Exorciser, ôter un mauvais sort. - (42) |
| dépicasser. v. a. Oter un sort. - (10) |
| dépicasseux. n. m. - Sorcier qui ôte le mauvais sort. - (42) |
| dépicasseux. s. m. Sorcier qui ôte les sorts, par opposition à empicasseux , sorcier qui les jette, qui les met. - (10) |
| dépichi : Détruire. « Dépichi in nid de jaquettes (pies) ». - Abîmer, massacrer, « Les sanglliés ant passé dans man treuquis i z 'y ant to dépichi » : les sangliers sont passés dans mon maïs, ils ont tout abîmé. - (19) |
| dépicoler : (vb) enlever la queue d’un fruit - (35) |
| dépicoler : décortiquer - (57) |
| dépicoler : Détacher le pédoncule. « Dépicoler des cheriges (cerises) ». - (19) |
| dépicoler : enlever la queue d'un fruit - (43) |
| dépicoler : v. a., détacher totalement ou partiellement un fruit de son pédoncule ; cueillir un fruit. Voir picot et repicoter. - (20) |
| dèpicoler : v. détacher les queues, les pikô. - (21) |
| dépicoler, v. a. enlever la queue, ou « picou », d'un fruit, spécialement de la cerise. - (24) |
| dépiècement (on) : déplacement - (57) |
| dépiécer. v. a . Mettre en morceaux, dépecer. - (10) |
| dépiéceter. v. a . Dégueniller. (Plessis-Saint-Jean). - (10) |
| dépiéci : déplacer - (43) |
| dépiéci : déplacer - (51) |
| dépièci : déplacer - (57) |
| dépièilli : déplier - (57) |
| dèpieilli : v. dételer. - (21) |
| dépier : délier les bœufs - désharnacher un cheval ; par extension, arrêter le travail. A - B - (41) |
| dépier : arrêter le travail, délier les bœufs, enlever les harnais d’un cheval - (34) |
| dépier. v. a . Dépailler. (Vassy-s 8 -Pisy). - (10) |
| dépiéter. v. n. Marcher vite, marcher à s'arracher les pieds. - (10) |
| dépieumè : n. m. Dépourvu (de poils ou de plumes). - (53) |
| dépieûmer : (vb) déplumer - (35) |
| dépieumer : déplumer - (51) |
| dépieumer. Déplumer. - (49) |
| dépiéyer : arrêter le travail, délier les bœufs, déharnacher un cheval - (43) |
| dépigeai - ôter les attaches, les liens mis au pied du bétail. - Malgré lai bôcheure ne dépige pas les chevau. - Te dépigerez le poulain. - (18) |
| dépigner, v. a. dépeigner, emmêler les cheveux. - (08) |
| dépigner, v. tr., dépeigner, mettre les cheveux en désordre. - (14) |
| dépigner. v. a. Mettre les cheveux en désordre. La v’Ià toute dépignée. - (10) |
| dépijé, enlever les entraves que quelqu'un a aux pieds ; s'dépijé sol-même ; s'dépijé se dit aussi pour : s'affranchir, se libérer d'une foule de petits travaux, en les exécutant. - (16) |
| dépiôler, v., enlever la peau et les poils. - (40) |
| dépionner : endroit où l'herbe manque après la sécheresse - (43) |
| dépioñner v. (de pion, mot brion. char. dérivé du lat. pilleum, bonnet à poil). Désherber. - (63) |
| dépioter, enlever la peau. - (26) |
| dépiôter, v., éplucher un fruit, un légume. - (40) |
| dèpioué, vt. déployer. - (17) |
| dépiquer. v. a. et n. Dépaisseler. - (10) |
| dépiquoter, dépigoter v. Détacher les fruits du pédoncule. - (63) |
| depis – dimpe : depuis - (57) |
| depis (adverbe) : depuis. - (47) |
| dépisser, dep'chi. Dénicher. Fig. Cueillir des fruits avant maturité. - (49) |
| dépit (faire) : contrarier - (61) |
| dépit, s. m. chagrin, contrariété, ennui. Faire du dépit, c'est faire de la peine à quelqu'un. - (08) |
| dépiter, défier. - (04) |
| dépiter, défier. - (05) |
| dépiter, v. a. défier une personne, la provoquer : « i t'dépite do fére », je te défie de le faire. - (08) |
| dépiter. Défier. Pour défier, nous disons aussi rappaler. Rappeler. Au jeu de quilles, on est rappeau lorsqu'on est à point égal. - (03) |
| dépiton (a), loc. avec défi, par défi, en provocation. - (08) |
| dépizer - (39) |
| déplâ : dételer et dételage. Voir l’inverse : éplâ pour atteler et attelage. - (62) |
| déplâgi. s. m. Déplaisir. (Domecy-sur-le-Vault). - (10) |
| déplâï, s. m., déplaisir. - (14) |
| déplâillant : adj. Déplaisant. - (53) |
| déplai'yant : déplaisant - (48) |
| déplayer : v. a., dételer. Voir applier. - (20) |
| dépléant. adj. - Déplaisant. - (42) |
| dépleumé : chauve - (46) |
| dépleurnè : plumer une volaille - (46) |
| déplèyer : dételer. - (31) |
| déplia : Déplier, étaler une pièce d'étoffe. - (19) |
| dépliâ : Dételer les bœufs, sortir les bœufs de dessous le joug, c'est le contraire de appliâ. - (19) |
| dépliaiji : Déplaisir. « Après le pliaiji le dépliaiji » : on a souvent regret de s'être donné trop de plaisir. - (19) |
| dépliâre : Déplaire. « Lilas te me depliâ ! » Langage des « Mais » (voir à Mai) - (19) |
| dépliâtrer (se) : Défaire (se), « An ne peut pas s'en dépliatrer ! » (Voir empliâtrer). - (19) |
| dépliayou (le) : Nom de lieu, c'est le point culminant du grand chemin de Mancey à La Chapelle-sous-Brancion, du dépliayou on voit parfaitement le Mont-Blanc. C'est au dépliayou que l'on dépliâ, que l'on détèle, pour renvoyer l'attelage de renfort qui a aidé à gravir la côte - (19) |
| déplié, Déployer, déployé… - (01) |
| dépliéchi : Déplacer, faire une course. « Quand la madecin se déplièche o se fa bien payer ». - (19) |
| déplieumer : Déplumer. « O commache à se déplieumer », il commence à perdre ses cheveux. - (19) |
| dèpliouter : v. effeuiller le maïs. - (21) |
| dèpnaché, vt. découdre. - (17) |
| dépnâiller, v. dépailler ; mal habiller. - (38) |
| dépnailli : complètement défait, habillé avec les vêtements mal arrangés - (51) |
| dép'nâyé, se dit de quelqu'un dont les vêtements sont en lambeaux et qui, par là, ne semble pas vêtu ; nous avons dans ce mot le pannus, morceau d'étoffe, des latins, un vêtement sans lequel on est dépannâyé, dép'nâyé. - (16) |
| dépnayi : tourner en lambeaux. Médisance. A - B - (41) |
| dépnayi : mettre en lambeaux - (43) |
| dèpö, sm. dépit, regret. - (17) |
| dèpôché, vt. dépêcher. - (17) |
| dépoche. Dépèche, dépêçhes, dépêchent. - (01) |
| dépocher, dépêcher (o long). - (26) |
| dépôcher, v. tr., dépêcher, hâter : « La sôpe é trempée ; dépôche te. » — « V'tu ben t’dépôcher, train-nard ! » - (14) |
| dépôchî (se) : dépêcher (se). - (62) |
| dépôchi (se) : Se dépêcher, se hâter. « Vla la beurrée, dépôchins nos de nos sauver » : voilà l'orage, dépêchons nous de fuir. - (19) |
| dépoéler : perdre ses poils - (39) |
| dépoiché, s'dépoiché, se hâter de commencer un travail et en le faisant. - (16) |
| dépoicher (se) ; v. ; se dépêcher. - (07) |
| dépoiler (se), verbe intransitif : perdre ses poils. - (54) |
| dépoille : Abats de bête tuées par le boucher, peau, tripes, suif, etc… - (19) |
| dépoïlli : Dépouiller, écorcher, dépecer. « Dépoïlli in lapin ». - (19) |
| dépoindre, dépeindre, participe passé dépoindu, pour dépeint. - (02) |
| dépoindre. : Dépeindre. Participe passé, dépoindu. - (06) |
| depointe : debout - (43) |
| dépointer, v. n. faire une pointe, prolonger un angle. S’emploie avec la préposition de lieu sur. Mon champ « dépointe » sur le bois. Le sentier « dépointe » sur la route - (08) |
| dépoische (ai lai), loc. a la dépêche, à la hâte. Un ouvrage fait « ai lai dépoische » est souvent un ouvrage bâclé ou mal fait. - (08) |
| depoischer, v. a. dépêcher, envoyer une dépêche, faire savoir quelque chose à quelqu'un par un message. « Dépouécer. » - (08) |
| dépoisonner : v. a., désempoisonner. Se dépoisonner, combattre le goût désagréable qu'on a dans la bouche le lendemain d'une cuite. Pour cela on prend généralement un ou deux verres de gnôle. - (20) |
| dépoitraillé, dépotraillé, ée. adj. Qui a la poitrine découverte, les vêtements débraillés. La sal’ femme ! Elle est toujours mal vêtue, dépotraillée. (Villiers-Saint-Benoît). - (10) |
| dépoitrailli v. Dépoitrailler. - (63) |
| dépoler, v. a. arracher, ôter le poil d'un animal, épiler. (Voir : poler.) - (08) |
| dépondre : dételer - (57) |
| dépondre : v. a., déchirer, dégueniller. Oh! ce p'tiot, quand i rentre, il est toujours dépondu. Voir appondre et rappondre. - (20) |
| dépondre, v. n. quitter, lâcher, cesser d'être joint ou uni à... au part, passé « dépondu. » - (08) |
| dépondre, v. tr., dépendre, décrocher, enlever. - (14) |
| déporter (Se) : v. r., se détacher de quelqu'un ou de quelque chose. - (20) |
| déporter (se). v. - Se retirer, refuser une affaire, s'en décharger. - (42) |
| déporter (Se). v. pronom. Se retirer d’une entreprise, ou refuser de s’en charger, se récuser. Vous frez ç’t’aflfaire-là, si vous voulez ; quant à moi, je m’en déporte. - (10) |
| dépotaiser (s'en) : se débarrasser de quelque chose - (39) |
| dépoter : enlever les pommes de terre, les carottes d'un silo en terre (ou poté*). A - B - (41) |
| dépoter : enlever du pote (silo à légumes réalisé dans les champs) - (51) |
| dépoter : enlever les pommes de terre, les carottes d'un silo - (34) |
| dépoter : enlever les pommes de terre, les carottes d'un silo - (43) |
| dépoter v. Désensiler (les pommes de terre) - (63) |
| dépotsi : vider, dépoter - (51) |
| dépotsi v. Dépocher, vider une poche, tirer de sa poche, débourser. - (63) |
| dépouachai (se) : se dépêcher. Dépouache touai : dépêche toi. - (33) |
| dépouâché (s'), mâgné (s') : v. pr. Se dépêcher. - (53) |
| dépouâché (s’) : (v. pron.) se hâter, se dépêcher. - (45) |
| dépouâcher (se) : dépêcher (se) - (48) |
| dépouacher (Se). v. pronom. Se dépêcher. (Saint-Germain-des-Champs). - (10) |
| dépouèler (se) : perdre ses poils - (48) |
| dépouesser (se) : se dépêcher - (39) |
| dépouille, sf. dépouille. Chair du porc, le lard ôté. - (17) |
| dépouillener, v. a. enlever les poux. - (08) |
| dépouilli : dépouiller - (57) |
| dépouillonner, v. a. nettoyer, enlever les ordures, tout ce que l'on appelle dans notre patois « lai pouion », c’est-à-dire la boue, la crasse, la vermine. - (08) |
| dépourtai (se) : se décharger d'une affaire. - (33) |
| dépourté (s') : v. pr. Se déporter. - (53) |
| dépourter (se) : décharger (se) d'une affaire, se retirer - (48) |
| dépourter : déporter - (48) |
| dépousi : déposer - (57) |
| dépousitaîre (on) : dépositaire - (57) |
| dépoussailli : dépoussiérer - (57) |
| dépoussailli : épousseter - (57) |
| dépoussonner (v. tr.) : dégermer les pommes de terre - (64) |
| dépoussonner v. Enlever les pousses adventices. Voir dédzarner. - (63) |
| dépravé : part pass., désœuvré. - (20) |
| dépraver (se) : Faire toute sortes de contorsions, de grimaces, d'excentricités « Veux tu bin ne pas te dépraver de la sôrte ! » - (19) |
| déprende (se) v. S'arrêter, s'interrompre. - (63) |
| déprendre (se) : (vb) s’interrompre (dans une tâche) - (35) |
| déprenre : séparer, libérer, quitter son travail - (48) |
| déprenre. v. n. déprendre, cesser de prendre, de tenir. - (08) |
| déprindre (se) : interrompre (s') (dans une tâche) - (43) |
| dépté, defsi : oiseau qui abandonne son nid - (43) |
| depu : (prép.) depuis - (35) |
| dépuis, du dépuis : conj-, depuis. Depuis huit jours j'ai perdu l'app'tit. - (20) |
| dépus , depus, dépeus adv. Depuis. - (63) |
| députai. Député, députés, deputer. - (01) |
| dépyâtrer (se) v. pr. Se sortir d'un mauvais pas, se débarrasser. - (63) |
| dépyéci v. Déplacer. - (63) |
| dépyeumé adj. et n. Déplumé, dévêtu, chauve, tondu. - (63) |
| dépyeumer v. Déplumer, dévêtir, tondre. - (63) |
| dépyiéci : (vb) déplacer - (35) |
| dépyier v. (construit sur apyier). Arrêter le travail. - (63) |
| déquainnefoi - quelquefois. - Pair bonheur que ci ne l'i airive pâ souvent ; ma tojeur des quainne fouai. - A sont genti ! A sont genti !! voué ! desquainne foué. - Plus guère usité. - (18) |
| déquarrer, v. a. déplacer, détourner du lieu où l'on est. Faire « déquarrer » quelqu'un, c'est obliger une personne à quitter sa place, à céder le terrain, à sortir de son « quarre. » (Voir quarre.) - (08) |
| dequei. De quoi. - (01) |
| déquemater, v. a. délayer. - (24) |
| déquemauté, v. a. délayer. - (22) |
| déquemauter (se) : enlever le plus sale - (39) |
| dequenaillai. : Déchiqueter. – Dequenaillai quelqu'un, c'est le déchirer sur le fait de sa réputation. - (06) |
| déquenailler (par corruption de décaniller). v. n. S’en aller, quitter la place, s’enfuir du chenil. De de, particule distractive, et de canis. - (10) |
| déquenedéfoi. : Ce terme répond au vieux français d'aucunes fois. - (06) |
| déquenelle : poire séchée (daguenelle) - (60) |
| dequepœyi, v. a. démêler, trier avec peine. - (24) |
| déqueuder et, par contraction, deq’der, deg’der. v. n. Emplir un moins grand nombre de tonneaux, de queues, à la vendange, faire moins de vin qu’on l’espérait. Se dit par opposition à queuder. - (10) |
| déqueûler (en), v., couler abondamment après une pluie orageuse. - (40) |
| déqueutener, v. tr., peigner, démêler les cheveux : « Jeannette, passe-me voué l'déqueût'nou, que j'me déqueùteùne. » (Fontaines, près Chalon-s-S.) (V. Déqueùtir.) - (14) |
| déqueutenou, s. m., peigne, démêloir. (Fontaines, près Chalon-s-S.) - (14) |
| déqueutir, v. tr., peigner, démêler les cheveux. Ce mot, comme les deux précédents, vient du temps où l'on portait la queue. - (14) |
| déquiaiher, v. a. déclarer. - (08) |
| déquignoler : v. a., démantibuler. Voir requignoler. - (20) |
| dequimoner : saccager. (F. T IV) - Y - (25) |
| déquiouler, v. a. déclouer, enlever les clous. - (08) |
| déquouairassé : débraillé - (39) |
| dêr (dard) : (dêr - subst. m.) faux. Dêr è acrou, "faux à débroussailler" (plus courte et plus solide). - (45) |
| der, adj., dernier. Les enfants ne sont pas verbeux. Toutes les fois qu'ils ont à établir un numérotage d'ordre pour leurs jeux, ils comptent ainsi : « pre, se, der, » ce qui veut dire : premier, second, dernier. - (14) |
| der, dergne. adj. Dernier ; abréviations employées par les enfants dans leurs jeux. - (10) |
| déracener : Déraciner. « I corait in vaut à déracener les abres » : il faisait un vent à déraciner les arbres. - (19) |
| déracher : arracher. Ex : "- Eh Camille ! Lavou qu'té vas don ? - J'vas déracher mes truffes, moun' houme !" - (58) |
| dérâcher, v. tr., arracher, déraciner. - (14) |
| déradi : Déraidir. « Arrâte voir que je descende, je va fare in bout de chemin à pid (à pied) pa me déradi les chambes ». - (19) |
| dérager. v. - Décolérer : « II en parlait toujou' et i' dérageait pas. » (Fernand Clas, p.276) - (42) |
| dérages : s. f. pl. pièces de bois ajoutées à la voiture pour la monter en « chê ». - (21) |
| déraiç’ner : déraciner - (57) |
| déraicher, v. a. arracher, déraciner. « Déraicer. » - (08) |
| dérailli : dérailler - (51) |
| dérâilli : dérailler - (57) |
| déraingi : déranger - (57) |
| dérainj’ment : dérangement - (57) |
| déràïoner, v. intr., déraisonner, perdre le sens. - (14) |
| dérâïonner, v. n. déraisonner, parler sans réflexion, comme un extravagant. (Voir : ràïon.) - (08) |
| déramiller. v. n. Oter les épines, les plantes parasites, les branches inutiles, pour éclaircir les bois. - (10) |
| dérandzi : déranger - (51) |
| dérangi : Déranger. « Dérangi vos pas » : ne vous dérangez pas. « Etre dérangi » : être anormal, détraqué, au moins pour certaines choses. « Ol est in ptiet bout dérangi » il a un peu le cerveau fêlé. - (19) |
| dérater. Se dit d'un chien ou autre animal qui creuse la terre avec ses pattes et fait un trou de rat. Une rate et un seri sont chez nous les noms de la souris. - (03) |
| dère (se) : emboîter (s') - (43) |
| dère : (vb) dire - (35) |
| dère : dire - (43) |
| dère v. Dire. - (63) |
| dérécher, déracher. v. - Arracher. - (42) |
| dérécher, derrécher (pour déracher, derracher). v. a. Arracher. (Accolay, Andryes). — Jaubert donne déracher. - (10) |
| dérèdze : côté en forme d'échelle des chars à foin - (51) |
| déréfourrer. v. a. Retrancher les aliments, le fourrage aux moutons. (Coulours). - (10) |
| dérégi : déranger. A - B - (41) |
| dérégi : déranger - (34) |
| dérère (drère) : dernière - (51) |
| dèrèse : voir darêche*. B - (41) |
| dèrese : ridelle d'un chariot à fourrage - (34) |
| deresses (char a —) char à ridelles, char à claire-voie pour rentrer le fourrage. - (30) |
| déreufer, décrasser. - (27) |
| déreuffer : nettoyer - (48) |
| déreuiller : dérouiller - (48) |
| déreuiller : enlever la rouille, se râcler la gorge pour l' éclaircir - (39) |
| déreûilli : dérouiller - (57) |
| déreuilli v. Dérouiller. - (63) |
| dergée, deurgée, deurzie. s. f. Dragée. (Avallonnais). - (10) |
| dergne, dergnier. adj. - Dernier. - (42) |
| dérhumer : v. a., désenrhumer ; se désenrhumer. Je n’ai pas dérhumé de toute l'hiver. - (20) |
| déri (dri) : dernier - (51) |
| déri (en) : arrière (en) - (57) |
| déri (le) : dernier - (57) |
| déri : (adj) dernier (féminin: d'rire) - (35) |
| déri : dernier - (57) |
| deri, s. m. 1. dernier : être le deri. — 2. derrière : le deri du char. - (24) |
| deri, s. m. 1. Dernier : être le deri. — 2. Derrière : le deri du char. - (22) |
| déridièlé (ël), vt. enlever les ridelles. Démonter. Désorganiser. - (17) |
| dérigandler (v. tr.) : disloquer, déglinguer - (64) |
| dérigondeller. v. - Cabosser, enfoncer, disloquer. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| dérigondier. v. - Disloquer, démonter un objet de telle manière qu'il est impossible de le remonter. (F.P. Chapat, p.85) - (42) |
| dérigouler. v. – Couler : « L'iau y sortait d'la piau grous coumme des pois ronds et y dérigoulait dans la rau du dous. » (Fernand. Clas, p.270). Mot issu de l'ancien français rigoler, signifiant égaliser les bords d'une rivière, aider à l'écoulement de l'eau. La rigole était un mot d'origine néerlandaise. - (42) |
| dérindzi : déranger - (43) |
| dèrindzi v. Déranger. - (63) |
| déri-né (on) – p’tchot déri (on) : dernier-né - (57) |
| dériper (v. int.) : déraper, riper - (64) |
| dériper. Glisser, couler. - (49) |
| dériper. v. - Riper, déraper, glisser. - (42) |
| dérir’ment : dernièrement - (57) |
| dérirouler, v, intr., dégringoler, tomber en roulant : « Les charbons ont dériboulé su l'carreau. » - (14) |
| dérisouaîre : dérisoire - (57) |
| dérivé. : Sorti de ses rives. Un vaisseau dérivé. (Del.) - (06) |
| dériyon (n.f.) : dérision - (50) |
| derlin. s. m. Espèce de sonnette suspendue au cou des bestiaux. - (10) |
| derlin. s. m. Variété de chêne. (Saint-Sauveur). — Se dit pour durelin, sorte de chêne à fruits sessiles, suivant Boreau. C’est le chêne roure ou rouvre ; du latin robur. - (10) |
| derline ! derllne ! Sorte d’onomatopée, par laquelle on imite de la voix le retentissement d’un coup de sonnette. - (10) |
| derliner (v. int.) : sonner, tinter - (64) |
| derliner : dreliner...faire drelin-drelin. Faire un bruit métallique en cascade. Ex : "T'l'entend-t-y avec soun' auto qui derline ?" - (58) |
| derliner. v. n. Résonner par suite d’une commotion ; faire retentir une petite cloche, une sonnette. - (10) |
| derlotte, dorlotte. s. f. Bonnet de vieille paysanne. (Festigny). - (10) |
| dérnangonné : démanché - (43) |
| derne (être) : avoir des vertiges. (F. T IV) - Y - (25) |
| derne. adj. Se dit d’une brebis qui a la maladie de tête, qui a le tournis. (Germigny). Voyez dame. - (10) |
| dernier : derrière - (44) |
| dernier : prép., vx fr. derrenier, derrière. - (20) |
| dernier. Ce mot s'emploie pour derrière : « il est dernier le pôrte ». - (49) |
| dérober subtilement. - (06) |
| dérocher. v. a. Enlever le crépi d’un mur. - (10) |
| dérogatouaîre : dérogatoire - (57) |
| dérogé. adj. - Dérangé ; se dit d'une personne qui perd la tête. (Mézilles, selon H. Chéry) - (42) |
| dérompe, v. n. interrompre une action : « i fré ç'lai san dérompe », je ferai cela sans arrêt, sans interruption. - (08) |
| déronté : s. m., vx fr. desrouter et desroter (v.), défriche. Voir ronté. - (20) |
| déroquer. v. a. Ebranler une muraille ; secouer, arracher une grosse pierre scellée dans un mur, un quartier de roche engagée dans la terre. — Se dit aussi figurément, à Auxerre, d’un homme ferme sur ses pieds ou dans ses résolutions. Il ne déroque pas. Il n’a pas déroqué. Du dé extractif et de roc. - (10) |
| déroter, sortir un char de l'ornière. - (05) |
| dérôter, v. tr., dérouter, sortir un char d'une ornière où sont engagées les roues. - (14) |
| dèrotjelé, vt. détortiller. - (17) |
| derrâ : Désenrayer, desserrer le frein. « Derra voir y ne descend plieu ». C’est le contraire de enrâ. - (19) |
| dèrré, dâré : dernier - (48) |
| dèrré, dâré : derrière - (48) |
| derré, derrer - dernier et derrière. Voyez darré. - (18) |
| derrérement - dernièrement - Ile nos é écrit to derrérement qu'ile ailo veni. - En n'ié pas Ion-temps, c'â to derrérement. - (18) |
| derri (dri) : derrière - (51) |
| derri (on) — tchu (on) : derrière - (57) |
| derri : derrière - (57) |
| derri ou drie : derrière ou dernier - (43) |
| derri, darri adv. Derrière, en arrière, à l'arrière. - (63) |
| derri, darri n.m. 1. Derrière, fesses. 2. Dernier. - (63) |
| derrie, dernier. - (05) |
| derriée. ad. v. - Derrière. - (42) |
| derser. v. a. Dresser. - (10) |
| derson. s. m. Cordon, ruban. De l’anglais dress, habillement, vêtement, toilette. - (10) |
| dersoué. s. m. Dressoir, meuble pour placer la vaisselle. - (10) |
| dertirer. v. a. Retirer. — Se dertirer. v. pron. Se reculer. Dertireter. - (10) |
| deruise : s. f., premier duvet des oiseaux venant d'éclore, qui tombe ordinairement et reste au fond du nid, en faisant place aux plumes véritables. - (20) |
| dervi-derva, çà et là. - (38) |
| dés (paire des), loc. on dit que la pluie, la grêle font des dés lorsqu'elles tombent avec force sur la terre et y creusent leur empreinte en forme de dés. - (08) |
| des : Des personnes, des gens. « Y en a enco des que crayant es seurciers » : il y a encore des personnes qui croient aux sorciers.« Ma je ne sus pas c'ment y en des » : moi je ne suis pas comme certaines gens. - (19) |
| des andes, régulièrement, de front ;mener des andes : mener de front. - (38) |
| des co - quelquefois. Voyez à co. Contentons-nous de donner ici un seul exemple - Que volez-vo !! des co ci vai bein, des co ci vai mau. - (18) |
| des cos : parfois - (43) |
| des fois, loc. adv., parfois, quelquefois: « Y a des fois qu'j'ain-me ben causer d'avou âll', des fois qu'âll' jacasse trop. » - (14) |
| désabeurier, v. a. enlever, ôter un abri, découvrir, mettre à jour. - (08) |
| désablatré : (p.passé) déshabillé ; avec ses vêtements en désordre - (35) |
| désaboltoner, et désabout'ner, v. tr., déboutonner : « C'drôle, ô cort tôjor d 'avou sa cueùlôte désaboutonée. » - (14) |
| désaffubler. v. - Dévêtir, déshabiller ; synonyme de débiller. Désafubler, au XIIe siècle, était déjà le contraire de afubler : vêtir, attacher avec une fibule La fibula latine désignait la broche utilisée pour fixer (figere en latin) les extrémités du vêtement. - (42) |
| désagroter, v. a. oter. Enlever les ergots. Un coq « désagroté. » - (08) |
| desaller (prononcez deszaller). v. n . Aller à l’encontre de bien, aller en sens inverse de ce qu’il faudrait, et même ne pas aller du tout. Se dit, à Bléneau, de la mauvaise tenue des animaux d’une ferme, du mauvais emploi qu’on en fait. Ça ne va pas ; au contraire, ça déva. - (10) |
| désalter, pour déserter, par suite de changement si fréquent de l’r en l. - (11) |
| désalter. Déserter. - (49) |
| désandaigni : Défaire les andains, étaler sur le sol le foin qui vient d'être fauché. - (19) |
| désandé : sans s'arrêter - (46) |
| desandé, de suite , sans retard. - (05) |
| désandenai - éparpiller, étendre les andains de foin, que l'on vient de faucher pour le faire sécher. Et au sens figuré. - En ne veut pas pliore ajedeu, vais ; ailon désandenai le foin. - Eh bein ! quoi que çâ don que to ces embarras qui ? Aitends, aitends ! qui désandenâ to cequi. - (18) |
| désandener : défaire à la fourche les andains de foin coupés à la faux. (VDS. T IV) - VdS - (25) |
| désandener : écarter les andains. - (31) |
| désandener, v. ; épancher l'herbe qui était en andains. - (07) |
| désandener, v. a. étendre les andains sur un pré. - (08) |
| désandener, v., retourner l'andain après les pluies. - (40) |
| désandenou, ouse, s. celui ou celle qui étend sur le pré les andains d'herbe fauchée. L’andain est la quantité d'herbe que le faucheur abat en suivant sa ligne. - (08) |
| désanzon, loc. nous n'en sommes jamais « désanzon », c’est à dire nous n'en manquons jamais. - (08) |
| désargoter (se), v., s'arracher un ongle. - (40) |
| dèsargoter v. Perdre un ongle. - (63) |
| dèsargueuté (se), vr. litt : s'arracher les ergots. Se hâter de finir un ouvrage. - (17) |
| dèsarpionné, vt. enlever les arpions (ergots, orteils). Réduire un ennemi. - (17) |
| désarroi. Je cite ce vieux mot français pour examiner sa formation. C'est, littéralement, un labourage fait à rebours. Arroi vient du latin arare. Rabelais a écrit : « le singe ne garde pas la maison comme le chien ; il ne tire pas l’aroy comme le bœuf. » Le mot are, mesure de terre, a la même origine. Le vieux verbe arréer, conduire, était employé dans le sens figuré... - (13) |
| désarrouaî (on) : désarroi - (57) |
| désarter : Déserter, abandonner, quitter « In ban ovré ne désarte pas le chantier tant que la jornée deure (tant que la journée dure) ». - (19) |
| désassembier : désassembler - (57) |
| désatreauder : v. a., gaspiller, perdre sou à sou, par morceaux. Voir atreauder. - (20) |
| désaumer : déchaumer - (39) |
| descende v. Descendre. - (63) |
| descende : v. i. Descendre. - (53) |
| descendée. s. f. Descente. - (10) |
| déscialer, v. déboucher un tonneau en enlevant la bonde avec l'assiau. - (38) |
| descier : débiter des planches - (43) |
| descier : désaltérer - (57) |
| déscier : scier (en long) - (57) |
| déscier : scier en long - (48) |
| déscier : Scier. « Ol est après à descier san beu »: il est en train de scier son bois. - (19) |
| descier : scier (cf chîler) - (39) |
| descier : v. a., scier, refendre, débiter du bois, de la pierre, etc. - (20) |
| dèscier, v. a. scier en long un arbre, une branche. - (24) |
| descier. Scier en longueur, en planches. - (49) |
| desciouler : déclouer - (57) |
| descise (d'eise) : s. f., descente d'un cours d'eau, et par analogie, d'une voie de communication quelconque. Le bateau de descise. Le train de descise. Voir remonte. — A la pêche, ce mot désigne le parcours du bouchon du point d'amont où on a jeté la ligne au point d'aval où on la retire. - (20) |
| descolcher. : (Dial.), écarter de soi, chasser de son lit, de sa demeure. - (06) |
| désempaler, v., enlever les paisseaux à l'automne. - (40) |
| désempicassai : conjurer le sort jeté par un sorcier. - (33) |
| désempicasser, v. a. désensorceler, délivrer de l'ensorcellement, lever un sort jeté sur quelqu'un. (Voir : empicasser, picassé.) - (08) |
| désempicasseux. n. m. - Sorcier, celui qui retire le mauvais sort, donné par l'empicasseux. - (42) |
| désempiger : v. a., enlever une empige. - (20) |
| désempiger, v. tr., dépêtrer. - (14) |
| désemp'lli : Désemplir. « Y a bin du mande seu le parquet y ne désemp'lle pas ». - (19) |
| desenda, dès enda : adv., tout de suite. A rapprocher des vx fr. ades et enda. - (20) |
| désendé : rapidement - (57) |
| désendées, en suivant régulièrement, sans interruption, par exemple en parlant de la fauchaison d'un pré. - (27) |
| désenfier : désenfler - (48) |
| désengagi : désengager - (57) |
| desengraignai, désennuyer ; de graigne, chagrin. (Voir ce dernier mot.) - (02) |
| desengraignai. : Désennuyer quelqu'un. (Voir au mot graigne.) - (06) |
| désenseursaler : Désensorceler. « J'ai pardu totes les parties jeusqu'à présent mâ y commache à me veni du jû, me via désenseursalé ». - (19) |
| désensorceler : enlever un sort - (39) |
| désensorcelou : quelqu'un qui enlève les sorts - (39) |
| désernoicher, v. a. déharnacher, ôter le harnais d'un cheval, d'un animal de trait. (Voir : hairnois, hairnoicher.) - (08) |
| désert (au), loc. a l'abandon, en ruine. - (08) |
| désespouaîr (on) : désespoir - (57) |
| déseubligi : Désobliger « Je n'ai pas ésu (eu) l'intention de vos deseubligi » - (19) |
| déseulé, adj. se dit principalement des herbages lorsqu'ils ont été rongés par le bétail ; « lé prés son déseulés, a fau seilli lé bœu. » - (08) |
| desfame (dé-fâme), s.f. amende pour infamie ? - (38) |
| desguier ou déguyer. : Diriger, commander. - (06) |
| déshabilli – dévitre : déshabiller - (57) |
| dèshabïlli v. Déshabiller. - (63) |
| déshabyi : déshabillé - (43) |
| déshâler (se) : désaltérer (se) - (48) |
| déshonneû : Déshonneur. « La pauvreté n'est pas in déshonneû ». - (19) |
| deshonté, adj. ehonté. - (17) |
| dèshonter v. Faire honte à quelqu'un qui s'est mal conduit, lui faire de vifs reproches. - (63) |
| déshonter. Faire honte ; faire de vifs reproches à quelqu'un qui s'est mal conduit. - (49) |
| déshouneu (on) : déshonneur - (57) |
| desi, ou d'si - cheville, petit fausset pour les futailles. - Tote les fouai que te tire du vin remets le desi bein queman qu'en faut.- I aijeuterai bein in robinet, ma ç'à tojeur cin ou chi so, pendant qu'in desi, in bout de faigot suffit. - (18) |
| désialé : (désyâ:lè - part. passé pris comme adj.) en parlant d'un tonneau, disjoint, qui perd ses cercles (syâ:l). Par extension, hors d'usage en général. On rencontre aussi désouâ:lè (v. trans. et adj.) qui signifie "démolir" (un mur, un livre). - (45) |
| désiâler, v., enlever la bonde d'un fût. - (40) |
| dèsigander v. Démolir, démonter en cassant. - (63) |
| désigni : désigner - (57) |
| désignoler : abîmer, casser - (61) |
| désiguer, des'maler : démolir - (48) |
| désiguer, v. détruire le bon ordre de plusieurs objets (de iguer 'égal'). - (38) |
| désiguer, v., rompre l'harmonie, détruire. - (40) |
| désinché. adj. déhanché. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| dés'naper : déchirer, mettre en charpie - (48) |
| desnaqué, se dit d'un vêtement mal ajusté au corps, d'un pantalon qui tombe faute d'être retenu par une ceinture ou des bretelles, dépenaillé. - (27) |
| desnaquer : briser. - (32) |
| désobligi : désobliger - (57) |
| désoilée : se dit d'une chose qui tombe en javelle. (E. T IV) - S&L - (25) |
| désoivre. : (Dial. ), tromper (du latin decipere). (S. B.) - (06) |
| desortir : venir - (44) |
| désosseler, désoussener. v. a . Désosser. (Saligny, Etivey). - (10) |
| désouéfer, v. a. oter la soif, désaltérer, cesser de boire : « i seu désouéfé », je n'ai plus soif ; « a n'désouéfe pâ », il a toujours soif. (Voir : soué, souéfer.) - (08) |
| désouetter : désaltérer - (39) |
| désovré : Désœuvré, sans entrain au travail. « Si an fâ tant sait pô (tant soit peu) la fête le dimanche, le lindi an est to désovré ». - (19) |
| despitaules. : (Dial.), méprisable (du latin despectabilis, rac. despicere). - (06) |
| desracher, arracher. - (04) |
| dessacquer. v. a et v. n. Arracher avec violence, en donnant des secousses vives, des saccades. (Perrigny). - (10) |
| dessailer : dessaler - (48) |
| déssailer : déssaler - (39) |
| dessaler. v. n. Expression figurée par laquelle on indique qu’une personne est là qui ne fait rien, qui se repose faute d’ouvrage. « Fanchette, voù qu’est toun houme ? — Ah ben, il est là qui dessale ! » Ce qui veut dire qu’il est la, désœuvré, comme le hareng saur qu’on fait dessaler dans une écuellée d’eau, avant de le mettre sur le gril. - (10) |
| déssampilli : Mettre en lambeaux. « Ce dreule a aré tot déssampilli sa culotte » : ce gamin a encore mis en lambeaux sa culotte. - (19) |
| dessampjller, essampiller : v a., déchirer, mettre en sampilles, déguenilier. Il est tout dessampillé. Voir sampille. - (20) |
| déssanpllyi, v. a. déchirer, lacérer, périr : le petit jean a déssampllyi son livre. - (24) |
| déssanpllyi, v. a. déchirer, lacérer, périr. - (22) |
| déssarchement. Déchargement. - (49) |
| dessârer : Desserrer. « Dessâre la mécanique », desserre le frein. - (19) |
| déssarger. Décharger. - (49) |
| dessaron. Desserrons. - (01) |
| dessârrer : desserrer - (57) |
| dessarter (pour essarter), v. a. et n. Arracher, supprimer les menus bois, les épines qui nuisent à la végétation des arbres dans une forêt. (Perrigny-lès-Auxerre). - (10) |
| dessarter (v. tr.) : essarter, débroussailler (dessarter des bouchues) - (64) |
| dessarter. v. - Débroussailler. Le français du XIIe siècle employait dessarter ou essarter pour signifier défricher. Le dialecte poyaudin a conservé intact le verbe dessarter, alors que le français utilise la seconde variante : essartage désigne un lieu défriché par abattage des arbres et destruction des ronces. Plusieurs localités en France sont appelées Les Essarts. - (42) |
| dessarzer : décharger - (39) |
| dessaubier : dessabler - (57) |
| dessaus (adv.) : dessous - (50) |
| dessaver, desseyer, dessoyer, dessoiffer : v. a., vx fr. dessoiver, désaltérer. - (20) |
| déssàyé, v. a. désaltérer. - (22) |
| déssàyer, v. a. désaltérer. - (24) |
| déssäyi : (vb) désaltérer - (35) |
| dessayi : désaltérer - (43) |
| dessécher : v. a., faire cesser un état de sécheresse. Qu’est-c’ que j’ pourraïs donc bien boire pour me dessécher la bouche ? - (20) |
| dessembler, v. a. désassembler, séparer ce qui était joint. Cette porte s'est « dessemblée ». - (08) |
| déssempiller, v. arracher les habits. - (38) |
| desser v. (mot lyon. construit avec le préfixe dé et sa, la soif). Désaltérer. - (63) |
| desserter, v. a. desservir. il faut des chemins pour « desserter » les champs, c’est à dire pour en faciliter l'accès. - (08) |
| desservant : ecclésiastique qui dessert une cure, une chapelle, une paroisse. - (55) |
| desserzer. v. a. Décharger. (Ménades). - (10) |
| desseu : Dessous, sous. « Mes pommes cheuyant, i sant totes desseu », mes pommes tombent, elles sont toutes dessous (l'arbre). - (19) |
| desseuchi : dessécher - (57) |
| desseudzi v. Désolidariser, disjoindre, desserrer. - (63) |
| desseurvi : desservir - (57) |
| dessevrer. : Séparer (du latin separare). – Le mot n'est resté dans le langage que sous l'acception de séparer un enfant de sa nourrice et sans la préposition de, c'est-à-dire qu'on n'emploie plus que le mot sevrer. - (06) |
| dessiâlai - ôter le ciâ ou la bonde d'une futaille. - Aiquoi ci sert de tant tapai su le ciâ ? en ne peut pu dessiàlai. - (18) |
| déssiâler, v. a. déboucher une futaille, ôter le bondon. - (08) |
| dessiàler, v. tr., déboucher un tonneau, en ôter la bonde. - (14) |
| dëssié, scier. - (16) |
| dessiquer. v. - Éclisser, tirer des essiques de l'osier. - (42) |
| dessiquier. v. a. Démonter, briser. (Fléys). — Voyez déziguer. - (10) |
| dessó, adv., dessous, sous. - (14) |
| dèssoché, vt. dessécher. - (17) |
| dessochir et essoucher, couper, attacher une souche. - (05) |
| dessocier. v. - Arracher, désolidariser de son socle. (Villiers-Saint-Benoît, selon M. Jossier) - (42) |
| dessocler : détériorer, arracher. (F. T IV) - Y - (25) |
| dessocler. v. a. Arracher, détacher de sa base. (Villiers-Saint-Benoît). - (10) |
| dessoiffer v. Désaltérer. - (63) |
| dessoiffer. v. - Désaltérer, enlever la soif. - (42) |
| dessoiffer. v. n. Boire sans cesse, sous prétexte qu’on a toujours soif. Il ne dessoifre pas. — Se dessoifer. v. pron. Se désaltérer. (Villiers-Saint-Benoît). - (10) |
| dessointe.s. f. Descente. (Domecy-surle-Vault). - (10) |
| dessoler. v. a. Remuer, ébranler, en tirant, en poussant à droite et à gauche, pour l’arracher tout à fait, un objet qui tient dans le sol : un arbre, une pierre, par exemple. — Se dit aussi des saccades imprimées à une dent qu’on remue, qu’on ébranle dans son alvéole, pour l’arracher, pour la faire sortir. - (10) |
| dessortir (d'sortir) : v. n., sortir de, venir de. Viens-tu prendre un verre ? — J'en d'sors. - (20) |
| dessortir, v. sortir (je dessors de la maison). - (65) |
| dessos, adv. de lieu. Dessous. - (08) |
| dessoter : surprendre - (57) |
| déssouâllé : v. t. Disloquer. - (53) |
| dessouciller, dessouciller. v. n. Synonyme de sourciller. S’emploie ordinairement avec la négation. Il n’a pas dessourcillé. Il m’a regardé effrontément, sans dessouciller. - (10) |
| dessouciller. v. - Ne pas bouger un sourcil, rester calme, impassible sous les menaces et les invectives. - (42) |
| dessoulu, dessolu. adj. - Gourmand, glouton, insatiable. - (42) |
| dessoulu, dessoulue et dessouluse : adj.» dessoulé, -ée. - (20) |
| dessoulu, e, adj. gourmand, avide, qui recherche tout ce qui est bon à prendre. - (08) |
| dessoûlu. adj . Gourmand , glouton. (Lainsecq). — Suivant Jaubert, dessoûlu serait une combinaison de soûlé et de dissolu. - (10) |
| dessouster : Terme de jeu, se défaire d'une carte qui en soutenait une plus forte. « T'as ési teu (tu as eu tort) de te dessouster de ta Dame ». - (19) |
| dessouster : v. a., terme de jeu de cartes, jeter une carte qui en soutenait une autre. J'ai fait une bêtise en me dessoustant à pique. Voir souster. - (20) |
| dessu. Dessus, sur. « Dessu lai faiçon », sur la façon.. - (01) |
| dessur, adv., dessus : « J'étôs ben tranquille ; ô m'a tombé d’ssur. » — « Y é lu qu'a mau fait, é pi on m'y a métu d'ssur le dos. » - (14) |
| destituer : (vb) mettre au rencart - (35) |
| destorbe. : (Dérivation du rég. latin disturbationem), trouble, empêchement. (Cout. de Beaune, 1370.)- Destorber la guerre, détourner la guerre quand on poussait le cri de guerre au seigneur, est une expression des franchises de Saulx-le-Duc de 1245. - (06) |
| destourber, déranger , détorber. - (04) |
| destremper. : (Dial.), troubler, agir avec emportement. C'est l'opposé de temprer (du latin temperare), qui signifie modérer quelqu'un, le faire agir avec mesure. - (06) |
| destrenzon. : ( Dial. ), affliction, oppression, tourment. Substantif formé de destraindre, dont la racine est le verbe latin stringere. - Les adjectifs détroit (destrictus) et restroit (restrictus) sont de la même famille de mots. - (06) |
| destrer. : (Dial.), montrer, apprendre, guider (du latin dextera, dextra, main droite, considérée comme indicatrice). - (06) |
| déstu, adv. aussitôt. - (22) |
| dèt, s. m., doigt : « L'maître d'école li a baillé su les dèts. » - (14) |
| détaicher, v. tr., détacher. - (14) |
| détaichi : détacher - (57) |
| détaichi : Enlever les taches. « Détaichi eune reube (robe) ». - (19) |
| détailli : détailler - (57) |
| détaller. v. a. et v. n. Dételer ; mourir. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| détârrage (on) : déterrage - (57) |
| détârrer - décrotter : déterrer - (57) |
| détarrer : déterrer - (51) |
| détarrer : Déterrer, exhumer. « J'ai trapi pa détarrer les raceunes », j'ai eu du mal à déterrer les racines. « O simb'lle in détarré » : il a l'air d'un déterré, il est d'une pâleur cadavérique. - (19) |
| détârrer v. Déterrer. - (63) |
| détatsi : détacher - (51) |
| détatsi v. Détacher. - (63) |
| détatssi : détacher - (43) |
| détauger. v. - Retirer les plumes d'un oreiller, d'un traversin ou d'un édredon. - (42) |
| détaulai. : Sortir de table. (Del.) (Voir au mot taule.) - (06) |
| détaulay, sortir de table. Taule signifie table dans notre idiome bourguignon. - (02) |
| détaupener. v. n. se dit d'un animal à l'agonie dont les membres, surtout les pattes, s'agitent convulsivement. - (08) |
| détcheinde : déteindre - (51) |
| détcheindre : déteindre - (57) |
| détcheindu : déteind - (51) |
| détchouaissi : découver - (57) |
| détchulotter - détchulatter : déculotter - (57) |
| détchûti : découper (la viande) - (57) |
| détéché , c'est défaire la meule lors du battage. - (45) |
| détéchi : Détacher. « Va detéchi les bâtes pa les mener en champ ». - (19) |
| détemi : Dégourdir, déraidir en chaufant légèrement. Voir entemi. - (19) |
| détendre (se). Se reposer, s'étirer. « Se détendre les membres ». - (49) |
| detepis, depis, ded’pis. prép. - Depuis. - (42) |
| déterber, détreuber : retarder, gêner, déranger - (48) |
| déterme : s. f., pâte détermée. - (20) |
| détermer : délayer de la farine pour faire de la pâte. A - B - (41) |
| détermer : délayer de la pâte - (34) |
| détermer : délayer de la pâte - (43) |
| détermer : v. a., battre une pâte, la détremper, la délayer. - (20) |
| déteuche. s. f. Entorse. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| déteudre : Détordre, tordre. « O s'est déteurdu le pî, o s'est fait eune entôrse ». - (19) |
| déteuilli : sortir des torpeurs du sommeil - (51) |
| déteurbe, s. f. trouble, dérangement, retard. - (08) |
| déteurbeman (n.m.) : dérangement, trouble - (50) |
| déteurbement, s. m. dérangement, trouble, empêchement. - (08) |
| déteurber (v.t.) : déranger (aussi détôrber) - (50) |
| déteurber, v. a. détourner, déranger, troubler. Détorber. - (08) |
| déteurber. v. a. Faire perdre du temps, détourner, distraire d’une occupation. (Argentenay). Du latin deturbare. - (10) |
| déteurmer : (vb) délayer la pâte - (35) |
| détiché : v. t. Détasser. - (53) |
| déticher (pour détisser). v. a. Démolir une tisse, une meule de blé. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| déticher : désempiler les gerbes - (48) |
| détichœur : n. m. Ouvrier qui détasse. - (53) |
| détiher, v. a. vider un lit de plume, un oreiller, etc., pour nettoyer, rafraîchir la plume. - (08) |
| détirer. v. a . Retirer. — Se détirer. v. pron. Se retirer. Détire- te, va-t-en. (Pasilly). - (10) |
| détiri : Etirer quand une pièce de linge a été lavée et séchée on la « détire » en la tendant fortement. « An se ment deux pa détiri les linsus », on se met deux pour étirer les draps de lit. - (19) |
| déto (on) : détour - (57) |
| déto : Détour. « J'ai fait in grand déto ». - (19) |
| détoindre. v. a. Éteindre. (Lucy-sur-Cure). - (10) |
| détolé : v. t. Dételer. - (53) |
| détoler : dételer, arrêter le travail - (48) |
| détoler : dételer - (39) |
| détoler, v. a. dételer, détacher d'une voiture ou d'une charrue l'attelage de chevaux ou de boeufs : « al ô tan de détoler. » - (08) |
| détor : détour - (48) |
| détor : détour - (39) |
| détor, s. m. détour : « fion eun détor, ailon viâ », faisons un détour, allons vite. - (08) |
| détôr, s. m., détour : « J'étions su la levée, làvou c' que l’Doubs fait son détôr. » - (14) |
| dètor, sm. détour. - (17) |
| détor. Détour, détours. - (01) |
| détorbe (n. f.) : se dit d'une chose, d'un événement qui occasionne du dérangement (avouèr d'la détobe) - (64) |
| détorbe. s. m. Trouble, retard, dérangement. - (10) |
| détorber (v. tr.) : déranger dans son travail - (64) |
| détorber (verbe) : détourner quelqu'un de son travail. - (47) |
| détorber : déranger, gêner dans son travail - (61) |
| détorber : empêcher de travailler, déranger, retarder - (60) |
| détorber : retarder, déranger. - (52) |
| détorber : déranger, perturber. Fig. : Sortir du droit chemin. Ex : "Vins pas nous détorber dans nout' ouvrage !" - (58) |
| détorber, v. tr., troubler, déranger. - (14) |
| détorber. v. – Troubler quelqu’un, le déranger dans ses pensées, dans son travail - (42) |
| détorber. v. Troubler, déranger. — I n’faut pas que ça vous détorbe. Du latin deturbare. - (10) |
| dètordjre, vt. détordre. - (17) |
| détornè : détourner - (46) |
| détornè : v. t. Détourner. - (53) |
| détornée, s. f. dérangement, indisposition, malaise passager. Avez-vous fait une maladie ? Non, seulement une petite « détornée. » - (08) |
| détôrner (se) Se retourner. Voir tôrner. - (63) |
| détorner : détourner - (57) |
| détorner : détourner - (48) |
| détorner : Détourner, se garer. « Fa attention de te détorner des voitures ». - (19) |
| détorner : détourner - (39) |
| detorner, v. a. détourner, écarter du chemin, changer de direction. - (08) |
| détorner, v. tr., détourner du chemin. - (14) |
| détorré : v. t. Déterrer. - (53) |
| detorser (se), v. réfl. se donner une entorse, se tordre le pied. - (08) |
| détorteuilli v. Détortiller. - (63) |
| détouinde : déteindre - (48) |
| détoupir, v., défricher. - (40) |
| détour : s. m., tour. Détour de reins, détour dans les reins, tour de reins, lumbago traumatique. - (20) |
| détour, entorse. - (16) |
| détourber, destourber. v. a. Troubler. (Soucy). - (10) |
| détourer : faire le tour des champs avant de couper les céréales - (39) |
| détourner, v., ranger les javelles hors de la portée du nouveau passage de la faucheuse. - (40) |
| détourner. Mettre de côté, conserver pour quelqu'un. - (12) |
| détraipai, déménager, desservir après le repas. Ce mot signifie aussi attraper, tromper... - (02) |
| détraipai. : Débarrasser, desservir après le repas. (Del.)- Bel détraipe signifie bon débarras. - On employait aussi ce mot dans le sens de tromper, attraper quelqu'un. - (06) |
| détraipe. Ce mot est tantôt nom, tantôt verbe. Quand il est nom, il marque la délivrance de quelque embarras ; ainsi à la mort d'un méchant homme : « Velai, dit-on, éne belle détraipe ». Quand il est verbe , il signifie débarrasser, déménager, tirer les meubles d'une maison… - (01) |
| détraipon. Débarrassons. - (01) |
| détrait : s. m., vx fr. destroit, détroit, lieu resserré ; travail à ferrer les bœufs. - (20) |
| détrapper : défricher - (39) |
| dètrau : s. f. hache. - (21) |
| détrau : s. f., vx fr. destral, s. m., cognée. « I z'y ave le père Liaude Mouêroux avu sa détrau su les reins. (Il y avait le père Claude Moiroux avec sa hache sur l'épaule (sic). » (Le P'teu, p. 388). - (20) |
| détrau*, s. f. cognée. - (22) |
| détrau, n.f. grande hache. - (65) |
| détrau, s.f. cognée. - (24) |
| détrebai, détrebement - déranger, contrariété. - En venant en ce manmant lai a m'é bein détrebai. - C'â pecho de chose, te me direz, eh bein ci n'empouâche pas que ç'â in vrai détrebement. - (18) |
| détrempé, ée. adj. Mouillé jusqu’au os. (Villiers-Bonneux). - (10) |
| détreuber (se) : se dépêcher. (S. T III) - D - (25) |
| détreuber : dérouter, faire changer d'idées. (RDV. T III) ; déranger, faire trébucher. (LF. T IV) (MLV. T III) - A - (25) |
| détreuber : (détreubè - v. trans.) troubler, gêner, importuner. - (45) |
| détreuber : troubler, déranger (angl. disturb). - (32) |
| détreuber, v. ; déranger, teins, coage-toi donc ; tu me détreubes. - (07) |
| détreuiller - détreuilli : sevrer - (57) |
| détreûyi, détri : (vb) sevrer - (35) |
| détre-yi, detre-yé : sevrer des veaux, des cabris - (43) |
| détri : sevrer des veaux, des cabris. A - B - (41) |
| détri : sevrer (trier les veaux pour les sevrer) - (51) |
| détri : sevrer des veaux, des cabris - (34) |
| détrî v. (construit avec trier, dans le sens de séparer). Sevrer, séparer les petits de leur mère. - (63) |
| détrié, v. a. sevrer un enfant ou un veau. - (22) |
| détrier : sevrer un jeune animal. - (62) |
| détrier : Sevrer. « San pu jeune n'est pas enco détrié » : le plus jeune de ses enfants n'est pas encore sevré. - Se détrier renoncer à faire usage de… « Te bois dan toje la goutte ? je crayais que t'y avais renanci. - Oh je sais bin qu’y me fâ du mau mâ je peux pas m'en détrier. » Etym. vieux français, détrier, détourner. - (19) |
| détrier : v. a., vx fr., séparer, sevrer ; être en désaccord. Vaut mieux s'accorder que non pas se détrier. - (20) |
| détrier, v. a. sevrer un enfant ou un veau. - (24) |
| dètriqué, vt. séparer par catégories les moutons, les fruits, etc. Voir triqué. - (17) |
| détroit. n. m. - Endroit, lieu (Saints, selon D. Levienaise-Brunel) - (42) |
| détroubler. v. a. Déranger, retarder, détourner, troubler. Du latin deturbare. - (10) |
| dètrousse, sf. aventure extraordinaire. - (17) |
| détroussi - détrossi : détrousser - (57) |
| détrure : Détruire. « Y n'y a ren de si maulaji à détrure que la nugerenche eune fois qu'eune tarre en est engringie » : il n'y a rien de si difficile à détruire que le chiendent quand un terrain en est infesté. - (19) |
| dëtrûre, détruire. - (16) |
| dètrure, vt. détruire. - (17) |
| détrure. Détruire. - (01) |
| détsardzi (détsèrdzi) : décharger - (51) |
| détsardzi v. Décharger. - (63) |
| détsau adj. Déchaussé. - (63) |
| détsauchi v. Déchausser. - (63) |
| détsaussi (se) : déchausser (se) - (43) |
| détsèrdzi (détsardzi) : décharger - (51) |
| détué adj. Vide, sec, en parlant des tonneaux, bennes ou cuves. - (63) |
| détuer v. Vider, en parlant d'un tonneau. - (63) |
| deu – dès ou depuis. - En n'é quemançai de plieuve deu les neuve heures. - Deupu ce temps lai en i é bein du nouveau. - (18) |
| deû (demain), dès (demain). - (27) |
| deu : dos - (43) |
| deû : Dos. « Faudra bin que je m'agéte quèque chose, je n'ai ren à me mentre su le deû », façon discrète de dire : j'ai envie d'une robe neuve. - (19) |
| deu : Féminin : deure. Dur. « Y est parto que les piarres sant deures », partout la lutte pour l'existence est dure. - (19) |
| deu, adv. de temps désignant le jour où l'on est. Ne s'emploie guère isolément que dans la locution « tô fin deu », aujourd'hui même. - (08) |
| deû, dès ; deû ke, dès que ; deû lë deuz'heure, dès les deux heures. - (16) |
| deû, deux ; deûsse, au féminin. - (16) |
| deu. Deux, j duo. - (01) |
| deudpée : depuis. - (52) |
| deud'peue : depuis - (48) |
| deud'pu : plus (+) - (48) |
| deue : malgré que, bien que. (RDF. T III) (LF. T IV) - A - (25) |
| deuguin ou doguin : Individu grossier, peu sociable, d'une humeur de dogue. S'emploie aussi comme terme d'amitié en s'adressant à un enfant : « Man ptiet deuguin ». - (19) |
| deûhi (n. m.) : petit bouchon que l'on place au fond d'un tonneau (tonne en avri, rogne l'deûhi (dicton signifiant que la vendange sera mauvaise)) - (64) |
| deuï, deuzil, dosil, dousil (l ne se prononce pas). s. m. Fausset, petite broche de coudrier, taillée en cône, qui sert à boucher les trous percés dans un tonneau. — Se dit aussi quelquefois d’une cannelle, d’un robinet. Du bas latin duciculus. - (10) |
| deûil : n. m. Deuil. - (53) |
| deuillan, ante, adj. sensible, douloureux, souffrant. - (08) |
| deuiller, v. n. s'attrister, se chagriner, avoir de la peine, souffrir de quelque mal. « Douiller. » - (08) |
| deuillot, ote, adj. sensible, douloureux. - (08) |
| deuillot. adj. Douillet. - (10) |
| deur : dur - (51) |
| deur(e) - (39) |
| deur, adj. dur, rude, coriace. - (08) |
| deùr, adj., dur, rude. - (14) |
| deurci : durcir - (51) |
| deurci : durcir - (39) |
| deurè : v. i. Durer. - (53) |
| deure, part. passé. Ne s'emploie guère que dans cette locution : avoir du temps « deuré », être dans le temps « deuré », qui signifie avoir, éprouver de l'ennui. - (08) |
| deurée (na) : durée - (57) |
| deurée n.f. Durée. Cié poummlé, feuille fardée, sant pas à la deurée. Ciel nuageux, fille fardée ne sont pas faits pour durer. - (63) |
| deurement, adv. durement avec un sens superlatif, souffrir durement, travailler durement, c’est à dire beaucoup, très fort. - (08) |
| deùrement, adv., durement. - (14) |
| deûrer (pâs) l’aîze d’ain yieux c’ien : ne pas durer longtemps - (37) |
| deurer (v.t.) : durer - (50) |
| deurer : durer - (51) |
| deurer : durer - (57) |
| deurer : durer, rester tranquille, patienter - (48) |
| deurer : Durer. « To ce qu’enraige ne deure pas » : tout ce qui est très violent ne dure pas. - « Le temps me deure » , le temps me paraît long, je m'ennuie ; on dit aussi « prendre in temps deur » pour s'ennuyer. - (19) |
| deûrer : durer. Tenir la distance. - (62) |
| deurer v. Durer. Tant que deure deure : tant et plus, jusqu'à extinction, épuisement. - (63) |
| deurer : durer, rester calme s' ennuyer (dans l'expression : « le temps m'deure ») - (39) |
| deurer, v. durer. - (38) |
| deurer, v. n. durer, endurer, patienter, pâtir, souffrir : « l' temps m' deure iqui. Bon gré mau gré, a fau bin qu'on deure », c’est à dire qu'on patiente, qu'on pâtisse avec résignation. - (08) |
| deurer. Durer. - (49) |
| deurillan : Induration. « J'ai in deurillan au greu arte » : j'ai un œil de perdrix au gros orteil. - (19) |
| deûrliner : sonner sans arrêt - (37) |
| deûrlingoler : dévaler rapidement, tomber - (37) |
| deurmî (Mhère) ou dreumî (Château-Chinon) : dormir. - (52) |
| deurmi, dreumi v. Dormir. - (63) |
| deurmir. Dormir. - (49) |
| deurmoux. Dormeur. - (49) |
| deurne. n. f. - Draine, espèce de grive. (Sainpuits, selon M. Jossier) - (42) |
| deurne. s. f. Draine, grive, oiseau. (Sainpuits). - (10) |
| deurson, s. f. fracas, grand bruit : « mougner aine deurson », faire beaucoup de bruit, de tapage. - (08) |
| deursoué. s. m. Cordon, ruban de fil. (Monlillot). - (10) |
| deurvin-deurva : Dans un sens et dans l'autre, en allant et en revenant. « O te li a foutu deux paillans deurvin-deurva », il lui a donné deux gifles, sur une joue puis sur l'autre. - (19) |
| deusse : gousse. (BEP. T II) - D - (25) |
| deusse, s. deux. au féminin deusse fait deule : « nos iron totes deules », nous irons toutes deux. - (08) |
| deussei-je. Dussé-je,. quamvis deberem. - (01) |
| deuté, vn. douter. - (17) |
| deuter : Oter. « Deute te dan de devant man jo » : ôte toi de devant mon soleil. - (19) |
| deuter, v. a. enlever, ôter. - (24) |
| deuts (au féminin : deutes) : dressés (attelage bien dressé) en parlant des vaches ou des bœufs. - (33) |
| deùv'dai, d'évdai : dévider, parler abondamment et vite. - (33) |
| deuvidiot. s. m. Dévidoir. - (10) |
| deux-piéces (on) : deux-pièces - (57) |
| deux-sous (un), loc, manière de désigner la pièce de dix centimes: « L'mossieu ôl a rencontré eùn pauve, é pi ô li a beillé un deux-sous. » - (14) |
| dév’yi : (vb) entrer chez soi (après la veillée) - (35) |
| dév’yi : rentrer chez soi (après la veillée) - (43) |
| devain : pourquoi ? - (09) |
| devalé*, v. a. descendre une côte. - (22) |
| dévaler : Descendre. « Dévaler les égrés » : descendre les escaliers. - (19) |
| dévaler : v. a., vomir (par opposition à avaler). - (20) |
| dévaler, descendre, devoler. - (04) |
| devaler, descendre. - (05) |
| devaler, v. a. descendre une côte, une pente, aller vers le val. - (24) |
| dévaler. Descendre, tomber. - (03) |
| dévaler. v. a. et n. Descendre. - (10) |
| dévaller : descendre. - (09) |
| dévalli : S 'en aller quand la veillée est finie. « N'y vla dix heures, y temps de dévalli ». (Prononcer dé-va-lli). - (19) |
| dévaluée, d’vallée. s. f. Descente, déclivité, pente d’un terrain, d’une colline, d’une montagne. On va queuque fois plus vite qu’on ne veut à la d'vallée. (Puysaie). — On dit d'rolée, dans l’Avallonnais. - (10) |
| devan, prép. devant et avant : « dié glli ç'lai d'van d'l'peuni », dites-lui cela avant de le punir. - (08) |
| devan. Devant, préposition, ante. Devant , participe actif debens. - (01) |
| devanquier : tablier. - (09) |
| devant (au, à son), loc. adv., à la rencontre : « J'vons li aller au d’vant. » - (14) |
| devant : Devant. Est souvent employé pour avant. « Ol est veni devant me » il est arrivé avant moi. - (19) |
| devant ma. Incessamment. Te li dirai qu'a s'en revenue devant mâ. Cette locution est usitée dans le village de Meursault. - (13) |
| devant, adv., avant. - (40) |
| devant, avant. - (04) |
| devant, loc. adv., de plus que: « Ol a deux ans d’vant moué, l'Tiéno t; n'empoche qu’ô trime tôjor. » - (14) |
| devant, prép. et adv., avant: « D’vant que d'parler, faut ben des fois r'torner sa langue. » — « La Rose, álle a évu son p'tiot d'vant la Jeanne. » - (14) |
| devanté - tablier. - Mets don ton devanté pou ne pâ te sali. - I ai aiportai des treufes pliain mon devanté. - C'â ine vraie brisaque, en lli fauro in devanté de cuir, queman les mairchaux. - (18) |
| devanté : grand tablier de cuisine, qui ne couvre que le « devant ». - (52) |
| devanté : tablier (de la ménagère) - (48) |
| devanté : tablier, devantier, à bavette. - (32) |
| devanté : tablier. - (66) |
| devanté : Tablier. « Cen li va c’ment in devanté à eune vaiche » : cela ne lui va pas du tout. - (19) |
| devanté et devantei (ce que tu portes devant toi), tablier de femme. - (02) |
| devanté et devantier, tablier. I te ferai fare un biâ devanté en indienne, pour tes dimoinches. Une devantennerée est ce qui peut tenir dans un tablier. J'ons encore raimassé eune grosse devantennerée de féviôles. - (13) |
| devanté : (d'vanté - subst. m.) tablier de protection, dont se sert la ménagère, le maréchal-ferrant, le rémouleur etc. - (45) |
| devanté : tablier - (39) |
| devante, d’vanti, devantier, d’vant’cher. s. m. Tablier. - (10) |
| devanté, devantée (C.-d., Br., Morv., Char., Y.), devantier (Y.), devantin (Chal.). - Tablier, du vieux français devantier, ce qui est devant. Littré considère devantier comme encore français, mais familier… - (15) |
| devanté, devantin : tablier. - (29) |
| devanté, s. m. tablier d'homme ou de femme. - (08) |
| devanté, tablier. - (27) |
| devanté, tablier. - (28) |
| devanté. Tablier. On a dit autrefois : devante, devanteau, devantel, devantez, devantier et devantière. - (03) |
| devanteau, devantier, tablier, devanté. - (04) |
| devantée, s. f., ce qui tient dans un « devantier », plein un tablier. - (14) |
| devantei, s. m., devantier, tablier : « Mets donc ton d'vantei : t'vas barboter ta robe. » - (14) |
| devanteire et devantière, s. f., tablier. Syn. du précédent. - (14) |
| devantel. : Un devant toi, c'est-à-dire le tablier que tu portes. - (06) |
| devantenerée – plein un tablier. – Vô cueilleras ine devantenerée de faiviôles. - Tenez voiqui ine devantenerée de copais pour ailemai vote feu. - (18) |
| devanter (n.m.) : tablier - (50) |
| devanter (un). Tablier. On dit aussi : « une devantére » en employant le féminin. - (49) |
| devanter, n. masc. ; tablier (qu'une femme met devant elle). - (07) |
| devant-hiar (n.m.) : avant-hier - (50) |
| devanti, s. m. tablier (du vieux français devantier). - (24) |
| devanti, s. m. tablier. - (22) |
| devantier (un) : un tablier - (61) |
| devantier : tablier de travail de la ménagère (voir : d'vantier). - (33) |
| devantier : prononcer : d'vantyer. Tablier. - (58) |
| devantier, devanti : vx fr., devantet, s. m., tablier. - (20) |
| devantier, n.m. tablier. - (65) |
| devantier, tablier. - (05) |
| devantin, s. m., tablier de toile pour le travail. - (40) |
| devantin, tablier. - (26) |
| devantö, sm. tablier d'étoffe. - (17) |
| devantrée (f), contenu d'un tablier. - (26) |
| devantrée, sf. contenu d'un tablier. - (17) |
| devantrenée, ce que peut contenir un tablier. - (27) |
| devantrien. : (Dial.), antérieur, supérieur. - (06) |
| devar, prép., devers, aux environs de. - (14) |
| devargonder (se), v. réfl., se dévergonder, devenir effronté, impudent. - (14) |
| devarré. Deviendra, deviendras. - (01) |
| devastre (pour dévaste, du latin dévastatio). s. m. Désordre considérable, bouleversement résultant de quelque catastrophe. — Se dit, par extension, de toute cause qui amène dans une maison ce qu’on appelle un grand remueménage. Tout est en dévaslre ici ; il va nous falloir au moins huit jours pour ranger et remettre en ordre. (Saint-Florentin). - (10) |
| devâter (se), v. réfl. se hâter en marchant, marcher vite. - (08) |
| dévaudurai, déchirer. Dans l'idiome breton, devadur signifie destruction par le feu. (Le Gon.) A Recey-sur-Ource, on appelle dévauduron un enfant qui brise et détruit tout. - (02) |
| devauduré, se dit d'un enfant dont les vêtements sont en loques. - (27) |
| dévauduré. : Déchiré. - Ce mot se dit aussi d'une personne dont les vêtements sont mal ajustés ou dont la mise est évaporée. - (06) |
| devaulai, descendre ; en latin de valle ire. (Voir au mot vaulée.) - (02) |
| dévaulai. : Descendre (en latin de valle ire), c'est-à-dire aller d'une pente plus élevée à une pente plus abaissée. - (06) |
| dévaulan. Descendant ; dévaulai, descendre : dévaler, en français, a vieilli… - (01) |
| dévaule. Descends, descend. - (01) |
| dévaûmas : désormais (mot ancien) - (39) |
| dévâyer, v. mal habiller, en parlant d'une personne ; qui contient mal, en parlant d'un sac de blé qui perd son grain. - (38) |
| dev'dai : dévider. Au figuré : parler beaucoup et vite. - (33) |
| dévdo : appareil pour enrouler le fil de chanvre filé à la quenouille. - (33) |
| devé (loc.prép.) : de vers, auprès de - (50) |
| devé, prép. de vers, d'auprès de : « i vin d' vé lu », je viens d'auprès de lui. » - (08) |
| devé. Devers, préposition, ou devé, verbe, vo devé, vous devez. - (01) |
| devedeau, devedou, s. m. dévidoir, instrument dont on se sert pour dévider. - (08) |
| dévedioeu, s. m. dévidoir de fileuse. - (22) |
| dévediou, s. m. dévidoir de fileuse ; on dit aussi échavou. - (24) |
| devée - vers, du coté de. - Lai girouette regairde in pecho devée les Bordottes. - Note vaiche éto en champ devée la rivière. - (18) |
| déveiller : v. n., terminer la veillée. - (20) |
| devein. Devions, deviez, devaient. - (01) |
| déveler, v. intr., dévaler, partir vivement : « Drès qu'ô t'a éporçu, ôl a drôl'ment dev'lé. » (V. Découler.) - (14) |
| de-veni : Venir de. « Queva dan que te devins ! », d'où viens-tu donc. - (19) |
| deveni, v. intr., venir, revenir. Se prononce indifféremment dev’ni, ou d’veni, selon la tonalité de la phrase: « D’lavoù c'ât-i qu' te d'veins ? » - (14) |
| deveni, v. n. venir de : je devins de Pont-de-Vaux. - (24) |
| deveni, v. n. venir de : je devins de Pont-de-Vaux. - (22) |
| deveni, v. n. venir de, revenir : « do qu' teu d'vin ? » d'où viens-tu ? - (08) |
| devenir : v. n., venir de. D'où donc qu’ te d'viens ? - (20) |
| devenir, venir de. - (04) |
| devenir. Venir de, comme revenir. - (12) |
| déventrounée. s. f. Quand on a mangé avec excès d'un aliment quelconque, et qu'on est plus ou moins incommodé, on dit qu'on s'est donné une « déventrounée. » (Voir : détornée.) - (08) |
| déver, s. m. versant, côté incliné d'un lieu ou d'une chose : sa maison est sur « le déver » de la montagne. - (08) |
| dévergondé, celui qui se débauche sans honte. - (16) |
| dévergondené, dévergondé. - (27) |
| déveri, v. a. détourner, mettre à l'envers : un parapluie déveri par le vent. - (24) |
| déveri, v. a. détourner, mettre à l'envers. - (22) |
| dévermigneu : débroussailler. - (29) |
| déverpiller : couper les menues pousses avant le travail des bûcherons. (VDS. T IV) - VdS - (25) |
| dèvèrre : c'est à voir (dubitatif), c'est probable (affirmatif). (ALR. T II) - B - (25) |
| dévers (n.m.) : versant ; côté incliné - (50) |
| déverser : v. a., verser, vider un contenant de son contenu. Fïg., incliner à. - (20) |
| dévêtre (se) : Se dévêtir, se déshabiller. « Dépôche te de te dévêtre », dépêche-toi de te déshabiller. - (19) |
| deveudiot, deveuguiot. s. m. Dévidoir. - (10) |
| deveune, s. m. devin, médecin, sorcier. - (08) |
| déveurgondé : impoli - (44) |
| déveurgondé : personne aux manières insolites - (34) |
| déveurgondé n. et adj. Trop émancipé, de moralité douteuse, débauché. - (63) |
| déveurgonder v. Entraîner sur la mauvaise pente, dissiper. - (63) |
| déveurgondja (na) : dévergondée - (57) |
| déveurminer : enlever la vermine - (44) |
| déveurminer v. Défricher, traiter contre les parasites. - (63) |
| déveurni : dévernir - (57) |
| dévî (adj.) : difficile (c'est pas dévî (c'est sans problème)) - (64) |
| deviandé : maigre, voire squelettique. Ex : "L'pour Pierrot, quand il a rentré d'prisonnier, il t'ait bin déviandé !" - (58) |
| déviarner (verbe) : déchirer, mettre en pièces. - (47) |
| dévidaire (adj.) : difficile à satisfaire - (50) |
| dévidaire : (adj) délicat sur la nourriture - (35) |
| dévidaire : qui n'aime pas la nourriture qu'on lui propose - (34) |
| dévidaire : qui n'aime pas la nourriture qu'on lui propose - (43) |
| dévidaire n. et adj. (de dévider, dérouler lentement). Difficile, exigeant pour la nourriture. Voir déniaqué. - (63) |
| dévidaire. Espiègle; difficile à satisfaire, à contenter ; exigeant. Personnage symbolique qui préside à Montceau, aux fêtes de Carnaval. - (49) |
| dévidère : personne qui n'aime pas la nourriture qu'on lui propose. A - B - (41) |
| dévidère : personne difficile - (44) |
| devidoire : vieille femme tracassière, exigente, maniaque. - (30) |
| dévidou : Dévidoir. « Tins (tiens) voir tes deux mains en l'ar pa me servi de dévidou ». - (19) |
| dévidou, s.m. dévidoir. - (38) |
| dévidouaîr (on) : dévidoir - (57) |
| dévie (ça mé). exp. - À mon avis, il me semble : « Parce qu'il' ont fait cinq ou six p'tits, ça mé dévie, ma foué arriée, qui faisaint semblant d's'enguieuler. » (G. Chainet. En chicotant mes braisons, p. 13) - (42) |
| dévié (fare), loc. agacer longuement ; causer du désagrément. - (22) |
| devie : prononcer : dévie. Je pense que, je crois que... Ex : "Ca m'es dévie, j'vons avouée la visite des Gendarmes !" - (58) |
| dévier (faire), loc. agacer longuement ; causer du désagrément. - (24) |
| dévier : Endéver. « Ses enfants sant to le temps à la fare dévier » : ses enfants ne cessent de la faire enrager. « Te me fa dévier » tu me fais mourir de chagrin, d'embêtement. Vieux français, desvier : perdre la raison. - (19) |
| devigné, vt. deviner. - (17) |
| devignire. Devinâmes, devinâtes, devinèrent. - (01) |
| deviguer. v. a. Deviner. - (10) |
| dévilli v. Rentrer d'une veillée. - (63) |
| devillot. s. ni. Petit entonnoir pour bouteille. (Courgis). - (10) |
| devin. Je devins, tu devins, il devint. - (01) |
| devinerôte, s. f., devinette. - (14) |
| devinette : Enigme. Exemple : « Quate dames dans in pré que se corant après sans pouya s'étraper, les quatre roues d'un char ». - (19) |
| devinette ou devineure. Enigme à deviner. - (03) |
| devinette : s. f., énigme populaire. - (20) |
| devinotte, s. f. devinette, chose à deviner, énigme. - (08) |
| devinou, s. m. et adj., qui devine. - (14) |
| devinsse. Devinsses, devint. - (01) |
| déviolé : en mille morceaux - (44) |
| dévirai: détourner une conversation. On dit également : dévirandouère (voir : virandouères). - (33) |
| dévirandouére : comptine - (48) |
| dévirandouére : dérivatif. Détournement d'une conversation, d'une action - (39) |
| devirandouére, s. m. détour, subterfuge, échappatoire de plaideur. - (08) |
| dévire*, s. f. versant d'une colline. - (22) |
| devirer (v.t.) : détourner, faire un détour - (50) |
| dévirer : tourner à l'envers - (48) |
| dévirer : v. a., retourner, renverser. Cré matin d' sort, j' viens de m’ dévirer un ongle ! - (20) |
| devirer, détordre, détourner. - (05) |
| devirer, v. a. détourner, faire un détour, prendre une direction différente. - (08) |
| dévirer, v. tr. et intr., dérouler, détourner, faire un détour : « Ma grand' a déviré tout son fî. » — « Ol a déviré du chumin. » - (14) |
| déviri : Dévirer, rabattre. « Ol a déviri sa casquette su ses orailles » : il a rabattu sur ses oreilles les oreillons de sa casquette. - (19) |
| dévirou, s. m., dévidoir. - (14) |
| dévirtoler, v. dérouler une ficelle, un fil, un chiffon autour de quelque chose. - (38) |
| dévirvocher, v. désentremêler des branches. - (38) |
| dévitir, dévitre, dévêtir, déshabiller. - (05) |
| devître (Se). a. pron. Se dévêtir. (Fresnes. Courson). - (10) |
| dévitre : dévêtir - (57) |
| devître, v. a. dévêtir, déshabiller, dépouiller. - (08) |
| dévler v. (fr.) Descendre rapidement, dévaler. - (63) |
| dév'nant : adj. Désolant. - (53) |
| dév'nè : n. Désespéré, désespérée. - (53) |
| dev'ni – d'veni : devenir - (57) |
| dev'ni, devenir quelque chose ; se dit aussi pour : venir ; d'là vou k'te devin ? d'où viens-tu ? Dev'ni s'orthographie aussi d'veni ; el â d'venu mô, il est devenu mort, pour : il est mort. - (16) |
| devo, vt. devoir. - (17) |
| dévo. Dévot, dévots. - (01) |
| dévodiurer, endommager. - (26) |
| dévodurè : aussi démanger, gratter - (46) |
| dévodurè : déchiqueter, être dévoduré, c'est avoir les vêtements en lambeaux. - (46) |
| dévoiement (le). n. m. - Diarrhée, selon J. Puissant. - (42) |
| dévoiher, v. a. tirer quelque chose d'un lieu, attirer à soi un objet en le déplaçant. « Dévoiher » est pour dévoyer, ôter de la voie. - (08) |
| dévoilli : Développer, c'est le contraire de envoïlli. - (19) |
| dévoirer, v. a. déchirer, mettre en lambeaux, en guenille : un enfant « dévoiré » ; une robe, un habit « dévoirés. » - (08) |
| dévoirer. v. a. Dévorer. Les chiens l’ont dévoiré. (Passilly). - (10) |
| devolai - descendre.- I ne sura vô dire l'aivou qu'al ant ailai ; i sai seulement qu'al ant dévolai dans lai rue. - Ci ç'à décroiché, et pu ci é devolai jeusqu'en bas. - (18) |
| dévôlé, descendre d'une hauteur. - (16) |
| devolée, s. f. pente, descente rapide. - (08) |
| devoler (v.t.) : descendre (peut-être de dévaler = descendre rapidement) - (50) |
| dévoler : descendre - (48) |
| dévoler et dévaler, descendre, marcher à val : c'est le contraire d'aller à mont c'est-à-dire de monter... - (13) |
| devoler : (d'volè - v. intr.) descendre. En d'volan " en descendant". - (45) |
| dévoler : dégringoler, dévaler. - (32) |
| devoler : descendre - (39) |
| dévoler, d’voler. v. a. et n. Dévaler, descendre. (Avallonnais). - (10) |
| dévoler, v. ; descendre ; allons, dépoiche-toi de dévoler. - (07) |
| devoler, v. a. dévaler, descendre, suivre en aval la pente d'un terrain, aller d'un lieu plus élevé à un autre. - (08) |
| devôler, v., tomber, se laisser choir. - (40) |
| devôma (adv.) : désormais, dorénavant - (50) |
| devômâ, adv. de temps. Désormais, dorénavant. - (08) |
| devon. Devons. Devon-je ? devons nous ? - (01) |
| devorai - dans tous les sens français de ce mot ; et, en outre, déchire, en mauvais état. - Dans quain état t'ée ! ma t'é étot dévorai ! - Ce petiot lai al é to dévorai son live. - (18) |
| dévorer (Se) : v. r„ se donner du souci en pensant à une chose ou de la fatigue en la faisant. Les auteurs du présent ouvrage se sont dévorés en y pensant et en le faisant. - (20) |
| dévorer : v. a., déchirer. Des habits tout dévorés. Vous n'avez pas idée de ce garnement ; il déchire tout ses habits ; c'est un dévorant ! - (20) |
| dévorer, v. tr., déchirer: « Sa cueûlote ét en âcles ; ô m' dévore tous ses ébits. » - (14) |
| dévorvelai. : Poussé au delà des portes (en latin de foris vulsus) et, au figuré, transporté hors de toute mesure. - (06) |
| dévotian : Dévotion. « fare ses dévotians » s'approcher des sacrements. - (19) |
| dévouaîler : dévoiler - (57) |
| dévouairé : 1 exp. Déchiré (tout). - 2 v. t. Dévorer. - (53) |
| dévouécher. v. a. Déverser. - (10) |
| devouér, v. tr., devoir. - (14) |
| dévouëré : déchiré (voir : dévoiré). - (56) |
| dévouèrer : dévorer, déchirer - (48) |
| dévouèrer : manger avec appétit - (48) |
| dévouèrer : (dévouèrè - v. trans.) déchirer complètement, mettre en lambeaux. - (45) |
| dévouèrer : dévorer, déchirer - (39) |
| dévouher, v. a. dévorer, manger avec avidité. S’emploie aussi au figuré « dévouher son butingn’ » manger son bien. - (08) |
| dévouler, v. intr., dévaler: « Allons, bon! v'là mét'nant mon chapiau qui dévoule !... Ol a dévoulé jeûsque dans la fondrée du champ, » (V. Déveler.) - (14) |
| dévourant, s. m. travailleur acharné. - (24) |
| devoüray (se), v., se gratter douloureusement. - (40) |
| dévouré, v. a. accabler de médisances. - (22) |
| dèvouré, vt. dévorer. Déchirer, abîmer : J'é dèvouré mes saibös ; è m'é dèvouré l'nez. Calomnier. - (17) |
| dévourer : Abîmer, mettre en lambeaux. « Ol a to dévouré san habit ». - (19) |
| dévoûrer v. Dévorer, arracher, déchirer. - (63) |
| devourer, v. a. accabler de médisances. Travailler avec acharnement. - (24) |
| dévouri, s. m. travailleur acharné. - (22) |
| dévouyanssi, v. a. répandre à terre avec vivacité le contenu d'un panier, d'un tablier. - (22) |
| dévoyancer : v. a., renverser pêle-mêle, mettre sens dessus dessous, vider. I m'a tout dévoyancé ma panière à ouvrage. A rapprocher du vx fr. desvolance. - (20) |
| dévoyanssi, v. a. répandre à terre avec vivacité le contenu d'un panier, d'un tablier. - (24) |
| devrâ, etc. - du verbe devoir - Voyez à daivoir, et à dairains. - (18) |
| dévregondé : personne aux manières insolites, dévergondée - (43) |
| dévrillounner, dévrionner, dévrillonner. v. - Déformation du néologisme « dévriller ». - (42) |
| devrò. Devrais, devrait. - (01) |
| dévudè, dévider, par exemple, une pelote de fil ; dévudè la bobine, le fuseau. - (16) |
| dèvudier, vt. dévider. - (17) |
| dèvudiö, dèvudiou, sm. dévidoir. - (17) |
| dèvûji : v. dévider. - (21) |
| dévyi : mourir - (51) |
| déyaîne. s. f. Dégâme. - (10) |
| déyer : délier - (48) |
| dézai adv. de temps. Déjà. - (08) |
| dézandai, adv. tout de suite et vivement : viens débandai. - (24) |
| dézandai, adv. tout de suite et vivement : viens dézandai. - (22) |
| dëzandë, régulièrement, sans désemparer; pieuchè eune vègne dëzandë, piocher une vigne sans interruption de travail. - (16) |
| dézar. Inculte. On laisse le crier an dézar, on laisse le ciel en désert. C’est un bourguignonisme qui signifie qu'on abandonne le ciel sans travailler à nous le rendre utile par nos bonnes œuvres. Quand on laisse une vigne sans la cultiver, on dit que ç’at éne vaigne qu’on laisse an dézar. - (01) |
| dezar. : Désert. -On laisse le cier an dezar est un bourguignonnisme signifiant qu'on abandonne le ciel (Del.) comme on laisse une vigne en friche. - (06) |
| dézerbé un terrain, en arracher les herbes. - (16) |
| dézigan-ner : s'utilise pour parler d'un meuble ou d'un outil qui manque de solidité, démancher, démonter - (39) |
| déziguer. adv. Ebranler, disloquer, desceller. - (10) |
| dezö, d'sö, prép. et adv. sous. Dessous. - (17) |
| dezo. Sous, dessous, avec cette différence de dessous à dezô, que dessous ne veut point absolument de régime, et que dezô se met également bien avec et sans régime. - (01) |
| dézonté, déhonté, trop hardi. - (16) |
| dgépe (na) : guêpe - (57) |
| dgére : guère - (57) |
| dgéri : guérir - (57) |
| dgeulârde (na) : gueularde - (57) |
| dgeule (na) : gueule - (57) |
| dgigognade : petite averse - (44) |
| d'hasar, loc. adv., peut-être. Assez souvent prise dans un sens dubitatif: « Vein'rez-vous pas vouer nout' fille? — Y é ben d'hasar. » - (14) |
| dhiôr, adv., dehors. - (40) |
| d'hiorer : mettre à la porte - (61) |
| dhiorer : mettre dehors. (PSS. T II) - B - (25) |
| di : Le chiffre 10 (se prononce di). « Eune pièce de di sous ». - (19) |
| di ce : de ce côté - (43) |
| di. Dis, dit. - (01) |
| diâ - expression pour faire tirer le cheval à gauche, pour exprimer cette direction. - Diâ ! – Tire ai dia. - Souteins tojeur bein ton chevau ai dia. - (18) |
| dia ! : à gauche ! - (43) |
| Diâ ! : A gauche !. Ordre de conduite du cheval. - (62) |
| dia ! : Cri pour faire aller les chevaux à gauche. « Tiri à hue et à dia » , ne pas s'accorder. - (19) |
| dia (à) : à gauche (pour un attelage) - (48) |
| dia : tourne à gauche (ordre donné à un attelage). - (52) |
| dia : tourner à gauche (attelage). - (33) |
| diâ, diant, dieussaint, diot - divers temps du verbe dire. - I vô diâ bein de vô défie de c't'homme lai. - Pour en ête sûre en fauro qu'à le dieussaint z-eux moinme. - Il y a une variante qui se rapproche du français : – Disâ, diso, diseussaint, etc. - (18) |
| diâ, exclamation pour faire tourner le cheval à gauche. - (40) |
| dia, V. guia. - (05) |
| diab' : n. m. Diable. - (53) |
| diab'à quatre : Vacarme. « Mây est in diab'à quatre ». - (19) |
| diabe : diable - (48) |
| diabe : Diable. « Le diabe bat sa fane et mairie sa fille », se dit quand il pleut et fait soleil en même temps. « Y est pas c 'meude à pigni in diabe que n’a point de cheveux », on ne peut se faire payer d'un homme qui ne possède rien. Au figuré : mauvais, méchant : « O n'est pas si Diabe qu 'ol est na », il n'est pas aussi diable qu'il est noir, c'est à dire il n'est pas aussi méchant qu'il en a l'air. - Demorer au diabe, habiter un pays très lointain. - Poêle à frire à manche court. - (19) |
| diabe : (dyâ:b' - subst. m.) diable. N' apparaît guère que dans les jurons et les imprécations. - (45) |
| diâbe, s. m., diable. S'applique aux enfants bruyants et indisciplinés. - (14) |
| diable : s. m., casserole en terre se composant de deux moitiés symétriques dont l'une sert de couvercle à l'autre. - (20) |
| diable. s. m. Marmite de fonte. (Maillot). — Fourche à trois dents, dont celle du milieu relevée. (Plessis-Saint-Jean). - (10) |
| diablète, s. f. diabète. - (22) |
| diablieutin : Diablotin. « S 't'enfant est in vra diablieutin », cet enfant est un vrai petit diable. On donne aussi le nom de diablieutins aux graines ridées (caryopses) de la petite renoncule qui croît dans les blés, (ranunculus gramineus). - (19) |
| diaice, sf. glace. - (17) |
| diaiçon, sm. glaçon. - (17) |
| diaisle - diable. - Guère employé qu'en forme de locutions. - Ci sero bein le diaisle si a reveno encore ine fouai ! Diaisle sait si… ! - (18) |
| diajö, sm. glaïeul. - (17) |
| diale, pour diable. Même abréviation chez les Picards, dans les Vosges, le Jura, la Lorraine, etc... - (02) |
| diale, sm. diable. - (17) |
| diale. Diable, diables. Les Picards disent aussi diale pour diable. - (01) |
| diale. : (Pat.), diaule (dial.), diable, et diaulie, diablerie. - La dérivation de diavolus est plus naturelle dans le dialecte que dans le patois. - (06) |
| dialezau. : Exclamation signifiant : Diable soit ! (Del.)- Faire le déale à quatre, faire partie quarrée de sabbat, allumer un feu d'enfer et danser autour. (Voir au mot raim.) - (06) |
| dialôgne. Dialogue, dialogues… - (01) |
| dian, sm. gland. - (17) |
| diandaine. n. f. - Racontar. (Mézilles, selon H. Chéry) - (42) |
| dian-na : glaner ; dian-nou : glaneur. - (29) |
| dianné, vt. glaner. - (17) |
| dian-ner, glaner. - (26) |
| diannie, sf. glane. Ène diannie, un tas. - (17) |
| diannodon, int. le diable soit donc. - (17) |
| diantre so si, int. diantre soit. C'est bien vrai, bien réel. - (17) |
| diantre, adverbe affirmatif. - (07) |
| diantre. Diable. Diantre n’est pas ici rapporté comme uu mot bourguignon , mais simplement comme burlesque , à l'exemple du diascans, du diacine, et du diambeme des Italiens. - (01) |
| diaquai - marcher difficilement, se traîner de faiblesse. - I ne peux pu diaquai, quoi… ! in ran me tue. - (18) |
| diarde : (nf) dartre - (35) |
| diarde : dartre, plaie - (43) |
| diardes : voir dardes - (23) |
| diau, s. m., dé à coudre. - (14) |
| diau, s. m., dé à coudre. - (40) |
| diau. Dé à coudre. - (03) |
| diavonou, gluant. - (28) |
| diche (en) : de ce côté - en venant ici. A - B - (41) |
| didi : diminutif enfantin pour doigt. IV, p. 62 - (23) |
| didi. s. m. Doigt, et plus particulièrement le petit doigt. Se dit en parlant aux enfants. Montre voir ton didi . — Se dit aussi poûr dodo , pour dormir. Va faire didi. (Sommecaise). - (10) |
| die - dix. - devant une consonne, et non suivi de quelque mot. - I ai besoin de die voitures de pierres. – I les ai comptai, en i en é die. - (18) |
| Die, Dieu. - (38) |
| die, diz : adj. num. card. Dix. - (53) |
| die. v. - Dire. - (42) |
| dieau, dez à coudre. - (05) |
| diémanté, v. n. se lamenter. - (22) |
| diémenter, v. n. se lamenter (du vieux français guaimenter). - (24) |
| dièpou, ouse, adj. englué de malpropretés : des tripes dièpouses. - (17) |
| diére - guères. - I n'en veux dière. - A ne sont dière forts. - En n'é dière plieuvu, lai poussère â ai pogne moillée. - (18) |
| dierle : Lierre, (hedera helix). « Les meureilles du chétiau sant crevi de dierle », les murs du château sont couverts de lierre. - (19) |
| dièrle, s. m. lierre. - (22) |
| dièrle, s. m. lierre. - (24) |
| diesse : glace. - (29) |
| dièsse, glace. - (26) |
| diet : s. m. 1° petit sentier qu'on fait dans une prairie, en marchant à la rencontre l'un de l'autre. 2° sentier que 2 hommes font dans les bois en s'appelant de chaque côté du taillis pour se rencontrer. - (21) |
| diète : (dyèt' - subst. f.) dartre. Les paysans ont grand soin d'empêcher les veaux de les lécher, car ils craignent d'attraper des dartres au contact de leur langue. - (45) |
| diètre : Dartre. « Ol a eune diètre su la jôe (sur la joue) ». - (19) |
| diêtre : dartre. La Roche Sainte Diètrine à Vaupitre eto sensée guérir les diètres : la Roche Sainte Diétrine à Vaupitre était censée guérir les dartres . Sainte Diétrine ou Diétrice, guérisseuse de dartres. - (33) |
| diètre : dartre. - (32) |
| diétre, s. f. dartre, maladie de la peau. - (08) |
| diètre. s. f. Dartre. (Domecy-sur-le-Vault). - (10) |
| diétroux. s. m. Dartreux. (Domecy-sur-le-Vault). - (10) |
| Dieu soit béni : Ioc. qui désignait autrefois les altnanachs populaires, parce que ces mots étaient imprimés sur leur couverture : Dieu soit béni pour l'an de grâce... - (20) |
| Dieu. : Ai dieu vo di, - ai Dieu vo command, c'est-à-dire je vous dis adieu, - je vous recommande à Dieu. - (06) |
| dieule : s. f gorge du four. - (21) |
| dieussaint - temps du verbe dire.- Voyez les articles diâ, etc. - (18) |
| dieux ait pai, part. - (05) |
| Dieuzaipai. Formule de vœu qui signifie que Dieu en ait sa part. C'est aussi une exclamation de bonheur. - (03) |
| diez, imp. du verbe dire. S’emploie comme une interjection, comme allez ! comme dites ! faites ! pour donner plus de force à la phrase : « i son d'aicor, diez » ! - (08) |
| difèrence, s. f., différence. Se prononce très ouvert. - (14) |
| diffaimer (v.t.) : déchirer ; mentir - (50) |
| diffaimer : déformer, estropier, blesser - (37) |
| diffamatouaîre : diffamatoire - (57) |
| diffamer (se) : se blesser. - (52) |
| diffâmer, v. a. déchirer, mettre en lambeaux. Le chien a « diffamé » mes habits. - (08) |
| diffarance : Différence Dicton : « Y a autant de diffarance de zéro à deux qu’y a du Ban Dieu à Saint Crépin ». - (19) |
| différence, s. f. différend, contestation, désaccord : ces deux hommes sont « en différence » pour un cours d'eau. - (08) |
| différent, adj. de mauvaise qualité, de mauvaise venue. S’emploie principalement avec la négation : ce seigle-là n'est pas « différent » ; la récolte de cette année n'a pas été « différente. » - (08) |
| différer (ne pas). v. a., ne pas refuser. Ex. : je ne diffère pas de payer ce que je dois. - (11) |
| différer de, loc. refuser de... avec la négation signifie consentir à : il ne « diffère » pas de me pardonner ; il ne « diffère » pas de faire ce marché. - (08) |
| dificille, adj. difficile. - (17) |
| digenter (se) : voir ce que l'on peut faire, faire le point, s'organiser - (39) |
| digessian : Digestion. « Paye me voir eune ptiète gotte d'iau de vie pa fare fare la digessian ». - (19) |
| dignè : diner - quouèque t'é fait è dignè ? Qu'as-tu fait à manger ? - ha, te velai ! yè belle lurette qui t'aitan pou dignai, ha, te voila ! il y a longtemps que je t'attends pour dîner - (46) |
| dîgné, dîner. - (16) |
| digné, vn. diner. Manger, en parlant des personnes. Voir mèger. - (17) |
| digner, dîner, déjeuner, faire un repas. - (27) |
| digner, manger. - (26) |
| digoter (v. int.) : manifester son mécontentement en paroles, maugréer, bougonner (syn. racointer) - (64) |
| digoter : répéter la même parole. - (09) |
| digoter. v. - Murmurer, ronchonner. - (42) |
| digoteux. n. m. - Celui qui digote. - (42) |
| digotter. v. n. Murmurer sans cesse. (Bléneau). - (10) |
| Digoué : nom de bœuf. III, p. 30-o - (23) |
| digouin don (ma) : mais pourquoi pas. (C. T IV) - A - (25) |
| dije, diji, adv. de temps. Déjà. - (08) |
| dijeuner, v. n. déjeuner. « Dézuner. » - (08) |
| dijû ! (y’y’ai) : (je lui ai) dit ! - (37) |
| dilai (loc.adv.) : de là - (50) |
| dilai, prép. de là : « dôte-toué d'ilai », ôte-toi de là. (Voir : lai.) - (08) |
| dilé (drilé) : derrière - (51) |
| dilé : là-bas - (34) |
| dilé, dlé adv. Là-bas. Voir drot-dilé et en tran-dlé. - (63) |
| dimanche : Dimanche. « Vêtre ses habits des dimanches », faire sa toilette, s'endimancher. - (19) |
| dimanche : s. m., habiller en dimanche, endimancher. - (20) |
| Dimanche, nom de baptême et même de famille qui équivaut à Dominique. - (08) |
| dimantse : (nm) dimanche - (35) |
| dimantse : dimanche - (43) |
| dimantse : dimanche - (51) |
| dimantse, dmantse n.m. Dimanche. - (63) |
| dîme ou dixme : dixième partie des récoltes, qu’on payait à l’Église ou aux seigneurs. - (55) |
| diméche, s. m. dimanche. - (24) |
| dimeux. n. m. - Enfant criant sans raison. - (42) |
| dîmeux. s. m. Agent qui était commis pour recueillir les dîmes. — Appeler les dimeux. Locution encore usitée dans la Puysaie, où, lorsqu’on entend un jeune enfant crier de toutes ses forces, même à propos de rien, on dit qu’il appelle les dimeux : c’est, paraît-il, une allusion à l’appel qu’on faisait autrefois, à grands cris, pendant la moisson, des agents chargés de lever la dîme au pied du champ. - (10) |
| dimoince (n.m.) : dimanche (aussi dimoinge) - (50) |
| dimoinche, dimanche. - (16) |
| dimoinche, dimoinge : n. m. Dimanche. - (53) |
| dimoinge - dimanche. - Ç'â demain dimoinge. - Allons ! que t'as soin de ne pâ sâli le dimoinge aivou ton ivrognerie. - Mes enfants, préparez vos aifares du dimoinge. - (18) |
| dimoinge : dimanche. - (29) |
| dimoinge, s. m. dimanche, le premier jour de la semaine. « Dimoince. » - (08) |
| dimouinche : dimanche. (B. T IV) - D - (25) |
| dimouinge : dimanche - (48) |
| din : dent - (43) |
| dindan : Dindon, dupe. « Si te fa s'te bâtije t'en seras le dindan ». - (19) |
| dinde (masc), dinde. - (27) |
| dinde, s. masculinisé chez nous, comme plusieurs autres : « Por la fête, nout'fille nous a envié eùn biau dinde. » — On donne aussi ce nom, mais en lui rendant son genre féminin,, à une fille ou femme bornée : « T'as causé d'avou la Jaqueline. Y ét eùne fameuse dinde. » - (14) |
| dindelle - toute petite cloche, une grosse clochette. - Les gens de Bouhey, al ant aichetai ine cliaiche, en parait ; ma ç'â ine dindelle. - Lai cliaichotte de note vaiche â trop grosse âtant ine dindelle. - (18) |
| dindelle, petite cloche... - (02) |
| dindelle. : (Le vrai mot est tintelle), petite cloche. Mot particulier aux Bourguignons qui disent aussi tinter une cloche. - (06) |
| dindoniau : Dindonneau « Eune couée (couvée) de dindoniaux ». - (19) |
| dînè : petit-déjeuner - (48) |
| dine, adj. digne. « a n'ô pâ dine de ç'lai. » (Voir : dinité.) - (08) |
| dine. s. f. Femelle du dinde. - (10) |
| dîner, déjeûner. - (05) |
| diner, sa cueûsine ét eùne écueùrie. » - (14) |
| diner, v. n. diner. S’emploie pour désigner le repas du matin et dans la forme passive : «. i seu diné » signifie j'ai déjeuné. - (08) |
| dîner. Ce mot s'emploie pour désigner le déjeuner et plus particulièrement pour prendre un bon repas. Le dîner s'appelle souper. - (49) |
| dîngé, danger. - (16) |
| dingné, daigner. - (16) |
| dingne, sm. tige de chenevière. Brin isolé. - (17) |
| dingne. s. m. Doigt. (Guy). - (10) |
| dingo. Bêta. Terme particulier à plusieurs régions. (Argot moderne). - (49) |
| dingué, vt. danser (au fig.). Envier dinguer qqun, envoyer promener qqun. - (17) |
| dinguer : (din:guè - v. intr.) tomber avec fracas. - (45) |
| dinguer : tomber - (48) |
| dinguer(envoyer) : envoyer au diable, faire tomber - (60) |
| dinguer, projeter quelque chose au loin et avec violence. - (27) |
| dinguer. v. n . Sonner une cloche. (Roffey). - (10) |
| dinguer. v. n. Sauter en courant. (Mailly-la-VilIe, Mouffy, etc). Se prend généralement en mauvaise part. J’vas te fai dinguer , attends ! - (10) |
| diniai - diner, manger. - En-n-â l'heure de diniai, airivez. - Al aivaint in bon diniai, certainement. - (18) |
| dinité, s. f. dignité. (Voir : dine.) - (08) |
| din-né : gâteau de maïs. - (21) |
| dîn-ner (on) : petit déjeuner - (57) |
| dîn-ner : déjeuner (petit-déjeuner) - (57) |
| dinou, ouse, s. m. et f. dîneur, dîneuse, celui ou celle qui mange, qui a de l'appétit, convive. - (08) |
| dinou, s. et adj., dîneur. On appelle dinous les convives d'un dîner. - (14) |
| dio : dire. O dio : il disait. O dien : ils disaient. - (33) |
| diô de l'ö, int. « chiche d'oeufs ». Se dit en manière de défi à qqun qui tient des œufs, pour l'inviter à en lancer un à la figure de l'interpellateur. - (17) |
| dioire, sf. gloire, faste, fortune. Dioire aifautie, m. à m. gloire souffreteuse, orgueil des pauvres, de gens «qui n'ont pas les moyens ». - (17) |
| diomaine : s. m., vx fr. diemaine, dimanche. - (20) |
| diont, et disont, 3e pers. pl., disent : « Ô diont, é qui, portant. » - (14) |
| dioquer, se dit du gloussement d'une mère poule. - (26) |
| dior (adv.) : dehors - (50) |
| dior, adv. de lieu. Dehors, dans la rue, à l'extérieur. En quelques lieux on prononce « di-hor. » - (08) |
| diôr, diôrè : dehors, mettre dehors - (46) |
| diore - dehors. - Mets voué le chien diôre. - Ç'â in homme qu'à tojeur diôre de chez lu ; ci ne vau ran cequi. - A restant jeusque diôre du pays. - (18) |
| diôrer, v., mettre à la porte. - (40) |
| dioriou, adj. glorieux. - (17) |
| diôrs : dehors. - (62) |
| diôrs, adv., dehors. Prononciation monosyllabique et très rapide. - (14) |
| diôrs, dehors. - (38) |
| diors. adv. - Dehors. - (42) |
| diot, diraint, diro - divers temps du verbe dire. - Quoi qu'à dirant quand al ailant aiprendre cequi. - A diro bein lai chose, ma à n'osuro pâ. - Voyez à l'article diâ, dieussaint, d'autres temps encore. - (18) |
| Diou : (NP) Dieu (dans les jurons) - (35) |
| diou : Employé dans les jurons. « Ban Diou ». - (19) |
| diou : Féminin, diouse. Diseur, diseuse. « Eune diouse de bonne fortune » : une diseuse de bonne aventure. - (19) |
| diou, ouse, oute, adj. diseur, diseuse; celui ou celle qui dit, qui parle. « Diteux, diteuse. » - (08) |
| Diou, s. m., Dieu. - (14) |
| Diou. n. m. - Dieu. - (42) |
| dipe, prép. depuis. - (22) |
| dire (se), loc. coïncider : deux coutures se disent ; faire dire deux surfaces. - (24) |
| dire : Gronder, faire ses observations, quereller. « Y est in vieux en-nuant, ol est toje après dire », c'est un vieil ennuyeux, il est toujours à gronder - « Y en veut bin dire », c'est bien étonnant. - (19) |
| Dire qu'on a un chenil dans l'oeil pour exprimer qu'on y a de la poussière, c'est une exagération de langage, c'est le tout pour la partie. - (06) |
| dire tot de cosse : dire carrément - (43) |
| dire : v. n., reprendre, faire des observations. Avec ce garnement-là, il faut toujours être après dire. - (20) |
| dire, v. a. dire avec la même signification qu'en français. - (08) |
| dire, v. intr., sembler, paraître ; « J'ai d'jà baliyé deux fois à c'maitin ; on n'y diròt pas. » C'est-à-dire : ya n'y paraît pas ; c'est déjà sale à nouveau. - (14) |
| diré. Diras, dira. - (01) |
| dîre. Vo dizë, vous dites ; i diré, je dirai ; te dirë, tu diras, é diré, il dira ; j’dizi, je dis ; dizi-t-il, dit-il ; i vé vô dire, je vais vous dire. - (16) |
| diriâme. s. m. et adj. ordinal . Dixième. (Domecy-sur-le-Vault). - (10) |
| dirigi : diriger - (57) |
| dirigi : Diriger. « O s'est dirigi du côté de Torneu ». - (19) |
| diron. Dirons, diront. - (01) |
| diron-je. Dirons-nous. - (01) |
| disâ, etc. - autre forme de divers temps du verbe dire. - I vô disâ ben, ailé. - Quoi que vô disez don, arré ? - (18) |
| discodje, sf. discorde. - (17) |
| dise (se) : (vb) s’emboîter, correspondre - (35) |
| disète, sf. betterave. - (17) |
| disette : betterave - (48) |
| disette : betterave fourragère. - (32) |
| disette. n. f. - Cancan. (Lainsecq, selon M. Jossier) - (42) |
| disette. s. f. Cancan, on-dit. S’emploie plus généralement au pluriel. (Lainsecq). - (10) |
| disettes, betteraves. - (27) |
| disettes, s. f. dires, racontages, causeries, propos en l'air. - (08) |
| diseur, diseuse : adj., qui reprend, qui fait des observations. Ce mot est employé par des inférieurs parlant de leurs supérieurs. La patronne est une diseuse ; j’ suis pas fâchée de quitter la place. - (20) |
| disheurer : Manger un morceau à 10 heures le matin (voir quatrheurer). - (19) |
| disi. Dit, dis. C’est le dixi, le dixisti et le dixit des Latins. - (01) |
| disire. Dîmes, dites, dirent. - (01) |
| disleuquer : Disloquer. « Ol a cheu abas de san char, o s'est to disleuqué les membres », il est tombé de son char, ses membres sont disloqués. - (19) |
| dison. Disons. - (01) |
| disons harjgneur , qui est le français hargneux. - (03) |
| disons-disettes, loc, causeries, bavardages, confidences. - (14) |
| disoor. Discours. - (01) |
| disò-t-i. Disait-il. - (01) |
| disou, s. et adj., diseur : « Ol a dit c'qui ? Bah ! y ét eùn disou d'ran. » - (14) |
| disparser : Disperser. « Sa famille est dispensée es quat'carres (aux quatre coins) de la France. » - (19) |
| dispense : s. f., dépense. - (20) |
| dispenser : v. a., dépenser. - (20) |
| dispensieux, dispensieuse : adj., dépensier, dépensïère. - (20) |
| dispourter, v. a. déporter, déplacer, acquitter, exempter. - (08) |
| disputai. Disputer. - (01) |
| disputé, s'disputé, se quereller, se dire des injures ; k'é s'disputèn ! qu'ils se disputent ! laissons-les faire. - (16) |
| disputier, sf. disputer. - (17) |
| disputje, sf. dispute. - (17) |
| dissime : Enorme. « In dissime morciau de pain ». Aphérèse de grandissime. - (19) |
| dissiper, v. tr., désennuyer, distraire. Un vieillard de 95 ans nous disait ; « J'travaille tôjor eùn p'chô ; ça m'dissipe. » - (14) |
| distanci : distancer - (57) |
| distric' : n. m. District. - (53) |
| dita : grande cruche dans laquelle on porte à boire aux champs. - (21) |
| ditan : Dicton, proverbe. « Je tâche de retrouer tos les vieux ditans de chez nos », j'essaie de retrouver tous les vieux dictons de chez nous. - (19) |
| dite : s. f., cruche. « Una dite... (Une cruche...) » (Fertiault, Noëls, p. 245). - (20) |
| diton (on) : dicton - (57) |
| Diu, Dieu. - (05) |
| divaigne. Divine, divines. - (01) |
| divarse : dissipé, distrait. - (29) |
| divarse : capricieuse. Se dit d'une femme : elle o divarse. - (33) |
| divarse, diverse, adj. étourdi, capricieux, folâtre, d'humour difficile. Un enfant « diverse », une femme « diverse ». - (08) |
| divarti : Divertir, s'amuser. « Vos êtes vos bien divarti à la fête ? » - (19) |
| divarti, v. a. divertir, amuser. - (08) |
| divarti, v. tr. divertir, amuser. - (14) |
| divartichement : Divertissement. « Dans les ptiets pays c’ment Manci y a guère de divartichements » - (19) |
| divartir. v. - Divertir. - (42) |
| divartissement, s. m. divertissement, amusement, récréation, fête. - (08) |
| divartissement, s. m., divertissement, amusement. - (14) |
| divers , sensible , mal élevé. - (05) |
| divers, adj. quai. ; polisson ; ce petiot est ben divers. - (07) |
| divers. L's se fait sentir. Se dit des enfants difficiles à élever. - (03) |
| diverse - étourdi, dissipé, toujours remuant, surtout en parlant des enfants. - Qu'â sont don diverses, ces enfants qui ! - Vote petiote ninze n'â pû diverse, lé, vos daivez en ête bein contente. - (18) |
| diverse (enfant) : remuant. (E. T IV) - C - (25) |
| diverse, adj. distrait, étourdi. Voir dègalice. - (17) |
| diverse, adj., gai, diable, difficile à tenir, à élever : « Mon Diou ! que c' petiot é donc diverse ! » - (14) |
| diverse, divarse. adj. - Capricieux, difficile en parlant d'un enfant. Au XIIe siècle, l'adjectif.divers signifiait varié, inconstant ou méchant , le latin diversus indiquait déjà cette idée de différent, allant dans un autre sens (divertus). Le poyaudin reprend toutes ces significations autour de la notion de caprice. - (42) |
| diverse, divarse. adj. Capricieux, étourdi, fantasque, difficile à conduire, en parlant d’un enfant. Du latin diversus. - (10) |
| diverse, remuant, dissipé. - (16) |
| diverse. Adjectif des deux genres qui signifie étourdi, remuant. Not' Piarre n’aipprend ran du tôt en l 'école, al ast trop diverse. - (13) |
| diverse. Turbulent, turbulente. Etym. di et vertere, tourner, changer de place. - (12) |
| divouin don (ma) : mais pourquoi donc ?(MM. T IV) - A - (25) |
| dix-hui : dix-huit - (57) |
| dix-neû : dix-neuf - (57) |
| dizaine : une tisane - (46) |
| dizaîn-ne (na) : dizaine - (57) |
| dizaiñne n.f. Dizaine. - (63) |
| dizain-ne : n. f. Dizaine. - (53) |
| dizane, tisane. - (16) |
| diziau, s. m. dizaine : un « diziau » de gerbes de blé. - (08) |
| diziau. s. m. Monceau de gerbes entassées par dix, dans les champs. - (10) |
| dizou, celui qui répète souvent une même chose et qui lasse ceux qui l'entendent. - (16) |
| d'ja : Déjà « Te t'en vas dja ? Y est bin temps n'y via d'ja causu (presque) né ». - (19) |
| d'ja, adv., déjà. - (14) |
| djà, dzà adv. Déjà. - (63) |
| dj'ab, dj'am. n. m. - Diable. - (42) |
| djabe : diable - (51) |
| djabe : diable. - (52) |
| djâbe : diable - (39) |
| djabe. Diable. Poêle à frire. Racloire faite avec une petite planchette en forme de trapèze et un long manche pour racler le blé sur le grenier. - (49) |
| djarde n.f. Dartre. - (63) |
| djarde, jiarde. Dartre. - (49) |
| djardeu : céréales aux pousses inégales. A - B - (41) |
| djardeux : céréales aux pousses inégales - (34) |
| Djé ! : À gauche (!). Ordre de conduite des bœufs sous le joug. Peut-être ordre au bœuf de gauche pour tourner à droite ? - (62) |
| djè : dire - (51) |
| djé. Dites : « djé m'y don », dites-moi donc. - (49) |
| d'jeau (d'yeau) : de l'eau - (51) |
| djée. adv. - Guère. - (42) |
| djére : guère - (39) |
| djerre. n. f. - Guerre. - (42) |
| djètre (na) : dartre - (57) |
| djeu : dieu. On ne prononçait le nom de Dieu que dans les jurons, ou pour se plaindre : hélè mon Djeu ! - (52) |
| djeu d'ran : (tr. litt. : diseur de rien) bavard, à la conversation insignifiante. A - B - (41) |
| djeu d'ren : bavard, à la conversation insignifiante - (34) |
| djeu d'ren n.m. Diseur de rien. Voir niaquouet. - (63) |
| Djeu. Dieu. - (49) |
| djeu. s. m. Dieu. (Béru). - (10) |
| djhôrs , djhô adv. Dehors. - (63) |
| d'ji : v. t. Dire - (53) |
| djôr : n. m. Dehors. - (53) |
| djoré : v. t. Expulser, mettre dehors. - (53) |
| djôrer : mettre à la porte (dehors) - (39) |
| djors, dihors. Dehors. - (49) |
| djouelle (na) : douelle - (57) |
| djuint, djuet. Ancienne charrue à bois à deux versoirs servant à curer les raies entre les sillons et à labourer en ados, « à regueux ». C'est l'ancêtre du buttoir. - (49) |
| d'là, d'lavou : d'où - d'là qu'èl â ? d'lavou qu'è vin ? D'où est-il ? D'où vient-il ? - (46) |
| dlé : là-bas (en A : yaba). B - (41) |
| d'lé : De là. Ne s'emploie que précédé de « en » ou de « liavent ». En d'lé : de l'autre côté, « Mon cousin demore en d'lé la mantaigne ». Liavent d'lé, là bas, de l'autre côté. « Queva qu'ol est ? Ol est liavent d'lé ». - (19) |
| dleire - trier, choisir. - Veins voué m'aidie ai deleire les faiviôles. - Le ri â bein sâle, dlée lu pour fâre le fian. - (18) |
| dlî (v. tr.) : trier des légumes (dlî des calons (débarrasser les noix de leurs coquilles)) - (64) |
| d'lire : éplucher, trier (par exemple des fèvioles, de la salade). (ALR. T II) - B - (25) |
| d'lire : se dit du nettoyage d'un bois. (B. T IV) - Y - (25) |
| d'lire : trier. (RDM. T III) - B - (25) |
| dlire : (dlir' - v. trans.) trier des haricots. Ce verbe n'existe qu'à l'infinitif, au part. passé dli, et aux trois personnes du singulier du présent de l'indicatif. - (45) |
| d'luge, s. m. déluge. Se dit pour exprimer un grave dommage, un dégât notable. - (08) |
| d'mâdze : (nm) dommage - (35) |
| dmâdze n.m. Dommage. - (63) |
| dmain adv. et n.m. Demain. Y'est pas peu dmain. Ce n'est pas pour demain. - (63) |
| d'mandè : v. t. Demander - (53) |
| dmander : demander - (43) |
| dmander v. Demander en mariage. - (63) |
| d'meûri : (vb) demeurer, rester - (35) |
| d'mi : adj. et n. m. Demi. - (53) |
| d'mi-ieue. n. f. - Demi-heure. - (42) |
| d'moizèle, support d'un rouet, d'une bobine. - (16) |
| d'morer : habiter - (57) |
| d'morer : rester (demeurer) - (57) |
| dmorer v. Demeurer. - (63) |
| d'morer, v. demeurer. - (38) |
| dô : dé (à coudre) - (48) |
| dô : dors - dô bin ! dors bien ! - i dô, je dors - (46) |
| do : petit crapaud. (P. T IV) - Y - (25) |
| do : petit crapaud. IV, p. 32 - (23) |
| dô : (dô: - subst. m.) dé à coudre et nom d'un oiseau: le ptyo dô: : troglodyte mignon, petit passereau des haies. - (45) |
| dô : dé à coudre - (39) |
| do : petit crapaud qui "chante" à la nuit tombée autour des maisons. Monotonique. L'appellation s'inspire du son. - (58) |
| dô, conj. dès. - (17) |
| dô, prép. de le : « ç'nô pâ maulâzié dô voua », ce n'est pas malaisé de le voir. - (08) |
| dô, s. m. doigt. - (22) |
| do, sm. doigt. - (17) |
| dô. Dos. C'est aussi une préposition, « dô qu'ai seré venun », dès qu'il sera venu. - (01) |
| do. n. m. - Petit crapaud, dont le coassement est réduit à la note do. - (42) |
| dô. : Depuis et dès que. - (06) |
| dôbtance. : Doute (en latin, dubitationem, régime de dubitatio). - (06) |
| Doche : diminutif de Andoche - (48) |
| doctœur : n. m. Docteur. - (53) |
| dodâne, s. m. catafalque, estrade en forme de cercueil dont on se sert pour les cérémonies funèbres. — amas de terre bombé au milieu et incliné sur les bords. - (08) |
| dô-d'chu : en haut - (39) |
| dodeignai, dorloter quelqu'un ; en français dodeliner, d'où le mot enfantin dodo. - (02) |
| dôdeignai. : Dorloter. Le vieux mot français dodin signifie indolent. (Roq.) - On trouve dans Rabelais : Dodeliner de la tête. - (06) |
| Dodi : surnom de Claude et, par extension, simple d'esprit - (39) |
| dôdi, doguin : idiot, bête - (48) |
| dôdi, subst. masculin :simple d'esprit. - (54) |
| dodine. s. f. Sorte de caresse faite à un enfant et qui consiste à le bercer sur ses genoux en lui chantant quelque chansonnette propre à l’endormir. — Se dit aussi, ironiquement, pour correction. Recevoir une dodine, c’est être châtié à raison d’un méfait. — Se dodiner . v. pron . Se reposer, ne rien faire. (Mont-Saint-Sulpice). - (10) |
| dodiner (v.t.) : dorloter - (50) |
| dodiner : prendre un enfant dans ses bras. IV, p. 61-g - (23) |
| dôdiner, v. a. abattre les angles du bois, arrondir en général. - (08) |
| dôdô, adj., polisson, gamin : « Boufre de dôdô, va ! » On voit que ce mot diffère du vocable enfantin qui veut dire : lit. - (14) |
| Dôdo, Claude ; Dôdon et Dôdine, Claudine. Pour Claudine, on dit aussi : Glodine ; comme on dit encore Glaude, pour Claude. - (16) |
| dodo, nom propre très usité pour claude. - (08) |
| dodo, s. m. dadais : quel grand dodo ! - (22) |
| dodo, s. m. dadais : quel grand dodo ! - (24) |
| dodoche : s. m., bêta. - (20) |
| dodouille, adj. douillet, délicat ; sans caractère. - (17) |
| dô-d'sôs : en bas - (39) |
| dœ, s. m. pressée de raisins dans un pressoir ayant, une fois sèche, la forme d'un gros dé. - (24) |
| doeuté, v. a. enlever, ôter. - (22) |
| dogin : (dogin: - subst. m.) 1- belier. 2- simple d'esprit. Ce sens figuré s'explique par le fait que le bélier passe pour particulièrement stupide, étant capable de foncer sur n' importe quoi. - (45) |
| dogne (membre) : sensible. (S. T III) - D - (25) |
| dogne : douloureux, on dit aussi bodiot en parlant d'un doigt - i m'seû cogné, yâ lè jambe toute dogne, je me suis cogné, j'ai la jambe toute douloureuse - (46) |
| dogne : endolori. (E. T III) - VdS - (25) |
| dogne ou doigne - très sensible, douloureux au toucher. - I ne sai pâ d'ou voint, ma mon bras à don doigne ! - Allons don, mai petiote feille, ne s'as don pas si doignotte. - (18) |
| dogne, chagrin, triste. Les Bretons disent dounia, s'ennuyer, et doan, chez eux, signifie tristesse, déplaisir. (Le Gon.) - (02) |
| dogne, dongne, adj. douillet, peu endurant, sensible à l'excès. - (17) |
| dogne, douloureux, sensible. - (27) |
| dogne. Qui ne peut souffrir le moindre attouchement sans douleur… - (01) |
| dogne. Tendre, mûr, malléable. Ce terme est employé dans les villages de la plaine. Le mau blanc (mal blanc) qu’ast ai mon doigt vai bintôt parcer : al ast dogne. - (13) |
| dognot, e. adj. - Douillet, sensible. Autre sens : difficile à nourrir, délicat. « Guade don' l'Dédé en train d'décortiquer c'te caille ! Te parles d'un dognot ! » - (42) |
| dognot. adj. Douillet, délicat, et surtout difficile sur la nourriture. (Perreuse). - (10) |
| dogué : exp. Donner des coups de tête. - (53) |
| dogueigne : 1 n. m. Farfelu. - 2 n. m. Simplet. - (53) |
| doguer (v.t.) : donner des coups de tête (bovins, ovins, caprins) - (50) |
| doguer (verbe) : donner des coups de tête à la manière d'un bélier. - (47) |
| doguer v. 1. Frotter. Se dit d'un animal qui vient frotter sa tête pour exprimer son bien-être ou son désir de caresses ou de nourriture. 2. Donner des coups de tête (animaux qui se battent), on dit surtout teurler dans ce sens. - (63) |
| doguer : (dogè - v.intr.) donner de la tête contre qqch. - (45) |
| dôguer : donner des coups de tête - (39) |
| doguer, buter - (36) |
| doguer, se cogner - (36) |
| doguer, v. a. donner des coups de tête à la manière des béliers. - (08) |
| doguer, v. sauter sur un pied. - (38) |
| doguer, v. tr., attendre, toucher. Expression enfantine, dont ne se privent pas les écoliers. - (14) |
| doguer, v., se dit des moutons qui se battent ou du veau qui cogne sa mère de la tête en tétant. - (40) |
| doguin : bovin très paisible, qui aime se faire flatter ou gratter. A - B - (41) |
| doguin - paresseux. - Ce mot est employé un peu même en français, c'est une conquête sur le patois. - Qué doguin que c't'homme lai ! - Allons don, gros doguin, te n'és pencore levai ! - (18) |
| doguin : bovin très paisible, qui aime se faire flatter - (43) |
| doguin : bovin très paisible, qui aime se faire flatter ou gratter - (34) |
| doguin : gros - (46) |
| doguin : pas dégourdi. (C. T IV) ; peu dégourdi. (RDC. T III) - A - (25) |
| doguin adj. (du v.f. dodiner) Docile, doux, affectueux, caressant, gentil, tendre. T'poux toudze fare le doguin t'aras ren d'maîs ! Tu peux toujours faire le tendre, tu n'auras rien de plus. - (63) |
| doguin : pitoyable, pas à la hauteur (en celt. dogan veut dire cocu). - (32) |
| doguin, adj., rogue, grincheux, qui a une humeur de dogue, signifie aussi : polisson. - (14) |
| döguin, döguin, ingne, adj. sans courage, traînard, fainéant - (17) |
| doguin, doguine : adj., bon, doux, comme un gros chien. - (20) |
| doguin, ine, adj. doux, facile, sans malice, sans méchanceté. S’emploie surtout en parlant des animaux. - (08) |
| doguin, n. masc. ; jeune homme qui ne travaille pas. - (07) |
| doguin, paresseux. - (26) |
| doguin, paresseux. - (27) |
| doguin, s. m. homme mou, lent au travail. - (24) |
| doguin. Bête, mal élevé. - (49) |
| doguin. Mal gracieux, hargneux, mauvais caractère. C'est l'emploi au figuré du mot doguin, petit dogue. - (12) |
| doguin. s. m . Enfant gros, gras, dodu, comme un petit dogue. - (10) |
| doi. Doigt, doigts, et le verbe dois, doit. - (01) |
| doigt-de-mort : s. m., racine de salsifis épluchée (à cause de sa forme allongée et de sa couleur cadavérique). - (20) |
| doigtlot. s. m . Doigtier, doigt détaché d’un gant de peau pour envelopper un doigt malade. - (10) |
| doigtot, s. m. petite pièce de linge qui enveloppe une blessure au doigt. - (08) |
| doigts. s. m. pl. A Perreuse et dans la Puysaie, on les désigne sous des noms assez singuliers, qu’il peut être intéressant de relater ici : Pouçot, pouce ; Liche-pot, index ( à cause de l’usage auquel le font servir les gourmands) ; Longis, médius ; Malacquis , annulaire, par allusion sans doute à l’anneau qui n’y est pas toujours légitimement placé, qu’on regrette quelquefois d’y avoir ou d’y avoir laissé mettre ; Pierrot-des-petits , petit doigt. - (10) |
| doile : douelle. - (62) |
| doile. Douve. - (49) |
| doïöt, sm. dé à coudre. - (17) |
| doir, daira – du verbe devoir. - Moi, i n'eume pas doir lai moindre chose, pâ moinme in liaird. - A doiro ine fortune qu'à ne se remuero pâ daivantaige. - Moins usité que la forme daivoir, dairain. - Voyez ces articles - (18) |
| doise. s . m. Galerie creusée par la taupe presqu’à la surface du sol. C’est une forme du vieux mot doisil, conduit, canal, passage étroit. Du latin ductus, et du bas latin doitus. - (10) |
| doitte. s. f. Dette. - (10) |
| doiyeu : délicat, douillet. - (29) |
| doizeu, sorte de fourreau de toile ou de peau de gant pour cacher une plaie au doigt. - (27) |
| dolé (adj.) : qui ne retire d'une chose que des inconvénients et de l'embarras (t'est bin dolé avec ça (tu es bien mal loti)) - (64) |
| doloser ou dolouser. : (Dial.), même signification que doloir ou douloir et même rac. latine, c'est-à-dire dolere. - (06) |
| domaine : vaste exploitation agricole, grande ferme, souvent isolée. Ex : "Quant te vas à Donzy, té passe devant Chambaujarr, sous l'bois." (Pour : Chamboyard). - (58) |
| domain-ne, s. m., domaine, propriété. - (14) |
| domaire, n. fém. ; ancien habit français que les hommes portaient pour les fêtes . C'ost Pâques hojodeu, mets tai domaire. - (07) |
| dômaire, s. f. habillement que portaient autrefois les Morvandeaux dans les jours de fête. - (08) |
| domballer v. (de Mathieu de Dombasle, agronome). Faire un demi-tour avec la charrue. - (63) |
| dombasler : labours effectués avec une charrue Dombasle - (43) |
| dômée, dômeue, dômaie. s. f. Habit de noces et de cérémonie des anciens paysans ; se dit aujourd’hui, par ironie, d’un vieux paletot. Bigre! on voit bien qu’ v’avez des rentes à persent (présent) ; vous n’ sortez pas sans vout’ dômée. - (10) |
| domeune, s. m. domaine, propriété rurale. En plusieurs lieux « doumeune. » - (08) |
| domino. s. m. Petite chemise d’enfant du premier âge. (Etivey). - (10) |
| Dompiarre : (NL) Dompierre-les-Ormes - (35) |
| Dompiarri(re) : (nm.f) habitant (e) de Dompierre-les-Ormes - (35) |
| domptaige : n. m. Domptage - (53) |
| don : conj. Donc - (53) |
| don, donc, sorte d'adverbe augmentatif dans cette locution : k'i seû don m'lède ! combien je suis malade ! Dans celle-ci : vîn don, viens donc ! il exprime une instance ; dans beaucoup d'autres locutions, don semble n'avoir aucun sens. - (16) |
| don. conj. - Donc. - (42) |
| don. Donc. - (49) |
| don. Dont, de qui, duquel, desquels, de laquelle, desquelles… - (01) |
| donaison. n. f. - Donation. - (42) |
| donaison. s. f. Donation. (Sommecaise). - (10) |
| donde : dompté, dressé. III, p. 30-s - (23) |
| donder. Mettre quelqu'un à terre et le rouler. Maîtriser. - (49) |
| dondon, grosse femme indolente (familier). - (16) |
| dondon. Grosse femme. Un auteur du siècle dernier dérive ce mot de dondaine, machine de guerre qui servait a lancer les pierres. Je ne crois pas qu'il y ait un rapport entre ces deux expressions. Un Bedon est un gros ventre : par une plaisante abréviation , on s'est servi du mot dondon. V. Beurde et beurdôler. - (13) |
| donméje, deumèje, dommage et regret. L'on dit de quelqu'un qui est mort trop jeune ou qu'on aimait : el â mô treu tô ; s'a deuméje ! il est mort trop tôt ; je le regrette. - (16) |
| donne, adj., généreux. - (40) |
| donné, donnée : part, pass., m. et f. Enfant cfonné, enfant naturel. A rapprocher du vx fr. donoieor, donneur, amant, galant, et donoier, donner, parler d'amour, faire l'amour. - (20) |
| donner : Donner. « Donner san lait » : se laisser dépouiller Au jeu de cartes « O donne bien san lait » : il se laisse gagner. - (19) |
| doñner la main v. Aider. Voir adzuer. - (63) |
| donner v. Couler, suppurer, sourdre. - (63) |
| donnou : Donneur, au féminin donne. « Alle n'est pas bien donne » elle n'est pas généreuse. - (19) |
| donter : dompter - (48) |
| donter : dresser les bêtes, dompter - (39) |
| donzalle, s.f. partie du foyer de cheminée. - (38) |
| donzelle : s. f., vx f r. donsele, sorte d'étrier de fer qu'on suspend à la crémaillère pour supporter la poêle, le moule à gaufres, etc. « Un réchaut de fert, une donselle... » (Inventaire du mobilier de Jean Delavaivre, bourgeois de Cluny, 1er, 2 déc. 1745, Archives dép.,, B. 1820, n° 60). Voir vervante. - (20) |
| donzelle, servante. Support suspendu à la crémaillère sur lequel repose la poêle à frire. - (49) |
| donziron(ne), n.m.(f.) habitant(e) de Donzy, adj. se rapportant à Donzy (s'écrit souvent Donzyron(ne)). - (65) |
| dôô, doue : dos - (48) |
| Dopiârre n.p. Dompierre-les-Ormes - (63) |
| dor, adv. de lieu. Dehors. (Voir : dior.) - (08) |
| dôr, adv. dehors. Voir defeur. - (17) |
| dorainne (prononcez do-rain-ne). s. f . Douzaine. (Domecy-sur-le-Vault). - (10) |
| dord (n. m.) : faux (affûter son dord) - (64) |
| dordée, dourdée. s. f. Crossée, râclée, volée de coups de poing ou de bâton. (Villiers-Saint-Benoît, Gourgenay, etc.). - (10) |
| dordée. n. f. - Correction, raclée. - (42) |
| dore : courtilière (insecte n'existant pas en b). A - (41) |
| doré, enduit de boue, malpropre. - (27) |
| dore. Courtilière. - (49) |
| dorée - rotie. - Ine dorée de confitures. - Teins, mon enfant, voiqui ine dorée de beurre pour ton goutai. - (18) |
| dorée est synonyme de tartine. Une tartine, rôtie au feu, devient dorée, surtout lorsqu'elle a été préalablement enduite de fromage fort ou de graisse d'oie. Dorée viendrait donc du latin deaurata. Je m'en tenais à cette étymologie, lorsque j'ai eu l'occasion de voir, dans un compte de la viérie d'Autun, publié par M. de Charmasse : « una denariata panîs » une denrée de pain, ce qu'on donnait pour un denier. Il y a entre denrée et dorée une ressemblance qu'il est utile de constater. - (13) |
| dorée, tartine, par exemple de confitures. - (27) |
| dorelot. Terme d'amitié aux enfants. - (03) |
| dorgnot. adj. - Endormi, mou, lourdaud. (Sainpuits, selon M. Jossier) - (42) |
| dorgnot. s. m. Niais, lourd, endormi. (Sainpuits). - (10) |
| dorlotte : béguin, bonnet. - (09) |
| dorlotte, s. f. bonnet de femme garni de grosse blonde noire. - (08) |
| dorlotte. s. f. Bonnet de femme en étoffe de couleur. (Montillot). - (10) |
| dormadou. n. m. - Gros dormeur ; se dit d'une personne qui s'endort n'importe où et à la moindre occasion. - (42) |
| dormant, part, substantivé, qui, avec celui dérivant, donne une saveur toute particulière à la formule du « Bonjour à Mars ». - (14) |
| dorme, drome (dr'me), dormie (vx fr.) : s. f., sommeil, somme, sieste. Voir pranire. Avoir la drome, avoir sommeil. Faire une dorme, faire un somme. - (20) |
| dorme. Dormes, dorment. - (01) |
| dormette. s. f. Sorte de bonnet en toile plus ou moins fine, fort en usage autrefois, dans la Puysaie, parmi les femmes, et qui sans doute, ainsi que l’indique son nom, leur servait particulièrement la nuit. - (10) |
| dormir : v. a, endormir. - (20) |
| dormiré. Dormiras, dormira. - (01) |
| dort-dans-iau. n. m. - Personne d'apparence inoffensive, qui cache son jeu, et dont il faut se méfier ; « attention à l' eau qui dort. » (F.P. Chapat, p.80) Autre sens : personne peu vive, qui prend son temps, fait tout sans se presser. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| dort-en-chiant : s. m., individu mou, sans énergie. - (20) |
| dortouaîr (on) : dortoir - (57) |
| dortouaire : n. m. Dortoir. - (53) |
| dos d’raisse : bossu - (37) |
| dos d'ane : s. m,, barre de bois cintrée servant de porte-manteau. - (20) |
| dosse : Dose. « Ol en a pris eune bonne dosse », il en a son compte, il est ivre. - (19) |
| dosse : gousse d'ail. (E. T II) - B - (25) |
| dossére : la dossière - (46) |
| dôte. Doute, doutes substantif, et doutes, doute, doutent verbe. Dôtai douter. Dôte substantif est toujours féminin en bourguignon, comme il l'était encore en français il y a 70 ans. - (01) |
| d'ôter (se) (v.pr.) : s'enlever - reprendre quelque chose - (50) |
| doter : enlever - (44) |
| dôter : enlever, ôter. « Dôte te d’là ! » : retire toi de là ! - (62) |
| dôter : ôter, enlever - (48) |
| dôter : v. a., ôter. Döter son chapeau. Dôte-toi donc d' là que j’ m'y mette ! - (20) |
| dôter, v. a. oter, reprendre quelque chose. - (08) |
| dôter, v. ôter. - (38) |
| dôter, v. tr., ôter : « Jean, dôte-te donc d'là ; t'mempôch's de passer. » — « Poui ! p'tiot mouchou ! y é prou peut. V'tu ben dôter les dèts d'ton nâz! » — « Avant d'li beiller l'saichot, ôl en a ben dôté tous les sous. » - (14) |
| dôter, verbe transitif : ôter. - (54) |
| doter. Ôter. - (49) |
| dôter. v., enlever, ôter. « Dôte touè d'iqui qu'i m'y mottâ » (ôte-toi d'ici que je m'y mette). - (40) |
| dou (pour du). Art. contract. pour de le. Cop-me dou paingne. - (10) |
| d'ou vin, loc. d'où vient ? - (08) |
| d'ou voint - d'ou vient, pourquoi. - A ne m'é pâ dit bonjour ; i ne sait pâ ai d'ou voint. - Demandez ll'i voué d'ou voint qu'al â ailai ai Quemanrain ? - (18) |
| dou, s. m. dos. - (08) |
| dou. art. - Du : « Dounne-moué dou froumage. » - (42) |
| douaigt (n.m.) : doigt - (50) |
| douaigté (du) : doigté - (57) |
| douaine, s. f. douzaine. - (08) |
| douair - d'vouair : devoir - (57) |
| douaire, don du mari à la femme pour le cas de veuvage. Dans l'idiome breton, douar signifie terre. - (02) |
| douais : n. m. Doigt. - (53) |
| douale : Douve de futaille. « Ce pansan a eune douale de casse » : ce tonneau a une douve qui est brisée. - (19) |
| douâlée, dôlée, s. f. ce qu'on tient dans ses doigts de « daignon » ou écorce de chanvre après le dépouillement des tiges. « Douâlée » = doigtée. (Voir : daignon.) - (08) |
| doualle, s.f. planche du fond d'un tonneau. - (38) |
| doualle. s. f. Douelle, douve, douvelle. - (10) |
| douayen (on) : doyen - (57) |
| douayenne (na) : doyenne - (57) |
| doub’ye (ain) : (un) double décalitre en bois pour mesurer le grain - (37) |
| doubié, outré, saoul - (36) |
| doubier, vt. doubler. - (17) |
| doubieûre (n.f.) : doublure - (50) |
| doub'ille (on) : double - (57) |
| doub'iller : doubler - (57) |
| doub'illure (na) : doublure - (57) |
| doubje, adj. double. - (17) |
| doublaine. s. f. Ligne de paisseaux réunis en tas après le dépaisselage. (Courgis). - (10) |
| doublas. s. m. Pâtisserie grossière. (Domecy-sur-le-Vault). - (10) |
| double : double décalitre. Superficie d'environ 10 ares semée avec un double décalitre de blé. A - B - (41) |
| double : double-décalitre (pour les grains) - (48) |
| double : s. f., gras-double. De la double. - (20) |
| double : s. m., deux parties simples d'un objet plié, ou chacun des objets similaires superposés en vue de donner à leur ensemble une résistance, une solidité plus grande. Un double de toile. Un double de ficelle. Un carton fait avec plusieurs doubles de papier. - (20) |
| double : s. m., double décalitre. Un double de pommes de terre. - (20) |
| double. Chapeau haut de forme. Double est la condensation des mots double-décalitre qui primitivement, désignaient cette coiffure à cause de sa ressemblance avec la boissellerie usitée pour mesurer les céréales. - (12) |
| doublée. s. f. Forte correction, correction double à fordinaire. Donner une doublée, Battre fortement. - (10) |
| doublette : s. f., groupe de deux joueurs associés. Voir quadrette. - (20) |
| doubleûre : doublure d’un habit. « Ô l’a caichit ses sous dans la doubleûre d’sa vaste ». - (62) |
| doub'lle : Double. Voir doub'lle, avoir la vue troublée par l'ivresse. « In doub 'lle », un double décalitre. - (19) |
| doub'llier : Doubler. « In mantiau bien doub 'llié ». - (19) |
| doub'llieure : Doublure. « Eune doub 'llieure de soie ». - (19) |
| doublue. n. f. - Doublure rectangulaire, en laine ou en coton, qui servait à envelopper le nourrisson. - (42) |
| doubye n.m. Double décalitre pour mesurer le blé. - (63) |
| doubyeûre n.f. Doublure. - (63) |
| douce (A la). Locut . adv. Bien, bellement, doucement. — Aller à la douce, jouir d’une bonne santé, se bien porter. - (10) |
| doucenöt, adj. douceâtre. - (17) |
| doucenot. adj. Douceâtre. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| doucette : mâche - (44) |
| doucette : mâche. - (66) |
| doucette, n.f. mâche (salade). - (65) |
| doucette, s. f. femme molle, indécise, paresseuse. - (08) |
| douceur, s. f. tiédeur, état de ce qui est un peu chaud : la « douceur » d'une chambre chauffée. - (08) |
| douchi : doucher - (57) |
| douci, v. a. adoucir, attiédir, rendre un peu chaud. Faire « douci » de l'eau, c'est la faire chauffer jusqu'au degré où elle n'est plus froide. - (08) |
| doucî, v. tr., adoucir, attiédir : « J'm'en vas fâre douci d'I'iau su l'feù. » - (14) |
| doucinâtre. adj. - Douceâtre. - (42) |
| doucinâtre. adj. Même signification que doucenot. - (10) |
| douço, douçôte. : Doux, douce. - Éne péà douçôtte, une peau douce ; du vin douçô. - (06) |
| douçô. Doux. Vin douçô, vin doux. Poulô douçô, un billet doux, un poulet. Douçô, quoique diminutif, se met là simplemeut pour doux. - (01) |
| douçot, adj., doux, doucet, agréable. - (14) |
| douçôte. Doucette. Le diminutif douçôte, dans l'endroit où il est employé, se prend simplement pour douce… - (01) |
| doudouille. Diminutif d'andouille mais seulement au figuré, comme nous l’employons, pour désigner un imbécile. - (12) |
| Doue (la) : Ruisseau qui se jette dans la Natouze, et qui nait d'une grosse source au pied d'une paroi calcaire. En Bourgogne on donne le nom de « douix » aux eaux souterraines qui ressortent en grosses sources, dans le fond des vallées, au pied des murailles calcaires. La douix la plus connue est celle de Châtillon-sur-Seine. - (19) |
| douè : doigt - (48) |
| doue : dos. J'ai ben mal au doue : j'ai bien mal au dos. - (33) |
| douë, ados au bord d'un fossé. - (05) |
| douegt. n. m. - Doigt. - (42) |
| douéle, s. f., douve de tonneau. - (14) |
| douelle (C.-d., Y., Morv.), douéle (Chal.). - Douve de tonneau, pour douvelle, petite douve. Littré le donne comme terme de construction, et venant du même mot douelle, qui, en patois berrichon (lequel a beaucoup d'analogies avec le bourguignon) signifie merrain, bois servant à faire les douves de tonneau. Le mot douelle vient lui-même du latin doela, dont la racine est dolium, tonneau. - (15) |
| douelle (pour douvelle). s. f. Douve de tonneau. Du latin dova. - (10) |
| douelle, s. f. douve de futaille. - (08) |
| douelle, s. f., douve d'un tonneau, ventre. - (40) |
| douelle. Douve d'une futaille, du latin dolium, tonneau. Même étymologie que le français doloire. - (13) |
| douèlot : doigtier - (48) |
| douelot : doigtier. - (33) |
| douère, devoir ; i n'ênme pâ douère, je n'aime pas devoir. - (16) |
| dougnot : douillet - (60) |
| douguer : heurter, cogner - (48) |
| douguin*, s. m. homme mou, lent au travail. - (22) |
| douiller. v. a. Choquer, toucher, frapper. Douiller une bille, la toucher, la frapper en jouant. (Bligny-en Othe). - (10) |
| douillot, adj., douillet, délicat. - (14) |
| douillot. s. et adj. m. Douillet. Fait douillotte au féminin. - (10) |
| douin (pour douvin). s. m. Voûte en bois, composée de planchettes, de douelles, comme on en voit dans beaucoup d’églises. - (10) |
| douix : source. - (66) |
| douix et doiz. Thibaut, comte de Champagne, a employé ce mot dans une de ses chansons : - Au renoulviau de la chaleur d'été - Que resclaircit li doiz à la fontaine. Douix parait venir du sanscrit dhü, agiter, mouvoir, ou de dhüni, rivière... A Beaune, le moulin le plus rapproché de la source de la Bouzaize s'appelait, au moyen-âge, le melin de la doiz : le mot Bouzaize fait supposer que cette doiz était consacrée à Esus ou à Isis. La jolie fontaine de l'Aigue paraît avoir été consacrée à Diane par les Gallo-romains... - (13) |
| doulant (adj.) : qui fait souffrir physiquement - (50) |
| doulé, ée. adj. Guenilleux, mal habillé, négligé, sale dans sa tenue et ses vêtements ; par assimilation avec les personnes qui se négligent, parce qu’elles sont dans la douleur et dans la peine, parce qu’elles sont à plaindre. Du latin dolere. - (10) |
| douleai, s. m. le dernier pain, plus petit que les autres, fait avec le reste de la pâte mise au four. - (08) |
| doulement, s. m. action de « douler » un toit, c’est à dire de le couvrir avec des planches ou de la volige sur lesquelles on pose la tuile ou l'ardoise. - (08) |
| douler (pour douloir) et ses diverses formes, telle que doule, doulant, doulera, doulerait. v. impers. Se dit en parlant de quelque élancement douloureux , d’une certaine continuité, qu’on éprouve dans une partie du corps, et qui est causé par une plaie ou par un mal interne. Ça me doule dans le côté. Hier, ça me doulait dans le dos. - (10) |
| douler (se), se plaindre - (36) |
| douler (se), v. réfl. s'affliger, gémir, se plaindre. - (08) |
| douler (v.t.) : faire mal, faire souffrir - se douler (v.pr.) : gémir, se plaindre (du lat . dolere = faire souffrir, a. fr., doler) - (50) |
| douler, v. a. doler, couvrir un toit de planches peu épaisses appelées « dôlement, doulement », sur lesquelles on pose ensuite la tuile ou l'ardoise. - (08) |
| douleu (na) : douleur - (57) |
| douleur : s. f., douleur rhumatismale. Je crois que c'est des douleurs ; dépuis quinze jours ça m’ tient dans le bas des reins. - (20) |
| douleureux ; douloureux (adjectif de douleur). - (16) |
| doulin. s. m. et adj. Douillet, qui se plaint pour la moindre chose. (Etais). - (10) |
| douller. v. - Faire mal, élancer : « Ca m'doulle dans l'douégt ! » (Sougères-en-Puisaye). Douloir ou daufer signifiait dès le Xe siècle souffrir, par déviation du latin dolere. On disait aussi se douler, pour se plaindre, s'affliger de douleur. Le nom français deul, puis deuil est de la même famille : chagrin très fort, puis douleur causée par la mort d'un être cher. - (42) |
| douloir (se) (dolere), se plaindre, se douler. - (04) |
| doumage, s. m., dommage, dégât. - (14) |
| doumaige, s. m. dommage, dégât, délit. « Doumaize. » - (08) |
| doumaigeaule, adj. soumis au dommage, sujet à être endommagé, à subir les dégâts, les accidents. - (08) |
| doumaiger, v. a. endommager, gâter, détruire, porter préjudice - (08) |
| doumèze : dommage. - (52) |
| dounaison. n. f. - Donation. - (42) |
| doune, s. f. don, cadeau, présent. Il m'a fait une « doune » de ces raisins. On dit que prendre et reprendre est la « doune » du diable. - (08) |
| doune. s. f. Secours, aumône, ce qui est donné régulièrement, périodiquement. La sainte doune. — Par extension, toute aumône en général. Il m’a fait une petite doune. (Joigny, Villeneuve-les-Genêts). - (10) |
| douner : donner. - (58) |
| douner, v. a. donner, faire présent de quelque chose. - (08) |
| douner, v. tr., donner, procurer. - (14) |
| douneu, euse. Celui qui donne. - (08) |
| dounne. n. f. - Aumône, don : « L 'poure gamin, j'lui fais une dounne pou ' la Nouël ! » - (42) |
| dounner (v.t.) : donner - (50) |
| dounner : donner - (61) |
| dounner : donner. - (52) |
| dounner. v. - Donner. - (42) |
| dou-quat : quelques - (43) |
| dou-quat’ : (adj inféfini pl) quelques - (35) |
| douriâme. s. m. et adject. ordin. Douzième. (Domecy-sur-le-Vault). - (10) |
| douru et doutu. adj. Qui a le dos rond, voûté, qui a le gros dos. (Ferreuse). - (10) |
| doûru, doûtu. adj. - Être voûté, faire le dos rond. (Perreuse, selon M. Jossier) - (42) |
| doûs (on) : dos - (57) |
| dous (oū), adj. numéral. Deux. Voir tros. - (17) |
| doûs. n. m. - Dos. - (42) |
| dous. s. m. Dos. J’ai ben mau dans le dous. (Passilly). — C’est l’orthographe du XVIe siècle. - (10) |
| doûs-d'âne (on) : dos-d'âne - (57) |
| doussier. s. m. Ciel-de-lit. (Annay-la-Côte). - (10) |
| doussnin, très doux. - (26) |
| doutance (n.f.) : doute, défiance - (50) |
| doutance : Soupçon. « An n 'est pas çartins ma an a bien des doutances » : on n'est pas sûrs mais on a beaucoup de soupçons. - (19) |
| doutance : doute. Ce que n'éto pas sur éto une doutance : ce qui n'était pas sur était un doute. - (33) |
| doutance : s. f., vx fr., doute, soupçon. - (20) |
| doutance, doute - (36) |
| doutance, doute. - (04) |
| doutance, s. f. doute, défiance, crainte, soupçon, supposition : « i é en mai doutance », je soupçonne que... - (08) |
| doutance, s. f., doute, soupçon, crainte, idée: « J'ai ben eùn p'chô doutance de c'qui. » - (14) |
| doutance. Doute. Dépeu (depuis) qu’an ai volé chez neus i ons de lai doutance su un de nos voisins, mas y n’osons ran dire... - (13) |
| doutance. n. f. - Doute, incertitude, soupçon. - (42) |
| doutance. s. f. Doute, soupçon, suppodition. J’ai doutance que les choses ont dû se passer ainsi. - (10) |
| doutances, s. f. pl. soupçons, doutes. - (22) |
| doutances, s. f. pl. soupçons, doutes. - (24) |
| doute : s. f., vx fr., inquiétude, crainte. Etre en doute, être dans une situation embarrassée au point de vue de l'argent ou des affaires, et donner des inquiétudes à ce sujet. - (20) |
| dôûtè : v. pr. S'enlever. - (53) |
| doûter – tchiter : quitter (déduire) - (57) |
| doûter : ôter - (57) |
| doûton. s. m. Bossu, qui tend le dos. — Fait, au féminin, doûtoune. - (10) |
| doûve (na) : talus - (57) |
| douve : s. f., talus, naturel ou artificiel, qui longe un chemin, une rivière, une terre, etc. Voir balme. - (20) |
| douve, s. f., haie vive, sorte de clôture très usitée, établie en forme de mur sur la terre extraite d'un fossé. On appelle aussi cette terre : la douve du fossé. - (14) |
| douve. Remblai d'un fossé. Autrefois ce mot signifiait le fossé lui-même. - (03) |
| douviai, dounnai (?) : donner. - (33) |
| doux (du), loc. Liqueur « de dame ». S'offre à l'arrivée d'une visite, et au dessert: « Eh ben! la Giraude, que qu'vôs v'lez ? Du doux, ben seùr ? - (14) |
| doux, adj. assoupli, dompté. On dit d'un homme humilié ou ruiné qu'il est bien « doux. » - (08) |
| doux-quate : deux-quatre - (51) |
| doux-quate, doux-quatre adj. indéf. Quelques. - (63) |
| doux-trois : deux-trois - (51) |
| douyo, douyote, douillet. - (16) |
| douzaîn-ne (na) : douzaine - (57) |
| douzil, fausset d'un tonneau , duzi. - (04) |
| d'ove - av' (av' li - av' you - av' mouai - av' ia) : avec - (57) |
| do'yin, doigtier. - (26) |
| doyot (adj.) : de consistance molle - (64) |
| dozain-ne : Douzaine. « Les ûs (les œufs) valant trente sous la dozain-ne ». Vieux français dozain. - (19) |
| dozaiñne n.f. Douzaine. - (63) |
| doze : Douze. « Les doze mois de l'an-née ». - (19) |
| dôze. Douze. - (01) |
| dôzéne. Douzaine, douzaines… - (01) |
| d'peu, depuis ; d'peu kan ? depuis quand ? - (16) |
| drâ : n. m. Drap. - (53) |
| drachi : Dresser. « Man père avait tojo des chins qu'étaint bien drachi ». - « Drachi la sope » tremper la soupe. - (19) |
| dradzée : dragée - (43) |
| dradzie n.f. Dragée. - (63) |
| draé, adj. droit ; on dit aussi dré ; r'draer, v. se redresser. - (38) |
| draer (se), v. se dresser. - (38) |
| dragan : Dragon, surnom d'un homme qui a fait son service dans un régiment de dragons. Au figuré : femme délurée et acariâtre. - (19) |
| dragées, s. f., grains de maïs, qu'on a fait éclater sur le feu dans une poêle percée, et dont les parties gonflées présentent une surface très blanche. La jeunesse les croque à belles dents. - (14) |
| dragie : dragée - (39) |
| drague : rateau large pour ramasser les épis cassés - (48) |
| draguer : courir au hasard. - (52) |
| draguer, v. n. sautiller comme certains oiseaux, comme la pie notamment, ou sauter à cloche-pied. - (08) |
| drai, sm. drap. - (17) |
| draigie : dragée - (48) |
| draigie : n. f. Dragée. - (53) |
| draijie, dragée ; quand il tombe du grésil, l'on dit qu'il tombe des draijie. - (16) |
| draî-lai : ici-même, en cet endroit-là - (37) |
| dràiller, v. intr., courir, se sauver vite : « Attends ! attends ! i'm'en vas t'envier dràiller ! » - (14) |
| draine, drainne. s. f. Espèce de grive. - (10) |
| draipaie : drapeau - (48) |
| draipeai, s. m. drapeau, linge dans lequel on enveloppe les enfants. - (08) |
| draipiâ : 1 n. m. Carré de Tissu servant à langer. - 2 n. m. Drapeau. - (53) |
| draipiau : couches de bébé - (39) |
| drait (adj.) : droit - féminin, draite = droite - (50) |
| drait : droit (pas courbe) - (57) |
| drait, dret, drat. adj. Droit. Tiens-te dret. — Au Dret. Locut. adv. En ce qui touche, en ce qui regarde. Chacun au - (10) |
| drait. Droit. - (49) |
| drait-chi -(adv.) : ici - (50) |
| draite (na) : droite - (57) |
| drait-lai (adv.) : là - (50) |
| draiver, v. n. déchirer, mettre en morceaux, en loques : « i seu tô draivé », je suis tout déchiré. - (08) |
| drâlè : se promener, courir vite - (46) |
| drâle ou la fouire : la courante. - (66) |
| drâlé : v. i. Errer, trainer dans la nature. - (53) |
| draler : aller vite. - (62) |
| drâler : errer, se promener - (48) |
| drâler : (drâ:lè - v. intr.) chercher aventure, tarder à rentrer à la maison. - (45) |
| drâler : avoir la colique - (39) |
| drâler, v., se promener sans but (péjoratif). - (40) |
| dralle, diarrhée. - (26) |
| draller, courir (souvent en mauvaise part). - (27) |
| drâlote : 1 adj. Machine qui bringuebale. - 2 n. f. Personne qui erre. - (53) |
| drâlou : n. f. Personne qui erre. - (53) |
| drambon : mot masculin désignant une courtilière, insecte ennemi des cultures - (46) |
| drapeau , lange. - (04) |
| drapeau : Nom masculin, lange. - (19) |
| drapeau, n.m. couche de bébé. - (65) |
| drapeau. Petit drap pour enfant. - (49) |
| drapeaux, s. m. pl., ensemble des couches d’enfants. - (40) |
| drapiau : (nm) couche, lange - (35) |
| drapiau : lange de bébé. C’est la déformation de « drapeau ». - (62) |
| drapiau : petit drap, lange de bébé - (34) |
| drapiau : petit drap, lange de bébé - (43) |
| drapiau n.m. Lange attaché par dessus la pointe, premier tissus directement en contact avec la peau du bébé. Voir pissou et pointe. - (63) |
| drapiau, s. m. drapeau, lange, drap. - (08) |
| drapiau, s. m., drap d'enfant, lange: « Ol é ben, l’petiot ; i'I'ai métu dans des drapiaux tout blancs. » - (14) |
| drâpiau. n. m. - Drapeau. Autre sens : lange de bébé. - (42) |
| drapiau. s. m. Couche, linge de toile dont on enveloppe un enfant au maillot. Dans l’Avallonnais, on dit draipail, drépias. - (10) |
| drapiô : petit drap, lange de bébé. A - B - (41) |
| drat : Droit, au féminin drate. « O se tin drat c'ment in ciarge ». Ironiquement : « Drat c 'ment man brai (comme mon bras) quand je me mouche ». Ancienne expression : « Drat c'ment le cordiau de Louis Mathieu ». Voir à cordiau. - (19) |
| draté : Droitier. « San frère est gauché ma liune est draté ». - (19) |
| drat-itié : Ici, juste droit. « Je l'ai mis drat 'itié ». - (19) |
| drat-vent, dret-vent. s. m. Vent du sud. (Mouffy, Soucy). - (10) |
| dravent : voir drévent - (23) |
| draver. v. - Déchirer. (Lainsecq, selon M. Jossier) - (42) |
| draver. v. a. Déchirer. (Sainpuits). - (10) |
| dré : droit - (51) |
| dré, adv., droit. - (40) |
| drechi v. a. tremper (se dit pour la soupe). - (24) |
| drecie. : (Dial.), voie, direction. – Dérivation du complément latin directionem. - (06) |
| dredilé : un peu plus loin - (43) |
| dredi-lé, dlé, dilé : là-bas - (43) |
| Drefy : Dulphey, hameau de Mancey. « Les gens de Drefy s'appalant des drefillans », « Le chétiau de Drefy ». - (19) |
| drégie : dragée - (61) |
| dreguet, droguet, étoffe de laine grossière. - (27) |
| drei lai lai loc. ici tout près ; à deux pas. - (08) |
| drei, dreitte, adj. droit, droite : « tô drei », tout droit ; « tô fin drei », absolument droit. - (08) |
| dré'ille : chiffon, loque, vêtements, vêtements usés - (48) |
| dreille : (dréy' - subst. f.) loques, mauvais vêtements. - (45) |
| dreille, s. f. drille, chiffon, loque, guenille. - (08) |
| dreillon : (drèyon - subst. m.) chiffon. - (45) |
| dreillon, s. m. grosse loque, grande guenille. - (08) |
| dreillou, ouse, adj. couvert de guenilles, en loques. - (08) |
| dreilloux, drilloux : en loques, en « drilles ›. - (32) |
| dreit d'bout. loc. adv. - Bien droit, bien campé sur ses jambes. «Là-d'sus, l'gars s'leuve, drêt d'bout et s'met à m'di'e ... » (Fernand Clas, p.18) - (42) |
| dré-là : ici - (51) |
| drélette : tissu ou vêtement très mince - (48) |
| drélô, nom d'homme, diminutif de andré. « Le drélô » et au féminin « la drélotte. » - (08) |
| dremedaire. Dromadaire, dromadaires, petits chameaux… - (01) |
| dremer, v., dormir. - (40) |
| dremi – dormir. - A dremant bein métenant, an parait. - I ai vu qué te dremas tote lai neu sans te révoillai. - En fau qui dreume in pecho aipré mon diniai. - (18) |
| dremi : dormir - (43) |
| dremi : dormir - (57) |
| dremi : Dormir « J'ai bien dremi » - « Dremi d'au mède » : faire un somme après le repas de midi, faire la sieste. - (19) |
| dremî : dormir. Et donc « endremî » pour endormir. - (62) |
| dremi : dormir. - (21) |
| dremi, dormir ; dremou, celui qui dort trop longtemps. A quelqu'un qui travaille nonchalamment, l'on dit : te dreme don ? - (16) |
| dremi, s. m., sommeil, - (40) |
| dremi, v. dormir. - (38) |
| dremi, v. intr., dormir, être inerte, engourdi. - (14) |
| dremille : s. f., dormilie ou loche franche (cobitis barbalula) ; gremilie ou perche goujdnnière (acerina cornua). Voir villette. - (20) |
| dremir (r ne se prononce pas). v. a. Dormir. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| dremir, dormir. - (05) |
| dremotter : somnoler. - (29) |
| dremou (on) : dormeur - (57) |
| dremou : Dormeur. « Y est bin temps de révailli les dremoux ». - (19) |
| dremoû, s. et adj., dormeur. - (14) |
| dremou, -se, dormeur, dormeuse. - (38) |
| drémoux. s. m. Dormeur. - (10) |
| drépiots : couches de bébé. - (66) |
| drère (dérère) : dernière - (51) |
| drés, prép. de temps, dès : « Drés que j'I'ai voyu, j'li ai dit la chouse. » - (14) |
| drêssé, drossé, préparer, servir, par exemple, la soupe. On dit aussi drossé lai tâbye, pour étendre la table (une table ployante), en la relevant. Les tables ployantes étaient, jadis, plus en usage que les tables fixes, parce qu'elles tenaient moins de place que celles-ci. - (16) |
| dresse-ereilles : très éveillé. O dresse l'éreille : il prête attention. - (33) |
| dresser (se), v. pron., se tenir debout : « Eh! la belote, dresse-te vouér eùn brin, qu'on ar'garde ta joulite mine. » - (14) |
| dresser, v. tr., servir, tremper. On entend fréquemment dire: « Dresser la sôpe. » - (14) |
| dressi v. Dresser. - (63) |
| dréssi, v. a. tremper (se dit pour la soupe). - (22) |
| dressoir. Buffet où est disposée la vaisselle dans les maisons de la campagne. Le meuble et le mot sont fort anciens. Nous le prononçons comme il était écrit au moyen-âge, dressouer. - (03) |
| dressouaîr (on) : dressoir - (57) |
| dressouère : vaissellier - (39) |
| dret (tout) : tout droit - (61) |
| dret : droit (drète au féminin) - è n’faut pas tornè, è faut èllè tout dret, il ne faut pas tourner, il faut aller tout droit - (46) |
| dret : droit (qui n'est pas courbe) mais aussi ensemble des règles régissant les relations entre individus. O fayot qu'un moinge s'es dret : il fallait qu'un manche soit droit. - (33) |
| dret de soi, chacun en ce qui le regarde. — Payer soun au dret, payer sa quote-part d’une consommation au café, au cabaret, payer son écot. (Lainsecq). — Du latin directus. - (10) |
| dret lai : juste là, là précisément - (39) |
| dret tchi : juste ici, ici précisément - (39) |
| dret : adv., droit, exactement. - (20) |
| drèt, adj. et adv., droit, justement: « Drèt-là ! v'tu v'ni ! » - (14) |
| dret, drette : droit. Tins-tè dret : tiens-toi droit. - (52) |
| dret, drette. adj. et n. - Droit. - (42) |
| dret, drot adj. Droit. - (63) |
| dret. n. m. - Vent du sud. - (42) |
| dret'conte : tout à côté, juste contre - (39) |
| dret-debout. adv. Droit sur ses pieds, tout debout. Tins-te là, dret-debout. - (10) |
| drète (pour droite). Féminin de dret. - (10) |
| drète : droite - (51) |
| drétue, dréture. s. f. Droiture. - (10) |
| dreu , bouillon blanc. - (05) |
| dreu : droit - (43) |
| dreù, ad]., dru, fort, touffu. - (14) |
| dreu, e, adj. dru. (Voir : dru.) - (08) |
| dreu. Nom patois du bouillon blanc, verbascum. On prétend que les animaux blessés connaissent cette plante qui étanche le sang. - (03) |
| dreûe : Nom patois du bouillon blanc. Sorte de jeu de bergers, voir treue. - (19) |
| dreugie (n.m.) : dragée (aussi draizie) - (50) |
| dreugie, s. f. dragée, bonbon. - (08) |
| dreugue : Drogue, mauvais breuvage. « Quelle dreugue y est-i que te nos a fait boire ? ». Sorte de jeu, voir treue. - (19) |
| dreuguet : étoffe grossière, mais très solide. (REP T IV) - D - (25) |
| dreuille : (nf) diarrhée - (35) |
| dreuiller, v. n. jouer, folâtrer avec entrain, avec vivacité. Se dit principalement des petits oiseaux qui sautillent autour de leur nid avant de s'envoler et aussi des enfants. - (08) |
| dreûlasse : Fille. « Dreûlasse » (pas plus que dreûle) n'a un sens injurieux. « Ol a ésu quat 'enfants, deux dreûles à peu deux dreûlasses » : il a eu quatre enfants, deux garçons et deux filles. - (19) |
| dreûle : Garçon, fils. « Dépeu quand est-ce que tan dreûle va à l'école », depuis quand ton fils va-t-il à l'école ? - Drôle, amusant, comique. « Je li ai dit qu’elle était brâve a peu le pu dreûle y est qu'alle y a crayu » : je lui ai dit qu'elle était belle et le plus drôle c'est qu'elle l'a cru. - (19) |
| dreûler : chauffer du fait du soleil, bronzer - (37) |
| dreuler, v. n. prendre des forces, de la vigueur, de l'énergie. - (08) |
| dreumai : dormir. J'ai ben dreumi c'te neu : j'ai bien dormi cette nuit. - (33) |
| dreume (n.f.) : sommeil - (50) |
| dreume, s. f. sommeil. La « dreume » guérit bien des maux. N’avoir pas de « dreume », avoir des insomnies. - (08) |
| dreumement : sommeil. - (32) |
| dreumer : dormir. - (32) |
| dreûmer, dreûmi : dormir (« ai dreûmer ! » : « il dort ! ») - (37) |
| dreumer. Dormir, par contraction et corruption. - (03) |
| dreumi (v.t.) : dormir - (50) |
| dreûmi : (vb) dormir - (35) |
| dreumi : dormir - (51) |
| dreumi : dormir - (48) |
| dreumi 1'méédio : Exp. Faire la sieste. - (53) |
| dreumi : dormir - (39) |
| dreumi : v. i. Dormir. - (53) |
| dreumi, deurmi v. Dormir. - (63) |
| dreumi, v. ; dormir. - (07) |
| dreumi, v. a. dormir. - (08) |
| dreumi, vn. dormir. - (17) |
| dreûmou : dormeur (exagérément) - (37) |
| dreumou, ouse, s. celui qui dort, qui aime à dormir; endormi, lâche, paresseux. - (08) |
| dreumou, sm. dormeur. - (17) |
| dreusadze : dressage - (51) |
| dreusson. Dressons. - (01) |
| dreût, dreute : (adj) droit (e) - (35) |
| dreute adj. Droite. - (63) |
| dreuze, s. f. vigueur, pour une plante. - (22) |
| dreûzi : (vb) (en parlant des vaches) se mettre à courir avant l’orage - (35) |
| dreuzi : vache courant dans les prés - (43) |
| drévare, vent d'ouest - (36) |
| drevent (nom masculin) : vent d'ouest. - (47) |
| drévent : vent d'ouest. III, p. 24-d - (23) |
| drévent, s. m. vent d'ouest. - (08) |
| drever : contrarier - (34) |
| drèver : déchirer - (48) |
| drèver : (drèvè - v. trans.) déchirer (une étoffe). La déchirure est supposée moins grande que dans fœrlas' - (45) |
| drevin-dreva : (exp) va-et-vient, aller-retour - (35) |
| drevin-dreva : va-et-vient, aller-retour quand on parle de labours - (43) |
| drevin-dreva loc. adv. (onom.). De-ci, de-là, en allant et en revenant, en avant et en arrière. - (63) |
| dri (déri) : dernier - (51) |
| dri (derri) : derrière - (51) |
| drigoler : boiter des deux jambes. - (30) |
| drigolin : celui qui marche en boitant des deux jambes. - (30) |
| driguer, dinguer. v. - Sautiller d'un pied sur l'autre en courant : « Qu'est-ce qu 'il fiche là ? Occupé à driguer en chassant du pied un caillou plat. » (Colette, Claudine à Paris, p.242) - (42) |
| driguer. v. n. Sautiller, en parlant des oiseaux ; sauter à cloche-pied, en parlant des enfants. (Chastenay, Etais, etc.). - (10) |
| drîlai : trembler, grelotter de froid. Quand o fait frè on drile : quand il fait froid on grelotte. - (33) |
| drilé (dilé) : derrière - (51) |
| drîler : 1. trembler, grelotter de froid ; 2. bruit d'une sonnerie électrique continue. - (52) |
| drîler : avoir froid - (39) |
| driler, v. a. déchirer la peau avec les ongles, les épines, les ronces, etc; déchirer en général. - (08) |
| driler. v. - Geler. (Saints, selon O. Levienaise-Brunel) - (42) |
| drileue, s. f. déchirure, écorchure. « Drileue» - (08) |
| drillai, fuir, vagabonder... - (02) |
| drillai. : Vagabonder. De drilles, chiffons, egt venue l'idée de drillou, ramasseur de gnenilles. De là à errer, vagabonder, il y avait des rapports. Drillai s'est aussi appliqué au vagabondage des gens de guerre. On a dit d'un soldat un bon ou un mauvais drille : - (06) |
| drille (f), torchon. - (26) |
| drille (n. f.) : diarrhée (avouèr la drille) - (64) |
| drille : diarrhée - (61) |
| drille : vieux chiffon. - (32) |
| drille et drillon. Chiffon d'étoffe. Al ai maingé jeuqu’ai son darnier sou : ses haibits sont teut en drilles.... - (13) |
| drille : 1 n. f. Etoffe de mauvaise qualité. - 2 n. f. Guenille. - (53) |
| drille : diarrhée, " chiasse " (suffisamment explicite pour que nous nous passions d'un exemple). - (58) |
| drille, n.f. chiffon. - (65) |
| drille, s. f. diarrhée, flux de sang. - (08) |
| drille, s. f., mauvais vêtement ou torchon. - (40) |
| drille. s. f. Diarrhée, foire. Synonyme de drouille. (Perreuse). - (10) |
| driller : déféquer (par ex en parlant des canes) - (61) |
| driller, v. intr., courir, vagabonder, jouer, folâtrer, et aussi : avoir la diarrhée. - (14) |
| driller, v. n. avoir la diarrhée, le flux de ventre. - (08) |
| driller. v. a. Déchirer. (Fléys). — De drille, lambeau, chiffon, guenille. - (10) |
| driller. v. n. Avoir la drille. - (10) |
| drilles : haillons. - (29) |
| drîlles : vêtements usagés - (37) |
| drillou (n. m.) : grappillon - (64) |
| drillou (os), os avec un peu de viande donnés aux enfants lors des noces. - (27) |
| drillou : quelqu'un vêtu de drilles, on utilise également le mot goniot - (46) |
| drillou : n. f. Personne mal habillé. - (53) |
| drillou(re) : personne frileuse - (39) |
| drillou, déchirés (en parlant de vêtements). - (28) |
| drîlloux : loqueteux - (37) |
| drilloux. drillier, marchand de drilles (Littré). Dans un autre sens, drilloux devient adjectif, et s'applique à ce qui est en loques, à ce qui a l’aspect d'une chose qui se défait, qui s'en va en morceaux. - (12) |
| drimer. v. n. Courir. Faire drimer, faire marcher vite, faire courir un peu forcément. (Percey). - (10) |
| drindelé, v. n. se dit d'un bruit clair produit par entrechoquement. - (22) |
| drindeler : sonner - (44) |
| drindeler, v. n. se dit d'un bruit clair produit par entrechoquement : les verres ont drindelé dans le placard. - (24) |
| dring'naler : faire un bruit de ferraille - (48) |
| dringnaler, v. frissonner. - (38) |
| dringu’nâler : tinter, résonner, émettre un son métallique - (37) |
| dringue, drouille : diarrhée - (48) |
| dringuenaler v. Bringuebaler, remuer en faisant du bruit. - (63) |
| dringuenaller : faire un bruit de ferraille. A - B - (41) |
| dringuenaller : faire un bruit de ferraille - (34) |
| drinle : drôle. (PLS. T II) - D - (25) |
| drinle, drôle. - (26) |
| drinne : diarrhée. (F. T IV) - Y - (25) |
| driol, but contre lequel on joue au palet. A Châtillon, les gamins ont dit triol, puis truol , et enfin truotte par corruption. - (02) |
| driol. : But contre lequel on joue au palet. - (06) |
| driou, celui qui porte des vêtements en lambeaux. - (16) |
| driquer, v., gicler très fort. - (40) |
| drœ itié, loc. ici tout près. - (22) |
| drœ itiœ, loc. ici tout près. - (24) |
| drœllye, s. f. diarrbée. Verbe drœllyi. - (24) |
| drœllye, s. f. diarrhée. Verbe : drœllyi. - (22) |
| droeublles, s. m. pl. épaisseurs de vêtements sur le corps : je n'ai pas froid, j'ai bien des droeublles. - (22) |
| drogne (na) - bieû (on) : hématome - (57) |
| droguasser : v. n., fréq. de « droguer », perdre son temps au lieu de travailler. - (20) |
| drogue, chose sans valeur (n'en dêplaiso aux marchands de drogues et aux pharmaciens !). - (16) |
| drogue, s. f., donné en épithète aux personnes de peu de valeur : « Oh! côge-te donc, ch'tit' drogue ! » - (14) |
| drogue. En Bourgogne on applique ce mot aux personnes, ce qui lui donne une analogie plus directe avec l'armoricain droug, qui signifie méchant, nuisible, malfaisant ; en Cornouailles drog, en Gallois drwg. (Price.) - (02) |
| droguer (se). Prendre des remèdes sans ordonnance et sans nécessité ; en abuser. - (49) |
| droguer : errer, vagabonder. - (30) |
| droguer. v. n. Se morfondre, attendre inutilement. Il m’a fait droguer pendant deux heures. - (10) |
| droila. Ici, près de là. - (03) |
| droïlle : Diarrhée. - (19) |
| dro'illi : Verbe, faire de la diarrhée. - (19) |
| droillon : fauvette. - (21) |
| droillou (du) : vin (nouveau) - (57) |
| droillou, adj. celui qui a le flux de ventre, la diarrhée. - (08) |
| droit, droit qui - juste, exactement. - I l'ons rencontrai droit qui. - Vô pouvez le mette droit qui, tenez. - (18) |
| droit. Adverbe auquel nous faisons signifier à côté, près de, joignant. - (12) |
| droit. En patois bourguignon, ce mot n'a pas la signification du latin directus. Quand on répond à un questionneur : voiqui le droit chemi pour ailler ai Biâne, cela ne veut pas dire que la roule à suivre est en ligne droite. Dans cette phrase : lé qu'ast don le p'tiot ? — Al ast droit qui ! ce droit ici est à quelques pas et n'indique nullement une direction droite. Droit, que l’on prononce souvent drait et que l'on écrit quelquefois drès, semble être une affirmation ayant le sens de vrai... - (13) |
| droits de mort : s. m. pl., droits de succession. - (20) |
| droiture. Droiture, devoir. - (01) |
| drôlai, petit drôle. - (02) |
| drôlai. Petit drôle. « Un de mé drôlai », un de mes petits drôles, de mes petits enfants. - (01) |
| drôlai. : Petit drôle, Drôlaisse (Lamonn. ), friponne, débauchée (du mot anglais droll). Les Bourguignons ont féminisé ce mot en l'empruntant. Il signifie, d'après la propre définition anglaise, a merry companion , c'est-à-dire un pur compagnon, un gaillard, un garçon éveillé. - (06) |
| drôlaisse. Drôlesse, drôlesses. Qui dit drôlesse, dit débauchée, et de plus friponne. - (01) |
| drôlasse, petite servante. - (05) |
| drôlasse, s. f. , fillette, jeune servante. - (14) |
| drolasse, s.f. drôlesse. - (38) |
| drolasse. Drôlesse. - (49) |
| drôle - outre les sens français on emploie ce mot pour dire domestique, jeune homme ou jeunesse en général. – I seu bein content de note nouveau drôle, à gairde bein les bétes. - Ce n'â pâ tojeur bein asille lès drôles. - Notons que drôlesse se prend plus souvent en mauvaise part. - Çâ ine drôlesse. - (18) |
| drôle : garçon ou fils. Drôlasse : fille. - (62) |
| drôle 1. adj. Bizarre. 2. n. Jeune (péj.). - (63) |
| dröle, adj. drôle. - (17) |
| drôle, drôlesse, nom que l'on donne communément au fils ou à la fille de la maison, au sortir de la première enfance. - (11) |
| drôle, enfant de la maison, petit domestique. - (05) |
| drôle, mauvais sujet. Dans l'idiome breton, diroll signifie hors la règle. (Le Gon.) ... - (02) |
| drôle, n.m. jeune homme. - (65) |
| drôle, s. m., gamin de 6 à 15 ans. - (40) |
| drôle. Drôle… - (01) |
| drole. Garçon. Drolasse, jeune fille. - (03) |
| drôle. s. m. et drôlesse. s. f. Termes d’amitié employés par certains parents pour désigner leurs enfants tant qu’ils sont jeunes. Mon drôle, ma drôlesse. — Se dit en mauvaise part, lorsqu’il s’agit de garçons et de filles d’un certain âge. - (10) |
| drôler, v. n. être dévoyé, avoir le flux de ventre ou simplement faire ses besoins. - (08) |
| drôlesse n.f. Femme de caractère, diablesse, fille légère. - (63) |
| drôlesse, n.f. jeune fille. - (65) |
| drôlesse, s. f., jeune fille célibataire. - (40) |
| drôlet, s. m., petit drôle, jeune domestique. - (14) |
| drôlet. Petit drôle, mais avec un sens bonhomme. Au figuré, chose un peu drôle, un peu piquante ou étonnante. - (12) |
| drôlin. s. m. Jeune garçon. - (10) |
| drolingne, droligne. s. m. et f. Petit drôle, petite drôlesse, et petit garçon, petite fille. Les gens qui veulent bien parler disent drôlin, drôline. (Savigny-en-Terre-Plaine). - (10) |
| dropè : aller vite - (46) |
| drossai - tous les sens français de dresser, mais particulièrement dans ces phrases pour préparer, servir. - Drossai lai tabe… - Drossai lai soupe… les gaudes. - Voiqui lai soupe drossée. - (18) |
| drossé : v. t. Dresser. - (53) |
| drosse-èreille : étourdi (inattentif), curieux - (48) |
| drosser - (39) |
| drosser : dresser (animal) - (48) |
| drosser : dresser, lever - (48) |
| drosser, v. a. dresser, relever, mettre debout, ranger en ordre, préparer. On « drosse « la soupe, lorsqu'on verse le bouillon sur le pain dans la soupière ou dans les écuelles. - (08) |
| drosser. v. a. Dresser. (Domecy-sur-le-Vault). - (10) |
| drossoire, meuble sur lequel on étale la vaisselle et dans lequel on tient fermés le pain et autres aliments. - (16) |
| drossois - sorte de buffet pour la vaisselle, les assiettes surtout, que l'on étale, que l'on dresse sur des rayons. - Vote drossouais à vraiment ben garni, mère Liaudon : ç'à joli. - Voilà ine soupiére flieurtée su vote drossouais, qu'ile â don jolie ! - (18) |
| drossoué (n.m.) : dressoir, buffet, vaissaillier - (50) |
| drossoué, s. m. dressoir, buffet qui se trouve dans la plupart des maisons aisées et sur lequel les ménagères étalent la faïence à fleurs, les grands plats, en un mot toute la plus belle vaisselle de l'endroit. - (08) |
| drossouère : vaisselier - (48) |
| drot, dret adj. Droit. - (63) |
| drot, ote, adj. droit, droite. - (17) |
| drot-dilé loc. adv. Droit devant, là-bas (on dit aussi en trandlé : plus loin). - (63) |
| drot-itié loc. adv. Droit devant, ici. Voir itié. - (63) |
| drot-là adv. Ici, là devant. - (63) |
| drouai : n. m. Droit. - (53) |
| drouait (on) : droit - (57) |
| drouait : le droit. Ensemble des règles régissant les rapports entre individus. - (33) |
| droubye : (nm) double - (35) |
| droub-ye : double - (43) |
| droubyes, s. m. pl. épaisseurs de vêtements sur le corps : je n’ai pas froid, car j’ai bien des droubyes. - (24) |
| droubyi : doubler (un vêtement) - (43) |
| droubyi, drobyi : (vb) doubler (un vêtement) - (35) |
| drouè : le droit. Ç'ot mon drouè ! - (52) |
| drouet : droit - (48) |
| drouèt' : n. f. Droite. - (53) |
| drouille : diarrhée - (48) |
| drouille : diarrhée. Drouillou : qui a la chiasse : chiassou, la fouire : fouirou… (et «… ouse » au féminin). - (62) |
| drouille : la diarrhée - (46) |
| drouille : mot féminin désignant un tissu qui ne se tient pas. On dit également trouille - (46) |
| drouille : tissu très léger, mauvais tissu - (48) |
| drouille : une épuisette - (46) |
| drouîlle d’aigaiç’e : rien du tout, quantité négligeable - (37) |
| drouille n.f. Diarrhée. Objet sans valeur, à jeter. - (63) |
| drouille : diarrhée - (39) |
| drouille : s. f., diarrhée. - (20) |
| drouille, drille. n. f. - Diarrhée. - (42) |
| drouîlle, fouîre : colique, diarrhée - (37) |
| drouille, n.f. diarrhée. - (38) |
| drouille, n.f. diarrhée. - (65) |
| droûille, s. f., diarrhée. - (40) |
| drouille, s. f., excréments liquides. - (14) |
| drouille. Diarrhée. Fig. « Avoir la drouille », c'est avoir peur. - (49) |
| drouille. s. f. Diarrhée, dévoiement, foire. - (10) |
| drouiller : s'échapper (liquide), fuir, avoir la diarrhée - (48) |
| drouiller et draller y avalent autrefois le sens de courir, se précipiter. Par extension et facétieusement ils signifient : avoir la diarrhée. On dit familièrement : j'ai la drouille.... - (13) |
| drouiller : avoir la diarrhée - (39) |
| drouiller : v. n., aller à la selle en drouille. - (20) |
| drouiller, driller. v. - Avoir la diarrhée. - (42) |
| drouiller, v. tr., avoir la diarrhée, rendre des excréments liquides. (V. Driller, et Drailler.) - (14) |
| drouiller. v. n. Avoir la drouille. - (10) |
| drouillou (oure) : se dit en parlant d'un animal qui a la diarrhée - (39) |
| drouillou : celui qui a la drouille (la chiasse) - (46) |
| drouillou : sans consistance - (48) |
| drouillou : 1 n. m. Lâche - 2 exp. Personne méprisante qui manifeste de la bassesse. - (53) |
| drouilloù, s. m., qui a le cours de ventre, et aussi petit drôle, jeune gamin. - (14) |
| drouilloux, drouillouse : adj., qui a la diarrhée, qui s'accompagne de diarrhée. Une femme drouillouse. Un pet drouilloux. - (20) |
| drouilloux, s. m., enfant qui a la colique. - (40) |
| droûle (on) : drôle - (57) |
| droûle : drôle - (57) |
| droule. adj. - Drôle. - (42) |
| droûl'ment : drôlement - (57) |
| droûl'rie (na) : drôlerie - (57) |
| drrr : fais marche arrière (ordre donné à un attelage). - (52) |
| dru - drute : vigoureux, de bonne pousse. Se dit à propos de jeunes plantes aussi bien que d’enfants. Ex : "L'pétit à la Lucie, il est ben dru !" - (58) |
| dru : Dru, vif, fort. « Je sais in nid de miarles les ptiets sarant bin acheteu drus » : je sais un nid de merles, les petits seront bientôt assez forts pour prendre la volée. Féminin : druge. - (19) |
| dru : en bonne santé - (44) |
| drû : en forme, en bonne santé, « entreprenant » - (37) |
| dru : robuste, dégourdi. - (52) |
| dru : vif - (60) |
| dru : vigoureux, énergique, actif - (48) |
| dru : vigoureux. Qualifie même une personne, et souvent un enfant. - (62) |
| dru : vivace - (61) |
| drû adj. Vigoureux, en bonne santé, plein de vie. - (63) |
| dru c'ment in goglu, vif, alerte (in goglu : pinson). - (38) |
| dru, adj., vif, entreprenant, solide. - (40) |
| dru, drue : (dru, dru: - adj.) plein d'énergie, de vitalité, débordant d'ardeur. Par ext., chaud lapin, coureur de jupons. - (45) |
| dru, drute (n. et adj.m. et f.) : fort (-e), vivace, en bonne santé - (50) |
| dru, e, adj. gaillard, robuste, ayant toute sa force. Se dit des personnes, mais surtout des oiseaux près de quitter le nid. - (08) |
| dru, épais. Il se prend aussi adverbialement : boire dru ; taper dru, c.-à-d. frapper fort. - (02) |
| dru. Assez fort pour quitter le nid en parlant des oiseaux. Fig. Vigoureux, solide. - (49) |
| dru. Solide, vigoureux, Ce mot, admis par l'Académie, est très usité en Bourgogne. M. d'Arbois de Jubainville pense qu'il a formé le mot druide. En Basse-Bretagne, comme chez nous, druz a le sens de gras. Il est employé comme adverbe : taper drû c'est se battre vaillamment. Dans cette acception, drû parait être l'anagramme de dur. Le sens le plus usité est celui de vigoureux, appliqué aux oiseaux nouvellement éclos... Dans Je Morvan, le maudru est le dernier poussin de la couvée celui que nous appelons le quelot. - (13) |
| dru. : Epais, serré, dense, vigoureux ; d'où nos villageois ont fait l'adjectif druesse. Ceux des bords de la Saône disent : L'herbe pousse avec druesse. - (06) |
| druble. s. m. Torrent. (Soucy). - (10) |
| drue. s. f. Sorte de jeu, consistant en une petite pièce de bois à trois pieds qui porte les enjeux et qu’on abat avec un palet. (Saint-Martin-sur-Ouanne). - (10) |
| druesse - vie, sève abondante dans les plantes épais, serré. - Pou ce temps qui tot â pliain de druesse, to pousse ai plâilli. - Les denrées que jaunissaint ces jors derrés, les voiqui qu'al airant beintot trop de druesse. - (18) |
| drugée. s. f. Matière blanche, écailleuse, qui reste dans le nid abandonné des petits oiseaux, et qui consiste sans doute en des particules de peau, d’épiderme provenant de la mue. (Percey). — Voyez drussin. - (10) |
| drugener. S'ébattre, courir, sauter de tous côtés comme affolé. Se dit au sujet du bétail. Fig. Se dit aussi des plantes qui émettent de nouvelles pousses, après coup. - (49) |
| drugeole. On dit qu'un oiseau est dru lorsqu'on peut l'enlever du nid et qu'il est assez fort pour être élevé. On appelle drugeôle les petites pellicules et les tiaux (tuyaux de plumes) qui couvrent le corps des oiseaux très-jeunes. - (03) |
| druger : grandir, devenir dru - (60) |
| druje s. f. vigueur, pour une plante : le fumier donne de la druje. - (24) |
| drujner v. (du gaul. drutos, fort). Courir affolé, s'enfuir. - (63) |
| drûler (v. int.) : être dru, en pleine santé (ça drûle (ça va)) - (64) |
| drûler : v. pr. S'exposer au soleil. - (53) |
| drûler, v., être plein d'ardeur. - (40) |
| drumelle. s. f. Terme de mépris. Synonyme de fumelle. - (10) |
| drûment : surtout, rapidement, bravement - (37) |
| drusse. adj. féminim de dru. Eh ben ! coument que va vout’ femme ? — A n’est toujou gué drusse. - (10) |
| drussin, drussot. s. m. Poussière qui reste dans un nid, quand les petits ont pris leur volée. Voyez drugée. - (10) |
| drussir. v. - Devenir dru. - (42) |
| drussir. v. n. Prendre de la force, devenir dru. Le v’ia qui drussit. Se dit particulièrement en parlant des petits oiseaux. - (10) |
| drut, te. adj. - Agile, vigoureux, fort : « L'Serge, il est ben dru pour soun âge. » Se dit-également pour parler d'une forte pluie : « C'matin ça tombé dru, coumme vache qui pisse ! » ... - (42) |
| d'sé (en), du côté gauche (?) - (38) |
| d'sô : adj. et n. m. Dessous. - (53) |
| d'so, dessous. - (16) |
| d'sortir, verbe intransitif : sortir de. - (54) |
| d'sos (on) : dessous - (57) |
| dsos : dessous - (51) |
| d'sos-d'brais (on) : dessous-de-bras - (57) |
| d'sos-d'plat (on) : dessous-de-plat - (57) |
| dssos prép., adv. et n. Dessous. - (63) |
| d'ssôs, dessous. - (38) |
| dssus prép., adv. et n. Dessus. - (63) |
| d'su : adj. et n. m. Dessus. - (53) |
| d'su, sur ; d'su lu, sur lui ; él é grôlé d'su zeû, il a grêlé sur eux, c'est-à-dire, sur leurs champs, sur leurs vignes. - (16) |
| d'sus - au d'sus : dessus - (57) |
| d'sus (on) : dessus - (57) |
| d'sus-d'yet (on) : dessus-de-lit - (57) |
| du : Deuil. « Alle s'est fait fare eune reube nare pa porter le du de san homme ». On dit aussi deuil. « Alle est en deuil ». - (19) |
| du : dur - (57) |
| du d'puis, prép., depuis, depuis lors. - (14) |
| du m’zer : de la nourriture - (37) |
| du rvin du rva (loc. adv.) : dans un mouvement de va-et-vient continuel (il arpente la maison du rvin du rva) - (64) |
| d'u vé que, conjonct. d'où vient que ? pourquoi ? - (17) |
| du vient (et) Pourquoi, d'où cela vient ? - (27) |
| du, adj. deux : « du beus, du leis », deux bœufs, deux lits. - (08) |
| du, dur ; on dit d'un pain desséché : el à du. - (16) |
| dûe, durot - convenir, être très utile. Ci nô due joliment bein, ailé, c'te jement qui ons aichetai ai lai fouaire de Ch'taisneu. - Voiqui qui vô duerot bein. - A sont gros geingnés, les Gossot ; si l'année â bonne ci liâ duré bein. - (18) |
| dueler. : (Dial.) , s'attrister (rac. lat. dolere). - (06) |
| duelle n.f. Douelle. Les duelles y'est p'les fillettes. - (63) |
| duelle : s. f., douelle, douve de tonneau. - (20) |
| dui. n. m. -Tige de seigle. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| duidet. s. m. Dévidoir. (Percey). - (10) |
| duire, v. n. convenir, être utile, profiter. - (08) |
| duire. v. - Diriger, commander. (Villiers-Saint-Benoît, selon M. Jossier) - (42) |
| duire. v. a. Maîtriser, mener, diriger en maître. Du latin ducere. (Viliers-Saint-Benoît). - (10) |
| duisaule, duïaule, adj. convenable, utile, qui vient à point, qui sied bien. - (08) |
| duquaule, pron. duquel. - (22) |
| duquaule, pron. duquel. - (24) |
| duque. Duc. On écrit en bourguignon duque, et régulièrement on devrait l'écrire de même en français , puisqu'on ne l'y prononce pas autrement… - (01) |
| duquée, duquainne ou de lai quée au féminin - duquel, de la quelle. - II suffit de voir les articles quée et quainne. - (18) |
| dur : adj. Temps dur, temps long, nostalgie. - (20) |
| dûr, adv., fort, beaucoup : « O mainge dûr, y é bé vrâ ; mâ ô pioche dûr itou. » - (14) |
| dûr, fortement ; traivoiyé dûr, travailler fortement. - (16) |
| duran. Durant. - (01) |
| Durand : nom propre. Le Père Durand, le soleil. Madame Durand, les w.-c. (peut-être parce qu'on y voit la lune) ! - (20) |
| durde, durte. adj. féminim de dur. La terre est bouguerment durte. - (10) |
| dure : s. f., temps long, nostalgie. Avoir la dure, trouver le temps long. - (20) |
| dure, nostalgie, regret du pays. - (05) |
| dure, v. n. convenir, être utile. On dit aussi « condure » pour conduire. - (08) |
| durer : être long, ne pas passer vite (on parle là de la durée en temps). Ex : "Déd'pis qu'moun' houme a parti, eh ! que l'temps m'dure !" - (58) |
| durer, v. patienter (il faut bien durer : il faut bien patienter). - (65) |
| durer, verbe intransitif : patienter. - (54) |
| duroillon, durillon. - (27) |
| dûs, s. m. pl. dettes : être dans les dûs jusqu'au cou. - (24) |
| dûs, s. m. pl. dettes : être dans les dûs. - (22) |
| dûsâbe – utile, qui est bien commode. Ine villerette, ine pince, c'â encore bein dusabe dans in mannége. - Totes ces petiotes aifâres qui sont bein sûr pu dûsâbes qu'en ne pense en bein des occasions. - Cequi m'â dûsabe. - (18) |
| dussiée, dossiée. n. f. - Dossière, partie du harnais d'un cheval qui servait à soutenir les limons. - (42) |
| dussiée. s. f. Dossière, partie du harnais d’un cheval de limon qui soutient la charge. (Bléneau). - (10) |
| duvànt (è) : pourquoi (mot à mot : Et d'où vient ?). (ALR. T II) - B - (25) |
| duvé, édredon. - (16) |
| duvée, pourquoi. - (26) |
| duvet (on) : édredon - (57) |
| duvient-durva, durvin-durva, dervi-durva, dervin-derva. exp. - Va-et-vient, aller-retour : « Y'a Gui-Gui dans les ances ! l' va dervin-derva avec son panier. Ben marche ! Il est encore en train d'ramasser nout mâche ! » - (42) |
| duvindon ? pourquoi ? - (38) |
| d'van hier, et d'van-z hier, adv., avant-hier. - (14) |
| d'vanci : devancer - (57) |
| dvanci v. Partir devant, précéder. - (63) |
| d'vant (on) : devant - (57) |
| dvant : devant - (51) |
| d'vant : devant - (57) |
| dvant prép., adv. et n. 1. Devant. 2. Avant. Dvant la neit. Avant la nuit. - (63) |
| dvant qu’ de : avant de - (51) |
| dvant qu’ neux sés prêts : avant que nous ne soyons prêts - (51) |
| d'vant que : avant que - (43) |
| d'vanté : tablier (de la ménagère) - (48) |
| d'vanté : n. m. Tablier de travail de la ménagère. - (53) |
| dvanté : s. m. tablier, devantier. - (21) |
| d'vanté, tablier de femme. - (16) |
| d'vanteil : un tablier - mets ton d'vanteil, vem qu'ri des treufes dans ljaidien, mets ton tablier, va me chercher des pommes de terre dans le jardin - èl é tout sali son d'vanteil, il a tout sali son tablier - (46) |
| d'vanti (on) : tablier - (57) |
| dvanti, dvantire n. (du v.fr. devantier) Tablier de fermière, doté d'une large poche ventrale et affecté à une multitude d'usages différents. - (63) |
| dvantier (n. m.) : tablier porté par les femmes - (64) |
| d'vantier (nom masculin) : tablier que les femmes portaient sur la blouse traditionnelle. - (47) |
| d'vantier : petit tablier (voir devantier). - (33) |
| d'vantin, s. m., tablier à tous usages. - (40) |
| d'vantire (na) : blouse - (57) |
| dvantire : (nf) tablier (mais avec une nuance plus élégante que le précédent) - (35) |
| dvantire n.f. Poitrine (péj.). - (63) |
| d'vanture (na) : devanture - (57) |
| d'vaut : prép., adj. et n. m. Devant. - (53) |
| dveni v. 1. Devenir Qui qu'ô dvint ? 2. Venir. D'quoî qu'ô dvint ? D'où vient-il ? - (63) |
| d'venir (en), loc, venir de : « As-tu été qu'ri do l'iâ ? — Voui, j’en d'veins. » - (14) |
| d'venir, verbe intransitif : venir. - (54) |
| d'vétsé : par-là, de ce côté - (43) |
| d'viner : deviner - (57) |
| d'viner : deviner d'voler descendre - (48) |
| d'vinette (na) : devinette - (57) |
| d'vinote, devinette. - (16) |
| d'vis (on) : devis - (57) |
| d'voir : v. t. Devoir. - (53) |
| d'volè : v. t. et v. i. Dévaler. - (53) |
| d'vôlée (à la), à la volée. - (38) |
| d'voler : descendre, dévaler. - (52) |
| d'voler, descendre, dévaler - (36) |
| d'vôler, v. descendre rapidement (un escalier). - (38) |
| d'vouaîr (on) : devoir - (57) |
| dybe, dybodô. : Onomatopée pour exprimer le carillon des cloches. - (06) |
| d'yeau (d'jeau) : de l'eau - (51) |
| dyor, dehors (prononcer en une seule syllabe). - (16) |
| dz’neû : (nm) genou - (35) |
| dz’velle : javelle non liée - (43) |
| dza (dédza) : déjà - (51) |
| dzâ : (nm) geai - (35) |
| dzâ : geai - (43) |
| dza : geai (oiseau) - (51) |
| dzà, djà,dédzà adv. Déjà. - (63) |
| dzâbye n.m. Rainure de douve de tonneau, jable. - (63) |
| dzacasse n.f. Autre nom de la pie. - (63) |
| dzacassi v. Jacasser. - (63) |
| dzacasson n.m. Bavard. - (63) |
| dzacques n.m. Geai. Son nom usuel est dzaya. - (63) |
| Dzacques, Dzacqlin, Dzacqline, Dzacquot, Dzacquotte n.p. Jacques et ses dérivés. - (63) |
| dzacquilli v. Remuer un petit objet avec fébrilité, le secouer : dzacquilli la pognée d'pôrte. - (63) |
| dzacquillon n.m. Gachette, détente, loquet qu'on actionne avec le doigt ou la main. - (63) |
| dzacquotte n.f. 1. Pie ; le nom le plus répandu est oyesse. 2. Femme bavarde. - (63) |
| dzafe : (adj) (fruit) aigre, acide - (35) |
| dzafe : acide - (51) |
| dzafe adj. (or. inc.). Âpre, acide. - (63) |
| dzaffre : fruit aigre, acide - (43) |
| dzago : maladroit. A - B - (41) |
| dzago, gautse, maladreu : maladroit - (43) |
| dzagot n.m. Maladroit. - (63) |
| dzagoter : bouger sans interruption. A - B - (41) |
| dzagoter v. Bricoler avec maladresse. - (63) |
| dzaillon n.m. Rejet d'un arbre ou d'un arbuste. - (63) |
| dzaillonni v. Rejeter de souche. On dit aussi rdzaillonni. - (63) |
| dzaillot n.m. (or. onom.). Chatouille. Faire le dzaillot : chatouiller. - (63) |
| dzal n.m. Gel. - (63) |
| dzale n.f. Jale, grande jatte, baquet de vendange. - (63) |
| dzaler (dzler) : geler - (51) |
| dzaler : (vb) geler - (35) |
| dzaler v. Geler. - (63) |
| dzalon n.m. Jalon. - (63) |
| dzalou : jaloux - (43) |
| dzalousie : jalousie - (43) |
| dzaloux n. et adj. Y'est dzaloux cment un piou ! - (63) |
| dzamais adv. Jamais. - (63) |
| dzambe n.f. Jambe. - (63) |
| dzambe. Jambe. - (49) |
| dzambion : jambon - (51) |
| dzambion n.m. Jambon. - (63) |
| dzambîre n.f. Jambière. - (63) |
| dzambolée : (nf) giboulée - (35) |
| dzambolée, dziboulée n.f. Giboulée. - (63) |
| dzame : résidu des grappes de raisin (syn. dzindre). A - B - (41) |
| dzandzé : effet d'agacement sur les dents dû aux fruits acides. A - B - (41) |
| dzanvi : (nm) janvier (le Père « Dzanvi » le Père Noël local) - (35) |
| dzanvi : janvier - (43) |
| dzanvî n.m. Janvier. - (63) |
| dzanvier : janvier - (51) |
| dzanzue n.f. (de l'anc.fr. jance, sauce épicée) Irritation des gencives et du palais par un aliment agressif. Dz'arréte de mandzi des plosses, y m'donne la dzanzue. J'arrêt de manger des prunelles, ça m'irrite le palais. - (63) |
| dzaper : japer - (51) |
| dzapia : personne qui parle sans arrêt ; chien qui aboie légèrement - (43) |
| dzappe n.f. Bavardage, clapet. Alle meune la dzappe : elle bavarde. Alle feurme sa dzappe : elle ferme son clapet. - (63) |
| dzapper du cul loc. Péter bruyamment. - (63) |
| dzapper la leune loc. Hurler à la mort. L'tsin dzappe la leune. Le chien hurle à la mort. - (63) |
| dzapper v. Japper, aboyer. - (63) |
| dzappeuille n.f. Bavarde. - (63) |
| dzappiâ n.m. Bavard. - (63) |
| dzapplli v. Jaspiner. - (63) |
| dzapy : personne qui parle sans arrêt, chien qui aboie légèrement. A - B - (41) |
| dzapy : personne qui parle sans arrêt ; chien qui aboie légèrement - (34) |
| dzaquette n.f. Jacquette, veste légère. - (63) |
| dzaquion : clenche de bois - (43) |
| dzaqu'yon : (nm) clenche de bois - (35) |
| dzar : jars. - (30) |
| dzardeni : jardiner - (51) |
| dzardeuillerie : mauvaise herbe, pesette. B - (41) |
| dzardeuillerie : mauvaise herbe, pesette - (34) |
| dzardeuillerie n.f. Vesce sauvage fine. - (63) |
| dzardin : jardin - (51) |
| dzardin n.m. Jardin. - (63) |
| dzardner v. Jardiner. - (63) |
| dzardnî n.m. Jardinier. - (63) |
| dzarle : baquet en bois (en B : bene). A - (41) |
| dzarle : gros baquet en bois sous le pressoir (approx. 300 litres) - (43) |
| dzarlot n.m. Benne de bois qui contenait 25 kg de raisin. - (63) |
| dzarlotî n.m. Porteur de raisins. Les vendangeurs vident leurs paniers dans le dzarlot. Le dzarlotî va vider son dzarlot dans une benne déjà sur le char ou portée à deux sur celui-ci quand il est trop éloigné des rangs de vigne. - (63) |
| dzarner : (vb) germer - (35) |
| dzarner v. Germer. - (63) |
| dzarnon : germe de pomme de terre. A - B - (41) |
| dzarnon : germe - (51) |
| dzarnon : germe de pomme de terre - (34) |
| dzarnon n.m. Germe (de pomme de terre). - (63) |
| dzarnon, dzèrnon : (nm) germe - (35) |
| dzarnoner : germer - (51) |
| dzarosse : sorte d'herbe. - (30) |
| dzarret n.m. Jarret. - (63) |
| dzarter : cingler - (51) |
| dzarter v. (de jarret, du gaul. gara, la jambe). Cingler avec une branche. - (63) |
| dzarteule n.f. Jarretelle. - (63) |
| dzartîre n.f. Jarretière. - (63) |
| dzaspiner v. Jaspiner. - (63) |
| dzassîre n.f. Jachère. Dans certains villages on appelle dzasse l'abri du gibier. - (63) |
| dzatte n.f. Jatte. - (63) |
| dzauna : jauni - (51) |
| dzaunailli : jaunir - (51) |
| dzaune : jaune - (43) |
| dzaune : jaune - (51) |
| dzaune adj. Jaune. - (63) |
| dzauneret : chardonneret - (34) |
| dzavelot : râteau de la javeleuse - (43) |
| dzäyâ n.m. Geai. - (63) |
| dzayan : geai. A - B - (41) |
| dzayan : geai - (34) |
| dzäyasse : (nf) pie - (35) |
| dzayo : chatouille. A - B - (41) |
| dzayo : chatouille - (34) |
| dze : je - (43) |
| dze : je - (51) |
| dze, dz' pron. Je. - (63) |
| Dzean, Dzâne, Dzânot, Dzânette n. Jean, Jeanne, Jeannot, Jeannette. - (63) |
| dzéçon : crochet de la vipère, langue fourchue. A - B - (41) |
| dzêçon : crochet de la vipère, langue fourchue - (34) |
| dzéçon : crochet de la vipère, langue fourchue - (43) |
| dzef : goût acide - (34) |
| dzèfe : goût acide. A - B - (41) |
| dzegni : toucher quelque chose. A - B - (41) |
| dzegni (dzeneuilli) : perchoir des poules - (51) |
| dzegni : toucher quelque chose - (34) |
| dzegogni, dzeguegni, dzagotter : bouger sans arrêt - (43) |
| dzeler : geler - (43) |
| dzencive n.f. Gencive. - (63) |
| dzendârme n.m. Gendarme. - (63) |
| dzendre : gendre - (51) |
| dzendre, dzendresse n. Gendre, belle-fille. - (63) |
| dzendresse : bru, belle-fille - (35) |
| dzendresse : brue, belle-fille - (43) |
| dzêne n.f. Gêne. - (63) |
| dzenét : genêt - (43) |
| dzeneuilli (dzegni) : perchoir des poules - (51) |
| dzenre n.m. Genre. - (63) |
| dzens : gens - (51) |
| dzentit, dzentite adj. Gentil, gentille. - (63) |
| dzerbe : gerbe de céréales - (43) |
| dzèrbe n.f. (anc. fr. jarbe du francique garba, la gerbe). Gerbe, c'est-à-dire réunion de plusieurs javelles (dzvelles). - (63) |
| dzèrbère : tas de gerbes empilées près de la ferme avant le battage; (en B dzarbire). A - (41) |
| dzerbi : tas de gerbes empilées au même endroit avant le battage - (43) |
| dzerbire : (nf) gerbier - (35) |
| dzerbire : gerbier, meule de gerbes - (43) |
| dzerbire : tas de gerbes empilées avant le battage - (34) |
| dzèrbîre n.f. Grosse meule de blé (gerbière) en attente de battage. Voir groue. - (63) |
| dzerdeni : jardinier - (43) |
| dzerde-yerie, poisio : vesce, légumineuse - (43) |
| dzerdin : jardin - (43) |
| dzermain, dzermaiñne adj. Germain, germaine. - (63) |
| dzermon, germon. Germe. - (49) |
| dzernon, pousson : germe - (43) |
| dzèrtire : jarretière - (43) |
| dzesson : (nm) dard - (35) |
| dzeter v. Essaimer, jeter. - (63) |
| dzeter, s’ter : essaimer - (43) |
| dzeu : joug. A - B - (41) |
| dzeu (dzo) : jour - (51) |
| dzeu : joug - (34) |
| dzeu : jour - (43) |
| dzeu, dessous. - (26) |
| dzeû, dzu : (nm) joug - (35) |
| dzeûdi : (nm) jeudi - (35) |
| dzeudi : jeudi - (43) |
| dzeudi : jeudi - (51) |
| dzeudi n.m. Jeudi. - (63) |
| dzeudi. Jeudi. - (49) |
| dzeûg n.m. Joug. - (63) |
| dzeûgni : (vb) joindre - (35) |
| dzeugni : joindre - (51) |
| dzeugni : joindre deux choses - (43) |
| dzeugni v. Joindre. - (63) |
| dzeuil : (nm) chatouille; (faire le « dzeuil ») - (35) |
| dzeuil : chatouille - (43) |
| dzeul : (nm) gel - (35) |
| dzeun’vri : (nm) genévrier - (35) |
| dzeûne : (adj) jeune - (35) |
| dzeune : jeune - (51) |
| dzeûne n. et adj. 1. Jeune. 2. Jeûne. - (63) |
| dzeûner : germer - (43) |
| dzeûner : jeûner - (43) |
| dzeunesse : jeunesse - (43) |
| dzeûnesse n.f. Génisse n'ayant pas encore eu de petit. - (63) |
| dzeuneux : genoux - (51) |
| dzeurdeuillerie : (nf) vesces, mauvaises herbes - (35) |
| dzeurement. Jurement. - (49) |
| dzeurer : jurer - (43) |
| dzeurer : jurer - (51) |
| dzeurer v. Jurer. - (63) |
| dzeurer. Jurer. - (49) |
| dzeûri: (vb) jurer ; dire des gros mots - (35) |
| dzeuron n.m. Juron. - (63) |
| dzeusqu'à tanque loc. Jusqu'à ce que. - (63) |
| dzeusque prép. et conj. Jusque. - (63) |
| dzeusson n.m. (de jeter) Dard de la guêpe ou de l'abeille, langue de la vipère. - (63) |
| dzeuste adv., adj. Juste. - (63) |
| dzeustice n.f. Justice. - (63) |
| dzeûtsi : (nm) perchoir (« jucher ») - (35) |
| dzeûtsi : perchoir - (43) |
| dzeûvou (ze) : (nm.f) personne entêtée, velléitaire - (35) |
| dzeûvru : (nm) givre - (35) |
| dzeûvruzi : (p.passé) givré - (35) |
| dzever : contrarier. A - B - (41) |
| dzever : contrarier - (43) |
| dzeveurné : genévrier. A - B - (41) |
| dzeveurnî n.m. Genévrier. - (63) |
| dzevleuse : javeleuse - (43) |
| dzevou : entêté, qui veut toujours avoir raison - (43) |
| dzevru : givre. A - B - (41) |
| dzevru : givre - (34) |
| dzevru : givre - (43) |
| dzevru n.m. Givre. - (63) |
| dzevruji v. Givrer. - (63) |
| dzevrusi : givré - (43) |
| dzi : (dzi - subst. f.) fausset, cheville de bois dont on bouche un trou pratiqué dans la bonde d'un tonneau pour fermer l’arrivée d’air. - (45) |
| dzi. Fausset, morceau de bois aiguisé avec lequel on bouche le trou fait par une vrille dans un tonneau. Etym. : onomatopée, à cause du bruit fait par le liquide qui s'échappe. On trouve dans Rabelais, douzil, avec la même signification. - (12) |
| dzibcîre n.f. Gibecière. - (63) |
| dzibe (tourné à la) : endroit exposé à l'ouest et à la pluie - (43) |
| dzibée : (tourné à la..) lieu orienté au vent et à la pluie. A - B - (41) |
| dziber : grelotter. A - B - (41) |
| dziber : frissonner - (51) |
| dziber : grelotter - (34) |
| dziblotte n.f. Gibelotte. - (63) |
| dzibolée, dziboulée : giboulée, petite averse - (43) |
| dziboulée, dzambolée n.f. Giboulée. - (63) |
| Dzibyes Gibles - (63) |
| dzichette n.f. (p.ê. de giclette) Seringue. - (63) |
| dzicler v. Gicler. - (63) |
| dzifle n.f. Gifle. Voir yape. - (63) |
| dzifler v. Gifler. Voir yaper. - (63) |
| dzigognade : petite averse - giboulée. A - B - (41) |
| dzigognade : petite averse, giboulée - (34) |
| dzigogni : bouger sans arrêt. A - B - (41) |
| dzigogni : bouger sans arrêt - (34) |
| dzigolette n.f. Gigolette, fille délurée. - (63) |
| dzigoter v. Gigoter. - (63) |
| dzigue (grande) n.f. Personne très mince dotée de longs membres. - (63) |
| dzigue n.f. Jambe. - (63) |
| dziguegni : gigoter - (51) |
| dziguegniole : manivelle. A - B - (41) |
| dziguegnoure : objet qui présente une ou des parties en mouvement rotatif, connotation plutôt péjorative - (51) |
| dzilet : gilet - (43) |
| dzilet n.m. Gilet. - (63) |
| dzin : (nm) juin (« l’ma d’dzin ») - (35) |
| dzin n.m. (de dzabye). Rabot à rainurer. - (63) |
| dzindre : résidu de grappe de raisin après pressurage (syn. dzame). A - B - (41) |
| dzin-dre : marc de raisin - (43) |
| dzîndre n.f. (anc. fr. gein, marc de raisin). Résidu de pressage du raisin. - (63) |
| dzinguer : ruer - (43) |
| dzinguer v. (de gigue) 1. Donner des coups de pied, ruer (vache). 2. Sauter et danser. Les dzeûnes ant dzingué tote la neit. Les jeunes ont sauté et dansé toute la nuit. - (63) |
| dziñne, dzeine : (nf) marc de raisin - (35) |
| dzin-ner : gêner - (43) |
| dzinti : gentil - (43) |
| dziper : faire ricochet, gicler, éclabousser (syn. rdziper*). A - B - (41) |
| dz'irai : j'irai - (43) |
| dziroflée n.f. Giroflée. - (63) |
| dziron n.m. Giron. - (63) |
| dzirouette n.f. Girouette. - (63) |
| dzize : aiguillon des laboureurs. - (30) |
| dzler (dzaler) : geler - (51) |
| dzment : jument - (51) |
| dzment n.f. Jument. - (63) |
| dz'net : (nm) genet - (35) |
| dzneu n.m. Genou. - (63) |
| dzneuillon (à) loc. (du vx.fr. genoillon, genoux) A genoux. - (63) |
| dznivre, dznavre : genévrier - (43) |
| dzô : en dzô = position d'une volaille perchée. A - B - (41) |
| dzo (dzeu) : jour - (51) |
| dzo : (nm) jour - (35) |
| d'zo : coq, d'où d'zonie ou d’zounie : poulailler qui se dit aussi d’zelinie : (cf. genelière). (C. T IV) - S&L - (25) |
| dzo : coq. - (30) |
| dzo n.m. Jour. - (63) |
| dzo. Jour. - (49) |
| dzogu’né : imbécile, bête - (51) |
| dzointer v. Jointer. - (63) |
| dzoli (brave) : joli - (51) |
| dzoli, -ite adj. Joli. Attention, par antiphrase : Ô fayot-ti dzoli ! signifie il faisait vilain, il rouspétait. - (63) |
| dzonc : jonc - (51) |
| dzonc n.m. Jonc. - (63) |
| dzôné : perchoir à volaille; (en B : dzouni). A - (41) |
| dzôneret : chardonneret. A - B - (41) |
| dzord’eu (au) : (adv) aujourd’hui - (35) |
| Dzordzes, Dzordzette n. Georges, Georgette. - (63) |
| dzornal : journal - (51) |
| dzornaleux n.m. 1. Journalier, tâcheron employé à la journée. 2. Journaliste (péj.). - (63) |
| dzornali : (nm) journalier - (35) |
| dzornalisse n. Journaliste. - (63) |
| dzornau n.m. Journal. - (63) |
| dzornée n.f. Journée. - (63) |
| d'zou : dessous - (46) |
| dzouer, dzeuiller : jouer - (43) |
| dzoug : joug - (43) |
| dzoûli n.m. Juchoir, perchoir. - (63) |
| dzouni : perchoir à volailles - (34) |
| dzournali : employé journalier pour les travaux des champs - (43) |
| dzournau : (nm) journal - (35) |
| dzournée : journée - (43) |
| dzouter : (vb) mater (une bête) - (35) |
| dzouter : mater une bête - (43) |
| dzouter v. (p.ê. de joute) Achever, épuiser. - (63) |
| Dzouzet d'la brîre n.m. Simplet, demeuré, stupide. Sans doute une référence à un Joseph, oublié aujourd'hui, habitant jadis dans le lieu-dit "la bruyère". L'expression est toujours vivace. - (63) |
| Dzouzet, Dzouzéphine n. Joseph, Joséphine. - (63) |
| Dzozé : NP Josèphe - (35) |
| dzteux d'sôrt, dzteux d'mauwaise fortune n.m. Jeteur de sort. - (63) |
| dzu : jeu - (43) |
| dzu : jeu - (51) |
| dzu n.m. Jeu. - (63) |
| dzuer : (vb) jouer - (35) |
| dzuer du poivre : (exp) partir sans prévenir - (35) |
| dzuer v. 1. Jouer. 2. Fonctionner. Fais don dzuer l'poste (de T.S.F.) - (63) |
| dzug : joug - (51) |
| dzuillet : juillet - (51) |
| dzuin : charrue en bois à deux versoirs. A - B - (41) |
| dzuin : charrue en bois à deux versoirs - (34) |
| Dzules, Dzulie, Dzulien, Dzulienne, Dzuliette n. Jules, Julie, Julien, Julienne, Juliette. - (63) |
| dzument. Jument. - (49) |
| dzûs n.m. Jus de fruit. - (63) |
| dzusque (tant qu'à) : jusque - (51) |
| dzuste : juste - (43) |
| dzustement : justement - (43) |
| dzüyé : (nm) juillet - (35) |
| dzvallon : javelle liée - (43) |
| dz'velle : (nf) javelle - (35) |
| dzvelle n.f. Javelle, gerbe. - (63) |
| dzvelleuse n.f. Javeleuse, gerbeuse. - (63) |
| dzvellon n.m. Javelle, petite gerbe. - (63) |
| dzver v. (de dzuer).Taquiner, contrarier. - (63) |
| dzveux adj. et n. Taquin, énervant, agaçant. - (63) |
| è : aux - (46) |
| è c' teu', à c'teur. loc. adv. - Maintenant, à cette heure : « C 'te poure vigne v'la qu'alle a à c 'teur des maladies qu 'on counnait pas. » (Fernand Clas, p.88) - (42) |
| è cavai : à cheval sur un objet - (46) |
| è coutène : à côté - (46) |
| é gné, il y a et il n'y a pas ; é gné lontan, il y a longtemps ; é gné pâ lontan, il n'y a pas longtemps. - (16) |
| e l'èssoute ; à l'abri. - (26) |
| e muet, glissé en parasite dans les conditionn. prés. : « Je prenderions, je suiverions, » etc. - (14) |
| è peu : et puis - (46) |
| é peu : adv. Et puis. - (53) |
| ê : (ê: subst. f.) eau - (45) |
| é, 2e personne de l'auxil. avoir : « Vous é bé boune mine, auj'deù, la vouésine. » - (14) |
| é, 3e personne de l'auxil. être : « Y é bon ». - (14) |
| e, ee, ou es, etc. - divers temps du verbe avoir, et quelquefois même du verbe être. - Al é bein de l'aitaichement pou ses pairents. - Al é venu hier. - Vos ai mau ai lai tête. - Voyez d'ailleurs es ; et beaucoup de mots commençant par ai, tels que Aibimai, Ainne, Aidie, Aicueillai, Aito etc., etc. - Cela vient du Bourguignon qui emploie souvent E pour ai. - (18) |
| è, ène, art. ind. un, une. - (17) |
| é, éz : art. masc. Au, aux. - (53) |
| é, il, au singulier et au pluriel ; é di, il dit ; é disait, ils disent. - (16) |
| ë, aux ; ë veigne, aux vignes. On dit ëz, par euphonie, devant une voyelle ; ëz un, ëz ôtre, aux uns, aux autres. - (16) |
| e. adj. indéfini. Se dit pour un, dans beaucoup de localités. E poué, é bâton, un puits, un bâton. (Sacy et lieux circon-voisins). - (10) |
| è. Pour à. « È demi » pour à demi ; « è lè pôrte » pour à la porte. - (49) |
| é. Quelquefois c'est as, habes : « Tu é bon tam », tu as bon temps. Quelquefois c'est a, habet : « El é bon tam », il a bon temps. Quelquefois c'est avez, hahetis : « Vos é bon tam », vous ayez; bon temps. Quelquefois E appartient au verbe être, comme quand on dit ; « Tu é un béa garçon », tu es un beau garçon. Quelquefois enfin c’est l'article aux du datif pluriel, auquel sens E ne se met que devant une consonne : « Je m'en répote é médecin », je m'en rapporte aux médecins. Devant une voyelle il faut és : « Je m'en répote és aivôcar », je m'en rapporte aux avocats. - (01) |
| e. : é fermé et er dans les substantifs et dans les désinences de la plupart des verbes de la 1re conjugaison se changent en la diphthongue ai. Ex. : nativitai pour nativité ; pôvretai pour pauvreté ; viôlaite pour violette. (Lamonn.) L'e ouvert (è) a conservé la vieille prononciation bourguignonne en ei, comme peire, meire, mysteire, ligeire (légère), etc., constamment orthographiés ainsi dans Lamonnoye. - (06) |
| è[y]and : gland. - (52) |
| ea ou eaa. Eau, qu'on écrivait autrefois eauë. - (01) |
| eai, s. f. eau : « lai boune eai ; lai ch'tite eai ; ailé q'ri d' l'eai. » - (08) |
| eau galleuse. s. f. Purin, eau noire qui découle des fumiers. (Maillot). - (10) |
| eau : s. f., eaux chaudes, pituite des alcooliques. Petite eau, syn. de blanquette. - (20) |
| eaubenité, s. m., bénitier. - (40) |
| eaubue. n. f. - Bonne terre, dense, difficile à travailler dans les périodes de sécheresse. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| eaubue. s. f. Terre forte et glaiseuse. C’est à tort que certaines personnes écrivent ce mot, obue et aubue. - (10) |
| eauche, maladroit qui échappe souvent ce qu'il a dans la main. - (16) |
| eau-m’nite. s. f. Eau-bénite. (Athie). - (10) |
| eaux-goût (nom masculin) : aromates destinés à donner du goût à un bouillon. - (47) |
| ébâchè : en parlant d'un vêtement devenu trop grand, trop ample - (46) |
| ébacher, distendre. - (26) |
| ébaffiner : voir baffiner. - (20) |
| ébafointé : (ébafouin:tè, -é: - adj.) coi. É:t' ébafouin:tè, c'est "rester muet", soit parce qu'on ne vous laisse pas la parole, soit parce qu'on n'ose pas la prendre. - (45) |
| ébaheuiller. v. a . Ebahir. (Domecy-sur-Cure). - (10) |
| ebai. Ebat, ébats. - (01) |
| ébalancer (S’). v. pron. Prendre son élan pour sauter. (Guy). - (10) |
| ébal'ches (les) : grange à foin au-dessus de l’aire. (CST. T II) - D - (25) |
| ébalourdi. adj. A demi assommé, à demi privé de sentiment. (Mailty-la-Ville). - (10) |
| ébanai, ouvrir... - (02) |
| ébandoner, v. tr., abandonner. - (14) |
| ébandouner. v. a. Abandonner. - (10) |
| ébâné : grand ouvert - (46) |
| èbané, vt. éborgner. - (17) |
| ébané. : Ouvert Porte ébanée, porte entièrement ouverte. (Del.) - Ebanoi, en dialecte d'oïl, signifie joie ouverte, et s' esbanoïer veut dire se dilater le coeur. (Lac.) – C’est le sens moral au figuré ; mais pour en revenir au sens propre, Lamonnoye dit que si le couvercle d'une banne (voir ce mot) était levé, on la disait ébanée, c'est-à-dire tout ouverte. - (06) |
| ebanée. Entièrement ouverte. Pote ébanée, porte ouverte autant qu'elle peut l'être… - (01) |
| èbanoïé, vr. se réjouir. - (17) |
| ébarbluté : ébloui. Y seus ébarbluté : je suis ébloui. Le soulai m'ébarblute : le soleil m'éblouit. - (33) |
| ébarbucher, v. a. ébarber, émonder, rogner. - (08) |
| ébarchi : Ebrécher. « J’ai ébarchi man cutiau ». - (19) |
| ébarlouté : ébloui. - (52) |
| ébarluté : éberlué, étourdi, atteint de vertiges. - (56) |
| ébarluté : ébloui. - (29) |
| ébarlûté : v. t. Éblouir par une lumière. - (53) |
| ébarluter : Eblouir. « Le sola m’ébarlute les yeux ». « Quand j'ai bu in varre de vin blian de treu je sus tot ébarluté » : j'ai la vue trouble. - (19) |
| ébarluter : (ébêrlu:tè - v. trans.) éblouir. Par ext. é:t' ébêrlu:tè, "avoir des vertiges". - (45) |
| ébarlûter : éblouir - (39) |
| ébarné, adj. débraillé, déboutonné. - (22) |
| ébas, adj. ébahi. - (38) |
| ébasser. v. a. Attacher les coursons de la vigne aux échalas. (Montillot). - (10) |
| ébâteloux. s. m. Flâneur, qui aime à s’ébattre, qui en prend à son aise. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| ébatiller. v. a. Abattre, faire tomber. (Sénonais). - (10) |
| ébatre, v. tr., abattre : « ôl a ébatu l'oïau. » - (14) |
| ébattre, v. a. laver sommairement le linge avant la lessive, le battre au battoir. - (22) |
| ébattre, v. a. laver sommairement le linge avant la lessive, le battre au battoir. - (24) |
| ébaubi - surpris, étonné (agréablement). - En feillo les voué ! al étaint tot ébaubi en entendant jue si bein du viôlon. - Al ant revenu de Beaune tot ébaubi de ce qu'al aivaint vu. - (18) |
| ébaubi : ébahi - (48) |
| ébaubi, ébahi, est fort en usage dans les environs de Beaune... - (13) |
| ébaubi, ébahi. - (04) |
| ébaubi, étonné... - (02) |
| ébaubi, ie. adj. et part. prés. d’ébaubir. Etonné, surpris. - (10) |
| ebaubi. Ébahi. - (01) |
| ébaubi. : Corruption du français ébahi. Les villageois dissent aussi éboüi. (Del.) - (06) |
| ébauche d'lé : le plafond au-dessus de l'aire à battre - (46) |
| ébauches : le grenier au-dessus de la grange - (46) |
| ébaûchi : ébaucher - (57) |
| ébauchi : Ebaucher. « As-tu fini tan ovrage ? Non ma je l'ai bien ébauchi ». - (19) |
| ébaudi (s') (v.pr.) : s'éclaircir, s'égayer - (50) |
| ebaudi (s'), v. réfl. s'éclaircir, s'égayer, se ranimer : le temps « s'ébaudit. » - (08) |
| ébaudir (verbe) : (S') s'améliorer, en parlant du temps. - (47) |
| ébaumi - en fleurs, épanoui. - Le rosé rouge du jairdin à ébaumi de lai neu ; qu'al â joli ai voué ! Les haies vives sont tote ébaumies ; ci sent bon… ! bon… ! - (18) |
| ébaumi (bois), bois qui commence à se couvrir de feuilles au printemps. - (27) |
| ébaumi (s’) (v.t., v.pr.) : épanouir ou s'épanouir (développement de la végétation) - (50) |
| ébaumi, v. n. épanouir. Se dit de la végétation lorsqu'elle se développe au printemps. - (08) |
| ébaumie, adj. employé au féminin pour parler d'une fleur bien éclose ou d'une jeune fille arrivée à l'adolescence. - (07) |
| ébaupin (n.m.) : aubépinier (aussi beuchon bianc) - (50) |
| ébaupin : aubépine - (48) |
| ébaupin : (ébô:pin - subst. m.) aubépin. - (45) |
| ébaupin, s. m. aubépin. En plusieurs lieux « ébaubin. » - (08) |
| ébaupin, s. m., aubépine. - (40) |
| ébauressé : ébouriffé. - (30) |
| ébayer. v. n. Aboyer. (Hugny). - (10) |
| ébazinure : endroit où deux pains se sont touchés au cours de la cuisson. (BEP. T II) - D - (25) |
| ébazoi ou ébasoi. Etre és ébasoi, être aux abois, c'est être réduit à une fâcheuse extrémité. - (02) |
| ébazoi. : Ètre és ébazoi, être aux abois ou réduit à une triste extrémité. - (06) |
| ébbucher (pour ébécher). v. a. Faire manger un petit enfant, un vieillard, une personne impotente. (Percey). - (10) |
| ébécile (n.m. et f.) : imbécile - (50) |
| ébécille : imbécile - (48) |
| ébécille, adj. ; imbécile. - (07) |
| ébécille, ll mouil. adj et subst. imbécile « léche-lu, ç'ô eun ébécille », laisse-le, c'est un imbécile. - (08) |
| ébelansai. : Balancer, mouvoir de çà de là. (Del.) - (06) |
| ébelansay (s'), se balancer, se mouvoir de çà, de là. - (02) |
| ébèn, eh bien. - (16) |
| éberché. Ébréché, édenté. - (49) |
| éberdi, ébeurdi. adj. et s. Frappé d’étonnement, stupéfié, étourdi. - (10) |
| éberdie, ébeurdie. s. f. Etonnement, stupéfaction, étourdissement. - (10) |
| éberdiller (S’). Se troubler, être stupéfié. - (10) |
| éberdiné. Hébété. On dit aussi : « ébeurdiné ». - (49) |
| éberlouir. v. a. Eblouir. - (10) |
| éberlué (Y.), éberluté (C.-d.), éberluté, ébeurluté (C.-d., Y., Br., Chal., Morv.), ébeurluqué (Char.). - Ebaubi, ébloui, comme quelqu'un qui a la berlue. La berlue est un éblouissement passager, un malaise momentané des yeux, consistant à faire voir des choses qui n'existent pas. Eberlué vient du verbe esberluer, lequel avait, en vieux français, la même signification, et venait lui-même de berlue… - (15) |
| éberluer, éberluter. v. a. Eblouir. Jaubert donne eberluter. - (10) |
| éberlûtè : étonné, surpris, ébaubi - (48) |
| éberluté, éberluqué. Ébloui par une vive lumière. - (49) |
| ébérluter (ébr'luter) : v. a., éberluer, étourdir, troubler, faire perdre la tête. Voir berlu. - (20) |
| éberlûter : étonner, surprendre, éblouir - (48) |
| éberluter, ébeurluter, verbe transitif : éblouir. - (54) |
| éberluter, éblouir, avoir la berlue. - (05) |
| eberluter. Donner la berlue, ébloui momentanément. - (03) |
| éberluter. Eblouir. Etym. éblouir. - (12) |
| éberluter. Eblouir. Les élèdes l'ont tôt éberluté. (V. Elède.) Avoir la berlue, c'est cligner les yeux, ne voir presque pas clair... - (13) |
| ébernouaiché : adj. Légèrement gris, étourdi par un choc. - (53) |
| ebeud'lé : adj. Rendu inconscient par un coup, par de l'alcool. - (53) |
| èbeudöié, vt. étonner, surprendre. - (17) |
| ébeuffer. v. a. Epouvanter. (Savigny-en-Terre-Plaine). - (10) |
| ébeuillanté : ébouillanté - (43) |
| ébeuillanti v. Ebouillanter. - (63) |
| ébeuillé : éventré - (44) |
| ébeuillé : v. t. Ébouler. - (53) |
| ébeuiller : v. a., ébouler. Voir débeuiller. - (20) |
| ébeuiller, verbe transitif : au sens propre ouvrir le ventre. - (54) |
| ébeuiller. Étriper. Fig. Ébouler. - (49) |
| ebeuilli : éventré - écrasé. A - B - (41) |
| ébeuillî : démolir, écrouler. - (62) |
| ébeuilli : Ebouler, écrouler. « Ma maijan risque bin d'ébeuilli ». - (19) |
| ebeuilli : éclater le ventre - (51) |
| ebeuilli : éventré, écrasé - (34) |
| ébeuilli v. (de l'a.f. esboeler, faire sortir la boele, les boyaux) 1. Eventrer. (voir beuille) 2. Vider (un poisson). - (63) |
| ebeûrcher, v. tr., ébrécher. - (14) |
| ébeurchi - ébrequener : ébrécher - (57) |
| ébeurdaulé : Etourdi. « Fa dan attention à ce que te fa, grand ébeurdaulé ». - (19) |
| ébeurdellè : 1 adj. En désordre. - 2 adj. Qui a les idées confuses. - (53) |
| ébeurdi (-e) (adj.m. et f.) : étourdi (-e) - (50) |
| ébeurdi : étourdi (inattentif), dans les vaps, moitié assomé - (48) |
| ébeûrdi : rendu berdin (voir ce mot). III, p. 50-7 - (23) |
| ébeurdi, adj. étourdi, braque, fou. - (08) |
| ébeurdie (n.f.) : étourdissement ; élan - prendre son ébeurdie : s'élancer - (50) |
| ébeurdie : élan - (48) |
| ébeurdilla : écervelé. (RDM. T IV) - B - (25) |
| ébeurdillé. adj. Etourdi. - (10) |
| ébeurdiné : étourdi, assommé par qqch., abasourdi (écanboicher ?). - (56) |
| ebeurdiner : rendre beurdin, fou - (51) |
| ébeurdiner, embeurdiner v. Rendre fou, abrutir. Voir beurdin. - (63) |
| ébeurdir (s') : prendre son élan. - (33) |
| ébeurdir : surprendre,étonner - (48) |
| ébeurdit : légèrement gris. Ol o ebeurdit : il est gris. Étourdi par un choc. Un simple eto ébeurdit : un simplet était étourdi. - (33) |
| ébeurdonné : (adj) ahuri - (35) |
| ébeurdouiller (S’). v. pron. S’étourdir, se hahurir, ne plus savoir ce qu’on fait. - (10) |
| ebeurdsi : ébréché, édenté. A - B - (41) |
| ébeurier (s') : (s'éboeryè - v. pronominal) prendre son élan, s' élancer. - (45) |
| ebeurionner (s') : forcer inconsidérément jusqu'à se faire éclater le beurion (nombril) - (51) |
| ébeurlancer, v. a. balancer, aller de droite et de gauche. - (08) |
| ébeurlançoire. s.f. Balançoire. (Athie). - (10) |
| ébeurlançouére, s. f. balançoire. - (08) |
| ebeurlichée : lumière du type de l'éclair - (51) |
| ébeurlu, adj. extravagant. - (08) |
| ébeurlu, adj. qual. ; ébloui, aveuglé ; Y seus tot ébeurlu ; son cadet se conduit comme un ébeurlu. - (07) |
| ébeurlues, ébeurlutai - éblouissement, être ébloui. - I ne sai pas ce qui ai, de temps en temps i ai quemant des ébeurlues. - Ah ! pair exemple en y aivo des lumières qu'en éto ébeurlutai. - Qué baivard ! a cause, a cause, qu'en en é les ébeurlues ! - (18) |
| ébeurluir. v. a. Eblouir. (Percey). - (10) |
| ebeurluqué : ébloui par la lumière. A - B - (41) |
| ébeùrluqué, adj., distrait, évaporé, étourdi. - (14) |
| ébeurluquer v. (de berlue). Etourdir par la lumière, l'alcool, la danse, éblouir. - (63) |
| ébeurluques n.m.pl. Vapeurs, étourdissement, 36 chandelles. - (63) |
| ébeurlutaige (n.m.) : étourdissement - aussi ébeurlutation - (50) |
| ébeurlutaines, s. f. pl., vertiges. - (40) |
| ébeurlutaines, s.f.pl. évanouissement ; "avoir les éberlutaines", s'évanouir ; ébeurluter, v. aveugler. - (38) |
| ébeurluté, éblouir, de manière à ne laisser voir les choses qu'à demi, confusément ; l'seulo m'ébeurlute, le soleil m’éblouit. - (16) |
| ebeùrlute, s. f., éblouissement : « A quand jem'leùve, j'ai des ébeùrlutes. » - (14) |
| ébeurluter - avouair la beurlue : éblouir - (57) |
| ébeurluter (v.t.) : éblouir - (50) |
| ébeurluter : éblouir. On retrouve la racine berlue : avoir la berlue (être ébloui, se tromper). - (62) |
| ébeurluter, v. ; éblouir. - (07) |
| ébeurluter, v. éblouir. - (65) |
| ébeurluter, v. n. éblouir, causer des étourdissements, des vertiges : « i seu tô ébeurluté «, je suis tout étourdi. - (08) |
| ebeùrluter, v. tr. et intr., éblouir momentanément, frapper vivement la vue, presque aveugler, avoir des éblouissements : « L'élide ma ébeurluté. » - (14) |
| ébeurluter, v., éblouir, surprendre. - (40) |
| ébeurlut'ment : (nm) étonnement - (35) |
| ébeurner v. Emietter, briser. - (63) |
| ébeurrouer, eberrouer, ebrouer. v . a. Effrayer, effaroucher. Nous poules sont ébeurrouées. (Argentenay). Roquefort donne ébouer, effrayer, et ébouaille, épouvantail. - (10) |
| ébeurtille. s. f. Personne qui va vite, qui se dépêche. Tu marches comme une ébeurtille. (Pasilly). - (10) |
| ébeurtsi v. Ebrécher. - (63) |
| ebeuyancer : ébouillanter. - (30) |
| ébi, habit. - (26) |
| ébiais : s. m., biais. En ébiais, en biais. - (20) |
| ébicile. adj. Imbécile. (Sainpuits). - (10) |
| ébiéter, v. a. briser les mottes à l'aide d'un râteau ou d'une pioche. - (24) |
| ébime : Abîme, gouffre. « Ol est-i bien priand ce partu ? J'y cras qu'ol est priand, o n’a point de fand, y est in ébime » : ce trou est-il profond ? Je crois bien, on n'en trouve pas le fond, c'est un abîme. - (19) |
| ébiouner. v. a. et n. Emonder une vigne, en retranchant durant l’hiver les bions, les branches inutiles. (Lucy-sur-Cure). - (10) |
| èbit : un habit - (46) |
| èblancé, vt. balancer. - (17) |
| èblançou, sm. balançoire - (17) |
| èblançoure, sf. balançoire. - (17) |
| èblèger : (èblèjè - v. trans.) 1- asperger. 2- au figuré: accabler, agonir (d'injures) - (45) |
| ébléger. v. a. Briser, meurtrir. I s’ot éblégé en chutant. (Collan). - (10) |
| ébliégi : Abîmer, verser, en parlant des récoltes. « Y a passé eune beurrée qu'a to ébliégi les bliés ». - (19) |
| éblinchi : (éblin;chi - subst. f.) : coup de serpe donné sur un petit arbre pour se repérer lorsqu'on trace des « filets » dans une forêt (cf. filet) - (45) |
| éblotai - écorné, cassé sur les bords. - C'â demaige, le pot de fleurs à tot éblotai. - L'aissiette à déji éblotée, qu'al aivo aichetée ai lai fouaire. - Lai pu petiote éblioture ôte bein de son prix. - (18) |
| ébôbi, adj., ébaubi, ébahi, étonné, stupéfait : « Que qu'tas donc, qu'te v’là tout ébôbi ? » - (14) |
| ébobir : ébahir. (B. T IV) - Y - (25) |
| ébobir, étonner. - (26) |
| ébœrdolè, adj. étourdi : quel ébœrdolé ! - (24) |
| ébœrdoulé, adj. étourdi. - (22) |
| ébœrnœlli, v, a. ébrécher, spécialement le tranchant d'un outil. - (22) |
| éboiler : écraser. - (62) |
| éboiler, éventrer. - (05) |
| éboiler, v. éventrer. - (38) |
| éboiler. Éventrer. Boelle autrefois se disait pour entrailles. - (03) |
| éboillas, s. m. se dit d'objets répandus pêle-mêle, en désordre, embrouillés. - (08) |
| éboiller, v. a. emmêler, jeter pêle-mêle, mettre sens dessus dessous. - (08) |
| ébolance (pour évolance). s. f. Marche rapide. Du latin evolare. - (10) |
| ébôler, v. tr., ébouler, renverser, démolir : « L'bestiâ ! en v'lant la côvri, ôl a ébôlé sa cadole ! » - (14) |
| ébollai et éboilai. : Renverser un édifice. Le mot boelle, dans le dialecte, signifie entrailles. - Dans la Bresse chalonnaise éboiler veut dire éventrer. ( Guill.) - (06) |
| ébôllai, abattre. L'ébôlleman de Tailan, la démolition de Talant. - (02) |
| ébônouer. v. a. Eborgner. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| éboraissi : (p.passé) ébouriffé - (35) |
| eboréchi : mal peigné (en forme de borèche*). A - B - (41) |
| eborechi : mal peigné - (34) |
| éboressi : ébouriffé, mal peigné - (43) |
| éborgé - se loger, habiter. Mot bourguignon cité dans la préface de notre présent vocabulaire. - (18) |
| eborgé. Héberger, loger. Hébergé, hébergez. - (01) |
| éborgeai, recevoir, faire l'hospitalité à quelqu'un. - (02) |
| éborgein. Hébergions, hébergiez, hébergeaient. - (01) |
| éborgener : Ebourgonner. « Quand an somarde treu tâ i faut bien fare attentian de ne pas treu éborgener les vignes ». - (19) |
| éborger. : Héberger, faire l'hospitalité. - (06) |
| éborgi, v. a. enchevêtrer : éborgi une pelote de laine. Éparpiller : èborgi du foin dans le pré. - (24) |
| éborgneux de crapauds. s. m. Vigneron (sobriquet donné aux vignerons, à Sergines). - (10) |
| eborgni : se faire mal à l'œil. A - B - (41) |
| éborgni (s’) : se faire mal à l'œil - (43) |
| éborgni : éborgner - (57) |
| eborgni : se faire mal à l'œil - (34) |
| ébôrgni v. Blesser à l'oeil. - (63) |
| éborgnier : se faire mal à l'œil - (44) |
| ébornai - ouvert au grand large, ordinairement par imprudence. - A laichant le jairdin tot ébornai, ce n'a a pas drôle que les poules y entraint. - En airivant i n'ons trouvai nun, et pu tot ébornai. - (18) |
| éborné : Eborgné. - (19) |
| eborni, v. a. rendre brumeux, sombre. Un temps « éborni », temps bas, couvert. - (08) |
| ebornicler, ébournicler : v. a., abîmer les yeux par une tension excessive de la vue. Ne lis donc pas quand i fait nuit ; t' vas tout t'ébournicler les veux. A rapprocher du vx fr. borgner. - (20) |
| ébornifler, v. tr., éborgner, aveugler d'un coup de poing. - (14) |
| éborrechi v. Ebouriffer. Voir borrèche. - (63) |
| èbôssumer : (èbôsûmè - v. tr.) agonir, accabler (d'injures). A m' é èbôsumè d' soti: "il m'a inondé d'insultes". - (45) |
| ébôssumer, v. assommer. - (38) |
| ébottognière. s. f. Boutonnière. (Plessis-Saint-Jean). - (10) |
| éboudrâilli, ébôdrâilli v. et adj. Disperser, éparpiller. On retrouve ici la bôrde (tas de bois de toutes provenances destiné à être brûlé). - (63) |
| éboudriller (v.t.) : écraser, aplatir - (50) |
| éboudriller, v. a. écraser, crever en aplatissant. On « éboudrille » une pomme mûre avec le pied, avec une grosse pierre. - (08) |
| ébouêchè : casser une coquille d'œuf pour favoriser l'éclosion du poussin - (46) |
| ébouécie, s. f. becquetée, bouchée. (Voir bouéce.) - (08) |
| ébouèilla : (ébouèyâ:) chose ébouèyé: : un fagot épars, une botte de foin déliée sont des ébouèyâ:. - (45) |
| éboué-illè : dispersé, hirsute - (48) |
| éboueillée : chevelure hirsute, mal peignée. - (33) |
| ébouéiller : disperser, épandre - (48) |
| éboueiller : mettre en tout sens, éparpiller - (39) |
| ébouèiller :(ébouèyé - v. trans.) : défaire, répandre, disperser. L'idée principale est celle d'une cohésion soudain rompue : il s'agira aussi bien d'une pelote de laine avec laquelle joue le chat, que d'une javelle, d'un fagot qui se défont. - (45) |
| eboueyée : adj. Abimé, qui n'a plus sa forme. - (53) |
| éboufené : tomber en ruines. (M. T III) - D - (25) |
| éboui - ébahi, surpris. - En entendant dire to celai, te peux jugeai queman qui étâ éboui. - Ah ! pou le co, i ai étai joliment éboui quand i les ai vues veni totes les deux. - On dit un peu dans le même sens ébaubi. - (18) |
| éboui : ahuri, dépité. - (29) |
| éboui, pour ébloui. - (02) |
| ëboui, très étonné, très surpris. - (16) |
| éboui. Etonné, surpris… - (01) |
| ebouïe. Etonnée, étonnées. - (01) |
| ébouillancer, ébeuillancer : v. a., ébouillanter, éluver. - (20) |
| ébouilli v. Ecraser, mettre en bouillie. Ebouilli les treuffes. Ecraser les pommes de terre. Voir treuilli. - (63) |
| ébouillir (s'), s'ébeuillir : v. f., vx fr. esboillir, s'écrouler, se partager, se démolir. - (20) |
| èbouiné, vn. t. enlever la bouffe du grain battu. Mettre en bouffe, c'est-à-dire en miettes, en mille briques. - (17) |
| ébouïsseman. : Répond au français ébahissement. - (06) |
| éboujalé, qui ressent une douleur au ventre à la suite d'un coup. - (28) |
| ébouler (Morv.), ébôler, ébôli (C.-d.), ébuyer (Chal.) (s'). - S'écrouler en roulant comme une boule, tel un tas de sable qui s'effondre… - (15) |
| ébouler (v.t.) : faire tomber, renverser, détruire - (50) |
| éboûler : accoucher, tomber, s'effondrer - (48) |
| ébouler : (éboulè - v. intr.) : mettre bas, en parlant des animaux, et, au figuré,en parlant d'une femme (très péjoratif). - (45) |
| éboûler : faire tomber - (39) |
| ébouler, v. a. faire tomber, renverser, détruire en fragments. On éboule une taupinière. - (08) |
| éboulu : Un peu fermenté aigrement. « Ce lait est éboulu ». - (19) |
| ébourdiller (verbe) : (S') se casser en petits morceaux. Se désagréger. - (47) |
| ébourgi, v. a. enchevêtrer. Éparpiller. - (22) |
| ébourifler, v. tr., ébouriffer les cheveux. (V. Eveùrlucher.) - (14) |
| ébourné, v. a. éborgner. - (22) |
| éboussiou (n.m.) : fruit de l'églantier - (50) |
| éboussiou, s. m. fruit du rosier sauvage appelé vulgairement gratte-cul. - (08) |
| éboussioulê, s. m. églantier, rosier sauvage. - (08) |
| éboussiouler (n.m.) : églantier (dans le glossaire du Morvan : éboussioulé, aussi éboussiou) - (50) |
| ébouyi, v. a. écrouler, ébouler : une vieille maison ébouyie. - (24) |
| ébouyi, v. a. écrouler, ébouler. - (22) |
| éboyer, éboyancer, ébuyancer : v. a., vx fr, esboeler et esboillier, arracher les boyaux, étriper, éventrer. - (20) |
| éboyi : écraser (les pommes de terre par exemple), éventrer - (43) |
| ebradzi (s') : parler très fort - se mettre en colère. A - B - (41) |
| ebradzi (s') : parler très fort, se mettre en colère - (34) |
| ébrâdzi (s') v. S'embraser, monter sur ses grands chevaux, s'énerver, se mettre en colère. - (63) |
| ébradzi : parler très fort, se mettre en colère - (43) |
| ébrâher, v. a. ébranler, disloquer au propre et au figuré un mur « ébrâhé », un empire « ébrâhé. » - (08) |
| ébraiser (S') : v. r., s'émietter. Voir braiser. - (20) |
| ébraiser, v. tr., mettre en miettes, réduire en parcelles comme de la petite braise. (V. Éfraiser.) - (14) |
| ébraiser. Réduire en miettes « en braises » ; émietter. On dit encore « effriser ». - (49) |
| ébraisi v. (du lat. pop. brisare, mot d'origine gauloise signifiant briser, rompre) Emietter. Voir braise. - (63) |
| ébranciner, v. a. balancer au moyen d'une branche d'arbre tordue en balançoire. - (08) |
| ébrancinouére, s. f. balançoire que les enfants se fabriquent à peu de frais en tordant une branche d'arbre à laquelle ils se suspendent. - (08) |
| ébrander : Couper les branches (la brande, voir ce mot) d'un arbre qui vient d'être abattu. - (19) |
| ébrécher : v. a., sécher. Un grand vent « ébrèche » la terre. - (20) |
| ebredaulé : voir bredaulé. - (20) |
| ébredeau : voir bredeau. - (20) |
| ébredené : ahuri - (43) |
| ébrediner, embrediner : v. a., rendre bredin, troubler les idées ; mettre le désordre dans quelque chose. - (20) |
| ébrelue et berlue. : (Del.), avoir lés ébrelüe c'est ne voir goutte. - (06) |
| ebreluë. Berlue, autrefois barluë… - (01) |
| ebreluté : ébloui. - (30) |
| ébreluté, v. a. éblouir. - (22) |
| ébreluter, ébeurluter : (vb) éberluer, abasourdir, éblouir - (35) |
| ébreluter, v. a. éblouir : l'éclair ébrelute. - (24) |
| ébréquigner. v. a. Ebrécher, émousser, casser la pointe d’un objet aigu. Ebréquigner une aiguille. (Vergigny). - (10) |
| ébretsi : ébréché - (43) |
| ebreuchi : Voir breuchi. - (19) |
| ébreuluté : ébloui par une forte lumière - (43) |
| ebreuner : émietter - (51) |
| ébreuqué, à qui il manque des dents. - (28) |
| ébreuquer : casser le bord d'une assiette ou d'une tasse par exemple, bouche édentée. - (66) |
| ébreutsi : (p.passé) ébréché - (35) |
| ebreutsi : ébrécher - (51) |
| ébrézi : émietter - (43) |
| ébri. n. m. - Abri. - (42) |
| ébriac, écervelé. - (28) |
| ébriaudé, ébriaulé : adj., syn. de bredaulé. - (20) |
| ébricoler. Casser, ébrécher Prends don ben garde : te vâs ébricoler mai caisserôle. Brix et brig sont des radicaux celltiques ayant le sens de brêche rocheuse. Ils sont entrés en composition dans les noms de plusieurs villages, villes ou pays, notamment dans arefbrignus. L'allemand ebrecken signifie ébricoler : je pense que le mot bric-à-brac a la même origine. - (13) |
| èbriconné, èbricorné, vt. écorner, endommager les bords d'une faïence, d'un verre. - (17) |
| ébrimer, v. a. ebrécher, entailler. se dit des brèches à un outil, à un instrument de fer ou d'acier ; à une assiette, à un verre, etc. - (08) |
| ébrimeure, s. f. brèche faite à un outil ou à un instrument de métal, à un corps solide en général. - (08) |
| ébrincer. v. a. Elaguer. - (10) |
| ebrinchè : v. t. Ébrancher à la serpe. - (53) |
| ébrinchi - débronder : ébrancher - (57) |
| ébriquer : v. a., mettre en briques. Il a foutu un bon coup su’ la cannelle en cuivre, ça li a tout ébriqué sa duelle. - (20) |
| èbroché, vt. ébrécher ; pp. f. ébrochée, brèche, brèche-dent : se dit de la brebis qui a perdu qques incisives ; se dit également des personnes. - (17) |
| ébroivouée. s . f. Abreuvoir. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| ébrondener, v. n. ebrécher. se dit principalement en parlant de la vaisselle : une écuelle, un pot « ébrondenés. » - (08) |
| ébronder : v, a., émonder, ébrancher, enlever la bronde. Voir débronder. - (20) |
| èbronder : v. émonder un gros arbre. - (21) |
| ébronder, faire la feuille : ébrancher un arbre abattu - (43) |
| ébronder. Couper les branches d'un arbre, élaguer. - (49) |
| ébrondi v. (de bronde). Couper la ramure. - (63) |
| ebroqu’né, âbroqu’né : ébréché en plusieurs endroits - (37) |
| ébroquai - à qui il manque plus ou moins de dents. - Teino, ma i me sembe que t'ée ébroquée. - I'eume pas cequi, éte ébroquai. - (18) |
| ébroquè : ébréché, édenté - (48) |
| ébroqué : ébréché, se dit aussi d'une personne à qui il manque des dents - (46) |
| ébroqué : édenté, cassé - (39) |
| ébroqué : v. t. Édenter. - (53) |
| ébroqué, adj. édenté pour quelqu'un qui à perdu ses dents de devant. - (65) |
| ébroque, adj. édenté, celui qui a les dents cassées et par extension celui qui en a perdu une ou plusieurs. - (08) |
| ébroqué, adjectif qualificatif : édenté, qui a perdu les dents de devant. - (54) |
| ébroqué, ébréché - (36) |
| ébroqué, ébroquée : part. pass,» ébréché. Un ébroqué, un brèche-dent. - (20) |
| ébroqué. Édenté : à qui il manque quelques dents, principalement les incisives. - (49) |
| ébroquer : casser (une dent) - (48) |
| ébroquer : casser, fracturer. Une dent ébroquée. - (56) |
| ébroquer, v. édenter. - (38) |
| ébroquer, v., casser. - (40) |
| ébroter : dégermer les patates. « Vas ébroter un pané de tapines ! » : vas dégermer un panier de pommes de terre ! Voir « brot ». - (62) |
| ébroter : Enlever les feuilles de betteraves, raves - (19) |
| ébrouer. v. a. Se dit de faction de la gelée et des bruines d’automne sur les feuilles de la vigne. - (10) |
| ébrouquer (pour ébroquer). v. a. Ebrécher. Ebrouquer un couteau, une serpe. Des aiguilles, des épingles ébrouquées. (Annay-sur-Sercin). - (10) |
| ébrousser : ébourgeonner la vigne. (M. T III) - D - (25) |
| ébrousseter. v. a. Couper, rogner les brosses, le brout, l’extrémité des branches des taillis. Si ce mot dérive de brout, comme nous le croyons, ne serait-il pas mieux d’écrire ébrouster ? - (10) |
| èbrouter : v. = couper les feuilles (le bru.) des carottes, raves, etc. - (21) |
| ébroutï. adj . Abruti. (Athie). - (10) |
| ébruyer, ébruer (de bru 'bruit'), effondrer, en parlant d'une maison, d'un mur. - (38) |
| ébruyote : un éblouissement, le fait de voir des « papillons » (médical) dans les yeux évouè les ébruyottes, voir 36 chandelles - (46) |
| èbsançou, sm. balançoire. - (17) |
| èbsanti, vt. balancer. - (17) |
| ébûcheter. v. - Ramasser des brindilles, des bûchettes. - (42) |
| ébûcheter. v. n. Ramasser des bûchettes, des brindilles de bois. (Puysaie). - (10) |
| ébuer (S’), ébuger (S’). v. pron. S’amuser. I n’faut pas toujous s’ébuer ; faut itout travailler. - (10) |
| ébufé (-e) (p.p.m. et f.) : effrayé (-e), ahuri (-e) - (50) |
| ebufé, part. passé. Effrayé, ahuri. - (08) |
| ebufer (s'), v. réfl. s'effrayer, s'épouvanter, s'emporter par peur ou autre cause : mon cheval s'est « ébufé » près du moulin. - (08) |
| ébûgement : Amusement, jeu « Ces dreûles sant to le temps à se trigouchi, y est in vilain ébûgement », ces gamins sont tout le temps à se tirailler, c'est un vilain jeu. - (19) |
| ébugeont (pour ébugeant). adj. et part. prés, d’ébuger. Amusant. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| ébugeotte.s. f. Jouet, amusement, tout ce qui sert à récréer. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| ébugi : Amuser. « Cen nos a bien ébugi » : cela nous a bien amusés. « Ol est bien bujan in frémi l'ébugerait » : il est bien badaud, une fourmi l'amuserait. - (19) |
| ébûiller (s’) : (s'èbu:yé: - v. pron.) : ne pas s'occuper utilement ; s'amuser, jouer. - (45) |
| ébujoux. s. m. et adj. Musard. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| ebuté. ; Choisir un but à certains jeux. (Grosley.) - (06) |
| ébuter, v. a. elargir, agrandir un trou, une ouverture quelconque. - (08) |
| èbuyè (s’) : s'amuser. (B. T II) - B - (25) |
| ébuyement, s. m., amusement, jeu quelconque. - (14) |
| ébuyer (s'), v. pr., s'amuser. - (14) |
| ébû-yer (s'), v., tomber, s'effondrer. - (40) |
| ébuyer : amuser. (MM. T IV) - A - (25) |
| ébûzé, abuser. - (16) |
| eç’neau, âç’neau : chéneau le long du toit pour rassembler les eaux de pluies - (37) |
| écâ.jer, v. a. écarter, disjoindre, séparer. L’homme frileux « écâje » ou « s'écâje » les jambes devant le feu. - (08) |
| écabanné : accroupi. (M. T III) - D - (25) |
| écabéchi, v. a. aplatir à demi. - (24) |
| écabi (s'), v. réfl. se baisser vers la terre, s'accroupir, s'affaisser. - (08) |
| écabier. v. a. Accabler. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| écabioter (s'), v. se baisser. - (38) |
| ècabonné,ie adj. éculé, ée. - (17) |
| écabonner (s'). S'accroupir avec abandon, s'étaler dans un fauteuil, s'affaisser. Etym. vieux français se capir, dans le mime sens. - (12) |
| écabonner, accroupir. - (26) |
| écabouler. v. fl . et v. n. Ebouler. (Etiuey). - (10) |
| écabousser (pour cabosser). v. a. Déformer, bossuer, écraser. (Gizy-les-Nobles). - (10) |
| écacoler, ecacoter, ecacouler. v. a. Dépouiller les noix de leur coque verte. C’est un composé de cacou, noix, et d’écaler. - (10) |
| ecafalée : fou rire bruyant. A - B - (41) |
| écafaler (s') v. (d'esclaffer). Rire bruyamment, s'esclaffer. - (63) |
| ecaffallé : fou rire bruyant - (34) |
| écaffallé : fou rire bruyant - (43) |
| ècaffer : écraser. - (21) |
| écaffouérer, écaffoirer. v. a. et v. n. Ecraser ; fondre. Voici le dégel, la neige va écaffoirer. (Etivey, Pasilly). - (10) |
| écafoillai - écraser complétement, mettre comme en bouillie. - Ces pôres œufs ant choué, en y en aivo ine douzaingne ; te pense bien qu'al en été to écafoillai. - Vois don ce sale craipaud ! Oh lai peute bête ! Ecafoille moi don cequi ! Poui ! - Voyez écliaforai. - (18) |
| écafoiller (v.t.) : écraser - (50) |
| écafoiller, v. a. écraser. - (08) |
| écafoirer (s') ; s'évaser. - (07) |
| écafoirer. v. a. Etaler, exposer des marchandises en vente. De Foire, marché public. (Vermenton). - (10) |
| écafouéiller : écraser - (48) |
| écafoueiller : (ékafouèyé - v. trans.) écraser violemment, "écrabouiller" quelque chose de mou. - (45) |
| écafoueiller : écraser - (39) |
| écafouillè : aplatir, écraser - (46) |
| écafouiller, v. tr., écraser, réduire en bouillie : « Ol a marché su c'te poume ; ô l'a écafouillée tout à plat. » - (14) |
| écafouiller. Ecraser (V. Echole). En Franche-Comté on dit cafouiller. - (13) |
| écafouiller. Ecraser violemment, de préférence avec jaillissement des débris. - (12) |
| écafouilli. : Briser, mettre en morceaux en pressant sur un objet. Ce mot a plusieurs congénères, comme éclaforai, écapourai ou eschaipporai, écarboullai , éclaifori, échairpi, lesquels , quoique semblant porter une physionomie d' onomatopées, ont trouvé leur origine dans le verbe latin excerpere, qui signifie séparer. - Dans le Châtillonnais, on disait écafouillé un oeuf. - (06) |
| écafouyé, écraser du pied. - (16) |
| ecafrer : aplatir. (REP T IV) - D - (25) |
| écagnardî, v. tr., acagnarder. Rèfl., s'amollir, paresser. - (14) |
| écagnards : courbatures. - (62) |
| écagnards, s. m. pl., lombalgies, courbatures musculaires. - (40) |
| écagnards. Courbature des muscles de la cuisse après un exercice violent. Etym. le vieux français écâjer ou s'écajer, ecarter, disjoindre. - (12) |
| écagnarts : courbatures. - (32) |
| écagnâts (avoir les), locution verbale : avoir des courbatures, une grande fatigue. - (54) |
| ecagnâts, âccagnâts : courbatures - (37) |
| écagni, v. a. gronder sévèrement et longuement. - (22) |
| écaibornai - étendu négligemment, les jambes écartées, les bras sur les genoux ; surtout devant le feu.- A s'a écaibornai devant le feu ; en n'y aivo de pliaice que pour lu. - Veux-tu bein ne pas t'écaibornai quemant cequi ! - (18) |
| écaignard : adj. Très fatigué au point de s'affaler membres écartés. - (53) |
| écaillé, e, adj. celui qui a les jambes écartées, hors de leur aplomb, un homme « écaillé » ; une vache « écaillée. » - (08) |
| écaille, s. f., morceau, rognure. S'applique à bien des sortes. On dit : des écailles de bois, de pots cassés, d’étoffes, etc. - (14) |
| écâiller : écarter, fendre - (48) |
| écaillotter, échaillotter. v . a. et n. Jeter des pierres. (Flogny, Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes). - (10) |
| écailvatrai - à peu de chose près le même sens que écaibornai. - (18) |
| écairmoueiller : (ékêrmouèyé - v. trans.) Ecraser violemment quelque chose (une limace, etc.) au point de faire gicler bruyamment (jitrè ou chitrè) les parties molles. - (45) |
| écairquiller : écarquiller, ouvrir grand (les yeux) - (48) |
| écairter : écarter, étendre (le fumier par exemple) - (48) |
| écaiver, v. a. creuser, échancrer, faire une entaille. - (08) |
| écajée. s. f. Enjambée. (Gollan). - (10) |
| écalanchi, v. a. blesser par écartement exagéré d'un membre lors d'une chute, d'un accident. - (24) |
| écalandre (pour calandre). s. f. Espèce d’alouette commune, et dont le gosier flexible, la voix sonore, harmonieuse, se prêtent à imiter le chant des autres oiseaux, particulièrement celui du rossignol, de telle sorte qu’on la prend pour point de comparaison et qu’à Auxerre, par exemple, quand on veut donner une idée de la fraîcheur, du chant et de la beauté de la voix d’une personne, on dit qu’elle chante comme une écalandre. - (10) |
| écàle, s. f., brou de la noix. - (14) |
| écaleinchi*, v. a. blesser par écartement exagéré d'un membre. - (22) |
| écaler v. 1. Décortiquer. Ecaler les noix (voir cala) 2. Fendre des souches de bois pour les brûler. - (63) |
| écaler, v. tr., sortir de leur enveloppe certains fruits et quelques légumes. On dit surtout : « écaler des noix. » - (14) |
| écaler, v., enlever la « caloffe » des noix. - (40) |
| écaler. Ce terme s'emploie pour écorcher : « écaler un lapin ». - (49) |
| écaleux. Se dit de celui qui écale, qui écorche. Les habitants de Perrecy-les-Forges, commune voisine de Montceau-les-Mines portent le nom d'« Ecaleux de singes ». Ils ont, autrefois, d'après la légende, écalé et mangé les singes d'un bateleur de passage qui refusait de payer ses dépenses. - (49) |
| écalle. s. f. Cosse de pois. - (10) |
| ecaller : enlever la peau, écorcher. Casser une noix - (34) |
| écalofe, s. f., cosse, enveloppe des pois, des fèves et autres légumes. Ne s'applique pas, comme écale, aux coquilles de noix. - (14) |
| écàlòfer (Chal., Br.), écàlofrer, décalofrer (Morv.), écàcòler (Y.), échòler, écacòffer (C.-d. j. - Ecaler des noix, c'est-à-dire en ôter les écales-, appelées aussi écalofes en patois ; du vieux français escaloppe, qui signifiait autrefois coquilleou écaille, venant de squamma, et désigne encore aujourd'hui, en terme de cuisine, une tranche de viande grillée… - (15) |
| écalofer, v. tr., écosser, tirer de leur enveloppe les légumes à cosse : pois, haricots, fèves, etc. - (14) |
| écaloffe. Coquille, cosse, épluchure de fruit ou de légume. Etym. écaler, qui a pour racine écaille, lequel pourrait bien venir du vieil allemand skalja, tuile, brique. - (12) |
| écaloffer, v., enlever la « caloffe » des noisettes, amandes et marrons. - (40) |
| écalofre (n.f.) : enveloppe de la noix ou de la châtaigne - (50) |
| écalofre, s. f. écale de noix. - (08) |
| écalofrer (v.t.) : écaler les noix ou les châtaignes - (50) |
| écalofrer, v. a. écaler les noix. - (08) |
| ecalon : noix. - (09) |
| écalon : voir calon - (23) |
| écalon, s. m. noix. - (08) |
| écalon. s. m. Noix. (Andryes). — En plusieurs endroits, on dit écalat. - (10) |
| écalordé (e): (écalordè (é:) - adj.) pris d'éblouissements. - (45) |
| écaloufe. (V. Echole). - (13) |
| écalougnier : voir calougnier - (23) |
| écalourdir, v., étourdir. - (40) |
| écalucher, v. a. écaler, enlever l'écale des noix. « Écalucher » - (08) |
| écaluchonner, v. a. écaler. - (08) |
| écalvatrer (s'). Se tenir fort mal, dans une pose absolument abandonnée, les membres jetés de ci de là. Etym. evidemment vautrer en est, mais je ne m'explique pas la présence d'écale. Peut-être a-t-on primitivement dit Ecarvâtrer, d'écart et de vautrer. - (12) |
| écalvotrer : éparpiller. (A. T II) - D - (25) |
| écamoicher, v. ; abattre, jeter ; a m’ai écamoiché sous lu. - (07) |
| écamper (s') v. Se camper, se dresser de toute sa hauteur. - (63) |
| écamper. Enjamber. Ex. : « écamper un reu », un ruisseau. - (49) |
| écanaché (être) : se dit en parlant d'une personne se déplaçant avec difficulté, à grand ‘peine, marchant cahin-caha. - (56) |
| écanboicher, v. n. trébucher, faire un faux pas en marchant. - (08) |
| écané, adj. se dit du bruit que fait un sabot fendu : il « brit » l'écané. - (24) |
| écané, adj. se dit du bruit que fait un sabot fendu : il « brit » l'écané. - (22) |
| écaner : Ecraser. « Ol a troué eune bonne plièche : o n’a ren à fare qu 'à mener promener le ptiet chin à sa Dame. -Oh bin ! me j 'amerais mieux aller écaner de la piarre su les routes ». - (19) |
| écanias, écagnards, courbatures des jambes. s.m.pl. - (38) |
| écanousser. v. a. Détacher d’une souche de bois tous les éclats qu’on peut en distraire sans outil. (Etivey). - (10) |
| écanshe : terrain en pointe. - (62) |
| écapé, adj. se dit d'un chapeau lorsqu'il est affaissé, déformé. - (24) |
| écapourè : épandre - èl é écapourè le f’meil, il a épandu le fumier - (46) |
| écapoutî : écrabouiller. Viendrait de l’allemand « kaputt » : cassé, détruit, fichu. Voir aussi : épouti. - (62) |
| écapoutir, v., aplatir. - (40) |
| écaquelourdir, acaquelourder. v. a. Etourdir d’un coup frappé sur la tête. (Perreuse). - (10) |
| écaquelourdir. v. - Étourdir par un coup porté à la tête. - (42) |
| écaqueugner, agrommer (s'). S'accroupir, s'asseoir sur les talons. - (49) |
| écarboïlli : Disperser. « Y a passé in follot qu'a to écarboïlli les jevales » : il est passé un tourbillon de vent qui a dispersé les javelles. - (19) |
| écarbouiller, v. écrabouiller. - (38) |
| ecarbouilli : jeté en tous sens. A - B - (41) |
| ecarbouilli : jeté en tous sens - (34) |
| écarbouilli : repandre - (57) |
| écarbouyi, v. a. écraser malproprement. - (22) |
| écarboyi : écraser, de façon involontaire - (43) |
| écarcueuché : 1 v. t. Écarteler. - 2 v. t. Écarter un objet, une idée. - (53) |
| éçardon, s. m. chardon. - (08) |
| écarmouchi – avouair la carmouche : éternuer - (57) |
| écarnucher. v. n. Eclater. (St-Aubin-Châteauneuf). - (10) |
| ecarochoir, s. m., double maillet en forme de T, servant à pulvériser les mottes sèches ou trop grosses. On le désigne aussi sous le nom de : brises-mottes. - (14) |
| écarofé : enlever l'enveloppe de certaines graines. (B. T II) - B - (25) |
| ecarpeuillade : étendue (d'un produit quelconque mis à terre) - (51) |
| ecarpeuilli : étaler, étendre - (51) |
| ecarqueucher : écarteler. - (59) |
| écarquillai des yos : ouvrir de grands yeux. - (33) |
| écarquilli : écarquiller - (57) |
| écarreure - belle taille et ordinairement forte, surtout des épaules et des reins. - C'à foutu c'â in gairson d'ine bonne équarreure. - Voué, al é ine écarreure que pliait. - (18) |
| écarsaler, v. n. se dit du tonnerre lorsqu'il est particulièrement violent et rappoché. - (24) |
| écartelé, v. n. se dit du tonnerre lorsqu'il est particulièrement violent et rapproché. - (22) |
| Ecarteler, écarter. - (63) |
| écarter : (vb) étendre (le fumier) - (35) |
| écarter : Ecarter. Au figuré : « San feusi écarte » : son fusil écarte se dit de quelqu'un qui a l'habitude de tout exagérer. - (19) |
| ecarter : étendre - (51) |
| écarter : étendre (le fumier) - (43) |
| écarter v. Etendre (du linge, du fumier, de la paille). - (63) |
| écarter, v. étendre le linge. - (65) |
| écartiller, écarciller. v. - Écarter. - (42) |
| écartiller. v. a. Ecarter. — Se dit surtout de menus objets groupés, réunis en certaine quantité. Ecartiller ses doigts. Ecartiller les brins d’un balai. - (10) |
| écartis, acartis. n. m.- Objet peu utilisé que l'on place à l'écart. - (42) |
| écartue. s. f. Etendue, surface. (Saint-Forentin). - (10) |
| écartvaller v. Ecarter, écarteler. - (63) |
| écarure, s. f., carrure. L'e préfixe est commun à plusieurs autres mots. - (14) |
| écât (n’) : écart - (57) |
| écatade ou écatrée, élargissement ou écart des jambes. (Voir au mot écarquillé.) - (02) |
| écatade. : Écartement des jambes. Les deux autres mots patois ecatrie et écarquilleman sont des degrés superlatifs. Le mot écart est la racine de ces trois vocables. - (06) |
| ècatié, vt. écarter. - (17) |
| écâtrai - un peu le même sens que écaibornai ; mais il est bon de dire que ces mots ne sont plus guère employés. - (18) |
| éc'aûchi : (Prononcer : keû). Ecarteler. « L'orage à éc'eûchi la pu greusse brainche de man noué » : le grand vent a écartelé la plus grosse branche de mon noyer. - (19) |
| écaudé : voir caud - (23) |
| écauder. v. a. Mettre caut, mettre à caut, mettre à l’abri de la nuit, se garantir de la pluie ou du vent. Du latin coutus. - (10) |
| écavaillé, adjectif qualificatif : élargi, forcé, écarté. - (54) |
| ecàyer, v. tr., écarter largement les jambes : « Eh! c'pouv' petiot ! c'ment ôl écàrye les jambes ! » - (14) |
| ecché, part, passé. déchiré, fendu. Une branche séparée dans le sens de sa longueur est « ecchée. » - (08) |
| èccodjè : accorder - si vous vous disputez, y vè vous éccodjè, si vous vous disputez, je vais vous mettre d'accord. - (46) |
| écervalè : écervelé - (48) |
| éc'euchi : (Prononcer ke). Ecosser. « Ec'euchi des faviôles » : écosser des haricots. - (19) |
| éc'euillan : Chiffon fixé au bout d'une perche et servant à nettoyer le four. - (19) |
| éc'eure : Avoir la peau rougie par le frottement pendant la marche, l'équitation ou un autre exercice. - (19) |
| éceurvalé (n') : écervelé - (57) |
| éceurvaler : casser (les oreilles) - (57) |
| éceurvaller - essordilli : assourdir - (57) |
| éc'eut : Brin de bois sec. « Casse dan des éc'euts pa allemer le fû » : casse donc du petit bois pour allumer le feu. Vieux français : esquette, éclat de bois. - (19) |
| éc'euter : Ramasser les brindilles qui restent sur le sol quand on a fagoté du bois. - (19) |
| éch’neau (n’) : chéneau - (57) |
| échâ : Essayer. « Alle est allé écha eune reube chez la coudrère ». « Echâ voir! Que je t'y prenne ». Ne pas confondre avec échâs (essart). - (19) |
| échabouée: fatiguée. (S. T IV) - S&L - (25) |
| échabué : surpris, ému. - (30) |
| échabué, échabuée : adj., las, fatigué. - (20) |
| échabuté : Troublé, abasourdi. - (19) |
| échadronner. v. a. et n. Echardonner. (Argentenay). - (10) |
| échadronnet. s . m. Chardonneret. (Bagneaux). - (10) |
| èch'afé : adj. mal cassé (en parlant du bois). - (21) |
| èchafourée, sf. échauffourée. - (17) |
| échailée : n. f. Petite échelle pour franchir une clôture. - (53) |
| échaillai, enlever le brou des noix, enveloppe à laquelle on donne en Bourgogne le nom d'échaillon... - (02) |
| échaillai. : Enlever le brou des noix, l'échaillon. (Del.) (Voir au mot calô.) - (06) |
| échaille, s. f., enveloppe, paillette des épis de maïs, grande ressource pour les ménagères locales, qui en garnissent copieusement les paillasses de leurs lits. - (14) |
| echailler (nom masculin) : sorte d'échelle double et rustique qui permet de franchir une clôture. On dit aussi écholée. - (47) |
| echailler (un) : petite échelle pour franchir les haies - (61) |
| echailler : echelle double pour traverser une haie - (60) |
| échailler : v. a., enlever les chailles, écaler. - (20) |
| échailler, dépouiller le maïs. - (05) |
| échailler, v. tr., enlever quelques-unes des feuilles qui enveloppent la panouille (les panichets), en n'en laissant que ce qui est nécessaire pour la suspendre au-dessous des toits et la faire sécher. - (14) |
| échailler. Oter la coquille, écailler. Même Etym. que écaloffe. - (12) |
| échailles, dépouille, paillotes de maïs. - (05) |
| échaïlli : Ecaler, sortir la noix de sa coque verte. « Alle a les mains tote nars d'échaïlli des calas ». - (19) |
| échaillier ou écheillier, demi- clôture d'un sentier avec marchepied. - (05) |
| échainge (n’) : échange - (57) |
| échaingi : échanger - (57) |
| èchaipé, vt. échapper. - (17) |
| échaipée, s. f. échappée, action faite à la dérobée, plus ou moins sans préméditation, délit commis inconsidérément et quelquefois par suite d'un accident. - (08) |
| échaiper, v. a. échapper, lâcher, cesser de tenir quelque chose, abandonner. - (08) |
| échairboter : (échêrbotè - v. trans.) effilocher, effranger (un habit). - (45) |
| échairde, échique, échiqu'te : écharde - (48) |
| échairdon (n.m.) : chardon (pour de Chambure : éçardon) - (50) |
| échaiti, attirer quelqu'un, comme on attirerait un chat, par des friandises... - (02) |
| echaiti. Affriandé, afiriandez, afiFriander. Voyez chaiterie. - (01) |
| échaiti. : Attirer, allécher quelqu'un comme un chat par l'appât de friandises. - (06) |
| échaivon, petit dévidoir. - (02) |
| échaivon. : Petit dévidoir de main (Del.). Du latin scapus ou srapulus, tige ou petite tige. - (06) |
| échaké, laisser tomber des mains, échapper. - (16) |
| échalai - enlever le brou ou écorce des noix, etc. - I ons échalai nos calots hier qu'an plieuvot. - Vos échalez vos fèves. - On peut voir cheillot. - (18) |
| échalas : grand et maigre - (44) |
| échalâs : personne grande et maigre, perche - (48) |
| échalé : Echalier. « Y a in échalé dans la boucheure (dans la haie) ». - (19) |
| échalé des noix, des amandes : leur enlever leur enveloppe verte. - (16) |
| èchalé : clôture destinée à empêcher le bétail d'entrer dans les champs ; pour la passer on est obligé de l'enjamber, en s'aidant de petits échelons. - (21) |
| échâlé : v. t. Rincer le linge pour enlever l'apprêt. - (53) |
| échale, échate (du lat. pop. astella, planchette, v.fr. estele, éclat de bois) n.f. Echarde, éclat de bois - (63) |
| échàle, s. f., échelle. - (14) |
| échalé, v. a. enlever la coque verte des noix, ou « chala ». - (22) |
| échàlée, s. f., échalier, barrière fixe établie aux champs, dans la longueur d'une haie vive, fait de bois en forme d'échelons, de marchepied, et permettant d'être escaladée par une personne sans toutefois laisser passer le bétail. - (14) |
| échalée. Sorte de barrière immobile servant de passage dans les champs, ainsi nommée de ce qu'elle est composée d'échelons. Elle se distingue de la « clé » qui est mobile et fermée d'osier tressé , par corruption de claie , et de la soi ou bouçhure, qui est plutôt une haie. Soi vient du latin soepes. - (03) |
| échaler. v. a. Ecaler, Echaler des noix. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| échaleure. s. f. Ecale. - (10) |
| échalle : échelle - (48) |
| échalle, s. f. échelle. - (08) |
| échaloter, v. a. enlever le brou des noix, dépouiller les noisettes de leur enveloppe. - (08) |
| échalouaine : n. f. Grosse noisette. - (53) |
| échambourrer. v. a. Battre le chanvre. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| échame: Ecale, coque. « Eune échaïlle de cala (noix) » ; il ne faut pas confondre l'échaïlle (écale) avec la cruge (coquille). - (19) |
| échanbrer, v. a. déchirer, spécialement ses habits. - (24) |
| échanbrouté, adj. se dit d'un blé dont les tiges sont affaissées est mélangées. - (22) |
| échandir : v. a., vx fr., échauffer. Voir réchandre. - (20) |
| échandir, v. tr., échauffer : « Alle aivot les dèts gòbes ; j’les y ai échandis. » - (14) |
| échaneau : Cheneau, gouttière pour recevoir l'eau des toits. « La pliô nos a pris à moitié chemin, j'ins été si bin saucés que la râ du cu no sarvait d'échaneau ». - (19) |
| echâner : mal traiter, en parlant de quelqu'un - (37) |
| écha-ner, chan-ner. Achever un animal blessé ou malade. - (49) |
| échan-ner : Finir, achever. « J'avais blessé in lièvre, man chin l'a échan-né ». - (19) |
| échanner, v. a. achever de tuer, de détruire. - (08) |
| échanplé ; une vigne, un arbre sont échanplés quand leur épiderme est détérioré par la gelée. Echanplure, la partie gelée. - (16) |
| échanson : officier dont les fonctions consistaient à servir à boire aux grands personnages. - (55) |
| écharar (provençal), écorcher, écharé (Écharé, littéralement, échauboulé, dont l'épiderme est enlevé par l'eau bouillante). - (04) |
| écharàyé, v. a. échauder. - (22) |
| écharàyer, v. a. échauder : la soupe trop chaude lui a écharàyé la langue. - (24) |
| écharboèyé : emmêlé, en désordre - (39) |
| écharboter, encharboter et encharbouter, v. tr., embarrasser, emmêler, embrouiller les fils d'un écheveau ; « Que qu't'as fait d'mon échevéte ? Te m'las toute écharbotée. » - (14) |
| écharboter. Ebouriffer. Se dit aussi de tout ce qui est filaments emmêlés, écheveaux de fil, plumes hérissées des oiseaux ; au figuré étonné avec une nuance d’embarras, etc… - (12) |
| écharbouter : Embrouiller, enchevêtrer. « Man fi est tot écharbouté ». Vieux français : encharboter. - (19) |
| écharbouter, mêler les brins du fil. - (05) |
| échard. s. m. Echarde. (Etivey). - (10) |
| échardon (n’) : chardon - (57) |
| échardonne. s. f. Chardonneret. (Malay-le-Vicomte). - (10) |
| échârée : effarée. (RDM. T II) - B - (25) |
| échârer (s'), v., se brûler avec de l'eau bouillante. - (40) |
| échârer : Ebouillanter. « Echârer eune tête de cochan », ébouillanter une hure de porc pour la blanchir. « La sope est treu chaude, alle m'échâre la gueule ». - Proverbe : « Chat échâré craint l'iau frade ». - (19) |
| écharer : échauder. Ébouillanter, ou faire subir à quelqu’un une mésaventure qui lui servira de leçon. - (62) |
| écharer, écharailler : v. a., échauder. - (20) |
| écharer, s'écharer : brûler, se brûler. - (56) |
| échàrer, v. tr., échauder, arroser d'eau bouillante, nettoyer. Dans la manipulation ménagère du sarrazin, on échâre la farine que l'on veut pétrir pour la mettre en pain : « I m'seû échàré la main d'avou d'liau boulante. » - (14) |
| échargner, écharnir : v. a. et n., vx fr., syn. de rechagner. - (20) |
| écharigné et échareugné. Déchiré, arraché, mis en morceaux. I Ile ne sait tant seulement pas découper eun poulet : en voiqui eun qu'ast tout échareugné. Le cadavre d'un animal est écharoigné par les loups et les renards. - (13) |
| èch'arji : v. éclaircir les jeunes pousses trop serrées. - (21) |
| écharmet, s. m., écharmée (?) : s. f., syn. de massout. - (20) |
| écharmonge. Rhume de cerveau, grippe, avoir l’écharmonge, être enchifrené. Impossible de découvrir l'origine de ce mot extraordinaire. - (12) |
| écharné, v. a. répéter un mot en écho, par moquerie : ce galopin écharne sa grand-mère. - (22) |
| écharni, v. a. railler, moquer, contrefaire ironiquement. - (08) |
| echarnir : se moquer en imitant. - (09) |
| écharnir, échernir, acharnir. v. a. Contrefaire les manières, les cris, la voix, le langage de quelqu’un, en exagérant ce qu’il peut y avoir de ridicule. Les écoliers s’écharnissent souvent entre eux. - (10) |
| écharnir, railler, se moquer. - (04) |
| écharnir. v. - Imiter, se moquer avec gentillesse : « Je vous défends de m'écharnir ! Si vous croyez que c'est plus élégant votre r parisien qu'on grasseye du fond de la gorge, comme un gargarisme. » (Colette, Claudine à Paris, p.l99). Eschamir est un mot employé dès le Xe siècle dans le sens de railler, tourner en dérision, ou bien outrager, injurier. L'usage poyaudin n'a gardé que le sens de moquerie légère. Voir aussi achamir. - (42) |
| écharogner : vx fr., syn. de charogner. - (20) |
| écharogni : Couper avec maladresse, de telle façon que ce soit déchiqueté. - (19) |
| écharogni, v. a. découper maladroitement avec arrachement. - (24) |
| écharougni, v. a. découper maladroitement avec arrachement. - (22) |
| écharouter. v. a. Asticoter, larder, taquiner. Sans doute pour charcuter. (Soucy). - (10) |
| écharpeter (s'), v. r. s'échauffer, se fâcher en discutant. - (24) |
| écharpiller : vx fr., syn. de charpiller. - (20) |
| écharpiller, v. tr., coupasser, mettre en pièces : « L'vau ran ! ô m'a tout du long ècharpillé sa bliaude. » - (14) |
| écharpiller. Disperser, répandre çà et là. - (49) |
| écharpiller. v. - Déchiqueter, réduire en miettes. - (42) |
| écharpiller. v. a. Mettre en pièces, réduire en miettes, en charpie. (Puysaie). - (10) |
| écharré. adj. - Échaudé. - (42) |
| écharré. adj. Echaudé. - (10) |
| écharre. La Monnoye a dit que ce mot ne signifie pas seulement rustre et grossier, mais chiche et avare... - (02) |
| echarre. On appelle ainsi à Dijon les vignerons les plus rustres, qui parlent le bourguignon le plus exquis ; le langage desquels est par conséquent le plus grossier, mais qui semblent se piquer, et se faire honneur de cette grossièreté… - (01) |
| echarre. : Chiche, parcimonieux, avare. – Le dialecte écrit échars, qui vient de la basse latinité scarpus (Duc.), et a même signification. On appelait écharre les vignerons les plus pauvres et les plus grossiers et qui se piquaient de plus de rusticité dans le langage. - (06) |
| échârrer (s’) : (se) brûler avec un liquide bouillant - (37) |
| écharrer : ébouillanter - (57) |
| écharrer, laver à l'eau bouillante. - (05) |
| écharrer, v, ébouillanter. - (38) |
| écharrer. Échauder ; brûler avec de l'eau bouillante. - (49) |
| écharrer. Échauder ; du mot français charrée, cendre qui reste sur le cuvier après qu'on a fait couler la lessive. - (03) |
| échâs : Nom de lieu bordant un bois. Les échas. Essarts. - (19) |
| échas, s. m. plur. débris en général, épluchure, rognure; déchet de la nourriture des animaux. - (08) |
| échasigner. v. a. Irriter. (Mont-Saint-Sulpice). - (10) |
| échaté, v. a. enlever l'épiderme par brûlure. - (22) |
| échater, v. a. enlever l'épiderme par brûlure : échater des pieds de veau. - (24) |
| échatir : (èchati - v. trans.) rendre "chat", gâter (un enfant, un animal). - (45) |
| échatrer (échâtrer) : v. a., châtrer. - (20) |
| échattes : (nfpl) éclats de bois, copeaux - (35) |
| échauder : faire la vaisselle. - (66) |
| échauder, v. laver la vaisselle. - (65) |
| échaudou, n.m. lavette pour la vaisselle. - (65) |
| echaufai. Echauffé, échauffez, échauffés, échauffer. - (01) |
| échaufâïon, s. f. échauffaison, échauffement avec ou sans éruption causée par une inflammation. - (08) |
| échaufaison, s. f., pleurésie. - (14) |
| échaufer, v. n. s'échauffer, se réchaufïer. Il fait si froid que je ne peux « échaufer ». - (08) |
| échauferdi. n. m. - Chaud et froid ; synonyme de chauraferdi : « Te vas attraper un échauferdi. » (Saint-Verain, selon M. Jossier) - (42) |
| échauffaijan : Echauffement, constipation. « O seuffre d'une échauffaijan ». - (19) |
| échauffision. Échauffement du sang, des intestins, inflammation. - (49) |
| echaufi. J’échauffai, tu échauffas, il échauffa. - (01) |
| échaulaillé : part, -pass., qui a un élourdissement, qui éprouve un malaise accompagné de sueurs et de nausées. J' suis toute échaulaillée. - (20) |
| échaulàyé, v. n. transpirer d'impatience : quand il raconte ses histoires sans fin, j'en échaulàye. - (22) |
| échaulàyer, v. n. transpirer d'impatience : quand il raconte ses histoires sans fin, j'en échaulàye. - (24) |
| échaumée : largeur 12-14 rayons, semée à la main - (39) |
| èchaumée : s. f. bande de terre que le semeur peut couvrir de grains d'un seul geste. - (21) |
| échaumer. v. a. Défricher. - (10) |
| èchaumi : (èchô:mi - v. intr.) avorter, en parlant des céréales. On dit que la graine "achaumit" lorsque, envahie par la mauvaise herbe, elle jaunit avant l' heure, avant que le grain n' ait eu le temps de mûrir complètement. - (45) |
| échaurée, n.m. bouffée de chaleur. - (65) |
| échaûrée, s. f., bouffée de chaleur de la ménopause. - (40) |
| échaurer (v.t.) : échauder, brûler - (50) |
| échaurer. Brûler avec de l'eau chaude. Ton couchon de lait nast pas aissez échauré ; t’airez de lai pone pour airraîcher ses pois. Essorer du linge, c'est faire égoutter l’eau chaude qu'il contient. Ce dernier mot n’est pas usité en Bourgogne. - (13) |
| échaviau. s. m. Echeveau. (Irancy). - (10) |
| échavoeu*, s. m. dévidoir de fileuse. - (22) |
| échavon, s. m., dévidoir à main. - (14) |
| échavotte, échevette, échevotte. s. f. Echeveau. - (10) |
| échavotte, s. f. écheveau de fil. - (08) |
| échavou : dévidoir. (S. T IV) - S&L - (25) |
| échavou : Dévidoir. « O n'arrâte pas de causer, y est in vra échavou » : il ne cesse de parler, il dévide des paroles. - (19) |
| èchavou : s. m. dévidoir. - (21) |
| échavou, s. m. dévidoir de fileuse ; on dit aussi dévediou. - (24) |
| échavou, s. m., vx fr. eschavolr, rouet, dévidoir. Marcher comme un échavou, aller très vite. - (20) |
| échavoué. s. m. Dévidoir. (Massangy). - (10) |
| échay-inte, échalote. - (26) |
| écheigné, part. passé. échiné : « i seu écheigné. » - (08) |
| écheille. Enveloppe des épis de maïs. écheiller, c'est ôté cette enveloppe. - (03) |
| écheiller : enlever les feuilles autour des épis de maïs. (CH. T II) - S&L - (25) |
| ècheillöte, sf. échalote. - (17) |
| echeintre : extrémité des sillons - (60) |
| èchéle, sf. échelle. - (17) |
| écheler. v. a. Ecaler. — S’écheler. v. pronom. Se dit des noix dont le brou se détache naturellement. - (10) |
| échelier, échalier. s. m. Petite échelle double disposée pour franchir une haie, au point où cette haie coupe un chemin rural traversant deux ou plusieurs propriétés. (Puysaie). - (10) |
| échelle a pain : s. f., échelle dont les montants ne sont reliés qu'à leurs extrémités et dont les barreaux, perpendiculaires au plan de ces montants, s'en détachent en avant l'un à la hauteur de l'autre. Chaque miche de pain repose à plat sur deux barreaux correspondants. Ces échelles à pain, spéciales à la campagne, ont presque disparu aujourd'hui. - (20) |
| échelle douce : s. f., escabeau à échelle. Voir Nouv. Larousse illustré, v° Escabeau, flg. 5. - (20) |
| échelli (n') : passage (aménagé dans un buisson) - (57) |
| échelnie. s. f. Chanille. (Béru). - (10) |
| échelon. s. m. Brou, coque verte dont la noix se dépouille, quand elle est mûre. - (10) |
| échelotte : petite « échelle » en bois aux extrémités d'un chariot pour le transport du foin - (46) |
| échelotte. Échalotte. - (49) |
| echelotte. n. f. -Ridelle. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| échelottes. s. m. Ridelles d’une voiture. (Villemer). - (10) |
| échenard, s. m., têtard de ruisseau. - (40) |
| échenau (n.m.) : chéneau, gouttière - (50) |
| échenau, n.m. chéneau. - (65) |
| échenau, s. m. échenal, gouttière, conduit pour les eaux pluviales. - (08) |
| échené : chêneau, gouttière, landier, chenet de cheminée. - (52) |
| echené : Echine. « In noud d'échéné », un quartier de porc pris dans l'échine d'une vertèbre à l'autre. - (19) |
| echeneau : chêneau - (44) |
| écheneau ou chanette - conduite pour les eaux des toits. - I và fare raiquemaudai les échenaux de note écurie qui perdant l'aie. - En ne peu pâ mettre des échenaux és couvert de paille. - (18) |
| écheneau, s. m., chêneau, chenal, gouttière : « L’écheneau a eùn portu ; l'iau j'icle à travar. » - (14) |
| écheneau, subst. masculin : chéneau. - (54) |
| écheneau. Chéneau. - (49) |
| échenée - voyez aichnée, bien que &chenée soit plus correct. - (18) |
| echenée, morceau de porc coupé sur l'échine. - (27) |
| echenet : gouttière. - (09) |
| échenet. n. m. - Gouttière. - (42) |
| échenet. s. m. Une des formes de chenau, conduit, gouttière. Du latin canalis. — A Accolay et dans tant d’autres localités, échenet se dit pour chenet. - (10) |
| échenets : chêneaux, gouttières. Landiers, chenets de cheminée. - (33) |
| échenets, s. m., pl., chenets, landiers. - (40) |
| échenillé, ée. adj. Se dit, à Villiers-Saint-Benoît, d’un enfant chétif, malingre, qui est comme un arbre dévoré par les chenilles. - (10) |
| écheper : Trébucher. « Je me sus-t-échepé dans eune range, j'ai manqué me foutre à bas », je me suis pris le pied dans une ronce, j'ai failli tomber. - (19) |
| écheprené : ébouriffé - (57) |
| écheprené : échevelé - (57) |
| échepreuner : décoiffer - (57) |
| échèrèiller : (échèrèyé - v. tr.) essoriller, arracher les oreilles. Au fig., battre violemment. - (45) |
| échèrni, v. a. répéter un mot en écho, par moquerie : ce galopin échèrnit sa grand' mère (du vieux français échernir, moquer). - (24) |
| écherpie, massacre. Le latin e carne y est pour quelque chose ; on disait aussi eschaipporay... - (02) |
| échesse (n’) : échasse - (57) |
| échetai, ou aichetai - s'asseoir. - A n'ant fait que s'échetai in manmant en passant. - Echetez vo don ine minute qui causain un pecho. - Moins usité que cheurtai ; voyez ce mot. - (18) |
| èchetè : acheter - (46) |
| écheté : assis. - (33) |
| écheter (S’). v. pron. S’asseoir. (Sermizelles). — écheu-te, asseois-toi. (Saint-Germain-des-Champs). - (10) |
| écheter, v. tr., acheter. - (14) |
| échetoux. s. m. Acheteur. - (10) |
| échette. s. f. Echeveau. (Athie). - (10) |
| écheuchener : (écheuch’nè – part. passé pris comme adjectif) recru de fatigue, épuisé. - (45) |
| ècheuilli : v. effeuiller le maïs. - (21) |
| écheule : Echelle. « Fare l'écheule », faire la courte échelle. « Echeule de mûnè », échelle de meunier, escalier en bois, très rapide, qui conduit au grenier. - (19) |
| écheûler, v., rabattre les feuilles de maïs. - (40) |
| écheulle (n’) : échelle - (57) |
| ècheulle : s. f. échelle. - (21) |
| écheûte : Se dit des fruits et en particulier des noix qui tombent sur le terrain appartenant au voisin. « Le quart de l'écheute d'in noué revint au chapliou », le quart des noix qui tombent chez le voisin revient à celui qui gaule le noyer. - (19) |
| echevan. Achevant. - (01) |
| échevasser, échavasser : v. a., enlever la chevasse. - (20) |
| écheveleuré, e, adj. celui qui a les cheveux, la chevelure en désordre. - (08) |
| écheveloté, adj., échevelé. - (14) |
| échevéte, s. f., écheveau : « Beill'-me eùne éch'vèt' de fî. » Certain tisserand ne manquait jamais, quand la besogne ou le vin blanc le mettait en colère, de jeter à la tête de sa femme un écheveau de son gros fil. C'était si fréquent et si connu, qu'on le surnomma Bernard-l’échevête. - (14) |
| échevette : Echeveau. « Eune échevette de fi roge » : un écheveau de fil rouge. - (19) |
| échevolée, s. f. bouture de vigne mise à raciner. - (24) |
| échevoulé, s. m. bouture de vigne mise à raciner. - (22) |
| échèye, feuille de maïs. - (16) |
| echi : essieu. A - B - (41) |
| échi : Essieu. « Les vieux chais avint des échis en beu, aujord'heu les échis sant en fé », les vieux chars avaient des essieux en bois, aujourd'hui les essieux sont en fer. - (19) |
| échi : s. m. essieu de la voiture. - (21) |
| échiairdi : éclaircir - (43) |
| échicle (Chal., Br., Morv.), échiqui (Morv.). - Eclat de bois, fragment aigu, écharde. Echarde et échicle ont la même signification, mais non la même origine. Echarde, du vieux français escbarde, a chardon pour racine, tandis que échicle vient du vieux français esclice, signifiant éclat, qui a fourni le mot éclisse, actuellement employé en chirurgie pour désigner les planchettes de bois destinées à maintenir en place les os fracturés. Dans l'Y onne,écicler signifie faire des éclisses, mais ce dernier mot désigne des claies d'osier ; écicler veut dire alors tresser des claies. - (15) |
| échicle : écharde. - (62) |
| échicle ou échiclai - petit éclat de bois ; faire ce petit éclat ; casser une branche contre le tronc même. - Ine échicle m'é percé le pied. - I me seu fourai ine échicle sô l'ongle. - (18) |
| échicle, échiye, écharde. - (28) |
| échicle, s. f., écharde de bois, arête de poisson. - (40) |
| échicle, s. f., petite lame soulevée dans un morceau de bois, écharde : « I m'seù foré eùne échicle dans l'dèt ; ô m'fâ bé mau. » - (14) |
| échicle. Echarde, tous les petits corps aigus, de quelque matière qu'ils soient, susceptibles de piquer la peau et de s'introduire dans l’épiderme. Etym. forme locale d'éclisse. - (12) |
| échicle. Fragment, éclat de bois. - (03) |
| échicle. Petit éclat de bois qui s'enfonce dans la peau des mains en travaillant. I me seûs enfoncé eune grosse échicle en faisant des paissias. Dans quelques pays, on dit une écharde. Il faut rapprocher ce mot de chicot et d’éclisse. - (13) |
| échicler. Produire des échicles. Mais ce verbe a plutôt la forme pronominale que la forme active. - (12) |
| échic'lle : Echarde. « Arrège me dan c'te échic'lle que je me sus fôrrée seu l'ang'lle », arrache moi donc cette écharde que je me suis fourrée sous l'ongle. - (19) |
| échic'llier : Ecailler. « Ol a fait c’eure des greus brochets sans les échic’llier ». - (19) |
| échier. s. m. Echelier, petite échelle double pour passer de l’autre côté d’une haie vive. (Saint-Sauveur). - (10) |
| échieu. Essieu. - (49) |
| échigne, s. f., échine. - (14) |
| èchigné, vt. échiner. - (17) |
| échigner (pour échiner). v. a. Voyez éssener. - (10) |
| échigner (s'), v. pron., se fatiguer beaucoup : « D'peû c't été, j’m'échigne gros en sâclant. » - (14) |
| échigner, v. tr., échiner, éreinter : « O n'nous lâsse point d'répit ; ôl échigne son monde. » - (14) |
| échikye, écharde, petit morceau de bois qui a pénétré dans un doigt, dans la main. - (16) |
| échikyé, terrain qui s'élargit et en grandit un moins large qui lui est attenant. - (16) |
| échille, esquille. - (26) |
| èchin : (èchin - subst. m.) essaim. - (45) |
| echiné, fatigué des reins. - (27) |
| échiné. Synonyme de courbaturé. - (13) |
| èchingne, sf. échine. - (17) |
| echintre, nom que portent quelques terrains dans la toponomastique rurale = chaintre avec prosthèse de l'e. (Voir : chintre, cinte.) - (08) |
| echiqhi', s. m. éclisse, éclat de bois ou de toute autre matière fendue ou brisée. - (08) |
| échique (n.f.) : éclisse, éclat de bois - (50) |
| échique : s. f., écharde. - (20) |
| échiquie : une écharde, une épine dans le doigt. On dit également échiquye. - (46) |
| échiquier, v. a. éclater, mettre en éclats, en morceaux. - (08) |
| échiqu'ye : (échiky' - subst. f.) 1- écharde. Au premier sens, le fr. éclisse signifie "petit morceau de bois en forme de coin". 2-éclisse, sorte de dessous de plat tressé et pourvu d'une poignée. - (45) |
| échitat. s. m. Petit banc. (Soumaintrain). - (10) |
| èchitre : asseoir. Èchitu : assis. Èchi-tè : assieds-toi. - (52) |
| échityeu : écharde. - (29) |
| échivoulai, s.m. rejet, bouture, plante nouvelle. - (38) |
| échler (S’). v. pron. s’asseoir. - (10) |
| échllianer, v. a. arracher une branche à son point d'insertion, avec déchirure : le vent a échlliané les sarments. Déchirer ses habits. - (24) |
| échlliauné, v. a. arracher une branche à son point d'insertion, avec déchirure. - (22) |
| échlliazi, v. a. éclaircir. - (22) |
| échllièrdi, v. a. éclaircir : le ciel s’èchllièrdit ; échllièrdir des salades. - (24) |
| éch'nau : chéneau - (48) |
| échnau n.m. Chèneau. - (63) |
| èchnau : s. m. chéneau. - (21) |
| éch'nau, s.m. chéneau. - (38) |
| éch'neau : n. m. Chêneau. - (53) |
| éch'nets : chenets, landiers - (48) |
| éch'nilli : écheniller - (57) |
| échôdé, laver la vaisselle à l'eau chaude. - (16) |
| échœfté (s'), v. r. s'échauffer en discutant. On dit aussi échevéssi (s’). - (22) |
| échoinge (n.m.) : échange - (50) |
| échoinge, s. m. échange, troc d'une chose pour une autre. - (08) |
| échoinger (v.t.) : échanger - (50) |
| échoinger, v. a. échanger. - (08) |
| échole : feuille de l'épis de maïs. - (31) |
| écholé : (écholé - subst. m.) petite barrière fixe qui permet aux chasseurs de franchir une haie sans l'endommager. - (45) |
| échole. Brou de la noix, d'où écholer, en français écaler. On a dérivé ce mot du germain scalja, tuile, du latin scotum, peau, ou de squamma, écaille. Je pense qu'il y a un radical primitif d'où sont venus écorse, écosser, écaille, échalotte, etc... - (13) |
| écholée (n.f.) : échalier ; passage dans une haie - (50) |
| écholée : échalier, passage dans une haie - (48) |
| écholée, s. f. échalier, ouverture et passage dans une haie vive où se place ordinairement une petite échelle. Quelques parties du prononcent « éçohié. » - (08) |
| écholet : petite échelle pour franchir un obstacle dans un sentier ou une haie. - (33) |
| échollet, n. masc. ; fermeture, en forme d'échelle, couchée en travers d'une haie. - (07) |
| échorai - brûler fortement par de l'eau chaude. - Lai chaudére s'a renvervée, al é aivu les jambes échorées. – An te fau échorai ces pieds de couchon. - (18) |
| échordaïlli : Assourdir, rompre les oreilles. « Ne gueule dan pas si feu, te m 'échordaïlles », ne crie pas si fort tu m'assourdis. - (19) |
| échòrder, v. n. faire un tapage à rendre sourd : ils mont échòrdé. - (24) |
| échorè : v. t. Échauder. - (53) |
| échorer (s' ) : brûler (se) (en général avec de l'eau bouillante), ébouillanter - (48) |
| échorer (s') : (s’échôrè - v. pron.) se brûler. - (45) |
| échorer, v. a. laver ou enlever la peau avec de l'eau chaude. On « échore » certaines viandes avant de les faire cuire ; on « échore » un porc pour détacher la soie. « Écharer » - (08) |
| échot : Partie de fléau que le batteur tient dans ses deux mains. - (19) |
| èchou : s. m. manche du fléau. - (21) |
| échouaîr : échoir - (57) |
| échouére : échoir - (48) |
| échoueste, s.f. fruit qui tombe d'un arbre penché sur le terrain du voisin. - (38) |
| échouétot. s. m. Compartiment à l’extrémité d’un coffre. (Diges). - (10) |
| échouette. s. f. Ce qui tombe des fruits d’un arbre chez le voisin. (Villeneuve-sur-Yonne). — En navigation, se dit d’un point d'une rivière où le courant vient échouer ; ce qui a lieu ordinairement dans une anse, dans un coude, dans un tournant. - (10) |
| échoumacher. Voyez éssoumasser. - (10) |
| échoumas, éssoumas. s. m.pl. Rognures de la vigne. - (10) |
| éch'tai (s’) : s'asseoir. Écheut'toi : assieds-toi. - (33) |
| éch'tiner, v., enlever les ch'tin (pousses de la vigne). - (40) |
| éch'ton : siège en bois. Un bon éch'ton ç'o toujours ben : un bon siège c'est toujours bien. - (33) |
| échupper, échoupper : v. a., chuffer, chupper, appeler. - (20) |
| éch'veau (n’) : écheveau - (57) |
| èchveulé, vt. enlever les tiges des pommes de terre, les feuilles des betteraves. - (17) |
| èchveulon, sm. tige de pomme de terre, feuille de betterave, de carotte. par ext. : personne mal peignée, les cheveux au vent. - (17) |
| écicler. v. - Faire des éclisses, tresser des brins d'osier pour la vannerie. - (42) |
| écicler. v. a. Faire des éclisses. — Se dit aussi de l’action de tresser des brins d’osier, des branches flexibles, pour faire des claies, des paniers et autres ouvrages de vannerie. (Puysaie). - (10) |
| éciou : éclos Tous les œufs sont éciou y en aivo deux de p'nas : tous les œufs sont éclos, il y en avait deux de punais. - (33) |
| éclafons, s .m. pl., débris provenant de la fabrication des échalas. - (40) |
| éclaiforai, éclaforai, écapourai. Ces trois mots paraissent synonymes et signifient briser, écraser, éparpiller, disperser... A Châtillon, l'on dit : écafouiller un œuf... - (02) |
| éclair, n.f. éclair, mais le genre est féminin. - (65) |
| éclaircie : (nf) clairière - (35) |
| éclaircie, n.f. clairière. - (65) |
| éclaire, éclairdôle : s. f., éclaircie (dans un ciel nuageux). - (20) |
| éclairer : v. a., allumer. Eclairer le feu. Eclairer la chandelle. Voir clairer. - (20) |
| eclaite. J'éclate, tu éclates, il éclate. « Ai fau qu’anfin j'éclaite », il faut qu^enlin j’éclate, que je fasse éclat, que je rompe le silence en chantant de toute ma force. - (01) |
| éclâler, v. a. éclater, fendre, mettre en morceaux : « éclaler » du bois ; « éclaler » une bûche, un arbre. - (08) |
| éclanchai. On dit, à Châtillon, églancher quelqu'un, c.-à-d. lancer de l'eau involontairement sur les vêtements d'une personne en piétinant vers elle. Dans l'idiome breton, glann ou klann signifie rivière. - (02) |
| éclanche : gros éclat de bois. - (30) |
| éclanché. : Éclabousser. - (06) |
| éclancher : fendre une planche en éclats. - (30) |
| éclancher. v. a. Couper une cuisse de mouton, la séparer du corps. - (10) |
| éclaper, éclaponner : v. a. et n., fendre, éclater. - (20) |
| éclapon : s. m., vx fr. esclape, éclat de bols. Voir clapon. - (20) |
| éclapon, s.m. éclat de bois d'échalas ; personne longue et mince. - (38) |
| éclarcie : clairière. - (62) |
| éclarivaux, s. m., plate-forme d'une tour ou d'un clocher. - (40) |
| éclasser. v. a . Casser, fendre une tige de bois de manière à enlever l’aubier par lames minces propres à faire des éclisses pour la vannerie. Ce mot est formé d’éclat. (Sommecaise). — S’éclasser. v. pronom. Eclater, se fendre en éclats. Se dit du bois qui s’éclate et se fend sous l’influence de la sécheresse ou de la gelée. (Villiers-Saint-Benoît). - (10) |
| écliâfer : Arracher en déchirant, se dit d'une branche d'arbre que l'on sépare violemment du tronc. - (19) |
| écliaforai - écarbouiller, briser en mille morceaux, un peu le même sens que que écafoillai. - I aivins in joli pot de flieurs, al é choué et pu a s'a écliaforai. - (18) |
| écliaifai - éclater, vieux mot qui n'est plus aujourd'hui que dans le patois. - Al à joliment drôle ! An ne peut pas la voir ni l'entendre sans que to le monde écliaife de rire. - (18) |
| écliargi : Eclaircir. « Le temps s'ecliargi », le ciel s'éclaircit. « Ecliargi des carottes », en enlever une partie pour permettre aux autres plants de mieux se développer. - (19) |
| ecliargie : Eclaircie, en parlant du temps. - (19) |
| ecliç’e : écharde - (37) |
| écliche, subst. féminin : écharde. - (54) |
| écliche. Écharde. Fig. Écaille de poisson. - (49) |
| éclicher. Écailler des poissons c'est « les éclicher ». - (49) |
| éclieupé : Eclopé. « O ne peut pas travailli, ol est tot éclieupé ». - (19) |
| éclincher. v. a. Eclabousser. - (10) |
| écliore : En tricotant, fermer le talon d'un bas ou d'une chaussette. - (19) |
| écliose : Ecluse. « L’écliose du melin ». - (19) |
| écliosée : La quantité d'eau contenue dans l'écluse au-dessus du niveau inférieur de la vanne d'écoulement. - (19) |
| éclisse, s.f, écumoir. - (38) |
| éclisser, églisser. v. a. Eclabousser. (Saint-Florentin). - (10) |
| éclisser. v. a. Mettre, poser des éclisses autour d’un membre fracturé. (St-Martin-sur-Ouanne). - (10) |
| éclô (prononcez écleu), hors de défense ; du latin exclusus. - (02) |
| eclô. Hors de défense. Quand un homme est déconcerté, qu’il est réduit à ne pouvoir répondre, on dit qu’el ai éclô… - (01) |
| eclô. : Déconcerté. - (06) |
| éclore. Éclore. - (01) |
| éc'mer : Ecumer. « Y est temps d’ec’mer la sope ». - (19) |
| éc'meudé, accommoder ; éc'meudè dëz eu, accommoder des oeufs. - (16) |
| éc'moire : Ecumoire. Au figuré on dit d'une personne fortement marquée de petite vérole : « Y est eune vra éc 'moire ». - (19) |
| écmouder. v. a. Accommoder. (Prégilbert). - (10) |
| ècmoure : s. m. écumoire. - (21) |
| eco : brindille. A - B - (41) |
| eco : brindille de bois ou d'épine - (34) |
| éco : brindille de bois ou d'épine - (43) |
| ècö, öte, adj. endolori : se dit des personnes qui souffrent d'une inflammation entre les cuisses, causée par la chaleur. - (17) |
| écoche (n’) : passage (libre dans un buisson) - (57) |
| écodai, accorder. - (02) |
| ecode. Accorde, accordes, accordent. - (01) |
| écoder, accorder. - (26) |
| écoeuillai. : Delmasse orthographie ainsi ; d'autres écrivent équelai, c'est-à-dire abaisser, mettre à cul.- Un soulier écueulé (autre orthographe encore) est celui dont le quartier est brisé et replié en dedans. - (06) |
| écœur (pour cœur). s. m. Se dit de la masse intérieure d’un pain mal levé, dont la croûte se détache en éclats, et qui est ainsi appelée sans doute parce que, en cet état, elle ressemble à l’écœur d’un de ces arbres malades, qui s’isole de son aubier et semble n’avoir plus aucune adhérence avec lui. (Villièrs-Saint-Benoît). - (10) |
| écoeure (n. f.) : partie mal cuite dans un gâteau - (64) |
| ècœurjou, sm. être faible et chétif ; avorton. - (17) |
| ècofe, sf. coque, coquille, cosse de pois. - (17) |
| écoi. s. m. Abri. Se mettre à l’écoi. (Puysaie). - (10) |
| écoicher, v. tr., écorcher, fendre, casser, déchirer : « T'vas écoicher c'te branche d'âbre. » — « J'ai manqué d'écoicher ma bout'neire. » - (14) |
| écoïé, s. m. écolier, enfant qui va à l'école. - (08) |
| écoïer, s. m., écolier. - (14) |
| écoin : s. m., coin, angle. Terre en écoin, terre formant une saillie anguleuse. - (20) |
| écoin, s. m. angle irrégulier dans une parcelle de terrain. - (22) |
| écoin, s. m. angle irrégulier dans une parcelle de terrain. - (24) |
| écoinceure, s. f. encoignure, coin, angle : l’ « écoinceure » d'un chemin, d'un champ, d'un bois. - (08) |
| écoinçon (en), loc. de biais, en travers. - (08) |
| ecoinçon : petit triangle. - (09) |
| écoité : las, effondré. - (62) |
| éçole, s. f. échelle. (Voir : échalle.) - (08) |
| écôle, s. f., école. (La jeune génération prononce école.) - (14) |
| ecole. Ecole, écoles. C’est aussi le verbe écoule, écoules, écoulent. - (01) |
| écôler, accoler les sarments de vigne avec de la paille. - (27) |
| eçoler, v. a. attacher la vigne après le cep ou la treille. - (08) |
| écomion. s. m. Limace. (Vincelottes). - (10) |
| écôner. Ecorner. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| éconfor, s. m. effort dans une crise quelconque physique ou morale. - (08) |
| èconné, vt. écorner. - (17) |
| écooûté une vigne : accoler ses sarments aux paisseaux. - (16) |
| écôquignai (s'), se trouver bien quelque part... - (02) |
| écôquignai (s'). : Se trouver bien quelque part ; prendre goût à la cuisine de son hôte (du bas latin coquina.) [Duc.] - (06) |
| écorcer : écorcher - (39) |
| écorcer, v. a. écorcher, enlever la peau. - (08) |
| écorçeux n.m. Ecorçoir. - (63) |
| écorcher, v. dépouiller (écorcher un lapin). - (65) |
| écorcher. v. - Dépouiller un lapin, un lièvre. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| écorchi : écorcher - (57) |
| écorchon.s. m. Petite écorchure. (Saint-Florentin). - (10) |
| écorder, v. tr., accorder. - (14) |
| écôre : Battre le blé au fléau. « Dan in temps an passait la moitié de l'hivé à écôre, à présent an bat à la mécanique, y est fait to de suite ». - (19) |
| écorer (s'), v. pr., s'époumoner en criant de toutes ses forces. - (11) |
| écorgie, s. f. fouet, corde, baguette flexible. - (08) |
| écorièt. Écureuil. - (49) |
| ecorna : arbre que l'on a élagué (têtard) - (51) |
| écornâ n.m. Têtard (arbre). - (63) |
| écorna. Arbre dont on coupe les branches tous les 3 ou 4 ans. - (49) |
| ecornat : arbre dans un buisson dont on a coupé toutes les branches basses pour faire du bois de chauffage. A - B - (41) |
| ecornat : arbre dont on coupe les branches latérales, pour le chauffage - (34) |
| écornat, trontse : arbre élagué dont les branches sont utilisées pour le chauffage et les feuilles ont données aux chèvres - (43) |
| ecornée, subs. fém. chêne auquel on a coupé la tête en ne laissant subsister que le tronc. - (11) |
| ecorner : couper les branches d'un ecornat*. A - B - (41) |
| écorner : (vb) émonder - (35) |
| ecorner : couper les branches d'un écornât - (34) |
| écorner : ébrancher un arbre - (43) |
| ecorner : élaguer - (51) |
| écorner ou ébronder. Élaguer, émonder. - (49) |
| écorner : v. a. Ecorner les oreilles, les fatiguer de bruit. - (20) |
| écorner, v. a. couper, enlever la corne, la saillie d'un arbre. - (08) |
| écorniller, v. a. donner des coups de corne : les taureaux ont « écornillé » un homme. - (08) |
| écornoû (n.m.) : arbre étêté - (50) |
| écornu n. m. Châtaigne d'eau ou mâcre, portant différents noms régionaux dont mâgre, macle nageante ou truffe d'eau ou marron d'eau ou noix aquatique ou cornes-du-diable ou noix de Jésuite ou cornelle. - (63) |
| écornue : (nf) châtaigne d’eau - (35) |
| écornue : châtaigne d'eau avec de grandes feuilles larges - (43) |
| écornue, écornure. s. f. Chêne coupé en têtard, comme un saule. (Diges). - (10) |
| ecorou (écoru) : écureuil - (51) |
| écorrues, s.f.pl. le fait de s'élancer sur quelqu'un. - (38) |
| écorsené une vigne : l'affranchir de ses jeunes tiges inutiles. - (16) |
| écortsi : égratigné - (43) |
| écortsi v. Ecorcher. Voir égrougi. - (63) |
| ecoru (écorou) : écureuil - (51) |
| écoru : (nm) écureuil - (35) |
| écorû : Ecureuil. « O se démene c’ment in écorû dans sa caige ». - (19) |
| écôsse : (nf) écorce - (35) |
| écosse : s. f., cosse. - (20) |
| ecosse, s. f., cosse, enveloppe des graines légumineuses, pois, fèves, etc. - (14) |
| écosseilles : Période pendant laquelle on bat au fléau. « Cen s'est fait padant les écosseilles » (du verbe écore, battre au fléau). - (19) |
| écôssi : (vb) écorcer - (35) |
| ecossou : fléau (en A : cho*). A - B - (41) |
| écôssou : (nm) fléau - (35) |
| écossou : fléau - (43) |
| ecossou : fléau (qui retire des cosses) - (51) |
| ecossumè : accablé de reproches. (ALR. T II) - B - (25) |
| ecot (à l') : abri. - (09) |
| écot : petit bois d’allumage sec pour démarrer un feu. - (62) |
| écot n.m. (du francique skot, pousse, rejet) Menu débris de bois en pourtour de champ, sous les arbres. - (63) |
| écot, s.m. sarment de vigne sec, coupé, - (38) |
| écot. Petit morceau de bois sec. - (03) |
| écot. Petit morceau de branche sèche. - (49) |
| écot. s. m., petit morceau de bois sec, mais plus gros que l’échicle : « Oh ! le ch'ti drôle! ôl é sec coume eùn écot. » - (14) |
| écotai, ou aicotai - c'est à peu près le même sens que cottai. - (18) |
| écotat : (nm) éclat de bois - (35) |
| écote (pour accoté). adj. Terme par lequel les mariniers de l’Yonne indiquent q'un bateau a perdu son aplomb et qu’un de ses côtés est à sec sur un perré, sur une berge ou sur des sables, tandis que l’autre plonge dans l’eau. Les mariniers n’ont pas eu la précaution de pousser leur bateau à mesure que l’eau baissait, à présent il est écoté sur la berge et on ne peut plus le ravoir, c’est-à-dire le remettre à flot. - (10) |
| écote (pour écoute). 2e pers. de l’impér. du verbe écoter (écouter). Attends. (Turny, Mâlay-le-Vicomte). - (10) |
| écôtée : une volée - (46) |
| écoter : effeuiller un chou vert - (43) |
| écoter : ramasser les brindilles - (43) |
| écoter v. Ramasser les écots. - (63) |
| écòter, v. a. enlever au râteau les menues épines dans un pré. - (24) |
| écoter. Couper, ôter les feuilles à certaines plantes, comme les betteraves, les choux, par exemple. - (49) |
| écôteûmance, s f., accoutumance. - (14) |
| ecôteûmer, v. tr., accoutumer. - (14) |
| écôtorre, appui, dossier de chaise ou de fauteuil... - (02) |
| écôtorre. : Appui, dossier de chaise ou de fauteuil. S'ecôtai signifie s'appuyer (rac. lat., costa) . - (06) |
| ecotsi : écosser des pois ou des haricots. A - B - (41) |
| écotsi : (vb) écosser - (35) |
| ecotsi : écosser des pois, des haricots - (34) |
| écotsi : écosser les petits pois, les haricots - (43) |
| écotsi v. Ecosser. - (63) |
| écou. : Battu, rendu, exténué. Écouai signifie battre. - Les écoussai ou écoussei sont les batteurs en grange. - Écourai, c'est battre les pailles de blé. Le verbe latin excutere est la racine de tous ces mots. - En Franche-Comté, le patois des Fourgs dit ecouore et celui de Mouthe équeure, comme exprimant l'acte de battre le blé dans la grange. (Tiss.) Venir à la rescousse, c'est prendre part à la bataille en faveur d'un des contendants. - (06) |
| ecouaiché : 1 v. t. Éreinter. - 2 v. t. Fatiguer. - (53) |
| écouale*, s. f. écuelle. - (22) |
| écouale, s. f. écuelle. - (24) |
| écouané, v. a. déchirer : ses habits sont écouanés. - (22) |
| écouaner, v. a. déchirer : ses habits sont écouanés. - (24) |
| écouârner : décorner - (57) |
| écouârner : écorner - (57) |
| écouarner, v. a. enlever la couenne ou motte de surface d'un gazon, d'un pré, etc. - (08) |
| écouaté, adj., fatigué, rompu. - (40) |
| écouauder : Arracher la queue à. « Le jeune chin s'est mi après ma pouleille nare, o ne l'a pas étran 'lli (étranglée) mâ ol l'a tote écouaudée » - (19) |
| écouauder, v. a. couper, rogner la queue d'un animal : un chat, un cheval « écouaudé. » - (08) |
| écoubi. adj. - Accroupi. - (42) |
| écouchî, v. tr., accoucher : « Voui, la Glaudine, àlle ét écouchie d'eùn gros garçon. » - (14) |
| ecouchi. Accouchai, accouchas, accoucha. - (01) |
| ecouchire. Accouchâmes, accouchâtes, accouchèrent. Le verbe accoucher est, comme on sait, tantôt neutre, tantôt actif. Quand il est neutre, c'est enfanter ; quand il est actif, c'est aider à enfanter. - (01) |
| écoué (à l') (loc. adv.) : à l'abri (s'mettre à l'écoué) - (64) |
| écoué (nom masculin) : (A l'). À l'abri. (Y va pleuvoir, mets te don à l'écoué sous I'châgne). - (47) |
| écoué, acoué (A l’). adj. et loc. adv. Se dit pour écoi, coi, à coi, à l’écoi, qui est à l’abri, à couvert de la pluie. Du latin quietus. (Etais). - (10) |
| écoué, ecoi (à l'). loc adv. - À l'abri : « A l'écoué, darriée ma bouchue, j's'rai assurée d'enn' vie d'bourgeouais ». (G. Chaînet, Én chicotant mes braisons, p.32) - (42) |
| ecouer : égrener. A - B - (41) |
| écouer : battre en parlant des céréales. (G. T II) - D - (25) |
| ecouer : égrener - (34) |
| écouer, écou, v. battre à la grange avec un fléau ; battre quelqu'un : ol l'écou, il l'a battu à plates coutures ; pleuvoir à verse : i'en écou, il pleut à verse. - (38) |
| ecouet : abri - (60) |
| ecoué-traichan. Ecuyer tranchant, officier qui coupe les viandes à un prince. - (01) |
| écouetter, couper, arracher la queue. - (05) |
| écoufle, épluchures. (Voir au mot cosse.) - (02) |
| écoufle. : Epluchures (voir au mot cosse). - (06) |
| écouillenai : écartelé. (C. T IV) - A - (25) |
| écouillonner : v. a., vx fr. escoillier, châtrer. S'applique aussi aux objets inanimés lorsqu'ils subissent la perte d'une partie essentielle, par exemple à la vis du pressoir à grand point quand la mortaise vient à sauter. - (20) |
| ecouillou. n. m. - Écureuil. - (42) |
| écouillou. s. m. Ecureuil. I n’évos envie de quer ine écouillou ai l’effût, j’avais envie de tuer un écureuil à l’affût. (Saint-Martin-des-Champs). — A Montillot, on écrit écouyou. - (10) |
| écoulacer (s'), v. réfl. glisser sur la glace : « a vé s'écoulacer », il va glisser. - (08) |
| écoulage (pour accolage). s. m. Action de relever les branches de la vigne et de les lier aux paisseaux, échalas. - (10) |
| écoule, école. - (05) |
| écouler : Accoler, attacher la vigne à l'échalas « J'ins causu fini d'écouler » : nous avons presque fini d'accoler. - (19) |
| écouler, attacher la vigne aux échalas. - (28) |
| écouler, v. accoler la vigne. - (38) |
| écouler. v. a. et v. n. Se dit, par altération, pour accoler, attacher contre. Ecouler la vigne ou, simplement, écouler, relever les branches des ceps et les lier aux échalas. - (10) |
| écouleures : Lien de paille, d'osier, de jonc ou de raphia servant à accoler la vigne. « In paquet d'écouleures ». - (19) |
| écouloué, s. m. écouloir, vase dans lequel on fait égoutter le petit-lait. - (08) |
| écoulouée. n. f. - Entonnoir. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| écoulue (pour accolure). s. f. Lien pour accoler. C’est avec le glui que se font les écoulues. - (10) |
| écounoumie. n. f. - Économie. - (42) |
| écouo, ou aicouo - voyez ce mot, et le verbe écoure. - (18) |
| écouomi : chétif, malingre. - (33) |
| écoupeau : s. m., vx fr, escoupel, copeau de bois. Affiche lue à la devanture d'un menuisier ; « Ecoupeaux à vendre. » écourre : v. n., vx fr. escoudre, battre à l’écousseux. - (20) |
| écoupeau, s. m., copeau, par suite de l’e augmentatif placé, par euphonie, devant un grand nombre de mots : éronce pour ronce, etc. - (11) |
| écoupeaux, frisons. Copeaux. - (49) |
| écoupiaux et écopiaux, s m., copeaux : « Va m'qu'ri des écoupiaux, et claire le feù. » - (14) |
| écour : battre au flaie les gerbes pour sortir le grain de l'épi - (46) |
| écoure - battre à la grange. - Te vâ écoure cette arie qui dans ta soirée. - Vos écourains bein cequi en deux heures ? - (18) |
| écoûre - conscier - torchi - tôner : battre (donner des coups) - (57) |
| écoure : (vb) battre au fléau - (35) |
| écoûre : battre (à la machine) - (57) |
| écoure : battre au fléau - (43) |
| écoure : battre le blé. (A. T II) - D - (25) |
| ècoure : v. battre au fléau. - (21) |
| écoure, battre à la grange ; écoussé, batteur en grange. - (16) |
| écoure, escoure et escouer. Battre le grain. - (13) |
| écoure. Battre à la grange. Vieux mot. Le mot est bourguignon, on le trouve dans Lamonnoye. Écoussé se dit pour batteur en grange. - (03) |
| écourgie, fouet (V. courgie) ; d'où les composés écouai, battre, écourré, battu, et écoussai, batteur en grange. - (02) |
| écouriâ, s. m., écureuil. - (40) |
| écouriau : écureuil. - (33) |
| écourieu (n.m.) : écureuil (aussi écouyou) - (50) |
| écourieu, s. m. écureuil. - (08) |
| écourniôler (s') v. S'égosiller, s'époumoner. - (63) |
| écourou, écureuil, branche sèche. - (05) |
| écourre, battre à la grange. - (05) |
| écourser. v a. Poursuivre. (Bligny-en-Othe). - (10) |
| écouru n. m. Ecureuil. - (63) |
| écoussé - batteur à la grange. - I vâ avoir quaite écoussés, et peu an me manque in fliais, prêtez moi z-en don un. - Les écoussés, vô saivez venant de bon maitin. - (18) |
| écousse, s. f. un peu de temps, un moment. - (08) |
| écoussé, s. m., batteur en grange. Peu usité. - (14) |
| ecoussei. Batteur, ou batteurs en grange, vanneurs, manœuvres loués pour vanner et cribler le blé, figurément pour tout valet de peine, tout robuste et vigoureux ouvrier. Du verbe écourre, secouer, est venu écousse, et d'écousse, écoussei, qui nettoie le blé en le secouant. En français on écrit et prononce escousse comme escouade. - (01) |
| écousser. v. - Renvoyer, expulser. (Sommecaise, selon M. Jossier) - (42) |
| écousser. v. a. Renvoyer, chasser. Ecousse donc les poules. (Sommecaise). - (10) |
| écousserai, s.m. batteur à la grange. - (38) |
| écousserey, batteur en grange. - (05) |
| écousseux n.m. Fléau à écosser. Voir flau. - (63) |
| écousseux : s. m., vx fr. escoussour, fléau à battre le blé. - (20) |
| écoussoeu, s. m. fléau. Verbe : écoure. - (22) |
| écoussou (n) : fléau (instrument) - (57) |
| écoussou : Fléau dont on se sert pour battre le blé. L'écoussou se compose de trois parties : l'échot (le manche), la varge qui s'abat sur le blé étendu sur l'aire et la chappe qui relie l'échot à la varge. - (19) |
| ècoussou : s. m. fléau. - (21) |
| écoussou, n.m. fléau. - (65) |
| écoussou, s. m. fléau. Verbe écoure, battre au fléau ou à la machine à battre (du latin excutere). - (24) |
| écouté, obéir ; é n'écoutan ran, ils n'obéissent pas. - (16) |
| écouté, v. a. enlever au râteau les menues épines dans un pré. - (22) |
| écouter : v. a., vx fr. écoter, ébrancher. - (20) |
| écoutrai, accoutré, ajusté. - (02) |
| écoutrai. : Parer, ajuster. (Del.) - (06) |
| écoutrer, v. tr., accoutrer, habiller grotesquement. - (14) |
| écoutrie (de fil) : aiguillée. (E. T IV) - S&L - (25) |
| écoutrie. Aiguillée. « Une écoutrie de fils de laine ». On dit aussi « éfaufilée ». - (49) |
| écouyou : écureuil. On dit écouriau à Château-Chinon. - (52) |
| écouyou, s. m. écureuil aux environs de Lormes. - (08) |
| ecouzat, âcauzet : houx - (37) |
| écôvai (prononcez éceuvai), écouvillon de boulanger. - (02) |
| écôvai. : Écouvillon de boulanger. (Del.) - (06) |
| écrabauiller (v.t.) : écraser - (50) |
| écrabisse. s. f. Ecrevisse. (Argenteuil). - (10) |
| écraboïlli v. Ecrabouiller. - (63) |
| écrabouaichai : s'écraser. L'âbre s'est écrabouaiché sur la majon : l'arbre s'est écrasé sur la maison. - (33) |
| ècrabouillé, vt. écarbouiller. - (17) |
| écrabouiller : écraser - (48) |
| écrabouiller : écraser. - (09) |
| écrabouiller, v. a. écraser quelque chose de mou, une limace par exemple. - (08) |
| écrabouiller, v. tr., broyer, écraser. - (14) |
| écrabouiller. v. a. Ecraser sous son pied ou dans ses doigts une chose qui, sous la pression, s’élargit, s’écarte en formant une sorte de pâte juteuse. On écrabouille un raisin, une pomme cuite, un insecte. — S’écrabouiller. v. pronom. S’écraser sous la pression, par la chute ou le frottement. Un abricot trop mûr s’écrabouille en tombant de l’arbre. En plusieurs endroits, on dit écraboiller. - (10) |
| ecraboÿi : écraser - (51) |
| écrabòyi, v. a. écraser malproprement. - (24) |
| écrâger, v. a. écraser, aplatir. - (08) |
| écraigne - avâre d'une économie sordide et bête. - C'â in homme bein écraigne. - C'â des gens écraignes, qu'a tueraint in pôille pou en aivoir lai paie. - (18) |
| écraigne (Br.), acraigne, escraigne, écrigne (C.-d.), écrin (Morv.), écrignot (Y.), écrignôle (Br., hal.). - Tous ces mots, qui ont des significations peu différentes viennent du latin scrinium, écrin, et expriment l'idée de garder de conserver. Les mots écraigne, acraigne, qui s'emploient en Côte-d'Or pour avare, ont désigné d'abord des espèces de huttes destinées à abriter de pauvres gens. Les fameuses escraignes dijonnaises de Tabourot des Accords étaient des réunions de femmes et de filles de vignerons, se rassemblant entre elles pendant l'hilver, à l'exclusion des hommes, pour veiIler ensemble et se conter des histoires en travaillant, faisant ainsi pour chacune l'économie du feu et de la lumière qui servaient à toutes. L'écrin est, dans le Morvan un coffre bas et long ; un écran est aussi quelque chose qui abrite et protège du feu … - (15) |
| écraigne : Avare, pingre. « San père est in vieux écraigne que ne li donne jamâ in sou ». - (19) |
| écraigne ou escraigne, hutte, cave ou taudis, où les vignerons et autres artisans tenaient leurs veillées... - (02) |
| écraigne, avare. - (05) |
| écraigne, écrigneule. Dans le patois ancien, écraigne signifiait une masure, un petit logement, spécialement l’endroit où les campagnards se reunissaient en nombre et par économie autour d'un seul foyer durant les veillées d'hiver ; les gens des écraignes étaient tous les plus pauvres ; de là on en est venu à designer les misérables, les malingres, sous le nom d'écraigneux, par corruption écrigneules. Les deux expressions designent un individu maigre ou chétif.Chose bizarre, écraigne et écrigneule qui remplacent les écraigneux sont aujourd'hui féminins. - (12) |
| écraigne. Avare. Ecrignôle, qui veut dire chétif, souffreteux, me semble en être un diminutif. - (03) |
| ecraigne. Tabourot, au Prologue de ses Ecraignes Dijonnaises, dit que, de son temps, Ecraigne, à Dijon, était une hutte faite avec des perches fichées en rond, et recourbées par en haut, d'une manière qui ressemblait à la forme d'un chapeau, le tout couvert de gazon et de fumier, si bien liés et mêlés que l’eau n’y pouvait pénétrer. En ce temps-là les vignerons de chaque quartier avaient leurs Ecraignes, où après souper ils s’assemblaient en hiver avec leurs femmes et leurs filles pour faire la veillée jusqu’à minuit… - (01) |
| écraignes ou escraignes. : Sortes de caves où les familles de vignerons faisaient la veillée pendant l'hiver,et primitivement huttes en torchis recouvertes en chaume. - (06) |
| écraimore, écumoire. - (02) |
| ecraimore. Ecumoire.La cuillier dont on se sert pour écumer le pot, servirait aussi fort bien à lever la crème, et de là sans doute l’a-t-on appelée originairement écraimore au lieu d’écumore… - (01) |
| ècraingne, sf. veillée ; réunion de femmes qui passent la veillée en tillant, tricotant et bavardant. - (17) |
| écrâmer, v. n. baver, écumer. se dit principalement du chien enragé : « l'peu lou vérou d' chien, al écrâme, al écrâmô », il écume, il écumait. - (08) |
| écramoiller, écramoyer. v. a. Ecraser. (Vertilly, Plessis-Saint-Jean). - (10) |
| écrâmoué, s. m. cuillère dont on se sert pour lever la crème. (Voir : crame.) - (08) |
| écramouée. s. f. Ecumoire. (Domecy-sur-le-Vault). - (10) |
| écramoure. s. f. Ecumoire. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| écramourer. v. a. Ecrémer. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| écrapèchi, v. a. pour une poule, gratter la terre ; pour une personne, s'agiter beaucoup. - (24) |
| écraper (vx fr.), écrapasser, écrapecher : v. et n., gratter, racler, nettoyer. La poule écrapasse, quand elle gratte le sol. S'écraper, se donner de la peine, du mouvement. Voir décraper. - (20) |
| écraper : Gratter la terre avec les griffes. « Les pouleilles ant tot écrapé ma planche de salade ». Au figuré se démener beaucoup sans faire bien de la besogne. - (19) |
| écraper : gratter le sol avec les pattes, telle la poule…avec ses poussins. - (62) |
| ècraper : v. se dit des poules qui grattent la terre pour chercher des graines ou pour se faire un nid. - (21) |
| ecraponer (verbe) : gratter le terrain avec les griffes ou les ergots, en parlant des animaux. - (47) |
| écrapouéssi, v. a. pour une poule, gratter la terre ; pour une personne, s'agiter beaucoup. - (22) |
| écrapper (s’) : se démener. (MLB. T III) - S&L - (25) |
| écrarer. v. a. Ecraser. Par conversion d’s en r. (Domecy-sur-le-Vault). - (10) |
| écrasation : Grande quantité. « Y a eune écrasation de peurnes su c 't 'abre ». - (19) |
| écrasé. Éboulis dans la mine. Terme minier. - (49) |
| écrasée : n. f. Éboulement dans la mine. - (53) |
| écraser, v. piler. - (65) |
| écrasoû (n.m.) : petit pilon de bois qui servait à écraser les pommes de terre cuites dans la chaudière pour la nourriture des porcs - (50) |
| écrasoû : pilon, écraseur - (48) |
| ecrazou (nom masculin) : petit pilon de bois. - (47) |
| écrechi, égregi, égregie :, adj., écorché, maigriot, gringalet. Il a l'air d'un chat écrechi. A rapprocher du vx fr. gregier. - (20) |
| écrechot, ékeurchot, égremet. Crochet de bois à longue tige, destiné à atteindre et à tirer à soi les hautes branches des arbres, pour ramasser les fruits. - (49) |
| écréchot. s. m. Crochet. (Goutarnoux). - (10) |
| écrègne, avare qui craint de faire des dépenses, méme nécessaires. - (16) |
| écrègne. Avare, ladre. - (49) |
| écreigne : adj., avare. - (20) |
| écreigne, adj., chiche, parcimonieux, avare : « O n'doune ran, é pi ô s'prive de tout, l'gouri d’écreigne !... » - (14) |
| écrémotte. s. f. Ecrémoire, ustensile pour enlever la crème de dessus les pots de lait. (Dillo). - (10) |
| écreni, écueuni : v. t. Encrassé. - (53) |
| écrènmè, écrémer le lait. - (16) |
| écréper. v. a. Habituer, accoutumer une vache à sortir. (Bussy-en-Othe). - (10) |
| écrepi, ou aicroupi - accroupi. - Les petiots étaint écrepis autor du feu. - Quemant qu'an plieuvo â se sant aicrepi derré des bôchons. - (18) |
| ecrétseure : douleur due à la croissance chez les jeunes adolescents, maux d'estomac, indispositions diverses. A - B - (41) |
| écrétseure : douleurs dues à la croissance chez les jeunes adolescents - (43) |
| écretsu : paralysie infantile, faiblesse des jambes. - (30) |
| écreuche, écroche. s. f. Crèche, mangeoire à l’usage des bœufs. De creche, pour crèche, et de l’é euphonique. (Saint-Martin-sur-Ouanne). - (10) |
| écreuche. n. f. - Mangeoire pour les bœufs. (Saint-Martin-sur-Ouanne, selon M. Jossier) - (42) |
| écreucher. v. a. Accrocher. - (10) |
| écreue, s. f. écrues, pousse, rejeton d'arbre ou d'arbuste. - (08) |
| écreûïé, adj., creusé, miné par la pluie. - (40) |
| écreussi : chétif, maigriot - èl été gros qu'men un écreussi, il était maigriot - (46) |
| écreuvaisser, v. n. crevasser, faire des crevasses, des fentes, des fissures, des gerçures. - (08) |
| écrevets, crevasses. - (27) |
| ècreveusson, sm. avorton [à Châtillon écrebi]. Voir ailiolon, aivreulö, ècœurjou, ècrignöle, estronjou, raifaud, etc. - (17) |
| écreville. s. f. Gravaude, sorte de salade qui ressemble au pissenlit. - (10) |
| écrevisse de montagne. s. f. Nom que les vignerons se donnent entre eux, à Cravant, par allusion à la marche en arrière qu’ils exécutent lorsqu’ils donnent aux vignes la façon d’automne. - (10) |
| écri'. v. - Écrire. - (42) |
| écrignaule : personne ratatinée et avare. (VDS. T IV) - VdS - (25) |
| écrigne : bête très maigre. (CST. T II) - D - (25) |
| écrigneule - qui n'est pas fort, pas bien portant, quand il s'agit des enfants surtout. - Pôre petiote écrigneule ! An te mettro dans sai poche. - Vote enfant â tô de moinme bein écrigneule, surto pou son âge. - (18) |
| écrigneûle : chétif, malingre - (46) |
| écrigneule, chétif, petit, malingre, en parlant d'un enfant, d'un fruit. - (27) |
| écrigneule, haridelle. - (26) |
| écrigneûle, se dit d'un enfant très frêle et d'un cheval étique. - (16) |
| écrignôle (prononcez écrigneule) se dit d'une personne chétive... - (02) |
| écrignôle : (nm ou f) personne maigre et chétive - (35) |
| écrignôle : malingre souffreteux. - (62) |
| écrignôle n.f. Enfant ou personne malingre, souffreteuse. Ce mot, à rapprocher de grignet, est connu également dans le Haut-Jura français ; en patois bourguignon il désigne l'écrevisse des ruisseaux. - (63) |
| écrignolè : n. m. Avorton, gringalet, adv. Chétif. - (53) |
| écrignole, chétif, très maigre. - (28) |
| écrignôle, s. et adj., souffreteux, chétif, ratatiné, malingre. - (14) |
| écrignôle, s. f., avorton, personne malingre. - (40) |
| ècrignöle, sf. animal chétif, maigre ; avorton. - (17) |
| ècrignölon, sm. diminutif de ècrignöle. - (17) |
| écrignot. s. m. Cage pour prendre les oiseaux. Du roman ecraigne, ecreigne , et du latin scrinium, petite maison, petite hutte, logette d’osier ou de branches d’arbres, écrin, petit coffre. (Mont-Saint-Sulpice). - (10) |
| écrim-mer : écrémer - (57) |
| écrim-meûse (n') : écrémeuse - (57) |
| écrimouaiche : n. f. Étincelle. - (53) |
| écrin, s. m. coffre bas et de forme allongée que l'on place devant les lits comme un marchepied. - (08) |
| ecrinche (nom masculin) : coffre bas placé contre le lit pour servir de marche pied. - (47) |
| écringe. s . f. Coquille d’œuf ou de noix. - (10) |
| écrin-meuse : écrémeuse - (43) |
| écrion. s. m. Crayon. (Etais). - (10) |
| écrit, adj. indiqué légèrement, ébauché - (08) |
| écrit, dans l'expression : « y est en écrit » - C'est fondé sur un document. - (40) |
| écritouére, s. f. écritoire, encrier. - (08) |
| écrivin, insecte nuisible à la vigne. - (16) |
| écrivou (-ouse) (n.m. ou f.) : écrivain - (50) |
| écrochet, s. m. crochet. - (08) |
| écrochure : s. f., crotte. - (20) |
| écrôgner, écorner - (36) |
| écrôpes, écraupes (pour crêpes, par addition de l’é euphonique). s. f. pl. Petits copeaux faits avec un couteau pour allumer du feu dans les champs. (Courgis). - (10) |
| écrouelle. s. f. Petit insecte qu’on trouve dans l’eau des puits, des fontaines. (Chablis et vallée du Serein). - (10) |
| écrougner (verbe) : couper de façon maladroite. - (47) |
| ecroûiller : enlever la croûte - (37) |
| écroumi, ie. adj. Accroupi. (Poilly-sur-Serein). - (10) |
| écrûji v. (de crûje, coquille) Ecaler les œufs. - (63) |
| écualaille, s.m. sorte de cage dans laquelle on mettait la vaisselle après l'avoir lavée. - (38) |
| écuale : Ecuelle. Le contenu d'une écuelle, « O mije des bonnes écuales de sope ». - (19) |
| écuder. v. a . Etudier. (Gy-l’Evêque). - (10) |
| ecué, adj. se dit d'un œuf ouvert par la sortie du poussin. « Écué ». - (08) |
| écueillai, abaisser, mettre à cul. On a écrit ce mot de différentes manières, comme écœuillai, équelay. Dans le Châtillonnais l'on dit écueuler ; un soulier écueulé est celui dont le quartier est brisé et replié en dedans. - (02) |
| ecueillon est le français écouvillon. Tampon de toile grossière, fixé au bout d'un bâton et servant à nettoyer le four avant d'y introduire le pain : on a préalablement enlevé avec un raule en fer la braise et les tisons Ces deux objets ont donné lieu à un proverbe pittoresque : c’ast l’écueillon qui se moque du raule. Nous disons dans le même sens : « C’est l'ambulance qui se moque de l'hôpital. » - (13) |
| écueillon. s. m. Houx. (St-Germain-des-Champs). — Sans doute pour aigueillon, aiguillon, à cause des pointes dont la feuille de houx est armée. - (10) |
| ècueillöte, sf. pièce de bois ou branche assez solide que l'on dispose en plan incliné pour charger des arbres sur une voiture. - (17) |
| écueillotte. n. f. - Petite écuelle en bois. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| écuellatte. s. f . Cupule du gland (Germigny). — Glisser à l’écuellatte, glisser le derrière assis dans une écuelle de bois, dans une sébille. (Lasson). - (10) |
| écuelle : s. f., faisselle, moule à fromage, en terre ou en fer-blanc, percé de trous. - (20) |
| écuelle, s. f. l'écuelle joue un grand rôle dans l'existence matérielle du paysan Morvandeau. - (08) |
| écuer : abreuver. Ne s’applique pas aux animaux. On met à écuer l’auge des cochons, les tonneaux quand ils sont secs pour les resserrer et en assurer ainsi l’étanchéité…en les saturant d’eau. - (62) |
| écuer : Mettre de l'eau dans un fût ou tout autre vaisseau en bois pour le rendre étanche grâce au gonflement du bois. « An a pu vite fait d'écuer eune feute d'ave de l'iau boulante que dave de l'iau frade ». « Vla les raijins causu meus y est temps d'écuer la cûe ». - (19) |
| écuerjou. : Ce mot sonne bien près du mot écorheu, que nos paysans donnaient aux mauvais drilles des Grandes Compagnies au XVe siècle. - (06) |
| écueuiller et acueuiller, v. tr., rassembler, chasser devant soi à l'aide d'une baguette: « Allons, écueuille les vaches ! » Ce que font les bergers de tous les troupeaux. - (14) |
| écueûillon, s. m., chiffon humide, emmanché au bout d'un long bâton, à l'aide duquel les ménagères nettoient le four chauffé au moment d'y mettre à cuire le pain. Au fig., personne dont les habits sont très sales : « T'é prou brave, ma fi ! d'avou ta jupe tout' tachée ; te r'ssembes à eùn écueùillon. » - (14) |
| écueùle, s. f., écuelle, eu bois ou en terre. Il y a la grôlote, écuelle de bois dans laquelle on fait tiédir le vin devant le feu, l'hiver. - (14) |
| écueûler (s'), v. pron., s'asseoir bas, s'accroupir. - (14) |
| écueûler, v. tr., éculer ses chaussures. - (14) |
| écueûmouére, s. f., écumoire. - (14) |
| écueuni, écreni : v. t. Encrassé. - (53) |
| écueûrie, s. f., écurie. - (14) |
| êcueùrjou, s. m., enfant chétif, mal portant, étiolé, sale. - (14) |
| écueùrvisse, s. f., écrevisse. - (14) |
| écueussher, luxer, entorser la cuisse. - (05) |
| écuffler (S’). v. pron. S’accroupir. (Plessis-Saint-Jean). - (10) |
| écufler (s’) : s'accroupir. (F. T IV) - Y - (25) |
| écuhie, s. f. écurie. - (08) |
| écuhier, v. a. écurer, nettoyer. (Voir : queurer, équeurer.) - (08) |
| écuhion. Torchon de paille qu'on emploie pour écurer les ustensiles de ménage. - (08) |
| écuille. s. f. Ecuelle. (Sénonais). Du latin scutella, scutula. - (10) |
| ècuilli : v. exciter les bêtes pour les faire marcher plus vite. - (21) |
| écuin : Irrégularité dans la largeur d'un champ. « C'te tarre est tote en écuin ». - (19) |
| écuire (s’). Gagner une vive cuisson aux cuisses par suite de la marche durant les fortes chaleurs. Etym. e et cuire. - (12) |
| écuire : v. a. (ne s'emploie qu'au part, pass.), déterminer une rougeur inflammatoire de la peau par action externe, comme dans le cas du frottement de deux parties du corps l'une contre l'autre. J’ suis tout écuit... - (20) |
| écuire. Etre écuit, c'est lorsque l'on éprouve au rectum un gonflement produit par une marche prolongée... - (02) |
| écuit (être). : Souffrir dans la région du siége par suite d'une marche prolongée. - (06) |
| écuit : être écuit, c'est avoir l'intérieur des cuisses enflammé (écuite au féminin) - (46) |
| ecuit. V. Equeu. - (13) |
| éculer. v. a. Casser, briser le derrière d’un objet. Se dit particulièrement des souliers, des chaussures dont le quartier de derrière s’affaisse, s’écrase, n’a plus de soutien. Des souliers éculés. — S éculer. S’asseoir sur son derrière, s’accroupir. - (10) |
| écume de beurre. s. f. On appelle ainsi, à Sommecaise, une terre ferrugineuse qui se trouve sous la couche de terre arable. - (10) |
| écureu : écureuil. - (66) |
| écureu, écureuil. - (26) |
| ècureu, sm. écureuil. - (17) |
| écurie de vatses : étable - (43) |
| écurie, n.f. bâtiment hébergeant des animaux. - (65) |
| écurie. n. f. - Étable, bâtiment destiné à loger indifféremment bovins ou chevaux. Le mot français « étable » n'est quasiment jamais employé en Puisaye. - (42) |
| Ecussiâs : nom de climat. - (38) |
| édarnes. s. f. pl. Gros éclats de copeaux de cerclier. — De darne , tranche, morceau, et de l’é euphonique. - (10) |
| édefice - engrais, fumier principalement. - En faut de l'édefice en quantité si en veut aivoir ine bonne récolte, en n'i é pâ ai dire. - I ai aichetai quaite voitures d'édefice pou mette dans lai Grand'-Bomme. - (18) |
| édegrai, escaliers. Il semble qu'on ait voulu exprimer quelque chose de la signification du latin egredi. - (02) |
| édegrai. : Marches d'escalier (du latin gradus, degré, échelon). - (06) |
| éderne, s. f. éclat d'aubier détaché de l'arbre qui a servi à fabriquer les paisseaux ou échalas de vigne. - (08) |
| édeulgence, s. f. indulgence, défaut de sévérité ; rémission des péchés. - (08) |
| édeune. s. f. Echarde. (Coutarnoux). — Semble être une variété de édarnes. - (10) |
| èdeusson, sm. grain dont le battage n'a pas enlevé les balles. - (17) |
| édfice, fumier. - (16) |
| édfier. Fertiliser : « édfier un terrain ». Améliorer. Élever une nouvelle race d'animaux. - (49) |
| edié ; s'ëdié, s'entr'aider. - (16) |
| édier : aider. (S. T III) - D - (25) |
| édifice. Engrais de toute nature : nos tartouffes aillont ben pousser ; j’aivons mis deux tombereaux d'édifice dans eune demi-ôvrie. La prononciation morvandelle, aitefice, a fait penser à M. de Chambure que ce mot venait d’artifice, travail fait avec art... - (13) |
| èdiolée : averse. (SY. T II) - B - (25) |
| édje (d'l') : eau - (57) |
| èdö, sm. épi mal battu et qui demeure sur le van. - (17) |
| édôsse, s. f. dosse, planche de rebut que la scie enlève lorsqu'on équarrit un arbre. La dosse en général renferme l'écorce et l'aubier de la bille. - (08) |
| édouâler (s'), v., tomber en douelles (tonneau). - (40) |
| édouellé : 1 v. t. Perdre les douelles d'un tonneau. - 2 v. t. Répandre sans soin. - (53) |
| édousser. v. a. Adosser. (Maligny). - (10) |
| edrâillé, edrîllé, âdrillé : déchiré fortement - (37) |
| édrasser, v. adresser. - (38) |
| èdret : adroit - (46) |
| èdret : adroit. - (52) |
| edrîllé : déchiré - (37) |
| édriller (s'), v., se transformer en drilles irrécupérables. - (40) |
| édriller : déchirer des vêtements. (RDM. T IV) - B - (25) |
| édroi, adroit, habile ; mettre une chose à l'édroi est la mettre comme elle doit être mise, non à l'envers. - (16) |
| édron. s. m . Héron. (Saint- Aubin-Châteauneuf). - (10) |
| éduire. v. a. Elever, nourrir. Enfant mal éduit, enfant mal élevé. Du latin educere. - (10) |
| édvin (adv.) : pourquoi (abréviation de d'où vient ? quelquefois mentionné, éduvoin) - (50) |
| ed'vin, loc. d'où vient ; pourquoi ? - (08) |
| eéchauffè : v. t. Réchauffer. - (53) |
| eEngravé. adj. - Se dit d'un animal qui boite parce que l'un de ses sabots est encombré de graviers. - (42) |
| éÉplue, étincelle. - (28) |
| eépogne, âpogne : petit « reste » de pâte, que l’on met à cuire en même temps que le pain de ménage sur le « devant » du four pour les enfants - (37) |
| ééport' : v. i. Importe. - (53) |
| éericher, erégher. v. a. Arracher. (Irancy). Du latin eradicare. - (10) |
| éessiè : v. t. Essayer. - (53) |
| ééte, ét' : v. i. Être. - (53) |
| eéyîîse, âyîîse : église - (37) |
| efaici. Effacer. « Ai fau éfaici ce mô lai », il faut effacer ce mot-Ià. On dit aussi j’éfaici, j'efface, tu éfaici, tu effaces, el éfaici, il efface, et « nos peiché sont éfaici », nos péchés sont effacés. - (01) |
| éfairer. v. a. égarer, fourvoyer. « Égahier. » - (08) |
| éfanti, affamé. Il semble qu'on lise les mots latins e fame acti, pressés par la faim... - (02) |
| efanti. : (Pat.), éfantel (dial.), jeune enfant, et, par extension, petit d'un animal. - (06) |
| éfâre, affaire. - (16) |
| éfare, affaire. - (26) |
| éfarfanter. Littéralement effrayer par des fantomes. - (13) |
| éfaufiler. Tirer le fil de la faufilure ou le fil de la trame d'un tissu. - (49) |
| éfée, s. f. fée. La roche des Éfées, commune d'Alligny, à la Chaux. - (08) |
| efeignai. Affiné, affiner. - (01) |
| éfeni, e, adj. infini. - (08) |
| éferfanté (-e) (adj.m. et f.) : saisi (-e), troublé (-e), effrayé (-e) - (50) |
| éferfanté, part. pass. d'un verbe inusité à l'infinitif. Saisi, troublé à l'excès par un accident imprévu. On est « éferfanté » en apprenant la mort d'un ami qu'on ne savait pas malade. - (08) |
| èféter : (èfé:tè - v.trans.) "affaîter", remplir plus qu'à ras bord. Se dit notamment d'un char trop chargé de foin . - (45) |
| éfeumoué, s. m. les « éfeumoués » sont des planches que l'on place sur les charrettes pour contenir un chargement de fumier. (Voir : feumer.) - (08) |
| éfeurfanté : (éfœrfan:tè - part. passé pris comme adj.) qui se signale par son exubérance, en proie à une excitation inhabituelle. - (45) |
| èfeurner : (èfœrnè - v. intr.) se tenir tranquille, prendre patience. - (45) |
| éfeutai (s'). : Se revêtir de. (Del.) – Éfeutai d'ène bone gonne (voir ce mot), c'est-à-dire revêtu d'une bonne casaque. - (06) |
| éfeutai, rusé.Eu français affûté, ou plutôt fûté. Comme verbe, il signifie encore se revêtir de... - (02) |
| effaillite. s. f . Nom du hêtre, à Rebourseaux. De fay, faïl, dérivés du latin fagus. - (10) |
| èffairfautée : affairée. (RDM. T II) - B - (25) |
| effanferlucher. v. a. Effiloquer un vêtement, une étoffe par des frottements trop répétés. (Percey). - (10) |
| éffareuchi : Effaroucher. « Eune fois que les padrix ant été éffareuchies i ne tenant plieu ». - (19) |
| effarfanté : 1 adj. Confus. - 2 v. t. Effrayer. - 3 Exciter. - (53) |
| effarochi : Dépeigné. - (19) |
| effarouchi - fére pou : effaroucher - (57) |
| effarvette, éfarvette. s. f. Fauvette. (Cuy). - (10) |
| effarvoyer. v. - Effaroucher. - (42) |
| effarvoyer. v. a. Effaroucher. (Bléneau). - (10) |
| effauberti. adj. - Abasourdi, affolé ; synonyme de affauberdi : « Quoué don' que s'passe ? Que dit l'curé en la voyant toute effaubertie. » (Fernand Clas, p.360) - (42) |
| effaudi - (èfô:di - adj.) privé, démuni. - (45) |
| effaudi : affamé. (MM. T IV) - A - (25) |
| éffaugi : Même sens que éffareuchi. - (19) |
| effauti, ie. adj. Qui tombe de faiblesse, de faim, de besoin. (Perrigny). Voyez affauti. - (10) |
| efferfanter : effrayer - (48) |
| efferlé. adj. Ivre. (Saint-Aubin-Châteauneuf). - (10) |
| effermetures. s. f. pl. Bourgeons de la vigne près de s’ouvrir. (Saligny). - (10) |
| effet (mettre en), loc. prendre l'intention, la résolution d'exécuter quelque chose : se proposer de faire... - (08) |
| effetir, nettoyer, ôter les fétus. - (05) |
| effeuches. s. f. pl. Des forces. ( Vassy-sous-Pisy). — Au même endroit, force se dit foûche, au singulier : pourquoi dit-on éffouches, au pluriel ? - (10) |
| effeûilli : effeuiller - (57) |
| effeuilli : effeuiller une branche - (43) |
| éffeuilli : Enlever les feuilles, dépouiller le maïs de son enveloppe. « Je sins allés vailli chez neut voisin pa éffeuilli ». - (19) |
| effeurlocher : éffilocher - (39) |
| effeurner: rester tranquille. (MM. T IV) - A - (25) |
| éffeut : Effort. « Ol li a donné dix sous d'étrain-nes, jamâ j'arais crayu qu’ol arait fait s’t’éffeut ». - (19) |
| effeutî : effeuiller. Pour le maïs, c’est épanouiller, enlever l’enveloppe de l’épi. D’autres disent échailler. - (62) |
| effiauler, affiauler. v. - Aller de biais, prendre obliquement, couper en sifflet. (Rogny, selon M. Jossier) - (42) |
| effiauler, affiauler. v. a. Aller de biais, prendre obliquement. Couper en affiaulant, couper en glissant, couper en sifflet. (Rogny). - (10) |
| efficat. n. m. - Appétit. Avoir bon efficat. - (42) |
| effilotsi v. Effilocher. Voir flotson, flotsoñner. - (63) |
| effioler. v. a. Retrancher la fiole, la fane des blés trop vigoureux, avant l’hiver ou au printemps. De folium, feuille, et exfoliare , effeuiller. - (10) |
| effiter. v.a. Exciter, provoquer. (Merry-la-Vallée). - (10) |
| efflanné. adj. - Efflanqué. - (42) |
| efflanné. adj. Efflanqué. (Villiers-Saint-Benoît). - (10) |
| effliouser. v. a. Egrener. (Etivey). - (10) |
| èfflor : pierre à aiguiser. (B. T II) - B - (25) |
| éfflouri : fleurir (mot ancien) - (39) |
| effluri, part. pass. fleuri à un degré avancé. - (08) |
| effoger : v. a., lat. effugare, mettre en fuite, chasser, effaroucher. - (20) |
| effoirer, écaffoirer. v. n. Fondre. Qui veune à pleuve un pouchot, la neige sera bentoût écaffoirée. (Pasilly). - (10) |
| éffondrai, enfoncer, briser... - (02) |
| effondrer. v. a. Vider. Effondrer des poissons, des volailles. - (10) |
| effondrilles. s. f. pl. Dépôt, résidu dans le pot-au-feu. - (10) |
| efforbué. : Courroucé, effarouché. - Le vrai mot est efferbué, venant du verbe latin effervere, prétérit efferbui. - (06) |
| efforces, s. f. forces. Ne s'emploie qu'au pluriel : des «efforces », grands ciseaux dont on se sert pour tondre les moutons. - (08) |
| efforci (s’) : efforcer (s') - (57) |
| efforcie. : Viol. - Femme efforcée, femme violée. (Fanchises de Seurre, 1278.) - (06) |
| effort de taverne. : Tumulte dans un lieu public où l'on donne à boire. (Franchises de Seurre, 1278.) - (06) |
| effouâ (n’) : effort - (57) |
| effouaiché : v. pr. Tomber lourdement, s'écraser. - (53) |
| éffouallai : tomber, s'écraser. - (33) |
| effouaquer : écraser - (39) |
| effouchaler (s'), se dit d'un fromage blanc qui ne tient pas au sortir de la faisselle (fouchalle). - (40) |
| effouqué : affolé, tête en l'air. O court partout coume un effouqué : il court partout comme un affolé. - (33) |
| effrâ : Effrayer. « Y est in vra gendarme ren ne l'effrâ ». - (19) |
| effracter : v. a., briser. Voir deffracter. - (20) |
| effrâgner (v.) : effrayer, mettre en fuite - (50) |
| effrâgner, v. a. effrayer, effaroucher, chasser, mettre en fuite : « n'teuche pâ c'te bôchonlaite, al ô brâman ilai p'effrâgner lé moches », ne touche pas à ce buisson-là, il est bien là pour chasser les mouches. (Voir : frâgnie.) - (08) |
| effrâgnie (prende son) : élan (prendre son) - (48) |
| effrâgnie : envolée de boutique - (48) |
| effraingilli : effiloché - (57) |
| effraiser. Mettre en petits morceaux. On dit également ébraiser, comme qui dirait réduire en braise. - (03) |
| effraiser. Reluire en miettes, diviser en petits fragments, comme on enlève les fraises mêmes de leur tige. Etym. mot très voisin d’effriter qui s'écrivait autrefois éfruiter. - (12) |
| effrâler - (39) |
| effrâler, v. a. briser, mettre en morceaux, écraser. - (08) |
| éffresé, émietté. - (28) |
| effreser, v. a. mettre en miettes, réduire en poussière. Effréser du pain, du sucre, du charbon. - (08) |
| effretir. Écailler le poisson. - (03) |
| effreumi : fourmi. - (32) |
| effreusè : affalé - (48) |
| effréyer : faire des miettes - (39) |
| effriche, s. f. terre en friche, terrain vague. Le troupeau est dans les « effriches. » - (08) |
| effrier. v. a. Réduire en poudre. Sans doute pour effriser, effriter. - (10) |
| effrigeai : émietter. On effrigeai son pain dans son bol : on émiette son pain dans son bol. - (33) |
| effriger, v. a. émietter, réduire en miettes. - (08) |
| effriller. v. a. réduire en miettes. - (08) |
| effrimer. v. - Émietter. (Rogny, selon M. Jossier) - (42) |
| effrimer. v. a. Émietter. (Rogny). - (10) |
| effringi : Verbe, effranger. - (19) |
| effriolant, effryolant, adj. affable, aguichant. - (38) |
| effriouser. v. a. Egrener, émietter, briser, réduire en poudre. - (10) |
| effriser. Émietter : « effriser du pain ». On dit aussi « ébraiser ». - (49) |
| effrisser (S’). v. pronom. Se frayer. (Bligny-en-Othe). - (10) |
| effrouler. v. a. Effeuiller. (Armeau). - (10) |
| effryolou, -se s. tentateur, aguicheur. - (38) |
| effutiau : habits ridicules. - (66) |
| effutiaux : vêtements féminins, effets. De biaux effutiaux. - (52) |
| effutiaux et affutiaux. Instruments qui servent à affûter les tranchants. Par extension, toute espèce d'outils : Al ai aippourté d'évou lu teus ses effutiaux. - (13) |
| effûtier, effûtoux. s. m. Celui qui va à l’affût. (Perrigny-lès-Auxerre, Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| éfiamné (-e) (adj.m. et f.) : harassé (-e), éreinté (-e) - (50) |
| éfianné, adj. échigné, harassé, éreinté. - (08) |
| éfierme (n., adj.m. et f.) : malade, infirme - (50) |
| éfierme, adj. infirme, affaibli, malade. - (08) |
| éfignai. : User de finesse avec quelqu'un. (Del.) - (06) |
| éfigné, duper, tromper, faire le fin. - (02) |
| éfiler, v. tr., affiler : « Prôt'me ton coutiau ; ôl é ben meû éfilé que l’mien. » - (14) |
| efiriande. Affriande, affiriandes, affriandent. - (01) |
| éfistouler. v. a. Afistoler, arranger, orner, parer. (Merry-la-Vallée). - (10) |
| ef'naillé : 1 v. t. Perdre les douelles d'un tonneau. - 2 v. t. Répandre sans soin. - (53) |
| éfoncer, v. a. défoncer, enlever le fond : « éfoncer » un tonneau, une voiture. - (08) |
| éfonci : (p.passé) enfoncé - (35) |
| èföné, èfunné, vt. battre à la main (principalement du seigle) pour obtenir des faisceaux de paille propre à faire des liens. - (17) |
| efor. Effort, efforts. - (01) |
| éfòrachllé, adj. embroussaillé, hérissé, comme un « forriau » (fourré). - (24) |
| éformer, v. a. informer : « i seu éformé d'ç'iai », je suis instruit de cela. - (08) |
| éforteuné, e, adj. infortuné, affligé. Se dit au propre d'un homme estropié, qui, par la privation d'un membre blessé ou par suite de maladie, ne peut gagner son pain en travaillant. (Voir : forteuné.) - (08) |
| éfouaiti : écailler - (57) |
| éfoualer (s') : tomber, s'aplatir - (48) |
| éfouaquer (s') : écraser (s'), aplatir (s') - (48) |
| éfouaquer : s'écraser comme un fruit mûr. - (52) |
| éfougé, e, adj. se dit d'un homme mais surtout d'un animal, qui est comme affolé, qui court en tous sens avec une sorte de transport. - (08) |
| éfouj’li : grande quantité. (RDM. T IV) - C - (25) |
| èfouracbé, vt. effaroucher, effrayer. - (17) |
| éfourachlli, v. n. embroussaillé, hérissé, comme un « fouriau ». - (22) |
| éföyie : (p.passé) (branche) éclatée - (35) |
| éfrâchi : Couper la frâche, les branches d'un arbre qu'on vient d'abattre. - (19) |
| éfraiser et éfreûser, v. tr., émietter, rompre en menus morceaux : « Pour mon quat' heures, j'ai éfraisé du pain bis dans mon lolot. » C'est un régal des goûters d'été. - (14) |
| éfraiser. Réduire en petits morceaux. Les Dijonnais disent frâcher. On dit bois de frâche celui qui provient des branches, par opposition au bois de pied... - (13) |
| éfranbeler, v. a. éfranger. - (24) |
| éfrandelé, v. a. éfranger. - (22) |
| éfraser : Emietter « Aile li a fait miji du pain éffrasé dans du cai 'lli ». - (19) |
| éfréser : émietter - (48) |
| éfreusai – émietter, réduire en petits morceaux. - En me fauro des treufes éfreusées pour mette dans le crépais. - Efreuse-moi voué ces crôtes de pain. - (18) |
| èfreusé, vt. écraser, pulvériser. [cf. effresoure, râpe à fromage dans un texte bourguignon (XIVe s.) cité par godefroy]. - (17) |
| éfreuzè : cassé, effondré (un lit éfreuzè) - (46) |
| éfrezé : émiétté. - (66) |
| éfrëziyé, réduire en miettes. - (16) |
| èfroinches : (èfrouin:ch' - subst. f. pl.) ranchets, supports des ridelles du char. - (45) |
| éfrouzè : équeuter les petits oignons - (46) |
| éfruté, effruiter ; une vigne à laquelle on fait trop produire est bientôt une vigne éfruté. - (16) |
| efuadzi : bête apeurée. A - B - (41) |
| efuadzi : bête apeurée - (34) |
| éfuger, v. a. infuser, faire fuser : faire « éfuger » de la chaux, la réduire en poussière en la mouillant. - (08) |
| éfugie, effigie, ressemblance ; on dit d'un enfant qui ressemble à son père qu'il en est l'éfugie. - (16) |
| èfûtiau : ustensile, outil, objet sans valeur - (48) |
| egabeulé : dont l'ouverture a été agrandie par l'usure. A - B - (41) |
| égabeûlé : (p.passé) (vêtement) avachi, détendu - (35) |
| egabeulé : dont l'ouverture est agrandie par l'usure - (34) |
| égabeulé : orifice dont l'ouverture s'est agrandie par l'usure - (43) |
| egabeulé : orifice usé et agrandi - (34) |
| egabeuler : déformer (notion de trop grand) - (51) |
| égabeuler v. Egueuler, agrandir l'ouverture par un usage intense. - (63) |
| égacer, égasser. v. n. Chanter, crier comme la pie, comme une agace, une égasse. - (10) |
| égacer, éguager. v. a. Aiguayer, rincer du linge. Du vieux mot aigue, eau. (Tronchoy). - (10) |
| égacia, s.m. acacia. - (38) |
| égaice, agace, pie. - (16) |
| égaicè, agacer, presque irriter ; un homme qui se lasse des impertinences de sa femme lui dit : couze te ! te m'égaice ! tais-toi, tu m'irrites. - (16) |
| ègairé, vt. égarer. - (17) |
| égaisse : une pie. - (66) |
| égaisse, pie. - (26) |
| égalaucher, égahaucher, égahucher. v. a . Effrayer, effaroucher par des éclats de voix, des menaces, des cris. Egalaucher les poules. - (10) |
| égalerie : A Mancey le rez de chaussée des maisons étant généralement occupé par la cave, l'habitation se trouve située au premier étage, on y accède alors par un escalier extérieur en pierre qui se continue par l'égalerie qui s'étend sur tout ou partie de la façade de la maison et que protège de la pluie un avant-toit. - (19) |
| egâleuchi : Agrandir une chaussure à force de la porter, la déformer. « Ses sulés (souliers) sant tot égâleuchis ». - (19) |
| égalir, v. tr., égaliser, aplanir, rendre uni. - (14) |
| égalita, s.f. égalité. - (38) |
| éga'lli : Déchirer « Ol a éga'lli sa culotte neue ». - (19) |
| égalochî : abimer les galoches et les chaussures d’une manière générale. - (62) |
| égambai, enjamber, franchir quelque obstacle matériel. En basse latinité, gamba signifie jambe. Dans le Jura, l'on dit camber le gouillat, c.-à-d. franchir le ruisseau. - (02) |
| ègambè : enjamber - (46) |
| égambé pour enjamber. : Passer par-dessus un obstacle. Le patois des Fourgs, en Franche-Comté, dit cambai. - Dans le Châtillonnais, on dit une égambée. - (06) |
| ègambé, vt. enjamber ; marcher très vite. - (17) |
| égambée. s. f. Enjambée. (Courgis). — Donné aussi par Jaubert. - (10) |
| ègambie, sf. enjambée ; course rapide. - (17) |
| égambiller. v. a. Rendre boiteux. (Sermizelles). - (10) |
| égambilli v. Etirer, déformer. - (63) |
| egambione : adj. Qui boite d'une jambe. - (53) |
| égamblé. adj. Boiteux. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| égambler, enjamber. - (27) |
| egamboueillé : adj. Qui boite. - (53) |
| égancher, v. tr., fatiguer, harasser, assommer : « J'ai tant sâclé, qu'j'en seù tôt éganché. » — « Ol a éganché son chin. » — Signifie aussi qu'on a détérioré son travail par sa maladresse. - (14) |
| égandillè : tarer une bascule - (46) |
| égandiller, contrôler les mesures. - (05) |
| égandiller, v. mesurer, contrôler une mesure de grain : égandiller la soille (1750). - (38) |
| égandiller, v. tr., vérifier, contrôler, poinçonner les poids et mesures. Ce qui plaît peu aux débitants. - (14) |
| égandiller. Vérifier et poinçonner les mesures. Le contrôleux vai veni demain égandiller les poids... - (13) |
| égandolè : bancal, boîteux - (48) |
| éganse. s. f. Boutonnière. (Courgenay). - (10) |
| egarade pour incartade. : (Del.), s'égarer ou s'écarter d'un point est bien la même idée. - (06) |
| égarade, méprise, erreur. - (02) |
| égarade, s. f., erreur, méprise, — et aussi promenade mystérieuse du soir... ce qui est souvent la même chose. - (14) |
| égaraille, égarade : s. f., parcelle de terre isolée et éloignée du gros d'une propriété. - (20) |
| égaraille, s. f. petite parcelle isolée, égarée pour ainsi dire. - (24) |
| égareille, s. f. petite parcelle isolée, égarée pour ainsi dire. - (22) |
| égarotté. Harassé, a dû se dire primitivement d'un cheval ; formé de garrot, comme éreinté de rein, échiné d'échine, dératé de rate. - (03) |
| égarouilleau : s. m., épouvantall à oiseaux. - (20) |
| égarouiller : v. a., vx fr., égarer, éloigner. - (20) |
| égarroter, fatiguer, harasser. - (05) |
| égasse (pour écasse). s.f. Casse. - (10) |
| égasse : pie - (44) |
| égasse, s.f. pie. - (38) |
| égasser : voir gasser. - (20) |
| égasser, v., secouer une patte dans l'eau. - (40) |
| égauder (s’). v. pron. Se mettre à l’abri. Sans doute pour s’écauder, s’écauter. Du latin cautus. - (10) |
| égaudir (s'), v. pron., se réjouir : « Enr'venant d'la fête, ô s'égaudissein prou. » - (14) |
| égaupée. Poignée : une « égaupée » de sel ; une pleine main. - (49) |
| égâzener, v. a. briser les mottes de terre gazonnée qui se trouvent dans un champ ; lever la surface gazonnée d'un pré. (Voir : gâzener.) - (08) |
| égduevouée. s. f. Pierre à repasser. Se dit, par un vice de prononciation, pour aiguvoué, aigusoué, aigusoir. - (10) |
| égé, ée. adj. Voyez aigé. - (10) |
| égé. adj. - Trempé, mouillé jusqu'aux os. - (42) |
| égelon, frileux. - (26) |
| égemié*, v. n. frissonner de peur. - (22) |
| égemier, v. n. frissonner de peur : cette histoire nous a fait égemier. - (24) |
| égenòïer (s'), v. pron., s'agenouiller. - (14) |
| égeoir. s. m. Trou d’eau, mare, endroit d’un ruisseau où l’on fait rouir le chanvre, et qui sert aussi ordinairement de lavoir. Voyez aigeoir. - (10) |
| eger : rouir - (60) |
| éger : rouir. - (32) |
| éger. v. a . Voyez aiger. - (10) |
| égetener : ébourgeonner la vigne. - (31) |
| égevrer : Frissonner. « Freme dan la porte, l'ar me fâ égevrer ». - (19) |
| égheurnée (ai l'), loc. a l'égrenée par métathèse. se dit d'une collection de choses séparées, répandues au hasard, en désordre. Lorsque tout est « ai l'égheurnée » dans une maison, la misère ne tarde pas à y entrer. - (08) |
| égheurner, v. a. égrener, détacher, répandre le grain : « l’vent é égheurné lé soilles. » - (08) |
| égibé (s'), v. r. se détendre brusquement. - (22) |
| égiclier : Sauter, faire un écart. « Man chevau a ésu peu o s'est égiclié in ban cô » : mon cheval a eu peur il a fait un violent écart. - (19) |
| égiffle. s. f. Erysipèle. (Gy-l’Evêque). - (10) |
| èginqué, vt. mouiller en lançant de l'eau. - (17) |
| égiver, v. trembler. - (38) |
| égland (on mouille le gl en prononçant, ce qui donne à peu près le son de éguiand, éghiant). s. m. Gland, fruit du chêne. - (10) |
| égland. Gland. On dit encore « èyant ». - (49) |
| églante ou églente, qui sautille, et par extension une puce... - (02) |
| égledan : Edredon. - (19) |
| égledon (nom masculin) : édredon. On dit aussi égueurdon ou égrifon. (Cui là, al est meilleur sous l'égueurdon qu'aux manches de la charrue). - (47) |
| ègledon : édredon - (48) |
| ègledon : édredon - (39) |
| égledon : n. m. Édredon. - (53) |
| égledon, édredon - (36) |
| égledon, édredon. - (16) |
| egledon, édredon. - (27) |
| égledon, s.m. édredon. - (38) |
| ègledon, sm. édredon. - (17) |
| églente ou eglante. : Puce. - Si le mot églantier vient du latin aculeatum, c'est-à-dire qui porte des aiguillons, il est vraisemblable que le mot églante n'a pas une autre origine. - (06) |
| églie (n.f.) : église - (50) |
| églie : église - (48) |
| églie : église - (39) |
| églie, s. f. église. - (08) |
| églie. n. f. - Église. - (42) |
| ég'liige : Eglise. « La veille ég'llige de Saint-Martin de Lâles » : la vieille église de Saint-Martin de Laives (monument historique). - (19) |
| eglinade (à l') (à l'églinée) : petit bout par petit bout - (51) |
| églinché (être) : recevoir de l'eau sur ses vêtements, par exemple quand une voiture passe dans un "gouillet" à côté de vous !!! - (66) |
| eglinée (à l') (à l'églinade) : petit bout par petit bout - (51) |
| egliner : faire tomber petit à petit - (51) |
| églisser. v. a. Synonyme d’églincher. - (10) |
| églizié, ére, adj. celui qui va souvent à l'église, qui se plaît aux cérémonies du culte religieux. - (08) |
| égmelle. s. f. Lame de couteau. (Villeneuve-la-Guyard , Villemanoche). Se dit pour aigumelle. - (10) |
| égnie : voir araignie - (23) |
| égobler : écorcer des chênes abattus. (VDS. T IV) - VdS - (25) |
| égolâilli v. Etrangler. - (63) |
| ègôli : gâté (enfant). (RDT. T III) - B - (25) |
| égôni, v. accabler d'injures. - (38) |
| égor : averse. (MM. T IV) - A - (25) |
| égorgette. s . f. Fauvette. (Percey). - (10) |
| égorgi : égorger - (57) |
| égosillè : enroué, aphone à force de crier - (46) |
| égosiller, crier fort, tousser par corps étranger dans la trachée. - (05) |
| égosser (pour égousser). v. a. Ecosser. Egosser des pois, les tirer de leur gousse. - (10) |
| ègöt, sm. égout. - (17) |
| égôton, égoût, restes. - (02) |
| egôton. : Dernière goutte, reste d'un liquide ou d'un mets. (Del.) - (06) |
| égotter. Égoutter. - (49) |
| égotter. v. a. Egoutter. — Egotter une vache, la traire. (Saligny). - (10) |
| égottière. s. f. Gouttière. (Plessis-Saint-Jean, Dillo). — On dit aussi égouttière. - (10) |
| égôttou: (nm) égouttoir à fromage - (35) |
| égoué : dégoûté. (LS. T IV) - Y - (25) |
| égoué, ée. part. p. et adj. Saturé, dégoûté, rebuté d’une chose. (Auxerre). - (10) |
| égouer (s’) : (s’) obturer l’entrée des voies respiratoires en « mal avalant » de la nourriture, du liquide - (37) |
| ègourgé, vt. égorger. - (17) |
| égoùsiller (s'), v. pron., s'égosiller. - (14) |
| égousiller, v. a. égosiller. - (08) |
| égoussai : écosser des pois, des haricots. - (33) |
| égousser , écosser. - (04) |
| égousser : éplucher des pois, des haricots. - (52) |
| égousser, v. a. enlever la gousse ou enveloppe des légumineuses, des pois, des fèves, etc. - (08) |
| égousser, v. tr., sortir un légume de ses gousses : « Égausser des pois. » - (14) |
| égousser. v. a. Ecosser. Voir égosser. - (10) |
| égouthiô, petite pelle pour enlever l'eau, un reste de vin d'une cuve. - (16) |
| égoutiau, s. m., écope, égoutte-eau. - (14) |
| égoutter : traire les dernières gouttes - (57) |
| égouttiau : voir agouttiau. - (20) |
| égouttiau. Ecope, instrument spécial pour vider l'eau d'une barque. Etym. égoutter et eau, avec un i euphonique au milieu. - (12) |
| égouttio : une pelle en bois pour prendre le purin - (46) |
| égouttouaîr (n') : égouttoir - (57) |
| égouziller, égosiller. - (26) |
| égouziyé ; s'égouziyé, s'égosiller, soit en parlant trop fort, soit en mangeant ou en buvant trop vite. - (16) |
| egôzille. Egosille, égosilles, égosillent. - (01) |
| égrafaignai, égratigner. Dans l'idiome breton, kraf signifie piqûre, et krafina blesser avec les griffes ou les ongles (Le Gon.).A Châtillon, l'on dit grafigner, et, dans le Jura, égrafiner... - (02) |
| égrafeugni v. Egratigner, griffer. - (63) |
| égrafignâ (s'), v., s'écorcher, s’égratigner. - (40) |
| égrafigner (vx fr.), égrafiner : v. a., égratigner. Voir grafigner, grafiner. - (20) |
| égrafigner et grafigner, v. tr., égratigner, écorcher : « D'là-vou c'que te d'veins, d'avou ta figure tôte égrafignée ? » - (14) |
| égrafigner, égratigner - (36) |
| égrafigner, égriffer. Égratigner. - (49) |
| égrafigner, v. a. égratigner. Nous disons encore « égrafiner, égraifigner. » - (08) |
| égrafigner. v. a. Egratigner. - (10) |
| égrafigneure, s, f., égratignure, écorchure. - (14) |
| égrafigneure, s. f. égratignure, écorchure. - (08) |
| égrafignure (vx fr.), égrafinure : s. f., égratlgnure. - (20) |
| égrafiner : égratigner. (VDS. T IV) - VdS - (25) |
| égrafiner : Egratigner. « T'as voulu tiri la coue du chat, o t'a égrafiné, bien fait ! » Vieux français, esgrafigner. - (19) |
| égrafiner, égratignier. - (04) |
| égrafiner, v. a. griffer, égratigner. - (24) |
| egrafiner. Blesser à coups de griffes. Voiqui ce que c’ast de contrarier not'chet : al ai ègrafiné ton niIlot. - (13) |
| égrafiner. Égratigner, du vieux verbe graphiner. - (03) |
| égraifaignai. : Déchirer la peau d'une personne comme la pointe d'un style (graphium) éraille le papier en y laissant une trace. - (06) |
| égraiffiner : égratigner, écorcher - (39) |
| ègraifiné, vt. égratigner. - (17) |
| égraifiniai - égratigner. - Prends gairde que le chat ne t'égraifigne. - En s'aibuyant a se sont contrariai, et pu le Jean al é égraifigniai son petiot frère ! – Quoi qu c'a don, arré, que ces égraifignieures que t'é su lai joue ! - (18) |
| égraillai - desséché de manière à perdre l'eau. - Le cuvier â tot égraillai ; aibreuve lu in pecho. - Aivou ces temps de soicheresse qui, lai terre a égraillée quemant tot ; en y é des fentes énormes. - (18) |
| ègraillé (s'), vr. se dit d'un fût, d'une cuve ou autre ustensile en bois, qui se disjoint sous l'influence de la sécheresse. - (17) |
| égrailli (s'), se dégourdir, se divertir... - (02) |
| egrailli (s'). : Se distendre, et, au moral, prendre ses aises, s'ébattre, s'épanouir. - (06) |
| égrailli : effilé par l'usage (linge). (S. T III) - D - (25) |
| ègrailli : v. se dit du tonnerre qui éclate à quelque distance. - (21) |
| égrailli, disjoint en parlant d'un tonneau. - (26) |
| égrailli, s'élargir (en parlant d'une fente). - (28) |
| égraitigner : égratigner - (48) |
| égraivai - blessé, écorché à la grève. - Ine pierre l'i échoué su lai jambe, c'â qu'il â ma foi, bein égraivée ! Ine égraiveure, ci demandero du repos dans le lei. - (18) |
| égrâ'lli : Craquer très violemment en parlant du tonnerre. « Le tonnare a cheu pas loin de ma, j'ai entendu égrâ 'lli in ban cô ». - (19) |
| égramoler : voir gramoler. - (20) |
| égramoler, v. a. émietter au râteau. - (24) |
| egraper, v. tr., enlever les grains de la grappe de maïs. - (14) |
| égraponer, v. a. gratter le terrain avec les ongles, avec les griffes. Se dit des oiseaux de basse-cour et autres. - (08) |
| égrappe. s. f . Agrafe. Se dit pour agrappe ; de grappin. (Argenteuil). - (10) |
| égrapper. v. a . Agrafer. (Flogny). - (10) |
| égrâs, s. m. pl., escaliers. - (40) |
| égratigni – écorchi : égratigner - (57) |
| égraufené, v. a. griffer, égratigner. - (22) |
| égravé : Se dit des bovins qui après avoir marché sur un sol graveleux semblent souffrir des pieds. - (19) |
| égravé : corne du sabot de l'animal abimée accidentellement en marchant, par exemple sur un caillou, ce qui provoque une boiterie. - (33) |
| égre (faire) : loc, faire basculer un objet autour d'un point fixe avec ou sans levier, comme quand on soulève une pierre à l'aide d'un presson, quand on décloue une caisse à l'aide d'un ciseau, on ouvre une porte à l'aide d'une pince-monseigneur, etc. A rapprocher du vx fr. egres. - (20) |
| égré : Marche d'escalier. « Je li ai fait dévaler les égrés quat à quat ». - (19) |
| égré : s. m., vx fr., degré, marche d'un escalier. - (20) |
| égré, s. m. marche d'escalier, degré : descendre les égrés. - (24) |
| égré, s. m. marche d'escalier, degré. - (22) |
| egreau : outil pour débroussailler - (61) |
| égrechir : voir gregir. - (20) |
| égrècver. Ecorcher le devant de la jambe. Voyez grève. - (12) |
| égréger. v. a. Témoigner par des caresses, par des gâteries, la préférence qu’on a pour tel et tel enfant. Du latin etgregare. (Sommecaise). - (10) |
| egregi : voir écrechi. - (20) |
| égreigne. Avare ; adorateur de sa cassette et de son écrin. Ne pas confondre avec écraigne du patois dijonnais, qui signifie une veillée d'hiver, et primitivement une chaumière... Par extension, un écreigne est une personne qui se nourrit mal, une personne maigre et chétive. Le diminutif écrignôle s'applique aux enfants maladifs, aux chats et aux chiens souffreteux. En patois de Namur, cranche est synonyme d'avare. - (13) |
| égreli, rendu grêle, desséché par la privation de l'humidité nécessaire à certains ustensiles en bois, tels que seaux, cuviers, etc. - (02) |
| égremiller (pour égrumiller). v. a. Mettre en miettes, en menus brins. Egremiller du pain, du vermicelle. — Se dit particulièrement des fruits à grappe, quand on détache les grains, les grumes, d’un seul coup, en les froissant de haut en bas entre les doigts. C’est un diminutif d’égremer, d’égrumer. - (10) |
| égrener : Le verbe est français, on dit plutôt egeumer. Oter les grains « Egrener des faviôles », ôter les grains des cosses de haricots. - (19) |
| égrenou (n') : égreneuse - (57) |
| égrès, égresse. s.f. Degrés, marches, escalier, issue, sortie. Du latin egressus. - (10) |
| égreule, subst. masculin : houx. Au figuré, on dit gracieux comme un beuchon d'égreule pour quelqu'un avare de sourires et peu aimable. - (54) |
| égreulée (de l'), s. houx. - (38) |
| égreumé, enlever les grains d'un raisin, les séparer de leurs pédoncules et de leurs copeaux. - (16) |
| égreumer : Enlever les grains (greumes) d'une grappe de raisin. « La grale (grêle) a tot égreumé les raijins, i ne demore que la crape (la rafle) ». - (19) |
| égreuné, égrener, ôter les grains de leur enveloppe. - (16) |
| égrèvè : abîmé par les graviers (corne des sabots des animaux), éraflé - (48) |
| égrèver : (égrèvè - v. trans.) seulement usité dans l'expr. égrèvè les dents, "agacer les dents". - (45) |
| égrier, égriller. v. a. Eparpiller. (Annay-sur-Serein). - (10) |
| égrifon, s. m. édredon, grand coussin rempli de plumes. - (08) |
| égrimgner, v. tr., arracher le chiendent (grirnon) avec une fourche, ou mieux une pioche à dents. - (14) |
| égrinchot : ustensile qui sert à cueillir les mures - (44) |
| égriôle : Petit crustacé ressemblant à une crevette que l'on trouve dans certaines de nos eaux courantes et qui par leur présence font considérer ces eaux comme de bonne qualité. - (19) |
| égrion. Héron. - (49) |
| égrippè : accrocher - (46) |
| égrippot. s. m . Crochet en bois pour tirer à soi les branches d’un arbre. (Etivey). - (10) |
| égriyon, petit morceau. - (28) |
| egrodzi : temps pluvieux virant au beau. A - B - (41) |
| egrodzi : temps pluvieux qui se met au beau - (34) |
| égrodzi, égredzi : temps pluvieux qui se met au beau - (43) |
| égron : oie sauvage - (48) |
| égron : héron. Les égrons sont migrateurs : les hérons sont migrateurs. - (33) |
| égron. s. m. Héron. Voyez aigueron. - (10) |
| egrons : oies sauvages - (39) |
| égrouer (s'), v. pron., se baisser : « Te n'pou pas rémasser c'qui ? Egroue-te, vouéyons ! » (V. s’Avoufer.) - (14) |
| égrouer. v. a. Couvrir. Se dit d’une poule qui cache ses petits sous ses ailes. De grouée, couvée. (Argentenay). - (10) |
| egrougi : égratigné. A - B - (41) |
| egrougi : égratigné - (34) |
| égrougi v. (d'égrugeoir). Ecorcher. A Suin on utilise le verbe écotrâlli. - (63) |
| égroûgner : ébrécher - (48) |
| égrougner, v. a. entamer, ébrécher, écorner : « égrougner » un pain, « égrougner » un meuble, une assiette, etc. - (08) |
| égrouiller : égratigner, écorcher - (39) |
| égruger, v. a., piler le sel. - (11) |
| égrumer : v. a., égrener. - (20) |
| ègu[y]on : aiguillon. - (52) |
| ègu[y]ouère : pierre à aiguiser les outils et principalement les faux. - (52) |
| éguairer : perdre, égarer - (48) |
| éguasser (s'). Se tremper dans l'eau en la faisant jaillir. Etym. e et gué, qui, dans toute la Bourgogne, ne signifie pas l’endroit ou un cours d'eau est guéable, mais un abreuvoir naturel ou artificiel. - (12) |
| égucher. v. a. Aiguiser, affiler. (Plessis-Saint-Jean). - (10) |
| égué ! excl, même acception que Aga. (V. ce dernier mot.) - (14) |
| ègué : s. m. pierre d'évier. - (21) |
| éguèche, oyasse. Pie. Fig. Surnom donné à une personne qui marche en sautant comme une pie. - (49) |
| éguègne : bête maigre. - (66) |
| égueldon, égledon, éguerdon. Édredon. - (49) |
| eguenillé, adj., déguenillé, couvert de guenilles. - (14) |
| éguenillé. adj . Eparpillé, jeté pêle-mêle, en désordre, comme un tas de guenilles. (Essert). - (10) |
| éguenotte (pour huguenotte). s. f. Marmite de terre sans pieds, pour la cuisson des viandes sur un fourneau. (Plessis-Saint-Jean). - (10) |
| éguer. v. a. Regarder. (Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes). Voyez aga. - (10) |
| éguéré, égarer une chose de manière à la faire chercher ; se dit aussi de quelqu'un qui semble atteint de folie ou qui s'écarte de ses devoirs. S'éguéré, s'écarter par inadvertance du chemin qu'on devait suivre. - (16) |
| éguéré. adj. Hagard. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| eguereillé : v. t. Disperser. - (53) |
| égueriou. s. m. Petit houx. Se dit pour aigriou, aigriot, et ce nom se donne au houx à cause des piquants de ses feuilles. (Montillot). - (10) |
| éguerjotte (pour griotte). s. f. Merise, petite cerise. - (10) |
| èguesse : pie. - (52) |
| ègueubeusné(e) : (èkeuboesnè(é:) - part. passé pris comme adjectif) (en parlant d'une personne âgée) recroquevillé, replié sur soi-même. Mot expressif à l'étymologie inconnue. - (45) |
| égueugne, s.f. averse. - (38) |
| égueugner. v. a. Piquer, taquiner, asticoter. Vient d’aigu, aiguillonner. - (10) |
| egueulé : trop ouvert, trop écarté - (37) |
| egueuler (verbe) : déformer, avachir un vêtement. - (47) |
| égueûne, s.f. chat maigre. - (38) |
| égueurer v. (or. inc.). Egoutter. - (63) |
| ègueuri : (ègeu:ri - v. trans.) gâter un enfant en cédant à tous ses caprices. Ce mot, très vivace, est resté en français régional. - (45) |
| ègueuriot : (ègeuryo - subst. m.) houx ; il est singulièrement rare à Liernais. - (45) |
| égueuriou : houx. - (52) |
| égueurjottier. s. m. Merisier, griottier. - (10) |
| égueurnai : égrainé. La tempête è egueurnai la mouéchon su pied : la tempête a égrené la moisson sur pied. - (33) |
| égueurné : n. m. Échenilloir. - (53) |
| égueurnè : v. t. Égrainer. - (53) |
| égueurner (pour égrener). v. a. Râteler. Se dit ainsi, sans doute, parce que, en râtelant le foin dans les prés, les graines se détachent et se sèment toutes seules. (Gollan). - (10) |
| égueurner : égrainer. - (52) |
| égueurner : égréner - (48) |
| égueurner v. Egrener. - (63) |
| égueurner, v. égrainer. - (38) |
| egueûrner, v. tr., égrener. - (14) |
| égueurner. Égrener. - (49) |
| ègueurzansi : v. secouer le van par un mouvement combiné des coudes et des genoux. - (21) |
| éguiâdner : (égyâ:d'nè - v. intr.) en parlant d'un morceau de bois, se fendre incomplètement, éclater de façon à ce que des fibres retiennent · encore les morceaux. Par exemple, il est fréquent qu'une bûche de charme égyâ:dn' lorsqu'on tente de la fendre avec un merlin inapproprié. - (45) |
| éguiand. s. m. Gland, fruit du chêne. (Charentenay). - (10) |
| éguieurer (pour écœurer). v. a. Décourager, troubler, ahurir. (Merry-la-Vallée). - (10) |
| éguieux. adj. Synonyme de frat. Noix éguieux, noix dont l’amande est adhérente à la coquille. (Etais). - (10) |
| éguigne, personne qui n'est guère apte à travailler, maladive, de santé délicate. - (27) |
| éguillée. s. f. Ecuellée. (Sénonais). - (10) |
| égumel. s. m. Bâtiment isolé. (Sénonais). - (10) |
| éguncher. v. a. Eclabousser. (Argentenay). — Voir aiguieucher. - (10) |
| éguœrllianssi*, v. n. balancer le van d'un mouvement combiné des bras et des reins. - (22) |
| égusé, aiguiser. A Châtillon, sans s'embarrasser d'un barbarisme bourguignon, l'on dit réguser. - (02) |
| égusé. : Aiguiser, affiler une lame. – Piarre égusore, c' est·à-dire pierre à aiguiser. - (06) |
| egûser, v. tr., aiguiser, sur la pierre ou la meule. - (14) |
| éguvoîle. s. f. Pierre à repasser. (Fleys). - (10) |
| èguye : s. f aiguille. - (21) |
| éguye, aiguille ; éguyë d'fi, aiguillée de fil. - (16) |
| éguye, s. f., aiguille. - (14) |
| égü-ye, s.f. aiguille. - (38) |
| éguyée, s. f., aiguillée de fil, enfilée ou non. - (14) |
| ègu-yer, v., aiguiser avec une meule. - (40) |
| éguy-ie, aiguille. - (26) |
| egüyon, s. m., aiguillon, arme du bouvier. - (14) |
| éguyottes : les racines des plumes restant sur la peau d'une volaille plumée, on dit également tiô - (46) |
| éguzé, aiguiser ; éguzé dë pessiâ, aiguiser des paisseaux, tailler à nouveau leur extrémité inférieure. - (16) |
| eguze. Aiguise, aiguises, aiguisent. - (01) |
| eguzon, ce qu'on abat d'un paisseau qu'on aiguise. - (16) |
| éguzon, parcelle de terre en pointe encastrée dans d'autres. - (26) |
| éhart. s. m. Hart. Une botte d’éharts. Addition de l’é euphonique. (Saligny). - (10) |
| éhaule. s. m. Erable. (Girolle). - (10) |
| éhitaize, s. m. héritage, ce qu'on reçoit par voie de succession, propriété rurale, champ, prairie, etc. (voir : héritaige.) - (08) |
| éhiter, v. n. hériter, avoir un héritage : « i é éhité du beutingn' d'mon pée », j'ai hérité du bien de mon père. - (08) |
| ého ! : Interjection ohé ! « Eho, vins-tu ? » - (19) |
| éholer : se dit des bergers chantant certains chants. Ill, p. 43 - (23) |
| éhouter, v. découdre, déchirer. - (38) |
| èianci. Églantier. - (49) |
| eide. Aide, secours. Il est aussi verbe. - (01) |
| eifiniai - raffiner, faire plus parfaitement. - Oh ! lai Luise, il eifigne, lé. .. ! c'â ine aidroite. - Le Félix aifigne to ; al à étai ai Paris. - (18) |
| eiglôgue. « Qu’on les épiglôgu »e, qu'on les examine avec toute l'attention possible, qu'on les épilogue. Epiplôgai, épiloguer. - (01) |
| eillan. ll mouill. s. m. gland. La même région prononce « eillandée » pour glandée. (Voir : aiguian.] - (08) |
| eille : eau - (43) |
| eille, s. f. oreille par syncope. - (08) |
| eilleurs (adv.) : ailleurs - (50) |
| eillioure, s. j. couche de blé disposée à terre pour être battue au fléau. - (24) |
| éillise (n’) : église - (57) |
| eillise, église. - (05) |
| eilloeure, s. f. couche de blé disposée à terre pour être battue au fléau. - (22) |
| eilluer. v.a. Louer. J’ai eillué un valot, j’ai loué un domestique. Du latin elocare. (Athie). - (10) |
| ein - du verbe avoir. Voyez : aint et l'interjection francaise. - (18) |
| ein, eine, adj., un, une: « Tôt por ein côp. » — « A c'maitin, y avôt eine fête. » - (14) |
| ein. Un. Quelques-uns écrivent in et én. Le bourguigtian dit même fort souvent un, qui a meilleure grâce en quelques endroits. Cela dépend de l’oreiile. - (01) |
| ein. : Un. On dit aussi in et en, mais mieux un. - (06) |
| einchlle, adj. enflé. Verbe : einchllé. - (22) |
| einchlliou, s. f. enflure. - (22) |
| eine (art.ind.) : une (aussi ène, eune) - (50) |
| eine. art. indéfini fémin. Une. Eine femme. Eine robe. (Sainpuits). - (10) |
| einteûrv’rie : entr’ouverte - (37) |
| eiscaiyer : escalier - (37) |
| eisser. : (Dial.), sortir (dérivation naturelle du verbe latin exire). - (06) |
| éjâder : chasser, faire fuir - (48) |
| éjaffré ou évaffré. : (Patois des bords de la Saône), stupéfait. Le latin expavefactus semble avoir défrayé ce mot. - (06) |
| éjâfré, adj., très étonné, stupéfait. - (14) |
| éjaïlli : Pousser un cri aigu dans un moment de surprise. « Quand y ant vu entrer les carnavals y se sant mis à éjailli », quand elles ont vu entrer les masques elles ont poussé des cris. - (19) |
| éjamoter : enlever les germes de pommes de terre de consommation. - (30) |
| éjançai (s'), s'agencer, se mettre en toilette. - (02) |
| éjassiner : Pousser un cri aigu causé par la frayeur. « Quand aile a vu la sarpe (le serpent) aile a éjassiné in cô ». - (19) |
| eje ! Cri poussé pour faire avancer les bovins. - (49) |
| éjé (adj.) : trempé (syn. enfondu, tripé) - (64) |
| éjedir, effrayer. - (05) |
| éjédir. Effrayer. Dans quelques localités du Chalonnais on appelle le feu-follet éju ; de la frayeur qu'il inspire aux naïfs habitants de la campagne est venue la formation de notre verbe. - (03) |
| éjer (v. tr.) : rouir le chanvre, l'immerger dans l'eau pour séparer les fibres - (64) |
| èjevrer : v. frissonner. - (21) |
| ejindrer (verbe) : répandre. (Notamment le fumier dans les champs). - (47) |
| ejment : récipient - (51) |
| éjouée (n. f.) : rouissoir, endroit où l'on rouit le chanvre - (64) |
| ékeûchi v. (d'éclisse) 1. Entailler une branche, un arbre, lacérer le bois. 2. (de keûche) - (63) |
| ékeulé : accroupi. (B. T IV) - S&L - (25) |
| ékeuler. Éculer. Fig. « S’ékeuler » s'emploie pour s'accroupir. - (49) |
| ékeume, écume. - (16) |
| ékeurie d'cotson n.f. Soue des porcs, porcherie. - (63) |
| ékeûrie d'cotsons : (nf) soue à porcs - (35) |
| ékeurie d'vatse n.f. Etable. - (63) |
| ékeûrie d'vatses : (nf) étable - (35) |
| ékeurkaÿi : (vb) écarquiller (les yeux) - (35) |
| ékeûssi : (p.passé) sans le sou, fauché - (35) |
| ékeûssi : (vb) écosser - (35) |
| ékéyatré, ée. adj. Personne courte et grosse, qui écarte les jambes en marchant. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| ékiarè : éclairer - (46) |
| ékié : (nm) éclat de bois, copeau - (35) |
| ekieulé (mo —) : accouplé (mal). (REP T IV) - D - (25) |
| ékigneul : malingre. (B. T II) - B - (25) |
| ékiore. v.n. Eclore. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| ékiuhie, Equiuhie. s. f. Ecurie. (Jussy). - (10) |
| ékoeurjou : se dit en parlant d'un enfant maussade, jamais content, ou d'une personne qui fait des manières. (CLB. T II) - C - (25) |
| ékouâfler. v. a. Escarbouiller, broyer, écraser. (Champlost). - (10) |
| èkrapé (s') : v. beaucoup s'agiter sans faire de bon travail. - (21) |
| ékrenner : mettre en miettes. - (30) |
| ékseuprë, exprès. - (16) |
| ékyaîré, éclairer. - (16) |
| ékyaîrsi, éclaircir ; se dit notamment pour : arracher d'une planche de jardinage ce qui la rend trop touffue. - (16) |
| ékyaîrsie, espace clair à travers un nuage ou après un orage. - (16) |
| ékyaté, éclater. - (16) |
| ekyer : éclair. (B. T IV) - D - (25) |
| el. art. déf. - Le. - (42) |
| el. Il, ils. El y fu, il y fut. El y fure, ils y furent, car on a remarqué ci-dessus au mot Ai, que le pronom el soit pluriel, soit singulier, se mettait toujours devant une voyelle. - (01) |
| el. pron. person. masculin de la 3e pers. Se dit pour il, dans plusieurs communes, notamment à Etivey. El ot endôvé, il est très- taquin, très-contrariant. El i tertevallé, il a beaucoup bavardé. - (10) |
| el’çon. s. f. Leçon, par transposition de l’e. Une el’çon. (Puysaie). - (10) |
| élâde (n.f.) : éclair - (50) |
| élâde (n.f.) : 1) éclair - 2) chélidoine - (50) |
| elade (nom féminin) : éclair. - (47) |
| élàde, s. f. éclair. - (08) |
| élâde, s. f. éclaire ou chélidoine. - (08) |
| élâder (v.t.) : éclairer, faire des éclairs - (50) |
| elader (verbe) : faire des éclairs. - (47) |
| élâder : faire des éclairs - (48) |
| élàder, v. impers. éclairer, faire des éclairs. - (08) |
| élâdir. v. m. Eclairer, faire des éclairs. (Domecy-sur-le-Vault). - (10) |
| élaide - éclair. - En y aivo des élaides qu'éclairaint quemant le jor. - Ile é po des élaides préque quemant du tonnerre. - Le temps à pliein d'élaides de chaleur. - (18) |
| élaide : éclair. (C. T III) (RDM. T IV) - B - (25) |
| élaide, éleude, éloïde, élouaide, éclair... - (02) |
| élaide, éleude, éloïde, élouaide. : Éclair. - (06) |
| élaille (être) : être à l'aise, en forme. - (56) |
| élancée : s. f., lancée, élancement. - (20) |
| èlandné, vn. se développer en épi : se dit de l'avoine. - (17) |
| élané : fatigué, lassé. (V. T IV) - A - (25) |
| élangouèré : (élangouèrè – adj. substantivé) homme grand, maigre, et de caractère mou. - (45) |
| élangouèré : très assoiffé, fatigué - (39) |
| elangué, âlangué : celui qui n’arrête pas de parler - (37) |
| élanguenai. : Accablé de langueur (du latin languescere). - (06) |
| élangueni. Mot très-expressif pour rendre un état d'affaiblissement, de langueur ou d'atonie ; en latin, languere... - (02) |
| élantè : haletant - (46) |
| élardé : qui est tombé de tout son long - (43) |
| elardé : qui est tombé le tout son long - (34) |
| élardé : tombé à plat - (44) |
| elarder (s') : tomber à plat. A - B - (41) |
| élarder (s') : (vb) tomber à plat ventre - (35) |
| élarder (s') v. Tomber à plat ventre. - (63) |
| élarder (s'). Tomber par terre de tout son long. « Je me suis élardé dans la borbe ». - (49) |
| élarder : tomber par terre en s'étalant de tout son long. - (30) |
| élargi : élargir - (57) |
| élation. : (Dial.), hauteur, fierté. Ce mot se trouve dans le livre de Job et vient du latin elatio qui a le même sens moral. - (06) |
| élaucher. v. a. Couper, diviser par bandes étroites, par lauches. — Elaucher un champ, en soulever et renverser la terre par bandes, avec la charrue. - (10) |
| élavas. s. m. Grande pluie, qui noie tout. Roquefort écrit élavasse, et fait dériver ce mot de alluvio, inondation, débordement ; nous croyons que c’est à tort, et qu’il vient plutôt de elavare, noyer, perdre sous l’eau. - (10) |
| élayage. s. m. Elagage. - (10) |
| élayer. v. a. Elaguer. - (10) |
| élayeux. s. m. Elagueur. - (10) |
| élayues (pour élayures). s. f. pl. Petites branches provenant de l’élagage d’un arbre. - (10) |
| el'çon. n. f. - Leçon. - (42) |
| éleçon – leçon, se dit à peu près uniquement dans le sens des enfants. - Mon enfant, aiprends bein ton éleçon. - (18) |
| élèder : (élèdè - v. intr.) faire des éclairs. Sè é:lèd', " il fait des éclairs". - (45) |
| éléder, éleuder, élider. v. n. Faire des éclairs. (Argenteuil, Quincerot). - (10) |
| élèder. Faire des éclairs. Nous n'avons pas l'équivalent en Français, car le verbe éclairer ne s'emploie guère dans ce sens. Les Avallonuais disent élâdir. En patois wallon : écliter... - (13) |
| élemai, allumer. Elemai ène élemôte, allumer une allumette. - (02) |
| elemote. Allumette, allumettes. - (01) |
| élenti : Déprimé, avachi. « Je sus si bin accablié de chaud que j'en sus tot élenti ». - (19) |
| élenti, élentie : adj., vx fr. alenter (v. a.), ralenti, fatigué. - (20) |
| èler : aller. - (52) |
| éleucher : séparer en fendant - (48) |
| éleucher : se dit d'une branche qui casse - (39) |
| éleucher, v. n. faire un faux pas, trébucher. - (08) |
| éleûmer, v. tr., allumer, faire briller. - (14) |
| éleûmote et el'mote, s. f., allumette. - (14) |
| éleuquer : Ebranler. « J'ai eune dent que grôle (qui remue) je n'ose pas enco l'arréji (l'arracher) elle est partant bien éleuquée», « Vla eune vilain-ne beurée, i pourrait bin graler, y ne faudra qu'in ban cô de tonnare pa y éleuquer ». Vieux français eslochier. - (19) |
| éleurdi : Etourdir. En sortant de table après de copieuses libations : « Je ne sais pas ce que j'ai, je sus tot éleurdi ». - (19) |
| éleurdi, v. a. donner le vertige, spécialement après qu'on a tourné rapidement. - (22) |
| éleurdi, v. a. donner le vertige, spécialement après qu'on a tourné rapidement. - (24) |
| éleurdissement : Etourdissement. « I me prend des éleurdissements, i me simb 'lle que je vas cheu ». - (19) |
| éleuter : avoir des nausées et se forcer pour vomir. - (62) |
| éleûter : avoir la nausée. (RDB. T III) - S&L - (25) |
| éleuter : Faire des efforts pour vomir. «Qu’est-ce-que t'as dan que te fa éleuter c 'men cen ? J'ai eune arrête au gousier ». - (19) |
| eleûter, âleûter : avoir envie de vomir sans pouvoir y parvenir - (37) |
| éleûter, v., avoir envie de vomir, vomir. - (40) |
| éleuve : Elève. Jeune bétail chez les cultivateurs qui font l'élevage. - (19) |
| eleuve, élève : se dit aussi bien des petits de certains animaux que des enfants qui fréquentent une école. - (16) |
| éleuve, s. m. élève, nourrisson. S’emploie en parlant des animaux : un veau, un agneau, un porcelet, sont des « éleuves. » on dit aussi des bêtes « d'éleuve. » - (08) |
| elevè : v. t. Élever. - (53) |
| élève-mort : s. m. et f., personne qui couve la mort. D'un vieillard agité, qui ne reste pas en place, on dit : « C'est la mort qui le mène. » - (20) |
| élexir, s. m., élixir: « La vieille a tôjor dans l'ormoire son élexir de longue vie. » - (14) |
| élicher, v. tr., frictionner. Quand le rebouteur frictionne le membre qu'il vient de remettre, il l’éliche. - (14) |
| élichoter, v. lécher doucement ; faire un travail avec grand soin. - (38) |
| elide : éclair. A - B - (41) |
| élide : (nf) éclair - (35) |
| elide : éclair - (34) |
| élide : éclair - (43) |
| élide n.f. (du lat. elidere, faire jaillir) Eclair. - (63) |
| élide ou élidôle : Eclair. « Je n’ai pas vu l'élide mâ j'ai bin entendu tonner ! ». - «Oh! la balle élidôle ». - (19) |
| élide*, s. f. éclair. Verbe : élidé. - (22) |
| élide, êleude, élède, élaide (Br., Chal., Y.), éloïde, élouaide, élaye (C.-d.), élâde (Morv.). - Eclair. Plusieurs de ces expressions se trouvent dans le vieux français avec la même signification et viennent soit de elucere (luire, briller), soit de elidere (faire jaillir). Les mêmes mots servent aussi à désigner la plante appelée communément éclaire (la chélidoine) Quant aux verbes élâder, élider, élayer, etc., ils signifient éclairer dans le sens de faire des éclairs. C'est encore un de ces vocables patois plein d'origina-lité et n'ayant pas d'équivalents en français… - (15) |
| élide, élider, éclair, éclairer. - (05) |
| élide, éloide, éclair qui n'est pas suivi d'un coup de tonnerre. - (16) |
| élide, éluide : s. f., vx fr. esloide, éclair ; clarté. - (20) |
| élide, s. f. éclair. Verbe élider (origine contestée, latine ou celtique). - (24) |
| élide, s. f., éclair de chaleur: « I fait des élides, mâ n'y ara point d'taboulot. » Néanmoins les paysannes ne manquent pas, à chaque éclair, de faire le signe de la croix pour se préserver de la foudre. - (14) |
| élide, s.f. éclair. - (38) |
| élide. Éclair. Fruit de « l'élidier », (alisier). - (49) |
| élide. Eclair. On a dit autrefois éclite, éclitre et éloise. - (03) |
| élider : faire des éclairs - (43) |
| élider v. Faire des éclairs. - (63) |
| èlider : v. faire des éclairs. - (21) |
| élider, éluider : vx fr. esloider, v. n.. faire des éclairs ; éclairer. - (20) |
| élider, luxer un os, un tendon. - (05) |
| élider, v. faire des éclairs. - (38) |
| élider, v. imp., faire des éclairs: « Boufre ! au mitan d'la neùt, y élidòt brament ! » - (14) |
| élider. Faire des éclairs, des « élides ». - (49) |
| élidier. Alisier (Sorbus torminalis). - (49) |
| èlidôle : éclair. - (21) |
| élier, délayer (par exemple de la farine dans de l'eau). - (27) |
| élifrer, v. n. marcher en traînant le pied, en laissant une trace. Les vaches ont « élifré » tout le long du bois. - (08) |
| éliger. v. a. Soulager. - (10) |
| éligner (pour aligner). v. a . Polir, mettre à sa place, mettre en ligne. — Eligner ses cheveux, les lisser. (Sommecaise). - (10) |
| éligner. v. - Aligner, regarder en fermant un œil. Autre sens : polir, lisser. (Sommecaise, selon M. Jossier) - (42) |
| éligner. v. n. Regarder d’un seul œil, bornoyer, comme font les géomètres, lorsqu’ils veulent dresser un alignement. (Mouffy). - (10) |
| éliguer, v. a. élaguer, émonder. - (08) |
| élijon, s. m. partie mobile et tournante de l'avant-train d'un chariot. - (08) |
| élin-ne. Alène. - (49) |
| élipade, s.f. glissade où l'on manque de tomber. - (38) |
| éliper, v., glisser, tomber. - (40) |
| èlirer : (èlirè - part. passé pris comme adj.) lisse et glissant. Lè rout' ô: tôt' èliré: "la route est glissante = il y a du verglas". - (45) |
| Elizai. Elisée, en bourguignon Elisai… - (01) |
| ellè : aller - i vè : je vais - i èleu : j'allais - i ireû : j'irais - vons'y : allons-y - (46) |
| èllè qu'ri : aller chercher - (46) |
| ellemale : mauvais couteau. (MM. T IV) - A - (25) |
| ellemotte. s. f. Allumette. (Girolle). - (10) |
| ellit au lieu d'élu. : (Dial.) «En amertume d'anrme sunt tuit li ellit. » (Job.) - (06) |
| èllongè : allonger - (46) |
| ellyénan. : Syncope des mots: il y a un an. - (06) |
| elmèce : limace. T'ai don du sang du sang d'elmèce ? : tu as donc du sang de limace ? - (52) |
| elmèce : voir limas - (23) |
| elmèce : limace - (39) |
| èlmelle. Vieille lame de couteau et par extension, vieux couteau, mauvais couteau. - (49) |
| elmer : allumer (le feu). - (52) |
| elmer : allumer - (39) |
| elmer, v. allumer. - (38) |
| élméte, allumette ; élmé, allumer ; éleume, allume. - (16) |
| elminte, allumette. - (26) |
| élocher, éloucher : v. a., vx fr., déchirer, dégueniller, mettre en loques. - (20) |
| élodir : abasourdir. (E. T IV) - VdS - (25) |
| élôgne. s. f. alêne. (Montillot). — A Vassy-sous-Pisy, on dit élouàgne. - (10) |
| éloicher, élocher, eslocher (du latin exlocare) v. a . Courber, tordre, disloquer, briser. Quand on pioche au pied d’un cep, disent les vignerons d’Auxerre, il faut prendre garde d’éloicher les jeunes pousses, la souche ou les racines. - (10) |
| éloigni : Eloigner. « I tonne pas si feû que t'ta l'heure, la beurée s'est éloigni ». - (19) |
| éloiri : étourdi. (C. T III) (V. T IV) - B - (25) |
| éloiri. part. p . et adj. Etourdi. - (10) |
| éloirir (l’r ne se prononce pas). v. a. Etourdir. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| elongé. Allonger, allongé, allongez. - (01) |
| élonger, v. tr., allonger, étirer. - (14) |
| élordé : adj. Pas assez cuit. - (53) |
| élordé : assommé, étourdi - (39) |
| élordi - élourdi par un coup violent ; amortir un morceau de viande sur le feu, etc. - Al i é beillé un co de poing que l'é élordi. - Ah ma, dis don ! ton bout de moton n'â pâ cueut, a n'â qu'élordi. - (18) |
| élordi : étourdi. - (29) |
| élordi : étourdi. Qui a le lordot : le vertige. - (62) |
| élordi, étourdir ; te m'élordi, tu me fatigues la tête, les oreilles. - (16) |
| élouacer. v. a. Etuler une branche d’arbre, la détacher de sa tige. (Merry-la-Vallée). — Voyez équeucher. — A Charentenay, élouacer, signifie, achever de fendre et séparer l’un d’avec l’autre les éclats d’un morceau de bois déjà plus ou moins fendu. - (10) |
| èlouâgne : (èlouâ:gn' - subst. f.) alêne , poinçon. - (45) |
| èlouchi : déchirer. - (21) |
| élouécher. v. a. Allécher. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| élouéde : éclair. - (29) |
| élouègner : éloigner - (48) |
| élouègner : éloigner - (39) |
| élouèri (adj.) pris de vertige, d'étourdissement. - (45) |
| eloueri : étourdi. (MM. T IV) - A - (25) |
| élouèri : étourdi. (RDF. T III) - A - (25) |
| élouéri : simplet, évaporé (mental), étourdi - (48) |
| élouéri : étourdi physiquement par un choc ou l'alcool. Un simple o éloueri : un simple est étourdi. - (33) |
| élouéri : étourdi - (39) |
| élouéri, élourdi : adj. Qui a la tête qui tourne. - (53) |
| élouérie (n.f.) : étourderie - (50) |
| élouérir : assommer, étourdir - (48) |
| élouési. adj. Affamé et fatigué. - (10) |
| élouette (n.f.) : alouette - (50) |
| élouette. s. f. La luette. (Plessis-Saint-Jean). - (10) |
| élouger (pour louer). v. n. et v. a. Assurer sa place au four pour cuire. — S’élouger. v. pron. Se louer, se mettre en condition, du latin elocare. - (10) |
| élouque. s. f. Secousse, mouvement qu’on so donne. - (10) |
| élouquer. v. a. Ebranler un objet planté dans la terre ou scellé dans la pierre ou le bois, en le tirant à soi et le repoussant tour à tour, pour l’arracher de l’endroit où il est. Du latin exlocare. (Auxerre). - (10) |
| élourdi : étourdi - (39) |
| élourdi, étourdi. - (04) |
| élourdi, v. intr., étourdir, tourner la tête, donner le vertige : « Je n'sais pas c'que j'ai ; j'seû tout élourdi, j'peux pas m'teni. » - (14) |
| élourdir : v. a., vx fr., provoquer un élourdissement. Ah ! reste donc un peu tranquille, t' m'élourdis toute. - (20) |
| élourdir : v. t. Avoir la tête qui tourne. - (53) |
| élourdir, alourdir, étourdir, causer des vertiges. - (05) |
| élourdir, verbe transitif : étourdir. - (54) |
| élourdir. Alourdir. Fig. Étourdir. - (49) |
| élourdir. Pour étourdir, mais uniquement dans le sens d'éprouver le malaise physique appelé étourdissement. Etym. forme altérée d'éduquer, avec un sens plus complet et favorable. - (12) |
| élourdissement : s. m., vx fr., état d'appesantissement ou de semi-vertige. - (20) |
| élourdissement. Alourdissement. Fig. Étourdissement. - (49) |
| élousser. v. a. Donner un violent coup de poing. (Etivey). - (10) |
| élouyou. s. m. Loriot. - (10) |
| elo-ye, éclair. - (26) |
| éltiée, s. f. litière, paille sur laquelle les animaux se couchent dans les écuries. - (08) |
| éluchai : détacher, séparer deux branches en les écartant. La tempête éluchai les arbres. - (33) |
| éluché, subvenir de justesse à ses besoins immédiats. - (28) |
| élucher (des enfants) : élever. (E. T IV) - C - (25) |
| élucher : éclater une branche. - (09) |
| élucher, v. a. pendre par éclats, en déchirant l'objet fendu. - (08) |
| élucher. Faire éclater des branches d'arbre : an y évot tant de pouères su c't'âbre iqui y qu'a s'ast éluchè. À Landrecies on dit écliffer. Ce mot vient peut-être du latin elocare. - (13) |
| éluchi, instruire; d'où éluche, élève, et, par extension, éluchon, nourrisson. A Aignay, se bien élucher ou alucher signifie se bien nourrir. Le sens primitif du mot peut bien avoir pour racine le latin elucere, éclairer. - (02) |
| eluchi. Instruisit, éleva. Le verbe éluché vient peut-être de par allusion aux bêtes dont les femelles ont coutume de lécher leurs petits. Aussi dit-on en Bourgogne elluchon pour nourrisson… - (01) |
| éluchon. : Élève (dial.). Grosley cite comme bourguignonne l'expression élûcher, qu'il traduit par élever avec soin. Dans certaines parties de la Bourgogne (à Aignay par exemple), se bien élûcher signifie se bien nourrir. - (06) |
| éludé; on élude quand l'estomac se soulève, comme si l'on voulait vomir. - (16) |
| éluette. n. f. - Halte, pause, coupure. (Granchamp, selon M. Jossier) - (42) |
| éluette. s. f. Halte. (Granchamp). — Se dit sans doute pour élusette, moment accordé pour se reposer, se récréer, se distraire. Du latin ludere , qui fait au supin lusum. - (10) |
| éluge. Étincelle. - (49) |
| éluger. v. - Ennuyer, agacer : « Va, va ma vieille, tu ne m'élugeras plus longtemps, je vais habiter Paris dans un mois.» (Colette, Claudine à Paris, p.178). Éluder ou éluser, dérivés du latin (e)ludere, jouer, signifiait jouer ou se jouer de. Ces mots du XVe siècle, légèrement altérés en éluger, sont conservés dans le dialecte poyaudin. - (42) |
| élumai. : Allumer. Les villageois disent : Élumai ène elemôte de chenefeuille (tige de chanvre). - (06) |
| éluré, adj., déluré, vif, dégourdi, hard i: « Cett’-là, j'en réponds, y et eùne élurée. » - (14) |
| élûtai – éprouver quand on rit trop fort, quand on vomit, des espèces de convulsions qui provoquent les larmes. - I ons ri ! i ons ri ! qui en élûtains. - Lu, quant a vomi al en à quemant mailaide, al élûte ai plieurai. - (18) |
| élute : suffoque en toussant. Ol en élute : il en suffoque (ou regarder à droite et à gauche). - (33) |
| élûté, ouaillé : v. t. Faire des efforts pour vomir. - (53) |
| éluteman (n.m.) : haut-le-coeur - (50) |
| élutener, avoir envie, efforts de vomir - (05) |
| éluter (C.-d., Morv., Br.), leuter {C-d., Chal.). - Faire des efforts pour vomir, avoir des hauts-le-coeur, de eluctare, sortir avec effort. - (15) |
| élûter (s') : égosiller (s') - (39) |
| éluter (v.t.) : faire des efforts pour vomir - (50) |
| élûter : tousser en s'étouffant, avoir des nausées - (48) |
| éluter, « L » faire effort (pour vomir), eluctari, s'efforcer. - (04) |
| éluter, avoir des renvois, des aigreurs, dans une digestion pénible. - (27) |
| éluter, Avoir envie de vomir. - (13) |
| éluter, v. avoir des nausées. - (65) |
| éluter, v. intr., faire des efforts pour vomir : « Oh ! l'pauv', ôl élutôt, ôl élatôt et i n'pouvôt rau v'nî ! » - (14) |
| éluter, v. n. paire des efforts pour vomir, avoir des nausées - (08) |
| éluter. Faire des efforts pour vomir, du latin eluctari. - (03) |
| élûtes, s. m. pl., éclairs d'orage. - (40) |
| él'ver : élever - (57) |
| él'veur (n’) - él'vou (n’) : éleveur - (57) |
| elweri : étourdi. (SY. T II) - B - (25) |
| elyéan. Il y a un an. Régulièrement c'est « el y é en an » qu'il faudrait dire, mais ici, par élision, pour éviter la rencontre trop dure des deux é, l'on prononce et l'on écrit « el y é nan »… - (01) |
| émachoter. v. a. Conspirer, machiner, ourdir un complot. (Sénonais). - (10) |
| émachotter. v. a. Ramasser le fourrage, l’avoine, l’orge en petits tas, sur le pré où l’on fauche, sur le champ où l’on moissonne. (Plessis-Saint-Jean). - (10) |
| émacier, v. maigrir, amincir. - (38) |
| émaginer, v. tr., imaginer. - (14) |
| émagnier. v. a. Imaginer. Altération consistant surtout dans la transposition du second i. - (10) |
| emaillenté : adj. Qui a perdu son lustre. - (53) |
| émaîllou (n’) : émailleur - (57) |
| émaiziner (v.t.) : imaginer - (50) |
| émaiziner, v. a. imaginer. - (08) |
| emamceler, v. a. blesser, meurtrir, mutiler. - (08) |
| émande, amande ; émandyé, amandier. - (16) |
| émandé, croître, en parlant des arbres, des plantes ; on dit d'un enfant qui a beaucoup grandi dans peu de temps : el é bén émandè. - (16) |
| émander : (vb) fermer - (35) |
| émander : grandir. Peut-être du latin emandare : améliorer. - (62) |
| èmander : grossir, prendre du poids, profiter, amender. Ç'ot ène bounne béte ! Elle èmande ben : c'est une bonne bête ! elle profite bien. - (52) |
| émandrelaie, s.m. amandier. - (38) |
| émandrolé : estropié d'un membre - (39) |
| émanzelé (-e) (adj.m. et f.) : mutilé (-e), estropié (-e) (de Chambure note : émancelé) - (50) |
| émapper : v. a., agiter, remuer. - (20) |
| émar, are. adj . Amer ; par la transposition de l’a et de l’e. (Bazarnes). - (10) |
| émargi : émarger - (57) |
| emarine : osier. A - B - (41) |
| emarine : osier - (34) |
| émarmiller. v. a. Ecraser entre ses doigts. (Gisy-les-Nobles). - (10) |
| émartoueiller : écraser - (39) |
| émarveiller, v. tr., émerveiller, étonner grandement. - (14) |
| emassai. Amassé, amassez, amasser. - (01) |
| émasser, v. tr., amasser, des chiffons comme des écus. - (14) |
| émasser. v. - Amasser. - (42) |
| emasson. Amassons. - (01) |
| émat. s. m. Lie que l’huile dépose au fond du vase ou du vaisseau qui la contient. (Percey). - (10) |
| émau : s. m., émail. Un émau bressan. - (20) |
| émauvo : étourneau. (C. T IV) - S&L - (25) |
| emauvu. Mauvais. - (49) |
| émauzeter (v.t.) : gaspiller (aussi émaujeter) - (50) |
| émauzeter, v. a. gaspiller, dépenser avec prodigalité, perdre. - (08) |
| embabiôler, v. tr., flatter, tromper. - (14) |
| embabouiner. v. a. Envelopper la tête, la figure de quelqu’un de manière qu’on lui voit à peine le milieu du visage. — S’embabouiner. v. pronom. S’envelopper, s’emmitouffler la tète et la figure pour se préserver du froid ou pour toute autre cause. - (10) |
| embâche, s. f. poupée ou « plain » de chanvre prêt à être filé. Même sens à peu près que « embâtenée. » environ de Château-Chinon. (Voir : embâtenée.) - (08) |
| embadouèré : enduit. (MM. T IV) - A - (25) |
| embadroïlli v. Étendre de la peinture, du badigeon, barbouiller. - (63) |
| embagué, qui a les doigts ornés de bagues... - (02) |
| embagué. : C'est-à-dire qui porte des bagues dans les doigts. Ce mot a fini par exprimer toute une toilette. - (06) |
| embailleuré, adj. se dit des pains trop rapprochés dans le four et dont la croûte n'a pu se former, faute de cuisson. Notre pain est mauvais, il est « embailleuré. » (Voir : bajé.) - (08) |
| embailleure, s. f. brisure, contact, choc de deux pains dans le four, lequel nuit à la formation de la croûte. - (08) |
| embairquer (s’) : emprunter un chemin avec un but bien défini - (37) |
| embaisaleure : Baisure, empreinte que portent deux pains qui étaient serrés l'un contre l'autre dans le four et qui ont eu leur croûte déprimée au point de contact. Vieux français, embaiser. - (19) |
| embaisure, s. f., baisure, la touchée de deux miches dans le four : « Oh! man-man, beille-me l’embaisure ; j'y ain-me gros. » Fraîche, elle est très recherchée. - (14) |
| embaite - battre une faulx pour lui donner du fil. - Mon daird ne cope pu, en faut absolument qui l'embaitte. - En fauro qui embettâ mon dair. - (18) |
| embajouré : se dit d'un pain dont les parties sont collées ensembles - (39) |
| embale, conteur de billeversées, prometteur, comme le sont avec emphase les gens peu sincères. - (02) |
| embale. : Fanfaron, hâbleur. - (06) |
| emballe - embarras, en parlant des personnes qui ennuient, qui gênent par leur inutilité. – Ne me pairle pâ de c't'homme lai, c'â ine vraie emballe. - Vos nos é envie ce gairson lai, c'â une emballe de première classe. - (18) |
| emballe. Personne ennuyeuse, qui vous obsède. Etym. corruption du mot embarras et transposition au figuré de son sens matériel. - (12) |
| embarber. v. a. et v. n. En navigation, action de faire pénétrer en droiture l’avant d’un bateau dans l’ouverture d’une écluse ou sous l’arche d’un pont, sans battre à droite ni à gauche, sans raser la barbe des parois. — Se dit aussi, par extension, de l’action d’éviter par quelque manœuvre habile les bateaux montants ou descendants, les épaves, pieux ou obstacles qui se rencontrent dans le chemin. - (10) |
| embarbouillé. adj. - Embrouillé, mélangé, en vrac. - (42) |
| embarbouiller. v. a. Embrouiller, obscurcir, emmêler. Embarbouiller une affaire, l’obscurcir, l’embrouiller de telle sorte qu’on n’y comprend plus rien. (Perreuse). - (10) |
| embardouiller. Embarbouiller. - (49) |
| embaressi : embarrasser quelqu'un - (43) |
| embaressi, dzain-né : embarrassé (être), confus (être) - (43) |
| embarillé, adj., se dit de la vache ou du mouton gonflé par la luzerne humide. - (40) |
| embarlificoté se dit, à Châtillon, pour exprimer la gêne des mouvements par suite de quelques entraves... - (02) |
| embarouillé : v. t. Barbouiller. - (53) |
| embarras (Ce n'est pas l’) Cette locution beaunoise n'a pas du tout le sens qu'on pourrait supposer. Sa signification est à peu près celle du mot effectivement. — Je n'ai pas envie de sortir de chez nous ? — Ah ! ce n'est pas l’embarras, le brouillard est si malsain ! - (13) |
| embarrassi : embarrasser - (57) |
| embarratier. s . m. Faiseur d’embarras. (Saint-Bris). - (10) |
| embarrer v. Boucher les trous d'une haie avec des branches coupées sur la haie elle-même. - (63) |
| embarressi : embarrasser - (51) |
| embarressi : mettre enceinte, être enceinte - (51) |
| embasurai - se dit des miches de pain placées dans le four trop près l'une de l'autre, et qui ne sont pas cuites comme il faut au point de contact. - Voiqui ine miche embasurée. - (18) |
| embât’née. s. f. Quenouillée de filasse. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| embâté, adj. ; pareil, semblable ; c 'ost lu, tot embâté. - (07) |
| embâtenée, s. f. se dit des étoupes de chanvre, lesquelles sont disposées pour garnir la quenouille. norm. « embatée », ce que l'on met sur un bât. (Voir : embâche.) - (08) |
| embâtener, embât’ner. v. a . Embâtonner, arranger, disposer sa filasse autour d’un bâton qui sert de quenouille. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| embâtener, v. a. garnir d'étoupes la quenouille. - (08) |
| embâter : Embêter, ennuyer. « Qu'est-ce qu'o vint tojo m'embâter cetu-la ? ». - (19) |
| embattage, n.m. bandage de roue. - (65) |
| embattaige : cerclage métalique des roues de bois - (48) |
| embauche, s. f. Bœuf ou vache à l’engrais dans une pâture. (Saint-Martin-sur-Ouanne). - (10) |
| embauche, s. f. pâturage, prairie, dans lesquels on enferme les bêtes « à l'embauche », c’est à dire soumises à l'engraissement. - (08) |
| embaucher, v. a. mettre des animaux dans « l'embauche » ou prairie où ils doivent s'engraisser. - (08) |
| embaucher. v. a. Mettre des ouvriers en travail, leur distribuer leur tâche. — En général, commencer un travail, une entreprise. — Se dit aussi, dans un autre ordre d’idées, pour mettre des animaux à l’engrais. - (10) |
| embaucheu, s. m. embaucheur, celui qui a pour industrie « d'embaucher » les bêtes à cornes, les bœufs, les vaches. - (08) |
| embauchi : embaucher - (57) |
| embauchi : Embaucher. « Ol est allé s'embauchi à la féculerie de Torneu ». - (19) |
| embaudir. v. a. Allumer. (Merry-la-Vallée). - (10) |
| embautsi v. Embaucher. - (63) |
| embelle : s. f.. embellie, circonstance favorable, situation améliorée. Aux billes, les enfants crient ; Pas d’embelle ! lorsque celui qui fait tirer une bille de valeur cherche à l'abriter au moyen d'un obstacle naturel. Peut-être faut-il écrire en belle, et sous-entendre place ou situation. - (20) |
| embenaché : pris dans des embûches. - (30) |
| emberder. v. a . Enduire, embarbouiller. (Bussy-en-Othe). - (10) |
| emberdi (prendre son). Partir rapidement, se sauver, s'enlever, au figuré se facher. Etym. probablement barder (voir ce mot). - (12) |
| embergnaud (un) : quelqu'un qui embarrasse - (61) |
| embergnot : gêneur, objet encombrant - (60) |
| emberlificoté : embarrassé dans des liens. - (09) |
| emberlificoter. v. a . Séduire, entortiller, circonvenir par de belles paroles. (Perreuse et un peu partout). — Signifie aussi quelquefois empêtrer, embarrasser. - (10) |
| embérnant. Embarrassant, encombrant. - (49) |
| emberner (pour embrener). Salir, embarbouiller d’ordure. = Au figuré, embarrasser, importuner, gêner. Qué qu’il a donc à venir toujours m’embeurner comme ça. — Etre emberné, être dans l’embarras, dans le pétrin, dans la gêne, dans de mauvaises affaires. = Il y a des endroits où l’on dit embarnir. - (10) |
| emberner : emmerder - (61) |
| emberner : encombrer - (60) |
| emberner : souiller d'ordure. - (09) |
| emberner. Embarrasser, encombrer. On prononce bien souvent : « embeurner ». - (49) |
| emberner. v. - Embarrasser, gêner. S'emploie également dans le sens d'encrasser, salir énormément. - (42) |
| emberneux (n. m.) : importun, gêneur - (64) |
| emberniau - emberniot : embarras, au sens concret. Du verbe : emberner – embarrasser. Ex : "Na plein d'emberniau dans ta vinée". - (58) |
| embêtant. adj. Qui vous fatigue, vous ennuie, vous ahurit de façon à vous rendre bête. - (10) |
| embêter. v. a. Ennuyer, contrarier, fatiguer. - (10) |
| embeubliner : Entortiller, séduire. « C'ment s'qu'alle a bin pouyu se laichi embeubliner de la sôrte ? ». - (19) |
| embeudrâilli, embeurdâilli v. Souiller, salir, barbouiller, et, au sens figuré, embarrasser. - (63) |
| embeurber : embourber - (51) |
| embeurdé : 1 v. t. Embarrasser. - 2 v. t. Encombrer. - 3 v. t. Mettre une bande. - (53) |
| embeurdiner : donner le vertige. A - B - (41) |
| embeurdiner : donner le vertige - (44) |
| embeurdiner : faire tourner la tête, avoir le vertige - (34) |
| embeurdiner, ébeurdiner v. Etourdir. Voir beurdin. - (63) |
| embeurdzi : emmêlé (se dit pour un lien). A - B - (41) |
| embeurdzi : ficelle corde emmêlée - (34) |
| embeurdzi : nigaud, lourdaud - (35) |
| embeurgnot (nom masculin) : chose inutile prétendue décorative et qui encombre plus qu'elle ne décore. - (47) |
| embeurioler, v. a. donner l'impulsion, mettre en train, imprimer un mouvement. - (08) |
| embeurjeuilli : Embrouiller. « Allans ban ! via que j'ai tot embeurjeuilli man cotan (mon coton) ». - (19) |
| embeurlificoter (verbe) : embrouiller. Tromper. - (47) |
| embeurlificoter v. (du v.fr. emberlicoquer, s'emplir la tête de chimères) Embrouiller, entortiller. - (63) |
| embeurlificoter : entortiller, embarrasser, emberlificoter, prendre dans un piège - (39) |
| embeùrlificoter, v, tr., embarrasser, engeôler, prendre dans un piège. - (14) |
| embeurlouaiché : 1 v. t. Barbouiller. - 2 v. t. Emmêler. - (53) |
| embeurné : embarrassé, confus. A - B - (41) |
| embeurné : embarrassé, confus, perdu - (34) |
| embeurné : embarrassé, encombré, signifie aussi embarras pulmonaire (contraire : débeurné). - (33) |
| embeurne n.f. Emmerdement, ennui, contrariété. - (63) |
| embeurne, gênant, encombrant - (36) |
| embeurner (s) v. 1. Se souiller avec des excréments 2. Sens fig. Se tromper, se mettre dans une mauvaise situation. - (63) |
| embeurner (v.t.) : embarrasser par des objets de toute sorte - (50) |
| embeurner (verbe) : encombrer de choses sans valeur. - (47) |
| embeurner : Terrer. « Le renâ s'est embeurné sell la reuche », le renard s'est terré sous la roche. - (19) |
| embeurner v. Emmerder, au sens propre ou figuré. Une mère réplique vertement à sa fille qui lui annonce qu'elle a trouvé un prétendant : Poûre gârs, si ô savot cment ô sra embeurné ! - (63) |
| embeurner, v. a. embarrasser, empêcher. - (08) |
| embeùrner, v. tr., barbouiller, salir, souiller. - (14) |
| embeurtaller v. Fixer une bretelle de sabot. Sens fig. Mal embeurtallé, mal parti, mal engagé. - (63) |
| embeuser (v. tr.) : enduire d'une substance grasse ou pâteuse - (64) |
| embeuser. v. - Salir, se salir de beuse, de boue. Emboser ou boserer signifiait au XIIIe siècle : salir en couvrant de bose (bouse). Ce mot bose, d'origine incertaine, pourrait être dérivé du mot qui donna « boue ». Curieusement, le poyaudin évoque aussi bien la boue que la bouse avec le verbe embeuser. - (42) |
| embeutiner, v. a. meubler, garnir de meubles, d'instruments, de provisions, etc. - (08) |
| embiaiver (verbe) : emblaver, mettre en culture. - (47) |
| embiâuder, embioûser : tromper, « rouler » en affaires - (37) |
| embicher. v. a. Embrasser, donner un baiser. - (10) |
| embie. n. m. - Vent du nord. - (42) |
| embier, v. a. imbiber, humecter à fond. Embier une étoffe, un papier. - (08) |
| embigarrer, v. a. emmêler, placer une chose sans ordre, la mettre hors de son lieu - (08) |
| embirure. s. f. Emblavure. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| embiscaudé, ée. adj. Ensorcelé. Un homme à qui rien ne réussit, dit : J’seus embiscaudé. (Sommecaise). - (10) |
| embiscaudé. adj. - Ensorcelé, malchanceux. - (42) |
| embiscauder. v. a. En faire accroire, tromper, ensorceler. (Laduz). - (10) |
| embistrouillé : embêté - (61) |
| embistrouiller. Ennuyer. - (49) |
| embistrouiller. v. - Déranger, embêter : « Vous avez-ti pas fini d'm'embistrouiller aveuc vos affai'es. » (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| embizé : gercé par la bise. - (30) |
| emblaive : emblave - (48) |
| emblaive : emblave - (39) |
| emblaive, s. f. emblavure, semis de grains et en général les semis de tout genre : une belle « emblaive. » - (08) |
| emblaiver (v.t.) : ensemencer, cultiver un terrain - (50) |
| emblaiver : emblaver, ensemencer - (48) |
| emblaiver : emblaver - (39) |
| emblaiver, v. a. ensemencer, cultiver un terrain en y jetant une semence quelconque. - (08) |
| emblaver (v. tr.) : encombrer un lieu - (64) |
| emblaver : ensemencer. Assimilation, quelquefois, avec labourer. - (58) |
| emblimer. v. - Envenimer, infecter : « La plaie s'est emblimée. » - (42) |
| emblimer. v. a . Envenimer, aggraver. (Bléneau). — Emblimer une plaie, l’enflammer. (Villiers-Saint-Benoit). - (10) |
| emblousé. adj. Qui est empêtré, embarrassé. (Mailly-la-Ville). - (10) |
| emblue, emblure. s. f. Contraction d’emblavure. Terre ensemencée en blé, et, quelquefois, blé destiné à la semence. (Lainsecq). - (10) |
| emblue. n. f. - Formé sur emblaver : terre ensemencée de blé et par extension de toute autre céréale. - (42) |
| embobeliner, v. tr., persuader, enjôler, subtiliser : « Y ét eùn r'naré ; ôl embobeline brament son monde. » - (14) |
| embobliner v. Embobiner. - (63) |
| embôche : Embouche, grand pré clos de haies dont on ne fauche pas l'herbe et qu'on fait pacager. « Y a des bans prés d'embôche dans le Charolla (dans le Charollais) ». - (19) |
| embôchi : Faire le commerce qui consiste à acheter du bétail maigre et à le revendre après l'avoir laissé à l'embouche le temps qui lui est nécessaire pour s'engraisser. - (19) |
| emboconer : empuantir à la façon du bouc. A - B - (41) |
| emboconer : empester. - (62) |
| emboconer, v. intr., sentir mauvais de la bouche. (V. Empôsener.) - (14) |
| emboconer. Sentir mauvais de la bouche, par extension puer en général. Etym. en et bucca. - (12) |
| emboconner : empuantir - (35) |
| emboconner : empuantir - (57) |
| emboconner : sentir mauvais (comme le bouc) - (43) |
| emboconner : sentir mauvais comme le bouc - (34) |
| emboconner v. 1. Empuantir. 2. Transmettre une maladie, une infection, contaminer. Voir bocon. - (63) |
| emboconner : v. n., empester (voir bocon). « Y est c'te sacrée bougie de Saint-Laurent qu’ emboconne tout le quai. - Oui, on en prend plus avec le nez qu'avec un' fourchette. » - (20) |
| emboconner. Répandre une forte odeur, une odeur de bouc. - (49) |
| embodzi v. Mettre en bodze, ensacher. Voir bodze. - (63) |
| embohêmer (on prononce embouèmer). v. a. Flatter, charmer, captiver, tromper, faire ce que font les Bohémiens et les Bohémiennes. (Auxerrois et Puysaie). - (10) |
| embohêmeux, euse (on prononce embouèmeux). s. f. Flatteur, charmeur, trompeur, qui fait capter la confiance des gens et qui en abuse. - (10) |
| emboire : v. a., faire un embu. - (20) |
| emboire. v. a. Absorber un liquide, s’en pénétrer comme une éponge. - (10) |
| emboisai. : (Dial. et pat.), enjôler, prendre quelqu'un comme dans un bois. Dans la langue d'oc, emboscar signifie se mettre en embuscade, se cacher dans un bois. Dans le dialecte, amboisieux signifie charlatan. - (06) |
| emboisé, enjôler par des compliments... - (02) |
| embôler : (embôlè - v. intr.) prendre de la terre, en parlant des souliers. - (45) |
| embondi. adj. - Bien pris, bien parti, en parlant du feu. - (42) |
| emboquè : donner la becquée - (46) |
| emboqué : v. t. Donner la becquée. - (53) |
| emboquener : Sentir mauvais, comme le bouc. - (19) |
| emboquer : faire manger un oiseau (par le bec ou boquot), ou un enfant… - (62) |
| emboquer : Gaver, engraisser la volaille en lui mettant de force la nourriture dans le bec. Vieux français boque, bouche, (Littré). - (19) |
| emboquer : mettre en bouche. - (66) |
| emboquer v. Gaver, mettre dans le bec, faire avaler de force. - (63) |
| emboquer, v. faire manger un enfant, remplir une cavité, un tuyau, etc. - (38) |
| emboquer, v. tr., embecquer, donner la pâtée aux petits oiseaux, aux volailles ; faire manger les petits enfants. - (14) |
| emboquer, v., faire manger de force, gaver. - (40) |
| emboquer. Donner la becquée, la « boquée ». - (49) |
| emborbé : embourbé - (43) |
| emborber : embourber - (48) |
| emborber : pris dans la boue - (39) |
| emborber. Embourber. - (49) |
| embordzi v. Emmêler. - (63) |
| emborner (s'), v. pron., entrer avec difficulté dans quelque endroit, corridor, allée tortueuse, etc. ; passer à travers des voitures : « Y f'sôt neùt ; ô s'ét emborné dans la bouchure ; ô s'é tout égrafigné. » - (14) |
| emborron : (nm) enveloppe de châtaigne - (35) |
| embôrser, v. a. mettre dans sa bourse et par extension dans sa poche. - (08) |
| embossus : bogue, enveloppe de la châtaigne - (43) |
| embotner v. Emboutonner. - (63) |
| embotonner : (vb) boutonner (un vêtement) - (35) |
| embouaillai : emméler. Mon peloton de laine o embouaillai : mon peloton de laine est emmêlé. Contraire : débouaillai. - (33) |
| embouaîter : emboîter - (57) |
| embouaît'ment : emboîtement - (57) |
| embouche : grand pré - (61) |
| embouche : pré où on élève les bœufs. VI, p. 43 - (23) |
| embouche, s. f., lieu clos, pâturage fertile dans lequel les paysans enferment certains bestiaux pour les engraisser. - (14) |
| emboucher, verbe intransitif : dans les jeux de cachette, cacher les yeux pour compter. - (54) |
| embouchi : emboucher - (57) |
| emboudaler. v. - Embourber, enliser. - (42) |
| emboudaler. v. a. Embourber. — S’emboudaler. v. pron. S’embourber. J’me seus emboudalé. (St-Martin-des-Champs). - (10) |
| emboudérer (s') (v.pr.) : s'embourber - (50) |
| emboudérer : pris dans la boue - (39) |
| emboudérer, v. a. enfoncer dans la boue, dans un lieu fangeux ou mouvant. - (08) |
| embouéiller : emmêler - (48) |
| embouêmer. v. - Tromper, entortiller, comme on peut le dire traditionnellement des bohémiens. - (42) |
| embouêmeux, euse. n. m. - Trompeur, entortilleur, flatteur. - (42) |
| embouèrbé, adj. ; embourbé. - (07) |
| embouler, v. a. emmêler, entortiller. - (08) |
| embouler. v. a. Embrouiller, mêler, emmêler. (Gourgis). - (10) |
| embouquer, abecquer, ingérer de la nourriture aux volailles. - (05) |
| embourriller : enchevêtrer - (60) |
| embours (A l’). adv. A rebours. (Michery). - (10) |
| emboursat : s. m., vx fr. embossoir, entonnoir à large tube servant à faire les saucisses boudins, etc. Voir boudinet et fait-clair. - (20) |
| embourser. embosser : v. a., remplir un boyau à l'aide de l’emboursat. - (20) |
| embourseur, embosseur : s. m., ouvrier saucissonnier, qui embourse. - (20) |
| emboussou : entonnoir pour pousser la viande dans le boyau - (46) |
| emboutée : (nf) contenu des deux mais jointes - (35) |
| emboutée : ce qui tient dans les mains jointes - (43) |
| emboûtée n.f. Le contenu de deux paumes jointes. - (63) |
| embouteilli : embouteiller - (57) |
| embouti : emboutir - (57) |
| emboutonner : v. a., boutonner. Voir aboutonner et remboutonner. - (20) |
| emboûtse n.f. Embouche. - (63) |
| emboutseux n.m. Emboucheur. - (63) |
| emboutsi (mal) loc. Mal élevé, qui parle mal. - (63) |
| emboutsou : emboucheur - (51) |
| embraichi : Voir aussi rembraichi. Embrasser, baiser. « Si je t'acoute (si je t'obéis) qu'est ce que te me donneras ? Je t'embraicherai pa le jo de l'an ». - (19) |
| embraichi. Embrasser. Ce mot représente à la fois l'infinitif et le participe passé. - (49) |
| embraînchi : embrancher - (57) |
| embranler. v. - Lancer un travail, mettre en route, mettre en branle. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| embranler. v. a. Mettre en branle. Embranler une cloche. — Au figuré, commencer, mettre en train, donner le branle. Embranler une affaire. (Etais). — S’embranler. v . pron . Se mettre en mouvement. - (10) |
| embrarillé (être), adj. s'emploie pour parler de la vache ou du mouton gonflé par la luzerne ; également pour une personne qui digère mal. - (65) |
| embrasse, filet pour foin des voitures. - (05) |
| embrasse, s. f., récipient contenant la provision de fourrage pour une journée. L’embrasse se composait de deux demi-cerceaux, tenus aux extrémités par deux cordes formant charnières, et garnis d'un filet à larges losanges par lesquels bœufs, et chevaux tiraient le foin fermé dedans. - (14) |
| embrassée : s. f., ancienne mesure de longueur pour les chemins, valant 6 pieds, c'est-à-dire 1 m. 949. - (20) |
| embrauder, embrôder (v.) : salir, souiller avec une matière visqueuse (de Chambure écrit embrôder) - (50) |
| embrèchi v. Embrasser. - (63) |
| embredener : faire tourner la tête, avoir le vertige - (43) |
| embrediner : voir ébrediner. - (20) |
| embrene : s. f., em...bêtement ; embarras, arrigailles. « T’ vas encore à la salle des ventes ; J’ n'ai pas besoin de toutes tes embrenes ici. » - (20) |
| embrené, tout couvert de. Dans l'idiome provençal, embrena signifie souillé. - (02) |
| embrener : v. a., em...bêter ; embarrasser, encombrer, empiger. Quand on veut faire ce qui s'appelle un gueuleton, faut pas s'embrener d' femmes... - (20) |
| embreniaudé : embarrassé. - (30) |
| embresi, emprundre : embrasé - (43) |
| embressè : embrasser - (46) |
| embressi : (vb) embrasser - (35) |
| embreugni : se dit d'un temps de brouillard. - (30) |
| embreuyo : le nombril - (46) |
| embreyaudé : pas libre. - (30) |
| embricoler. v. - Mettre des bricoles, des brides à des sabots. (Mézilles, selon H. Chéry) - (42) |
| embridè (sabot) : avec une bride (sabot) - (48) |
| embrigander : entrainer dans un mauvais coup - (44) |
| embrintsi v. Embrancher, ramifier. D'une personne grande et mince on dit qu'elle est embrintsie haut. - (63) |
| embrochi : embrocher - (57) |
| embrôder : enduire, salir, maculer - (48) |
| embrôder, v. a. salir, souiller. Se dit pour l'emploi d'une matière plus ou moins épaisse ou visqueuse. On « embrôde » une assiette avec de la sauce, de la graisse, du miel, etc. - (08) |
| embroicher, v. a. piquer avec une aiguille, une chose pointue ; embrocher. (Voir : broiche.) - (08) |
| embroïlli : Embrouiller. « Quand les hommes de loi se maulant de veutés affâres y est bin rare si y est pas pa les embroïlli ». - (19) |
| embrotsi v. Embrocher. - (63) |
| embrouillamini, s. m., mélange d'idées, ou de choses incompatibles et incompréhensibles. - (40) |
| embrouille, pantalon de toile bleue pour protéger un autre. - (27) |
| embrouille, s. m. pantalon de toile que les ouvriers mettent par dessus un autre pour préserver ce dernier. « Brouiller », en patois, signifie salir. - (08) |
| embrouille. n. f. - Cotte de toile bleue. (Mézilles, selon H. Chéry) - (42) |
| embrouille. Pantalon de toile grise grossière que l’on met par-dessus un autre pour protéger celui-ci pendant le travail. Etym. en patois, on dit vêtement brouillé pour vêtement tache de boue, d'où l'embrouille {en et brouillé) est le vêtement destiné à préserver les autres de la boue en la recevant lui-même. - (12) |
| embrouiller (s'), v. pr., courir, s'élancer, se mettre en train, donner l'impulsion : « Y ét ein vrâ démon ; quand i s'agit d'côri, y é tôjor lu qui s’embrouille le premei. » - (14) |
| embrouilli : embrouiller - (57) |
| embroussailli : embroussaillé - (57) |
| embrô-yer, v. embrouiller - (38) |
| embrue (n.f.) : élan, impulsion - (50) |
| embrue : élan - (39) |
| embrué, mis en mouvement. Dans l'idiome breton, broeza signifie s'emporter. (Le Gon.) On dit à Châtillon qu'une chose s'embrue quand elle acquiert de la vitesse dans l'impulsion qu'elle a reçue. - (02) |
| embrue, s. m. élan, impulsion. Prendre son embrue, se mettre en train, s'élancer. - (08) |
| embruer (Char.), embruyer (C.-d., Morv.), embrouyer (Chal.), ambruer (Br.), (s'). – Se mettre en train vivement ; travailler avec ardeur et rapidité. Ce verbe s'emploie de préférence passivement ; seul, le patois bressan l'emploie activement… - (15) |
| embruer (s'), courir pour s'élancer. - (05) |
| embruer (s'), v. réfl. se mettre en train, recevoir l'impulsion pour un mouvement, prendre son élan. - (08) |
| embruer, v. embrayer, mettre en train. - (38) |
| embruiller, donner l'élan à quelque chose (embruiller une voiture, un moteur). - (27) |
| embrunchi (adjectif) : chargé de nuages. - (47) |
| embrunchi, v. a. couvrir, obscurcir, voiler, cacher, et au figuré rendre triste, maussade : un ciel « embrunchi », c’est à dire nuageux ; un visage « embrunchi », c’est à dire sombre ou refrogné ; une cloche « embrunchie », c’est à dire au son voilé. - (08) |
| embrunchir (v.) : se dit des nuages qui envahissent le ciel - "las carniaux embrunchissan le cié" - (50) |
| embrunchir : v. a., vx f r. embrunir, brunir, s'assombrir. Voir brundir. - (20) |
| embruyai (et s’) - mettre une chose en mouvement s'élancer. – Allons, embruye tai fort, et pu t'airiverez devant lu. – Grande aifâre que de bien embruyai. - (18) |
| embruyer (S'). Travailler avec ardeur et rapidité. - (13) |
| embruyer. Mettre en mouvement, commencer une course, une carrière ; au figuré se lancer, être lancé. Etym. en, ruere. - (12) |
| embu : s. m., fronce. - (20) |
| embu, ue. adj. et partic. p. du verbe emboire. Imbibé, pénétré, saturé d’eau ou d’un autre liquide. - (10) |
| embue. adj. - Se dit d'une terre saturée par la pluie. - (42) |
| embuer : Mettre dans le cuvier le linge sale qu'on veut lessiver. « Alle s'est levée à la pique du jo pa embuer la beue ». - (19) |
| embuer, mettre en lessive. - (05) |
| embüer, v. intr., mettre le linge en lessive. - (14) |
| embuer. Mettre en lessive ; nous disons bue pour lessive, du vieux mot buée, du latin buo. - (03) |
| embuier, embuer (embûer) : v. a., mettre le linge dans le cuvier à lessive. Voir buie. - (20) |
| embyauder v. Revêtir une blouse, habiller. - (63) |
| éme : Esprit, sagesse, intelligence. « O n'a pas ésu l'éme de se cougi », il n'a pas la sagesse de se taire. « Tête à po d'éme », tête sans cervelle. - (19) |
| ème : Fragon ou petit houx (ruscus aculeatus) plante à baies rouges et à feuilles dures terminées en pointe aigue. - (19) |
| ême, s. f. bon sens, esprit, intelligence : avoir de l’ême (vieux français). - (24) |
| ême, s. f. bon sens, esprit, intelligence. - (22) |
| émelinge. s. f. Mésange. (Sougères-sur-Sinotte. — A Laduz, on dit éméange. - (10) |
| èmender : (èmandè v. intr.) grossir, prendre des forces, profiter. Al é jêr bin: èmandè, ton: gâ: ! "il a drôlement profité, ton fils !". - (45) |
| émender. Voyez amender. - (10) |
| émener, v. amener. - (38) |
| èmerale : (èmral' - subst. f.) matricaire, sorte de plante qui dégage une odeur assez forte ; on l'accroche aux branches des arbres où l'on ne veut pas que l'essaim qu'on y a capturé revienne se poser. - (45) |
| émeraude : s. f., cétoine dorée (cetonia aurala), coléoptère vivant sur les roses. Voir tailleuse. - (20) |
| emerillonai. Emérillonné, éveillé, gai, qui a l’œil vif comme l’oiseau de proie nommé émérillon… - (01) |
| émertouéiller : écraser - (48) |
| émêtir (le cœur): l'affadir. (E. T IV) - C - (25) |
| émétsi adj. Eméché. - (63) |
| émeudes : s. f. plur., glas ; première sonnerie pour un mort, variable suivant que le défunt est un homme, une femme ou un enfant. - (20) |
| émeudes, s. f. pl. premier glas annonçant le décès. - (22) |
| émeudes, s.f. pl. premier glas annonçant le décès. - (24) |
| emeune. Amène, amènes, amènent. - (01) |
| émeùner, v. tr., amener, conduire vers. - (14) |
| émeurné (éte) : être très fatigué - (39) |
| émeurner : frapper sur quelqu'un - (39) |
| émeurssî : fatigué. - (62) |
| émeuseler (s') : S'abîmer la figure. « Ol a cheu, o s'est tot émeuselé ». - (19) |
| émeuzaler : écorcher…le museau. Verbe usuellement pronominal. - (62) |
| émi, ami. - (16) |
| émi, s. m., ami. « Toi, t'é ein émi. » - (14) |
| èmi. Ami. - (49) |
| emi. n. m. - Ami. - (42) |
| émiâler : écraser - (39) |
| émiauler, emmiauler (pour emmieller). v. a . Attirer, séduire quelqu’un par de belles paroles, par des flatteries, par des compliments, pour essayer de le faire parler, de lui arracher un secret, ou pour une autre cause. (Sommecaise). - (10) |
| émiauler. v. - Flatter, séduire, entortiller. (Sommecaise, selon M. Jossier) - (42) |
| émiauleux, euse. adj. - Flatteur, séducteur. - (42) |
| emiaullay, réduire en miettes. - (02) |
| émicolou, adj. amical. - (38) |
| émie, s. f. amie : « L'vauran ! ô vous a d'jâ eùne bonne émie ! » - (14) |
| émiger. v. a. et n. Manger. — Se dit aussi, substantivement, pour mangeaille. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| emillan. Les bonnes gens à Dijon disent « émillan peri » pour éminent péril… - (01) |
| emillan. : C'est le mot éminent défiguré. Se bôtre an ein leu émillan, c'est-à-dire se placer sur une hauteur. Le patois, en disant aussi émillan pèril, confondait les deux idées éminent et imminent. - (06) |
| emillant - imminent, qui menace d'arriver. - Mot bourguignon cité dans la préface de ce vocabulaire. - (18) |
| emiolai - émietter, réduire en petits morceaux. - Emiole ces bouts de pain qui pou les poules. - A faisant bein al émiolaint lai terre, aivant de semai. - (18) |
| emiôlai. : Flatter, caresser.- Emmieller, dans Nicot, signifie amadouer. - (06) |
| emioler. Flatter. Il semble que ce soit une altération d'emmieller. Cependant on trouve le vieux verbe emmaïoler avec le sens de « donner le mai. » Une troisième étymologie est indiquée par M. Lorédan Larchey dans son « Dictionnaire des noms » : c'est celle du verbe amiôter, employé au moyen-âge dans le sens de « faire amitié ». Tout bien onsidéré... je préfère le miel. - (13) |
| émioter, v. a. émietter, disperser en miettes. - (08) |
| émioter, v. tr., émietter, réduire en parcelles. - (14) |
| émiotter (v.) : émietter - (50) |
| émiotter : émietter - (48) |
| émiotter : émietter - (39) |
| émiquié, s. f., amitié. - (14) |
| emmaigi : Mettre le linge dans le cuvier. Même sens que embuer. - (19) |
| emmainter (v. tr.) : empoigner, saisir - (64) |
| emmainter (verbe) : prendre en mains. (Emmainte don la bêche et r'tourne mouai c'te ch'tit bout d’jardin). - (47) |
| emmainter. v. - Prendre en main, entortiller : « Aveuc c't'histouère d'héritance, l'Aline alle a ben emmainté l'Denis ! Il est d'son couté à c't'heu' ! » (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| emmaiser : v. a., mettre en maie, encuver le linge de la lessive. - (20) |
| emmaliner. v. - Rendre méchant (malin) un animal ou un enfant. Se dit également d'une plaie infectée. - (42) |
| emmaliner. v. a. Rendre méchant. Emmaliner un cheval, un enfant. (Canton de Toucy). - (10) |
| emmanc’er : emmancher, commencer, prendre une direction - (37) |
| emmanche (n. f.) : affaire embrouillée (c'est enne drôle d'emmanche) - (64) |
| emmanche, emmanchie. n. f. - Embrouille, complication, histoire. - (42) |
| emmanche, subst. féminin : combinaison qui comporte des risques, affaire embrouillée, mal engagée. - (54) |
| emmanche. s. f. Difficulté imprévue qui survient dans le cours d’une affaire. V’là une drôle d’emmanche qui se présente là. (Sommecaise). - (10) |
| emmancher (S’). v. pronom. Se fourrer, s’introduire danz un lieu, dans une affaire, à l’étourdie, d’une manière plus ou moins inconsidérée. (Vilieneuve-les-Genêts). - (10) |
| emmanchis. s. m. pl. Observations contradictoires, oiseuses ou peu intelligibles que, dans une conversation d’affaires, un des intéressés oppose à celui qui parle, et qui sont mal accueillies. Qu’est-ce que ça signifie, tous ces emmanchis-là? Tu nous embêtes avec tes emmanchis. - (10) |
| emmangi : Emmancher. « Emmangi eune plieuche. Man dâ ne cope ren. Y est qu'o n'est pas bien emmangie », ma faux ne coupe pas. C'est qu'elle est mal emmanchée, c'est à dire : ce n'est pas la faux qui est de mauvaise qualité, c'est le manche, le faucheur qui s'en sert. - (19) |
| emmantsi, emmandzi v. Emmancher. - (63) |
| em-manze : affaire embrouillée. - (52) |
| emmardé : v. t. Emmerder. - (53) |
| emmarder : emmerder - (39) |
| emmardouillé : 1 v. pr. S'affaisser. - 2 v. pr. S'écraser comme une merde. - (53) |
| emmater : v. a., mettre en mate. - (20) |
| em'm'cho, un peu, une petite quantité de. - (28) |
| emmeillé, adj. on dit des épis de blé qu'ils sont bien « enmeillés » lorsqu'ils sont régulièrement garnis de grains dans toute leur longueur. - (08) |
| emmeilleneter : Emmailloter. « San daré ptiet est-i tojo emmailleneté ? », son plus jeune enfant est-il toujours au mailllot ? - (19) |
| emmêlis. n. m. - Enchevêtrement, mélange. « Te parles d'eune emmêlis aveuc ceux ficelles ! » - (42) |
| emménaigi : Emménager. « J'emmenaigerins quand les pliâtres serant sos », nous emménagerons quand les plâtres seront secs. - (19) |
| emmesser (s'). v. - Assister à la messe. (M. Jossier, p.53) - (42) |
| emmesser (S’). v. pron. Assister à la messe. (Puysaie). - (10) |
| emmeuner (v.t.) : emmener - (50) |
| emmiauler. v. a. Emmieller, flatter, séduire, tromper par de douces paroles. Dans le Doubs, on dit emmiouler. - (10) |
| emmiauleux, euse. adj. et s. Flatteur, séducteur, hypocrite, qui trompe par son langage doucereux. - (10) |
| emmingi : introduire - (57) |
| emminji : emmancher - (57) |
| emmioler. v. a. Emmaillotter. - (10) |
| emmirôlai. : Ce qui est enroulé en spirale. (Voir au mot virai.) - (06) |
| emmirolé, ce qui est roulé en spirale. - (02) |
| emmitôlai (s'), s'envelopper de quelque chose comme d'un manteau. Dans le vieux français, s'affistoller signifie se parer... - (02) |
| emmitôlai : (Pat.), emmitofler ou emmistoufler (dial.), s'envelopper. - (06) |
| emmitoune (verbe) : s'emmitoufler, se couvrir chaudement. - (47) |
| emm'nè : v. t. Emmener. - (53) |
| emmner : emmener - (51) |
| emm'ner : emmener - (57) |
| emmoinge : affaire embrouillée. Drôle d'emmoinge : une drôle d'embrouille. Signifie aussi emmancher : emmoingai un outil : emmancher un outil. - (33) |
| emmoinge : n. f. Affaire embrouillée. - (53) |
| emmoingè : v. t. Emmancher. - (53) |
| emmoinger (v.t.) : emmancher - (50) |
| emmoinze : objet indéfini, chose inutile ou curieuse, affaire obscure - (39) |
| emmoinzer : emmancher - (39) |
| emmoinzer.v. a. Emmancher. (Ménades). - (10) |
| emmôlé : emmêlé - (37) |
| emmôlè : emmêler - (46) |
| emmôler (v.t.) : emmêler - (50) |
| emmôler : Emmêler (voir à démôler). - (19) |
| emmôler : emmêler - (39) |
| emmouégner : emmener - (39) |
| emmougner (v.t.) : emmener - (50) |
| emmouracher (s'). Se prendre d'un grand amour, d'une grande amitié pour quelqu'un. - (49) |
| emmouracher (S'). v. pronom. S’amouracher, s’éprendre follement d’amour. - (10) |
| emmûler. v. - Mettre en meules le foin ou la paille. Ce mot n'a pas été modifié depuis son emploi en ancien français du XIIIe siècle où il signifiait déjà mettre en meules. - (42) |
| emmuler. v. a. Mettre en meule. Emmuler du blé, du foin, de la paille. - (10) |
| em'né : v. t. Emmener. - (53) |
| émné, amener ; j’l'èmeune, je l'amène. - (16) |
| èm'ner. v. - Emmener. - (42) |
| emneu (loc.adv.) : de nuit - (50) |
| emneûyé (-e) (adj., p.p.m. et f.) : p.p. du verbe ennuyer - (50) |
| émorfer (s'), v. r. s'irriter, s'échauffer : ne t'émorfe donc pas tant ! - (24) |
| émortel, adj. immortel. - (08) |
| emorvaillai. Etonné, émerveillé. C'est dommage pour la langue que ce dernier commence à vieillir. - (01) |
| émorvîtes. s. f. pl. Hémorrhoïdes. - (10) |
| emoti. Amortir, amorti, amortis. - (01) |
| émouchailler : v. a., fréq. d'émoucher, chasser les mouches. Voir quol. - (20) |
| émouchè, émochè. Filet placé sur la tête des bœufs au travail pour les garantir des mouches. - (49) |
| emoucher, battre des gerbes liées. - (05) |
| émoucher, battre, corriger, moucher. - (04) |
| émouder, v. a. exciter, mettre en train, mouvoir. - (08) |
| émougner. v. a. Amener. - (10) |
| émouhier, émouguier. v. a. Prononciation défectueuse d’amodier, à Athie et autres lieux. - (10) |
| émouner : amener. Et faire venir : «émoune - te ! » - (62) |
| émourfé (s'), v. r. s'irriter, s'échauffer. - (22) |
| emourlandaire : aiguiseur, rémouleur. - (30) |
| émourler. v. n. Frapper au visage, battre de façon à briser le moure. (Bligny-le-Carreau). — Voyez mourguer. - (10) |
| émoutelle. s. f. Très petit poisson qu’on trouve dans les ruisseaux, sous les pierres, le même sans doute que la mouteule des Noëls Bourguignons de La Monnoye. Du latin mustela. - (10) |
| émouter : v. a., syn. d'écouter. - (20) |
| émoûti, ie. adj. et partic. p. Qui n’est pas cuit. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| émoûtir (r ne se prononce pas). v. a. Amortir. - (10) |
| èmouvé, vt. émouvoir ; pp. emouvé. - (17) |
| empachi : empêcher - (57) |
| empach'ment : empêchement - (57) |
| empaffer. v. a . Empiffrer, enivrer. — S’empaffer. v. pronom. Manger, boire avec excès, s’emplir de mangeaille et de vin. - (10) |
| empagnadzi : mauvaise herbe qui a envahi un champ. A - B - (41) |
| empagnadzi : mauvaise herbe qui a envahi un champ - (34) |
| empailli : empailler - (57) |
| empaillou (n') : empailleur - (57) |
| empaiteûillé (ât’e) : (être) ennuyé - (37) |
| empaitouiller : ennuyer, déranger - (37) |
| empalgotter : mettre un carcan - (43) |
| empan : s. m., giffle, application de la largeur de la main sur la figure. A rapprocher d'arpan. - (20) |
| empanneau : une aile de canard servant de plumeau pour faire le ménage - (46) |
| empâster : Empester. - (19) |
| empatouiller. Couvrir de boue, « de patouille » ; salir en couvrant d'une matière gluante. - (49) |
| empatroilli : empêtrer - (57) |
| empatroïlli : Engluer, empâter. « Alle vint de brâ de la chorlatte, aile a encor les mains totes empatroïllies ». - (19) |
| empatrouiller paraît être le synonyme augmentatif d'empâter. On l'emploie dans le sens de salir. Mai culotte ast empatroillée. - (13) |
| empattée. s. f. Emjambée. (La Celle-Saint-Cyr). - (10) |
| empau, ampau : s. m., mesure de superficie. - (20) |
| empaugener : empoisonner. - (32) |
| empauyena : empoisonner. (S. T IV) - B - (25) |
| empavocher : éclabousser, étaler - (61) |
| empedzi : se dit d'un être mou, pas dégourdi. - (30) |
| empeige : (an:pèj' - subst. f.) 1 - entrave qu'on met aux pieds des chevaux pour les immobiliser. 2 - Au fig. personne maladroite et encombrante. - (45) |
| empeigé, embarrassé (dans la poix), empigé, empêtré. - (04) |
| empeige, empige, s. f. entrave, embarras, obstacle. - (08) |
| empeiger, empiger, v. a. entraver, embarrasser. On « empeige » les animaux pour les empêcher de courir, de quitter l'enceinte où ils sont enfermés. - (08) |
| empeiller (v.t.) : empailler - (50) |
| empeiller, v. a. empailler, garnir de paille. - (08) |
| empeillou (n.m.) : empailleur, taxidermiste - (50) |
| empeillou, ouse, s. m. et f. empailleur, celui ou celle qui empaille les chaises, etc. - (08) |
| empeinte, empeintre : s. f., gouvernail très long et très lourd qu'on adapte aux radeaux et aux chalands. empelotonner : v. a., pelotonner. - (20) |
| empena-yer, v., puer, dégager une odeur infecte. - (40) |
| emperchè : s'empêtrer, on dit aussi s'empiger - (46) |
| empetouger : v. a., embourber (au prop. et au flg.). Voir petouger. - (20) |
| empêtré : embarrassé. - (09) |
| empétsi : empêcher - (43) |
| empêtsi v. Empêcher. - (63) |
| empeuchi : Empocher. « empeuchi du blié (mettre du blé en sac) » on dit aussi ensaichi. - (19) |
| empeûdzi : (adj) empoté, maladroit - (35) |
| empeudzi : mettre de la colle - (43) |
| empeudzi v. (de peudze, poix) Encoller de poix ou de colle, poisser. - (63) |
| empeugi, adj. poisseux (j'ai les doigts empeugis). - (65) |
| empeuté, ée. adj. Embourbé. (Lindry). - (10) |
| empeuter (s'). v.- S'embourber. (Sainte-Colombe-sur-Loing) - (42) |
| empeuter : Calomnier, desservir auprès de quelqu'un. « Si je cougnaichais (s'tu) c'tu là que m'a empeuté je li farais voir de qué beu je me chauffe ». - (19) |
| empeuter. v. n. Enfoncer dans la bourbe, dans les peux. (Voyez ce mot). (Diges). - (10) |
| empggi : entraver - (57) |
| empgi adj. (de piège). Empoté, maladroit. - (63) |
| empgi v. (de piège). Entraver un animal. Voir coubyi. - (63) |
| Empi, Pire : s. m., terre d'Empire, rive gauche de la Saône. Termes de batellerie : aller d'Empi, virer de Pire. Voir riaume. - (20) |
| empiarrer : empierrer - (43) |
| empiârrer : empierrer - (57) |
| empiarrer : Empierrer. « Ma in chemin qu'a bien faute (besoin) d'empiarré ». - (19) |
| empiâtre : personne envahissante, dont la présence gêne. A - B - (41) |
| empiatre : emplâtre - (43) |
| empiatre : personne qui gêne - (34) |
| empiatre : personne qui gêne - (43) |
| empicaisser (v.t.) : ensorceler - (50) |
| empicassai : jeter un mauvais sort (action faite par un « sorcier »). Contraire : dépicassai. - (33) |
| empicasser (v. tr.) : ensorceler (ant. dépicasser) - (64) |
| empicasser : ensorceler - (48) |
| empicasser, v. a. ensorceler, jeter un sort. - (08) |
| empicasser. v. - Ensorceler, jeter un mauvais sort : « Elle a fait empicasser ces souvenirs pour que je ne les perde jamais. » (Colette, Claudine à Paris, p.l80) - (42) |
| empicasser. v. a. Ensorceler, donner des maladies au moyen de sortilèges. - (10) |
| empicasseur : jeteur de sort. - (33) |
| empicasseux. n. m. - Sorcier, celui qui jette un mauvais sort : « Va don' vouère Lucien l'empicasseux, i' va ben t'guéri ' ! » - (42) |
| empicasseux. s. m. Sorcier, qui jette de mauvais sorts. (Sommecaise). - (10) |
| empieiller : employer - (43) |
| empiéilli : employer - (57) |
| empierner, v. a. empêtrer, embarrasser, encombrer : « c'te poure fon-n' ile ô empiernée d'p'tios », cette pauvre femme est embarrassée de petits enfants. - (08) |
| empieudzi : être trempé jusqu'aux os - (43) |
| empieudzi adj. (de empois). Saturé, gorgé d'eau, poisseux. - (63) |
| empige (C.-d., Chal., Br., Y., Morv.), empeige (Morv.).- Entrave, empêchement, obstacle. Empiger, empeiger veulent dire entraver, empêcher, empêtrer, mettre obstacle. Appliqué aux personnes, empige signifie maladroit. Il est, sous ce rapport, à rapprocher des mots emplâtre et empois. Ce vocable vient des mêmes mots empeige, empige, qui ont la même signification en vieux français et dont l'origine est le latin pix, poix. Pège ou pouège est encore usité en Bourgogne dans ce dernier sens. - (15) |
| empigé (être) : encombré par ses vêtements. - (66) |
| empige (n’) : entrave - (57) |
| empigé (s') : v. pr. S'empêtrer. - (53) |
| empige : entrave, personne maladroite - (60) |
| empige : Entrave. Au figuré quand on dit d'une jeune femme remuante et un peu coquette : « (s'tu) C'tu cô ale a troué eune bone empige », cela veut dire qu'elle est enceinte. - (19) |
| empige : entrave. Empiger des animaux avant de les mettre à la pâture pour éviter leur fuite et faciliter la récupération. - (62) |
| empige : s. f.. entrave, et au fîg., personne empêtrée ou empêtrante. Voir pege. - (20) |
| empigé, empegé, empêtré, gauche. Ah ! il est bon à rien, c'est un empegé ! Voir pegeux. - (20) |
| empigé, empêtré - (36) |
| empige, empigé : bon à rien. Maladroit. Pas débrouillard. - (33) |
| empige, empize (n.f.) : entrave - (50) |
| empigé, empize : empoté, empotée - (37) |
| empigé, qui a les pieds gênés par de grandes herbes, des fils de fer, etc... - (28) |
| empige, s. f., entrave mise aux jambes du bétail. Au fig., personneui gêne, qui embarrasse vos mouvements comme vos projets : « Dôte-te donc d'iqui, empige. » — « Ah ! j'ai des empiges plein les jambes ! - (14) |
| empige, s. f., lien en corde et cuir qui entrave les pattes antérieures d'un animal au pré. - (40) |
| empige. Embarras, tout objet qui empêche de marcher. Empiger, mettre des entraves aux pieds de certains animaux. Not' âne ai envie de cori dans le pasquier : an faut l 'empiger. Au figuré, un empige est un homme qui se remue beaucoup pour ne rien faire, qui empêche les ouvriers de travailler. - (13) |
| empige. Entrave que l'on met aux jambes du bétail. Se prend au figuré ; d'une personne qui se jette au travers de vos projets, on dit : C’est une empige. - (03) |
| empige. Lien qu'on met aux jambes de certains animaux ; au figure, entrave, par extension, individu indolent, dont il est difficile de tirer quelque chose. Etym. em prohibitif et piger, verbe du vieux bourguignon demeuré dans le patois qui signifie fouler avec les pieds, et qui d'ailleurs a pied pour racine. Ex. : « piger une cuve.» - (12) |
| empige. n. m. - Gêneur, importun, crampon : « L'gamin, quel empige ! Toujou’ dans mes jambes. » - (42) |
| empigeai : entraver, s'empêtrer dans des branches. On empigo une vèche maline : On entravait une vache maligne. - (33) |
| empiger (s') : s'empêtrer - (61) |
| empiger (s'), s'empêtrer dans un petit obstacle. - (27) |
| empiger (s'), v, pron., s'embarrasser, s'enchevêtrer dans quelque entrave. N'est pas loin d'impedire. - (14) |
| empiger (s'), v. s'empêtrer. - (65) |
| empiger (s'), verbe pronominal : (s')empêtrer, (s')entraver. - (54) |
| empiger (s'). v. - S'empêtrer, se prendre les pieds : « La Lulu a s'est empigée dans l'chat ! Te l'aurais entendue hucher ! Fallait mieux pas rigoler ... » - (42) |
| empiger (s’) : (s’) emmêler les jambes en marchant - (37) |
| empiger (s’), v., se prendre les pieds dans un fil de fer ou des ronces. - (40) |
| empiger : embarrasser. - (66) |
| empiger : empêtrer, entraver - (48) |
| empiger(s') : s'empêtrer - (60) |
| empiger, empeger : v. a., vx fr. empigier, entraver, mettre des empiges à un animal. Au flg., gêner, embarrasser. - (20) |
| empiger, empizer (v.t.) : entraver (de piège) - (50) |
| empiger, v. entraver, gêner. - (38) |
| empiger, v. tr., entraver : « Ol a empigé son ch'vau. » - (14) |
| empiger. v. a. Empêtrer. — S’empiger. v. pronom. S’empêtrer, s’embarrasser les pieds comme si on les avait dans la poix. Tu marches comme un empigé. Du latin pix et du vieux français pège. - (10) |
| empiges, empiger, entraves, entraver. - (05) |
| empiges. s. f. pl. Entraves, obstacles qui retardent, qui arrêtent. (Vincelottes). - (10) |
| empigi : Entraver. « J'ai empigi mon chevau ». - (19) |
| empilaige, s. m. se dit absolument pour exprimer l'action d'empiler les bois de moule sur les ports afin de préparer l'opération du flottage. - (08) |
| empileu, s. m. empileur, celui qui a pour industrie l'empilage du bois. - (08) |
| emp'illi : emplir - (57) |
| empilœur : n. m. Empileur. - (53) |
| empingé, entravé par quelque obstacle. Dans le latin, impingere compedes (Plaute) signifie mettre les fers aux pieds. - (02) |
| empinte, s. f., gouvernail de bateau de canal, formé d'une longue pièce de sapin de 15 à 20 mètres, aminci par le gros bout et placé à l'arrière. - (14) |
| empioter – pioquer : embourber - (57) |
| empioter : enfoncer (dans la boue) - (57) |
| empire : s. m., empirément. Foutre un empire à quelqu'un, lui administrer une raclée. - (20) |
| empistreuîller : ennuyer quelqu'un, « l’embêter » - (37) |
| empizer (s') : empêtrer (s'). - (52) |
| empizer (s') : se prendre dans quelque chose - (39) |
| emplâtre. s. et adj. des deux genres. Souffreteux, dolent, qui se plaint toujours. — Se dit fréquemment, dans la Puysaie, pour citation, cédule, assignation. - (10) |
| empléter, v. a. acheter, faire des acquisitions, des emplettes. - (08) |
| empliâ : Employer. On dit d'un enfant qui paraît grand pour son âge: « Ol a bien empliâ san temps ». - (19) |
| empliâtre : Emplâtre, cataplasme. Au figuré personnage obséquieux et tenace dont il est difficile de se débarrasser : « Quel empliâtre ! ». - (19) |
| empliatte : Emplette au figuré, en parlant de quelqu'un qui épouse une femme dont la réputation laisse à désirer on dit : « En via in que fa eune fameuse empliatte » - (19) |
| emplièchement : Emplacement. « Vla l'emplièchement queva je farai bâti ». - (19) |
| emplieurai - désolé, les larmes aux yeux. - Al â venu, le pore gairson, tot emplieurai. - Quoi que té don ; t'é lai figure tote emplieurée. - (18) |
| emplieuré, éploré. - (02) |
| emplieuré. : Éploré. (Del.) [Latin, in ploralione.] - (06) |
| emp'lli : Emplir. « O n'a pas ésu prou (assez) de vendange pa emp'lli sa cûe (cuve) ». - (19) |
| emploite, s. f. emploi, place, position : « eune bonne emploite », c’est à dire une bonne place. - (08) |
| empni v. (p.ê. de pène). Ankyloser. - (63) |
| empôchè : empêcher - (46) |
| empochè : empocher - (46) |
| empôche, s. f., empêchement, obstacle : « J'irô ben l’voué ; ma son frâre é d'avou lu ; y et eùne empoche. » - (14) |
| empôcher, v, empêcher. - (38) |
| empocher, v. tr., empêcher, faire obstacle. - (14) |
| empôchi : Empêcher « I faut laichi fare ce qu'an ne peut pas empôchi ». - (19) |
| empôchî : empêcher. - (62) |
| empochi : empocher - (57) |
| empogne : Acheter un objet à la foire d'empogne : le voler. - (19) |
| empogne, poignée. - (26) |
| empogner (v.t.) : empoigner - (50) |
| empogner : empoigner, saisir par la poigne - (37) |
| empogner : saisir par la poigne, par la poignée - (37) |
| empògnes, s, f., poignées d'un meuble, secrétaire, commode, etc. Ces poignées sont toujours métalliques, et le plus fréquemment en cuivre - Plusieurs ont de la valeur comme ciselure. On dit aussi l’empògne d'un fer à repasser. - (14) |
| empogni : empoigner - (43) |
| empogni : Empoigner. « Empogni à la braichée », prendre à bras le corps. - « S'empogni», se prendre au collet, se battre « S'empogni de gueule », se disputer, se dire des injures. - (19) |
| empogni v. Empoigner, saisir fermement avec les mains : ôl l'a empogni p'la piau du cul. - (63) |
| empoiché, e, part. passé. Empêché, arrêté par un obstacle. « Empoicé. » - (08) |
| empoichement, s. m. empêchement, obstacle qui détourne ou ralentit. - (08) |
| empoicher, empêcher. - (08) |
| empoicher, empouécer (v.t.) : empêcher - (50) |
| empoicher. v. a. Empêcher. (Athie). - (10) |
| empoigne : s. f.. poignée en étoffe épaisse qui sert à saisir le fer à repasser ou tout autre ustensile chaud. - (20) |
| empôillenai - empoisonner, sentir mauvais ; rempli ou encombré de choses mauvaises. - En dit qu'al à mort empôillenai. - I ne sais pas quoique te sens, ma t'empôilleune. - Ouvre don lai fenéte, ci empôyeune ici. - (18) |
| empoison : s. m., poison ; odeur infecte. Ça sent rien mauvais ici ; t'as donc fait un empoison ! - (20) |
| empoiter. v. - Enduire de poix. (Saint-Martin-des-Champs, selon M. Jossier) - (42) |
| empoiter. v. a. Enduire de poix. (Saint-Martin-sur-Ouanne). - (10) |
| empôlement : Vanne. « Lever l'empôlement » : ouvrir la vanne. - (19) |
| empollement, s. m. empellement, appareil au moyen duquel on arrête, on barre le passage de l'eau. Cet appareil se compose de la vanne ou pelle et de l'échafaudage en bois qui la renferme. - (08) |
| empôrter, v. tr., emporter. - (14) |
| emporter, v., emporter. - (40) |
| empôsener, v. tr. et intr., empoisonner, infecter, sentir fort et mauvais : « Le c'hti drôle ! ôl einpôs'ne le vin. » - (14) |
| empotchè : emporter - (46) |
| empoté, ée. Gêné, contraint, embarrassé dans son langage et ses mouvements. Vient de pot. - (10) |
| empoter, emporter. - (27) |
| empotsi v. Empocher. - (63) |
| empouâché : v. t. Empêcher. - (53) |
| empouâcher : empêcher - (48) |
| empouaison'ment (n’) : empoisonnement - (57) |
| empouaisonner – emboconer : empoisonner - (57) |
| empouaisson'ment (n’) : empoissonnement - (57) |
| empouaissonner : empoissonner - (57) |
| empouchener : mettre des alevins dans un étang - (39) |
| empouchener, v. a. garnir de jeunes élèves, d'alevin, un étang, une pièce d'eau, un colombier, une gelinière, etc. - (08) |
| empouèch'ner : empoissonner - (48) |
| empouèsonner : empoisonner, puer - (48) |
| empouèsser : empêcher, être essoufflé - (39) |
| empouèznè : sentir très mauvais - (46) |
| empouezounner : empoisonner - (39) |
| empougnade (n’) - empugnade (n’) : empoignade - (57) |
| empougnè : empoigner - (46) |
| empougne : petit pain de ménage - (60) |
| empougne : voir épogne - (23) |
| empougner, v. empoigner. - (38) |
| empougner, v. tr., empoigner, saisir vivement. - (14) |
| empougneure, s.f. empoignure. - (38) |
| empouillener (v.t.) : empoisonner, infecter - (50) |
| empouillener : puer, empoisonner (odeur) - (48) |
| empouillener, v. a. empoisonner, infecter. - (08) |
| empouillot, s. m. poulie en général et en particulier la poulie à l'aide de laquelle on monte les gerbes dans les greniers. (Voir pouïer.) - (08) |
| empour : prép., vx fr., en échange. Il m'a donné mes étrennes ; je l'ai embrassé empour. - (20) |
| empour, adv., en échange de. S'emploie sans régime : « Alle avôt deux casses. J'li en d'mandis eùne, é pis j'li beillis eùne tarine empour. » - (14) |
| empourter, v. a. emporter. - (08) |
| empourter, v. emporter. - (38) |
| empousenai, infecter. Les Bourguignons disent encore : Il empoisonne, au lieu de il sent mauvais. - (02) |
| empousenai. : Infecter. On dit au village : Un tel empoisonne ; et l'on dit d'un ivrogne : Il empoisonne le vin. - (06) |
| empoy'né, empoyeuné : 1 v. t. Empester. - 2 v. t. Empoisonner. - (53) |
| emprayadze : prairie nouvelle - (43) |
| empräyer : (vb) mettre (une terre) en pré - (35) |
| empra-yer : mettre une terre en pré - (43) |
| emprendre : Allumer. « Apporte dan du beu so (du bois sec) pa emprendre le fû (le feu) ». - (19) |
| emprendre, allumer le feu, la lampe. - (05) |
| emprendre. Allumer, comme qui dirait entreprendre le feu, vieux mot. - (03) |
| emprer : vx fr. emprendre, allumer. Empre donc la lampe. - Part, passé, empri. La lampe est emprie. - (20) |
| emprés , après. - (04) |
| emprés-demaing (n.m.) : après-demain - (50) |
| empressé, part. passé. Oppressé par suite de difficulté de respiration. - (08) |
| empresser, v. a. mettre en forme, dresser en comprimant. On « empresse » un instrument, un outil, un objet auquel on veut donner une forme déterminée. - (08) |
| emprijonner : Emprisonner. « O s’est fait emprijonner ». - (19) |
| emprinter : Emprunter « O charche parto à emprinter ». Etre emprinté : être timide. « T'as dan bin l'ar emprinté ». - (19) |
| emprinter, v. a. emprunter. - (08) |
| emprôté (ât’e) : (être) sans initiative, « pas dégourdi » - (37) |
| emprôté : maladroit. Gêné, emprunté. - (62) |
| emprôter : emprunter - (37) |
| emprôter, v. tr., emprunter, ustensiles et argent. - (14) |
| empter. v. a. Emporter. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| empugne (n’) : empoigne - (57) |
| empugni : empoigner - (57) |
| empyâtre n. m. (du lat. emplastrum, anc.fr. emplastre, onguent) 1. Personne qui gêne, qui empêche d'agir. 2. Cataplasme. - (63) |
| empyâtrer v. Encombrer, mettre dans une situation délicate. - (63) |
| empyécement n.m. Emplacement. - (63) |
| ém'rale : matricaire camomille - (48) |
| emrours (A l') : Ioc. adv., à l'envers. - (20) |
| emser. v. n. Rester sur ses œufs, couver, en parlant d’une poule. (Montillot). - (10) |
| émuser, v. tr., amuser, cajoler. - (14) |
| émusôte, s. f., amusette, objet de distraction. - (14) |
| emusôte. Amusette, amusettes… - (01) |
| émusou, s. m., amuseur, musard, flâneur, cajoleur : « Eh ! p'tiote, Jacot n'é ran qu'eùn émusou. » - (14) |
| en - pronom indéfini : On et Il. A peu près comme an. - En veinré nos chercher quand en fauré. - En fait bein cliair âjedeu. - (18) |
| en (pronom impersonnel) : on…ou «nous» (pronom personne). En avot (on avait), en étot (on était)… « en » est une altération de on, qui lui vient de homme, homo en latin. Voir « Je » qui se substitue à nous. - (62) |
| en : un (èn artuzon) - (51) |
| en ? hein ? s'emploie pour faire répéter une chose qu'on n'a pas entendue ; il est familier ; par politesse on dit : piai-t’i ? pour : vous plaît-il de répéter. - (16) |
| en baver : avoir des difficultés - (44) |
| en chian de temps. exp. - De temps en temps, sans se presser. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| en croire, ou encroire. Mauvaise prononciation pour accroire. Mais de plus il y a le substantif encroire, tiré du verbe, qui signifie mensonge, attrape, chose que l’on fait accroire. Ex. : « II est simple comme un enfant, on lui fait avaler toutes les encroires. » - (12) |
| en disse : (loc adv) par ici, près (« vins en disse » : approche-toi) - (35) |
| en d'lai et and'lai, loc. adv. et prép., au delà : « En d’lai l'iâ, » de l'autre côté de l'eau. On dit aussi : « Liâv'en-d'lai. » là-bas au delà, loin au delà. - (14) |
| en d'lé : Voir d'lé. - (19) |
| èn don ? n'est-ce pas vrai ? - (16) |
| en panse de vaiche : en désordre - (48) |
| en pieûsse : en plus - (37) |
| en pô : En retour, en échange. « Donne me ta reutie (rôtie) je te donnerai quèque chose en pô ». - (19) |
| en point d'endre : nulle part - (43) |
| en pou : en contrepartie - (46) |
| en pour (adverbe) : en contrepartie. - (47) |
| en pour : (loc adv) en échange - (35) |
| en pour : en échange. - (52) |
| en pour, en d'pour. loc. adv. - En échange de : « Renée a am'né des c'ries pou' midi, en pour va don' lui pourter un mouciau d'gâtiau ! » Le poyaudin a conservé la très ancienne préposition du XIe siècle empor / empour signifiant « pour » uniquement dans le sens de en échange, à la place de. - (42) |
| en poûrre : en échange - (37) |
| en rogne : énervé - (44) |
| en sauver (s'). v. - Se sauver, s'en aller. - (42) |
| en yiau : les anglois (village proche de st léger-de-fougeret, sur la route de château-chinon) - (37) |
| en : art. masc. Au. - (53) |
| en : prép., dans, à. Une maison exposée en matin, en soir. J' vas me baigner en Saône. En remplace a comme préfixe dans certains mots comme engraver (aggraver), envoisiner (avoisiner), etc. - (20) |
| en, prép. a, dans, à l'intérieur de... - (08) |
| en, prép., à la, aux : « Battre en grange. » — « Aller en champs. » - (14) |
| en, pronom on. - (38) |
| en-â : n. m. et expr. En aval. - (53) |
| énainché, éreinté, harassé ; du mot ainche, qui signifie hanche. On dit fort bien en français déhanché pour exprimer qu'on a les hanches disloquées. - (02) |
| énainché. : Éreinté, harassé. Ce mot répond au français déhanché, exprimant qu'on a les hanches (ainches en patois) disloquées. - (06) |
| énardoir. : (Dial.), avoir de l'ardeur à s'enflammer pour. - (06) |
| enbalé ; s'enbalé, s'emporter, se précipiter. - (16) |
| enbale, sm. être encombrant, propre à rien. - (17) |
| enbarâ ; fâr sëz enbarâ, faire l'important ; enbarâ se dit des personnes comme des choses. - (16) |
| enbaraissé, vt. embarrasser. - (17) |
| en-bas, en-haut : s. m., rez-de-chaussée et étage. Le boulanger a l'en-bas, et pis nous, nous avons l'en-haut. - (20) |
| en'bassiée : creux, dénivellement de terrain. - (33) |
| enbauconné, v. n. répandre une odeur persistante et désagréable. - (22) |
| enbauconner v. n. répandre une odeur persistante et désagréable (du vieux parler lyonnais). - (24) |
| enbeurné, adj. placé dans un lieu sombre, comme le fond d'une «beurne ». On dit aussi encabeurné. - (22) |
| enbeurteller : mettre les brides de cuir sur les sabots de bois - (51) |
| en'beurtillotte : brindille. - (33) |
| en'biellai : en automne faire des rigoles pour assainir. - (33) |
| enbôché ; s'enbôché, s'engager pour un travail temporaire. - (16) |
| enbœrné, adj. placé dans un lieu sombre, comme le fond d'une « beurne ». On dit aussi encabeurné. - (24) |
| enbœrné, v. a. encombrer. - (22) |
| enbœrner, v. a. encombrer. - (24) |
| enbringuer (s'), v. r. s'embarrasser, s'encombrer de quelqu'un peu intéressant : ne nous embringue pas de cet homme. - (24) |
| enbruyé, vt. lancer. Prendre son élan ; se jeter impétueusement contre qq. chose. - (17) |
| enç’aûver (s’) : déguerpir rapidement, sortir de la casserole pour le lait qui bout - (37) |
| enç’eûte : ensuite - (37) |
| encabouiner, encacouiner : v. a., engluer, enduire d'un corps gluant. Fais donc attention oû-c - que t’ marches ; t’ vas toute t'encabouiner. - (20) |
| encachonner. v. a. Mettre le foin en petits tas, en cachons dans les prés. - (10) |
| encafougni : emmitoufler - (57) |
| encairner : puer - (48) |
| encairner : sentir mauvais - (37) |
| encaissi : encaisser - (57) |
| encaissou (n’) : encaisseur - (57) |
| encalfeùtrer, v. tr., envelopper avec précaution : « I fait donc bén si frèd, qu'vous v'là tôt encalfeùtré ? » - (14) |
| encan (n. m.) : amoncellement d'objets - (64) |
| encan : vente aux enchères. Dans certain cas : de peu de valeur. Ex : "Ta charrue, al' est boune à mett' à l'encan". - (58) |
| encanailla : encanailler - (57) |
| encanailler : encombrer, embarrasser - (61) |
| encancher (v. tr.) : remplir à l'excès, surcharger, saturer - (64) |
| encancher. v. a. Entremêler, enserrer les uns dans les autres des objets plus ou moins lourds, plus ou moins volumineux, de telle sorte qu’on ne peut plus les déplacer facilement. Voyez décancher. - (10) |
| encaniller (S’). v. pronom. S’encanailler. De canis , chien. - (10) |
| encapuchonner (S’). v. pronom. Se couvrir, s’envelopper la tète, la figure d’un capuchon. - (10) |
| encarné, encarnagé, vn. empester. - (17) |
| encarner, encarnager. v. a. et v. n. Sentir la carne, la charogne ; puer, infecter. - (10) |
| encarner, verbe intransitif : empester, répandre une mauvaise odeur. - (54) |
| encarner. v. - Puer, sentir la décomposition de la chair, la carne, la charogne. - (42) |
| encassonner : mettre en tas - (43) |
| encassonner, encatsonner v. (de casson) Mettre en petits tas (le fumier). - (63) |
| encatiner (s') (v. pr.) : s'emmitoufler - (64) |
| encatiner (s'). v. - S'emmitoufler, s'entortiller comme avec une catin, un pansement. - (42) |
| encatiner (S’). v. pronom. S’envelopper comme une catin, s’entortiller dans ses vêtements, s’emmitoufler pour se préserver du froid. (Sommecaise). - (10) |
| encauraizer (v.t.) : encourager - (50) |
| enceintrer : Terme de chasse : cerner. « Pa prendre in greu gibier le maillo (meilleur) moyen est de l'enceintrer ». - (19) |
| encelé, ée. adj. Qui est à l’abri, caché, à couvert. Du latin encelatus. - (10) |
| encelé. adj. - Abrité, couvert : « On s'est encelé tous les troués sous l'grous chêne. » - (42) |
| enchaiche : Echasse « Pa aller su des enchaiches i faut en avoi l'habitude». - (19) |
| enchaîn-né : enchaîner - (57) |
| enchain-ner, v. tr., enchaîner, attacher solidement. - (14) |
| enchairbotai – emmêler, embarrasser. – Ceute échevette de fi â joliment enchairbotée ! – T'é gros enchairbottai c'te peliotte de laingne qui ; aidie-moi don ai lai devudai. - Son procès é l'air d'éte bein encherboté. - (18) |
| enchairger, v. a. charger quelqu'un de quelque chose, donner à charge : « i l'é enchairgé d' vô pairler. » - (08) |
| enchâner, v. a. enchainer, mettre à la chaîne ou en forme de chaîne. - (08) |
| enchapeler : v. a., vx fr., couvrir d'un chapeau ; revêtir la jante d'une roue de son bandage. - (20) |
| enchapeler, v. battre la faux. - (65) |
| enchapeler. Marteler une faulx, une meule de moulin. - (03) |
| enchapier : v. redresser le fil de la faux. - (21) |
| enchâplè : rebattre la faux - (46) |
| enchaple : s. f., petite enclume de faucheur. - (20) |
| enchaplé : v. t. Battre la lame d'une faux. - (53) |
| enchapler : battre la faux. Reformer le fil de la lame de la faux, entre marteau et enclumette. - (62) |
| enchapler : v. a., vx fr. chapler, frapper ; battre la faux sur l’enchaple. - (20) |
| enchàpler, v. tr., frapper sur la lame d'une faux, pour l'amincir et la faire couper ; la rabattre. - (14) |
| enchapler, v., battre un fer de faux ou de faucille sur le chaplou (cf. ce mot). - (40) |
| enchaplier : Battre la faux sur l'enchap'lle. « T'enchap'lle dan bin langtemps ? autant saint-Liaude ! ». - (19) |
| enchap'lle : Action d'enchaplier. Petite enclume étroite sur laquelle les faucheurs battent le tranchant de la faux pour l'amincir. Marteau d'enchap'lle, le marteau dont on se sert pour enchaplier. - (19) |
| enchapllié, v. a. battre une faulx au marteau. - (22) |
| enchappe : mal de gorge. - (32) |
| enchappes, encharpes. n. f.pl. - Glandes situées au niveau du cou. - (42) |
| enchappes. s. f. pl. Glandes au cou, abcès, tumeurs scrofuleuses. (Sommecaise). - (10) |
| enchappler, piquer, marteler une meule, faulx, faucilles. - (05) |
| enchapye : s. f. petite enclume sur laquelle on martèle le fil de la faux. - (21) |
| encharbeuté, encharboté, vt. emmêler. - (17) |
| encharbôtai, embarrassé... - (02) |
| encharbôtai. : Embarrassé et comme si l'on disait pris ou mis sous un char. (Bôtre signifie mettre.) - (06) |
| encharboter, v. ; emmêler ; ton fil, al ost tot encharboté. - (07) |
| encharbouillai (s'). (Voir aux mots charbouillé et encharbôtai.) - (02) |
| encharbouter. Emmêler. - (03) |
| encharbouton : fil embrouillé. (CH. T III) - S&L - (25) |
| encharboutter - entortilla : emmêler - (57) |
| encharmougé, ie, adj. enrhumé, enchiffréné. - (17) |
| encharmouture : rhume de cerveau. (A. T II) - D - (25) |
| encharpes. s. f. pl. Ecrouelles.(Villiers-Saint-Benoît). — Voyez enchappes et enquervelles. - (10) |
| enchartrure. s. f. Envie, caprice de femme enceinte. (Nailly). - (10) |
| enchatre (enchâtre) : s. f., vx fr. enchastre, syn. de bâche, bachut. - (20) |
| enchatre : se dit d'un enfant noué. (CLB. T II) - C - (25) |
| enchâtre, s. chambre de grenier ? - (38) |
| enchâtres, loges d'écurie. - (05) |
| enchavir, v., en finir. - (40) |
| enche adj. Enflé. La transformation du "fl" en "ch" se retrouve dans d'autres mots tels que gonche. - (63) |
| enchécher (pour ensécher, ensacher). v. a. Mettre en sac. Du latin saccare. - (10) |
| enchècher : tasser. (T. TIV) - Y - (25) |
| enchemoïllé, vt. Ensommeiller ; endormir. - (17) |
| enchemoiller (s’) : (s’en:choemouèyé: - v. pronominal) s'assoupir. - (45) |
| enchenillé, chien accouplé et pris. - (05) |
| enchèpllier, v. a. battre une faulx au marteau. - (24) |
| encherance, enchérissement. - (05) |
| encherboiller. v. a. Embarbouiller. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| encheuge, adj. très caressant, affectueux à l'excès. - (22) |
| enchevêtrue. n. f. - Chevêtre. - (42) |
| enchi v. Enfler. - (63) |
| enchiaisser, v. a. ensacher, remplir un sac ou quelque chose de semblable en pressant ou en secouant ce qu'il renferme. - (08) |
| enchiesner : (enchyèsnè - v. trans.) mettre en sac, tout en imprimant au sac de petites secousses afin d'en tasser le contenu. - (45) |
| enchieûre n.f. Enflure. - (63) |
| enchifóner, v. tr., enchifrener : « J'ai pris l’rheûme ; j'sis tôte enchifónée. » - (14) |
| enchifrené, qui éprouve un embarras dans l'acte de la respiration par suite d'un rhume. Dans l'idiome breton, siferni signifie s'enrhumer. (Le Gon.) - (02) |
| enchifronné (être) : malade, pas en forme. - (56) |
| enchin. Essaim, par corruption. - (03) |
| enchlle, adj. enflé. - (24) |
| enchllier, v. n. enfler. - (24) |
| enchllieume, s. f. enclume. - (22) |
| enchllieume, s. f. enclume. - (24) |
| enchlliou, enflure. - (24) |
| enchnet (n. m.) : gouttière - (64) |
| enchòsse, s. f. échasse. - (22) |
| enchotte, s.f. petit entonnoir. - (38) |
| enchotter (v. tr.) : enrober les semences de chaux et de sulfate de cuivre - (64) |
| enchu, loc. adv. en sus, en haut, au-dessus de... - (08) |
| enchuchement, denrée que le fermier sortant devait, selon la coutume, laisser à son successeur pour lui permettre de faire face aux premiers besoins de son exploitation. - (27) |
| enchus (adv.) : en-dessus - (50) |
| ençhye : (adj. verbal) enflé(e) - (35) |
| ençhyi : (vb) enfler - (35) |
| enciauler, v. a. chauler, mettre dans la chaux ; « enciauler las biés. » - (08) |
| encin, ainsi. - (26) |
| enclavè (sabot) : sans bride (sabot) - (48) |
| encleume : l'enclume (du forgeron) - (46) |
| encleûme, s. f., enclume. - (14) |
| enclouer, enclorre un fonds. - (05) |
| enclume : s. f. petite enclume. - (21) |
| encô : (adv) encore - (35) |
| enco : encore - (43) |
| enco : encore - (51) |
| encô adv. Encore. Ôl 't encô bié mlède. Il est encore bien malade. - (63) |
| enco ou encor : Encore. « Les raijins ne sant pas enco meus », les raisins ne sont pas encore mûrs « Queva ce que te va encor ? », où vas tu encore ? - Exclamation : « Encota ! » (Encore toi !). - (19) |
| enco, adv. encore. - (38) |
| enco, adv. encore. A la fin d'une phrase : encor. - (17) |
| encôche, s. f., encoche, coche. Entaille faite sur la taille du boulanger, et à la flèche pour y introduire la corde de l'arc. - (14) |
| encochi : encocher - (57) |
| encœurni, adj. entré jusqu'au cœur (d'un arbre) ; creusé jusqu'au cœur (d'un fruit). - (38) |
| encognoure, s. f. 1. trace laissée par le contact mutuel des pains dans le four. - 2. Encognure, coin. - (24) |
| encoi, encoire, adv. ; encore. - (07) |
| encoi, encoué, adv. de temps. Encore. « Enco. » - (08) |
| encoiche, s. f. coche, entaille dans un morceau de bois. - (08) |
| encontre, adv., en face, au-devant, à côté : « Tôt d'ein côp, j'lai vu c'ment c'qui encontre moi. J'li f'sô ran, é pi ô m'a fait mau. » - (14) |
| encontre, prép. contre, malgré : « ai rencontre », à l'opposé, en opposition; « i n'vé pâ ai rencontre de ç'lai », je ne m'oppose pas à cela, je ne conteste pas cela. - (08) |
| encoradzi : encourager - (51) |
| encorbassé, part, passé d'un verbe encorbasser qui n'est pas usité à l'infinitif. On dit d'un cheval, d'un bœuf, d'un animal quelconque attaché à l'écurie, qu'il est « encorbassé » lorsqu'il se prend dans sa longe, dans sa chaîne, en un mot dans le lien qui le retient. - (08) |
| encorbasser : attacher une patte d'une vache avec les cornes pour la traire pour qu'elle ne donne pas de coups de pieds - (39) |
| encorbouachai, encourbachai : entraver un animal. - (33) |
| encordeûilli v. Atteler, attacher avec des cordes. - (63) |
| encordeûyi : (vb) atteler - (35) |
| encorde-yi un barreu : action d'attacher la caisse et le timon d'un tombereau - (43) |
| encorégi : Encourager. « Porte voir eune botaille de vin à tes ovrés, y est le maillo moyen de les encorégi ». - (19) |
| encornailler. v. a. Donner des coups de cornes. - (10) |
| encorpier, entraver. - (28) |
| encôté, adv. de lieu. À côté de s'asseoir « encôté » de quelqu'un ; ma maison est « encôté» de la sienne. - (08) |
| encotse : encoche - (43) |
| encotse n.f. Encoche. - (63) |
| encou, engoué, engouére. adv. Encore. (Druyes, Domecy-sur-le-Vault). - (10) |
| encouder. v. a. En viticulture, action de relever, en provignant, l’extrémité de la branche qu’on vient de coucher en terre, de manière à ce qu’elle forme un coude. (Perrigny-lès-Auxerre). - (10) |
| encoué (adv.) : encore - (50) |
| encoué : encore. - (09) |
| encouère : encore - (48) |
| encouère : encore - (39) |
| encoûère, encouai : encore. T'es encoûère ben dru pour ton âge : tu es encore bien lests pour ton âge. - (33) |
| encoulue. n. f. - Encolure. - (42) |
| encoulue. s. f. Encolure. - (10) |
| encourage – encourègi : encourager - (57) |
| encourageant : adj. Encourageant à travailler, courageux au travail. Au fig., attrayant, désirable. Une femme encourageante. - (20) |
| encourbaisser. v. - Attacher la patte avant d'un animal à son cou, pour l'empêcher de courir. (Champignelle, selon M. Jossier) - (42) |
| encourbaisser. v. a. Attacher la patte d’un animal à sa tète pour l’empêcher de courir. (Champignelles). - (10) |
| encouti, adj. se dit des cheveux lorsqu'ils sont emmêlés. - (22) |
| encouti, adj. se dit des cheveux lorsqu'ils sont emmêlés. - (24) |
| encouti, habitant des bois , sauvage , homme inculte et grossier... - (02) |
| encouti. : Embrouillé. On appelle coutisse, en Franche-Comté, la laine emmêlée de la queue des moutons (du latin cauda). [L'abbé Dartois.] - (06) |
| encoutié : à côté - (61) |
| encrâre : Promesse illusoire. « Alle li a fait totes sôrtes d'encrâres », « Fare encrâre », faire croire des choses fausses. - (19) |
| encrâre v. Croire. Faire encrâre. - (63) |
| encre : adj., excessif, exagéré, fort, suprême. - (20) |
| encre, adj. courageux au travail, attaché à la besogne. Verbe encràyer (s'). - (24) |
| encre, adj. courageux au travail, attaché à la besogne. Verbe : encràyé (s'). - (22) |
| encrécher (v.t.) : rentrer le bétail pendant la période d' hiver - (50) |
| encrement : adv., vx fr., extrêmement, brusquement, violemment. - (20) |
| encrené, adj. qui a pénétré, qui est indélébile : une tache bien encrenée. - (24) |
| encrené, adj. qui a pénétré, qui est indélébile. - (22) |
| encreni, adjectif qualificatif : très sale, encrassé. - (54) |
| encreni, creni : encrassé. - (32) |
| encreté : s. f., augmentation, excès, exagération, suprême degré, forcé, violence. A rapprocher du lat. incrementum. - (20) |
| encreté, s. f. acreté. - (22) |
| encreté, s. f. acreté. - (24) |
| encreûtè : mettre en terre, enterrer - (46) |
| encreuter : Enfouir dans la terre. « San chin a cravé, ol l'a encreuté dans san jardin ». - (19) |
| encrô, s. m. sillon, raie dans laquelle cesse l'enroi d'une charrue. - (08) |
| encroire - mensonge, dit ordinairement pour rire, en forme d'amusement. - Ne l'écoutez pâ, ailé, c'â des encroire qu'a vos dit. – I voi bein, vais, te vourâ me fâre encroire des béties. - (18) |
| encroire (faire) : tromper en mentant, faire croire par un mensonge. - (62) |
| encroire (faire), loc, faire accroire, conter un mensonge : « Ah ! t'voudrô bon m’y fare encroire... ! » (V. le mot précédent.) - (14) |
| encroire, encrouére, v. a. croire, accroire, faire « encroire » quelque chose : tu ne me feras pas « encroire » cela. - (08) |
| encroire, s. m., chose fausse que l'on veut faire accroire : « Y n'é pas ein encroire ; y é, pardine, bé vrâ ! » - (14) |
| encrore, encroire, sm. craque, mente. Faire des encroires, mystifier, illusionner. - (17) |
| encröté, vt. enfouir. - (17) |
| encroter : enterrer un animal. A - B - (41) |
| encroter (v.t.) : cacher dans un trou, enterrer (de l'a.fr., crotte = creux) - (50) |
| encrôter : (vb) enterrer (un animal mort) - (35) |
| encrôter : Encroûter. « I ne vaut ren de s'encrôter dans la routine ». - (19) |
| encrôter : enterrer (un animal) - (43) |
| encroter : (en:crotè - v. trans.) enterrer. - (45) |
| encroter, v. ; mettre un animal crevé dans un trou. - (07) |
| encroter, v. a. enfouir dans la terre, dans un « crôt »). - (24) |
| encroter, v. a. enterrer, mettre dans un creux, un trou : « mai vaiche ô périe, i m'en va l'encroter. » - (08) |
| encroter, v. tr., enfouir, mettre clans un trou, enterrer : « J'I'ai encroté ; voui, j'li ai métu l'nazo dans l'crôt. » - (14) |
| encroter. Enfouir ; se dit pour enterrer. - (03) |
| encrottai : enterrer dans une ornière, embourber. On encrotte un animal crevé : On enterre un animal crevé. - (33) |
| encrotté : v. t. Embourber. - (53) |
| encrotter (v. tr.) : enterrer - (64) |
| encrotter : enfouir - (57) |
| encrotter : enterrer - (44) |
| encrotter : enterrer (un animal mort) - (57) |
| encrotter : enterrer un animal. - (52) |
| encrotter : enterrer, enfouir - (37) |
| encrotter : enterrer, enfouir - (48) |
| encrotter v. (du v.fr. crot, creux, trou) Enfouir, ensevelir, - (63) |
| encrotter : enterrer - (39) |
| encrotter, v. enfouir un animal crevé. - (65) |
| encrotter. v. - Enfouir, enterrer. - (42) |
| encrouée. s. f. Chose qu’on vous a fait accroire et qui est fausse. (Lucy-sur-Cure). - (10) |
| encrouère : croyance, quelque chose que l'on fait croire, mensonge - (48) |
| encrouï, v. a. mettre en croix, croiser, accrocher. - (08) |
| encrouté, v. a. enfouir dans la terre, dans un « crout ». - (22) |
| encuchonner : v. a., mettre en cuchon. - (20) |
| encueurmi : Imprégné de crasse, de saleté. « Aile a biau ésu laver sa sarviette, les taiches étint si bin encueurmies qu'alle n’a pas pouyu les fare en aller ». - (19) |
| encuni, encrassé dès longtemps. - (05) |
| encuvir. : (Dial.), convoiter, désirer (du latin cupere). - (06) |
| end' çai, loc. adv. et prép., en deçà. - (14) |
| end’jeuler : engeuler - (57) |
| endai. Andain. - (49) |
| endailler : v. a., ramasser à la fourche les épis pour les mettre en gerbe. - (20) |
| endardé, ie, adj. enduit de saletés. - (17) |
| endauille (n.f.) : endouille - (50) |
| endauvai (et fâre) - ennuyer, déranger, contrarier. Dans un autre sens, ardent, obstiné. - Chaisse voué ces enfants qui, a nos faisant endauvai. - Mon pore homme, a n'â pâ méchant, ma qu'a me fait don endauvai des co ! - On dit aussi endiabai. - (18) |
| endauver : enrager (de colère), pester. Faire endauver : faire enrager. - (52) |
| endayer : mettre les foins en rouleaux - (43) |
| en-d'dans : au-dedans - (57) |
| endeçai (loc.) : en deçà - (50) |
| endeçai, loc. adv. en deçà. - (22) |
| en-deçai, loc. adv. en deçà. - (24) |
| endeçai, prép. en deçà. Dans l'usage, « endeçai » signifie près, proche, par opposition avec « endelai » qui signifie loin : « al ô endeçai », il est près ; « al ô endelai », il est loin. (Voir : çai.) - (08) |
| endeiver, v. intr., endiabler, être contrarié : « L'marmôt ? O nous fâ prou endeiver. » - (14) |
| endelai (loc.) : là-bas, au-delà - (50) |
| en-delai, loc. adv. en delà. - (24) |
| endelai, prép. là-bas, au loin, au-delà. - (08) |
| endémenai pour endémoné. : C'est-à-dire endiablé. (Del.) - (06) |
| endemeurer. v. - Embourber, enliser. - (42) |
| endemeurer. v. n. Se dit ordinairement d’un charretier, dont la voiture embourbée ou entravée par un cas de force majeure ne peut plus avancer. (Puysaie). - (10) |
| endémoné, endiablé... - (02) |
| endémouné et endém'né. adj., espiègle, entêté, évaporé. - (14) |
| endeuran, ante, part, passé du verbe « endeurer. » celui qui souffre sans colère, sans emportement les défauts de son prochain. - (08) |
| endeurci, e, adj. engourdi, endormi, apathique. - (08) |
| endeuré, v. a. porter avec satisfaction. Se dit des vêtements par temps froid. - (22) |
| endeurer (v.t.) : endurer - (50) |
| endeurer : endurer - (57) |
| endeurer : endurer - (48) |
| endeurer : souffrir de la faim, endurer - (43) |
| endeurer : supporter, patienter. « Ôl’o brâment mau’endeurant » : il ne supporte rien particulièrement ! - (62) |
| endeurer v. Supporter stoïquement, endurer. - (63) |
| endeurer : endurer, supporter - (39) |
| endeurer, v. a. endurer, supporter, souffrir, pâtir : « ç'ô eune mauvaille fon-n', a n' veu pâ endeurer son père », c’est à dire le supporter, souffrir son contact. « Deure don ! », prends patience ! - (08) |
| endeurer, v. a. porter avec satisfaction. se dit des vêtements par temps froid : j'endeure deux tricots. - (24) |
| endeùrer, v. tr., endurer, supporter, mais dans le sens agréable : « I fait eùn frèd d'loù ; Jean-nète, j'endeùr’ro ben eùn brin d'feù. » - (14) |
| endeurmi. Endormir. - (49) |
| endèvé et andaivai. : (Dial. et pat.), pester, être hors de soi. - Faire endêver quelqu'un, c'est le contredire, le taquiner outre mesure. - (06) |
| endêvé, ée. adj. Qui est endiablé, qui ressemble à Eve après sa tentation par le serpent. - (10) |
| endêvé, vt. fare endêvé, faire enrager. - (17) |
| endever (faire). v. - Faire enrager, asticoter. Autre sens, tourmenter : « Des maladi ' qu'chacun epporte pou' fai'e endever les pour' vieux. » (Fernand Clas, p. 72). Desver ou derver s'employa au Xe siècle pour « devenir fou » ; au XIIe siècle, on dit endesver pour enrager. Le poyaudin a retenu la même signification que l'ancien français. On trouve parfois endever aujourd'hui en français dans un emploi familier. - (42) |
| endêver , en pur patois endôver et endauyer. Ton petiot garçon fait endôver teut le monde : mets-lu cucher teut de suite. Dans quelques pays dêver signifie être fou. Voici une étymologie un peu hasardée mais très séduisante. Les Morvandeaux disent envaudoyer : n'est-ce pas une altération du vieux mot envaudoiser, qui avait le sens d'ensorceler. Les Vaudois étaient, comme on le sait, des sorciers et des hérétiques... - (13) |
| endêver : ennuyer quelqu'un. - (09) |
| endêver : enrager - (60) |
| endéver : enrager, endiabler. - (32) |
| endéver : taquiner, « faire enrager » - (37) |
| endèver, endôver. v. a. Obséder, tourmenter, comme fit notre mère Eve lorsqu’elle obséda Adam pour lui faire manger du fruit défendu. — Faire endèver quelqu’un, le tourmenter. — Endèver. v. n. Être ennuyé, impatienté, surexcité ; avoir de la rage, du dépit. - (10) |
| endever, v. enrager (faire endever quelqu'un). - (65) |
| endever, v., berner méchamment, se moquer. - (40) |
| endêver. (C-d., Br., Chal., Y.), endôver (C-d., Morv., Y.). - Être endiablé, enragé, hors de soi… On dit aussi faire endêver, pour faire enrager, tourmenter quelqu'un. Le verbe peut d'autre part, être pris activement : endêver sa vie, se dit pour enrager sa vie, mener une vie d’enragé, d'endiablé. - (15) |
| èndiféran, avec une négation ; son vin n'â pâ èndiféran, son vin n'est pas mauvais. On dit aussi d'un enfant qui n'est pas sensible au bien qu'on lui fait : el â bèn èndiféran. - (16) |
| endimanchi - r'lingi - r'chingi : endimancher - (57) |
| endmantsi v. Endimancher. - (63) |
| endô, s. m. ados, terre relevée par la charrue dans un sillon, petit talus sur le sol. - (08) |
| endoche, endosse, sm. homme mou [andouille]. - (17) |
| endoîlai, endouallai : enduire de matières gluantes ou malodorantes .Quand on o engaudré on o endoilé : quand on est sale on est enduit de matières gluantes. - (33) |
| endôlement, s. m. action de doler les toitures, c’est à dire de les couvrir de planches minces sur lesquelles on pose la tuile. (Voir : doulement.) - (08) |
| endoler, v. a. a le sens de planchéier une toiture pour la préserver de la pluie et de la neige. (Voir : douter.) - (08) |
| endöre, vt. enduire. - (17) |
| endoussi : endosser - (57) |
| endôvai: provoquer des ennuis. Faire endovai : faire enrager. Enrager de colère, pester. - (33) |
| endôvé, s. m. endévé, enragé, endiablé. - (08) |
| endover (v.) : (vx. fr. endêver) mettre en colère, faire enrager - (50) |
| endôver : ennuyer quelqu'un. - (09) |
| endôver, v. n. et a. endêver, être hors de sens, enrager. Être endové après une personne, c'est l'aimer ou la haïr à l'excès, jusqu'à la rage. - (08) |
| endra : Endroit, lieu. Pays : « Ol a ésu vite fait cougnaichance ave les gens de l'endra ». Site : « La seurce de la Doue est in brave endra ». « En què que endra » quelque part. - (19) |
| endrait (n.m.) : endroit - (50) |
| endrait (n’) : endroit - (57) |
| endre : quelque part - (43) |
| endrei, s. m. endroit, lieu, place, pays. - (08) |
| endreimi, part., endormi, engourdi, paresseux. - (14) |
| endremi - ensuqué : endormi - (57) |
| endremi (v.t.) : endormir - (50) |
| endremi : endormir - (48) |
| endremi : Endormir. « Ol est endremi. Tos les sas o s'endeut au carre du fû », tous les soirs il s'endort au coin du feu. - (19) |
| endremou (n’) : endormeur - (57) |
| endret (nom masculin) : endroit. Peut désigner un lieu. - (47) |
| endret : contraire d'envers : Mets tè ch'mise è l'endret : mets ta chemise à l'endroit. - (52) |
| endret : endroit - (51) |
| endret : endroit - (39) |
| endrét, s. m., endroit, beau côté d'une étoffe : « Ol ôt béte ; ô n'sait pas tant s'ment mét'e sa veste à l’endrét. » - (14) |
| endrét, s. m., endroit, lieu : « J’l’ai choupé, épeù j'li ai montré l'boun endrét. » - (14) |
| endreu : endroit (contraire d'envers) - (43) |
| endreumi (-e) (p.p.) p.p. du verbe endormir - (50) |
| endreûmi (s'), v., s'endormir. - (40) |
| endreumi : endormir - (39) |
| endreumi, v. a. endormir : « eun endreumi », un individu d'humeur somnolente, un paresseux. - (08) |
| endreumi, vt. endormir. - (17) |
| endreût : (adv) endroit, face exposée au sud - (35) |
| endrot n.m. Endroit, lieu. - (63) |
| endroué : endroit - (44) |
| endrouet : endroit - (48) |
| endrouîllé, endreuîllé : enduit de produit gluant - (37) |
| endrouler (v.t.) : enrouler, rouler autour - (50) |
| endrouler, v. a. enrouler, rouler autour. Le corsage de cette femme était « endroulé » de rubans ; il a « endroulé « un linge autour de sa tête. - (08) |
| endrûlé : v. i. Devenir droit, fort. - (53) |
| endrûler(s') : se chauffer au soleil - (39) |
| endruser : mettre de l'engrais. - (30) |
| en-d'sos : au-dessous - (57) |
| en-d'sos : en dessous - (57) |
| endurci : endurcir - (57) |
| endurer (S') : v. réfl., se supporter. S'endurer avec quelqu'un, supporter Ies défauts de ce quelqu'un. Que voulez-vous ? i faut ben s'endurer ensemble quand on est marié. - (20) |
| en-d'vant : au-devant - (57) |
| endvée (qqn) : envers (qqn) - (48) |
| endzin : engin - (51) |
| ene : une - (51) |
| ène : une. ène fone : une femme. - (52) |
| éne. Une, unes. - (01) |
| en-empour, adv., en échange, en troc. - (40) |
| énépouïaible, adj. inépuisable : « c'te Mère de Dieu, aine énépouïable aibime d'dons saicrés. » - (08) |
| énercé : exciter. (SY. T II) - B - (25) |
| énerrher. v. n. Pour énarrher, donner des arrhes. - (10) |
| en'essoulotai : se mettre au soleil, prendre un bain de soulai (soleil). - (33) |
| en'etouïé, vt. nettoyer. - (17) |
| éneuré, ée. adj. Ennuyé. - (10) |
| éneuté, adj. privé de sommeil, qui a de l'insomnie et littéralement qui est sans nuit. (Voir : neu.) - (08) |
| éneutille (adj.) : inutile - (50) |
| éneutille, adj. inutile : « ç'ô éneutille d' fére ç'lai. » - (08) |
| enfâ (n’) : enfer - (57) |
| enfâ, s.m. enfer. - (38) |
| enfagoté, ée. adj. - Mal habillé, débraillé. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| enfaîté. adj. - Rempli à ras bord en parlant d'un fût. (Sougères-En-Puisaye) - (42) |
| enfaîtures. s. f. pl. Ce qui dépasse les bords, le faîte de la mesure. — Au sing., signifie comble. Vout’ cherrette est chargée par trop haut, ail’ a troup d’enfaîture. - (10) |
| enfancenon. : (Dial.), éfanti (pat.), diminutif d'enfant. - (06) |
| enfanci : Enfoncer. « La bige est âgre, enfance ta casquette su tes orailles », le vent du nord est piquant, enfonce ta casquette sur tes oreilles. - (19) |
| enfantiau, adj., enfantin, qui se livre à des enfantillages, qui dit ou l'ait des bêtises. - (14) |
| enfar : enfer - (48) |
| enfar : enfer - (39) |
| enfár, s. f., enfer, milieu intolérable. - (14) |
| enfar, s. m. enfer. - (08) |
| enfarant : adj., enflammé, cuisant, irrité (au sens morbide). - (20) |
| enfaré n.m. (du gr. pharos, le phare). Furoncle. - (63) |
| enfarer : Enferrer, commencer un labour. - (19) |
| enfarer v. Enfler, infecter. - (63) |
| enfarfouiller, v. a. embrouiller, troubler. - (08) |
| enfarrer : enferrer - (57) |
| enfé : Enfer. « Fare un fû d'enfé », faire un grand feu. - (19) |
| enfectâcion, infection, chose qui sent mauvais. - (16) |
| enfermer, v. engager un domestique dans une ferme. - (65) |
| enferrer (v. int.) : entamer la terre avec la charrue - (64) |
| enferteiz. : Infirmité. (S. B.) - (06) |
| enfeüi. : (Dial.), être en feu, est une expression qu'on trouve dans saint Bernard et qui n'a point d'analogue dans la langue française. (Voir au mot déambler.) - (06) |
| enfeumer : enfumer - (48) |
| enfeumer : enfumer - (39) |
| enfeurdzi : entravé, empêtré. A - B - (41) |
| enfeurdzi (s’) : (vb) trébucher - (35) |
| enfeurdzi : (adj) gauche, maladroit - (35) |
| enfeurdzi : emmêler - (51) |
| enfeurdzi : entrave - (34) |
| enfeurdzi v. (v. fr. enfergier, enchaîner). Entraver, enfarger, s'empêtrer dans quelque chose. S'enfeurdzi su eune merde de pole. Loc. Se voir arrêté par peu de chose. Le verbe enfarger est encore bien vivant au Québec. - (63) |
| enfeurnaler, v., abonder (à propos d'une grosse récolte). - (40) |
| enfeûter : Enfûter, envaisseler. « Vendre san vin enfeûté », le vendre à fût perdu. - (19) |
| enfiauleux. n. m. - Enjôleur. (Arquian) - (42) |
| enfié (ât’e) : (être) ivre - (37) |
| enfié (ât’e) : (être) trompé, « roulé » en affaires - (37) |
| enfiè : enflé - (48) |
| enfié : enflé, grossi - (37) |
| enfier (s’) : (s’) ennivrer - (37) |
| enfier : enfler, grossir - (37) |
| enfier c’mment ain bot (s’) : (s’) enfler, se faire gonfler l’estomac comme un crapaud en mangeant et en buvant trop - (37) |
| enfier, vt. enfler. - (17) |
| enfieure : enflure - (48) |
| enfigoûri : mélange - (37) |
| enfilée. s. f. Suite, file, enfilade. Une enfilée de maisons. - (10) |
| enfiler v. Emprunter un chemin. - (63) |
| enfiller, vt. enfiler. - (17) |
| enfing (adv.) : enfin - (50) |
| enfing’, adv. enfin. - (08) |
| enflammaition : inflammation - (37) |
| enflammation (n’) : inflammation - (57) |
| enfle : adj., enflé. La vache est enfle ; j’ compte qu'elle aura trop mangé de trèfle vert. - (20) |
| enfle, adj. enflé (j'ai la cheville enfle). - (65) |
| enfle, adj., enflé : « I m’seù tapé davou mon martiau ; j'ai l'dèt tôt enfle. » - (14) |
| enfle, adj., enflé. - (40) |
| enflé. adj. - Ivre : « Guade don' la Vovonne alle est encore enflée ! » (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| enfler : enfiler, mettre - (51) |
| enfler : partir en direction de - (51) |
| enfleture, enflure, inflammation. - (05) |
| enfleure : enflure - (39) |
| enfleure, s. f. enflure, gonflement, bouffissure qui survient dans quelque partie du corps. - (08) |
| enflier : Enfler. « Ol a la joe (joue) enfliée ; sa main est enf'lle ». - (19) |
| enflieure : Enflure. « J'ai ésu bien mau es dents ; mâ i me casse in ptiet bout moins depeu qu 'y a de l'enflieure », j'ai eu bien mal aux dents mais cela me fait un peu moins mal depuis qu'il y a de l'enflure. - (19) |
| enfmöré, vt. enfumer. - (17) |
| enfoiré : se dit d'une personne outrecuidante. - (30) |
| enfoirer, placer son bétail sur le champ de foire ; a donné naissance au verbe DÉFOIRER, emmener le bétail du champ de foire. S'emploie ainsi on commence à enfoirer, on commence à défoirer. - (11) |
| enfonci : enfoncé - (43) |
| enfonci : enfoncer - (57) |
| enfonde (v. tr.) : mouiller abondamment - (64) |
| enfondre (s'). v. - Se faire mouiller jusqu'aux os. - (42) |
| enfondre : mouiller, tremper - (60) |
| enfondre. (S’). v. pronom. Se laisser mouiller par la pluie de manière à être transpercé. (Diges). - (10) |
| enfondrer : eventrer - (60) |
| enfondrer, v. tr., effondrer, enfoncer, défoncer : « Ol a enfondré la pôrte. » — « V'tu ben n'pas monter d'ssus ; t'vas enfondrer l'touneau. » - (14) |
| enfondrer. Enfoncer. - (03) |
| enfondu (adj.) : trempé (syn. éjé, tripé) - (64) |
| enfondu : très mouillé. - (09) |
| enfondu : complètement mouillé. Ex : "L'temps qu'j'alle à l'écurie, j'atais complètement enfondu !" Voir synonyme : Mou-tripé. - (58) |
| enfondu, ée. part. prés. et s. f. Trempé, mouillé jusqu’à la peau. (Diges). — Se dit aussi pour inondé. Des terres enfondues. - (10) |
| enfondu. adj. - Trempé, mouillé jusqu'aux os. Emprunt direct de l'ancien français du XIIe siècle, où fondre (du latin fundere) signifiait verser, répandre un liquide. - (42) |
| enforchener. v. a. Enfourcher. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| enforchi : enfourcher - (57) |
| enforgé (adj.) : engoncé - (64) |
| enforner : enfourner - (57) |
| enforner : enfourner - (48) |
| enforner : Enfourner. « Le fo (four) n'est pas treu chaud, depôche te d'enforner ». - (19) |
| enforner v. Enfourner. - (63) |
| enforner : enfourner - (39) |
| enforner, v. a. enfourner, mettre au four : « enforner » le pain : - (08) |
| enforner, v. enfourner. - (38) |
| enfôrner, v. tr., enfourner, mettre au four pain, pâtisserie et viande ; mais surtout pour le pain. - (14) |
| enfortsi v. Enfourcher. - (63) |
| enfourager. v. - Approvisionner une ferme ou une métairie en fourrage. - (42) |
| enfourné, étourdi à force de tourner sur soi-même. - (27) |
| enfourrager. v. a. Approvisionner de fourrages une ferme, une métairie. (Villiers-Saint-Benoit). - (10) |
| enfourure. n. f. - Ration de fourrage pour la journée ; synonyme d'affourée. (Sainte-Colombe-sur-Loing) - (42) |
| enframer, enfromer, enfroumer. v. a. Enfermer. - (10) |
| enfredzi, embordzi : emmêlé - (43) |
| enfremer : enfermer - (43) |
| enfremer : enfermer - (57) |
| enfremer : Enfermer. « Dépeu que san homme est meu alle s'enfreme dans sa maijan a peu aile ne veut voir neguin », depuis que son mari est mort elle s'enferme chez elle et ne veut voir personne. - (19) |
| enfromer (v. tr.) : engermer (s'enformer comme un mangeux d'poules (s'enfermer chez soi pour ne pas être importuné, pour être à l'abri des regards indiscrets)) - (64) |
| enfromer (v.t.) : enfermer - (50) |
| enfromer : enfermer - (48) |
| enfromer : enfermer - (39) |
| enfromer, v. a. enfermer. - (08) |
| enfroumer, enfromer. v. - Enfermer. - (42) |
| enfumaiger, v. a. fumer, répandre du fumier, de l'engrais. (Voir : fumaiger, pouteurer.) - (08) |
| enfuter (enfûter) : v. a., vx fr., enfutailler. - (20) |
| enfyé, enfler. - (16) |
| engaboiré : v. t. Barbouiller plus fort. - (53) |
| engaboré, enduit de matières gluantes ; par ex. un enfant enduit de confitures. - (28) |
| engaborer (s'), v., se salir, se couvrir de taches. - (40) |
| engabourer (s’), v. pron., se salir en mangeant, aussi bien qu'en marchant : « Tôt côp qu'ô sôpe cheù son fiyeû, ô s'engaboure c'ment eùn goret. » — « Pou s'en r'veni, ô s'a engabouré ; i f’sôt si ch'ti temps ! » - (14) |
| engadai, se bien garder de. - (02) |
| engadai. : Se bien garder de. (Del.) - (06) |
| engadroïlli v. Eclabousser, maculer de boue. - (63) |
| engadrouyi, v. a. embarbouiller malproprement. - (22) |
| engadròyi, v. a. embarbouiller malproprement. - (24) |
| engadzi : engagé - (43) |
| engager : v. a., border (un lit). - (20) |
| engagi - embringuer : engager - (57) |
| engaigé, vt. engager. - (17) |
| engaigi : Engager. « Je t'engaige pas à fare ce marchi. O s'est engaigi pa devanci l'appel ». - (19) |
| engaine : n. f. Aine. - (53) |
| engaine, aine (de inguen). - (05) |
| engaine, s. f., pli de l'aine. - (40) |
| engaingner (S’). Se mettre dans une gaine. Lai souris s'eugangnit vitement dans son trou. - (13) |
| engain-ner : engainer - (57) |
| engalouèchè : sale, couvert de boue - (48) |
| engambé, enjamber. - (16) |
| engamber. v. a. Enjamber. - (10) |
| engamer (v. tr.) : envelopper, enserrer - (64) |
| engâmer. v. - Engranger des provisions, avec excès. « Il est en train d'tout engamer i' va pus ren nous rester ! » (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| engarcer : Enjôler. « N'acoute pas les garçans, i ne charchant qu'à vos engarcer ». - (19) |
| engarder, v. a. garder de... garer de... « Engardez-vous-en », pour garez-vous-en. - (08) |
| engarouêché (être) : sali au visage par de la sauce ou de l'assaisonnement (voir : galouécher). - (56) |
| engaûder, s'embroder : enduire, embarrasser. (EDSEA. T II) - A - (25) |
| engaudrai: salir, enduire de saleté. - (33) |
| engaudre (n.f.) : femme indolente, gauche - (50) |
| engaudré : enduit. (MM. T IV) - A - (25) |
| engaudre : toile à nettoyer le four, personne malpropre - (60) |
| engaudre : voir gaudre - (23) |
| engaudre, angaudre. s. f. Femme paresseuse, maladroite et malpropre. - (10) |
| engaudre, engaude. n. f. - Empotée, maladroite, paresseuse « Vous on ne vous demande pas ça. Prenez vos valises, vos collets, ne soyez pas les éternelles engaudres. » (Colette, Claudine à l'école, p 130) - (42) |
| engaudre, s. f. femme indolente, gauche, sans capacité, ce qu'on appelle familièrement en français un emplâtre. (Voir : empeige.) - (08) |
| engaudrer (v.t.) : salir avec une matière gluante - (50) |
| engaudrer : barbouiller, enduire - (39) |
| engaudrer, v. a. salir avec une matière épaisse et gluante : un vase a engaudré » de résine. - (08) |
| engaudrouner : barbouiller, enduire - (39) |
| engaupé : gêné dans ses vêtements, engoncé - (60) |
| engaupe, bonne à rien - (36) |
| engé, se dit d'un enfant couvert de vermine, d'un champ couvert de mauvaises herbes (un champ engé de chadons). - (27) |
| engeance, s. f., mauvaise qualité (péjoratif). - (40) |
| engeluré, adj., qui a des engelures. - (14) |
| engencé. adj. Difficile à denouer. Se dit d’un nœud qui est fait, agencé de telle sorte qu'on ne peut plus le défaire. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| engencerie, chose compliquée. - (26) |
| engenrer, v. a. engendrer, produire. la malpropreté « engenre » la vermine. «Enzenrer, inzindrer. » - (08) |
| engenréure. : (Dial. ), production (rac. lat. generare). - (06) |
| enger, communiquer par contagion une maladie. - (05) |
| enger, v. tr., féconder, introduire, communiquer, ensemencer. La rougeole enge, est contagieuse. Employé pronominalement et dans un sens particulier par le paysan, qui dit : « J'voudrein ben nous enger de c'te grain-ne, » c'est-à-dire nous voudrions bien en ensemencer notre champ. — Fournir de l'espèce, de la race : « J'vous engerai d'mes pois, d'mes poules. » A donné engeance. - (14) |
| enger. Faire pulluler, vieux mot. - (03) |
| engheurnaige, s. m. action de présenter par poignées à la machine à battre les gerbes entassées sur la « teiche. ». (Voir : teiche.) - (08) |
| engheurner, v. a. engrener, présenter le grain avec la paille à la machine. - (08) |
| engheurnou, s. m. engreneur, celui qui engrène. - (08) |
| enghuéter (s'), v. réfl. s'embourber, s'enfondrer dans un lieu marécageux. (Voir : gheuti, ghuéte, gutte.) - (08) |
| engi : Communiquer une maladie contagieuse. « Ol li a engi la rogeôle ». - Procurer, « T'as dan plianté des ârli (pommes de terre early rose) ? oué, i est neut 'maître que m'en a engi. ». - (19) |
| engier, v. peupler. - (38) |
| engier, v., se munir d'un instrument. - (40) |
| engigonnai, croiser ses jambes... - (02) |
| engin : Treuil pour arracher la vigne. - (19) |
| engin, s. m. treuil pour arracher les ceps de vigne. - (22) |
| engin, s. m. treuil pour arracher les ceps de vigne. - (24) |
| engiôler. v. a. Enjôler. - (10) |
| engiôleux. s. m. Enjôleur. — Fait, au féminin, engiôleuse. - (10) |
| engivaler, mettre en javelles, en gerbes. - (05) |
| engivaler. Mettre en javelles. Nous disons engearber pour mettre en gerbes, en vieux français garbe pour gerbe ; faire à Dieu garbe de foarre. Une fille « mal engearbée », c'est une fille mal faite , expression qui a une saveur toute rustique. - (03) |
| engiveler, v. tr. , enjaveler, rassembler les diverses poignées d'herbes coupées à la faux ou à la faucille, pour en former une gerbe. - (14) |
| engliôpi. : Envelopper. - (06) |
| engnui, enneu. s . m. Ennui, tort, dommage. I m’a fait ben des engnuis, ben des enneus. - (10) |
| engochou n.m. (du v.fr. engouer, obstruer le gosier) Accapareur. - (63) |
| engôdrer : enduire (de saleté) - (48) |
| engogaudè : mal habillé - (34) |
| engognaudé : mal habillé - (43) |
| engogniauder v. (de la racine gogg ou gobb, enflé). Engoncer, habiller de plusieurs épaisseurs de vêtements. - (63) |
| engogôdé : mal habillé. A - B - (41) |
| engoicher (s'), v. réfl. s'étouffer, s'étrangler en mangeant, en buvant, en avalant trop avidement. - (08) |
| engoncé, ée. adj. Se dit de celui qui semble avoir le cou enfoncé dans les épaules, soit parce qu’il l’a trop court, soit parce que ses vêtements lui montent trop haut. - (10) |
| engoncé, enveloppé jusqu'au nez dans son vêtement... - (02) |
| engonçer : serrer. - (66) |
| engonché : emmitouflé - (44) |
| engonchi v. Engoncer. - (63) |
| engondner (prononcez engonner). v. a. Poser une porte, une fenêtre, un volet sur ses gonds. (Merry-la-Vallée). - (10) |
| engôper adj. (de engober). Jointoyer, enduire. - (63) |
| engôrer : Emmitoufler. « I ne vaut ren de treu s'engôrer ». - (19) |
| engorger (s'). v.- S'étrangler. - (42) |
| engorgère : voir gorgère. - (20) |
| engorgi : Engorger. « Le melin est engorgi ». - (19) |
| engorzer, v. a. engorger, embourber. - (08) |
| engossou (ze) : (nm.f) personne âpre au gain - (35) |
| engoucher (s') : s'étouffer en mangeant. - (56) |
| engouer (s') : (vb) s'étrangler - (35) |
| engoufrement : adv., goulûment, en goinfre (vx fr. gaufre). - (20) |
| engougou : entonnoir à large goulot pour entonner le sang dans les boyaux pour la fabrication du boudin. - (30) |
| engouigneu : empêtrer. - (29) |
| engouillé, adj., empêtré dans la gouille (cf. ce mot). - (40) |
| engouiller (v.) : saturer,créer un encombrement - (50) |
| engouiller : v. a., engoncer. Etre engouillé, être embarrassé par ses vêlements. Voir agouiller et dégouiller (Se). A rapprocher aussi de gourrer (Se). - (20) |
| engoûilli v. Envelopper, emballer, emmailloter (du vieux français engoler signifiant garnir d'une gole ou collerette ; n'oublions pas que la cagoule des moines, sans manches, enveloppait tout le corps). - (63) |
| engouler, avaler, ingurgiter. (Engoulevent.) - (05) |
| engouler, v. tr., avaler voracement, ingurgiter. - (14) |
| engounner, engonner. v. - Replacer une porte, un volet, une fenêtre sur ses gonds. - (42) |
| engourdi, vt. engourdir. - (17) |
| engouré, v. a. engoncer dans des habits épais. - (22) |
| engourmi. adj. - Engourdi. - (42) |
| engourmi. adj. Engourdi. (Etais). - (10) |
| engourner. v. - Placer, enfoncer un objet dans un orifice quelconque. - (42) |
| engoûter, v. a. encourager, donner du goût pour... - (08) |
| engouyi (s’) : envelopper (s’) ; être engoncé - (43) |
| engouyi : (vb) envelopper - (35) |
| engouyi : enveloppé - (43) |
| engouyi, adj. être engoncé dans des habits épais. - (24) |
| engo'yé : v. t. Embouer. - (53) |
| engraicher (v.t.) : engraisser - (50) |
| engraicher : engraisser - (48) |
| engraicher : engraisser - (39) |
| engraicher, v. a. engraisser. (Voir : graiche.) - (08) |
| engraichi : Engraisser. « To les ans ol engraiche in ban cochan ». « Qu'est-ce que te no fa boire itié ? du vin troub'lle ! Bois dan seulement, te sais bin qu'an ne les engraiche pas (sous-entendu les cochons) ave de l'iau fine ! ». Ciel qui se couvre de nuages; « le temps s'engraiche, i va pliu ». - (19) |
| engrain. s. m. Menus grains, criblures, ce que les meuniers appellent petit blé. — Variété d’orge. - (10) |
| engraingi : engranger - (57) |
| engraire, encrer, encrouer. v. a. Accroire. — Faire encrer, faire accroire. Faudrait pas essayer de nous fai encraire ça. - (10) |
| engraissi : engraisser - (43) |
| engraissi : engraisser - (57) |
| engran, s. m. grain restant à l'intérieur de la batteuse après chaque battage. - (24) |
| engrandzi : engranger - (51) |
| engravé. adj. Se dit d’un animal qui a dans le pied un gravier qui l’empêche de marcher. — Se dit aussi, par extension, de tout animal qui, par excès de fatigue, ne peut plus marcher. Dans ce dernier cas, Engravé viendrait du latin ingravatus. - (10) |
| engraver : v. a., aggraver. - (20) |
| engredon. n. m. - Édredon. (Arquian) - (42) |
| engregni, v. n. avoir le cœur gros depuis longtemps : ses malheurs l'ont engregni. - (24) |
| engregni, v. n. avoir le cœur gros depuis longtemps. - (22) |
| engreigner (grandior), augmenter, empirer, engrigner, le mal s'engrigne. - (04) |
| engreintssi : monter par-dessus - (51) |
| engrelé. Houx, que nous appelons ainsi à cause de la dentelure de ses feuilles, du mot engrêlé, dentelé, qui ne s'emploie plus que dans le blason. - (03) |
| engrelet. V. augrelet. - (05) |
| engrenè : amorcer une pompe à eau - (46) |
| engrenou (n') : engreneur - (57) |
| engrenou : celui qui enfournait les javelles dans la batteuse - (43) |
| engresse et engres. : (Dial.), impétuosité et impétueux. Incre en patois. - (06) |
| engreumé, adj. se dit de celui qui a mangé du raisin avec excès. - (08) |
| engreumé, celui qui souffre d'avoir mangé trop de raisins. - (16) |
| engreunaige : n. m. Engrenage. - (53) |
| engreuné quelqu'un : lui donner des graines ou des plants de légumes qu'il n'a pas encore. - (16) |
| engreuvé : peiné. (S. T III) - D - (25) |
| engrevé, très ennuyé, contrarié. Se dit aussi d'un enfant dont les larmes ne cessent de couler à cause d'une douleur physique ou après une correction. - (27) |
| engrignant. s. m. Médicament. (Sénonais). - (10) |
| engrigné, engrni : adj., vx fr, engroigné, renfrogné, de mauvaise humeur. - (20) |
| engrigner (S’). v. pron. S’entêter. - (10) |
| engrinché : monter difficilement - (44) |
| engriner, empirer, augmenter - (36) |
| engringi : Envahir, infester en parlant des mauvaises herbes « (s'te) C'te tarre est engringie de nugerenche (chien-dent) ». - (19) |
| engrintsi : personne juchée sur un arbre, un bâtiment. A - B - (41) |
| engrintsi (s') Grimper. Se percher. - (63) |
| engrintsi : (p.passé) perché - (35) |
| engrintsi : percher (être) - (43) |
| engrintsi : personne montée sur un arbre, un bâtiment - (34) |
| engroinger : engranger - (48) |
| engrumer (s'). Etre engrumé. Forme défectueuse d'engrumeler ; mais engrumer a un sens… je voudrais dire propre…, autre qu'engrumelé, et n'est guère usité que pour exprimer l'état dans lequel se trouve une personne qui à trop mange de raisin. - (12) |
| enguernauder : emmêler - (51) |
| enguerner : avaler, mettre dans la gueule de la batteuse - (39) |
| engüetter (s') : se prendre dans la boue - (39) |
| Engueule (Mère) : nom d'un croquemitaine femelle qui passe pour habiter les puits, les rivières et en général les endroits dangereux. On en menace les enfants qui s'exposent et ceux qui sont désobéissants. Attention ! ne t'approche pas ; la Mère Engueule ! — Si t'es pas sage, j’ vas t’ faire prendre par la Mère Engueule ! - (20) |
| engueule (Mère-), personnage mythique qui attire les enfants au fond des puits. - (40) |
| engueulé, crier de fortes injures à quelqu'un. - (16) |
| engueûler : (vb) dévorer, avaler - (35) |
| engueulue. n. f. - Bord d'un récipient, d'un sac, etc. (Sougères-En-Puisaye) - (42) |
| engueurdi : Engourdi. « J'ai les mains engueurdies d'avoi ésu fra ». - (19) |
| engueurgni adj. (du francique grinian, faire la moue). Malgracieux, somnolent. - (63) |
| engueurmé (-e) (adj.m. et f.) : qui a trop mangé de raisins - (50) |
| engueurnai : introduire la céréale dans la batteuse. - (33) |
| engueurné : v. t. Engrener. - (53) |
| engueurner : engrener - (57) |
| engueurner : engréner (dans la batteuse), introduire dans la bouche - (48) |
| engueurner : Mettre du grain dans la trémie du moulin. Au figuré, mettre en train, amorcer. - (19) |
| engueûrneû : engreneur. celui accompagnant la machine à battre, qui est spécialisé pour « enfourner » les épis des céréales à battre dans les cylindres de la batteuse. - (37) |
| engueurneur : celui qui introduit la céréale dans la batteuse. Les battoirs evin un engueurneur : les battoirs avaient un engueurneur. - (33) |
| engueurneux n.m. Egrenoir. Homme charger d'alimenter l'égrenoir. - (63) |
| engueurni (la maillette) v. Engrener, c'est-à-dire faire passer le plus régulièrement possible la javelle dans la batteuse. - (63) |
| engueurni v. 1.Egrener, mettre dans l'égrenoir. 2. Amorcer une pompe. - (63) |
| engueurnœur : n. m. Personne qui introduit la céréale dans le battoir. - (53) |
| engueurnou : Celui qui met du grain dans la trémie, ou des céréales dans la batteuse. - (19) |
| engueurnoû : engreneur - (48) |
| engueûser, v. tr., tromper, amorcer, enjôler comme une gueuse : « Ah ! p'tiote coquine, te l’engueûses joliment ! » - (14) |
| enguiché, ée. adj. - Bloqué, englué par la graisse ou le cambouis ; généralement utilisé en parlant d'une roue. - (42) |
| enguiché, ée. adj. Se dit d’une roue qui ne peut plus tourner, parce qu’elle est encrassée par le camhouis. (Diges, Villiers-Saint-Benoit). - (10) |
| enguiller, élever, mettre au-dessus - (36) |
| engunmi (s'), vr. [s'engourmer]. s'engorger : se dit des mamelles des vaches. - (17) |
| enguœllmeinchi, v. a. embrouiller d'une manière étrange : je ne sais comment c'est enguœllmeinchi. - (22) |
| enguœllmenchi, v. a. embrouiller d'une manière étrange : je ne sais comment c’est enguœllmenchi. - (24) |
| enharber : enherber - (57) |
| enharder, v. a. exciter, provoquer à une lutte, à un combat. On « enharde » des personnes prêtes à en venir aux mains, des animaux, chiens, chats, taureaux, etc. qui sont aux prises. - (08) |
| enhau, s. m. grenier à foin. On prononce en-au : il a mis dix milliers de foin sur « l'enhau. » - (08) |
| enhausse : réhausse (en particulier sur petite planche que l'on rajoute sur les côtés des tombereaux pour en augmenter la capacité - (51) |
| en-haut (n.m.) : fenil (prononcé en naû) (pour de Cambure : enhau) - (50) |
| en-haut : voir en-bas. - (20) |
| enherdir (se). : (Dial.), se hérisser. Le substantif latin hirtus est la racine de ce mot : « Si enhardissent li poil de ma char. » (Job.) - (06) |
| enheuillé (s'), s'assoupir, avoir les yeux pris par le sommeil. - (02) |
| enheuillé. : Qui est assoupi (Del.) et en donne les marques par l'abaisement des paupières. - (06) |
| enheurser : énerver,exciter - (48) |
| enhiautement. s. m. Action d’élever, de mettre plus haut. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| enhiauter. v. a. Mettre plus haut, élever. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| enicher. v. n. Ânonner, ânicher. Se dit d’un écolier qui récite mal, qui ne sait sa leçon qu’à demi. (Béru). - (10) |
| enincer, v. agacer. - (38) |
| éninché, adj. déhanché ; qui a les jambes disloquées. (Voir : inche.) - (08) |
| enjarber, v. a. engerber, entasser les gerbes, les mettre les unes sur les autres. (Voir : jarbe, jarber.) - (08) |
| enjàrber, v. tr., engerber, entasser gerbes sur gerbes. - (14) |
| enjarjillé, ie, adj. plein de farjillöt (vesce sauvage). - (17) |
| enjarmener, v. a. répandre le germe, ensemencer une mauvaise chose. - (24) |
| enjartmené, v. a. répandre le germe, ensemencer une mauvaise chose. - (22) |
| enjaudreuiller, v. a. mettre en train, amuser, dissiper. - (08) |
| enjavaler : mettre en javelles. Puis en gerbes, et au figuré : ramasser un tas de choses pour les mettre en paquets. - (62) |
| enjaveloux : Féminin : enjavelouse. Celui, celle qui « enjevale ». « In ban layou peut suvre quat'enjevalous », un bon lieur peut suivre quatre enjaveleurs, autrement dit il faut quatre fois moins de temps pour lier la gerbe que pour la préparer. - (19) |
| enjevaler : Enjaveler, ramasser des javelles et les entasser sur le lien pour former la gerbe. « Dépôchins no d'enjevaler ». - (19) |
| enjevaler : v. n., enjaveler, mettre en jevalle s; faire un paquet de plusieurs jevalles de sarments, ordinairement une douzaine. - (20) |
| enjiôlou, sm. enjôleur. - (17) |
| enjôlai. : Caresser quelqu'un pour le tromper. - (06) |
| enjoler. Je donne place a ce verbe familier, mais français, pour avoir l'occasion d'indiquer son origine probable. En Bourgogne, il signifiait donner des joyaux : Guigone de Salins, fondatrice de l'Hôtel Dieu de Beaune, fit présent, dans l’année 1446, d'une magnifique croix d’or ornée de pierreries, pour enjoyaler et parer l’austel et chapelle dudict Hostel-Dieu. - (13) |
| enjôleu, adj., qui enjôle : « N'ty fie pas, ma pauv' petiote ; ton Cadet et ein enjôleu. » - (14) |
| enkernir. Racornir ; devenir coriace. Fig. Recouvert d'un dépôt dur de crasse. - (49) |
| enkieume : enclume - (48) |
| enkios, enquios.s. m. Enclos. (Pasilly). - (10) |
| enl’ver : enlever - (57) |
| enlaie. s. f. Epidémie. (St-Florentin). - (10) |
| enlareigner, v. a. entasser dans les « lareignes » ou espaces vides qui se trouvent le long des murailles, sous les toits. On « enlareigne » les fourrages, les pailles, etc. - (08) |
| enleuve (y s’) : (vb) le ciel s’éclaircit - (35) |
| enleuvé : v. t. Enlever. - (53) |
| enlevé élevé. - (04) |
| enlever, v. a. élever. Au part, passé « enlevé », qui a de l'élévation, de la hauteur. - (08) |
| enloiemenz. : (Dial.), entrelacement (rac. lat., intus ligamentum.) - (06) |
| enloupe, s. f. enveloppe. - (08) |
| enlouper (pour envelopper). v. a. Se dit par contraction d’envelopper. - (10) |
| enlouper (v. tr.) : envelopper (qu'j'ons don du mal, pi rin pour l'enlouper) - (64) |
| enlouper : envelopper - (61) |
| enlouper, v. a. envelopper. On prononce en plusieurs lieux « ailouper » ou « élouper. » - (08) |
| enlouper. v. - Envelopper. - (42) |
| enloupiau (contraction et altérat. d’enveloppeau). s. m. Linge qui enveloppe une plaie. Voyez anloupiaux. - (10) |
| enloupiau, enlopiau. n. m. - Bande de toile servant à envelopper une plaie, une brûlure. - (42) |
| enloupiot (n. m.) : vêtement, pansement - (64) |
| enlouppé : enveloppé - (37) |
| enloure (S’). v. pronom. Se communiquer. — Ça s’enloue, se dit d’une maladie contagieuse qui se communique, qui se gagne. (Soucy). - (10) |
| enmanches, s. f. plur. embarras, complications, affaires embrouillées. - (08) |
| enmanigancer, v. a. arranger d'une manière confuse, entortiller une affaire. - (08) |
| enmanjoner, v. a. emmancher, mettre un « manje ». - (24) |
| enmanjouné, v. a. emmancher, mettre un «manje ». - (22) |
| ènmankable, ce qui no peut pas ne pas arriver. - (16) |
| enmantsi : emmancher - (43) |
| enmaté, v. a. mettre en meule, ou «mate ». - (22) |
| enmater, v. a. mettre en meule, ou « mate ». - (24) |
| ènmé, aimer ; s'ènmê, se plaire: é n’s'èinme pâ an ville, il ne se plaît pas à la ville. - (16) |
| enmégi : Préparer le feu : « Va dan enmégi le fû peu te l'emprendras », va donc préparer le feu puis tu l'allumeras. - (19) |
| enmiôler, v. tr., caresser, flatter, câliner. - (14) |
| enmistoufler, v. tr., emmitoufler, envelopper. - (14) |
| en'mner : emmener - (48) |
| en'mner en champ : emmener au pré - (48) |
| enm'ni et env'ni, v intr., aller, venir, se rendre à quelque part. S'env'ni, s'en venir. - (14) |
| enmoinger, v. a. emmancher, mettre un manche à un outil, à un instrument quelconque. (Voir : moinge.) - (08) |
| enmölé, vt. emmêler. - (17) |
| en'môlège : emmêlage - (48) |
| en'môler : emmêler - (48) |
| enmortai - enfoncer dans la boue. - Les chemins sont don mauvais ! les chevaux emmortant ai chèque pas. - I ne sai pas, ma! i crains bein qu'â s'enmorte dans ces aifâres lai qu'al é entrepries. - (18) |
| enmorter, v. a. enfoncer dans une morte, dans un marais, dans un endroit mouvant et fangeux : « enmorter » une voiture, un bœuf, un cheval. - (08) |
| enmouéiller, v. a. enfoncer dans une mouille, dans un terrain mouvant et ordinairement rempli d'eau. - (08) |
| enmougner, v. a. emmener. - (08) |
| en'mouinge : affaire embrouillée - (48) |
| en'mouinger : emmancher - (48) |
| enmouner, v. tr., emmener. - (14) |
| en-moutte : motte de terre. - (33) |
| en-muzer, amuser. - (26) |
| en-myinler, emmieller, amadouer. - (26) |
| enmyôlé quelqu'un : lui dire des choses qui le flattent pour en obtenir une chose que l'on désire. - (16) |
| en-n’haut (chu l’) : (sur le) grenier à foin - (37) |
| enn’téger. v. a. Nettoyer. (Lindry). - (10) |
| ennâïé, adj., se dit d'un bois sec arrosé de pluie. - (40) |
| enne (art. indéf. fém.) : une - (64) |
| enne (art. indéf. masc.) : un, si le no masculin commence par une voyelle) - (64) |
| enneiger, ennuéger. v. a. Ennuyer. - (10) |
| enneigi : enneigé - (57) |
| enneu, loc. en nuit, de nuit : être «en-neu», être en nuit, c’est à dire se laisser surprendre par la nuit : « a s'ô mettu enneu », il s'est mis en nuit. - (08) |
| en-neù, s. m., ennui, chagrin. - (14) |
| enneuillé, e, adj. se dit d'une personne qui a de l'embarras dans les intestins pour avoir mangé trop de fruits avec leurs noyaux, trop de cerises ou de griottes principalement. - (08) |
| enneuter, v. a. mettre en nuit, dans la nuit. - (08) |
| enneuyé : constipé - (39) |
| enneuyé, à moitié ivre. - (27) |
| en-neuyer : ennuyer - (43) |
| ennioussè : s'étouffer (le gâteau de semoule m'enniousse) - (46) |
| enniové : gorgé d'eau - (46) |
| en-niûant, adj., ennuyeux. C'est surtout à cause de la bizarrerie de sa prononciation que l'on signale ce mot, dont les deux syllabes finales sonnent comme la fin de chat-huant, légèrement mouillées devant l’a. - (14) |
| en-niûer, v. tr., ennuyer. (V. Enniàant, pour la remarque sur la prononciation.) - (14) |
| ènn'mi, ennemi (prononcer : înn'mi). - (16) |
| Enno (é-no), ("les enfants d'énno) ; petits cumulus qui se montrent parfois le matin avant une journée orageuse ; on dit "ciel pommelé, fille fardée, n'est pas de longue durée"). - (38) |
| ennoige (eune) : une mère brebis. (RDT. T III) - B - (25) |
| ennorcer, déglutir avec difficulté. - (28) |
| ennoré (ou ennioré ?), vt. dorer. - (17) |
| ennossé (s'), vr. s'étrangler avec un os. - (17) |
| ennossé, part, passé. se dit d'une personne qui a le cou très court et comme enfoncé dans les épaules. On prononce an-nô-cé. - (08) |
| ennoué (s'), vr. s'étouffer, s'étrangler en buvant et en mangeant. - (17) |
| ennouilli : ennuyer - (57) |
| ennové (s') (õ), vr. s'étrangler avec un os. Voir ennossé. - (17) |
| en-novré : Affairé, absorbé par sa besogne. « Ol était bin si en-novré qu'o ne m'a pas vu passer ». - (19) |
| en-nû : Ennui. « Chéquin a bin ses ennûs ». Douleur, mal aux jambes, « J'ai des ennu dans les chambes ». - (19) |
| ennua : ennui. - (29) |
| eñnuer : (vb) ennuyer ; « alle s'en-nuot à la v'yie » (elle s'ennuyait à la veillée) - (35) |
| en-nuer : Ennuyer. « Finis voir ! Te commaches bin pa m'ennuer », Finis, tu commences à m'ennuyer ! - (19) |
| eñnuer v. Ennuyer. - (63) |
| en-nüer, v. ennuyer. - (38) |
| ennuyan, ennuyeux (prononcer en deux syllabes : en nuyan ; nuyan en une seule émission de voix). - (16) |
| ennuyance. s. f. Ennui. (St-Florentin). - (10) |
| en-ô : n. m. et expr. En amont. - (53) |
| éno : non, mais non (cf ino) - (39) |
| énocence, s. f. innocence. - (08) |
| énocent, adj. et s. innocent, qui n'est point coupable, qui ne connaît pas le mal, celui ou celle qui manque de connaissance, d'expérience. - (08) |
| enœillé : v. t. Perdre un œil. - (53) |
| énoite. : (Dial.), adjectif du verbe énoiter, accroître, augmenter (rac. lat., le participe passé auctus du verbe augere et la préposition in). - (06) |
| énorcer, v. tr., embarrasser, engorger : «Êtree énorcé » veut dire : avoir la gorge embarrassée par quelque chose qui ne veut pas descendre : « Arrange donc ton feù ; c'te feùmeire m’énorce. » - (14) |
| enorser (S') et s'enosser. S'étouffer en avalant un os. - (13) |
| enossé. Quand on est enrhumé on a le rhume, quand on est en ossé, on a un os... dans le gosier ! Se dit plus généralement des chiens et chats que des gens. - (12) |
| enouaîrè : v. t. Enduire de matières gluantes, malodorantes. - (53) |
| énouer (S’). v. pronom. S’étouffer, s’étrangler en mangeant trop vite ou parce que on a un os (un ou) dans la gorge. Se dit par altération de s'énosser. (Merry-la-Ville). - (10) |
| enouiller, enivrer, ennuyer. - (05) |
| en'oûsser (s') : étouffer (s') en mangeant - (48) |
| enpaffé (s'), vr. s'étouffer en avalant un morceau sec, brioche, pâté, etc. - (17) |
| enpare, s. f. cloison de manches à mi-hauteur. - (22) |
| ènparfé ; mal élevé ; k' t'ë don ènparfé ! dit une mère à son enfant qui ne fait pas ce qu'elle lui commande. - (16) |
| enpature, sm. entrave. Par ext. : individu encombrant. - (17) |
| enpaturé, vt. entraver le bétail. Voir enpigé. - (17) |
| enpegi, v. a. empêtrer, comme englué avec de la « pœge » (poix), au propre et au figuré. - (24) |
| enpegi, v. a. empêtrer, comme englué avec de la « pœge ». - (22) |
| enpeniôtre, adj. têtu, buté. Verbe : empeniôtré. - (22) |
| enpiâtre, sm. emplâtre. Voir piâtre. - (17) |
| enpieuti, vt. tasser ; ensacher. - (17) |
| enpige, et enpiger - attacher les pieds aux bêtes, surtout dans les pâturages : embarras. - Enpige bein les chevaux pour qu'à ne sortaint pâ du prai. - Ailez-vos en don, tenez ! vos ne faisez que m'enpigeai. - (18) |
| enpigé, vt. empêtrer, entraver, encombrer. - (17) |
| enpillé, vt. empiler. - (17) |
| enplliâtre, adj. 1. Caressant à l’excès. — 2. Qui se plaint souvent et sans cause. - (22) |
| enplliâtre, adj. 1. caressant à l'excès. — 2. Qui se plaint souvent et sans cause. — 3. Encombrant, indiscret, dont on ne peut se débarrasser. - (24) |
| enpô, prép. adv. [empour]. En échange. - (17) |
| enpöché, vt. empêcher. - (17) |
| enpochené, vt. empoisonner. - (17) |
| enpogené, vt. empoissonner. - (17) |
| enpor - pour, en échange. - Quoi que vos me beillerà empor qui vos ai fai vote commission ! - Enpor qui liô-z-ai gardai lote petiot a m'en beillé in gros painé de treuffes. - (18) |
| ënpössé, vt. dérober. - (17) |
| en'poulat : coq de basse-cour. - (33) |
| en-pour : en échange. - (33) |
| enpri, v. a. allumer : enpri la lampe, le poêle. - (22) |
| enpri, v. a. allumer : enpri la lampe, le poêle. - (24) |
| enque, s. f. encre. - (08) |
| enque, s. f., encre. - (14) |
| enqueniller : placer le linge dans le lavier. - (09) |
| enquentir, enmêler les cheveux. - (05) |
| enquervelles. s. f. Se dit par altération pour écrouelles, maladie que, dans la croyance naïve de nos pères, les rois de France avaient le privilège de guérir par un simple attouchement. (St-Martin-sur-Ouanne). - (10) |
| enquétan, ante, adj. celui qui est en quête de nouvelles, de caquets, curieux, indiscret. - (08) |
| enqueûlotter : enculotter, assembler - (37) |
| enqueurnale, n. fém. ; marque dans du bois ; fais enne enqueurnale po remairquer. - (07) |
| enqueurne, s. f. cran, entaille faite dans un morceau de bois pour servir de marque. - (08) |
| enqueûrnî : couvert de tâches tenaces - (37) |
| enqueurnî : fortement encrassé, et de longue date. - (62) |
| enqueûtir, v. tr., emmêler les cheveux. - (14) |
| enqueutir. Emmêler plus particulièrement les cheveux ; déqueutir, démêler. Ces mots ont été sans doute créés du temps où l'on portait la queue. - (03) |
| enquieume (n.f.) : enclume - (50) |
| enquieume, s. f. enclume. Les faucheurs ont tous une petite enclume portative sur laquelle ils battent la lame de leur faux ou dard. - (08) |
| enquieupart. adv. - Sans doute : « C'jour là, l'ch'vau i' s'est enquieupart ben emballé, la vouétue ya passé su'l'corps ... » (G. Chaînet, L'Coustume dé vélours) - (42) |
| enquiller : elever sur quelque chose - (60) |
| enquiller, verbe transitif: heurter accidentellement quelque chose ou quelqu'un. - (54) |
| enquilli v. Enfoncer, enfiler. - (63) |
| enquinter : v. a.; commencer, entreprendre, organiser. Une chose peut être bien ou mal enquintée. - (20) |
| enrâ : Enrayer. « Enrâ in chai », enrayer les roues d'un char. Faire le premier sillon (la râ) dans une terre que l'on veut labourer, et au figuré, mettre quelque chose en train « quand eune affâre est bien enrâ, alle a bien des chances de réussi ». - (19) |
| enracener : Enraciner, pousser des racines. « Mes chevolées sant bien enracenées ». Au figuré, attaché à : « O ne veut pas quitter le pays, ol y est bin treu enracené ». - (19) |
| enracer. v. - Se procurer une variété de plante, d'espèce, de race qu'on ne possède pas. - (42) |
| enradzi v. Enrager. - (63) |
| enrager : (faire enrager) taquiner, jusqu'à l'excès, souvent. Ex : "Te vas t-y finie de l' fée enrager c'pour gamin ?" - (58) |
| enragi - enrègi : enrager - (57) |
| enrai : groupe de sillons. III, p. 31 - (23) |
| enraiger : enrager - (48) |
| enraigi : Enrager. « In chin enraigi ». « Enraigi sa vie », se démener comme un enragé. « Fare enraigi », faire endêver, taquiner, « Fa dan pas tant enraigi ta mère ». - (19) |
| enraigier, v. a. enrager comme en français avec ses diverses significations : « enraigier » après quelqu'un, tourmenter, harceler une personne pour en obtenir ce que l'on désire. - (08) |
| enraillè : commencer quelque chose - (46) |
| enrâilli : enrayer - (57) |
| enraisser. v. n. Mettre en raie, commencer. - (10) |
| enraissue (pour enraissure). s. f. La première raie faite dans un champ qu’on laboure. (Perreuse). - (10) |
| enraiyer : (an:ryé - v. intr. et trans.) 1- faire l'enroi d'un champ au labour. 2- bloquer la roue d'un véhicule (chariot, tombereau .. ) à l'aide d' un en:rouè (ce qui peut être une chaîne ou un bâton), ou en serrant le frein.. - (45) |
| enraiyeur : (an:ryeu:r' subst. f.) le premier aller et retour de la charrue lors du labourage d'un champ. - (45) |
| enraizer (fé) : provoquer, exciter - (37) |
| enraizer (v.t.) : enrager - (50) |
| enraizer : n’être « pas content », être en colère, s’exciter - (37) |
| enraizer sai vie : se démener comme un beau diable - (37) |
| enraizer sai vie : se démener, comme un beau diable - (37) |
| enraizer : enrager - (39) |
| enrauchement : enrouement. - (32) |
| enraucher (s'), v., s'enrouer. - (40) |
| enrauguer, v. a. enrouer, rendre la voix rauque : « i seu enraugué, i m'enraugue », je suis enroué, je m'enroue. - (08) |
| enrauqué (-e) (ad., p.p.m. et f.) : enroué (de rauque) - aussi enraugué - (50) |
| enra-ye : première entaille de la charrue pour commencer les labours. On fait un passage à la faux près de la haie pour passer la lieuse ou la moissonneuse - (43) |
| enràyé, v. a. commencer un travail, spécialement faire la première raie d'un labour. - (22) |
| enraÿer : (vb) commencer une raie de labour (ou un travail) - (35) |
| enrayer : commencer (par ex.: les moissons (Brionnais). - (30) |
| enrayer : commencer le premier sillon. III, p. 36-4 - (23) |
| enra-yer : commencer une raie de labour - (43) |
| enrayer : serrer le frein (la mécanique) d'une voiture. III, p. 36-4 - (23) |
| enràyer, v. a. commencer un travail, spécialement faire la première raie d'un labour. - (24) |
| enrâyi v. Commencer un ouvrage, mettre en chantier, littéralement mettre la charrue à la raie, au sillon). - (63) |
| enréger, v. a. tracer un sillon, ouvrir le premier sillon ou la première raie d'un labourage. - (08) |
| enreuillé ée, adj., enroué, avoir une voix enreuillée. Ex. : al ô enreuillé, pour il est enroué. - (11) |
| enreuillé, enroué. - (38) |
| enreuiller : enrouer - (39) |
| enreuilli : Rouiller. « In ban ovré ne laiche pas enreuilli ses eutis ». Au figuré, enroué, « T'es dan bin enreuilli ? ». - (19) |
| enreuillir, enrouiller. - (05) |
| enreumer. v. a. enrhumer, causer du rhume. - (08) |
| enreuté, embourbé (en parlant d'une voiture). - (27) |
| enrevâr (à l’), loc, à l'envers. - (14) |
| enrheumé adj. Enrhumé. - (63) |
| enrheûmer, v. tr., enrhumer, donner mal à la gorge. - (14) |
| enrhumé comme un loup. Enrhumé violemment, comme avoir une faim de loup signifie avoir très faim. - (12) |
| enrhumer : v. n., s'enrhumer. J'enrhume. - (20) |
| enricer. v. a . Enrichir. (Ménades). - (10) |
| enricher, v. a. enrichir, rendre riche : cela « n'enriche » pas de faire tort au prochain. - (08) |
| enrié : encore - (44) |
| enrier : enrayer, bloquer une roue - (48) |
| enrier : faire la première raie (labour) - (48) |
| enrïer, v. a. enrayer, ouvrir un sillon dans un champ, faire un enroi. - (08) |
| enrieure : première raie - (48) |
| enrincer. v. - Commencer le premier sillon, mettre en raue. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| enriôler (s') (v.) : 1) se mettre en joie - 2) faire entrer dans un groupe - (50) |
| enriure, enrure. s. f. Enrayure, planche de labour. Une enrure de blé. (Chassignelles, Serrigny). - (10) |
| enrocher (v. tr.) : enrober, recouvrir d'une substance quelconque - (64) |
| enroi, enroué, s. m. sillon que trace la charrue au début d'un labourage. - (08) |
| enroiasser (enroïasser) (S') : v. r., vx fr. enroir, s'enrouer. - (20) |
| enroichement, s. m. enrochement, enduit de mortier appliqué sur un mur. - (08) |
| enroicher, v. a. crépir un mur, faire un crépi, couvrir d'un enduit quelconque. - (08) |
| enroichou, s. m. enrocheur, celui qui pose les enduits de mortier, de ciment, etc. - (08) |
| enroidi, v. a. devenir raide : « i seu tô enroidi d' froué. » - (08) |
| enrosser : rouler (tromper) - (57) |
| enrosser : tromper - (57) |
| enrotai - engagé dans une ornière d'où l'on a peine de se retirer. - Les chevaux ant airotai pré du melin. - A ne sait pâ menai les chevaux, et pu al é anrotai. - Voyez airotai. - (18) |
| enrôté, part., pris dans une ornière, en parlant, d'un char dont les roues enfoncées ne peuvent plus tourner. - (14) |
| enröté, vt. embourber. Voir reutö. - (17) |
| enroter (s') : s'embourber dans un chemin boueux avec une voiture. - (66) |
| enroter : Enfoncer dans la boue. « Le chemin était bin si mauvâ qu'an enrotait jeusqu'au botint (jusqu'au moyeu) ». Au figuré : « Te migeras bin encor ce ptiet morciau, y est pas cen que veut t'enroter ». - (19) |
| enroter : enliser, embourber - (48) |
| enroter : v. a., embourber. - (20) |
| enroter, v. ; enfoncer dans la boue, mai chairrotte s'ost enrotée. - (07) |
| enroter, v. a. enfoncer dans la terre, embourber : une voiture enrotée. - (24) |
| enroter, v. a. se dit d'une voiture qui a les roues prises dans les difficultés d'un chemin, dans la boue, dans une ornière, etc. - (08) |
| enrotjelé, vt. entortiller. - (17) |
| enrouai - envelopper : outre le sens de enroué. - En te fau bein enrouai ton bras qu'à étai cassai. – Al é lai tête enrouée. - Enroue-moi voué le doigt, qu'a saigne. - (18) |
| enrouaiyer (v.t.) : 1) tracer le premier sillon - 2) commencer un travail - (50) |
| enrouati, ie. adj - Enroué. (Saint-Martin-sur-Ouanne, selon M. Jossier) - (42) |
| enrouati, ie. adj. Enroué. (St-Martin-sur-Ouanne). - (10) |
| enrouatissement. n. m. - Enrouement. (Saint-Martin-sur-Ouanne, selon M. Jossier) - (42) |
| enrouatissement. s. m. Enrouement. (Saint-Martin-sur-Ouanne). - (10) |
| enroué du fil, le mettre en pelote. Être enroué, avoir la voix gênée par un rhume. - (16) |
| enrouècher : enduire (maçonnerie) - (48) |
| enrouer : empaqueter, envelopper en enroulant. « Enrouez m’y don » : enveloppez le moi, donc. - (62) |
| enrouer : commencer le premier sillon d'un labour - (39) |
| enrouer, envelopper. - (05) |
| enrouer, v. tr., enrouler, envelopper, entourer : « O s'a copé ; j'vein d'li enrouer l'dèt. » - (14) |
| enrouer. Enrouler, envelopper. « S'enrouer dans son mantchau » (manteau). - (49) |
| enrouer. Envelopper. - (03) |
| enroûtè : embourbé (en parlant d'un véhicule) - (46) |
| enrouté, v. a. enfoncer dans la terre, embourber. - (22) |
| enroûter : envelopper - (48) |
| enrouter : chasser, mettre dehors. Ex : "V’la la Lucienne qué vint m’die qu’mes poules ataint dans yeu blé. J’te l’ai enroutée la fumelle, t’entends ben !" - (58) |
| enroûter : envelopper - (39) |
| enroûter, v. ; entourer avec un linge ; tu t'est copé ; enroûte-toi le doigt d'aivou enne pièce. - (07) |
| enrouter, v. a. enrouler, envelopper en tournant, rouler. On « enroute » avec du linge un doigt blessé, une jambe meurtrie. - (08) |
| enrouvouée. s. f. Arrosoir. (Montillol). - (10) |
| enroyer, v., faire le premier sillon avec la charrue. - (40) |
| enro-yiessi : enroué - (43) |
| enrubanté, ée. adj. Enrubanné. - (10) |
| enrue. n. f. - Labour en planche, c'est-à-dire par bandes larges et planes ou légèrement bombées. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| enruse. s. f. Surface de terrain labourée et convenablement unie. (Maligny). - (10) |
| ensacher : v. a., mettre en sac, tasser par secousses ; ou autrement. - (20) |
| ensaches, essaches (échassier). - (05) |
| ensáches, s. f., échasses. Tous les gamins s'amusent à trotter perchés sur leurs « ensáches ». Ils vont par les rues et surtout aux bords vaseux du petit Doubs. La boue, qu'ils vont chercher, justifie selon eux l'usage de l'objet. - (14) |
| ensachi - ensèchi : ensacher - (57) |
| ensachi, v. a. 1. Mettre dans un sac, ou « sache ». — 2. adj. qui est trapu, sans cou, comme si on l'avait tassé dans une « sache ». - (24) |
| en-sai : en-soi - (57) |
| ensaicher, v. ; enfoncer dans un sac en pesant ; peser sur du foin, de la paille, pour l'ensaicher. - (07) |
| ensaichi : Ensacher, mettre en sac. « Ensaichi du blié ». Secouer fortement le sac de façon à en bien tasser le contenu. Au figuré : enfoncer ; « Ol a la tête ensaichi dans les épaules », pour dire d'une personne qu'elle a le cou très court. - (19) |
| ensaichi, 1. v. a. mettre dans un sac, ou « saiche ». 2. adj. qui est trapu, sans cou, comme si on l'avait tassé dans une « saiche ». - (22) |
| ensaigné, vt. ensanglanter. - (17) |
| ensaigner. Ensanglanter. - (12) |
| ensaignure, s. f., région du cou où l'on plonge le couteau (chez le porc). - (40) |
| ensaim : (nm) essaim - (35) |
| ensain : adv. ensemble. - (21) |
| ensain : essaim - (43) |
| ensainter (S') : v. r., se mettre dans la sainteté, tomber dans la dévotion. - (20) |
| ensangner, v. a. ensanglanter, mettre en sang. - (08) |
| ensanner (prononcez ensan-ner). v. a. Ensanglanter. (Etais). - (10) |
| ensanner. v. - Ensanglanter. - (42) |
| ensârer : mettre dans - (48) |
| ensârer, v. tr., serrer, enfermer dans : « L'vieux chin, làvou y ét-i donc qu'ôl ensâre ses écus ? » - (14) |
| ensarrer (v.t.) : mettre sous clef ; enfermer - (50) |
| ensârrer : enserrer - (57) |
| ensârrer : serrer - (37) |
| ensarrer, v. a. serrer, mettre sous clef. - (08) |
| ensatsi : (vb) mettre en sac - (35) |
| ensatsi : mettre en sac - (43) |
| ensatsi v. Ensacher. - (63) |
| ensaûb'illement : ensablement - (57) |
| ensaûb'iller : ensabler - (57) |
| ensauvé (s'), vr. se sauver. - (17) |
| ensauver (s') (v.pr.) : se sauver - (50) |
| ensauver (s'), v. pron., se sauver, détaler sans attendre : « Oh! le ch'ti ! V'tu ben t’ensauver ! » - (14) |
| ensauver (s'), v., s' enfuir, se sauver. - (40) |
| ensauver (s'). Se sauver. - (49) |
| ensaûver (s’) : déborder de la casserole en bouillant pour le lait - (37) |
| ensauver (S’). v. pron. Se sauver, s’enfuir. Je l’ai appelé, il s’est ensauvé. - (10) |
| ensauver v. Sauver. - (63) |
| ensauver, v. a. sauver de... tirer de péril.., « ensauver » quelqu'un de danger. - (08) |
| ensauver, v. fuir. - (38) |
| enscier : enfler - (57) |
| ensciûre (n’) : enflure - (57) |
| enseigni - ens'gni : enseigner - (57) |
| enseigni : Enseigner, faire connaître, montrer. « Vins voir, je vas t'enseigni in nid ». - (19) |
| ensein, ansain : adv., vx f r. ensems, ensemble. - (20) |
| ensembé (s'mét'e), loc, se dit volontiers des unions où M. le Maire n'a point passé : « O s'sont métu ensembe ; ma i n'allôt guère. » - (14) |
| ensembe : ensemble - (39) |
| ensemb'ille : ensemble - (57) |
| ensembye (adv.) : ensemble - (50) |
| ensemenci : Ensemencer. « Ensemenci eune tarre en blié ». - (19) |
| ensenle, ensembe - ensemble, avec. - I sons venus toi les chisse ensenle, c'éto ine vraie bande. - Emportez tot cequi ensenle. - (18) |
| ensenod : voir ancenat. - (20) |
| ensequeubla : verser. (S. T IV) - B - (25) |
| enserrer : v. a., vx fr., égarer. - (20) |
| enseuchement, ensouchement. Capital en bétail ou en grains que le propriétaire remet au fermier et que ce dernier doit lui rendre à sa sortie. - (08) |
| enseudre et encheudre, soulever un sac, un fardeau. - (05) |
| enseurçaler : Ensorceler. « Ren ne li réussit, an dirait qu'ol est enseurçalé ». - (19) |
| enseùte, adv., ensuite, après. - (14) |
| enseuv'lichouse, s. f. ensevelisseuse, femme chargée du triste soin non d'enterrer les morts, mais de les revêtir du drap qui les enveloppe dans le cercueil. - (08) |
| ensigner : renseigner, dévoiler un « petit secret » - (37) |
| ensin : (adv) ensemble - (35) |
| ensin : ensemble - (43) |
| ensin : Ensemble « An ne les voit jamâ ensin ». - (19) |
| ensin adv. Ensemble, en commun. - (63) |
| ens'menci : ensemencer - (57) |
| ensoigner. v. a. Enseigner, désigner. (Etivey). - (10) |
| ènsolanté, insulter, dire des insolences. - (16) |
| ensômeilli, v. a. ensommeiller, endormir : « tô ô don ensômeilli iqui », tout est donc endormi ici. - (08) |
| ensorciïer, v. tr., ensorceler, jeter un sort. - (14) |
| ensorciller, v. a. ensorceler, jeter un sort sur les animaux. Au moyen âge les sorcières étaient souvent appelées sorcelleresses. - (08) |
| ensoucer(s') : s'étrangler en mangeant ou en buvant - (60) |
| ensoucer, v. a. on est « ensoucé » lorsque l'on tousse d'une manière prolongée après avoir avalé de travers. - (08) |
| ensouégne, s. f. indice, indication, symptôme. - (08) |
| ensouégnement, s. m. enseignement, renseignement, indication. - (08) |
| ensouégner, v. a. enseigner, apprendre, indiquer. (Voir : ensouégne.) - (08) |
| ensougner : enseigner, apprendre à qqn. - (56) |
| ensouiemenz. : (Dial.), soin, embarras, entrave (du verbe ensouier, donner son soin à). - (06) |
| ensouvle, s. m. ensouple, cylindre sur lequel les tisserands enroulent leurs fils - (08) |
| enspendre. : (Dial), répandre intérieurement (rac. lat., intus spandere). - Il ne faut pas confondre ce verbe avec ensprendre, qui signifie surprendre, arrêter, comprimer (lalin intus prehendere). - (06) |
| ènstrure, instruire ; on dit d'un enfant honnête : el â bèn ènstru. - (16) |
| ensuifer : Suiffer « Ol a ensuifé ses sulés pa core dans la nage ». - (19) |
| en'sûlè : v. pr. Se mettre au soleil. - (53) |
| ensuqué. adj. - Mal réveillé, manquant de sommeil. (Sougères-En-Puisaye) - (42) |
| ensus, en haut, enchu. - (04) |
| ent’ieugnoeure, s. f. trace laissée par le contact mutuel des pains dans le four. - (22) |
| entabe, v. assoupir. - (38) |
| entachi - entéchi : entacher - (57) |
| entailli : entailler - (57) |
| entaîme. n. f. - Entame. - (42) |
| entaîmer, entômer. v. a. Entamer, couper une portion d’un pain qui est encore entier. Il y a quelque trente ans encore, même dans les familles les moins chrétiennes, il n’était pas rare de voir celui qui, à table, coupait le pain — ordinairement le chef de la maison — faire un signe de croix avec la pointe de son couteau sur le milieu de la miche, avant de l’entaîmer. - (10) |
| entaîmer. v. - Entamer. - (42) |
| entaissé, vt. entasser. - (17) |
| entalenté. : (Dial. et pat.), désireux de. - Mautalent signifie mauvaise volonté. - (06) |
| entâmer, v. tr., blesser, déchirer : « J'ai les mains tôt entâmées. » — « Ol a chu, é pou ô s'a entamé l'genô. » - (14) |
| entàmeûre, s. f., entame, entamure, premier morceau coupé d'un pain. - (14) |
| en'tapouellai : tripotter dans l'eau. - (33) |
| entaquer (S’). v. pronom. Se heurter contre un obstacle, être entravé, gêné par quelque difficulté à laquelle on ne s'attendait pas. (Saint-Florentin). - (10) |
| entâré, enterré ; entâr'man, enterrement. - (16) |
| entàrer l'feù, loc, le couvrir de cendres, afin qu'il se conserve pour rallumer le bois le lendemain. - (14) |
| entàrer, v. tr., enterrer, enfouir profondément. - (14) |
| entarrement : Enterrement, obsèques. « Ol a ésu in bal entarrement ». - (19) |
| entarrer : enterrer - (43) |
| entarrer : enterrer - (57) |
| entarrer : Enterrer, inhumer. « Y a pa huit jos qu'alle a entarré san homme à peu alle pense d'ja à se remairier ». - (19) |
| entarri: (vb) enterrer - (35) |
| entarr'ment (n’) : enterrement - (57) |
| entarvé (s'). : S'opposer, se mettre en travers du chemin, inter viam. C'est une expression du Châtillonnais. - (06) |
| entarvé ou entervé , s'opposer, barrer le chemin , se mettre entre le chemin et une personne , inter viam. - (02) |
| entassi : entasser - (57) |
| entaumé : entamé. Le pain entaumé durci : le pain entamé durci. - (33) |
| entaumer : entamer. - (52) |
| entauné, v. a. entamer. Écorcher. - (22) |
| entauner, v. a. entamer : entauner un pain. Commencer : entauner un travail. Écorcher : avoir le genou entauné. - (24) |
| enté, entère - entier, entière. - A vouraint aivoir le couchon tôt enté ran que pour z-eux. - Beillez lio mai pairt tot entière. - (18) |
| enté, ère, adj. entier : « i é aiqueté l'bin tô-t'-enté. » - (08) |
| entéger (s') (v. pr.) : s'embourber - (64) |
| enteicher, enticher, entisser, v. a. entasser les gerbes les unes sur les autres ; les mettre en « teiche, tiche ou tisse » ; trois formes usitées selon les lieux. - (08) |
| entêmer (v. tr.) : entamer - (64) |
| entemi : Engourdi. « J'ai les das entemis », j'ai les doigts gourds. Vieux français : entomir, engourdir. - (19) |
| entemi, adj. 1. Timide. — 2. Engourdi par le froid. - (22) |
| entemi, adj. 1. Timide. — 2. Engourdi par le froid. - (24) |
| entemi, adj., engourdi, presque paralysé. - (14) |
| entemi, engourdi, paralysé. - (05) |
| entemi, entoumi : voir etômi. - (20) |
| entemi. Engourdi. - (03) |
| entenayer. v. a. Mettre le linge dans le teneau, dans le cuvier pour la lessive. (Argenteuil). - (10) |
| entend’ment : accord, écrit ou verbal - (37) |
| entend’ment : réflexion, raison - (37) |
| entendement : s. m., ouïe, sens de l'audition. - (20) |
| entendement, s. m. entente, accord entre deux personnes pour l'exécution d'un dessein : « a ié dé-z-entend'mans enteurmi eusse», ils s'entendent entre eux. (Voir : entendue.) - (08) |
| entendue, s. f. entente, accord préalable entre deux ou plusieurs personnes. Se prend souvent en mauvaise part avec la signification de complot. - (08) |
| entendue, s. f., entente, accord survenu entre personnes dissidentes : « O s'a r'métu d'avou sa fonne ; y a êvu eùne bonne entendue. » - (14) |
| entenouaillai, faire entrer dans son intelligence. Entenouaillé vo dan lai tête, c.-à-d. mettez-vous dans la tête. - (02) |
| entenouaillai. : Faire entrer dans son intelligence.- Entenouaillai vo dan lai téte, c'est-à-dire mettez-vous dans la tête. (Del.) - (06) |
| enter, v. tr. N'est point le synonyme de greffer, et ne s'emploie guère que dans cette phrase : « Enter des bas, » pour : remonter des bas. La ménagère a-t-elle vu, dans ce travail, une sorte de greffe ? - (14) |
| èntérè, dommage causé ; fâr de l'entérè, faire du dégât. - (16) |
| enterloi, s.m. lanière en peau de serpent reliant le manche du fléau à la verge. - (38) |
| entermi : entre deux, parmi. Ex : "Le blé, il est beau, mais n’a ben du coq' licot entermi !" - (58) |
| entermi, au milieu - (36) |
| enterprie. s. f. Entreprise, par interversion du second e et retranchement de l’s. - (10) |
| enterrer (une bête crevée notamment). - (63) |
| enterténi (par suppression de l’r, qui ne se prononce pas). v. a. Entretenir. - (10) |
| en-téte (n’) : en-tête - (57) |
| enteuilli : mal réveillé, mal en point. A - B - (41) |
| enteuilli : mal réveillé, mal en point - (34) |
| enteuilli : ne pas être réveillé, engourdi par le sommeil - (51) |
| enteur (prép.) : entre - (50) |
| enteur, prép. de lieu. Entre : « lai meureille ô enteur lu é moue », la muraille est entre lui et moi. - (08) |
| enteurdeu, enteurdeusse, s. m. entre- deux, milieu, ce qui est entre deux personnes ou deux choses: «l'enteurdeu » d'un bois, d'un champ. Les propriétaires plantent des bornes dans leurs « enteurdeux. » - (08) |
| enteurfin : boucle en cuir avec ligature. - (32) |
| enteurla : bande de cuir servant à rattacher l'une à l'autre les deux parties du fléau. - (21) |
| enteurlée : lanière de cuir reliant le manche au battoir du fléau. A - B - (41) |
| enteurlet : lanière de cuir qui relie la verge au museau du fléau - (43) |
| enteurlin (n.m.) : courroie de cuir qui réunit les deux parties du fléau à battre - (50) |
| enteurlin, s. m. courroie de cuir qui réunit les deux parties du fléau à battre. - (08) |
| enteurmi (prép.) : entre - (50) |
| enteûrmi : entre les deux, au milieu d’eux - (37) |
| enteurmi, s. m. entre-deux, au milieu de... - (08) |
| enteurmôler (v.t.) : entremêler - (50) |
| enteurmôler, v. a. entremêler, mêler ensemble, embrouiller. (Voir : môler.) - (08) |
| enteurteni : Entretenir. « S'enteurteni des gens », se concilier leur bienveillance. - (19) |
| enteurteni, v. a. entretenir, fournir ce qui est nécessaire à l'entretien, à la subsistance, à l'habillement. - (08) |
| enteurtin, s. m. entretien, ce qui est nécessaire à tous les besoins de la vie. - (08) |
| enti : entier - (43) |
| enti : entier - (57) |
| enti : Entier. - (19) |
| enti, adj. entier. - (22) |
| enti, adj. entier. Féminin entire. - (24) |
| entiché : v. t. Tasser. - (53) |
| enticher (pour entisser). par conversion, en prononçant des deux s en ch. Entasser les gerbes dans la grange, les mettre en tisse. (Domecy-sur-le-Vault). - (10) |
| enticher (s'), v. r. avoir pour quelqu'un une affection quelque peu exagérée. - (24) |
| enticher (v.t.) : entasser le foin ou les gerbes - (50) |
| enticher : empiler les gerbes dans la grange - (48) |
| entierteit. : (Dial.), qualité de ce qui est entier. - (06) |
| entiger, entayer (pour entaiger). v. n. Enfoncer dans la boue. Voiture entigée, voiture embourbée. ( Sommecaise ). De aige , eau, et de en , préposition ; Enfoncer dans l’eau, dans l’eau bourbeuse. - (10) |
| entiger, entrayer. v. - Embourber. (Sommecaise, selon M. Jossier) - (42) |
| èntihété, inquiéter ; n' t'ènthiéte pà, ne sois pas inquiet. - (16) |
| entiö, sm. clos. Voir tiö. - (17) |
| entir'ment : entièrement - (57) |
| entisser, v., mettre le foin en tisses (pour le conserver). - (40) |
| entneiller : empiler en croisant, le linge quand on faisait la lessive - (39) |
| ent'noueiller, ent'nôllher, v. a. encuver, mettre le linge sale dans le cuvier pour la lessive. - (08) |
| entö, öre, adj. entier, entière. - (17) |
| entœnœbré*, v. a. rendre un lieu sombre, ténébreux. - (22) |
| entôman : Le premier morceau que l'on coupe d'un pain. « Donne me dan in ban entôman pa porter ma marande ». - (19) |
| entôme : (nf) première entaille de la charrue - (35) |
| entôme : entâme - (48) |
| entômer (s') : entâmer (s') - (48) |
| entômer (s') : verbe utilisé pour parler d'un vieillard qui a des escarres - (39) |
| entômer (v.t.) : entâmer - (50) |
| entômer : (vb) entamer - (35) |
| entômer : entamer (le pain) - (43) |
| entômer : Entâmer. « Neutés vieux avint coutume de fare eune croix su le pain devant de l'entômer (avant de l'entâmer) ». - (19) |
| entômer v. Entâmer. - (63) |
| entômer : entamer - (39) |
| entômer, v. a. entamer, couper une partie d'une chose qui est entière. «Enfourner.» - (08) |
| entômeure (n.f.) : entame - (50) |
| entômeure : entâme - (48) |
| entômeure : La section de ce qui est entâmé, ne pas confondre avec entôman qui est le morceau qui a été enlevé. - (19) |
| entômeure : entame - (39) |
| entômeure, s. f. entame, entamure, le premier morceau de pain que l'on coupe sur une miche ou une tourte. « Entoumeure. » - (08) |
| entômeures : escarres - (48) |
| entommé, entamé. - (04) |
| entoné : adj. Pas très propre. - (53) |
| entoneau et entouneau, s. m., entonnoir. - (14) |
| entonner : Verser dans l'entonnoir. « Entonner du vin », verser du vin dans un entonnoir. « Entonner du boudin », introduire dans un boyau de porc préalablement nettoyé la préparation composée de sang, de graisse et de fines herbes qui compose le boudin, cette opération se fait à l'aide d'un petit entonnoir appelé « moule de boudin ». - (19) |
| entonner, entounner. v. - Action de verser un liquide dans un entonnoir. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| entonner, v. ; verser dans un tonneau, dans un vase. Tu n'entonnes pas bin. - (07) |
| entonnou : (nm) entonnoir - (35) |
| entonnou : Espèce d'entonnoir formé d'un baquet muni d'une douille qu'on introduit dans la bonde de la futaille à remplir. - (19) |
| entonnou, s. m. entonnoir de bois. - (24) |
| entonnou, s. m., grand entonnoir de cave en bois. - (40) |
| entonnouaîr (n’) : entonnoir - (57) |
| entonnoue, entonnoir. - (26) |
| entor (ai I’) (loc.) : autour, à l'entour de - (50) |
| entor (ai l'), loc. adv. autour, à l'entour. - (08) |
| entôr, adv., autour, à l'entour. - (14) |
| entorche : Poignée de paille humide dont on entoure l'une des extrémités du lien d'osier employé pour lier les gerbes. - (19) |
| entorreman (n.m.) : enterrement - (50) |
| entortéiller (v.t.) : envelopper ; tromper quelqu'un par la ruse - (50) |
| entorteiller : entortiller, séduire ou tromper quelqu'un - (39) |
| entorteiller, v. a. envelopper; séduire ou tromper quelqu'un par la ruse. - (08) |
| entorteuilli : entortiller - (51) |
| entorteuilli v. Entortiller. - (63) |
| entortilli : entortiller - (57) |
| entortiyé quelqu'un, l'ennuyer, le séduire par des paroles qui le flattent ; è mé entortiyé. - (16) |
| entortouéiller : entortiller - (48) |
| entouailer : entoiler - (57) |
| entouârse (n') : entorse - (57) |
| entounailles. n. f. pl. - Noces : « Au lieu de r'pren' leux ch 'min, ceux là vont pou' les entounailles ». (Fernand Clas, p.l43) - (42) |
| entoûner : entamer - (57) |
| entouner, v. entonner. - (38) |
| entounoeu, s, m. entonnoir de bois. - (22) |
| entounou, s.m. entonnoir. - (38) |
| entounoué, s. m. entonnoir. - (08) |
| entounouée. n. f. - Entonnoir. - (42) |
| entouris. s. m. Clôture, enceinte. (Merry-la-Vallée). - (10) |
| entourmir. v. a . Ensommeiller, allanguir, énerver, ôter le ressort, l’énergie, la chaleur du feu entourmit. (Percey). - (10) |
| entourviner. v. - Entortiller, enrouler quelque chose. (Saint-Privé, selon M. Jossier) - (42) |
| entourviner. v. a. Entortiller, rouler à l’entour. (Saint-Privé). - (10) |
| ent'prenre, v. a. entreprendre ; donner ou prendre un travail à forfait : « i é ent'pri d' fére ç'lai », j'ai entrepris de faire cela. - (08) |
| entrabucher (s'), v., risquer de tomber en marchant. - (40) |
| entrâner, v. a. entraîner ; traîner après soi. (Voir : trâner.) - (08) |
| entrapé : entravé - (43) |
| entrape : entrave - (51) |
| entraper (s'), se coincer le pied dans un trou en marchant. - (40) |
| entraper (s’) : empêtrer (s’) - (43) |
| entraper : entraver - (51) |
| entr'apercevouair : entr'apercevoir - (57) |
| entrappe. s. f. Personne mal intentionnée, qui cherche à nuire à une autre. - (10) |
| entrapper s' v. S'accrocher au passage, trébucher. - (63) |
| entraule, adj. ouvert, engageant, affable. - (08) |
| entravaucher, entrevaucher. v. a. Embarrasser, embrouiller. Il y a des personnes qui entrevauchent leurs pieds en marchant, d’autres qui entrevauchent leur langue en parlant. — S’entrevaucher. v. pronom. S’embrouiller, se perdre, s’égarer. On s’entrevauche dans les calculs, dans ses discours, dans ses combinaisons. - (10) |
| entravinure, s. f., entorse des ligaments du pied. - (40) |
| entravirer, v. tr., fatiguer, tourner la tête : « Ah! la bavarde ! All' m'en a dégoisé si long. . . áll’ m'a tôt entraviré. » (V. Élourdir.) - (14) |
| entre : donner de l'entre = donner de la profondeur à un sillon. A - B - (41) |
| entre dix-neuf et vingt (être), loc. être sous l'influence d'un commencement d'ivresse : il est souvent entre dix-neuf et vingt. - (24) |
| entre n.m. Profondeur du labour. Ôter ou donner de l'entre. - (63) |
| entrebâilli : entrebâiller - (57) |
| entrebayi : entrouverte (porte) - (43) |
| entrechambe (n') : entrejambe - (57) |
| entrecoûte (n’) : entrecôte - (57) |
| entrecrouaîser : entrecroiser - (57) |
| entredéchiri : entredéchirer (s’) - (57) |
| entrée, s. f. défaut dans une haie ou dans un mur ; vide, ouverture, passage par où l'on peut s'introduire dans un champ, dans un pré. On bouche les « entrées » avec des épines. - (08) |
| entr'égorgi (s’) : entr'égorger (s') - (57) |
| entrelaci : entrelacer - (57) |
| entrelaissemenz. : (Dial. ), interruption. (S. B.) - (06) |
| entre-leu : entre eux - (46) |
| entreme : (entreum') Entre. « I ne fa pas ban être entreme l'enclieume et le martiau ». Vieux français entremi (XIIe siècle) entre, au milieu de, parmi. - (19) |
| entremeli : engourdi. (BEP. T II) - D - (25) |
| entremi - entre, au milieu. - Vos pliantai des rangs de cho, vos airains pu mette de lai salade entremi. - A nos envie in painé de poumes, en y aivo quéque poires entremi. - (18) |
| entremi (prép. et adv.) : entre, au milieu de - (64) |
| entremi : (prép) entre - (35) |
| entremi : au milieu - (61) |
| entremi : entre - (43) |
| entremi : entre - (57) |
| entremi : entre deux choses. L'entremi : l'intervalle. - (52) |
| entremi : entre deux. Préposition - (62) |
| entremi : entre, parmi - (48) |
| entremi : entre. - (29) |
| entremi : entre deux choses (l'entremi : l'intervalle). - (33) |
| entremi : entre - (39) |
| entremi : n. m. Intervalle. - (53) |
| entremi : prép., vx fr., au milieu de. - (20) |
| entremi, adverbe, préposition, entre. - (40) |
| entremi, au milieu de. - (04) |
| entremi, entermi. prép. - Au milieu, au centre, entre. Autre sens : parmi. Emprunt direct à l'ancien français qui utilise ce sens dès le XIe siècle, dérivé de mi, mige, milieu. - (42) |
| entremi, prép., entre, parmi, au milieu de : « J'ons m'né le p'tiot à la fouére entremi nous deux. » — « Mon chapiau a, chu entremi la cheire et la pôrte. » - (14) |
| entremi. Entre. Le relôge êtot plaicé entremi lai mai et lai taule. - (13) |
| entremi. s. m. Milieu de plusieurs choses. — C’est aussi, dans certains cas une préposition adverbiale, et alors il signifie : Entre, parmi, au milieu de. Ces objets sont si serrés, qu’on ne peut rien fourrer entremi. Viens donc te mettre entremi nous deux. Je l’ai vu entremi les autres. Du latin intermedium. - (10) |
| entremier. Qui est entre deux choses, du latin intermedius. - (03) |
| entremis, prép ; entre ; ne te botte pas entremis eux. - (07) |
| entremiter (S') : v. réf., s'interposer, se mettre entre. - (20) |
| entremö, entremi, prép. entré. - (17) |
| entremoine : s. f., vx fr. entremoien, espace intermédiaire, intervalle. - (20) |
| entremouin-ne, s. m. intervalle libre séparant deux étendues de foin dans le pré. - (22) |
| entremouin-ne, s. m. intervalle libre séparant deux étendues de foin dans le pré. - (24) |
| entrepousi - ringi : entreposer - (57) |
| entreprende v. 1. Affronter. Ôl a entrepris l'Toîne (il a affronté Antoine, il s'est opposé à lui, s'est dressé contre lui, s'est attaqué à lui). 2. Séduire. Ôl a entrepris la poûre feuille jusqu'à tant qu'alle cède. - (63) |
| entrepris, adj., embarrassé, qui a perdu contenance, malade : « L' pauv'gas ! ôl é tôt entrepris ; ô pourrôt ben rester pou la façon d' s'a mâre. » - (14) |
| entrequîlle, s. f. sarrazin. - (22) |
| entresauté : voir nerf. - (20) |
| entretchein : entretien - (51) |
| entre-tchuer (s’) : entre-tuer (s') - (57) |
| entretenir (S’) de : loc. Avolr des relations plus ou moins suivies avec quelqu'un. I vaut mieux s'entretenir des chetits que des bons, c'est-à-dire il vaut mieux être en bons termes avec les méchants pour qu'ils ne vous nuisent pas. - (20) |
| entretni (s') v. I faut s'entretni du mauwais monde. Il faut maintenir un minimum de bonnes relations avec les méchantes gens. - (63) |
| entretni : entretenir - (51) |
| entreutcheûsse (n’) : entrecuisse - (57) |
| entreuvri : entrouvrir - (51) |
| entrevauche. s. f. Fausse direction que prend sur le dévidoir le fil que l’on dévide. (Etivey). - (10) |
| entrevouaîe (n’) : entrevoie - (57) |
| entrevouaîr : entrevoir - (57) |
| entrhivarner. v. a. Donner à la vigne la façon d’hiver. (Cuy). — A Gisy-les-Nobles, on dit entrevarner, dans le même sens. - (10) |
| entrouvre : entrouvert - entrouvrir - (57) |
| entrucher (s'). Avoir subitement cet embarras de la gorge qui force a tousser, par exemple quand on avale de travers. Etym. ? ? - (12) |
| entruler : arranger quelque chose plutôt mal que bien - (60) |
| entsapye (y) : (vb) ça a du goût, c’est relevé - (35) |
| entsapye n.f. (de entsapyi). Petite enclume utilisée pour battre la faux. - (63) |
| entsapye, entsèpye : (nf) fer à battre la faux - (35) |
| entsapyi : (vb) battre la faux - (35) |
| entsapyi v. (du lat. incappulare, frapper sur la faux). Battre la faux, marteler (ce verbe est très ancien : il aurait pour origine un terme germanique, kappan, couper). - (63) |
| entsepille : petite enclume portative servant à battre la faux. A - B - (41) |
| entsepilli : aiguiser la faux en la battant au marteau sur l'entsepille*. A - B - (41) |
| entsèpye : enclume pour battre la faux - (43) |
| entsin-né : enchaîné - (43) |
| entsné : (nm) timon de labour - (35) |
| entsné n.m. Timon destiné aux labours. - (63) |
| enty-in, enclos. - (26) |
| env’ni (s’) : (vb) rentrer chez soi - (35) |
| envâ (l’) : envers - (57) |
| envadrouiller : rempli de - (44) |
| envairai - tout agité, tout hors de soi. - Al â venu qui tot évarai : i ne sai pâ ce qu'al aivot. - In chien é passai à mutan de nos brebis ; les pôres bêtes, jugez quemant qu'à devaint éte envairées. - (18) |
| envalâ (n.m.) : charbon embrasé (on prend un envalâ, pour allumer un autre feu, de Chambure) - (50) |
| envâlâ, s. m. charbon embrasé, braise, ce qui est rouge comme un charbon ardent. On prend un « envâlâ » pour allumer un autre feu. - (08) |
| envalai : enflammer. O faut du petit bois ç'o pou ben envalai : il faut du petit bois, c'est pour bien enflammer. - (33) |
| envâlai – lancé, bien commencer, pris ardemment avec entêtement. - C'a bon, allons voilai l'aifâre bein envâlée. - Si vo saivins al é in caractère vif, â s'envâle pour in ran. - (18) |
| envâlé (s') : v. pr. S'emballer. - (53) |
| envalè : v. t. Enflammer. - (53) |
| en'vâlé, part. passé. Enflammé, embrasé. - (08) |
| envalé, se dit des abeilles très excitées à certains moments et qui deviennent dangereuses pour ceux qui les approchent. Par analogie se dit d'une personne prompte qui se fâche facilement. - (27) |
| envaler : (vb) avaler - (35) |
| envâler : allumer, prendre (feu) - (48) |
| envaler : avaler - (43) |
| en'vâler, v. a. allumer, embraser : « i é fé envâler l'feu. » - (08) |
| envâler. Enflammer, mais avec un sens énergique. Etym. le latin vallare, donner de la vigueur. - (12) |
| envalhé. : Enflammé. Peau envalhée. (Del.) – Aux Fourgs, en Franche-Comté, on dit enwaillai. (Tiss.) - (06) |
| envar (à l’) : envers (à l’). Par opposition avec adroit qui est à l’endroit. Voir l’équivalent : «arnenvâ ». - (62) |
| envâr, s. m., envers d'une chose. - (14) |
| envarimer, v. tr., envenimer. - (14) |
| envariné, adj. très assidu à un travail. - (38) |
| envarmé : se dit d'un champ pris en ronces, friches, en vermine - (39) |
| envarré : Acharné, comme une bête en rut. Etym, varrat. Vieux français, enverrer, rendre furieux. - (19) |
| envarrer : presser (de faire) - (57) |
| envaudégi. Enragé. - (03) |
| envaudoueiller, v. a. ensorceler, jeter un sort sur quelqu'un. - (08) |
| envaudoyer, ensorceler - (36) |
| envayissou, envaïssou (ouse) (n.m. ou f.) : envahisseur (-euse) - (50) |
| envé : avec. - (30) |
| envé moi, « L » malgré moi, me invitus. - (04) |
| enveçoeu, s. m. orgelet. - (22) |
| envée – comparée à, à côté de, par rapport à. - I ons bein quique chose, ma quoi que c'â que ce qui envée lu ? – Ce qu'a nos an beillé lai ce n'a ran anvée ce qu'a nos daivant. - (18) |
| enveilli, e, v. n. vieillir, devenir vieux. - (08) |
| envelamilleu. n. m. - Milieu du champ. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| envenir (S') - venir de…, revenir. - Ile s'â envenue hier â sair. - A se sont enrevenus moillés queman des caines. - (18) |
| envêprer (s'). v. - Assister aux vêpres. - (42) |
| envêprer (S’). v. pronom. Assister aux vêpres. (Puysaie). - (10) |
| envergée. s. f. Mèche de fouet. - (10) |
| envermai - toutes choses, les fruits surtout où il y a des vers. - En i é to plein de fruts envermai c't année. - Du fremaige envermai… poui !! - (18) |
| envermè : plein de vers - (48) |
| envermé. Se dit d'une chose, d'un fruit ou les vers se sont mis. - (12) |
| enverminé. adj. - Envahi par les ronces et les mauvaises herbes. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| enverner : répandre une très mauvaise odeur. (G. T II) - D - (25) |
| envernicher(s') : s'obstiner à faire quelque chose - (60) |
| envesseler : mettre du vin en fûts. (V. T III) - B - (25) |
| envess'lé : v. t. Loger du vin, ou une autre récolte, se dit d'un travail terminé. - (53) |
| enveu : un orvet - (46) |
| enveulmer (v.t.) : envenimer - (50) |
| enveulmer, v. a. envenimer. Se dit d'une blessure, d'une plaie. - (08) |
| enveurmé (adj. et p.p.) : rempli de vers - (50) |
| enveûrmé (ât’e) : qui renferme des vers, de la vermine - (37) |
| enveurmé (-e) (adj.m. ou f.) : rempli (-e) de vers - (50) |
| enveurmer, v. a. se dit d'un objet qui est attaqué, rongé par les vers : une viande « enveurmée », une étoffe, un fruit « enveurmés. » - (08) |
| enveùrner (s'), v. pron., être attaqué par les vers. Se dit des fruits, des étoffes, des viandes : « J'I'avô portant métu dans l'sau ; ma mon lâr s'a tôt d'mein-me enveùrmé. » - (14) |
| enveurtœyi, v. a. enrouler autour (du vieux français vertir. Latin vertere). - (24) |
| enveurtoïlli v. (de veurtiau et touilli) Emmêler, enchevêtrer. - (63) |
| enveurtöyi : (p.passé) enroulé - (35) |
| envi. Avec répugnance, invitus. - (01) |
| envi. : (Du latin invitus), envi son maître, c'est-à-dire malgré son maitre. - (06) |
| enviai, enviant, envieussaint - divers temps du verbe envoyer. On pourrait dire que la forme de ce Verbe et celle d'Envier, c'est-à-dire porter envie, sont absolument les mêmes. – En faut los enviai to cequi ons premi. - I vas envie ai lai Pierrette sai calle qu'il m'aivo prôtée. – Vos liô diras qu'en fauro bein qu'a m'envieussaint mes haibits des dimoinges. - (18) |
| envider. Contraire de dévider; enrouler quelque chose, plus spécialement du fil, de la ficelle. - (12) |
| envie - envoyer. Plus usité que Enviai : voyez là. A différents temps : - N'obliez pas de l'envie... - Al â envie… - C'â moi qui l'ai envie. - (18) |
| envie : Envie, tache sur la peau que la croyance populaire attribue à une envie de la mère pendant sa grossesse. - (19) |
| envie d'bin fére, loc. très usitée qui signifie plutôt envie de gagner de l'argent, de faire fortune, d'amasser du bien, que de se bien conduire, de mener une vie vertueuse. - (08) |
| envie échtourbe : faire tomber (avec dommage). (CST. T II) - D - (25) |
| envi-é un fion : faire une remarque désobligeante - (43) |
| envié : v. t. Envoyer. - (53) |
| envier (v.t.) : envoyer - (50) |
| envier : envoyer quelqu'un - (43) |
| envier : envoyer. - (62) |
| envier : Envoyer. « Ecrivez-nous de temps en temps, pour nous envier de l'argent ». (vieille chanson), vieux français, envier. - (19) |
| envier ai l’ours, envier s’fâre voui : « envoyer promener » - (37) |
| envier, nenvier, v. a. envoyer ; chasser. Renenvier, renvoyer. - (24) |
| envier, v. a. envoyer, charger quelqu'un d'aller en quelque lieu : « i l'é envié qu'ri d' l'eai », je l'ai envoyé chercher de l'eau. - (08) |
| envier, v. envoyer. - (38) |
| envïer, vt. envoyer. - (17) |
| envïer. v. a. Envoyer. - (10) |
| envieuseté : s. f., envie. - (20) |
| enviezé et avoisiez. : (Dial. et pat.), invétéré dans le vice (rac. lat., vitiosus). - (06) |
| envigoré et ravjgoré. : (Dial.), ranimé (racine lat. vigor, avec les prépositions.) - Les villageois corrompent ce mot en rabigolé. « Sa volentiez fut envigoréie par la grâce de Deu. » (S. B.) - (06) |
| envihon, adv. a peu près, environ. - (08) |
| env'iller : envoyer - (57) |
| envillotter. v. a. Faire, au moyen du râteau et de la fourche, des villottes, des petits tas de foin dans les prés. Flogny). - (10) |
| enviner. v. a. Se dit d’une futaille neuve dans laquelle on passe du vin nouveau ou de la lie avant d’y mettre du vin vieux. - (10) |
| enviou (oure) : envieux - (39) |
| enviou (-ouse) (n. ou adj.m. ou f.) : envieux (-euse) - (50) |
| envioû : envieux - (48) |
| enviou, adj. envieux. - (17) |
| enviou, ouse, adj. envieux, celui qui a de l'envie, de l'ambition, qui a le désir passionné d'une chose. - (08) |
| envioureté. s. f. Envie. (Domecy-sur-Ie-Vault). - (10) |
| envioux, ouse. adj. Envieux. (Domecy-sur-le-Vault). — Du latin invidiosus. - (10) |
| envirai – tourner une chose autour d'une autre pour attacher. - Envire ceute corde qui âtor du bâton. - Pour ailai ai Cruchey enviretai bein in moché ator du co, cair en fait froid. - (18) |
| envirai, envirotai, envirements - étourdi pour avoir tourné sur soi, ou autour de quelque chose, ou par le travail du sang dans la vieillesse. - Montai su les chevaux de bô, ou bein ailai su ine balançôre, ci m'envirotte to de suite. - Ne tornez don pâ queman cequi en rond, ci vai vos envirottai. - (18) |
| envîré, celui qui sent que la tête lui tourne. - (16) |
| envirer et envirotter. Rouler une corde autour d'un axe, une ficelle autour d'un peloton. Chez les Romains, viria était un bracelet, qui vire autour du bras. Il doit y avoir la un radical primitif qui exprime l'action de tourner, de rouler. A Beaune nous appelons virette l'outil que le français appelle vrille : nous écrivons logiquement virebrequin et non pas vilbrequin. Virer signifie tourner, changer : les girouettes virent ai tous les vents C'est à Dijon qu'on a écrit le Virgile virai en bourguignon. Virot, étourdissement, d'où envirotté, homme ou animal qui a le virot, le vertige. Déviré est opposé à enviré ; c'est tourner en sens contraire. (V. Revirer.) - (13) |
| envirer, enviroter, enrouler. - (27) |
| envirer. v. n. Tourner sur soi jusqu’à l’étourdissement. (Annay sur-Serein). - (10) |
| en'viroler, v. a. entourer, envelopper en tournant, entortiller. - (08) |
| enviroter : enrouler. - (31) |
| envirtoler, v. tresser, entourer d'une corde d'un chiffon. - (38) |
| envirvocher, v. enlacer, entremêler. - (38) |
| envisagi : envisager - (57) |
| enviver, v. a. aviver, ranimer, rallumer. Le feu s'éteint « envivez-le. » - (08) |
| enviyer, v. tr., envoyer, faire partir. - (14) |
| envleupé, vt. envelopper. - (17) |
| env'ni (s') : rentrer chez soi - (43) |
| envni s' v. Venir. Envins-te dave ma. Viens avec moi. - (63) |
| envoigée : enjambée. O fait des bounes envoigées : il fait de bonnes enjambées. - (33) |
| envoïlli : Envelopper. « Ol a la main envoïlli », contraire devoïlli. - (19) |
| envoisiné : part, pass., avoisiné. - (20) |
| envôlé (s') : v. pr. S'envoler. - (53) |
| envölé, vt. envoler. - (17) |
| envorné - envourné : être étourdi. Sens physique. Ex : "J'ai fait un tour de cri-cri, jé r'descend, j'seus tout envorné !" (le cri-cri était un manège tournant vite constitué de sièges à une seule place suspendus par deux longues chaînes à la partie haute et tournante du manège - un peu casse-cou quand, en plus du mouvement, on se livrait à des fantaisies un peu acrobatiques). - (58) |
| envorne : Achillée millefeuilles (plante). III, p. 43 - (23) |
| envorne : mille-feuille - (60) |
| envornement, enviorn'ment. n. m. - Étourdissement. - (42) |
| envorner (v. tr.) : donner le tournis - (64) |
| envorner : étourdir. Ill, p. 43 ; III, p. 49-6 - (23) |
| envorner, enviorner, envourner, enviourner. v. - Être étourdi par un malaise ou par toute autre raison : « Cependant, je vois la tête d'oiseau de mademoiselle Aimée déjà envornée sur cette mince aventure et j'en suis un peu triste. » (Colette, Claudine à l'école, p.25) - (42) |
| envorner. v. a. Etourdir, faire tourner la tête. — S'Envorner. v. pronom. S’étourdir en tournant sur soi-même, en pirouettant. (Saint-Privé). - (10) |
| envortaïli : Enrouler. « La vollié s'envortaïlle après le chot », le liseron s'enroule autour du cep. - (19) |
| envorteiller, entortiller. - (05) |
| envorteilli : v. enrouler. - (21) |
| envouai (n’) : envoi - (57) |
| envouerger, v. a. allumer, embraser. S’applique au moment où le feu devient ardent, où le tison devient incandescent. Se dit aussi d'une plaie qui prend les caractères de l'inflammation. - (08) |
| envouinné (en-von-in-né), adj. très ardent au travail, à la course, etc. - (38) |
| envoûlé : envolé - (37) |
| envoulé : envolé. L'oujat s'o envoulée : l'oiseau s'est envolé. - (33) |
| envoûlée (n’) : envolée - (57) |
| envoûler (s’) : (s’) envoler - (37) |
| envoûler (v.t.) : envoler - (50) |
| envoûler : envoler - (57) |
| envoûler : envoler - (48) |
| envoûler : envoler. - (52) |
| envoûler : envoler - (39) |
| envoûler, v. n. envoler. - (08) |
| envourner (v.) : étourdir - (50) |
| envourner : donner le vertige, ennuyer - (60) |
| envoûrner : faire mal à la tête, aux autres personnes, à force de leur parler sans arrêt - (37) |
| envourner, enveurner : v. a., vx fr. envermer, rendre véreux. Au fig., ça l’envourne dans la tête, il a des étourdissements et comme des grouillements dans la tête. - (20) |
| envourtœlli, v. a. enrouler autour. - (22) |
| envoyer : v. a., renvoyer. - (20) |
| envreto-yi : enrouler - (43) |
| envyi : (vb) envier, avoir envie - (35) |
| envyi v. Envier, désirer. - (63) |
| enwöyi v. Envoyer. - (63) |
| enzambée : enjambée - (39) |
| enzamber : enjamber - (39) |
| enzeusser : se jucher - (39) |
| enziôler : Endêver. « Fare enziôler », faire enrager, tourmenter. « Ses ptiets la fiant bin enziôler », ses enfants la font bien enrager. - (19) |
| enzuter (v.) : mettre sous le joug lier les bœufs - (50) |
| enzuter, v. a. mettre sous le joug, lier les bœufs. De zu pour jou apocope de joug. (Voir : zu.) - (08) |
| éouter, éhouter, v. déchirer, découdre. - (38) |
| ep’ché (pour eb’ché, contraction d’ebe-ché, variante d’zbecqué). adi. Eclos. - (10) |
| épafauder : faire peur. Chasser les oiseaux,… avec un épouvantail : qui est un « épafaudiau d’ouyos ». - (62) |
| épailler : chasser, éloigner, poursuivre. - (62) |
| èpailler : (èpâ:yé - v. trans.) apaiser, calmer. - (45) |
| epâiller, v. tr., démarrer, éloigner une embarcation du bord : « L'barquôt touche tare ; épâille-le. » Un jour, nous allions pour entrer dans le bac, lorsque nous le vîmes trop loin pour l'enjamber. Alors nous entendîmes : « Qui'c'qui a donc épaillé ? » Se dit aussi dans le sens de poursuivre : « Attends, polisson ! j'm'en vas t’épailler. » - (14) |
| épailler, v., sortir rapidement. - (40) |
| épâilléte, s. f., rame pourvue d'une monture (chaple) en fer, pour pouvoir ramer assis dans le bateau. Sert-elle, de préférence, à épailler ? En tout cas, ce mot est bien le substantif du verbe. - (14) |
| épaillette : s. f., aviron. Dans le Lyonnais, l’ « arpaillette » est la rame de fond. - (20) |
| épaire : s. f., paire. - (20) |
| épairer. v. a. Apparier. De par, paris. - (10) |
| épaissou (n’) : épaisseur - (57) |
| èpaitné, ie, adj. a bout de forces, de pattes, après une longue course. - (17) |
| èpalantchi : transporter en un endroit sec le foin coupé dans un pré humide. - (21) |
| épalissade, s. f. palissade. Ce jardin est bien clos de braves « épalissades. » - (08) |
| épalogniau. s. m. Palonnier. (Subligny). - (10) |
| épancher d’I’iâ, v., uriner. - (40) |
| épanchi, v. a. répandre un liquide, l'épancher. - (24) |
| épandre, éparpiller (répandre). - (05) |
| épaneuilli : Détacher les épis de maïs (paneuilles) de leur tige épantation : Grande appréhension. - (19) |
| épaneûyi : (vb) défaire les épis de maïs - (35) |
| épanière : s. f., v. fr., appareil fait de deux perches horizontales et parallèles, suspendues au plafond et destinées à recevoir la provision de pain. - (20) |
| épanouiller, v, tr., dépouiller de leurs enveloppes les grappes de maïs (les panonilles). (V. Échailler.) - (14) |
| epantai (s') - s'effrayer, s'épouvanter ; être tourmenté, inquiet. - Pour ailai chez Mossieu le Curai, al à portant gros bon, eh bein an s'épante tojeur in pecho. - Ile â si porouse qu'ile s'épantero, i croi bein, s'il vio côre in chien devant lé. - (18) |
| épantau, s. m., épouvantail, mannequin planté dans les champs pour faire peur aux oiseaux. - (14) |
| épantaule, adj. inquiétant, tourmentant, fait pour surprendre en causant un certain effroi. - (08) |
| épanté (-e) (adj.m. ou f.) : étonné (-e), inquiet (-ète) - (50) |
| épanté (s'), v. r. se tourmenter à l'avance : ce travail difficile m'épante. - (22) |
| épanté : surpris, étonné - (48) |
| épante : s. f., épouvante. - (20) |
| epanté, celui qui éprouve de l'embarras à dire ou à faire une chose ; s'épanté, se troubler, s'effrayer devant une difficulté. - (16) |
| épanté, épenté : v. t. Appréhender. - (53) |
| épanté, part. passé. Étonné, inquiet : « i seu bin épanté d'aivouâ fé ç'lai. » - (08) |
| épante, s. f., peur, frayeur, épouvante. - (14) |
| épanter (s') - griver : épouvanter (s') - (57) |
| épanter (s') : se tracasser. (RDM. T IV) - B - (25) |
| épanter (s'), v. r. se tourmenter à l'avance : ce travail difficile m'épante. - (24) |
| épanter (s'), v., s’épouvanter, être surpris. - (40) |
| épanter (s’) - tremanter (se) : inquiéter (s') - (57) |
| épanter (s’) : épouvanter, s’inquiéter. Certains utilisent ce verbe selon son sens transitif direct : épanter la peur. Du bas latin expavantare. - (62) |
| épanter : apeurer, effrayer - (48) |
| épanter : épouvanter. - (66) |
| épanter : Inquiéter, épouvanter. « Je voudrais bin aller ma canfasser mâ i m'épante. T'épantes pas ! », ne t'inquiète pas ! - (19) |
| épanter : v. a., épouvanter. - (20) |
| épanter(s') : (s’épan:tè - v. pronom.) s'effrayer de quelque chose par anticipation, "s'en faire un monde". - (45) |
| épanter, épouvanter. - (05) |
| épanter, v. a. troubler, inquiéter, étonner. - (08) |
| épanter, v. épouvanter. - (38) |
| épanter, v. tr., troubler, épeurer, épouvanter : «Lu! l'taribe ! ô n'a épanté qu’les poules. » - (14) |
| épanter. Synonyme d'épouvanter.... - (13) |
| épanter. v. a. Syncope d’Epouvanter. Voir apanter. - (10) |
| épantiau : épouvantail. - (66) |
| épanto, épouvantail. - (26) |
| epantou : épouvantail. (REP T IV) - D - (25) |
| épantsi v. Epancher. - (63) |
| éparcevar, v. apercevoir. - (38) |
| éparchailli : disperser - (57) |
| éparchàyé, v. a. chasser bruyamment, avec de grands gestes, comme à coups de « parche » (perche). - (22) |
| éparchouâ-yer, v. semer, répandre. - (38) |
| épàrçu, et épôrçu, part., aperçu, entrevu. - (14) |
| épare (n.f.) : traverse en bois qui réunit les côtés d'une charrette (a.fr., esparre = barre) - (50) |
| épare : traverse (d'une barrière, d'un volet) - (48) |
| épare : (épâ:r' - subst. f.) lambourde, pièce de bois destinée à servir de support à des lattes, solives, etc. On parle des épares d' une barrière. - (45) |
| épare, s. f. traverse en bois qui réunit les côtés ou gouttereaux d'une charrette. Une « épare », des « épares. » - (08) |
| éparenne : barre de bois avec 2 crochets, fixée à la charrue maintenant l'écartement des traits - (46) |
| épariô : Sorbe. « Mige voir des épariôs pas meus a peu après t'echârras de sublier », essaie de manger des sorbes pas mûres et de siffler ensuite! - (19) |
| épariolé : Sorbier (sorbus domestica) « I a in greu épariolé dans manjardin ». - (19) |
| éparmé ; réparmé, faire peu de dépenses, ne pas manger d'une seule fois un mets, en conserver une part pour un second repas. - (16) |
| éparmi : Se dit des pommes de terre en robe de chambre ouvertes par la cuisson « Tes tapines sant totes éparmies ». - (19) |
| éparmifias (n.m.pl.) : éclairs de chaleur (Morvan-sud) - (50) |
| éparni (v.t.) : faire des éclairs - (50) |
| eparni, v. n. eclairer, faire des éclairs : « al éparni souen ozedeu », il éclaire souvent aujourd'hui. - (08) |
| éparnir : v. a., vx fr. espanir, épanouir, ouvrir. - (20) |
| éparnission (nom mascculin) : éclair. - (47) |
| éparnission, s. f. éclair, lumière de l'explosion électrique. - (08) |
| éparnissons (n.m.pl.) : éclairs de chaleur (Morvan-nord) - (50) |
| éparon, s. m. pièce de bois soutenant les ridelles d'un char. - (22) |
| eparpeuilli : éparpiller - (51) |
| éparpilli - écarbouilli – espadroilli : éparpiller - (57) |
| éparre : traverse d'un chariot - (39) |
| eparre. Apprendre. On dit aussi éprarre. - (01) |
| èpartyeu : s. f. écheveau. - (21) |
| éparveulés : cheveux décoiffés avec mèches en tous sens. (E. T IV) - C - (25) |
| èparvolé, vt. éparpiller ; dissiper ; mettre en fuite. - (17) |
| èparvölon, sm. isolé ; égaré ; perdu. - (17) |
| épassée, s. f., marche à grandes enjambées. - (40) |
| épassi : Epaissir. « Je cras bin qu'alle commache à épassi », je crois bien qu'elle est enceinte. - (19) |
| épassou : Epaisseur. « Je na sais pas si c'te (s'te) planche pourra sarvi alle n 'a guère d'épassou ». « Te te trampes de tote tan épassou », tu te trompes beaucoup. - (19) |
| épatau. Épouvantail pour les oiseaux. Congénère bourguignon, épontau. - (03) |
| épater et épanter. Épouvanter ; avec cette différence que le premier indique une frayeur causée par une surprise, tandis que le second implique une crainte morale raisonnée, et qui peut être mêlée de remords. - (03) |
| epater : v. t. Terme de bucheron pour casser la patte ou le pied d'un arbre avant de l'abattre. - (53) |
| épatie ou espatie. : Écheveau de fil (du latin partitionem, complément de partitio; rac. lat., partiari, diviser). L'italien spartire et le dialecte bourguignon espartir signifient séparer, diviser comme il convient à un paquet de fil à dévider. - (06) |
| epatie. Echeveau. « Deuz épatis », deux écbeveaux… - (01) |
| épatienter : v, a., impatienter. - (20) |
| épatraché, adj. se dit d'un animal, d'un bœuf principalement qui a les pieds meurtris, qui marche avec difficulté. - (08) |
| épatté, ée. adj . Etonné, surpris extraordinairement, de manière à perdre contenance, à n’en avoir plus de pattes. - (10) |
| épatter v. Couper les racines apparentes d'un arbre, le préparer pour la coupe à la cognée ou à la scie. - (63) |
| épattevoler (s') : Se dit des oiseaux, des poules en particulier qui enfermées ont peur et battent des ailes pour s'envoler et s'enfuir. - (19) |
| épaumé ou épaumi, étendu et ouvert comme la paume de la main. - (02) |
| épaumi - épanoui, tout fleuri. - Les peurnés, les cerilliers sont tot épaumis ; ci embaume, i tenons l'étai. - (18) |
| epaumi. Etendu comme la paume de la main. S’épaumi, s'ouvrir, s'étendre comme la paume de la main ; car il me parait plus naturel de tirer épaumi de paume, que de le prendre pour une corruption d'épanoui. - (01) |
| épaumi. : Étendu, élargi et ouvert comme la paume de la main. (Del.) - Paumée, dans une charte des franchises de Salmaise de 1265, signifie ce que peut contenir d'argent une main ouverte et étendue. - (06) |
| épaus, épausse. adj. Epais, épaisse. (Athie). - (10) |
| épaussir : chasser au loin. (S. T III) - D - (25) |
| épautré : expr. Étendre sans soin, coucher n'importe comment. - (53) |
| épave, ée. adj. Troublé, effrayé, épeuré. Du latin pavor. - (10) |
| épéche. Barrage momentané d'un ruisseau. Elles sont presque toujours établies de façon à circonscrire un creux dont on épuise l'eau afin de pécher les poissons plus facilement. - (13) |
| épeçi, v. a. couper en morceaux, pour l'utiliser, une pièce d'étoffe neuve, une planche. - (24) |
| èpèdiu, adj. éperdu. - (17) |
| epeigne. Épine, épines… - (01) |
| epeigne-veignette. Épinevinette. - (01) |
| épeille. s. f. Epingle. (Sacy). - (10) |
| épeinchi, v. u. répandre un liquide, l'épancher. - (22) |
| épenda : Hangar. « Remise dan ta voiture seu l'épenda ». - (19) |
| épène, épine. - (26) |
| éperau, éprau, s. m., sorbe, corme, fruit du sorbier, ou cormier. - (14) |
| épère, fruit du sorbier. - (27) |
| eperfanté : v. t. Effrayer. Épouvanter. - (53) |
| éperio : sorbe. (RDM. T III) - B - (25) |
| éperioté : sorbier. (RDM. T III) - B - (25) |
| èpèron, sm. tendue en planches ou en pierres minces qui sépare une grange d'une écurie ou d'un manège de battage. - (17) |
| épertie - écheveau ou échevette de fil. - Ile é portant tot emmôlai ceute épertie de fi qui. - Quand en pense qu'ine petiote épertie quemant que voiqui ci côte deux so ! - (18) |
| épertie. s. f. écheveau de fil, de chanvre. - (08) |
| épervier : s. m. Poser ou jeter l’épervier, locutions imagées qu'emploient les habitués des bords de la Saône comme synonymes de dégainer. Il semble qu'il y ait entre les deux locutions une nuance fondée sur la forme, plus ou moins en éventail, de la dégaillade. - (20) |
| épetit, s. m., appétit : « Voui, j'mainjons ben ; j'avons prou d'l’épetit. » - (14) |
| épétition, s. f. pétition, demande adressée aux autorités : « i va fére eune épétition. » - (08) |
| épeu : et puis. - (09) |
| épeù, et épi, loc. adv., et puis. Tantôt on écrit d'un seul mot, comme ici, tantôt on sépare l’é initial. - (14) |
| épeu, et puis ; è peu s'ki, et puis cela. - (16) |
| épeudre , épeillu, éclore, éclos. - (05) |
| épeuiller : éclore, épanouir. - (30) |
| épeuiller, v. éclore. - (65) |
| épeûiller, v. intr., éclore, en parlant de l'herbe qui sort de terre, des bourgeons qui se montrent. - (14) |
| epeuilli : éclore - (51) |
| épeuillî : éclore. À propos d’oisillons. - (62) |
| épeuilli, v. n. 1. naitre, pour un oiseau, un poussin. — 2. éclore, pour une fleur. — 3. v. a. détacher et envoyer au pâturage, pour du bétail. — 4. v. r. se lever de grand matin, pour une personne (du vieux français espelir. Latin expellere). - (24) |
| épeuilli, v. n. 1. Naître, pour un oiseau, un poussin. — 2. Éclore, pour une fleur. — 3. v. a. Détacher et envoyer au pâturage, pour du bétail. — 4. v. r. Se lever de grand matin, pour une personne. - (22) |
| épeuillir : v. n., vx fr. espelir, éclore, s'ouvrir, s'épanouir. Ne s'emploie qu'au propre, pour les animaux ovipares et pour les végétaux. - (20) |
| épeûler, v. tr., appeler : « Qu'é c'que t'as donc dans la caboche, de n'pas v'nî ? V'qui trente six foués que j’t’épeùle ! » - (14) |
| épeunâ (n.m.) : buisson épineux - (50) |
| épeunâ, s. m. buisson épineux, lieu rempli d'épines. - (08) |
| épeune (n') : arête - (57) |
| épeune (n.f.) : épine - (50) |
| épeune (n’) : épine - (57) |
| épeune : (nf) épine - (35) |
| épeune : épine - (43) |
| epeune : épine - (51) |
| épeune : Epine, menu bois dont les rameaux sont armés d'épines. « In fagueut d'épeunes ». Au figuré « In bochan d'épeunes », une personne hargneuse. - « Tiri eune épeune du pî à quèqu 'in », le sortir d'embarras. - (19) |
| épeune : épine, ronce - (48) |
| épeune : épine. - (32) |
| épeune : épine. - (52) |
| épeûne : épine. Désigne aussi une arête de poisson. - (62) |
| épeune : une épine sur le buisson ou la plante - (46) |
| épeune : épine. Une piqûre d'épine fait meau : une piqûre d'épine fait mal. - (33) |
| épeune biainche : aubépine - (48) |
| épeûne blanche : aubépine. - (62) |
| épeune blanche : aubépine - (39) |
| épeune n.f. Epine. - (63) |
| épeune noère : épine noire - (39) |
| épeûne noire : prunelier. Voir peurnale et pouloshe… et peurnaler, plossier et pouloshier. - (62) |
| épeune nouère : prunelier - (48) |
| épeune : épine - (39) |
| épêûne : n. f. Épine. - (53) |
| épeune, épine. - (16) |
| épeune, s. f. épine et en général tout ce qui a des piquants. - (08) |
| épeune, s. f., épine d'acacia ou de prunellier. - (40) |
| epeùne, s. f., épine. On applique aussi ce mot à la grosse arête de poisson. - (14) |
| épeune. Épine, se dit dans le sens d’arête de poisson. - (03) |
| épeune. s. f. Epine. (Domecy-sur-le-Vault). - (10) |
| épeuner, v. a. épiner, garnir d'épines ou de ; toute plante à piquants. On « épeune » un jardin pour écarter les poules, un arbre pour empêcher qu'on ne cueille les fruits. - (08) |
| èpeunne, èpinne, sf. épine. - (17) |
| épeuraison : s. f., vx fr. espeurissement, frayeur, épouvante. T' nous fais d' ces épeuraisons !.. - (20) |
| épeuran, ante, adj. ruisselant d'eau, mouillé jusqu'à ce que l'eau dégoutte : « al ô seilli d' l'eai tô épeuran », il est sorti de l'eau tout ruisselant. (Voir : épeurer.) - (08) |
| èpeurcer : approcher. - (52) |
| épeurcher. v. a. et n. Approcher. (Parly). - (10) |
| épeureau, s. m. egoût : les « épeureaus » d'un toit, d'un terrain, d'un canal d'irrigation. - (08) |
| épeurement, s. m. ecoulement de l'eau, égouttement des eaux qui filtrent à travers la terre ou qui s'échappent d'une rigole trop pleine. Les terrains inférieurs reçoivent les « épeuremens » des versants supérieurs. - (08) |
| èpeurer : égoutter - (48) |
| épeurer : v. a., effrayer, épouvanter. - (20) |
| épeurer, v. a. égoutter, faire sortir l'eau d'une matière fortement humectée ou mouillée. On « épeure » un fromage pour le faire sécher; on « épeure » une salade avant de l'assaisonner. - (08) |
| épeùrer, v. tr., épurer, faire sortir l'eau d'un objet mouillé, égoutter : « J'nous sons métues à l'tord'e, épeû j 'avons ben épeùré l’linge. » - (14) |
| épeuriau (n.m.) : corme, fruit du sorbier - (50) |
| epeûriau : fruit du sorbier - (37) |
| épeuriau, s. m. sorbe ou corme, fruit du sorbier ou cormier. - (08) |
| épeurieu : sorbe. (E. T IV) - S&L - (25) |
| épeurieux : n. m. Fruit du sorbier. - (53) |
| épeûyé, épeler, nommer, assembler les lettres. - (16) |
| épeuyer. v. a. Epeler, nommer les lettres qui composent un mot. (Annay-sur-Serein). - (10) |
| épeûyi : (vb) éclore - (35) |
| épeûyi : éclore - (43) |
| épi : s. m. èpi. - (21) |
| épialé : v. t. Dépecer. - (53) |
| epiâlé, dâpiaûté, dâpiâlé : qui a eu sa peau enlevée - (37) |
| epiâler, dâpiâler, dâpiaûter : enlever la peau d’un animal - (37) |
| épialer, dépecer. - (26) |
| épiarrer : ramasser les pierres dans les champs - (43) |
| épiât. s. m. Ouvrage facile, avantageux, parce qu’on le fait vite. Du latin eplere. Voyez éplet. - (10) |
| épiauler : enlever la peau - (39) |
| épiauter : même sens que le mot précédent - (39) |
| épiçi, v. a. couper en morceaux, pour l'utiliser, une pièce d'étoffe neuve, une planche, etc. - (22) |
| épidancer (pour pitancer, épitancer). v. a. Pourvoir une famille, un ménage, de tout ce qui est nécessaire à son alimentation en dehors du pain. — S’épidancer. v. pronom. Se pourvoir des aliments nécessaires pour manger avec le pain. — Epidancer, s’épidancer ! difficile problème que, chaque jour, doit s’ingénier à résoudre une mère de famille aux prises avec la misère. - (10) |
| épiéilli : appareiller (des animaux) - (57) |
| épiétai : faire vite au travail. - (33) |
| èpieu : s. f. : ailleurs. - (21) |
| épieuré, ée. adj. Eploré. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| épignière. s. f. Epinard. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| épiïer, v. intr., épier, monter en épi. - (14) |
| épilotteux. adj. Minutieux. (Etivey). — Dans le sens absolu, qui arrache les petits poils. De épiler, épilotter. - (10) |
| èpimbye : s . f. épingle. - (21) |
| ëpinasser : v. a., entourer d'épines, défendre, protéger. Oh ! c'te fille, y a pas de risque qu'on la prenne ; elle est trop bon épinassée. - (20) |
| épinché : v. t. Épandre, éparpiller. - (53) |
| épincher (pour épancher). v. a. Répandre, écarter. Epincher du fien. (Cravant). - (10) |
| épincher : épandre, étendre, éparpiller - (48) |
| épincher : (épin:ché - v .trans.) épandre (du fumier). Au fig. éparpiller. - (45) |
| épincher, v, répandre. - (38) |
| épincher, v. a. épancher, épandre, répandre. « Épancer. » - (08) |
| épinchi : épancher - (57) |
| épinchi : Répandre un liquide. « Ol a épinchi du lait su la traub 'lle (sur la table) ». « Epinchi de l'iau », uriner. - (19) |
| épine blanche, n.f. aubépine. - (65) |
| épine noire, n.f. prunellier. - (65) |
| épine, n.f. arête de poisson. - (65) |
| épine, n.f. épine ; plante épineuse ; lieu planté d'épineux. - (65) |
| êpine, subst. féminin : arête. - (54) |
| épiner (s'), se piquer aux épines. - (04) |
| épingale. s. f. Très-petit poisson à nageoires épineuses, qu’on trouve dans les ruisseaux, et qui nous semble être le même que l’épinoche, piscis aculeatus. - (10) |
| épinghiée : voir picasse - (23) |
| épingles (donner les). exp. - Donner la pièce. (Saints, selon G. Pimoulle) - (42) |
| éping'lle : Epingle. « Tiri san éping'lle du jû », sortir indemne d'une situation dangereuse. - (19) |
| épingne (n.f.) : épingle - (50) |
| épingne, s. f. épingle. - (08) |
| épingne. s. f. Epingle. (Domecy-sur-le-Vault). — Dans beaucoup de communes, épingle se prononce à l’italienne, on en mouillant le gl. - (10) |
| èpingö, sm. étui à épingles, à aiguilles. - (17) |
| épingue, et epiône, s. f., épingle. - (14) |
| èpingue, sf. épingle. - (17) |
| épingu'ye : épingle, pourboire - (48) |
| épiniâs : les épinards - (46) |
| épin'ille (n’) : épingle - (57) |
| épin-illes : arrhes. Pourboire : donner un pourboire à l'employé ou aux enfants en sus du prix convenu. Epingle à nourrice. - (33) |
| épin'illi : épingler - (57) |
| épinocher. v. n. Mander avec dégoût. Doit être le même que pinocher, qui a le même sens. - (10) |
| épiñye : (nf) épingle - (35) |
| épiñye n.f. Epingle. - (63) |
| épinye : épingle - (39) |
| épin-ye: épingle - (43) |
| épisson (n.m.) : barbe de l'épi des céréales - (50) |
| épisson, s. m. barbe de l'épi : « l'épisson » de l'orge, du seigle ; petit épi avorté. - (08) |
| épiter, v. a. épier, espionner. - (08) |
| épiter. v. n. Epier, monter en épis, en parlant des céréales. (Athie). - (10) |
| èpiuché, vt. éplucher. - (17) |
| épivacer, v. a. effrayer en dispersant. On dit qu'un troupeau est « épivacé » lorsque les animaux qui le composent s'enfuient de tous côtés sous l'impression de quelque panique. - (08) |
| epivasser : eparpiller - (60) |
| épivasser : faire l'excentrique. - (30) |
| éplâ : atteler et attelage. Fâre un’ éplâ : atteler, et travail derrière un attelage : un’ jornée d’éplâ .Voir L’inverse :déplâ. - (62) |
| éplayée. Journée de travail, long travail, travail soutenu. Etym. possible, déployer, dans le sens de prolonger, d'étendre, déployer ses forces, son courage. - (12) |
| ep'lè : appeler - on l'èpeule mais è n'vin pas, on l'appelle mais il ne vient pas - (46) |
| èpléillè : reculer le cheval dans le limon pour l'atteler - (46) |
| épléilli : mesure du temps de travail dans les champs (avec un cheval) - (46) |
| épléillie : une bonne journée de labour - (46) |
| éplet (avoir de l' ). n. m. - Adresse, habileté. - (42) |
| éplet. s. m. Habileté, promptitude, célérité dans le travail. Cet homme a de l’éplet. (Sommecaise). Du latin eplere. - (10) |
| éplétant. adj. Qui se fait vite. Ouvrage éplétant. (Villeneuve-la-Guyard). - (10) |
| épléter, épleuter. v. - Faire vite, travailler avec rapidité. - (42) |
| épléter, épleuter. v. n. Aller vite, avancer, fournir, abonder. Se dit en parlant de l’ouvrage, des récoltes. Eh ben, les amis? Ça va-t-il, la vendange? — Ah ! mon bon Monsieur, les raisins n’sont gué grous, et pis i gnien a gué ; ça n’éplète pas. Du latin eplere. - (10) |
| épléter, v. a. aller vite en besogne, avancer l'ouvrage, travailler lestement. - (08) |
| éplèuë, s. f., étincelle, point qui brille subitement. - (14) |
| épleûer, v. intr., étinceler, briller tout à coup. - (14) |
| épleumer, v. a. oter les plumes, la laine, et par extension la peau, l'enveloppe. - (08) |
| épleûte, s. f., grosse étincelle sortie du feu. - (40) |
| éplieurai - éploré, désolé. A peu prés le même sens que emplieurai ; celui-ci exprimant surtout l'air, celui-là surtout la réalité. - (18) |
| éplongé (s'), s'arranger... - (02) |
| eplonge. Eponge, éponges. - (01) |
| éplonge. s. f. éponge. - (08) |
| eplonge. : Eponge. - (06) |
| éplonger, v. a. éponger, étancher avec une éponge, un linge, etc. - (08) |
| éplougnot. s. m. Palonnier. (Sougères-sur-Sinotte). - (10) |
| épluai, épluant - étinceler. - Si vos saivain que c'éto joli !.. tot y épluot. - Les autels épluaint de lumières. - Tot y éplue ! - (18) |
| épluance. : Éclat. Adjectif provenant du substantif éplue, éclair, synonyme d' élaide. Ce dernier vocable n'a point de verbe comme épluai, qui signifie faire des éclairs, des étincelles, des aigrettes, comme on en voit dans les feux d'artifice. - (06) |
| epluante. Eclatante, brillante… - (01) |
| épluchi - pieumer – épiûchi : éplucher - (57) |
| éplue - étincelle. - Ine éplue veint de sautai su tai robe. - Vois don ces tas d'éplues autor de lai mairmite : i airons in choingement de temps. - (18) |
| éplue (n.f.) : étincelle - (50) |
| éplue : étincelle. - (29) |
| éplue ou épluie. Sorbe, fruit du sorbier. Etym. epluie s'est peut-être dit autrefois de divers fruits et n'est plus conservé que pour un seul ; dans ce cas sa formation serait e et l'allemand pflüchen, ôter en cueillant. - (12) |
| éplüe, éplute (C-d), épruye (Chal., Br.). - Petite étincelle du vieux mot éplue, espelue, épluettes, qui a la même signification et a fait le mot bluette appliqué principalement à un petit ouvrage spirituel et sans prétentions. Dans la Côte-d'Or éplute a le sens d'éclair. - (15) |
| éplue, et épluyé - sorbier et son fruit. - Vo m'é dit que vos eumains bein les éplues ; en airé de quoi vos régalai, les épluyés en sont chairgés. - (18) |
| éplue, étincelle qui jaillit du feu. - (16) |
| éplue, étincelle. - (26) |
| éplue, s. f. étincelle. - (08) |
| èplue, sf. étincelle ; flammèche d'incendie. - (17) |
| éplue. Pluie d'étincelles. Les enfants s'amusent bien souvent à faire jaillir d'un tison incandescent les milliers d’éplues qu'ils appellent des soldats. - (13) |
| epluein. Étincelions, étinceliez, étincelaient. - (01) |
| épluer, épluter, v. n. étinceler, faire des étincelles. - (08) |
| éplure : étincelle. (E. T IV) - C - (25) |
| éplute (nom féminin) : étincelle. - (47) |
| éplute : étincelle - (48) |
| eplute : étincelle. (C. T III) - B - (25) |
| éplute : étincelle. (E. T IV) - S&L - (25) |
| éplute : (éplu:t' - subst .f.) étincelle. - (45) |
| éplûté : 1 expr. Avoir chaud. - 2 v. t. Briller fortement jusqu'à éblouir. - (53) |
| éplute : étincelle. (RDM. T IV) - B - (25) |
| éplute, s.f. étincelle. - (38) |
| éplute. Eclair. Mot voisin de ébelouir (voir éberluter), et de l'allemand beuleutchen, qui veut dire éclairer par la lueur des éclairs. - (12) |
| éplûter : faire des étincelles, des éclairs - (48) |
| épluter, épluer (v.t.) : étinceler - (50) |
| épluter, v. faire des étincelles. - (38) |
| éplûter, v., faire des étincelles, bruyamment. - (40) |
| éplutes : étincelles. (RDC. T III) - A - (25) |
| éplutes, n. fém. plur. ; étincelles. - (07) |
| éplutsi v. Eplucher. - (63) |
| ép'ner : Entourer d'épines. « J'ai ép’né man pommé (mon pommier) ». - (19) |
| épo : Féminin épaisse. Epais. « In matelas bien épo ». - Trouble. « Tan vin est bien épo, y a autant à migi qu'à boire ! ». - Dense, nombreux « Des ovrés c 'ment liume y en a pas bien épo », les travailleurs comme lui sont rares. - (19) |
| épô, epôs : adj. Épai, épaisse. - (53) |
| époedriger : effaroucher les volailles. (T. TIV) - Y - (25) |
| épœnéchi, v. a. protéger avec un entourage d'épines. Se dit particulièrement pour un jeune arbre. - (24) |
| épœnéssi, v. a. protéger avec un entourage d'épines. - (22) |
| épœtœvéssi (s'), v. r. s'agiter bruyamment au cours d'une discussion. - (22) |
| épòfer (s'), v. pr., s'épouffer, pouffer : « O disôt tant d'bétises, que j'nous épòfions d'rire. » - (14) |
| époffai (s') - s'étouffer : essouflé d étonnement. - A nos en é contai, qui en époffains de rire. - Eh bein, quoi don ! vos é l'air époffai ! - (18) |
| épôffai (s'), s'esquiver; s'époffai dequart, s'esquiver de côté ou par derrière... - (02) |
| epôffai (s'). - (Pat.), s'épouffer (dial.) ; racine latine expavere, s'esquiver, se sauver pour cause de frayeur. - (06) |
| epogne : variété de gâteau cuit au four. A - B - (41) |
| épogne : (nf) pain-gâteau - (35) |
| épogne : Pain fait le dernier et qui est généralement plus petit que les autres. - « Va dan commander au fo, t'aras l'épogne » invitation à un donneur de conseils dont on cherche à se débarrasser. - (19) |
| épogne : petit pain. III, p. 19-k - (23) |
| épogne : tarte. (C. T IV) - S&L - (25) |
| epogne : variété locale de gâteau cuit au four - (34) |
| épogne : variété locale de gâteau cuit au four - (43) |
| épogne n.f. (p.ê. de pogne, poigne) Gâteau cuit au four. - (63) |
| épogne, n.f. petit gâteau fait avec des restes de pâte. - (65) |
| épògne, s.f. pain rond. Diminutif pognon. - (24) |
| époigne : voir épogne - (23) |
| époigne, épogne (n.f.) : petit pain - (50) |
| époigne, s. f. petit pain, galette, gâteau de forme arrondie. - (08) |
| epoiller : répandre partout - (44) |
| époinchai : écarter (étendre le fumier dans les champs). - (33) |
| époinché, épancher. - (16) |
| époincheu : séparer, écarter. - (29) |
| époinser : épandre (du fumier) - (39) |
| épointe, s. f. pointe, le bout d'une chose. — clou cylindrique et allongé avec ou sans tête. - (08) |
| épointiau (pour pointau, une des formes de pointai). Pieu, poteau. — S’emploie, figurément, dans cette phrase : Siète-te, et n’reste pas là drait debout coume un épointiau. - (10) |
| époirer. v. a. Epeurer, épouvanter. (Etivey). - (10) |
| époiriot, épouquiot. s. m. Epouvantail, fantôme pour faire peur aux petits oiseaux. — Se dit pour épeurot et pour épouvantiot, épouvanteau. (Argenteuil). - (10) |
| epoise. Apaise, apaises, apaisent. - (01) |
| epoisé. Apaiser, apaisez, apaisés. - (01) |
| époitir, époutir. v. a. Aplatir, écraser. Tais-te, ou j’ t’époitis le nez. - (10) |
| époitir. v. - Éclater, exploser : « Et s'fourront jusqu'à époiti d'la tête de viau et du routi. »(Fernand Clas, p.142) - (42) |
| epôlôgie. Apologie… - (01) |
| épômòner (s'), v. pr., s'époumoner, trop parler, crier tort. - (14) |
| épondre, v. atteindre, joindre. - (38) |
| épondre. v. a. Elargir, rallonger ; nouer un fil à un autre. (Migé, Montillot). - (10) |
| épongi : éponger - (57) |
| éponicher (S’). v. pronom . S’accroupir, s’affaisser sur soi-même. (Sénonais). - (10) |
| èponté, vt. épouvanter. - (17) |
| eponte. Effraie, effraies, effraient. Eponle vient d'épouvante. Un épontau c'est un épouvantail… - (01) |
| éponter, effrayer... - (02) |
| èponton, sm. épouvantail ; personne d'aspect repoussant. - (17) |
| épôrai - effrayer, épouvanter. - En me disant cequi, vos m'é éporai. - En fau dire qu'a s'épôrant pou dière. - (18) |
| éporer (S'). Prononciation patoise d'épeurer ; avoir peur. T'ai mis ton cotillon rouge : not' viâ vai s'épôrer. L'adjectif peureux se prononce pouèrou dans le patois du Morvan. - (13) |
| éporigné. Mal peigné. Ce mot vient peut-être du latin porigo, crasse de la tête. - (13) |
| eporsevoi. : Apercevoir, part. passé éporsu. - (06) |
| eporsu. Aperçu. I m’éporsu, je m'aperçus ; i me seù éporsu, je me suis aperçu. - (01) |
| épôrter, v. tr., apporter. - (14) |
| épôs(osse) : épais - (39) |
| épos, éposse (adj.m. et f.) : épais, épaisse - (50) |
| épôs, éposse : épais, épaisse - (48) |
| épos, éposse : (épô:, épos' - adj.) épais. - (45) |
| épôs, éposse, adj. épais, épaisse : un bois « épôs » ; une bouillie « éposse. » - (08) |
| épôs, ôsse, adj., épais, lourdaud. - (14) |
| épôsé : Epoux, marié. « Les épôsés », nom que l'on donne aux nouveaux mariés pendant les jours de noces seulement. - (19) |
| épôseriau : Nouveau marié. - (19) |
| épossi (v.t.) : épaissir - (50) |
| épossi : épaissir - (39) |
| épôssi, v. a. épaissir. On « épossit » une sauce avec de la farine. - (08) |
| epôssî, v. tr., et intr., épaissir, prendre du corps. - (14) |
| épossir : épaissir - (48) |
| épostrofler. v. a. Troubler, interloquer. (Soucy). - (10) |
| epotai. Apporter, apporté, apportez. - (01) |
| épotalets, s. m., hautes échasses : « Ol é fin hébile ; avon ses épotalets ô côrt tôt cment d'avou ses pieds. » - (14) |
| epote. Apporte, apportes, apportent. - (01) |
| époter, apporter. - (26) |
| épôti, faire cuire au pot. Viande épôtie, c.-à-d. cuite au pot. - (02) |
| epôti. Laisser longtemps cuire au pot quelque viande que ce soit, en sorte que, comme on dit, elle en soit pourrie à force de cuire : « Lé poi son bon quant ai son bén épôti »… - (01) |
| epôti. : Laisser bien cuire au pot quelque viande ou quelque légume. « Lé poi son bon quan ai son ben épôti. » (Dial.) - (06) |
| épotsi v. Vider (ses poches). - (63) |
| epouairigné : v. t. Dépeigné, chevelure hirsute. - (53) |
| épouantaule, adj. qui est sujet à prendre peur, à s'épouvanter. On dit d'un cheval qu'il est « épouantaule » lorsqu'il est ombrageux. - (08) |
| épouchi : apeuré. (MM. T IV) - A - (25) |
| epoudrailli : éparpillé. A - B - (41) |
| epoudrailli : éparpillé - (34) |
| époudriller : répandre de tous côtés. (RDM. T IV) - B - (25) |
| epoudrîller, âpoudrîller, époutrâiller, âpoutrâiller : répandre, disperser - (37) |
| épouéri : effrayé, apeuré. Les animaux sauvages sont épouéris : les animaux sauvages sont effrayés. - (33) |
| épouéri, v. a. causer de la peur, effrayer. - (08) |
| épouèrigné : (épouèrigné - adj.) ébouriffé, dépeigné. - (45) |
| épouerir (r ne se prononce pas). v. a. Appauvrir. - (10) |
| épouffer (s'), v., se dit des poussins qui se secouent dans le sable ou la cendre. - (40) |
| épougne, s. f. pain rond. Diminutif : pougnon. - (22) |
| épougne, s. f. petit pain rond. - (08) |
| épougne, s.f. pain rond comme le poing (envier ine épougne "envoyer une épougne"). - (38) |
| épougnotte : voir épogne - (23) |
| épougnotte, s. f. petit pain. Diminutif d’épougne. - (08) |
| épouïer, v. a. épuiser. se dit en parlant d'un liquide qu'on extrait d'un creux, d'une fosse, d'une carrière, etc. (Voir : pouïer.) - (08) |
| épouiller ou, plutôt, épouyer (S’). v. pronom. Mauvaise prononciation de s’appuyer. - (10) |
| épouilli – pûilli : épouiller - (57) |
| époulevâdai - chasser avec vigueur et en dispersant.- Vote chien é époulevâdai nos poules. - Aitand-voué qui t'époulevâde to cequi mouai ! - (18) |
| époulvarder : épouvanter en s'éparpillant - (39) |
| époulvauder (v.t.) : mettre en fuite (en parlant des volailles) - (50) |
| époulvauder, v. a. effrayer, mettre en fuite, chasser. - (08) |
| époulvôder (s') : se sauver dans tous les sens - (48) |
| époulvôder : faire fuir, disperser - (48) |
| epouni (s'), v. réfl. s'épouvanter, s'emporter à la suite d'une frayeur subite : « mon ch'vau s'ô épouni. » - (08) |
| épouni(e) : apeuré(e) - (39) |
| épounu, participe passé de "épondre". - (38) |
| épourci (v.t.) : effrayer, épouvanter - (50) |
| épourci, v. a. effrayer par surprise, épouvanter. - (08) |
| épourciaule (adj.m. ou f.) : sujet à s'effrayer - (50) |
| épourciaule, adj. sujet à s'effrayer : ce cheval est fort « épourciaule. » - (08) |
| épourcissement, s. m. frayeur subite, panique. - (08) |
| épouré : apeuré - (43) |
| épouri (pour épeurir). v. a. Faire peur. I m’è épouri, il m’a fait peur. (Argenteuil). - (10) |
| épouri, adj. ; épouvanté. - (07) |
| épourigné, ébouriffé. - (28) |
| épourigné, échevelé, ébouriffé surtout en parlant des femmes. - (27) |
| épournifler : postillonner en injuriant, en éternuant, et autres « embruns » du genre: des épournifleûrs. - (62) |
| époursi : apeuré, épouvanté - (48) |
| épourter, v. apporter. - (38) |
| épourter. v. - Apporter. - (42) |
| épousnaillé : 1 v. t. Dépoussiérer. - 2 v. pr. Se faire expulser. - (53) |
| époussonner : Enlever les germes (les poussons). « Epoussonner des tapines (pommes de terre) ». - (19) |
| époussóter, v. tr., épousseter légèrement. - (14) |
| époustaler, v. tr., chasser, pourchasser : « Qu'é c' que t' fais iqui, ch'ti crapiau ? Attends, j'vas t’époustaler. » - (14) |
| époutager, être en bon état ; maul époutagé : "mal fichu, abîmé". - (38) |
| épouter : Ecraser avec les doigts. « Epouter eune greume de raijins ». - (19) |
| épouter. v. a . Ecraser, broyer. Voyez époitir. - (10) |
| époutevasser : v., a., ahurir. - (20) |
| époutevéchi (s'), v. r. s'agiter bruyamment au cours d'une discussion. S’effrayer, se tourmenter de peu. - (24) |
| époutî : écrabouiller. On dit aussi écapoutî pour accentuer la notion d’écrasement. Voir : écapouti. - (62) |
| épouti v. (or. inc.) Ecraser. - (63) |
| épouti, v. tr., écraser, aplatir : « J'ni'é épouti l'dèt d'avou mon martiau. » - (14) |
| époutie, pommes de terre écrasées en purée (plur.). - (28) |
| epoûtir, âpoutir, équarpoutir, âquârpoutir : écraser - (37) |
| époutir, v. écraser. - (38) |
| époutir, v., écraser, aplatir. - (40) |
| époutir. - Voir plus haut : Apoutir. - (15) |
| èpoutir. Aplatir, écraser. - (49) |
| époutir. Écraser. - (03) |
| époutis. s. m. pl. Litière, ordures des animaux réduits en menus brins, en poussière. - (10) |
| époutrailler. Ébouler, affaisser. - (49) |
| epouzai. Epouser, épousé, épousez. - (01) |
| éppéégue : n. f. Épingle. - (53) |
| eppendige. s. m. Appentis. (Athie). - (10) |
| eppopinier. v. a. Dodeliner, bercer dans ses bras pour endormir. Du latin pupus, et du vieux français popin, popine, poupon, pouponne. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| èppotchè : apporter - (46) |
| èpprenre : apprendre - (46) |
| èpprôtè : apprêter - (46) |
| epran : cheville fichée dans une paroi. A - B - (41) |
| epranti. Apprenti, qu'on ferait mieux de n’écrire jamais apprentif ; car, puisqu'on ne dit plus au féminin ni apprentive, ni apprentisse, mais uniquement apprentie, qui ne peut se former que du masculin apprenti, pourquoi écrire apprentif, dont on est obligé de convenir que l’f ne se prononce point ? - (01) |
| épràs, prép., après : « O s'é métu dans eùne jolite afâre ! Epras c'qui, qu'é-c'qu'ô va d'venî ? » - (14) |
| éprâter, et eprôter, v. tr., apprêter, disposer, préparer. - (14) |
| éprau, s. f., sorbe. - (40) |
| épraÿ, s. m., sorbier. - (40) |
| eprée : prép. Et adv. Après. - (53) |
| éprende, v. tr., apprendre, enseigner. - (14) |
| éprendre : apprendre. - (62) |
| eprenein. Apprenions, appreniez, apprenaient. - (01) |
| éprenne, barre de fer servant à fixer les traits pour tirer une charrue. - (28) |
| eprère : portion de surface plane sur un côteau. (RDM. T IV) - C - (25) |
| epréte. Apprête, apprêtes, apprêtent. - (01) |
| epreti. Apprêtai, apprêtas, apprêta. - (01) |
| épreuchan, environ, è-y-en-é èpreuchan dix, - (16) |
| épreuché, approcher ; épreuche, vers ; ëz êpretiche de Noë, vers Noël. - (16) |
| épreuilles, étincelles. - (05) |
| épreune : épars de charrue. - (31) |
| épreupi, rendre propre, nettoyer. - (16) |
| épreupriyé, s'épreupriyé, s'approprier une chose. - (16) |
| epri. Appris. Bén épri, bien appris, honnête, civil… - (01) |
| epri. : Participe passé du verbe eprarre (apprendre), ayant ici un sens passif ; car el a bén épri signifie il est bien élevé. - (06) |
| éprieux, sorbier. - (05) |
| éprimer (v.t.) : imprimer - (50) |
| éprimer, v. a. imprimer. - (08) |
| épris, adj., appris, élevé, en parlant d'un enfant, d'une personne : « Ol é, ma fi, bon épris ; ô dit bonjor à tôt l'monde. » - (14) |
| éprivé, s. m. épervier, filet de pèche. - (08) |
| épròche, s. f., approche. - (14) |
| eprôche. Approche, approches ; soit que ce soit un verbe, soit que ce soit un nom. - (01) |
| épròcher, v. tr., approcher. - (14) |
| éprochî : approcher. - (62) |
| eproo ou eprò. Apprêt, apprêts. - (01) |
| éprôpri, v. tr., approprier, tenir propre, nettoyer. - (14) |
| èpröre, éprère, sm. portion de surface plane dans un pré en coteau. - (17) |
| épros, s.m. sorbe. - (38) |
| éprôté, apprêter ; s'éprôté, se préparer à dire ou à faire une chose. - (16) |
| éprôter. v. a. Apprêter. (Soucy). - (10) |
| éproue : sorbe. (CLF. T II) - D - (25) |
| èproue, sf. fruit de l’éprouer. - (17) |
| èproué, vt. épierrer (un sol). - (17) |
| èprouier, èprouer, sm. cormier (sorbus domestica). - (17) |
| éprousse, hâte, diligence. Dans la langue d'Oïl on dit approusse ; en latin ad proximum, au plus proche. - (02) |
| éprouver : v. a., accuser un défaut ou masquer une qualité (au physique). Le jaune éprouve les blondes. - (20) |
| eprôvai. Éprouver, éprouvé, éprouvez. - (01) |
| éprûe, sorbe domestique, épruyé, sorbier. - (16) |
| éprue. Étincelle. (Prononcez épruye). Du vieux mot éplue. - (03) |
| éprûïe, et eprùle, étincelle. Quand on tisonne la bûche, on en fait sortir des « éprûïes. » - (14) |
| épruleû, s. m., fruit du sorbier. (V. Épereau.) - (14) |
| épru-yé, s.m. sorbier (forme ancienne : épru-yaille). - (38) |
| épsiner (s'), v., se dit des volailles qui s'enfuient dans tous les sens. - (40) |
| épter. v. a . Apporter. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| épudre : Eclore. « Les ûs que la pouleille nare groue ne voulent pas tarder d'épudre ». - Epier, en parlant des graminées. « Les bliés commachant à épudre ». vieux français, espolier, faire éclore. - (19) |
| épu-ier, v. sortir de l’œuf. - (38) |
| épuillé : Eclos. « Ces ûs sant épuillés ». - (19) |
| epuilli : éclos. A - B - (41) |
| épû'illi : éclore - (57) |
| èpuilli : v. 1° faire sortir les bêtes de l'écurie. 2° éclore (en parlant des oiseaux et des fleurs). - (21) |
| épuïlli v. (du lat. expellere, pousser au dehors) Eclore. - (63) |
| épurer, Nous employons ce verbe dans son sens propre. Il signifie faire sortir un liquide d'un linge, d'une éponge, ou même d'une préparation culinaire. Epure les torchons aivant de les fare choicher sur le guernier. — Jeutte tes z’haricots dans eune passoire pour les fare épurer. C'est l'origine du mot purée. - (13) |
| èpusé, vt. épuiser. - (17) |
| épuyé, appuyer. - (16) |
| épûyer, v. intr., éclore. Ne se dit qu'eu parlant des œufs d'oiseaux. (V. Épeùiller.) = - (14) |
| épû-yer, v., éclore (poussins). - (40) |
| epuyi : éclore - (34) |
| épuza-yer : chasser, faire partir - (43) |
| épuzäyi : (vb) chasser, faire partir - (35) |
| épyé, chercher à surprendre un malfaiteur. - (16) |
| ëpyé, se mettre en épis ; l’biè à-t-ëpié, le blé est en épis. - (16) |
| épyeûtsi : (vb) éplucher - (35) |
| equaignards (avoir les) : expr. Avoir mal aux mollets de trop marcher. - (53) |
| équairmoiller, v. a. écraser, broyer. - (08) |
| équairteure, s. f. endroit à l'écart, éloigné d'un centre. - (08) |
| équand. adv. et conjonct. Quand. - (10) |
| équârie, s. f. pierre ordinairement massive et de forme carrée qu'on place à l'entrée d'une cour ou d'un champ pour y attacher la barrière. - (08) |
| équarquillé, faire un écart, écarter les jambes... - (02) |
| équarre : Equerre. « Eune équarre d'arpentou ». - (19) |
| équarrer : v. a., vx fr. escarrer, équarrir. - (20) |
| équarri : Pierre d'angle d'une construction. - (19) |
| équarri n.m. Grosse pierre d'angle, dans une construction. - (63) |
| équarri v. 1. Travailler une pièce de bois pour lui donner une section carrée. 2. Fig. Tins-te tranquille obin t'vas t'faire équarri, gredin ! Tiens-toi tranquille sinon on va te mettre la tête au carré, gredin ! - (63) |
| equarri : s. m., vx fr. escarrie (f.), angle droit formé par deux surfaces. L'équarri d'un mur, d'une maison, d'une poutre. - (20) |
| équarrie (n.f.) : pierre à base carrée, à l'entrée de la cour, servant à fixer la barrière d'entrée - (50) |
| équarrie : pierre d'angle - (48) |
| équasiller (s'), se disloquer le bassin (le quasi) lors d'un vêlage. - (40) |
| equaûcher, âqueûcher : enlever les cuisses d’un animal - (37) |
| équauder : enlever la queue - (48) |
| equaussé : v. t. Élancer. - (53) |
| équefiller, écosser. - (26) |
| équeillâtre, adj. se dit d'une personne qui n'a pas le sens droit, qui se trouve sur la limite de la démence et de l'idiotisme. Cet homme ne sait ce qu'il fait, il est tout « équeillâtre. » - (08) |
| équeillon : houx - (39) |
| équeilvatran (en) :jeté pêle-mêle. (RDM. T IV) - B - (25) |
| équêlie. s. f. Désordre. (Nailly). - (10) |
| equené (equ'né), équoiné : adj., épuisé, usé, vanné et vidé (au sens argotique). J' veux m' marier avec un bel homme ; j’ veux pas d'un équené. - (20) |
| équené adj. (du vx.fr. équené, échiné) Epuisé, usé, vanné, vidé. Dzuer au pouce équené loc. Se dit au jeu de billes lorsqu'on tient sa bille dans la concavité formée par les trois phalanges de l'index. - (63) |
| équené, adj. malingre. - (24) |
| équeni. adj. Fané, flétri. Du raisin équeni. — Maigre, décharné, sans force, épuisé. Ah! mon pouv’ équini, siète-te, t’es ben las. (La Gelle-Saint-Cyr). - (10) |
| équênya : courbature. (E. T IV) - S&L - (25) |
| équercio. n. m. - Petit enfant chétif.(Arquian) - (42) |
| équernot. s. m. Voyez échouétot. - (10) |
| équeu et écuit vient peut-être du latin coctus, cuit. Etre équeu c’est avoir, par suite de la chaleur et d'une longue marche , des rougeurs et des écorchures dans la partie du corps où il y a le plus de frottement. Cette indisposition, peu dangereuse, se dissipe par une application de saindoux et du repos. - (13) |
| équeuble, équieuble, étieuble. s. f. Eteule, chaume laissée sur pied. Du latin stipula. - (10) |
| équeucher (s'), se taper sur les cuisses - (36) |
| équeucher (v.t.) : diviser, séparer en deux - (50) |
| équeucher : écarter, fendre, prendre une bouture, terminer un labour par des raies incomplètes - (48) |
| équeucher : ( ékœché:) 1 – (v. trans.) fendre une branche en écartant deux rameaux. 2 - (v. intr.) labourer une « hâte » en décrivant une spirale centripète 1 sens contraire des aiguilles d'une montre, de façon à rejeter la terre du côté de la haie (le versoir situé à droite de la chareru ); cela a pour effet de creuser le milieu. - (45) |
| équeucher : se dit d'une branche qui casse - (39) |
| équeucher, geste de se taper sur les cuisses - (36) |
| équeucher, v. a. diviser, séparer en deux parties, écarteler. (Voir : queuche.) - (08) |
| équeucher. Casser, briser en tirant violemment.. - (03) |
| équeucher. v. a . Casser une branche à l’endroit où elle tient à l’arbre. Du bas latin ecaudare . (Chablis). — Equeucher des noix, les détacher de l’arbre, les abattre, les gauler. - (10) |
| équeuchette (n.f.) : morceau de bois en forme de fourche (aussi équeuchie) - (50) |
| equeuchie : n. f. Point de départ, jonction de deux hanches. - (53) |
| équeuchie : séparation de 2 branches sur un pied de bois - (39) |
| équeudre : chasser vivement à coups de baguette : « équeudre les vaîches ». - (62) |
| équeuillé, s. m. tas d'ordures, amas d'épluchures, de débris, de déchets de toute sorte. - (08) |
| équeuillerot. s. m. Ecureuil. (Rugny). - (10) |
| équeuilles, s. f. balayures, ordures, épluchures. - (08) |
| equeûlé, âqueûlé : effondré, abattu - (37) |
| équeuler (s’) : s’accroupir. - (62) |
| équeuler (s’) : s'accroupir. (R. T IV) - Y - (25) |
| equeûler (s’), (s’) âqueûler : (s’) effondrer, (s’) abattre à terre - (37) |
| équeuléson : mal venu d'une couvée ou même d'une famille. (R. T IV) - Y - (25) |
| équeume (n.f.) : écume - (50) |
| équeume : écume - (39) |
| équeumer : écumer - (48) |
| équeumer : écumer - (39) |
| équeurché, v. accrocher. - (38) |
| équeurer : faire de la rame, émonder une branche - (39) |
| équeurer, v. a. curer, nettoyer, élaguer. - (08) |
| équeurio (éguerriou) : rouquin(ne) - (39) |
| équeurjou. Très-sale. Congénère bourguignon, aiceurjou. - (03) |
| équeurlou, s. m., grand sécateur à manche pour les grosses tailles de la vigne. - (40) |
| équeurvisse (n.f.) : écrevisse - (50) |
| équeurvisse : écrevisse - (48) |
| équeurvisse, s. f. écrevisse. - (08) |
| équeuté : adj. Éculé. - (53) |
| équeuter (en) : avoir très chaud, suffoquer. - (56) |
| équeuter : enlever la queue - (48) |
| équeuter. (S’). v. pronom. S’accouder. Rugny). Sans doute pour s’équeuder. - (10) |
| equeville. Balayures. Equeville, quoique sans s finale est toujours pluriel... - (01) |
| equeville. : Balayures. - (06) |
| equevilles : s. f. pl., bas-lat. scobillæ, ordures, balayures. - (20) |
| equevilleur : s. m., boueur, ramasseur d'équevilles. - (20) |
| equevillon : s. m., boite à ordures. - (20) |
| équéyoux (n.m.) : houx (Nivernais) - (50) |
| équi, iqui. adv. Ici. - (10) |
| équia : éclat (morceau de bois) - (48) |
| équia, s. m. éclat : un « ékia » de bois. - (08) |
| équiâder, v. a. éclater, mettre en éclats. « échialer, équialer. » « équiâder » une bûche, c'est la fendre, la mettre en morceaux. - (08) |
| équiair (n.m.) : éclair - (50) |
| équiair : un éclair - (46) |
| équiaircie (n.f.) : éclaircie après un orage - (50) |
| équiaircie, s. f. éclaircie dans le ciel, dans un bois, etc. - (08) |
| équiairer (v.t.) : éclairer - (50) |
| équiairer, v. a. éclairer, répandre de la clarté. - (08) |
| équiâlè : éclaté (bois) - (48) |
| equialé : v. t. Fendre. - (53) |
| équiâler : bois qui se fend - (39) |
| équialle, écuelle. - (05) |
| equiar (nom féminin) : éclair. - (47) |
| equiarcie (nom féminin) : éclaircie. - (47) |
| équiârè : éclairer - (46) |
| équiâs : éclats de bois - (39) |
| équicher : pousser des cris de joie. - (30) |
| équiercie : une éclaircie - (46) |
| équiercir : éclaircir - (48) |
| équièrer : éclairer , faire voir clair, faire des éclairs - (48) |
| équiéte, s. f. inquiétude : « al ô en équiéte », il est inquiet. - (08) |
| équiéteude, s. f. inquiétude. - (08) |
| équieule, s. f. écuelle. Env. de Lormes. (Voir : écuelle, étuelle.) - (08) |
| équiller, v. a. écurer une marmite ou autre ustensile du même genre. - (08) |
| équiller. v. - Étriller. (Saint-Martin-des-Champs, selon M. Jossier) - (42) |
| équiller. v. a. étriller. (Saint-Martin-des-Champs). - (10) |
| équinger. v. a. Rogner la vigne pour la seconde fois. (Merry-la-Vallée). - (10) |
| équinjue, équingeure. s. f. Rognure de vigne. (Merry-la-Vallée). - (10) |
| equior' : v. i. Éclore. - (53) |
| equiou : adj. Éclos. - (53) |
| équioupi, ie. part. prés. et adj. Accroupi. (Arcy-sur-Cure). - (10) |
| equioure : éclore. - (33) |
| equipaige. Equipage, équipages. - (01) |
| équipaize (n.m.) : équipage - (50) |
| équiper, verbe intransitif : former des équipes. - (54) |
| équiter, v. tr., acquitter, tenir quitte. - (14) |
| équiu. s. m. Ecu. (Dillo). - (10) |
| équiude. s. f. action d'étudier, d'apprendre une leçon. - (08) |
| équiuder, v. a. étudier. - (08) |
| équivalouair : équivaloir - (57) |
| équoeur, écœur. s. m. Cœur du bois. Du bois d’équiœur. De l’écœur de chêne, etc. - (10) |
| équouasser : dégarnir - (48) |
| èquouauder : (ècouô:dè - v. trans.) attacher un cheval à la queue d'un autre, pour éviter qu'ils ne se séparent quand on veut les faire transiter d'un endroit à un autre. - (45) |
| équouauder : (écouô:dè - v.tr.) effaner les légumes. - (45) |
| équouauder : équeuter - (39) |
| equouessé : v. t. Ébrancher. v. pr. Se faire battre. - (53) |
| èquouria : écureuil - (48) |
| er. : C'est une loi du patois bourguignon de ne pas prononcer l'r final des verbes de la 1re conjugaison, c'est pourquoi il a substitué à cette terminaison celle en ai ou celle en é simple : il dit, par exemple, s'epôffai au lieu de s'epoffer, palai au lieu de parler, éborgé (Lam.) au lieu de éborger, etc. - La finale de l'infinitif é dispensait d'une prononciation vicieuse qu'on rencontre encore de nos jours et à laquelle Génin faisait une rude guerre : ainsi, aimer sonne aimerre, comme éborger éborgerre dans la bouche de certains (voir au mot ir). - (06) |
| er’né, ée (pour érèné, arèhé). adj. Couvert d’arène. - (10) |
| èrabje, sm. érable. - (17) |
| érâfier : érafler - (48) |
| érageou, s.m. arracheur. - (38) |
| érager, v. arracher. - (38) |
| èrâgner : (èrâ:gné - v. tr.) houspiller les animaux de traits, si besoin à l'aide d'une trique. Au fig., malmener quelqu'un. - (45) |
| éragner. v. a. Toucher. (St-Germain-des-Champs). - (10) |
| éragnie, s.f. araignée. - (38) |
| éraige, race, espèce, raige (quelle raige de maladie ?) - (04) |
| éraignant, civil, arrangeant. - (02) |
| eraigne : araignée - (51) |
| éraignou, hargneux, incivil... - (02) |
| eraignou. : Hargneux, querelleu r; dans le midi de la France on disait ergnous, et dans le dialecte français ereux (Roq.). Rac. lat. : ira, iracundus. - Le mot ereignant, au contraire, signifie civil, commode, arrangeant, parce que l'analyse donne pour résultat ireux niant, c'est-à-dire non colère. - (06) |
| éraille, s.f. oreille. - (38) |
| érailler : faire une écorchure légère. - (09) |
| érailli : érailler - (57) |
| éraingi, pour arrangé... - (02) |
| eralai : couper les branches à la serpe. Dans les savées on érale le bois : dans les savées on coupe le bois. - (33) |
| éraler : ôter la grappe du raisin. - (09) |
| éraler. v. - Enlever les grains de la ralle, bois de la grappe. - (42) |
| éraler. v. a. Détacher les grumes du raisin d’après la raie. — Ecorcher, érafler légèrement la peau. J’ai la main tout éralée. - (10) |
| érâler. v. a. rompre, briser, éclater des branches de bois - (08) |
| éralin, éraloir. s. m. Bâton fourchu servant à éraler, à fouler le raisin dans la cuve. - (10) |
| éranger, v. tr., arranger, terminer. - (14) |
| érang'ment, s. m., arrangement, combinaison. - (14) |
| éraper. v. n. Lever, en parlant des semences. Il faudrait ben un peu de pluie, pour faire éraper les blés. (Pasilly). — S’éraper. v. pronom. Se mettre sérieusement à l’ouvrage, s’accrocher à son ouvrage. (Mailly-la-Ville). - (10) |
| érâte, s. f., arête, épine, mainte chose piquante. - (14) |
| érâte, s. f., arrêt, répit : « D'avou toué, on n'a pas eùn p'tiot moument d'érâte. » - (14) |
| érâter, v. arrêter. - (38) |
| érâter, v. tr., arrêter, empêcher, faire obstacle. - (14) |
| ératon. s. m. Versoir de charrue. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| erauler : calmer, apaiser (en parlant du mauvais temps). (ALR. T II) - B - (25) |
| èrâyé, endommager un objet ; on dit d'un vêtement un peu déchiré, d'un vase ébréché qu'ils sont èrâyê. - (16) |
| erbale : adj. Revêche. - (53) |
| érbe salée, s. f. oseille. - (22) |
| erbeuher (v.t.) : réparer, raccommoder des bas - (50) |
| erbeuher, v. a. réparer, raccommoder : « erbeuher » des bas. - (08) |
| èrbeuille-marde : scarabée bousier. - (52) |
| erbeuille-marde : bousier - (39) |
| erbeuiller (v.t.) : 1) fouir, retourner la terre avec le groin en parlant du porc ou du sanglier - 2) mal travailler la terre - (50) |
| èrbeuiller : retourner le sol avec son groin, remuer de façon désordonnée. - (52) |
| erbeuiller : remuer - (39) |
| erbeuiller, r'beuiller. Remuer la terre. Se dit du porc qui remue le sol avec son groin, pour découvrir des vers et des racines. Fig. Mal labourer. - (49) |
| erbeuillon, r'beuillon. Faire « l'erbeuillon » c'est mal faire le ménage, mettre tout sens dessus, dessous. - (49) |
| erbiffer(s) : rebiffer (s') - (39) |
| erbion-ner : se dit d'une plante qui fait une nouvelle pousse - (39) |
| erbiquer : repousser, faire une nouvelle pousse - (39) |
| erboulejous, s. m. se dit d'un homme qui regarde de côtés et d'autres avec curiosité. - (08) |
| erbouler (v.) : hérisser ; se mettre en boule ; rouler de gros yeux - (50) |
| erbouler : rouler (les yeux) - (39) |
| erbouler, v. a. hérisser, rebrousser. - (08) |
| ercamper (S’). v. pron. Se recamper, se redresser, faire l’homme d’importance. Voyez camper. - (10) |
| ercandier : (êrcan:dyé - subst. m.) aventurier, personne qui n'offre pas grande garantie de sérieux. - (45) |
| ercevouâ (v.t.) : recevoir - (50) |
| ercheloter, v. a. maintenir un membre fracturé avec des attelles ou petites lames de bois. - (08) |
| erchie : voir arsie - (23) |
| erchie, recrie, recie, s. f. temps qui s'écoule entre la matinée et la soirée ; intervalle de l'après-midi où les animaux se reposent dans les étables. Un pâtre fait « erchie ou rechie » entre dix heures du matin et trois ou quatre heures du soir. - (08) |
| erchignechat, loc. lorsque les joueurs commencent à se fâcher et à se lancer de gros mots, on dit : « l'jeu vé v'ni erchignechat », c’est à dire va dégénéré en querelle. - (08) |
| erchigner. v. a. Contrefaire, écharnir. - (10) |
| ercho (fi d'ercho) : fil de fer. (B. T IV) - D - (25) |
| erchouer (pour rechouer). v. n. Retomber. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| erchoupe, s. f. éclat de bois. - (08) |
| erchouper, v. a. receper, mettre en éclats un tronc ou une racine d'arbre. (Voir : reussoper.) - (08) |
| ercie, erchie : sieste. - (32) |
| ercoche. s. f. Recoche, hache, redent. Champ qui fait hache, qui fait ercoche. (Mézilles, Perreuse). - (10) |
| erconduire. Reconduire. - (49) |
| ercougnâssu (p.p.) : p.p. du verbe reconnaître - (50) |
| ercougnâtre (v.t.) : reconnaître - (50) |
| ercoummencer (v.t.) : recommencer - (50) |
| ercoummencer : recommencer - (39) |
| erçuer, v. a. renouveler l'acier d'un outil ou d'un instrument, le recharger. - (08) |
| erculer. Reculer. - (49) |
| erdouner, v. a. redonner, donner une fois de plus. (voir : douner.) - (08) |
| erdouter, v. a. oter de nouveau, ôter ce qu'on a donné. - (08) |
| erdouteu, euse, adj. celui qui reprend une chose qu'il a donnée. « Douner » et « erdouter », donner et reprendre, c'est, dit-on, « la doune » du diable. (Voir : doune.) - (08) |
| erdrosser (v.) : redresser - (50) |
| ère : rêche - (48) |
| ére : raiche (se dit d'une terre pas douce) - (39) |
| éré, aérer, donner de l'air. - (16) |
| ere, s.f. blé couché sur l'are, prêt à être battu. - (38) |
| ere. : Cette terminaison est trés fréquente, au lieu de celle en eur, dans les noms et adjectifs du dialecte : c'était, du reste, la désiuence du sujet, celle du régime étant eor – Les terminaisons en aire ont été celles du patois, car il ne distinguait point le régime du sujet. - (06) |
| érécher, v. tr., arracher, enlever de force. - (14) |
| éréchou, airéchou (-ouse) (n.m. ou f.) : arracheur (-ouse), dentiste - (50) |
| érée (pour airée, airie). s. f. Planche, carreau de jardin. Du latin area. (Quincerot). - (10) |
| èrëgnie, araignée. On dit de quelqu'un qui a l'esprit comme voilé par une idée fixe et singulière : el è eune èrëgnie dan lai tëte. - (16) |
| ereigne. Aborde gracieusement, complimente… - (01) |
| éreigni - érigni : énerver (quelqu'un) - (57) |
| éréille (n.f.) : oreille - (50) |
| èreille : oreille - (48) |
| èreille : versoir de la charrue - (48) |
| ereille, oureille. n. f. - Oreille. - (42) |
| éreille. s. f. Oreille. - (10) |
| éreiller. v. a. Attacher les pousses de la vigne aux échalas. (Argenteuil). - (10) |
| éreillottes (pour oreillottes). s. f. pl. Morceaux d’étoffe adaptés à une coiffure pour cacher les oreilles. - (10) |
| éreiner, éreinner (érein-ner). v. a. Ereinter. (Parly). De é privât, et reins. - (10) |
| éreinter : échiner - (57) |
| érenai ou errenai , frapper sur, éreinter... - (02) |
| erenai ou errenai. : (Pat.), errener (dial.), frapper sur, éreinter. Rac. lat., renes. - (06) |
| erène : sable pour mortier - (61) |
| érène. s. f. Sorte d’argile jaunâtre, arénacée, complètement impropre à la végétation, qui se rencontre dans certains climats au-dessous du sous-sol , particulièrement dans la vallée du Serein, aux environs de Chichée, et dans quelques communes du Tonnerrois. Comme elle fait d’excellent mortier, on l’utilise pour les constructions ; on s’en sert aussi pour faire des aires de grange et pour liaisonner le macadam sur les chemins. Elle est connue, à Auxerre, sous le nom de terre de Saint- Julien. - (10) |
| érènier (pour arènier). s. m. Lieu où l’on extrait de l’érène. - (10) |
| èrèpè : (èrèpè - adj.) avare. - (45) |
| érëte, arrête, repos. On dit d'un homme qui travaille constamment : è n'é pâ d'érëte. - (16) |
| eréte. Arrête, arrêtes, arrêtent. - (01) |
| érèter, arrêter (è long). - (26) |
| eréti. Arrêtai, arrêtas, arrêta. - (01) |
| èreûsè : arroser - (46) |
| èreûsou : un arrosoir - (46) |
| éreuti (qu’on devrait peut-être écrire héreuti). s . m. Pauvre hère; pauvre de corps et d’esprit. Du latin hérus , sans doute par antiphrase. - (10) |
| éreuti, v. a. affaiblir, étioler par un contact trop fréquent. se dit principalement en parlant des animaux domestiques qu'on énerve en les tenant toujours captifs ou en les caressant avec excès. Un chien, un chat, un oiseau « éreutis. » - (08) |
| éreuti. n. m. - Pas malin, simplet : « Heumectez-vous la langu' d 'iau d'vie pou' n'pas ettraper la pépie. Fait’ vouer qu' v'êtes pas éreutis, fourrez-v'en jusqu'au gargari. » (Fernand Clas, p.ll9) - (42) |
| erflet. s. m. Reflet. Au soulé, ça fait des erflets. (Trucy). - (10) |
| erfreidissû (n.m.) : réfrigérateur - (50) |
| ergain : regain - (39) |
| ergâmer : se dit d'une plante qui fait une nouvelle pousse - (39) |
| ergarder (v.t.) : regarder - (50) |
| ergarder. Regarder. - (49) |
| ergarder. v. - Regarder. - (42) |
| ergeniller, v. n. faire une nouvelle pousse, repousser. - (08) |
| ergîner : ricaner, se moquer - (39) |
| ergiper : voir erziper - (23) |
| ergiper. v. - Tressaillir, sursauter. - (42) |
| ergiper. v. n . Tressaillir. (Etais). — Regimber. (Vassy-sous-Pisy). Se dit pour regiper. - (10) |
| ergipiau (pour regipiau, regipeau). s. m . Petit morceau de bois rond, terminé en pointe par les deux bouts, que l’on fait sauter en frappant avec un petit bâton sur une des extrémités. De regiper, ressauter, rebondir. (Mézillos). — Voyez bistoquet. - (10) |
| ergipiau. n. m. - Jouet ; voir bistoquet. - (42) |
| ergogner, v. ; contrarier ; voir ogueigne. - (07) |
| ergoler. v. a . Blesser, humilier, mortifier. (Dollot). Je n’peux pourtant pa me laisser ergoler. - (10) |
| ergotier. s. m. Envieux du bien d’autrui. (Ménades). - (10) |
| ergourgé, ée. adj. Qui est soûl, repu, gorgé jusqu’au cou. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| ergrigner. Grigner, goder ; « s'ergrigner » : manifester son mécontentement par une grimace. - (49) |
| erguelle, eruelle. s. f. Mauvaise prononciation de ruelle, usitée dans la Puysaye. - (10) |
| érhes, s. f., arrhes. - (14) |
| ériaule (n:m.) : érable champêtre - (50) |
| ériaule, ouriaule, s. m. érable champêtre. - (08) |
| ériaule, s. m., érable. - (14) |
| érichau (Fil d’). s. m. Fil d’archal. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| éricót, s. m., haricot. - (14) |
| éricót, s. m., souci, tracas, ennui, inquiétude. - (14) |
| éricoter, v. intr., haricoter, chipoter, faire des difficultés. - (14) |
| éricotoû, adj., difficultueux, tracassier. - (14) |
| érié*, v. n. hériter. - (22) |
| érieu : s. f. « aire ». - (21) |
| èrifler. Effleurer, érafler. - (49) |
| èrigain : crochet formé par un morceau de bois le long d’une branche mal élaguée. (CLF. T II) - D - (25) |
| érignaie, erignée. s. f. Araignée. (Argenteuil). - (10) |
| érigner,v. exciter, taquiner. - (38) |
| erigneutte : enfant malingre et criard. (REP T IV) - D - (25) |
| érignî : agacer. Taquiner. - (62) |
| érignie : voir araignie - (23) |
| érignoû, adj., querelleur, hargneux. - (14) |
| érignou, s.m. taquin. - (38) |
| érigô, chicane. - (02) |
| erigôtai. : Disputer, batailler, provoquer (Del.), d'où le substantif erigô, chicane. - (06) |
| érigotay, provoquer, en latin iram agere... - (02) |
| érigue. Cheval maigre. - (03) |
| érigueu (m), arbuste taillé à la base en biseau (ce qui subsiste d'). - (26) |
| èriller : (èryé: - v. trans. ) étendre d'eau (une pâte à crêpe, une sauce). - (45) |
| érin ou airain : Eau de vie de Marc non rectifiée et très forte en alcool. L'érin est le liquide qui sort du serpentin tout à fait au début de la distillation et qui titre jusqu'à 90 degrés. - (19) |
| éringnie : araignée. (PLS. T II) - D - (25) |
| éringnie, araignée. - (26) |
| éringnotter. v. a. Exciter, contrarier. (Etivey). - (10) |
| érinzoue, arrosoir. - (26) |
| éripâle, cf. élipâle - (38) |
| ériper, v. manquer de tomber. - (38) |
| érisipère, s. f., érysipèle. - (14) |
| éritanse, héritage. - (16) |
| éritation, irritation ; héritage. - (27) |
| èritiaicion, sf. héritage. - (17) |
| èritier, vn. hériter. - (17) |
| érivage, assaisonnement, arrivage (dans l'expression : lai main pourte érivage : la main donne). - (38) |
| érivage, s. m., arrivage. - (14) |
| erivai. : Le Virg. virai donne la détlnition du mot au chant IV : …..Ein homme Ben érivai, ben en bon poin. - (06) |
| érivaû, s. m., peigneur de chanvre. - (40) |
| èriver : (èrivé - v. trans.) arranger la charge d'un char. èrivè lé: bot', "recevoir et empiler les bottes". - (45) |
| ériver, v. arriver. - (38) |
| ériver, v. intr., arriver, parvenir. - (14) |
| érivou, s.m. ouvrier agricole venant d'un pays étranger. - (38) |
| erjauder (pour rejauder, par transposition de l’e). Ressauter, rebondir, revenir sur soi, en parlant d’un corps lancé, qui fait contre-coup en frappant contre un autre. (Perreuse). - (10) |
| erjauder. v. - Ricocher, rebondir. (Perreuse, selon M. Jossier) - (42) |
| erjaut (pour rejaut, par transposition de l’e). Contre-coup, rebondissement, ressant d’un corps qui revient à son point de de départ. (Perreuse). - (10) |
| erlever (v.t.) : relever - (50) |
| erlever. Relever. - (49) |
| erluire. Reluire. - (49) |
| erluquer (v.t.) : reluquer - (50) |
| ermalle (par transposition de l’a à la place de l’e). Armelle, lame de couteau. (Etivey). - (10) |
| ermander : raccomoder - (39) |
| ermarcier (v.t.) : remercier - (50) |
| ermarcier, v. a. remercier. On dit qu'un couteau « ermarcie » son maître lorsque le ressort joue bien et que la lame donne un bruit sec en s’abattant. - (08) |
| ermarcier. v. - Remercier. - (42) |
| érmare, armoire. - (26) |
| erme5se et remesse, balai, Remesser, balayer... Le mot balai vient de bouleau ou bien du breton balaen qui signifie genêt. « Ermesse » et « remesse » dérivent du latin ramus. On donnait le nom de ramassières aux sorcières du Moyen-âge : elles allaient au sabbat à cheval sur une remesse. - (13) |
| ermèd'. n. m. - Remède. - (42) |
| ermette (s') : remettre (se) - (39) |
| ermette (v.t.) : remettre - (50) |
| érmilrage, ermitage ; èrmitre, ermite. - (16) |
| ermôler : remêler - (39) |
| ermôna : almanach (celt. monac'h : le moine). - (32) |
| ermonas : (êrmonâ: - subst. m.) almanach. - (45) |
| ermonter (v.t.) : remonter - (50) |
| ermuer. Remuer. - (49) |
| ermuer. v. - Remuer. (Arquian) - (42) |
| ernaison, s. f. mal de reins : être erné, souffrir d'une ernaison. - (24) |
| ernard : renard - (39) |
| ernarder. v. n. Se dit pour renarder, par transposition de l’e. Marcher par derrière les autres, en lambinant, marcher lentement, avec précaution, à la manière du renard. - (10) |
| erné : énervé (celt. bret. ernez : fureur, rage). - (32) |
| érné : Ereinté, affligé de maux de reins, courbaturé. « Je me sus bin tant dépôchi que j'en sus tot érné ». - (19) |
| érnézon, s. f. mal de reins. - (22) |
| erniffler : renifler - (39) |
| ernifier : renifler. - (52) |
| ernifler, eurnifler. v. n. Respirer fortement, renifler. (Mailly-la- Ville). - (10) |
| ernifler. v. - Renifler. - (42) |
| ernipier, v. n. renifler. - (08) |
| ernocter v. a. Reprendre. (Domecy-sur-Cure). - (10) |
| ernoncer (v.t.) : renoncer - (50) |
| ernotte : noix de terre. - (31) |
| ernottes - c'est la gesse tubéreuse des champs dont le petit tubercule peut se manger. - Les ernottes, ce n'â pas mauvais ; en dit qu'en en vend su le mairchi de Dijon. - Les ernottes an des jolies flieurs que ressenlant ai des Pouas-flieur. - (18) |
| ernouacher : (êrnouâ:ché: - v. trans.) harnacher un cheval. - (45) |
| ernouas : (êrnouâ: - subst. m.) harnais, et par extension, personne inutile et encombrante. - (45) |
| èrôde : (èrô:d' - subst. m.) arête de poisson. - (45) |
| érôder, v. n. perdre ses plumes par suite de la mue ou de quelque maladie. - (08) |
| éroéchoue. s. m. Déplantoir. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| éroilé : (éroualè - part. passé pris comme adj.) très las, épuisé. - (45) |
| éroincher. v. a. Ereinter. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| éronce, subst. féminin : ronce. - (54) |
| eronces, âronces : ronces agrippantes - (37) |
| érondale, hirondelle. - (16) |
| érondalle. s. f. Hirondelle. (Savigny-en-Terre-Plaine). - (10) |
| éronge (n’) : ronce - (57) |
| èronge : ronce. - (21) |
| èronze, aronze. Ronce. - (49) |
| eronzi : couper les ronces en dessous des buissons laissés poussés en balliveau pour les exploiter en bois de chauffage - (51) |
| érou - heureux. Ces gens lai sont érou, a n'en point de cueusans. - Vos êtes bein érouse, vo Claudine ; à moins vo pouvez ailai ai lai messe to les Dimoinges. - A ne sont vraiment dière éroux ; tojeur des mailaides ! - (18) |
| éroualè : éreinté - (48) |
| èrouè : (èrouè - subst. m.) sauce grasse. - (45) |
| éroue. s. f. Rose. (Montillot). - (10) |
| éroueille : oreille. (B. T IV) - D - (25) |
| éroueilles : oreilles. - (32) |
| erouette. n. f. - Branche flexible, qui après avoir été travaillée, est utilisée comme lien pour attacher les fagots. - (42) |
| érouette. s. f. Rouette, branche flexible qui, après avoir été tordue, tournée sur elle-même, pour être plus souple, sert à lier des fagots, des bourrées, et s’emploie surtout à la confection des trains de bois. Une botte d’érouettes. (Puysaie et Haute- Yonne). - (10) |
| éroufé (être) : usé superficiellement, éraflé, ou écorché ; s'éroufer : s'enlever la peau. - (56) |
| érouffé : très fatigué - (39) |
| érouffer (pour éruffer). v. a. Détacher les feuilles ou les graines d’une plante en faisant glisser dans sa main, de bas en haut, la tige qui les porte. Eruffer des branches de bouleau pour faire des balais. Eruffer des feuilles de vigne, d’orme, etc., pour les vaches. (Armeau). - (10) |
| érouher. v. a. arroser. (Bazarnes). - (10) |
| éroûser, v. tr., arroser, aussi bien les fleurs que le gosier. - (14) |
| érousoi, érousoué. s. m. Arrosoir. - (10) |
| érouter : embourber. - (31) |
| érouyer, érouhier. s. m. Rosier. (Montillot). - (10) |
| éro-ye, oreille. - (26) |
| érôzé, arroser. - (16) |
| erpas : repas - (39) |
| erpions- variante d'ergoins, c'est-à-dire ergots, griffes. – Ce chien lai al é des erpions pire qu'in chat. - Défie-toi de c'te fonne làvant ; ile é des erpions qu'en ne s'en douterot pà. - (18) |
| erpouher, v. a. reposer, donner du repos ou poser une fois de plus. - (08) |
| erprenre (v.t.) : reprendre - (50) |
| erprie, eurprie. n. f. - Reprise. - (42) |
| erprie. s. f. Reprise ; par interversion du premier e et retranchement de l’s. (Puysaie). — On prononce aussi quelquefois eurprie. - (10) |
| erprige, s. f. reprise, réparation, raccommodage à l'aiguille. - (08) |
| erpriger, v. a. repriser, faire une reprise : « erpriger sé chausses », repriser ses bas. - (08) |
| erragier. : (Dial.), arracher. Rac. lat., eradicere. - (06) |
| erragnai : chercher des poux dans la paille. (C. T IV) - A - (25) |
| errangî : mettre en ordre. Mettre en place, arranger… - (62) |
| errâter : arrêter. - (62) |
| erre, se dit de mains rugueuses. - (26) |
| errecher, éricher, éreucher. v. a. Arracher. Du latin eradicare. - (10) |
| erreur : s. f., différence entre deux chiffres se rapportant à des choses semblables, âge, compte, etc. Il y a trois mois d'erreur entre nous, c'est-à-dire l'un de nous a trois mois de plus que l'autre. II y a cinq francs d'erreur entre nos comptes, c'est-à-dire l'un de nos comptes est de cinq francs plus élevé que l'autre. - (20) |
| errhes : arrhes. III, p. 30 et ibid note q. - (23) |
| errhes, errher, arrhes, arrher. - (05) |
| errhes. s. f. pl. Arrhes, gages d’un marché ; garantie de son, exécution. Donnez-vous des errhes ? — A quoi bon ? Vous avez ma parole. - (10) |
| erria : difficultés. (C. T IV) - A - (25) |
| errière (en), loc. adv., en arrière : « Mon diâbe de ch'vau, ô va tôjor en errière. » - (14) |
| errivège. s. m. Assaisonnement d’un mets. Voyez arrivage. - (10) |
| erriver. v. - Arriver. - (42) |
| errœur : n. f. Erreur. - (53) |
| erronces (nom féminin) : ronces (voir aronces). - (47) |
| ersanner (pour rechanner, par transposition de l’e et changement de ch en s). v. n. Braire. (Domecy-sur-Cure). - (10) |
| ersarzer : recharger - (39) |
| ersâtrer : raccommoder grossièrement - (39) |
| ersauter (pour ressauter, par transposition de l’e et suppression du premier s). v. n. Synonyme d’erjauder. (Perreuse). - (10) |
| ersembiance. s. f. Ressemblance, analogie. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| ert : Etait. « I ert causu né quand j'eurint fini », il était presque nuit quand nous eûmes fini cette forme a vieilli, on dit de préférence « était ». - (19) |
| ert'chére : litière - (39) |
| erténi. v. - Retenir : « Te vas ben l'erteni encore quioque mineutes ! » - (42) |
| ertiher, v. a. retirer, reprendre, ôter. - (08) |
| ertirer. v. - Retirer. - (42) |
| erto : (êrto - subst. m.) orteil . - (45) |
| ertomber (v.t.) : retomber - (50) |
| ertorner : retourner - (39) |
| ertots - orteils. Le gros erto me fait bein mau ; ce qui me fait in pecho mairchai queman que si étâ gambi. – I ai des cors su les deux petiots ertots. - (18) |
| ertrouer : retrouver - (39) |
| ertrouer, ertrôer (v.) : retrouver - (50) |
| ertùson, s, m., artison, teigne, mile, ciron. Les bois, les étoffes, les livres en sont rongés : « La poutrôle a craqué ; álle étôt dévorée par les ertùsons. » - (14) |
| éruç-hon, hérisson. - (05) |
| éruchon. Hérisson. - (03) |
| eruelle. n. f. - Ruelle. - (42) |
| érushion : hérisson. - (62) |
| érusser : égratigner. (F. T IV) - Y - (25) |
| ervaisson : rave sauvage - (39) |
| erveire, n. fém. ; rivière; Vos laverez lai bouie (lessive) ai l'erveire. - (07) |
| ervenant (n.m.) : revenant - (50) |
| ervenger. Revenger. - (49) |
| erveni (v.t.) : revenir - (50) |
| erveni : revenir - (39) |
| ervenir, ervéni. v. - Revenir. - (42) |
| ervenir. Revenir. Ex. : « erviens don de suite ». - (49) |
| ervère (n.f.) : rivière - (50) |
| ervesson (n.m.) : rave sauvage - (50) |
| erveusser(s') : se défendre, on dit aussi qu'un chat « erveusse » ses poils - (39) |
| ervindre (v.) : revenir - (50) |
| ervitré v. a. Revêtu ; par transposition des deux e. — Ervitu, revêtu. (Etais). - (10) |
| ervître, v. a. r'habiller, revêtir. au part, passé « ervitu. » (Voir : vître.) - (08) |
| ervosse (n.f.) : congère - aussi revouse - (50) |
| ervosse : congère - (39) |
| ervouâ (v.t.) : revoir - (50) |
| ervouere. v. - Revoir. - (42) |
| ervue. n. f. - Revue. - (42) |
| ervue. s. f. Revue ; par transposition de l’e. J’soumes genss’ d’ervue. (Puysaie). - (10) |
| èrwé : assaisonnements (de l'ancien français aroi qui avait le sens très général de : arrangement, manière d'agir, etc... et qui a pris une signification très restreinte dans certains patois). (SY. T II) - B - (25) |
| erzâ, s. m. rejeton parasite ; avorton. On dit d'un enfant chétif : « ç'ô ain erzâ. » - (08) |
| erzan-ner : braire. Se dit en parlant d'une personne qui bougonne - (39) |
| erzeter, v. a. rejeter. - (08) |
| erziper (v.t.) : sursauter ; trembler de froid ou de peur - (50) |
| erziper : sursauter. VI, p. 3-7 - (23) |
| erziper : remuer vite - (39) |
| erziper, se dépêcher - (36) |
| èrzipper : remuer, bouger, se démener. - (52) |
| es - aux. - Es aute fouai an ne faiso pâ queman cequi. – En vos faut beiller cequi es pôres. - Al é mau es dents. – Voyez d'ailleurs E ou E-e. C'est également une personne de verbe Etre et du verbe Avoir. - (18) |
| es (art.déf.cont.m. et f.pl.) : aux, en les, dans les - (50) |
| és : (art. contracté) aux - (35) |
| es : Aux, article contracté « Donner du grain es pouleilles ». Article précédant parfois un lieu-dit. « Es Lames, es Echats ». - (19) |
| és prép. ou art. contracté. Aux. - (63) |
| és : aux - (39) |
| es, dans les, aux (Es Velay), surtout dans les noms de lieux. - (38) |
| és, éz : art. masc. Aux. - (53) |
| es, prép. aux ; en les ; dans les. - (08) |
| és, prép., aux : « Le p'tiôl Dodiche s'en va-t-és champs. » - (14) |
| ès. Préposit. Aux, dans les. J’m’en vas ès champs. All’ o ès vignes. - (10) |
| es’ments, essoments : semences (graines) - (43) |
| ésaingnie, s. f. saignée. Le médecin fait une « ésaingnie » ; les petites rigoles des prés sont des « ésaingnies. » (Voir : saingnie.) - (08) |
| ésape (linge). Linge a demi séché après la lessive. Etym. inconnue. - (12) |
| ésarnir. v. a. Contrefaire quelqu’un, le singer, se moquer de lui. (Domecy-Sur-Cure). — Voir écharnir. - (10) |
| ésata (linge). Linge fort éliée, usé de façon à ne plus pouvoir supporter le raccommodage. Etym. inconnue. - (12) |
| esauvadzi : apeurer, rendre sauvage - (51) |
| esbile. s. f. Sébile ; par transposition de l’s. (Béru). - (10) |
| ésbrouf, taire des ésbrouf, faire des embarras pour se distinguer. - (16) |
| escabier, v. a. accabler, charger à l'excès, assommer. - (08) |
| escabillard. adj. Pétulant. Enfant escabillard. (Soucy). Du latin scaber. - (10) |
| escabreu, euse, adj. scabreux, difficile, périlleux. - (08) |
| escabrou, adj. qui se cache. - (38) |
| escagussé : fatigué. - (30) |
| escaibea. Escabelle, escabeau. - (01) |
| escailler (n’) - escaillet (n’) : escalier - (57) |
| escaillés : les escaliers - (46) |
| escairçalle, s. f. escarcelle, bourse en cuir. - (08) |
| escaircelle - bête bien maigre ; même une personne. Son chevau, ma ce n'a qu'ine escaircelle. - Mai pôre fonne, te ressenle ai ine escaircelle. - (18) |
| escalibôt, s. m., châtaigne épineuse, mâcre flottante, châtaigne d'eau, dont l'enveloppe est entourée de pointes très piquantes. On la partage avec la lame du couteau, on en sort la chair farineuse, aqueuse parfois, et on les mange par passe-temps en se promenant, surtout en allant aux foires. - (14) |
| escalier, n.m. au singulier, désigne une marche. - (65) |
| escaliers, n.m.pl. au pluriel, désigne l'escalier. - (65) |
| escalvaudrer : vautrer. (EDSEA. T II) - A - (25) |
| escampaite. : Evasion, fuite (e campo ire). - Prarre de lai poudre d'escampaite sigmfiait, en langage familier, décamper au plus vite. - (06) |
| escandaile, s. m. scandale. - (08) |
| escandailiser, v. a. scandaliser : « a n' fau pâ escandailiser l'poure monde », ne scandalisons pas notre prochain. - (08) |
| escandli, échalas... - (02) |
| escandli. : Echalas (Del.). Escander dans le dialecte signifie monter. Rac. lat., scandere. - (06) |
| escandri. Petite variété de l'abricot ; ïl a peu de chair et sa beurde est relativement très grosse. - (13) |
| escarbillat ou escarbillart. : Nom du fou ou des fous moqueurs qui suivaient le char de la Mère folle (du latin scarificatio, incision de la peau). On dit d'un moqueur : Il emporte la pièce. - (06) |
| escarbouyer, v. tr., écarter, étendre, éparpiller, disséminer : « La bise souflôt c'ment l'diâbe ; álle escarbouryot les feúyes beùrotes au long d'la place. » - (14) |
| escarcelle (maigre comme une). Comparaison qui parait fort inexacte, puisque les escarcelles peuvent aussi bien être rebondies que maigres. Mais escarcelle, dans notre expression, ne veut pas dire une bourse ; ce mot est la forme actuelle du mauvais latin escharcellus avare, pingre, qui s'impose par avarice des privations, d'où sa mauvaise mine, son amaigrissement. Escharcellus a fait, dans le vieux français, Eschars, avare. Le mot générateur est le latin excarpus, contracté, réduit en volume. - (12) |
| escargöté, escargoté, vt. Assommer ; terrasser. - (17) |
| escargueut : Escargot. « Eune pliô d'escargueut », une petite pluie qui ne sature pas le terrain mais qui suffit pour faire sortir les escargots. - Volute : « Le cu d'escargot à Tournus » c'est la maison qui fait le coin de la grande rue et de la place de l'hôtel de ville, ainsi nommée à cause d'un ornement en forme d'escargot. - (19) |
| escarguin, s. m., escargot. - (14) |
| escaribeut : Mâcle ou châtaigne d'eau (trapa natans). - (19) |
| escaribot. Mâcre ou châtaigne d'eau à laquelle on attribue des propriétés fébrifiantes. Elle est appelée cornuelle dans l’Autunois où sa consommation est encore assez grande. Il y a cinquante ans, les fruitières de Beaune la vendaient au quarteron ; mais le palais raffiné de nos enfants ne s'accommode plus de cette friandise. - (13) |
| éscarlate, écarlate. - (16) |
| escarmoucher, v. intr., synonyme comique d'étarnuer. (V. ce dernier mot.) - (14) |
| escarmoucher. Éternuer, mot expressif dont la composition s'explique naturellement. - (03) |
| escarole. Scarole. - (49) |
| escarpeter (s’) : gesticuler en parlant - (43) |
| escarpin de bôs, loc., sabot. (V. Esclot.) - (14) |
| escayer (n.m.) : escalier - (50) |
| escàyer, s. m., marche : « Monter les escàyers. » On monte les marches de l'escalier. - (14) |
| esc'euse : Excuse. « Demender esc'euse » demander pardon, faire des excuses. - Dicton « an n'esc'euse plieu, an fouatte » : on a déjà pardonné, maintenant il faut corriger. - (19) |
| eschaiporai. (Voir au mot échairpi.) - (02) |
| eschaller écaler, eschalons, noix. - (04) |
| eschalon, s. m. noix. - (08) |
| escharnir et eschernir. : (Dial.), railler. - (06) |
| eschergaitemenz. : Forteresse, et eschargaite, sentinelle. - (06) |
| eschevir et eschuir. : (Dial), éviter. - (06) |
| eschine, s. f. animal qui n'a que la peau et les os ; bête ruinée ; rosse. - (08) |
| eschoite. : (Du latin excipere, prendre, se saisir de), succession, épave. (Franchises de Dijon, 1314.) - (06) |
| eschoner. Achever. An faut eschôner lai boiche (bêchage) devant que d'ailler goûter. Un acte de 1407, relatif à l'élection d'un maire de Beaune, porte ces mots : « Pour eschener les tumultes, débat et estaude qui se pourroient ensuyvre. » - (13) |
| éschoûée, s. f., ensemble des fruits tombés spontanément sous un arbre. - (40) |
| esciargi : démarier (les betterraves) - (57) |
| esciargi : éclaircir - (57) |
| esclette, esquelette. Squelette. - (49) |
| esclos, chaussures en bois. - (04) |
| esclos, s. m. sabots qui se portent avec des chaussons. - (08) |
| esclôt, s. m., sabot. - (14) |
| esclot. Espèce de sabot garni de cuir dont on se servait encore il y a un demi-siècle. A rapprocher du verbe éclopper. - (13) |
| escoffier : tuer - (60) |
| escoffier. v. a. Tuer, occire, assassiner. — Se dit aussi quelquefois pour voler, sans doute parce que très-souvent celui qui vole, assassine aussi volontiers. - (10) |
| éscofié, dérober adroitement. - (16) |
| escôgrife. Grand vilain escroc. Ce mot n'est pas bourguignon, mais purement burlesque ; on ne s'en est guère servi avant l'an 1640… - (01) |
| escoïfion, coiffe. - (02) |
| escoifiou. : Coiffe. (Del.) - (06) |
| escondit. : Opposition (de condicere, signifier, assigner).- Franchises de Molesmes, 1260. - (06) |
| esconterie. : Chose hors de compte. (Franchises de Saulx-le-Duc, 1246.) - (06) |
| escorper. : Annuler, retrancher quelque chose d'un tout, d'un corps quelconque, ex corpore. (Cout. de Beaune, 1370.) - (06) |
| escorpion, crysalide de gros papillon. - (05) |
| escorpion, s. m. nous donnons ce nom à une espèce de salamandre qui se trouve dans les lieux humides et qui n'a rien de commun avec le véritable scorpion. - (08) |
| escorz. : (Dial.), sein, giron. - (06) |
| escoufiner. v. a. Ecraser. (Poilly-sur-Serein). - (10) |
| escourgens (pour secours-gens). s . m. Locution par laquelle, de temps immémorial, les vignerons de Joigny désignent une sorte de petite vendange anticipée destinée à leur faire un peu de vin pour leur boite pendant la vendange principale. Deux ou trois semaines avant la mise du ban de vendange, ceux d’entre eux qui n’ont plus de vin, vont à la mairie demander la permission d’aller tel jour, dans telle vigne, couper le raisin nécessaire à cet effet, et cette permission leur est accordée en considération des besoins qu’ils disent avoir. — C’est une sorte de secours accordé par l’autorité à de pauvres gens ; c’est un seoours-aux-gens, un s’cours-gens, un escours-gens. - (10) |
| escout. : Secoué (du latin excutere, excussum). se dit d'un arbre dont on a fait tomber les fruits en le secouant. - (06) |
| escouvette, mince manche à balai. - (05) |
| escouvettes, poignée de bruyères, de bruyère, de houx, (scoba, escoba, en espagnol), égoujat, houx. - (04) |
| éscranpoulon, s. m. le derrière, la croupe, en langage plaisant : il lève l'escrampoulon. - (22) |
| escreupion, sm. scorpion. - (17) |
| escrevisse : Ecrevisse « I est défendu de pauchi les escrevisses la né ave eune lantarne » Vieux français, escrevisse. - (19) |
| escropion, s. m., scorpion. Ce mot a dû être d'abord escorpion, puis, par métathèse, le mot actuel. - (14) |
| escuhe, s. f. excuse. - (08) |
| escuzé. Excusez, excuser. - (01) |
| ésegué (s'), v. r. s'essayer à un jeu. - (22) |
| éseguer (s'), v. r. s'essayer à un jeu : s'éseguer aux billes. Commencer un travail. - (24) |
| éseireiller : écouter. (E. T IV) - S&L - (25) |
| èsèmè : (v. intr.) comprendre. I y èsèm' ran du tô. "je n'y comprends rien du tout". - (45) |
| eseumier : un petit malin, en forme d'exclamation : Chameau ! (amical). - (33) |
| esgoubille de chien. Locution en usage à Massangy et qui veut dire imbécile. - (10) |
| esgourdes : oreilles. (VDS. T IV) - VdS - (25) |
| esgra : escaliers. (S. T IV) - B - (25) |
| ésgré, marche d'escalier (prononcer le s). - (16) |
| esgrès, escaliers. - (27) |
| esguer : ébrancher en mettant à longueur de fagots - (51) |
| éshiouper (s’) : achopper. Buter, se prendre les pieds dans quelque chose, et généralement tomber. - (62) |
| ési : feu follet. (S. T IV) - S&L - (25) |
| ésiobé : sureau herbacé. - (33) |
| ésisser. v. a. Agacer. Se dit de cet état d’agacement dans lequel se trouvent les dents, lorsqu’on a mangé des groseilles vertes, du verjus ou autres fruits très âcres. A Auxerre, on dit hisser. J’ai les dents hissées. - (10) |
| éskandriye, le plus petit des abricots. - (16) |
| éskinté, fatiguer a l'excès; s'éskinté, se donner trop de peine en travaillant ou en parlant trop. - (16) |
| ésklète, squelette ; s'a ein vrë esklète, se dit d'une personne très maigre. - (16) |
| ésklipe, éclipse. - (16) |
| ésklope, celui qui n'est pas libre de ses membres. - (16) |
| eslocer. : (Dial.), se mettre en mouvement, partir d'un lieu (rac. lat., ex locore). - (06) |
| esmance ou æsmance. : (Dial.), opinion.- C'est la dérivation naturelle du complément oestimationem. «La esmance del jugeor, » c'est-à-dire l'opinion du juge. (Job.) - (06) |
| esme : s. f., vx fr. aesme et esme, intelligence, jugement. T'as donc bien peu d'esme pour ne pas comprendre c’ qu'on t' dit! T'as de l'esme autour de la tête, mais pas dedans ! - (20) |
| esnoillie (n.f.) : rayon de soleil entre deux averses - (50) |
| esnoillie (nom féminin) : percée du soleil entre deux averses. - (47) |
| esnoillie, s. f. ondée de soleil entre deux nuages. - (08) |
| esodéli, assoudi, étonné. - (02) |
| ésoingne. s. m. Echange. (Domecy-sur-le-Vault). - (10) |
| ésolent, adj. insolent. - (08) |
| espâce : Espèce « La marquise est eune bonne espâce de poire », la vertelongue est une bonne espèce de poire. - (19) |
| espalgotée : claudication due à une ancienne blessure. A - B - (41) |
| espalgotté : claudication due à une ancienne blessure - (34) |
| espar : Chasse à l'affût. « O tue sovent des lièvres à l'espar ». - (19) |
| espar. Expert, experts. - (01) |
| espardjau : genre de légumineux nuisible des prairies mal entretenues - (34) |
| espardjo : légumineuse nuisible des prairies mal entretenues. A - B - (41) |
| espardjo. Genêt herbacé, poussant dans les prés mal entretenus. - (49) |
| espardjôt n.m. Vesce sauvage. On dit aussi pajôt. - (63) |
| esparluca, expert, habile dans un art... - (02) |
| esparluca. : Expert dans un art. - (06) |
| esparron : s. m., vx fr. palonnier ; cheville de bois, mobile ou fixée à la ridelle d'un char, et qui la soutient. - (20) |
| esparvier : voir raud - (23) |
| espèce : sorte - (61) |
| espèce. Nous faisons ce substantif masculin, et cela avec une obstination incroyable. Trente ans après avoir quitté la Bourgogne, un vrai Dijonnais dit encore : « Un espèce d'homme. » - (12) |
| espéran. Espérant. - (01) |
| espercette. Sainfoin. - (49) |
| espèrer, v. tr., attendre, craindre : « J’espèrons la mâre-grand', qui doit v'ni tantôt. » — « Ol é mau ; ôl espère la fieûve. » - (14) |
| espi : Grosse chenille. - (19) |
| espic (pour aspic). s. m. Reptile fort dangereux qui, dans l’opinion de certains habitants des campagnes, la Puysaie notamment, est muni de petites pattes comme un lézard. - (10) |
| espic. n. f. - Aspic, vipère. - (42) |
| espic. Serpent ; plus particulièrement vipère. - (49) |
| éspicié, épicier ; éspis'rie, épicerie. - (16) |
| espiration, s. f. inspiration. Les enfants disent au catéchisme : « l’espiration » du Saint-Esprit. S’emploieaussi quelque fois pour haleine, souffle : Je ne puisavoir « mon espiration », mon haleine, je suis oppressé. - (08) |
| esploit. : (Dial.) - Ce mot signifiait avantage, profit, et il dérivait du latin expletio. - (06) |
| espoentaule. : (Dial. et pat.), épouvantable. - (06) |
| espouaîr (n’) : espoir - (57) |
| espourir, espouerir et espaurir. : Étonner, effrayer (du latin expavere ou expavescere). - (06) |
| espri. Esprit. - (01) |
| espricieux se, adj., instruit, malin, s'emploie surtout dans le sens négatif. Ex. : cet enfant n'est pas espricieux. - (11) |
| esprité, ée. adj. Qui a de l’esprit, de l’intelligence. Se dit le plus habituellement, par antiphrase, de celui qui n’en a pas. - (10) |
| esquèbelle : n. m. Avorton, qui ne grossit pas. - (53) |
| esquéïer, escuïer. v. a . Secouer. Du latin encutere. - (10) |
| esquelette (n.m.) : squelette - (50) |
| esquelette : Squelette, personne d'une maigreur exrême. « O n'a que la piau à peu les eus, y est in vra esquelette ». - (19) |
| esquelette, s. m. squelette ; ossements d'un corps mort. (Voir : escandale, escorbut.) - (08) |
| esquemenin - maigre et défait, surtout en parlant des enfants. - C'à in petiote esquemenin : i ne sai vraiment pâ si çai veinré. - (18) |
| esquémié : adj. et n. Maigre. - (53) |
| ésquené, adj. malingre. - (22) |
| esqueprés (à l') : Exprès. « Ol y a fait à l'esqueprés » essarcevaler : Abasourdir « O m'essarcevale », il m'abasourdit, me casse la tête. - (19) |
| esquerbouiller. v. a. Ecraser, renverser, briser. O li esquerbouillé. (Savigny-en-Terre-Plaine). - (10) |
| esquerre. : (Dial.), esqueure (pat.), secouer (rac. lat., excutere). - (06) |
| esquersale, escarcelle. - (27) |
| ésqueumié : mauvais sujet, sacripant (excommunié). - (33) |
| esqueumié : 1 n. m. Excommunié. - 2 n. m. Mauvais sujet, sacripant, chenapan. - (53) |
| esquicher : faire disparaître, s'esquiver. - (30) |
| esquiller. v. a. Attiser le feu, rapprocher l’un de l’autre les fragments des tisons. (Armeau). - (10) |
| esquinacie, s. f., inflammation de la gorge, du type abcès de l'amygdale. - (40) |
| ésquinté : fatigué, abîmé. On éto esquinté par un travail inhabituel : on était fatigué par un, travail inhabituel. - (33) |
| esquinter - escagasser : abîmer - (57) |
| esquinter (v.t.) : très fatigué - (50) |
| esquinter : abîmer - (48) |
| esquinter : Fatiguer à l'excès « J'ai sâ (fauché) to le jo, y m'a esquinté ». - (19) |
| esquinter : fatiguer - (48) |
| esquinter, v. a. échiner, rouer, briser, rompre en frappant, au propre, et fatiguer à l'excès, au figuré : il l'a « esquinte » ou échiné de coups : il est « esquinté » ou épuisé au moral. - (08) |
| esquinter, v. tr., fatiguer, épuiser, exténuer : « J'n'en peux pus ; j'ai tant fait d'chumin, qu'je m'sis esquinté. » - (14) |
| esquinter. Éreinter. - (49) |
| esquinter. v. a. Battre à outrance, meurtrir, échiner, éreinter, briser. - (10) |
| esquiômô, s. m., bizarre prononciation locale de : Eccehomo, personne à la figure immobile, atone, maladive, et volontiers pauvre d'intelligence : « Ma fi ! ô n'sait ni entend'e, ni dire ; ôl é là, c'ment c'qui, ...y ét eùn vrâ esquiômô. » - (14) |
| esquiopé, adj. écloppé, endolori, souffrant, affaibli par la maladie ou par la fatigue. - (08) |
| esquipot (Pique-nique. L'esquipot était le tronc où les garçons barbiers mettaient jadis leur pour-boire qu'ils partageaient avec les maitres. —Furetière). - (04) |
| esquipot, s. m. repas où chacun contribue, soit en payant son écot, soit en fournissant son plat ; pique-nique. - (08) |
| ésquœvllyi*, v. a. houspiller. - (22) |
| esquœvllyi, v. a. houspiller. - (24) |
| esquoux ou escout , eu latin excussum, se dit d'un arbre dont on fait tomber les fruits en le secouant. El at escout, il a été secoué. - (02) |
| es-re, s.f. aire - (38) |
| ess’ments : (nmpl) semences - (35) |
| essabouir : v. a., vx fr., éblouir, hébéter, stupéfier. J’suis tout essaboui. - (20) |
| essâïer, v. a. essayer, faire l'essai de... mettre à l'essai. - (08) |
| essaïer, vt. essayer. - (17) |
| essaiger, v. a. essayer. - (08) |
| essailli : essayer - (57) |
| essaime (n.m.) : esprit, jugement - (50) |
| essaime, s. f. esprit, jugement, intelligence, sagacité. - (08) |
| essaimer (v.) : comprendre, juger, apprécier - aussi aissaimer - (50) |
| essaimer, v. n. comprendre, juger, apprécier avec intelligence. - (08) |
| essainné : v. t. Essouffler. - (53) |
| essaireillé : pas malin, simple - (39) |
| essambrer : v. a., déchirer. Voir déchambrer. - (20) |
| essame. s . f. Mousse, écume qui se produit sur l’eau, sur les liqueurs qui fermentent ou qui sont agitées. La bière et les vins de Champagne font beaucoup d’essame. — Se dit aussi de la bave, de l’écume qui sort de la bouche de certains animaux. - (10) |
| essamer, v. n. baver, projeter de la bave. Se dit surtout des animaux : prenez garde, votre chien « essame. » - (08) |
| essamer. v. n. Ecumer, mousser. - (10) |
| essanger (du latin exsaniare). v. a. Passer le linge dans l’eau et le frapper avec le battoir pour en enlever les plus grosses saletés avant de le mettre à la lessive. (Courgis, Joigny). — C’est ce que, à Auxerre, on appelle rouiller. - (10) |
| éssan-née, s. f. largeur de terrain que le laboureur peut semer (« san-ner ») d'un seul jet. - (22) |
| essaper : essorer. - (21) |
| essaper : v. a., essorer. - (20) |
| essaper, v. essorer. - (65) |
| essaper, v. sécher, désaltérer : s'habituer à recevoir de l'eau froide sur le corps. - (38) |
| essaper, v. tr., enlever l'humidité d'un linge mouillé : « Maugré l'vilain temps, not'buë é jâr ben essapée. » Le mot ne signifie pas complètement sec, mais encore un peu humide. - (14) |
| essaper, v., essorer, tordre (le linge). - (40) |
| essaper, verbe transitif : égoutter, essorer grossièrement à la main. - (54) |
| essaper. Enlever l'eau et le savon dont un linge est imbibé ; c'est presque le synonyme d’épurer. Devant que d'étendre tes chemises, t'airai ben soin de les fare essaper. Ce mot me parait venir du latin sapo, savon. - (13) |
| essarper : essarter - (57) |
| essarper : faucher, revorcher (en parlant d'un sanglier, de la volaille qui gratte dans un champ). - (30) |
| essarper, essarpins, essarter, couper les ronces, accrues, essarpins, etc. - (05) |
| essart, s. m. terrain essarté. (Voir : ichars, issar.) - (08) |
| essarvalé : Ecervelé. « An ne peut pas campter su liune, y est in essarvalé ». - (19) |
| essarvaler : étourdir. - (21) |
| éssarvelé, écervelé, qui agit à la hâte, sans réflexion. - (16) |
| essas. s. m. Désordre. Sans doute pour excès, qu’on prononce essès, en donnant à l'è le son de l’a. (Sermizelles). - (10) |
| essasser. v. a . Epamprer. (Ménades). - (10) |
| essatai, déchirer... - (02) |
| essatai. : (Pat.), essarter (di al.), arracher des broussailles ; du bas latin exartare. (Duc.) - (06) |
| essater : écarter. - (66) |
| éssati ou esserté, se dit d'une déchirure en longueur dans un vêtement. - (28) |
| essatier, vt. essarter. - (17) |
| essaudrûlé : pas malin, échaudé, simplet - (39) |
| essauriller : écouter, espionner. (G. T II) - D - (25) |
| essauvadzi : bête apeurée - (43) |
| essauvadzi : rendre sauvage - (43) |
| essauvager : v, a., vx fr, ensauvagir, assauvagir, effaroucher, effrayer. - (20) |
| esseaunes : voir, aissiaules - (23) |
| esseillon. s. m. Billon, sillon étroit. C’est une mauvaise prononciation du mot sillon. (Montillot). - (10) |
| esselage : distance laissée à la limite d'un voisin. - (31) |
| esselage : espace à laisser du côté du voisin. (VDS. T IV) - VdS - (25) |
| esselle : échelle - (39) |
| essemaïlle : s. f., semaille. - (20) |
| essemblai. Assemblé, assemblez, assembler. - (01) |
| essement : s. m., vx fr. essemée (terre ensemencée), semence. Voir sement. - (20) |
| éssement, s. m. semence. - (22) |
| essement, s. m. semence. - (24) |
| essenée, s. f. largeur de terrain que le laboureur peut semer d'un seul jet de grain. - (24) |
| essener, essiner (altération d’échiner). v. a . Frapper, battre, assommer. (Courgis). - (10) |
| éssëni, assainir. - (16) |
| èssenler (s’) : (s'èsan:lè - v. pronom.) en parlant d'une vache, donner son lait. - (45) |
| essequ'près. Exprès. - (49) |
| esserber. v. a. Enlever les pousses parasites de la vigne. — Enlever les mauvaises herbes, sarcler. (Guillon). — Du latin ex et herba. - (10) |
| essetai (s'). : S'asseoir. On dit d'une personne : Al at esesée, c'est-à-dire elle est assise. - Éseute-te, assieds-toi. - Ce verbe est un des plus irréguliers du dialecte et du patois. - (06) |
| essetai. Assis… - (01) |
| esseter, ess’ter, essiter. v. a. Asseoir. — S’essiter. v. pronom. S’asseoir. - (10) |
| esseter, v. tr., asseoir. Plus souvent pronominal. - (14) |
| ésseufié, essoufflé, celui dont la respiration est difficile, précipitée, après une course ou un travail effectué trop à la hâte. - (16) |
| esseùrance, s. f., assurance, sécurité. - (14) |
| esseuré, ée (pour assuré). adj. Effronté, qui a de l’assurance au-delà de ce qu’il faut. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| esseùrer, v. tr., assurer, affirmer. - (14) |
| esseurfantai et eseurfantai. : Surpris, embarrassé, effrayé. Les Francs-Comtois disent éfarfantâ. Tous ces mots sont différents modes du latin expavefactus. - (06) |
| esseurfantai ou eseurfantai, effrayer, surprendre, embarrasser quelqu'un... - (02) |
| esseurfantai. Epouvantés, surpris, effrayés… - (01) |
| esseutte : assieds-toi. - (66) |
| esseuyer : essuyer - (43) |
| essiain. s. m. Essaim. - (10) |
| essiat, essillat. s. m. Essieu de charrue. (Percey). - (10) |
| essiau. s. m. Essieu. - (10) |
| essicler (verbe) : faire éclater les coutures d’un vêtement, le déchirer. - (47) |
| essieler : casser - (44) |
| essieller. Assommer. - (49) |
| essiéner. v. - Essaimer. (Villiers-Saint-Benoît, selon M. Jossier) - (42) |
| essiéner. v. n. Essaimer. (Villiers-Saint-Benoît). - (10) |
| essiérer, essiéter. v. a. Asseoir. — S’essiéter. v. pronom. S’asseoir. - (10) |
| éssiéte, assiette. - (16) |
| essiette. n. f. - Assiette. (Arquian) - (42) |
| essique, assique. n. f. - Éclisse du vannier. - (42) |
| essistance, s. f., assistance, secours. - (14) |
| essments n.m.pl. Semences. - (63) |
| essodillai. : Assourdir ; part. passé essodeli, assourdi, étonné. (Del.) - (06) |
| essoéyie : éclaircie - (39) |
| essoflier : Essoufler. « Quand an vint vieux an est vite essoflié à la mantée ». - (19) |
| essoie, adj. tranquille. - (38) |
| essoine. : Excuse d'un soin, d'une affaire. (Franchises de Seurre, 1278.) - (06) |
| essolle : échelle - (39) |
| essomacer, v. a. émonder la vigne, la débarrasser du bois superflu. - (08) |
| essoper (s'), v. pron., se heurter, se butter par inattention les pieds contre une pierre, un morceau de bois, et manquer de tomber : « I m'seû essopé cont'l'escâyé d'la Glaudine ; i m'seù fait bé mau. » - (14) |
| essoper. v. a. Entraver, ôter l’usage des pieds. Des mots latins ex et pes. (Chassignelles). - (10) |
| essorâilli v. Abasourdir, assourdir. - (63) |
| essordailler, v. rendre sourd. - (38) |
| essordalè : étourdi, sourd - (48) |
| essordaler : rendre sourd, rendre « sordais » : sourd. - (32) |
| essordé : assomé, sourd - (39) |
| essordé : assommé, simplet - (39) |
| essorder, essordiller. v. - Assourdir, rendre sourd : « Cheu essordi pa' l'bruit ». (Saint-Martin-des-Champs, selon M. Jossier) - (42) |
| essorder, essordiller. v. a. Assourdir. Ce bruit m’essorde. ( Saint-Martin-des-Champs). - (10) |
| essoreillé : v. t. Écouter en douce, en cachette. - (53) |
| essorer : Sécher à l'air. « Man linge n'est pas tot à fait so mâ ol est d'ja bien essoré ». - (19) |
| essôté. IJeu où l’on se met à couvert de la pluie… - (01) |
| essôte. : Abri. Se mettre à l' essôte de la pluie ou du vent. Dans l'italien, all'asciutto signifie à sec ( dictionn. d'Alberti) et en terre et sous terre. - (06) |
| essotte (n') - esseute (n') : abri (contre la pluie) - (57) |
| essôtte, abri. Se bôttre ai l'essôte, se mettre à l'abri. En latin, ad sedem. (Voir au mot acoyo.) ... - (02) |
| essouloter (verbe) : (S'). se chauffer au soleil. - (47) |
| essouloter, v. a. placer, exposer au soleil. - (08) |
| essoumassai : couper les gourmands de la treille. - (33) |
| essoumasser. v. a. Ebourgeonner la vigne, en retrancher les branches inutiles. - (10) |
| essoumé : assommé par un coup, pas malin, simplet - (39) |
| essoumer, v. tr., assommer, ennuyer à l'excès. - (14) |
| essoumer. v. a. Assommer. (Irancy). - (10) |
| essouoller : arriver à l'imprévu - (39) |
| éssourdé, v. a. faire un tapage à rendre sourd. - (22) |
| essourdi, assourdir ; t' m'essourdi ! tu m'assourdis ! dit-on à un enfant tapageur. - (16) |
| essourdiller, et essordiller, v. tr., assourdir, fatiguer les oreilles : « V'tu ben pas tant couiner ; t’m’essourdilles. » - (14) |
| essourdiller. Rendre sourd, rompre les oreilles. On disait autrefois essoriller et essoreiller, au propre, pour arracher les oreilles. - (03) |
| essourer, v. n. sécher, en parlant d'un terrain mouillé exposé au vent ou au soleil. - (24) |
| essouriller, essoriller. v. a. Couper, arracher les oreilles. — Au figuré, assourdir, et, par extension, étourdir. - (10) |
| essoutir. v. n. Abasourdir, étourdir, troubler, interloquer. (Cravant). — Jaubert donne essotir, dans le même sens. — Se dit sans doute pour assotir. - (10) |
| essue-main : Essuie-main. - (19) |
| essuer : Essuyer. « Essue voir bien tes pids devant d'entrer ». Vieux français, essuer, sécher dessécher - latin, escurare. - (19) |
| essuer : ressuyer (assèchement de la terre après les pluies) - (51) |
| essuger (v.t.) : essuyer - (50) |
| essuger, v. a. essuyer. - (08) |
| essui. adj. - Égoutté, qui a perdu son eau : un fromage essui. - (42) |
| essui. adj. Qui a séché, qui a perdu son eau. Fromage essui, fromage bien égoutté, par opposition à fromage mou. - (10) |
| essuire. v. - Sécher, égoutter, en parlant d'un fromage : « Faut fai'e essuie les froumages. » - (42) |
| essuire. v. a. et v. n. Sécher, s’égoutter. Faire essuire des fromages. - (10) |
| essure. Assure, assures, assurent. - (01) |
| essuver (du latin uva, raisin). v. a. Attacher les pousses de la vigne aux échalas. (Anitaÿ-sur-Serein). — C’est ce qu’ailleurs on appelle écouler, accoler. - (10) |
| est’heure : maintenant. - (66) |
| estaller (v.) : installer - (50) |
| estampiller : voir dessampiller. - (20) |
| estan, s. m. instant. Dans eun ou ain « estan », dans un instant. - (08) |
| estance, s. f. instance. Former une « estance », terme de plaideur. - (08) |
| estanuer. v. n. Eternuer. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| estatue (n.f.) : statue - (50) |
| estatue : Statue. « Qu'est-ce que te fas itié plianté c'ment eune estatue ». - (19) |
| estatue, s. f. statue. - (08) |
| estatue, sf. statue. - (17) |
| estatue. n. f. - Statue. - (42) |
| estatue. : (Dial. et pat.). C'était la règle d'adoucir par l' e euphonique les mots commençant par sp, sc, st ; nos villageois l'ont conservée. - (06) |
| estatut. Statut. - (49) |
| estaufion - personne sans énergie, qui est là comme une sotte. - Pôre estaufion, vais ! – Le ninot, ce n'â qu'in grand estaufion. - (18) |
| estaulaige. : Aujourd'hui étal (du latin stabilitionem). [Fran ch. d'Is-sur- Tille, 1310.] - (06) |
| estaumeau : insulte intraduisible - (39) |
| esté, ée (pour essité, ée). partic. p. et adj. Assis. Gomment donc que v’êtes esté ? V’n’ôtes pas ben du tout. - (10) |
| ester, ster, v. n. asseoir, reposer, tranquilliser ; s'arrêter : « esté-vô ; a fau vô-z-ester, mai mée », asseyez-vous, il faut vous asseoir, ma mère. - (08) |
| estériau. s. m. Hottereau de femme. (Bessy). - (10) |
| esteûle, s. f., paille. - (14) |
| èsteure : à cette heure, maintenant. - (52) |
| esteurlogue. s. m. Beau parleur, qui fait le savant, l’astrologue. - (10) |
| estimer : v. a. Estimer de, manifester l'estime qu'on a pour quelqu'un, faire son éloge. Il m'a bien estimé de vous, il m'a dit qu'il vous estime beaucoup. - (20) |
| estiômo, "Ecce Homo". - (38) |
| estituer, v. a. instituer, établir. Nous disons aussi « estitutions » pour institutions. - (08) |
| estituteur (n.m.) : instituteur - (50) |
| estoc, s. m., coup d'œil, esprit, intelligence, jugement. - (14) |
| éstomaké; s'estomaké, se fatiguer la poitrine en partant trop et trop haut. - (16) |
| estomaquer. v. a . Epoumonner. - (10) |
| estôque. : Ligne de parenté (Del.). Le dialecte dit estoc. - (06) |
| estordre. : (Vraie dérivation du latin extorquere). S'emparer par violence. - (06) |
| estouit, ite. adj . Accablé, hébété par la chaleur ; ennuyé, fatigué, ahuri par un bruit importun, par les cris ou les jeux assourdissants des enfants. (Etivey). Du latin stultus. - (10) |
| estoumâ : estomac - (39) |
| estoumà, s. m., estomac, poitrine : « Ol a pris eùn chaud-frèd, épeu l’rheûme li a tumbé su l’estoumâ. » - (14) |
| estoumac. n. m. - Estomac. - (42) |
| estourbi : se faire assommer - (39) |
| estourbi. s. m. Toupie. Du latin turbo, parce que la toupie tourne sur elle-même comme un tourbillon. ( Perrigny-lès-Auxerre). - (10) |
| estourbiot, estourbignot. s. m. Tourbillon de vent et de poussière. (Perrigny-lès-Auxerre). - (10) |
| estrafilé. Estropié, blessé. - (49) |
| estrafiler. Estropier. « S'estrafiler», c'est se blesser, s'estropier. - (49) |
| estragot, estragout. s. m. Escargot. (Bagneaux, Arcy-sur-Cure, Chablis). Du vieux français estrage, cabane, cahute, maisonnette, parce que l’escargot traîne sa coquille, sa cabane avec lui. - (10) |
| estrague, s. f. extravagance, délire : battre « l'estrague » = battre l'estrade, la campagne, délirer. - (08) |
| estrain. : Du latin stramen, paille. (Priv. de Rouvres, 1215.) - (06) |
| estrangouiller, estragouiller : v. a., étrangler. - (20) |
| estrangouiller, v. tr., étrangler, comprimer. - (14) |
| estrangouiller. Étrangler, fait de strangulare, comme estomac de stomachus. - (03) |
| éstrangouyé, s'éstrangouyé; s'étrangler, en quelque sorte, en parlant trop vite, comme il arrive dans des instants de colère ou en mangeant avec trop de précipitation. Ce mot traduit le strangulare des latins. - (16) |
| es-tre, v. être. - (38) |
| estrèce. : (Dial.), état de ce qui est étroit ou rétréci (rac. lat., strictum). On dit en français étroitesse. - (06) |
| estréminer. v. a. Exterminer. (Arcy-sur-Cure). - (10) |
| estreument, s. m. instrument : - (08) |
| estreupier : Estropier. « O s'est cassé eune chambe a peu o se l'est fait rarangi à in madecin, si ol avait fait veni le Bliandiau aujord'heu o ne serait pas estreupié ». - (19) |
| estreupier : estropier - (39) |
| estreupier, v. a. estropier, blesser, meurtrir. - (08) |
| estreupique, adj. des deux genres. hydropique. Il y a beaucoup d' « estreupiques » dans nos montagnes. - (08) |
| estreupisie, s. f. hydropisie. - (08) |
| estreùpisie, s. f., hydropisie. - (14) |
| estreure, v. a. instruire, donner de l'instruction à quelqu'un. - (08) |
| estrigouaire, estringouaire : n. m. Estomac et œsophage. - (53) |
| estringler, estringoler. v. - Étrangler. - (42) |
| estringoler. v. a. Etrangler. Que le guiab’ t’estringole ! Du latin strangulare. (Puysaie). - (10) |
| estringouére :œsophage - (48) |
| estrinkmère : trachée. (SY. T II) - B - (25) |
| estrôlôgie. Astrologie. Estrôlôgue, astrologue. - (01) |
| estrongeon, et estronjon, s. m., esturgeon. Est surtout employé au figuré pour critiquer, — à tort, — la petitesse d'une personne ou d'un animal. L'esturgeon étant d'un gros format, par quelle bizarrerie sert-il de point de comparaison avec un être chétif et petit ? Par antiphrase, sans doute : « Va donc, espèce d’estrongeon ! » - (14) |
| estrongeon, s. m. avorton. se dit d'un enfant de petite taille et qui ne grandit pas : « eun p'tiô estrongeon. » - (08) |
| estronjou, sm. avorton. - (17) |
| estrop'illi : estropier - (57) |
| éstropique, hydropique ; estropizie, hydropisie. - (16) |
| estropisie. s. f. Se dit par corruption pour hydropisie. - (10) |
| ésu : Eu, participe passé du verbe avoir. A quelqu'un qui s'est marié par inclination et contre le gré de ses parents et vient ensuite se plaindre de son conjoint on répond : « Te l'a voulu te l'as ésu ». - (19) |
| esu : eu. - (30) |
| ésu : p.passé du verbe ava (avoir) - (35) |
| ësué, essuyer ; é'sû mèn, essuie-main. - (16) |
| esveudier (s'). Se dépouiller de ; cette forme appartenait au dialecte et au patois. Le mot du dialecte vuit (vide), provenant lui-même du latin viduus, en est la racine. - (06) |
| eswarder. : (Dial.), regarder. - (06) |
| ésyeuter. Enlever l'œil, le bourgeon. S'emploie surtout en horticulture. - (49) |
| ét' : Verbe être, voir être. - (19) |
| et que cètera. Et caetera, etc. - (49) |
| et tô. Aussi. « Et moi et tout », pour et moi aussi en français, est du bas peuple ; mais en bourguignon, et moi et tô, c'est une élégance. - (01) |
| ét, ééte : v. i. Être. - (53) |
| et, eir, eis ou eiz, eit, étaient les désinences habituelles des imparfaits, des infinitifs et des noms, sujet et régime du dialecte bourguignon. - (06) |
| et’cho : orteil. (LCSS. T IV) - S&L - (25) |
| ét’ieindre, v. a. éteindre. - (22) |
| et’ieinsson, s. m. pinson. - (22) |
| ét’ler : (vb) fendre le bois - (35) |
| ëta, manière d'être ; une vigne est en bon ëta, quand elle est bien cultivée et que rien ne lui manque. - (16) |
| eta. Etat, états. - (01) |
| étabieue. s . f. Etable. Du latin stabulum. - (10) |
| etabji, vt. établir. - (17) |
| étâcher. v. n. Essayer. - (10) |
| étager, étôger : v. a., vx fr. estuier, procéder par degrés, ménager, économiser. - (20) |
| étâger, v. n. faire un effort, tâcher de faire. - (08) |
| étai - été. - L'étai a été bein molié c't-année. - (18) |
| étaibye (n.f.) : étable - (50) |
| étaiche, et étéche, s. f., attache, cordon, agrafe, etc. - (14) |
| étaicher, et étécher, v. tr., attacher. - (14) |
| etaige. Etage, étages. - (01) |
| étailantai, désirer ardemment... - (02) |
| etailantai. : (Pat.), atalanter (dial.), avoir bonne volonté de, avoir pour agréable. - (06) |
| étainai, éteiné, étenné, éténé, ennuyer, fatiguer quelqu'un. Cette expression est fort en usage dans le Châtillonnais... - (02) |
| étainche, petit batardeau. - (05) |
| etainé. : (voir au mot atainé.) – Fatiguer quelqu'un par du bruit ou des importunités. - (06) |
| étain-ner, impatienter. - (38) |
| étale : copeau de la hache. Du bas latin hastella : petite lance. - (62) |
| étale : Fragment de bois que détache du tronc de l'arbre chaque coup de la hâche du bûcheron On appelle aussi étales les déchets du travail du charpentier, du sabotier. « Les étales de sabeuté sant bin c’meudes pa emprendre le fû ». - Etales de chai, on nomme ainsi les deux petits leviers qui actionnent le to (treuil) servant à serrer les deux cordes qui assurent la solidité du chargement sur le char. - (19) |
| étale : morceau de bois fendu - (43) |
| ëtale, copeau, buchaille ; ëtalé un gros morceau de bois est le fendre en morceaux moindres. - (16) |
| étalé, v. a. fendre et morceler du bois de chauffage ; les éclats minces sont des étales. - (22) |
| étaler : fendre du bois - (43) |
| étaler : Maintenir par des étales ou petites planchettes. - (19) |
| étaler, v. a. fendre et morceler du bois de chauffage ; les éclats minces sont des étales. - (24) |
| ètalle : 1° éclat de bois, 2° petit bâton dont on se sert pour faire tourner le « to >> de la voiture. - (21) |
| étalloires (pour ételloires). s. f. Chevilles pour atteler les chevaux. (Etivey). - (10) |
| étamine, s. f. tamis de soie pour tamiser la fleur de la farine, etc. l'étamine était un tissu très clair dont on se servait pour fabriquer des blutoirs et des tamis. - (08) |
| étampe : étai - (43) |
| étampe : Etai. « Le plianchi de tan gueurné n'est pas solide, te farais pas mau d'y mentre des étampes ». - (19) |
| étamper : (vb) étayer, soutenir - (35) |
| étamper : étayer, soutenir - (43) |
| étamper : Etayer. - (19) |
| etan. J’étends, tu étends, il étend. « Ai s’étan », s'étend. Il signifie aussi j'attends, tu attends, il attend, et de plus le participe étant. - (01) |
| étancener, v. a. étançonner, mettre des étançons, des étais ; étayer. - (08) |
| étançot. s. m. Souche, tronc d’un arbre coupé un peu au-dessus du sol. (Montillol). - (10) |
| étandre, v. tr., attendre, être prêt : « Dépôche-te ; le fricot nous étand. » - (14) |
| étané : abasourdi. (V. T IV) - A - (25) |
| étâner (pour tanner). v. a. Se dit, figurément, pour taquiner, ennuyer, asticoter ; frapper, battre, donner des coups. (Sermizelles). - (10) |
| étang (féminin) : étang (masculin) - (48) |
| étang, s. f. étang. Nous disons « une étang » comme « une serpent. » - (08) |
| étanner : ennuyer. (MM. T IV) - A - (25) |
| ètanué, vn. éternuer. - (17) |
| étaper, v. a. vanner le blé en le criblant, en rejetant ce qu'on appelle ici les « crinses » ou les « éteuriottes », c’est à dire les graines parasites, l'ivraie notamment. - (08) |
| étapes, s. f. pl. débris de battage formés de grain et paille mélangés. - (22) |
| étapes, s. f. pl. débris de battage formés de grain et paille mélangés. - (24) |
| étardi, e, adj. interdit. Ce garçon a été « étardi » : cette jeune fille a été « étardie » par leur père et mère. - (08) |
| étargnot, étorgnot. s. m. Avorton ; en général, chétif, mal venu. (Maillot, Soucy). - (10) |
| étarnailles, s. f. pl. toute matière servant à faire la litière du bétail. Verbe éternir (du latin sternere, joncher). - (24) |
| étarneilles, s. f. pl. toute matière servant à faire la litière du bétail. - (22) |
| étarni : épandre - (57) |
| étarni : étaler - (57) |
| étarni : étendre - (57) |
| ètarni : faire la litière. - (21) |
| etarnue. Eternue, éternues, éternuent. - (01) |
| étarnuer : Eternuer. « Prends dan voir eune bonne prise de tabac pa te fare étarnuer ». - (19) |
| étarnuer : éternuer - (39) |
| étarnuer, v. intr., éternuer. - (14) |
| étarnuer, v. n .éternuer. « Étarni.» - (08) |
| étartaillé, écarpeussi : éparpillé - (43) |
| état (au par) (loc. adv.) : à proportion - (64) |
| étatrer (s') : (s'étatrè - v. pronom.) s'étendre de tout son long. - (45) |
| étatri : foulé. (LS. T IV) - Y - (25) |
| états (être dans tous ses), loc., situation affairée, tourmentée, tumultueuse : « La bigre ! áll’ va s’marier ; aussi álle é dans tous ses états. » - (14) |
| étau - étonné, surpris. - En entendant cequi al éto tôt étau. - Eh bein ! t'é l'air tot étau ! quoi qu'en y é don, arré ? - (18) |
| étaú, adj., surpris, étonné, stupéfait : « De c'qu'ô m'a raconté, voué-tu, j'en pouvô pas r'veni ; j'en seû rasté tout étaú. » - (14) |
| étau, s. m., dessus de l'ancienne entrée extérieure des caves. - (14) |
| étau, table de boucherie... - (02) |
| etau. : Etonné, surpris, stupéfait : Ai son tôt étau, c'est-à-dire ils sont tout stupéfaits. - (06) |
| étaugi : Epargner. « A force d'étaugi ol a fini pa rangi eune greusse borse », il a fini par mettre de côté une grosse bourse éteurner : Faire usage d'une chose pour la première fois. « Alle était bin balle, alle éteurnait sa reube neue » - (19) |
| étaugi, v. a. économiser, épargner. - (22) |
| étaugi, v. a. économiser, épargner. - (24) |
| étaulailler : v. a., enlever les étaules. L’orage de c'te nuit a tout étauIaillé ma vigne des Jean-Loron. - (20) |
| étaule : pied de blé. - (09) |
| étaule : s. f., éteule, paille, chaume ; branchette, brindille. - (20) |
| étaule, étable. - (16) |
| étaule, s. f., étable, écurie. - (14) |
| etaule. Etable, comme taule, table, faule, fable, ôzeraule, érable, etc. - (01) |
| étaules, éteules et étoules, ce qui reste aux champs de la paille des blés après moisson. Dans l'idiome breton, taol est la partie du tuyau de blé comprise entre deux de ses nœuds. (Le Gon.). A Châtillon l'on dit étroubles ; c'est plus mal parler pour vouloir mieux dire. Le vrai mot est esteules, du latin stipula, paille, chaume, tiges de céréales... - (02) |
| etaules, éteules, étoules et esteules. : (Du latin stipula.) Ce qui reste aux champs de la paille des blés après moisson. -Dans le Chàtillonnais on · dit improprement étroubles. - (06) |
| étauper : étaupiner (détruire les taupinières) - (48) |
| étauper. v. - Battre le linge. « Elles lavent les draps, les couches, étaupent, tordent deux à deux. » (Fernand Clas, p.l30) - (42) |
| étcheume (d’l’) - tcheume (d'la) : écume - (57) |
| étcheumer : écumer - (57) |
| étcheumouaîre (n’) : écumoire - (57) |
| étchuelle (n’) : écuelle - (57) |
| étchuelle (s) : écuelle (s) - (39) |
| étchuélotte. s. f. Petite écuelle. (Sacy). — Voyez étchumer. - (10) |
| étchumer. v. a. et n. Ecumer. A La Belliole et dans quelques autres communes, le c dur se prononce également tch. J’ai mal au tchœur. - (10) |
| étchurie (l’) : écurie - (57) |
| étchuter : écouter - (57) |
| éte - infinitif du verbe Etre. - Qu'i vourà don bein éte riche, pour pouvoir fâre des éroux ! – Voyez du reste l'article Eto, Eta, etc. - (18) |
| éte (v.i.) : être - (50) |
| éte : être - (48) |
| été : s. f. Toute l'été. « Un soir de cette été... » (V. la citation, v° Tendue). - (20) |
| éte crins'nalè : être frigorifié - (48) |
| éte en ddans loc. Etre renfermé, introverti. - (63) |
| éte en dsos loc. Etre dissimulé, sournois. - (63) |
| éte v. Être. - (63) |
| éte virandiau : être étourdi, avoir le tournis - (48) |
| éte : être - (39) |
| été, part, passé du v. être : « i seu été, al ô été » = j'ai été, il a été. S’emploie pour eu, part, passé du verbe avoir : « i é été, al é été « =: j'ai eu, il a eu. - (08) |
| éte, v, aux., être, appartenir. - (14) |
| éte, v. auxiliaire être. «Âte. » - (08) |
| ete. Etes, pluriel de la seconde personne du verbe être, au présent de l’indicatif. Je son, vos éte, ai son, nous sommes, vous êtes, ils sont. Le premier é, dans le bourguignon éte, est fermé, au lieu que dans le français êtes, il est ouvert. Ete aussi se prend quelquerois pour l'infinitif être, comme vote et note, pour votre et notre. - (01) |
| étéche, attache, dans tous ses sens. - (16) |
| étécher. v. a. Attacher. (Bazarnes). - (10) |
| éteignu, ue. part. p. D’éteindre. J’t’avais dit de laisser la chandelle allumée : d’à caue que t’I’as éteignue. - (10) |
| etein. Etions, étiez, étaient. l’é initial est ouvert dans étions et dans étiez ; mais il est fermé dans étaie, était et étaient. En bourguignon, cet é initial est fermé partout dans ce verbe. - (01) |
| éteinde, et étoinde, v.tr., éteindre. - (14) |
| éteindoir : s. m., éteignoir. - (20) |
| éteindoir, s. m., éteignoir. - (14) |
| éteindu, et étoindu. part., d’éteinde. - (14) |
| éteindu, éteindue : part, pass., éteint, éteinte. La chandelle est éteindue. - (20) |
| éteiné. adj. - Très préoccupé, impossible à distraire. (Sommecaise, selon M. Jossier) - (42) |
| éteiné. adj. Qui est tellement préoccupé, tellement absorbé, que rien ne le dérange, rien ne le distrait. Sommecaise). Du latin attonitus. - (10) |
| éteinte : s, f., vx fr. esteinte, extinction. J'ai une éteinte de voix. - (20) |
| étele, fragment de bois détaché à la hache, à la serpe. - (28) |
| étèle, sf. petite bûchette, éclat de bois. - (17) |
| ételée (pour attelée). s. f. demi-journée de labour, temps pendant lequel les animaux restent attelés à la charrue. La journée se partage ordinairement en deux ételées. - (10) |
| èteler. Atteler. - (49) |
| ételle : bête très maigre. (BD. T III) - VdS - (25) |
| ételle : copeau de bois. - (31) |
| ételle : une éclisse, éclat de bois produit par la hache du bûcheron - (46) |
| etelle : lamelle de bois sec (celt. etev : bûchette sèche). - (32) |
| ételle, éclat, copeau de bois lorsqu'on abat un arbre à la hache. - (26) |
| ételle, étèle, aitelle (C.-d., Chal., Br.), atèle (Morv.) - Copeau de bois, du vieux français astèle, signifiant tronçon, éclat de bois, écharde. En chirurgie une attèle est une pièce de bois servant à maintenir un membre fracturé. C'est aussi la partie du collier des chevaux où les traits sont attachés, d'où est venu le verbe atteler. La racine est-elle bastella, diminutif de bâsta (lance, bâton), ou bien astula, du latin assis (planchette) qui a fait atelier? Nous conclurions volontiers pour hastella. - (15) |
| ételle. Copeaux de bois tombés sous la cognée à la coupe ou à l’équarrissage des arbres. - (12) |
| ételle.s, s. f., éclats de bois, gros copeaux en lamelles, détachés par la hache des troncs et poutres qu'on équarrit. Elles servent au chauffage. - (14) |
| eteller : casser, briser - (51) |
| ételler, étaller : v. a., faire des étoiles. A la campagne, on dit ételler du bois quand on fend en éclats le bois à brûler, et fendre du bois quand on divise le bois pour en faire des pieux, des échalas, etc. - (20) |
| ételles, déchets de bois obtenus avec la cognée. - (27) |
| ételles, éclats de bois fabriqué. - (05) |
| ételles, s. f. pl., éclats d' abattage servant à allumer le feu (réservés au charretier). - (40) |
| etelles. Débris de bois faits par la cognée en abattant les arbres. - (13) |
| ételligence (n.f.) : intelligence - (50) |
| ételligent (adj.) : intelligent - (50) |
| ételon. s. m. Etalon. - (10) |
| etendou (nom masculin) : sorte de palette pour étendre la pâte à pain. - (47) |
| étendou : le séchoir à linge composé de piquets en bois et de fil de fer - (46) |
| étendou, s. m. espèce de palette avec laquelle ou étend la pâte des pains de seigle. - (08) |
| étendre, v. attendre. - (38) |
| eténe. Ennuie, ennuies, ennuient. « Tu m’éténe », tu m'ennuies. Ai n’éténe pa, il n'ennuie, ou ils n'ennuient pas… - (01) |
| étèner : fatiguer quelqu'un. (G. T II) - D - (25) |
| étêner, abasourdir. - (26) |
| éténi adj. Fané, mou, affaissé. - (63) |
| étènné, étèngné, agacer, taquiner (prononcer étin-né). - (16) |
| étention, s. f. intention et attention. - (08) |
| étention, s. f., attention, soins, application. - (14) |
| étention, s. f., intention, volonté. - (14) |
| étèpes, sf. épis mal battus, ce qui ne passe pas au tarare et reste sur la paille. - (17) |
| étépouée, étépoie (A l’). locut. adv. A l’étouffée. Pommes de terre cuites à l’étépouée. (Véron). - (10) |
| étéressé, adj. attaché à ses intérêts, parcimonieux. - (08) |
| ëtergnué. A une personne qui éternue on dit : Dyeu va b'nisse ! La raison de ce souhait est celle-ci : dans une forte épidémie, on mourait en étemuant ; comme alors on n'avait pas le temps de procurer aux mourants les secours de la religion, pour leur en tenir lieu, autant que possible,on leur disait : Dyeu vô b'nisse ! que Dieu vous bénisse ! On dit encore et dans le même sens : ai vô soué ! à vos souhaits ! - (16) |
| éterio : espace de petite hotte qui servait à remonter la terre dans les vignes en côteau et qui servait également au vigneron pour emporter ses outils et son manger. Sans doute dérivé de hottereau. (R. T IV) - Y - (25) |
| éterlot (n.m.) : roitelet - (50) |
| étermouècher : (étêrmouèché - v. intr.) éternuer (vieux). - (45) |
| éternaille : s. f., ce qui sert à faire la litière. - (20) |
| éternailler, éternir : v. a., vx fr. esterner et esternir, étendre, joncher. Eternailler les vaches, faire leur litière. - (20) |
| étèrni : (vb) faire la litière des bêtes - (35) |
| éternir : faire la litière - (43) |
| éternir, faire la litière (sternere). - (05) |
| éternir, v. faire la litière. - (65) |
| étérompe, v. a. interrompre, gêner, déranger « i n' veu pâ vô-z'-étérompe », pour je ne veux pas vous déranger. - (08) |
| èteuîé, vt. étouffer. - (17) |
| éteujotte, s. f. tige de fer ou de bois avec laquelle on accommode la mèche des lampes rustiques. L’éteujotte est un petit attisoir. - (08) |
| éteule : (nf) morceau de bois fendu - (35) |
| éteupe n.f. Etoupe. - (63) |
| éteûpons : (nmpl) bruyère incarnat - (35) |
| éteupons n.m.pl. (de étoupe). Ajoncs. - (63) |
| éteurié, s. m. étrier. - (08) |
| éteuriotte (n.f.) : graine d'ivraie vivace mêlée aux céréales - (50) |
| éteuriotte, s. f. graine de l'ivraie vivace qui se trouve souvent en abondance dans les céréales. - (08) |
| éteurler v. Débiter jusqu'à la teurle (nœud, tête noueuse). - (63) |
| éteurnâilles n.f.pl. Tout ce qui peut servir à faire la litière des vaches. - (63) |
| éteurnâilli (s') v. (à rapprocher d'étèrni ou d'étarnailli, faire la litière, dérivés du lat. sternere, étendre, recouvrir le sol de quelque chose, mots que l'on rencontre dans les communes voisines) S'étaler de tout son long. - (63) |
| éteurne, étorne (n.f.) : étrenne - (50) |
| éteùrne, s. f., étrenne, non celle du jour de l'an, mais la première vente faite, la première aumône reçue : « Dion bénisse la main qui m'éteùrne ! » dit toute marchande en se signant dès qu'elle a vendu son premier objet. - (14) |
| éteùrner, v. tr., étrenner : « Éteùmez-moi , mon bon mossieu, » vous dit la mendiante en vous tendant la main. Et, si vous répondez à sa demande d'une façon affirmative, elle embrasse le sou que vous lui donnez, en vous disant : « Dieu vous l'rende ! » - (14) |
| éteurnia : étourdi. (RDM. T IV) - B - (25) |
| éteurnuer v. Eternuer. - (63) |
| éteurri, ie. adj. Atterré, renversé, couché par terre. Se dit en parlant des personnes et des plantes. Le vent a éteurri tous les blés. J’iai éteurri d’un coup de poingne. (Etivey). - (10) |
| éteuyi v. Etuver. Voir étwer. - (63) |
| éteûyi, étuer : (vb) rendre étanche - (35) |
| éti. Locut. interrogat. C’est une abréviation de plaît-il ? - (10) |
| étiaffé, chose molle qui s'écrase. - (26) |
| ètiafouré, vt. écraser, mettre en bouillie. - (17) |
| ètiaire, sf. grande éclaire (chelidonium majus). - (17) |
| ètiairé, vt. éclairer. Voir tiairé. - (17) |
| étiale, équiale. s. f . Ecuelle. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| étiâler, v., sarcler la vigne. - (40) |
| étialle, n. fém. ; écuelle. - (07) |
| ètiaron (ā), sm. bûchette propre à éclairer. - (17) |
| ètiation (ā), sm. objet effilé, aplati. - (17) |
| ètiatré, (ā), vt. écraser, aplatir ; étendre. S’ètiatré, s'accroupir, s'aplatir. - (17) |
| ètiaulon, sm. avorton. - (17) |
| éticot : filet de pêche. - (31) |
| et'ieinsson, s. m. pinson. - (24) |
| étïer, éthier. v. a. Attiser. (Parly). - (10) |
| ètieupi, ètioupi, ètoupi, vt. [etouper]. boucher. Étouffer (le feu). Recouvrir qqun d'un excès de vêtements. (Dans ce cas il semble qu'on emploie la première forme.) - (17) |
| ét'ieuter (s'), v. r. s'exagérer son mal, s'y complaire. - (24) |
| étifer, v. tr., attiffer, parer avec affectation. - (14) |
| étignier (pour étaingnier). s. m. Porte-vaisselle. De étain, parce qu’autrefois la vaisselle se composait de pots, de plats et d’assiettes d’étain. (Cravant). - (10) |
| étin, aussi. - (26) |
| étiner. v. a. Taquiner, provoquer, irriter. (Sénonais). Du latin tineare , ronger, asticoter. - (10) |
| ètingnan : (ètin:gnan - adj.) agaçant. - (45) |
| ètingner : (ètin:gné - v. trans.) énerver, agacer, fatiguer. 2- (ètin:gné - v. intr.) en avoir assez. - (45) |
| etio. Orteil, du vieux mot arto, par contraction. - (03) |
| Etiôpie. Ethiopie. - (01) |
| ètiöre, vn. éclore ; pp. ètiö. - (17) |
| étioter : éclater. - (29) |
| étiquet : carrelet. Le filet de pêche carré monté sur des arceaux croisés. - (62) |
| étirâ, s. m. assemblage confus ; fouillis de choses jetées pêle-mêle. - (08) |
| étirer : v. a., tirer. Littré dit qu'on étire le métal et qu'on tire le linge. - (20) |
| étiri : étirer - (57) |
| ètiuse, sf. écluse. - (17) |
| étiver, étuver un cuvier. - (05) |
| étiver, v. tr., faire tremper la lessive dans l'eau de cendres. Corruption de : étuver. - (14) |
| étiver. Faire tremper la lessive dans l'eau mêlée de cendre, par corruption de étuver pour baigner. - (03) |
| ét'ler (on ch'vau) - épieilli (des bûs) - appondre : atteler - (57) |
| eto : aussi (syn. aré*). A - B - (41) |
| étô : (asv) aussi - (35) |
| eto : aussi - (34) |
| eto : aussi - (51) |
| ëtô ; teut ëtô, très étonné, comme stupéfait : i an seû teut ëtô. - (16) |
| éto, étâ, étaint - divers temps du verbe Etre. - Al étaint to ai lai messe. - Quand i l'ai vu al éto bein occupai ai traiveiller. - (18) |
| etodi. Etourdi, étourdis, étourdit, étourdir. - (01) |
| ètodji, vt. étourdir. - (17) |
| etoffe mal cousue. - (17) |
| étoffe-chrétien : nom d'un gâteau assez lourd appelé à Bessey-en-Chaume : bourre-doguins. Un doguin est un galopin ou un domestique paresseux. (B. T II) - B - (25) |
| étoffer : Etouffer. « I fa eune chalou ! an étoffe ». - (19) |
| etoi. Toit, toits… - (01) |
| étoile (faire), loc., employée par les jeunes patineurs. - (14) |
| étoinde - éteindre. - Ne laiche pâ étoinde le feu. - Al é étoindu lai lampe trop tôt. - An ne fauro pâ que les chandelles s'étoindeussaint. - (18) |
| étoinde : (é:touin:d' - v. trans.) éteindre le feu. Pour "éteindre la lumière", cf. sôflè. - (45) |
| étoinde : éteindre - (39) |
| étoindre (v.t.) : éteindre - (50) |
| étoindre : éteindre, souffler les bougies - (46) |
| étoindre : éteindre. On dira « étoignez la chandalle ! ». - (62) |
| étoindre : éteindre le feu. Fayo etoindre les chandelles : il fallait éteindre les chandelles. - (33) |
| ëtoindre, éteindre ; ëtoindu ou ëtoignu. - (16) |
| étoindre, v. a. éteindre. - (08) |
| étoindre, v. éteindre, souffler la bougie. - (40) |
| étoindre. v. a. Eteindre. (Sermizelles). - (10) |
| étoindu : éteint. - (29) |
| étoindu, ue. participe p. d’étoindre (éteindre). Eteint, éteinte. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| étoler : ébrancher - (48) |
| étoler : ébrancher. - (52) |
| étoler : ébrancher - (39) |
| étoler, étolner, v. a. ébrancher, couper les branches ou « toles » d'un arbre. - (08) |
| étoler. v. a. Atteler. (Sermizelles). - (10) |
| étômi, adj., lourd, engourdi : « R'mue-te donc ; t'as l'âr d'ein vrâ étômi. » - (14) |
| étômi, celui dont l'esprit est comme paralysé d'êtonnement. - (16) |
| étômi, entemi, entoumi : adj. et s., vx fr. entomi, engourdi, endormi, emprunté, hébété. T'as l'air d'un étômi ! - (20) |
| étonne (m' — voir), je voudrais bien savoir. - (27) |
| étonner (s'), v. r. se tourmenter, être inquiet avant d'entreprendre un travail long et difficile. - (24) |
| étonner (S’) : v. r., devoir être étonné, redouter. Je m'étonne s'il viendra (c'està-dire je serai étonné s'il vient). J'ai si tellement la fièvre que j’ m'étonne d'aller m’ coucher c' soir. - (20) |
| ètonnöt, sm. étourneau. - (17) |
| etoo. Etais, était. Etô, en marquant l'O d'un accent grave, fait le même effet. - (01) |
| étope : Etoupe. « Sa grand mère felait des étopes ». - (19) |
| étôpe, s. f. étoupe, la partie la plus grossière de la filasse de chanvre. - (08) |
| étôpe, s. f., étoupe, filasse pour attacher à la quenouille. - (14) |
| étope. Étoupe. - (49) |
| etopon : ajonc (en A : balai pneu*) B - (41) |
| ètoppe : s. f. étoupe. - (21) |
| étoquer. v. a. Accoter. - (10) |
| étoquoir. s. m. Accotoir. - (10) |
| étordi, v. tr., étourdir, importuner. - (14) |
| étorgi (s') : étrangler (s') - (57) |
| étorne, s. f. étrenne. - (08) |
| étorniau : Etourneau, sansonnet « Eune volée d'étorniaux ». - (19) |
| étorniau n.m. Etourneau. - (63) |
| étorniau. Étourneau. - (49) |
| étot (de l'a.fr. atout, avec l'ensemble, qui a donné item, itou) adv. Pareillement, également, de même. Ah ba, ma étot ! Eh bien, moi aussi ! - (63) |
| étòt, imparf. du v. éte, était : « Ol étòt bé brave. » - (14) |
| étou (adv.) : aussi (également aitau) - (50) |
| étou : aussi - (57) |
| ètou : aussi. Chi tu vins, moué étou : si tu viens, moi aussi. - (52) |
| étou : idem - (57) |
| étou : itou - (57) |
| étou : aussi. T'es content ? mouai étou ! : tu es content ? Moi aussi ! - (33) |
| étou, adv. aussi. - (08) |
| étou, adv., aussi, pareillement. - (14) |
| étou, aitôt : adv. Aussi. - (53) |
| étou, aussi ; me étou, moi aussi. - (16) |
| etou, etôt, atout, ytout. Cette traduction provinciale du latin etiam me semble plus rationnelle que le français aussi... Dans le Morvan, aitou est synonyme de : avec. - (13) |
| étou, itou. adv. Du latin etiam. - (10) |
| étouâgée, étouâ'illie : enjambée - (48) |
| étouaile (n.f.) : étoile - (50) |
| étouaîle (n’) : étoile - (57) |
| étouaile : n. f. Étoile. - (53) |
| étouaîler : étoiler - (57) |
| étouâiller : marcher vite, à grandes enjambées - (48) |
| étouèle : l'étoile - (46) |
| étouèle. n. f. - Étoile. - (42) |
| étoufailli : étouffer - (57) |
| étoufé ; une pomme de terre est dite cuite ai l'étoufé, quand elle est cuite avec sa peau ; on dit moins bien aujourd'hui : cuite en robe de chambre ; en effet, quelle ressemblance y a-t-il entre une robe de chambre et la peau d'une pomme de terre ? - (16) |
| étouffeur, s. f. touffeur, chaleur accablante, exhalaison ou vapeur qui étouffe. - (08) |
| étouffoir : s. m., éteignoïr. Si t’ continues à fourrer tes doigts dans ton nez, t’ vas l’ fair’ venir comme un étouffoir. - (20) |
| étouffouair (n’) : étouffoir - (57) |
| ètoui, ie. adj. ecrasé, ée. - (17) |
| étouinde : éteindre - (48) |
| étouindre : v. t. Éteindre. - (53) |
| étouinte : éteinte. (B. T IV) - D - (25) |
| ëtoul, ëteul, chaume, paille qui reste en terre du blé moissonné. - (16) |
| étoulâ (n.m.) : brin d'éteule pris isolément - (50) |
| étoulâ : chaume (tige de céréale restant dans le sol après la moisson), éteule - (48) |
| etoulâ, s. m. brin d'éteule pris isolément. Il y a beaucoup « d'étoulas » dans ce champ. - (08) |
| étoule (n.f.) : éteule, chaume - (50) |
| étoule : éteule - (48) |
| étoule : éteule (chaume). - (52) |
| étoule signifie aussi étable, parce que le toit en était couvert de chaume. - (02) |
| étoule : emplacement de moisson (nom de champ ou bois) - (39) |
| étoule, champ de blé coupé. - (04) |
| étoule, éteuhle, estouble. s. f. Eteule, chaume laissée sur pied après la moisson. (Athie). Du latin stipula. - (10) |
| étoule, éteule. - (26) |
| étoule, s. f. éteule, chaume qui reste sur place après la moisson. Le lièvre est dans «l’étoule». - (08) |
| étoule, s. f., éteule, chaume : « Dans l'pays, les couverts des mâïons sont tout en étoule. » - (14) |
| ètoule, sf. eteule, chaume coupé, champ après la moisson. On dit une étoule de blé, de seigle, de trémois, d'avoine. - (17) |
| étoule. Chaume, du latin stipula. - (03) |
| étouler, v., enfouir les étoules, par un labour superficiel. - (40) |
| étoules - ce qui reste de la tige du blé dans les champs après la moisson. - Les étoules sont pliennes d'herbe c't-année, les bétes ailant i éte joliment bein ! - En peut menai les vaiches en champ les étoules. – En meune les couchons es étoules ; c'a préque in co de charrue. - (18) |
| étoules : les éteules, les chaumes, la partie non récoltée de la paille dans un champ - (46) |
| etoules et etroubles. Partie inférieure des tiges de céréales, qui restent en terre après la moisson. Ce substantif pourrait venir de stipula qui signifie chaume, tuyau de blé... - (13) |
| étoules, n. fém. plur. ; éteules, ce qui reste au-dessus du sol des tiges des céréales coupées. Se dit aussi des champs moissonnés. - (07) |
| étoules, s. f .pl., ce qui reste dans le champ après la moisson. - (40) |
| étoules. Eteules, chaume des céréales qui restent sur place après la moisson. - (12) |
| étoumi. s. m. Qui ressemble à un idiot, qui a l’air atone, stupide. - (10) |
| etounan, part. présent de « étonner. » facile à inquiéter, à étonner. Être « étounan », être prompt à s'émouvoir ; n'être pas « étounan », c'est avoir du flegme, du sang-froid. - (08) |
| étounance, s. f. chose étonnante, surprenante, merveilleuse : il est si riche que c'est une « étounance ». - (08) |
| étouné (s'), v. r. se tourmenter, être inquiet avant d'entreprendre un travail long et difficile. - (22) |
| étouner : étonner - (48) |
| étouner : étonner - (39) |
| étouner, v. étonner. - (38) |
| étouner, v. tr., étonner, surprendre. - (14) |
| étounner : étonner. I m'étounne : je m'étonne, ça m'étonne, je me demande. - (52) |
| étouordi : étourdi. (B. T IV) - D - (25) |
| étoupe : 2nde qualité de chanvre. IV, p. 15-1 - (23) |
| étoupi (fil). Emmêlé, comme des étoupes. - (12) |
| étoupi, part., étoupé, éteint, bouche : « L'feù ét étoupi. » - (14) |
| etoupi, partie, passé du verbe précédent. Bouché avec une étoupe, et par extension, éteint, étouffé d'une manière quelconque : « l' feu ô étoupi », c’est à dire est couvert de cendres. - (08) |
| étoupi, v. a. étouffer en couvrant, en comprimant. On « étoupit » le feu en le chargeant de cendres. - (08) |
| étoupiau, s. m., étoupe. (V. Étôpe.) - (14) |
| étoupon, s. m. bouchon de paille, de linge, de filasse, etc. dont on se sert pour fermer une ouverture, une fente, un trou. - (08) |
| étoupon, s. m., bouchon fait d'étoupes, de filasse, de linge, de paille, etc. - (14) |
| étoupon. s. m. Paquet de filasse de rebut. - (10) |
| étourniau, s. m., étourneau, garçon léger, étourdi. « T'ét eùn fameux étourniau, va ! » - (14) |
| étousiot. s. m. Hottereau. (Mont-Saint-Sulpice). - (10) |
| étout, aussi. - (05) |
| étrachi : Etrécir. « Ma chausse (mon bas) sera acheteu finie, je commache à étrachi ». - (19) |
| étrain, n. masc. ; paille pour les bêtes. - (07) |
| etrain, s. m. paille, litière. Usité seulement dans une partie du Morvan bourguignon. - (08) |
| ètrain, train, sf. paille ; qqf. fourrage. Fumier. Paillasse. - (17) |
| ètrainge, ètrange, sm. étranger. - (17) |
| ètraingé, vt. opprimer ; exploiter abusivement. - (17) |
| etrainge. Etrange, étranges. - (01) |
| étraîn-ne (n’) : étrenne - (57) |
| étrain-ne : Etrennes, prémices. « T'en a pas ésu l'étrain-ne. - As tu bien ésu des étrain-nes pa le jo de l'an? ». - (19) |
| etraipai. Attraper, attrapé, attrapez. Attraper vient de frapa, comme qui dirait prendre à une trappe. - (01) |
| étrait : étroit - (57) |
| étrandzi : étranger - (43) |
| étraner. v. a. Etrangler. Du roman estraner, et du latin strangulare. - (10) |
| étrange : adj., étranger, différent. - (20) |
| étranger quéqu'un, loc., le traiter en étranger, lui vendre plus cher qu'à une pratique habituelle : « Ah ! ben voui ! ô m'a brament étrangée ! » - (14) |
| étranger : v. a., vx fr. estrangier (éloigner), traiter un client en étranger, lui surfaire la marchandise, ce qui a pour effet de l'éloigner. - (20) |
| étrangi : Substantif et adjectif Etranger. « Cougnis tu ces gens ? Man fa nan, i sant étrangis au pays ». - Verbe. Exploiter : « J'ins pris eune bonne marande à peu l'aubargiste ne nos a pas étrangis », nous avons fait un bon dîner et l'aubergiste ne nous a pas fait payer trop cher. - (19) |
| étrang'lli : Etrangler. « Quand i li vint du mande alle a vite fait d'étrang'lli in poulot ». - (19) |
| étranguelle (J’), tu étranguelles, il ou all étranguelle, manière dont se prononce, à Saint-Martin-sur-Ouanne et dans plusieurs autres localités, l’indicatif présent du verbe étrangler. - (10) |
| étran'illi : étrangler - (57) |
| étran'illou (n) : étrangloir - (57) |
| étranyi : (vb) étrangler, tordre le cou - (35) |
| étran-yi : étrangler, tordre le cou - (43) |
| étrañyi v. Etrangler. - (63) |
| étraper : Attraper « Ol a pris la pu greusse poire seurement alle s'est trouée blieuche, ol a été bien étrapé. Les gormands sant toje étrapés. » - Atteindre « Je li ai bin coru après mâ j'ai pas pouyu l'étraper ». - (19) |
| étrat : Etroit. « Ces sulés ne me vant pas, i me sant treu étrats » « avoir le gousier étrat », n'être ni bon buveur ni gros mangeur. - (19) |
| etraubiÿe : étable - (51) |
| etraubiÿi : rentrer les animaux à l’étable, hiverner le bétail - (51) |
| étrauble : s. f., étable. - (20) |
| étraubye : (nf) étable - (35) |
| étraubyi : (vb) rentrer (les bêtes) à l’étable - (35) |
| étraubyi, rtraubyi : rentrer à l'étable - (43) |
| étraver. v. a. Mettre le foin en viottes (en veillottes) au bout du pré, pour qu’il soit chargé plus facilement sur les voitures. (Sens). — Dans un sens général, étraver veut dire apporter. - (10) |
| étre : être - (57) |
| être : Etre (verbe) Prononcer : être devant une voyelle et êt' devant une consonne Le verbe se conjugue comme suit : Indicatif présent : je sus, t'es, ol est, je sins, vos êtes, i sant. Imparfait : j'étais, t'étais, ol était, j'étins, vos étaie, i étint Passé défini, peu usité : j'ère, t'ères, ol ert ou ol était, j'érins, vos èrent, i érint. Futur : je serai, te seras, o sera, je serins, vos serez, i serant. Subjonctif présent : que je sais, que te sais, qu'o sait, que je sayins, que vos soyez, qu'i sint. Subjonctif passé : que je feusse, que te feusses, qu'o feusse, que je feussins, que vos feussent, qu'i feussint. Participe passé étant, été. - (19) |
| être après : être en train de faire quelque chose - (43) |
| être beugni : recevoir un gros coup - (43) |
| être ça, être cela : loc, falloir, convenir. C'est pas ça qu'est ça, ce n'est pas ce qu'il faut, ce n'est pas ce qui convient. - (20) |
| être force, loc., être d'obligation : « Que v'lez-vous ! yé ben force que j'y fasse. » - (14) |
| etre. Etre. Le bourguignon être se prononce comme piètre, le français être comme prêtre ; on dit aussi « les étre d’éne moison », les êtres d'une maison, c'est-à-dire les routes, les adresses. - (01) |
| étrebot (pour éterbot, éleurbot, éturbot). s. m. Tourbillon de vent. Ce n’est pas autre chose que le mot latin turbo, un peu défiguré par la prononciation de nos paysans. ( Mont-Sain t-Sulpice). - (10) |
| etrein. s. m. Grosse paille de blé. (Argenteuil). - (10) |
| étreinglier (prononcez étrein-yer, en mouillant le gl). v. a . Etrangler. Du latin extringere. (Arcy-sur-Cure). - (10) |
| étreit (adj.) : étroit - (50) |
| étreit, e, adj. étroit. Comme « dreit » - (08) |
| etrenai. Etreuner, étrenné, étrennez. - (01) |
| étrènghyé, étrangler (gh dur). - (16) |
| étrépote, attrapoire. - (16) |
| êtres : s. m. plur., constructions extérieures ou annexes d'un bâtiment, telles que appentis, galeries, escaliers, etc. Il faut orthographier aussi êtres (et non aîtres) le mot par lequel on désigne les dispositions intérieures d'un bâtiment et les meubles qui s'y trouvent. Les personnes qui écrivent aitres et qui se croient en cela bien « averties », comme on dit aujourd'hui, sont en réalité des double-six (voir couyon). Le mot aitre, qui correspond au latin atrium, signifie cour, parvis, etc. - (20) |
| êtres : toujours au pluriel - partie de la maison recouverte par l' avancement du toit. - (21) |
| etrésillon : petits liteaux de bois qui servent à espacer les plateaux de bois fraichement scier - (51) |
| etrésillonner : caller avec des étrésillons - (51) |
| étrèt, adj., étroit, borné, resserré. - (14) |
| é-treu : étroit - (43) |
| ètreunne, sf. étrenne. - (17) |
| étreûyi : (vb) panser, étriller - (35) |
| étreuyi : étriller - (43) |
| étrever, dzever : énerver quelqu'un - (43) |
| étrî n.m. Etrier. - (63) |
| étri. adj. - Moisi, en parlant du linge ; synonyme d'utri. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| étrillè : gratter - (46) |
| étrilli : étriller - (57) |
| étrilli : Etriller. « As-tu bien étrilli le chevau ? ». - Faire payer un prix exagéré. « J'ins bin pa mau marandé, seurement j'ins été étrillis. Oh ! cen ne me seurprend pas, dans (s'te) c'te gargeute l'étrille est daré la pôrte ». - (19) |
| etrilli. Etrillai, étrillas, il étrilla. - (01) |
| étrillou, s. m. petite aiguille de bois qu'on emploie pour dévider le fil. - (08) |
| ètrindié, vt. étrangler. - (17) |
| étringuiè : étrangler - (46) |
| étriñne n.f. Cadeau, pourboire, étrenne. - (63) |
| etriote, s. f. ivraie. - (11) |
| étriper. v. a. Serrer trop fortement, serrer à faire sortir les tripes. Tu me serres trop, tu m’étripes. (Sommecaise). - (10) |
| étrippé, éventré. - (04) |
| ètrôbye : écurie. - (21) |
| étrocher, v., rabattre la cime d'un arbre. - (40) |
| étrogne. s. f. Tronc d’arbre étèté et qui pousse des rejets qu’on élague de temps en temps. - (10) |
| étrogner (pour étronçonner). v. a. Couper la tête d’un arbre, n’en laisser que le tronc. — Se dit aussi pour couper les étrognes. - (10) |
| étroichener, v. a. briser, couper, détacher les trochets ou rameaux en corymbes de certaines plantes, du sarrazin principalement. - (08) |
| étroinge (adj.) : étrange - (50) |
| étroinge, adj. étranger, dépaysé, désorienté : « i m' seu troué étroinge en c' pais-quite ». - (08) |
| etroinge, s. m. étranger, une personne d'un autre pays. - (08) |
| étroinger, v. a. gêner, contraindre, embarrasser : « i n' veu nun étroinger », je ne veux gêner personne. - (08) |
| étroinguier, v. a. étrangler. - (08) |
| étroinyer (v.) : étranger - (50) |
| étroinyer : étrangler - (39) |
| étroncener, v. a. tronçonner, couper les petites branches d'un arbre ou d'un arbuste. (Voir : troncener.) - (08) |
| etroncher (verbe) : tailler les haies. - (47) |
| étroncher : v. a., vx fr. estronchier, étronçonner. - (20) |
| étronner (prononcez étron-ner). v. a. Etrogner, élaguer. (Lindry). - (10) |
| étropage : action d'étropai. - (33) |
| étropai : tailler une haie à l'aplomb. - (33) |
| étropement, s. m. extirpement ; action d'arracher, de couper à fleur de terre les racines d'arbres ou d'arbustes. - (08) |
| étroper : tailler verticalement (une haie) - (48) |
| étroper, v. a. couper à fleur de terre ou même arracher des broussailles, des genêts, des bruyères, etc. on « étrope » les champs de balais (voir : balai et genêtre) avant d'y mettre la charrue. - (08) |
| étroperir : faire brûler les étroperies (déchets produits par l'étropage). - (33) |
| ètrossée : espace de terrain compris entre le fossé qui partage le champ et son extrémité. - (21) |
| étrosser : raccourcir en coupant - (57) |
| étrossi : étêter - (57) |
| étrouble, n.f. éteule. - (65) |
| étrouble, s. m., blé coupé, dont il reste assez de paille toutefois pour que le chanvre et le sarrazin sèchent sans trop toucher terre ; chaume, champ de blé moissonné. « Le chanvre, après avoir été roui, est séché sur l'étrouble. » — « Sarrazin d'étrouble, c'est-à-dire semé sans engrais ni labours préliminaires. » Le Verdunois dit plus volontiers Étoule. - (14) |
| étroubyeu : chaume après la moisson (étoule). - (30) |
| étrougnues (étrognures). s. m. pl. Branches provenant d’étrognes qu’on a élaguées. (Sommecaise). - (10) |
| étrouin'yer : étrangler - (48) |
| etroussée, s. f. espace délimité dans une vigne par deux allées transversales. - (24) |
| étrub’ille (n’) : chaume (champ d’) - (57) |
| étrubion (n') : chaume (reste de la tige de paille) - (57) |
| étrubions (des) : éteule - (57) |
| étrublle, étrubllions, éteule, chaume. - (05) |
| ètrubye : 1° chaume, 2° champ après la moisson. - (21) |
| étruchoué. s. m. Petit instrument de bois, ordinairement en sureau et en forme de mirliton, dont on se sert pour dévider du fil en pelote. (Saint-Martin-sur-Ouanne). - (10) |
| étrugniau. s. m. Etourneau. (Rugny). - (10) |
| éts’lette : (nf) échelle de char - (35) |
| éts’leute : échelle de char - (43) |
| étsalî n.m. (de l'a.f. eschalier) Echalier : échelle double permettant de passer par dessus les haies ; les barres de bois permettant d'escalader les barbelés sans se blesser s'appellent des sauteux. On dit aussi étséli. A Suin on dit plutôt échlet, terme peu employé à Sivignon. - (63) |
| etsarpeûter (s’) : (vb) gesticuler en parlant, s’emporter - (35) |
| etsarri : ébouillanter. - (30) |
| etsauder : échauder - (51) |
| étsaudi v. Echauder. - (63) |
| étséli n.m. Voir étsali. - (63) |
| étselle : échelle - (43) |
| etselle : échelle - (51) |
| etselli : petite échelle pour passer par-dessus les clôtures - (51) |
| étserper : discuter violemment - (43) |
| étseule n.f. Echelle. - (63) |
| etsevêchi : couper les fanes des betteraves ou des carottes. A - B - (41) |
| etslette : petite fourragère à l'avant des chars à foin - (51) |
| étslette n.f. Petite échelle à l'avant du char. - (63) |
| étsnau : (nm) chéneau - (35) |
| etson : hache - (51) |
| etsope : petite enclume pour battre les faux - (51) |
| étsoreyi : tirer les oreilles - (43) |
| étsvéchi v. Effeuiller, retirer les fanes. - (63) |
| étsvessi : enlever les fanes de betteraves, de carottes - (43) |
| ettatse : attache - (51) |
| ettatses : attaches - (43) |
| ettatsi (attatssi) : attacher - (51) |
| èttendre : attendre - tu m'è fait èttendre, ton dignè é gueûmè, cè vè pas êt'bon !, tu m'as fait attendre, ton dîner a traîné, ça ne va pas être bon - (46) |
| étuelle - écuelle. - Aivant de t'en ailai, échaude quemant qu'en fau tote nos étuelles. – Té don cassé l'étuelle du chait ? - (18) |
| étuelle, s. f. écuelle, petit vase de forme arrondie dans lequel on dresse la soupe - (08) |
| étuer : mouiller un fût pour le rendre étanche, étuver - (43) |
| étuer : v. a., étuver. - (20) |
| étule : n.f. Éteule. - (53) |
| étuotte (pour étirotte). s. f. Petit morceau de bois servant à étirer la mèche d’une lampe. (Montillot). - (10) |
| étu-yer, v. remuer les cendres d'un foyer. - (38) |
| étwer v. Mouiller pour rendre étanche, étuver. Voir éteuyi. - (63) |
| étyal, écuelle de bois. - (16) |
| eu (n’) : œil - (57) |
| eû : (nm) œil - (35) |
| eû : œil - (43) |
| eu : œil - (51) |
| eu : Os. « O s'est copé jeusqu 'à l'eu ». « N'avoi que la piau à peu les eus » : être très maigre. « Donner des eus à reugi à quéquin », tenir en sa présence des propos qui peuvent froisser. - Noyau. « Des eus de cheriges » - (19) |
| eû : un oeuf - (46) |
| Eu ; au singulier ; euf, au pluriel, contrairement à la prononciation française. - (16) |
| eü, évu. partic. p. d’avoir. J’ai évu mal aux dents toute la nuit. Il a éii si peur, qu’il en tremble encore. - (10) |
| eu, oeuf. - (26) |
| eu, s. m. os. - (24) |
| eû, s. m., œuf. - (14) |
| eu. Eus, illi. - (01) |
| eu. Syllabe surnuméraire locale, qui s’ajoute à tort et à travers entre deux mots. Ex. : cart’eu d'visite, pour carte de visite; poudr'eu d’perlimpinpin, pour poudre de perlimpinpin ; Arc-eu-sur- Tille pour Arc-sur-Tille, etc… - (12) |
| eubeurdi, euberdi. adj. - Imbibé, abruti par l'alcool : « Ben du bruit pas très ben d'ouvrage, euberdis quasiment toujours.» (Fernand Clas, p.35) - (42) |
| eûbiè : oublier - (46) |
| eubier, oublier. - (26) |
| eubiyer : oublier - (43) |
| eubjié, vt. oublier. - (17) |
| eubjigé, vt. obliger. - (17) |
| eubligi : Obliger, forcer. « Ol a bin été eubligi de payer le demâge ». - (19) |
| euchi, v. n. avoir des nausées. - (24) |
| euching (n.m.) : essaim - (50) |
| euclé, vn. respirer difficilement, haleter. - (17) |
| eude : cheville en fer qui tient la roue dans l'essieu - (60) |
| eue, ie, eun(e), eun' : art. Un, une. - (53) |
| euffeurtoire : Offertoire, service religieux. - (19) |
| euffri : Offrir. « Y est la Françoise qu'a euffri le pain bénit dimanche ». - (19) |
| euffri, v. a. offrir. - (08) |
| eugaigne ou eugeigne, mauvais cheval. (Voir au mot chevau.) - (02) |
| eugaigne ou eugeigne. : Mauvais cheval. - (06) |
| eugaingne, sf. vieux cheval, rosse efflanquée. - (17) |
| euger. v. a. Appeler, crier. (Véron, Nailly). - (10) |
| eugne, pour un. Se prononce ainsi quand le mot termine la phrase. - (10) |
| eûgnon : (nm) oignon - (35) |
| eugnon : oignon - (51) |
| eugnon, woignon n.m. Oignon. - (63) |
| eûgnons : oignons - (43) |
| euguer : Arranger, attifer. « Ol est tojo si bin mau eugi », il est toujours tellement mal habillé. - (19) |
| euill', ll mouil. s. m. œil, organe de la vue. - (08) |
| euillasse (nom féminin) : pie. On dit aussi ouillasse, eguiche ou ageasse. On dit également margot. - (47) |
| euille : oie - (43) |
| euille. QEil et yeux. Nos anciens écrivaient eul et prononçaient euil ils écrivaient de même deul, orgueul, cercueul, quoiqu'ils prononçassent deuil, orgueil, cercueil… - (01) |
| euille. : Pour yeux. Pissai dés euille, c'est-àdire pleurer abondamment. L'image est forte et vraie, quoique choquante. - (06) |
| euillére : l'oeillère du cheval - (46) |
| eûillô : les oeillets des chaussures dans lesquels passent les lacets - (46) |
| euillon : s. m., aiguillon. - (20) |
| euillot (n.m.) : oeil - (50) |
| euillot, s. m. œil - (08) |
| euillot. s . m. Entonnoir. Du vieux mot eut (oculus), et de eullîer (ouiller), remplir jusqu’à l’œil, jusqu’à la bonde, en parlant d’un tonneau. (Montillot). - (10) |
| euillots - (39) |
| eûjon, s. m., oison, au propre comme au figuré. - (14) |
| eul art. L' (façon de transcrire un l' accentué placé entre un e muet et une consonne : ôl est bié brave eul Dzacqu'lin !). - (63) |
| eule. s. f. Huile ; du latin oleum. De la boun’ eule. - (10) |
| euler, v. n. hurler, pousser des hurlements. - (08) |
| eûlever, v. tr., élever, instruire, éduquer. - (14) |
| eulmaisse : limace - (48) |
| eulmèche : limace. - (21) |
| euls (pr.pers. 3ème pers.fém.pl.) : elles (euls pour le cas régime, a pour le cas sujet) - (50) |
| euls, pron. pers. de la 3" pers. pluriel, féminin. Elle se dit « euls » pour le régime, et «a» pour le sujet : « a son mailaides ce fon-nes-laite », elles sont malades ces femmes-là ; « c' nô pâ por-z-euls », ce n'est pas pour elles. « Lé » s'emploie pour elle au singulier. - (08) |
| eul'ver, v. a. élever, nourrir, instruire un enfant. - (08) |
| eulvin, s. m. alevin, jeune bétail qu'on élève, petits veaux. Environ de Château-Chinon, Frétoy, Anost, etc. (voir : alvin.) - (08) |
| eumabe. adj.- Aimable. - (42) |
| eumâble aimable - (48) |
| eumai, eumant, eumerains - aimer et divers temps de ce verbe. - En fau bein eumai le bon Dieu et pu ses père et mère. – Al airo velu qui eumeussains son peut gairson. - Ah c't-ile lai ! ile eumo bein ailai es offices. - (18) |
| eum'cho : un peu - (46) |
| eum'chot : un peu - (48) |
| eumé : v. t. Aimer. - (53) |
| eumer (v. tr.) : aimer - (64) |
| eumer (v.t.) : aimer - (50) |
| eumer : aimer - (48) |
| eumer : aimer. - (32) |
| eûmer, v. a. aimer. La prononciation appuie sur la première syllabe : « c'te fon-ne-laite eûme bin se p'tios », cette femme-là aime bien ses enfants. - (08) |
| eumer. v. - Aimer. - (42) |
| eun', eu ne, euns : art. Une, une, uns. - (53) |
| eun, eune : Un, une Le masculin eun s'emploie devant une voyelle ou un h muet et se prononce eune. « Eun ujau, eun homme » ; devant une consonne on emploie in « in bû, in chevau ». Le féminin eune s'emploie dans tous les cas eune maijan, eune écurie, eune histoire ». « N'en fare ni eune ni deux » ne pas hésiter. - (19) |
| eùn, eùne, adj., un, une. - (14) |
| eun, eune, s. numéral, lin, une. - (08) |
| eun', un' art. ind. Un (seulement devant une voyelle ou un h) : eun' heurchon, eun' ujeau, eun' û pné, un' homme. - (63) |
| eune (att.ind.fém.sing) : une (aussi eine, ène) - (50) |
| eûne : une - (43) |
| eune : une - (46) |
| eune : une - (48) |
| eune art. ind. Une. - (63) |
| eune, ène. adj. num. et art. - Un, une : eune houmme. - (42) |
| eune, une ; à la fin d'une phrase : j'n'en von qu'eune : Je n'en veux qu'une. - (38) |
| euni, v. a. unir : « a son bin eunies entre-z-eules », elles sont bien unies entre elles. - (08) |
| eunion, s. f. union. - (08) |
| eûnorme, adj. énorme. On appuie sur la première syllabe. - (08) |
| eunpoichenot, adv. de quantité ou subst. peu, un peu, une petite quantité. - (08) |
| eupiniâtre : Opiniâtre, entêté, taquin « si ces enfants avint été bien élevés i ne saraient pas si eupiniâtres ». - (19) |
| euppe : partie supérieure de la houe - (43) |
| eur. : Terminaison des subst. latins en or, se change souvent en eu, comme auteu pour auteur ; et eu, terminaison des subst. latins en osus, se change souvent en ou, comme aimorou pour amoureux. - (06) |
| euragner. v. a. Aiguillonner les bœufs, fouetter les bestiaux, les chevaux, pour les faire marcher plus vite. De erre, route, chemin, marche, voyage. (Chassignelles). — A Chàtel-Censoir, on dit aragner. - (10) |
| euraigne ou euraignie : Araignée. « Des toiles d'euraignies » En parlant d'une chose dont on ne se sert pas « I va s'y mentre des euraignies» - (19) |
| euraingné, vt. molester ; agacer. - (17) |
| eurbondi, v. n. rebondir, bondir de nouveau. (Voir : bondener.) - (08) |
| eurbouécher, v. a. reboucher, boucher une fois de plus. - (08) |
| eûrç’é : très fatigué (ou) « assommé » par la boisson - (37) |
| eurc’moincer, v. a. recommencer, faire quelque chose une fois encore : « les ouiaux aiveient ercoomoincé d'çanter. » - (08) |
| eurcevouâ, v. a. recevoir. au part. pass. « eurçu » : « i é eurçu d' lu dix pistoles », j'ai reçu de lui, etc. - (08) |
| eurche : grosse giboulée. A - B - (41) |
| eurche - herse. - Voyez orche et orcher, autres prononciations. - (18) |
| eurché : fatigué - (44) |
| eurché : adepte de la bouteille. - (66) |
| eurchi, v. n. avoir des nausées. - (22) |
| eurchi, v. n. avoir les cheveux dressés de peur sur la tête. - (24) |
| eurchon : hérisson. A - B - (41) |
| eûrchon : hérisson - (37) |
| eurchon, subst. masculin : hérisson. - (54) |
| eurconduite, eurcondeute, s. f. reconduite. Faire la reconduite à un individu c'est l'accompagner dans sa course ou sa promenade. - (08) |
| eurconsoler, v. a. reconsoler. - (08) |
| eurcôpe, s. f. recoupe, rigole dans un chemin ou dans un champ. - (08) |
| eurdingotte. s. f. redingotte, habit - (08) |
| eurdzent, ente adj. (de urgent) Voleur, chapardeur, en parlant d'un chien ou d'un chat notamment. - (63) |
| eurdzenter v. (de urgent) Se jeter sur la nourriture sans attendre d'y être invité. - (63) |
| eurègne : araignée. - (21) |
| eurègne, s. f. araignée ; toile d'araignée. - (22) |
| eureuse (nom féminin) : année. - (47) |
| eurfromer (v.t.) : refermer - (50) |
| eurfromer, v. a. refermer, fermer une fois de plus. - (08) |
| eurfuge, s. m. refuge, asile, abri. - (08) |
| eurgairder, v. a. regarder. - (08) |
| eurgiper (s') : démener (se) - (48) |
| eurgippai, airgippai (?) : se démener. - (33) |
| eurichan : Hérisson. « Ol a tué eun eurichan ». Porte-bouteille composé d'un cylindre de bois dressé sur un socle et portant sur tout son pourtour des chevilles qu'on introduit dans le goulot des bouteilles vides. - (19) |
| euriot (pour euillot). s . m. Petit entonnoir de fer-blanc. - (10) |
| eûriot ben ! (ai l’) : (il) riait beaucoup ! - (37) |
| eurjeter, v. a. rejeter. « Erzeter. » - (08) |
| eurlanci, v. a. relancer, gourmander, malmener quelqu'un. - (08) |
| eurleuver, v. a. relever, lever une autre fois. (Voir : leuver.) - (08) |
| eurligion, s. f. religion, culte religieux. « Erlizion. » - (08) |
| eurligiou, ouse. adj. religieux. - (08) |
| eurliques, s. f. reliques, objets sacrés. - (08) |
| eurlôge, horloge. - (26) |
| eurloge, rloge, sm. horloge. - (17) |
| eurluquer, v. a. reluquer, regarder, considérer avec attention, avec une sorte d'intensité qu'explique la convoitise. - (08) |
| eurméde, s. m. remède, médicament. Morvan nivernais « erméde, arméde. » - (08) |
| eurmerquâble, adj. remarquable. - (08) |
| eurmerque. v. a. remarque. (Voir : remerque, merque.) - (08) |
| eurmontrance, s. f. remontrance, semonce. - (08) |
| eurmontrer, v. a. montrer à, enseigner, instruire. C’est un bon maitre, il « eurmontre » bien ses élèves. - (08) |
| eurné : éreinté. - (33) |
| eurniquer, v. a. refuser quelque chose à quelqu'un. - (08) |
| eûrnîre n.f. Ornière. - (63) |
| eurnoille : voir guernouille - (23) |
| eurnoueille ; voir guernouille - (23) |
| eurnoueille, s. f. grenouille. (Voir : renoueille.) - (08) |
| eurœgne, s. f. araignée ; toile d'araignée. - (24) |
| eurpas, s. m. repas, nourriture prise à une certaine heure. - (08) |
| eurphelin : Orphelin. « Ol était tou sou (seul) c 'ment in paure eurphelin ». - (19) |
| eurproucher, v. a. reprocher, faire un reproche. - (08) |
| eurqueuler, v. a. reculer, aller ou mener en arrière. Le charretier crie à son cheval qu'il veut faire reculer : « eurqueule, eurqueule » ! - (08) |
| eurse : bourrasque - (43) |
| eursemblance, s. f. ressemblance. Un peintre habile attrape bien « l'eursemblance » du modèle. - (08) |
| eursembler, v. a. ressembler, avoir de la ressemblance avec quelqu'un en quelque chose. - (08) |
| eurssé(e) : très mouillé(e), très las le poil d'une bête très mouillée - (39) |
| eursson, rsson, sm. hérisson. Graine munie d'aspérités après le vannage. - (17) |
| eurtère : litière. À l'eurtère = bétail malade n'ayant plus la force de se relever. A - B - (41) |
| eurtie : ortie - (43) |
| eurtie : ortie - (51) |
| eurtie : Ortie (urtica dioïca) « Alle mériterait qu'an la fouate dave des eurties». En plaisantant : « Empogne dan ces eurties, te n'en risques ren, i ne piquant pas ce mois. - Non mâ i piquant bin les mains ». - (19) |
| eûrtie : ortie. - (62) |
| eûrtie n.f. Ortie. - (63) |
| eurtie, ourtie. Ortie. - (49) |
| eurtie, s.f. ortie. - (38) |
| eurtie. s. f. Ortie. (Pasilly). - (10) |
| eûrtie: (nf) ortie - (35) |
| eurveni, v. a. revenir, venir une autre fois. - (08) |
| eus (des) : yeux - (57) |
| eusa : usé. - (29) |
| euse - usure, dans le sens de détérioration. - Voiqui mon chaipais que s'en vai sur l'euse. - C'a fini, sai santai â eusée ! - (18) |
| eûse : usé, usagé - (37) |
| eûse ! (ai l’ot ben) : (elle est très) usagée ! - (37) |
| eusé, vt. 1) oser. 2) user. - (17) |
| euser : oser - (43) |
| euser : User. « Ma culotte est eusée es geneus». - En présentant sa tabatière ouverte : « En eusez vos ? » « Tiri su l'euse », toucher à sa fin en parlant du contenu d'une futaille. « Ma fillette (ma feuillete) de vin blianc tire su l'euse » - (19) |
| euser, v. user. - (38) |
| eussaint - temps du verbe avoir. - En fauro pou bein fâre qu'al eussaint fini ai médi. - (18) |
| eusse : eux - (44) |
| eusse, sf. 1) esse, cheville qui maintient la roue dans l'essieu. 2) eusse ! int. arrière ! s'emploie avec les bœufs de trait. - (17) |
| eusse. Eût, habuisset. Le bourguignon eusse se dit des trois personnes, et la diphthongue eu s'y prononce comme dans le français jeu, feu, cheveu. - (01) |
| eussein. Eussions, eussiez, eussent. - (01) |
| eusserö, sm. tarière, outil pour percer à la main. - (17) |
| eusses. pron. pers. -. Eux. - (42) |
| eûtè : ôter, enlever - i eûte mè veste pass'què fait chaud, j'enlève ma veste parce qu'il fait chaud - (46) |
| eûti (n. m.) : outil - (64) |
| euti : outil. Au sens propre et figuré. Ex : "Ce ch'tit gars, c'est un euti !" "Le loufou, il perdait ben tous ses eutis !" - (58) |
| eûti. n. m. - Outil. - (42) |
| euti. s. m. Outil. Un petit eutil. Un mauvais, un boun eutil. - (10) |
| euties, n. fém. plur. ; orties. - (07) |
| eutil ou util : Outil. « In ban ovré prend soin des ses eutils ». Au figuré : « Alle n'est pas tant seurement bien peute. -Oh nan y est in brave eutil », elle n'est pas si laide que ça : penses-tu, c'est un vilain outil moi je la trouve laide. - (19) |
| eutji, sm. outil. - (17) |
| eutjie, sf. ortie. - (17) |
| eutsi : contractions de l'estomac - (43) |
| euve - filasse de chanvre beau et bien préparé pour filer ; actions quelconques. - I ons beillé tote note euve ai fêlai. - Oh ! lai jolie euve que vos é lai ! Ci vai fâre ine jolie toile. - Quemant qu'en dit, le père Pierrot é de l'euve dans sa quelogne. - I eume aissez les Gossot, mouai c'â des gens que faisant bein des bonnes euves. - (18) |
| euvë, poule, carpe, qui a beaucoup d'oeufs. - (16) |
| euvradze : ouvrage - (51) |
| euvradzi : ouvrager - (51) |
| euvrai (à l'). À l'abri du froid, du vent. - (49) |
| eûvre, filasse, chanvre prêt à être filé. - (16) |
| euvrë, ouvrée, ancienne mesure agraire de quatre ares vingt-huit centiares. Il faut conserver ce mot beaucoup plus court que quatre ares vingt-huit centiares. - (16) |
| eûvre, s. m., filasse, chanvre adapté à la quenouille pour être filé. Filer était l'œuvre par excellence des femmes. - (14) |
| euvre. Chanvre apprêté pour être filé. - (03) |
| euvre. Filasse, nommée euvre en bourguignon par les femmes, qui en faisaient autrefois leur ouvrage le plus ordinaire… - (01) |
| euvrée, ouvrée. : Mesure à graine représentant un huitième du journal de vigne. – Quoique le mot ouvrée ait prévalu, euvrée est préférable, à cause de l'oeuvre ou ouvrage qu'un vigneron peut faire en un jour. (Voir au mot ouvrée.) - (06) |
| euvrée. On dit aujourd'hui ouvrée. C'est une mesure agraire valant le huitième du journal. Quoique le mot ouvrée ait prévalu, euvrée ou œuvrée serait préférable, comme venant du mot œuvre, à cause de l'œuvre ou ouvrage qu'un vigneron peut faire en un jour. En latin opus. - (02) |
| euvre-gueule : Litt. ouvre-gueule. Badaud flaneur, « Quand je traveillins je n'ins pas faute d'euvre-gueules vé nos », quand nous travaillons, nous n'avons pas besoin de badauds vers nous. - (19) |
| euvrenage (à l’), loc. placé dans un endroit sombre et frais. - (22) |
| eûvrers (dâs) : (des) ouvriers - (37) |
| eûvri (à l') (or. inc.). A l'abri du vent. - (63) |
| euvri (à l') : A l'abri du vent. « J'étins bin à la coi mâ je n'étins pas à l'euvri », nous étions bien à l'abri de la pluie mais nous n'étions pas à l'abri du vent. - (19) |
| euvri (à l') : adv. à l'abri. - (21) |
| eûvri (à l’) : (nm) à l’abri du vent - (35) |
| eûvri (à l’) : à l’abri du vent - (43) |
| euvri (p.p.) : participe passé du verbe ouvrir - (50) |
| eûvri : (vb. p.passé) ouvrir, ouvert - (35) |
| euvri : ouvrir - (51) |
| eûvri : ouvrir, ouvert - (43) |
| eûvrî : ouvrir. - (62) |
| eûvri : Ouvrir. « J'ai rencontré eune brigade de saoûlans que chantin à grande gueule êuvrie (à gorge déployée) ». Proverbe : « I n'y a point de voleus de porte euvrie », les voleurs n'entrent pas dans une maison dont la porte est ouverte, persuadés qu'ils n'y trouveraient rien à prendre. - (19) |
| eûvri v. Ouvrir. - (63) |
| euvri(à l') : à l'abri - (51) |
| euvri, adj. ouvert. Verbe euvri. - (24) |
| euvri, euvreussaint - divers temps du verbe ouvrir. - Voiqui qu'a venant, allez don lio z-euvri. - Lai porte à tote euvrie, à grand lairge. - I vouraint qu'al euvreussaint lai croisée, ai cause de l'air. - (18) |
| euvri, ouvrir. - (26) |
| euvri, v. ouvrir. - (38) |
| euvri, v., ouvrir. - (40) |
| euvri, vt. ouvrir. - (17) |
| euvri. Ouvrir, vieux mot. - (03) |
| euvrö, sm. ouvrier. - (17) |
| euvröge, sm. ouvrage. - (17) |
| euyi, s. m. aiguillon de bouvier. - (24) |
| euyo d'beu, « oeil de bœuf » : 1 - désigne les grosses bulles que forment les gouttes de pluie en tombant sur une flaque d'eau. – 2 - nom du colchique en graines en été. - (45) |
| eûzè, oser et user. - (16) |
| euzerôle, érable. - (02) |
| euzerôle. : Erable (Del.). - (06) |
| euzet : usé - (48) |
| euzille : l'oseille - (46) |
| euzioler : se divertir inconsciemment. (S. T IV) - S&L - (25) |
| évachir (S’). v.pron. S’avachir, devenir mou, s’élargir, en parlant du cuir et de certaines étoffes. Les chaussures, à la longue, finissent toujours par s’évachir. - (10) |
| évâcler, v., tiller le chanvre. - (40) |
| évadai - à peu prés le même sens que évarai, mais ne se dit que des personnes. Effrayé comme quand on court un grand danger. - I l'on rencontrai al éto quemant un évadai. - (18) |
| évâdé, part, passé qui s'emploie substantivement. Écervelé, extravagant, celui qui parle à tort et à travers, qui bat la campagne dans ses actions ou dans son langage. - (08) |
| evâdée : n. f. Correction, bastonade. - (53) |
| évâder, v. a. chasser, mettre en fuite, pousser dehors : « qu'a veune, i l'évâderai brâman », qu'il vienne, je le ferai joliment partir, je le pousserai comme il faut ; « évâder » les mouches, les chasser. - (08) |
| évagât. s. m. Trombe d’eau. Du vieux mot agaster , gâter, dévaster. (Soucy). - (10) |
| evaingille. Evangile. Evaingilles e prononce comme fille. - (01) |
| évaini : évanouir (s') - (57) |
| évaini, vain, sans force. - (05) |
| évairai - chasser les mouches. - Les moches sont enraigées aipré les chevaux ; évaire-les pendant qui ailons chairgeai. - Ne vais pas copai lai quoue de ceute bête : ile ne pouro plus s'évairai. - (18) |
| évairai, chasser... - (02) |
| evairai. : Chasser, effrayer, mettre en fuite. - Pris au sens neutre, s'éuairai signifie s'égarer, s'esquiver ; dans ce sens, l'étymologie latine evadere est plus rationnelle. - (06) |
| evaire. Tu t’évaire, tu te sauves, tu te retires, tu décampes. El al évairai, ou ai s’at évairai, il est parti, il s'est retiré… - (01) |
| évairer (C-d., Chal., Br., Morv.) - Chasser, mettre en fuite ; s'évairer, fuire. Fertiault fait une différence entre évairer, chasser et evarer, égarer ; ce dernier mot paraît être la corruption de égaré. Dans l'Yonne, évaré signifie effrayé, effaré, ahuri; par exemple : des poules évarées, des moutons évarés. L'origine est évidemment la même et donne l'étymologie qui paraît être effarer, c'est-à-dire, chasser en effrayant… - (15) |
| évairer, actif et neutre. Dans le premier cas il signifie chasser ; dans le second, s'égarer. - (03) |
| évairer, et evèrer, v. tr., effrayer, chasser, mettre en fuite. - (14) |
| évairer, v. a. chasser, mettre en fuite, pousser dehors, disperser. - (08) |
| évairer. Rabelais s'est servi de ce mot qui n'est plus guère employé que dans cette locution : évairer les mouches. C'est la traduction presque littérale du latin everere : chasser avec un balai. Un évaire-môche est une verge dont les lanières sont en papier. - (13) |
| évaler : Avaler. « Ol a d'abord fait dévaler un varre de vin ». Au figuré : « Oh! cen je ne peux pas y évaler », oh cela je ne peux pas l'admettre. « Eun évale to cru », un gros mangeur et aussi un fanfaron, un tranche montagne. - « Morciau évalé n'a plieu de goût », quand la peine ou le plaisir sont passés on n'en ressent plus l'amertume ou la douceur. - (19) |
| évâler : se dit en parlant de feu s'allume - (39) |
| évalon (pour avalon). s. m. Gorgée. - (10) |
| évaltonée, personne étourdie, évaporée, peu sérieuse, agissant sans réfléchir. - (27) |
| èvan ziè : avant-hier - (46) |
| évan, avant. - (16) |
| évance, s. f., avance : « Oh ! j'ériv'rai prou ; j'ai d'l’évance. » - (14) |
| évancer, v. avancer. - (38) |
| évancer, v.tr., avancer. - (14) |
| évançôre : avancée. Rapprochement par une mise en place « en avant ». - (62) |
| évani : (p.passé) fatigué, fané, flétri - (35) |
| évani, v. n. évanouir : elle a évani. - (22) |
| évani, v. n. évanouir : elle a évani. - (24) |
| évanle : (genre ?) élan - (35) |
| évanle : Elan. « Ol a pris san évanle a peu ol a sauté jeusque de l'autre côté du fossé ». - (19) |
| évanler : Donner de l'élan. « Quand la roe (roue) est bien évanlée, elle tome tout sou (toute seule) ». - (19) |
| évanoussi, adj. fatigué, comme prêt à s'évanouir. - (22) |
| évanture, s.f. aventure. - (38) |
| évanture. s. f., aventure, événement. - (14) |
| évarbé (s'), s'écarter de son droit chemin. C'est une expression du Châtillonnais. En latin e via recta ire. - (02) |
| évaré, ée. adj. Effrayé, effaré, ahuri. Des perdrix, des brebis évarées. - (10) |
| évare-auzia : épouvantail. - (29) |
| évare-ôiau, s.m. épouvantail pour les oiseaux. - (38) |
| évàrer (s'), v. pron., s'égarer. - (14) |
| évârer (s'), v., se dit d'un troupeau qui s'égaille dans le champ, par peur. - (40) |
| evârer : chasser, éloigner, « faire partir » - (37) |
| évarer, verbe transitif : chasser, écarter. - (54) |
| évârouïo, s. m., épouvantail à moineaux. - (40) |
| evarpillai (s'). : S'évertuer. - (06) |
| évarpillai(s'), s'évertuer... - (02) |
| évarrer, v. effrayer, épouvanter ; de (loup-)varrou. - (38) |
| évartir, v. tr., et intr., avertir, faire signe. - (14) |
| evartisseman. Avertissement. - (01) |
| évartissement, s. m., avertissement, signal. - (14) |
| évarvouiner. v. a . Faire jouer. (Soucy). - (10) |
| évasé, v. n. se dit d'un terrain qui éboule par friabilité. - (22) |
| évaser v. n. se dit d'un terrain qui éboule par friabilité. - (24) |
| évases. s . f. pl. Pluies qui se préparent à tomber, quand le temps est chargé d’eau. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| évasiller. v. a. Tailler grossièrement la vigne. (Cuy). - (10) |
| évasiver, ébourgeonner la vigne. - (28) |
| évau, adj., profond. (V. Avau.) - (14) |
| évaudir (s'), se divertir, s'ébattre. - (05) |
| evaulai . : Selon que les mots dérivent du latin ad vallem ou e valle, ils ont des significations diverses. C'est ainsi que l'expression évaulai a aussi bien le sens d'avaller un morceau que d'étendre ou diriger un objet en bas : Evaule tes cueusses signifie étends tes jambes. (Cit. de Del.) - (06) |
| évaulai, avaler. - (02) |
| evaulai. Avaler. Evaulai a, de même que le français avaler, diverses significations.. - (01) |
| évaûler : avaler. - (62) |
| évauler, v. tr., avaler, mettre en bas, et aussi manger avidement. - (14) |
| évauler. v. a. Avaler. - (10) |
| évauloire (pour avaloire). Gosier. All’ ot eine boun’ evauloire. (Athie). - (10) |
| évâzivé, enlever à la vigne ses vazy, c'est-à-dire, ses jeunes tiges inutiles. - (16) |
| èvec : avec. - (52) |
| evêche : évêque - (51) |
| évégé, ée. adj. Eveillé, avisé. Toi, mon p’tiot, t’es ben trou évégé pou toun âge ; g’eume pas ça. - (10) |
| évéger (S’). v. pron. S'éveiller. — Par extension, se mettre en marche, se mettre en train. (Bussy-en-Othe). - (10) |
| éveillée, s. f. étincelle qui s'échappe du feu. - (08) |
| éveillées, évêyées.(n.f.pl.) étincelles qui s'échappent du feu de Noël - on tisonne la grosse bûche et l’on dit : " éveilles, -éveillons autant de gerbes que de gerbeillons" - (50) |
| èveilli. Éveillé. - (49) |
| éveillotte : s. f., veillotte, veilleuse, colchique d'automne. - (20) |
| eveinni : faner - (51) |
| evèlé, vt. étendre. Tirer. Retirer. Loc. : evèle tes pies, Colas, tire-toi de là. - (17) |
| événi (s') v. S'évanouir, perdre conscience. - (63) |
| événi adj. et v. Evanoui, fané. - (63) |
| évênir (l’r ne se prononce pas). S’évanouir, tomber en faiblesse, en syncope. Du latin evanescere. (Plessis-Saint-Jean). - (10) |
| evenler : tituber - (51) |
| évent : Auvent. « Je nos sint mis à la coi seu l'évent ». - Event, altération causée par l'exposition à l'air. « In goût d'évent » un mauvais goût que prend le vin quand on néglige de le soustraire au contact en ayant soin de tenir les fûts bien bondonnés et bien ouillés. - (19) |
| éventionner, v. a. inventer, imaginer. Cet homme-là « éventionne » toujours des mensonges. - (08) |
| éventionneu. euse, adj. et s. celui ou celle qui invente des choses plus ou moins fausses. - (08) |
| éventrée. s. f. Coliques de cheval, tranchées. Son cheval est mort d’une éventrée. - (10) |
| éventrouiller. v. a. Serrer le ventre trop fortement. (Percey). - (10) |
| évèré, chasser en les effrayant, des mouches, des oiseaux. - (16) |
| évèrer : battre (un enfant). - (31) |
| évèrer : chasser, disperser - (48) |
| évèrer : (é:vèrè - v. trans.) (en parlant des chevaux) chasser les mouches. Au fig. rouer de coups, rosser. - (45) |
| évérer, évairer (v.) : chasser, mettre en fuite (de Chambure écrit évairer) - (50) |
| évergetier. s. m . Merisier. (Courson). - (10) |
| éverguè eune nouvelle : propager une nouvelle. (RDT. T III) - B - (25) |
| èveriot (è l’) : à l'abri du vent ou du froid (et non de la pluie). (ALR. T II) - B - (25) |
| évermouche, s. m., chasse-mouches, filet spécial, généralement employé, jadis, par tout possesseur ou conducteur de chevaux, et des plus efficaces pour éloigner les mouches. La bête en avait sur le front et tout autour des flancs. Le travail en était ingénieux, d'une coquetterie simple et d'un effet très pittoresque. - (14) |
| éverpé, ée. adj. Avare. (Menades). - (10) |
| éverrai (se fare) : se faite corriger. (C. T IV) - A - (25) |
| éverrer, chasser, expulser. - (05) |
| èveu : avec, on utilise aussi le mot d'èveû vin d'èveû mouè, viens avec moi - (46) |
| éveuger. v. a . Frayer. (Mont-Saint-Sulpice). - (10) |
| eveugle. Aveugle, aveugles… - (01) |
| éveugliotte (A l’). Locut. adv. A l’aveuglette, à tâtons. (Etivey). - (10) |
| éveûglôte (à l’), loc., à l'aveuglette, à tâtons, à travers l'obscurité: « La pauv'fonne ! áll’ n’é point hureuse ; áll’ n'a ran, épeû áll’ va à l’éveûglôte » (Dans cette loc. le g reparaît). - (14) |
| èveugner : (èveu:gné - v. trans.) finir par découvrir, découvrir quelque chose après l'avoir cherché. - (45) |
| èveûguiè : aveuglé - (46) |
| éveûille (n’) : aveugle - (57) |
| éveuille : Aveugle. « Changi san chevau borne cantre eun éveuille », faire un marché de dupe. - Proverbe : « Dans le pays des éveuilles, les bornes sant rois. » - (19) |
| éveuillé. Aveuglé. - (49) |
| éveuille. s. m. Aveugle. (Vincelottes). - (10) |
| éveuiller. v. a. Aveugler. (lrancy). - (10) |
| éveûilli - ébeurluter : aveugler - (57) |
| éveuilli : Aveugler, voir aussi ébarluter. - (19) |
| éveûillie, s. f., liseron sauvage, qui a de profondes racines et multiplie avec ténacité dans les allées des jardins : « Quasi tous les maitins, à c'te éveuillie, j'li fais la guâre d'avou mon coutiau ; pas moins que l'souér j'en vois d'jà la tête parcer l'gravier. » - (14) |
| éveûle, s. m., aveugle. - (14) |
| éveûler, v. tr., aveugler. - (14) |
| éveulye : s. f. abeille. - (21) |
| eveùrdin, et eveùrdon, s. m., caprice, lubie, idée subite, action inattendue et instantanée : « Depeû qu'álle ét amoureuse, áll’ ne sait pu c'qu'áll’ fait ; álle a les éveurdins. » - (14) |
| éveure, étourdi. Ce substantif est formé du verbe bourguignon évairat, fuir. S'évairai signifie s'égarer, disparaître, s'aventurer. En latin evadere... - (02) |
| éveurlaché : mal peigné - (39) |
| éveurlouché : échevelé, ébouriffé. - (52) |
| éveùrluché, adj., dépeigné, ébouriffé. - (14) |
| éveurluché, e, adj. ébouriffé. se dit d'une tête mal peignée et en général de tout ce qui est en désordre, pêle-mêle, hérissé en broussaille. « Évourlacé. » - (08) |
| eveurnailli : éparpiller - (51) |
| éveûrnâilli v. (du germanique waron, mettre en garde). Chasser les poules. - (63) |
| éveurna-yi : chasser en flagellant - (35) |
| éveûye, aveugle ; marcher aî l’éveûyote, marcher dans l'obscurité : se dit aussi pour : marcher les yeux couverts. Éveuyé, aveugler. - (16) |
| évéyer : regarder un peu partout - (39) |
| évi : Avis. « O m'a dit de fare c'ment cen mâ y est pas man évi ». « M'est évi » : il me semble, « M’est évi qu'aile te vaut bin ». - (19) |
| eviander, âviander : enlever la viande - (37) |
| eviée, sf. sentier, piste, trace. - (17) |
| évier : Mettre en marche, mettre en train. « J'ai bin manté le releuge (l'horloge) mâ je cra bin que je l'ai pas évié ». « Ol est c'ment le melin de Mouchau, eune fois évié an en peut plieu l'arrater. ». Au figuré : « Man malède commache à se lever mâ o n'est enco guère évié (il n'est encore guère gaillard) ». - (19) |
| évïer, éviser (S’). v. pron. S’apercevoir, s’aviser d’une chose. - (10) |
| évier, n.m. petite pièce où l'on fait la vaisselle. L’évier est appelé pierre à évier. - (65) |
| évier, v. continuer à pleuvoir. - (38) |
| évigi : Aviser. « O m'a évigi ». - (19) |
| évigner. v. a. Aveindre, tirer à soi. Il était trop haut, j’ai pas pu l’évigner. (Bessy, Annay-sur-Serein, Gourgis, etc.). - (10) |
| évinnir (S’). v. pronom. S’évanouir. On prononce évin-ni. (Montillot). - (10) |
| éviôle : Etincelle. « I suffit d'eune éviôlle pa allemer in greu fû ». - (19) |
| éviot (al o pa) : il n'a pas bon caractère. (C. T IV) - A - (25) |
| évis, s. m., avis, conseil : « M'ét évis que... » — « J'sons prou d’évis... » - (14) |
| evisai. Avisé. S’évizai, s'aviser. - (01) |
| évisé, adj. avisé ; mol évisé n'ôt pas sans poin-ne ("mal avisé n'est pas sans peines"). - (38) |
| éviser, v. tr., aviser, conseiller. - (14) |
| évitation, s. f. invitation, premier appel au tribunal du juge de paix, avertissement officieux de comparaître. - (08) |
| éviter (v.) : inviter - (50) |
| éviter, v. a. inviter. - (08) |
| évitou (-ouse) (n.m. ou f.) : inviteur (-euse) - (50) |
| évitou, ouse, s. inviteur, inviteuse, celui ou celle qui fait les invitations pour un mariage. - (08) |
| évivaus, s. m. étincelles du feu qui pétille. (Voir : éveille, signaude, soldats.) - (08) |
| évivre, adj. malingre. - (38) |
| évni, advenir ; el évni, il advint ; se dit aussi pour avenir ; ai l’évni, à l'avenir, dans la suite. - (16) |
| évnûe, avenue, plantation d'arbres en allée ; se dit aussi pour l'arrivée de quelqu'un : ai l'évnûe d'Jèsuss'-Cri. - (16) |
| évogrer, v. écosser. - (38) |
| évogrer, v., égrener le maïs. - (40) |
| évoi, avoir ; jé évu, j'ai eu. - (16) |
| évoigne. s. f. Avoine. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| évoiller, v. a. éveiller, réveiller. - (08) |
| évoiller, v. tr., éveiller, appeler l'attention. - (14) |
| évoilli, e, part, passé. Éveillé, réveillé. - (08) |
| évoindre, aveindre. v. a. Prendre, saisir en se haussant, ou en élevant les bras, un objet qui n’est pas tout à fait à portée de la main. - (10) |
| évoinge (loc.) : ne rien apporter de bon - "ne pas avouâ d'évoinge" - (50) |
| évoinger. v. a. Propager. (Etivey). - (10) |
| évoir d’quoi : être riche. Avoir …«Ô l’a d’quoi » : il a les moyens. - (62) |
| évolagi, v. n. se dit d'un oiseau, d'une volaille qui agite violemment les ailes sous l'effet de la peur. - (24) |
| évôlatré : (p.passé) affolé, effrayer - (35) |
| évolâtré : affolé, effrayé - (43) |
| evolatré : personne qui ne tient pas en place, qui s'évolatre - (51) |
| evolatrer : exciter, faire disperser, s'envoler, disséminer - (51) |
| évolâtrer v. (de voler). Chasser les poules en parlant d'un rapace ou d'un chien. - (63) |
| evonne, avoine. - (26) |
| évons. 1re p. ind. pr., avons : « V'tu v'nî à la fête ? J’évons prou l'temps d'nous ébuyer. » - (14) |
| èvoré : (homme) évaporé. (A. T II) - D - (25) |
| évorné, adj. ; disjoint (pour parler d'un tonneau). - (07) |
| évorteau : Avorton. Au figuré : un être chétif et rachitique. - (19) |
| évorter : Avorter. « Dans le vieux temps an croyait que les seurciers jetaient in sort su les vaiches pa les fare évorter ». - (19) |
| évoté : v. pr. Se fatiguer par un grand effort. - (53) |
| évoù dan. Locut. interrogat. Là où donc Evoù dan que t’vas ? (Lucy-sur-Cure). - (10) |
| évou et d’évou. Avec. Vins don d'évou moué. Il ne faut pas confondre ce mot avec lévou qui signifie dans quel endroit et qui semble venir de là où. Lévou qu'al ast été, pour se brôiller tant que ce qui ? - (13) |
| évou, adv., avec. (V. Avou.) - (14) |
| évoù, adv., de l., où. Tantôt une contraction enlève à un mot une ou plusieurs lettres ; tantôt, au contraire, le mot s'amplifie d'une ou de plusieurs lettres redondantes. Vou, écou, fournissent un exemple du dernier cas : « D'évoù qu'te d'veins ? » - (14) |
| évouaîn-ne (d’l’) - avouaîn-ne (d’l’) : avoine - (57) |
| èvouè : avoir - évouè soum avoir sommeil - èvouè lè fouirasse, avoir la diarrhée - (46) |
| évoué, avouer. - (16) |
| évoueillot. s. m . Entonnoir. C’est une altération des mots ouillot, oeillot, ovillot, instrument servant à remplir les fûts et les bouteilles. On dit encore aujourd’hui ouiller, pour remplir, remplir jusqu’à l’œil jusqu’à la bonde. On dit également ouillage, pour remplissage, action de remplir les tonneaux. - (10) |
| évougrer : Egrener. « Evougrer du treuquis, égrener du maïs». « Le père Jannot Millot qu'avait fait totes les campagnes du vieux Napoléon racantait sovent c'ment ol avait battu en retraite dans les treuquis évougrés ». - (19) |
| évouillé. adj . et part. p. d’Evouiller, aveugler. — Etre évouillé, être soûl, rassasié à n’en voir plus clair. Il a tant bu, tant mangé, qu’il en est évouillé. (Dollot). - (10) |
| évouinger : progresser, avancer rapidement - (48) |
| évoûlant : plancher à foin - (48) |
| évoulaté, v. n. se dit d'un oiseau, d'une volaille qui agite violemment les ailes sous l'effet de la peur. - (22) |
| évoulâyé, adj. celui qui parle étourdiment, qui agit comme un étourneau, qui n'entend pas la raison. - (08) |
| évourâcher, v. tr., brouiller, mêler. - (14) |
| évourer : Egratigner. « J'ai cheu dan in rangi je me sus lot évouré », je suis tombé dans un buisson de ronces, je me suis tout égratigné. - (19) |
| evourluché : cheveux en désordre, hirsutes. On éto evourluché par le vent : on était échevelé par le vent, décoiffé. - (33) |
| évourton. s. m . Avorton. (Bazarnes). - (10) |
| évô-yâ, s.m. fenil dont le plancher à jour est constitué par quelques poutres seulement ; perche pour faire sécher les haricots, grand évôyâ se dit d'un grand garçon qui n'a que la peau et les os. - (38) |
| évoyau. s. m. Petit entonnoir. (Charentenay). — A Migé, on dit Jean voyau. - (10) |
| évô-yé, v. aveugler. - (38) |
| èvre (pour oeuvre). s. m. Filasse qui entoure la quenouille. J’n’ai pas d’èvre à ma quenoille. (Sacy). - (10) |
| évrena-yi : chasser en fouettant l'air - (43) |
| évret (n') : abri (du vent ou de la pluie) - (57) |
| evri (à l'), loc. à l'abri du vent. - (24) |
| évri (pour verri, par transposition de l’e). adj. Verri, rouillé, couvert de vertde-gris. (Chassignelles). - (10) |
| èvril : avril - (46) |
| évrillè : boucher, obstruer - évrillè contre le frai, boucher contre le froid - (46) |
| évriller : protéger du froid une écurie avec de la paille. (G. T II) - D - (25) |
| évu (j'ai, ôl a), passé indéf. d'avouér : « J'ai évu mon mourciau ; ôl a évu l'sien. Y é d'aicord. » - (14) |
| èvu. Eu. « Ol ai èvu in-ne fruction de poitrine ». Il a eu une fluxion de poitrine. - (49) |
| evu. v. - Eu, participe passé du verbe avoir. « A peuvait pas s'empêcher de penser à c'tormouère qu'alle avait jamais évu, madame aveuc ène glace au miyeu ... » (G. Chaînet, L'Coustume dé vélours) - (42) |
| ewier. : (Dial.), s'égaler à. - L'adjectif ewal, iwel, du dialecte d'oïl, vient du latin oequalis. « Quant aucuens se welt ewier par aventure à un aultre. » (S. B.) - (06) |
| exceptionnellement : adv., superlativement. II faisait la noce exceptionnellement (prononcer ex-cep-ti-o-nel-le-ment). - (20) |
| exécutouaîre : exécutoire - (57) |
| exempe, s. f., exemple. On entend souvent : « Oh ! por exempe ! » - (14) |
| exemp'lle : Exemple. « Donner le ban exemp'lle ». - (19) |
| exempt de, loc. a l'abri de, dispensé de. - (08) |
| exeprès (exeuprès) : adv., exprès. Je suis venue exeprès. — On dit de même exepress pour express, exeposer pour exposer, etc. - (20) |
| exeupré - exprès. - I veins jeusque de Clombé exeupré pou vos dire que vote frère à mailaide. - (18) |
| exeùprès (par), loc, exprès : « J'y ai pas fait par exeùprès. » Cette locution (par exprès), qu'on doit éviter, n'est point une faute, mais seulement un archaïsme. (Ecseùprès représenterait mieux la prononciation.) - (14) |
| exeuprés adv. Exprès. Dz'sus vni d'Dopiârre exeuprés. - (63) |
| exhon. s. m. Héron . ( Bléneau).— Jambes d’exhon. - (10) |
| exigi : exiger - (57) |
| exiomo. s. m. Ecce-Horao, tableau représentant Jésus-Christ couvert d’épines. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| exomon, sm. [ecce homo]. Personne immobile, statue, momie. - (17) |
| expartie : Expertise ez : Voir es (aux). - (19) |
| expatri-illi : expatrier - (57) |
| expérient. adj . Qui est expérimenté, qui a de l’expérience. (Saligny). - (10) |
| expiri : expirer - (57) |
| explouaît (n’) : exploit - (57) |
| explouaitable : exploitable - (57) |
| explouaiter : exploiter - (57) |
| expouser : exposer - (57) |
| exqueumier. v. - Excommunier. (Saint-Martin-des-Champs, selon M. Jossier) - (42) |
| exqueumier. v. a. Excommunier. (Saint-Martin-des-Champs). - (10) |
| éyan(s) - (39) |
| eyau : charrue de bois - (60) |
| eyau : type de charrue. III, p. 31 - (23) |
| èye : (nf) (à la Chapelle, Brandon) eau - (35) |
| é'yer : délayer - (48) |
| èyeûre n.f. (du lat. ex-ligare, délier). Gerbe de blé étalée sur l'aire de battage au fléau, les épis dirigés vers le centre. - (63) |
| éyeuter ou éleuter, verbe intransitif : avoir un haut-le-cœur, faire des efforts pour vomir. - (54) |
| èyeuter. Hoqueter pour vomir. - (49) |
| èyîge : s. f. église. - (21) |
| éyise : église - (43) |
| éyise n.f. Eglise. - (63) |
| éyize : (nf) église - (35) |
| eyœuter. v. a . et n. Cligner, regarder d’un œil pour aligner, pour voir si une chose est droite. Eyoeuter une règle. (Annay-sur-Serein). - (10) |
| éyoqué : v. t. Disjoindre. - (53) |
| eyot, oeillot. s. m. Œil. Les lermes l’i chésint des éyots, les larmes lui tombaient des yeux. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| eyot. adj. et n. - Idiot. (Perreuse, selon M. Jossier) - (42) |
| eyot. adj. et s. m . Idiot, imbécile. (Perreuse). - (10) |
| éyoure : (nf) aire à battre - (35) |
| éyoure : gerbes déliées sur l'aire de la grange pour être battues au fléau - (43) |
| ez : aux - (51) |
| ez : avez (v’ez pas trop fraid ? : vous n’avez pas trop froid ?) - (37) |
| ézâdé : excité, évadé, simplet - (39) |
| ézeuille : oseille - (43) |
| ezondées (par), (par) intervalles - (36) |
| ézondées, s. f. par « ézondées », par intervalles, par accès, par secousses. - (08) |
| èzter : acheter. « Èzeute, èzeute ! » : « Achète, achète ! » - (52) |
| f’ler : filer (la laine) - (35) |
| f’llée (ll mouillés). s. f. Feuillée. (Rebourseaux). - (10) |
| f’llon (ll mouillés). Feuillon, petite feuille. Du latin foliolum. - (10) |
| f’mée. s. f. Fumée. - (10) |
| f’meil : le fumier - n'eû bie pas d'eûtè tes bottes pleines de f’meil, n'oublie pas d'enlever tes bottes pleines de fumier - (46) |
| f’mer : fumier. - (62) |
| f’mer, v., fumer. - (40) |
| f’mére : fumée. Et aussi : F’mer pour fumer, mais on conjugue : J’feume, T’feumes, Ô feume… (au présent). - (62) |
| f’naichon. s. f. Fenaison. - (10) |
| f’nailles : (nfpl) fenaison - (35) |
| f’nau : (nm) fenil - (35) |
| f’nau, piaintsi, soli : fenil - (43) |
| f’ner. v. n. et se f’ner, se fener. v. pronom. Faner, se flétrir. Un bouquet fné. — Il fait si chaud que tout fène dans les champs. A s’ feune ben la pouv’ fille. — v. a. Faner, secouer, écarter dans les prés l’herbe qui vient d’être fauchée, pour la faire sécher. Du latin fenum. - (10) |
| f’nétre (na) - crouaîsée (na) : fenêtre - (57) |
| f’neuillè : farfouiller, chercher - (46) |
| f’neuillou : quelqu'un qui cherche - (46) |
| f’ni (nom masculin) : fenil. Lieu où l'on serre le foin. - (47) |
| f’ni : endroit sous les tuiles où l'on met le foin - (46) |
| fâ (on) : fer - (57) |
| fâ : charge, fardeau, faix. El en ai son fâ : il est bien chargé. - (52) |
| fa : Foi. Usité seulement dans : « ma fa », « men fa », exclamation employée pour donner plus de force à une affirmation ; « men fa oué », oui ma foi. - (19) |
| fâ : Nom de lieu « Su la fâ ». - (19) |
| fâ pardon ! loc., pardonnez-moi ! - (14) |
| fa tira ! loc. impér., fais tirer ! Cri des mariniers pour activer la marche des chevaux qui tirent un équipage. (V. Louïa.) - (14) |
| fâ : fardeau - (39) |
| fâ, s. m. faix, fardeau, charge : « eun fâ d’herbe, eun fâ d'peille », fardeau en général. - (08) |
| fâ, s.m. fer. - (38) |
| fâbe, s. f., fable, récit douteux. Se dit maintenant plus couramment que faule. - (14) |
| fabliasse : Faiblesse, évanouissement, syncope « Alle a ésu eune fabliasse », elle a eu une syncope. - (19) |
| fab'lle : Faible. « C'ment que va veute malède ? - O va mieux mâ ol est enco bien fab'lle ». « De l'iau de vie fab'lle » : de l'eau de vie qui n'a pas le degré d'alcool commercial. (50 à 52°) - (19) |
| fabricien : membre du conseil de fabrique d'une paroisse. - (55) |
| fabrique : ensemble des personnes nommées officiellement pour administrer les biens d’une paroisse ; ensemble des biens et revenus d’une église. La fabrique a été abolie par la loi du 9 décembre 1905. - (55) |
| fâcer (v.t.) : fâcher ; (v.pr.) se fâcher - (50) |
| fàcer. v. a. Fâcher. (Ménades). - (10) |
| fachale. Vase où l'on fait égoutter le fromage ; du latin fiscella. - (03) |
| fâchè : v. t. Facher. - (53) |
| fâche, s. f., fâcherie, grondée, réprimande : « L' vieux a évu eùne grande fâche à l’encontre d'Jean-ne. » - (14) |
| fachelle (nom féminin) : moule en fer ou en terre percé de trous dans lequel on place le caillé pour faire le fromage. - (47) |
| fâcher, v. a. fâcher avec le sens actif, gronder quelqu'un, faire des reproches : mon père m'a « fâché », c’est à dire m'a réprimandé. - (08) |
| fâcher, v. intr., être pénible, faire de la peine : « I li fâchòt gros d'mouri. » — « Not'dame, i n'me fâche point d'fâre vote ôvraige. » - (14) |
| fâcher, v. tr., gronder, réprimander, faire des reproches : « J'avô tout dévoré ma cueûlote ; la mâre m'afâché. » - (14) |
| fachi : tresser un panier. A - B - (41) |
| fachi : tresser un panier - (34) |
| fachi v. (du lat. fascem, lier) Tresser un panier (on retrouve le verbe fascer en héraldique). - (63) |
| faciliter : v. a., faciliter quelqu'un, faciliter quelque chose à quelqu'un. « M. J.-B. Giray, député, a écrit au ministre pour lui demander de faciliter les carriers de la région de Montalieu à expédier leurs envois de pierres de taille. » (Progrès de Lvon, 28 janv. 1919). - (20) |
| facille (ll mouillés). adj. Facile. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| facille, adj. facile. - (17) |
| facine : n. f. Petit bois pour allumer le feu. - (53) |
| facine, s. f. brins de bois, jeunes pousses, la partie la plus menue du branchage des arbres. - (08) |
| façon n.m. Apparence. - (63) |
| façonnoux n. et adj. Homme qui aime se faire prier. - (63) |
| facteux. n. m. - Facteur. - (42) |
| façu, e, adj. celui qui a une grosse face, une figure rebondie. Un visage « façu » est un visage de pleine lune. - (08) |
| fâd’ fougîres (ain) : (une) charge liée de fougères - (37) |
| fade, adj. mollasse. S’emploie pour exprimer un état maladif où les chairs sont flasques: « l'poure p'tiô ô tô fade », le pauvre petit est sans force, il ne peut se soutenir par affaiblissement. - (08) |
| fadé, qui est avantagé matériellement. - (27) |
| fadea. Fardeau, fardeaux. - (01) |
| fadiiller, v. n. avoir beaucoup de famille, avoir de nombreuses portées. Se dit principalement en parlant des animaux. les truies et les lapins « faimillent » plus que d'autres femelles. - (08) |
| faes-re, v. faire (prononciation moderne : fes-re). A Saint-Martin, on dit fare. - (38) |
| faeu, s.m. feu. - (38) |
| faeune, s.f. fagot de sarment contenant environ 12 branches, pour allumer le feu. - (38) |
| fafions, s. m. plur. chiffons de peu de valeur, menus objets de toilette, oripeaux. - (08) |
| fafiot, s. m., soulier d'enfant. - (11) |
| fafiotaige, s. m. emploi de « fafions », de chiffons sans valeur pour la toilette ou pour un usage quelconque. - (08) |
| fafioule (na) - favioule (na) - failloule (na) : haricot - (57) |
| fafluches. s. f. pl. Menus copeaux de menuisier. — Flocons de neige. - (10) |
| fagiou, sm. faiseur. - (17) |
| fâgniant : fainéant - (37) |
| fagot, n.m. fagot de brindilles de bois, botte de paille. - (65) |
| fagoter : mettre en fagots. Être mal fagoté : être mal habillé - (51) |
| fagoti : (nm) tas de fagots - (35) |
| fagoti v. Faire des fagots. - (63) |
| fagotté. Mal habillé : « aul est fagotté c'ment personne ». (Français familier). - (49) |
| faguena (sentir le) : mauvais. - (30) |
| faguena, odeur repoussante... - (02) |
| faguenâ, s. m. odeur fade, nauséabonde. - (08) |
| faguena. Sorte de mauvaise odeur, telle que celle d'un crocheteur échauffé… - (01) |
| faguena. : Mauvaise odeur. Cette expression est dans Rabelais, et, quoique adoptée par notre patois, elle ne me semble pas d'origine bourguignonne. - (06) |
| faguenas : (fag'nâ: - subst.) odeur fétide caractéristique de l' hygiène corporelle négligée, faguenas. - (45) |
| faguenas, mauvaise odeur. - (04) |
| faguenas, Mauvaise odeur. Les Wallons nommen t fanias un endroit fangeux. De tous les lexicographes, Roquefort me parait avoir donné la meilleure définition : « odeur qui s'exhale d'un lieu fermé où il y a beaucoup de monde. » On a aussi appliqué ce mot aux parfums trop capiteux de certain es femmes. - (13) |
| fagueut : Fagot. « In fagueut de millier » : est un fagot à deux liens fait de bois et dans lequel il entre un ou deux « jarans ». - « P'tiet fagueut » fagot de bon bois à un seul lien. - « Fagueut de racliat » fagot de mauvais bois (voir racliat) - « Fagueut d'épeune, fagueut de bouis, etc... » c'est le cas de dire qu'il y a fagot et fagot. - (19) |
| fagueuter : Fagoter. Faire des fagots. « Ol est allé fagueuter sa pâ de beû », il est allé faire des fagots de sa part de bois, c'est à dire de son lot d'affouage. - Se fagueuter, s'habiller san goût, s'habiller de vêtements mal ajustés : « Aile est dreulement fagueutée ». - (19) |
| fai fouè : fait foi - (48) |
| fai foué : faire foi, affirmatif. J'en fais foué et pou fé foué faut être sûr : j'en fais foi et pour faire foi il faut être sûr. - (33) |
| fai. Fais, fait, faits. - (01) |
| faib'ille (on) : faible - (57) |
| faib'illement : faiblement - (57) |
| faib'illesse (na) : faiblesse - (57) |
| faib'illi : faiblir - (57) |
| faibje, adj. faible. - (17) |
| faibjï, vn. faiblir. - (17) |
| faibricien, s. m. fabricien, celui qui administre la fabrique d'une paroisse. - (08) |
| faichale : Faisselle, sorte de pot percé de trous où l'on met égoutter les fromages frais. Vieux français : faissel faim : Faim. Dicton : « O n’a pas pu faim que la Seune (la Saône) a sa (soif) ». - (19) |
| faiçon (n.f.) : façon - (50) |
| faiçon : n. f. Façon. - (53) |
| faiçon, façon. - (04) |
| faiçon, sf. façon. - (17) |
| faiçon. Façon, façons. - (01) |
| fai'e viau. Exp. -Vêler, mettre bas, « faire veau ». - (42) |
| fai'e. v. - Faire. - (42) |
| faïence (yeux de) : Ioc, yeux bleus. Avoir les yeux de faïence. - (20) |
| faignant, faigniant. adj . et s. m. Lâche, paresseux, fainéant. - (10) |
| faignant. Fainéant. Ce mot se retrouve dans d'autres dialectes. (Français familier). - (49) |
| faignanterie. s. f. Fainéantise. - (10) |
| faignantie, faignanterie. n. f. - Fainéantise. - (42) |
| faignantise. Fainéantise (Français familier). - (49) |
| faigo, faigueu, fagot de branches d'arbre ; se dit aussi pour : amas de médisances et de mensonges. - (16) |
| faigot : fagot de branchages - (37) |
| faigot : n. m. Fagot. - (53) |
| faigöt, sm. fagot. - (17) |
| faigotté : mal habillé - (37) |
| faigueu : fagot. - (66) |
| faihine, s. f. farine, mouture des grains. (Voir : faireune.) - (08) |
| faihiner, v. a. enfariner, mettre dans la farine. - (08) |
| fai'illère : falloir - (48) |
| failli. Manqua, manquera. Failli se prend aussi pour fallut : « I failli an passai po lai », il fallut en passer par là. - (01) |
| faillouli - faviouli - fafiouli : haricot (pied) - (57) |
| failot (ain) : (un) falot (lampe portative à faible lumière) - (37) |
| faim : s. f. « T'as autant faim que la Saône a soif », se répond à un enfant qui demande encore à manger quand il n'a plus faim. - (20) |
| faim, n. fém. ; envie, besoin, il a faim de picher. - (07) |
| faim. s. f. Envie, besoin. Avoir faim de boire, avoir faim de dormir. - (10) |
| faimeune, s. f. famine. - (08) |
| faimg (n.f.) : faim - (50) |
| faimgne. s. f. Faim. (Athie). - (10) |
| faimille : n. f. Famille. - (53) |
| fainasse (ça). v. - Pluie fine ; ça fainasse, ça brouillasse. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| faing : faim - (39) |
| faingn’, s. f. faim, besoin de manger. - (08) |
| faingnant, adj. fainéant. - (17) |
| fainiant : fainéant - fainiant c'ment en'ierche, fainéant comme une herse (car la herse se laisse traîner !) - (46) |
| fain-nè : v. t. Freiner. - (53) |
| faíre (v.t.) faire (p.p. faísu = fait) - (50) |
| faire chabro, exp. ajouter du vin rouge à un bouillon de viande. - (65) |
| faire des grimaces loc. Etre obséquieux. Se faire prier. - (63) |
| faire dévier, loc. faire enrager, donner de l'ennui. - (24) |
| faire encrâre v. Mentir, faire croire. - (63) |
| faire encroire, locution verbale : faire croire. - (54) |
| faire faute v. Manquer. - (63) |
| faire fin, loc. prospérer, arriver à bonne fin. - (24) |
| faire la chigne, loc. faire la moue, rechigner. - (24) |
| faire la mère loc. Se ramollir et pourrir en parlant de la pomme de terre. - (63) |
| faire la teupe : bouder - (43) |
| faire la tsalée : enlever la neige du sentier, faire un sentier dans la neige - (43) |
| faire lai mére du vente : faire sa portée (pour une vache) - (48) |
| faire le dzeuil : chatouiller - (43) |
| faire le ptiet v. Accoucher. - (63) |
| faire le viau v. Vêler. - (63) |
| faire les pieinnes mains : étendre la javelle sur la machine avant de l'enfourner dans la batteuse - (43) |
| faire les us : pondre - (43) |
| faire mau à voué, loc. être pâle, débilité ; littéralement : faire mal à voir. - (24) |
| faire montrer, locution verbale : faire voir, montrer. - (54) |
| faire naître des dûs, loc. se dit lorsque dans une liquidation des dettes fictives et frauduleuses sont présentées. - (24) |
| faire pauter : faire basculer quelque chose - (43) |
| faire pet'iœ, loc. manger peu de viande ou d'autre aliment avec beaucoup de pain. L’inverse est faire groeu. - (24) |
| faire queure la tsaudire : faire chauffer la chaudière - (43) |
| faire regrai, loc. dégoûter, écœurer : il est si sale qu'il fait regrai. - (24) |
| fairelécher, fairelicher. v. - Lécher, gratter, nettoyer un plat : « Te vas faireléche la casserole. » - (42) |
| fairène : farine - (39) |
| faireune (n.f.) : farine - fareune fôlle = poussière de moulin - (50) |
| faireune : farine - (48) |
| faireune, s. f. farine. On nomme « faireune fôle » la poussière de farine qui saupoudre l'intérieur des moulins et qui dans le pays sert à faire la colle ou chas des tisserands. (Voir : fanée.) - (08) |
| fairfouéiller : farfouiller, fouiller, remuer - (48) |
| fairfouillè (éte) : écoeuré (être), être gêné côté digestion - (48) |
| fairfoûillier : fouiller intensément - (37) |
| faîrna (d'la) : farine - (57) |
| fairo, faiso, faiseussaint - divers temps du verbe faire. - Ah ! s'a vélo, a fairo cequi ai lai perfection, cair al â gros aidroit. - I vourâ bein qu'a faiseussaint celai-z-eux-moinme, ci sera tôjeur ine dépense de répermée. - Voyez fâre. - (18) |
| faironghi', s. m. furoncle, appelé vulgairement clou. (Voir : fronllhe.) - (08) |
| fairselle. n. f. - Faisselle ; pot en grès percé de nombreux trous, où 1’on dépose le lait caillé à égoutter. - (42) |
| faisée. n. f. - Travail fait, terminé. (Villiers-Saint-Benoît, selon M. Jossier) - (42) |
| faisée. s. f. Fait accompli, chose faite, consommée. — Au jeu de cartes, action de faire les cartes, de les distribuer, de les donner à chacun des joueurs. (Villiers-Saint-Benoît). - (10) |
| faisu : fait - (37) |
| faît (n. m.) : faîte, sommet (monter su l'faît d'un pernier – j'en ai par au faît d'la tête (j'en ai par-dessus la tête)) - (64) |
| fait (qu'a) - du verbe faire ; ici dans le sens de dit-il. - Voyez dans la Préface, à l'article Locutions. - (18) |
| fait (Si). Si vraiment. J'écris fait pour me conformer à l'usage, mais il faudrait fé : si, par ma foi. Non fait ne se dit plus guère dans la Côte-d’Or, si ce n'est à Gémeaux, où l’on prononce n’fâ. - (13) |
| fait : Terminé, fini « T'aras bin ach'teut fait ! ». - (19) |
| fait l’oeû ! (ai l’ai) : se dit de la poule qui vient de pondre - (37) |
| fait : s. m., grand fait, fait important, digne de remarque. Y a grand fait que te l'as laissé aller tout seul en bateau ; i pouvait s' noyer. - (20) |
| fait. : (Dial. et pat.), mot explétif encore en usage chez nos paysans. On trouve au livre de Job : « Demandeir fait por coi, » c'est-à-dire, demander pourquoi. - (06) |
| faîtaize. s. m. Faîtage. (Ménades). - (10) |
| fait-clair : s. m., entonnoir. - (20) |
| faitelée. Quantité d'objets placés les uns au-dessus des autres. - (49) |
| faiteux. s. m. Faiseur. (Athie). - (10) |
| faitigant : adj. Fatigant. - (53) |
| faitigué, vi. fatiguer. - (17) |
| faîtire : poutre de faîte - (43) |
| faîtîre n.f. Poutre faîtière. - (63) |
| faitrage (faitrage} : s. m., faîtage. - (20) |
| faitrâs : mélange - (37) |
| faitre (faître) : s. m., vx fr. f estre, faite. - (20) |
| faitres. : (Dial.), créateur.- Ce mot vient du substantif latin factor, comme le complément faiteor vient du régime latin fartorem. - Le livre de Job, en parlant de Dieu, a dit: « Il est faitres de sa nature. » -Le mot faiture, créature, vient du latin factura. - (06) |
| faitron. s. m. Faîne, fruit du hêtre. (Arcy-sur-Cure). - (10) |
| faivieûle, haricot. Faivieûle, diminutif de fève, est encore français dans le mot faviole, donné dans les dictionnaires, bien qu'on lui préfère le mot quelque peu barbare haricot. - (16) |
| faivieules, haricots secs. - (28) |
| faiviôle, fève. - (02) |
| faiviole, s. f. haricot. - (08) |
| faiviöle, sm. haricot. - (17) |
| faiviôle, zaricot : n. m. Haricot. - (53) |
| faiviôles – haricots. - I venons de pliantai des faiviôles. - Nos faiviôles sont dures ai cueurre, ma â sont bonnes. - (18) |
| faivôrïer, v. a. favoriser, être favorable à. - (08) |
| faix (n. m.) : botte (un faix d'paille) - (64) |
| faix. n. m. - Botte ou fagot : « L’souer, tut t'git à l'ébri d'eune meule, dans un faix d'paille tu fais ton nid » (Fernand Clas, p.88) - (42) |
| falander. v. n. Faisander. — Se dit, figurément, d’une chose qui reste là, qui attend plus que de raison. Elle aura le temps, dit-on, de falander, elle prendra du fumet. (Mailly-la-Ville). - (10) |
| falé, adj. félé. - (38) |
| faleut : Falot, lanterne « Le vent a soflié (éteint) man faleut ». - (19) |
| falibourne (pour falibourde). s. f. Conte en l’air, fable, faribole, folie, mensonge. (Jussy). - (10) |
| falin : Maladie bénigne et quelque peu épidémique. « T'as des c'euhques, ma j'en ai atot, y est par itié c'ment in falin que co », tu as des coliques, mais j'en ai aussi, c'est comme une épidémie qui court par ici. - (19) |
| falla : falloir - (51) |
| falla : Falloir. « I va bin falla s'en aller ». - (19) |
| falla v. Falloir. - (63) |
| fallet – faullai : falloir - (57) |
| falloi. : Falloir, dans l'acception de manquer. C'est le vrai sens primitif de ce verbe, et qu'il a conservé dans le patois. Ran n'i fau, c'est-à-dire, rien n'y manque. - (06) |
| falo : n. m. Lanterne. - (53) |
| falo, lanterne ; un vigneron préfère le mot falot, bien que la langue française l'ait adopté, au mot lanterne qui lui est presque inconnu. - (16) |
| falot (n.m.) : lanterne vitrée à bougie - (50) |
| falot : Lampe tempête à pétrole. Le réservoir est au-dessous et la flamme est protégée par un large verre ovalisé, lui-même garanti par un cerclage métallique. On s'en sert dans les écuries ou pour faire un parcours de nuit à pied. - (58) |
| falot, s. m. grosse lanterne carrée qui éclaire sur les quatre faces. - (08) |
| faloter. v. n. Flamber. — Faloter un poulet, le passer à la flamme, le flamber, après qu’il a été plumé. — Faloter un cochon, le griller avec de la paille flambante. (Villiers-Bonneux). - (10) |
| falourda : mortier de bois où l'on pilait le maïs. - (21) |
| falourde : s. f., mouette. Voir Littré, v° falourde. - (20) |
| falu. adj. - Touffu. (Mézilles, selon H. Chéry) - (42) |
| fameigne. Famine. - (01) |
| fameune : Famine. « La gormandije ameune lafameune ». - (19) |
| famine : s. f., faim. C’ pauv' goss’ i n'a pas son biberon, i pleur’ de famine. - (20) |
| fammelôte. Pauvre petite femme… - (01) |
| famosité : renommée. - (55) |
| fan noche : garçon efféminé. - (66) |
| fanceure : Fond. « La fanceure de man pansan ne vaut plieu ren ». - (19) |
| Fanchette, nom de femme. Diminutif de Françoise, comme le français fanchon usité pour désigner un fichu de tête. - (08) |
| fanchi. s. m. Surnom ou, plutôt, sobriquet généralement donné aux flotteurs, dans les pays riverains de l’Yonne. Pourquoi ? — A Gy-l’Evèque, ce mot est une abréviation de François, comme, ailleurs, Fanchon et Fanchonnette se disent pour Françoise. - (10) |
| Fanchon, Fanchète, Françoise. - (16) |
| fanchon. s. f. Grand mouchoir avec lequel les femmes de la campagne se couvrent la tête dans les champs. - (10) |
| fanchonnette : s. f., fanchon en laine tricotée ne couvrant que le sommet de la tête. - (20) |
| fanci : Foncer, mettre un fond à « Fanci eune cûe », c'est mettre à une cuve remplie de vin un fond ou plutôt une espèce de couvercle fait de planches sur lesquelles on étend une couche de plâtre. Ce procédé n'est employé pour loger le vin que lorsque la futaille fait défaut à la suite d'une récolte surabondante. - (19) |
| fane : Femme « Sa fane est gentite (aimable) ». « Chez z 'eux y est la fane que porte la culotte ». - (19) |
| fanée, s. f. poussière de farine qui voltige et se répand partout dans les moulins. On l'emploie pour faire le chas ou colle à l'usage des tisserands. La «fanée» est plus connue chez nous sous le nom de « faireune fôle. » (Voir : faireune.) - (08) |
| fanes : partie d’une plante constituée par les rameaux et les feuilles. S’emploie surtout à propos de plantes comestibles. Ex : "Les fanes de mes truffes sont ben drutes, j’vas attendre pour déracher." - (58) |
| fanfareux. n. m. - Musicien dans une fanfare. - (42) |
| fanferluche. n. f. - Fanfreluche. - (42) |
| fanfeurluche : fanfreluche - (48) |
| fanfeurluche : fanfreluche - (39) |
| fanfeurlue, s. f. fanfreluche, bagatelle de toilette, rubans, chiffons. - (08) |
| Fanfouine. Sobriquet quelquefois appliqué aux femmes en plusieurs lieux. - (08) |
| fanfreluche, choses vaines et frivoles... - (02) |
| fanfreluches. : (Dial. et pat.), choses frivoles. - Freluches, dans le dialecte, signifie bagatelles (Roq.), d'où freluquet, jeune vaniteux ou pomponné. - (06) |
| fange : Maladie des jeunes enfants, caractérisée par des aphtes à la bouche. - Harbe à fange, stellaire (stellana holosta) d'après la croyance populaire une pincée de cette plante placée dans le bonnet d'un enfant atteint de la fange suffit pour amener la guérison. - (19) |
| fangeant : Spongieux, « Du papier fangeant », du papier buvard. Vieux français, fongeux. - (19) |
| Fanie, pour Stéphanie, féminin de Stephanus, Etienne. - (16) |
| fanme, sf. femme. - (17) |
| fânné (prononcer fan, comme dans fân-ne), celui qui se plaît trop dans la société des femmes. - (16) |
| fânne, femme (prononcer fân-ne ; fan, comme on le prononce dans la dernière syllabe du mot en fan, enfant. - (16) |
| fanne, femme. - (05) |
| fan-ne, Femme. - (26) |
| fan-ne, s. f. femme. - (22) |
| fanne. Femme, femmes. On dit néanmoins aussi femme en parlant bourguignon, mais alors on écrit famme. - (01) |
| fanne. : Femme. Fannelôte, petite femme. Fannei, femmelet, idolâtre de sa femme, dit Delmasse. Toutefois, au village ce mot a plus d'étendue ; il s'applique à celui qui se plaît avec les femmes et recherche leur société. - (06) |
| fannei. Idolâtre de sa femme… - (01) |
| fannet, un homme qui fait l'ouvrage d'une femme. Ce mot est de la contrée de Semur, où l'on dit aussi cocotte pour synonyme de fannet. - (02) |
| fan-nèye, homme qui a des occupations de femme. - (28) |
| fannochon, sm. même sens que fannöt. - (17) |
| fannöt, sm. homme qui se mêle d'ouvrages de femmes, « embarras de cuisine ». - (17) |
| Fanny : s. f., nom donné à la « vieille » dont, au jeu de boules, ceux qui n'ont pas fait un seul point sont condamnés à « baiser le cul » (voir cul). - (20) |
| fanouze : une mauvaise herbe (les chénopodes) - (46) |
| fantaijie : Fantaisie. « Y est bin rare qu'an pouye (qu'on puisse) se passer totes ses fantaijies ». - (19) |
| fantain-ne : Cannelle, gros robinet de cuivre que l'on met aux cuves et aux gros fûts. « Ol a mis la fantain-ne de la cûe bien adratement, sans pèdre eune gotte de vin ». L'opération qui consiste à remplacer le « tapan » de la cuve par la « fantain-ne » est assez délicate en raison de la forte pression exercée par la masse du liquide contenu dans la cuve. - Petite source : « La fantain-ne es cabres ». - (19) |
| fantaisie : beignet - (48) |
| fantaisie : s. f., pâtisserie analogue à la bugne, mais beaucoup plus légère. - (20) |
| fantaisies. Ne s'emploie qu'au pluriel. Pâtisserie nationale qui se fait en coupant de longues bandes de pâte à l'aide d'une roulette dentelée, on noue ces bandes plusieurs fois, on les fait frire, puis on les sert saupoudrées de sucre. - (12) |
| fantasie, s. f. fantaisie. - (08) |
| fantasque. Fantasque. - (01) |
| fanteume : Fantôme, épouvantail que l'on met dans les champs pour effrayer les oiseaux. - (19) |
| fantëzie, petites bandes de pâte frite qu'on saupoudre de sucre. - (16) |
| fantôme : épouvantail - (43) |
| fantôme : s. f., mannequin, épouvantai!. - (20) |
| fantôme, se dit à quelqu'un qui déplaît ou est vêtu négligemment. - (16) |
| faquin : (faquin: - adj.) coquet, élégant à l'excès, faraud. - (45) |
| faquin, adj. fade au goût. - (22) |
| faquin, adj. fade au goût. - (24) |
| far (n.m.) : fer - (50) |
| fâr : fer - (51) |
| far : fer - (48) |
| fâr n.m. Fer. - (63) |
| far : fer - (39) |
| far : n. m. Fer. - (53) |
| fâr, s. m. fer avec les mêmes significations qu'en français : « ain c'mingn' d'fâr », un chemin de fer. - (08) |
| fâr, s. m., fer du cheval ou du bovin. - (40) |
| fâr, s. m., fer, chaîne, demi-cercle cloué au sabot des chevaux, et aussi jadis sous certaines chaussures. - (14) |
| fâr, v., faire. - (40) |
| far. s. m. Fer. A Givry et dans beaucoup d’autres endroits, Ve très-souvent se convertit en a. - (10) |
| fara : s. m. instrument de fer sur lequel on frottait les fibres de chanvre. - (21) |
| farabout : s. m., faraud, qui se donne de l'împortanee. qui fait ses embarras ; étourdi, écerveié. - (20) |
| farache, adj. brusque, turbulent, sauvage. - (08) |
| farachou, ouse, s. braque, fantasque, brutal. Les charretiers appliquent souvent cette épithète à leurs boeufs lorsqu'ils sont rétifs ou, au moins, lorsqu'ils n'obéissent pas assez vite à l'aiguillon. - (08) |
| faraga, s. m., jeune enfant turbulent. - (40) |
| Faramine (la Béte) (du bas lat. faramina, bêtes sauvages) Animal fantastique. Légende du XIVe s. connue en mâconnais au XVIIIe s., transcrite par l'Abbé Ducrost. - (63) |
| faramine : « La bête faramine », monstre imaginaire. « As-tu vu la bâte faramine ? ». - (19) |
| faramine : adj. f.» faramineuse (voir Littré, v° pharamineux), fantastique. Yonne, faramine, ad. f., méchante, nuisible : « bêle faramine, bête dangereuse. » - (20) |
| faramine. adj. - Méchant, féroce, en parlant d'un animal : une bête faramine. Issu du latin fera / feramen (bête sauvage), le mot faramine s'est développé en ancien français du XIV' siècle, avec l'idée de bête nuisible ou d'animal fantastique à craindre. Le poyaudin l'emploie sans altération, en insistant sur l'idée de dangerosité de l'animal. - (42) |
| faramine. adj. f. Méchant, nuisible. Bête faramine, bête dangereuse, menaçante. Des mots latin fera et minus. - (10) |
| faramine. Sauvage, méchant : « une bête faramine ». - (49) |
| farandole : s. f., récit, conte, légende. - (20) |
| fàrau, adj., faraud, fier, orgueilleux, et aussi coquet, endimanché. - (14) |
| farau, aude, adj. se dit d'une personne qui a mis ses plus beaux habits. - (08) |
| farau. :Fier, hautain. Ce mot vient-il du latin ferox, qui a aussi cette signification ? Dans le langage familier, on entend souvent traiter de féroce celui qui a un certain apprêt de toilette ou de la prétention à la mise. Toutefois, le mot bas latin baro a fait aussi faro et varo. - (06) |
| faraud (de) : (farô: -ô:d' - adj.) fier, voire crâneur. - (45) |
| faraud : coquet. - (09) |
| faraud n. et adj. Prétentieux, vaniteux. - (63) |
| faraud, fier de sa tenue, de ses habits, de ses avantages physiques. - (27) |
| farauder. v. - Faire l'élégant. - (42) |
| farauder. v. n. Faire parade de ses beaux habits, faire le faraud, l'élégant. (Saint-Martin-sur-Ouanne). - (10) |
| farauderie. s. f. Recherche dans la parure, coquetterie. C’est la farauderie qui perd les jeunes filles. - (10) |
| farbalas. Falbalas, rubans d'une robe. S'emploie surtout au pluriel. - (49) |
| farbeuillai : fouiller, identique à feurbeuillai. - (33) |
| farce, s. et adj., farceur, plaisant : « É-t-i farce, c'garçon ! O nous fâ mouri d'rire ! » - (14) |
| farce. s. f. Hachis de viande de bœuf et d’oignons, assaisonné de sel et de poivre, que l’on coud dans un morceau de poitrine, de hampe de mouton, qu’on met bouillir ensuite dans une marmite avec de l'arrivage, et dont le bouillon, quand il a été soigné, sert à tremper une soupe, que certains gourmets trouvent fort à leur gré, ainsi que la farce elle-même. — Voyez fras. - (10) |
| farçou (on) : farceur - (57) |
| fardœne, s. f. sac de toile servant à porter le goûter aux champs. - (22) |
| fardœne, s. f. sac de toile servant à porter le goûter dans les champs : prends la fardœne et partons. - (24) |
| fâre - faire. - Voyez différents temps aux articles Fairo, Fait, Fiant, Fieussaint, Fiot, Fas. - (18) |
| fare : (vb) faire - (35) |
| fare : faire - (48) |
| fare : faire. - (29) |
| fare : Faire. « Fare san ovrage », faire sa besogne. - Jouer. « Fare au caichot », jouer à cache-cache. - Accoucher. « Fare le p 'tiet ». « Sa fane a fait la p'tiet », sa femme est accouchée. - Pondre. « La pouleille chante, aile a fait l'û ». - « Fâre faute » : manquer, faire besoin. - (19) |
| fâre caibairdouç’e : faire la pirouette - (37) |
| fare crape, loc. dédaigner, mépriser. - (22) |
| fâre c'tu qui..., loc., feindre, faire celui qui... faire semblant : « L'feignant ! ô fâ c’tu qu’é mau ! » - (14) |
| fâre de besoin, loc., être nécessaire, manquer : « J'ai ma casserole qu'a tapé su l'feù ; eùne aute me fà d’ besoin. » - (14) |
| fare dévié, loc. faire enrager, donner de l'ennui. - (22) |
| fare fin, loc. prospérer, arriver à bonne fin. - (22) |
| fare la chigne, loc. faire la moue, rechigner. - (22) |
| fare lai câquoûe : bouder, avoir un air renfrogné, mécontent - (48) |
| fare lai creusse : bouder, avoir un air renfrogné, mécontent - (48) |
| fare lai reue : bouder, avoir un air renfrogné, mécontent - (48) |
| fare pet’iai, loc. manger peu de viande ou d'autre aliment avec beaucoup de pain. L’inverse est fare groeu. - (22) |
| fare regrai, loc. dégoûter, écœurer : il est si sale qu'il fait regrai. - (22) |
| faré, adj. ferré. - (38) |
| fâre, faire et dire; les anciens employaient, en effet, le mot fâre pour le verbe dire : fi-t'i, dit-il ; h'é m'fé, qu'il me dit. Fâre une vigne est la cultiver. A l'imparfait, on dit : i vzô, je faisais ; é vzèn, ils faisaient, par le changement du f en v. Parmi ses sens très nombreux, fare a, notamment, celui de simuler : fâre le fô, faire le fou. - (16) |
| fare, faire. - (26) |
| fâre, v. tr., faire, fabriquer. - (14) |
| fare, vt. faire. - (17) |
| fareau : fier, crâneur - (48) |
| fareaud, n. masc. ; un homme bien mis . - (07) |
| fareng'lle : Furoncle « Ol a des fareng'lles plien la cliate (la nuque) ». - (19) |
| farenole, provision de fruits. - (05) |
| fârer, v. tr., ferrer, clouer le fer aux pieds d'un cheval. - (14) |
| fareu : Nom masculin, mauvais outil, bon pour la ferraille « C'te pieuche, y est in fareu ». - (19) |
| fareune : Farine. « Eune saiche de fareune », un grand sac de farine. - (19) |
| fareune, s.f. farine. - (38) |
| fàreùre, s. f., ferrure, garniture de fer. - (14) |
| farfoilli : farfouiller - (51) |
| farfoïlli : Farfouiller. « Ne vins pas farfoïlli dans mes affâres ». - Remuer. « I me farfoïlle au gousier ». - (19) |
| farfoïlli v. Farfouiller. - (63) |
| farfottement : s. m., râle pulmonaire. - (20) |
| farfotter : v. n., avoir des farfottements. - (20) |
| farfoueiller : farfouiller - (39) |
| farfouillai, fureter quelque part avec désordre ; en latin perfodere , creuser, fouir. - (02) |
| farfouillai. : Fouiller avec tumulte et sans ordre. - En Franche-Comté, aux Fourgs, on dit farfouilli la terre (Tiss.), du latin perfodere, fouir. - (06) |
| farfouillé : écœuré - (44) |
| farfouiller : bouleverser en cherchant. - (09) |
| farfouiller : v. a., troubler la fonclion digestive, donner mal au coeur. Ça m’ farfouille sur l'estomac. J' suis toute farfouillée à c’ matin. - (20) |
| farfouiller, v. tr. et intr., chercher avec indiscrétion. Se dit ensuite des aliments qui ont de la difficulté à digérer et font mal au cœur : « C'morciau d'lard que j'ai maingé, ô n'pass'pa s; ô m' farfouille. » - (14) |
| farfouiller, verbe transitif : remuer dans l'estomac. - (54) |
| farfouiller. Donner des envies de vomir. Avoir mal au cœur ; remuer le cœur. On dit aussi : « le cœur me farfouille ». - (49) |
| farfouiller. v. n. Fouiller, chercher en brouillant, en emmêlant tout. Il est français dans ce sens, mais, par extension, par analogie, on le dit en patois, à Mailly-la-Ville, de celui qui bégaye, de celui qui, en parlant, semble fouiller de sa langue le fin fond de son gosier pour en tirer péniblement quelques mots confus, des syllabes entortillées. - (10) |
| farfouilli : farfouiller - (57) |
| farfouillon : s. m., farfouilleur (syn. de frenouillon). - (20) |
| farfouillou, adj., curieux, chercheur indiscret. - (14) |
| farfouin. n. m. - Celui qui parle avec une voix nasillarde. (Saint-Martin-sur-Ouanne, selon M. Jossier) - (42) |
| farfouin. s. m. Celui qui parle du nez. (Saint-Martin-sur-Ouanne). - (10) |
| farfouiner. v. - Parler du nez. (Saint-Martin-sur-Ouanne, selon M. Jossier) - (42) |
| farfouiner. v. n. Parler du nez, accentuer péniblement. (Champignelles, Saint-Martin-sur-Ouanne). - (10) |
| farfouyé, mettre le désordre dans des choses où l'on en cherche une ; l'estomac farfouye quand il digère mal un liquide ou un mets. - (16) |
| farfouyi, v. n. provoquer une mauvaise digestion : cette viande trop grasse m'a farfouyi. - (22) |
| farfoyi : farfouiller - (43) |
| farfòyi, v. n. provoquer une mauvaise digestion : cette sauce trop grasse m'a farfòyi. - (24) |
| fargot : n. m. Fagot. - (53) |
| farigné, garçon de moulin. - (16) |
| farine jaune : s. f., farine de maÏs. On dit aussi farine de Turquie. - (20) |
| farinier : Garçon meunier. - (19) |
| farinier, garçon meunier. - (05) |
| farinière : Coffre dans lequel on met la farine destinée à faire le pain farme : Ferme. « Alle a été sarvante de farme ». - Adjectif, ferme, solide : « O se tint farme c'ment in marchand de poulots ». - (19) |
| farinière : s. f., coffre à farine ou à provisions quelconques, et, par extension, ces provisions elles-mêmes. Une farinîère de noix. - (20) |
| farmas'rie, pharmacie. - (16) |
| farme (n.f.) : ferme - (50) |
| farme : ferme - (48) |
| farme : ferme - (39) |
| farme : n. f. Ferme. - (53) |
| farme, adj. ferme, solide : « tin farme », tiens ferme. - (08) |
| farme, adj., ferme, solide, compact. - (14) |
| farme, s. f. ferme, domaine affermé. - (08) |
| fàrme, s. f., ferme, métairie. - (14) |
| farme. n. f. - Ferme. - (42) |
| fàrmei, s. m., fermier, métayer. - (14) |
| farmelot : Un peu ferme. « Tan p'tiet freuge-t-i bien ? Oh oué ol est d'jà farmelot », ton enfant grandit-il ? Oh oui, il est déjà solide des reins. - (19) |
| farmer, v. tr., fermer, boucher une ouverture. (V. Fremer.) - (14) |
| farmer. v. - Fermer. - (42) |
| farmier : Fermier. « Ol a de la chance davoi in ban farmier ». - (19) |
| farmier : n. m. Fermier. - (53) |
| farmier, ère. n. m. - Fermier, fermière. - (42) |
| farne : s. f. farine. - (21) |
| farner : faire sécher des fruits au four. - (30) |
| farô - fier, vaniteux. - Al à farô ce gairson lai. - Vos é remarquai, quemant qu'a fait le farô ! Ci lli vai aissez ben. - (18) |
| farô, adj., hautain, insolent. - (40) |
| faro, celui qui so montre fier d'être bien vêtu. - (16) |
| farô, fier, hautain ; le latin ferox signifie aussi superbe, orgueilleux. Le même mot s'écrit faraud ; il est usité à Paris, et Vadé s'en sert dans ses couplets poissards. Il se dit principalement de ceux qui se quarrent dans leurs habits. - (02) |
| farouiller (se). v. - Se noircir avec les ustensiles de cuisine. (Perreuse, selon M. Jossier) - (42) |
| farouiller. v. a. Noircir avec du noir de fumée, du noir de chaudière ou de chaudron. — Se farouiller. v . pron. Se noircir au contact des ustensiles cuisine. (Perreuse). - (10) |
| farquette, fourquette : s. f., vx fr. farcosle, barque à fond plat, dont l'avant est carré et relevé et dont l'arrière est en arête. Voir barquot et nagerat. - (20) |
| farragoin : s. m., farrago, mélange, salmigondis. - (20) |
| farrai, pour ferré... - (02) |
| farraille (d'la) : ferraille - (57) |
| farraillou (on) : ferrailleur - (57) |
| Farran. M. Ferrand, intendant de Bourgogne, depuis intendant de Bretagne, aujourd'hui conseiller d'Etat. - (01) |
| farre (pour feurre, foarre, fouarre). s. m. Foin, paille, fourrage. (Soucy). - (10) |
| farrè : ferrer (les chevaux) - (46) |
| farreille : Ferraille, vieux fers, outils de rebut. « An troue des fois quèque chose de ban dans la farreille ». - (19) |
| fârrer : ferrer - (51) |
| farrer : ferrer - (57) |
| farrer : Ferrer. « San chevau est farré à glièche ». - (19) |
| fârrer v. Ferrer. - (63) |
| farrure (na) : ferrure - (57) |
| fartachou, s. m., peigneur de chanvre. - (14) |
| farter) v. frotter les fibres de chanvre sur un racloir de fer. - (21) |
| fâs (i). Je fais. - (08) |
| fas (ie), je fais. - (04) |
| fas (n.m.) : faix, fardeau - (50) |
| fasant. partic. pr. du verbe Faire. (Sommecaise). - (10) |
| faseux. n. m - Celui qui fait quelque chose, « faiseur» : l’faseux d'goutte. - (42) |
| fasex. : Portefaix (du latin fascis, fardeau). - (Franch. d'Ts-sur-Tille, 1369.) - (06) |
| fassalle (na) : faisselle - (57) |
| fasse : Fesse. « Alle a cheu su ses fasses ». - (19) |
| fasse, s.f. fesse. - (38) |
| fât. s. m. Faix, charge, fardeau. Un fât d’herbe. - (10) |
| fate : Mou, flasque, sans consistance. - (19) |
| fate, adj. flétri, flasque, spécialement pour un végétal sous l'effet du soleil. - (24) |
| fate, adj. flétri, flasque. - (22) |
| fatigaule (adj.) : fatigant - (50) |
| fatigaule, adj. qui cause de la fatigue, qui est pénible. Un chemin, un voyage « fatigaules. » - (08) |
| fatigue : s. f., indisposition légère. Une fatigue d'estomac. - (20) |
| fatigué, fatiguée : adj., malade. Se dit de la plus légère indisposition comme aussi de l'affection la plus grave. Madame ne reçoit pas aujourd'hui ; elle est un peu fatiguée. - (20) |
| fâtsi : fâcher - (43) |
| fâtsi : fâcher - (51) |
| fâtsi v. Fâcher. - (63) |
| fau, fou (h.m.) : hêtre (haut-Morvan) - (50) |
| fau, s. m., hêtre. Nous avons plusieurs mots pour désigner cet arbre. - (14) |
| fau. Ce mot a deux sens : celui de faulx (faix) et celui de hêtre (fagus). - (02) |
| fau. Tantôt c'est l'adiectif falsus, ou au pluriel falsi, tantôt c'est le verbe « oportet » : « Ai fau voi », il faut voir ; tantôt c'est falx ou falces, une faux, des faux. C'est aussi le faux du corps, savoir, la ceinture, où est le défaut des côtes… - (01) |
| faubòr, s. m., faubourg. - (14) |
| faucéille (n.f.) : faucille - (50) |
| fauceille, s. f. faucille, instrument pour moissonner. - (08) |
| fauceiller, v. a. fauciller, se servir de la faucille. - (08) |
| faucet. Petite cheville en bois qui sert à boucher les trous d'un tonneau. L'Académie admet ce mot qu'elle écrit à tort fausset. L'ancienne orthographe, d'accord avec l'étymologie, était celle que je donne ici. - (13) |
| fauçeuille n.f. Faucille. - (63) |
| fauçeuilli v. Affûter dent par dent. Syn. beurtsi. - (63) |
| fauchè : faux à moisson - (46) |
| faûcherie (na) : fâcherie - (57) |
| fauchet, fauchat, fauchot. s. m . Faucon, oiseau de proie. (Diges, Jussy, etc.). - (10) |
| faucheû, s. m., faucheur. - (14) |
| faûchi : fâcher - (57) |
| fauchi : Monture de faux. - (19) |
| fauchi, s. m. manche, monture de la faulx (du latin falcariu). - (24) |
| fauchi, s. m. manche, monture de la faulx. - (22) |
| fauchir (se), se fâcher. - (05) |
| faûchot, s. m., rateau en bois pour les foins. - (40) |
| fauchot. n. m. - Faucon. - (42) |
| faûchou : fâcheux - (57) |
| faucillon. s.m. Petite faucille. (Lindry). - (10) |
| faufourche. s. f. Branche ou morceau de bois fourchu servant à étayer un arbre trop chargé de fruits ou de support à quelque chose. Les enfants qui s’amusent à fabriquer de petits moulins, qu’ils font tourner dans un ruisseau, appuient les extrémités de leur axe sur deux faufourches. - (10) |
| faule, s. f., fable, conte, menterie. - (14) |
| faule. Fable, fables ; l'italien dit aussi fola et fole. - (01) |
| faule. : Fable. C'est la dérivation naturelle du latin fabula, comme taule l'est de tabula. - (06) |
| faunâjon. s. f. Fenaison. (Tharot). - (10) |
| fauner. v. a. Faner. (Montillot). - (10) |
| faur (n.m.) : four - (50) |
| faurce (n.f.) : fourche - (50) |
| faurçu (-e) (adj.m. et f.) : fourchu (-e) - (50) |
| faure : four - (43) |
| faurnée (n.f.) : fournée - (50) |
| fauro, fauré, feillu - divers temps du verbe falloir. - En fauré bein que te venâ nos aidie. - En fauro de lai plieue pendant in jor et ine neu… - En ni é pâ aivu ai dire, en nos é feillu liô cédai. - (18) |
| fausse indigestion. Désignation hypocrite, non ! Euphémique d'une bonne indigestion. - (12) |
| faussot, s. m., petite quille en bois pour le « barrot ». - (40) |
| fautale, foutale, s. f. hêtre. Cet arbre abonde dans les bois du Morvan. - (08) |
| faute (avoir) loc. verb. Avoir besoin. - (63) |
| faute (avoir), loc. avoir besoin. - (22) |
| faute (avoué), loc. avoir besoin : j'ai faute d'argent, j'ai faute de sortir (vieux français). - (24) |
| faute (faire) : manquer - (61) |
| faute (faire), loc. faire besoin, manquer : cet argent me fait faute. - (24) |
| faute (fare), loc. faire besoin, manquer : cet argent me fait faute. - (22) |
| faûte : besoin - (57) |
| faute : Besoin. « Avoi faute de… Quand an a fait la Saint-Geôrges deux jos peu deux nés an a bien faute de dremi ». - (19) |
| faute n.f. Manque, défaut. - (63) |
| faute : (fô:t' - subst. f.) manque. Ne s'emploie que dans la locution èvouê:r fô:t, "manquer, être privé de". - (45) |
| faute : s. f., vx fr. faut, manque, besoin. Ah ! qu’ ça m' fait faute ! J'ai trop faute de... - (20) |
| faute, mais seulement un archaïsme. (Ecseùprès représenterait mieux la prononciation.) - (14) |
| faute, s. f. besoin, privation. Avoir faute, avoir besoin, manquer du nécessaire. Avoir faute de pain, manquer de pain ; mourir de faute, périr de besoin. - (08) |
| fauteai, s. m. hêtre. - (08) |
| fauter : Commettre une faute. « Eune fille qu'a fauté » qui s'est laissée séduire. - (19) |
| fauter v. Se laisser séduire (pour une fille). - (63) |
| fauter, commettre une faute. - (05) |
| fauter, v. n. faire une faute, manquer : « i é fauté en fian ç'lai », j'ai fait une faute en faisant cela. - (08) |
| fauter, v. tr., mal faire, commettre une faute, faillir. - (14) |
| fauter. v. n. Faillir, tomber en faute. - (10) |
| fautif, e, adj. des deux genres. Sujet à manquer, à faire défaut. S’emploie surtout en parlant des terres dont la culture est chanceuse, dont les récoltes sont peu assurées. - (08) |
| fautseûx n.m. Faucheur. - (63) |
| fautsi : (vb) faucher - (35) |
| fautsi : faucher - (43) |
| fautsi : faucher - (51) |
| fautsi v. Faucher. - (63) |
| fautsou : faucheur - (51) |
| fautsou, fautsu : (nm) faucheur - (35) |
| fautsous (les) : faucheurs (les) - (43) |
| fauvâ, s.m. sorte de légumineuses sauvages qui croissent dans les vignes ; les fauvâs portent de jolies fleurs d'un rouge cerise au parfum très agréable et dont les racines forment des tubercules à peau noire que les enfants trouvent très à leur goût. - (38) |
| faux piaintsi : partie supérieure de la grange, plancher sur la grange - (43) |
| faux pientssi : faux plancher (fenil situer au-dessus de la grange) - (51) |
| faux pyintsi n.m. Faux plancher, plancher amovible au-dessus du char, dans la grange. Voir partsâ. - (63) |
| faux tsmin n.m. Impasse, raccourci. - (63) |
| faux-mouchet. s. m. Emouchet. (Saligny). - (10) |
| fâve : Fève. (faba vulgaris) « In sa de fàves » : un sac de féves. - « Jeter des fâves », c'est une façon de les vanner : quand on a battu les féves au fléau, après avoir enlevé la « chala » (la paille) on ramasse les grains, les cosses et tout ce qui reste sur l'aire, puis avec une large pelle de bois destinée spécialement à cet usage on lance ce mélange sur le sol de la grange, les grains, plus lourds que les cosses et la poussière, roulent plus loin et sont ainsi séparés mieux qu'ils ne le seraient avec le van. - (19) |
| fave, s.f. fève. - (38) |
| favère, s. f., fève. - (40) |
| faviaud : haricot. Même racine celtique que « fève ». - (62) |
| faviaule : haricot (lat. faba) (celt. fav). - (32) |
| faviôle : Haricot. « Eune acmeude de faviôles », un plat de haricots. Vieux français, faverolle. - (19) |
| faviôlé : Plant de haricots (phaseolus vulgaris). « Des faviôlés nains ». - (19) |
| faviôle, et fafiôle, s. f., féverole, haricot. - (14) |
| faviole, favioule : s. f., vx fr. faverolle, haricot. - (20) |
| fàviôle, féviôle (Chal., Br., C.-d), faiviôle (Morv.). - Haricot, de fabiola, petite fève, diminutif de faba. Cependant Cham bure et Guillemin donnent à ce mot une origine encore plus noble et le font venir du grec pbaselos, même sens, qui a fait le latin faseolus, puis le français faséole, espèce de haricot. - (15) |
| faviole, haricot, féverolle. - (05) |
| faviole, n.f. haricot. - (65) |
| faviole, s.f. haricot. - (38) |
| faviole. Haricot ; du latin faseolus, en vieux français fazeol. - (03) |
| faviôles, s. f. pl., haricots secs. - (40) |
| faviôlon, s. m., petit haricot, diminutif de faviôle. - (14) |
| favioule n.f. Haricot sec. - (63) |
| favioule, faviau : (nf.nm) haricot - (35) |
| favioules : s. pl. haricot. - (21) |
| favioulon (on) : haricot blanc - (57) |
| favounette. s. f. Fauvette. (Sacy). - (10) |
| favré : Février. « Devine voir en quel mois les fanes causant le moins ? Le mois de favré pasqu 'o n 'a que vingt huit jos ». - (19) |
| fay, faye : s. m. et f., vx fr. faye (t.) et feyot (m), mouton, brebis. - (20) |
| fäyeux, euse n. Faiseur, exécutant. - (63) |
| fayite (pour faïl, fay, fays). s. m. Hêtre. (Germigny, Percey). Du latin fagus. - (10) |
| fayot : haricot - (48) |
| fazi (m), menues pierrailles. - (26) |
| fcechi, v. a. ficher, planter en terre un pieu, un échalas. - (24) |
| fé : Fer. « Eune barre de fé ; in fé de chevau ». Soc, « In fé de charrue ». « In fé de gauffres » : un moule à gauffres. - On dit d'une personne qui est fréquemment malade « Alle a tojo in fé que leuque », on la compare ainsi à un cheval mal ferré. - (19) |
| fé d'paille : paille mise en gerbe après le battage du blé. Locution. On va chercher le fé d'paille au plongeon. Ex : "J'vas allé met' un fé d'paille sous la barrée. " Le travail consiste à délier la gerbe et à étaler la paille avec la fourche, en la répartissant convenablement. - (58) |
| fè : adj. Fait. - (53) |
| féchale, s. m., forme à fromages. - (14) |
| fèchalle : s. f. faisselle. - (21) |
| fechoeu, s. m. plantoir de jardin. - (22) |
| fechou s. m. plantoir de jardin. - (24) |
| fedau, fedeau : s. m., tablier en toile grossière. - (20) |
| féét' : n. f. Fête. - (53) |
| fègain, fagot. - (26) |
| fëgnan, fainéant ; fëgnantîze, paresse. - (16) |
| feignance. Finance, finances. - (01) |
| feignant (porte-), s. m., siège mobile accroché sur les brancards d'un char. - (40) |
| feignant : Fainéant, paresseux. « Que grand feignant ! ». Lâche, peureux « Sô (sors) dan voir dave ma si te n'es pas feignant ». - (19) |
| feignantije : Fainéantise, paresse. « O n'a pas élevé ses enfants à la feignantije ». - (19) |
| feignasson, adj., paresseux, lambin. - (40) |
| feigne. Fine. Feigne fleur, fine fleur. - (01) |
| féille (n.f.) : fille - (50) |
| féille : fille - (48) |
| feille : fille - (39) |
| feille : n. f. Fille. - (53) |
| feille, s. f. fille. - (08) |
| feille. Fille (prononcer« fe »). - (49) |
| feillette, fillette : s. f, feuillette, ancienne mesure de capacité pour les liquides, valant un demi-tonneau, soit 104 litres 583. Aujourd'hui, en Mâconnais, la feuillette contient de 107 à 108 litres. - (20) |
| feillu du verbe falloir. - Voyez à Fauro. - (18) |
| feingnan, ante, s. et adj. fainéant, paresseux, lâche. - (08) |
| feintije : Feinte, tromperie. « Je me sus pas laichi prendre à ses feintijes ». - (19) |
| feintise , feinte, tromperie. - (04) |
| feintise, s. f. feinte, ruse, tromperie, trahison. - (08) |
| felain, felan (flin, flan) : s. m., maladie régnante, de caractère bénin et indéterminé. C'est un felain qui court. A rapprocher du vx fr. felon. - (20) |
| Felebar. Philibert. Ce saint donne le nom à la septième et dernière paroisse de Dijon, dans laquelle on gagne d'amples indulgences. - (01) |
| feler : Filer. « Aujord'heu i n' y a plieu guère de fanes que felint la conaille (la quenouille) ». « O fele in mauvâ coten », sa santé, ses affaires prennent une mauvaise tournure. - (19) |
| fêleure (n.f.) : fêlure - (50) |
| Felipe. Philippe de France, roi d’Espagne, Ve du nom, appelé Felipe en bourguignon comme en espagnol.. - (01) |
| felogne. : Quenouille. On dit aussi quelogne et quenoille (Del.). - (06) |
| felôle, s. f. éclair long et éblouissant. - (22) |
| felongne, quenouille. On dit encore quelogne et quenoille. - (02) |
| felorde : s. f. mouette. - (21) |
| felouse : Fileuse. « Dans le temps les felouses venint vailli ». - (19) |
| femai, femé - engraisser les terres, surtout avec du fumier ; fumier. - I n'ai pâ aissez de femé, en faut qui en aichetâ à moins deux voitures. - Vos viez bein, père Rose, vos ne femez pas assez ; assi vo ne récoltez ran. - Vos femereins moinme vos prai que ci sera bein. - (18) |
| femai, femére - fumer et fumée. - Ma vote chambe â plieine de femére. - Lai feumére é déji noirci les rideaux. – Oh ! ces chevenées qui ailant mau ; à femant tôjeur. - (18) |
| female : Femelle. « J'avais deux quinchans (pinsons) en caige mâ la female a cravé ». Female s'emploie aussi dans le sens de femme mais seulement en mauvaise part « Dave ces sacrés females an n’est jamâ tranquille ! ». - (19) |
| femalle. s. f. Femelle. (Qomeçy-sur-le-Vault). - (10) |
| fembrier. : (Dial), fumier. - (06) |
| femé : Fumier. « Si an veut récolter des balles denrées faut pas réparmer (épargner) le femé ». « Ol a déjà mis de la peille su san femé » : il porte déjà un chapeau de paille. (Plaisanterie plus que grossière). - (19) |
| femé, fumier. - (05) |
| femée : fumée. - (52) |
| femée : fumée. Pas de femée sans feu : pas de fumée sans feu. - (33) |
| femeire, fumée... - (02) |
| femeire. Fumée… - (01) |
| femeire. : Fumée. - (06) |
| femellier, femali (femâli) : s. m., coureur de femmes. - (20) |
| femère : Fumée. « I n'y a point de fû (feu) sans femère ». - (19) |
| femère, fumée. - (05) |
| femere. Fumée. - (03) |
| femerée, lie de fumier. - (05) |
| femeria (d'la) : purin - (57) |
| femme, n.f. femme, épouse. Le terme épouse n'est pas usité. - (65) |
| femme-sage : s. f., sage-femme. - (20) |
| fenacer. v. n. Brouillasser. - (10) |
| fenaiger - fréquenter un lieu, y venir souvent. - Te fenaige don de ce cotai qui métenant ? - Quoi qu'a veint don tojeur fenaiger qui ? - Oh, â ne velant pâ y fenaiger long-temps. - (18) |
| fenailles, s. f. pl., balayures de « foineau ». - (40) |
| fenaillon. s. m . Mauvais chiffon, morceau d’étoffe passée, fenée (fanée). (Saint-Florentin). - (10) |
| fenal, fenau : s. m., feniêre : s. f., vx fr. fenal et fenière, fenil. - (20) |
| fenarder. v. n. Boire avec excès, s’enivrer. (Percey). - (10) |
| fenasse (nom féminin) : terrain non entretenu. - (47) |
| fenasse : herbe sèche - (60) |
| fenasse. s. f. Herbes des bois, graminées sauvages, que les femmes de la campagne cueillent pour les bestiaux. - (10) |
| fenasser (verbe) : tomber une pluie fine. - (47) |
| fenau - fenil. - En y é tré bein de foin c't'année, nos fenau sont aipruchant plieins. - Al é choué deupu le dessus du fenau. - (18) |
| fendaiche : Fente. « Y a eune fendaiche dans le porteau (portail) ». Vieux français, fendace. - (19) |
| fendaichi : Fendre, gercer. « Si te laiche ces planches au sola (soleil) t'es bin seur qu y vaut se fendaichi ». - (19) |
| fendaïou, s. m., morceau de buis cranté à trois dents pour fendre les osiers de vannerie. - (40) |
| fendasse, s. f. fente, crevasse, lézarde. - (08) |
| fende : fendre - (48) |
| fende v. Fendre. - (63) |
| fende : fendre - (39) |
| fendeau : fronde en bois. - (09) |
| fendedre, s. f. fendure, fente, crevasse, lézarde. - (08) |
| fendelé. adj. Fendillé, plein de petites fentes. (Puysaie). - (10) |
| fendeure, s. f. fente. - (22) |
| fendis. s. m. Osier fendu à l’usage des tonneliers. (Saint-Florentin). - (10) |
| fendoû : fendeur - (48) |
| fendou : Outil qu'emploient les tonneliers pour fendre en trois les brins d'osier dont ils se servent pour lier les cercles de tonneaux. - (19) |
| fendou : fendeur - (39) |
| fendue, s.f. action de partager la battue en deux dans la grange. - (38) |
| fendure, s. f., fente, lézarde: « Vrà ! t'as eùne fameuse fendure à ta robe ! » - (14) |
| feneau. s. m. Fenil. (Etais). - (10) |
| feneret : efféminé. - (30) |
| féneril. s. m. Grenier à foin. (Champignelles, Saint-Martin-sur-Ouanne). - (10) |
| fenéte (n.f.) : fenêtre - (50) |
| fenêtre. Fenêtre… - (01) |
| fenétron : s. m., petite fenêtre. - (20) |
| féniant - fainéant, paresseux. - Quand en pense qu'al é in état ; al é des enfants, et pu a fait le féniant préque tu les jors. - Té vu son champ, c'a bien le champ du féniant, en peut le dire. - (18) |
| féniant (on) : fainéant - (57) |
| feniasse : mot féminin désignant un fainéant - (46) |
| feniller : v. a., faner (le foin). - (20) |
| fenitre, v. n. finir. - (08) |
| fen-ne. Femme. - (49) |
| fen-né. Qui se plaît en compagnie des femmes. Péjor. : qui court après les jupons. - (49) |
| fenot : (f'nô: - subst. m.) fenil. Ce mot subit la concurrence sévère de plinché, "plancher". - (45) |
| fenouiller : perdre son temps. - (66) |
| fenre, v. a. fendre. - (08) |
| fenril. n. m. - Fenil, grenier pour conserver le grain. - (42) |
| fèntize, feinte, dissimulation. - (16) |
| fer ou plutôt fers. : Ornement de toilette interdit aux servantes par l'édit somptuaire de la municipalité de Dijon en 1580. - (06) |
| fer : (fê:r - subst. m.) 1- fer (matériau). 2- instrument en fer, et en particulier : fer à ferrer les animaux (vaches, chevaux ... ) et soc de charrue. - (45) |
| fer. Soc de la charrue. - (49) |
| férâ, s. m. le salmo lavaretus des naturalistes. Ce poisson est devenu Morvandeau, grâce à son acclimatation complètement réussie dans le réservoir des settons. - (08) |
| feragni : chercher un objet dans un désordre - (34) |
| feranz. : (Dial.), cruel, terrible, qui sévit (du latin ferire, frapper, et du participe feriens). - (06) |
| ferbaud, frébaud. adj. Gourmand. - (10) |
| ferbiller. v. - Astiquer, frotter, « faire briller ». - (42) |
| ferbiller. v. a. Fourbir, essuyer, frotter. T’vas ferbiiier la table. - (10) |
| ferbillon, feurbillon (pour fourbillon). s. m. Petit torchon pour fourbir, pour essuyer. (Andryes). — A Lindry, on dit frobillon. - (10) |
| ferbillon. n. m. - Petit torchon pour nettoyer, dépoussiérer. - (42) |
| ferblanquier. Ferblantier, quincaillier. - (49) |
| fercelle (pour fescelle). s. f . Moule à fromage. Du latin fisçella. - (10) |
| fercielle : moule à perforations pour égoutter les fromages - (60) |
| fercielle : aisselle. Cylindre bas en grès avec fond et tour percé de trous pour l'écoulement du petit lait. On plaçait une étamine à l'intérieur pour éviter les pertes de matière constituant le fromage blanc en formation. Synonyme d'agoutasse. - (58) |
| ferdauler. v. a. Battre. (Lucy-s-Cure). - (10) |
| ferdiller, frediller, friller, friler. v. - Frissonner. - (42) |
| ferdir. v. - Refroidir. - (42) |
| ferdue, ferdure. v. a. Froidure. —Roi de ferdue, nom donné au roitelet dans nos campagnes. - (10) |
| ferdusiau. s. m . Roitelet, roi de ferdure. (Saligny). - (10) |
| fére (v.) : faire - (50) |
| fére : faire - (57) |
| fére dépit : vexer - (57) |
| fère lè boque : faire la moue, aussi fère lè reûe - (46) |
| fère quance : faire semblant - èl é pas mô, mais è fait tance de breuillè, il n'a pas mal mais il fait semblant de pleurer - (46) |
| fére rapô : ramasser la mise au jeu de quilles - (39) |
| fère trempusse : tremper du pain dans du vin sucré ou dans du lait - (46) |
| fére : faire - (39) |
| fére : v. t. Faire. - (53) |
| fére, v. a. faire. Dit « fée » à l'infinitif par la chute de l'r. - (08) |
| feré. Feras, fera, ferez. - (01) |
| féreine. s. f. Farine. ( Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| féreineux. adj. Farineux. (Ibid.). - (10) |
| fèréne, farine. - (26) |
| fergonner (v. int.) : fourgonner (fergonner dans l'poêle) - (64) |
| fergouner, feurgouner, fargouner. v. - Chercher, remuer, farfouiller : «La vieille a' passait toute la sainte journée au cougnot du feu à berdouner en fergounant les tisons. » (Fernand Clas, p.334). Le verbe forgoner signifiait enancien français remuer avec un forgon, un tisonnier. Il se confondait avec le verbe furgier : chercher, fouiller comme un voleur; le furet était un petit voleur (de fur, voleur en latin). La tige métallique crochue du voleur, le fourgon, a été appliquée aux braises du feu. Le français utilisait encore fourgon et fourgonner dans la première partie du XXe siècle (notamment pour le four du boulanger). Le poyaudin a conservé également ces deux mots en gardant l' idée de rechercher. - (42) |
| feriandies. n. f. pl. - Friandises ; synonyme de ferloties. - (42) |
| ferlampe. n. f. - Réunion de buveurs et de débauchés. Dérivé du moyen français de la Renaissance, le frelampier désignait un homme de peu, pas bon à grand-chose ; cette signification était un emprunt au dialecte picard frelamper, boire avec avidité. - (42) |
| ferlampe. s. f. Nom donné, dans la Puysaie, à certaines associations de buveurs et de débauchés, ainsi appelées parce que, dans l’origine, ces sortes d’associations se composaient de ferlampiers (de frères lampiers), individus qui étaient chargés de l’entretien des lampes dans les églises et les couvents, qui étaient tous, paraît-il, de grands ivrognes, aimant à se réunir ensemble pour jouer et faire godaille, pour lamper, ainsi qu’ils le disaient entre eux et qu’on le dit encore aujourd’hui à leur exemple. (Perreuse). — Voyez lampée et lamper. - (10) |
| ferlamper. v. - Bien boire, s'empiffrer : « On est ici pou' ben manger, s'remplir l'gézier et ferlamper. » (Fernand Clas, p.ll8) - (42) |
| ferland, ferjand. adj. et s. m. Friand. - (10) |
| ferlauber. v. a. Lécher en faisant entendre un clapement. — Se dit aussi pour exprimer qu’on a tout mangé, qu’on n’a rien laissé. (Saint-Martin-sur-Ouanne). - (10) |
| ferlaud, ferbaud. adj. - Curieux, indiscret, incorrect. - (42) |
| ferlaud, ferlot. adj . et s. Friand. (Ghampignelles). - (10) |
| ferler (pour freler). v. n. Fureter, faire comme un frelon en quête de miel. (Gourson, Etais). - (10) |
| ferler (v. int.) : rôder (syn. trôler) - (64) |
| ferler. v. - Flairer. - (42) |
| ferleux (n. m.) : rôdeur - (64) |
| ferlicher (Se). v. pronom. Se passer la langue sur les lèvres, se pourlécher. (Lamsecq). - (10) |
| ferlot. adj. - Gourmand. - (42) |
| ferloties. n. f. pl - Friandises, gourmandises : « Elle est possédée d'un besoin fou de câlineries, et de ferloties, comme on dit â Montigny. » (Colette, Claudine à Paris, p. 242) - (42) |
| ferlouner (pour frelonner). v. a. et n. Fredonner, faire entendre un bourdonnement comme le frelon. ( Villiers-Bonneux). - (10) |
| ferlu. adj. - Plusieurs usages : 1. Vif, intelligent, en parlant d'un enfant ou d'un petit chien. 2. Gourmand, friand : « On y dounnait du pain trempé dans du vin et il était tellement ferlu qu'il en mangeait jusqu'à en trébucher comme vous et moué. » (Fernand Clas, p.281) 3. Incorrect, inconvenant, mauvais. - (42) |
| ferlu. adj. Inconvenant. Si ce mot, qui se prononce ainsi à Granchamp, est là pour frelu, il signifie, suivant Roquefort, vaurien, larron, voleur. - (10) |
| ferluquier, ferlutier. n. m. - Se dit d'une personne prétentieuse, hautaine. (Treigny) - (42) |
| ferlusettes. s. f. pl. Copeaux de menuisier. (Nailly). - (10) |
| ferluter. v. n. S’introduire indiscrètement chez les autres, pour savoir ce qui s’y passe. (Sommecaise). Doit avoir la même origine que ferlu. - (10) |
| fermailles (vx fr.), fremailles, fromailles, formailles, fourmailles : s. f. pl., dragées de fiançailles. Dans les villages, les fiancés vont de porte en porte offrir, la future des dragées, le futur une prise de tabac. - (20) |
| fermer : v. a., voir à déhors son emploi avec ce mot. - (20) |
| fermi : voir froumi - (23) |
| fermi, frémi, feurmi, fromi. n. f. - Fourmi. - (42) |
| fermi, fremi, fromi. s. m. Fourmi. - (10) |
| fernailler (pour frenailler). v. a. Refréner, frapper pour corriger. Du latin frenare. (Etais). - (10) |
| fernailler. v. - Trainailler : « Qu'est ce qui fernaille ? l' vint pas ? » (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| fernaule, s. f ., part, provision de noix offerte à quelqu'un au moment de la récolte. Ce mot ne s'applique pas à une autre espèce de fruits : « J'vons chapler les calas ; j'te frai ta fernaule. » - (14) |
| fernouillat. s. m. Enfant qui trépigne, qui remue sans cesse. (Villiers-Saint-Benoit). - (10) |
| fernouiller. v. n. Remuer, s’agiter sans cesse. (Champignelles). - (10) |
| feron. Ferons, feront. - (01) |
| féroter, v. tr., frotter le chanvre contre un instrument de fer planté dans le mur, afin de le préparer au peignage. - (14) |
| ferraillon. n. m. - Ferrailleur. - (42) |
| ferraillon. s. m. Acheteur et revendeur de vieilles ferrailles. - (10) |
| ferratier, ferretier : s. m., vx fr., taillandier. - (20) |
| ferrer. v. a. Carder. (Rogny). - (10) |
| ferrer. : Frapper (du latin ferire). - (06) |
| ferreter. v. - Peigner le chanvre. - (42) |
| ferreux, ferteux. n. m. - Filassier ; celui qui peigne le chanvre. - (42) |
| ferreux. s. m. Peigneur de chanvre. (Villiers-Saint- Benoît). - (10) |
| ferrier. n. m. - Gisement de scories de fer. - (42) |
| ferrier. s. m. Amas de scories de fer. (Puysaie). - (10) |
| ferrière. Ce mot signifie dans le pur français un sac de voyage, ou bien le sac de cuir des serruriers. Chez nous il désigne le vase en fer-blanc ou l’on apporte le lait, soit de la campagne en ville, soit du marché à la maison. - (12) |
| ferselle (n. f.) : faisselle - (64) |
| fersue (n. f.) : (avouèr la fersue tombée (être indisposé ou de mauvaise humeur)) - (64) |
| fersue, farsue. n. f. - Fressure : viscères du porc, du veau, etc. - (42) |
| fersue, frechue, frechure. s. f. Fressure, comprenant le cœur, la rate, le foie et les poumons d’un animal. Une fersue de vjau. — A Subligny, on dit férchure. - (10) |
| fertailler. Corriger. « Se faire fertailler », c'est se faire corriger avec une verge. - (49) |
| fertasse. s. f. Filasse. (Bessy). - (10) |
| fertasser. Chercher dans les broussailles. Par extension, chercher, remuer avec bruit. - (49) |
| fertasses. Broussailles, débris de ramures, amas de brindilles (s'emploie au pluriel). - (49) |
| fertée (n. f.) : raclée, correction - (64) |
| fertée, feurtée (frottée). s. f. Quantité de chanvre que l’on met dans une pile, pour être broyée sous le pilon. (Perreuse). — Tranche de pain dont la croûte a été frottée d’ail et sur laquelle est étendue une couche de fromage mou, semée de sel et de poivre et quelquefois de menus brins d’ail ou d’appétit. Fais-moi une boune feurtée. - (10) |
| fertée, feurtée. n. f. - Quantité de chanvre que l'on place dans une pile, pour être broyée sous le pilon. (Perreuse, selon M. Jossier) . - (42) |
| ferter (n. m.) : sérancer le chanvre, diviser la liasse avec le séran – donner une raclée - (64) |
| ferter : carder le chanvre. - (09) |
| ferter : fouetter. Battre quelqu'un en fouettant (ou plutôt en menaçant de fouetter). Ne s'emploie que pour les personnes. Ex : "L'pour pétit, il s'a fé ferter par son pée !" La personne menaçant l’enfant utilisait une botte de chanvre pour le fouetter. - (58) |
| ferteux (n. m.) : ouvrier chargé de sérancer le chanvre - (64) |
| ferteux. s. m. Filassier, peigneur de chanvre. - (10) |
| fertier : buisson - (60) |
| fertil (pour fretil). s. m. Friche, terre inculte. (Montillot). - (10) |
| fertille. adj. (ll mouillées). Fertile. - (10) |
| fertissier. s. m. Mistoupon, peigneur de chanvre. - (10) |
| fertoler. Chercher en déplaçant les objets avec bruit. - (49) |
| ferzin. Bruit : « faire du ferzin ». Fig. Se fâcher en criant fort. - (49) |
| feseau, fuseau. - (05) |
| fesoûe : appareil génital féminin - (48) |
| féssale, s. f. moule à fromage (du vieux français faisselle. latin fiscella). - (24) |
| fesse : s. f., avoir les joues comme les fesses d’un pauvre homme, être très joufflu. - (20) |
| fessô (prononcez fesseu), houe, instrument recourbé pour couvrir la terre. Fessou, une pioche ; d'où fessourou de veigne, c.-à-d. vigneron... - (02) |
| fessô, fezô et fessou. : Pioche de vigneron (du latin fodere, supin fossum). - On dit ein fessourou de vaigne, c'est-à-dire un vigneron. - (06) |
| fessou (C.-d., Chal.). - Outil à sarcler, houe. Fessourer, c'est travailler avec le fessou. Le fessourei, fessorei ou fessorou de vigne est, par conséquent, un vigneron. Vient du vieux français fosser, creuser, dérivé du latin fodere. Le fosseur ou fosserier était un laboureur ; ce n'est plus à présent que le fossoyeur. Le fessou n'est pas connu dans l'Yonne, cependant fosser y est employé dans le sens de creuser des provins, provigner. - (15) |
| fessou, n.m. binette. - (65) |
| fessou, s. m., houe carrée pour sarcler le maïs et les pommes de terre. Dans les régions proches de la Saône et du Doubs, elle est plus large vers l'emmanchure que vers le tranchant. - (14) |
| fessou, s. m., pioche vigneronne à col de, cygne. - (40) |
| fessou, s.m. pioche au fer triangulaire pour râper la terre. - (38) |
| fessou. Le principal outil du vigneron. C'est une pioche très recourbée qui laboure la vigne sans attaquer les racines. Fessourer, travailler avec le fessou.... - (13) |
| festain-ne, s. faîte. - (38) |
| fésure : n. m. Débris. - (53) |
| fêt de paille : fagot (faix ?). (SS. T IV) - N - (25) |
| fétai. Fêter, fêté, fêtez. - (01) |
| féte (lai) : fête (la) - (48) |
| féte (le) : sommet (le) - (48) |
| féte (na) : fête - (57) |
| féte : Fête, fête patronale. « Vins tu à la féte de Roué, à la Saint Sébastien ? ». « Quand la féte est passe, adieu la Saint » quand la fête est passée, adieu la reconnaissance. - Instrument de musique, « Mère m'a ageté eune féte pa le jo de l'an », ma mère m'a acheté une trompette pour mes étrennes. « Ol apprend à mener la féte » , il apprend à jouer d'un instrument de musique. - Au jeu de cache-cache, « féte » signifie que les recherches peuvent commencer. - (19) |
| féte : (fé:t' - subst. m.) partie haute d' une chose, sommet. - (45) |
| fête*, s. f. instrument de musique en général : le ménétrier et sa fête. - (22) |
| fête, s. f. dans tout le Morvan, « fére lai fête » c'est se régaler, c'est surtout aller à la noce. - (08) |
| fète, s. f. instrument de musique en général : le ménétrier et sa fète. - (24) |
| féte, s. f., fête, réjouissance, réunion : « J'vons fâre la féte. » disent les gens dès qu'il s'agit de se régaler, dès qu'on va à la foire, à l'apport, à la noce, etc. - (14) |
| fête. Fète, fêtes. A Dijon, donner une aubade, s'appelle baillé lai fête; et les enfants, disent d'un homme qui joue du violon, qu’ai meune lai féte. - (01) |
| Féte-Dei. Féte-Dieu, jurement. Nos Bourguignons jurent souvent ainsi, surtout en des occasions de joie… - (01) |
| féte-dieu (la) : fête-dieu - (57) |
| fêtéger (pour festoyer). v. n. Fêter, régaler, faire bonne chère. (Etais). - (10) |
| fêtéger. v. - Faire la fête, bien manger. (Étais-la-Sauvin, selon M. Jossier). - (42) |
| fétégeu, adj. celui qui prend part à une fête, à une noce, à un festin de mariage. Les bons repas ne manquent jamais de « fétégeux. » - (08) |
| fêtégeux. s. m. pl. Ceux qui font partie d’une noce, qui sont conviés, qui assistent à un repas de noce. (Venoy). - (10) |
| feteine. : Futaine. - Pour prix de la course, dans certains villages on donnait une pièce de futaine, de là ces mots : Couri lai feteine lDel.). - M. Littré (Dictionn.) dit que cette étoffe a été apportée da Fostat, nom d'un faubourg du Caire. - (06) |
| féter : fêter - (57) |
| fétîre (na) : faîtière (tuile) - (57) |
| fétire : (nf) poutre de faîte - (35) |
| fé-tout (on) : fait-tout - (57) |
| feu (Au) : Ioc, très cher, hors de prix. Le gibier est au feu en ce moment. Dans ce magasin (nous ne le nommons pas, pour ne pas lui faire de réclame) tout est au feu. - (20) |
| feû : Féminin fôrte. Fort. « Ol est feû c'ment in cri (un cric) ». « Ne choupe dan pas si fêu ! » : ne crie donc pas si fort ! - (19) |
| feû : fort - (43) |
| feu du ciel, la foudre ; feu se dit aussi pour incendie et pour désigner quelqu'un qui est décédé ; avec ce dernier sens, il dérive du latin fuit, il fut ; nommons aussi le feu de joie que font les enfants, le premier dimanche de Carême, pour fêter le retour du soleil et de sa lumière plus vive. - (16) |
| feu jeu ! feu jeu ! Juron signifiant « feu de Dieu ! » - (49) |
| feu : n. m. Furoncle. - (53) |
| feu : s. m., inflammation. C'est un grand feu qu'il a dans le ventre ! - (20) |
| feu, s. m. le dimanche des feux, premier dimanche de carême, est appelé dans une partie du Morvan le dimanche des bordes. - (08) |
| feù, s. m., feu, ménage, incendie. C'est pour sa prononciation que ce mot figure dans notre patois ; il sonne absolument comme je, le, de. - (14) |
| feù. Ce mot, quelque signification qu'on lui donne, n'est bourguignon que par sa manière de le prononcer, particulière aux gens du pays. - (01) |
| feu. Chez nous, désigne le furoncle. - (12) |
| feu. Synonyme bourguignon de : furoncle. - (13) |
| feucho : barreau de chaise, d'échelle. (F. T IV) - Y - (25) |
| feue, feussaint - divers temps du verbe être. - I vourà qu'à feussaint bein content de ce qui liô z-ai dit, ci liô fairo du bien. - Pour trouvai ai se pliaicer en fauro qu'ile feusse in pecho pu jeune. - (18) |
| feùgère, s. f., fougère. - (14) |
| feugnai - flairer, fourrer son nez partout. - Quoi qu'à veint don feugnai qui ? – Mouai, i me défie des gens que feugnant quemant cequi de to côtai. - (18) |
| feugnassou (nom masculin) : personne curieuse jusqu’à l'indiscrétion. - (47) |
| feûgné, chercher comme en flairant ; r'feugné (augmentatif). - (16) |
| feûgnée, s. f., prise, ce que peut contenir le nez ; une feùgnée de tabac : « T-i-pas, vieux pâre, qu'ôs évez pris eùne boune feûgnée ? » - (14) |
| feûgner (v.t.) : flairer, renifler (aussi freugner) - (50) |
| feugner (verbe) : sentir. En curieux, mette son nez partout. - (47) |
| feugner : chercher, fouiller (feurtasser, feurgouner) - (60) |
| feûgner : flairer, sentir, chercher - (48) |
| feugner : sentir avec le feugnon. (RDV. T III) - A - (25) |
| feugner : (feugné - v. trans.) flairer attentivement, chercher en reniflant. - (45) |
| feugner : sentir - (39) |
| feûgner, ferler, fleuer, fleuser. v. - Flairer. - (42) |
| feugner, v. a. flairer ou fouiller la terre avec le museau, le groin. - (08) |
| feugner, v. fouiller un peu partout en mettant tout en désordre. - (65) |
| feûgner, v. tr., priser, flairer, chercher, fouiller la terre : « Que qu't'as donc envie d'treùver aujordeù ? T'feûgnes partout. » (V. Feùgnon.) - (14) |
| feugner, verbe intransitif : flairer, sentir. - (54) |
| feugner. Creuser la terre avec son feûgnon. Le feûgnon est le nez de certains animaux, tels que le porc, le furet, les fouines, les taupes. Fouiner et feûgner sont presque synonymes : le premier ne s'emploie qu'au figuré en parlant des personnes qui ont peur et qui se cachent. Par extension, feûgner signifie : sentir de loin, chercher en furetant. - (13) |
| feugner. Flairer. Fig. Chercher. - (49) |
| feugner. Sentir, flairer. Au propre se dit presque exclusivement du porc. Par extension, on l'a dit d'autres animaux, notamment du chien, puis au figuré des gens curieux qui fourrent leur nez partout. Etym. le bas latin fogerare, fouiller la terre avec le museau. - (12) |
| feûgni : (vb) (en parlant d’un chien) flairer, fouiner - (35) |
| feûgni : renifler, flairer, fouiner - (43) |
| feugni v. (du lat. pop. fundiare, fouiller) 1. Flairer, renifler, fureter. 2. Fouir avec son museau, en parlant du porc, du sanglier ou du chien. - (63) |
| feugni, v. a. flairer, pour un animal. - (22) |
| feugni, v. a. flairer, pour un animal. - (24) |
| feugniè : v. t. Flairer, chercher en remuant, fouiller. - (53) |
| feûgnier : renifler, flairer, rechercher - (37) |
| feûgnier, v., gratter et fouiller le sol avec son groin. - (40) |
| feugnon - par mépris, nez du cochon, du chien : par mépris plus grand encore, nez de personne. - Vos é tuchai le feugnon du cochon, ailez don laivai vos mains. - Qu'al â peut c't-homme lai ! Ne diro-t-on pâ que c'â in feugnon qu'ai é ! - I n'eume pâs les gens que fourant lô feugnon laivou que ci ne les regairde pas. - (18) |
| feûgnon (n.m.) : museau, groin - (50) |
| feugnon (nom masculin) : museau, nez, groin. - (47) |
| feugnon : groin du porc. (RDV. T III) - A - (25) |
| feûgnon : nez, museau - (48) |
| feugnon n.m. Museau. - (63) |
| feugnon : (feu:gnon - subst. m.) groin ; nez des animaux renifleurs (truffe du chien). Par métaphore, nez chez l'être humain. - (45) |
| feugnon, groin de porc ou de sanglier. - (27) |
| feugnon, groin du porc. - (28) |
| feûgnon, groin du pore et nez du chien. - (16) |
| feugnon, meufion : n. m. Nez. - (53) |
| feugnon, s. m. museau, groin. S’applique aux animaux en général. On dit le « feugnon » des bœufs, des vaches, des porcs, des moutons et même des chevaux. - (08) |
| feùgnon, s. m., nez, museau, groin de porc, avec lequel il remue la terre ou les détritus pour y chercher sa nourriture. De là feùgner. — Signifie également : flair. Avoir du feùgnon, c'est deviner les choses. - (14) |
| feugnon. Groin, museau, nez : « ôte don ton feugnon de de là ». - (49) |
| feugnon. s. m. Muffle, groin, museau. — A domecy-sur-Gure , on dit feugnot pour groin de cochon. - (10) |
| feugnon. Substantif tire de feugner, groin. Par extension museau et nez. - (12) |
| feugnot : groin du porc. On brcoh'to le feugnot du couecho : on brochetait le nez du cochon. - (33) |
| feugnou : museau - (39) |
| feuhiau, s. m. fuseau. (Voir : feujau.) - (08) |
| feuil : feu. (LEP. T IV) - D - (25) |
| feuillai : fouiller. - (33) |
| feuillard, f’llard (ll mouillées). s.m. Fouillée. — Ne s’emploie guère qu’au pluriel. Faire des f’llards, des feuillards, couper des branches garnies de feuilles pour alimenter les bestiaux pendant l’hiver. (Saint-Martin-sur-Ouanne). - (10) |
| feuillard. n. m. - Repère au milieu d'un champ ; synonyme de fia. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| feuillarder. v. - Froisser, remuer les feuilles. (Perreuse, selon M. Jossier) - (42) |
| feuillarder. v. n. Remuer dans les feuilles, en parlant d’un petit animal. (Perreuse). - (10) |
| feuillâs : petite branche feuillée plantée en terre pour indiquer une limite (par ex. de semis) - (48) |
| feuillâs, s. m. plur. feuilles sèches par opposition avec les feuilles vertes : « oll’ vié aine grosse sarpant que s'sauvot p'las feuillâs », elle vit un grand serpent qui se sauvait dans les feuilles sèches. - (08) |
| feûille : (nf) feuille - (35) |
| feuille : (nf) fille - (35) |
| feûille : branche feuillue, de noisetier, frêne ou charmille mise en fagots et séchée pour nourrir les chèvres - (43) |
| feûille : feuilles - (51) |
| feuille : fille - (43) |
| feuille : fille - (51) |
| feûille : une feuille - (46) |
| feûille n.f. Feuille. - (63) |
| feuille n.f. Fille. - (63) |
| feûille, fûille (n.f.) : feuille - (50) |
| feuille-de-saule : s. f., petit poisson plat. Voir clef-de-montre. - (20) |
| feuiller. v. a. Feuiller. - (10) |
| feuilleron, s. m. branche d'arbre garnie de feuilles. - (08) |
| feuillet. s. m. Scie. (Puysaie, Saint-Martin-sur-Ouanne). - (10) |
| feuillette (otte) : foin avec beaucoup de feuilles - (39) |
| feuillette : fût de 114 litres - (48) |
| feûillette : tonneau en bois de 114 litres de contenance (en morvan… le « quid » indique 134 litres,11 : 2 quartauts) - (37) |
| feuillette, feuillotte (Chal., Br.), fillette (Morv., Char.), fillotte (C.-d.). - Mesure de liquide ou tonneau contenant la moitié d'un poinçon de vin, c'est- à-dire, en Bourgogne, d'environ 114 litres. Expression très usitée dans le patois bourguignon; l'étymologie serait le bas latin folieta, dérivé de pbiala, vase. - (15) |
| feuillette, fillette n.f. Petit tonneau. - (63) |
| feuillie : fagots de branches d'ecornat* contenant ses feuilles, stocké comme fourrage. A - B - (41) |
| feûillie (feuille) : fagot de pousses de frêne de deux à trois ans séchés et servant de nourriture aux chèvres et aux moutons pendant l'hiver - (51) |
| feuillie : branche feuillue, de noisetier, frêne, mise en fagots pour le fourrage - (34) |
| feûillie n.f. Branches feuillues mises en fagot comme fourrage. - (63) |
| feuillie, s. f. feuillure, entaillure dans la pierre où s'adaptent les portes et les fenêtres. - (08) |
| feuillote (nom féminin) : tonneau, saloir. - (47) |
| feuillotte (n.f.) : feuillette (tonneau dont la contenance est de 114 à 136 litres suivant les régions) - (50) |
| feuillotte : saloir. VI, p. 4-9 - (23) |
| feuillotte, s. f., feuillette (2 quartauts). - (40) |
| feuilloû (-ouse) (adj.m. et f.) : feuillu, feuillue - (50) |
| feûillou (ze) : (adj) feuillu (e) - (35) |
| feuillou : feuillu - (43) |
| feuillou, ouse, adj. feuillu, qui a beaucoup de feuilles, un chêne « feuillou. » on se promène à l'ombre dans une forêt « feuillouse. » - (08) |
| feujau, s. m. fuseau. (Voir : feuhiau.) - (08) |
| feulaisse, s. f. filasse de chanvre. - (08) |
| Feulbèr, Philibert. - (16) |
| feulemâche. s. f. Flammèche. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| feûler (v.t.) : filer - (50) |
| feuler, v. a. filer, faire du fil. - (08) |
| feuler. v. a. Filer. Fait à l’indicatif présent : je feule, tu feules, etc. (Montillot). - (10) |
| feulère : bûcher. - (32) |
| feûlére : mot féminin désignant le fait de brûler les mauvaises herbes dans un champ, on dit aussi feûlée. - (46) |
| feûlot : un petit feu - (46) |
| feulotte : fileuse. - (32) |
| feulouse, s. f. filandière, femme ou fille dont le métier est de filer. - (08) |
| feùmaillon, s. m., jeune drôle qui fume. - (14) |
| feumaillou (on) : fumeur (petit) - (57) |
| feumain : adj. Fait main. - (53) |
| feumant : fumant - (57) |
| feume (nom masculin) : fumier. - (47) |
| feumé : fumier - (48) |
| feumé : fumier. - (52) |
| feumé : fumier. - (33) |
| feumé : 1 n. m. Fumier. - 2 v. t. Épandre le fumier. - 3 v. t. Fumer. - (53) |
| feumé, s. m. fumier, engrais animal. - (08) |
| feume-cigarette (on) : fume-cigarette - (57) |
| feumée - (39) |
| feumée (n.f.) : fumée - (50) |
| feumée : fumée - (48) |
| feumée : n. f. Fumée. - (53) |
| feumée, s. f. fumée, nuage plus ou moins coloré qui s'échappe du feu : « i n'en vouâ fin feumée », je n'y vois rien, pas la moindre chose. - (08) |
| feùmei, s. m., fumier, tas d'ordures. - (14) |
| feumer - boudailli : fumer - (57) |
| feûmer (du) : (du) fumier de ferme - (37) |
| feumer (n.m.) : fumier - (50) |
| feumer (v.t.) : fumer - (50) |
| feûmer : fumer - (37) |
| feumer : fumer - (51) |
| feumer : fumer - (48) |
| feumer : fumer et mettre du fumier dans les terres - (39) |
| feumer, v. a. fumer, répandre du fumier, ou, pour parler le langage du pays, « épincher l'feumé », c'est une besogne que les femmes exécutent vaillamment avec les mains et sans le concours d'aucun intermédiaire. - (08) |
| feùmer, v. tr. et intr., fumer, jeter de la fumée ; fumer la pipe ; se dit aussi des mauvaises cheminées. - (14) |
| feùmer, v. tr., fumer un champ, une terre. - (14) |
| feúmére, et f'mère, s. f., fumée : « O liche trop ; toutes ses târes s'en vont en feùmére. » - (14) |
| feùmerée, s. f., lie du fumier. - (14) |
| feumeret : purin épais - (43) |
| feumeron : petit tas de fumier dans les champs. (BD. T III) - VdS - (25) |
| feumeron : un petit tas de fumier, dans un champ, destiné à être épandu pour fumer le sol - (46) |
| feûmeusserie : (nf) pluie fine - (35) |
| feumeviau. s. m. Petit tas de fumier dans les champs. (Mailly-la-Ville). - (10) |
| feumi (du) : fumier - (57) |
| feumi : fumier - (51) |
| feûmi, f’mi : (nm) fumier - (35) |
| feumî, fmî n.m. Fumier. - (63) |
| feumi, fomi : fumier - (43) |
| feûmiot : petit tas de fumier dans le champ. - (33) |
| feumire (na) - boudire (d'la) : fumée - (57) |
| feûmire : (nf) fumée - (35) |
| feûmire : fumée - (43) |
| feumire, f. fumée (du vieux français fumière). - (24) |
| feumire, s. f. fumée. - (22) |
| feumou (on) : fumeur - (57) |
| feumou (-ouse) (n. ou adj.m. ou f.) : fumeur (-euse) - (50) |
| feumou : fumeur - (39) |
| feumou, s. m. fumeur; celui qui fume : « i n'eume pâ lé feumou, a boutan l'feu dan lé groinges », je n'aime pas les fumeurs, ils mettent le feu dans les granges. - (08) |
| feùmoù, s. m., fumeur, celui qui fume la pipe. - (14) |
| feumouaîr (on) : fumoir - (57) |
| feum'raie : petit tas de fumier (dans un champ) - (48) |
| feumron : petit tas de fumier à épandre avant le labour. - (62) |
| feun’ret : homme qui s'occupe de tâches féminines - (43) |
| feûn’yi : (vb) faner - (35) |
| feune : femme - (51) |
| feûnion : un nez tordu, malformé - (46) |
| feunne : (nf) femme - (35) |
| feunne : femme - (43) |
| feunne n.f. Femme. - (63) |
| feunneret n.m. 1. Homme aimant la compagnie des femmes. 2. Homme efféminé. 3. Homosexuel. - (63) |
| feunn'ret : (nm) homme qui s’occupe à des tâches féminines - (35) |
| feûnyi v. Faner. - (63) |
| feunyi, feuneuyi : faner - (43) |
| feur et defeur. : Dehors. Feur d'iqui, hors d'ici (du latin foras et de foras). - (06) |
| feuragni : chercher un objet dans un fouillis. A - B - (41) |
| feûragni : fouiner (se dit pour une personne) - (43) |
| feuragni : fureter, fouiner - (51) |
| feurâgni v. Chercher, fourrager. - (63) |
| feurbad, s. m. voleur par gourmandise, par friandise. - (08) |
| feurbaud (adjectif) : se dit d'un animal domestique (chat ou chien) qui a tendance à voler la nourriture qui ne lui est pas destinée. - (47) |
| feurbeillé : chercher en remuant beaucoup de choses, fouiller, mettre le désordre. Feurbeille pas dans ma boîte à coutûre : ne fouilles pas, ne met pas le désordre dans ma boîte à couture. - (33) |
| feurbéllions : effets vestimentaires. Une dame avec tous ses feurbéllions : une dame avec tous ses colifichets. - (33) |
| feurber - (39) |
| feurber : fouiller, chercher - (48) |
| feurber : (foerbè - v. intr.) mettre tout sens dessus dessous pour chercher quelque chose. - (45) |
| feurber, v. a., chercher, fouiller. - (11) |
| feûrber, v., chercher des yeux, sans toucher, çà et là. - (40) |
| feurber. v. n. Fureter. (Pasilly). - (10) |
| feurbeut : Enfant très remuant. « Y est in vra feurbeut ! ». - (19) |
| feurbeutte n.f. (de fourbe) Mauvais tour. - (63) |
| feûrbi airaibe ! : exclamation d’impatience que l’on profère lorsqu’on n’arrive pas à démêler ou à retrouver quelque chose dans un ensemble d’affaires rassemblées - (37) |
| feurbot - (39) |
| feurboter (v.t.) : aller de ci de là en cherchant - (50) |
| feurboter, v. n. toucher malhonnêtement aux choses comestibles par friandise ; voler pour se procurer des « chatteries ». - (08) |
| feurbouéiller : fouiller, remuer - (48) |
| feurçeure, s. f. fressure par métathèse, gros viscères des animaux : fressure de veau, de porc, de mouton, etc. - (08) |
| feurchaule (n.f.) : faisselle - (50) |
| feurchelle (nom féminin) : faisselle, moule à fromage. - (47) |
| feurchelle, s. f., vase percé de petits trous pour faire égouter et dans lequel on place les fromages frais. - (11) |
| feûrchelles, fourcholles : récipient en fer blanc, percé de trous pour égouttage du fromage frais - (37) |
| feurcholle(s) : faisselle(s) - (39) |
| feurciner. v. n. Frissonner. Feurciner de fraid dans le dous. (Fresnes). - (10) |
| feurdaine : fredaine - (48) |
| feurdaine : n. f. Petit écart de conduite. - (53) |
| feûrdaines : fredaines, farces - (37) |
| feurdaines : fredaines, petits délits, faire des sottises. Les gamins f'tont des feurdaines : les gamins font des fredaines. - (33) |
| feurdale (en) : v. t. Éparpiller. - (53) |
| feurdale (loc.) : rien ou presque rien - (50) |
| feurdale : rien - (48) |
| feurdale : (fœrdal' - subst. f.) mot-outil servant à la négation, comme en fr. "goutte, mie, point, pas". Al en ré:ste pâ: fœrdal, "il n'en reste absolument rien, pas la moindre trace." - (45) |
| feurdale, s. f. ne s'emploie guère que dans cette locution : il n'en reste que « des feurdales », pour dire il n'en reste rien ou presque rien en parlant d'un grave dommage causé par un incendie, un orage, un coup de force quelconque. - (08) |
| feurde adj. Froide. Y'iau étot bié feurde. Le masculin est frôd. - (63) |
| feurdeneman, fredonnement de la voix. - (02) |
| feurdi. adj. - Refroidi. - (42) |
| feùrdonement, s. m., fredonnement, petit murmure. - (14) |
| feùrdoner, v. tr., fredonner, chantonner. - (14) |
| feurdonneman. : Fredonnement, roulade de voix. (Del.) - (06) |
| feurdzi : se dit des porcs qui fouillent la terre avec leur groin. - (30) |
| feurdzin : grand bruit. A - B - (41) |
| feurdzin : grand bruit - (44) |
| feurdzin n.m. (en dialecte bourguignon le feurzin désigne une multitude de petites bêtes ou d'objets). Raffut, remue-ménage bruyant, dans un grand désordre. (probable déformation de fourrager). - (63) |
| feure. : (Du latin faber), forgeron chargé d'enfforger et de defforger, c'est-à-dire de mettre aux fers et de déferrer les prisonniers. (Cout. de Châtillon de 1371.) - (06) |
| feurée. s. f. Fusée ; par conversion de l’u en eu et de l’s en r. (Domecy-sur-le-Vault). - (10) |
| feurgainches - voyez vergainches. - (18) |
| feurgan : Perche dont on se sert pour remuer le bois qui brûle dans le four. - (19) |
| feurgon : bâton servant à attiser le feu dans le four à pain. Personne autoritaire ou enfant turbulent. A - B - (41) |
| feurgon (n.m.) : 1) long tisonnier pour four à bois - 2) personne qui cherche partout et toujours - (50) |
| feurgon (nom masculin) : tisonnier. Egalement longue perche destinée à étaler les braises dans le four à pain autrefois. - (47) |
| feurgon (vieux) : epithète très désobligeante pour une femme - (60) |
| feurgon : outil pour fourgonner les braises. IV, p. 29-h - (23) |
| feurgon : personne très active, qui n'arrête pas - (48) |
| feurgon : petite perche de bois pour remuer et attiser le feux dans le four à pain - (34) |
| feurgon : tisonnier - (48) |
| feurgon : perche de bois avec laquelle on attisait le feu dans le four à pain. - (33) |
| feurgon n.m. 1. Bâton, tige de métal pour attiser le feu dans l'âtre, pique-feu. 2. Personne qui s'agite beaucoup pour accomplir sa tâche. - (63) |
| feûrgon ! (yieûx) : (vieux) bonhomme embêtant ! - (37) |
| feurgon : 1 n. m. Perche de bois avec laquelle on attisait le feu dans le four à pain. - 2 n. f. Personne très active. - (53) |
| feurgon : genre de tisonnier, se dit de quelqu'un qui remue sans arrêt - (39) |
| feurgon, fourgon. s. m. Tige de fer ou grande perche avec laquelle on râge, on remue les tisons dans un four. - (10) |
| feurgon, s. m. longue perche avec laquelle on remue la braise du four ; tige de fer dont on se sert pour tisonner ou « feurgonner » le feu de la cheminée. - (08) |
| feùrgon, s. m., fourgon, tige de fer pour tisonner, perche pour remuer (fourgonner) la braise du four. - (14) |
| feurgon. Fourgon. Longue perche servant à remuer le bois dans le four, pour activer le feu. - (49) |
| feurgônai. : Remuer, tracasser. - (06) |
| feurgoner : remuer avec un feurgon*. A - B - (41) |
| feùrgoner, V. tr., fourgonner, remuer la braise, chercher sans ordre, retourner, comme avec une fourche en mettant tout sans dessus dessous. - (14) |
| feurgonné : 1 v. t. Attiser le feu. - 2 v. t. Chercher en remuant beaucoup de choses, fouiller, mettre en désordre. - (53) |
| feurgonnée, s. f. une petite quantité de pommes de terre cuites sous la cendre, ce que le « feurgon » peut en préparer devant le feu. - (08) |
| feurgonner (v.t.) : fouiller dans un trou avec un instrument pointu - (50) |
| feûrgonner : attiser, remuer, déplacer, rechercher, s’agiter - (37) |
| feurgonner : remuer avec un bâton, un feurgon - (34) |
| feurgonner : Remuer la braise dans le four avec le feurgan. - (19) |
| feurgonner : remuer le feu pour l'activer, s'agiter, fouiller - (48) |
| feurgonner v. Activer, remuer avec un bâton. - (63) |
| feurgonner, feurgouner. v. a . Râger, remuer le feu, tisonner avec le fourgon. - (10) |
| feurgonner, v. a. fourgonner, fouiller dans un trou, dans la terre, dans le sable, etc. avec un instrument plus ou moins pointu. - (08) |
| feurgonner, verbe intransitif : fouiller, fureter avec une notion de désordre. - (54) |
| feurgonner. Fourgonner. - (49) |
| feurgoûmé : v. t. Remuer avec un objet, avec le feurgon. - (53) |
| feurgoûmer : remuer avec un objet. Avec le feurgon, on ferugoûne le feu pou le faire clairer : on remue le feu pour le faire clairer. - (33) |
| feurgouner (verbe) : remuer l'âtre pour activer le feu. - (47) |
| feurgouner : farfouiller (feurtasser, feugner) - (60) |
| feurgouner : remuer, fouiller avec bruit - (39) |
| feurguenai (écrivez fôrgônai), remuer, attiser. Dans l'idiome breton, fourgas signifie agitation, remuement. (Le Gon.) - (02) |
| feurguiller : frapper à petits coups. (E. T IV) - VdS - (25) |
| feurguin, s. m. petit chanvre qui n'a pas pris de croissance et qui est sans valeur. Il reste toujours du « feurguin » dans les chenevières. (Voir : feurtin.) - (08) |
| feurguinche, débauche passagère ou intermittente. - (27) |
| feurguiner, v. a. tirer, arracher le « feurguin » ou petit chanvre. - (08) |
| feurian, ande, adj. friand, gourmand. - (08) |
| feurkèchi v. Fricasser, rissoler. - (63) |
| feurkèchie n.f. Fricassée de viande ou de légumes. - (63) |
| feurlapié : d'humeur excentrique. - (33) |
| feurlasse : (fœrlas' - subst. f.) déchirure profonde et large. Par extension, sexe féminin. - (45) |
| feurleuche : Filoche. « Eune pliei-ne feurleuche de poissans ». - (19) |
| feurlon, s. m. frelon par métathèse. - (08) |
| feurlore : Perdu. Employé seulement dans ce dicton : « Si i plio pa la Saint-Geôrges les cheriges sant feurlores » : s'il pleut pour la Saint-Georges, les cerises sont perdues. - (19) |
| feurlot ou ferlot : gourmand (goulape) - (60) |
| feurloux, adj., pourri en son milieu, en parlant de fruits ; sens plus fort que « beurnoux ». - (40) |
| feurluquet : freluquet - (39) |
| feurmailles n.f.pl. Dragées de fiançailles. Les fiancés allaient de porte en porte, la future offrait des dragées, le futur une prise de tabac. Quand le fiancé n'était pas de première jeunesse on lui disait : "des feurmailles d'un vieux gârs, qui qu't'en voux fare ? Is sant totes crûjes !" - (63) |
| feurmaize (n.m.) : fromage - (50) |
| feûrmaize d’bigue : fromage de chèvre - (37) |
| feurman, feurment (n.m.) : froment - (50) |
| feurme : (nf) ferme - (35) |
| feurme n.f. Ferme. - (63) |
| feurmi : (nm) fermier - (35) |
| feurmi : fourmi. - (62) |
| feurmi : voir froumi - (23) |
| feurmî, feurmîre n. Fermier, fermière. - (63) |
| feûrmill’rie, d’ran d’voyue : trop petit, sans valeur - (37) |
| feurmillée. s . f. Fourmilière. (Etais). - (10) |
| feurmin. s. m. Fourmi. (Argenteuil). - (10) |
| feurmingn', s. m. fourmi. (Voir : frémi.) - (08) |
| feùrnàcher, v, tr,, farfouiller, fureter, sans trop savoir, ce que l'on veut. On dit aux enfants qui vont et viennent en cherchant : « Que qu'te feùrnàches donc par iqui ? » - (14) |
| feurnaillé : v. t. Chercher sans trouver. - (53) |
| feurnailli, v. Fourrager, chercher en mettant du désordre. - (63) |
| feurnaler, v., abonder, avoir une production largement excédentaire. - (40) |
| feurnater Chercher, fouiller, fureter. « Padant que je sus parti aile feurnate partot » : pendant que je suis parti, elle fouille partout. - (19) |
| feurni : Fournir. « O fâ fare san pain au bolangi mâ o feurni la fareune », il fait faire son pain chez le boulanger, mais il fournit la farine. - (19) |
| feurniteure, s. f. fourniture. - (08) |
| feurnitre, v. a. fournir. - (08) |
| feurnoïau (en), loc. en tas, en monceau. - (08) |
| feurnoiller, v. imp., s'emploie pour désigner la température chaude, humide et nébuleuse, particulière à certaines journées d'août et favorable à la maturité du raisin. Ex. : le temps feutnoille. - (11) |
| feurnouéiller : se mettre en tas (moutons) - (48) |
| feurnouéiller : (fœrnouèyé - v. intr.) 1- en parlant des moutons, se rassembler en tas pendant la chaleur. 2- en parlant du temps : le temps foernouèy' : "les nuages moutonnent" (signe d'un mauvais temps imminent). - (45) |
| feurnoyau (en) (loc.) : en tas ; se dit d'un lot de moutons qui pendant la chaleur se mettent en groupe - aussi feurnouéy(i )au, feurnoueillo, feurnoïau - (50) |
| feuron : petite fenêtre ou trou dans un mur servant au rangement. A - B - (41) |
| feuron : petite fenêtre, trou dans un mur pour ranger de petits objets - (34) |
| feuron : petite niche dans un mur ou petite fenêtre dans un bâtiment - (51) |
| feuron : portillon aménagé entre l'étable et la grange pour faire passer le foin dans le râtelier - (43) |
| feûron du diabye n.m. Télévision. (C'est bien la preuve que le patois n'est pas encore mort !). - (63) |
| feûron n.m. (anc.fr. feurre, la paille, le fourrage). Lucarne pour donner le foin. Voir guitsot. - (63) |
| feuron, trappon : petite fenêtre dans le grenier - (43) |
| feuronghi', s. m. furoncle, clou, tumeur en général. - (08) |
| feurquéchi : fricasser, rissoler. A - B - (41) |
| feurquêchi : fricasser, rissoler la viande, les légumes - (34) |
| feûrron, feurnotte : (nm.f) ouverture dans un mur d’écurie ; trou dans la paroi interne d’une cheminée - (35) |
| feursi (pour feurdi, ferdi, par substitution de l’s au d). adj. Refroidi, transi. (Gourgis). De ferdir, frédir, et du roman fredzir, dérivant tous trois du latin frigidus. - (10) |
| feursilleux. adj . Sensible au froid, frileux. (Gourgis). C’est un diminutif de feursi. - (10) |
| feurson, s. m. frisson, par métathèse. Avoir les « feursons » = avoir la fièvre. (Voir : fiéves.) - (08) |
| feurson. s. m. Frisson. (Domecy-sur-le-Vault). - (10) |
| feursonner, v. n. frissonner, avoir le frisson. - (08) |
| feursouner. v. n . Frissonner. (Ibid.). - (10) |
| feursure : fressure, foie du porc (ou du sanglier) ainsi que rate, reins, poumons, cœur. - (33) |
| feurtace : herbe haute - (44) |
| feurtache : n. f. Friche. - (53) |
| feurtache, subst. féminin : friche, terrain en broussailles. - (54) |
| feûrtaic’e : herbes folles - (37) |
| feurtâier, v. tr., chercher en déplaçant les objets à la main. - (40) |
| feurtaige, s. m. furetage, action d'abattre périodiquement, tous les huit ou dix ans par exemple, les brins les plus âgés d'un taillis pour les réduire en bois de moule. - (08) |
| feurtaille n.f. Restant des fagots d'feuillie. - (63) |
| feurtailli : frétiller, se démener - (51) |
| feurtaisses (n.f.) : friches, broussailles (aussi feurtasses) - (50) |
| feurtasi : s'occuper avec énergie dans un endroit - (51) |
| feurtasse (norn féminin) : roncier, végétation sauvage. - (47) |
| feurtasse : friche - (52) |
| feurtassée (nom féminin) : correction. - (47) |
| feurtasser (verbe) : chercher en fouillant avec application. Corriger. - (47) |
| feurtasser : chercher, fouiller, remuer (feurgouner, feugner) - (60) |
| feurtasses : friches, broussailles - (39) |
| feurtasses, fortasses : broussailles - (48) |
| feurtasson : touche-à-tout (soux) - (60) |
| feurte : (nf) chiffon mouillé servant à nettoyer le four à pain - (35) |
| feurte : petit trou situé dans un mur, (souvent placé à la tête du lit), pour ranger des petits objets - (43) |
| feurte n.f. (de frotter) Chiffon mouillé fixé au bout d'un long bâton pour nettoyer le four à pain avant d'enfourner ; ce chiffon était souvent confectionné avec des vieux sacs ayant contenu du charbon de bois. - (63) |
| feurté : v. i. Fouiner. - (53) |
| feurtèches n.f.pl. (du lat. pop. fraxicare, rompre). 1. Buissons, éteules. Voir frateux. 2. Environs immédiats. - (63) |
| feurtéchi : changer un assolement. A - B - (41) |
| feurtêchi : changer un assolement en mettant deux céréales de suite - (34) |
| feurtée n.f. (de frottée). Correction. - (63) |
| feurtéiller (v.t.) : fureter - (50) |
| feurteiller, v. n. frétiller, aller et venir avec agitation. - (08) |
| feurteillon, s. m. frétillon. se dit d'une personne qui est toujours en mouvement dans une agitation vaine ou puérile. - (08) |
| feurteillou, ouse, adj. celui qui frétille, qui s'occupe de minuties en s'agitant beaucoup. - (08) |
| feurter - veurder : aller vite - (57) |
| feurter : se dépêcher. A - B - (41) |
| feurter (v.t.) : déformation de fureter, chercher pour découvrir - (50) |
| feurter : corriger, fesser - (60) |
| feurter : Frotter. « Ol est bin mâgre, i faudrait le feurter ave eune couanne de la pâ pa l'engraichi ». - Frôler. « La roe m'a feurté ». - (19) |
| feurter : fureter - (43) |
| feurter : se dépêcher - (34) |
| feurter : se dépêcher - (44) |
| feurter v. (de frotter) Se dépêcher. - (63) |
| feûrter, feûrtaiç’er : chercher à découvrir « en douce » - (37) |
| feurter, v. a. se dit d'un bois qu'on coupe dans le système du « feurtaige » : il y a longtemps que ce bois n'a été « feurté », c’est à dire abattu par le furetage. - (08) |
| feurter. v. a. Frotter le chanvre, le convertir en filasse. - (10) |
| feurtier : broussailles - (60) |
| feurtillan : Sévère réprimande. « Dire à quéqu 'in san feurtillan », lui dire son fait. - (19) |
| feùrtiller, v. intr., frétiller, s'agiter vivement. - (14) |
| feurtilli : Frétiller. « O feurtille c'ment un poissan dans l'iau ». - (19) |
| feurtin, s. m. fretin. S’emploie en parlant de tous les objets sans valeur ou de rebut, mais principalement du menu poisson. - (08) |
| feurtingau : bon repas - (34) |
| feurtingo : bon repas. A - B - (41) |
| feurtintaille (nom féminin) : petites choses sans grande valeur. Récolte mal venue. (C t'année mes patates c’est que d'la feurtintaille). - (47) |
| feurtoche : n. m. Fourré. - (53) |
| feurtoches : broussailles. (C. T III) - B - (25) |
| feurtoches, s. f. pl., grandes herbes, broussailles. - (40) |
| feurtôle : Croûton de pain frotté d'ail ?. « Eune sope à la feurtôle ». - (19) |
| feurtôler v. (du v.fr. fresteler, faire du bruit et remuer) 1. Se dépêcher, se hâter, s'activer bruyamment. 2. Frire, fricasser en remuant la poêle. 3. Battre, fouetter. 4. Mettre beaucoup d'engrais, pour "fouetter" la croissance. - (63) |
| feurtou (en), loc. être en « feurtou », c'est poursuivre, rechercher quelque chose avec agitation, inquiétude. - (08) |
| feurtou (éte en) : fœrtou (é:t' en) (être en) colère. - (45) |
| feurtou : fureur, colère - (48) |
| feurzin : multitude de petits êtres, plantes, etc... (CLB. T II) - C - (25) |
| feûrzin, breût : bruit - (37) |
| feurzôle, s.f. frisson (?), débris. - (38) |
| feurzotte, s.f. brindille de bois. - (38) |
| feusce, s. m. fuseau de fileuse. - (22) |
| feûse : (nf) fuseau - (35) |
| feusè : v. i. Fuser, jaillir comme une fusée. - (53) |
| feûsée (aine) : (une) fusée - (37) |
| feusée : Fusée, la quantité de fil dont on charge le fuseau. « Le premé fi n’est pas feusée » ce proverbe exprime la même idée que la sentence : « Paris n'a pas été fait en un jour ». - (19) |
| feusée : épis de maïs - (39) |
| feusée, s. f. fuseau garni de fil. - (22) |
| feusée, s. f. fuseau garni de fil. - (24) |
| feusée. Fusée. - (49) |
| feuser : filer, aller vite - (48) |
| feuser, v. n. courir avec rapidité. - (24) |
| feûsi : (vb) filer ; aller à toute allure - (35) |
| feûsi : fusil - (43) |
| feusi : Fusil. « Un vieux feusi à pistan » un vieux fusil à baguette. - (19) |
| feusi, s.m. fusil. - (38) |
| feuso. Fuseau. - (49) |
| feusot (n.m.) : fuseau - (50) |
| feusot : Fuseau. « Les vieilles felaient au feusot à la pointe, les pas si veilles au feusot à la c'euche, les jeunes ne felant plieu du tot. ». Le fuseau à pointe était très pointu et plus long que le fuseau à la c'euche. - (19) |
| feus'rer, v. biner la vigne pour la première fois. - (38) |
| feus'rot : 1 n. m. Fouineur - 2 n. m. Morceau de bois servant à remuer le feu. - (53) |
| feus'rou, s.m. homme qui bine. - (38) |
| feûsse : Fosse. « Ol est bin vieux, bin usé, ol a in pid dans la feûsse ». - (19) |
| feusse. Fusse, fusses, fut. - (01) |
| feussein. Fussions, fussiez, fussent. - (01) |
| feûsseint, 3e pers. pl., imp. subj., fussent : « Les p'tiots ont piâlé ; y érôt follu qu’ô feûsseint d'avou toué. » - (14) |
| feusseu, s. m. craintif, honteux, timide. - (08) |
| feussou, s. m., outil courbe et à long manche pour gâcher le mortier. - (11) |
| feûstaiç’er : gronder, réprimander - (37) |
| feut, feurent, fut, furent. - (04) |
| feûte : Fût, futaille. « In goût de feûte » : mauvais goût communiqué au vin par une mauvaise futaille. - (19) |
| feute*, s. f. futaille. - (22) |
| feuté, v. a. choquer la vue, heurter le goût. - (22) |
| feuteûr (son) : (son) fiancé - (37) |
| feûtre, lisière épaisse du drap dont on fait des bretelles et des chaussures appelées des feûtre. - (16) |
| feûtrouîlle, foutrouîlle : mélange, désordre - (37) |
| feûve, s. f., fève, celle qu'on mange, et celle qu'on met dans la tabatière. - (14) |
| feuvérier. Février. - (49) |
| feuveurier : février. Feuveurier inquiète : le mois de février inquiète. - (33) |
| feuvré - février. - Quand en â en Feuvré, c'a bein, en vai du bon cotai ; le sulo monte ; en le voit montai. - Lai plieue de Feuvré vaut du femé. - (18) |
| feuvré : février - (48) |
| feuvré, fevré : n. m. Février. - (53) |
| feûvré, février. - (16) |
| feuvré, s. m. février, le second mois de l'année. - (08) |
| feuvrer - (39) |
| feuvrer (n.m.) : février - (50) |
| feuvreuil : février - (46) |
| feûvri : (nm) février - (35) |
| feûvrî n.m. Février. - (63) |
| feuvrö, sm. février. - (17) |
| feux d’bordes : feux de « râpes », de haies - (37) |
| feûyau (n.m.) : fuseau (aussi foujeau) - (50) |
| feuye : fraie de poissons. - (30) |
| feûye, s. f., feuille d'arbre, de livre. - (14) |
| feûyôte, s. f., feuillette, mesure de liquide, de la contenance de 100 à 140 litres ; environ 1/2 du tonneau. - (14) |
| feûze : fuseau - (43) |
| feuzer, aller vite. - (27) |
| feûziquer, fuziquer : (vb) fouiller ; fouiner - (35) |
| féve (na) : fève - (57) |
| féve n.f. Fève. - (63) |
| feveurier. s. m. Février. (Ménades). - (10) |
| féviaule (n.f.) : haricot (aussi faiviôle) - (50) |
| féviole. C'est le nom patois du haricot. Du latin phaseolus, petite fève. - (13) |
| févràyé*, v. n. bafouiller, comme dans la fièvre. - (22) |
| févri : février - (51) |
| féyi, faillir ; el é féyi m'ri, il a failli mourir. - (16) |
| feyiàtre, s. m. ou f. gendre ou bru (du vieux français filliâtre). - (24) |
| feyiôtre, s. m. ou f. gendre ou bru. - (22) |
| féyu, du verbe falloir : el é féyu, il a fallu. - (16) |
| fezan. Faisant, qu'on prononce fesant comme pesant.. - (01) |
| fezat : fuseau. - (21) |
| fezein. Faisions, faisiez, faisaient, qu'on prononce fesions, etc. - (01) |
| fezeu. Faiseur, faiseurs, qu'on prononce feseur, etc. - (01) |
| fezo. Faisais, faisait, qu'on prononce fesais, etc. - (01) |
| fezon. Faisons, qu'on prononce fesons. - (01) |
| fFiati, flétri. - (26) |
| fi : collet à gibier. A - B - (41) |
| fî (du) : (du) fil à coudre - (37) |
| fî (l’) : (le) fil de la lame bien aiguisée - (37) |
| fi (mai), loc. ma foi. Quelquefois « ma fine. » - (08) |
| fí (n.m.) : fil ; aussi collet - (50) |
| fi (on) : fil - (57) |
| fi (on) : verrue - (57) |
| fi : (nf) foi : « Ma fi ! » - (35) |
| fi : collet pour attraper le gibier - (34) |
| fi : Fil « Eune échevette de fi », un écheveau de fil. - (19) |
| fi : fil - (48) |
| fi d'archaû (on) : fil de fer - (57) |
| fî des reins n.m. Colonne vertébrale. - (63) |
| fi d'ia Vierge, sorte de fil soyeux, produit, vers l'automne, par une petite araignée noire. - (16) |
| fî n.m. Fil. Du fî d'fâr. Du fil de fer. Frein de la langue. Alle a l'fî bié copé ! Elle s'exprime avec facilité, elle parle beaucoup. - (63) |
| fi : (fi - subst. m.) fil. Du fi d' fèr "du fil de fer" - (45) |
| fi : fil - (39) |
| fi : s. m. fil. - (21) |
| fi, fil. - (16) |
| fi, foi, ma fi, ma foi. - (04) |
| fi, ma fi, ma foi, par ma foi. : On dit aussi mai fiane. - Il y a peu d'exemples d'une proposition plus implicite, car c'est une abréviation de tous ces mots latins : Per meam fidem juro ou polliceor. - (06) |
| fi, ma fi. Foi, ma foi ! Diminutif local de ce diminutif de juron. - (12) |
| fi, s. f., foi : « Eh ! par ma fi ! y é prométu. » - (14) |
| fi, s. m. fie, porreau, verrue, tumeur par assimilation de la partie enflée avec une figue. - (08) |
| fi, s. m. fil : « peurné eune aigullhe é deu fi», prenez une aiguille et du fil. - (08) |
| fî, s. m., fil : « Passe-me eùne couterie d'fî. » - (14) |
| fi, s. m., fil. - (40) |
| fi, s.f. foi ; ma fi, ma foi : aujourd'hui, on dit ma foué. - (38) |
| fi, s.m. fil. - (38) |
| fi, sf. foi, dans l'expression mai fi, ma foi. - (17) |
| fi. Fis, fit, et fils : Dei le Fi, Dieu le Fils. - (01) |
| fi. n. m. - Excroissance de la peau, grain de beauté, verrue, etc. Ce mot est emprunté au nom « fic », utilisé dans le langage vétérinaire pour désigner une verrue chez les bovins ou les chevaux. - (42) |
| fi. Verrue, du latin ficus. - (03) |
| fiâ : fléau. - (32) |
| fia : fléau. On batto mes céréales au fia : on battait les céréales au fléau. - (33) |
| fia, fié (ā, ĕ), sm. fléau. - (17) |
| fia, fléau pour battre les céréales. - (27) |
| fia, fiant, fiaint - divers temps du verbe faire. - Es aute fouai i fià cequi…., en feillo voué ; ma ai c't-heure vo le faisez mieux que mouai. - En fiant quemant cequi tenez regairdez, en vai pu vite. – Voyez Fairo, Fiot, etc. - (18) |
| fia. n. m. - Repère constitué d'une branche garnie de feuilles, et planté au milieu d'un champ afin de prévenir les bergers de ne pas y pénétrer. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| fiabamoux. s. m. Flagorneur. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| fiâbe : faisable - (48) |
| fiâchi, v. n. fléchir, céder, faiblir. (Voir : flâche.) - (08) |
| fiacon, sm. flacon. - (17) |
| fiacre (eune) : un fouet. (MM. T IV) - A - (25) |
| fiade ou fiarde, toupie que les enfants lancent avec une ficelle. - (02) |
| fiade ou fiarde. : Toupie marchant par l'impulsion d'une ficelle (Del.). Aux Fourgs, en Franche-Comté, on dit fiadot (Tiss.). - (06) |
| fiafia, faire du fiafia, faire du luxe tapageur. - (16) |
| fiaíme (n.f.) : flamme - (50) |
| fiaime, s. f. flamme. - (08) |
| fiaímeuse (n.f.) : galette de sarrasin cuite au four sur une feuille de chou - (50) |
| fiaippi (ât’e) : (être) très fatigué - (37) |
| fiairde : espèce de prune (très peu usité) - (37) |
| fiairde : toupie à fouet - (37) |
| fiairder, fieûser : se déplacer très vite - (37) |
| fiais, fiat, fiau, fléïaux. s . m . Fléau à battre le grain. Du latin flagellum. - (10) |
| fiait parfois les habitants des Maillys. - (46) |
| fiaité, vt. flatter. - (17) |
| fiaitou, sm. flatteur. - (17) |
| fiaitté (adj.) : flatté - (50) |
| fialé, vt. battre au fléau. - (17) |
| fialou, sm. batteur au fléau. - (17) |
| fiambai : flamber. Le feu fiambe. - (33) |
| fiambè : v. i. Flamber. - (53) |
| fiamber (v.t.) : flamber - (50) |
| fiamber : flamber - (48) |
| fiamber : flamber. - (52) |
| fiamber, v. n. flamber, jeter de la flamme. - (08) |
| fiameusse : crêpe faite avec de la farine de sarrasin. - (33) |
| fiamme : flamme - (48) |
| fi'amtai : brûler par un retour de flamme. O c'o fait fi'amtai les ch'veux : il s'est fait brûler les cheveux par un retour de flammes. - (33) |
| fian (ā), sm. 1) flan. 2) flanc. - (17) |
| fian : flan - fian d'cotch, flan à la courge - (46) |
| fian : tarte à la semoule - (48) |
| fian, fiante, adj. confiante, celui ou celle qui a de la confiance, et le plus souvent, trop de confiance : « al ô bin fian », dit un peu plus qu'il a beaucoup de confiance. - (08) |
| fianbé, vn. flamber. - (17) |
| fianc. s. m. Flanc. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| fiançailles : s. f. plur, dragées de fiançailles. A Mâcon, un magasin de confiserie à pris pour enseigne : Aux Fiançailles. Voir fermailles. - (20) |
| fiance - sûreté, assurance. - An é point de fiance aivou ces gens lai. - Cequi paraît solide, ce n'â portant pà ine fiance ; faisez encore aitention. - (18) |
| fiance, confiance (surtout dans l'expression, pas de fiance, par exemple, avec ce chien, il est dangereux de se fier à lui). - (27) |
| fiance, confiance ; i n'ai pâ d'fiance an lu, je ne me fie pas à lui. - (16) |
| fiance, confiance. - (04) |
| fiance, s. f. confiance : n'avoir pas fiance en quelqu'un. - (22) |
| fiance, s. f. confiance : n'avoir pas fiance en quelqu'un. - (24) |
| fiance, s. f. confiance, assurance, sîireté. - (08) |
| fiance, s. f., confiance, foi en quelqu'un. - (14) |
| fiance. Confiance, vieux mot. - (03) |
| fianceilles : Fiançailles, jour où l'on se fiance, où les parents du jeune homme viennent demander la jeune fille en mariage Dragées que les fiancés distribuent pendant la période des fiançailles. « I vaut se mérier, an dit qu’y est tot fait. - Je cras bin, i portant des fianceilles », ils vont se marier, on dit que c'est fait. - Je crois bien, ils distribuent des dragées. On appelait aussi « fianceilles », les prises de tabac que le fiancé offrait à la place des dragées. - (19) |
| fiancer : v. a., tromper, abuser de la confiance de quelqu'un. « T m'as fiancé ! Tiens, on peut pas plus s’ fier-a toi qu'à une planche pourrie...» - (20) |
| fianci : Fiancé, féminin fiancie. « As tu vu les fiancis? Je les ai vus passer tot les trois, le fianci, la fiancie a peu la danzale ( la fille d'honneur) ». - (19) |
| fianqué, vt. flanquer. - (17) |
| fiaque, sf. flaque. - (17) |
| fiaque. s. m. Fouet. (Ibid.). - (10) |
| fiaquer. v. a. et n. Fouetter. (Ibid). - (10) |
| fiar : fier - (52) |
| fiar, adj. fier, orgueilleux. - (08) |
| fiàr, adj., fier, arrogant, dédaigneux. - (14) |
| fiar, sm. flair. - (17) |
| fiar. adj. Fier. (Domecy-sur-Ie-Vault). - (10) |
| fiàrde (C.-d., Chal., Morv.), fiàde (C.-d.), flàdôt (Br.) - Petite toupie de buis à pointe de fer. La Monnoye dit qu'on l'appelle ainsi parce qu'on l'entoure d'une ficelle pour la lancer, mais ce n'est pas la véritable étymologie. L'origine de ce mot serait, d'après Bigame, dans l'ancienne appellation de cette toupie, dénommée autrefois fuyarde ou courante, par opposition à la grosse toupie ronflante ou dormante Dans le Verdunois, dit Fertiault, on prononce fuarde, ce qui viendrait à l'appui de cette assertion. - (15) |
| fiarde (n.f.) : toupie - (50) |
| fiarde (na) : fronde - (57) |
| fiarde : Toupie, jouet en forme de poire terminé par une pointe en fer, on lui imprime un mouvement de rotation au moyen d'une cordelette enroulée autour et qui se déroule brusquement quand on lance la fiarde. « Eune fiarde en bouis ». - (19) |
| fiarde n.f. 1. Toupie. 2. Culot. - (63) |
| fiarde : s. f., toupie en forme de cône renversé, armée d'une pointe de fer au sommet du cône et, à sa base, d'un coqueluchon de bois. Voir frise. - (20) |
| fiarde : toupie. - (32) |
| fiardè : v. i. Faire vite. - (53) |
| fiàrde, et fuarde, s. f., petite toupie massive en bois, conique, terminée par un fer, autour de laquelle ou enroule une ficelle, et qu'on fait tourner en la lançant adroitement à terre. Triomphe de nos gamins. - (14) |
| fiarde, n.f. toupie. - (65) |
| fiarde, petite toupie ; on dit que la fiarde barde ou dort quand elle parait immobile, par suite de ses mouvements rapides sur elle-même ; en cet état, la fiarde est une petite image de l'apparente immobilité de la terre. - (16) |
| fiarde, pirondelle. Toupie. - (49) |
| fiarde, s. f. toupie. - (08) |
| fiarde, s. f. toupie. - (22) |
| fiarde, s. f. toupie. - (24) |
| fiârde, s. f., toupie lancée avec une ficelle. - (40) |
| fiarde, s.f. toupie. - (38) |
| fiarde, subst. féminin : toupie en forme de poire qu'on lance avec une ficelle. - (54) |
| fiarde. Toupie fort en usage dans le pays beaunois. Elle est armée à sa pointe d'un éperon de fer ou d'acier. Autrefois, on l'appelait toupie fuyarde, pour la différencier des toupies dormantes ou ronflantes. On devrait donc dire et écrire une fuyarde. - (13) |
| fiarde. Toupie, parce que, dit Lamonnaye, ou l'entoure d'un fil pour la jeter ; congénère bourguignon fiade. - (03) |
| fiarde. Toupie. Au figuré, jouet, personne dont on fait ce que l’on veut. Etym. onomatopée ; notre patois a le mot fiâler, pour indiquer que l’on agite un fouet ou que l’on frappe avec et qu'il siffle, mais sans le faire claquer. - (12) |
| fiarder (v.t.) : aller vite ; se hâter - (50) |
| fiarder : aller vite, en vélo par exemple. Le mot vient de fiarde : nom donné à la toupie qui va vite, en ronflant. - (62) |
| fiarder v. (de fuyarde, toupie). Filer à toute vitesse. - (63) |
| fiarder : tourbillonner. - (32) |
| fiârder, v., aller très vite (à vélo). - (40) |
| fiarder, verbe intransitif : aller vite, se dépêcher. Au sens figuré, c'est l'équivalent de barder en parlant d’une discussion animée, d'une dispute. - (54) |
| fiarder. Caler, reculer, faire le poltron. - (49) |
| fiaré, fiairé, vt. flairer. - (17) |
| fiargeolot : Flageolet, petit instrument de musique qui se rapproche de la flûte. « Ol a appris à juer du fiargeolet ». Sorte de haricot. - (19) |
| fiarjoulo, s. m., iris des jardins. - (40) |
| fiarjoulot, s.m. fleur d'iris, - (38) |
| fiartise, s. f. fierté. On dit encore « fiarantise » dans le même sens. - (08) |
| fiate, s. f. confiance, sûreté, assurance. La maison n'est pas solide ; il n'y a pas de « fiate. » - (08) |
| fiàte, s. f., confiance. A son synonyme plus haut. - (14) |
| fiatri : flétri. - (52) |
| fiatri : flétri. Les vieux freus sont fiatri : les vieux fruits sont flétris. - (33) |
| fiatri : adj. Flétri. - (53) |
| fiatri, vn. flétrir. - (17) |
| fiatte : confiance. - (09) |
| fiau : fléau, instrument manuel de battage des céréales - (37) |
| fiau, fiôt (n.m.) : fléau - (50) |
| fiau, flau, fléau, s. m. Fléau. Voyez fiais. - (10) |
| fiau, s. m. fils, enfant. S’emploie aussi comme terme d'amitié. - (08) |
| fiau. Fléau. Instrument pour battre le blé en grange. - (49) |
| fiaule, s. f. fiole, petite bouteille. - (08) |
| fiauner, fiouner, fionner. v. - Gémir, geindre ; se dit du chien qui marque son impatience à vouloir sortir. - (42) |
| fiauner. v. n. Crier, pleurnicher. (Champignelles). — Suivant Jaubert, voudrait dire aussi, fureter. - (10) |
| fiaûtre (na) - ball’fille (na) : bru - (57) |
| fic (le c ne se prononce pas). s. m. Maladie de peau, rogne, verrues, toute excroissance à la surface du corps. Ce mot est français et figure dans Larousse. - (10) |
| fic, fil, excroissance de chair. - (04) |
| fiçale, s. f., ficelle. - (40) |
| fiçale, s.f. ficelle. - (38) |
| ficelle adj. Rusé, malhonnête. - (63) |
| fichan : Morceau de bois pointu avec lequel on fait un trou dans le terrain pour y placer un plant. « Plianter de la vigne au fichan ». - (19) |
| fichant : Malheureux, regrettable. « Man vin a torné y est-i pas fichant ! ». - (19) |
| fichant, adj., dépitant, contrariant: « Ol a-t-i pas pardu son ch'vau. Vrâ, y é gvos fichant tout d'mein-me. » - (14) |
| fiche (pour ficher). v. a. Mettre, placer, fixer, faire, appliquer, jeter, flanquer, lancer. J’m’en vas t’fiche une claque. On l’a fichu en prison. Si tu me fiches des pierres, j’te fich’ en iau. Qué qui vient fiche par ici, c’t’espèce de mouchard-là ? — Se ficher. v. pron. Se moquer. Faudrait pourtant pas avoir l’ar de vous fiche de moi. - (10) |
| fiche : Longue charnière des portes des anciennes armoires. « In meub 'lle à grandes fiches » : une armoire à grandes fiches. - (19) |
| fiche : s. f., ligne de fond. - (20) |
| fiche, fichai (se) - diminutif de foutre ou fouté bien moins grossier, à peu près passable. - Voyez donc là. - (18) |
| fichecot. s. m. Piquet. (Massangy). - (10) |
| fichelle d’yieûse : ficelle de moissonneuse lieuse, pour lier les gerbes (à brins « bourrus » de couleur jaune foncé) - (37) |
| ficher, v. tr., donner, flanquer : « N'piaûl' pas, vou j'te fiche eùne claque. » - (14) |
| fichet, n.m. plantoir. - (65) |
| fichi : Donner. « Je li ai fichi eune caleute » : je lui ai donné un soufflet. – Faire. « Ou'est-ce que te fiche itié ? » qu'est-ce que tu fais là ? - Au participe passé: fichu, en mauvaise santé, sur le point de mourir. « Ol est fichu ». - (19) |
| fichole : cerce à égoutter le fromage blanc. - (33) |
| ficholoué : récipient recevant le petit lait. - (33) |
| fichon (nom masculin) : plantoir. - (47) |
| fichon : s. m. instrument dont on se sert pour planter la vigne. - (21) |
| fichot (n. m.) : plantoir - (64) |
| fichot : plantoir de jardin. - (62) |
| fichot : figé, immobile comme un pieu. Lo ficho : il est figé. - (33) |
| fichot, fitsot. Plantoir. - (49) |
| fichot. n. m. - Petit piquet ou plantoir du jardinier. (Sougères-En-Puisaye) - (42) |
| fichot. s. m. Plantoir de jardinier. (Montillot). - (10) |
| fichu - outre les sens du français, nous disons dans le sens de Gônay. – Quemant t'é airaingé !... ma qui dont t'é fichu quemant cequi ? - Voilai in haibit qu'en t'é fichu lai, pair exemple ! c'â pour fâre rire, bein sûr. - Tout cela dans le sens de foutu. - Voyez là. - (18) |
| fichu. On dit en Bourgogne : Comme le voilà fichu ! pour exprimer combien la personne dont on parle est mal vêtue. C'est de l'idiome breton tout pur ; car le verbe ficha, prétérit fiched (Le Gon.), signifie accommoder, apprêter, orner, parer... - (02) |
| fichu. : Bien ou mal fichu, c'est-à-dire bien ou mal mis (du latin fingere, supin fictum, qui signifie façonner, ajuster). - (06) |
| fié. Fié : Fié vos y, fiez-vous-y ; Ai ne s’y fau pa fié, il ne s'y faut pas fier. - (01) |
| fie. Foi. On dit : « ma fie ! » pour ma foi ! Le vieux français était « fie ». - (49) |
| fiéchi, vt. fléchir. - (17) |
| fien : crottin. - (09) |
| fien, s. m. fumier d'écurie ou d'étable. - (08) |
| fien. n. m. - Fumier. Mot directement emprunté à l'ancien français fient - fiens, issu du latin fimitus, et conservé presque intact depuis le XIIe siècle dans le dialecte poyaudin. - (42) |
| fience. s. f. Fiente. - (10) |
| fiencer. v. n. Fienter. - (10) |
| fiense, s. f. fiente. Il y a beaucoup de « fiences » d'oiseau sur la terre. - (08) |
| fient. s. m. Fumier. - (10) |
| fiér en cul : adj. et n. Orgueilleux. - (53) |
| fierabra. Fiérabras, nom d'un fameux géant qui, dans combat contre Olivier, pair de France, quelques mortelles blessures qu'il reçût, les guérissait en un moment par le moyen d’un merveilleux baume qu'il avait… - (01) |
| fiére : adj. Fière. - (53) |
| fierjolet, s. m., flageolet, instrument de musique. - (14) |
| fier-sale, s. m. faraud à prétentions d'élégance qui est volontiers sale sous sa toilette : c'est un fier-sale. - (24) |
| fieteu : flatteur. - (66) |
| fiette. s. f. Confiance. Il n’y a pas de fiette à avoir en c’t’homme-là. Du latin fidere, fides. - (10) |
| fieu : fils - (48) |
| fieù, s. m., fils : « Y et un ben jauti gas qu'ton fieù. » - (14) |
| fieuhi, v. n. fleurir, être en fleur. Le Morvandeau nivernais prononce « fieu, fieur, flieur » pour fleur. (Voir : flieur.) - (08) |
| Fieumeusse, gâteau au fromage. - (27) |
| fieur, sf. fleur. - (17) |
| fieure. s. f. Fleur. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| fieuröt, sm. drap grossier destiné à garnir l'intérieur d'une cuve à lessive, à couvrir qque chose. - (17) |
| fieuröte, sf. fleurette. - (17) |
| fieûsè : aller vite, foncer - (46) |
| fieûse ! (y) : (ça) avance très vite ! - (37) |
| fieûser : avancer très vite - (37) |
| fieûser ou feûser, verbe intransitif : filer à toute vitesse. Il signifie aussi se dépêcher, travailler vite. - (54) |
| fieuser, fieuzer : aller vite, circuler, se déplacer à grande vitesse. - (66) |
| fieussaint - temps du verbe faire. - I vourâ qu'à fieussaint d'ine autre manière ; eh bein â ne velant pas. - Voyez Fia et d'autres temps. Le verbe faire, au patois, est un des mots qui ont notablement souffert de la compagnie du Français, tous les exemples donnés dans ces deux artiticles se disent très souvent qu'â faiseussaint, i faisâ, ne laisaint, â faiso etc... - En vouro que te fieusse cequi aito. - (18) |
| fieusse - temps du verbe faire. - Voyez à fieussaint. - (18) |
| fieuter, vn. flûter, jouer d’un instrument à vent. Boire d'un trait. - (17) |
| fieûve, s. f., fièvre, agitation : « Dà ! ô v's a eùne chiéne de fieûve... ôl et à bas. » - (14) |
| fieuve. n. f. - Fièvre. - (42) |
| fieuve. s. m. Fleuve. (Ibid.). - (10) |
| fieux (n.m.) : faiseur - (50) |
| fiéves, s.f. fièvre. Ne s'emploie qu'au pluriel lorsqu'il s'agit de fièvres intermittentes : il a les « fiéves » ; « les fiéves » l'ont repris, l'ont quitté. - (08) |
| fièvroux : Fiévreux « Le malède va mieux mâ ol est encor in ptiet bout fièvroux ». - (19) |
| fi'fer : fil de fer - (61) |
| Fifine, Joséphine. - (16) |
| figai, s.m. figuier. - (38) |
| figaÿ, s. m., figuier. - (40) |
| fignoler : orner. - (09) |
| fignôler, v. a. faire avec soin, avec raffinement. - (08) |
| fignolet, adj. qui a de la recherche dans sa toilette, ses manières, qui les fignole. - (24) |
| fignôlet, s. m. petit-maitre de village. - (08) |
| fignôleu, s. m. petit-maître de bas étage, élégant à la suite de la mode. - (08) |
| fignoleux. s. m. Celui qui fignole, qui parle et qui fait tout prétentieusement. - (10) |
| fignoloû, s. m., celui qui fignole, qui prend des manières, élégant et aussi blagueur : « N'I'écoute donc pas ; y ét eùn ch'ti fignoloû. » - (14) |
| fignou : hargneux. (VSLD. T II) - S&L - (25) |
| fignoulet, adj. qui a de la recherche dans sa toilette, ses manières, qui les fignole. - (22) |
| figue n.f. Crotte, surtout quand elle est en rond. - (63) |
| figue : s. f., figue de chat, crotte de chat. - (20) |
| figué, s. m. figuier. - (08) |
| figué, s. m., figuier. - (14) |
| figurer de (Se) : voir de. - (20) |
| fil des reins. Colonne vertébrale, moelle épinière. - (49) |
| fil : s. m, filet, frein de la langue. Avoir le fil, avoir la parole facile et la réponse aisée. - (20) |
| fil : s. m., fil des reins, colonne vertébrale. En tombant i s'a cassé l’ fil des reins. - (20) |
| fil, s. m., filet de la langue : « Jarni ! on n'a pas oblié d’li còper l’fil ; ô jacass' prou. » — Pour du fil à coudre, on dit : du fi ; pour le filet de la langue, on dit bien : couper le fil. (V. Fi.) - (14) |
| filanche, filange. n. f. - Objets ou animaux regroupés en alignement : fruits, légumes, champignons, fourmis, etc. Une filanche d'oignons suspendus. - (42) |
| filange, filanche, firlanche. s. f. Chapelet, guirlande. Une filanche de boutons, d’ognons. Une filanche de fleurs, de fraises, de rouelles de carottes séchées au four. (Puysaie, Sommecaise, Villiers-Saint-Benoit). - (10) |
| filardiau (nom masculin) : grande scie. - (47) |
| filardiau, filariau, filareau. s. m. Scie de bûcheron. - (10) |
| filardiot : un petit fil. - (56) |
| filardjeau : scie de bûcheron - (39) |
| filariot, s. m. scie pour le bois de chauffage et autre. - (08) |
| filat. s. m. Filet. (Givry). - (10) |
| filaterie : s. f., fabrication et commerce du fil. - (20) |
| filau (nom masculin) : petite scie. - (47) |
| filau, s. m. petite scie à l'usage d'un seul homme. - (08) |
| filè (subst. m.) : dans une forêt, ligne qu'on trace perpendiculairement au chemin de coupe. Les filets sont espacés de 30 m les uns des autres, encadrant des légn' (lignes) où l'on détermine des cantons. Pour marquer des filets, on choisit quelques arbustes placés en enfilade, et on les écorce partiellement pour se repérer. - (45) |
| filë, ai lai filë, sans interruption, à la suite l'un de l'autre. - (16) |
| filer au bôs v. Se dit des arbres fruitiers qui font beaucoup de branches et peu de fruits. - (63) |
| filer : v. n., couler (en parlant des fruits qui ne nouent pas). Filer au bois, se dit des arbres dont les branches s'accroissent démesurément au détriment de la fructification. - (20) |
| filer, v. n. se dit du chat lorsqu'il émet le bruit sourd, le ronronnement qui lui est particulier. - (08) |
| filerie : s. f., vx fr., veillée (où, habituellement l'on file) ; lieu où l'on veille. - (20) |
| filéte, s. f., roue destinée au filage du chanvre. Généralement on préfère le filage au fuseau. - (14) |
| filfer : prononcer filferre, les r roulés. Fil de fer, y compris le barbelé. Ex : "Il a mis du filfer pour pas qu'on pâsse !" - (58) |
| filiére (na) : filière - (57) |
| fillacaca : Terme de mépris por désigner un petit garçon qui aime mieux s'amuser avec des filles ou avec des jeux de fille qu'avec les enfants de son sexe. - (19) |
| fillai. Fil, soit de lin, soit de chanvre. Filllai se prononce en mouillant les deux II. - (01) |
| fillas, s. m. feuillard ; branche d'arbre garnie de ses feuilles. (Voir : feuilleron.) - (08) |
| fillâte, s. f., fillette, chopine. - (40) |
| fillatre (fillâtre) : s. m. et f., vx fr., gendre, bru ; beau-fils, belle-fille. - (20) |
| fillatre. Beaufils, mot de la langue romane, de filiaster. - (03) |
| fillau (n.m.) : filleul - (50) |
| fille : Poupée, dans le sens de doigt malade entortillé dans un linge. - (19) |
| filler : v. n., vx fr, enfanter, accoucher. - (20) |
| filler, vt. filer. - (17) |
| fillère, n.f. grosse poutre horizontale. - (65) |
| fillette - demi-tonneau ou feuillette. - I ons aichetai ine fillette de vin ai Saivigné ; c'â aissez pour note fouachaillon et note moichon. - (18) |
| fillette (na) : feuillette - (57) |
| fillette : Feuillette. La fillette vaut la moitié d'une pièce et contient à Mancey, 108 litres. - (19) |
| fillette : fût de 114 litres - (48) |
| fillette : s. f. feuillette. - (21) |
| fillette, feuillette n.f. Tonnelet. - (63) |
| fillette, feuillette, demi-tonneau. - (05) |
| fillette, feuillette. - (26) |
| fillette, prénom qu'on donne souvent à l'une des filles puînées. (Voir : cadette.) - (08) |
| fillette, s. f. feuillette, vase de bois dans lequel on met du vin. - (08) |
| fillette, s. f. feuillette. - (24) |
| fillette. Feuillette. - (49) |
| filleu : filleul - (48) |
| filliâtre : Gendre. « Ol est allé demorer dave san filliâtre » : il est allé habiter avec son gendre. - (19) |
| filliâtre, gendre, bru. - (05) |
| fillô : Filleul, féminin fillôle. « Ol est allé à la noce à sa fillôle ». - (19) |
| fillô, s. m. filleul. - (08) |
| fillol, filleul, fillot. - (04) |
| fillole. Filleule ; de filiola. - (03) |
| fillot : filleul. - (33) |
| fillot. n. m. - Filleul. Diminutif.affectueux de filius (fils en latin), ce mot s'employait en ancien français. Au XVIe siècle, Rabelais utilisait fillot en termes d'amitié pour désigner un jeune homme. Le poyaudin a conservé la dimension affective de ce mot en l'appliquant aux relations filleul / parrain. - (42) |
| fillot. s. m. et fillole. s. f. Filleul, filleule. Du latin filius, filiolus. - (10) |
| fillôte. Petite fille ; dans un autre sens, fillôte est un demi- muid de vin. On dit vulgairement à Dijon fillette. Le bon usage est pour feuillette. - (01) |
| fillotte, s.f. feuillette (tonneau) - (38) |
| fillou (on) : filleul - (57) |
| fillou, filleul. - (05) |
| fillou, s. m. homme qui recherche les filles, qui se plait avec les femmes. (Voir : garçongniée.) - (08) |
| filloule (na) : filleule - (57) |
| fillouse : une pomme de terre dégénérée - (46) |
| filoche : filet en forme de poche. On dit aussi filochon. - (62) |
| filocher : v. a., employer le filochon pour cueillir un poisson. - (20) |
| filochon : s. m., épuisette pour la pêche à la ligne. - (20) |
| filot : fil. O éto mince coume un filot : il était mince comme un fil. - (33) |
| filot, s. m. filet ; on donne ce nom aux jets longs et flexibles de la vigne. - (08) |
| filot. s . m. Fil. (Accolay). - (10) |
| filoter. v. a. Filouter. (Domecy-sur-le-Vault). - (10) |
| filoux : s. m., fileur de chanvre, cordier. - (20) |
| fin (faire) v. Grossir, grandir, engraisser, profiter. - (63) |
| fin (faire) : loc,. se dit des personnes et des animaux dont le corps se développe et profite bien. - (20) |
| fin : Fin, clair, rusé, malin. « Ce vin n'est pas fin » : ce vin n'est pas clair, pas limpide. « Le temps est tot fin » le ciel est pur. On dit en plaisantant : « Le temps est fin c'ment in voleu », jouant ainsi sur le mot fin qui signifie clair mais aussi rusé. Pour blâmer quelqu'un dont on réprouve l'attitude ou la conduite, on dit : « Te m'en fa in fin ! ». - La partie extrême : « Ol a cheu au fin fond de la revire ». - Adverbe fin signifie : complètement, « Ol est fin saoul ». - (19) |
| fin : juin - (46) |
| fin adv. (du lat. finis, le terme) parfait, parfaitement, excellent, tout-à-fait. Ôl est fin prêt ! Il est tout-à-fait prêt. - (63) |
| fin de force (à), à la longue, à force de... - (27) |
| fin fon. Dan le fin fon, tout au fond… - (01) |
| fin premé, fin premier ; finte premëre,finte première,locution dont le premier terme exclut un égal. Un enfant est fier, lorsque, revenant de l'école, il peut dire à son père et à sa mère qu'il est le fin premier. - (16) |
| fin seul (tout), absolument seul. - (04) |
| fin : adj. Temps fin. temps clair résultant d'un ciel pur et d'un air léger. - (20) |
| fin, adj., dans l'expression « Y ôt fin » (C'est bon). - (40) |
| fin, élément utilisé devant les adjectifs comme marque de superlatif : la fin première « la toute première ». - (07) |
| fin, feu. - (26) |
| fin, finage étendu. - (16) |
| fin, fine, adj. s'ajoute au subst. pour lui donner une valeur superlative ou absolue : le fin dessus, le fin dessous, c’est à dire ce qu'il y a de plus haut, ce qu'il y a de plus bas ; « tô fin sou », absolument seul. - (08) |
| fin. Idiotisme. « Fin premier », tout le premier. - (03) |
| fin. : Po lat fin dou fignon fignelle. Nos pères s'amusaient à rendre de la sorte ces mots : Pour la fin définitive, ou, bref et pour en finir. - (06) |
| fin... - pour exprimer le plus. - Regairdez vote ouiyais, tenez, que s'a envôlai ; vo le viez jeusqu'â fin coqueluchot de l'âbre. - Ile n'â pâ bête, ile é choisi le fin pu gros bout. - Al éto le fin derré. - (18) |
| finage : autrefois, étendue d'une juridiction ou d'une paroisse. Se disait, dans certaines provinces, de l'étendue du territoire d'une commune. - (55) |
| finage et finaige. Dans l'origine, ce mot signifiait limite, confins, comme le latin fines, dont il dérive. On l’a ensuite appliqué au territoire d'une commune. La légende de Saint-Urbain appelle le village de Longvic, prés Dijon, finis longoviana. On a appliqué ce terme de finage à une petite étendue de terrain. Les Nuitons ont la fin blanche. C'est un lieu-dit qu'on pourrait nommer lieu maudit y car c'est là, en face des trous-léger, que la légende place le grand sabbat des sorciers et des fées. - (13) |
| finaige, s. m. finage, limite. - (08) |
| finaige. Finage, territoire, contrée. - (01) |
| finasse : Finesse, ruse. « Des finasses cousues de fi blian ». - (19) |
| finaud : malin - (44) |
| fincai : fienter. - (33) |
| fin-des-fins, loc., fin absolue : « J'li dirai tant, qu'à la fin-des-fins i faura ben qu'ô marche. » - (14) |
| fine sœur, loc. sœur germaine ou même demi-sœur par opposition avec belle-sœur. - (08) |
| finelle. Finale. - (01) |
| finerot, finêrot : adj., vx fr., limitrophe, séparatif. Voir chemin. - (20) |
| fing (n.f.) : fin - (50) |
| fingne. adj. Fin, habile ; délié, menu. Al ot bé fingne et bé ruhé, il est bien fin et bien rusé. (Avallonnais). - (10) |
| fingne. s. f. Fin. Le commencement et la feigne. - (10) |
| fini : finir - (48) |
| fini : Finir. « Finis dan ! te m'en-nue » : finis donc, tu m'ennuies. - (19) |
| fini v. Finir. S'emploie aussi au passif avec l'auxiliaire être. L'butin est pas fini d'seutsi. Le linge n'a pas fini de sécher. - (63) |
| fini : finir - (39) |
| finiolai - chercher à raffiner, à faire mieux que les autres. - Si te viâs l'ôvraige de lai Berthe ! Ah ! c'â du finiolai, cequi ! – Mouai, i ne finiôle pâ ; i fâ du solide, c'â tot. - (18) |
| finir : v. a., s'emploie incorrectement au passif. « Le linge n'est pas fini de sécher. » - (20) |
| finissement, s. m. la fin, le bout, l'extrémité, la limite. Le « finissement» d'un bois, d'un champ. - (08) |
| finission, la fin d'une chose, d'un travail. - (16) |
| finition - fin, action de finir. - Vos ne saivez pâ ? Eh bien c'â l'hopital que seré sai finition, â train qu'al i vai. - Pou lai finition de lai chose i vos dirai que â m'é enfin payé jeusqu'â derré so. - En finition de tot. - (18) |
| finition, s. f. fin, terme, conclusion. - (08) |
| finition, s. f., fin, achèvement, conclusion. - (14) |
| fin-ye, feuille. - (26) |
| fio : cendres. (MLB. T II) - S&L - (25) |
| fioeuge s. f. fougère. - (22) |
| fiôlai. : (Dial. et pat.), boire à petits coups (du latin phiala, petite bouteille). - (06) |
| fiôlan, fanfaron, présomptueux, et plutôt bravache... - (02) |
| fiôlan, s. m., fendant, beau, blagueur, poseur, fanfaron, et aussi buveur. - (14) |
| fiôlan. Fanferon, présomptueux… - (01) |
| fiole, n.f. bouteille, biberon. - (65) |
| fiôle, s. f., fiole, petit flacon. - (14) |
| fiole. s. f. Feuille ou, plutôt, tige feuillue des céréales. (Merr y-la- Vallée). Du latin folium. - (10) |
| fioler (se), v. se saouler. - (65) |
| fiôler : Boire avec excès. « T'as fiôlé » : tu as trop bu. - (19) |
| fiôler, v. tr., boire, boire à petits coups, boire sans soif : « O n'é content que quand ô fiôle. C'buvochoû là, ôl a tant fiolé, qu'ôl en a dégobillé. » - (14) |
| fioler. Boire ; de fiole, comme pinter de pinte. - (03) |
| fioler. v. a. Couper les feuilles du blé, lorsqu’il est encore en herbe et qu’il pousse trop vite. (Perrigny). Du latin foliare. - (10) |
| fion : (nm) sarcasme - (35) |
| fion : essaim - (60) |
| fion : remarque désagréable - (43) |
| fion : voir j'ton - (23) |
| fion, n.m. remarque désagréable (il ne fait qu'envoyer des fions). - (65) |
| fion. n. m. - Finition : donner un coup de fion. - (42) |
| fion. s. m. Dernière façon, poli que l’on donne à un ouvrage. Donner le coup de fion. - (10) |
| fion. s. m. Scion, rejeton, petite branche sortant du tronc, du pied d’un arbre. (Festigny, Ménades). — Se dit sans doute pour fiot, pour fieu, de fins, fitius. - (10) |
| fionner : essaimer - (60) |
| fionner : voir jeter - (23) |
| fîons (dâs) : (des) allusions sournoises, blessantes - (37) |
| fions, fumier, tire-fiens, instrument. - (04) |
| fioque, floque. s . f. Nœud de rubans. (Pasilly). Du latin flosculus. - (10) |
| fiot – 3e personne de l'imparfait du verbe faire. - Quand à velo, oh ! à fiot ai lai perfection. - Aivant d'éte mairie à fiot encore aissez souvent des sottises. - On a souvent employé Fiot et Fait dans le sens de Dire, en répétant avec une sorte de manie, lorsqu'on rapporte les paroles d'une autre personne. - En vos fauré laiborai bein bas, qu'à fiot ; et pis aipré cequi, qu'à fiot vos casseras les mottes, vos pourez éte sûr, qu'a fiot, que vos airas fait in bon ovraige, qu'a fiot,… - (18) |
| fiotte : flotte, pluie - (48) |
| fiou : faiseur d’ennuis. « Un fiou d’embarras » - (62) |
| fiou : filleul (e) - (43) |
| fiou de pauvres, faiseur de pauvres. - (05) |
| fioû d'goutte : distillateur, brandevinier - (48) |
| fiou, fiouse, s. m. et f. faiseur, celui qui fait, qui construit, qui fabrique : « eun fiou d'balais, eun fiou d'maions, eun fiou d'saibôs », un faiseur de balais, de maisons, de sabots. - (08) |
| fiou, fiouze : (nm.f) filleul (e) - (35) |
| fiou, s. m. filleul. Fioule, filleule. - (24) |
| fioû, s. m., faiseur, presque toujours en mauvaise part. - (14) |
| fioûle (na) : fiole - (57) |
| fioule : (nf) bouteille - (35) |
| fioule : fiole - (43) |
| fioûle : fiole, bouteille - (48) |
| fiouler. v. n . Produire un sifflement, une sorte de vibration sonore, en parlant d’une pierre plate qui, lancée à l’eau vivement et d’une certaine façon, glisse à la surface en ricochant. (Mont-St-Sulpice). - (10) |
| fiouner, v. a., gratter la terre. Ex.: les poules fiounent. - (11) |
| fioûner, vioûner. Ronfler, bourdonner : « les oreilles me fioûnent » pour bourdonnement. « Faire fioûner sa toupie » c'est la faire tourner rapidement pour qu'elle ronfle. - (49) |
| fioux : Faiseur. « Fioux d'embarras ». - (19) |
| fire. Fimes, fites, firent. - (01) |
| firer : v. a., férir, frapper. - (20) |
| firlanche. s. f. Voyez filange. - (10) |
| firmaman. Firmament. - (01) |
| fissia : barreau. - (29) |
| fissias, échelons d'une échelle. - (27) |
| fistolé, adj. ; bien fait, bien arrangé. - (07) |
| fiston, s. m., garçon, garçonneau : « Eh! dis donc, fiston, v'tu v'ni ? » - (14) |
| fiston. s. m. Se dit familièrement pour jeune fils. - (10) |
| fite (na) : poutre (au faîtage) - (57) |
| fitso : plantoir. A - B - (41) |
| fitso : plantoir - (34) |
| fitso : plantoir en bois pour le jardin - (51) |
| fiu : n. m. Faiseur. - (53) |
| fiûte, sf. flûte. - (17) |
| fivre : (nf) fièvre - (35) |
| fivre : fièvre - (43) |
| fiyète, feuillette, fût de cent quatorze litres. La feuillette semble tenir son nom du latin folium, feuille, à raison du peu de longueur et d'épaisseur de ses douves. - (16) |
| fiyeu, filleul (comme petit-fils) ; fiyote, au féminin. - (16) |
| fiÿeû, s. m., filleul. - (14) |
| fiÿòle, s. f., filleule. - (14) |
| fiÿòt, s. m., petit-fils, petit garçon. Pour certaines localités, se rattacherait fiyeù. - (14) |
| fiÿòte, s. f., petite-fille, fillette. - (14) |
| fl. : Les Bourguignons mouillent ces deux consonnes comme s'il y avait un i entre elles et un i à la suite ; telle est la règle de prononciation de plusieurs mots qui suivent. - (06) |
| fla (être à la), loc. avoir grand faim, avoir l'estomac délabré. - (22) |
| flâ : fléau - (39) |
| flâ, flache. adj. - Mou, flapi, sans énergie : « Bonjour mademoiselle. Bonjour, les petites. Comme te voilà affalée, toi ! Je suis flâ. Je n'ai plus d'os. » (Colette, Claudine à l’école, p 92) Emprunt à l'ancien français du XIIe siècle, et issu du latin flaccum, flac ou flache signifiait au Moyen Âge mou, flasque, affaibli. - (42) |
| flâ, flai : fléau - (48) |
| flâ, fléau pour battre à la grange. - (16) |
| flâber, v. tr., abattre les noix. - (14) |
| flâche (du) : aubier - (57) |
| flâche : Défaut d'une pièce de bois dont les angles ne sont pas inttacts. « C'te (S'te) poutre a du flâche ». Vieux français, flache. - (19) |
| flâche : faiblesse dans un pièce de bois - (48) |
| flâche : (flâ:ch’ - subst. m.) veine d'aubier ou d'écorce qui après le débitage d'une planche y reste adhérente à la faveur d'une anfractuosité. - (45) |
| flâche, adj. flexible, pliant. - (08) |
| flâche, s. f. défaut, lacune, endroit défectueux, courbe ou nœud dans une tige de bois. - (08) |
| flâche, s. f., lacune défectuosité, creux. Les flâches d'un terrain, d'une route. - (14) |
| flache. adj . Mou, flasque, sans consistance, sans vigueur, sans énergie. Du latin flaccidus. - (10) |
| flache. Flétri, flasque. Se dit d'une plante flétrie ; d'une étoffe sans apprêt, qui ne se tient pas. - (49) |
| flâchou, ouse, adj. flacheux, qui a des flaches, des défauts, des lacunes. - (08) |
| flâci (-e) (adj.m. et f.) fané (-e), vidé (-e) - (50) |
| flâci, e, adj. fané, flétri, ridé. - (08) |
| flâci, v. a. paner, flétrir - (08) |
| flacoux. s. m. Celui qui fouette, qui fait claquer son fouet. (Guillon). - (10) |
| flaeler. : Flageller, et au moral tourmenter. -Le substantif est flaial et flael, dérivation naturelle du latin flagellum. - (06) |
| flaie : un fléau pour battre le grain - (46) |
| flaijôlai. Flageolet, flageolets. - (01) |
| flaimeuche : n. f. Flamèche. - (53) |
| flaimeusse : fainéant - (48) |
| flaimeusse : galette épaisse - (48) |
| flaimeusse : galette épaisse - (39) |
| flaimeusse : n. f. Pâtisserie de modeste qualité. - (53) |
| flaimeusse, gâteau des campagnes, formé d'un mélange de farine de maïs et de seigle ou de froment, et pétri au lait. - (02) |
| flaimeusse, s. f. galette de sarrasin cuite au four sur une feuille de chou. - (08) |
| flaimeusse. : Gâteau des campagnes pétri au lait. -La lettre l se mouille toujours quand elle est précédée de la consonne f, ainsi il faut prononcer filiaimeusse. - (06) |
| flaine : s. f., vx fr., taie d'oreiller. Syn. de flune. - (20) |
| flaîner. v. a. Battre. (Guy). - (10) |
| flairé : pièce de toile dans laquelle le semeur met le grain à semer à la volée - (48) |
| flairé, s. m. manteau de boge que portent les paysannes. — linge dans lequel on enveloppe le pain pour le conserver frais, ou dont on se sert pour couvrir la cendre des cuviers de lessive. (Voir : fleuret.) - (08) |
| flairé. Grand drap dont on garnit les cuviers à lessive. Origine inconnue. - (03) |
| flairer (n.m.) : charrier, grosse boite pour couvrir les cendres des cuviers de lessive - (50) |
| flairet, n. masc ; morceau de toile ou d'étoffe, dont on se couvre la tête et les épaules, contre la pluie. A plieut, prends ton fiairet. C'est aussi la toile qui contient les cendres, dans le cuvier. - (07) |
| flairure. : (Prononcez filiairure), odeur de viande cuite. - Flairé le vadô, c'est-à-dire sentir le vin doux pour apprécier la qualité de la récolte. - (06) |
| flaitte, s. f. flatterie, câlinerie, prévenance. - (08) |
| flaittement, s. m. flatterie, cajolerie. - (08) |
| flaitter, v. a. flatter, caresser. « Flaitter » un enfant c'est lui faire des caresses, lui parler avec douceur, avec bonté. - (08) |
| flaittou, ouse, adj. et subst. flatteur, caressant, celui qui emploie la flatterie jusqu'à la ruse avec un but intéressé ; trompeur. - (08) |
| flamanche (C.-d, Morv., Chal., Br.). Terme de construction ; fenêtre à saillie hors du toit, suivant la mode flamande. La chose et le mot sont probablement une importation faite en Bourgogne au temps des ducs. - (15) |
| flamanche, flamange, s. f. fenêtre à jambages et à saillie hors du toit. - (08) |
| flamanche, s. f., lucarne d'un grenier, petite fenêtre d'une mansarde : « O s'balançòt. Ol a été trop fôr ; ôl a dévaulé par la flamanche. » - (14) |
| flamanche, s.f. (de Flamand) ; petite ouverture dans les combles d'une maison, fermée avec un volet. - (38) |
| flamb', s. f., flamme, lueur vive. - (14) |
| flambe, s. f. flamme, jet de feu qui s'allume. - (08) |
| flambée, s. f. feu qui flambe, qui projette une grande flamme. - (08) |
| flamberon. s. m. Tison, flambeau. (Armeau). - (10) |
| flàmer, v. intr., flamber, flamboyer, luire, brûler. - (14) |
| flameusse : brioche. (T. T IV) - S&L - (25) |
| flammauche, flammesauche. s. f. Flammèche. - (10) |
| flammer (v. int.) : brûler, flamber – être allumée, en parlant d'une lampe - (64) |
| flammer (v. tr.) : (l'diâbe me flamme ! (juron)) - (64) |
| flammer, v. n. flamber, lancer de la flamme, brûler : « fié flan-mer l'feu », faites flamber le feu. - (08) |
| flammer. v. - Flamber. Mot déjà utilisé au XIIe siècle, flamer ne sera remplacé par flamber qu'au XVIe siècle. Le poyaudin a conservé le terme ancien français. - (42) |
| flammer. v. n. Flamber, jeter des flammes. (Perreuse). - (10) |
| flammeron. s. m. Fumeron. (Villiers-Saint-Benoît). - (10) |
| flam'ter : brûler à la flamme - (48) |
| flamuche, -sche, s.f. pâtisserie faite de farine, de beurre et d'œufs avec du fromage. - (38) |
| flàmusse (C.-d., Chal., Br.), flaimeusse, flameusse (C.-d.). -Tarte ou flan (pâte recouverte d'une couche de crème, semoule ou courge, fromage blanc, bouillie de maïs, etc.). Du vieux français flaon, gâteau plat, et musse pour mussé, caché… La flamusse, au contraire, a été de tout temps connue en Bourgogne. Elle n'est donc pas une importation des Flandres ; il se pourrait même que la flamiche, ainsi prononcée en dialecte picard, ait été empruntée à notre pays. Le remplacement de la crème par des poireaux s'explique par l'excellence de ces légumes en Picardie. D'ailleurs, dans certains pays de la Côte, les fruits sont également remplacés, lorsqu'ils ont fait défaut, par de simples poireaux ; la flamusse devient alors un pouroté. - (15) |
| flamusse : gâteau de maïs. - (31) |
| flamusse et flémeusse. Pâtisserie commune, plate et circulaire, dans laquelle il entre du fromage blanc et de la courge... Le nom et la chose sont très anciens en Bourgogne... - (13) |
| flamusse : s. f., gâteau de la campagne, brioche. - (20) |
| flamusse, flameusse ou flamausse. Pâtisserie nationale ; pâte extrêmement molle apprêtée au lait. Au figuré, personne sans caractère. Etym. flan et meusse (voir ce mot). - (12) |
| flàmusse, flémusse, flameùsse, petit pain, gâteau des campagnes, pétri à la farine, au maïs, au sarrazin et assaisonné d'œufs, de lait et parfois de courge. Toutes ces pâtisseries locales ont une saveur des plus agréables. Les ménagères les réussissent à merveille. - (14) |
| flamusse, gâteau de farine de maïs. - (16) |
| flamusse. Pain de maïs ou de sarrasin. On a dit flamiche. - (03) |
| flan : tarte à la semoule - (48) |
| flan de queurde : flan de courges - (43) |
| flan, n.m. tarte aux fruits. - (65) |
| flan, pâtisserie couverte d'une sorte de fruit. - (16) |
| flan. Flanc, flancs… - (01) |
| flan. Pâtisserie de la famille des flamusses. On la confectionne surtout pour la fête du village, pour l’apport. C'est une feuille de pâte recouverte de fruits, de courge menusée, d'épinards ou de comeau. La fête de Nantoux a lieu en hiver : les fruits et les légumes font défaut, on y fait du pouroté, c'est-à-dire du flan aux poireaux. Jadis, le flan était une sorte de crêpe ou d'omelette cuite dans une casse, sur un feu flambant. La préparation que nous appelons maintenant flan de lait ou flandelet lui ressemble beaucoup. - (13) |
| flanc : s. m., côté, direction. - (20) |
| flancher. v. n. Faiblir, manquer de force. — Au figuré, manquer de fermeté, chanceler dans ses résolutions. De flanc. (Percey). - (10) |
| flanchet. s. m. Viande provenant du flanc, du côté, du ventre des animaux de boucherie. - (10) |
| flandrin, adj., flemmard. - (40) |
| flanké des coups, des soufflets ; flanké quelqu'un à la porte dans sa première signification, flanké veut dire donner ; dans sa seconde, il a le sens de jeter. - (16) |
| flans : chiendent. - (21) |
| flapi : exténué - (44) |
| flapi : fatigué, exténué - (48) |
| flapi, flapie : part, pass., vx fr. flapir (v. a.), flétri, mou, flasque. S'emploie tant au propre qu'au figuré. - (20) |
| flapi. Très fatigué, harassé. - (49) |
| flappi adj. (du lat. faluppa, balle de blé). Mou, fatigué, vidé. - (63) |
| flappi : très fatigué - (39) |
| flaque d'eaau. : Prononcez filiaque d' eaa - (06) |
| flaque, fliaque. s. f. Fouet. (Athie. Etivey). - (10) |
| flaquer. v. a. et v. n. Fouetter. — Figurément, faire flic-flac, se donner de l’importance, faire claquer son fouet. (GuilIon). - (10) |
| flaquer. v. n. Être mou, flasque, sans raideur, sans maintien, sans consistance, en parlant des étoffes. Ce jupon n’a pas assez d’empois, il flaque sur les jambes. - (10) |
| flaquoise. s. f. Gros fouet. (Annay-sur-Serein). - (10) |
| flarée : odeur, fumet. (VSLD. T II) - S&L - (25) |
| flargeoulot, s.m. iris. - (38) |
| flasquer. v. n. Répandre une mauvaise odeur. (Sens). - (10) |
| flasse. s. f. Filasse. (Montillot). - (10) |
| flât. s. m. Fléau à battre le grain. (Coutarnoux). — A Guillon, on dit fiait et, à Etivey, flias. - (10) |
| flate, s. f., flatterie, louange, caresse intéressée. - (14) |
| flâti, v. a. affadir, rendre flasque, mou : cette eau chaude m'a « flâti i, le cœur. - (08) |
| flatoû, adj., flatteur, qui dit des paroles trompeuses. - (14) |
| flatou, flatteur. - (16) |
| flâtri (adj.) : flétri - (64) |
| flâtri, ie. adj. Fané, flétri. - (10) |
| flâtri. adj. - Flétri. - (42) |
| flatte (prendre de), amadouer, attirer à soi ou à son avis par ruse, par douceur, par flatterie. - (11) |
| flatte : s. f., vx fr. flate, flatterie. Prendre quelqu'un de flatte : le prendre par la flatterie. « Mettre en flatte, tromper. » (Godefroy, Dictionnaire). - (20) |
| flatter. Flatter. - (49) |
| flattoux, flattouse : adj., flatteur, flatteuse. - (20) |
| flau (nom masculin) : fléau. (Battre au flau). - (47) |
| flau n.m. Fléau. Voir écousseux. - (63) |
| flau : prononcer flôôô. Fléau, pour battre le grain. Composé de 2 lourds bois ronds, l'un plus long (celui que le batteur tient) que l'autre, les deux parties étant reliées par deux bandes de cuir cloutées souples, pour assurer un mouvement ample à la partie battante. Le batteur faisait un geste circulaire avant d'abattre son flau. - (58) |
| flau, fléau. s. m. Fléau à battre le grain. Du latin flagellum. - (10) |
| flau, s. m. fléau, malheur, catastrophe : c'est un « flau » de dieu, se dit d'une calamité publique. On emploie cette forme en quelques lieux pour désigner l'instrument qui sert à battre les céréales. - (08) |
| flau. n. m. - Fléau. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| flaubée, fleaubée. s. f. Forte correction, suite de coups donnés à l’imitation des coups réitérés du flau qui bat le grain. — Pluie d’orage qui tombe a flots pressés. — De fléau, que les ouvriers de la campagne prononcent flau. - (10) |
| flauber, fleauber. v. a . Battre à coups redoublés, ainsi qu’on bat le grain avec le flau (le fléau). Attends, galopin, j’ m’en vas te flauber, si tu ne finis pas. - (10) |
| flauder : flâner. - (09) |
| flaupée : beaucoup - (48) |
| flaupée : beaucoup. Ol é eu une flaupée d'ptiots : il a eu beaucoup d'enfants. - (33) |
| flaupée, floupée. s. f. Nombre, foule, quantité, multitude. C’est une altération de flaubée. - (10) |
| flauppée, f’yauppée : beaucoup, un grand nombre - (37) |
| flavouteit. : (Dial.), faiblesse, pusillanimité. Mot emprunté au latin flabilitatem, rac. flabilis ; ce qu'un souffle disperse. Flabellum est de cette famille latine et signifie éventail. - (06) |
| flayrure, odeur, vapeur de viande... - (02) |
| flê : (flê: - subst. m.) fléau à battre les céréales. - (45) |
| flé, filer. - (16) |
| fleai, s. m. fléau, instrument pour battre et séparer les grains de la paille. - (08) |
| flèche : pièce de bois réunissant le train avant au train arrière d'un char - (48) |
| flèche, s. f., longue perche de bois entre l'avant-train et l'essieu arrière d'un char. - (40) |
| flèmard. Paresseux, enclin à la « flème ».(Argot). - (49) |
| flème, flemme (pour flegme) s. f. Nonchalance, manque de courage, d’énergie. Avoir la flemme, c’est être pris d’un accès de paresse. - (10) |
| fléme, s. f., flegme, mollesse, paresse, accablement, maladie de l'ouvrier qui ne veut pas travailler. — N'est pas inconnu, même à Paris. - (14) |
| flème. Paresse. (Argot). - (49) |
| flèmeusse : flemmard - (48) |
| flèmeusse : (flèmeus' - subst. f.) galette formée d'un morceau de pâte demi-molle posée sur une feuille de chou et passée au four. On en faisait le "jour du pain", quand le four était chaud. Au figuré : paresseux, fainéant (par attraction du fr. flemme). - (45) |
| flemme, s. f. flegme, langueur causée par la fatigue ou la mollesse, accablement. Avoir « la flemme », c'est n'en pouvoir plus, être à bout de force et de courage. - (08) |
| flemmeusse : adj. inv. Gnangnan. - (53) |
| flène : enveloppe d'oreiller et d'édredon. - (30) |
| fler : filer (la laine) - (43) |
| fler v. Filer. - (63) |
| fler, v.filer. - (38) |
| flet. s. m. Petite claie de paille ou d’osier pour les fromages (Villemanoche). - (10) |
| fleu, adj., fluet, sans forces. - (40) |
| fleu, e, adj. faible, mou, lâche, sans consistance : un épi « fleu », une plante « fleue », c’est à dire qui n'a pas de rigidité, qui aurait besoin de soutien. On prononce « fleure » en quelques lieux. - (08) |
| fleuïau. s. m. Fléau à battre le grain. (Bleigny-en-Othe). - (10) |
| fleur, n.f. employé au singulier, désigne la fleur des arbres fruitiers. - (65) |
| fleur, s. f., fleur de froment. Ce mot s'emploie seul, et a un sens absolu : « J'ai écheté d'la fleur ; j'vons fâre des flamusses aux ûs. » - (14) |
| fleûré, drap qui reçoit les cendres, dans le cuvier à lessive. - (16) |
| fleuré, toile servant à placer les cendres d'une lessive. - (28) |
| fleuret, s. m. nappe qu'on étend sur le cuvier de lessive entre le linge sale et la cendre. Cette nappe sert à quelques autres usages. - (08) |
| fleureter, v. a. aller à fleur de... à la surface de... : « fleureter » un terrain pour en extraire les pierres. - (08) |
| fleurin : flamèche - (39) |
| fleurin, s. m. matière volatile qui s'échappe d'un feu de cheminée ou d'incendie. - (08) |
| fleurot (n. m.) : jonquille - (64) |
| fleurte, ée. adj . Qui a toute la fleur, en parlant des fruits qui ont été cueillis avec soin, qui ont encore toute leur fraîcheur, leur coloris, leur velouté. Que ces prunes, que ces pêches sont jolies ! Comme elles sont bien Heurtées! — À Auxerre, il y a des personnes qui ne prononcent pas l’r, et qui disent fleuté. - (10) |
| fleuser. v. a. Flairer. (Courgis, Saint-Martin-sur-Ouanne, etc). - (10) |
| fleûtaine, s. f., école buissonnière : « C'crapaud là, ô n'éprendra jamâ ran ; ô fait quasiment tôs les jors la fleûtaine. » - (14) |
| fleûte, s. f., flûte, instrument, et petit pain pour le café au lait. - (14) |
| fleùte. Flûte, flûtes. - (01) |
| fleuteau, s. m. flûteau, diminutif de flûte. - (08) |
| fleuter, v. a. flûter ; jouer d'un instrument quelconque où l'on souffle ; chanter, siffler, fredonner. - (08) |
| fleûter, v. intr., jouer de la flûte. - (14) |
| fleûter, v. tr., boire avec complaisance et à bonne dose. (V. Fiôler.) - (14) |
| fleuteu, fleutou. s. m. flûteur, celui qui joue de la flûte ou de tout autre instrument à vent : joueur de cornemuse. - (08) |
| fleûtiau, s. m., flûteau, petite flûte d'enfant : « O n'ain-me qu'à sòfler dans son fleùtiau. » - (14) |
| fleutiau, s.m. flûte. - (38) |
| fleûtoû, s. m., joueur de flûte. Figure dans les orchestres des fêtes de village. - (14) |
| fliachi (se) : Se flétrir. « Arrose tes hoquets (tes fleurs) i commachant à se fliachi ». Vieux français, flachesse, molesse. - (19) |
| fliais - fléau, pour battre le grain dans la grange. - C'â in bon baittou ai lai groinge ; en faut voué quemant qu'a beille in co de fliais ! - I vas portai le fliais à borrelé pour rairainger lai corroie. - (18) |
| fliameuche : Nom sous lequel on désigne les divers gâteaux brioches, cac'euts, flans, que les ménagères font à la maison à l'occasion de fêtes. - (19) |
| flian : Flan, sorte de gâteau composé d'une croûte de pâte dure sur laquelle on a mis de la pâte à cac'eut ou « comeau » ; la pâte dure est une pâte feuilletée, brisée, étendue au rouleau et coupée en rond. « Pa la Saint-Geôrges an fa des plieins fos de flians a peu de cac 'euts ». - (19) |
| fliaque metreux. adj. et s. Grand niais. (Etivey). - (10) |
| fliaque, pour flaque, amas d'eau. - (02) |
| fliaquer, v. ; claquer. - (07) |
| fliatter : Flatter, caresser, faire des compliments. « Si je te dis y est qu’y est vrâ, y est pas pa te fliatter ». - (19) |
| fliattou : Flatteur, caressant « Alle a pris eune homme que n'est guère fliattou (qui n'est guère caressant, qui n'est guère tendre) ». - (19) |
| fliau : Fléau, instrument dont on se sert pour battre le blé. - (19) |
| flicoire, fliquouère. s. f. Seringue faite d’un morceau de branche de sureau. (Villiers-Saint-Benoit, Dillo). — Jaubert donne flictoire, fliquetoire et fic-foire. - (10) |
| Flies (Les Flies), climat ("les Follies "). - (38) |
| flieu : Fleur « Les pommés sant en flieu » les pommiers sont en fleur. - Flux. « Flieu de sang » hémorragie. - (19) |
| flieumeusse – espèce de patisserie, en forme de galette, garnie de pommes de terre, ou de riz, ou même de poireaux. Dans ce dernier cas on spécialise en disant Pourottère. - I n'ai pâ fait de flian caite fouai qui ; i me seue contentée de fare des flieumesses, ci côte moins. - (18) |
| flieûne : Taie d'oreiller. « Eune flieûne tote neue (toute neuve) ». - (19) |
| flieuquer : Se dit d'un liquide qui bat les côtés du vase quand on le transporte en le secouant trop fort. - (19) |
| flieur, s. f. fleur. - (08) |
| flieuré - piéce de grosse toile, qui recouvre la lessive dans le cuvier, et sur laquelle on place des cendres. - Le flieuré à in pecho petiot ; ine aute fouai i l'élergirai. - Vote flieurai â eusai et a pourro se perçai, et pu les cendres passeraint su le linge et ci ne vauro ran. - (18) |
| flieuri : Fleurir « Les abres sant bienflieuri, i ara des fruts c't' (s't') an-née ». - (19) |
| flieurtai - orner de fleurs. - Lai Marianne é ine jolie robe tote flieurtée. - Lai feille du Bureau de Tabac é des mochés de poches flieurtai és coins. - T'é vu quemant qu'en aivo flieurtai to le devant du Reposoir. - (18) |
| flieute : Flûte. Proverbe : « Ce qui vint à la flieute s'en retorne au tambour ». - (19) |
| Flipe, Flipot. Nom d'homme pour Philippe. - (08) |
| Flipe, Philippe - (16) |
| flliammes, lancettes, bistouris. - (05) |
| flliammusse, pain de sarrasin. - (05) |
| fllian, tarte. - (05) |
| fllianchot, peau entre cuisse et flanc. - (05) |
| flliatter, caresser, exercer copulation. - (05) |
| flliau, fléau à battre gerbes. - (05) |
| fllieunard, flâneur. - (05) |
| fllieuner, flâner. - (05) |
| fllieur, fleur. - (05) |
| fllieuri, toile de cuvier de lessive. - (05) |
| fllyœte, s. f. feuillette. - (22) |
| flneroz. : (Lat. fines regionis), chemin de desserte d'une contrée. (Cout. de Châtillon, 1371.) - (06) |
| flo (n. m.) : fléau destiné à battre le grain - (64) |
| flô, s. m., fléau. - (40) |
| flô, s.m. fléau. - (38) |
| floche (na) : trouble (filet de pêche) - (57) |
| floché : adj. Quand les jambes se dérobent. - (53) |
| floche, et flochon, s. f., filoche à prendre le poisson, petit filet. - (14) |
| flocher, v. tr., prendre dans la filoche : « J'seû été d'avou l'vieux André, qui poche. J'li ai floché eùne carpe. » - (14) |
| flochon. Sac en filet pour mettre le poisson, par contraction de filoche, parce qu'il est fait en fil. - (03) |
| flôder, v., battre les graminées au fléau. - (40) |
| flôdou, s. m., celui qui se sert d'un fléau. - (40) |
| flogre, flogue. adj. - Trop mûr, blet : « Vite, vite, donne m'en d'autres, pour ôter le goût, celles-là étaient flogres. » (Colette, Claudine à l'école, p. 76) - (42) |
| flogue (adj.) : blet, en parlant d'un fruit (des pouées flogues) - (64) |
| flogue : blet, blette. (P. T IV) - Y - (25) |
| floibeteiz. : (Dial.), faiblesse (du complément latin flebilitatem.) - On sait que dans le dialecte on disait aussi floible au lieu de foible. - (06) |
| flon, s. m., fil formé de plusieurs crins, tordus ensemble pour attacher un hameçon. - (14) |
| flône, adj. qui fléchit. - (38) |
| flon-flon. Refrain d'un vaudeville de 1687, qui consistait en des couplets de quatre vers, dont le refrain était Flon flon, làrida dondaine, Flon, flon, flon, larida dondon… - (01) |
| flonner. v. - Rosser, corriger. « Deux grands drôles à large carrure l'attrapent et s'mettant à flonner. » (G. Chaînet, En chicotant mes braisons, p. 11) - (42) |
| flôô : n. m. Fléau. - (53) |
| floppée : gros tas, grande quantité - (39) |
| flôquai. : (Dial. et pat.), réunion de plusieurs fleurs ou fruits sur une même branche. - (06) |
| floquer, aller au gré du vent. - (04) |
| floquer, v. intr., flotter, osciller. Ne s'emploie qu'en parlant de l'effet des pieds dans des chaussures trop larges : « Ses pieds floquont dans ses saibots. » - (14) |
| floquer, v. n. flotter. Le sens est restreint et le mot ne s'emploie plus guère qu'en parlant des chaussures trop larges. On dit : ses pieds « floquent» dans ses sabots, dans ses souliers. - (08) |
| floquet, réunion de plusieurs fleurs ou fruits sur une même branche. Dans le Châtillonnais, on dit un floquet de cerises... - (02) |
| floquet, s. m., grappe de fruits ou de fleurs tenant à la même branche. - (14) |
| floquéte, s. f., nœud de cravate, coquettement disposé. - (14) |
| Flôrantin. Florentins. On entend le grand duc de Toscane en 1701. - (01) |
| floret, s. m., fleuret, arme, et fil de soie. - (14) |
| flot, s. m. on donne ce nom par métonymie à la masse des bois de moule que les eaux de la Cure ou de l'Yonne conduisent à paris. - (08) |
| flòte, s. f., écheveau de fil, de soie, etc. - (14) |
| f'lotsi : (vb) s'effilocher - (35) |
| flotson : plante grêle, rabougrie. A - B - (41) |
| f'lotson (ne) : (adj) en pleine fleur - (35) |
| flotson : plante grêle, rabougrie - (34) |
| flotson n.m. et adj. Désigne une plante, un arbre ou même un individu maigre. - (63) |
| flotson, finotson : plante grêle, rabougrie - (43) |
| flotsoñner v. 1. Filer, filocher, partir en filoche. 2. Fig. Grandir sans s'épaissir, comme les adolescents. - (63) |
| flottage, s. m. le flottage est le transport par eau des bois flottés. - (08) |
| flottaige, s. m. somme fixée de gré à gré qui représentait l'intérêt du prix des marchandises livrées à l'avance : tant pour la marchandise, tant de « flottaige » ; j'achète votre bois payable dans un an, mais sans « flottaige », etc. - (08) |
| flotte : pluie - (44) |
| flotte : s. f., vx fr., échéveau. - (20) |
| flotter, v. a. mettre à l'eau les bois de moule accumulés sur les « ports » ou conduits sur place par les chariots. On « flotte » ordinairement dans les mois de novembre ou décembre. - (08) |
| flotteur, s. m. un flotteur. On donne encore ce nom dans le Morvan à tous les hommes employés au flottage, à tous ceux qui, échelonnés le long des ruisseaux, travaillent à pousser le flot vers son but. - (08) |
| flougue (pour flogue). adj. Blet, ette. Poire flougue, poire blette. - (10) |
| flouquer (pour floquer). v.a. Basser, remuer un liquide. — Se dit aussi, neutralement, du liquide qui basse, qui s’agite sous une action quelconque. Dérivé de flot, qui, mal prononcé, fait flou. - (10) |
| flouquet (pour floquet).s. m. Bouquet de fleurs, nœud, rosette, pompon de rubans. Du latin floccus ou de flosculus. (Perrigny-lès-Auxerre). - (10) |
| flous (des), cendres de bois pour faire la lessive. - (38) |
| floûser, v., péter, avoir des vents. - (40) |
| flume : s. f.. vx fr. fleume, flegme, mucosité rendue par expectoration ou vomissement. Un ivrogne rend ses flumes dès le matin. - (20) |
| flune : s. f., taie d'oreiller. Syn. de flaine. - (20) |
| flune, s. f. enveloppe d'oreiller, taie (du latin fluxina). - (24) |
| Flûri, s. m. nom de bœuf. - (08) |
| flûrî, v. intr., fleurir. - (14) |
| flûri, v. n. fleurir, être en fleur. - (08) |
| flûtaine. s. f. Synonyme d’école buissonnière. — Faire la flûtaine, errer, vagabonder le long des buissons et des haies pour faire des flûteaux avec de jeunes branches de saule, au lieu d’aller à l’école. - (10) |
| flûteau : sifflet. V, p. 25 - (23) |
| flûter : siffler - (61) |
| flûter : siffler (principalement au sifflet de la machine à battre) - (37) |
| flûter : siffler - (48) |
| flûter : siffler - (39) |
| flûter, v. siffler. - (65) |
| flûter. v. - Siffler. - (42) |
| flutes (faire ses), supporter ses caprices. - (27) |
| flûteux : joueur de flûte. V, p. 40 - (23) |
| flutiau (un) : une flûte, un sifflet - (61) |
| flûtiau : flûte (et aussi) personne de grande hauteur - (37) |
| flûtiau : sifflet. Un grand flûtiau : un homme grand et maigre. - (52) |
| flûtiau : voir flûteau - (23) |
| flutiau : petite flûte artisanale, jouet d’enfant. Ex : "Arrête don anvec ton flutiau, t’as don rin d’aut’ à fée ?" - (58) |
| flûtiot : une petite flûte. - (56) |
| flûtiot : 1 n. m. Sifflet fait dans un bout de bois. - 2 adj. Personne grande et maigre. - (53) |
| flûtiot, flûtchot, flûteau. n. m. - Petite flûte en bois de saule ou de sureau. - (42) |
| flutiot, flutot : sifflet. Un grand flutot : un homme grand et maigre. Les borgers faitin des flutiots : les bergers faisaient des sifflets. - (33) |
| flûtot : sifflet (objet ou personne grande et maigre) - (48) |
| flûtot : instrument pour siffler - (39) |
| flux : n. f. Diarrhée. - (53) |
| fluxia. Fuchsia (Fuchsia magellanica). - (49) |
| flû-yot, adj., véreux, (un cala flû-yot, une noix véreuse). - (40) |
| f'male (na) : femelle - (57) |
| fmale, femelle d'un animal, d'une plante. - (16) |
| fmé : s. m. fumier. - (21) |
| fmé, fumier et fumer. - (16) |
| f'mée, feumée. Fumée. - (49) |
| fmer v. Fumer. - (63) |
| f'mer, feumer. Fumer. - (49) |
| fmére : s. f. fumée. - (21) |
| fmëre, fumée ; ceux qui veulent se distinguer disent fumière. - (16) |
| f'mes-re, s.f. fumée. - (38) |
| fmeux n.m. Fumeur. - (63) |
| fmî v. Fumer (répandre du fumier). - (63) |
| fmî, feumî n.m. Fumier. - (63) |
| f'min, fumier. - (26) |
| fminre : fumée. (PLS. T II) - D - (25) |
| f'minre, fumée. - (26) |
| fmîre n.f. Fumée. - (63) |
| fmö, sm. fumier. - (17) |
| fmöre, sf. fumée. - (17) |
| fmöron, funmron, sm. fumeron. - (17) |
| fmou, celui qui fume trop souvent. - (16) |
| f'naille (en) : 1 v. t. Tout démonter. - 2 adj. En désordre. - (53) |
| f'naillè, débeurnaillè : v. t. Démolir. - (53) |
| fnau : fenil - (34) |
| fnau : fenil - (51) |
| fnau n.m. Fenil. - (63) |
| fnêche : agrostis : plante nuisible du blé (se dit aussi plou). A - B - (41) |
| fnèche n.f. (du lat. fenum, foin). Plante parasite, ivraie, - (63) |
| f'née'te : fenêtre - (48) |
| fneilli : fané - (51) |
| f'ner : faner - (57) |
| f'ner : faner. - (58) |
| fnesse : agrostis (plante nuisible au blé) - (43) |
| f'néte. n. f. - Fenêtre. - (42) |
| fneu, adj. malhabile. Incapable. - (17) |
| f'neûiller : fureter. (E. T IV) - VdS - (25) |
| fneuté, vn. faire des riens, demeurer inactif. Voir tanusé. - (17) |
| fnô : fenil. A - B - (41) |
| fno : fenil. - (29) |
| fnô, fouainô, fouanô : n. f. Planche à foin. - (53) |
| fnot (n. m.) : fenil - (64) |
| fo (on) : four - (57) |
| fo (on) : fournil - (57) |
| fô : (nm) four - (35) |
| fô : fort (fôtch au féminin) - èl â fô, il est fort - (46) |
| fo : Four. « Les pains sant levés, y est bien temps de chauffer le fo ». « Y est pas par ta que le fo chauffe » : ce qui s'apprête n'est pas pour toi. - « Commandou au fo » : mouche du coche (voir épogne). Au figuré : « chauffer le fo », faire des excès de boisson. « An voit que t'as chauffé le fo hiya (hier) t'as mau es cheveux c'tu (s'tu) métin ». - (19) |
| fo : le four - lè chambre è fo, pièce dans laquelle se trouve le four à pain - (46) |
| fô n.m. Four. - (63) |
| fo : s. m four - (21) |
| fô, adj., fou, badin, enjoué, excentrique. - (14) |
| fô, feurte : (adj) fort (e) - (35) |
| fo, fou ; feûle, au féminin. - (16) |
| fo, fou... - (02) |
| fo, four. - (05) |
| fô, sf. fois. Ène fô, une fois. - (17) |
| fö, sm. 1) feu. 2) foie, adj. fou, folle. - (17) |
| fô. Fou, stultus et stulti ; fô est aussi l'arbre nommé hêtre, autrefois fou, foteau, fouieau, fau, fouteau, fayant et fayard. - (01) |
| fo. Fou. Nous disons « chin fô » pour chien enragé. - (03) |
| fo. Four. - (49) |
| fô. : Ce mot signifie à la fois fou (privé de raison) et hêtre ou foyard. Dans cette dernière acception, les villageois au lieu de prononcer fau, comme étant la vraie dérivaaon du latin fagus, ont prononcé fou et ont donné à ce faux substantif les diminutifs fouteau ou foutiau.- Quant au vocable fou (privé de raison), il a toute l'apparence d'un mot gaulois latinisé. - (06) |
| foâché, fâcher ; s' foâché, se fâcher ; être foâché se dit aussi pour être peiné, attristé, comme dans cet exemple : el â don mo ! j’an seû bèn foâché ! il est donc mort ! j'en suis bien peiné ! - (16) |
| foâcher : faucher. - (32) |
| foâchillon : fauchaison. - (32) |
| fòblle*, adj. affaibli et fatigué par la maladie. - (22) |
| fochalle, fochelle n.f. Faisselle. On utilise surtout le mot cope pour désigner la faisselle. - (63) |
| foche (ŏ), sf. force. - (17) |
| fòché (ō), vt. faucher. - (17) |
| fóché (ŏ), vt. forcer. - (17) |
| fochelle, fouchelle : n. f. Faisselle. - (53) |
| fôchi : s. m. manche de la faux. - (21) |
| fochou, .sm. faucheur. - (17) |
| fôchou, faucheur. - (16) |
| fœche (être tout), loc. être droit, immobile, figé. - (24) |
| fœche (être tout), loc. être droit, immobile, figé. On dit aussi : être tout campe. - (22) |
| fœchi, v. a. ficher, planter en terre un pieu, un échalas. - (22) |
| foêle. s. m. Hêtre. (Etais). - (10) |
| foénasse : grande herbe - (39) |
| foéner : faner - (39) |
| fœnne s. f. femme. - (24) |
| foénou : grenier à foin - (39) |
| foènou(re) : faneur (euse) - (39) |
| foère : foire - (51) |
| foère n.f. Foire. - (63) |
| foèreux n.m. Individu qui va régulièrement à la foire. - (63) |
| fœrté, v. a. 1. Frotter. — 2. Battre : ce galopin a été fœrté. - (22) |
| foesse, foesser, fouace, ou bois clayonné et enduit de terre. - (05) |
| fœza : s. m. fuseau. - (21) |
| fofotte. s. f. Cocarde, touffe de rubans cousue sur un vêtement, sur une coiffure ou une chaussure. - (10) |
| foi. Fouet ; c’est aussi fois, une fois, deux fois, etc… - (01) |
| foie blanc. Le poumon des animaux ; désignation naïve inspirée par une anatomie sommaire ! Les poumons tiennent au foie, tout vient ensemble quand on vide les animaux, donc c’est la même chose, ... foie blanc ! - (12) |
| foie blanc., foué blanc. n. m. - Poumon. - (42) |
| fôienne (i), "ça foisonne". fôiner, v. foisonner. - (38) |
| foije, fane de pomme de terre. - (16) |
| föille (ŏ), sf. feuille. - (17) |
| foillenai : foisonner. (C. T IV) - A - (25) |
| foilles : s. f. pl. noms des grands feux des Bordes : on allumait de gros fagots fixés sur une perche que l'on promenait autour des pommiers. - (21) |
| foilloir : v. impers. Falloir. - (53) |
| foin : Foin. Dicton : « An-née de foin, an-née de ren » : les années de foin sont des années pluvieuses qui ne sont pas favorables ni pour les champs ni pour les vignes. - (19) |
| foin : s. m. foin. - (21) |
| foin, fouine. - (05) |
| foin, s.m. fouine. - (38) |
| foin. Fouine. - (03) |
| foinache, subst. féminin : foin coupé, herbe sèche. - (54) |
| foinaison, et f'naison, s. f., fenaison. - (14) |
| foinàjon. s. f. Fenaison. (Ménades). - (10) |
| foinasse, fouinaisse, s. f. grande herbe à demi sèche qu'on ramasse dans les bois ou dans les lieux incultes. - (08) |
| foinde - céder, diminuer, dépérir. - C'â in fichu gas, vais !.. si en n'éto pas in pecho hairdi, en foindro tojeur aivou lu. - Eh ! dis don, lai provision, quemence de foinde. - Dans mai mailaidie i ai bein fondu ; viez don ce qui seû !.. - (18) |
| foinde : (fouin:d' - v. intr.) diminuer de volume, de quantité. - (45) |
| foindre - (39) |
| foindre (se). Se diminuer. - (49) |
| foindre (v.t.) : diminuer en poids, en volume ou en quantité - (50) |
| foindre : Céder dans la discussion. « I se sant bien cantra (disputés) mâ le ptiet n’a pas foingnu ». - Etre tassé, diminué comme le foin sec dans le « foinné » et par extension amaigri. « La mère Catherine a bin foingnu, alle vint veille ». - (19) |
| foindre : fondre, diminuer - (60) |
| foindre : réduire (fondre) : « tout a foindu ! », « ça foint », « ça s'est foindu ». - (56) |
| foindre : s'affaisser. - (09) |
| foindre : diminuer de volume, fondre. - (33) |
| foindre : v. t. Fondre. - (53) |
| foindre, céder, se soumettre. - (05) |
| foindre, participe passe foindu. Intraduisible autrement que par une périphrase ; foindre désigne le fait par une chose de diminuer de volume spontanément. Ex. : « Vous avez devant vous une belle omelette soufflée qui s'affaisse en refroidissant, elle foint. - (12) |
| foindre, quoique venant de fingere , faire semblant de, n'a pas ce sens chez les Bourguignons. Il foint signifie il a peur, et il ne foint pas veut dire il ne craint rien. - (02) |
| foindre, v. n. diminuer en poids, en volume, en qualité ; maigrir ; se détériorer. On dit d'un tas de blé travaillé par les rats qu'il « foint » ; d'une meule de paille séchée parle vent qu'elle «foint », etc. - (08) |
| foindre, vn. [feindre]. faiblir, céder devant plus fort que soi : s'humilier. - (17) |
| foindre. Céder, reculer, hésiter. - (03) |
| foindre. Diminuer, se condenser. J'aivâs mis un gros cbou dans lai marmite : a s'ast teut foindu. On dit aussi : not' vin sast foindu dans le tonneau, al ai un p'chot coulé. Le manquant s'appelle la feinte. Vient peut-être de foin qui se tasse en séchant. - (13) |
| foindre. v. - S'affaisser, s'effondrer, se rapetisser : « Il y ouvrit la bouche pou'y z’yeuter l'ampas, il y pinça su'1 fil des reins pou'y fai'e foindre le dous. » (Fernand Clas, p.263) - (42) |
| foindre. v. n. S’affaisser, diminuer de volume, s’effondrer. Ol ô bé foindu, il a bien maigri. (Saint- Brancher) . — Au figuré, signifie céder, reculer. Il a pas peur, il a pas foignu. (Courgis). — Se dit aussi pour s’abaisser, se soumettre, s’humilier. C’est à l’inférieur à foindre. (Annay-sur-Serein). - (10) |
| foindre. : Se retirer par appréhension d'une difficulté ou d'un danger. Le latin fingere, qui signifie feindre, a reçu, comme on voit, de l'extension dans son dérivé. - (06) |
| foindu, diminué de volume. - (26) |
| foiné, ramasser le foin. - (16) |
| foineau : fenil. - (62) |
| foineau, fenil. - (05) |
| foineau, fouénau (n.m.) : fenil, grenier où l'on entasse le foin (de Chambure préfère foineau) - (50) |
| foineau, s. m. fenil, grenier où l'on entasse le foin. - (08) |
| foineau, s. m., fenil, grenier, grange où l'on rentre le foin : « Ol a couché dans l’foineau. » - (14) |
| foineau, s.m. fenil. - (38) |
| foinèche : se dit de l'herbe quand elle est haute - (44) |
| foiner, foinaison, fener, fenaison. - (05) |
| foiner, v. retourner le foin. - (38) |
| foiner, v. tr., couper lefoin. - (14) |
| foiner. v. a. Faner. (Ménades). - (10) |
| foineux, euse. s. m. et f. Faneur, euse. (Ménades). - (10) |
| foingne. s. m. Foin. (Accolay). - (10) |
| foingner. v. - Geindre. (Villiers-Saint-Benoît, selon M. Jossier). - (42) |
| foingner. v. n. Geindre. (Villiers Saint-Benoît). - (10) |
| foin-le-corps (A). Locut. adv. A bras le corps. J’ l’ai pris à foin-le-corps. - (10) |
| foinnaijan : Fenaison, temps de la récolte des foins. - (19) |
| foinné : Fenil, grenier à foin. - (19) |
| foinneau. s. m. Fenil, grenier à foin. (Coutarnoux). - (10) |
| foinner : Faner, retourner le foin pour le faire sécher. « Dépochins nos de foinner padant que le sola lut ». - (19) |
| foinô, s. m., fenil où on range le foin. - (40) |
| foinoû, s. f., faneur. - (14) |
| fointe, s. f. diminution, déchet, amoindrissement, rabais. S’emploie au figuré comme au propre. - (08) |
| fointe. Feinte, feintes. Feindre, feindre… - (01) |
| fointure. Feinte. Le mot fointure est burlesque, et l'on doit le passer à l'auteur pour une licence poétique. Le vrai et naïf bourguignon est fointe. - (01) |
| fôïon, fouïon, s. f. foison, abondance, grande quantité. - (08) |
| fôïon, s. f., foison, abondance : « Des peùrnes, des poires, des calas, j'en avons à foïon. » - (14) |
| fôïonner, fouïonner, v. n. foisonner, abonder. On dit de la chaux vive qu'elle « fôionne » lorsqu'on la met en fusion. - (08) |
| foirai. : Célébrer une fête. Foirai lai sain Jan (du latin feriari, rac. forum). On disait aussi : Foirai lai bone venue d'un aimin . - (06) |
| foiral, foirail : s. m., champ de foire. - (20) |
| foiray, célébrer. Foiray lai sain Jan, fêter la Saint-Jean ; du latin forum, concours de peuple. - (02) |
| foire des gourmands : loc, foire du Jeudi gras, à Mâcon. - (20) |
| foire, marché, dérive de feria ou de forum, place publique... Foireux se prononce foroux en patois. Lorsqu'un cortège de baptême traverse les rues du village sans jeter des draigies, les jeunes enfants courent après en lançant cette imprécation : Parrain, marraine, enfant : foroux ! (V. tire-pois.)... - (13) |
| foire. n. f. - Colique. Issu du latin foria, la foire désigna la diarrhée dès le XIIIe siècle. Le français ne l'emploie plus que dans le registre vulgaire, alors que le poyaudin a conservé le sens premier usité en ancien français. - (42) |
| foirés : Gens de la foire. « Qu'est-ce qu 'y est dan que tot ce mande que passe su la route? - Te sais dan pas qu'y est les bordes (le foire des bordes) y est tot des foirés ». - (19) |
| foirôle, fourôle (pour foirolle). s. f. Mercuriale annuelle, suivant Boireau.(Argenteuil, Vassy-sous-Pisy). — On dit à Laffon, foisaule. — Jaubert donne foirelle. - (10) |
| foirolle : plante mercuriale. - (33) |
| foirotte : s. f., foirande, foiroile, mercuriale annuelle. Voir bleuïasse. - (20) |
| foirou, fouirou (n.m.) : scops. Genre d'oiseaux rapaces où l'on distingue le scops européen, vulgairement appelé petit-duc - (50) |
| foiroux : s. m., individu qui va à la foire. Un train de foiroux. - (20) |
| foiroux, foirouse : adj., foireux, foireuse. - (20) |
| fois (des), loc. adv., parfois : « T'é si jantiie, vois-tu, qu'y a des fois que j't'embrasserò. » - (14) |
| fois : s. f., à des fois, vx tr. à la fois, parfois. - (20) |
| fois-de-corps. loc. - Se dit d'un arbre dont le tronc a été sectionné à mi-hauteur sous l'effet d'un choc, de la foudre ou de la tempête. (Sougères-en-Puisaye). Cette locution était déjà usitée à la Renaissance : faux-de-corps ou fois-de-corps (issue de faut, faillir, manquer) désignait la partie du corps au-dessous de la taille. - (42) |
| foisonner, v., abonder (en parlant de la vendange). - (40) |
| foissale, s. f. moule à fromage blanc. - (22) |
| foisse, en vieux français fouace ; du latin focum, parce qu'on faisait cuire sous la cendre du foyer ce pain mollet confectionné avec des jaunes d'œufs, auxquels on ajoutait de l'anis ou autres substances d'un goût agréable. - (02) |
| foisse. Fouace, sorte de pain blanc que les boulangers cuisent à Dijon la veille de Noël, et dont ils font un très grand débit, parce qu'il n'est pas jusqu'aux pauvres gens qui, à l'honneur de la fête, ne veuillent manger de la fouace. - (01) |
| foisse. : (Pat.), fouace (dial.), petit pain blanc anisé que l'on cuisait sous la cendre du foyer (en latin foculus). On lit dans Ducange fouhacea ; c'était la gourmandise de la veillée de Noël. - On appelait fouacier (dial. ), et foisset (pat.), le marchand pâtissier ou le boulanger (du latin focacius), qui fabriquaient ce genre de pâtisserie. Rabelais la considérait sans doute comme une friandise puisqu'il dit (liv. 1, ch. xi) que Gargantua mangeait sa fouace sans pain. - (06) |
| foiyâ, branche feuillée du foyard, c'est-à-dire du hêtre. - (16) |
| foiyance, faïence. - (16) |
| foiyar, hêtre. - (16) |
| Foiyen, Symphorien. - (16) |
| fôla, s. m. tourbillon d'air comme il s'en produit par les journées chaudes. - (24) |
| folard : foulard - (51) |
| fole. Folle, folles. - (01) |
| folet : tourbillon d'air par temps orageux - (51) |
| fôletô (prononcez feulteu), feu follet... - (02) |
| foletô. : Feu follet. Le mot du dialecte foleur, foleté, foleton a le même sens et semble venir du latin volaticum, régime de volaticus, signifiant volage, éphémère. - (06) |
| foli, v. s'évanouir, défaillir ; ol étot prôs à foli, il était prêt à. . . s'évanouir. - (38) |
| foligo. Folâtre. - (03) |
| foligot, adj. excentrique, follet. - (38) |
| foligot, adj., excentrique, anormal. - (40) |
| foligòt, adj., folâtre, folichon, d'humeur trop gaie : « Oh ! lap'tiote foligote ! all'ne fait qu'rire. » - (14) |
| folissot (i), ça a failli, ça a cédé. - (38) |
| fôlle (n.f.) : folle - (50) |
| folle, s. f., bonnet de forme légère et avenante que portaient naguère les jeunes filles, et qu'à tort elles remplacent maintenant par des coiffures plus « à la mode ». (V. Caline.) - (14) |
| follére, foulére, fouillére, fouyero. Feu en plein air ; se dit surtout des feux allumés sur les hauteurs le dimanche des brandons et le jour de la Saint-Jean. Etym. foyer, qui a fait foyère, fouyères et les autres formes. - (12) |
| follet : (nm) tourbillon estival - (35) |
| follet : tourbillon estival - (43) |
| follet : s. m., coup de vent. - (20) |
| follet, s. m. esprit malin qui, pendant la nuit, s'amuse à friser la crinière des chevaux. - (08) |
| follo. Poussière soulevée en tournoyant, par le vent. - (49) |
| folloir, v. intr., falloir, manquer : « Cor ein p'chô, ô gâgnôt ; i s'en é pas follu gros. » - (14) |
| follot - coup de vent. - I nos sons trouvai dan in follot que nos é couvri de poussére. - In follot s'â levai, et pu les jaivales en étai tote épairpillées. - En i é des follots que casseraint les brainches des âbres. - (18) |
| follot : Tourbillon de vent, sorte de cyclone. « I s'est élevé in follot qu'a tot écrapé neutés jevalles ». - Follet. « Du poi follot » : du poil follet. « In paure p'tiet ujau (oiseau) que n'a enco point de plieumes, ren que du poi follot ». - (19) |
| follot ou foullot. Tourbillon soudain et violent de vent. Etym. foulau, dans le vieux bourguignon, veut dire fou ; —follot vient évidemment de foulau, qu'on a pris peu à peu substantivement après avoir laissé le mot vent de côté. - (12) |
| follot, follet n.m. Tourbillon de vent. - (63) |
| folvielle (droit de) : droit de folvieil ou de folle vieille que percevait autrefois l’abbé de Maugouvert (voir ce mot) sur les veufs ou veuves qui se remariaient. - (20) |
| fombreyer : nettoyer une écurie - (60) |
| fomme (na) : femme - (57) |
| fômme, s. f., femme mariée, épouse. - (40) |
| fomme. s. f. Femme, par conversion de l’e en o. - (10) |
| fon, foin, sm. foin. - (17) |
| fon, profond. - (16) |
| fon. Fond, fundus ou fundum. Quelquefois fon signifie faisons, facimus, et font faciunt ; quelquefois les fonts baptismaux. - (01) |
| fonai : faner, secouer, écarter l'herbe à la fourche pour qu'elle sèche plus vite. On fono l'harbe verte : on fanait l'herbe verte. - (33) |
| fonâIlle, se dit des nigauds qui se plaisent innocemment dans la compagnie des femmes. - (38) |
| fonaison : fenaison - (48) |
| fonaison, s. f. époque où l'on fane le foin, où on le fait sécher en le remuant. - (08) |
| fonassa : mésange. - (33) |
| fonasse : herbes folles, mauvais foin - (48) |
| fonasse : herbe, avoine folle. La mauvage herbe c'éto de la fonasse : La mauvaise herbe c'était de la fonasse. - (33) |
| foncer, v. n. aller au fond, creuser profondément. S’emploie d'une manière absolue. Pour trouver la pierre, il faut « foncer » ; l'eau viendra quand vous aurez « foncé » davantage. - (08) |
| fonci : fabriquer un fond (de panier) - (51) |
| foncié, ère, adj. qui a du fond, dont la couche végétale est épaisse, profonde. Un terrain « foncié », une terre « foncière. » - (08) |
| fondériot. s. m. Très-petit vallon résultant d’un effondrement, d’un affaissement du sol. (Argenteuil). Du latin fundere. - (10) |
| fondie (pour fondis). s. f. Fondrière ; fossé large et profond. (Laduz). Du latin fundere. - (10) |
| fondrée : dépôt laissé par l'huile, ou un autre liquide, au fond d'un vase - (60) |
| fondrée : dépôt, lie - (48) |
| fondrée : dépôt, lie. Il y a de la fondrée dans mon verre : ol y a du dépôt dans mon verre. - (33) |
| fondrée : (fon:dré: - subst. f.) dépôt que laisse la décantation d'un liquide au fond d'un récipient (lie de vin, marc de café...).. - (45) |
| fondrée : n. f. Lie. - (53) |
| fondrée, n.f. dépôt (il y a plein de fondrée dans mon verre). - (65) |
| fondrée, s. f. terrain humide, marécageux. - (08) |
| fondrée, s. f., dépôt dans une bouteille ou une tasse. - (40) |
| fondrée, s. f., fond, résidu aussi bien de terrains que d'ustensiles : « J'sons descendus dans la fondrée du parc. » — « J'ai ramassé la fondrée de la marmite. » - (14) |
| fondrilles : dépôt laissé par l'huile, ou un autre liquide, au fond d'un vase (fondrée) - (60) |
| fondron, sm. grosse femme courte de taille. - (17) |
| fondrot - (39) |
| fone (o ouvert comme dans Simone) : femme. - (52) |
| fone : femme. L’homme est l’houme. - (62) |
| fone, fonne: femme - (48) |
| fone, s.f. femme. - (38) |
| foneau : fenil - (48) |
| fonei. : Enfourneur, boulanger. (A. P.) - (06) |
| foner : faner (faire les foins) - (48) |
| foner : faner, secouer, écarter l'herbe à la fourche pour qu'elle sèche plus vite. - (52) |
| foner, foiner, v. a. faner, remuer le foin pour le faire sécher. - (08) |
| fonessot, s. m. fauvette. On donne ce nom ou celui de « foinassat » aux petits oiseaux qui voltigent dans les herbes le long des haies vives. On les appelle encore pour le même motif des « trâne-bouchons », des traîne-buissons. - (08) |
| foneute, emplacement réservé sous le four pour mettre les cendres. - (27) |
| fongeant (papier), s. composé, papier buvard. - (14) |
| fongis. s. f. Écume, lie, résidus qui tombent au fond d’un vase. - (10) |
| fonne - femme. - Note gairson é pris ine fonne dans ine famille bein honnête.- Mai fonne n'entend pâ que nun chez no travaille le Dimoinge. - Ah ! ine bonne fonne ! c'â ine fortune dans lai mâillon. - (18) |
| fonne (n.f.) : femme - (50) |
| fonne : femme - (37) |
| fonne : femme - (39) |
| fonne : n. f. Femme. - (53) |
| fonne, femme - (36) |
| fonne, n. fém. ; femme, épouse ; la bonne fonne est l'accoucheuse. - (07) |
| fonne, s. f. femme. En plusieurs lieux « foune » : « al eume bin sai fon-ne. » - (08) |
| fonne, s. f., femme : « Y é pas lu qu'é méchant; y é sa fonne. » - (14) |
| fonnelòte, s. f., femmelette. - (14) |
| fonner : faner - (39) |
| fonnöt, sm. fourneau. - (17) |
| fonoû : faneur - (48) |
| fonou, foinou, ouse, s. m. et féminin faneur, faneuse, celui ou celle qui fane le foin. En quelques lieux « foineu ». - (08) |
| fontaine : lavoir couvert, sur un ruisseau, ou une rivière. De forme carrée ou rectangulaire, avec pierre à laver inclinée, de chaque côté de la grande longueur pour être dans le courant. Un espace derrière les emplacements de lavage permet de circuler avec la bérouette. - (58) |
| fontaingne, s. f. fontaine, source. - (08) |
| fontaîn-ne (na) : fontaine - (57) |
| fontâne, s. f., gros robinet de bois. - (40) |
| fonte. Grande marmite en fonte sans couvercle, dans laquelle on fait chauffer l'eau pour laver la vaisselle. - (49) |
| fontena, s. m. petite fontaine. - (24) |
| Fontenette, Fontenotte. Nom de lieu. - (08) |
| fontenî, s. m., terrain marécageux, entretenu par une quantité de petites sources. Givry a un lieudit les Fontenottes. - (14) |
| fonteni, source à marécage. - (05) |
| fonteni. Marais, terrain mouvant. - (03) |
| fontenò, s. m. petite fontaine. - (22) |
| fôôle : adj. f. et n. f. Folle. - (53) |
| for : (for - subst. m.) four à pain. Lorsqu'on veut parler du four de la cuisinière, on a soin de préciser : l' for du pouê:l'. - (45) |
| for : four - (48) |
| for à tsaux : four à chaux - (51) |
| for à tsaux n.m. Four à chaux. - (63) |
| fôr : four - (39) |
| fôr, fôrte adj. Fort, forte. - (63) |
| for, fotje, adj. fort, forte. - (17) |
| for, four. - (16) |
| fôr, s. m. four où l'on cuit le pain. Il faut chauffer « l'fôr » ; mon pain est au « fôr. » - (08) |
| fôr, s. m., four à pain. - (40) |
| fòr, s. m., four. (Pour la loc. : « Faire au four, » voir Cueùre.) - (14) |
| for. Forts, forts ; c'est aussi four, « le for dé Fée », nom qu'en langage du pays on donne à certaines cavernes percées naturellement dans une chaine de rochers sur le chemin de Dijon à Plombière ; en français le four, et non pas le fort des Fées. - (01) |
| foraîller : ferrailler, émettre des bruits métalliques - (37) |
| forailler: farfouiller, s'agiter, travailler le fer - (48) |
| forain-ne : adj. Foraine. - (53) |
| forandié, s. m. celui qui travaille le chanvre. - (08) |
| foras : (forâ: - adv.) dehors. - (45) |
| forat. adj. Très-touffu, qui ressemble à une forêt. (Etivey). - (10) |
| forbance. s. f. Bombance. (Rogny). - (10) |
| forbeute : sottise, filouterie. Lubie - (51) |
| forbir. : (Dial.), nettoyer, polir (de l'ancien haut allemand furban). [Burg.] - (06) |
| force (aine) : (une) fourche - (37) |
| force (n.f.) : fourche en bois - (50) |
| force : fourche. - (52) |
| force : adj., forcé. Y est ben force, c'est bien forcé. Y est ben force, quand on ne peut pas mieux faire. - (20) |
| forcé : branche en forme de fourche - (39) |
| force : fourche - (39) |
| forcé : part. passé, vin forcé, vin qui commence à aigrir. Il a un goût de forcé, ce vin. Il sent le forcé. - (20) |
| force. Il y a force, pour être forcé, est une locution très usitée : j'ai vendu mon champ, il y avait bien force, c’est à dire j'y étais bien forcé. - (08) |
| forcée : hernie. III, p. 19-1 - (23) |
| forcelot (faire le), faire la mariole, le vantard. - (38) |
| forceôle : Effort, foulure. « Qu'est-ce que t'as dan que t'as la main anvoillie (enveloppée) ? - Oh y est eune forceôle, i me gêne pu que ma borse ! ». - (19) |
| forcer (n.m.) : fourche aux dents en métal - (50) |
| forcer (se), v. pron. se donner une courbature, se faire mal aux reins par un effort. - (08) |
| forceure : entorse, foulure. - (33) |
| forçeure n.f. Conséquence d'un effort musculaire, déchirure musculaire, tour de reins, entorse. - (63) |
| forceure, s. f. courbature, mal qu'on se fait à la suite d'un effort excessif. - (08) |
| fôrchatte, s. f., fourchette. - (40) |
| forchaucer. : (Dial.), chasser, écarter avec le pied (rac. lat., foris etcalcare). - (06) |
| forche (na) : fourche - (57) |
| forche (na) : trident - (57) |
| forché : branche fourchue (parfois utilisée pour soutenir une branche très chargée de fruits) - (48) |
| forche : fourche - (48) |
| forche : Fourche. « Ol a cassé le mange de sa forche ». - (19) |
| forche : fourche. Durant le remembrement local, le correspondant varnois du Courrier avait écrit que les rebelles au bornage devraient passer sous les « Forches Caudines ». [Épreuve historiquement nécessaire, difficile et humiliante]. - (62) |
| forche : une fourche - (46) |
| forche : (forch' - subst. f.) fourche. - (45) |
| forche : n. f. Fourche. - (53) |
| forche : s. f. fourche. - (21) |
| forche, forchatte, s.f. fourche de bois, fourchette. - (38) |
| forche, fourche ; forchë, ce que l'on prend d'une fois avec une forche. - (16) |
| forche, s. f. fourche, instrument qui sert à divers usages. « Fource. » - (08) |
| fôrche, s. f., fourche en bois, pour le foin. - (40) |
| fòrche, s. f., fourche, à dents en bois ou en fer. - (14) |
| forché, s. m. fourche ordinairement en fer qui est employée pour enlever le fumier. C’est une espèce de trident qui a été appelé, suivant les lieux, forchat, fourchât, fourchel, fourchier, fourcher. - (08) |
| forche, sf. fourche. - (17) |
| forche. Fourche, bois fourchu servant de gibet. - (01) |
| fôrchée : n. f. Contenue d'une fourche. - (53) |
| forchée, forchie : fourchée - (48) |
| forchée, forchie : petit tas de foin. Le foin éto en petit tas d'une forchée. - (33) |
| forcheillou : Difficile à articuler. « In mot forcheillou », un mot qui fait fourcher la langue. - (19) |
| forchète, fourchette (petite fourche) ; forchetë, ce que l'on prend avec une fourchette. - (16) |
| fòrchéte, s. f., fourchette. - (14) |
| forchetée, s. f. petite fourchée de foin, de paille, etc., une pleine fourchette. - (08) |
| forchette : fourchette - (48) |
| forchette : Fourchette. « Alle a fait rétamer ses forchettes ». Il n'y a pas très longtemps qu'à la campagne on connaît les couverts de ruolz ou de métal blanc, naguère on n'avait que des cuillères et des fourchettes de fer qu'on faisait étamer tous les ans par l'étameur (le méguin) quelques jours avant la fête du pays. - (19) |
| forchette : fourchette - (39) |
| forchette, s. f. fourchette, diminutif de forche. « Forcette. » - (08) |
| forchiat (na) : fourchée - (57) |
| forchie : (forchi: - subst. f.) amas de foin qu'on formait avec la fourche : pendant la fenaison, on disposait dans les prés des forchies à intervalles réguliers, pour que le char et son équipage viennent les ramasser, comme on fait actuellement avec des bottes. - (45) |
| forchie, s. f. amas de foin qu'on forme avec la fourche. Mettre le foin « en forchies », c'est le disposer en petits tas sur la prairie pour en hâter la dessiccation ou pour le défendre de la pluie. - (08) |
| forchillan : Dent de fourche. « Eune forche à tras forchillans ». - (19) |
| forch'lot : dans un chariot, partie du train arrière qui porte la mécanique du frein. - (33) |
| forcholle : faisselle. - (52) |
| forchon (on) : fourche (très grande à 2 dents) - (57) |
| forchon : mot masculin désignant une petite fourche - (46) |
| forç-hon, fourche de fer. - (05) |
| forchou, ouse, adj. fourchu, qui a la forme d'une fourche. - (08) |
| fòrchu, adj., fourchu. - (14) |
| forci : Forcer. « An est bin forci d'être honnête ! », on fait cette réflexion lorsque quelqu'un remplit un devoir auquel il lui a été impossible de se soustraire. - (19) |
| forcian : Fourche à long manche « Ta forche est treu corte, prend dan le forcian ». - (19) |
| forcie (forcire) : fougère - (39) |
| forcie : fougère. - (52) |
| forcie : petit tas de foin - (39) |
| forcie, forcire (n.f.) : fougère - (50) |
| forcieu, euse, adj. qui a de la force, de la fécondité, une certaine puissance de production : une terre « forcieuse », un pré « forcieu », c’est à dire une terre riche et fertile, un pré qui pousse vigoureusement. - (08) |
| forcir : grossir - (48) |
| forcir : grossir, prendre du poids. - (52) |
| forcir : grossir, prendre du poids. Quand on meuge trop on forcit : quand on mange trop on grossit. - (33) |
| forçon : fourche en fer. - (31) |
| fòrçon, s. m., fourche en fera deux pointes. (V. Bident.) - (14) |
| forçon, s.m. fourche de fer. - (38) |
| forçure : s. f., vx fr. forcerie, lésion produite par un effort, spécialement la hernie. - (20) |
| forçure, forçue, forcée. n. f. - Entorse. - (42) |
| forçure. Courbature, fatigue causée par un effort violent ou trop prolongé. - (12) |
| forçure. s. f. Foulure. - (10) |
| fordzeron : forgeron - (51) |
| fordzi v. Forger. - (63) |
| fordzi : (vb) forger - (35) |
| fore : four - (51) |
| foré : (forè - adj.) très solide, renforcé, blindé. C'est ainsi qu'on appelle ch'mi forè la voie romaine qui va d' Autun à Saulieu et traverse la commune de Liernais de part en part. - (45) |
| fore, sf. foire (marché). - (17) |
| fòre. Fourre, fourrent : « Ai se fòre an tô leû », il se fourre, ou ils se fourrent en tout lieu… - (01) |
| forea. Fourreau. - (01) |
| forer : (forè - v. trans.) ferrer un animal. Forè œn treu: "ferrer une truie" ; opération qui consiste à fixer dans le grouin de la truie une sorte de mouchette qui l'empêche de fouir. - (45) |
| fôrer : introduire dans, mettre - (39) |
| fòrer, v. tr., fourrer, introduire de force. - (14) |
| forget : s. m., vx fr. forgiet, bénitier portatif en usage dans les cérémonies religieuses. - (20) |
| forgi : Forger. « A fôrce de forgi an devint forgeran ». - (19) |
| forgnat (nom masculin) : jeune oiseau qui vient de quitter le nid. Enfant chétif. - (47) |
| forgnat : oiseau prêt à sortir du nid - (60) |
| forgneau. s. m. Fourneau. (Chigy). - (10) |
| forgner : quitter le nid - (60) |
| forgon. Outil en fer destiné à remuer le feu d'une forge ou d'un foyer. On dit en Bourgogne : ce qui vint de lai polle (pelle) retorne au forgon. C'est l'équivalent de « ce qui vient de la flûte retourne au tambour. » Au figuré, forgonner est s'agiter inutilement et mettre tout sens dessus dessous. - (13) |
| forgoné le feu, le remuer inutilement. - (16) |
| forgoner, remuer le feu. - (27) |
| forgounner : 1. remuer le feu pour l'attiser ; 2. remuer bruyamment avec un bâton : grand-mère forgounnait sous le lit pour en chasser le chat ; 3. gronder vivement, quand on est en colère. - (52) |
| forjet : dépassant du toit. - (21) |
| formaige. : Fromage. - Le patois transpose souvent ainsi la lettre r, tantôt la rapprochant, tantôt l'éloignant par une sorte d'euphonie.- En langage familier, laissai allai le chai au formaige c'était succomber à une tentation. - (06) |
| forme (le) : gîte du lièvre - (43) |
| fôrme n.f. Forme, gîte du lièvre. - (63) |
| forme : s. f., bourgeon à fruit. - (20) |
| forme : s. m., gîte du lièvre. Un forme de lièvre. - (20) |
| forme, n.f. gîte du lièvre. - (65) |
| forme, s. f., gîte du lièvre. - (40) |
| former : v. n., produire des formes. Par c'te chaleur, la vigne forme bien. - (20) |
| fòrmi, s. f., fourmi. (V . Fremi.) - (14) |
| forna : Passer au four « Je vas forna man treuqui (maïs) pa fare des gaudes ». - (19) |
| fornaie : fourneau de charbonnier , emplacement où a été fait le charbon - (48) |
| fornaige. s. f. Fournaise. (Athie). - (10) |
| fornaille, fornai, s.m. fourneau. - (38) |
| fornailli : faire griller le maïs au four - dérivé de for = four. - (21) |
| fornaillon : oiseau sortant du nid. A - B - (41) |
| fornaleau, petit fourneau de charbon. - (05) |
| fornasse (n. f.) : grosse pierre - (64) |
| fòrnayer, v. a. griller au four à pain. - (24) |
| fornaÿi : (vb) passer au four - (35) |
| fornayi, fornayer : passer au four - (43) |
| fornayon : oiseau sortant du nid - (34) |
| fornayon : oiseau sortant du nid - (44) |
| forné : Fournil, petite construction où est le four. « Porte dan voir in fageut de bouis seu le famé ». - (19) |
| fornë, fournée de pain. - (16) |
| fornée : fournée (de pain). - (52) |
| fornée : fournée - (48) |
| fornée : Fournée, ce qu'on fait cuire en une fois dans un four. « Eune forme de chorlattes » une fournée de gâteaux à la courge. Au figuré : « Eune bonne fornée de nage » une abondante chute de neige. - (19) |
| fornée : sac blanc de coton d'une contenance de 90 kg de blé, dans lequel on ramenait la farine - (43) |
| fornée : fournée de pain mise à cuire dans le four. On f'to une fornée tous les dix jours : on faisait une fournée tous les dix jours. - (33) |
| fôrnée : n. f. Fournée. - (53) |
| fornée, s. f. fournée, quantité de pain cuite à la fois : « i va qu'ri mai fornée », je vais chercher ma fournée. - (08) |
| fòrnée, s. f., fournée, ce que le boulanger met de pâte pour emplir son four. - (14) |
| fornée. Fournée. Quantité de pains, cuisant à la fois dans le four. - (49) |
| fornège : quantité de pain nécessaire à la panification d'une journée. - (33) |
| fornége, s. m. bouillie composée d'un mélange d'avoine et de blé noir ou sarrasin. - (08) |
| forneller, fourneller. Quitter le nid, en parlant des oiseaux. Fig. Quitter la maison sans laisser d'adresse, se sauver. - (49) |
| fornellon, fournellon. Jeune oiseau qui vient de quitter son nid. - (49) |
| fôrner : fournier. petite construction attenante à la maison dans laquelle, entre autres, existe le four familial dans lequel on cuit le pain de ménage (et les jours de fête la brioche) - (37) |
| forner, fournier. Fournil, local où se trouve le four. - (49) |
| forni : (nm) fournil, chambre à four - (35) |
| forni : fournil - (43) |
| fornî n.m. Fournil. - (63) |
| fôrni : n. m. Fournil. - (53) |
| fòrni, s. f., fournil, endroit où se trouve le four. - (14) |
| fòrni, v. tr., fournir, livrer. - (14) |
| forniau : chaudron où l'on prépare l'alimentation des cochons - (51) |
| forniau : fourneau - (43) |
| forniau : fourneau ; ensemble en fonte composé d'un foyer (à bois) sur pieds surmonté d'une cuve mobile, de 80 à 100 litres, servant à faire cuire les pommes de terre pour les animaux. - (52) |
| forniau : fourneau, four à chaux - (34) |
| forniau : Fourneau, foyer. « Le forniau de l'alambic ». - (19) |
| forniau n.m. Fourneau. - (63) |
| fòrniau, s. m., fourneau, portatif ou à demeure. - (14) |
| fornicoter : draguer - (44) |
| fornié, s. m. fournil, lieu où se trouve le four et où l'on fait le pain. - (08) |
| fornieau, de charbon. - (05) |
| fòrnier, s. m., fournier, le maître d'un four, boulanger. - (14) |
| forniô : fourneau, four à chaux. A - B - (41) |
| fornio. Fourneau de charbonnier. Feu de mauvaises herbes dans les champs. - (49) |
| fornisse. Fournisse, fournissent. - (01) |
| fornne : femme. - (32) |
| fornoige, fornouaille, s. f. fournaise, brasier. Usité dans quelques localités seulement. Dans une partie du Morvan, on prononce « fournauge », comme « vaudauge » pour vaudoise, araignée. (Voir : vaudouaille.) - (08) |
| fornoiller (v.t.) : se dit du ciel lorsqu'il se couvre de nuages et prépare un changement de temps - (50) |
| fornoiller, v. n. se dit du ciel lorsqu'il se couvre de nuages, lorsqu'il s'obscurcit et prépare un changement de temps. - (08) |
| fornotte (n.f.) : partie du four à pain où se trouvait la cendre - (50) |
| fornotte (nom masculin) : petit four. - (47) |
| fornotte : cavité dans la cheminée pour mettre la braise et la cendre retirées du four - (48) |
| fornotte : (fornot' - subst. f.) cavité pratiquée dans une des parois intérieures de la cheminée, et destinée à recueillir les cendres de l'âtre en prévision de la "bue". - (45) |
| fornotte : petit réduit sous le four pour mettre les cendres - (39) |
| fornotte, s. f. cavité ménagée dessous la gueule du four pour recevoir les cendres ; petit four. - (08) |
| fornouage : petite cavité dans l'âtre de la cheminée où se mettait la braise retirée du feu ou du four à pain. - (33) |
| fornouailler : verbe utilisé pour parler d'un temps changeant - (39) |
| foro : mécanique bruyante - (37) |
| foron, feuron : s m., trou pratiqué dans un mur. - (20) |
| forot : personne très active (sens souvent péjoratif) - (48) |
| forot : fer pour ferrer les cochon, insulte à l'adresse d'une personne - (39) |
| forot : n. f. Personne dur à la tâche. - (53) |
| fôroté : v. t. Faire et ne rien faire. - (53) |
| forrâdze n.m. Fourrage. - (63) |
| forradzère : fourragère - (51) |
| forrage : Fourrage. « La lizarne (luzerne) est in ban forrage ». - (19) |
| forrai. Fourrer, faire entrer : Se forrai, se fourrer, se faire passage ; c'est aussi fourrer, garnir de fourrure une étoffe : Forrai sai robe, fourrer sa robe. - (01) |
| forre. Fourre : « Le pu devo forre son prepoin de malice », le plus dévot fourre son pourpoint de malice ; le plus dévot en apparence est en effet le plus malin… - (01) |
| forré. Fourrez, impératif de fourrer : Forré ce coquin an prison, fourrez ce coquin en prison ; forrez-y sai côqueigne de fanne qui ne vau pa meù que lu, fourrez-y sa coquine de femme qui ne vaut pas mieux que lui. - (01) |
| forrer : ferrer - (48) |
| fôrrer : Fourrer. « Queva ce que te t'es bin fôrré pa te sali de la sôrte ? ». - (19) |
| forrer : ferrer - (39) |
| forrer, v. a. ferrer, garnir de fer, ferrer un cheval, un bœuf. - (08) |
| forrer, v. fourrer. - (38) |
| forrer. v. a. Ferrer. (Domecy-sur-le-Vault, Guillon, Avallonnais en général). - (10) |
| forreue. s. f. Ferrure. (Ménades). - (10) |
| forrot (n.m.) : sorte de peigne à chanvre - (50) |
| forrot, s. m. instrument dont se servent les tisserands pour préparer le chanvre. (Voir : forandié.) - (08) |
| forsener. : (Latin foras· et sensus), extravaguer, être hors de sens (dial.) ; on trouve aussi au même dialecte le substantif forsennerie . - (06) |
| forson ; la forche est en bois, tandis que le forson est en fer. - (16) |
| fortai, fortou - peigner le chanvre, celui qui le peigne. - I vâs portai note chenôve fortai ai Bouhey. - No, i l'ons envie ces jors derrei à père Lili ; c'â in bein bon fortou et pu al â dans le pays. - (18) |
| fortce : fourche à 4 dents pour curer les écuries - (43) |
| fortcés : foin mis en tas pour le protéger de l'orage - (43) |
| fortci (le) : fourche à 3 dents, en fer ou en bois - (43) |
| forter (v.t.) : frotter, peigner le chanvre - (50) |
| forter et feurter. Nettoyer le chanvre teïllé avec un gros peigne de bois. Les fortoux, autrefois ferteurs, battent le chanvre ; ils nettoient, peignent et flambent jusqu'à ce que les débris ligneux aient disparu ; après quoi on forme les poupées. (V. ce mot.)... Les fortoux du Morvan et de l’Auxois venaient exercer leur industrie dans la côte de Beaune : ils avaient à Autun, dans l'église Saint Jean-Baptiste, une confrérie qui était sous le vocable de la Présentation de la Sainte- Vierge. - (13) |
| forter, v. ; carder le chanvre. - (07) |
| forter, v. a. frotter, peigner le chanvre pour en tirer la filasse. Aux environ de Lormes et ailleurs, « fréter, froter. » - (08) |
| forteuné, adj. celui qui a un bon bien, riche. On prononce souvent « forteugné ». - (08) |
| forteune, s. f. fortune, richesse. - (08) |
| forteùne, s. f., fortune, biens : « Oh! j'ons pas compté d'avou lu ; ma ôl a d'la forteùne. » - (14) |
| forteux : frotteur. IV, p. 15-1 - (23) |
| fortieux, forcieux. adj. - Fort, vigoureux. - (42) |
| fortieux, forcieux. adj. - Riche, fertile, en parlant de la terre. - (42) |
| fortieux, forgieux. adj. Qui a de la force. Ç’ t’enfant-là n’est pas forcieux. ( Villeneuve-les-Genêts). — Terre forcieuse, terre féconde, qui abonde en blé, en fourrage. - (10) |
| fortôler : (vb) cuire à la poêle, fricasser - (35) |
| fortot, ote, adj. celui qui prend de la force, qui se fortifie. Ce garçon est « fortot », cette fille est « fortote. » - (08) |
| fortou, n. masc. ; cardeur de chanvre. - (07) |
| fortou, s. m. celui qui peigne ou frotte le chanvre. - (08) |
| fortse : petite fourche. A - B - (41) |
| fortse : (nf) fourche - (35) |
| fortse à deux pûs n.f. Fourche servant au déplacement des fagots de bois. - (63) |
| fortse n.f. Fourche à 4 ou 5 dents. - (63) |
| fortsette : fourchette - (51) |
| fortsette n.f. 1.Fourchette. 2. Herbe à lapins. - (63) |
| fortsi : grande fourche. A - B - (41) |
| fortsi : (nm) fourche à long manche et à trois dents - (35) |
| fortsi : fourche - (51) |
| fortsi : grande fourche - (34) |
| fortsi n.m. Fourche à 3 dents et à long manche. - (63) |
| fortsie : fourchée - (51) |
| fortsie n.f. Fourchée. - (63) |
| fortssette : fourchette - (43) |
| fortune de M.de Tavannes. Fortune jadis proverbiale des Saulx-Tavannes, qui a servi de terme de comparaison pour désigner une fortune colossale. - (12) |
| fortune : s. m. Enfant de fortune, enfant du hasard. - (20) |
| forvié (être) : être perdu. (RDR. T III) - A - (25) |
| forvié : v. t. Abasourdir. - (53) |
| forvier (se), s'égarer ; l'ancien français forvoyer était moins près du latin foras viœ. - (04) |
| forvier, v. n. fourvoyer, égarer, mettre hors du bon chemin : il a été longtemps en route parce qu'il a « forvié. » - (08) |
| forze. s. f. Forge. (Ménades). Par conversion du g en z. - (10) |
| forzer. v. a. Forger. (Ménades). Par conversion du g en z. - (10) |
| foson*, s: m. rapprochement avec effusion de deux amoureux (plaisant). - (22) |
| fossat, s. m. haie sèche, clôture de bois entrelacé. - (08) |
| fossayer ou fossoyer un lit. Le border. Le vieux mot fossoyer voulait dire clore par des fossés. - (12) |
| fôssé, petit morceau de bois aigu à sa partie inférieure, avec lequel on ferme un trou fait dans un fût, avec la vrille. Ce mot dérive du latin fossus (de fodere, creuser, percer) et convient mieux au trou que bouche le fôssé qu'au fôssé lui-même. - (16) |
| fosse. s. f. Provin. Faire des fosses, faire des provins. (Serrigny). — C’est le contenant pour le contenu. - (10) |
| fosser : tresser une haie - (48) |
| fosser : (fosè - v. tr.) tresser, entrelacer. - (45) |
| fosser. v. n. Provigner. (Chassignelles). Du latin fossare, creuser, faire des fosses, notamment celles destinées à la culture de la vigne. C’est le mot consacré. - (10) |
| fosseyeux n.m. Fossoyeur. - (63) |
| fosseyeux. Fossoyeur. - (49) |
| fôssoiyé, faire des fosses pour y coucher la vigne et la multiplier. - (16) |
| fosson, fousson : s. m, vx fr. fosson, fourche, fourchet. - (20) |
| fossonner, foussonner : v. a., remuer à l'aide d'une fourche ou d'un fourchet. - (20) |
| fôssou, fëssou, instrument à manche très incliné, servant à cultiver la vigne. - (16) |
| fossou. Sorte de pioche ; synonyme de bacelon. - (03) |
| fot-an-gueule. Fort ou forts en gueule, qui a, ou qui ont la voix forte. - (01) |
| fot-bal : n. m. Football. - (53) |
| fôte, besoin ; el è fôte, il a besoin, il n'a pas le nécessaire à la vie. - (16) |
| fote, forte. - (27) |
| fôté, tomber en faute. - (16) |
| foté-paule. Nom du lutin. Ce qu'est le Moine-bourru à Paris, la Malobestio à Toulouse, le Mulet Odet à Orléans, le Loup-garou à Blois, le roi Hugon à Tours, Forte-épaule l’est à Dijon ; ici foté-paule est mis pour le diable. - (01) |
| fotépaule. : Forte épaule, lutin, diable. - (06) |
| foteu, enfant déjà fort. - (27) |
| foteùgne. Fortune. De foteùgne, par hasard, heureusement. - (01) |
| fôtiau : Foyard, hêtre (fagus sylvatica). « Le fôtiau de Navoie » C'était un hêtre gigantesque qu'on voyait encore il y a une quarantaine d'années (donc vers 1860) dans la forêt de Mancey. Il servait d'abri et de rendez-vous aux chasseurs Il fut abbatu en pleine vigueur comme bois d'affouage et vendu à un sabotier ! - (19) |
| fou (nom masculin) : hêtre. - (47) |
| fou : adj., chien fou, chien enragé. - (20) |
| fou, foûle, adj. fou, folle : « ço eune fonne foule », c'est une femme folle. - (08) |
| fou, fouteau, foutel, hêtre, fouel. - (04) |
| fou, s. m. hêtre. - (08) |
| foua : fouet - (51) |
| fouâ : fouet, martinet - (43) |
| fouâ n.m. Fouet. - (63) |
| fouace. Vieux mot français encore usité en Bourgogne. C'était une sorte de galette cuite sous la cendre... Dans notre région, on faisait des fouaces Je jour de Noël. En souvenir de cet ancien usage, le pain bénit distribué aux fidèles à la messe de ce jour était mélangé d'anis verts. Cet usage a cessé, dans notre ville de Beaune, depuis une cinquantaine d'années... Les pains jaunes, confectionnés à Autun pour les grandes fêtes et notamment pour la Saint Ladre, ne sont autre chose que des fouaces : on les fabrique avec de la pâte sans levain, des anis verts et du safran. - (13) |
| fouacer, fouâcher, fouasser. v. a. Faucher. (Domecy-sur-le-Vault, Ménades). - (10) |
| fouachai : faucher. On fouache évant de foner : on fauche avant de faner. - (33) |
| fouâchai et fouâchaillon – faucher, fauchaison. - Lai fouâchaillon aipruche ; ile premet d'éte chaude. - En fau absolument du vin es fouâchoux. - Le Batisse fouâcho mieux en i é in an ; à n'â pu jeune. - (18) |
| fouachaison : n. f. Fenaison. - (53) |
| fouâchè : v. t. Faucher. - (53) |
| fouâcher : faucher - (48) |
| fouâcher, v. a. faucher, abattre l'herbe avec la faux qu'on appelle dard dans le pays. « fouaicer. » - (08) |
| fouâcheuse : n. f. Faucheuse. - (53) |
| fouâchi'illon : fauchaison - (48) |
| fouâchïon, s. f. fauchaison, le temps où l'on fauche les prés. « fouâcïon. » - (08) |
| fouachison : action ou période de fenaison. - (33) |
| fouâchiyon : fenaison. (E. T IV) - S&L - (25) |
| fouâchoû : faucheur - (48) |
| fouâchou. s. m. faucheur, celui qui fauche. « Fouaiceu. » - (08) |
| fouacijon, fouassijon. s. f. Fauchaison. (Ménades). - (10) |
| fouai (na) : foi - (57) |
| fouaî (on) : foie - (57) |
| fouai s (n.f.) : fois - das fouais = parfois - (50) |
| fouai : n. f. Fois. - (53) |
| fouaice, sf: fouace. Pain grossier, galette de basse qualité. - (17) |
| fouaïer, v., fouetter par punition. - (40) |
| fouaige. Ce mot a deux acceptions. 1- Tiges de plantes destinées à être brûlées. Des fouaiges de turquis, de haricots, de pois, de pommes de terre. On rapplique même aux feuilles de raves et de choux. C'est le synonyme de cheillas (V. ce mot.) 2 - Fouaige ou affouaige, en français affouage : droit de prendre du bois dans une forêt pour l’usage de sa maison : portion de bois attribuée à chaque ménage dans les coupes communales. À rapprocher du verbe « raffourer, » employé par les Picards dans le sens de donner la nourriture aux bestiaux. - (13) |
| fouaiges, fanes de pommes de terre. - (28) |
| fouaillard, foyard : n. m. Hêtre. - (53) |
| fouaille : baguette très flexible. A - B - (41) |
| fouaille (satte): fine baguette de bois souple qui servait d'instruments de correction - (51) |
| fouaille : baguette souple - (44) |
| fouaille : bâton très flexible - (34) |
| fouâille : faible, fatigué, affamé - (48) |
| fouaille : Rameau sans feuilles dont on se sert pour cingler un enfant. D'où le verbe fouailler, frapper avec une fouaille. - (19) |
| fouâillé : v. t. Fouetter, frapper. - (53) |
| fouaille. adj. Faible, sans force. (Givry). — Dans l’Auxerrois, on entend par fouaille, s. m., un petit propriétaire, un vigneron qui, ne trouvant pas à vendre dans son pays le vin de sa récolte, prend le parti de le conduire lui-même par bateau sur le port de Bercy, où, après s’être fait tirailler, fouailler par l’un, par l’autre, il est assez souvent forcé de s’en défaire à un prix plus ou moins désavantageux. De là les locutions, aller en fouaille, vin de fouaille, et aussi les verbes fouailler, se faire fouailler, qui ont pour synonymes étriller, se faire étriller. - (10) |
| fouâillée : fessée, rossée - (48) |
| fouaillée : fessée. O l’ai reeçu une boune fouaillée : il a reçu une bonne fessée, triquée. - (33) |
| fouâillée : n. f. Fessée. - (53) |
| fouailler : fesser. - (31) |
| fouailler : Fouetter avec une fouaille. - (19) |
| fouâiller : fouetter, fesser, rosser - (48) |
| fouailler : fouetter. Ex : "Si té monte dans l'âbe, té vas t'fée fouailler par ton pée, ma gamine !" - (58) |
| fouailler. v. – Foudroyer : « L'Rémi, il a fouaillé l'yeuve du prémier coup ! Il'tait au moins à cent mètes ! » (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| fouailli (satter) : taper avec une fouaille (fine baguette de bois souple) - (51) |
| fouâilli v. Fouetter. - (63) |
| fouâillie n.f. Correction. - (63) |
| foûaillot : oiseau tiercelet, petit oiseau de proie. Le fouaillot vole les poules : le triercelet vole les poules. - (33) |
| fouaillot, s. m. tiercelet, oiseau de proie. - (08) |
| fouaillou : branchu - (51) |
| fouaillou, adj. ce terme n'est guère usité que dans la locution « vent fouaillou », pour désigner un vent qui souffle de l'orient et vous fouette la figure d'une pluie fine et froide. - (08) |
| fouaillou, fouaillot (n.m.) : vent, souffle de l'orient qui fouette la figure d'une pluie fine et froide - (50) |
| fouainaiç’e : herbe à foin courte - (37) |
| fouainaicherot, fauvette, nom tiré de la fouainaiche avec laquelle cet oiseau construit son nid. - (11) |
| fouainassot : petit oiseau - (39) |
| fouainè : v. t. Faner. - (53) |
| fouainer : faner, faire les foins - (37) |
| fouainô, fouanô, fnô : n. f. Planche à foin. - (53) |
| fouaire (n.f.) : foire - (50) |
| fouaîre (na) : foire - (57) |
| fouaire : foire - (43) |
| fouairée : n. f. Forêt. - (53) |
| fouaîrer : foirer - (57) |
| fouaîreux : foireux - (57) |
| fouais (na) - coup (on) : fois - (57) |
| fouaison : foison - (57) |
| fouaisonner (fâre) : augmenter la consistance - (37) |
| fouaisser : faucher - (39) |
| fouaisser, fouêcer (v.) : faucher - (50) |
| fouaissillon (n.f.) : fauchaison (de Chambure écrit fouâchïon) - (50) |
| fouaissillon : fauchaison - (39) |
| fouaissou : faucheur - (39) |
| fouâllye, s. f. rameau sec et feuillu qu'on a enflammé et qui brûle rapidement. Verbe : fouailli. - (22) |
| fouanaiche, fouanesse : n. f. Herbe sèche. - (53) |
| fouanèche, pleu. Pâturin des prés. - (49) |
| fouaner, fouenner. Faner. - (49) |
| fouaner, v., faire les, foins. - (40) |
| fouaquai : frapper, fouetter. La pluie fouaque les vitres : la pluie fouette les vitres. - (33) |
| fouârce (na) : force - (57) |
| fouârte : forte - (57) |
| fouascine : Fascine - Brindilles de bois. - (19) |
| fouasse. s. f. Voyez fouée. - (10) |
| fouasseux. s. m. Faucheur. - (10) |
| fouât (on) : fort - (57) |
| fouât : fort - (57) |
| fouat : Fouet « Le fouat du charretier ». - Fessée. « Si te te couge pas (si tu ne te tais pas) ta mère va te fout' le fouat ». - (19) |
| fouat, s.m. fouet ; fouatter, v. fouetter. - (38) |
| fouat. Fouet. - (49) |
| fouater : jeter, se débarrasser de quelqu'un. A - B - (41) |
| fouater : jeter - (51) |
| fouàter, v. tr., fouetter, les fesses et la crème. - (14) |
| fouatter : balancer, se débarrasser de quelqu'un - (34) |
| fouatter : Fouetter. « Allons hue ! fouatte cocher ! ». « O rogit c'ment in cu fouatté ». - (19) |
| fouatter. Fouetter. - (49) |
| fouäye : (nf) baguette ; verge - (35) |
| fouâyer : frapper avec une trique - (39) |
| fouäyi : (vb) fouetter - (35) |
| foua-yi : fouetter - (43) |
| foubraique, braique : détraqué, simple d’esprit - (37) |
| foucade : toquade, petite folie, caprice passager. - (33) |
| foucade. n. f. - Toquade, caprice, folie. Néologisme formé sur la réunion de « fou » et « toquade ». - (42) |
| foucade. s. f. Flot, chute, survenance de gens nombreux qu’on n’attend pas. — Faire une chose par foucades, s’y mettre à l’improviste, brusquement, vivement, par intermittences, et puis cesser, l’abandonner de même, tout à coup. — Avoir des foucades, être pris de caprices, de vouloirs plus ou moins violents, excentriques, mais qui ne durent pas. — D’une foucade. Locut. adv. D’un seul coup. - (10) |
| foucara. adj. - Fou-fou, violent, excité. - (42) |
| foucaral : tête brûlée, foutraque - (60) |
| foucarat. adj . Fou, bruyant, dissipé ; brutal, violent. — Substantivement, signifie étourdi, écervelé. Jaubert donne foucaral dans le même sens. - (10) |
| fouchale, s. f., passoire à fromage blanc, faisselle. - (40) |
| fouchalle : faisselle, cerce - (48) |
| fouchalle, fouchelle, s. f. faisselle, vase en poterie et percé de trous dans lequel on met égoutter les fromages. « feurcholle. » - (08) |
| foûche. s. f. Force. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| fouchée, foucheue. s. f. Fougères. (Ménades). - (10) |
| fouchelle : égouttoir. - (32) |
| fouchelle : n. f. Faisselle. - (53) |
| fouchelle, cope. Faisselle : moule à fromage percé de trous pour laisser écouler le petit lait. - (49) |
| fouchelle, fouchalle, fechalle : s. f., fr. féchelle (Littré) et faisselle (Nouv. Larousse illustré), syn. d'écuetle (moule à fromage). - (20) |
| fouchére : fougère - (48) |
| fouchére, s. f. fougère. - (08) |
| fouchetons (pour fourchetons). s. m. pl. Mancherons de la charrue, dont l’assemblage forme une espèce de fourche. - (10) |
| fouchie : fougère. Les fouchies sont isolante : Les fougères sont isolantes. - (33) |
| fouchiyon : fauchaison, fenaison. (RDC. T III) - A - (25) |
| fouciller, border un lit avec les draps et les couvertures. - (27) |
| fouçon, s. m., fourche en fer pour les gerbes. - (40) |
| foudre, tempête, vent impétueux. - (05) |
| foudri, abondance, tas de choses. Dans l'idiome breton, founder (Le Gon.) signifie une grande quantité de. - (02) |
| foudri. Tas, foule, assemblage confus, parce que la foudre, quand elle tombe, entraine et entasse pêle-mêle tout ce qu'elle rencontre. Ainsi un foudri c’est un grand nombre accompagné de tumulte, et c'est pour exprimer cette idée qu'on dit à Dijon : « En veci tan que lai foudre », ou « en veci un foudr »i. - (01) |
| foudri. :Tas, foule, multitude, confusion, parce que, dit Delmasse, la foudre entraîne et entasse tout. A la place de ce philologue, j'eusse préf »ré l'étymologie de foudre dans son acception toute bourguignonne qui siguitie tonne de forte capacité et contenant une grande quantité, un foudre de vin. Le mot foudre, dans ce sens-là, vient de l'allemand fuder qui siguifie tonneau. - (06) |
| foudzaire : fougère - (43) |
| foudzère : fougère - (51) |
| foudzire : (nf) fougère - (35) |
| foudzîre n.f. Fougère. - (63) |
| fouè : foi - (48) |
| fouê : fois - (48) |
| foué : n. f. Foi. - (53) |
| foué, s. f. foi, croyance religieuse : « lai foué keûrtiéne », la foi chrétienne; « mai foué » ! ma foi ! - (08) |
| foué. n. f. - Foi, fois, foie. « On croit à ren, on n'a pus d'foué, j'voyons déjà la différence et j'les r'grett'rons, p't'êtr' pus d'eune foué. » (Fernand Clas, p.l96) - (42) |
| foué. n. m. - Foie. - (42) |
| foué. s. m . Foyer. Du latin focus. - (10) |
| fouêcer (v.t.) : faucher - (50) |
| fouèchale : (fouèchal' - subst. m.) faisselle, forme à fromage. - (45) |
| fouèchèfe. s. m. Fauchage. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| fouéçû (n.m.) : faucheur - (50) |
| fouée : diarrhée. - (33) |
| fouée, fouère. n. f. - Foire. - (42) |
| fouée, fougée. s. f. Galette cuite à la flamme d’un four. (Soucy). Du bas latin focata. — C’est la fouace de Rabelais. - (10) |
| fouéger, fouger. s. m. Foyer. Du latin focus, focarius. - (10) |
| fouè'illair : hêtre, foyard - (48) |
| fouèillard : (fouèyêr - subst. m.) hêtre. - (45) |
| foueiller, v. intr., ployer, fléchir. Se dit surtout de la glace trop faible pour porter ceux qui sont dessus, et qui va craquer : « Oh ! j'vons pas glisser par iqui ; y é trop mince, y foueille. » - (14) |
| fouel : foyard, hêtre - (37) |
| fouël : hêtre - (60) |
| fouël, hêtre - (36) |
| fouel, s. m. hêtre. Environ de Château-Chinon. - (08) |
| fouelle : hêtres(P. T IV) - Y - (25) |
| fouelle, foualle (n.m.) : hêtre (haut-Morvan) - (50) |
| fouelle. n. f. - Hêtre. - (42) |
| fouénâgeon. s. f. Fenaison. (Domecy-sur-le-Vault). - (10) |
| fouénaller. v. n. Se dit des moutons quand, dans les grandes chaleurs, ils se serrent les uns contre les autres, le nez à terre, de telle sorte que le berger a peine à les faire avancer. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| fouène : Fruit du hêtre. « J'ai ramassé de la fouène seu le fôtiau ». - (19) |
| fouèné : fenil. - (21) |
| foueneau : fenil. - (31) |
| fouéneau : grenier à foin. III, p. 31-r - (23) |
| fouèner : v. faner. - (21) |
| fouèner : (fouènè - v. intr.) 1 - faner, procéder aux travaux de la fenaison. 2- (v. intr. et impersonnel) faner, sécher (en parlant du foin) - (45) |
| fouènese : (fouènès' - subst. f.) nom collectif des graminées parasites. - (45) |
| fouènesse : herbe folle. - (52) |
| fouéniyon (n.f.) : fenaison - (50) |
| fouéolle (n. f.) : chénopode ou ansérine, plante herbacée commune dans les cultures - (64) |
| fouère : (nf) foire - (35) |
| fouère : foire - (48) |
| fouère : foire. - (52) |
| fouère : foire. Les fouères sont plus rares : Les foires sont plus rares. - (33) |
| fouére : (foué:r' - subst. f.) diarrhée, foire. - (45) |
| fouère : foire, diarrhée - (39) |
| fouère : n. f. Foire, marcher de bestiaux, fêtes. - (53) |
| fouère, s. f. diarrhée. Verbe fouèrer. - (24) |
| fouére, s. f. marché public. - (08) |
| fouère, s. f., foire, apport, marché : « Y é d'main la fouère ; y veinras-tu ? » - (14) |
| fouère, s. f., foire. - (40) |
| Fouére. Foire. - (49) |
| fouérer - (39) |
| fouèrer : avoir la diarrhée - (48) |
| fouèrer : foirer, rater - (48) |
| fouérien (pour foiriain). s. m. et adj. Forain. Les marchands fouérens. - (10) |
| fouèrou : foireux - (48) |
| fouérou : personne qui va à la foire - (39) |
| fouérou, s. m. foireux, celui qui va au marché public, à la foire. - (08) |
| fouertou, ouvrier spécialiste qui peignait le chanvre. - (27) |
| fouéson. Foison. - (49) |
| fouésonner. Foisonner. - (49) |
| fouèsser : faucher. - (52) |
| fouesses - pains ou gâteaux que les parrains et les marraines donnent à leurs filleuls, le jour de Noël, comme étrennes. - Voiqui que beintôt en beilleré les fouesses. - C'â que, mouai, i ai deux fillots, et, bein entendu, en me faut deux fouesses. - (18) |
| fouettai (et se) - jeter, se jeter (outre le sens ordinaire). - Ma ! fouette-mouai don cequi ai lai porte. - A côrot trop vite, et pu a s'â bramant fouetai en bas, qu'a s'â fait encore aissez mau ! - C'est une variante de foute. - (18) |
| fouèyard (n.m.) : hêtre (sud-Morvan) - (50) |
| foufraille : adj. Tout fou, exalté. - (53) |
| foufraye, adjectif qualificatif : étourdi, instable, hyperactif. - (54) |
| fougaler (s') (v. pr.) : se hâter, se précipiter (il est pas fougalé (il n'est pas bousculé, il a du temps à perdre)) - (64) |
| fougaler : pourchasser. (P. T IV) - Y - (25) |
| fougaler : courir après quelqu'un ou un animal pour l'effaroucher. Ex : "Té vas pas fini' d'fougaler les poules ?" - (58) |
| fougaler, v. a. pourchasser, poursuivre, mettre en fuite. - (08) |
| fougaler. v. - Malmener, effaroucher, pourchasser. « Va don' voué l'chien, il est en train d 'fougaler les poules ! » - (42) |
| fougaler. v. a. Gronder, malmener, pourchasser. (Etais, Perreuse). – A Sainpuits, effaroucher. - (10) |
| fougaleux (n. m.) : (fougaleux d'couisses (vagabond)) - (64) |
| fougassé, vt. dissiper ses provisions. - (17) |
| fouge, s. f. fougère. - (24) |
| fougé, s. m. foyer de cheminée. - (08) |
| fougener : Foisonner. « Fare fougener » : ménager, faire durer. « Je vas te donner in bout de lâ (un morceau de lard), fâ le bien fougener, y est tot ce que t'aras ave tan pain ». - (19) |
| fougeon (n. m.) : groin du porc, du sanglier - (64) |
| fougeonner (v. int.) : fouiller ou creuser le sol avec son nez, en parlant du porc, de la taupe, ... - (64) |
| fouger (v. int.) : fouiller ou creuser le sol avec son nez, en parlant du porc, de la taupe, ... - (64) |
| fouger. v. - Creuser le sol, à la manière du sanglier, du porc, ou de la taupe. - (42) |
| fouger. v. a. Fouiller la terre à la manière de la taupe, du porc, du sanglier. (l'erreuse). Du latin fodicare. - (10) |
| fougére : fougère - (48) |
| foug'gue. s. f. Fouillée. (Perreuse). - (10) |
| fougner, refuser, renoncer. - (05) |
| fougouni, fougini. n. m. - Désordre, fouillis. Autre sens : labour mal exécuté. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| fouigné, manquer de courage pour faire une chose qui paraît difficile. - (16) |
| fouigner. v. a. Feindre. (Vassy-sousPisy). Du latin fingere. - (10) |
| fouigner. v. n. Faire la moue. (Vassysous-Pisy). - (10) |
| fouillasserie. n. f. - Désordre. (Sommecaise, selon M. Jossier) - (42) |
| fouillasserie. s. f. Confusion d'objets de nature diverse mêlés en désordre les uns dans les autres. (Sommecaise). - (10) |
| fouillat. s. m. Terrain labouré, fouillé par les cochons. - (10) |
| fouilleau, petite scie. - (05) |
| fouille-merde. s. m. Scarabée pilulaire, proscarabée de fumier. - (10) |
| fouillener, v., faire abonder. - (40) |
| fouilli - r'veûilli : fouiller - (57) |
| fouillon, s. m. homme sans soin, qui met tout en désordre, sens dessus dessous. - (08) |
| fouillon, s. m., individu sans ordre et sans soins, qui dérange tout. - (14) |
| fouillon. s. m. et f. Homme ou femme sans soin, qui laisse tout en desordre. - (10) |
| fouillonner, v. a. mettre en désordre, bouleverser. - (08) |
| fouillonner. v. - Fouiller. - (42) |
| fouillou (on) : fouilleur - (57) |
| fouillu, feuilli. - (05) |
| fouin : Fouine. « Ol a tué in fouin ». Vieux français, fouin, mâle de la fouine. - (19) |
| fouin : s. m., vx fr., fouine et plus spécialement le mâle. Tousser comme un fouïn, tousser beaucoup. Il est à remarquer que le fouin ne tousse pas plus que le putois ne crie. - (20) |
| fouin, s. m. fouine. - (24) |
| fouin, s. m. grosse belette, fouine : « l'fouin minge tô lé p'sins », la fouine mange tous les poussins. - (08) |
| fouinâ (on) : fouinard - (57) |
| fouinâ : Fouinard, qui met son nez partout, s'occupe des affaires des autres sans en avoir l'air. - (19) |
| fouinai, se glisser en tapinois, s'esquiver comme une fouine. - (02) |
| fouinai. : Se glisser, disparaître en tapinois comme la fouine. « Tu é pô (peur) tu fouine. » (Del.). - (06) |
| fouinard. s. m. Celui qui fait la fouine, qui aime à rôder, à épier le gibier, à espionner ce que les autres font et disent. (Sommecaise). - (10) |
| fouinasser : v. n., fouiner, espionner, se mêler des affaires d'autrui. - (20) |
| fouinasses : brumes. (P. T IV) - Y - (25) |
| fouinasseur : s. m., qui fouinasse. - (20) |
| fouinat. Malin, débrouillard. - (49) |
| fouiné, vn. se dit du feu qui commence à s'allumer, de la flamme mêlée de fumée. - (17) |
| fouîner (s’) : (se) cacher, (se) blottir dans les bras de sa maman - (37) |
| fouiner (verbe) : chercher avec insistance en faisant quelquefois preuve d'indiscrétion. - (47) |
| fouîner : rechercher, « fourrer son nez » partout - (37) |
| fouîner â touailes (s’), (s’) feûrrer â touailes : (se) coucher au lit - (37) |
| fouiner, faner - (36) |
| fouiner, v. intr., fuir comme une fouine, s'esquiver, décamper : « L'sans-cœur ! quand les autres s'batteint, ôl a fouiné. » - (14) |
| fouiner, v. n. faire des concessions, reculer, avoir peur. - (08) |
| fouiner. Chercher. Se dit d'un malin qui cherche, fouille partout : « au fouine pertot ». - (49) |
| fouiner. v. n. Rôder comme une fouine, être sans cesse à l'affût du gibier, ou de ce que font et disent les autres. (Sommecaise). A Perreuse, se dit des enfants qui vagabondent, qui font l'ecole buissonnière. - (10) |
| fouin-ne, fouenne. Faine. - (49) |
| fouinoux, adj., qui cherche de façon indiscrète et dérangeante. - (40) |
| fouirasse : la diarrhée - (46) |
| fouire : diarrhée. A - B - (41) |
| fouire : colique. Fouiroux : sujet aux coliques, à la diarrhée. « Chat du mois d’août : chat fouiroux !» - (62) |
| fouirè : couler - ça fouire, ça ne tient pas - (46) |
| fouire : diarrhée - (34) |
| fouïre : diarrhée - (43) |
| fouire : diarrhée - (44) |
| fouire : diarrhée - (51) |
| fouîre : diarrhée, flux - (37) |
| fouire : Foire, diarrhée. « Si te mije des raijins à la rosée t'es seur d'avoi la fouire ». Vieux français, foire, diarrhée ; foirier, avoir la diarrhée. - (19) |
| fouire : la colique - (46) |
| fouire n.f. Diarrhée. - (63) |
| fouire, fouirer, diarrhée. - (05) |
| fouire, n.f. colique. - (65) |
| fouire, sf. foire (diarrhée). - (17) |
| fouire. s. f. Foire, diarrhée. (Rugny). - (10) |
| fouirou : petit hibou. Animal affaibli par la diarrhée. A - B - (41) |
| fouirou : petit hibou - (34) |
| fouirou : quelqu'un de pas clair, radin - un parrain fouirou, un parrain avare - (46) |
| fouirou : quelqu'un qui a la diarrhée - (46) |
| fouirou : voir chavan - (23) |
| fouirou ; parrain fouirou, disent les enfants à un parrain qui ne leur jette pas assez de bonbons. - (16) |
| fouirou n.m. Petit hibou. - (63) |
| fouiroux (parrain) : nom dont les gamins gratifiaient les parrains qui jetaient parcimonieusement des dragées et des sous. - (30) |
| fouîroux : celui qui a la diarrhée, peureux - (37) |
| fouiroux : Féminin fouirouse. Celui qui à la diarrhée. « Ce p'tiet est tot fouiroux ! ». - (19) |
| fouiser, v. a. fouiller, remuer en cherchant, en creusant. Les porcs, les sangliers « fouissent » la terre, le sable. - (08) |
| foujau (n.m.) : fuseau (aussi feûyau) - (50) |
| foulaire ou fouleire. : Feu d'artifice. En dialecte, fouleir, comme si l'on avait voulu dire le feu en l'air. - (06) |
| foulâtre, s. m. extravagant, lunatique. - (08) |
| foûle : folle - (48) |
| foûle : folle. El-l'ot complètement foûle : elle est complètement folle. - (52) |
| foùle. adj. Folle. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| foule. n. f. – Folle : « La poure femme alle est d'venue brâment foule ! » - (42) |
| fouleire et fôlaire, feu d'artifice (feu en l'air)... - (02) |
| fouleire. Feu d'artifice, et généralement tout feu allumé plus clair et plus grand qu'à l'ordinaire… - (01) |
| fouler : Marcher. « Prends garde de fouler dans la borbe ». - « Fouler su de la mauvase harbe » s'égarer. - (19) |
| foùler, v. n. marcher sur quelqu'un ; ou sur quelque chose en y commettant des dégâts : tu me foules sur les pieds ; il ne veut pas qu'on foule dans son jardin. - (24) |
| foulère, feu de joie qu'on allumait autrefois le premier dimanche de Carême. - (27) |
| foulerie, s. f. folie, extravagance. - (08) |
| foùlerie. s. f. Folie. (Ibid.). - (10) |
| fouleu (de nouage) : flocon (de neige). (REP T IV) - D - (25) |
| fouleur : foulure, entorse. - (33) |
| fouleûre : foulure - (48) |
| foulie, s. f. folie, extravagance, déraison. - (08) |
| fouligan. s. f. Petile fille peu soumise et n'aimant qu'à courir. (Etivey). - (10) |
| fouligot, folâtre. - (05) |
| foulise (n.f.) : tourbillon de vent ; tempête tourbillonnante (aussi foulot, folot) - (50) |
| foulise, s. f. tourbillon de vent, ouragan, tempête. - (08) |
| foûlle (na) : folle - (57) |
| foulle : folle. Elle o complètement foulle : elle est complètement folle. Se dit des humains et des bêtes. - (33) |
| foulo (on) : tourbillon (petite tornade) - (57) |
| foulo, tourbillon de poussière soulevée par un vent tournant. On dit poi foulo, pour le poil follet des petits oiseaux au nid et foulo d'noije, pour : flocon de neige. - (16) |
| foulo. Coup de vent. On dit d'une tête exaltée qu'elle « a son foulo ». - (03) |
| fouloir : s. m., pressoir à vis horizontale, connu sous le nom de « pressoir châtillonnais » - (20) |
| foulöre, sf. fumée d'un fourneau de chiendent, après les hersages. - (17) |
| foulot (n.m.) : petit tourbillon de vent (a.fr., folot = petit soufflet) - (50) |
| foulot : follet. Tourbillon d’été qui démolit les tas de foin. Fugitif et léger. Qualifie les premiers poils au menton. - (62) |
| foulot, s. m. petit tourbillon qui s'élève tout à coup lorsque l'air est tranquille. - (08) |
| foulòt, s. m., tourbillon de poussière, coup de vent, bourrasque. Au figuré, exaltation du cerveau : « Y é v'nu ein foulòt, je n'pouvò pu me t'ni su la levée. » - (14) |
| foulot, s. m., vent violent qui fait tourbillonner la poussière et les feuilles ; annonce l'orage. - (40) |
| foulot, s.m. tourbillon de vent qui disperse dans l'air la poussière mêlée à des débris de toutes sortes. - (38) |
| foulot, tourbillon de vent. - (05) |
| foulotte, se dit en parlant d'une terre fine "une terre foulotte". - (38) |
| fouloué. n. m. - Fouloir. - (42) |
| foultöt, sm. follet, toqué. adj. : pô foultöt, poil follet. - (17) |
| fouluiot, noix ou noisette percée d'un trou de ver "une noix fouluiotte" - (38) |
| fouoiblliesse, fouoibllir, faiblesse. - (05) |
| fouorche : fourche. (B. T IV) - D - (25) |
| fouot : n. m. Fouet - (53) |
| fouot, s. m. fouet. Diminutif de fou, hêtre. (Voir : fou.) - (08) |
| fouot, s.m. four. - (38) |
| fouquiotte. s. f. Faîne, fruit du fouquiot, du foutiau, du fouteau, du hêtre. Du latin fagus. (Merry-la- Vallée). - (10) |
| fouragner, foragner, feuragner : v. n.. lat. foraginare, fourrager, fureter ; aller et venir, s'agiter. Voir frenouiller. - (20) |
| fourbi, s. m. amas confus de choses, matériaux ou débris de construction, d'habillement, etc. - (08) |
| fourbiller : chercher dans un certain désordre. (S. T III) - D - (25) |
| fource. s. f. Fourche. (Menades). - (10) |
| fourche à feu, fourchette à feu : s. f., petite fourche en fer servant à grabotter le feu. Le manche de cet instrument, long de moins d'un mètre, était ordinairement fait d'un vieux canon de fusil, à l'aide duquel on pouvait souffler aussi le feu. Voir grappe et grappin. - (20) |
| fourche, forche, s. f. embranchement de deux ou plusieurs chemins, point où ils se croisent. - (08) |
| fourchée, s. f., tas de foin que l'on amasse dans les prés au temps de la fauchaison. Le terrier de la seigneurie de Lucenay-l'Evêque, rédigé en 1460, emploie fourchée comme mesure agraire pour évaluer une certaine étendue de pré : « six fourchées de foing, en l'estimation de demye soiture de prey. » - (11) |
| fourcher, forcher. Fourche en fer à deux ou trois pointes : « pûcs ». - (49) |
| fourchet. s. m. Fourche à deux dents, de longueur inégale. (Villiers-Saint-Benoit). - (10) |
| fourchine. n. f. - Petite fourche en bois servant à tendre les peaux de lapin. - (42) |
| fourchon. n. m. - Petite fourche à trois dents. - (42) |
| fourchot. s. m. Fougère ; ainsi appelée à Parly, sans doute à cause de la disposition de ses feuilles. - (10) |
| fourch'tu, fourchetu. adj. Qui a la forme d'une fourche. (Sommecaise). - (10) |
| fourch'tu. adj. - Fourchu. - (42) |
| fourcie, forcie : fougère - (36) |
| fouré, placer sans précaution un objet, par exemple, dans un meuble. S'fouré dans un embarras ; dans une assemblée de personnes sans honneur ; s'fouré le doigt dans l'oeil. - (16) |
| fourège, fourrage. - (16) |
| fourègé, fourrager, piétiner une récolte et en dérober une partie. - (16) |
| fourérou (ouse) : (fouèrou -ouz' - adj .) foireux, brenneux. - (45) |
| fourgonner, v. gratter fortement. - (65) |
| fourillonner. v. a. Chiffonner, friper. (Saint-Florentin). - (10) |
| fourme, s. f. forme, avec la plupart de significations française. Ne s'emploie guère que pour exprimer la manière dont une chose est traitée ou réglée : « l’contrat ô été mettu en fourme », le contrat a été mis en règle. - (08) |
| fourmer, v. a. former, produire, faire, opérer : « fourmer » eune demande, eune plainte. - (08) |
| fournat. s. m. Endroit où l'on met les cendres retirées du foyer. (Bessy). - (10) |
| fournàyé, v. a. griller dans le four à pain. - (22) |
| fournayer, fornayer, v. a., vx fr. fornier, cuire au four, passer au four. - (20) |
| fourneau : fourneau pour la cuisson des pommes de terre pour la pâtée - (48) |
| fournia : fourneau. (B. T IV) - D - (25) |
| fourniat (na) - forniat (na) : fournée - (57) |
| fourniau : fourneau. Ensemble composé d'un foyer (à bois) sur pattes surmonté d'une cuve métallique mobile (80 à 100 litres) servant à faire cuire les pommes de terre pour les animaux. - (33) |
| fourniau. n. m. - Cuisinière à bois. - (42) |
| fournichon : garçon meunier. - (30) |
| fournichoux. m. Fournisseur. (Vassysous-Pisy). - (10) |
| fournieau (on) - fornieau (on) : fourneau - (57) |
| fournier (n.m.) : fournil - (50) |
| fournier : fournil. - (59) |
| fournouâge. s. f. Fournaise. - (10) |
| fournouilleu, s. m. individu qui s'habille à la mode, personne fringante. - (08) |
| fourou, adj. foireux. - (17) |
| fouroux, adj., foireux, drouillou. - (40) |
| fourquéte, et frouquéte, s. f., sorte de petite barque de pêche, dont l'arrière est façonné en pointe. (V. Barquòt, Arloquin.) - (14) |
| fourquette : voir farquette. - (20) |
| fourragére : emplacement où l'on jette le foin du fenil - (48) |
| fourraige, délit de pâturage. - (05) |
| foûrraizer : fourrager, rechercher - (37) |
| fourreau, fourriau. s. m. Robe. (Fléys). - (10) |
| fourrer, v. ; mettre, placer. - (07) |
| fourriere, vache qui fourrage. - (05) |
| fourte ! interj., dehors ! « Fourte ! va-t-en ! sors ! » Nous est resté des invasions. - (14) |
| foussé : fossé. - (62) |
| foussé : fossé. - (33) |
| foussé : fossé. On prononce : fouuu-sé. - (58) |
| foussé : n. m. Fossé. - (53) |
| foussé, s. m. fossé. - (08) |
| foussé, s. m., fossé : « Ol a tant bouévu chopine, qu'ôl a chu dans l’foussé. » - (14) |
| fousse. n. f. - Fosse. - (42) |
| foussé. n. m. - Fossé. - (42) |
| fousser. v. - Fausser. - (42) |
| fousserage, s. m., premier coup de pioche à la vigne, au printemps. - (40) |
| foûsses : s. f. ciseaux. - (21) |
| foussi, vt. border, engager une couverture sous le matelas. - (17) |
| foussir, border le lit. - (26) |
| fousson. s. m. Celui qui cache, qui enfouit des objets qu'il veut dérober aux regards. (Villiers-Saint-Benoit). - (10) |
| foussonner. v. - Enfouir, cacher, dissimuler. (Villiers-Saint-Benoît, selon M. Jossier) - (42) |
| foussonner. v. a. Cacher, enfouir, entener des objets pour dérober aux regards. (Villiers-Samt- Benoît). - (10) |
| foussouer. v. n. Fossoyer. (Vassysous-Pisy). - (10) |
| foutchau : futaie, surtout de hêtres et de foyards - (34) |
| foutcho : futaie, essentiellement de foyards*. A - B - (41) |
| foutchot. n. m. - Fou-fou, pas malin. - (42) |
| foute et foutre - mot de mauvais ton, de bas étage, et néammoins fort employé, qui veut dire jeter, chasser, dédaigner, mettre, donner. - Fou mouai to ce qui diôre. - Dépouâche tai de foute le feu ai ce' tas d'épeunes. – Oh ! voué, i lli fouterai ine raclée qu'a mérite. - Ma, qui c'a que m'é foutu cequi ? - Foutez-mouai le camp ! - Les personnes convenables disent fiche, fichai… Voyez donc ces mots, et puis fouettai. Et d'ailleurs foutu, qui a diverses variantes de sens. - (18) |
| foute le fu : mettre le feu - (51) |
| foute v. Jeter, poser, foutre. - (63) |
| fouteau, et foutiau. (Voir Foyard, et Fau.) - (14) |
| fouteau, foutiau, fouquiau. s. m. Hêtre. Synonyme de fouteau. - (10) |
| foutéchi : Saboter, faire mal un travail « Y est foutéchi ! » on dirait aussi dans le même sens « foutimasser » : « Y est foutimassé ». - (19) |
| foutiau (n.m.) : hêtre (Nivernais) - (50) |
| foutiau, foyard : hêtre - (43) |
| foutiau, s. m. hêtre. - (08) |
| foutimacé, ie, adj. indisposé. - (17) |
| foutimasser, v. intr., s'occupcr à des riens, agir comme un imbécile, faire quelque chose avec nonchalance. - (14) |
| foutre : Donner, lancer avec violence. « Attends voir je va te foutre in paillan » : attends un peu je vais te donner un giffle. – Mettre. « Je savais pas qua mentre su ma reube c'ment garniture, j’y ai foutu du velours ». (Authentique). - Perdu. « Cras tu qu'ol est bien malède ? –Oh ! ol est foutu ». - (19) |
| foutre, foute. Donner : « foute un coup de pid », « foute in-ne pile » ; se moquer « au se fout de moi » ; chasser, mettre dehors « le foutre è lè pôrte » ; mépriser, s'en moquer, s'en désintéresser : « je m'en fous » ; perdu « mon coutchau est foutu » ; il ne s'en sauvera pas, il va mourir « aul est bin mélède, aul est foutu » ; se heurter, se cogner « au s'est foutu lè té te contre le mur » ; tomber à terre « au s'est foutu lè nez par terre » ; laissez-moi tranquille « fous-mé lè paix » ; mal construit, mal habillé, mal fait « aul est foutu c'ment personne » ; complètement, en entier « y est un foutu bête » ; jeter « foutre en l'air » ; envoyer au diable « va te faire fout'e » ; mal constitué, bossu, impotent, fatigué « être mal foutu » ; faire « que fous-tu là » ; un « Jean-Foutre » est un personnage peu intéressant. - (49) |
| foutreau : s. m., jeu de cartes dans lequel on « fout » au perdant des coups de cartes sur le bout des doigts. « Un coquin à figure patibulaire tenait les cartes à une partie de foutreau, noble jeu qui est un dérivé de la bouillotte. » (P. Féval, La Vampire). - (20) |
| foutriquet. s. m. Petit homme frétillant, taquin, hargneux. - (10) |
| foutro. Sorte de jeux de cartes. - (03) |
| foutrôt, s. m., jeu de cartes. Au figuré, chose légère, peu consistante. - (14) |
| foutu - participe du verbe foute, que les personnes bien élevées remplacent familièrement par fichu. Voyez donc ce mot. D'autre part signifie décidément, sans espoir. - C'a foutu, quoi ! i n'en veinrai pâ ai bout ! - A souffre de pu en pu ; oh! al â foutu… - (18) |
| foutu, part, passé. Perdu, flambé, miné, jeté, lancé. - (08) |
| fouzire (n.f.) : fougère - (50) |
| fouzire, fouizire, s. f. fougère. (Voir : fouchére.) - (08) |
| fouzîres : fougères - (37) |
| föyâ : (nm) hêtre - (35) |
| foyar, hêtre. - (26) |
| foyard : hêtre. A - B - (41) |
| foyard (Chal., Br., Y.). - Hêtre, de fagus. On dit aussi fouteau, foutiau, futeau, d'où futaie. - (15) |
| foyard (du) : hêtre - (57) |
| foyard (n..m.) : hêtre (aussi foutiau) - (50) |
| foyard : hêtre - (34) |
| foyard : hêtre (français) - (51) |
| foyard : hêtre. - (09) |
| foyard : hêtre. - (66) |
| foyard : hêtre. Le fayard méridional. - (62) |
| foyard et fayard, s. m., hêtre. Des sabots de foyard. C'est, avec le bouleau, un des arbres que les sabotiers mettent le plus à contribution. On a dit fouteau et foutiau. - (14) |
| foyard Hêtre. Lamonnoye dit qu'on a désigné autrefois cet arbre par les mots : Fou, foteau, fouteau, fau, fauteau, fayant et fayard ; du latin fagus. - (03) |
| fôyârd n.m. Hêtre. - (63) |
| foyard, foutchau. Hêtre. - (49) |
| foyard, n.m. hêtre. - (65) |
| foyard, s. m., hêtre. - (40) |
| foyard, subst. masculin : hêtre. - (54) |
| foyasse : s. f.. foyer ; syn. aussi de foyère dans sa troisième acception. - (20) |
| foyère : Taque de cheminée. « J'ai troué eune veille foyère qu'est greu brave, y est demage qu'aile est fendue ». - (19) |
| foyère : s. f.. taque de cheminée ; dalle de pierre, ou de marbre placée en avant de la cheminée ; foyer élevé au-dessus du niveau du sol et dont la plaque centrale n'est supportée qu'à ses deux extrémités, de manière à laisser au-dessous d'elle un espace vide comme un four. - (20) |
| föyesse : (nf) âtre ; foyer - (35) |
| fo-yesse : âtre, foyer - (43) |
| foyo, falloir (dans l'expression, è vé—). - (26) |
| fôyon (n.f.) : foison - (50) |
| fôyonner (v.) : foisonner - (50) |
| frâ : Froisser les raisins avec les mains et les tasser dans la benne. « In râ (une benne de vendange) bien frâ fa eune fillette de vin ». - Frayer, se fréquenter « I ant biau ête voisins i ne voulant pas frâ ensin » : bien qu'ils soient voisins ils ne veulent pas frayer ensemble. Vieux français, feai, action de briser. - (19) |
| frâ : garniture du flan à la semoule, de la tarte - (48) |
| frâ : ce qui est sur la croûte de la tarte, en principe de la semoule. Une tarte au fra : une tarte à la semoule. - (33) |
| frâ : (frâ: - subst. m.) couverture friande d' une tarte ou d'une tartine (compote, semoule, confiture...). - (45) |
| frâ, frâche, adj., frais, fraîche. - (14) |
| frâ, frô : adj. Frais. - (53) |
| fra. adj. - Se dit d'un bois sec, cassant, sans souplesse. - (42) |
| fra. Garniture, dessus de la tarte. - (49) |
| frabot : petit morceau de bois qui s'effrite - (51) |
| fracassi : fracasser - (57) |
| frâchai - briser, rompre, déchirer. - Note charrue â étai tôt frâchée. - Ces molaidroits, al ant frâchai les painés de venoinges. - L'orle de tai robe â tote frâchée ; ci fait voué des pendrillons. - (18) |
| frachai, briser; en latin frangere... On dit aussi frezai et freusai, et le mot frachun a le même sens que celui plus moderne de fraisil ou frasil, poussière de charbon. (Forges du Châtillonnais.) ... - (02) |
| fraché (ā), vt. briser, mettre en morceaux. - (17) |
| frâche (d’la) : branches (d'un arbre à abattre) - (57) |
| frâche : branchage de chêne. - (31) |
| frâche : L'ensemble des branches et des rameaux d'un arbre « Ce châgne (chêne) a bien de la frâche ». - (19) |
| frâche : ramure (d’arbre). Voir défrâchî : élaguer. Vient du bas latin fracta : branchages. - (62) |
| frâche : s. f. brindilles, petit bois. - (21) |
| frache : s. f., bas-lat. frasca, ramée ; chevasse. Voir bronde et fretal. - (20) |
| frâché, détériorer, par exemple un vêtement, en le déchirant. - (16) |
| frâche, n.f. ramure de l'arbre. - (65) |
| frâche, s. m., grosses branches au-dessus de la couronne d'un fût d'arbre. - (40) |
| frâche, s.f. tige aérienne de la pomme de terre. - (38) |
| fracher, casser, briser. - (28) |
| frâcher, détériorer, salir. - (27) |
| frâches, s. f. pl., tiges aériennes des pommes de terre. - (40) |
| frâches, s. f., tiges de plantes : frâches de pommes de terre, de betteraves, etc. Branchettes entourant les jârons et complétant le fagot. Les fagots de frâches sont des fagots de branches d'arbres. - (14) |
| frâchœur : n. f. Fraicheur. - (53) |
| frachon (ā), sm. morceau de bois cassé. - (17) |
| fracule. s. f. Culot, dernier né d'une nichée de petits. (Percey). - (10) |
| frad : Féminin frade. Froid. « Alle est malède, aile a pris frad. Les nés (nuits) santfrades ». - (19) |
| fradi : Froidir, refroidir. « Quand les sordats (soldats) fiant l'exarcice l'hivé leu canan de feusi les i fradi bien les das ». - L'enfant en soufflant sur sa soupe trop chaude dit : « fradis, fradis, mère y a dit ». - (19) |
| frâer, frâser, frâsser (se). v. - Se glisser doucement, se mouvoir avec un léger bruit : « T'as-ti entendu la couleuve ? A vient d'fraer dans la bouchue. » On employait fraier ou froier en ancien français du XIIe siècle (du latin fricare, frotter). Ce verbe signifia frotter, puis frapper, briser. C'est le premier sens qu'a retenu le poyaudin, avec l'idée de frottement, alors que le français évoluait en frayer. - (42) |
| fraer, fraser. v. n. Passer, glisser avec un léger bruissement dans les feuilles. J' crè qu' cè é sarpent qu'a fraé t't' à l'heue dans la bouchue, je crois que c'est un serpent qui a passé tout à l'heure en bruissant légèrement dans la bouchure. (Perreuse). Doit être une altération de frayer, donnée par Roquefort dans le même sens. - (10) |
| fragile : adj., frêle, délicat; sensible, douloureux au toucher. Cet enfant est bien fragile, — J'ai mal là ; quand j'y presse, c'est fragile. - (20) |
| frâgne - frêne. - Le frâgne, c'â in bon bô ; i en plianterai dans l'haie vive du Pontot. - Lai feuillée de frâgne serai aibondante ceute année qui pour les bêtes. – Aivou le frâgne en fait de jolis meubles, queman d'aivou l'oriaule. - (18) |
| frâgne (Chal., Br., Y.). - Frêne, on dit aussi cbâgne pour chêne, etc. Toutefois le mot frâgne se rapproche davantage du latin : fraxinus. - (15) |
| frâgne (n.m.) : frêne - (50) |
| frâgne : (nm) frêne - (35) |
| frâgne : frêne - (37) |
| frâgne : frêne - (43) |
| frâgne : frêne - (51) |
| frâgne : Frêne (fraxinus excelsior) « Eune parche de frâgne ». - (19) |
| frâgne : frêne - (48) |
| frâgne : frêne. - (52) |
| frâgne : frêne. Du latin fraxinus. - (62) |
| frâgne : frêne. Les charrons aimin les frâgnes : les charrons aimaient les frênes. - (33) |
| frâgne n.m. Frêne. - (63) |
| frâgne : (frâ:gn' - subst. m.) frêne. Le frêne fournit d'excellents manches d'outils. - (45) |
| frâgne : frêne - (39) |
| frâgne : n. m. Frêne. - (53) |
| frâgne : s. m. frêne. - (21) |
| fragne, frêne - (36) |
| fragne, frêne. - (05) |
| frâgne, frêne. - (16) |
| frâgne, s. m. frêne. - (08) |
| frâgne, s. m., frêne. - (14) |
| frâgne, s.m. frêne. - (38) |
| fragne, subst. masculin : frêne. - (54) |
| fragne. Frêne. - (49) |
| fragne. Frêne. Comme nous disons chasne ou châgne pour chêne. - (03) |
| frâgne. s. m. Frêne. (Étais). - (10) |
| fragnie (n.f.) : grand bruit, fracas, vacarme - (50) |
| fragnie : fête. On a fait la fragnie toute la neu : on a fait la fête toute la nuit. - (33) |
| frâgnie, s. f. grand bruit, fracas, vacarme : ils ont fait une « frâgnie » à tout rompre pendant la nuit. - (08) |
| Fragnot : nom de bœuf. III, p. 30-o - (23) |
| frai : le froid - (46) |
| frai : froid. Quand la température baisse o fait frai : quand la température baisse il fait froid. - (33) |
| frai. Frais, récent, nouveau, ou frais, dans le sens de fraicheur ; il fait l'office d'adverbe dans frai venun, frais venu, frai parcé, frais percé, frai soti dé flan de sai meire, frais sorti des flancs de sa mère. Au pluriel i il signifie dépense : « Ai se bôte en frai », il se met en frais. - (01) |
| fraicager, v. a. fracasser, briser avec violence. le vent a « fraicagé » le bois. L’orage a « fraicagé » la moisson. - (08) |
| fraîche, s. f., fraîcheur, humidité, frais du matin ou du soir : « Je m'leùve de boune heure ; j'aime ben de marcher à la fraîche. — Ce mot n'empêche pas frâche. (V. Frô et Frâ.) - (14) |
| fraicheur : s. f., pluie fraîche et de courte durée. - (20) |
| fraicheur, s. f. refroidissement qui cause des douleurs rhumatismales : il est au lit, il a pris des « fraîcheurs. » - (08) |
| fraîchi : fraîchir - (57) |
| fraichou : a) Fraîcheur, coup de froid. «Ou'est-ce que t'as dan troué que t'as la jôe borenf'lle ? Oh y est eune dent que me ituasse, j'ai étrapé eune fraichou ». - b) Mammite au moment du vélâge. « La Bardote a de la frai chou dans le pé (pis) ». - (19) |
| fraîcul. s. m. Gratte-cul. (Germigny). - (10) |
| fraid (on) : froid - (57) |
| fraid : froid - (57) |
| fraid : froid - (39) |
| fraid, fraide (adj.m. et f.) : froid, froide - (50) |
| fraideliou (adjectif) : frileux. On dit aussi frédillon. - (47) |
| fraideliou, ouse, adj. frileux. - (08) |
| fraideur (na) : froideur - (57) |
| fraideure (n.f.) : froidure - (50) |
| fraid'ment : froidement - (57) |
| fraigeottes, n. fém. plur. ; fraises. - (07) |
| frainche. Franche, franches, - (01) |
| fraingale. : Cette expression a tenu en échec bon nombre de philologues. Ici le sens véritable est faim maligne. On sait, en effet, qu'une appétition violente des aliments saisit comme une fièvre ardente une personne atteinte du mal qu'exprime le mot dont il s'agit. Or, male-faim ou faim-male rend exactement cette situation. - (06) |
| frainge (na) : frange - (57) |
| frâïon, s. m. branche d'arbre dont on se sert, comme d'un frein, pour enrayer les chariots sur les pentes très inclinées. - (08) |
| frâïonner, v. a. enrayer un chariot avec une branche d'arbre. - (08) |
| fraipein. Frappions, frappiez, frappaient. - (01) |
| fraiperon. Frapperons,firapperont. - (01) |
| frais : adj., fraîche de lait, se dit de la femme ou de la femelle des mammifères qui a récemment petioulé. - (20) |
| frais, frait, fraide et fred, frède. adj. Froid, Froide. - (10) |
| fraisi : fraisier - (43) |
| fraîsî n.m. Fraisier - (63) |
| fraisi, et fresi, s. m., fraisil, petite braise. - (14) |
| fraison : s. m., trempette. Manger un fraison de cailli. Voir Littré, fraisé et fraiser. - (20) |
| fraitse : fraîche - (51) |
| fraîtse adj. f. Fraîche. - (63) |
| fraitsou : fraîcheur - (43) |
| fraiyer : « fréquenter » une jeune fille - (37) |
| fraiyer : s’accoupler, se reproduire (« lâs pou’chons fraiyont ! ») - (37) |
| fraiyer ain ç’min : rendre praticable un chemin envahi par les ronces - (37) |
| fraize. Fraise. - (01) |
| fraize. : Ne pas montai fraize, autrement ne pas compter même comme une fraise, c'est-à-dire compter pour peu de chose. - (06) |
| fraizon, s. m. pain émietté trempé de lait. - (22) |
| fraizon, s. m. pain émietté trempé de lait. - (24) |
| frâle, adj. franc, cassant, qui se brise facilement. - (08) |
| fra'lli : Eparpiller ce qu'on jette, d'un geste pareil à celui du semeur. Le jeune chasseur : « J'ai biau guinder (viser) bien c'ment faut, je ne tue ren. ». Le vieux chasseur : « mâ i ne faut pas guinder, i faut tiri en fra 'llant ! ». - (19) |
| framboisi : framboisier - (43) |
| frambouaîse (na) : framboise - (57) |
| frambouaîsi (on) : framboisier - (57) |
| frambouée (n.f.) : framboise - (50) |
| frambouèze : une framboise - (46) |
| frâmer (v. tr.) : blesser, estropier - (64) |
| framer, v. fermer. - (38) |
| frâmer, v., fermer. - (40) |
| frâmer. v. - Blesser, fatiguer, user, brûler : « J'ons bu eune p'tite goutte chez Daniel, elle était ben bounne ! A m'a frâmé la langue ... » - (42) |
| franc, franche. adj. - Généreux : « l' m'a dounné troué lites de ratafia. Ah ! C'est sûr ! Il est ben plusfranc qu'son fré'e ! » - (42) |
| franc, franco : adv., franchement, entièrement, exactement. « Le chemin de Placé ? — Franc devant vous. » - (20) |
| franc. Libéral, prodigue, qui donne, qui paie facilement. - (49) |
| franç’ouaîse : françoise - (37) |
| français abechier, créé à partir de « bec » : donner la becquée à un animal. - (42) |
| Françan : Françoise. « La veille Françan », peu usité, on dit maintenant Françoise. - (19) |
| franc-comtouaîs (on) : franc-comtois - (57) |
| franche, francher de char. - (05) |
| Franchi, -schi, prénom, François. - (38) |
| Franchy. Nom d'homme, diminutif de François, on dit aussi Franci. - (08) |
| franci : Froncer. « Franci eune garniteure de reube » froncer un volant. - (19) |
| Françoi. Français, Francus, et François, Franciscus. - (01) |
| Françon, Françoise. - (16) |
| Françon, prénom, Françoise. - (38) |
| frandaille (pour frondaille). s. f. Petite fronde consistant en un morceau de bois fendu, dans lequel on introduit le projectile. (Percey). - (10) |
| frandale, s. f. fronde, petit appareil dont les enfants se servent pour lancer des pierres. - (08) |
| frandaler (v.) : lancer avec une fronde ; lancer des pierres - (50) |
| frandaler, v. a. lancer avec une fronde. - (08) |
| frandenée, s. f. feu de courte durée mais qui donne beaucoup de flamme. - (08) |
| frandeûler : bouleverser, bousculer, jeter. - (29) |
| fran-mer, fermer. - (26) |
| frâquenter : faire la cour à une jeune fille avec l’intention de se marier avec elle - (37) |
| frâre, s. m., frère. - (14) |
| frâre, s. m., frère. - (40) |
| frârot, s. m., frérot, petit frère (dim. de frâre). - (14) |
| frâs (n.m.) : garniture d'une tarte - (50) |
| frâs : partie friande de la galette - (39) |
| fras, freu. n. m. - Sorte de tarte salée. Spécialité poyaudine, à base de fromage blanc... - (42) |
| frâs, s. m. le frâs est la partie friande d'une galette, d'une tartine, ce qu'on met en dessus, la confiture, la crème, etc. - (08) |
| fras. s. m. Se dit de tout amalgame de substances alimentaires, hachées ou broyées, mélangées dans une proportion convenable avec du fromage, un peu de farine, des œufs, du beurre et du sel, et qui est étendu sur une pâte préparée exprès, pour faire ce qu'on appelle une badrée, une tartine. Dans certains cas, un bons fras d'épinards, de pommes déterre, de fromage, de potiron ou de gourde, cuit au four dans un plat de terre ou, dans une tourtière, au moyen d'un feu vif en dessus et en dessous, peut être aussi un mets savoureux, qui a son charme même pour les délicats et les gourmands. Du latin frac tus. - (10) |
| frase : Fraise « Les frases des beus sant bin pu sades (savoureuses) que les frases de jardin ». - (19) |
| frasé : Fraisier (fragaria vesca). « Eune planche de frasés ». - (19) |
| frâse : Miette. « Des frâses de pain ». - (19) |
| frasé sauvage : Potentille rampante, quintefeuille. - (19) |
| fraser : Cueillir la fraise, usité seulement dans ce dicton : « La Pentecôte après diné, prends tan pané va t-en fraser ». - (19) |
| frasette : Cordon de soulier en cuir. - (19) |
| frasse-ahaie, frasse-ehaie. s. m. Nom donné, dans la Puysaie, au serpent, à cause du bruissement qu'il fait dans les feuilles, en passant à travers les haies. - (10) |
| frassement. n. m - Action de frâer - (42) |
| frassement. s. m. Action de frasser, de glisser sur les feuilles, en les faisant bruire. - (10) |
| frasser. v. n. Remuer sans cesse. Ramper, glisser sur les feuilles et dans les herbes en les faisant bruire. (Puisaye). Voyez fraer. - (10) |
| frat (Morv.), frate (Y.), frâches (C.-d., Chal.). - Branchages d'un arbre, petit bois sec et cassant ; du latin fractus (brisé). En bas latin fracta signifiait le branchage des arbres. Dans la Côte, le verbe frâcber existe pour briser, et on dit du bois de frâche en parlant des branches, par opposition au bois de pied provenant du tronc. Dans le Chalonnais, le mot frâche s'applique spécialement aux fanes ou feuilles de certaines plantes herbacées. On dit des frâches de navets, de carottes, etc. - (15) |
| frat, ate. adj. Se dit des noix d'une dureté excessive, et dont on est obligé de briser la coquille pour en retirer l'amande. Par une sorte de contradiction que nous ne comprenons guère, à moins qu'il n'y ait en cela antiphrase, frat, dans beaucoup de communes, se dit d'un bois sec, à fibres courtes et sans cohésion, qui se casse ou qui se fend facilement. On dit également, dans le même sens, peau frate, pour peau cassante. Du latin fractus, suivant M. Savatier-Laroche. - (10) |
| frâte : n. f. Tête de chêne, branchages d'arbre dont le fût est commercialisable. - (53) |
| frâte, s. f. branchages d'un arbre, à peu près synonyme de rame. Vendre un chêne avec la « frâte », c'est le vendre tout entier, sans réserve des branchages ou débris de toute sorte. - (08) |
| frâteiller (v.) : faire du bruit en marchant - en remuant des feuilles sèches - (50) |
| frâteiller, v. n. faire du bruit en marchant ou en remuant dans les feuilles sèches. - (08) |
| frateu : chaume. A - B - (41) |
| frateu : chaume - (51) |
| frateûs : (nmpl) éteules - (35) |
| frateussi : marcher vite - (43) |
| frateux : chaume de céréales - (34) |
| frateux : chaumes - (43) |
| frateux n.m.pl. (du lat. fraxicare, rompre). Chaumes, éteules. Voir feurtèches. - (63) |
| frati, s.m. champ qui a été moissonné, - (38) |
| fratras : Perruquier. « Aller se fare coper les cheveux chez le fratras ». Prononcer l's de fratras. - (19) |
| frâtré : 1 v. pr. Se déplacer sous couvert. - 2 v. t. Émettre un bruit léger par frottement. - (53) |
| frattis, s. m. , champ après la moisson. - (40) |
| fraudou : Fraudeur. « Les vignerons que fiant de l'iau de vie de leu récolte ne sant pas des fraudous ». - (19) |
| fraudou, ouse, adj. fraudeur, celui qui fait la fraude, qui trompe. - (08) |
| fraye (freille). s. f. Frai de poisson. - (10) |
| frayée, s.f. chemin fait dans une couche de neige. - (38) |
| frayon. n. m. - Élément d'une charrue rattaché au cep. - (42) |
| frayon. s. m. Pièce d'une charrue qui tient au sep. (St-Martin-sur-Ouannc). - (10) |
| frayor, s.f. frayeur. - (38) |
| fré (freu) : froid - (51) |
| fré : cassant(BY. T IV) - S&L - (25) |
| frè : froid. - (52) |
| fré : (Féminin : frède). Froid. Ex : "Euh qui fé fré !" - (58) |
| fré, fréde, adj. froid. - (08) |
| fré. adj. - Froid. - (42) |
| frebai - friper, user, chiffonner du linge, des vêtements. – I l'ons haibillé tot ai neu, ma ci vai éte beintot frebai. - Quemant que vos frebez don vos aifâres ! ci fait frémi. - (18) |
| freber, marauder. - (27) |
| frebloeu, adj. frileux. - (22) |
| frebou, maraudeur. - (27) |
| frecassi : fricassée - (43) |
| frecassi : fricasser, rissoler une viande, dei légumes - (43) |
| frëchi, se dit de l'atmosphère qui se refroidit un peu : l’tan frëchi. - (16) |
| fred (adjectif) : froid. On dit aussi fro. - (47) |
| fred : froid. IV, p. 21-4 - (23) |
| frèd, adj., froid : « Oh! qu'i fait donc frèd ! que temps ! » (V. Froid.) - (14) |
| fred. Froid. - (49) |
| frèdi, v. tr. et intr., refroidir : « Veins donc, t'vas lasser frèdi ta sôpe. » — « L'dèt m'breûle ; j'vas l’tremper dans l'iau por le frèdi » - (14) |
| frediller, friller, friler. v. - Frissonner. - (42) |
| frediller. v. n. Avoir froid, frissonner. (Sommecaise). - (10) |
| frédillou, ouse, adj. frileux, frileuse, celui ou celle qui craint le froid, qui en souffre. - (08) |
| frèdure, s. f., froidure. - (14) |
| frée (frére) : frère, ce mot est utilisé dans un sens plus large qu'en français et pourrait se traduire par « mon camarade » ou « mon ami » - (39) |
| frée : frère (s'emploie comme terme d'amitié ; c'est par ce mot que j'interpellais mon cousin Roger). - (52) |
| frée : frère. Ne pas confondre avec le mot précédent. Ils se différencient à l'oreille par la durée du son. (Fré : froid, est très bref, Frée, est long). - (58) |
| frée. n. m. - Frère. - (42) |
| frée. s. m. Syncope de frère. Mon frée, ma soeu. - (10) |
| fréger. v. a. Frayer. Lesch'mins qui ne sont pas frégés dounont ben du tirage. - (10) |
| fregon : tisonnier en bois ou en fer - (43) |
| fregon : un gamin qui remue beaucoup. On dit également freguillou. - (46) |
| fregon, s. m. long tisonnier. Verbe fregoner. - (24) |
| fregon, s. m. long tisonnier. Verbe : fregouné. - (22) |
| fregon, s. m., fourgon, râteau de boulanger pour remuer la braise dans le four, tisonnier. - (14) |
| fregon, tisonnier, perche à attiser. - (05) |
| fregoner, v. tr., fourgonner, tisonner, remuer sans motif. - (14) |
| fregonnè : remuer, fouiller - (46) |
| fregonner : attiser, fouiller, remuer avec un bâton - (43) |
| fregonner : v. n., fourgonner, tisonner, fouiller. - (20) |
| fregonner, attiser le bois au four. - (05) |
| fregouyi, v. a. remuer une friture. - (22) |
| freguillè : s'agiter comme un poisson sorti de l'eau - (46) |
| freguiller, faire un petit bruit. - (26) |
| freguiller, v. tr. , frétiller, remuer constamment : « Aga donc c'poisson, coume ô freguille ! » — « C'te p'tiote, all' freguille tôjor. » - (14) |
| freguillòt, adj., remuant, frétillant. - (14) |
| freguillou : un gamin qui remue beaucoup, on utilize également le mot fregon - (46) |
| freguœyi, v. n. se dandiner. - (24) |
| fréier, friler, effleurer. - (04) |
| freille. adj. - Frai de la femelle du poisson, période de reproduction. - (42) |
| freillée : miette - (39) |
| freiller, v. a. effleurer, toucher légèrement et comme en passant, friser, frôler. - (08) |
| fréilli : frayer - (57) |
| freilli : v. écraser. - (21) |
| freillot - (39) |
| freillot : le chemin ou la trace laissé par le gibier dans la végétation - (46) |
| freillot, miette - (36) |
| freillote, s. fraise des bois. env.de Lormes. Diminutif de « frile. » (Voir : frile, frijotte.) - (08) |
| freillotte : petites fraises des bois - (39) |
| freillou : celui qui se fait un passage, un chemin - (46) |
| freinette : boisson avec du frêne - (39) |
| frein-ner : freiner - (57) |
| frelasse, feurlasse, s. f. chose déchirée, accroc dans une étoffe. - (08) |
| frelin, s. m. épidémie bénigne. - (24) |
| frelingon : s. m., idée fixe, obsession, cafard. Avoir son frelingon. - (20) |
| frelingue (prendre sa), loc. faire une fugue. - (24) |
| frelore. Les Allemands disent : Ich been verloren, je suis perdu... - (02) |
| frelore. : Les Allemands disent : Ich bin ver loren, je suis perdu. - (06) |
| frélu. adj. - Frileux. (Grandchamp, selon M. Jossier) - (42) |
| frélu. adj. Altération de frileux. (Grandchamp). Signifie aussi, mauvais sujet ; vif, petulant, fringant. - (10) |
| fremadze, fromadze : fromage - (43) |
| fremage (on) : fromage - (57) |
| fremage : Fromage. - «fremage blian » fromage de vache frais. - « fremage so » fromage de vache sec. - « fremage feu » mélange de fromage sec et de fromage de gruyère rapés puis broyés ensemble et fermenté. - « fremage de cabre » fromage de chèvre. - « fremage peuri » fromage fait de minces tranches de fromage de vache mi-sec alternées avec de minces tranches de beurre frais, il n'est bon qu'au bout d'un certain temps quand il a fermenté. - « fremage passé » voir à géne. - (19) |
| fremâge : s. m. : fromage. - (21) |
| fremage, fromage. - (05) |
| fremagère : Nom patois de la mauve (malva rotondifolium). Les enfants qui jouent à la dinette font figurer sur leur semblant de table, en guise de fromage, les graines de mauve qui ont une vague ressemblance avec un minuscule fromage ; d'où le nom de fremagère donné à la mauve. - (19) |
| fremagere, mauve. - (05) |
| fremai - fermer. - A nos é fremai lai porte â nez. - Vos dairain mieux fremai votejairdin que cequi. - Vos fremeras lai fenéte. - (18) |
| fremailles : Petites dragées qu'on offrait autrefois lors des fiançailles, aujourd'hui les dragées sont grosses et on les appelle fianceilles. - (19) |
| fremailles*, s. f. fiançailles. Très petites dragées offertes autrefois au moment des fiançailles. - (22) |
| fremailles, s. f. fiançailles. Très petites dragées offertes autrefois au moment des fiançailles (du vieux français fermailles). - (24) |
| fremaize (n.m.) : fromage (pour fromage de Chambure décline 5 termes : fromaize, formaige, froumaize, fromaige, froumaige) - (50) |
| fremajoule, s. f. mauve à tisane. - (22) |
| fremajoule, s. f. mauve à tisane. - (24) |
| freman, froment. - (16) |
| frematin : roux clair - (43) |
| fremé, fermer. - (16) |
| fremège, fromage. - (16) |
| fremejo : mauve (plante). (B. T II) - B - (25) |
| freméjo, mauve sauvage. - (16) |
| frement : froment, blé - (43) |
| frement : Froment. « Dans le vieux temps on fiait du pain de tremois, (orge, fèves, maïs etc…) pa les valots peu les sarvantes, i n 'y avait que les maîtres que mijaint du pain de frement ». - Blé (taraxacum sativum). - (19) |
| frement, froment. - (05) |
| frement, s. m., froment. - (14) |
| frementeau : Fromental ou avoine élevée, graminée vivace (avena elastior) ou ray-grass de France. - (19) |
| fremer : fermer - (43) |
| fremer : fermer - (57) |
| fremer : Fermer. « Les portes sont faites pa fremer ». - (19) |
| fremer, v. tr., fermer, clore, entourer. - (14) |
| fremi - fourmi ; avec un accent frémir, frisson. - Al é fourai son bâton dans lai fremilière ; oh ! i ne me souveins pa d'aivoir jaimâ vu tant de fremis, et de si grosses ! - Ce qu'en nos é dit nos é fait fremi. - Ran que de pensai ai ce qui ons vu, en me sembe qui ai des fremis dans le dos. - (18) |
| fremi (masc.), fourmi. - (27) |
| fremi : fermier - (43) |
| fremi : fourmi. - (66) |
| frémi : Fourmi. « Les fremis roges sant pu mauvas que les autres », la piqûre des fourmis rouges est plus douloureuse que celle des autres fourmis. Fremi est masculin : « in fremi ». - Frémis : picotements. « J'ai des fremis es chambes », j'ai des picotements dans les jambes. « Avoi les fremis es fasses » ne pas tenir en place. - (19) |
| fremi : une fourmi - (46) |
| frémi : voir froumi - (23) |
| fremi, formi (n.f.) : fourmi (aussi fromi) - (50) |
| frémi, fourmi ; d'où le verbe fremillai, pour indiquer une foule, un grand nombre... - (02) |
| fremi, fourmi et picotements dans quelque partie du corps. - (16) |
| fremi, fremiller, fourmi. - (05) |
| fremi, freumi, fromi, s. m. fourmi. Nous disons un frémi comme autrefois. - (08) |
| fremi, s. f. (jadis m.), fourmi : « Méchant comme un frémi roussot » dit un vieux proverbe cité par Jules Guillemin. « On diròt qu'jai des fremis dans l'dos. » - (14) |
| fremi, s. f. fourmi. - (24) |
| fremi, s.f. fourmi. - (38) |
| fremi. Fourmi. On a dit fromi. - (03) |
| frémi. s. m. Fourmi. - (10) |
| fremi. : Fourmi, d'où le mot fremillai, pour exprimer le mouvement d'une grande foule. - (06) |
| fremigerie : Fourmillère. « Fa attention te vas te siter (tu vas t'asseoir) dans eune fremigerie ! ». - (19) |
| fremille. Fourmille, fourmilles, fourmillent, comme frémi de fourmi, fregon de fourgon, freguenai de fourgonner, Fremille, en parlant du bruit que faisait le chant des anges à la Nativité, signifie proprement retentit. - (01) |
| fremillée, fremillouée, fremilloire. s. f. Fourmillière. – A Etais, on dit feurmillée. - (10) |
| fremillement, s. m. fourmillement : « i é dé fremillemans dan le queuches », j'ai des fourmillements dans les jambes. - (08) |
| fremiller, v. n. fourmiller. - (08) |
| frémiller. v. - Frémir. Se dit fermiller à Sougères-en-Puisaye. - (42) |
| fremiller. v. n. Fourmiller. - (10) |
| fremillére, s. f. fourmilière, lieu où se retirent les fourmis. - (08) |
| fremin, fourmi. - (26) |
| fremissire. Frémirent… - (01) |
| fremiyé, fourmiller ; teut an fremiyé, dit-on, pour indiquer une multitude de personnes assemblées dans un lieu. - (16) |
| fremiyement, s. m., fourmillement. - (14) |
| fremiyer, v. intr., fourmiller, démanger. - (14) |
| fremiyère, s. f., fourmilière, et foule nombreuse. - (14) |
| frémodzi : (vb) curer l’étable - (35) |
| frémoger : remuer le fumier, remuer à tort et à travers. - (30) |
| fremouaîr (on) : fermoir - (57) |
| fremougi : Fourmiller, grouiller. « Y a des vés (vers) dans ce fremage, i en fremouge ! ». - (19) |
| fremougi : v. ôter le fumier de l'écurie. - (21) |
| fremouji, v. a. débarrasser une étable de son fumier. - (22) |
| fremouji, v. a. débarrasser une étable de son fumier. - (24) |
| fremourée, s. f. purin. - (24) |
| fremourò, s. m. purin. - (22) |
| fremrée : s. f. purin. - (21) |
| frenailler : farfouiller. - (30) |
| frénarie, frénésie - (36) |
| frénârie, s. f. frénésie, fureur, dispute, querelle, tapage. - (08) |
| frenasie, frénésie, frenarie. - (04) |
| frenouiller (fr'nouiller), fournailler : v. n., fureter dans une chose et la mettre en désordre. Voir fouragner. - (20) |
| frenouillon (fr'nouillon) : s. m., individu qui frenouille. - (20) |
| frequéchi, v. a. fricasser. - (24) |
| fréquenter, verbe intransitif : avoir des relations amoureuses, généralement en vue du mariage. - (54) |
| frequi*, v. n. action de la fileuse faisant tourner son fuseau entre ses doigts frottés vivement. - (22) |
| frére (on) : frère - (57) |
| frére : frère - (48) |
| frére ! : frère ! terme employé en morvan lorsqu’on s’adresse à un proche, à un ami, à un enfant - (37) |
| frére, fré (n.m.) : frère - (50) |
| frérot : frère, petit frère - (39) |
| frérot, s m. frère, petit frère. Diminutif de frère. S’emploie en-dehors des liens de famille, comme terme d'amitié. - (08) |
| frése (na) : fraise - (57) |
| frése : fraise - (48) |
| frésée, s. f. poussière, miette, débris d'une chose brisée ou broyée, petite quantité d'une substance quelconque : « al é tô mingé, a n'm'en é pâ beillé tan cheul'man eune frésée », il a tout mangé, il ne m'en a pas seulement donné une miette. - (08) |
| fréser : fraiser - (57) |
| frési (on) : fraisier - (57) |
| fressigner : froisser, frotter le chai. - (66) |
| fressiller : tortiller. (SB. T IV) - C - (25) |
| fressure : les abats du cochon - (46) |
| fret (la) : le froid - (61) |
| fret’iéssi, v. a. fricasser. - (22) |
| frét’iu, s. m. chaume de blé après la moisson. - (22) |
| fretaille : s. f., vx fr., fretin. - (20) |
| fretaille, chose menue et de peu de valeur... - (02) |
| fretaille. : Diminutif de fretin. - (06) |
| fretasser : faire du bruit en parlant par exemple d'un serpent qui file sur des feuilles mortes. - (30) |
| fretat : s. m., fretin (d'arbres ou arbustes), rejet, branchette. Voir frache. - (20) |
| fretaule, s. f. croûte de pain frottée d'ail. - (22) |
| fretaule, s. f. croûte de pain frottée d'ail. - (24) |
| fréti : Chaume, terre à blé qui vient d'être moissonnée. Vieux français, fretil, terre en friche. - (19) |
| fréti : champ de céréales dépouillé de sa récolte. (CH. T II) - S&L - (25) |
| fréti, s. m. chaume de blé après la moisson (du vieux français frètis, terre en friche). - (24) |
| freti, s. m., et frétille, f., paille, chaume, terre en chaume. A peu près le même sens q’Etoule. (V. ce mot.) - (14) |
| freti. Chaume, synonyme d'étoule. - (03) |
| frêtière, faîtière. - (26) |
| fretil : s. m., vx fr., friche, chaume. C'est jamais sans un ièvre dans c’ fretil. - (20) |
| frètil. Chaume, nom donné au champ après la moisson. - (49) |
| frétille. Paille, terme de l’argot. - (01) |
| fretiller. (Voir : feurteiller.) - (08) |
| frétilli : frétiller - (57) |
| fretin. (Voir : feurtin.) - (08) |
| fretintaille, menues choses sans importance. - (26) |
| fretis, terre en chaume. - (05) |
| fretouiller. v. - Tripoter, frotter. (Bléneau, selon M. Jossier) - (42) |
| fretouiller. v. a. baver, frotter, tripoter. (Bléneau). C'est une altération et un diminutif de frotter. - (10) |
| fretoux : s. m., chevaine des cours d'eau de la Bresse, caractérisé par sa petite taille. Voir brochet d'Espagne. - (20) |
| fretouyi, v. a. frotter, en langage plaisant. - (22) |
| fretouyi, v. a. frotter, en langage plaisant. - (24) |
| freto-ye, panoyon : sac mouillé et emmanché sur la pelle à pain, pour nettoyer le four chaud - (43) |
| fretti : chaume. L’éteule. - (62) |
| frettîs (dâs) : (du) foin mélangé à des buissons et à des pousses d’arbres, recouvrant un terrain non entretenu - (37) |
| frettis : chaume. Partie des céréales restante sur le champ après moisson. - (59) |
| freu (fré) : froid - (51) |
| freu : froid - (43) |
| freu : fruit - (48) |
| freu : (freu - subst. m.) fruit. - (45) |
| freu, s. m. fruit. « frû. » nous disons « à freu » pour en maturité. Les seigles, les pommes de terre ne sont pas « à freu », c’est à dire murs. - (08) |
| freuber : fureter. (MM. T IV) - A - (25) |
| freùber, v. intr., chercher, fureter, déranger : « Que c'que t'veux donc ? Tôjor te freùbes partout. » - (14) |
| freûç’ie : « camelote » sans valeur - (37) |
| freûc’is : débris forestiers après coupes de bois terminées - (37) |
| freuchan : Frisson. « In freuchan de fièvre ». - (19) |
| freuche ou froche : « Simblier la freuche » avoir l'air minable, malpropre, déguenillé. - (19) |
| freuche, s. f. friche, terre inculte, couverte de bruyères, de genévriers, etc. « fruche.» - (08) |
| freucher : (frœché - v. trans.) user ses habits, et surtout ses chaussures ; d'où au figuré, marcher vite. On appelle du nom de frœchâ: un homme très actif, qui use rapidement ses vêtements. - (45) |
| freucher, v. a. abattre, froisser, fouler. On « freuche » certains légumes, comme l'ognon, pour leur donner de la force. - (08) |
| freûd : (nm ou adj) froid - (35) |
| freugean : Nom que l'on donne au hoquet des enfants, d'après la croyance populaire que le hoquet est un symptôme de croissance. - (19) |
| freugi : Croître, grandir. « Mije voir de la sope pa te fare freugi » mange bien de la soupe pour te faire grandir. - « Freugi c'ment des calas dans in sa (comme des noix dans un sac) », ne pas grandir du tout. Vieux français, frogier : profiter, fructifier. - (19) |
| freûgon : (nm) tisonnier ; femme autoritaire - (35) |
| freugon : personne autoritaire - (51) |
| freugon, sm. fourgon. - (17) |
| freûgonner : (vb) attiser ; s’agiter, fouiller - (35) |
| freugonner : activer, disputer pour dynamiser quelqu'un - (51) |
| freuguené, vt. fourgonner. - (17) |
| freugueunner : fourgonner - (57) |
| freuguillé, vn. remuer vivement. S’échapper ; glisser des mains. - (17) |
| freuguiller : frétiller. (REP T IV) - D - (25) |
| freuguillon, sm. personne très active, très vive, insaisissable. - (17) |
| freuiller : fureter. (E. T III) - VdS - (25) |
| freuilli v. Roussir. - (63) |
| freumadze : fromage - (51) |
| freumâdze n.m. Fromage. - (63) |
| freumâdzîre n.f. Egouttoir à fromage. Voir bâgnon. - (63) |
| freumaige : n. m. Fromage. - (53) |
| freumè : fermer - freum lè pôtch, ferme la porte - (46) |
| freument n.m. Froment, blé. - (63) |
| freumer : (vb) fermer - (35) |
| freumer : fermer - (51) |
| freumer v. Fermer. - (63) |
| freumer : fermer. - (32) |
| freumeuilli : fourmiller - (57) |
| freumeuillire (na) : fourmilière - (57) |
| freumi (na) : fourmi - (57) |
| freumi : fourmi - (48) |
| freumi : voir froumi - (23) |
| freumi : fourmi - (39) |
| freumin, sfm. ? fourmi. - (17) |
| freumöre, sf. fourmillière. - (17) |
| freuser : filer, aller vite - (48) |
| freut (n.m.) : fruit - (50) |
| freût : (nm) fruit - (35) |
| freut : fruit - (43) |
| freut : fruit. - (33) |
| freût n.m. Fruit. - (63) |
| freut : n. m. Fruit. - (53) |
| freut. Fruit. - (49) |
| freutcher. Fruitier ; on l’emploie dans le sens de verger. Dans ce cas, on dit bien souvent « jardin freutcher ». - (49) |
| freuté, vt. frotter. - (17) |
| freutoler, freucassi : cuire à la poêle, fricasser - (43) |
| freutou (ŭ), sm. frotteur. - (17) |
| freuzeu : miette. (S. T III) - D - (25) |
| frévote, frésote. s. f. Fraise. (Argenteuil). - (10) |
| fréyére (na) : frayère - (57) |
| freza, freuza. : Rompre, briser. Dans certains lieux on dit fracher. - Le fraisi est un charbon très tenu et la fresée est la cendre de fraisi. Tous ces mots ont pour racine le latin frangere. - (06) |
| frezaille, choses réduites en miettes. - (26) |
| frézée : miette - (48) |
| fri - sans espoir, perdu. - Le pôre gairçon ne vai pencore âssi bein qu'hier… Oh ! al â fri. - Les Noirots ne s'en retirerant pâ ; â sont fris… - (18) |
| fri*, v. a. frapper : il m'a fri. - (22) |
| fri, v. a. frapper : il m'a fri (du vieux français férir. Latin ferire). - (24) |
| frian pour frayan. - Éne sente bé friante, c'est-à-dire un sentier bien frayé. - (06) |
| frian. Friand, délicat… - (01) |
| friblotte : reste - (51) |
| friboule : s. f.. morille. - (20) |
| fric frac. Locut. Peu de chose. Se dit toujours avec la négation. Cette maison est ruinée, il n'y a plus ni fric ni frac. - (10) |
| fric ni frac (ni), loc. ne laisser derrière soi « ni fric ni frac », c'est tout détruire, tout saccager, prendre, enlever, piller tout ce qui est susceptible de l'être. - (08) |
| fricaissé, vt. fricasser. - (17) |
| fricaissée, s. f. fricassée ; viandes ou légumes cuits et assaisonnés avec du beurre, de l'huile ou de la graisse. - (08) |
| frican, ce qui arrive fréquemment. - (16) |
| fricanté, fréquenter une personne, la voir souvent. - (16) |
| fricassée : Fricassée, ragoût de viande ou de légumes. - Au figuré : « Avoir les yeux à la fricassée » : avoir le regard provoquant. - (19) |
| fricasser. v. a. Frotter. Fricasser ses mains, les frictionner, les frotter vivement l'une contre l'autre, parce qu'on a froid ou par signe de contentement, manus suas fricure. Phèdre a dit aussi asinus asinum fricat. – Se fricasser. v. pron. Se frotter, se frictionner. - (10) |
| frichetis. s. m. Repas, diminutif de fricot, qui, selon l'abbé Corblet, se dit quelquefois pour festin, bonne chère. J'avons fait un frichetis, un bon petit frichetis. - (10) |
| frichti (nom masculin) : cuisine sommaire. Repas. - (47) |
| frich'ti. Festin, bon repas. - (49) |
| frichtouner (verbe) : préparer un repas simple ridement. - (47) |
| fricielle : faisselle - (61) |
| frico, toutes sortes de viandes cuites. - (16) |
| fricot : Mets. « Tire voir in ban bout de fricot su tan assiètte ». - (19) |
| fricot : repas - (60) |
| fricot : préparation culinaire mijotée ou non. Repas, par extension. Ex : "Faut qu'j'all maint'nant fée mon fricot !" - (58) |
| fricot, s. m. régal, bombance, bonne chère. - (08) |
| fricot. L'Académie n'admet pas ce mot qui est cependant usité dans presque toutes les provinces de France. C'est une fricassée, un ragoût de viande frite dans la poêle. - (13) |
| frigeotte : petite fraise sauvage. - (33) |
| frigi : s'agiter. Chien ou chèvre remuant la queue. A - B - (41) |
| frigi : se remuer; chien, chèvre qui remue la queue - (34) |
| frigne (n. f.) : petite quantité (syn. grigne, grignon) - (64) |
| frigne. n. f. - Miette, menu morceau. Autre sens : trace. « On n'en voué plus frigne. » (Perreuse, selon M. Jossier) - (42) |
| frigne. s. f. Trace. On n'en voit pas frigne. On n'en voit plus la frigne. (Ferreuse). - (10) |
| frig'neuté, vt. fignoler, friser, décorer de dessins, de stries, d'arabesques un pain de beurre. Se dit d'une surface qui se ride. - (17) |
| frigolai - faire cuire sur la flamme, sur le charbon, dans la poële. - Vos veinras ai ce sair, i frigolerons des châtaignes, et vo saivez qui ons in pecho de vin blian. - Note fonne é frigolai des beugnots dans le beurre. - (18) |
| frigölé, vt. frire, rôtir (des marrons, etc.). - (17) |
| frigolé; faire frigolé, par exemple, des châtaignes dans une poêle à trous. - (16) |
| frigoler (v.t.) : faire griller - (50) |
| frigoler : faire griller légèrement. - (31) |
| frigoler : Rôtir, griller. « Fare frigoler des chataignes su le c'euc'lle du poile (sur le couvercle du poêle) ». - (19) |
| frigoler est de la même famille. Ce verbe s'applique surtout à la cuisson des marrons. Les marchandes de châtaignes cuites qui se tiennent sur nos places publiques les jours de marchés d'hiver ne manquent pas d'annoncer leurs marchandises par le cri : toutes chaudottes, toutes frïgolottes. - (13) |
| frigôler, friller (dans toute la Bourg.). - Faire griller, rôtir ; frigoler s'applique surtout aux marrons que l'on fait cuire dans la poêle où leur pelure éclate avec bruit. La poêle à marrons s'appelle frigoloire. En Bourgogne, friller se dit dans le sens de grésiller, par exemple : friller un poulet, pour faire flamber (dans le Charollais on dit beucler), ou dans le sens de griller ; on dit, par exemple : « les feuilles des arbres sont frillées », quand la chaleur les a roussies. Vient du latin frigere, dans le sens de frire, fricasser. Frigoler et friller existaient en vieux français. C'est dans le même sens et par suite de la même étymologie qu'un ragoût ou fricot devient de la frigousse en patois. - (15) |
| frigoler, frîller, frigoûç’er : frire - (37) |
| frigoler, v. a. faire griller. - (08) |
| frigoler, v. faire cuire des châtaignes dans une poêle à trou. - (65) |
| frigoler, v. tr., faire griller, rôtir des marrons des châtaignes. - (14) |
| frigoler, v., faire cuire des marrons dans une grande poêle percée de trous ; cette poêle est nommée « la frigouloire ». - (40) |
| frigoler, verbe transitif : faire griller. - (54) |
| frigoler. Faire rôtir des châtaignes dans la frigoloire. Etym. diminutif de frire; du latin frigere qui donne le g. - (12) |
| frigolés, adj., rôtis. On appelle ainsi les châtaignes et les marrons tout chauds sortant de la poêle trouée. (V. Chodòtes, Frigolòtes.) - (14) |
| frigoller. Faire griller : « faire frigoller les châtignes ». - (49) |
| frigoloire, n.f. poêle percée. - (65) |
| frigoloire, subst. féminin : poêle ou récipient percé de trous pour griller les marrons. - (54) |
| frigoloire. Poêle ou casse percée de trous, dans laquelle on frigole les marrons et les châtaignes. - (13) |
| frigololre. Substantif tiré de frigoler, sorte de poêle percée de trous dans laquelle on fait rôtir des châtaignes ou des marrons. - (12) |
| frigolôtes, adj. f., rôties, grillées. Ne s'applique qu'aux châtaignes seulement. (V. Chodòtes.) - (14) |
| frigolouaire : grosse poêle percée de trous circulaires pour faire frire les châtaignes, les marrons - (37) |
| frigousse : Fricassée, ragoût. « Fa nos voir eune bonne frigousse ». - (19) |
| frigousse : viande en sauce. - (31) |
| frigoussé : v. t. Frire, cuisiner. - (53) |
| frigousse, s. f., friture, cuisine, fricassée : « Jeanneton n'nous fait pus d'la bonne frigousse. » Ne se prend guère en bonne part. - (14) |
| frigousse. s. f. Fricassée, ragout, platée de fricot. - (10) |
| frigousser, v. tr., faire frire, fricasser, cuisiner tant bien que mal. - (14) |
| frijale : jouet fabriqué avec une ficelle et une planchette. A - B - (41) |
| frijotte, s. f. fraise des bois. (Voir : freillotte.) - (08) |
| frilai : frôler. Le thermomètre ai frilai la gealée : le thermomètre a frôlé la gelée. - (33) |
| frile (n.f.) : fraise - (50) |
| frilè : v. t. Frôler. - (53) |
| frile, s. f. fraise des jardins ou des bois. - (08) |
| friler : frire, griller - (60) |
| friler : frissonner (quand on mange quelque chose d'aigre) - (61) |
| frîler : frôler - (39) |
| friler : moment- état du beurre ou du gras quand il commence à grésiller dans le récipient au feu. - (58) |
| friler, friller. v. n. Se dit, par onomatopée, pour exprimer le bruissement, le grésillement produit par l'eau qui tombe sur le fer rouge. (Perreuse). Se dit aussi pour frôler. - (10) |
| friler, v. a. friser, frôler, toucher légèrement. - (08) |
| frilieux, adj., frileux : « Ol é si frilieux, qu'ô tient le poile entremi ses jambes. » - (14) |
| frillan : Odeur de poil brûlé. « Qu'est-ce que te breule dan ? i sent le frillan ». - (19) |
| frillant nu. adj. - Se dit d'une personne trop peu vêtue : « Gade don' l'Jean Luc pa' la cour, il est frillant nu ! Faura pa' qui vienne se plainde, s'il a attrapé fré ! » - (42) |
| frillant-nu. adj. Qui est en guenilles, à peine vêtu, et de manière à geler de froid. De friller, avoir froid, geler. (Bléneau). - (10) |
| frillè : brûlé légèrement et frisé par la sécheresse ou le gel - (48) |
| frillè : griller (exemple : frillè le cochon) - (46) |
| frîlle-poulot : petit enfant - (37) |
| friller : brûler superficiellement. - (32) |
| friller : deux sens : brûlé par le gel ou doré à la cocotte, on dit aussi "jaunir". - (66) |
| friller : frire, desséché, passer à la flamme - (48) |
| friller : roussir. (E. T IV) - C - (25) |
| friller est synonyme de flamber et de roussir. An faut friller les couchons putôt que d' les dépiâler. — Lai jallée de mai ai frillé nos vignes du Pays-Bas. - (13) |
| friller : v. a., bucler, roussir. J'ai frillé mes cheveux. Ça sent le frillé, ici. - (20) |
| friller, brûler légèrement le poil. - (05) |
| friller, geler. - (26) |
| friller, v. a. flamber, griller légèrement. - (08) |
| friller, v. brûler légèrement (une petite gelée frille les jeunes pousses). - (65) |
| friller, v. brûler les soies du porc que l'on vient de tuer. - (65) |
| friller, v. tr., brûler avec de la paille la soie d'un porc que l'on vient de saigner. Ce feu d'artifice vulgaire est toujours une fête pour les gamins, qui ne manquent pas d'accourir aussitôt qu'ils entendent les cris aigus de la bête au boudin. - (14) |
| friller, v., brûler les soies du porc que l'on vient de tuer. - (40) |
| friller. Brûler. - (03) |
| friller. Flamber, dans le troisième sens donné par Littré ; « passer à la flamme d'un feu clair une volaille ou un oiseau plumé pour en ôter les petites plumes qu'on n'a pu enlever avec la main. Se dit aussi des porcs tués que l’on passe à la flamme pour enlever leurs poils. Par extension, bruler légèrement. Etym. diminutif de frire. - (12) |
| frilleux (ll mouillés). adj. Frileux. - (10) |
| frillî : flamber légèrement. Passer une volaille, un porc…au feu pour éliminer les restes de plumes ou de soies… - (62) |
| frilli : Flamber. « Frilli in poulot - Frilli le cachan », quand le porc vient d'être saigné on le recouvre d'une couche de paille à laquelle on met le feu et on achève de griller les poils de l'animal avec une torche enflammée. - (19) |
| frillie, s. f. miette, débris : « eune frillie » de pain, de sucre, (voir : effrèser, effriller, frésée.) - (08) |
| frilloler : v. a., dim. de friller. - (20) |
| frillon, s. m. copeau frisé de menuiserie que soulève le rabot : « eun béai frillon ; eun fâ d' frillons. » - (08) |
| frillot, s. m. trempée au vin. - (08) |
| frillòte, s. f., cuisson particulière de l'estomac, bien connue des trop assidus buveurs de vin blanc : « Prends garde, Jacot ; t'chopines ben souvent. . . Gare à la frillòte ! » - (14) |
| frillotte (n.f.) : fraise des bois - (50) |
| frillou, frileux. - (27) |
| frillou, ouse, adj. frileux, qui craint le froid. - (08) |
| frilôt, frillôt : dépôt, résidu de cuisson au fond d'un récipient, et non consommable. - (56) |
| friloux : Frileux. « T'as dan bin mauvâse mine est-ce que t'es malède ? Oh non seurement (seulement) je sus tot friloux ». - (19) |
| frimai : faire semblant, crâner. - (33) |
| frimanç’e : très peu - (37) |
| frimance (pron.ind.) : rien, personne - (50) |
| frimance : rien. (S. T IV) - S&L - (25) |
| frimance : (friman:s' - subst. f.) auxiliaire de négation (cf. fœrdal' ). - (45) |
| frimance, dans la locution « Y a pas frimance » (pour parler d'un repas peu abondant et vite servi). - (40) |
| frimance, n.f. abondance. - (65) |
| frimance, s. f. apparence, ombre de ce qui a existé, dernière forme d'une chose disparue. - (08) |
| frimence n.f. (p.ê. construit sur frime) Aucun, pas un seul, pas du tout, pas l'ombre d'un. - (63) |
| frimence. Pas un seul, pas du tout : « aul en ai frimence ». - (49) |
| frimer. v. - Chercher, fouiner, fureter. (Lainsecq, selon M. Jossier) - (42) |
| frimer. v. n. Chercher, fureter partout curieusement ; ce que, à Auxerre, on appelle meuter. (Lainsecq).-Suivant Roquefort et l'abbé Corblet, ce mot signifierait geler, et serait un dérivé de frimas. - (10) |
| frimouille, s. f. frimousse, figure, visage. - (08) |
| frimouse (de l'anglais free mouth, bouche ou mine sincère, ouverte, naturelle ), bonne mine... - (02) |
| frimousse, figure pleine, indiquant une bonne santé. - (16) |
| frimousse. : Figure bien vivante, visage bien plein et bien nourri. - (06) |
| frinchi : L'ensemble des pièces de bois qui tiennent les planches de la caisse d'un char. - (19) |
| frinchi : s. m. pièces de bois destinées à soutenir les binches. - (21) |
| frindaler : Jeter en travers rageusement. « Je li ai frindalé man batan dans les chambes (jambes) ». Vieux français, fraindre : briser, fracasser. - (19) |
| frindaler. Saisir un objet et le faire tournoyer avant de le jeter à terre. Al ai pris mes nippes dans l'armoire et a les ai fait frindaler teut le traivars de lai chambre. Par extension : maltraiter, repousser avec colère : mon meichant houmme m'ai teute frindallée. A rapprocher de fronder, dans le sens de lancer avec une fronde. - (13) |
| frinde : Fronde. « Dave sa frinde ol a envié eune piarre jeusque vès le poulot du clieuchi » : avec sa fronde il a envoyé une pierre jusqu'à la hauteur du coq du clocher. - (19) |
| fringai, sauter, gambader, comme dans le mot fringa de l'idiome breton. Né ra né met fringa, il ne fait que gambader. (Le Gon.) - (02) |
| fringale, faim subite, excessive. - (16) |
| fringale. s. f. Faim violente dont on est pris subitement. - (10) |
| fringe : Frange, sorte de filet qu'on met sur la tête des bœufs attelés pour chasser les mouches. - (19) |
| fringuai. : Sauter, bondir, gambader (du latin frigo, je saute avec bruit. (Quich.)- Le mot fringuenelle ou friquenelle signifie non seulement danseuse, mais coquette. (Del.) - (06) |
| fringuenelle ou friguenelle, coquette... - (02) |
| fringuenelle. Fringante. - (01) |
| fringuer (Se). v. pron. Se carrer, marcher avec prétention, faire le fringant. (Ronchères). - (10) |
| fringuer, danser (Noël de M. Buteau). - (04) |
| fringuer, v. n. danser, sauter, frétiller en gambadant. - (08) |
| frinqu’nâle : faim importante - (37) |
| frinte. : (Dial.), frémissement, trouble (du rég. latin fremitum). On faisait aussi usage dans le dialecte du verbe frinter. - (06) |
| friocard (pas), pas fier à la suite d'une déconvenue. - (27) |
| friolée : Flambée. « Ments (mets) voir in sarment dans le fû qu'an fiait eune bonne friolée devant de s'aller couchi ». - (19) |
| frïon. s. m. et frïue. s. f. Contraction de frison et de frisure. Se dit des copeaux de menuisier, parce qu'ils sont presque toujours roulés sur eux-mêmes et comme frisés. - (10) |
| friot. s. m. Petite fraction, menue parcelle d'une chose rcduite en miettes ou en poudre. De friser, effriser, ou de froïer, froyer, briser, broyer, pulvériser. (Montillot) - (10) |
| friotte. n. f. - Fraise. - (42) |
| friotte. s. f. Fraise. A Athie, on dit fréjotte. - (10) |
| friottier. s. m. Fraisier. - (10) |
| frioture, disparition soudaine de quelque chose. Ex.: j'avais deux paniers, je n'en vois plus frioture. - (27) |
| fripe-lippe, goinfre, glouton. On peut le traduire littéralement par frotte-lèvre. - (02) |
| fripouille, s. f., gens de rien, chose de rien. Terme de mépris : « Eùne vrâë fripouille que ce gas-là ! » — « Sa marchandise ? N'yé que d’la fripouille ! » - (14) |
| fripouner, v. a. friponner, duper, tromper, voler. - (08) |
| fripoûye, celui qui ne mérite aucune considération et vêtement sans valeur. - (16) |
| frippe-lippe. : Goinfre, glouton. C'est littéralement frotte-lèvre. - (06) |
| friquentation, s. f. fréquentation, rapport intime entre deux personnes de sexe différent. - (08) |
| friquet, n. masc. ; pimpant ; al ost bal et ben friquet, cetu-là. - (07) |
| friquet. s. m. Sorte d'écumoire pour retirer la friture de la poêle. - (10) |
| friquette (ne pas durer), loc. ne pas faire vie qui dure, ne pas prospérer longtemps : sa fortune a fondu comme rosée : elle n'a pas duré « friquette. » - (08) |
| frisale, frise, fiarde : toupie - (43) |
| frisans : Copeaux de menuisier. « Allemer le fû dave des frisans ». - Boucles de cheveux. - (19) |
| frise : (nf) toupie - (35) |
| frise : Jouet d'enfant du genre de la fiarde mais beaucoup plus petit et qu'on met en mouvement en le faisant tourner avec les doigts. « Ol a fait eune frise dave in botan de culotte peu in morciau d'allemette ». - (19) |
| Frisé : nom de bœuf. VI, p. 7 - (23) |
| frise : s. f., syn. de fiarde et de tonton. - (20) |
| frisé, v. n. tourner rapidement. - (22) |
| frise-cou : Perce-oreille, forficule (insecte). - (19) |
| frisée, s. f., petite quantité d'une chose, parcelle. Ex. : je n'en ai pas une frisée, comme on dirait : pas une miette. - (11) |
| frisées, subst. féminin pluriel : miettes, débris. - (54) |
| friselot, s. m., pain trempé dans du lait. - (40) |
| friser : (vb) agiter, faire tourner : « l’tsin frize la coue » (le chien agite la queue) - (35) |
| friser : agiter, faire tourner - (43) |
| friser : Tourner autour. « J'étais pas tranquille dave ce chin que frisait auto de ma (autour de moi) ». « Friser c'ment eune fiarde » : tourner très vite, comme une toupie. - (19) |
| friser : v. n., tourner. Friser autour d'une personne, tourner autour d'elle, généralement dans une intention galante. - (20) |
| friser, v. n. tourner rapidement : le danseur fait friser sa cavalière. - (24) |
| frisi : friser - (57) |
| frisi : se remuer ; chien, chèvre qui remue la queue - (43) |
| frisolé : (nm) thym - (35) |
| frisolet : s. m., thym. - (20) |
| frisolet, s. m. thym. - (24) |
| frisolo. Un peu frisé. - (03) |
| frison : copeau - (43) |
| frison : s. m., copeau de bois, de métal, etc. - (20) |
| frisons : copeaux. - (66) |
| frisons : les copeaux - (46) |
| frisons n.m. Copeaux de bois. - (63) |
| frisons, s. m. pl. boucles frisées. Fins copeaux. Rouleaux de crasse produits par glissement de la main. - (22) |
| frisons, s. m. pl. boucles frisées. Fins copeaux. Rouleaux de crasse produits par glissement de la main. - (24) |
| frisons, s. m., rubans de bois qu'enlèvent le sabotier et le menuisier dans leur travail de rabotage. - (14) |
| frisotte, fresotte : s. f., « cordon de soulier » en cuir. - (20) |
| frisoulet, s. m. thym. - (22) |
| frisque, au féminin frisquette, jeune fille éveillée. Ce mot vient de l'anglais frisk, sautiller. - (02) |
| frisque, frisquet. : Sautillant, éveillé. C'est encore un mot que les Anglais ont laissé aux Bourguignons dans le temps de leur alliance, car le verbe to frisk signifie gambader, sautiller. - Ai n'a pu ni frisque ni frasque signifiait, en langage familier, il n'est plus ni alerte ni éveillé. - (06) |
| fristue. n. f. - Évoque une petite quantité, un soupçon, un rien, moins que rien : « On n'en voit pas fristue. » - (42) |
| fristue. s. f. Si peu que ce soit, ombre, soupçon, apparence ; un rien, moins que rien, un néant. On n'en voit pas fristue. Se dit sans doute par corruption du latin fesluca, fétu, brin de paille. (Perreuse). - (10) |
| frisure, n.f. feuilles de vigne gelées. - (65) |
| frisure, s. f., feuilles de vigne gelées. - (40) |
| frivoles. s. m. pl. Copeaux de menuisier. - (10) |
| friyé, brûler superficiellement, par exemple, un porc ; friyé s'emploie aussi substantivement : senti l’friyé, sentir le roussi. - (16) |
| frizolet n.m. Thym sauvage. - (63) |
| frîzon : petit copeau. - (21) |
| frizon, copeau recoquillé qui sort de la varlope du menuisier. - (16) |
| frô , frais, froid. - (05) |
| frô, adj., frais : « Dis donc, not'belle couraude, all' n'é jà pu si frôche ! » Ce mot n'empêche pas notre locution « à la fraîche. » (V. ce dernier mot.) - (14) |
| frô, adj., froid. - (40) |
| frô, frâ : adj. Frais. - (53) |
| frô, frais ; pèn fro, pain tout fraîchement cuit. - (16) |
| frô, frouéde, adj. frais. Froid et frais chez nous sont absolument synonymes. « Frôche » au féminin. - (08) |
| fro, ode, adj. froid, froide. - (17) |
| fro. Frais, au féminin frôche ; de même en bourguignon. - (03) |
| froché : fatigué. (E. T IV) - S&L - (25) |
| froché : adj. Anéanti sans forces ni volonté. - (53) |
| froche. Fraiche. - (01) |
| frocher : froisser, frayer un chemin - (39) |
| frocher, v. a. froisser. Ne s'emploie qu'au propre en parlant des grains, des herbes que le vent ou le passage d'un être vivant a foulés et plus ou moins écrasés. - (08) |
| frôd adj. Froid (au féminin, feurde) - (63) |
| frodiure, froidure. - (26) |
| frodiure, sf. froidure. - (17) |
| frôdou, fraudeur. - (16) |
| frœ, s. m. 1. Froid. — 2. Outil servant à assouplir le chanvre. - (22) |
| frœ, s. m. 1. froid. - 2. Outil servant à assouplir le chanvre. - (24) |
| frœllyi, v. a. brûler l'extrémité, la surface : le soleil a frœllyi les feuilles. - (24) |
| frœllyi, v. a. brûler l'extrémité, la surface. - (22) |
| frœter, v. a. frotter. Battre : ce galopin a été frœté. - (24) |
| frognai - froncer, surtout les traits de la figure. - En te fau te corrigeai de l'habitude que t'é de frognai le nez. - A frogne les soucis, ci n'indique pâ in bon caractère. - (18) |
| frogné ; s'frogné, faire cesser une démangeaison en pressant la main, avec agitation, sur l'endroit où on la ressent. - (16) |
| frogne. Froncement du nez ou des sourcils en signe de mauvaise humeur. Etym, froncer. - (12) |
| frogne. Remue, remuent. C'est une marque de joie que de se frogné d’aise les épaule. On les hausse et baisse alors naturellement de la sorte, et c'est le plaisir, ou présent, ou prochain, qui produit ce trémoussement. Refrogner a une signification toute opposée. - (01) |
| frogner (se). v. - Se frotter. - (42) |
| frogner, plisser le front. - (28) |
| frôgner, v. intr., remuer, se remuer, se caresser par un petit mouvement ondulatoire : « Ol é bê si content, qu'ô s’en frogne les épaules. » - (14) |
| frogni, plisser le front ; d'où le réduplicatif refrogni, et avoir un air renfrogné ; du latin frons. - (02) |
| frogni. : Plisser le front, ainsi que l'indique le mot latin frons. - Se refrogni a un sens complétement opposé.- Le participe frognan veut dire remuant. - Un air refrogné est une mine plissée ou contractée. - (06) |
| froi. Froid, froids. - (01) |
| froid (geler de), locut. redondante et fautive. Quand on gèle, c'est toujours de froid, (V. Bas, Bois, Chaud, Haut.) - (14) |
| froid et chaud : loc, chaud et froid. Il a ramassé un froid et chaud ; ça li a foutu I’ coup d’ la mort. - (20) |
| froid : s. m., refroidissement qui engendre un trouble quelconque de la santé ; maladie ou indisposition réputée consécutive au refroidissement. - (20) |
| froid, s. f., la froid. Certains citadins, pour mieux parler que les paysans, disent froid (V .frèd), mais en féminisant ce mot : « Oh! la, la! brrr! je grûle la froid. » - (14) |
| froid. s. f. S'emploie souvent, dans les campagnes, pour froideur. Quand on est pris de la froid, on n'est pas à soun aie. - (10) |
| froidissement : s. m., refroidissement. - (20) |
| froïlian : Tricheur. « Je ne jue plieu dave ta, t'es in froillan ». - (19) |
| froïlle : Tricherie. Quand le joueur qui a triché perd quand même la partie on dit : « La froïlle s'en revint ! », se retourne contre son auteur. - (19) |
| froïlli : Tricher. « In ban juriau (joueur) ne charche pas à froïlli ». - (19) |
| froinlie. s. m. Furoncle. (Vassy-sousPisy). Du latin furunculus. - (10) |
| frôlé, vt. rosser. - (17) |
| frôlée, sf. rossée. Voir peingnée. - (17) |
| frôlée. s. f. Volée de coups reçus ou donnés. (Armeau). - (10) |
| frôler, frouler. v a. Battre, étriller, frotter. (Massangy). - (10) |
| frôlon, ferlon. s. m. Frelon. - (10) |
| fromâdze : (nm) fromage - (35) |
| fromage : s. m. — Fromage blanc, fromage de vache. — Fromage de chèvre (voir Biquot, Cabrion et Bouton,de culotte). - (20) |
| fromage : s. m., élève qui dans un lycée ou collège ne suit pas les cours de l'enseignement classique. Voir lapin. - (20) |
| fromage, n.m. mauve (fleur). - (65) |
| frômagée. n. f. - Mélange de beurre frais et de fromage blanc. (Villiers-Saint-Benoît, selon M. Jossier) - (42) |
| frômagée. s. f. Conserve de beurre frais et de fromage mou mélangés. (Villiers-Saint-Benoît). – AVilliers-Bonneux, se dit d'un tôt-fait ou mélange de farine, d'oeufs et de lait cuit au four. - (10) |
| fromageöt, , sm. mauve officinale. - (17) |
| fromageot. Dans le Nord : fromigeom. Petite plante sauvage de la famille des malvacées. Ses graines ont la forme d'un petit fromage. - (13) |
| fromager, fremouger : v. a., enlever le fumier dune écurie ; renouveler la litière.du bétail. A rapprocher des vx fr. fomerer et fomerol. - (20) |
| fromagère. Mauve (Malva sylvestris). Tire ce nom de la forme de son fruit qui est celle d’un petit fromage. - (49) |
| fromai : fermer. On frome les portes le soir : on ferme les portes le soir. - (33) |
| fromai. Fermer, fermé : Lai pote au fromerô, la porte au fermerot, nom d'une rue de Dijon. - (01) |
| fromaige : fromage - (48) |
| fromaige, froumaige, freumaige, formaige, froumaize, s. m. fromage. - (08) |
| fromaigeot (n.m.) : mauve à feuilles arrondies - (50) |
| fromaigeot : petite mauve - (48) |
| fromaigeot, froumaigeot. s. m. mauve à feuilles arrondies. « froumézot. » - (08) |
| frombi, vn. passer rapidement, brûler l'espace. - (17) |
| frombir. v. n. Se dit du bruit que produit l'air déplacé par un corps dur lancé avec rapidité ou qu'on fait tourner sur lui-même. (Etivey). - (10) |
| fromé : v. t. Fermer, enfermer. - (53) |
| fromé, vt. fermer. - (17) |
| fromège : (fromèj' - subst. m.) fromage. - (45) |
| fromèjo (subst. m.) mauve sylvestre, qu'on nomme ainsi à cause de ses fruits qui rappellent plus ou moins la forme d'un petit fromage. - (45) |
| froment (du) : blé - (57) |
| froment : blé (français) - (51) |
| froment : blé. III, p. 23-4 - (23) |
| froment : Le froment, lorsqu’il ne qualifiait pas les grains de blé séparés de la tige après battage, était, vers 1760, l’avoine fourragère appelée aussi avoine élevée. - (55) |
| fromer (v. tr.) : fermer - (64) |
| frômer : (vb) fermer - (35) |
| fromer : fermer - (37) |
| fromer : fermer - (48) |
| fromer : fermer. - (52) |
| fromer l’ bé, couper l’chûlot : faire cesser de parler quelqu'un - (37) |
| fromer : fermer - (39) |
| fromer, v. a. fermer : « fromez lai maion », fermez la maison. - (08) |
| fromèze : fromage. - (52) |
| fromi : voir froumi - (23) |
| fromi. s. m. Fourmi. - (10) |
| frômige, s. m., tout fromage, sauf le « claquin ». - (40) |
| fromilloire. s. f. Fourmillière. (Rogny). - (10) |
| fromion (n. m.) : fourmi - (64) |
| fromion : voir froumi - (23) |
| fromodzi : enlever le fumier, curer l'étable - (43) |
| fromoû, fromouère : fermoir - (48) |
| fromou, sm. fermoir. - (17) |
| fron. Front. - (01) |
| fronce, s. f. pli, ride. Se dit des personnes et des choses. - (08) |
| froncle, furoncle. - (04) |
| frondale. Fronde. Du vieux mot fondelle. frondaler se dit pour lancer avec une fronde, et par extension pour jeter violemment. - (03) |
| frondaler - feurter : aller vite (pour un véhicule) - (57) |
| frongle (gl mouillé). s. m. Furoncle. (Mouffy). - (10) |
| frongle. n. m. - Furoncle. - (42) |
| fronllhe, s. m. furoncle, clou. - (08) |
| fronmer. v. a. Fermer. (Argentenay). - (10) |
| fronse, rides du visage et plis rapprochés les uns des autres que les couturières font à certains vêtements de femme. - (16) |
| front (avoir du), locut., être effronté. - (14) |
| front’chére (na) : frontière - (57) |
| frontonière, s. f., fronteau, bandeau formé de plusieurs tresses, au milieu duquel est fixé un petit joyau de plus ou moins de valeur, et dont les jeunes femmes s'ornent le front. Sorte de ferronnière. - (14) |
| froque. s. f. Assortiment des nippes et vêtements qu'on possède, et plus particulièrement de ceux qu'on a sur soi. Toute sa froque ne vaut pas deux sous. C'est l'opposé de défroque. - (10) |
| froquette : barque de pêche. (PSS. T II) - B - (25) |
| fros (adj.) : frais - (50) |
| frôs, frôç’e : frais, fraiche - (37) |
| fros. adj. Frais, par conversion d'ai en o. (Domecy-sur-le-Vault). - (10) |
| frot. Frottoir. Instrument contre lequel on frotte, assouplit la filasse brute du chanvre. - (49) |
| frotcha (na) : frottée - (57) |
| frotë, croûte de pain frottée d'ail et coups reçus. - (16) |
| frotée, s. f., croûton de pain frotté d'ail, qu'on mange pour déjeuner, ou qu'on met dans le fond du saladier. - (14) |
| frotte-beurion n.m. (de beurion). Slow, danse rapprochée et plus si affinités. - (63) |
| frottée : une défaite - èl é pris eune sacrée frottée, il a été sévèrement battu - (46) |
| frottée, s. f. la frottée est une croûte de pain sur laquelle on écrase une gousse d'ail. - (08) |
| frottouaîr (on) : frottoir - (57) |
| frou. s. m. Poêle percée de trous, dans laquelle on fait griller des marrons, des châtaignes. (Perrigny). - (10) |
| frouâ, s.f. cf, frayée. - (38) |
| frouaissi - chifougni : froisser - (57) |
| froubillouner. v. a. Essuyer, fourbir avec un froubillon. (Laduz). - (10) |
| froucher. v. n. Se dit du léger bruit qu'on fait en frôlant les branches feuillues d'un taillis ou bien en se frottant contre un objet. - (10) |
| froucillon (pour tourbillon). s. m. Torchon, linge pour essuyer. (Laduz). - (10) |
| frouè : froid - (48) |
| frouè : n. m. Froid. - (53) |
| frouée : flambée. (VDS. T IV) - VdS - (25) |
| frouer. v. n. Frôler, faire frou-frou Une jupe de soie qui traîne, qui frôle sur un parquet, fait, à chaque pas de celle qui la porte, frou frou. C'est une onomatopée. – Frouer, se dit aussi de l'action de faire un certain sifflement, par lequel on imite le cri de la chouette, pour attirer des oiseaux. - (10) |
| frouer. v. n. Ressentir une chaleur cuisante sur quelque partie du corps. L'hiver, quand la bise vous pince les oreilles, on dit : Les oreilles me frouent. (Annay-sur-Serein). - (10) |
| frou-frou, loc. faire du frou-frou, faire l'important, faire de l'étalage, prendre de grands airs. - (08) |
| frougi : frotter un vêtement entre ses doigts. A - B - (41) |
| frougouner, v. tr., remuer, mais d'une façon ennuyeuse : « Ah! p'tiot, que qu’te frougounes donc tôjor à coûté d'moi ? » (V, Fregoner, Bouliguer, Ranger.) - (14) |
| frouille : intention douteuse. A - B - (41) |
| frouillè : tricher - (46) |
| frouille n.f. Fraude, tricherie. - (63) |
| frouille : s. f., tricherie au jeu. - (20) |
| frouille, s. f., fraude, tricherie. - (14) |
| frouiller (v. tr.) : fouiller, trifouiller - (64) |
| frouiller : tricher. la tricherie est la frouille et le tricheur est un frouillou. - (62) |
| frouiller : v. a., vx fr. froier, frotter ; tricher au jeu, faire perdre. - (20) |
| frouiller, frouillon, tricher. - (05) |
| frouiller, v. a. froisser avec la main, chiffonner, fripper. - (08) |
| frouiller, v. tr. et intr., tricher, tromper son adversaire au jeu : « J'quitte la partie ; te n'fais qu'frouiller. » - (14) |
| frouiller. Tromper au Jeu tricher. - (49) |
| frouillerie (na) : tricherie - (57) |
| frouilleur, frouilleuse, frouillon, frouillonne : adj., tricheur, tricheuse. - (20) |
| frouilleur, frouillon. Tricheur. - (49) |
| frouilli : froissé. A - B - (41) |
| frouilli : tricher - (57) |
| frouilli v. Tricher. - (63) |
| frouillon (on) : tricheur - (57) |
| frouillon n.m. Tricheur. - (63) |
| frouillon : s. m., frison, copeau. - (20) |
| frouillon, et frouilloû, adj., tricheur au jeu, trompeur : « Te gagnes, mais pasque t'ét un frouillon. » - (14) |
| froule. s. f. Feuilles. (Armeau). - (10) |
| frouleau. n. m. - Tourbillon de vent ; synonyme d'atourbou. « La cassiette à Titi alla a été prie dans un frouleau, alle est montée aussi haut ! l' l'a jamais r'trouvée ! » Histoire véridique ! (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| froulée. s. f. Volée de coups, frottée. Synonyme de Dégelée. – Se dit aussi pour grand nombre, quantité. Le vent a fait tomber des froulées de pommes. - (10) |
| frouler. v. a. Battre, étriller, frotter. Se dit aussi pour frôler, toucher légèrement en passant. (Germigny). – Se dit également de l'action de faire rôtir, de faire griller des châtaignes dans un frou. - (10) |
| froullyi, v. a. tricher au jeu. Adjectif et subst. frouillon. - (24) |
| froullyi, v. a. tricher au jeu. Adjectif : frouillon. - (22) |
| froûlon, frolon. n. m. - Frelon. - (42) |
| froûlot : tourbillon (mini tornade) - (48) |
| froulot : tourbillon de vent par journée orageuse, mini tornade. Le froulot peut aspirerrins de paille ou de foin sec jusqu'à 10 à 20 mètres. Le froulot précède souvent l'orage : le tourbillon de vent précède souvent l'orage. - (33) |
| froûlot : tourbillon du vent - (39) |
| froulot. s. m. Tourbillon. (Etais). - (10) |
| froulot. s. m. vent impétueux, tourbillon. (Voir : foulot.) - (08) |
| froumage (un) : un fromage - (61) |
| froumage, froumège, fourmage, formage. n. m. - Fromage. Froumage mou désigne le fromage blanc. - (42) |
| froumage, s. m., fromage. - (14) |
| froumageôt, et fromageon, s. m., fruit de la mauve, dont la forme capsulaire figure un petit fromage, que les gamins mangent avec avidité. - (14) |
| froumagère, s. f., mauve à feuilles rondes, dont les enfants recherchent le fruit. - (14) |
| froumaige : fromage - (48) |
| froumaige : fromage. Avec le lait on feto du fromage : avec le lait on faisait du fromage. - (33) |
| froumaize : fromage - (39) |
| froumège. s. m. Fromage. Du bon froumège. – A Etivey, on dit Fronmège. - (10) |
| froument : froment - (48) |
| froument : froment. - (33) |
| froument : froment - (39) |
| froument, s. m. froment, blé. - (08) |
| froumer : fermer. Ex : "Froume la porte, n'y fé fré !" - (58) |
| froumer, fourmer, fromer. v. -Fermer : froumer la pourte. - (42) |
| froumer. v. a. Fermer. - (10) |
| froumi : fourmi. IV, p. 27 - (23) |
| froumiller. v. - Fourmiller. - (42) |
| froumiller. v. n. Fourmiller. Se dit d'une sorte de picotement multiple, de chatouillement qu'on éprouve quelquefois dans un membre engourdi, et qui ressemble à celui que pourrait causer une multitude de fourmis qui se promèneraient sur ce membre en le mordillant. Ça me fourmille dans les pieds. - (10) |
| froumion : voir froumi - (23) |
| frousse, grande frayeur ; el è lai frousse, il a la frousse. - (16) |
| frouster : (froustè) 1- (v. int.) courir, se dépêcher, se sauver à toute allure. 2 - se hâter, être pris par le temps. - (45) |
| frouter. v. - Frotter. - (42) |
| frouyi : (vb) tricher - (35) |
| frouyi : tricher - (43) |
| fru, fruit (fructus). - (04) |
| fru, fruit ; fruté, fruitier ; fruté se dit aussi adjectivement d'un vin qui a bien le goût du raisin et est moelleux, - (16) |
| fru, fruit. - (26) |
| fru, s.m. fruit ; un dicton populaire dit : "année de gevru, année de fru" (année de givre, année de fruits). - (38) |
| fru, sm. fruit. - (17) |
| fru. Fruit, fruits. - (01) |
| fructiôle, fructifère. - (27) |
| fruction. Fluxion. Pneumonie : « avoir une fruction de poitrine ». - (49) |
| fruitaille, futaille. n. f. - Ensemble des fruits. - (42) |
| fruiter : v. n.. avoir le goût du fruit. Du vin qui fruite bien. - (20) |
| frure : Aspirer et avaler un aliment semi-liquide. « Frure eun û » gober un œuf. - Au participe passé : frué, « J'ai frué un û ». - (19) |
| frus : les fruits - (46) |
| frusques (pour frustes). s. f. pl. Nippes, vêtements, tout ce qu'on a d'effets, tout ce qu'on possède en fait de linge et d'habits. Prends tes frusques, et fiche ton camp. Du latin frustum. - (10) |
| frusquin. Les Languedociens disent fresquin (Dict. de l'abbé Sauvage). Ailleurs, on dit frisquin. Manger son saint frisquin (je crois qu'on devrait dire son sien frisquin), c'est dépenser son avoir. D’après Ducange (Gloss. med. et inf. latin.), frustum terra signifie parcelle de terre, la partie d'un bien. - (02) |
| frusquin. : Argent, nippes, ce qu'on possède. - D'après Ducange, ce mot serait emprunté au vocabulaire de la moyenne latinité où frustum terroe signifie parcelle de terre. Or, pour le villageois qui a quelque bien en terres, dépenser son saint frusquin, c'est manger son fonds. - (06) |
| frut : Fruit. « Plianter des abres à fruts » : planter des arbres fruitiers. « Botans à fruts » : bourgeons à fruits. - (19) |
| frût, s. m., fruit, de n'importe quelle nature. - (14) |
| frûterou froûter : humer du bouillon ou de la soupe - (60) |
| fruts, fruits. - (05) |
| f'to : faire. O f'to fré : il faisait froid. - (33) |
| fu (on) : feu - (57) |
| fu : (nm) feu - (35) |
| fu : feu - (51) |
| fu : feu de cheminée - (43) |
| fû : Feu. « Site te dan, te prendras eun ar de fû. - Y est pas l'embarras, pa ce temps de liage eun ar de fû vaut mieux qu'eun ar de violan ! ». - « Y est au fû », se dit quand les choses coûtent très cher et que tout le monde en veut. - (19) |
| fu du çeu (ou du ciel) : (nm) foudre - (35) |
| fû du cié n.m. Foudre, feu du ciel. - (63) |
| fu du ciel : foudre - (43) |
| fu du ciel. Foudre. - (49) |
| fû n.m. Feu. - (63) |
| fu : feu. - (21) |
| fû, feu. - (05) |
| fu. Fus, fut, verbe. Fu, substantif, signifie un fuseau, des fuseaux. - (01) |
| fuâ : Pigeon fuyard. « Ma si j'élevais des pigeans j'amerais mieux les pattous que les fuâs ». (Autrefois les pigeonniers s'appelaient fuyes). - (19) |
| fuadze : bête peureuse. A - B - (41) |
| fuadze : bête peureuse à la moindre occasion - (34) |
| fuamman. Couramment (voy. Coramman). Le fuamman vient de fuir, le coramman de courre, pour donner à entendre que la facilité avec laquelle on fait telle et telle chose est si grande, qu'on la ferait tout en fuyant, tout en courant. - (01) |
| fuard, fuardze n. et adj. Peureux, peureuse, sauvage. - (63) |
| füard, s. m., pigeon. (Le vieux mot fuie voulait dire colombier.) - (14) |
| fue. Feu, comme bue pour bœuf, et ue pour œuf, vieux mot. - (03) |
| fuêillat (na) - fouêillat (na) : flambée - (57) |
| fuer. : (Dial.), chasser, expulser (du latin fugare, mettre en fuite), expression du livre de Job. - Dans notre patois, fuammam signifie couramment et il est formé du latin fugoe mente. - (06) |
| fugeaie. s. f. Fuseau. (Athie). - (10) |
| fuhi, s. m. fusil, arme à feu. - (08) |
| fuhi. s. m. Contraction de Fusil. Du bas latin fugillus. - (10) |
| fuiard, qu'on prononce fuard. Pigeon, du vieux mot fuie, colombier. - (03) |
| fuïllon, sm. groin ; gros nez. - (17) |
| fuillotte : n. f. Feuillette. - (53) |
| fuine, fouine. - (26) |
| fuitaine (Faire la). Locution usitée à Vassy-sous-Pisy, et qui signifie se retirer à l'écart, s'isoler de la compagnie, de la société, semble être synonyme de bouder, et doit être une forme du mot flûtaine. - (10) |
| fuiter, v. intr., fuir, couler par une fissure : « Ma tarine a fuité ; j'ons pas évu d'bouillon. » - (14) |
| fuiter, v. n. fuir, s'échapper par une fente, une fissure. un tuyau percé « fuite. » - (08) |
| fuja (nom masculin) : fuseau. - (47) |
| fujà, s. m. fuseau. - (08) |
| fumaiger, v. a. fumer, répandre du fumier. - (08) |
| fumaillon (f’maillon) : s. m., péjoratif de fumailloux. - (20) |
| fumaillou (un) : un jeune qui commence à fumer - (61) |
| fumailloux : s. m., fréq. de fumoux. - (20) |
| fûmâle, s. f., femelle (péjoratif). - (40) |
| fumard. s. m. Fumeron. - (10) |
| fumée : s. f. Accommodé à la fumée de mon cul, locution exprimant un souverain mépris. Il y a peut-être un rapprochement à faire entre celte locution et les « fumées, fiente des bêtes fauves » (Littré). - (20) |
| fuméle, s. f., femolle. Le paysan ne marchande pas pour ce mot ; il le donne carrément à sa femme, que cependant il appelle aussi sa fonne. - (14) |
| fumèle, sf. femelle. - (17) |
| fumelin. s. m. Homme passionné pour les femmes. (Vilhers-Saint-Benoît). - (10) |
| fumelle (nom féminin) (Péjoratif). mot vulgaire pour désigner une personne du sexe féminin. - (47) |
| fumelle (une) : une femme (désolé mesdames !) - (61) |
| fumelle , femelle. - (04) |
| fumelle n.f. Avec malice et familiarité, femme. Dans le Bourbonnais le fumelier était un coureur de cotillons. - (63) |
| fumelle : femme. Courant, mais souvent péjoratif et vulgaire. Usage machiste naturel. Ex : "Al' marchait ben, la fumelle !" - (58) |
| fumelle, s. f. femelle par opposition avec mâle, femelle d'animal ou de plante, du chanvre par exemple, et femme : « ç'ô eune mauvaille fumelle », c'est une méchante femme. - (08) |
| fumelle. Femelle en parlant des animaux. Se dit aussi d'une fille, d'une femme, dans un sens péjoratif. - (49) |
| fumelle. n. f. - Femelle ou femme. Employé dans un sens péjoratif.depuis le XIIe siècle : aller à la fumelle. - (42) |
| fumellier, fumelin. n. m. - Coureur de fumelles, de femmes : « Saleté, t'as profité de ce qu'il était saoul, hors d'état (sic) pour le mettre dans ton lit, ce fumellier-là ! » (Colette, Claudine à Paris, p.l69) - (42) |
| fumer : v. n.. vx fr., être en colère. Il en fume. Oh ! ce qu'il fume ! - (20) |
| fumer, v. fumer. - (38) |
| fumeras, fumeriaux. n. m. pl. - Petits tas de fumier au milieu des champs. On utilisait au XIIIe siècle le mot fumeras pour désigner le fumier. - (42) |
| fumère, n.f. fumée. - (65) |
| fumeriau. s. m. Petit tas de fumier. (Trucy, Champignelles). - (10) |
| fumeron, n.m. petit tas de fumier. - (65) |
| fumerons. n. m. pl. - Grosses cuisses. « Heulla t’as ti vu la Liliane ! Alle a d'ceu fumerons, faut voué ça ! » - (42) |
| fumeziau. s. m. Fumeron. (Germigny). - (10) |
| fumiére : s. f., vx fr., fumée. - (20) |
| fumoûére, échelle clayonnée pour le transport du fumier. - (14) |
| fumoux : s. m., fumeur. Les « fumouses », bien que nous n'ayons jamais entendu ce mot, ne sont pas rares. - (20) |
| fum'ron, tison fumant et qualificatif injurieux que l'on donne à quelqu'un de malpropre. - (16) |
| funmé, vt. fumer. - (17) |
| fur : Fuir. « Fu d'itié ! » : Va-t’en ! Ne s'emploie qu'à l'impératif. Aux autres temps on emploie le verbe sauvé. « O s'est sauvé ». - (19) |
| furette : voir meuhaigne - (23) |
| furiau, fuziau. s. m. Sureau. (Jussy, Truny). - (10) |
| furil. s. m. Fusil, par conversion de l’s en r. - (10) |
| furonsc’ille (on) - fu (on) : furoncle - (57) |
| fusée : quantité de fil qui peut garnir un fuseau. II, p. 12-16 - (23) |
| fusiau, s. m., fuseau. Les grand'mères l'emploient encore en filant au rouet : « La grande Glady, all'vas'casser ; alle é mince coume ein fusiau. » - (14) |
| fusiquer v. 1. Fouiller, chercher de manière désordonnée. 2. Regarder. - (63) |
| fusiquer : v. n., fouiller, fureter. - (20) |
| fusœ, s. f. fuseau. - (24) |
| fusseau, sm. tige verticale des ridelles d'une voiture. Échelon d'une échelle. - (17) |
| fusucien, s. m. escamoteur, saltimbanque qui se montre aux foires et fait, coram populo, des tours de physique. - (08) |
| futai ou futé. : Fin, rusé. - (06) |
| futaillier (fûtaillier) : s. m., vx fr. fusicillier, tonnelier. - (20) |
| futaine - le sens de courses, de promenades, de sorties, plus ou moins répréhensibles. - Ah laivou qu'al à ?... a corre lai futaine. - Ile core sai futaine to les sairs. - (18) |
| futaine (faire la), loc. faire des escapades. Se dit principalement des enfants qui, au lieu d'aller à l'école, vont battre la campagne. - (08) |
| futaine : école buissonnière. (G. T II) - D - (25) |
| futaine n'a rien de commun avec l'étoffe qui porte ce nom. Faire la futaine ou prendre la futaine, c'est se dérober, c’est s'enfuir. Quand nous allions au collège, nous appelions cela faire la ruine. - (13) |
| futainne, sf. fugue, escapade. - (17) |
| fute (fûte) : s. f., vx fr. fuste. fût. - (20) |
| futeille : Futaille. « Si an veut avoi du ban vin dans sa cave i faut d'abord avoi de la bonne futeille ». - (19) |
| futène ; on dit d'un enfant qui fuit l'école pour perdre son temps à courir çà et là, qu'il fait la futène ; on prononce aussi ce mot : fuitène (du mot fuite). - (16) |
| futer (fûter) : v. a. vx fr. fuster, surpasser, éclipser, avoir une supériorité marquée, contrarier avec. Se dit des personnes et des choses. - (20) |
| fûter, v. a. choquer la vue, heurter le goût : ce ruban trop voyant fûte. - (24) |
| futiau : (nm) futaie - (35) |
| futier (fûtier) : vx fr. fustier, s. m., charpentier en bateaux. Voir taquter. - (20) |
| fuyarde : bête peureuse - (43) |
| fùye, s. m. feu. - (22) |
| fûye, s. m. feu. - (24) |
| fuyoux : s. m., fuyard, réfractaire, déserteur. - (20) |
| fya : fléau. (B. T IV) - D - (25) |
| fyae, fléau. - (26) |
| fyin : fumier. (F. T IV) - Y - (25) |
| fyince : bouse - (39) |
| fyincer - (39) |
| g’nâppes : testicules - (37) |
| g’nâves : genévriers - (37) |
| gâ (syncope de gars), se dit en bonne et mauvaise part : bon gâ, bon sujet ; chti gâ, très mauvais sujet. - (16) |
| gâ : Sorte de sillon que le faucheur trace en ligne droite en marchant, d'une borne à l'autre, pour délimiter avant de la faucher une parcelle de prè dépourvue de clôtures, celui qui fait cette opération a soin de coucher et de tasser fortement l'herbe sous les pieds. - (19) |
| gâ – enfant, homme en général rusé, méchant. –Terme très familier. - C'â in bon gâ, vais ! – Défie-toi de lu, c'â in vilain gâ. - (18) |
| ga, int. regarde. Voilà ! Ga lu, c'est lui. - (17) |
| gâ, s. m. garçon, jeune homme : « not' gâ », se dit du « valôt » ou serviteur comme du fils de la maison. - (08) |
| gabachon. s. m. Garde-genoux de laveuse. - (10) |
| gaban : blouse bleue ou noire portées pour les sorties ou les jours de foire. A - B - (41) |
| gaban : blouse (biaude : aussi). (B. T IV) - S&L - (25) |
| gaban : blouse bleue ou noire que portaient les charollais pour les sorties, les foires - (34) |
| gaban : blouse bleue ou noire que portaient les charollais pour les sorties, les foires - (43) |
| gaban : blouse de maquignon. - (30) |
| gaban : blouse de paysan - (51) |
| gaban : blouse d'homme - (44) |
| gaban : blouse. - (62) |
| gaban : Courte blouse de toile bleue. « Ol a vêti san gaban neu » : il a revêtu son « gaban » neuf. - (19) |
| gaban n.m. Blouse de sortie, la biaude étant la blouse de foire. - (63) |
| gaban, blouse, roulière. - (05) |
| gaban, n.m. blouse. - (65) |
| gaban, s. m., blouse, roulière, synonyme de bliaude. (V. ce mot.) - (14) |
| gaban, s.m. blouse bleue des paysans. - (38) |
| gaban. Blouse bleue très en vogue autrefois. - (49) |
| gabardouler : tomber avec fracas - (51) |
| gabasser : Secouer un fut en vidange, brasser le liquide qu'il contient. - (19) |
| gabegie : Fraude, concussion. « Cet' (s't) affâre n'est pas cliare, i da y avoir de la gabegie » : cette affaire n'est pas claire, il doit y avoir de la fraude. - (19) |
| gabegie, s. f. tromperie, abus de confiance, tripotage malhonnête. - (08) |
| gabegie. s. f. Ruse, tromperie, affaire embrouillée, grabuge. - (10) |
| gabelle : gros criquet. (C. T IV) - S&L - (25) |
| gabelou : Employé des contributions indirectes. Cette appellation est prise en mauvaise part. Etym. gabelleur, officier de la gabelle (voir gapian). - (19) |
| gabelou, s. m., agent des contributions indirectes. - (40) |
| Gaberial, prénom, Gabriel. - (38) |
| gabet : taureau. (DC. T IV) - Y - (25) |
| gabet. s. m. Taureau. - (10) |
| gabgie - toute chose mal organisée ; ouvrage mal fait mauvaise entente. - Traiveiller queman cequi, ma ç'â de lai gabgie ! - A disant, a se dédisant, a se disputant, c'â ine vraie gabgie ; ne m'en pairlez pas. - (18) |
| gabi. Chargé. Cette expression est usitée dans les villages de la plaine. Qeu jouli âbre : al a gabi de poummes. — C’t’enfant qu’ast gabi de pôyons (de poux.) - (13) |
| gabiat (un) : un maladroit - (61) |
| gabidou (à la). exp. - Porter à la gabidou, porter sur les épaules, « à cheval ». - (42) |
| gabillot. s. m. Petit baril à eau-de-vie ; jeune veau mâle. (Collan, Courgis). - (10) |
| gabjie. Mets mal préparé, ratatouille, surtout quand la mauvaise qualité de la chose vient d'un mélange mal fait ; au figuré, mauvaise entente entre les gens, dissentiment. Etym. le vieux français gaber, se moquer des gens. - (12) |
| gablou : (nm) inspecteur chargé de contrôler les bouilleurs de cru - (35) |
| gaboille : Boue liquide. « Foule dan pas dans la gaboille » : ne marche donc pas dans la boue. - (19) |
| gaboïlle n.f. Eau boueuse. Boue liquide. - (63) |
| gaboïlli : Patauger dans la boue. « Quand i plio c'ment cen an gaboïlle tot san soû » : quand il pleut comme cela on patauge tout son saoul. - (19) |
| gaboïlli v. Se mouiller les pieds, patauger, barboter. - (63) |
| gabon : s. m. blouse bleue des paysans. - (21) |
| gabon : s. m., blouse en toile bleue. - (20) |
| gaborai - couvrir de taches, de saletés souiller. - La neu en é gaborai lai porte de gôille. – Lai vou que t'é don gaborai queman cequi tai figure ? – Ne vai pâ vé les peintres, te te gaboreras de couleurs. - (18) |
| gaboré uno personne, une chose : la couvrir d'ordures, de boue. - (16) |
| gaborer. Enduire de boue... ou d'autre chose. Petiot sâle ! tai chemise ast tote gaborée. - (13) |
| gaborer. Enduire quelque chose avec une substance quelconque, plus généralement en mauvaise part avec une matière malpropre. Etym. inconnue. - (12) |
| gaboron - grosse tache, enfant malpropre. - Qu'ée gaboron té fai lai su tai robe ! et pu su lai tabe ! – T'écris diére proprement, mon enfant, tai page à pliaine de gaborons. - T'é in petiot gaboron, vais ! - (18) |
| gaborré, enduite de malpropreté, de boue. - (27) |
| gaboué, gabois. s. m. Enfant hargneux, querelleur. (Courgis). Du roman gabeour, gabeor, et du bas latin gabator, ou bien encore du provençal gab, querelle, bruit, tumulte. A Etivey, gabois se dit pour mauvais cheval. - (10) |
| gabouille : s. f., eau boueuse, boue claire. - (20) |
| gabouille. Boue très claire. - (49) |
| gabouiller : v. n., barboter dans la gabouille. — S'emploie d'une manière impersonnelle en parlant d'un sol couvert de flaques d'eau boueuse. Ça gabouille rudement aujourd'hui. — Au fig., v. a., gâcher. - (20) |
| gabouiller. Patauger dans la boue ; s'emploie pour dire qu'il y a beaucoup de boue : « y gabouille » ; agiter de l'eau boueuse pour faire des remous, des glouglous. - (49) |
| gabouillon : s. m., linge, généralement de couleur, qu'on n'emmaise pas avec les autres, mais qu'on rince en même temps qu'eux. - (20) |
| gabouilloux. Qui se plaît à gabouiller. - (49) |
| gabou-yi : (vb) patauger - (35) |
| gabouyi, v. a. 1. Salir, détériorer : gabouyi ses habits. —2, v. n. Être boueux : ce chemin gabouye — 3. v. r. Brouiller, au propre et au figuré : le ciel se gabouye ; ses affaires se gabouyent. - (22) |
| gaboye : boue (de neige) - (43) |
| gaboyi : se souiller. Se laver de façon sommaire. A - B - (41) |
| gabo-yi : jouer dans l'eau - (43) |
| gabòyi, v. a. 1. salir, détériorer : gaboyi ses habits. — 2. v. n être boueux : ce chemin gabòye. — 3. v. r. brouiller, au propre et au figuré : le ciel se gabòye ; ses affaires se gabòyent. - (24) |
| Gabriai. Gabriel. - (01) |
| gacenô et gaichenô , un garçon ; ène gaichôte, et même ène jasôte, une jeune fille. - (02) |
| gacenô, gaichenô et garcenô. : Adolescent, jeune homme. - Le dialecte disait gars puis garson et garchon. (Roq.) Le patois a féminisé le mot ci-dessus en gaichôtte et gaichôtte, et même jaisôtte. - Au mot gars on a supprimé l'r et l'on a dit un gas, un grand gas, un gas bien alluré. En FrancheComté on dit aussi bien béçote que gachote (l'abbé Dartois). La différence n'est pas grande avec les mots du dialecte bacelote et bacheloteet l'expression française bachelier. - (06) |
| gach’neu : garçon. - (66) |
| gâche, s. f. pâte de pain dont on fait des galettes grossières en y mêlant de l'huile ou autres assaisonnements : faire de la « gâche. » - (08) |
| gâche. s. f. Sorte de gâteau. (Domecysur-le-Vault). - (10) |
| gacheneu, gacheute : gamin, gamine. (N. T IV) - C - (25) |
| gachenin : jeune garçon. (CLF. T II) - D - (25) |
| gachenöt, sm. garçonnet. - (17) |
| gacheute : fille. - (66) |
| gâchi : gâcher - (57) |
| gachi v. Rincer sommairement (la vaisselle). - (63) |
| gâchiller. v. a. Mâcher, mâchonner, mastiquer. Je n' peux pas gâchiller mon pain. (Courgis). - (10) |
| gachilum : n. m. Sparadrap. - (53) |
| gachnin : garçon. (PLS. T II) - D - (25) |
| gach'nin, garçon. - (26) |
| gachon, sm. garçon. - (17) |
| gachöte, sf. fillette. - (17) |
| gaçon. s. m. Garçon. - (10) |
| gadan : s. m. tige de chanvre mal venu. - (21) |
| gadan, s.m. grande pièce de toile de chanvre grossière que l'on emploie pour couvrir ou contenir du linge. - (38) |
| gadanche : Levier en bois adapté à l'écrou de la vis du pressoir. « Donner in cô de gadanche » : pousser la gadanche pour faire descendre l'arbre du pressoir. - Au figuré, « Donner in cô de gadanche » signifie verser à boire, faire couler le vin de la bouteille comme le coup de gadanche le fait couler du pressoir. - (19) |
| gadanche : s. f. barre de fer servant à serrer la vis du pressoir. - (21) |
| gade : (nf) petite branche de résineux pour allumer le feu - (35) |
| gade : branche de résineux - (43) |
| gade : branches de sapins séchées - (51) |
| gade : instrument au bout d'un long manche pour nettoyer le four. - (30) |
| gade : tissu humidifié que l'on passe dans le four à pain chaud pour nettoyer la cendre qui reste après avoir retiré les braises - (51) |
| gade n.f. (du germ. wadal, le plumeau). Branche sèche pour allumer le feu. - (63) |
| gade, 2e personne de l'impératif : regarde. - (54) |
| gade, garde. - (27) |
| gade. Garde, substantif, ou masculin, un gode du cor, un garde du corps ; au féminin, Dieu vos oo an sai sainte gade, Dieu vous ait en sa sainte garde ; il est aussi verbe, je gade, je garde, tu gade, tu gardes, ai gade, il garde, ils gardent. - (01) |
| gadeau. s. m. Personne de mauvaises mœurs, de conduite sale et déréglée. Se dit sans doute pour gadoue, ordure. - (10) |
| gader : passer la gade dans le four à pain - (51) |
| gader : regarder - (44) |
| gadier : grenier à gade (branches de sapins séchées) - (51) |
| gadier, vt. garder. - (17) |
| gadin : chute - (60) |
| gadin : s. m., galet, pavé. Ramasser un gadin, ramasser une pelle (tomber). - (20) |
| gadin. n. m. - Grande écuelle en grès. - (42) |
| gadin. s. m. Pièce de vaisselle. (Villiers-Saint-Benoit). A Vertilly, ce nom se donne à un petit plat. Dans la Puysaie, c'est une grande écuelle de grès. - (10) |
| gadinée. n. f. - Grosse quantité, contenu du gadin : eune gadinée d’soupe. - (42) |
| gadinée. s. f. Contenu d'un gadin. Une gadinée de soupe, de pommes de terre, de haricots, etc. (Puysaie). - (10) |
| gadiou, sm. gardeur. - (17) |
| gadiou, sm. toile grossière faite d’étoupe et d'œuvre. - (17) |
| gadje, sf. garde. Baillez-vo gadje, prenez garde. Baille-te d'gadje, prends garde. - (17) |
| gadjenöt, sm. linge pour habiller le cuvier. - (17) |
| gadoi, vidangeur.Dans le langage des Trouvères, gadoue signifie immondice. - (02) |
| gadoi. : Vidangeur. Dans le dialecte, ,gadoue signifie fumier, immondices. (Roq.) - Dans le Châtillonais, en Bourgogne, on dit gassouiller et une flaque d'eau boueuse se nomme gassouillat ou, par abréviation, gouillat. - Gargouilli dans l' eà c'est tripoter dans l'eau et l'on nomme gargouillou celui qui le fait. - (06) |
| gadou, s. m., gadouard, vidangeur. - (14) |
| gadoue, s. f., matière que remue le vidangeur. - (14) |
| gadoueille : boue - (39) |
| gadouillage : s. m., action de gabouiller ; syn. aussi de gabouille. - (20) |
| gadouille (nom féminin) : boue, sol détrempé. - (47) |
| gadouillè : patauger dans la boue - (46) |
| gadouille : boue - (39) |
| gadouille, subst. féminin : boue. - (54) |
| gadouillou (adjectif) : état d'un sol boueux. - (47) |
| gadouillou : boueux - (44) |
| gadouillou : celui qui marche dans la boue - (46) |
| gadoulin, adj. faible d'esprit, en langage plaisarnt. - (22) |
| gadôye - (39) |
| gadroïlle n.f. Eau troublée par une intervention, un passage. - (63) |
| gadroïlli v. Patauger, éclabousser. - (63) |
| gadrouille : s. f., gabouille, avec un sens péjoratif. - (20) |
| gadrouille, boue très-liquide. - (05) |
| gadrouille, s. f., eau sale, boueuse, vase, et aussi boisson désagréable, sauce mal apprêtée, etc. - (14) |
| gadrouille. s. f. Grosse femme mal propre. - (10) |
| gadrouiller : v. n., gabouiller, avec un sens péjoratif. - (20) |
| gadrouiller, v. tr., gâcher, salir, barboter dans l'eau, marcher dans la boue. - (14) |
| gadrouillon, s. m. gâchis d'eau répandue. Plat mal cuisiné. - (22) |
| gadröyi : (vb) patauger dans la boue - (35) |
| gadroyi : boire beaucoup au bistrot - (43) |
| gadro-yi : patauger dans la boue - (43) |
| gadròyon, s, m. gâchis d'eau répandue. Plat mal cuisiné. - (24) |
| gadröyye : (nf) boue (de neige fondue) - (35) |
| gafer, v. intr., patauger, mettre les pieds dans l'eau de manière à la faire jaillir. Se dit des gens, des chevaux, etc. - (14) |
| gâffée (n. f.) : quantité indéterminée - (64) |
| gaffée. n. f. - Contenance des deux mains bien jointes. - (42) |
| gaffée. s. f. Plein les deux mains, tout ce que peuvent contenir les deux mains. (Sainpuits). – Se dit ainsi pour caffée, de caffe et du latin cavea, enfoncement, creux, dépression daus une surface qui devrait être plane. Dans le cas présent, il s'agit de creux formé par les deux mains réunies. – A Trucy, gaffée signifie grosse charge, par extension sans doute. - (10) |
| gâfoueiller : manger en gâchant la nourriture, manger hors des heures de repas - (39) |
| gâfoueillou : qui « gâfoueille » - (39) |
| gafouiller, v. tr., remuer, agiter en tous sens et en désordre. - (14) |
| gâfre, greffe. - (16) |
| gagé : s. m., cultivateur à gages. Estce que vous avez un vigneron ou ben si vous faites faire vos vignes par un gagé ? - (20) |
| gagi : gager - (57) |
| gagin. s. m. et gagine. s. f. Garçon, fille, se dit, plus particulièrement, d'un garçon et d'une fille qui ont échangé des gages, des promesses de mariage. - (10) |
| gagnatse, niaque : mâchoire - (43) |
| gagneau (grand). s. m. Fat, maniéré, vaniteux. (Percey). - (10) |
| gâgner l’aivouaine: gagner l’avoine (se dit de l’âne qui se roule sur le dos dans le pré en brayant bruyamment) - (37) |
| gagner la belle, locution verbale : terminer un travail avant l'heure prévue. - (54) |
| gâgner vé lai traisse : se diriger vers la haie - (37) |
| gagni : gagner - (43) |
| gâgni : gagner - (51) |
| gagni : Gagner. « Les portous d'heuttes gagnant des bonnes jornées » : les porteurs de hotte gagnent de bonnes journées. - (19) |
| gâgni v. Gagner. - (63) |
| gagnouler : pleurer pour un chien. Par dérision étendu à l'homme - (51) |
| gagnoûler v. Japper, aboyer de douleur ou d'ennui. - (63) |
| gâgo, gâgote, cagot, cagotte, religieux par excès. Ce mot semble dériver du grec kakos, mauvais ; une religion excessive est, en effet, mauvaise. - (16) |
| gagot : personne très pratiquante - (43) |
| gagoue. s. f. Femme sale et de mauvaise conduite. (Saint-Florentin). - (10) |
| Gâgui, prénom, Marguerite. - (38) |
| gaguie. s. f. Fille. Une grousse gaguie, une grosse dondon, une bonne grosse fille. (Sacy). - (10) |
| gaguin. s. m. Garçon, (Sacy). - (10) |
| gahet (par contraction de guaret). s. m. Guéret. - (10) |
| gai ! à gauche, en parlant aux bœufs à la charrue. - (05) |
| gai – outre le sens ordinaire du français, agile, leste. - A sont joliment gai ! en dansant lô pieds tuchant ai pogne lai terre. - Lai Claudine à bein gaite, vais, ile saute en bas de lai voiture absolument queman in gairson… et pu bein ! - (18) |
| gai, gaite, adj. gai, d'humeur accommodante. Se dit des choses comme des personnes. - (08) |
| gai, gaite, adj. gai, gaie. - (17) |
| gaibelou, percepteur d'impôts sur certains objets de consommation , le vin par exemple... - (02) |
| gaibelou. Gabeleurs, maltotiers. - (01) |
| Gaibeurié. Nom d'homme Gabriel. - (08) |
| gaicenot - petit garçon. Ce mot, importé chez nous, est peu usité. - (18) |
| gaichon (gaiçon) : garçon - (51) |
| gaîchon. s. m. Garçon. (Vassy-sousPisy). - (10) |
| gaichöt, sm. cachot. - (17) |
| gaiçon (gaichon) : garçon - (51) |
| gaidan – grosse toile de fil dont on faisait des couvertures de lit, chargées de dessins grossiers eux-mêmes. – Hier, in toindou â venu, et pu i li ai fait toindre in gaidan aivou de jolies flieurs ; bein jolies, vous vouairà. - (18) |
| gaidan, drap que l'on étend sur le cuvier entre le linge et la cendre, dont le Glossaire nous fournit un équivalent sous le nom de fleuret. - (11) |
| gaidoûille, gaibouîlle : boue épaisse - (37) |
| gaidrouille, sf. femme de rien [vadrouille]. - (17) |
| gaie : n. m. Chemin forestier. - (53) |
| gaïenne. s. f. Cantharide. (Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes). - (10) |
| gaife : veuf, célibataire, impair, seul (s'utilise surtout à propos d'un bœuf non couplé) - (39) |
| gaife, adj. impair. Un bœuf, trois veaux, cinq moutons, etc., forment des nombres « gaifes. » - (08) |
| gaige, s. m. gage, garantie, salaire d'un domestique. - (08) |
| gaige, s. m., gage, garantie. - (14) |
| gaige, sm. gage. - (17) |
| gaigé, vt. gager. - (17) |
| gaige. Je gage, tu gages, il gage, ils gagent ; c'est aussi le substantif gage, singulier et pluriel. - (01) |
| gaiger, v. a. gager, faire une gageure. - (08) |
| gaiger, v. tr., faire une gageure. - (14) |
| gaigère. : Saisie. (Charte de 1245.) - (06) |
| gaigeure, s. f. gageure. - (08) |
| gaigeùre, s. f., gageure, pari. - (14) |
| gaigné. Gagner, gagné, gagnez. - (01) |
| gaiguéillotte (n.f.) : gorge, gosier - a.fr., gargaite, gargueton = gorge, gosier - (50) |
| gaijoure, sf. gageure. - (17) |
| gail’toûje : gamelle, récipient métallique - (37) |
| gaile, sf. gale. - (17) |
| gaileupin, sm. galopin. - (17) |
| gailimétchiâ : 1 n. m. Drôle de mélange.- 2 n. m. Gâteau très mauvais. - (53) |
| gailipotte : revenant, fantôme revêtu d’un suaire blanc - (37) |
| gaillâ (on) - tâneû (on) : gaillard - (57) |
| gaïllâ : Gaillard « Y est in solide gaillâ ». - (19) |
| Gaillar, nom de bœuf. - (08) |
| Gaillard : nom de bœuf. III, p. 29-o - (23) |
| gaillârde n. et adj. 1.Femme ou jeune fille de moeurs légères. 2. Femme ou jeune fille en pleine santé. - (63) |
| gaillarde. Jeune fille de mœurs faciles. Fig. Jeune fille très forte. On dit : « c'est une gaillarde ». - (49) |
| gaillaude, s. f. balai en chiffons avec un manche dont on se sert pour le nettoyage des fours. - (08) |
| gaille (n.f.) : truie - (50) |
| gaille (na) : truie (vieille) - (57) |
| gaille (nom féminin) : truie. - (47) |
| gaille : truie - (48) |
| gâille : truie. - (31) |
| gaille : (gay’- subst. f.) vieille truie. - (45) |
| gai-lle : n. f. Truie. - (53) |
| gaille : truie - (39) |
| gaille, gailla : s. f., boue. - (20) |
| gaille, s. f. femelle du porc, coche, truie. - (08) |
| gaille, s. f., truie gestante. - (40) |
| gaille, s. f., truie. (V. Treuë.) - (14) |
| gaille, subst. féminin : truie. - (54) |
| gaille, treûe : truie, femme de mauvaise réputation - (37) |
| gaille, treue. Truie. - (49) |
| gaille. s. f. Rosse, mauvais cheval. (Pasilly). Roquefort donne gaillofre dans le même sens. - (10) |
| gailllemafri (gaillemâfri) : s. m., Galimafré, nom d'un pitre bien connu à Paris au commencement du XIXe siècle, et qu'on applique aux personnes, grandes ou petites, qui se livrent à des bouffonneries. - (20) |
| gâillon - femme malpropre, qui sâlit tout, ne soigne rien. - Ne vai pas prenre c'te feille lai, il ne seré jaimâ qu'in gâillon. - C'â tot ai fait in gâillon, su lé et dans son mannège. – Quée gâillon, vais ! - (18) |
| gaïllon : flocon de neige - (60) |
| gaillon. Souillon ; se dit plus habituellement des servantes malpropres. Etym. haillon, dont l’h aspirée s'est adoucie en g. - (12) |
| gaillon. : Petite servante de cuisine. (Del.) - (06) |
| gaillot : n. f. Mare. - (53) |
| gaillou : En loques, déchiré, vêtu de loques. « Alle laiche ses enfants aller tot gaillloux » : elle laisse ses enfants porter des vêtements déchirés. - (19) |
| gailö, gailo, sm. galop. - (17) |
| gailoche, sf. 1) galoche. 2) femme de rien. - (17) |
| gailochöt, sm. fainéant, vaurien, coureur. - (17) |
| gailop (n.m.) : galop - (50) |
| gailope (ai lai) : (à la) « va-vite » - (37) |
| gailôpe (ai lai), loc. a la galope, c’est à dire en grande hâte et comme en courant au galop : « i é fé ç'iai ai lai gailôpe ", j'ai fait cela très vite. - (08) |
| gailôpin, s. un galopin, une galopine, jeune garçon ou jeune fille qui aime à jouer, à folâtrer, à courir. - (08) |
| gailôpiner, v. a. faire le galopin, la galopine. - (08) |
| gaïlou (ū), adj. galeux. - (17) |
| gailou : celui qui a des éruptions de boutons suppurants - (37) |
| gaiman. Gaiement. - (01) |
| gaimouèche, triste nom donné à la gracieuse mésange. - (11) |
| gainaiç’e (lai) : (la) peau du visage - (37) |
| gainche. Proprement, c'est l’avance qu'on reçoit ou qu’on donne d'un certain nombre de pas à la course ; de là figurément gainche pour licence… - (01) |
| gainche. : (Dial. et pat.), gauche. Tournure gainche ; se gainchai, se pencher.- Le verbe gainchir est employé par le sire de Joinville dans le même sens que le français gauchir. - (06) |
| gaindôl: casserole. (RDB. T III) - S&L - (25) |
| gaindraûle : vieille gamelle - (37) |
| gaingnant (on) : gagnant - (57) |
| gaingné, vt. gagner. - (17) |
| gaingne-pain (on) : gagne-pain - (57) |
| gaingner, v. a. gagner, faire un gain. - (08) |
| gaingnes - loques, vêtements usés et malpropres. - Quoi qu'ile veint don trainnier ses gaingnes iqui ? - C'a ine traingne gaingnes. - Pôre gairson, â traingne ses gaingnes por les rues ! – On peut voir gueuniai. - (18) |
| gaingni : gagner - (57) |
| gaingnou (on) : gagneur - (57) |
| gainmater : Gémir, geindre. « Ol est tot le temps à gainmater » : il ne cesse de gémir. - (19) |
| gaîn-ne (na) - corset (on) : gaine - (57) |
| gaiñne n.f. Gaine. - (63) |
| gaiou, sm. petite mare. - (17) |
| gairaignâ : n. m. Habitant du quartier La Garenne. - (53) |
| gairaiye : misère - (37) |
| gairaïye, gu’nîlloûx : loqueteux, miséreux - (37) |
| gairaude, garaude (n.f.) : femme ou fille débauchée - (50) |
| gairçon, garçon ; au lieu de dire : mon fils, un vigneron dit toujours : mon garçon, quel que soit l'âge de son fils. - (16) |
| gairçon. s. m. garçon, enfant mâle. - (08) |
| gairde, s. m. garde, gardien d'une propriété. - (08) |
| gairder (v.) : garder - (50) |
| gairder, v. a. garder, conserver, surveiller. - (08) |
| gairdou, ouse, s. m. gardeur, gardeuse, celui ou celle qui garde, qui surveille : « eun gairdou d' vaiches, eune gairdouse d'oués. » - (08) |
| gaire. Gare, espèce d'impératif pour avertir quelqu'un de se détourner… - (01) |
| gaireau - averse, forte pluie qui ne dure qu'un instant. - Ce n’â qu'in gaireau, ma cié tojeur fait du bein : ci ôte le feu de lai terre. - To ces gaireaux qui ne laichant pas que de nos contrariai pour nos foins. - (18) |
| gaireau : n. f. Averse d'orage ou très grosse pluie. - (53) |
| gaireau, averse orageuse. - (28) |
| gairéille (n.m.) : chiffon pour nettoyer le four - (50) |
| gaireille : 1 n. m. Chiffon. - 2 n. m. Habit usagé. - (53) |
| gairelot, n. masc. ; étui. - (07) |
| gaireune, s. f. garenne. - (08) |
| gairgan - se dit d'un poulet à grandes pattes, et par malice, d'un homme à grandes jambes qui se tient d'une manière négligée. - Ne me pairlez pas de ces poulots lai de ces gairgans que sont méchants queman tot. - I ai vu ce gairson que vo mé dit : ah ! ma, c'a in grand gairgan. - (18) |
| gairgoichons - charançons. – Les gairgoichons s'ant mis dans note tiche. - Note bliai â to mégé des gairgoichons su note geurné. - (18) |
| gairgouaillé : v. t. Remuer la boue. - (53) |
| gairgouéiller : faire un bruit de gargouille (en parlant du ventre) - (48) |
| gairgouéillot, gairlûtot : gorge, gosier - (48) |
| gairgoûillou (ain) : (un) individu « bon-à-rien » - (37) |
| gairgueuchon : n. m. Charenson. - (53) |
| gairguillô, gosier... - (02) |
| gairguillot - gosier, cou, expression familière. - I te mettrai le pouce su le gairguillot, et pu te vouairé, mon gairson ! – C'â fini, quoi ! en faut qu'a s'airose le gairguillot, le mâtin qu'al à ! - (18) |
| gairguillote, garguillotte : n. f. Gorge. - (53) |
| gairguillotte, gairgainet : gosier - (37) |
| gairion, s. f. guérison, retour à la santé. - (08) |
| gairlot - étui à mettre les aiguilles. - Teins, mai feille, voiqui in joli gairlot. – Vais prenre ine aiguille dans mon gairlo… te sais. - (18) |
| gairlûtot : n. f. Pomme d'adam. - (53) |
| gairösse, sf. petite vache. - (17) |
| gairôt : toute petite averse - (39) |
| gairot, garot, sm. averse abondante. - (17) |
| gairzeillot, s. m. gorge, gosier, cou. (Voir : garguillot.) - (08) |
| gaissé, vt. secouer dans l'eau. Remuer vivement. [aiguayer.] - (17) |
| gaisson. Garçon. - (49) |
| gaissoyer, laver sommairement du linge dans peu d'eau. - (28) |
| gaîtcheau (on) : gâteau - (57) |
| gaite : Féminin de gai. « C'te fille est toje gaite » : cette fille est toujours gaie. - (19) |
| gaîte : gaie - (37) |
| gaite : gaie - èl â gaite, elle est gaie - (46) |
| gaîte, adj., en bonne santé, agréable à vivre. - (40) |
| gaite, adj., fém. de gai : « Alle é prou gaite, all'rit tôjor. » - (14) |
| gaite, féminin de gai ; ill' â gaite, elle est gaie ; une porte qui roule trop facilement sur ses gonds ou ne se ferme pas assez est trop gaite. - (16) |
| gaite. adj. - Féminin de gai. - (42) |
| gaite. adj. fém. de Gai. Une femme ben gaite. - (10) |
| gaitiâ : n. m. Gâteau. - (53) |
| gaitiâ, s. m., gâteau. - (40) |
| gaitiau : Gateau. « Le mairiage est in gaitiau mau salé, tot le mande en veut goûter » : le mariage est un gâteau peu salé tout le monde veut en goûter. - (19) |
| gaitouillé, vt. chatouiller. - (17) |
| gaitouillé. : Chatouiller. (A. P.) - (06) |
| gaîtreux , misérable, dépenaillé, gâtroux. - (04) |
| gaittre, dartre à la peau. - (05) |
| galafre : glouton, colosse. (S. T IV) - S&L - (25) |
| galâfre ou galâsse – gourmand, gros mangeur.- Quin galâsse ci fait ! C'â in vrai galâfre ai rasasiai. - (18) |
| galafre, adj. se dit d'un vêtement trop ample. - (22) |
| galâfre, adj., goinfre, gourmand. - (40) |
| galâfre, glouton. - (16) |
| galafre. adjectif. Glouton, gourmand. (Etais). Jaubert écrit galaffre. - (10) |
| galafre. Glouton, goinfre, vorace. S'emploie comme nom et comme adjectif : « un galafre » ; « aul est galafre ». - (49) |
| galafre. Goinfre. On a dit en vieux français galiffre pour gros mangeur. - (03) |
| galâfre. Gouliafre, gourmand, gros mangeur. Etym. gueule, gula. - (12) |
| galafre. n. et adj. - Goinfre, gourmand. - (42) |
| galafron n.m. (du vx.fr. goulafrer, goinfrer) Goinfre. - (63) |
| galairne (n.m.) : vent du nord-ouest ou d'ouest (du lat.pop., galerna - de Chambure a choisi la graphie de l'a.f. galerne) - (50) |
| galandure, s. f., galandage. - (20) |
| galant n.m. Amoureux, prétendant. - (63) |
| galapia : garnement - (60) |
| galapiâ, adj., gamin turbulent. - (40) |
| galapia, galopin, mauvais sujet. - (27) |
| galapiat. Mauvais sujet. (V. Garnipille.) - (13) |
| galapiat. s. m. Polisson, vaurien, mauvais sujet. L'abbé Corblet fait dériver ce mot de l'islandais galapin, dont il ne donne pas la signification. - (10) |
| galarme : vent du sud-ouest. - (33) |
| galarme ou galarne : voir galerne - (23) |
| galarme, galarne. n. m. - Galerne: vent d'ouest ou nord-ouest. - (42) |
| galarme, vent du nord - (36) |
| galarne (pour galerne). s. m. Vent froid, du nord-ouest. - (10) |
| galas. Même sens que galâfre. - (12) |
| galata : Galetas. « I fâ bin fra dans ce galata » : il fait bien froid dans ce galetas. - (19) |
| galatat. s. m. Mauvais garnement, vaurien. (Maligny). - (10) |
| galboudre : Prodigue. « Y est in galboudre, ol a tot miji san butin » : c'est un prodigue, il a tout mangé son bien. - (19) |
| galboudrer : Gaspiller. « Se mentre à galboudrer » : se mettre à gaspiller. - (19) |
| galceneu, jeune garçon. - (27) |
| gale, s. f., employé adjectivement pour qualifier une méchante personne : « Oh ! n'vas point d'avou alle ; y ét eùne vrâ gale. » - (14) |
| galeingne, sf. [galène] vieille brebis. - (17) |
| galené, s. m. noyer, arbre qui produit les noix. - (08) |
| galer. v. a. Gratter. Quand on a la gale, on se gratte c'est la cause pour l'effet. Par analogie, on dit que les vignerons galent la terre, parce qu'ils la piochent, et sans doute à cause du mal que cela leur donne. - (10) |
| galérer, v. a. se servir de la galère, rabot de charpentier que l'on manœuvre à deux. - (08) |
| galerne : vent de galerne = vent du nord-ouest. III, p. 24-d - (23) |
| galerne, s. m. le vent de galerne est chez nous le vent d'ouest, le vent de la pluie. - (08) |
| galetra : mansarde, comble. A - B - (41) |
| galetra : mansarde, comble - (34) |
| galette : galette ou tarte (on ne dit jamais « tarte » en patois) : « La galette ot bounne ch'è y ai du beurre dedans ; Ch'è n'y é point d'beurre dedans, la galette ne vaut ren ! » - (52) |
| galette : tarte (on ne disait jamais « tarte »). - (33) |
| galette : n. f. Tarte, on ne disait jamais "tarte" en patois. - (53) |
| galeuche : Galoche. « Motan de galeuche » : menton pointu et proéminent. - (19) |
| galeup : Galop « Aller le galeup » : courir très vite. Au figuré faire sa besogne avec plus de hâte que de soin. « San ovrage n’est jamâ bin fait, o veut aller le galeup, l'avance et le bin fait ne vant pas ensin ». - Réprimande. « Sa mère li a fichi in ban galeup » : sa mère l'a bien réprimandé. - (19) |
| galeuper : Galoper. « O se pliâ à fare galeuper san chevau » : il aime à faire galoper son cheval. - (19) |
| galeupin : Galopin. « In cheti galeupin » : un petit galopin. - (19) |
| galeux, galeuse : adj., qui a la peau, l'enveloppe ou la surface rugueuse. Fruit galeux. Agate galeuse. - (20) |
| gâleviâ. Crachat de grand format. Etym. le latin glarea, grain de sable, mais aussi, dans la basse latinité, chose gluante ; altération par une métathèse et une déformation. - (12) |
| galfatre, mendiant. On trouve dans le vieux français galfrettier, gueux sans feu ni asile. - (02) |
| galfatre. : Un gueux malpropre. L'ancien français dit galfretier (Lac.) ; M. le comte Jaubert donne au terme galefretiausa véritable étymologie, qui est frotteur de gale. - (06) |
| galfeurtié, s. m. coureur, vagabond, vaurien. - (08) |
| galfeurtier, galfeurtié (n.m.) : coureur, vaurien - (50) |
| galfeurtier. s. m. Enfant sale. (Tronchoy). - (10) |
| galfretier. Homme de rien, vagabond, malpropre. C'est le vieux mot français galefretier, que Littré fait venir de calfat, calfatier, d'où galefretier avec un sens péjoratif. Je ne puis m'empêcher de trouver cette Etymologie aventureuse, mais, faute d'autre !... - (12) |
| galgal. Niais, imbécile. - (49) |
| galibeurdâs (n.f.pl.) : prunes séchées au four pour faire des tartes - (50) |
| galibeurdàs, s. m. prunes cuites au four. - (08) |
| galimafrée. n. f. - Grosse quantité, nourriture lourde ; synonyme de gadinée : « La roûtie, ça vous r'gaillardit ; on s'en four' eun' galimafrée, on n'est pus l'même, on rajeunit. » (Fernand Clas, p.64). Ce mot d'origine obscure (peut-être picarde) signifiait en ancien français du XIVe siècle une sauce très épaisse ou bien un ragoût de diverses viandes mal préparé. Il est employé en français (rarement) de manière péjorative pour désigner un mets peu appétissant, une ragougnasse. Le dialecte poyaudin insiste plutôt sur l'aspect quantitatif.du mot. - (42) |
| galin, s. m., ablette, vairon. - (40) |
| galinant : s. m., terme du jeu de bouchon, se dit du sou dont on a taillé en biseau les deux arêtes du pourtour pour en faciliter le glissement sur le sol. Voir piquant. - (20) |
| galine (nom féminin) : truie qui a porté plusieurs fois. - (47) |
| galine : s. f., galet, palet, jeu du bouchon. - (20) |
| galine, s. f. truie qui a porté plusieurs fois. - (08) |
| galine, s. f., petite pierre et caillou plat. Les enfants jouent « à la galine » en tâchant, à une certaine distance, de renverser une pierre avec une moins grosse. Ce jeu s'exécute aussi en sautant sur un pied, et poussant devant soi la pierre avec le pied qui est à terre. Dim. de galet. - (14) |
| galine, s. f., poule. - (14) |
| galine, s. f., poule. - (40) |
| galine. s. f. Petit champ, petite pièce de terre ou de vigne. (Saint-Florentin). - (10) |
| galine. Sorte de jeu dans lequel les enfants tâchent de jeter à bas une grosse pierre avec une plus petite, et à une certaine distance ; diminutif de galet, caillou. C'est le jeu du palet. - (03) |
| galiner. v. – Gratter : se gratter la peau, ou gratter la terre avec un outil. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| galingne : brebis. (CLF. T II) - D - (25) |
| galipe. s. f. Portion détachée, enlevée d'une plus grande. Galipe de foin, de paille, brassée, poignée, fourchetée de foin ou de paille prise sur une meule, sur un tas. Se dit aussi d'un morceau de quelque chose, qui n'a pas été coupé, détaché avec un couteau, mais séparé de son entier ou d'une portion plus grosse par rupture ou déchirure. Une galipe de crêpiau, de pain, de galette, de tarte. - (10) |
| galipètes (s'emploie au pluriel). Saut en hauteur en signe de joie. - (49) |
| galipia, s. m., galopin, vaurien, rôdeur, vagabond ; qui ne travaille pas. Certains donnent ce mot avec un s ou un t final. - (14) |
| galipiau. s. m. Terme de flottage. Portion d'un train brisé. A la suite des embâcles qui se font quelquefois sur l'Yonne, quand il y a plusieurs trains de brisés, les flotteurs ont peine à se reconnaître au milieu des galipiaux confondus. – Ce mot, encore familier aux riverains de l'Yonne, n'aura bientôt plus d'objet ; dans un an ou deux, le flottage aura cessé d'exister, et, conséquemment, il ne pourra plus y avoir ni embâcles de trains, ni galipiaux. Dans quelques communes, on le dit pour guenille dans d'autres, à Charentenay notamment, il voudrait dire traître, méchant. - (10) |
| galipiaût (on) : galapiat - (57) |
| galipiaux. n. m pl. - Vêtements: « Cabrez-vous pou la danse, remuez ieux ben la panse, secouez les galipiaux de tous ces oubeuziots. » (Fernand Clas, p.l22) - (42) |
| galipiot : gamin, enfant - (51) |
| galipiot n.m. Galopin, garnement. - (63) |
| galipote : fantôme habillé d'une peau de bête pour effrayé les passants (région de Ballore). A - B - (41) |
| galipote : être fantômatique…. Ou animal mythique et maléfique hantant les humains. - (62) |
| galipote : fantôme - (44) |
| galipote n.f. Fantôme. Au XVIIIe s. courir la galipote, c'était aller au sabat sur un manche à balai, être ensorcelé. L'idée de course s'est maintenue dans l'expression courir la prétentaine ou courir le guilledoux ; en patois charolais corre la galipote ou corre la pretentaiñne… - (63) |
| galipote : n. m. Petite créature noctambule sensée faire peur aux enfants. - (53) |
| galipote, sorte de loup fantastique qui rôde la nuit on dit ainsi de certains rôdeurs, qu'ils se déguisent en galipote. - (11) |
| galipote. Fantôme couvert d'un drap qui parcourt la campagne, la nuit, pour faire peur aux passants. - (49) |
| galipotte : fantôme - (48) |
| galipotte : personne qui se transformait en loup. III, p. 18 - (23) |
| galipotte, subst. féminin : animal fantastique, fantôme. - (54) |
| gallades. s. f. pl. Brebis. (Etivey). - (10) |
| galline. Jeu d'enfant, appelé ailleurs le bouchon. Ce mot est en usage dans le Hainaut aussi bien que dans la Bourgogne. - (13) |
| galline. s. f. Jeu de bouchon. Du vieux français galline, qui veut dire poule. Or poule, en terme de jeu, se dit de la mise des joueurs, représentée, dans la circonstance, par les sous posés sur le bouchon. - (10) |
| gallois. s. m. Fusain, arbrisseau dont les fruits rouges sont appelés vulgairement bonnets carrés. (Villiers-Saint-Benoît). - (10) |
| galoche : sabot à bride de cuir sur le coup de pied. - (58) |
| galocher : marcher ou courir en sabots. Faire du bruit avec ses sabots en marchant. Ex : "A galocher coum' ça dans la maison, té nous assabouis !" - (58) |
| galochî : lapider. Plus simplement : bombarder, canarder …de boules de neige par exemple. - (62) |
| galochier, galouchier. s. m. Synonyme de galtru, galapiat. Littéralement, traîneur de galoches usées, cassées, éculées ; espèce de va-nu-pieds. (Saint-Florentin). - (10) |
| galon (n. m.) : croûte qui se forme sur la peau après une blessure - (64) |
| galon, s. m., croûte d'une plaie. Sorte de mascul. de gale : « Pouih ! j'veux pas l’biquer ; ôl a des galons sur toute la figure. » - (14) |
| galon, s. m., gabillon de ruisseau. - (40) |
| galop (un coup d') : expression : rapidement, en vitesse... Ex : "Monte don au bourg d'un coup d'galop charcher du pain". - (58) |
| galopée (A la). Locut. adv. Avec précipitation. Faire une chose à la galopée, la faire trop vite et comme en courant le galop. (Villeneuve-les-Genêts). - (10) |
| galopiâ, galopin, coureur de rues. - (16) |
| galorer : mal peindre. (S. T III) - D - (25) |
| galot, s. m. jardin, enclos, défrichement au milieu des roches, très usité aux environ d'Avallon. - (08) |
| galotse n.f. Galoche à semelle de bois. - (63) |
| galotte. s. f. Pâte préparée comme celle de la galette, et qui, ensuite, étant coupée par petits morceaux carrés, se fait cuire dans du lait et se trouve, après quelques instants, mélangée dans une sorte de bouillie. Les enfants qui ont bon estomac sont friands de ce mets savoureux, mais assez lourd. - (10) |
| galoù, adj., galeux, principalement celui qui a de la crasse sur la tête. Aussi ce qui est inégal et rugueux. - (14) |
| galouaichai: patauger dans une flaque d'eau malpropre. - (33) |
| galouaichot : flaque d'eau malpropre. - (33) |
| galoubi. n. m. - Gourmand. (Perreuse, selon M. Jossier) - (42) |
| galoubi. s. m. Gourmand. (Perreuse). – Suivant l'abbé Corblet, ce mot voudrait dire, gamin, polisson. - (10) |
| galouchiat. s. m. Enfant dépenaillé, déguenillé. (Gourgis). – Voyez galochier. - (10) |
| galouècher : patauger - (48) |
| galouécher, v. n. faire du gâchis, manger malproprement. - (08) |
| galouèchot : gadoue, flaque d'eau sale - (48) |
| galouéchot, s. m. gâchis, tache ou flaque de boue liquide. - (08) |
| galouéchou, ouse, adj. celui qui est dans le gâchis, dans la boue, ou celui qui en fait, qui en répand. - (08) |
| galouferier (pour galoufrier). s. m. Micocoulier, arbre à fruit rouge, ressemblant à une petite cerise. (Perreuse). – Ce serait, suivant Jaubert, le sorbier allouchier de Boreau. - (10) |
| galoupée, galopée (à la). loc. adv. - Avec précipitation, à la va-vite : « I disait sa messe à la galoupée pour qu'a souyée pus toût finie et pour r'trouver un bon feu qui l'attendait. » (Fernand Clas, p.334) - (42) |
| galouriau. s. m. Petit vagabond. (Cuy). - (10) |
| galouse, s. f., bon gâteau local, dans la pâte duquel on mêle abondamment de petits cubes de courge. Après la cuisson, ces cubes, quoique très attendris, restent saillants à la surface, qui se trouve ainsi garnie de reliefs granuleux faisant disparaître le poli de la croûte. De là le nom : galouse, c'est-à-dire rugueuse. (V. Galoù.) - (14) |
| gâloux : Galeux « Ol en mijerait su la tête dun galoux » : il en est si friand qu'il en mangerait sur la tête d'un galeux. - (19) |
| galoux, galouse : adj., galeux, galeuse. - (20) |
| galoux. s. m. et adj. Galeux. (Etivey). - (10) |
| galtapiat. s. m. Vaurien, voyou, polisson. (Essert). - (10) |
| galtra : grenier sous les tuiles - (51) |
| galtrou : enfant - (61) |
| galtru : buveur d’eau, peu estimé. (LS. T IV) - Y - (25) |
| galtru. n. m. - Vaurien, menteur, personne à éviter : « J'ai écouté des tas d'galtrus qu'arrivint eveuc un' escorte de professeurs et d'malotrus. » (Fernand Clas, p.71) - (42) |
| galtru. s. m. Homme de rien, mauvais sujet. (Lichères). - (10) |
| galuche : friche. (S. T IV) - B - (25) |
| galuche. n. f. - Petite croûte qui se forme sur une écorchure ou sur une plaie. - (42) |
| galuche. s. f. Petite croûte, petite gale qui se forme sur une écorchure, sur un mal qui a suppuré. (Perreuse, Villeneuveles-Genêts). - (10) |
| galure, s. m., vieux chapeau. - (40) |
| galustrot. n. m. -Bon à rien, fainéant. (Sommecaise, selon M. Jossier) - (42) |
| galustrot. s. m. Vaurien, fainéant, paresseux. (Sommecaise). - (10) |
| galvaché : abîmer. (RDT. T III) - B - (25) |
| galvache : la conduite des bœufs au travail ou transport par charrette à bœufs. - (55) |
| galvache, s. f. travail exécuté par les bœufs du « galvaché » dans des régions lointaines : aller à la « galvache » : bœufs de « galvache », etc… - (08) |
| galvaché, s. m. charretier du Morvan qui entreprend des charrois dans les contrées éloignées et qui les exécute avec les bœufs qu'il a amenés. - (08) |
| galvacher : bouvier - (48) |
| galvacher : conducteur d'attelage de bœuf, bouvier (celt. gale : cri, appel) ? mais, en breton, galgacher désigne celui qui parle un méchant français ! - (32) |
| galvacher, galvauder, gaspiller, faire des dégâts dans les propriétés, voler. - (27) |
| galvacher, n.m. bouvier. - (65) |
| galvachou, s. m. coureur de grands chemins, vagabond, débauché. - (08) |
| galvaud. n. m. - Vagabond allant de ferme en ferme pour trouver un petit travail. Ce mot vient du verbe galvauder. On employa en français le nom galvaudeur ou galvaudeux jusqu'au milieu du XXe siècle, dans le sens de vagabond, rôdeur. - (42) |
| galvaud. s. m. Espèce de vagabond, travaillant sans suite, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, à toute sorte d'ouvrages, et souvent aussi ne faisant rien. - (10) |
| galvaudai, gâter, tripoter quelque chose ; c'est le sens qu'on donne à cette expression en Bourgogne... - (02) |
| galvaudai. : (Dial. et pat.), tripoter une chose, une affaire. (Del.) C'est aussi le sens que Lacombe donne au mot galvauder en le faisant dériver du bas latin caballicare. -D'autre part, le dictionnaire de l'Académie, 5e édition, donne au mot galvauder le sens de maltraiter quelqu'un de paroles : On l'a galvaudé d'importance. - M. Littré (Dict.), pense que ce mot doit son origine à celui du bas latin galbanum, casaque, vêtement de gens errants ou de pauvres ouvriers qui gâtent ou galvaudent ce qu'ils entreprennent. - (06) |
| galvauder : se promener - (44) |
| galvauder v. Errer. - (63) |
| galvauder, v. a. gâter, abîmer, bousiller. - (08) |
| galvauder. v. n. Travailler vite et mal. Du latin caballicare. – Signifie plus généralement travailler sans suite, en allant à l'aventure, en vagabondant.. Se dit, à Etivey, pour falsifier. - (10) |
| galvaudeux n.m. Traînard. - (63) |
| gama : gamay. (S. T IV) - B - (25) |
| gamache : s. f., vx fr., savate, pantoufle sans quartier ou dont le quartier est rabattu à l'intérieur. - (20) |
| gamache, s. f. mauvaise chaussure, savate. - (08) |
| gamache, s. f., pantoufle dont le talon est écrasé. - (40) |
| gamache, s. f., vieille chaussure, savate, soulier dont on a plié ou coupé le talon pour en faire une sorte de pantoufle. - (14) |
| gamache, s.f. pantoufle. - (38) |
| gamaches, mauvaises chaussures. - (04) |
| gambader : Boiter. « Le bliandiau li a bin racmeudé sa chambe cassée mâ o n'a tot de mou-in-me pas pouyu l'empôchi de gambader » : le rebouteux a bien réduit la fracture de sa jambe mais cela ne l'empêchera pas de boiter. - (19) |
| gambasser. v. - Tituber, ne pas tenir sur ses gambes : (jambe en ancien français). - (42) |
| gambe, s. f., jambe. (Le français en a encore gardé gambade et gambader.) - (14) |
| gambée, s. f., enjambée, grand pas : « Pour passer l'gouillat, i m'a folu fâre la gambée. » Quelques-uns, fautivement, prononcent cambée. - (14) |
| gambi (adj.) : boiteux - (50) |
| gambi : (gan:bi - adj. inv.) boiteux. - (45) |
| gambi : boiteux - (60) |
| gambi : boiteux (gambie : boiteuse). - (52) |
| gambi : boîteux - (48) |
| gambi : boiteux. - (09) |
| gambi : boiteux. - (32) |
| gambi : boiteux (gambie : boiteuse). Le gambi éto informe : le boiteux était informe. - (33) |
| gambi et gambillai - boiteux, boiter, tirer la jambe en marchant. - Al â gambi. - Dépeu qu'al â choué, à gambille in pecho. - (18) |
| gambi : n. m. Boiteux. - (53) |
| gambi(e) : boiteuse (euse) - (39) |
| gambi, adj., bancal, qui marche de travers, qui boite d'un côté : « Ol a chu d'Ia mate, é pi ôl en é resté gambi. » — « Ol é gambi ; ma c'qui n'I'empôche pas d'ginguer quand ô joue. » - (14) |
| gambi, boîteux - (36) |
| gambi, boiteux. - (05) |
| gambi, boiteux. - (27) |
| gambi, e, adj. celui qui a de mauvaises jambes, qui boite, qui est écloppé. - (08) |
| gambi, n. masc. ; boiteux. - (07) |
| gambi, qui ne marche pas droit... - (02) |
| gambi. adj. - Boiteux. Même origine que gambasser. - (42) |
| gambi. adj. Boiteux. - (10) |
| gambi. Boiteux, opposé à ingambe, de l'italien gamba, jambe. - (03) |
| gambi. Boiteux. Substantif de même origine que gambiller. - (12) |
| gambi. : Boiteux. Le verbe gambiller, dans le dialecte, signifie boiter (Roq. ), marcher tortu. - (06) |
| gambiguener : boiter - (39) |
| gambillai : boiter. T'ai une entorse ? tu gambille ! : tu as une entorse ? Tu boites. - (33) |
| gambillé : v. i. Boiter. - (53) |
| gambille, s. f., jambe. Synonyme moqueur et dim. de gambe : « n'se tient pu su ses gambilles. » - (14) |
| gambiller : boiter - (44) |
| gambiller : boîter - (48) |
| gambiller : boiter. - (52) |
| gambiller, boiter. - (27) |
| gambiller, gambi : boiter, boiteux - (36) |
| gambiller, v. ; boiter. - (07) |
| gambiller, v. intr., agiter les jambes de travers, boiter. Se prend toujours ironiquement. - (14) |
| gambiller, v. n. boiter, marcher en traînant la jambe. - (08) |
| gambiller. Ce mot signifie régulièrement agiter les jambes avec impatience, ne pouvoir les tenir tranquilles. Etym. gamba, jambe. - (12) |
| gambiller. Littéralement : marcher avec des gambes de bois. Les béquilles étaient appelées autrefois des billes. Par extension : chanceler comme un homme ivre. De là est venu l'adjectif gambillard et son diminutif gambi, boiteux, usités dans tous les villages de la côte... - (13) |
| gambiller. v. n. Boiter. (Arcy-sur-Gure). - (10) |
| gambilli : Boiter. « O gambille » : il boite. - (19) |
| gambillot, « L » nombillot, nombril , umbilicus. - (04) |
| gambiner : (gan:binè - v.intr.) boiter. - (45) |
| gambiner, v. n. traîner la jambe, boiter. - (08) |
| gambiollé : v. i. Boitiller. - (53) |
| gambit : Boiteux. « Alle se mairie d'ave in gambit » : elle se marie avec un boiteux. - (19) |
| gamborder : clopiner. - (29) |
| gamboule. s. f. Petite enflure locale. - (10) |
| gamelle : truie - (39) |
| gamelle, s. f. truie qui a porté plusieurs fois. - (08) |
| gamelle. s. f. Truie. (Pasilly). Se trouve aussi dans Jaubert. - (10) |
| gamin, gamine, s. enfant, fils ou fille. - (08) |
| gamin, ingne, smf. gamin, gamine. - (17) |
| gaming (n.m.) : gamin - (50) |
| gaming : gamin - (39) |
| gamingn', gamine : ces mots, qui ne sont pas étrangers au français, étaient exclusivement employés pour désigner garçons et filles. - (52) |
| gaminotte. n. f. - Petite fille, gamine. - (42) |
| gamion, mets de farine, œufs et lait cuits ensemble. - (05) |
| gamoche, s. f., petit escargot de buisson. - (40) |
| gamouéche (ai). Jeu d'enfants, le même que le jeu de bouchon, sauf que le liège est ordinairement remplacé par un morceau de bois taillé ad hoc. - (08) |
| ganache : savate, vieille chaussure. - (62) |
| ganache n.f. Mâchoire. - (63) |
| ganache : n. f. Injure ou vieille pantoufle. - (53) |
| ganache, personne faible et sans force... - (02) |
| ganache. Liqueur appelée eau de noix ou brou de noix. - (49) |
| ganache. s. f. Grosse mâchoire. – Figurément, homme faible, sans intelligence, sans volonté propre, qui subit toutes les influences et se laisse mener par le premier venu. - (10) |
| ganache. Soulier éculé et par extension pantoufle, à cause de sa ressemblance avec une mâchoire de cheval. Mets vitement tes ganaches pour ne pas te refroidi les piés su le paivé. - (13) |
| ganatse : mâchoire (on mettait une machoire de cochon au fond du cuvier l'on faisait la lessive). - (30) |
| ganbi, boiteux, - (16) |
| gance (nom féminin) : reculée de Loire. (Si t’veux « faire » un brochet va sur la gance, t’es sûr de l'avoir). - (47) |
| gancher. v. a. Balancer. (Domecy-surCure). - (10) |
| ganchette, s. m. gâchette, pièce de fer sur laquelle on appuie pour faire partir la détente d'une arme à feu. - (08) |
| ganconnôte, sf. primevère. - (17) |
| gandâilli v. (p.ê. d'égandiller). Secouer, houspiller. - (63) |
| gandaule, s. f. grande écuelle pleine de soupe. - (08) |
| gandeulon, sm. petite casserole. - (17) |
| gandieule, gamelle. - (26) |
| gandille. : Vagabonde. - (06) |
| gandoise, n.f. histoire mensongère. - (65) |
| gandoise. Mystification, mensonge pour rire. De gannum qui, d'après M. J. Quicherat, signifie dérision et déception et de aise, joie... - (13) |
| gandoises - farces, paroles pour rire, ordinairement peu modestes. - C'â des gandoises qu'a vo dit lai, des béties ; ne l'écoutez pas. - A ne dit que des gandoises. - Ne fais voué pas le béte en contant tes gandoises. - (18) |
| gandoises, choses qui amusent... - (02) |
| gandoises, subst. féminin pluriel : histoires farfelues et mensongères. - (54) |
| gandoises. Sornettes, choses futiles ou mensongères. Etym. absolument inconnue. - (12) |
| gandoises. : Fleurettes, sornettes. Je suppose que c'est une corruption de gaudoises (gaudere). - (06) |
| gandôle : n. f. Gamelle. - (53) |
| gandöle, sf. casserole. - (17) |
| gandole. Vieux chaudron, mauvaise casserole. - (49) |
| gandòler, v. intr., remuer ondulatoirement, balancer : « Quand ô marche, ô gandòle. » - (14) |
| gandolin, ine, s. celui qui manque de vigueur, d'énergie, qui agit ou parle avec nonchalance, mollesse. - (08) |
| gandouaise : n. f. Fadaise. exp. En faire toute une histoire. - (53) |
| gandouése (n.f.) : plaisanterie osée - (50) |
| gandouése, s. f. propos libre, plaisanterie salée. - (08) |
| gandouèses. Blagues, niaiseries : « raconter des gandouèses ». (Employé plutôt au pluriel). - (49) |
| gandouèze : bêtises, sottises - (39) |
| gandoulin. s. m. Homme dont les mouvements lents, la voix et la parole maises témoignent de peu d'intelligence et de peu d'énergie. C'est un gandoulin, dit-on, une espèce de gandoulin. - (10) |
| gandoure : les excréments des fosses septiques - (46) |
| gandouse : boue, ordures. - (30) |
| gandouse : s. f., gadoue. - (20) |
| gandouse, s. f., mélange de terre et de fumier. - (40) |
| gandouser : v. a., vidanger ; fumer une terre avec de la gandouse. - (20) |
| Gandoux : les maraîchers des Granges d'Auxonne - (46) |
| gandoux, gandousier : s. m., gadouard, vidangeur. S'appliquait autrefois exclusivement aux paysans de la Bresse qui venaient enlever la gadoue à Mâcon chez les particuliers. - (20) |
| gandrou, personne qui n'a point de tenue, et qui tue le temps... - (02) |
| gandrou. : Personne d'un extérieur très négligé. - (06) |
| ganet. s. m. Enfant ou jeune homme de peu de vigueur, qui vante sa force. C'est un diminutif de gas. Un fameux ganel. (Percey). – Il existe à Villeneuve-sur-Yonne une famille du nom de Gasnet. - (10) |
| ganf'lle : Ampoule. « D'avoi plieuchi i li a fait veni des ganf'lles » : d'avoir pioché lui a fait venir des ampoules. - « Etre ganf'lle » avoir le cœur gros, étouffer de chagrin ou de colère. - (19) |
| ganf'lli : Météoriser. « Sa vaiche est ganf'lle » : sa vache est météorisée. - (19) |
| gangan. s. f. Femme empotée, disgraciée par l'âge et les infirmités. Une vieille gangan. - (10) |
| gangner. v. - Gagner. - (42) |
| gangône : escargot. (R. T IV) - Y - (25) |
| gangoner, v. n. ronchonner, marmotter. Adjectif gangoni, gangonire. - (24) |
| gangonner : Marmotter des observations désagréables, des réprimandes. « Ol est toje après gangoner » : il est toujours en train de réprimander. - (19) |
| gangouin-ner : v. voir ègueurzansi. - (21) |
| gangouné, v. n. ronchonner, marmotter. Adjectif : gangounat, gangounârde. - (22) |
| gangrain-ne (na) : gangrène - (57) |
| ganguenaler : (gan:g'nalè - v. intr.) avoir du jeu, être mal affermi, comme l'outil qui branle dans sa gogue. On dit aussi gan:g'nèyé. - (45) |
| gangueneille (ai lai), loc. adv. sans vigueur, sans ressort, mollement, au hasard. - (08) |
| ganguenillai : même sens que beurloquai : cahoter. Tu parles d'être ganguenillé dans tous les sens dans ce véhicule : tu parles comme on est cahoté dans ce véhicule. Se dit aussi d'un individu qui a une démarche chaloupée : O se ganguenille dans tous les sens : il se balance dans tous les sens. - (33) |
| gangueniller, v. marcher de travers comme un homme saoul. - (65) |
| gangueniller, v., aller de gauche à droite, comme un homme saoul. - (40) |
| ganguenilleutte (f), objet qui pend en grappes. - (26) |
| ganguigné, ganglié, ganguenillé, vt. n. pendre, suspendre. Être pendu et secoué par le vent. - (17) |
| ganguignöte, sf. (environs de Minot) coucou des prairies et en général fleur dont la tige porte un ensemble de fleurons pendants. - (17) |
| ganiatse : (nf) mâchoire - (35) |
| ganif : Canif. « Prôtes me tan ganif » :prête moi ton canif. - (19) |
| ganif, canif. - (04) |
| ganif, s. m., canif. - (14) |
| ganifion : savate, chaussure usée - (61) |
| ganifouillous. n. m. pl. - Tas de guenilles, fouillis. (Rogny-les-Sept-Écluses, selon M. Jossier) - (42) |
| ganifouillous. s. m. pl. Tas de guenilles, fouillis. (Rogny). - (10) |
| ganiouler : (d’un chien) hurler - (35) |
| ganiouler : hurler (se dit d'un chien) - (43) |
| ganivelle : mécanique — femme bonne à rien. - (30) |
| ganivelle. n. f. - Objet sans valeur, camelote : « C'est pas de la ganivelle, c'est de la qualité ! » Également employé pour une personne dans le sens de crapule, vaurien. - (42) |
| ganivelle. s. f. Marchandise de rebut. (Sainpuits). – Signifie aussi, canaille, crapule. - (10) |
| gan-mèche : vieil habit. (LS. T IV) - Y - (25) |
| gannèche (Gan-nèche). s. f. Espèce d'habit à pans fort longs. Faut rac'moder ma gannèche. ( Villeneuve-les-Genêts, Perreuse). – Se dit sans doute pour Ganache, qui a le même sens, et qui vient du bas latin gaunace, gaunacum. - (10) |
| gannèche. n. f. - Vieux vêtement ne craignant plus rien, démodé, usé, porté uniquement pour effectuer des travaux ingrats ou salissants : « Il outa son chapiau qu'i' mit su' la tab'e, il enleva sa gannèche qu'i' laissa tomber su' eune chai'e. » (Fernand Clas, p.269). La gannèche est l'altération de garnache, ancien mot du XIIIe siècle, désignant une sorte de long sarrau porté pardessus le surcot, puis un manteau de voyage ou de pluie. Le terme poyaudin, comme le terme ancien français, a conservé le sens premier issu de garnir, protéger, faire attention, d'origine francique (que l'on retrouve dans le français « garnison » ). - (42) |
| gànote, s. f., sorte de gâteau, de forme ovale, tenant de la flamusse et de la corniote, mais se rapprochant un peu plus de la brioche. (V, Corniote, et Flamusse.) - (14) |
| gant, s. m. digitale pourprée, vulgairement doigt de notre-dame, digitalis purpurea. - (08) |
| gaôde. n. f. - Forte pluie, giboulée. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| gâpette, subst. féminin : casquette. - (54) |
| gâpian (Chal., Morv.), gâlapiât (C.-d., Y.). - Mauvais sujet, garnement, vaurien, galopin, chenapan ; corruption de ces derniers mots. Il est à remarquer toutefois que le mot gâpian s'applique plus spécialement aux employés d'octroi, vulgairement appelés gabelous (de gabelle), et que ce mot est pris dans un sens injurieux vis-à-vis de ces modestes agents, le fisc ayant toujours été détesté du peuple. - (15) |
| gapian (gâpian) : s. m., gabelou, employé d'octroi. - (20) |
| gâpian, s. m. drôle, polisson, homme de rien. - (08) |
| gàpian, s. m., employé de l'octroi, gabelou, rat-de-cave. Terme volontiers injurieux. — Signifie aussi drôle, polisson. - (14) |
| gâpiats. s. m. pl. Rognures de cercles et d'osiers, débris de toute sorte provenant du reliage des tonneaux par les tonneliers. - (10) |
| gapiein*, s. m. employé d'octroi ou de régie. - (22) |
| gapiein, m. employé d'octroi ou de régie. - (24) |
| gapien : Ce nom que l'on donne aux employés des contributions indirectes est pris en mauvaise part. - (19) |
| gapouéillot : boue liquide - (48) |
| gar. Gard, la troisième personne du verbe garder, au subjonctif gard, à l'antique pour garde. On disait autrefois : Dieu gard la lune des loups, pour se moquer d'un homme qui menaçait de loin. - (01) |
| garâille, s. f., treue (truie). - (40) |
| garaille, s. f., vieux chiffon pour essuyer. - (40) |
| garaille, subst. féminin : guenille, loque. - (54) |
| garailles. Chiffons, guenilles, vieux habits déchirés. (S'emploie plutôt au pluriel bien que l'on dise « traîner la garaille » pour dire : avoir des habits en lambeaux). - (49) |
| garailloux, adjectif qualificatif et subst. masculin : vagabond, personne désœuvrée ou négligée, sale, mal habillée. - (54) |
| garailloux. Habillé de guenilles. On dit aussi : « garèilloux ». Fig. Mal habillé. - (49) |
| garan : témoin de la borne à l'intérieur d'un bois - (43) |
| garant n.m. Nom donné à la pierre enfouie sous la borne pour la consolider et au besoin, en retrouver la trace. Témoin. - (63) |
| garant : s. m., pierre enfouie à côté d'une borne pour la consolider et, au besoin, en retrouver la place. - (20) |
| garau, averse de pluie, de grésil ou de neige, ne durant pas. - (27) |
| garaudaiñne n.f. Terrain accidenté, ravine, forte pente. Voir beurdoûle. - (63) |
| garaude (n.f.) : averse, giboulée - aussi ragasse - (50) |
| garaude (nom féminin) : forte averse qui survient brusquement. - (47) |
| gâraude : fille qui aime mieux jouer avec les garçons qu’avec les filles - (37) |
| garaude : grosse pluie - (60) |
| garaude : s. f., gamine qui court les rues ; femme de mauvaise vie. - (20) |
| garaude : s. f., guêtre de toile. - (20) |
| gâraude, s. f. femme ou fille débauchée, coureuse. La « gâraude » est-elle la femelle du garou, ce terme joignant à l'idée de sorcellerie celle de libertinage ? - (08) |
| garaude, s. f., coureuse, fille de mauvaise vie. - (14) |
| garaude, s. f., grande guêtre de toile. - (14) |
| garaudé, v. n. courir les rues, vagabonder. - (22) |
| garauder : v. n., courir les rues, vagabonder. Que saprée maison ! toute la nuit on entend les chats garauder ! - (20) |
| garauder, v. intr., courir, mener mauvaise conduite : « Tous les soirs ô s'en va. On n'sait point c' qu'ô fait... O garaude. » - (14) |
| garauder, v. n. courir les rues, vagabonder : je te défends de garauder. - (24) |
| garauder, v. n. mener une vie de désordre, de débauche. - (08) |
| garaudeû, s. m., coureur, garçon qui se dérange. - (14) |
| garbaud : très bon poisson de rivière (chevesne?) - (30) |
| garbe, du bas latin garba, zarbe, gerbe. - (04) |
| garçan : Garçon. Veut dire aussi le fils. « Le garçan à Jean » le fils de Jean. - (19) |
| garcenô. Petit garçon. - (01) |
| garcenòt, et garçounòt, s. m., garçonnet, petit garçon. Dans nos vieux Noëls, le petit Jésus est fréquemment appelé garcenot. - (14) |
| garcon : garçon. Fils...mais jamais fils, toujours garçon ! Ex "C'est l'garçon à la Bernadette, il est ben fôrt". - (58) |
| garçongniée, s. f. « garçongniée » est pour garçonnière par la chute de l'r dans la terminaison. Fille qui recherche les garçons, qui se plaît avec les hommes. (Voir : fillou.) - (08) |
| garçonniaude : Fille qui va volontiers avec les garçons. - (19) |
| garçonnière, garçounière. s. f. Petite fille aimant à jouer avec les garçons, ayant les allures d'un garçon. - (10) |
| garçougnot. n. m. - Garçonnet. (Perreuse, selon M. Jossier) . - (42) |
| garçougnot. s. m. Petit garçon. (Terreuse). - (10) |
| garçounades : voir jiolées - (23) |
| garçoune, garquioune. s.f. Petite fille ; mot de tendresse. (Perreuse). - (10) |
| garçouniaude, et garçounière, s. f., fillette qui joue trop volontiers avec les garçons : « Ta Jacote, prends-y garde ; alle é prou garçouniaude. » - (14) |
| garçounieaude, petite fille qui hante les petits garçons. - (05) |
| gard' : n. Garde. - (53) |
| garde (d’la) : beaucoup. « Y’en cheuzo d’la garde » : il en tombait beaucoup…et intensément. - (62) |
| gârde (on) : garde (gardien) - (57) |
| gârde : Garde. « Le gârde champêtre ». Expression « De la gârde ! » d'importance. - (19) |
| gârde d'chaisse (on) : garde-chasse - (57) |
| garde de Dieu (ai lai). Cette locution, très connue en français, prend un sens particulier en Morvan. Une veuve, en parlant de son mari défunt, se sert souvent comme d'une formule pieuse de la locution : « not mâtre ô ai lai gairde de Dieu. » - (08) |
| gârde d'péche (on) : garde de pêche - (57) |
| garde-bêterie. n. f. - Petite ferme à cheptel ; le travail essentiel du fermier ne consistait qu'à garder le bétail. - (42) |
| garde-bêterie. s. f. Sorte de petite ferme à cheptel, où le travail du fermier ne consiste guère qu'à garder les bestiaux. (Saint-Martin-sur-Ouanne). - (10) |
| garde-bêtes. n. m. - Celui dont le travail était uniquement de garder le bétail. - (42) |
| garde-bêtes. s. m. Celui qui exploite une garde-bêterie. A Charny, la location résultant d'un contrat à garde-bête est présumée faite pour trois ans. - (10) |
| garde-mandzi : garde-manger - (51) |
| garde-pertus (pr'tu), s. m. et f., porte-respect, personne qui accompagne les fiancés au cours de leurs visites. - (20) |
| garde-peurtus n.m. Personne chargée d'accompagner les fiancés au cours de leurs visites. - (63) |
| garde-robe n.m. Armoire sans rayonnages, penderie. - (63) |
| garde-robe : s. m., armoire à linge, cabinet. - (20) |
| garderobe, s. m., armoire, meuble, et non pas chambre à renfermer linge et habits. Se dit concurremment avec ormoire. - (14) |
| gardeur. Gardien. - (49) |
| gârde-vouaîe (on) : garde-voie - (57) |
| gardouillé : v. i. Patauger dans une flaque d'eau boueuse. - (53) |
| gardoux : Gardeur. « Eune gardouse d'oies » : une gardeuse d'oies. - (19) |
| gâre : n. f. Gare. - (53) |
| gare, adv. guère. - (17) |
| gàre, adv., guère, un tout petit peu. - (14) |
| gàre, s. f., guerre, lutte, bataille. - (14) |
| gàreau (C.-d., Morv., Chal.), garot (Char.), garreau, guérot (C.-d, Morv.), garode (Y.). - Averse, pluie subite, abondante et courte… - (15) |
| gareau : averse forte et brève. Pourrait tenir son nom de l’avertissement « Gare à l’eau !», du temps où on vidait les seaux par la fenêtre. (Voir ragasse). - (62) |
| gareau : averse. - (31) |
| gareau : averse. (A. T IV) - S&L - (25) |
| gareau, s. m., pluie abondante, averse : « En r'venant d'la noce, j'avons reçu un fameux gareau. » - (14) |
| gareau, s. m., pluie d'été, subite, torrentielle et de courte durée. Même sens que le synonyme beurée, donné dans le Glossaire du Morvan, p. 78. - (11) |
| gareau. Averse. Etym. gare eau ! - (12) |
| garelle : (on dit aussi truie garelle) voir gore - (23) |
| garer v. Ecarter. Gare-te don, vlà l'tsè ! - (63) |
| garet (n. m.) : guéret, terre labourée - (64) |
| garet : sillon de labour, terre labourée. Ex : "Y m'nait sa j'ment dret dans l'garet !" - (58) |
| garet. n. m. - Guéret, terre labourée et non ensemencée. Ce mot est directement emprunté à l'ancien français · garet, signifiant jachère, terre de labour. La garete désignait le temps du labour, et le garetor le laboureur. - (42) |
| garet. s. m. Guéret, terre labourée et non ensemencée. - (10) |
| gareut : Garrot. Morceau de bois dont on fait usage pour serrer un lien en le tordant. Le gareut est l'outil indispensable au lieur de gerbes. - (19) |
| gareuter : Garroter. « In ban layoux a vite fait de gareuter eune gerbe » : un bon lieur a vite fait de garroter une gerbe. - (19) |
| gargaché, vn. gargouiller. - (17) |
| gargaichon, s. m. aigreurs d'estomac. - (24) |
| gargaisse (f), gâteau (fantaisies). - (26) |
| gargaisse, sf. culotte. Fantaisie, pâte frite qu'on sert à carnaval. - (17) |
| gargaisse. Culotte ; gargaisse est toujours pluriel… - (01) |
| gargaisses, culottes... - (02) |
| gargaissö, sm. vaurien. - (17) |
| gargaisson, s. m. aigreurs d'estomac. - (22) |
| gargaméle, s. f., gorge, gosier. Nous trouverons plusieurs mots ayant une double signification. - (14) |
| gargan : poulet. (N. T IV) - C - (25) |
| gargan, coq. - (27) |
| garganet. s. m. Cou, gorge, gosier, larynx. On dit quelquefois à un enfant qui fait des difficultés pour manger sa soupe : Si tu n'avales pas mieux que ça, j'vas te l'entonner dans le garganet. - (10) |
| gargari. s. m. Gosier. - (10) |
| gargauche. s. f. Femme de conduite dissolue, vivant dans la prostitution et la debauche. (Saint-Florentin). - (10) |
| gargochon. Charançon. - (49) |
| gargòiller, v. intr., gargouiller. - (14) |
| gargoilli : gargouiller - (51) |
| gargoïlli : Gargouiller. « Y me gargoïlle dans l'estomac ». - (19) |
| gargoïlli v. Gargouiller. - (63) |
| gargòillon, s. m., charançon minuscule, qui fait son nid dans les grains : fèves, pois, lentilles, etc. - (14) |
| gargoin : ça sent le bruler - (44) |
| gargoter, v. intr., barboter, presque synonyme de gargouiller. - (14) |
| gargouéillâ (n.m.) : creux plein d'eau - (50) |
| gargouéillâ, s. m. mare, creux plein d'eau bourbeuse ; petit étang d'eau croupissante - (08) |
| gargoueiller : gargouiller - (39) |
| gargouéiller, v. a. barboter, remuer l'eau sale avec les mains ou avec les pieds. - (08) |
| gargouéillou, ouse, adj. celui ou celle qui barbote, qui patauge, qui agite ou remue la fange, une eau croupissante. - (08) |
| gargouillâ : n. f. Flaque d'eau boueuse. - (53) |
| gargouille (Morv.), garguillôt (Y.), garguillôte (C.-d., Br., Chal.). - Gorge, gosier, du bas latin, gargalio ou gargulio, qui vient du grec gargareon, même sens, d'où gargariser. A rapprocher de gargouille et gargouiller, qui ont fait le patois gouillis, et de goullia qui se prononce gouya. (Voir ce mot plus loin.) - (15) |
| gargouiller. Agiter de l'eau ou d'autres liquides... - (13) |
| gargouiller. v. a. et n. Agiter une eau bourbeuse barboter dans l'eau avec ses pieds. – Se dit aussi des bruits sourds, des bredouillements, des borborygmes qui se produisent quelquefois dans les intestins. Ça me gargouillc dans le ventre. - (10) |
| gargouillis. s. m. Enu d'égout, sortant d'une gargouille. = Au figuré, dans le langage populaire, sale et mauvaise fricassée. – Ouvrage mal soigné, mal fait. - (10) |
| gargouillon. Petit charançon qui se loge dans les pois. - (03) |
| gargouiner : se dit d'une préparation culinaire ayant un goût de brûlé. (S. T IV) - S&L - (25) |
| gargouléte, s. f., gosier. - (14) |
| gargoulette : gosier. On dit aussi : garguillotte. - (62) |
| gargouyon, aliments mal préparés ; se dit aussi du charançon qui ronge l'intérieur des pois, des lentilles. - (16) |
| garguari. n. m. - Gorge, gosier : « Pou’ n'pas ettraper la pépie, fait' vouer qu'v'êtes pas éreutis, fourrez-v'en jusqu'au gargari. » (Fernand Clas, p.ll9). Le poyaudin a conservé l'idée de gorge, présente dans l'ancien mot gargarisme (XIIIe siècle), d'origine gréco-latine, et utilisé dans le langage savant : liquide ou médicament pour rincer l'arrière-bouche. - (42) |
| garguches, guerguches. s. f. pl. Petits grumeaux de pâte cuits dans de la bouillie de farine au lait. C'est ce qu'on appelle, à Auxerre, des miettes. – Se dit aussi, à Maillot, de morceaux de pâte ferme frits dans la poêle. - (10) |
| garguchon : charançon. - (31) |
| garguchon. Larve des pois, des fèves et d'autres grains On dit aussi cosson, et par corruption cochon, à cause de la cosse des pois. - (13) |
| gargueillo : gosier. Il lui a coupé le gargueillo : il lui a coupé la gorge. - (33) |
| garguelotte, gosier, trachée-artère, - (05) |
| garguenot, garguilleux : gosier (celt. gargadenn : gosier). - (32) |
| garguesse : délicieux beignet Châtillonnais, à Dijon on disait "fantaisie". - (66) |
| garguesson, gargousson : s. m., pyrosis, renvoi aigre avec sensation de brûlure le long de l'œsophage. A rapprocher du vx fr. garguelon. - (20) |
| gargueute : Gargotte, mauvais cabaret. « Ol était bin treu faignant pa fare in vigneran, ol a mieux amé aller teni eune chetite gargueute à Tôrneu (à Tournus) ». - (19) |
| garguille : mot féminin désignant le cou, la gorge On utilise aussi garguillotte - (46) |
| garguille, s. f. cou, gosier, gorge : « sarrer la garguille », étrangler, terme burlesque. - (08) |
| garguilleu, gosier. - (26) |
| garguillô. Gorge, gosier, conduit par où l'on avale… - (01) |
| garguillo. : Du grec luette, et par extension gosier. Le patois dit encore gargari et gargoulette. L'expression margoulette est un barbarisme. Le mot garguillô a un synonyme en Bourgogne, c'est jarbeire. - (06) |
| garguillot, s. m., gosier, gorge. - (14) |
| garguillot. Canal qui sert à la respiration, gosier, gorge et, par extension, cou. Diminutif de garguille. - (08) |
| garguillot. Larynx, gorge, gosier. Etym. le bas latin gargalio, même sens (Du Cange). - (12) |
| garguillot. s. m. Cou, gorge, gosier. (Etivey). - (10) |
| garguillòte, s. f., gorge, gosier. Après le masc. qui précède, il a fallu encore ce fém. pour dire la même chose : « Se ranfròchir la. garguillòte, » c'est boire un coup. On se la rafraîchit souvent. - (14) |
| garguillote, subst. féminin : pomme d'Adam ou cou, gorge. - (54) |
| garguillotte : gosier, gorge - (39) |
| garguillotte, gairguillote : n. f. Gorge, n.m. gosier. - (53) |
| garguillotte, s. f., larynx, trou du cou. - (40) |
| garguillotte. Gorge, gosier. - (03) |
| garguillotte. Gosier, gorge. On dit : « se rincer la garguillotte » pour boire un bon coup. - (49) |
| garguiyo, gosier du porc, du poulet, etc. - (16) |
| gargusse. s. f. Pâte très-ferme, coupée par petits morceaux et cuite dans le lait, avec lequel elle finit par former une bouillie. (Argenteuil). Voyez galette, miette et garguches. - (10) |
| gâri, v. a. guérir, rendre la santé : « i n'seu pâ encoi gâri », je ne suis pas encore guéri. - (08) |
| gàrî, v. tr., guérir. - (14) |
| gariaude, s. f., vieille truie. - (11) |
| garichon : baliveau de la grosseur du poignet utilisé pour le transport d'un chêne avec un char (voir « varpi ») - (39) |
| garille : (nf) vieille truie - (35) |
| garin : odeur de roussi. - (30) |
| gârison (n.f.) : guérison - (50) |
| garison, gari, guérison, guéri. - (04) |
| gârison, s. f. guérison. - (08) |
| garitiot. s. m. Etui. (Quincerot). - (10) |
| gàriÿon, s. f., guérison. - (14) |
| garlai*, s. m. étui à aiguilles. - (22) |
| garlai, s. rn. étui à aiguilles. - (24) |
| garlauder : (vb) traîner, se promener sans but - (35) |
| garlet, et garlòt, s. m., étui à aiguilles. D'autres penchent pour garrelet. - (14) |
| garlieut : Etui à mettre les aiguilles. « Prends garde de pèdre tan garlieut » : prends garde de perdre ton étui à aiguilles. - (19) |
| garlo : mauvais poêle souvent fabriqué avec une cuve en fer. A - B - (41) |
| garlô et garrelô, étui à mettre des aiguilles. - (02) |
| garlo ou garrelo. : Etui à mettre des aiguilles (Del.). En Champagne on dit uaritiau. (Grosl.) - (06) |
| garlo : s. m. étui à aiguilles. - (21) |
| garlo, petit étui dans lequel on garde les aiguilles, les épingles. - (16) |
| garloche. Vieille galoche ; par extension vieux soulier. - (49) |
| garlocher, v., traîner des sabots trop grands. - (40) |
| garlot (nom masculin) : petit poêle. - (47) |
| garlôt : (nm) sorte de petite poêle - (35) |
| garlot : poêle à charbon - (44) |
| garlot et garlet. Etui à aiguilles. C’est la métonymie altérée de carrelet, ancien nom de l'aiguille, le contenant pour le contenu ; « carreler ! souliers ! » est le cri des cordonniers ambulants qui parcourent nos campagnes avec la hotte sur le dos. - (13) |
| garlot n.m. Poêle en mauvais état. - (63) |
| garlot ou garlet. Étui à mettre les aiguilles. - (03) |
| garlot, étui d'aiguilles. - (05) |
| garlot, n.m. étui à aiguilles. - (65) |
| garlot, pouaile : n. m. Poële. - (53) |
| garlot, s. m. étui à aiguilles ; fourreau en bois où l'on met les cartes employées dans le jeu dit : à la blanque, jeu ou le gagnant reçoit un couteau. - (08) |
| garlot, s.m., petit poêle en fonte, à trois -pieds. - (40) |
| garlöt, sm. étui à aiguilles. - (17) |
| garlot, subst. masculin : poêle pour le chauffage. - (54) |
| garlot. Vieux poêle. Se dit aussi d'un poêle chauffant mal. - (49) |
| garloter. Faire une corde à plusieurs brins entrelacés. - (03) |
| garlotse n.f. Galoche. - (63) |
| garlotsi : (vb) être mal fixé, flotter - (35) |
| garlotsi : être mal fixé, flotter - (43) |
| garlotsi v. 1. Traîner des pieds en faisant du bruit. 2. Traîner quelque chose en faisant du bruit - (63) |
| garlotte, s, f., étui à aiguilles. - (40) |
| garlupette (courir la) : — la fredaine. - (30) |
| garlurette : paysanne qui avait délaissé le pays pour être fille de salle dans un cabaret d'une grande ville. - (30) |
| garlûto : n. m. Grande gueule. - (53) |
| garlûtot : gosier - (39) |
| garlutrot, s. m. gosier, gorge, terme burlesque. (Voir : lutrot.) - (08) |
| garne n.f. Petite prairie naturelle à proximité de la ferme. - (63) |
| garni : Garnir, harnacher, atteler. « Va vite garni tan chevau a peu je nos s'en airint » : va vite atteler ton cheval puis nous nous en irons. - (19) |
| garni ; louer un garni, c'est-à-dire, un logement muni de tout ce qu'il faut pour un ménage. - (16) |
| garni, e, part. passé. S’emploie fréquemment pour exprimer un excédant de remplissage. - (08) |
| garnifle*, s. m. canif à tailler les plumes d'oie. - (22) |
| garnifornat. s. m. Confiture de prunes. - (10) |
| garniment, s. m., garnement : « T'pourôs ben garder ton p'tiot ; y et un prou ch'ti garniment. » - (14) |
| garnipille et guernipille. Mauvais sujet, maraudeur. Littéralement : pilleur de guerne. Ce dernier mot était synonyme de poule... Nous employons le mot galapiat avec le même sens que garnipille. Les Berrichons disent galapiot et les Normands ganipion. - (13) |
| garnipille, s. m., coureur, maraudeur. - (14) |
| garnir : harnacher - (46) |
| garnir, v. harnacher. - (65) |
| garnir. v. - Se dit de gros nuages noirs à l'horizon. « Faut s'presser avant la pluie, ça s'garni su' Étais ! » (Sougères-en-Puisaye) Autre sens : Harnacher : « L'ch'vaux il est-ti prêt ? Te l'as-ti garni ?» - (42) |
| garnissâre : Garnissaire, porteur de contrainte. « Ol est hardi c'ment in garnissâre », allusion au sans gêne des agents du fisc qu'on mettait autrefois en garnison chez les contribuables pour les contraindre au paiement de la taille. - (19) |
| garo (garau) : mot masculin désignant une averse - (46) |
| garô : (nm) grosse averse - (35) |
| garo : averse. (LCSS. T IV) - S&L - (25) |
| garô : Violente et courte averse. « I a cheu in ban garô » il est tombé une bonne averse. Etym. garrot : trait d'arbalète. Ainsi le mot garô exprime à lui seul l'idée qui a donné lieu à la locution : il pleut des hallebardes. - (19) |
| garo, averse. - (26) |
| garô, guèrô, averse de pluie de courte durée. - (16) |
| garô, s.m, averse. - (38) |
| garode. s. f. Ondee, pluie subite et passagère. (Rugny). - (10) |
| garôder, v. faire des averses successives. - (38) |
| garòille, s. f., truie salie. Se prend souvent, au figuré, pour désigner une fille de conduite peu propre. - (14) |
| garoille, truie salie de boue. - (05) |
| garon : (nm) témoin de la borne - (35) |
| garôpèn, nom du fromage fort, voulant dire : gare au pain, parce que le fromage fort fait manger beaucoup de pain. - (16) |
| garôt ou gareau, subst. masculin : averse violente et brève. - (54) |
| garot, n.m. averse d'été de courte durée. - (65) |
| gàrot, s. m. .garrot, gros bâton court, gourdin, trique. - (14) |
| garot, s. m., pluie brutale et courte. - (40) |
| garot. Forte averse de pluie et subite. - (49) |
| garoter : secouer. A - B - (41) |
| garoter : cahoter - (51) |
| garoteux : cahoteux en parlant d'un chemin. A - B - (41) |
| garotou : cahoteux - (51) |
| gârou, adj. sorcier. (Voir : vârou.) - (08) |
| garouche. Averse. - (49) |
| garoucher. Jeter des pierres. - (03) |
| garouiller (se) : se souiller de boue. (CH. T II) - S&L - (25) |
| garouiller : barboter dans l'eau, en la répandant autour de soi (vient de « gargoueiller »). - (56) |
| garouiller, v, intr., courir salement, mettre les pieds n'importe où. Au figuré, vagabonder, hanter les mauvais lieux. - (14) |
| garre : Voir : guarre. - (19) |
| garre. Guerre. Le menu peuple de Paris et les paysans des environs prononcent garre… - (01) |
| garreau : averse violente et assez brève. - (32) |
| garreau : averse. - (29) |
| garreau : n. f. Averse. - (53) |
| garreau. s. m. Sorte dc mets composé d'oeufs, d'un peu d'eau et de fromage de gruyère, battus ensemble, et qu'on fait cuire dans une tourtière avec un feu vif en dessus et en dessous, comme les œufs au lait, dont il a toute l'apparence lorsqu'il est bien réussi. Il est ainsi appelé, sans doute, du nom de son inventeur, un Garreau quelconque, devenu célèbre sans le vouloir. - (10) |
| garrelot, garrelet, garreleut : s. m., vx fr. garillon, étui à aiguilles. Voir garreut. - (20) |
| garreut, garreleut : s. m., garrot, bâton que l'on attache transversalement au cou des animaux pour les empêcher de franchir une clôture ; svn. aussi de paleron. - (20) |
| garrot (on) : giboulée - (57) |
| garrot : grosse averse - (43) |
| garrot : s. m. sorte de levier en bois dont on se sert pour tourner le « tour du garrot ». - (21) |
| garrot n.m. (du germ. warri, l'eau). Averse. - (63) |
| garrot : s. m., averse subite et de courte durée. Voir ballerasse. - (20) |
| garrot, bâton court. - Rain de fagot. - Scion d'arbalète. - Nuée de grésil, giboulée ou grosse pluie. - (05) |
| garroucher, lancer des pierres. - (05) |
| gârs n.m. Fils, jeune homme. - (63) |
| gârs : n. m. Gars. - (53) |
| gars, n.m. fils, serviteur. - (65) |
| garsier. Homme débauché avec les femmes. - (03) |
| garuche, s. f., terre en friche depuis longtemps. - (40) |
| gàs, s. m., garçon, jeune homme. Se prend aussi bien en bonne qu'en mauvaise part. - (14) |
| gas, sm. mare, retenue d'eau, abreuvoir. - (17) |
| gas. Ce mot signifie jeune homme. Il s'emploie encore dans certaines contrées de la Bourgogne. On dit mon gas, un grand gas, un gas bien alluré. - (02) |
| gas. s. m. Jeune garçon. Se dit assez généralement en mauvaise part. Un mauvais gas, un ch'ti gas. - (10) |
| gase : s. f., gaize, sol dur et compact, motte de terre. Rapprocher de ce mot le nom du « chemin des Gaises » à Mâcon. - (20) |
| gasi, gasant : adj., compact, aggloméré, en mottes ou gases. Du pain gasi. - (20) |
| gasins (ā), sm. décombres. Voir ptuns. - (17) |
| gaspilli – peut’fener : gaspiller - (57) |
| gaspilli : Gaspiller. « Ol a gaspilli tot ce qu'ol avait ». - (19) |
| gasse n.f. (du germ. wattja, l'humidité). Bourbier.Voir borbî, beurbî . - (63) |
| gasse : s. f., allée séparative de deux coupes de bois. - (20) |
| gassé, v. n. enfoncer, piétiner dans un lieu très humide. - (22) |
| gasser : Agiter dans l'eau. « Gasser du linge dans le bè (dans le lavoir) ». - « Fare gasser les chevaux dans le revire » faire s'ébrouer les chevaux dans la rivière. On dit aussi d'un terrain vaseux qu'il « gasse » sous les pieds. - (19) |
| gasser : remuer dans l’eau. (BY. T IV) - S&L - (25) |
| gasser : remuer, agiter, par ex.: battre des œufs pour une omelette. - (30) |
| gasser : v. patauger dans l’eau. - (21) |
| gasser, égasser : v. a. et n., faire gargouiller, gargouiller. Gasser du linge à la platte. Gasser un fût. Quand on remue un fût qui n'est pas plein, ça gasse. Quand on a « beaucoup bu », ça gasse dans le ventre. - (20) |
| gasser, marcher dans l'eau, guéer. - (05) |
| gasser, v. agiter du liquide dans un récipient. - (65) |
| gasser, v. intr., marcher dans l'eau, passer à gué avec éclaboussures. - (14) |
| gasser, v. n. enfoncer, piétiner dans un lieu où l'eau ou le purin sont à fleur du sol. - (24) |
| gasser, v., agiter du liquide dans un récipient. - (40) |
| gassevale : s. f., personne qui gassevale. - (20) |
| gassevalé, v. a. gâcher un travail. - (22) |
| gassevaler : v. a., parcourir en tous sens, battre une région. - (20) |
| gassevaler, v. a. gâcher un travail. courir de côté et d'autre. - (24) |
| gassi : secouer un liquide - (51) |
| gassi v. Remuer, gargouiller. Y gasse dans ma beuille ! - (63) |
| gassôde. Soit averse, soit forte pluie. Etym. voyez le mot s'éguasser. - (12) |
| gassoïllat n.m. (de gasse). Flaque d'eau. - (63) |
| gassoiller, v. ; se mouiller, se salir avec l'eau. - (07) |
| gassoilli : faire quelque chose dans l'eau - (51) |
| gassoïlli v. (de gasse). Se laver rapidement, s'amuser avec l'eau. - (63) |
| gassoïlli: Patauger, barbotter dans de l'eau plus ou moins propre. « Les ptiets amant à gassoïlli » : les enfants aiment à barbotter. - (19) |
| gâsson : (nm) garçon - (35) |
| gassouillage : s. m., action de gassouiller ; syn. aussi de gassouille. - (20) |
| gassouillarde : s. f., amie de la mariée, qui fait la servante volontaire au repas de noce. « Les amies intimes de la mariée, sous le titre de gassouillardes, s'occupèrent à servir les mets. Ce titre-là est fort envié... » (S. Blandy, La dernière Chanson). - (20) |
| gassouille : s. f., vx fr. gassouil (s. m.), mouille, dépression de terrain contenant de l'eau. - (20) |
| gassouiller : v. n., vx fr., barboter dans l'eau. Fréquentatif de gasser. S'emploie d’une manière impersonnelle lorsque le sol est couvert de flaques d'eau. Ça gassouille dans ce pré ! - (20) |
| gassouiller, v. tr. et intr., salir en marchant dans la boue, répandre de l'eau, barboter. - (14) |
| gassouiller, v., même sens que gasser, mais péjoratif. - (40) |
| gassouiller. v. a. Salir, abîmer, gâter. Se dit surtout des fruits trop murs qui, à force d'être maniés, remués, secoués, finissent par s'écraser plus ou moins. Des prunes, des cerises, des raisins gassouillés. – Si dit aussi d'un liquide qu'on trouble en l'agitant. Voyons, vas-tu gassouiller ce vin longtemps comme ça ? - (10) |
| gassouilli : (vb) jouer dans l’eau - (35) |
| gassouyi, 1. v. a. laver sommairement et maladroitement — 2. v. n. se dît d'un bruit produit en secouant un récipient mi-plein de liquide : ce fût gassouye. - (22) |
| gassoya : flaque d'eau ou petite marre. A - B - (41) |
| gassoya : flaque d'eau ou petite mare - (34) |
| gassoya ou goya : flaque d'eau ou petite mare - (43) |
| gassoyi : patauger, laver sommairement. A - B - (41) |
| gassoyi : laver sommairement - (34) |
| gassoyi : laver sommairement - (43) |
| gassòyi, 1. v. a. laver sommairement et maladroitement. — 2. v. n. se dit d'un bruit produit en secouant un récipient mi-plein de liquide : ce fût gassòye (du vieux français gassouiller). - (24) |
| gasvaler v. Remuer dans tous les sens, secouer un tonneau. - (63) |
| gât, s. m. dommage, dégât. La grêle a fait bien du « gât » dans les champs. - (08) |
| gâta : gâté. - (29) |
| gatai. Gâter, gâté, gàtez. - (01) |
| gâtaie : gâteau - (48) |
| gâtcheau : gâteau - (51) |
| gate (gâte) : adj., gâté, gâteux. - (20) |
| gate (n.f.) : fille (féminin de gars) - (50) |
| gate : gamine. - (30) |
| gâte : Gâté « Y a la moitié de mes tapines de gâtes » : il y a la moitié de mes pommes de terre qui sont gâtées. - (19) |
| gate : petite fille (peu usité) - (37) |
| gâte, adj. endommagé, altéré, entamé, un animal atteint d'une maladie organique est « gâté.» se dit aussi d'une fille enceinte : « elle est gâtée». - (08) |
| gatein. Gâtions, gâtiez, gâtaient. - (01) |
| gatelöt, sm. gâteau. - (17) |
| gâter, v. tr., salir, déchirer : « Le ch'ti morveû ! ô m'a tout gâté ses hébits. » - (14) |
| gâterat. s. m. Personne sans soin pour ses vêtements. (Courgis). – Dans les hôpitaux, on appelle gâteux, les malades qui ne peuvent pas se retenir, qui salissent leurs vêtements et leur lit de leurs ordures. - (10) |
| gâtias. s. m. gâteau. (Domecy-sur-leVault). - (10) |
| gatiau (père), loc., familière, pour désigner le grand-père qui gâte ses petits-enfants. - (14) |
| gâtiau : gâteau - (61) |
| gâtiau : un gâteau. - (56) |
| gâtiau n.m. Gâteau. - (63) |
| gâtiau, s. m., gâteau, désigne volontiers toutes sortes de pâtisseries. - (14) |
| gâtiau. n. m. - Gâteau. - (42) |
| gatiére (n.f.) : fille mal propre, souillon - (50) |
| gatière (nom féminin) : jeune fille. - (47) |
| gâtière : mlle (gazoute) - (60) |
| gâtière : fille. - (33) |
| gâtiére : fille à marier - (39) |
| gâtiére, s. f. fille malpropre, dont la toilette est en désordre, souillon. - (08) |
| gatille (pour castille). s. f. Querelle. Chercher gatille agaée (égarée), chercher querelle sans raison, à propos de rien. (Ferreuse). - (10) |
| gatille. n. f. - Querelle : « Chercher gatille ». (Perreuse, selon M. Jossier) - (42) |
| gatin : ablette. (VSLD. T II) - S&L - (25) |
| gatio : gâteau - (43) |
| gatouiller. v. a. Chatouiller. - (10) |
| gâtre, s. f., guêtre. - (14) |
| gâtre. s. f. Guêtre. (Accolay, Trucy, et généralement toutes les communes riveraines de l'Yonne, en amont d'Auxerre). - (10) |
| gâtron. s. m. et f. Femme sale, toujours mal peignée et fagotée, n'ayant pas plus de soin de son ménage que d'elle même et des siens. - (10) |
| gâtrou (un poula) : un poulet malade. (RDR. T III) - A - (25) |
| gâtrou : petit garçon - (37) |
| gatrou : celui dont les chaussures et le bas des jambes sont sales. - (33) |
| gâtrou, ouse, adj. sale, crotté, déguenillé, misérable. Se dit aussi d'un individu qui marche pesamment, en pataugeant. - (08) |
| gâtroux, misérable, malpropre - (36) |
| gâtsi v. Gâcher. - (63) |
| gatuge : Danger d'être endommagé par le bétail « Te farais bien de renfremer tan pré, ol est su le gatuge » : tu ferais bien de clore ton pré, il est bien exposé aux déprédations du bétail qui passe à proximité. - (19) |
| gâture : carie. - (32) |
| gaû (n.m.) : 1) mendiant (étym.: qui sort des bois) - 2) coq (du lat., gallus) - (50) |
| gau, jau, coq. - (04) |
| gau, s. m. coq, le mâle de la poule. - (08) |
| gau, s. m., coq. A plusieurs synonymes. - (14) |
| gaube : engourdissement des mains - (60) |
| gauboule (se) : en parlant du temps : se couvre. (DC. T IV) - Y - (25) |
| gaubouler (Se). v. pronom. Se couvrir, se charger de nuages. Le temps se gauboule c'est signe d'orage. (Grandchamp, Villeneuve-les-Genêts). - (10) |
| gaubouler (v. tr.) : exécuter un travail avec un total manque de soin, le bâcler (syn. gouillarder) - (64) |
| gauboulot (n. m.) : mauvais travailleur (syn. gouillard) - (64) |
| gauce. s. f. Voyez guenipe. - (10) |
| gaucer, v. a. mouiller et salir. Un homme qui tombe dans une eau fangeuse a ses habits « gaucés. » - (08) |
| gauche : Qui est opposé à droit. « L'oraille me corne. - Laquelle ? - La gauche - Y est du bin qu'an dit de ta : la gauche porte la bonne novale à l'autre ». - « Cougnaitre sa main gauche » : être avisé, discerner ce qui peut être nuisible de ce qui peut être avantageux. - Maladroit. « Ol est gauche c'ment eune aule de m'lin à vent » : il est maladroit comme une aile de moulin à vent. - (19) |
| gauchi (on) : gaucher - (57) |
| gaud, s. m. mendiant. - (08) |
| gaudailler. Ne pas travailler : tuer le temps en s’amusant. Constatons que la terminaison ailler donne à certains verbes une signification particulière exprimant l'idée de paresse et de nonchalance, comme mâchouiller, mangeailler, buvailler, tournailler. « Gaudailler » est le péjoratif de gaudir, comme le français « tirailler » est le péjoratif de tirer. - (13) |
| gaude : bouillie de maïs (celt. Yod : bouillie et goadenn : pâtée grossière). - (32) |
| gaude : n. f. Bouillie de lait, semoule et sucre. - (53) |
| gaude : s. f., farine de maïs, bouillie faite avec cette farine. - (20) |
| gaudelée. n. f. - Marmelade, compote de prunes. - (42) |
| gaudelée. s. f. Marmelade de prunes. (Vilhers-Saint-Benoit). - (10) |
| gaudelurô et galurô, jeune homme libertin, qui ne songe qu'au plaisir. Ce mot vient du latin gaudere, ainsi que les mots gaudi (se), s'amuser, se réjouir, et gaudrille, fille de joie. - (02) |
| gaudelurô. : (Pat.), galureau (dial.), jeune libertin qui ne songe qu'au plaisir. (Voir au mot luron.) - (06) |
| gaudence. : Réjouissance. - (06) |
| gaudenée. : Fête publique. - (06) |
| gaudes (dans toute la Bourg.). - Farine de maïs. Mets national de la Bresse (et aussi de la Franche-Comté). Ce mot viendrait, suivant les uns, de calida, chaude, parce que les gaudes se mangent de préférence toutes chaudes, et suivant les autres, de caldarium, chaudière, parce qu'elles se font dans un chaudron. L'origine parait en être tout simplement la même que celle de la gaude, espèce de réséda qui sert à teindre en jaune. La bouillie de maïs étant d'une belle couleur jaune, aura reçu le nom de la plante tinctoriale, laquelle aurait pris elle-même le sien, suivant Littré, de l'allemand Wauda, même sens. - (15) |
| gaudes : (nfpl) soupe à la farine de maïs - (35) |
| gaudes : Bouillie de farine de maïs. « Eune marmite de gaudes ». - (19) |
| gaudes : farine de maïs, et la bouillie (jaune) faite avec cette farine. Son nom vient d’une espèce de réséda donnant une teinture jaune.Henri Vincenot écrit que le nom vient du celte «god » ou « yod » pour bouillie. - (62) |
| gaudes, bouillie de maïs, de sarrasin. - (05) |
| gaudes, n.f.pl. farine de maïs d'origine bressane. - (65) |
| gaudes, s. f., bouillie préparée avec la farine du maïs, soit au lait, soit à l'eau et au beurre. Mets des plus usités et des plus goûtés en Bourgogne. Avec addition de sucre, recommandé par les médecins aux convalescents. Ce potage pourrait aspirer à être classé comme mets national, si toutefois il ne l'est déjà. - (14) |
| gaudes. Farine de grains de maïs et bouillie qu'on en fait. C'est le mets national. - (03) |
| gaudi (se), v. pron., se gaudir, se réjouir. - (14) |
| gaudin. : Conte grivois divertissant. - (06) |
| gaudine. : Qui a deux sens : divertissement et forêt, selon qu'il dérive de naudium ou de caulis. - (06) |
| gaudran : Goudron. « Ol a les mains totes nares (noires) de gaudran ». - (19) |
| gaudre : guenille pour essuyer le four. IV, p. 29-h - (23) |
| gaudreux, euse. adj. Qui est dans un état de souffrance, de malaise habituel. – Par extension, se dit d'une personne de mauvaise tenue, sale, aux vêtements boueux, effiloqués. Une femme gaudreuse. – Temps gaudreux, temps brumeux, pluvieux, mais de cette pluie fine, qui fait de la boue et ne lave pas les rues, comme le fait une grande pluie. - (10) |
| gaudrille, s. f., libertine, fille de mauvaise vie : « C'te feignante-là, n’y é ran qu'eùne peùte gaudrille. » - (14) |
| gaudrille. Débauchée, débauchées, du latin gaudere, comme en français filles de joie. - (01) |
| gaudrille. : Fille de joie. - (06) |
| gaudrillon : n. m. Habit usagé qui a fait son temps. - (53) |
| gaudron, goudron. - (04) |
| gaudronner : Goudronner. « Y est ban de gaudronner les paichauds (échalas) i les fâ deurer bien pu longtemps ». - (19) |
| gaudrou, sm. rôdeur, fainéant [all. Wanderer]. - (17) |
| gaufeter. v. n. Se dit, à Maligny, d'une femme qui, étant à l'herbe, va tantôt à droite, tantôt à gauche, choisissant les meilleures places pour faire son faix. - (10) |
| gaufre : s. m., un gaufre. Les pelites gaufres du Mâconnais, qui sont bien connues, doivent leurs qualités à la crème qu'on ajoute à la pâte. - (20) |
| gaufrei, s. m., gaufrier, ustensile dont l'emploi réjouit toujours les enfants. - (14) |
| gaufrer : Tuyauter. Les garnitures des calots (bonnets) de neutés grand 'mères étaient bien gaufrées ». - (19) |
| gaugé (être) : avoir ses chaussures pleines d'eau. (G. T II) - D - (25) |
| gaugé (s'). : S'enfoncer dans la boue. Lamonnoye donne à ce mot l'étymologie de vadum, gué. - (06) |
| gaugè : se mouiller les pieds en marchant dans une flaque d'eau ou un fossé - è sé gaugé en sautant dans lé gouillats, il s'est mouillé les pieds en sautant dans les flaques d'eau - (46) |
| gaugé : trempé - (48) |
| gaugé, se dit des pieds mouillés dans les chaussures. - (28) |
| gaugé, vt. salir, enduire de boue. - (17) |
| gaugé. Se gaugé se dit de ceux qui, passant dans un lieu où il y a de l’eau, sentent qu’il en entre dans leurs souliers… - (01) |
| gauger (C.-d., Chal., Br., Y.), gouager (C.-d.), gaucer (Morv.), (verbe n. et passif ; on dit aussi se gauger).- Patauger, se mouiller les pieds, marcher dans l'eau boueuse de manière à en faire entrer dans ses chaussures. Il y a, pour ce mot, un choix d'étymologies nombreuses… - (15) |
| gauger (se), mettre pieds dans l'eau. - (05) |
| gauger (Se). Se mouiller les pieds. - (03) |
| gauger (se). Se salir, au propre et au figuré. - (12) |
| gauger (v. int.) : enfoncer dans l'eau de telle manière que les chaussures soient immergées (j'ai gaugé en travarsant le rio) - (64) |
| gauger (verbe) : en passant dans une flaque d'eau, en prendre par-dessus les chaussures. (J'ai gaugé dans l'patouillat). - (47) |
| gauger : être aspergé d'eau, jusqu'au cou ! - (66) |
| gauger : marcher dans la boue, se mouiller les pieds en marchant dans l'eau (1) - (61) |
| gaûger : prendre de l’eau qui rentre par le dessus du sabot lorsqu’on enfonce trop le pied dans un terrain humidifié - (37) |
| gauger : prendre l'eau dans ses chaussures (gaffer) - (60) |
| gauger : se mettre l’eau dans les chaussures. Patauger dans l’eau ou la boue, à en rentrer l’eau dans les chaussures. On dit aussi gasser. Du bas latin guazzare : passer à gué. Voir : gois. - (62) |
| gauger : prendre de l'eau dans ses sabots, en marchant dans la boue ou dans une flaque d'eau. Patauger. Ex : "Si té prends çeu ch'min là, t'as pas fini d'gauger moun' houme !" - (58) |
| gauger, chasser une cheville, etc. - (05) |
| gauger, emplir ses chaussures d'eau en marchant dans l'eau, la boue épaisse. - (27) |
| gauger, v. intr., mettre les pieds dans l'eau ou la boue : « Dieu de Dieu ! j'sui-t-i fait ! En v'nant, j'ai gaugé tout mon soû. » - (14) |
| gauger, v., patauger dans, la boue, à ras du sabot. - (40) |
| gauger,v. se mouiller les pieds dans un creux d'eau. - (38) |
| gauger. v. - S'enfoncer dans la boue ; se dit lorsqu'on a marché dans un patouilla ! et que la boue a pénétré dans la chaussure ou le sabot : « Claire alle a gaugé ! J'lui avais pourtant ben dit d'mette ses bottes ... » - (42) |
| gauger. v. n. Marcher ou enfoncer dans la boue liquide, de manière à en emplir ses souliers ou ses sabots. (Perreuse). - (10) |
| gaugerd ougoujère : serpe emmanchée sur un long manche pour couper les haies - (60) |
| gaugi (se) v. (du celte gauch, ordure, immondice) Mettre les pieds dans l'eau boueuse. Attends don qu'dze rkeule, t'vas t'gaugi dans l'gouillat ! Attends donc que je recule, tu vas te salir dans la flaque boueuse. - (63) |
| gaugi : Piétiner dans la boue, dans la terre amollie par la pluie. « Quand i plio (pleut) padant les vendanges an est bin forci d'aller gaugi dans la borbe (dans la boue) ». - Tasser avec les pieds. « Gaugi la gène (le marc de raisin) su le pressoi ». - (19) |
| gauglu : coq (vieux). Du latin gallus, dans d’autres régions on dit gau. Chez nous Gauglu désignait le N°1 du poulailler. - (62) |
| gaûgné c’mment ain pait’lot (ât’e) : (être) très mal habillé - (37) |
| gaugner, v., ranger, placer en mauvaise place. - (40) |
| gaugni (mal) : mal habillé - (34) |
| gaugnû (n.m.) : rebouteux - (50) |
| gaugueniller. v. n. Se dit d'une pièce de linge, d'un mauvais vêtement, d'une guenille ou loque quelconque suspendue, et que le vent agite. - (10) |
| gaûillas (n.m.) : flaque d'eau - (50) |
| gaûille (n.f.) : boue - (50) |
| gaujard. s. m. Serpe à long manche. - (10) |
| gaujoux: Ne s'emploie que dans l'expression « gaujoux de borbe » qui se dit par mépris du paysan parce-qu'il travaille toujours dans la terre, dans la boue. - (19) |
| gaulai, abattre avec une perche, un gaulis (en latin caulis). Gaulai quelqu'un signifie le frapper avec un bâton. - (02) |
| Gaule. France ; Gaule se prend aussi pour gale, auquel sens il ne se dit guère qu'au pluriel : « Aivoi dé gaule », avoir des gales, ou, comme on parle, la gale. - (01) |
| gaule. Perche ou baguette servant à gauler des noix, des pommes, et quelquefois à corriger. On disait autrefois galler : - Vostre peau sera gallée - Ou vous ferez vostre debvoir. Gwal signifie « branche » en bas-breton. - (13) |
| gaule. : Grande baguette. Du latin caulis, venant lui-même du grec, tige ; - d'où le verbe gaulai, battre un arbre, un noyer par exemple, pour en faire tomber les fruits. - (06) |
| gaulée. n. f. - Action de gauler les noix. - (42) |
| gaulfretié (se), se rassasier de... - (02) |
| gaulfretié (se). : Se délecter à manger. - (06) |
| gauliard. Débauché, fainéant. - (03) |
| gauliat. s. m. Glouton, gourmand. (Saint-florentin). - (10) |
| gaulon, gaudelon. n. m. - Bouchée, gorgée : un gaulon de pain. - (42) |
| gaulon, grosse bouchée ; en latin gula... - (02) |
| gaulon. Gros morceau avalé goulûment : « Ai n'an fai qu'un gaulon », il n'en fait qu'un morceau… - (01) |
| gaulon. s. m. Bouchée, gorgée, avalon. (Smiipuits). - (10) |
| gaulouaîs (on) : gaulois - (57) |
| gaumache. adj. et s. Gourmand. (Tronchoy). - (10) |
| gaumai : Gamay, plant de vigne qui produit un raisin à gros grains serrés, plant très connu dans la région de Mancey. - (19) |
| gaumé : s. m. raisin gamay. - (21) |
| gaumer, se dit des aliments qui restent trop longtemps sur le feu en attendant des convives. - (27) |
| gaumer, v. intr., séjourner trop longtemps dans l'eau, dans la sauce, sur le feu : « Ton linge gaume dans l'baquet. » — « L'mainger gaume su l'forniau. » - (14) |
| gaumichon. s. m. Petit gâteau. (Perrigny-lès-Auxerre). - (10) |
| gaumiot (nom masculin) : gamelle en fer. On dit aussi tingot. - (47) |
| gaumiot : récipient (tingot) - (60) |
| gauné, adj., habillé (de belle tournure). - (40) |
| gaunè, gônè : adj. Vêtu de façon hétéroclite. - (53) |
| gauné, gôné. Voyez gonné. - (10) |
| gauné, mal vêtu, mal habillé. - (28) |
| gauné, sali. - (26) |
| gauner (se) : (s'gô:nè - v. pronom.sauf au part.passé où il joue aussi le rôle d'adj.) s'attitrer, s'accoutrer (péjoratif). Gèd' don: c'men qu'al ô: gô:nè ! "regarde donc comme il est accoutré !" - (45) |
| gauner ou gôner : Habiller sans recherche. « Etre mau gauné » : être mal habillé. - (19) |
| gauner ou gôner, gaunipper (dans toute la Bourg.), gaugner (Char.). - Verbe actif et passif. Mal habillé, vêtu sans goût, sans soin : du vieux français gone ou gonne (manteau, robe), venant du bas latin gonna, gonnaca, dont la racine est gaunacum (vètement de peau). Ce mot qui désignait à l'origine le manteau que les hommes de guerre mettaient par dessus leur armure, désigna également plus tard les robes de femme. Cette expression aurait fini par être prise en mauvaise part et s'appliquer à des vêtements en mauvais état par suite d'usure ou d'une avarie quelconque. Parlant de quelqu'un tombté dans la boue, on dit : « le v' là bin gauné. » Le mot gauné a, dans ce cas, le sens d'une chose mal arrangée ; il s'applique, d'ailleurs, également aux objets, car on dit très bien : « Y me l'a ben gaunée », en parlant d'une chose salie, brisée, détruite ou mise en mauvais état. Un gaunot, gônot ou goniot est quelqu'un de mal gôné ; une gonnelle est une fille de mauvaise vie. Gone dans le patois lyonnais désigne un galopin. On peut encore comparer ce mot à l'italien gona, robe ou vêtement de femme, et à l'anglais goum, robe, goumed, vêtu d'une robe. - (15) |
| gaûniç’er (s’), (s’) gaûgner : (s’) habiller sans goût - (37) |
| gauniché : mal habillé. - (31) |
| gauniot : Individu mal habillé. - (19) |
| gâunipper. Mal vêtir, déguiser, couvrir d'oripeaux. Etym. galnape puis gaunape, vieux mot qui voulait dire casaque, de gaunacum, peau, vêtement de peau. - (12) |
| gaupe, fille folâtre. Dans l'idiome breton, goap signifie plaisanter, badiner. (Le Gon.) - (02) |
| gaupe, s. f. femme ou fille de moeurs déréglées. - (08) |
| gaupe, s. f., coureuse, fille ou femme dont la conduite laisse tout à désirer. Notre patois est riche pour désigner ces créatures. - (14) |
| gaupe. Femme de mauvaise vie. On trouve ce mot dans d'autres régions. - (49) |
| gaupe. s. f. Fille ou femme de mauvaise vie ; d'ou le verbe gaupiner, vadipare. (Etivey). - (10) |
| gaupe. : (Dial. et pat.), femme qui se néglige dans ses occupations ou dans ses moeurs. – Aux Fourgs, en Franche-Comté, on dit gaupot (Tiss.). Du latin vapida, vicieuse, corrompue. - (06) |
| gaure : terre glaise, argile jaune —vache maigre malgré les soins et la nourriture. - (30) |
| gaûs (dâs) : (des) haricots à écosser - (37) |
| gause : genre d'osier à l'écorce blanchâtre, poussant dans les marécages - (34) |
| gaussai. Gausser, railler… - (01) |
| gaussé, mentir. Dire des gausses (expression du Châtillonnais), c'est dire des mensonges... - (02) |
| gausseû, s. m., gausseur, qui fait le malin : « J’n'ain-me pas d'aller nous deux lui ; tôjor ô s'moque. Y ét ein gausseû. » - (14) |
| gausseu. : Réjoui, railleur (du part. lat. gavisus), d'où le verbe gaussai, dire des gausses ou gosses. - (06) |
| gaussieu : gosier. - (29) |
| gautse : gauche - (43) |
| gaûtse adj. Gauche, maladroit. - (63) |
| gaûtsi n. Gaucher. - (63) |
| gautsse : gauche - (51) |
| gauveine. s. f. Cancans, propos médisants. - (10) |
| gauviotte, carotte blanche , bonne seulement à donner au bétail.Dans l'idiome breton, géot signifie herbe. (Le Gon.) - (02) |
| gauvoiñne (faire) loc. Ce que fait le cheval qui se roule sur le dos en remuant les pattes en l'air. Syn. Faire le pautlin. On dit aussi, en parlant de ce cheval : ô gâgne l'avoiñne. - (63) |
| gauziotte. s. f. Primevère jaune des prés. - (10) |
| gavache, lâche, fainéant (Gavache, en espagnol, gavacho, terme de mépris qui s'applique aux gens mal vêtus, aux fainéants. On nomme ainsi, dit Furetière, le peuple qui habite les montagnes qui séparent la France de l'Espagne, parce que ce peuple va gagner sa vie en s'adonnant aux métiers les plus vils. Ne serait-ce point là l'origine de notre mot galvache ?) - (04) |
| gavallon, gavillon : s. m., bâton, trique. A rapprocher du bas-latin gavèlo el du vieux français gauvelat (javelot). - (20) |
| gavar, adj. boiteux, bancal, qui a les jambes tortues; sale, malpropre. - (08) |
| gavard. adj. et s. m. Qui a les jambes arquées, qui marche en dehors. (Domecy-sur-Cure). - (10) |
| gavarder, v. n. marcher en boitant, être bancal, avoir les jambes difformes. - (08) |
| gavarder. v. n. Marcher de travers. (Sermizelles). - (10) |
| gavélaut ! : C'est le cri du chasseur des Avents que l'on entendait à minuit dans les bois de Mancey pendant la nuit de Noël. D'après la légende, le Chasseur des Avents serait un seigneur de Balleure dont la passion dominante était la chasse. - (19) |
| gavelle. n. f. - Tas de sarments. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| gaver. v. a. Donner la pâtée, engraisser. (Tronchoy). – Se gaver. v. pronom. S'emplir, se gorger d'aliments. Nous donnons ce mot, bien qu'il soit déjà dans Larousse. - (10) |
| gaviau. s. m. Gosier. (Perrigny-lès-Auxerre). - (10) |
| gavllion, s. m. gros bâton, trique. - (22) |
| gavllion, s. rn, gros bâton, trique. - (24) |
| gavodée (nom féminin) : averse. On dit aussi gavode. - (47) |
| gavoichis. s. m. Action d'uriner. (Sermizellcs). C'est un diminutif de gave, nom donne, dans les Pyrénées, aux cours d'eau qui descendent des montagnes. - (10) |
| gavot : malpropre - (43) |
| gavot, gavout : s. m., ouvrier maladroit, gâcheur de besogne. - (20) |
| gavot, n.m. mauvais travailleur. - (65) |
| gavot, s. rn. ouvrier qui bâcle son travail. Verbe gavoter. - (24) |
| gavoter, v. mal travailler. - (65) |
| gavouillou : se dit de quelque chose qui se décompose - (46) |
| gaya : sorte de jeu de marelle. - (30) |
| gayer, gayer. v. a. Se dit du degré d'enfoncement, du tirant d'eau d'un bateau. « Votre bateau, combien tient-il ? Il gaye tant. Il est parti gayant tant. » Du latin aqua, et du roman aigue, aige, par transposition du g avant l'a. - (10) |
| gayi : s'amuser, être joyeux. B - (41) |
| gäyi : (vb) (d’un chien) jouer - (35) |
| gayi : s'amuser, être gai, jouer (se dit pour un chien) - (43) |
| gàyœte, s. f. serpette à vendanger. - (24) |
| gayon, s. f., femme malpropre, par extension du vocable morvandeau Gaille, cité dans le Glossaire du Morvan, p. 391, avec le sens de truie, et du vocable lyonnais caillon qui signifie cochon . - (11) |
| gayôt, s. m., gros bâton, rotin pour se défendre, et dont nos gas savent souvent trop bien jouer. - (14) |
| gaze, s. f. motte de terre dure. - (24) |
| gâzener, v. a. gazonner. Un terrain «gâzené» est un sol ensemencé de graminées ou garni de mottes gazonnées. - (08) |
| gâzenou, ouse, adj. gazonneux, qui est en gazons, en mottes enracinées. Un champ « gâzenou » est un terrain qui n'est pas meuble; une terre « gâzenouse » est pleine de racines, d'herbes plus ou moins liées au sol. - (08) |
| gazi : Adjectif. Etat d'une pâte qui ne s'est pas gonflée à la cuisson. « Ta pâte n'était pas prou levée, tan pain est gazi ». Au figuré : tasser. « Ol a tellement pigi le tarrain, qu'ol est tôt gazi ». - (19) |
| gazi, adj. qui est dur (en parlant du pain) comme une « gaze ». - (24) |
| gazille, gazoute : fille. - (32) |
| gâzin – petits déblais, fatras qui proviennent d'une ruine. – Te peux menai ce gazin dans les champs, al â bon. – Ce gâsin n'a diére propre qu'ai jetai dans les rues. - (18) |
| gazin ou gazun. Brique épaisse qu'on emploie dans la construction, notamment des cheminées. - (12) |
| gazoïlli : Gazouiller, commencer à parler, balbutier. « Tan ptiet cause t'i dja, o commache seureument à gazoïlli » : ton enfant parle-t-il déjà ? il commence seulement à parler. - (19) |
| gazon : motte de terre et d'herbe - (48) |
| gazon, n.m. motte de terre. - (65) |
| gâzon, pierre plate servant à border des allées de jardin, à faire des cloisons, etc. - (16) |
| gâzon, s. m. grosse brique que confectionnent les tuiliers du pays. - (08) |
| gazouilli - jacassi : gazouiller - (57) |
| gazoute (nom féminin) : fille. - (47) |
| gazoute (une) : une jeune fille - (61) |
| gazoute : fille (gâtière) - (60) |
| gazoute. n. f. - Terme affectueux, pour désigner une fillette. - (42) |
| geais, n. masc. ; jars (mâle de l'oie). - (07) |
| geaissier, gessier. s. m. Geai. (Villeneuve-les-Genêts, St-Denis-sur-Ouanne). – Homme sans jugement. (Sommecaise). - (10) |
| geaissier. n. m. - Personne sans jugement, petite tête, comme peut l'être le« geai». (Sommecaise, selon M. Jossier) - (42) |
| gealer, (jaler), v., geler. - (40) |
| geârbe (na) : gerbe - (57) |
| gearbé : Tas de gerbes, meule. « Ol a ésu in biau bliié dans sa tarre, y a fait un ban gearbé » : il a eu un beau blé dans sa terre, cela a fait une belle meule. - (19) |
| gearbe ou jarbe : Gerbe. - (19) |
| gearbe : n. f. Gerbe. - (53) |
| gearbe, jarbe. n. f. - Gerbe. Ce mot n'a pas changé depuis le XIIe siècle ; influencé par un terme francique, jarbe signifiait alors gerbe, et jarber mettre en gerbes. - (42) |
| gearbe, s.f. gerbe. - (38) |
| gearber : gerber - (57) |
| gearber : Gerber, placer des tonneaux les uns sur les autres de la même façon qu'on place les gerbes sur le char. - (19) |
| gearbi (na) : gerbier - (57) |
| gearbillon. n. m. - Petite gerbe. - (42) |
| gearbire (na) : gerbier (en dehors) - (57) |
| gearbire (na) : meule (de gerbe) - (57) |
| gearman : Première pousse qui sort de la graine des végétaux. « In gearman de faviôles (de haricots) ». - (19) |
| gearner : germer - (57) |
| gearnon (on) : germe - (57) |
| geat. s. m. Geai. (Sougères-sur-Sinotte). - (10) |
| geau : coq (jau) - (60) |
| geaudaler, v., se divertir à courir, à sauter ; les jeunes poulains geaudalent dans les prés. - (07) |
| gèche : Gesse, lathyrus sativus. « Sonner des gèches » : semer des gesses. - (19) |
| gef. Acide, piquant ; se dit d'un fruit pas mûr. - (49) |
| gèfion : (jèfyon: - subst. m.) dard de l'abeille ou de la guêpe. Par extension, sexe masculin. - (45) |
| gège : mue (pour les volailles) - (48) |
| gége. s. f. Mue, poussinière, endroit ou l'on élève des poussins, ou l'on engraisse de la volaille. (Etivey, Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| géïant, sm. géant. - (17) |
| geignard, arde. s. et adj. Pleurnicheur, euse. (La Celle-Saint-Cyr). De geindre. - (10) |
| geigner, v. ; donner un coup de pied. - (07) |
| geigner. v. n. Geindre, pousser des plaintes, des gémissements, et, par extension, contrefaire, écharnir ceux qui se plaignent. (Limites du Tonnerrois, environs d'Ervy). - (10) |
| geigneux, geindeux. adj. et s. Celui qui geint, qui se plaint souvent. - (10) |
| geigneux, génieux. s. m. Tasse de faïence, ordinairement de forme cylindrique et d'un diamètre égal à sa hauteur. – Par extension, petite cruche à vin, pouvant aller devant le feu. - (10) |
| geigneux. n. m. - Celui qui geint. - (42) |
| geillot. s. m. Jonc qui pousse dans les ruisseaux. (Ferreuse). - (10) |
| gein-ne, s. f., gêne, physique et financière. - (14) |
| gein-ner, v. tr., gêner, contraindre. - (14) |
| geinner. v. a. Gêner. - (10) |
| geitai et geite. : Giter et gîte. (Du latin facere.) - (06) |
| geitai. Giter, gité, gitez. - (01) |
| geite. Gite, gites. - (01) |
| gelaigne, gelinotte ; en latin gallina, poule. - (02) |
| gelaudée. n. f. - Petite gelée. - (42) |
| gelaudée. s. f. Petite gelée. Dans le mois de mai, on a souvent des gelaudées. - (10) |
| gelauder. v. - Geler légèrement. - (42) |
| gelauder. v. n. Geler un peu. Cette nuit, il a gelaudé. - (10) |
| gêlè : geler - (46) |
| gèlè : v. t. Geler. - (53) |
| gèlé, ègèlé, jolé (ö), vn. geler. - (17) |
| geleignôte de boo. Gélinote, ou gélinotes de bois. - (01) |
| geler : D'après une vieille légende Saint-Georges aurait le pouvoir de faire geler les vignes et en userait trop fréquemment. - (19) |
| gèler : geler - (48) |
| geleuter : Geler légèrement. - (19) |
| géline (nom féminin) : poule. - (47) |
| géline : poule. - (55) |
| géline : volailles. - (32) |
| géline, poule. - (04) |
| geline, s. f. poule. Le mot est tombé en désuétude. - (08) |
| gelinier : poulailler. Très peu utilisé, mais figure sur nos actes notariés du XIXème. Vient du latin gallina : la poule - (62) |
| gelinier : s. m., v.t fr., poulailler. - (20) |
| gelinier, gelinière, gennelière. Poulailler. Etym. gallina. - (12) |
| gélinière (nom féminin) : poulailler. - (47) |
| geliniére, s. f. poulailler, lieu où l'on enferme les poules. - (08) |
| gelis, gelisse : adj., gelif, gelive, état des fruits et légumes, gelés ou non, qui ne s'amollissent pas à la cuisson. - (20) |
| gelniére. s. f. poulailler. On prononce quelquefois « jeulniére, jeurnère. » - (08) |
| gelò, adj., gelé. Indépendant du v. Jauler. (V. ce mot.) - (14) |
| gelòchi, v. n. geler légèrement. - (24) |
| gelouchi v. n. geler légèrement. - (22) |
| gemboulée. Giboulée. - (49) |
| gémi, v. intr., gémir. - (14) |
| gémissu, parf. de gémi : « Alle a tant gémissu, qu'alle en a tombé mau. » - (14) |
| genâbe (n.m.) : genièvre (aussi znâbe) - (50) |
| genâbe, genâbre, genâve, genâvre : genévrier - (48) |
| genabre, genavre et genâvre. s. m. Genièvre, genévrier. - (10) |
| genâbre, genàvre, s. m. genévrier, arbre de la famille des conifères : « z'nâbe. » - (08) |
| genâbrette, s. f. fruit du genévrier. - (08) |
| genabrette. s. f. Genièvre. - (10) |
| genâbrotte (n.f.) : fruit du genévrier - (50) |
| genaisé, qui a trempé trop longtemps dans l'eau et qui n'est plus propre à un usage normal (ex.: de la paille genaisée). - (27) |
| génance, s. f. gène, embarras, difficulté. - (08) |
| genâvre : genévrier. - (29) |
| genâvre : Genièvre, Juniperus communis. - (19) |
| genceaux (avoir les), les dents agacées. - (05) |
| gences - agacement aux dents. - Çes poumes m'ant beillé les gences, que ci me contrarie pour méger. - (18) |
| gences (avoir les). Avoir les dents agacées. Etym. gencives. - (12) |
| gences (ça baille les) : ça irrite les gencives. (SB. T IV) - C - (25) |
| gences, sf. agacement des dents ou des gencives après mastication de fruits verts. Se dit aussi des moutons qui commencent à paître. - (17) |
| gences. « Avoir les gences » c'est avoir les dents et ]es gencives agacées par des fruits verts. Les Morvandeaux disent : avoir le genciot. - (13) |
| genci (pour chanci, par conversion de ch en g). adj. et part. p. Couvert de mousse blanche, de moisissures. (Accolay). Du latin canescere, canus. - (10) |
| genciau. Mal de dents. (Aocolay). Vient sans doute de gencive. - (10) |
| genciot (le), s. m. effet que produit dans la bouche l'acidité d'un fruit encore vert ; agacement des dents ou peut-être des gencives. - (08) |
| gencive. Gencive. - (49) |
| gençòts (les), s. m., agacement des dents produit par des fruits verts, ou des aliments acides : « Tes pernes sont pas meùrtes ; all' m'ont baillé les gençots. » (On dit : donner les gençots, avoir les gençots.) - (14) |
| gendârme (on) : gendarme - (57) |
| gendarme, s. m., hareng saur. - (40) |
| gendre, s. m., genre, sorte, manière : « I vorô ben por mon gàs eùne fillote dans l’gendre d'la vôt'. » Est dit par l'Italien qui parle français. - (14) |
| gendresse : belle fille - (44) |
| gendresse : Belle-fille, bru. - (19) |
| gendresse : belle-fille. (MLB. T II) - S&L - (25) |
| gendresse : s. f., bru, belle-fille. Sa gendresse était si tellement ficelée dans ses biaux babils le jour de la noce qu'elle en était rouge corne un cul-fessé (prononcer cu-fsé). - (20) |
| gendresse, n.f. belle-fille. - (65) |
| gène : Marc de raisin pressé. « De l'iau de vie de gène » : de l'eau de vie de marc. - (19) |
| gène, s. f. marc de raisin après le pressurage. - (22) |
| gène, s.f. marc de raisin après le pressurage (vieux français). - (24) |
| genelinre (f), poulailler. - (26) |
| générau : s. m., général. - (20) |
| genéte : genêt - (48) |
| genête : genêt. - (33) |
| genétes - genet. - Vai don cueillé des genétes dans lai Seigne ou bein s'te veux en Belleforet. - Deux ou trois rains de genétes nos duraint bein pour l'écurie, a sont pu solides que ceux de boulouâ. - (18) |
| genêtière. s. f. Terrain planté de genêt. (Puysaie). - (10) |
| genêtrale, genêt des teinturiers. - (05) |
| genêtre, s. f. genêt, le genêt à balai qui pousse admirablement dans nos terrains granitiques. - (08) |
| genette : voir balaîtier - (23) |
| geneu : Genou. « Se mentre à geneu » : s'agenouiller. - (19) |
| geneuillère : Genouillère. « Y en a que portant des geneuillères pa se teni chaud » : il y a des gens qui portent des genouillères pour se garantir du froid. - (19) |
| genevri (on) : genevrier - (57) |
| genevri, s. m. givre, vapeur glacée qui s'attache aux arbres, aux herbes, etc., glaçons qui pendent aux branches. - (08) |
| genevriller, v. imp. faire du givre : « a gen'vrille », il tombe du givre, il fait du givre. - (08) |
| genier – abréviation de gelinier poulailler. - On dit plus ordinairement juché. Voyez donc ce mot. - (18) |
| genière : poulailler. - (32) |
| genière, gélinière, poulailler. - (27) |
| genière. s. f. Syncope de gelinière, poulailler. (Savigny-en-Terre-Plaine). - (10) |
| genilier : s. m., métathèse de gelinier. - (20) |
| genilier, gelinier, poulailler. - (05) |
| génilier, s. m., gélinier, poulailler. - (14) |
| genillé, Genillet. s. m. Se dit pour genillier, lequel lui-même, par une transpositlon qui se voit fréquemment, s'écrit pour gelinier, poulailler. Du latin gallina et du vieux français géline. - (10) |
| geniller. Gélinier, poulailler. - (49) |
| genillier. n. m. - Perchoir dans le poulailler (Sougères-en-Puisaye). Ce mot est une déformation de gelinier, poulailler. En ancien français du XIIe siècle, une poule se dit géline, par dérivation du latin gallina. Le mot poule, féminin de poul, jeune coq, a peu à peu éliminé le mot géline alors qu'il est conservé dans plusieurs patois (Bourgogne, Est, Midi). - (42) |
| genne (C.-d., Chal), geindre (Br.).- Marc, résidu du raisin après le pressurage. Aucune étymologie n'a encore été donnée de ce mot expressif… - (15) |
| genne (gên’) : s. m. et f., vx fr., marc de raisin. Du genne. De la genne. Eau-de-vie de genne. - (20) |
| genne, s. f. marc produit par le raisin après le pressurage. - (11) |
| genne. Marc de raisin. L'étymologie ne m'est pas connue, car je ne pense pas que l'on puisse trouver quelque rapport entre ce mot et celui de gebenne, espèce de torture qui consistait à écraser les membres du patient. En Bourgogne, nous distillons nos gennes pour avoir de l’eau-de-vie de marc. Le gin anglais est une sorte d'eau-de-vie, de même que le genièvre flamand et hollandais... - (13) |
| genne. Résidu du raisin après qu'on a foulé la cuve, marc du raisin. Etym. inconnue. - (12) |
| geno, s. m. genou. - (08) |
| genò, s. m., genou. - (14) |
| Génoi. Génois en 1701. - (01) |
| genôllée, s. f. genouillère; boucle que l'on met aux vaches pour les empêcher de ruer. Avec cette attache elles n'ont plus que trois pieds en liberté. - (08) |
| genon, sm. genou. - (17) |
| genon. Genou, genoux. - (01) |
| Genotte. s. f. Diminutif de Geneviève. (Poilly-sur-Serein). ). - (10) |
| genouillon : s. m., vx fr. genoillon, genou. A genouillons, à genoux. Dicton : - Qui sème son chanvre aux Rogations le récolte à genouillons. - (20) |
| genre – gendre. - Al â tot ai fait content de son genre. - In genre ç'â pu endeurant qu'ine bru. - (18) |
| genre : gendre - (48) |
| genre : (jan:r' - subst. m.) gendre. - (45) |
| genre : s. m., chic. C'est pas genre. Il est rien genre, çui-là. - (20) |
| genre, s. m. gendre. « zindre. » - (08) |
| genre, sm. gendre. - (17) |
| gens de Saône : loc, habitants des bords de la Saône, vivant de la batellerie et de la pêche. - (20) |
| genson, genseron. n. m. - Aiguillon de la guêpe, de l'abeille, etc. (Perreuse, selon M. Jossier) - (42) |
| gensos (Faire les). Agacer les dents. C'est une onomatopée comme agacer. - (03) |
| gensron : dard. IV, p. 27 - (23) |
| gensson, Gensseron. s. m. Aiguillon des abeilles, des frelons, des guêpes, etc. Voyez jasson. (Ferreuse). - (10) |
| gent - (Féminin : gente) : beau, dans le sens de bien mis, élégant. Ex : "Oh, ben t'es ben gente a c'matin, lavou qu'té vas ?" - (58) |
| gent, gente, adj. gentil, aimable, gracieux. « zent, zente. » - (08) |
| gent, gente, gracieux, agréable. - (04) |
| gentaiser. v. n. Phraser, faire le beau parleur. Se dit sans doute pour chantaiser. - (10) |
| gente (adj.) : belle, jolie, généralement en parlant d'une femme ou d'une jeune fille (alle est bin gente) - (64) |
| gente : gentille. - (09) |
| gente : jolie, gracieuse - (61) |
| gente. n. f. - Jolie, gentille : « On a fait counnaissance de la Josiane, ma foué, alle est ben gente ! Et pas fière ... Arrié ! l'vont ben ensemble. » - (42) |
| genti homme, s. m. homme d'humeur facile et serviable, doux, complaisant : « i l'eunie bin, çô eun genti hon-m' », je l'aime bien, c'est un aimable homme. - (08) |
| genti, adj. travailleur. Aimable. Fém. gentite. - (24) |
| genti, adj. travailleur. Fém. gentite. - (22) |
| genti, adj., gentil, agréable, gracieux. (V. Gentite.) - (14) |
| genti, ite, adj. gentil, ille. - (17) |
| genti, tite, adj. gentil, aimable, gracieux, complaisant : « ç'ô eun genti p'tiô ; voiqui eune gentite fon-n'. » - (08) |
| gentil houmme : bel homme - (61) |
| gentit (te) : gentil, gentille - (39) |
| gentit : Gentil. « Alle n'est pas brave (belle) mâ aile est gentite ». - (19) |
| gentite : gentille - (46) |
| gentite : adj. f., gentille, active, travailleuse. Si t'es bien gentite, J’ te donn'rat un p'tit rien tout neuf. - (20) |
| gentite : adj. Gentille. - (53) |
| gentite, adj., sympathique, aimable. - (40) |
| gentite, adjectif qualificatif : gentille. - (54) |
| gentite, fém. de genti, gentille, jolie : « La p'tiote, j'la prendrôs ben ; alle é gentite à croquer. » - (14) |
| gentite, féminin de genti, gentil. - (16) |
| gentite, gentille. - (26) |
| gentite. Gentille. - (49) |
| georget (en), loc. en négligé, en bras de chemise. - (17) |
| geormer, v. germer. - (38) |
| geormer. v. a. et n. Germer. (Elivey). - (10) |
| geormon. s. m. Germe. (Domecy-surle-Vault). - (10) |
| gerbe : s. f., ensemble de rangées de fûts superposées. - (20) |
| gerber : v. a., mettre en gerbe. Gerber en second, en troisième, etc., superposer une deuxième, une troisième rangée de fûts, etc. - (20) |
| gerber, v., vomir en fusée. - (40) |
| gerdine. n. f. - Grande bringue ; toujours employé dans un sens péjoratif.(Arquian) - (42) |
| gergille : ivraie, mauvaise graine - (48) |
| gergoniai - disputer à tort et à travers ; parler seul avec mécontentement, en murmurant. - Et pu quoi qu'i ons fait ? ran du tot… I ons gergognai, voilai tot. - Pôre homme ! a gergogne du matin à sair sans pouvoir se fâre obéi. - (18) |
| gerle - ronde ou petit cuvier pour la lessive. - Lai gerle cole, en faut l'aibreuvai, et tré bein moinme. - Vai to de suite rempli lai gerle de luchu. - (18) |
| gerle : baquet en bois. (TSO. T III) - D - (25) |
| gerle, gerloter, gerlotier : voir jarlot, jarloter, jarlotier. - (20) |
| gerlicouée : grande quantité. (VDS. T IV) - VdS - (25) |
| gerlicouée : n. f. Tripotée. - (53) |
| germon. Germe. - (49) |
| gernon : voir gensron - (23) |
| gésier : estomac. - (32) |
| géssier. n. m. - Geai. - (42) |
| gêtre : Gîte. « Ol a tué in lièvre au gêtre » : il a tué un lièvre au gîte. - (19) |
| geumer, v. n. lambiner. - (24) |
| geune : marc de raisin. - (31) |
| geurdoler : (vb) trembloter - (35) |
| geuriaud: (nm) vagabond - (35) |
| geurlot : (guêrlo - subst. m.) 1- petit récipient cylindrique, destiné aux usages les plus divers : boîte à épingles, boîte à plumes, tirelire ... 2 - mauvais poêle. 3- cylindre d'écorce qu 'on détache d'un chêne par incision. - (45) |
| geurnouille (nom féminin) : grenouille. - (47) |
| geurnouille : n. f. Petite mare mal entretenue. - (53) |
| geurnouiller : boire au café. - (66) |
| geuvri (n.m.) : givre - (50) |
| gève (m) : poulailler. (CST. T II) - D - (25) |
| Gevrâ : Gervais. « Vins-tu à la Saint Gevrâ ? » : viens tu à la fête d'Ozenay ? La fête patronale d'Ozenay tombe le jour de la Saint Gervais, 19 Juin. - (19) |
| gevreney, genévrier. - (05) |
| gevri, s. f. givre. Verbe : gevràyé. - (22) |
| gevri, s. m. givre. - (08) |
| gevri, s. m. givre. Verbe gevràyer. - (24) |
| gevri, s. m., givre, frimas. - (14) |
| gevriller, v. imp. faire du givre. (Voir : genevriller.) - (08) |
| gevriller, v. intr., se dit du givre qui tombe. - (14) |
| gevrillons, frissons. - (05) |
| gevrin. s. m. Givre. A Sacy et dans toutes les communes circonvoisines, on dit gevringne. - (10) |
| gevrine. s. f. Sorte d'osier qui se plante sur le talus des berges des rivières pour amortir la violence du courant et les garantir ainsi des érosions. - (10) |
| gevringne. s. m. Givre. - (10) |
| gevru (on) : givre - (57) |
| gevru : Givre. « Y a du broilla, si i gèle s'te né y ara du gevru demain le métin » : il y a du brouillard, s'il gèle cette nuit il y aura du givre demain matin. - (19) |
| gevru, s.m. givre. - (38) |
| gevrus, givre. - (05) |
| géyâ : Geai. « In nid de géyâs ». - (19) |
| gëzu, gros intestin du porc dont on se sert pour faire de gros saucissons. - (16) |
| gheille, s. f. morve, humeur qui découle des narines. - (08) |
| gheilleeeai, s. m. morveau, morve épaisse, stagnante ou projetée. - (08) |
| gheiller, v. n. morver, rejeter de la morve. - (08) |
| gheillou, ouse, adj. morveux, celui qui a de la morve au nez. se dit d'un enfant comme en français morveux : « eun p'tiô gheillou, eune ptiote gheillouse. » - (08) |
| gheute, s. f. goutte, terrain qui verse ou qui reçoit les égouttements de terrains supérieurs. (Voir : gutte.) - (08) |
| gheuti, s. f. terrain où se trouvent des sources, endroit humide ou mouvant. - (08) |
| ghiéèpe : guêpe. IV, p. 27 - (23) |
| ghuéte, s. f. terrain fangeux, mouvant, où se trouvent ordinairement des eaux de source. Environ de Lormes. (Voir : enghuéter.) - (08) |
| giante. n. f. - Une femme qui vient d'accoucher (Lainsecq, selon M. Jossier). Giante est la contraction de gisante du verbe gésir, dont l'un des nombreux sens était, dès le XIe siècle, accoucher. Dérivé du latin jacere, être étendu immobile, le verbe gésir en français, ne s'emploie plus qu'au présent (ci gît...) ou par le nom « gisant », statue d'un mort étendu. Au début du XXe siècle, on disait encore « être en gésine » pour être en couches, accoucher. Avec la giante, le poyaudin conserve un mot de français en cours de disparition. - (42) |
| gïante. s. f. Contraction de gisante, mot par lequel on désigne, à Lainsecq, une femme qui vient d'accoucher. Dans beaucoup de communes, et notamment à Auxerre,on dit géante, ce qui nous semble moins bien. Cependant, cette prononciation se comprend jusqu'à un certain point, puisque cet adjectif serait une contraction du féminin de gésant, participe présent inusité de gésir. Et puis, suivant les vieux dictionnaires, gisante est synonyme d'accouchée, et vient du latin jacens, qui gît, qui repose, qui est couché, et du vieux verbe gisir, gésir, lequel a donne lieu au mot gésine, encore usite aujourd'hui. - (10) |
| Giaude, Glaude : diminutifs de Claude - (48) |
| gibai. Gibet. - (01) |
| giban. s. f. Femme peu estimable. (Etivey). - (10) |
| gibasse (nom féminin) : giboulée. - (47) |
| gibasse, giboulée - (36) |
| gibasse, s. f. giboulée de pluie, averse subite. - (08) |
| Gibassié. Nom de famille assez répandu dans le pays. - (08) |
| gibeceire. Gibecière : « Jueu de gibeceire », joueur de gibecière ; ici c’est trompeur. - (01) |
| gibecien. s. m. et gibecienne. s. f. Qui a des allures vives, éffrontées, vagabondes, comme celles des bohémiens et des bohémiennes. C'est une syncope des mots Egyptien et Egyptienne. - (10) |
| giber : grelotter de froid ou trembler d'émotion. - (30) |
| giblotée. n. f. - Ribambelle, un certain nombre : une giblotée de gamins, de moigneaux. - (42) |
| gibouler. v. - Parler abondamment. (Mézilles, selon H. Chéry) - (42) |
| giboulòte, s. f,, gibelotte, fricassée. - (14) |
| giboulotte, fricassée en gibelotte. - (05) |
| gichlle ou gichllœ, s. m. seringue en sureau. Du verbe : gichllé, gicler. - (22) |
| gichlliat, s. m. seringue en sureau. Du verbe gichller, gicler. - (24) |
| giclai, lancer de l'eau... - (02) |
| gicle, petite seringue de sureau. - (05) |
| giclée : s. f., jet de liquide. Viens donc, j’ vas t’ payer une giclée de vin. - (20) |
| gicler : v. n., vx fr., jaillir avec force. - (20) |
| gicler, seringuer, éclabousser. - (05) |
| gicler. - Voir: jicler. - (15) |
| giclian : Moucheture faite par une goutte d'eau sale ou de boue liquide. « Tan c'eutillan est pliein de giclians de borbe » : ton jupon est plein de taches de boue. - (19) |
| giclier : Gicler. « S'ébugi à fare giclier des eus de cheriges» : s'amuser à faire gicler des noyaux de cerises, en les serrant entre le pouce et l'index. - (19) |
| giclieux : Sorte de seringue faite d'un morceau de branche de sureau dont on a enlevé la moelle. - (19) |
| giclo, giglo : jet (de lait sortant du pis) - (48) |
| giclot : éclaboussure, par un liquide qui gicle. - (62) |
| giclot : jet - (44) |
| giclot, éclaboussure d'eau, de boue. - (05) |
| giclòt, ou giquelòt, s. m., loquet Constitue encore dans maints villages toute la fermeture des portes. Les paysans vont aux champs, pour la journée, et se contentent de laisser retomber le loque t; ils n'ont point de cambrioleurs à craindre. - (14) |
| gicloter, v, tr., loqueter, agiter, faire tourner le giclòt. - (14) |
| giclou, giclard : s. m., petite seringue faite ordinairement avec une tige de sureau dont on à enlevé la moelle. - (20) |
| gidounée. s. f. Charge que l'on porte dans son tablier. Se dit pour girounée, gironnée. (Gourgis). – A Maligny, on dit gisounée dans le même sens. - (10) |
| gidrer : laisser échapper du jus ou un liquide, par une pression (manuelle ou autre). - (56) |
| gidron, s. f. grosse andouille. - (08) |
| gidrou : rectum du porc avec lequelle on fait une grosse andouille - (48) |
| gidrou : (jidrou - subst. m.) gésier. Au figuré, l'estomac humain. - (45) |
| gidrou : un fruit gidrou, une poire gidrouse : qui laisse sortir du jus. - (56) |
| gidrou, gidron (n.m.) : grosse andouille (de Chambure écrit : gidron) - aussi bitrou - (50) |
| gidrouillon : reprise mal faite. (S. T III) - D - (25) |
| giendre : marc de raisin, ou la genne (rafles+ peaux+ pépins), après pressurage ou distillation. - (62) |
| gif’llier : Souffletter, gifler. « Finis ou bin te vas te fare gif'llier » : finis ou tu vas te faire gifler. - (19) |
| gife, s. f., gifle, soufflet. - (14) |
| giffe : s. f., vx fr., gifle. J'i ai foutu une giffe ; la terre li a rendu l'autre. - (20) |
| giffes, giffles. s. f. pl. Nom vulgaire de la maladie dite des oreillons. - (10) |
| giffles : s. f. pl., oreillons (maladie). II a les giffles. - (20) |
| gifje, sf. gifle. - (17) |
| giflair, adj. joufflu, qui a de grosses joues, au féminin « giflairde. » - (08) |
| gifle ; avoir les gifle est avoir les joues enflées près des oreilles. - (16) |
| gifles, s. f. pl. enflure des joues, engorgement des glandes du cou, ampoules, oreillons dans plusieurs patois. - (08) |
| gifles. Maladie, les oreillons. - (12) |
| gif'lle ou gif'ye : Gifle. « Ol a reçu eune fameuse gif'lle » : il a reçu une forte gifle. - (19) |
| gif'lles : Maladie appelée en français « oreillons ». « San garçon a ésu les giflles » : son fils a eu les oreillons. - (19) |
| gigandelle, gigantine, gigandine. s. f. Femme de très-haute taille. Du latin gigas, géant. - (10) |
| gigasse. n. f. - Femme très grande et très maigre. Employé dans un sens péjoratif: « Te parles d'eune grande gigasse. » Ce mot est dérivé de «gigue», synonyme de gambe, jambe, très peu employé en français contemporain. Au XVIIe siècle, il signifiait « jambe et cuisse » ; de là vient le mot « gigot». Aujourd'hui le langage de la vénerie l'utilise encore : une gigue de chevreuil. - (42) |
| gigasse. s. f. Femme très-grande et d'une maigreur qui la fait paraître plus grande encore. Du latin gigas. - (10) |
| gigasser. v. - Gesticuler, gigoter, ne pas tenir en place. - (42) |
| gigi, subst. masculin : gésier. - (54) |
| gigier - gésier, estomac des poules, des oiseaux en général. - Pôre poule ! ile aivot le gigier encore pliain d'orge. - Dieu merci ! vos dindes ant de fameux gigiers ; vos les neurissez bein. - (18) |
| gigier : s. m., gésier. Ce mot s'applique aussi par erreur au jabot et par plaisanterie au gosier. - (20) |
| gigier, gégier. s. m. Gésier. Du latin gigerium. - (10) |
| gigier, s. m. gésier. - (08) |
| gigier, s. m., gésier. Se dit aussi de l'estomac d'un ivrogne, d'un goinfre : « S'en é-t-i fourré dans le gigier ! » - (14) |
| gigier, sm. gésier. - (17) |
| gigier. Estomac des volailles. Gigerium, en basse latinité. - (13) |
| gigier. Gésier. En latin gigeria dans Lucilius. - (03) |
| gigille : (jigy' - subst. f.) seringue, clystère. - (45) |
| giglâder, v. n. jouer, folâtrer, se démener étourdiment. Giglâder est le fréquent, de «giguier» pour « giguer », jouer des jambes, danser. - (08) |
| gigle : petit jouet en sureau utilisé pour lancer de l'eau - (39) |
| gigler (que dans certains endroits on prononce giller). v. n. Se dit du filet d'eau qui, sous une impulsion quelconque, s'échappe vivement par l'orifice étroit d'une seringue ou de quelque autre instrument semblable. - (10) |
| gigler : lancer de l'eau. - (09) |
| gigliai - lancer de l'eau par un jet plus ou moins fort comme avec une seringue ou par ricochet. - Ces galopins lai, d'aivou des bâtons a gigliaint de l'aie sale su nos haibits. - Pendant qui passaint, tai voiture que corrot é fait gigliai de lai gôille sur no. - (18) |
| gigliôre, gigliot, giliotai - petite seringue faite ordinairement avec un morceau de sureau ; goutte d'eau, de boue liquide, lancée ou tombée sur des habits. - Quand i étâ petiot i m'aibuyâ joliment aivou ine gigliôre. - Aitend in manmant qui t'ôtâ in gros giglio que t'é su tai robe. - Laivou que t'té don gigliottai quemant cequi ? - (18) |
| giglo, quequio : une petite giboulée. O n'y ai tombai qu'un giglo : il n'est tombé qu'une petite giboulée. - (33) |
| gigloie, gigloire. s. f. Voyez gille. (Perreuse). ). - (10) |
| giglon. s. m. Filet d'eau lancé par une giglouée. (Argentenay). - (10) |
| giglot. Eclaboussure, plus exactement la chose qui gicle. Etym. onomatopée. - (12) |
| gigne (na) - tourille (na) : génisse - (57) |
| gigne (na) - tourille (na) : taure - (57) |
| gigne, génisse. - (05) |
| gignerée : grande quantité de fruits, etc..., ramassés dans le d'vanté. (CLB. T II) - C - (25) |
| gigneuve. n. m. - Genièvre. - (42) |
| gignieuvre. s. m. Genièvre. - (10) |
| gigogner (v.t.) : gesticuler, remuer - (50) |
| gigogner : v. a., syn. de cigogner. - (20) |
| gigogner. - Forme locale du mot gigotter. Etym. gigue, jambe en bas français ; kig, breton, jambe. - (12) |
| gigogni : Tirailler, secouer. « A fôrce de gigogni te finiras pa tot y arrégi » : à force de tirailler tu finiras par tout arracher. - (19) |
| gigoignaige, s. m. ouvrage fait à bâtons rompus, travail sans suite et sans utilité. - (08) |
| gigoigner, v. a. exécuter un travail avec maladresse, se livrer à des occupations peu utiles ; faire des riens, perdre son temps. - (08) |
| gigoignou, ouse, s. et adj. celui qui va et vient, qui se démène dans des occupations minutieuses et de peu d'importance. - (08) |
| gigolette. n. f. - Petite fille remuante, vive, toujours en train de sauter ou de danser. - (42) |
| gigoner, remuer en tirant mollement. - (28) |
| gigoniai - perdre son temps en travaillant maladroitement, estropier la besogne que l'on fait. - Quoi que te gigogne don lai ? Décampe vite, t'é in prope ai ran. - Oh, ce n'a pâ in ovré, cequi, c'â to bonnement un vrai gigognou. - (18) |
| gigouée, giglouée (pour gigoire, gigloire). s. f. Seringue de bois, ordinairement en sureau. (Saint-Sauveur). - (10) |
| gigouée, giglouée, gigloie, giglée. n. f. - Seringue en bois, généralement en sureau, dont les enfants se servaient pour jouer à s'arroser. - (42) |
| gigouègner : lutiner - (48) |
| gigouègner : remuer, avoir du jeu - (48) |
| gigouègner : gigotter, secouer - (39) |
| gigouéniller : (jigouènyé - v. trans.) branler, imprimer à qqch un léger mouvement de va-et-vient. (de gigue + suffixe). - (45) |
| gigougner (v. int.) : s'agiter, remuer - (64) |
| gigougner (v. tr.) : agiter, secouer - (64) |
| gigougner (verbe) : remuer, se débattre. - (47) |
| gigougner ou gigogner, verbe transitif : secouer. - (54) |
| gigougner : gigotter, secouer - (39) |
| gigougner, et gigogner, v. intr., gigoter, remuer les jambes : « Pendant tout l'bal ôl a tant gigougné, qu'ô n'en peut pu. » — V. tr., tirailler, secouer en disloquant : « T'veux donc l'éracher, que t'gigougnes si fort la porte ? » — « T'as biau gigougner l'manche du martiau, te l'démanch'ras point. » - (14) |
| gigougner, v., secouer dans tous les sens pour retirer un robinet. - (40) |
| gigougnî : bouger, gigoter. Branler, avoir du jeu dans le manche. Un individu qui gigote exagérément est un gigougnou. - (62) |
| gigouille - mauvaise cuisine, mauvaise boisson en général toute chose mal faite, sans valeur. - Dans c't'auberge en ne vos sert que de lai gigouille. - To ce que ces petiots mairchands colportant queman cequi, ç'â de lai pure gigouille. - (18) |
| gigouille, sf. cuisine sans goût. Mauvais vin. - (17) |
| gigouille, sf. marcher ou remuer dans l'eau. - (17) |
| gigouille. Mauvais vin. Vin acide qui donne envie de ginguer, et qui n'est bon « qu'à faire danser les chèvres ». Il faut être trois pour boire un verre de gigouille : les deux premiers maintiennent le troisième pendant qu'il avale ! (V. Ginguer.) - (13) |
| gigouiller : crouler, agiter. - (32) |
| gigounée : grande quantité - (60) |
| gigouner : engendrer, saillir. - (09) |
| gigouner, v. a. gigotter, remuer les jambes avec vivacité. - (08) |
| giguaignai : secouer fortement dans tous les sens. - (33) |
| gigue d'andouille, loc. Se dit d'un homme mou, qui se laisse aller en marchant, qui n'a pas la jambe (gigue) plus forte qu'une andouille. - (14) |
| gigue, s. f. jambe, d'où probablement gigot. - (08) |
| gigue. s. f. Jambe. Aller à la gigue, sauter, marcher à cloche-pied. (Villiers-Saint-Benoît). - (10) |
| gigues, s. f. pl. jambes, en langage plaisant. - (24) |
| gigueut : Gigot. « In gigueut de moutan ». - (19) |
| giguier : (jikyè - v. neutre) gicler, éclabousser. - (45) |
| giguillo : (jigyo: - subst.m.) éclaboussure - (45) |
| giguogné : v. t. Secouer fortement dans tous les sens. - (53) |
| giindre,s.f. germe (marc de raisin) - (38) |
| gikié : se dit d'une plante qui monte, avortée - (46) |
| gilet, n.m. désigne tout vêtement masculin couvrant le thorax (maillot, pull, veste). - (65) |
| gille, gigle (on mouille le gl). s. f. Petite seringue de sureau avec laquelle les enfants font gigler de l'eau. (Perreuse, Villers-Saint-Benoît, etc.). - (10) |
| gille. n. f. - Fusil de chasse. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| gillée. n. f. - Giclée. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| giller (prononcer jiyé) : gicler - (61) |
| giller (v. int.) : gicler, jaillir - (64) |
| giller, pétiller - (36) |
| giller. v. - Fuir, se sauver sans demander son reste. « Grand pée, il a pris eune poignie d'ortie, t'aurais vu l'Julien si i' gillait ! » Ce verbe est directement formé sur l' expression faire gille, signifiant à la Renaissance s'enfuir, se retirer. Le mot gille, d'origine douteuse, serait issu de l'ancien français gille (tromperie, supercherie) et / ou du nom d'un bouffon très célèbre du théâtre de foire. Les Gilles sont encore représentés aujourd'hui par les personnages naïfs du carnaval de Binche, en Belgique. - (42) |
| giller. v. n. Gigler, jaillir. – S'échapper, disparaitre sans être vu. (Perreuse, Villiers-Saint-Benoît). - (10) |
| gillet, sm. gilet. - (17) |
| Gillot : diminutif de Gilles - (48) |
| gillot. n. m. - Colique. Se dit gille à Sougères-en-Puisaye. - (42) |
| gillouée (n. f.) : désigne tout instrument destiné à projeter un liquide - (64) |
| Gilot, nom d'homme. Diminutif de Gille. - (08) |
| gimbelée (nom féminin) : giboulée. - (47) |
| gimbelée, s. f. giboulée, averse subite de pluie ou de grésil. - (08) |
| gimer. Remuer, hausser dans le sens de hausser les épaules : « gimer les épaules ». - (49) |
| gindre, gendre, zindre. - (04) |
| gingenillé : effiloché. - (56) |
| gingille,s.f. pacotille. - (38) |
| gingnâ (on) - tingnâ (on) : geignard - (57) |
| gingoi (de). Guingois ; de travers. - (49) |
| gingois (de) : travers (de) - (48) |
| gingois (De) : loc. adv., de guingois. - (20) |
| gingois (de), loc. adv., de guingois : « Drès qu'ôl a bu eun varre de vin, ô va tout de gingois. » - (14) |
| gingot. adj. Boiteux. (Nailly et localités circonvoisines). - (10) |
| gingoua (de), locut. adv. de travers, non d'aplomb. Ex. : marcher tout de gingoua. - (11) |
| gingouâ (tot de) - tout de travers. - Oh ! c'â fait vraiment to de gingouâ. - Pôre gairson, a fait cequi tot de gingouâ, sans gout ! - (18) |
| gingouas et gingois. Cori tôt de gingouas, c'est courir de travers, en titubant. Je laisse aux étymologistes le soin d'étudier l'origine de gingouas : j'indiquerai seulement l'analogie de ce mot avec gigot et gigue... - (13) |
| ginguè : v. i. Gigoter. - (53) |
| gingué, v. n. faire des bonds joyeux, des cabrioles ; se dit pour les animaux seulement : ils sont « en gingueroute ». - (22) |
| gingue-du-cul : s. m. et f., qui se tortille, qui se trémousse, qui cherche à se donner de l'importance et du genre. - (20) |
| ginguer (v.t.) : lancer des coups de pieds - (50) |
| ginguer : lancer un coup de pied. - (09) |
| ginguer : Se démener, sauter, faire des entrechats. La maman dit à son enfant qui gigote dans son lit : « Veux tu fini ! quand an est couchi y est pa dreumi (pour dormir), y est pas pa ginguer ». - (19) |
| ginguer ou jinguer (C.-d., Chal., Morv.), zinguer (Br.). - Sauter, lancer des coups de pied en arrière. Ce mot doit venir de gigue plutôt que de jaculare comme on l'a cru, car le vieux français employait ginguer ou giguer dans le sens de ruer. On dit aussi dinguer en français vulgaire pour rejeter quelque chose avec colère, bruyamment. Ce doit être une onomatopée exprimant le bruit d'une vaisselle de fer blanc, par exemple, qui rebondit sur le sol. Dinguer s'emploie également avec le sens de renvoyer brusquement quelqu'un : « Envoie-le donc dinguer. » Dans l'arrondissement de Tonnerre, dinguer signifie sonner une cloche ; l'onomatopée est ici évidente. - (15) |
| ginguer : (jin:gè - v. neutre) donner des coups de pieds, en parlant d'une vache. - (45) |
| ginguer : v. n., giguer, danser, sauter, s'agiter. - (20) |
| ginguer, et giguer, v. intr., sauter, courir, danser outre mesure, s'amuser bruyamment : « C't étourniau ! tout le temps ô n'fait qu’ginguer. » — « T'sais, ta mère veut ben que t'joues ; mâ à n'veut pas qu'te gingues. » On a nommé ginguet du vin à faire sauter les chèvres. - (14) |
| ginguer, s'amuser, folâtrer, danser. - (05) |
| ginguer, v. a. lancer des coups de pied ; ruer ; jouer des gigues ou jambes. « zinguer. » - (08) |
| ginguer, v. n. faire des bonds joyeux, des cabrioles ; se dit pour les animaux surtout : ils sont « en ginguerotte ». - (24) |
| ginguer. Même sens que le bas français giguer (Littré), ruer, sauter de côté, mais avec la prononciation nasale du terroir. - (12) |
| ginguer. Ruer. Ce mot, très usité à Beaune, s'applique aux animaux et quelquefois aux hommes. Lô vaiche gingue tant qui ne peux pas lai traire. — Meïre, le Léion ast trop meichant : a se met ai ginguer sitôt qu'an veut jue évon lu. - (13) |
| ginguer. Sauter. On sait que gigue est le nom d'une sorte de danse. - (03) |
| ginguer. v. - Plusieurs usages : 1. Sauter, bondir. 2. Ruer en parlant d'un cheval. 3. Éjecter, renvoyer, « faire valser » au sens figuré. - (42) |
| ginguer. v. n. Sauter, gambader, ruer. – Se dit des hommes et des animaux. S'emploie quelquefois activement. Il m'a gingué toute la nuit, c'est-à-dire il m'a donné des coups de pieds, des coups de gigues. - (10) |
| ginguet (n.m.) : vin un peu aigre (a.fr., ginguet) - (50) |
| ginguet, petit vin... - (02) |
| ginguet. Petit vin aigrelet. - (12) |
| ginguet. : Chose d'une qualité minime. Du vin ginguet ; un habit trop court. - (06) |
| ginguette : s. f., ondée fouettée par le vent. Une ginguette de traverse. - (20) |
| ginguette. Petite surexcitation nerveuse des jambes qui prend quand on est couché, généralement après une journée de fatigue, et qui fait qu'on plie et que l’on détend brusquement les membres inférieurs. Etym. ginguer. - (12) |
| ginguœt'e, s. f. petite averse. - (22) |
| ginguœt'e, s. f. petite averse. - (24) |
| ginguois (de).De travers. Etym. ginguer, car les choses qui sont de travers ont sauté hors de la ligne droite. - (12) |
| gîn-nant : gênant - (57) |
| gîn-ne (na) : gêne - (57) |
| gin-ne : s. f. résidu des raisins pressurés. - (21) |
| ginnè : v. t. Gêner. - (53) |
| gin-ner - empiôtrer : gêner - (57) |
| gin-nou (on) - empiôtre (n’) : gêneur - (57) |
| ginre : gendre. - (29) |
| gion. n. m. - Petit panier d'osier suspendu au bout d'un bâton, sorte de châsse enjolivée de rubans, de fruits et de verdure, porté par les enfants à la procession des Rameaux. (M. Jossier, p.74) - (42) |
| gipai. - Sauter, gambader. - Le mot français jupon se disait gipe et gippon dans le dialecte du temps de Charles VI. - Selon Roquefort, le mot viendrait de l'arabe guibba, souquenille. Il y a deux dérivés de ce mot, c'est-à-dire regipai qu'on peut traduire par regimber et gipallai, c'est-à-dire faire sauter ses jupes en lair en s'évertuant. - (06) |
| gipaillai, faire sauter ses jupes en l'air en s'évertuant de gambader... - (02) |
| gipaillé. S'ébattre, s’ébaudir, folâtrer. Gipaillé est un espèce de fréquentatif du verbe bourguignon gipai, qui signifie la même chose, et qui vient du substantif gipe, sorte de souqueniile que les palfreniers, paysans, vignerons, et autres gens de peine, mettaient sur leur pourpoint. Comme la gipe était large et de grosse toile, le pourpoint, au contraire, étrcnt, et pour l'ordinaire de drap, la coutume de ces gens-là, quand ils voulaient danser, sauter, folâtrer à leur aise, était de se mettre en simple gipe, d’où sont venus les mots de gipai et de gipaillé, qu'on a même appliqué en ce sens à tout âge, à tout état, à tout sexe… - (01) |
| gipailler, v. intr., sauteriller, gambader en faisant sauter ses jupes. - (14) |
| gipè : rebondir, sauter de tous les côtés - (46) |
| gipé, vn. gipper, sauter, jouer : se dit des chiens ou des petits enfants. - (17) |
| giperonde : blouse. - (29) |
| giperonde, blouse bleue ne dépassant guère la ceinture. - (28) |
| gipou, sm. endroit où l'on gippe ; par plaisant., lit nuptial. - (17) |
| gippai - s'amuser à sauter, à se remuer. - Ces petiots qui, ci ne songe qu'ai gippai, quoi ! – To remue chez c't'enfant lai ; en faut qu'à gippe moinme en mairchant. - (18) |
| gip'ronde, blouse, non composé de gipe, jupe, vêtement, et de ronde, à raison de la forme ronde de la gip'ronde, - (16) |
| giquiè : gicler - (46) |
| giquiot : n. f. Éclaboussure. - (53) |
| giratouaîre : giratoire - (57) |
| girette*, s. f. girouette. - (22) |
| girette, s. f. girouette. - (24) |
| girie, s.f. grimace, minauderie. Une «girie» est une façon d'être ou de parler qui couvre un défaut de franchise. - (08) |
| girie. Plainte, lamentation. - (03) |
| giries (faire des) : faire des embarras. (F. T IV) - Y - (25) |
| giries, s. f., plaintes sans grand fondement, manières de plaignarde, et aussi simagrées, grimaces, affectations hypocrites : « Ah ! mon Dieu ! en fait-elle des giries ! » - (14) |
| girlicouée - grande quantité, surtout en parlant des animaux et des personnes. - En en â venu tote ine girlicouée. - Al ant ine girlicouée d'enfants. - En voiqui ! en voiqui ! ine vraie girlicouée ! - Voyez courie. - (18) |
| girlicouée. Amas de personnes ou d'objets disposés en cercle. Uae girlicouée d’enfants. Même racine que girouette, girandole, etc. Les lutins avaient le verbe girare, tourner. - (13) |
| girliquouée : bande, grosse quantité. (RDM. T IV) - B - (25) |
| girliquouée : grande quantité, série, kyrielle. - (32) |
| girliquouée, grand nombre. - (27) |
| girliquouée, grande quantité de menus objets pêle-mêle. - (28) |
| girliquouée, s. f., abondance, grand nombre des personnes et des choses. Ex. : une girliquouée d'enfants. - (11) |
| girliquouée. Nombreuse couvée d'enfants. Etym. giron. - (12) |
| girof'llée : Giroflée, cheiranthus cheiri. « Eune girof'llée à cinq feuilles, une gifle ». - (19) |
| girond, adjectif qualificatif : gracieux, aimable ou content. - (54) |
| gironde : femme qui a de l'embonpoint. - (30) |
| gironnée, gennerée. s. f. Plein le de vant du giron, plein le tablier. – A Saint-Martin-sur-Ouanne, on dit gihonnée et gisonnée. – Se dit par extension, dans plusieurs communes, pour faix, fagot. Une gironnée d'herbe. - (10) |
| gironnée, gihonnée, gisonnée. n. f. - Contenu du giron. - (42) |
| girouate : Girouette. « Ne te fie pas à ce qu'o dit, y est eune vrâ girouate » - (19) |
| girouiller, v., envoyer des rejets à distance, en parlant d'un arbre. - (40) |
| girouillon, s. m., plante qui a repoussé sur un « clot », une souche. - (40) |
| girouotte (n.f.) : girouette - (50) |
| giscia (na) : giclée - (57) |
| giscier : gicler - (57) |
| gisciou (on) : gicleur - (57) |
| gisonnée : amas dans un tablier. (DC. T IV) - Y - (25) |
| gisonnée : contenu d'un tablier. (F. T IV) - Y - (25) |
| giter, jiter. v. a. Ancienne prononciation et ancienne orthographe du mot jeter. (Perreuse et un peu partout). - (10) |
| giter. v. - Jeter. - (42) |
| giternier. n. m. - Grenier. (Lainsecq, selon M. Jossier) - (42) |
| giternier. s. m. Grenier. (Lainsecq). - (10) |
| gitier, vn. gicler. - (17) |
| gître, s. f. gite, lieu où l'on se retire, retraite, tanière. - (08) |
| gître. s. m. Gîte ; mauvais lit. - (10) |
| gitrer (se). v. - Se coucher. (Perreuse, selon M. Jossier) - (42) |
| gîtrer. v. a. et n. Loger. – Se gîtrer. v. pronom. Se coucher. (Perreuse). - (10) |
| give, rive d'une rivière... - (02) |
| give. : Rive d'un cours d'eau. - (06) |
| givéle, s. f., javelle. Ce qu'on coupe d'herbes (blé, orge, seigle) avec la faux ou la faucille, et qui attend d'être mis en gerbes. - (14) |
| givelé. adj. Se dit du bois provenant d'un arbre fendu par la foudre ou la gelée. - (10) |
| giveler, v. tr., javeler, couper, faucher des poignées de céréales. - (14) |
| givelòt, et givelòte, s. m. et f., petite javelle, et petit fagot de sarments. - (14) |
| gizò. Gisais, gisait. - (01) |
| glacé mince. Sorte de pain d'épices national, plat, étroit, sec et glacé au sucre. - (12) |
| glacier. : (Dial.), glisser (ral. lat. glacies). Saint Bernard a dit : Glacier en la voie du salut. - (06) |
| glaciére (na) : glacière - (57) |
| glagau, glayay. s. m. Glaïeul, sorte d'iris aquatique. (Villiers-Saint-Benoît). - (10) |
| glaice, et glas, s. f. et m., glace. - (14) |
| glaice. Glace. - (01) |
| glaiçon, s. m., glaçon. - (14) |
| glaiçon. Glaçon, glaçons. - (01) |
| Glaidie (lai) : (la) Gladie - (37) |
| glaine. n. f. - Glane. - (42) |
| glainer. v. - Glaner. - (42) |
| glaineux. n. m. - Glaneur. - (42) |
| glainglain : s. m., gland, pompon. Saint Glainglain, saint imaginaire, dont, par suite, la fête n'existe pas au calendrier. - (20) |
| glais. s. m. Glas. Se dit, à Lindry, pour Glaïeul, iris aquatique. – Du latin glaiolus, gladius, gladiolus. - (10) |
| glajau : iris jaune des marais. (DC. T IV) - Y - (25) |
| glande, s. f. source qui ne jaillit pas hors de terre sans être éloignée cependant de la surface du sol. On prononce « guiande » dans plusieurs lieux. - (08) |
| glander (verbe) : garder les cochons sous les chênes en automne. Par extension : perdre son temps. - (47) |
| glandouiller (verbe) : paresser, musarder. - (47) |
| glapins. s. m. pl. Plâtrat, déblais, débris de démolitions. - (10) |
| glard. adj. et s. m. Gourmand. (Trucy). - (10) |
| glars. s. m. Sac de toile dans lequel on porte le pain, quand on va travailler dans les champs. (Perrigny-lès-Auxerre). - (10) |
| Glaude - (39) |
| Glaude, Yaude Claude. - (63) |
| Glaude. Claude, nom propre. Depuis longtemps on prononce ainsi. - (03) |
| Glaude. Pour Claude. Beaucoup de gens non seulement prononcent Glaude, mais l'écrivent. - (12) |
| Glaûdine (lai), (l’) Glaûde : (la) Claudine, (le) Claude - (37) |
| Glaudine : Claudine - (39) |
| glaviaux : crachat - (44) |
| glée : bouchée - (44) |
| gléjaux. s. m. pl. Glaïeuls. Se dit aussi des haricots verts. Voulez-vous manger des gléjaux ? - (10) |
| gléneau : botte de paille. - (09) |
| glener, v. tr., glaner. - (14) |
| glenot, s. m., contenu d’une main en blé (ou autre céréale), après la moisson. - (40) |
| gleu ou glô. : Grosse paille. En vieux français glui signifie gerbe (Lac.) ; c'est le même mot en Picardie et en Franche-Comté. - Il semble d'origine gauloise. - (06) |
| glia : Glas. « Sais tu quû s'qu'est meu ? J'ai entendu sonner in glia » : sais tu qui est mort ? J'ai entendu sonner le glas. - (19) |
| glià, s. m., glas, tintement lugubre de la cloche pour annoncer une mort. - (14) |
| gliace. s. f. Glace. Il a gelé fort j'avons de la gliace. (Perreuse). - (10) |
| gliaijo - glaïeul. - I ons deux gros pieds de gliaijo dans note jairdin ; c'â des jolies flieurs. - Beillez-mouai don des raiceunes de gliaijo pour fàre ine chaingne pour mette dans lai bûe ; ci fait senti bon le linge. - (18) |
| gliaire : Glaire. « Le malède a rendu des gliaires ». - (19) |
| gliand : Gland du chêne. « Ol est allé au beu (bois) ramasser de la gliand pa donner à ses cochans ». - (19) |
| gliand, et gliand-dô, s. m., gland, et gland-doux. - (14) |
| gliande : Glande. « Ol a des gliandes seu le cô (sous le cou) ». - (19) |
| gliandu. Gland. - (03) |
| gliardasse (on mouille le gl). Se dit ainsi pour lardasse, longue coupure faite avec un instrument tranchant. (Perreuse). - (10) |
| gliardenne (on mouille le gl). s. f. Pièce de deux liards. Se dit ainsi par combinaison de liard et de dardenne. - (10) |
| glichade : glissade - (48) |
| glicher : glisser - (48) |
| glicher : (gliché - v. intr.) glisser. - (45) |
| glicherôde : (glich'rô:d' - subst. f.) neige en plaques qui a fondu puis regelé. - (45) |
| glièchan : Glaçon. « T'as les mains frades (froides) c'ment des glièchans ». - (19) |
| glièche : Glace. « In chevau farré (ferré) à glièche ». « Si ol a le nez roge (rouge) y n'est pas de chuchi (sucer) de la glièche ». - (19) |
| glièchi : Glacer « J'ai coru dans la nage ave des chetits sulès, j'ai les pids glièchis » : j'ai couru dans la neige avec de mauvais souliers, j'ai les pieds glacés. - (19) |
| glienne (hlienne) : s. f., glane, syn. de daillette. - (20) |
| glienne : Glane, poignée d'épis ramassés en glanant. - (19) |
| glienner (hlienner) : v. n., faire des gliennes. - (20) |
| glienner : Glaner. « I ne demore pas grand chose à glienner darè liune » : il ne reste pas grand chose à glaner derrière lui. - (19) |
| gliennoux : Glaneur. « I faut tojo laichi quèque chose pa les gliennouses » : il faut toujours laisser quelque chose pour les glaneuses. - (19) |
| glienœllion, adj. qui n'avance pas au travail. - (22) |
| glieu - glu, ou paille dans toute sa longueur arrangée pour faire des liens. - En me fauré des glieux encore pas mau, bein vingt faigots. - Ces glieux qui c'â pou fâre des liens, qui ailons ailai jaivelai. - I va couvri note écurie en peille, vends-mouai don voué des glieux. - (18) |
| glieu : Petite gerbe de seigle ou de blé dont on se sert pour faire des liens. - « J'ai mis tremper du glieu pa fare des écouleures ». - (19) |
| glieuter : Clapoter. Se dit du bruit qu'on entend quand on secoue une futaille qui n'est pas tout à fait pleine. - (19) |
| glin : Très petit, se dit d'un enfant dont la taille est bien inférieure à celle des enfants de son âge. « In pauv chetit glin ». - Crotte. « In glin de cabre » : une crotte de chèvre. - (19) |
| glin. s. m. Parcelle minime d'une chose, un tout petit brin. - (10) |
| glincher, glinser. v. n. Glisser sur la glace. (Soumaintrain, Flogny). - (10) |
| gline (à la) n.f. A la suite, à la longue, peu à peu. - (63) |
| gline (à la). L'un après l'autre : « tomber à la gline ». - (49) |
| gliner. v. n. Manger par petites bouchées, par petits glins. (Fresnes). - (10) |
| glin-glin n.m. Gland, pompon. - (63) |
| glinguer. v. n. Faire du bruit. (Bagneaux). - (10) |
| glise, église. : Les villageois ont bien dit d'abord l'aiglise, puis ils ont fini par écrire lai glise : on a dit dans le dialecte même la glise. - (06) |
| glissière : s. f., glissoire. - (20) |
| glissière, s. f., glissoire : « O s'é flanqué le c... su la glissière ; ôl a fait étoile. » - (14) |
| glissouère : glissade - (39) |
| gllhi, ll mouillées, v. a. lier, attacher ensemble, réunir en faisceau : « i seu été gllhi aine jarbe », j'ai été lier une gerbe. - (08) |
| glliaiç-he, glace. Glliaiç-hon, glaçon. - (05) |
| glliainer, glliaines, glaner, glanes. - (05) |
| glliandu, gland de cbêne. - (05) |
| gllieux, gllius, gluis de paille. - (05) |
| glô de paille. Botte de paille. Glô vient de glui, synonyme de chaume… - (01) |
| globulot : bulle - (44) |
| gloire : s. f., gloriole, vanité, ostentation. - (20) |
| glon. s. m. Petit panier d'osier tressé au bout d'un bâton, qui était comme une sorte de châsse enjolivée de rubans, de fruits et de verdure, que portaient les enfants à la procession des rameaux (Saint-Florentin, Puysaie). Dans quelques pays, ce n'était qu'une simple branche de feuillage ou de rameau ornée de pommes et de gâteaux. - (10) |
| glonfer. v. tr., gonfler, distendre. - (14) |
| gloriéte, s. f., cabinet de verdure dans un jardin. A Chalon- sur-Saône on a encore le rempart « de Gloriette ». - (14) |
| glorieux*, adj. orgueilleux, prétentieux. - (22) |
| glorieux, adj. fier, orgueilleux (le maire c'est un glorieux). - (65) |
| glorieux, adj. orgueilleux, prétentieux. - (24) |
| glorieux, adj., fier, orgueilleux. - (40) |
| gloriotte. s. f. Primevère. (Argenteuil). - (10) |
| glôton. Glouton, gloutons. Le vieux mot glouton, qui est un augmentatif de glout, signifie proprement goulu, gourmand, et c'est en ce sens qu'il est pris, Noël 8 ; mais d'ordinaire dans les vieux romans, de même que paillard et ribaud, il se prend pour un méchant homme en général. - (01) |
| glouaire (n.f.) : gloire - (50) |
| glouaîre (na) : gloire - (57) |
| glouat. s. m. et glouasse. s. f. Ces deux mots, qui viennent de glu signifient boue visqueuse, boue épaisse et gluante. (Soucy). - (10) |
| glouère. n. f. - Gloire. - (42) |
| glouguer. v. n. se dit du bruit qui se fait dans la gorge lorsque l'on boit. - (08) |
| glousser. v. n. Se dit du bruit que font les pieds en marchant dans des chaussures imprégnées d'eau. (Percey). - (10) |
| glu : lien. - (32) |
| glû, glus, gluix, s. f., et glin, s. m., paille de seigle de l'année précédente, qu'on emploie souvent à faire des liens et surtout à couvrir les maisons. - (14) |
| glu, n.m. paille de seigle. - (65) |
| glu, s. m., « du glu », pour de la glu. - (14) |
| glu, s. m., paille de seigle pour accoler. - (40) |
| glu. Paille de seigle à couvrir les maisons. - (03) |
| gluaix, n. masc. ; glas. - (07) |
| glue, paille de seigle pour accoler la vigne ou faire des liens. - (27) |
| glus, sm. pl. paille de seigle battue et nettoyée pour la confection des liens. - (17) |
| glus. En français gluis. Longue paille de blé ou de seigle, qui sert à couvrir les toits et à accoler la vigne. - (13) |
| gluy : paille non brisée. - (09) |
| g'nâb, g'nâbre : genévrier - (48) |
| g'nabre : arbuste : genévrier (on le pendait comme enseigne à la porte des cafés). - (33) |
| gnac, mucus du nez. - (28) |
| gnacotes : diminutif enfantin pour dents. IV, p. 62 - (23) |
| gnacou, qui ne se mouche pas et dont les mucosités coulent sous le nez. - (27) |
| gnacoux, gnacouse (niacou) : adj. ; qui montre les dents, ou qui sait en user ; hargneux. - (20) |
| gnacter. Ronger en faisant grincer les dents, mordiller. - (49) |
| gnaf. n. m. - Cordonnier. - (42) |
| gnaf. s. m. Cordonnier. - (10) |
| gnaffre : nom donné quelquefois au cochon - (60) |
| gnaguer : mordiller, croquer, mâchonner - (48) |
| gnalou : mouchoir - (48) |
| gnalou : personne ayant la goutte au nez, le nez sale - (48) |
| gnalou : poisson-chat - (48) |
| gnance, s. f. mollesse, niaiserie, nullité par incapacité ou défaut d'énergie. - (08) |
| gnan-gnan (adjectif) : sans énergie. Personne molasse. - (47) |
| gnangnan n. et adj. Lent, sans énergie, sans ressort intellectuel ou physique. - (63) |
| gnangnan, s. homme ou femme sans énergie, sans volonté ; personne nulle. - (08) |
| gnan-gnan, s. m., stupide, mou. - (40) |
| gnangnan. Lambin. Long à se décider, à faire son travail. - (49) |
| gnantou, ouse, s. et adj. niais, sot. - (08) |
| gnaque (niaque) : s. f., dent. - (20) |
| gnaquer (niaquer) : v. n., donner un coup de dent, mordre, manger. - (20) |
| gnaquer : mordre, mâcher - (51) |
| gnaquer : Se dit d'un chien qui se précipitant sur quelqu'un fait semblant de le mordre en serrant très peu les dents. - (19) |
| gnarcoter (niarcoter) : agacer, agresser en agaçant - (51) |
| gnarcoter (se) : se chamailler - (43) |
| gnarcotter (se) : (vb) se chamailler - (35) |
| gnarou, s. m., enfant morveux et chougnard. - (40) |
| gnasse. s. f. Pie. – Gnasse-agurrièche, pie-grièche. (Saint -Martin-sur-Ouanne, Vilhers-Saint-Benoît). - (10) |
| gnau : œuf en plâtre. - (32) |
| gnau : œuf en plâtre pour faire un leurre à la poule - (39) |
| gnau : œuf factice. (CH. T II) - S&L - (25) |
| gnau, œuf factice en plâtre ou en porcelaine pour exciter les poules à pondre. - (27) |
| gnaud - niaud : œuf factice. Posé par l'éleveur dans le nid où les poules pondent pour les inciter à le faire. - (58) |
| gnaulus : nigaud. - (32) |
| g'né[y]ou : mal habillé, habits déchirés, en guenilles. - (52) |
| gnée (faire la). exp. verb. - Bisquer, faire la grimace : « On songe au départ du lendemain matin, on songe avec délices qu'on fera la gnée aux camarades recalées. » (Colette, Claudine à l'école, p.l23) - (42) |
| gnée : grimace. - (09) |
| gnée : nichée - (43) |
| gnée. n. f. - Portée d'animaux, porcelets, poussins etc. - (42) |
| gnée. s. f. Grimace. (Châtel-Censoir).– Voyez gniée. - (10) |
| g'nellè, gu'neille : v. t. Défraîchir. - (53) |
| gnêpe. s. f. Nèfle, fruit du néflier. - (10) |
| g'nête : genêt, balai de genêt. - (33) |
| g'néte : n. m. Genêt. - (53) |
| gneugneute, gneugneuterie. s. f. Bigoterie. Se dit probablement pour gnognotte, chose de rien, niaiserie, bagatelle, et, généralement, tout ce qui n'est pas sérieux, les apparences de piété, les semblants de religion comme le reste. (Saint-Valérien). - (10) |
| gniac. s. f. Dent. Un bon coup de gniac. (Bagneaux). - (10) |
| gniaf, et gniafe, s. m., cordonnier, mais pas de premier ordre, resseméleur. Expression dédaigneuse. - (14) |
| gniaf, savetier (ne pas faire sentir le g initial). - (16) |
| gniaguer, v. a. mordre, saisir avec les dents. - (08) |
| gniaiquottes : dents d’enfant - (37) |
| gniaîrgue : vieil accordéon, vielle - (37) |
| gnialé : se dit des fruits qu'une gelée ou une maladie a flétris. - (21) |
| gniâler - (39) |
| gniâler : pleurer (pour un bébé) - (48) |
| gniâlou : bébé - (39) |
| gniangnian, niais (prononcer nian-nian). - (16) |
| gnian-gnian. s. m. et adj. Homme lambin, sans énergie. Un grand gnian-gnian, parler lentement, d'un ton câlin et dolent. - (10) |
| gniaqueai, s. m. celui qui a de grandes dents. - (08) |
| gniaquer, niaquer. v. - Mordre du bout des dents : « En pâssant pa'l'chmin, j'm seu fait gniaquer pa'l' chien du Titi ! » - (42) |
| gniaquette (n.f.) : petite vent d'enfant - (50) |
| gniaquette, s. f. petite dent, terme enfantin. - (08) |
| gniau (n.m.) : nichet, oeuf factice - (50) |
| gniau : œuf en bois, terre ou porcelaine laissé dans le nid pour encourager la poule à venir pondre. - (52) |
| gniaû : œuf en plâtre que l’on place dans les nids des poules « afin de les inciter à y pondre » ( ?!) - (37) |
| gniau, s. m. nichet, œuf couvain. - (08) |
| gniaud, gniot. s. m. Nichet, œuf naturel ou artificiel placé dans le nid des poules pour les y attirer et les engager à pondre. - (10) |
| gniauler, v. n. se dit de certains fruits et particulièrement des noisettes. Les noisettes «gniaulent » bien lorsque l'amande se forme et grossit. - (08) |
| gniaûx (dâs) : (des) dettes laissées un peu partout - (37) |
| g'niavre : genevrier. (B. T IV) - D - (25) |
| gniée. s. f. Portée de petits cochons. Se dit pour niée, syncope de nichée. (Perreuse, Villiers-Saint-Benoît). - (10) |
| gnien chaut ben ! Exclamation qui indique le dédain, l'indifférence, et qui veut dire n'importe pas, qué qu' cç m' fait, j' m'en f… iche ben ! De nient (nihil), de chaut, 3e pers. ind. du verbe chaloir, et de ben, pour bien. (Etivey). - (10) |
| gnieû, s. m., nichet, œuf couvé laissé dans le nid pour que la poule y vienne pondre. - (14) |
| gnignaud, aude. adj. Qui est rechigné, grimaud, grognon de mauvaise humeur. Synonyme de grimaud. (Chastenay). - (10) |
| gniguer, v. a. faire le « gnin», menacer quelqu'un en montrant les dents, faire une moue de défi lorsqu'on présente une chose et qu'on la retire aussitôt avec menace. - (08) |
| g'nillou, gu'nillou, gueuillon : n. f. Guenille (une personne en guenilles). - (53) |
| gnin (faire la) : narguer - (60) |
| gnin (fére le), loc. faire une moue qui exprime le défi. « Gnin » imite le bruit de la langue contre les dents serrées. - (08) |
| gnin : (adj) nigaud - (35) |
| gnin : niais, nigaud, benêt - (43) |
| gniô (niô) : cagnotte, ou œuf en plâtre qu'on met dans les nids de poules (voir : niau). - (56) |
| gniô : n. m. Œuf en bois, en terre ou porcelaine laissé dans le nid pour encourager la poule à venir pondre. - (53) |
| gniô, oeuf qu'on laisse au nid des poules, pour les faire pondre au même endroit (prononcer niô). - (16) |
| gniodot, s. m. niais, benêt : grand « gniodot», grand bêta. - (08) |
| gniogniole, bagatelle ; s'â d'lai gniogniote, c'est peu de chose, ce n'est rien (prononcer nioniote). - (16) |
| gniôle (prononcez gnieule), niais. En basse latinité, geniolus signifie petit esprit. On dit, dans le Châtillonnais, un gniot pour exprimer un dernier né. - (02) |
| gniôle : nielle des blés - (21) |
| gniolé, adj. tacheté de noir. S’emploie pour désigner les taches de la nielle et par extension les taches accidentelles, même en parlant des personnes. - (08) |
| gniole, niole. s. f. Bourde, conte en l'air, fadaise, et, dans certains cas, tape, coup, soufflet. - (10) |
| gniole, s. f. coup, tape, choc. Dans le jeu des « gnioles » le perdant subit le choc de billes lancées avec force sur son poing fermé. - (08) |
| gniòle, s. f., tape, coup : « Si te n'me lâches pas, j'vas t'envoyer eu ne gniòle. » - (14) |
| gniôle. : Niais, petit esprit. Du diminutif bas latin geniolus. - (06) |
| gniore, adj. mou, lent, paresseux. - (08) |
| gniôt : nichet (œuf de plâtre mis dans le nid pour inciter les poules à pondre) - (48) |
| gniot : œuf en bois, terre ou porcelaine laissé dans le nid pour encourager la poule à venir pondre. - (33) |
| gniot, niot. n. m. - Œuf.naturel ou artificiel déposé dans le nid de la poule pour l'attirer et l’inciter à pondre. - (42) |
| gniouche. s. m. Enfant. C'est sans doute une corruption de mioche. (Sermizelles). - (10) |
| gniyou, guenilleux, mal vêtu (prononcer dur le g Initial). - (16) |
| gno : leurre en forme d'oeuf pour déclencher la ponte des poules - (60) |
| gnoche (nioche), gnoune (nionne), s. f., gniole, personne niaise et mollasse. - (20) |
| gnognote : oseille. - (31) |
| gnognote : pas grand chose - (60) |
| gnognòte, s. f., bagatelle, chose de peu de valeur : « Qu'é c'qui é que c'qui ? Y é d'ia gnognòte ! » - (14) |
| gnognotte : Futilité, chose sans importance. « Y est de la gnognotte ». - (19) |
| gnognotte. s. f. Niaiserie, vétille, babiole, chose insignifiante et de nulle valeur. - (10) |
| gnogue. s. f. Petite brisure, petit dommage accidentel fait à un objet. - (10) |
| gnoguer. v. a. Erafler, écorner ou briser légèrement un objet en le frottant, en le laissant tomber ou en le cognant. - (10) |
| gnole, adj. niais, simple, sans défense. - (08) |
| gnôle, adj., crédule, niais, simplet : « Côse-te ; t'é ben trop gniôle. » - (14) |
| gnole, gn’aûle : bosse (« torgnoler » : frapper au point de faire éclore des bosses) - (37) |
| gnon : œuf en plâtre - (51) |
| gnot (nom masculin) : œuf (faux) en plâtre ou en porcelaine sensé inciter les poules à pondre à un endroit donné. - (47) |
| gnoufé, gnofé, vn. manger avec avidité. - (17) |
| gnoûler : pleurer. - (32) |
| gnouquer. v. n. Faire une chose en tâtonnant. (Tormancy). - (10) |
| gnué (n.f.) : nuit (de Chambure et Déchard emploient cette graphie ; le premier écrit aussi nuée) - (50) |
| go (Tout de). Locut. adv. Sans difficulté, librement, sans obstacle. Ce mot se trouve encore dans quelques dictionnaires, nolamment dans Boiste et Larousse. - (10) |
| go (tout). loc. adv. - D'un coup, d'un trait. Cette locution vient du français « tout de gob », utilisée au XVIe siècle pour signifier« gober d'un trait». - (42) |
| go : gousse de pois. (E. T II) - B - (25) |
| goa : variété de noix. Voir calon - (23) |
| goballe, gobille: bille - (48) |
| gobarger. v. - Penser, ressasser le passé. Déformation du français argotique « gamberger ». - (42) |
| gobargi (se). : S'égayer. –Dans le dialecte gobe signifie gaîté. (Roq.) - En Champagne, se goberger de quelqu'un c'est le railler, s'égayer à ses dépens. - (06) |
| gobargi, se réjouir, se divertir, être de belle humeur... - (02) |
| gobe : (nf) « dz’ai la gobe » : j’ai les doigts gourds (à cause du froid) - (35) |
| gobe : empoté - (57) |
| gobe : engourdi - (60) |
| gobe : gourd - (43) |
| gobe n.f. (du lat. gibbum, la bosse). Engourdissement par le froid. Dz'ai la gobe és dagts : j'ai les doigts gourds. Dans le mâconnais au XIXe s. on utilisait le verbe gobiner : picoter, démanger. Y m'gobine dans les dagts. - (63) |
| gobé une insulte, l'avaler en quelque sorte ; te l'ai gobe ! tu la gobes ! Gobé, dans le langage enfantin, signifie aussi prendre une chose. - (16) |
| gobe, et gobôt, adj., gourd, engourdi par le froid : « Je n'peux pus t'ni ma pleùme ; j'ai les dèts gobes. » - (14) |
| gobe. Engourdi par le froid, gourd : « avoir les mains gobes ». - (49) |
| gobe. s. f. Grosse cerise aigre, dont le jus fermenté donne un vin assez bon. (Avallonnais). - (10) |
| gobeilles : billes. - (09) |
| gôbelle, petit vase, d'où, par extension, gobelotter, boire à petits coups... - (02) |
| gobelle. s. f. Gobille, petite bille de pierre à l'usage des enfants. (Accolay). - (10) |
| gôbelle. : Petite bouche. (Del.) - (06) |
| gobelòt, et goubelòt, s. m., gobelet, vase à boire, et liseron, fleur qui ressemble à un gobelet. - (14) |
| gobelot, n.m. liseron des haies. - (65) |
| gobeloter, boire plus que de raison. - (27) |
| gobeloter, v. se couvrir de verrues (en parlant des feuilles de la vigne). - (65) |
| gobeloter, v., se couvrir de verrues, en parlant des feuilles de vigne. - (40) |
| gober. Avaler rapidement. Ce verbe, admis par l’Académie, est placé ici parce qu'il a formé une ancienne locution beaunoise. Tu la gobes a le sens ironique et vindicatif de : c'est bien tait. On dit, dans le même sens : tu bisques. Le vieux mot gobeur est, depuis quelques années, remis à la mode. Un gobeur est un sot qui se gobe lui-même, ou un niais « qui croit que c'est arrivé. » - (13) |
| goberger (se), rester couché. - (05) |
| goberger (Se). v. pronom. S'étendre sur un lit par fainéantise ; c'est l'acception propre. – Se dit, par extension, de tout individu qui en prend à son aise, qui flâne ou se repose quand il devrait travailler. Il ne fait donc pas que de se goberger, ça n'en fait guère. - (10) |
| goberges. s. f. pl. Barres de bois mobiles qui, autrefois, se mettaient en travers d'un lit pour soutenir la paillasse et les matelas. Les goberges sont aujourd'hui remplacées par un châssis ou par un fond sanglé. – De ce mot on fait le verbe se goberger. - (10) |
| gobet (A) : voir Dagobert (A la). - (20) |
| gobette. n. f. - Jeune fille : « Sans doute, il y a des grandes gobettes qui en auront causé. » (Colette, Claudine à Paris, p.252) - (42) |
| gobette. s. f. Jeune fille. – Bâton, canne pour marcher. - (10) |
| gobeusse : (gobeus' - subst. f.) injure à l'adresse d' une femme, de sens relativement indéterminé. Le terme est souvent agrémenté de l'épithète vé:y', "vieille". - (45) |
| gobi, goubi. adj. Gaucher, maladroit, engourdi, paralyse des mains. Il a les mains goubies. J'suis goubi, se dit quand, par une cause accidentelle quelconque, on ne peut pas se servir de ses mains. – Jaubert donne gobe dans le même sens. - (10) |
| gobi. s. f. Vide entre la chemise et la poitrine, par allusion sans doute à celui qui existe à l'intérieur de l'estomac et qui sert à contenir ce que l'on mange, ce que l'on gobe. - (10) |
| gobille (n.f.) : bille dont se servent les enfants dans leurs jeux - (50) |
| gobille (na) - gobiote (na) : bille - (57) |
| gobille : (nf) bille, boulette - (35) |
| gobille : bille - (44) |
| gobille : bille (pour le jeu). On dit aussi : gueude. - (62) |
| gobille : bille à jouer, un petit morceau rond comme une bille. - (66) |
| gobille : bille, boulette - (43) |
| gobille : une bille - (46) |
| gobille : bille - (39) |
| gobille : n. f. Bille en terre ou de verre pour jouer. - (53) |
| gobille : s. f., bille à jouer. - (20) |
| gobille, bille. - (26) |
| gobille, n.f. bille (les pommes de terre ne sont pas plus grosses que des gobilles). - (65) |
| gobille, s. f. bille dont se servent les enfants dans leurs jeux. - (08) |
| gobille, subst. féminin : bille. - (54) |
| gobille. Synonyme beaunois de bille. Il y a des gobilles en palisse, en verre, en agate, en marbre. Au pays wallon, une gobille est appelée cassïdône. La calcédoine est une espèce d'agate. - (13) |
| gobillère ! Sorte d'interjection, d'exclamation., par laquelle les enfants de Percey, en jouant aux billes, se réservent le droit de placer, entre eux et le pot, la bille de leur adversaire. - (10) |
| gobilles n.f. Billes, yeux ronds. - (63) |
| gobilles, s. f. pl., billes de terre, testicules. - (40) |
| gobinée. s. f. Plein la gobine. Une gobinée de ceruses. - (10) |
| gobinotte. s. f. Petite tasse. (Plessis-Saint-Jean). - (10) |
| gobio, gobiote : maladroit(e) de ses mains. - (33) |
| gobiot (otte) : maladroit(e) de ses mains - (39) |
| gobiot (te) : (gobyo, gobyot' - adj.) gourd, gourde. Y è lé: douè tô gobyo "j'ai les doigts complètement gourds". - (45) |
| gobiot : maladroit (souvent à cause de la vue). Ex : "T’èm’ charch’ ma tasse coum’ ène gobiote !" - (58) |
| gobiot(e) : maladroit(e) - (48) |
| gobiot, otte, adj. celui ou celle qui a de la maladresse dans les mains, par suite d'une infirmité ou pour toute autre cause. - (08) |
| gobiot,gobiotte (n.m. et f.) : qui a les doigts gourds - (50) |
| gobiotte. n. f. - Faible, sans force, en parlant d'une main : « Quioqu'un y tend l'goupillon qu'il attrape d'ène main gobiotte. » (G. Chaînet, L 'Coustume dé vélours) - (42) |
| gobœye, s. f. bille d'enfant : jouer aux gobœyes. - (24) |
| gobricher, v. tr,, gober, avaler vile, croire à la légère : « Tout ça qu'on li dit, ô l’gobriche. » - (14) |
| gobuer. v. a. Tourmenter, contrarier. (Villemer). - (10) |
| gochot : Gousset, partie du corset où est ménagée la place des seins. - (19) |
| goda : jars (oie mâle). A - B - (41) |
| gôdâ : (nm) jars - (35) |
| goda : jard - (51) |
| goda : jars - (43) |
| goda : jars, mâle de l'oie - (34) |
| goda : jars. - (30) |
| godâ n.m. (d'une racine péjorative god- présente dans la formation de mots évoquant un gonflement, une jouissance ou une tromperie). Jars. - (63) |
| godai , garder. - (02) |
| godaillai, (certains disent gogaillai ), faire métier d'ivrogne. Godale, en roman, signifie mauvais vin, comme godaille en bourguignon... - (02) |
| godaillai. : Boire sans fin ni cesse. - (06) |
| godaîllé : n. m. Vêtement qui tombe mal sur une personne. - (53) |
| godailler : mal tomber, en parlant d'un vêtement, pendre de partout. - (56) |
| godâiller, godrâiller : faire des faux plis, goder - (48) |
| godailler, v., musarder et boire de cabaret en cabaret. - (40) |
| godaïlli : Boire souvent, sans nécessité, fréquenter les cabarets. « Tan homme n'est dan pas à la maijan ? - Oh bin ol est arè allé godaïlli ! » : ton mari n'est donc pas à la maison ? - Ma foi non, il est encore allé boire ! - (19) |
| godailli : être trop large, mal ajuster (vestimentaire) - (51) |
| godard. s. m. Mari dont la femme est en couches. (Joigny). - (10) |
| godau : s. m. coyer du faucheur. - (21) |
| gode : (nf) coffin, étui pour la pierre à aiguiser la faux - (35) |
| gode, godiche : s. f., grosse gobille, et, par analogie, bosse consécutive à un coup. - (20) |
| godelle ou gueudelle : une vache. - (66) |
| godelu. adj. - Goulu. - (42) |
| godelu. adj. Goulu. Dans la Puysaie, on se sert de ce mot pour appeler les canards. Godelu ! Godelu ! - (10) |
| godelurô, qui fait le galant... - (02) |
| gôdenô (prononcez geudeneu), violon. En latin gaude nos, réjouis-nous, parce que, en effet, le violon est l'âme de la danse chez les villageois... - (02) |
| godeno. : Violon (du latin gaude nos, c'est-à-dire réjouis nous.) - (06) |
| goder : v. n.. tomber, dégringoler ; se faire une gode (bosse). - (20) |
| goder, v. a. faire un trou dans la terre avec un bâton, avec un plantoir ou tout autre instrument pointu et, par extension, avec les pattes, comme certains animaux. - (08) |
| gòdes (avoir les), loc. se dit lorsqu'on est paresseux au travail, momentanément. - (24) |
| godiche : Gauche, ridicule, pataud. « Ce qu'ol a l'ar godiche » : ce qu'il a l'air ridicule. - (19) |
| godiche, adj., plaisant, bizarre, ridicule : « D'avou sa cane, ét-ti godiche., c'ti-là ! » Altération de Claude, qui, comme Jean-Jean, veut dire : nigaud. - (14) |
| godiche, godichon, drôle, niais dont on rit (familier). - (16) |
| godiche. adj. Qui est un peu niais, qui a des idées singulières et qui prêtent à rire. - (10) |
| godichon (la mère) est un personnage historique dans le pays beaunois. Je ne sais pas si elle a réellement existé. C'est peut-être un de ces types bouffons créés par l 'imagination gouailleuse de nos pères, pour se gaudir. On dit familièrement à un enfant boudeur et criard : aittends voi ! i vas te fârz chanter lai meire Godichon ; en bon français : je vais te corriger... - (13) |
| godichon : Employé seulement dans cette expression : « Chanter la mère godichon »: chanter des chansons très libres, des refrains d'ivrognes. Quand on dit des gens qu'ils chantent la mère godichon cela signifie qu'ils sont en train de festoyer joyeusement, qu'ils sont plus ou moins pris de boisson et chantent tout ce qui leur passe par la tête. - (19) |
| godichon : vêtu de vieux habits. - (31) |
| godille. Boue très boueuse. - (49) |
| godiller : creuser dans la terre - (60) |
| godilli : godiller - (57) |
| godin : s. m., vx fr., bâton. - (20) |
| godine, copinette : s. f., petit godin. Baguette graduée qui permet de mesurer la hauteur du liquide dans un fût. - (20) |
| god'lurò, s, m., débauché, jeune libertin. - (14) |
| godo : pierre à aiguiser. (RDB. T III) - S&L - (25) |
| godos (À). adv. Se dit d'une manière de porter sur le dos consistant en ce que le porté embrasse des deux mains le cou du porteur, qui, lui, de son côte lui tient les jambes à droite et à gauche. - (10) |
| godot (nom masculin) : petit cochon. - (47) |
| godot : Gros sabot sans bretelle. « Eune pare de godots ». - Espèce d'étui, de récipient, en bois ou en fer blanc, que les faucheurs suspendent à leur ceinture et dans lequel ils mettent de l'eau où trempe leur pierre à aiguiser appelée « piarre de dâ ». - (19) |
| godot n.m. 1. Etui de ceinture pour la pierre à aiguiser, coffin. 2. Sabot sans bride. - (63) |
| godot : s. m., vx fr., godet, collier, sabot bressan sans bride. Voir gondole. - (20) |
| godot, s. m. petit cochon. S’emploie par les femmes comme terme caressant pour appeler leurs jeunes « habillés de soie » : « vin, vin, mon godot ! » - (08) |
| godots : sabots entièrement taillés dans le bois, sans « coussins » - (37) |
| godrâilli v. Passer son temps au café, godailler. - (63) |
| godrâillon n.m. Pilier de bistrot. - (63) |
| gôdron, goudron ; gôdroné, goudronner. - (16) |
| gôdron, s. m. goudron. Le mot s'applique à toutes les matières visqueuses. - (08) |
| gôdron, s. m., goudron. - (14) |
| gôdroner, v. a. goudronner, enduire de goudron, de poix ou de toute autre matière visqueuse. - (08) |
| godrons. : Manchettes plissées interdites aux servantes par édit somptuaire de 1580 de la municipalité de Dijon. - (06) |
| goduser (Se). v. pronom. Se tromper. (Fontaine-la-Guillarce). - (10) |
| godze, dzargau : coffin, étui de la pierre à aiguiser - (43) |
| goe, n. masc. ; grand fond d'eau dans une rivière ; encore présent dans les noms de lieux. - (07) |
| goëtron, goître. - (05) |
| goeu, s. m. gros rat. - (22) |
| gogaille . : Bonne chère à une table où l'on a tout à gau-gau. Cette apocope de gaudium a été empruntée au poète latin Ennius. (L'abbé Corblet.) - (06) |
| gogàÿe, s. f., bon repas, copieusement arrosé : « Voui, l'fameux gas ! ôl é prou bon pour faire la gogàÿe. » - (14) |
| goget, gouget. s. m. Etui de bois ou de ferblanc, que les faucheurs suspendent à leur ceinture pour mettre leur pierre à aiguiser. - (10) |
| goglu, s.m. petit oiseau (roitelet ?) - (38) |
| gognandise, s. f., bêtise, histoire crue. - (40) |
| gognat. n. m. - Verrat gras. (Mézilles, selon H. Chéry) - (42) |
| gognauder, v. n. caresser en riant et plaisantant. - (24) |
| gogne, cougne, regougnoux, regogneux. Masseur populaire ; synonyme de rebouteur. - (49) |
| gogne. n. f. -Truie grasse. (Mézilles, selon H. Chéry) - (42) |
| gôgner, gôner, verbe transitif : habiller sans recherche, sans élégance, sans goût. - (54) |
| gog-nette (n. f.) : plaisanterie, histoire drôle (raconter des gog-nettes) - (64) |
| gogneux adj. Maladroit. - (63) |
| gogni (mal) : mal habillé. A - B - (41) |
| gôgni, gôni v. (racine gogg-, gobb-, god- enflé qui se retrouve dans de nombreux mots qui expriment soit un gonflement ou une déformation, soit au sens figuré, un travestissement ou des mauvaises fréquentations). Habiller, déguiser. - (63) |
| gogniaud n.m. Epouvantail. - (63) |
| Gogniauds (les) n. pr. Fête de Carnaval. Voir gôgni. - (63) |
| gognod : vieil habit en mauvais état - (51) |
| gognoder : habiller avec des gognods - (51) |
| gogo (à), à foison. - (27) |
| gogo, avoir tout à gogo, c'est avoir tout en abondance ; être en goguette, c'est se réjouir... - (02) |
| gogo. Naïf, simple d'esprit. (Français familier). - (49) |
| gogo. s. m. Œsophage, canal qui porte la nourriture de la bouche à l'estomac. Les gourmands, lorsqu'ils sont à table, s'en mettent toujours plein le gogo. Un coup de bon vin, quand ça passe, ça fait bien dans le gogo. – A gogo. locut. adv. A souhait, en abondance. Vivre, manger à gogo. - (10) |
| Gogote, Goton, Marguerite. - (16) |
| gogue : douille d'un outil - (48) |
| gogue : (gog’ - subst. f.) douille, partie creuse et cylindrique de certains instruments métalliques, qui reçoit une autre pièce, fixe ou mobile. Ainsi, on appellera gogue aussi bien la douille d'une bêche que le manchon métallique qui assujettit le tuyau du poêle dans le conduit de la cheminée. - (45) |
| gôgue, s. f., plaque de fer attenant au bateau, et où se place l’épaillète. - (14) |
| gogué. : Etre en goguette, en réjouissance. - (06) |
| goguée : boisson fraîche à base de vin, d'eau et de sucre - (48) |
| Goguelu (Mère) : se dit d'une personne chargée de petits paquets. Elle est comme la Mère Goguelu. Tiens, voilà la Mère Goguelu. A rapprocher des vx fr. goguelu et gogue, ce dernier mot s'appliquant à une « sorte de farce ou de ragoût composé de lard, d'œufs, d'herbes et de fromage mêlés d'épices et de sang de mouton, que l'on mettait cuire dans une panse de cet animal. » (Godefroy). - (20) |
| goguenette : Plaisanterie. « O dit tojo des goguenettes ». Vieux français, goguenette. - (19) |
| goguenette : plaisanterie. - (33) |
| goguenette, blague, histoire amusante souvent gauloise. - (27) |
| goguenette, s. f. propos joyeux ou moqueur, gaillardise. - (08) |
| goguenette, s. f., petite histoire très salée. - (40) |
| goguenette. n. f. - Plaisanterie, histoire amusante. - (42) |
| gôguenettes, railleries, plaisanteries... - (02) |
| goguenôte. : Gai propos de table. - (06) |
| goguenoter, v. n. demeurer oisif ou se divertir. S’emploie aussi pour boire par désœuvrement. « Goguenoter » est pour gogueneter, être en goguette. - (08) |
| goguer : plaisanter, goguenette, plaisanterie (celt. goge : raillerie). - (32) |
| goguette : mélange de vins à d'autres alcools amené aux jeunes mariés le lendemain de la noce. A - B - (41) |
| goguette : mélange de vin et autres alcools porté aux jeunes mariés le lendemain de la noce - (43) |
| goguette : mélange de vin et d’alcools, porté aux jeunes mariés le lendemain de la noce - (34) |
| goguette : s. m., bol de vin chaud. - (20) |
| goguezie. adj. Maigre, sec, décharné. (Tormancy). - (10) |
| goguignon. s. f. Femme de mauvaise vie. (Percey). - (10) |
| goi. Mulot. - (49) |
| goicher. v. - Pencher. (Mézilles, selon H. Chéry) - (42) |
| goidromel. s. m. Mauvais vm, hydromel. (Saint-Martin-du-Tertre, Paron, etc.). - (10) |
| goiêtres. s. f. pl. Dartres. (Courson). – A Merry-la-Vallee, on dit ghiette, dans le même sens. - (10) |
| goiffon : s. m., goujon. - (20) |
| goiffon, s. m , goujon. D'un apprenti pêcheur on dit : « O n'prend qu'des goiffons ! » - (14) |
| goiffond, n. masc. ; goujon. - (07) |
| goifon. Goujon. - (03) |
| goillarde) s. f. serpe à long manche pour élaguer les buissons. - (21) |
| goïllat n.m. (du francique gulia, flaque d'eau). Trou d'eau. - (63) |
| goïllat, gouillat n.m. Flaque d'eau boueuse. - (63) |
| gôille et gaillais (prononcer gôïais) - boue, et endroit très boueux d'une boue liquide, une flaque. - Qu'en y é don de lai gôille dans les rues ! - Prends gaide, mon enfant de ne pâ tant te goîllai. - (18) |
| gô-ille : (gô:y' - subst. f.) boue très liquide. - (45) |
| gôille, goye : n. f. Boue. - (53) |
| goille. Linge usé et déchiré : c'est le patois de guenille. - (13) |
| goillet : s. m. flaque d'eau. - (21) |
| goillon, gôyon. s. m. Personne malpropre, d'un extérieur dégoûtant. (Mont-Saint-Sulpice). C'est évidemment une altération ou une syncope de goignon, qui signifie porc, cochon. - (10) |
| gôillote : n. f. Bourse. - (53) |
| goillotte : petit sac pour mettre l'argent. - (31) |
| goin : né mouillé - (44) |
| goinfre, qui mange outre mesure... - (02) |
| goinger (pour coincher). v. n. Prendre l'eau dans ses chaussures en marchant, quand les chemins sont trempés do pluie. Du vieux français coinche et du latin congium. - (10) |
| goipe, gouape. adj. et s. Ivrogne. - (10) |
| gois (un’e) : trace pour le faucheur. Dans l’herbe à faucher, voie faite par piétinement du faucheur pour délimiter son espace de travail. Voir gauger. Déformation de « gué ». En Vendée : la chaussée submersible entre le continent et l’ile de Noirmoutier, leur patois a donné « goiser » pour patauger ! - (62) |
| goîtron, s. m., maladie du cou, qui décime souvent les troupeaux de moutons. On la nomme aussi bouteille. - (14) |
| gojard (n. m.) : goyard, sorte de serpe à long manche servant à débroussailler - (64) |
| gojard. n. m. - Sorte de serpe à long manche, utilisée pour la taille des branches. - (42) |
| gôjé; s'gôjé, mettre ses souliers dans l'eau qui s'y introduit. - (16) |
| gola : s. m. creux de la pierre par où l'eau de vaisselle s'écoule ; aussi pour le vin qui coule du pressoir = « goulot ». - (21) |
| gôlâillon n.m. 1. Gosier. 2. Pomme d'Adam. - (63) |
| gôlaingne, s. f. enflure qui se montre au bas du visage, au menton, à la gorge; gros cou, tumeur goitreuse. Se dit également en parlant des animaux. (Voir : gôlée.) - (08) |
| golayon : pomme d’Adam. Œsophage. A - B - (41) |
| golayon : œsophage, pomme d’Adam, gosier - (43) |
| golayon : pomme d’Adam - (44) |
| golàyon, s. m. pomme d’Adam. - (24) |
| gole : bouton, croûte, gale - (48) |
| gole : gale. - (29) |
| gole : gale. (RDC. T III) - A - (25) |
| gole et golou - gale, galeux. - Le pôre enfant, al é lai tête tote couvrie de gole. - Le père Masson, ai son âge, â tot golou. - (18) |
| gole : (gol’ - subst. f.) gale. - (45) |
| gole : plaie avec une croûte - (39) |
| gôlé : v. pr. Se gratter. - (53) |
| gole, s. f. gale, maladie de la peau. Se dit de tous les boutons purulents, des croûtes dartreuses, des callosités, des durillons. - (08) |
| gôle. Avoir les doigts gôles, c'est les avoir saisis par le froid. Ce mot a été emprunté évidemment au latin gelu, glace, grand froid. - (02) |
| gole. s. f. Gale. (Ménades). - (10) |
| gôle. : Enraidi par le froid (rac. lat. gelu, froid glacé). - Avoir les doigts gôles, c'est les avoir enraidis par le froid. - (06) |
| golée n.f. Goulée, gorgée. - (63) |
| gôlée, goulée (goûlée) : s. f., vx fr., gollie, gorgée. J'en ai bu une bonne gôlée. - (20) |
| gôlée, s. f. boursoufflure qui se manifeste à la gorge et qui chez les moutons est le plus souvent un symptôme de cachexie. - (08) |
| golèïon. Gosier. Œsophage. D'un buveur on dit : « Aul è in bon golèïon » pour « il aime bien boire ». - (49) |
| goler (s’) : (s' golè - v. pronom.) "se galer" c-à-d se gratter. - (45) |
| goler (se) : gratter (se) - (48) |
| goler (se) : gratter (se) - (39) |
| goler (se), v. réfl. se gratter, se frotter. On dit que les animaux « se golent » contre les arbres pour se débarrasser des insectes. - (08) |
| golère. Espace entre la poitrine et la chemise : « au les èvot cachés dans sè golère », pour il les avait cachés sous sa chemise. - (49) |
| golerette : boire à la régalade A - B - (41) |
| golerette : boire à la régalade - (34) |
| golerette n.f. 1. Petite gorgée. 2. Régalade (sans toucher le récipient avec ses lèvres). - (63) |
| goleron, s. m. bourdon, insecte de la famille des mellifères. - (08) |
| golerotte - goulerotte, petit goulet ; entaille, petit conduit pour faire couler l'eau, pratiquée dans la terre, sur la pierre, au bord d'une casserole, au flanc d'une cruche. - Al é fait creusai su lai pierre de son lavier ine petiote gollerotte. - Est-ce que c'â toi qu'é cassai lai golerotte de note beurchie ?... - (18) |
| gôleute, vallon, passage étroit et réservé. - (27) |
| golie (ō), sf. gueulée, bouchée. - (17) |
| goliet : Flaque de boue liquide. « Fâ voir attentian de ne pas mentre le pid dans ce goliet ! » : fais attention de ne pas mettre le pied dans cette boue ! - (19) |
| golimichon. s. m. Sorte de crêpe très épaisse. (Vertilly). - (10) |
| golle : petit bouton, croûte sur la peau se détachant facilement (signifie : gale). - (56) |
| golli. s. m. Goulot d'une bouteille. - (10) |
| gollie. s. f. Poussière enlevée par le vent. (Quincerot). - (10) |
| gollu, gouape : quelqu'un qui mange bien - (43) |
| golon - bouchée, morceau. - I ne veux pas to cequi, beillez moi-z-en ran qu in golon ou deux. - Al é aivu tô fait, vais ; â n'en é fait qu'in golon ci é passai queman ine lettre ai lai poste. - (18) |
| golon (ō), sm. bouchée. Dignez don è golon, mangez donc un morceau. - (17) |
| gôlon : nom masculin désignant une grosse bouchée - (46) |
| golon et goulée. Grosse bouchée qui remplit bien la gueule : Bouarbis qui bêle pard sai goulée. - (13) |
| golot - ouverture dans une clôture de la campagne ou une bouchure, ou une haie. - Le golot du prai Mairtin â cassai po les bêtes. - Ferme le golot queman qu'an faut, que les beu ne sortaint pas. - (18) |
| golotte : petit goulot, robinet (celt. goul : bouche). - (32) |
| golou : personne qui se gratte, galeux - (48) |
| golou : désigne quelqu'un qui se gratte - (39) |
| golou, ouse, adj. galeux, qui a la gale ou des callosités, des durillons. Se dit d'un fruit, d'une branche d'arbre, d'une pomme de terre, etc., comme d'une personne. - (08) |
| goloux. Galeux. C’t'enfant-qui n'ast pas soigné, al ast teut goloux. S'applique plutôt aux éruptions de la tête qu'à la gale proprement dite. - (13) |
| golrotte : (golrot' - subst. f.) littéralement "goulerette" ; désigne toutes sortes de becs verseurs, et en particulier celui de la "sapine" (seau à traire). - (45) |
| golu : dindon. A - B - (41) |
| golu : dindon - (43) |
| golu : galeux. (E. T IV) - S&L - (25) |
| golu n.m. Dindon. Voir codinde. - (63) |
| golu : n. m. Galeux. - (53) |
| gômai ou gueumai – rester là inactif, attendre en s'ennuyant ; en parlant de l'eau qui ne remue pas, d'un linge qui y reste trop longtemps. - A nos é fait gômai lai in temps infini. - Quoi que te gôme don qui en i airé beintôt deux heures ? - Ne me paile pâ d'ine aie que gueume en s'y met tot pliein de petiotes bètes ! - (18) |
| gomblai, gonfler, enfler. - (02) |
| gome : touffe d'herbe dépassant dans une prairie. A - B - (41) |
| gomé : qui moisit dans quelque coin humide ou malpropre. (B. T II) - B - (25) |
| gôme, s. f. tumeur qui est particulière à l'espèce bovine. - (08) |
| gomer : rester immobile. Bétail immobile en raison d'une maladie. A - B - (41) |
| gômer : attendre (dans un sens péjoratif). (CLB. T II) - C - (25) |
| gômer. Attendre, dans tous les sens du mot. Ex. : « Voilà une heure que les escargots goment dans le four du poêle en attendant monsieur, ils ne seront plus mangeables ! » - (12) |
| gomichon. n. m. - Sorte de pâtisserie. - (42) |
| gomichon. s. m. Sorte de pâtisserie. A Saint-Martin-des-Champs, on fait la fête des gomichons. - (10) |
| gomme n.f. Refus dans les prés de pâture. - (63) |
| gomme. Touffe d'herbe non pâturée, s'élevant au-dessus de la surface de la prairie. - (49) |
| gommer : rester en place sans bouger, bête couvant une maladie - (43) |
| gommer : rester en place sans bouger. Bétail couvant une maladie - (34) |
| gommer : rester immobile, ne pas bouger pour un animal malade - (51) |
| gommer. Se dit d'un bovin qui boude pendant que le troupeau broute ; c'est un indice de maladie. - (49) |
| gommes : (nfpl) ronds d’herbe non broutée (correspondant à l’emplacement de bouses) - (35) |
| gommes : ronds d'herbe non broutée correspondant à l'emplacement des bouses - (43) |
| gômon, s. m., mélampyre, plante des terrains calcaires, qui colore le pain en rouge vineux. Se dit aussi de l'avortement du grain de froment, maladie plus locale que le charbon. - (14) |
| gonaché - mal mis, mal arrangé. - Quemant te voilai gonaché !.. Mai qui don t'é gonaché de lai sorte ? – Voyez gônai. - (18) |
| gônai - arranger mal, sans soins. - C'te feille lai, qu'à portant bein jolie, qu'ile se gône don mau ! - Ces gens lai gônant bein mau los enfants. - (18) |
| gonai (se).- Se mal vêtir. - (06) |
| gonai, gounai et gaunai, mal vêtu... - (02) |
| gonaîche n.f. Femme facile. Voir gôgni. - (63) |
| gonçhe : (adj verbal) gonflé (e) - (35) |
| gonçhe : (nf) ampoule sur la main - (35) |
| gonche : ampoule (dans la main) - (43) |
| gonche : gonflé - (51) |
| gonche adj. (de gonflé). Gonflé, météorisé. - (63) |
| gonches : aphtes - (43) |
| gonçhi : (vb) gonfler - (35) |
| gonchi : gonfler - (51) |
| gonchllye, 1. s. f. bulle, vessie. — 2. adj. gonflé, qui a le cœur gros. Verbe : gonchllyé. - (22) |
| gonchllye, 1. s. f. bulle, vessie. — 2. adj. gonflé. Qui a le cœur gros. Verbe gonchllyer. - (24) |
| gonchyi : gonfler - (43) |
| gondole : s. f., remorqueur à aubes ; sabot bressan sans bride (voir godot). - (20) |
| gôné (être mal) : être mal habillé. (G. T II) - D - (25) |
| goné (mal) : habillé (mal) - (43) |
| gôné : être mal habillé - (46) |
| gônè : faire un travail sans l'approfondir, le faire mal, labourer sur une faible épaisseur - (46) |
| goné : mal habillé. (RDV. T III) - A - (25) |
| gôné adj. Habillé. Voir gôgni. - (63) |
| gone : s. m., gosse. - (20) |
| gôné, adj. habillé sans goût : comment est-il gôné ? - (22) |
| gòné, adj. habillé sans goût : comment est-il gòné ? - (24) |
| gôné, celui dont les vêtements sont en désordre ; gôné quelqu'un, l'accabler de reproches ou d'injures. - (16) |
| gôné, mal habillé. - (27) |
| gonelle : mauvaise, méchante femme. - (31) |
| gonelle : n. f. Chipie. - (53) |
| gonelle, s. f., jeune femme coureuse. - (40) |
| gonelle. Jeune fille effrontée. - (49) |
| gonelle. Mot de dénigrement dont on se sert contre une femme de mauvaise vie. Origine inconnue. - (12) |
| gôner (mal) : mal habiller. - (66) |
| gôner (se) (v.pr.) : s'habiller sans goût - mal gôné = mal habillé - (50) |
| gôner (se) : (vb) mal s'habiller ; se déguiser - (35) |
| gôner (se) : déguiser (se) - (43) |
| gôner (se) : s'habiller, se déguiser. - (32) |
| gôner (se), v. pr., s'habiller de travers, sans goût, et aussi se travestir, se déguiser pour les jours de carnaval. - (14) |
| gôner : habiller ; se gôner : s'attiffer ; être bizarrement gôné. - (56) |
| gôner : habiller. Principalement s’habiller de travers, se déguiser…d’où les Gôniôts de Carnaval. - (62) |
| gôner : v. a., habiller. S'emploie surtout dans un sens péjoratif. Oh ! qu’ t'es mal gôné ! Voir gôniauder. - (20) |
| gôner, détériorer un objet. - (27) |
| gôner, mal habiller. - (05) |
| gôner, v. a. habiller sans goût, avec désordre : « ah ! mai feille, t'voiqui bin gônée ! », ah ! ma fille, comme te voilà faite ! - (08) |
| gôner, v. mal habiller ; terme péjoratif ; maul gôné, mal habillé. - (38) |
| goner. Habiller de travers. Ce verbe est usité dans tout le centre de la France : on le trouve dans le Lyonnais, le Berry, le Morvan, la Bourgogne et la Franche-Comté. De là est venu le mot gonias, habit déchiré et usé ; par extension, mendiant et mauvais sujet. (V. Gonot) - (13) |
| gôner. Mal arrangé, au propre et au figuré. Etym. voyez gaunipper, gôner doit être le même mot avec un sens plus vif. - (12) |
| goner. Vêtir mal ou de façon ridicule. Du vieux mot gone qui signifie robe et vêtement de femme. - (03) |
| gonf’ye (ât’e) : (être) enflée (pour une bête qui a trop mangé d’herbe fraiche) - (37) |
| gonf’ye (ât’e) : (pour un humain) avoir trop mangé - (37) |
| gonfe. adj. - Gonflé, enflé. Se dit également d'une vache qui a mangé trop d'herbe, et qui risque d'étouffer: « La Noireaude alle est gonfe, va don' m'chercher Serge ! Dis-lui d'ém'ner l'trocard » - (42) |
| gonfié, vt. gonfler. - (17) |
| gonfje, adj. gonflé. - (17) |
| gonfle : n. f. Phlyctène, boursouflure de la peau. - (53) |
| gonfle : part pass., vx fr., gonflé. Je suis toute gonfle. J'ai le cœur gonfle. Une vache qui a mangé trop de trèfle vert devient gonfle. - (20) |
| gonfle : s. f., ampoule, bulle de savon, vessie de poisson, etc. - (20) |
| gonfle, adj. enflé, boursoufflé. - (08) |
| gonfle, adj. gonflé, pour parler de la vache qui a mangé de la luzerne, et s'emploie aussi pour une personne qui trop mangé (je suis gonfle). - (65) |
| gonfle, adj., gonflé : « Ol a tant buvoché, qu'ôl en é gonfle. » Quand un bœuf a trop mangé de trèfle mouillé, il est gonfle et crève. Alors on le fait assavoir, et on le vend au rabais, sous la garantie du vétérinaire. - (14) |
| gonfle, adj., gonflé, dilaté. - (40) |
| gonfle, bouton, ampoule, cloque. - (54) |
| gonfle, pour gonflé ; une personne qui a trop mangé d'une chose dit qu'elle est gonfle. - (16) |
| gonfle, s. f., bulle, ampoule ; « Faire des gonfles de savon. Avoir des gonfles dans les mains. » - (14) |
| gonfle, s. f., musette : « J'vons danser ; Simon va nous jouer de la gonfle. » - (14) |
| gonfle, vessie de porc. - (05) |
| gonfle. Pour gonflé. Ne se dit que des choses du corps, soit de l'homme, soit des animaux. Ex. « Je crois que j'ai trop mange de potée, je me sens tout gonfle. » Etym. conflare. - (12) |
| gonfle. Vessie de porc, de poisson. - (03) |
| gonfler : v. a., exciter quelqu'un, lui monter la tête. - (20) |
| gonflò. Gonflais, il gonflait. Gonfler n'a pas un siècle d'usage dans la langue. - (01) |
| gongoise. s. f. Donzelle. (Ménades). - (10) |
| gongon : s. m. et f., personne qui gongonne. Père Gongon. Mère Gongon. - (20) |
| gongòner, v. intr., murmurer, se plaindre : « C'te vieille, all' n'é point drôle ; all' gongòne sans fin. » - (14) |
| gongonner : (vb) ronchonner - (35) |
| gongonner : ronchonner - (43) |
| gongonner : v. a., gronder, grogner. Il m'a rien gongonné. J' sais pas c’ que l’ patron a aujourd'hui ; i fait qu' gongonner. - (20) |
| gôni Voir gôgni. - (63) |
| gonia : personne négligée. (RDM. T IV) - B - (25) |
| gônia : 1 n. m. Carnaval. - 2 n. f. Personne très mal habillé. - (53) |
| gôniâ, adj. mal vécu. - (38) |
| gonia, personne mal habillée. - (27) |
| gônià, s. m., chiffon, loque, et aussi la personne qui en est vêtue. (V. Gônòt.) - (14) |
| goniâ, vêtements usés, déchirés. - (16) |
| gôniau : (vb) gros nuage avant la pluie - (35) |
| goniau : chiffon, vieillerie, parure de mauvais goût — nuage noir. - (30) |
| gôniau : gros nuage cotonneux annonçant l'orage - (43) |
| gôniau : s. m., vx fr. gonet, vieil habit, vêtement en loques, guenille ; gros nuage. - (20) |
| goniaud : épouvantail - (44) |
| goniaud : habillé en haillons - (34) |
| goniaud n.m. (vx.fr. gonel, habit usé, vêtement en loques, guenilles) 1. Déguisement de carnaval. 2. Nuage plus ou moins déchiqueté. - (63) |
| gôniauder v. Habiller de gôniauds, mal habiller. Voir gôgni, gôni. - (63) |
| gôniauder : v. a., habiller de gôniaux, mal habiller. Voir gôner. - (20) |
| goniauds (s'emploie au pluriel). Vieux habits, oripeaux. Désigne aussi ceux qui en sont habillés. Ce terme est employé dans les régions voisines, à Chalon par exemple. - (49) |
| goniauds : haillons ; fripes - (43) |
| gônicher, habiller sans recherche, sans élégance, sans goût. - (54) |
| gonié. Habillé de vieux habits ; mal habillé ; habillé sans goût. - (49) |
| goniô : epouvantail. Habillé en haillons. A - B - (41) |
| goniot : mot masculin désignant une personne mal habillée - (46) |
| gonné (mal), mal habillé - (36) |
| gôn'né : habillé, mal vêtu - (48) |
| gonné, ée. adj. Mal mis, mal vêtu ou, plutôt, vêtu ridiculement. Se dit sans doute par allusion aux longs vêtements, aux houppelandes et aux longues et larges robes tombées en désuétude et passées de modes que portent certaines gens. - (10) |
| gonne, robe, mal gonée, mal vêtue. - (04) |
| gonné, vt. mal habillé, vêtu rudement et sans précautions [à Châtillon : gôné). Par ext., secouer, morigéner. - (17) |
| gonnelle : femme vieille (peu usité) - (37) |
| gonner (Se). v. pronom. S'habiller sans soin, ridiculement, ou avec de vieux habits passés de mode. - (10) |
| gonnole : poupée grossière. (B. T IV) - S&L - (25) |
| gonot - vieil habit, vieux linge ; particulièrement un bonnet de femme. - To ces gonots qui, teins, c'â bon pour le drillou. - Ne mets don pu ces gonots qui ; ce n'â pâ de l'économie. - (18) |
| gônòt, et gôniòt, s. m., personne travestie de façon grotesque et triviale : « J'sons en carnavau ; les gônòts côront les rues. » - (14) |
| gonot. Capuchon de laine grise à l'usage des vigneronnes. On appelait autrefois gonot une sorte de mantille à pointes, surmontée d'un capuchon et garnie de plissés ou fraisés : on en portait encore il y a cinquante ans. Ce vêtement était fait avec de l'indienne piquée, à petits dessins et d'un ton clair. Les laitières ne venaient jamais à la ville sans ce capuchon sur lequel on plaçait lai tôrche, destinée à maintenir le pot au lait sur la tête. Les torches même deviennent rares : les pots-au-lait sont portés en voiture ou à la main... - (13) |
| gonscier : gonfler - (57) |
| gonsciou (on) : gonfleur - (57) |
| gôpé : mal habillé (aussi fagoté) - (46) |
| gôpe, femme vêtue d'une façon burlesque. - (16) |
| gor(s) : trou(s) creusé(s) par l'eau aux bords des biefs (en dessous) ou se logent truites et écrevisses - (39) |
| gôr, gorre (n.m.) : trou dans une rivière, un étang (de Chambure écrit gôr) - aussi gore - (50) |
| gor, plus souvent gôrais - cochon mâle. – Les gôrais, c'â âssi méchant que c'a sale. – Oh ! les vilains gors ! - Ce-t-homme lai croyez-mouai, c'â in vilain gor. - (18) |
| gôr, s. m. trou profond dans une rivière ou un étang, crevasse remplie d'eau, cavité souterraine au bord des ruisseaux où se retirent les truites et les écrevisses. - (08) |
| gorai. Goret, cochon… - (01) |
| gorai. : Gouri, jeune cochon. Le mot gorrona en espagnol signifie prostituée. Nous avons bien pu emprunter à ce dernier vocable notre vilain mot carogne. - (06) |
| gorain : petit cochon - (43) |
| gord, gourd. s. m. Trou profond et plein d'eau, sorte de gouffre dans une rivière ou ailleurs. Du latin gurges. – On connaît la ferme et l'ancien port de Gord, à Appoigny. - (10) |
| gordale : Frelon. « Y est pas eune môche à mié ni eune grande, y est eune gordale » : ce n'est ni une abeille ni une guêpe, c'est un frelon. - (19) |
| gorde : Gourde. « Ol a mis sa gorde dans san carnier ». - (19) |
| gorde. s. f. Gourde. (Véron). - (10) |
| gorder : (gordè - v. intr.) mendier. Gordè p'lé: port' "mendier aux portes". - (45) |
| gorder, mendier. Gordeau, en patois gordia et son féminin gordelle, homme ou femme vivant dans la fainéantise et la saleté : porteurs de gourdes. Gourd, dit M. Francisque Michel, est un terme d'argot qui signifie fripon, fourbe et vagabond. - (13) |
| gorder, v. tr., quémander, mendier : « T'n'as donc pas honte, d'aller c'ment c'qui tôjor garder cheû les vouésins ? » - (14) |
| gôrdze n.f. Gorge. - (63) |
| gordzenioule n.f. Gorge. Voir cornioule. - (63) |
| gore : truie. III, p. 43-m - (23) |
| gore, celui qui mange ce qu'il a, sans en faire part à autrui. - (16) |
| gore, gorelle (n.f.) : jeune truie - (50) |
| gore, s. f. truie, femelle du porc. - (08) |
| gore. s. f. Truie, femme débauchée. - (10) |
| gorelle (nom féminin) : jeune truie. - (47) |
| gorelle, s. f. jeune truie, coche qui a ses petits. Diminutif de gore et forme féminine de gorel ou goret. - (08) |
| gôrer : Duper, attraper. « O s'est fait gôrer in fin cô » : il s'est fait duper un bon coup. - (19) |
| goret : porcelet - (48) |
| goret, s. m. petit cochon. Diminutif de gor. - (08) |
| goret. Cochon mâle. Goreille et treue guéreille, truie. Guéreillon, jeune truie : an n'y ai point de guéreillon qui ne trouvet son eppéreillon. Ce curieux proverbe signifie qu’il n'y a fille si laide et malpropre qui ne trouve à se marier. C'est un mot gaulois. Chez les Celles gorrit était le sanglier. Les Bas-bretons disent gorth. Dans le pays beaunois, un gouri est un cochon de lait ; au figuré : jeune homme qui se vautre dans l'ordure. En provençal, un gourri est un vagabond. - (13) |
| goret. Le féminin, goreille, est synonyme de truie, en patois : treue.... - (13) |
| gorfoler, gorfoller. v. n. Jouer, s'agiter, crier. Se dit en parlant des oies et des moutons qui jouent au lieu de manger. (Nailly). - (10) |
| gorgandin, gourgandin. s. m. Homme de mauvaise conduite, coureur de femmes et de mauvais lieux. Il a aussi son féminin gourgandine, qui est aussi très usité. - (10) |
| gorgandiner, gourgandiner. v. n. Courir les rues, les femmes, les mauvais lieux. - (10) |
| gorgane. s. f. Fève, gourgane. - (10) |
| gorgaud. adj. et s. Salaud. (Maillot). - (10) |
| gorge : s. f., bouche. - (20) |
| gorge, s. f. bouche. - (24) |
| gorgeire. Gorgère, collet antique de femme, servant à couvrir la gorge et le cou. Les mots gorgerin et gorgerette étaient plus en usage à Paris; en province, on disait plutôt gorgère. On les y portait plus ou moins façonnés, suivant la condition… - (01) |
| gorgeon (on) - gorgia (na) : gorgée - (57) |
| gorgeon : repas de baptême, lunch. - (32) |
| gorgeon. n. m. - Gorgée. Prendre un gorgeon., prendre un petit verre. - (42) |
| gorgère, engorgère : s. f., vx fr. gorgière, gorgerette, guimpe. - (20) |
| gorgéte, s. f., petite gorge, gorgerette, col de femme. - (14) |
| gorgette, s. f. col de femme en mousseline, collerette. - (08) |
| gorgi - bouhin-ner : gorgé - (57) |
| gorgignôle : Oesophage. « Coper la gorgignôle » : égorger. - (19) |
| gorgnole, subst. féminin : gorge, gosier. - (54) |
| gorguillan : Charençon des fèves ou des pois. - (19) |
| gorguœllion, s. m. charançon de la fève, des pois (du latin curculio). - (24) |
| gòri ! goret ! exclamation des campagnardes pour rassembler leurs petits cochons. On entend aussi parfois : Gouri (V. ce mot.) - (14) |
| gori, gouri n.m. Cochon. - (63) |
| gori. Exclamation dont se servent les femmes de campagne pour rappeler ou pour rassembler leurs jeunes porcs et par extension leurs volailles, leurs oies, tous leurs « neursons », en un mot : gori ! gori ! - (08) |
| gorichionné : qui a subi une brûlure - (43) |
| gorichon, gorain : odeur de cochon grillé, odeur de corne, de poil brûlé - (43) |
| gorichon, gorin : (nm) à l'origine: odeur de poil de cochon grillé (de brûlé, de roussi) - (35) |
| gorichonner : (vb) sentir le « gorin » - (35) |
| gorichonner : v. a., syn. de bucler et de friller. J'ai gorichonné ma robe. - (20) |
| gorin : odeur de brûlé (cheinte le gorin : sentir le brûlé) - (51) |
| gorin, gourichon n.m. (anc. fr. gore, truie). Brûlé, roussi. - (63) |
| goriné : brûlure, brûlé - (43) |
| goriner (breuler) : brûler (plutôt pour la cuisine) - (51) |
| goriner v. Brûler, griller. - (63) |
| gorjöre, sf. gorgère. - (17) |
| gorle : frelon. A - B - (41) |
| gorlé : personne mal habillée, clochard (en B : gorli). A - (41) |
| gorle : savate, mauvaise chaussure. A - B - (41) |
| gorle : (nf) frelon - (35) |
| gorle : frelon - (34) |
| gorle : frelon dont suivant le dicton il en faut 7 pour tuer un homme. - (30) |
| gorlé : personne mal habillée, clochard - (34) |
| gorle : savate, mauvaise chaussure - (34) |
| gorle : savate, mauvaise chaussure - (43) |
| gorle n.f. Frelon. Voir gronde et gueurionde. - (63) |
| gorle, gronde : frelon - (43) |
| gorle. Vieille chaussure usagée. Ce mot a, à peu près, le même sens que garloche ; frelon, grosse guêpe jaune. On l'appelle encore « gorlon », nom qui s'applique aussi au bourdon. - (49) |
| gorléchi : matériel faisant un bruit de ferraille. A - B - (41) |
| gorlêchi : matériel faisant un bruit de ferraille - (34) |
| gorler : trainer ses gorles*. A - B - (41) |
| gorler : qui traîne ses groles - (34) |
| gorlessi : matériel faisant un bruit de ferraille - (43) |
| gorlis n.m. Courlis. - (63) |
| gorlon (n.m.) : bourdon (insecte) - aussi gueurlon - (50) |
| gorlon : frelon - (48) |
| gorlon : bourdon - (39) |
| gorlon, bond'na, bordon. Bourdon. Fig. Désigne un individu méchant, difficile à contenter. - (49) |
| gorlonner (v.t.) : fredonner ; rouspéter, grogner - (50) |
| gorlonner. Bourdonner, murmurer entre les dents, pour exprimer son mécontentement. - (49) |
| gormai, frapper à coups de poings... - (02) |
| gorman, adj. gourmand, mange-tout, débauché. - (08) |
| gorman, gourmand ; chien d'gorman ! (familier). - (16) |
| gormand (être), loc, être désireux, avoir besoin : « Ol é gormand d'soumei. » — « C'te târe é gormande d'iau. » - (14) |
| gormand : gourmand - (46) |
| gormand : gourmand - (51) |
| gormand : gourmand - (48) |
| gormand : Subs. gourmand, rameau improductif. - Adjectif, gourmand, qui mange avec excès, qui aime la bonne chère. « Jamâ gormand n'a été gras ». - (19) |
| gormand : gourmand. Le gormand o insatiable : le gourmand est insatiable. - (33) |
| gormand : n. m. Gourmand. - (53) |
| gormand(e) : gourmand(e) - (39) |
| gormand, adj., gourmand, qui a l'appétit d'une chose, qui mange beaucoup. - (14) |
| gormand, adj., gourmand. - (40) |
| gormand, de adj. et n. Gourmand. Voir tsat. - (63) |
| gormand, tsa : gourmand - (43) |
| gormandie, s. f. gourmandise : - (08) |
| gormandige. s. f. Gourmandise. (Domecy-sur-le-Vault). - (10) |
| gormandise : gourmandise - (51) |
| gormandises, s. f., friandises, sucreries : « Y évòt eun biau dessert ; y étòt plein de plats d'gormandises. » - (14) |
| gorme : Gourme, maladie des enfants. - Partie de la tige coupée d'une céréale qui est opposée à l'épi. « En enjevalant men z'y su le gorme » : en plaçant (les tiges coupées) sur le lien mets les bien sur le gorme ; parce-que pour qu'une gerbe soit bien liée, il faut que le lien soit mis loin des épis. - (19) |
| gorme : s. m. bout inférieur de la tige de blé coupée. - (21) |
| gorme, s. f. gourme. - (08) |
| gorme, s. rn. gros bout des tiges coupées de blé, d'avoine, d'orge. - (24) |
| gorme. s. m. Chaume, pied des céréales laissé en terre après la moisson. (Michery, Plessis-Saint-Jean). - (10) |
| gornaille : Grenouille. « An a guère fait de vin c 't' (s 't ') an-née, i va falla boire ave les gornailles » : on n'a guère récolté de vin cette année il va falloir boire avec les grenouilles, c'est à dire boire de l'eau. - (19) |
| gornaïlli : Gargouiller, avoir des borborygmes. « Le ventre me gornaïlle ». - (19) |
| gornaude : grenouille - (34) |
| gornaude : grenouille. - (30) |
| gornaude, gueurnaude n.f. Grenouille, porte-monnaie. - (63) |
| gorne, s. f. bûche de bois de moule plus ou moins défectueuse et que les bûcherons fendent avant l'empilage. - (08) |
| gornôde : grenouille. A - B - (41) |
| gornoudi : (nm) petite mare - (35) |
| goröte, sf. petite vache. - (17) |
| gorre, homme pauvre, sale comme un cochon. - (05) |
| gorsâiller (v. tr.) : gaspiller, gâcher - (64) |
| gorzat, s. m. bourbier, mare fangeuse. - (08) |
| gosanche, godanche, gasanche, gadanche, gadache, cadoche : voir pressoir. - (20) |
| gôse : variété d'osier à l'écorce blanchâtre poussant dans les marécages. A - B - (41) |
| gôse (na) : motte - (57) |
| gosse et gousse de pois, d’ail : synonyme patois de cosse. - (13) |
| gòsse, s, f., gausserie, mensonge, bourde ; jacasserie, potin : « Côse-te ; t'é tôjor à nous conter des gòsses. » - (14) |
| gosse. s. m. Petit garçon vif, remuant, espiègle. - (10) |
| gosseau, gousseau. s. m. gousse, enveloppe des graines : un « gousseau » ou « gosseau de genêtre », gousse de genêt à balais. - (08) |
| gòsser, v. intr., mentir, conter des blagues. - (14) |
| gossine : s. f., gosseline, gamine. - (20) |
| gosson. s. m. Jumeau. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| gossot. Poche. Gousset. C’est la variante de potenère. - (13) |
| got : trou pour jouer - (60) |
| Gôt, nom propre, diminutif de Guillaume. - (08) |
| got, s.m. cosse ; par extension, haricot. - (38) |
| Gote, Goton. s. f. Diminutif de Marguerite. - (10) |
| gòte, s. f., goutte, ration de « dur », que l'indigène multiplie avec trop de complaisance. - (14) |
| gôte. Goutte, gouttes. - (01) |
| goter : goûter - (43) |
| gôter : Goûter. « Donnes m'en voir in ptiet bout à gôter ». Terme vieillot, on dit aujourd'hui goûter. - (19) |
| goter, v. a. goûter, essayer par le goût. « Goter » est peu usité, le vrai terme est « tâter » - (08) |
| gôter, v. tr. et intr., goûter, discerner les saveurs, et aussi tomber par gouttes. - (14) |
| gotillai - chatouiller, gratter ou ç'a démange. - A m'é révoillé en me gotillant sô le nez. - I ne peu pa mairchai nun pieds, mouai ci me gotille trop. - (18) |
| goton : souillon - (60) |
| Goton, prénom, Marguerite. - (38) |
| goton, s.f. fille de mauvaise vie. - (38) |
| gotou - qui a des boutons, des espèces de petites verrues comme de la gale, mais non malpropres plus guère usité. - T'é vu l'André Daird, al é les doigts in pecho gotou, vais. - Ile é le front gotou ; ce n'â pas grand'chose ; ma… - (18) |
| gotou : mouillé, eau croupie - (43) |
| gôtré : plein de boue - (39) |
| gottailli v. Tomber des gouttes de pluie. - (63) |
| gotte : goutte - (43) |
| gotte : goutte - (51) |
| gotte : Goutte, goutte de pluie. « I cheut des gottes » : il commence à pleuvoir. - (19) |
| gotte : (nf) goutte de liquide (opposée à « goutte » qui désigne de l'alcool) - (35) |
| gotte, s. f. goutte, très petite quantité de liquide : « beille m'en eune gotte. » maladie des articulations très rare d'ailleurs dans nos campagnes - (08) |
| gotte. Goutte ; un peu : « boire in-ne gotte ». - (49) |
| gotte. s. f. Goutte. (Véron). - (10) |
| gotter : Dégoutter, tomber goutte à goutte. « Prends gârde de fare gotter la chandâle su ta culotte ». Gotter a un sens plus étroit que « dégotter » ; « La chandale gotte, le covâ (toit) dégotte ». - (19) |
| gotter, v. n. tomber goutte à goutte ; couler peu à peu, suinter. - (08) |
| gottére : Défaut d'un toit qui laisse passer l'eau de pluie. « Y a eune gottére dans le covâ i faut fare veni le crevou (couvreur) ». - (19) |
| gottiée. n. f. - Pot à égoutter d'une faisselle. - (42) |
| gottire : (nf) gouttière - (35) |
| gottîre n.f. 1. Gouttière. 2. Fuite dans la toiture. - (63) |
| Gotton, Marguerite. - (05) |
| Gotton. Synonyme patois de Marguerite. La terminaison ou qui semble masculine s'appliquait aux femmes, tandis que le suffixe iche désignait une personne du sexe fort- Annelon, Dannon, Philison, Margueron, Reinon, étaient usités à Beaune au moyen-âge. Ils se sont continués jusqu'à notre époque par les Jeannon, Nannon, Marion, Françon, Toinon. Madelon. Au siècle dernier et au commencement de celui-ci, on disait Coliche pour Colas, Paliche pour Pierre, Dodiche pour Claude, Beaucoup de noms de baptême se terminaient en ot : Tieanot, Jacquot, Charlot. - (13) |
| gou : rat. A - B - (41) |
| gou : (nm) rat - (35) |
| gou : rat - (34) |
| gou : rat - (43) |
| gou barda : loir, rat fruitier. A - B - (41) |
| gou barda n.m. Lérot. Voir barda. - (63) |
| gou barda, gou tsapé : (nm) lérot - (35) |
| gou bardé : mulot bardé - (51) |
| gou n.m. (or. inc.). Gros rat, surmulot ou rat d'égout. - (63) |
| gou tsapé n.m. Loir. C'est un rat revêtu d'un chape (tsape), une fourrure. Chez l'épicière. - (63) |
| gou, s. m. gousse, cosse des légumineuses. - (08) |
| gou, s. m. gros rat. - (24) |
| gou. Espèce de rat qui mange les fruits. Dans le Chatonnais on les appelle rat vou, ou ravou, origine inconnue. - (03) |
| goua, s. m. grosse serpe à couper les branches. - (22) |
| gouâche - gauche. Plus guère usité. - Vai in pecho ai gouâche. - Teins ! t'é gouâchey ? - (18) |
| gouâche : n. et adj. Gauche. - (53) |
| gouâché : n. m. Gaucher. - (53) |
| gouâche, gouâce. adj. Gauche. (Domecy-sur-le-Vault, Ménades). - (10) |
| gouâgè : expr. Prendre eau et boue dans ses chaussures. - (53) |
| gouâgeai et (se) – se mouiller les pieds avec leurs chaussures en passant dans l'eau. - Té velu passai su les pierres puto que su lai plianche, et pu te t'é gouâgeai. - A se sant gouâgeai to deux dans le gôillais. - (18) |
| gouager : patauger. (RDM. T II) ; remplir d'eau les chaussures. (RDM. T IV) - B - (25) |
| gouager, v. a., mettre les pieds dans l'eau, avoir les chaussures pleines d'eau. - (11) |
| gouager. Patauger dans la boue. Al ai gouâgé ses saibois en corant dans l'iâ. Anciennement ce verbe signifiait : « passer une rivière à gué... Le radical celtique gué ou wé est bien connu. - (13) |
| gouai, s. m. grosse serpe à couper les branches (du vieux français gouart). - (24) |
| gouaillai. : Plaisanter, railler (du latin joculari). Le mot du dialecte, goiart, signifie enjoué et vient de jocularius. - (06) |
| gouaille : Raillerie, moquerie. « Y est tojo c'tu (s'tu) qu'a le mau qu'a la gouaille » : c'est toujours celui qui est malchanceux qui est exposé à la raillerie. - (19) |
| gouaillé : v. i. Mentir. - (53) |
| gouailler. v. a. Faire le mauvais plaisant, railler, persiffler grossièrement. - (10) |
| gouaî'lli : gouailler - (57) |
| gouaïlli : Railler, plaisanter. « Neguin (personne) n'ame bien être gouaïlli ». - (19) |
| gouaî'llou (on) : gouailleur - (57) |
| gouaïlloux : Gouailleur, moqueur. « T'as bin l'ar (l'air) gouaïlloux ! ». - (19) |
| gouant. s. m. Fosse à purin, à fumier. (Villemer). - (10) |
| gouape : goulu - (43) |
| gouape : soiffard - (60) |
| gouape, jeune homme qui aime mieux boire que travailler. - (27) |
| gouâpe, s. f. ivrogne, celui qui s'enivre continuellement. Se dit d'un homme comme d'une femme. - (08) |
| gouape. s. f. Larcin, maraude. Aller à la gouape. (Maligny). - (10) |
| gouape. s. m. Débauché, mauvais sujet. - (10) |
| gouaper, aime mieux boire que travailler, fainéanter. - (27) |
| gouâper. v. n. boire à outrance, faire l'ivrogne, le soulard. - (08) |
| gouard, s. m., serpe à long manche. - (40) |
| gouârge (na) : bouche - (57) |
| gouârge (na) : gorge - (57) |
| gouat, s.m. serpette. - (38) |
| gouatte, s.f. petite serpette pour cueillir le raisin. - (38) |
| gouau, gouaude, adj. paresseux jusqu'à la négligence et à la malpropreté. - (08) |
| gouaule : gaule - (39) |
| gouaule, s. f. gaule, perche dont on se sert pour abattre les fruits et pour divers autres usages. - (08) |
| gouauler : gauler - (39) |
| gouauler, v. a. gauler, employer une gaule ou perche pour abattre des noix ou autres fruits ; battre. - (08) |
| gouâyé, quelqu'un, en rire plaisamment. - (16) |
| goubelat. s. m.. Gobelet. (Accolay). - (10) |
| goubelo. Liseron ou volubilis, de sa ressemblance pour la forme à un gobelet. Vieille orthographe, goubelet. - (03) |
| goubi, ie. adj. Engourdi. - (10) |
| goubillon adj. m. Grossier, malpropre. (Trucy). - (10) |
| goubin (pour gobin). s. m. Gros morceau de pain. De gober. (Fresnes). - (10) |
| goubiot (te) (être) : maladroit(e), gauche, emprunté(e) (voir : gobiot). - (56) |
| gouble, adj. engourdi ou gonflé par le froid : avoir les doigts « goubles. » - (08) |
| gouble. Raidi parle froid. Al ai les mains goubles. Ce mot est employé dans la plaine. Sur la côte on dit : Al ai les mains bigues. - (13) |
| goudâ (on) : jars - (57) |
| goudâ (on) : oie (mâle) - (57) |
| gouda, oie mâle. - (05) |
| goudais. Mâle de l'oie. - (03) |
| goude (savoir les), loc. se dit lorsqu'on est paresseux au travail, d'une manière momentanée. - (22) |
| goudô. Jupe plissée, faite ordinairement de plusieurs bandes de velours de diverses couleurs, tenant à un corps bigarré, ouvert et lacé par devant, mais non plissé. Les goudô des villageoises n'étaient souvent que d'une couleur seule et d'une étoffe fort simple, la plupart même de toile rousse… - (01) |
| goudot : sabot sans bride. Et aussi jeu d’enfant « à toucher » : jouer au goudot (le dernier touché a le goudot). - (62) |
| goudòt, s. m., jeu d'écolier consistant à courir d'après certaines règles, et à s'attraper : « Veins-tu jouer au goudòt ? » - (14) |
| goudôt, s. m., sabot couvert (en bois). - (40) |
| goudze n.f. Gouge. - (63) |
| goué : grosse serpe. - (09) |
| gouè : seulement usité dans la loc. è gouè, "complètement repu, rassasié". I seu: è gouè, "je n 'ai plus faim, je n'en peux plus". - (45) |
| goué, gouet. s. m. Grosse serpe à l'usage des flotteurs et des bûcherons. « Sauve la bouteille et le goué, criaient autrefois les flotteurs à leur compagnon dans les embâcles. » - (10) |
| gouè, s, m., grosse serpe à ébrancher. - (40) |
| goué. Grosse serpe dont se servent les vignerons pour abattre les arbres et aiguiser les paisseaux. Y vas fâre raicmôder le moinche de mon goué. J'ai vu ce mol écrit goé dans un acte de 1409. En Belgique et dans le nord de la France, on dit un courbé. - (13) |
| goué. Lieu d'une rivière qui est plus profond. - (03) |
| gouèce (adj. et n.) : gauche - (50) |
| gouèfon, goujon, petit poisson. - (16) |
| gouéillâ (n.m.) : creux rempli de boue liquide - (50) |
| gouéillâ : flaque, mouille, mare - (48) |
| goueillâ, s. m. creux rempli de boue liquide, flaque d'eau fangeuse. - (08) |
| goueille : (gouéy' - subst. f.) crachat épais. - (45) |
| goueille, guenille. Goueilloux, mou, flasque. Les rasins sont goueilloux, a ne meureront pas. Les Rémois disent une goile. - (13) |
| goueille, s. f. boue, vase, eau bourbeuse. - (08) |
| goueiller (se), v. réfl. se couvrir de boue. - (08) |
| goueiller : (gouèyé - v. intr.) cracher des gouéy ; donc, à distinguer de keupè. - (45) |
| goueiller : se dit d'un vêtement qui fait des plis - (39) |
| goueilles, n. fém. plur. ; pâte de pain, coupée par morceaux et cuite dans du lait. Le peuple ne mangeait des goueilles qu'une fois l'an, le dimanche soir des Bordes (1er dimanche de Carême). - (07) |
| gouèillet : (gouèyè - subst. m.) ou gouèya ou gouè. Croissant, volant, c-à-d sorte de serpe en demi-cercle munie d'un long manche et qui sert à élaguer les haies. Pour élaguer correctement, il faut frapper de bas en haut, car, de la sorte, les branches offrent moins de résistance (cf. von:j' et crouèsan). - (45) |
| goueillo : (gouèyo - subst. m.) flaque d'eau. - (45) |
| gouéillon : guenille, chiffon - (48) |
| goueillon : guenille. O lo en gouellon : il est en guenilles, mal vêtu, déchiré. Signifie aussi : serpillière. - (33) |
| gouéillotte : porte-monnaie, bourse - (48) |
| goueillotte : porte-monnaie. On dit aussi « grolotte ». - (33) |
| goueillotte : (gouèyot' - subst. f.) escarcelle, petite bourse. - (45) |
| goueilloux. s. f. et adj. Guenilleux. (Coutarnoux). – A Etivey, ce mot signifie voyou, et se dit sans doute pour gouilloux, bâfreux, gourmand, ou pour goillon, goignon, cochon, individu de conduite sale et dégoûtante. - (10) |
| gouéjard. s. m. Croissant, grosse serpe emmanchée au bout d'une perche pour émonder les arbres. - (10) |
| gouelle : femme (peu usité) - (37) |
| gouener (se), v. pr., geindre, se plaindre. - (11) |
| gouèpe : (gouèp - subst. f.) ivrogne. - (45) |
| gouère (n.f.) : clafoutis aux pommes, aux cerises... - (50) |
| gouère : clafoutis - (44) |
| gouère : genre de clafoutis sans fruit, base pâte à crêpes cuite au four. - (59) |
| gouère n.f. Crêpe épaisse. - (63) |
| gouère, subst. féminin : gâteau cuit dans une marmite, sorte de galette épaisse. - (54) |
| gouére. Espèce de crêpe épaisse et cuite au four. On dli aussi : « tort' chère ». - (49) |
| gouères, crâpiauds : mets à la farine et au lait - (37) |
| gouet : Grosse serpe dont se servent les bûcherons. « Vins dan torner la môle padant que j'aigugerai man gouet » : viens tourner la meule pour que j'aiguise mon gouet. - (19) |
| gouet : serpette à pointe. Pour décolleter les betteraves. - (62) |
| gouet : serpe, nom de l'arum. - (32) |
| gouet, goiot, serpe à long manche goyard. - (04) |
| gouet, goui (C.-d., Chal., Br.). goué (Y.), goyard (Morv.). - Serpe de vigneron ou de bûcheron, du bas latin gubia, gouge, qui a formé le vieux français goi ou goui (même signification), suivant Littré, qui cite ce mot comme usité dans certaines provinces, mais surtout en Bourgogne. Dans la Côte, le goui est ajusté sur un long manche à l'aide d'une douille creuse, et sert à couper les épines dans les buissons. Le dos de la serpe est même, à cet effet, garni d'un crochet destiné à retenir la ronce qu'on veut couper. - (15) |
| gouêtre : goître - (48) |
| gouêtre : goître - (39) |
| gouette : s. f. serpette spéciale pour les vendanges. - (21) |
| gouette : Serpette dont se servent les vendangeurs pour couper le raisin. Elle est ordinairement faite d'une lame de vieux ciseaux dont le forgeron a recourbé la pointe. - (19) |
| gouette, s. f., petite serpe à vendange. - (40) |
| gouèyote, bourse. - (16) |
| gouffer. v. n. Se gonfler, se gondoler. Se dit des douves et des fonds d'un tonneau travaillés par l'humidité. (Etivey). - (10) |
| gouffre. adj. Un coin est gouffre, lorsque ses deux plans inclinés forment un angle un peu ouvert, et que, par suite, son action est plus rapide. Très-usité dans les environs de Vézelay. - (10) |
| gougeard : outil à long manche pour débroussailler. La lame a la forme d'un croissant. Quelquefois avec un court croc de même profil et de même sens aiguisé à l'arrière soudé sur l'emmanchement de la lame. (2 prononciations : 1. goujarr ("a" bref, ouvert avec "r" roulé) - 2. goujââr - "r" roulé.) Ex : "J'vas aller douner un coup d'gougeard dans la bouchue". Ex : "J’vas monter sous l’bois douner un coup d’goujard si j’veux pas qu’la friche all’ mange bentoût ma vigne !" (Bentoût = bientôt). - (58) |
| gougeat : manœuvre approvisionnant le maçon. - (33) |
| gougeat : n. m. Manoeuvre en maçonnerie. - (53) |
| gougeau. s. m. Serpette à vigne. (Saint-Florentin). - (10) |
| gougère. Brioche nationale au fromage de gruyère, excellente d'ailleurs ! N.-B. II faut qu'elle soit bien cuite. - (12) |
| gouget. s. m. Voyez goget. - (10) |
| gouglin. s. m. Crapaud qui chante la nuit. (Courgis). - (10) |
| gougnafié : goinfre, gougeat - (48) |
| gougnafié : goinfre. Le gougniafié éto souvent un gormand : le goinfre était souvent un gourmand. Ou quelqu'un qui s'y prend mal pour faire son travail. Tu parles d'un gougnafié : tu parles d'un maladroit au travail. - (33) |
| gougnârde : marmelade ou cougnârde ? Purée consistante de fruits cuits. A noter que marmelade tient son nom du portugais marmelo : coing. - (62) |
| gougnat (pour gouillat). s. m. Goujat, mortier ; boue, mare vaseuse. - (10) |
| gougnaudé, v. n. caresser en riant et plaisantant. - (22) |
| gougné (adjectif) : mal habillé. On dit aussi gaugné. - (47) |
| gougne. s. f. Jeu du mail. (Saint-Florentin et lieux environnants). - (10) |
| gougneur, s. m. vétérinaire sans diplôme, sorcier souvent sans malice mais non sans crédit, grâce à l'ineffable crédulité des campagnes. - (08) |
| gougoune (à) (loc. adv.) : à califourchon, sur son dos (porter quiqu'un à gougoune) - (64) |
| gouguette. s. f. Escargot. Voulez-vous manger des gouguettes avec moi ? - (10) |
| goui : mot masculin désignant une serpe pour couper des branches - (46) |
| goui : serpe - (51) |
| goui et guisô. : Serpe et serpette. Je crois que ce mot vient du grec, qui signifie une faux. - (06) |
| gouï, s. m., serpe à tailler la vigne ; sans variante de goué. - (40) |
| gouî, s. m., serpette de vigneron. - (14) |
| goui. n. m. - Sorte de serpe à l'usage des bûcherons, utilisée pour la confection de fagots. - (42) |
| gouilla : flaque d'eau. (RDV. T III) - A - (25) |
| gouillafre, et gouliafre, s. m., goinfre, glouton, qui mange par gourmandise. - (14) |
| gouillafre, goulafre. adj. Gourmand, personne qui mange beaucoup et avidemment. (Saint-Martin-sur-Ouanne). - (10) |
| gouillafre, qui mange salement. - (05) |
| gouillai, flaque d'eau. Le même terme s'emploie à Besançon aussi bien qu'à Bourges, où l'on dit en outre se gouiller, pour se crotter, et où l'on appelle un laquais un saute-gouilla. On dit à Châtillon gassouillat pour ruisseau, et gassouiller pour exprimer l'acte d'un enfant qui barbotte dans l'eau... Le mot gargouillai (usité à Châtillon) veut dire fouiller dans l'eau, barboter... - (02) |
| gouillard (n. m.) : mauvais travailleur (syn. gauboulot) - (64) |
| gouillârde (na) : croissant (outil) - (57) |
| gouillarder (v. tr.) : bâcler, saboter un travail (syn. gaubouler) - (64) |
| gouillasse : boue, gadoue - (48) |
| gouillasse : de la boue ; gouille, on dit aussi borbe - (46) |
| gouillasse, bouillasse n.f. Boue. - (63) |
| gouillàt (C.-d., Chal., Y.), gouyat (Br.), goueille, goueillâ (Morv.), gouille (Y., Br.), Gabouille (Char.). - Boue, flaque d'eau, eau bourbeuse ; le verbe gouiller (barboter) existe également. - (15) |
| gouillat : mot masculin pour désigner une flaque d'eau - (46) |
| gouillat : (gouèyâ: - subst. m.) endroit très humide dans un pré, où l'on s'embourbe facilement. - (45) |
| gouillat : s. m., flaque d'eau sale ; ruisseau de ville (voir Saute-gouillat). - (20) |
| gouillat, goïllat n.m. Flaque d'eau boueuse. - (63) |
| gouillat, s. m., flaque d'eau qui reste après la pluie, creux d'eau sale, bourbier : « N' pass' pas dans l’goidllat! » - (14) |
| gouillat. Mare, flaque d'eau boueuse. - (49) |
| gouillat. s. m. Flaque d'eau, petite mare, qui reste dans les rues, dans les chemins, après la pluie. (Bessy). - (10) |
| gouille (d' la) : boue - (57) |
| gouille (d'la) : gadoue (boue) - (57) |
| gouille (nom féminin) : boue. - (47) |
| gouille : boue - (60) |
| gouille : boue liquide. (RDV. T III) - A - (25) |
| gouille : boue, gadoue - (48) |
| gouille : boue. - (29) |
| gouillé : sali, crotté. II, p. 12-15 - (23) |
| goûillé : trempé par une chute dans la boue, sali - (37) |
| gouille, boue - (36) |
| gouille, boue. - (27) |
| gouille, boue. - (28) |
| gouillé, ée. adj. - Sali, crotté. - (42) |
| gouillé, ée. adj. et partic. prés. Sali, crotté. - (10) |
| gouille, gouilla, boue, bourbier ; d'où : gargouille, margouillis. - (05) |
| gouîlle, goûillaisse : boue épaisse - (37) |
| gouille, gouillat. n. f. - Endroit marécageux, trou d'eau boueux. - (42) |
| gouille, s. f. de Gouillat, flaque, boue, sale ruisseau. - (14) |
| gouille. Boue ; gouilla, bourbier. - (03) |
| gouille. s. f. Mare bourbeuse. Voyez gouillat et gouiller. (Perreuse). - (10) |
| gouiller (verbe) : (Se). se vautrer dans la boue. (Se dit d'un porc ou un sanglier qui se roule dans la boue pour se débarrasser des parasites.) - (47) |
| gouiller : salir (par un liquide) - (61) |
| gouiller, goussailler. v. a. Crotter, salir, ablmer, gâter. – Se Gouiller. v. pronom. Se salir, se crotter dans la boue. - (10) |
| gouiller, verbe intransitif : patauger dans la boue. - (54) |
| gouiller. v. - Se salir. S'emploie également dans le sens de détériorer, abîmer. - (42) |
| gouillessou - gouillassou : boueux - (57) |
| gouillet, flaque d'eau sur une route. - (27) |
| gouillet, gouyet : trou d'eau sur un chemin, flaque d’eau. - (66) |
| gouillet, sm. flaque d'eau. - (17) |
| gouillette (pour gouguette). s. f. Limace, escargot. (Festigny). - (10) |
| gouilleux, euse. adj. Qui fait de la mauvaise besogne. - (10) |
| gouillis. s. m. Ouvrage mal fait. Ramassis. (Percey). – Terre détrempée. (Beugnon). - (10) |
| gouillò, s, m. flaque d'eau sur le chemin après la pluie. - (22) |
| gouillot : bouchée - (60) |
| gouillotte, n. fém. ; poche, bourse. - (07) |
| goûilloux : boueux - (48) |
| goûilloûx : boueux, sale - (37) |
| gouilloux. Boueux. - (49) |
| goûillu : n. m. Boueux. - (53) |
| gouin d'âne : Plante sauvage de la famille des pissenlits, qu'on consomme parfois en salade. « Eune salade de gouin d'âne ». - (19) |
| gouine (dans toute la Bourg.). - C'est le mot femme pris en mauvaise part ; une gouine est une femme de mauvaise vie. Ce mot n'est pas absolument bourguignon, il se dit dans le bas langage français… - (15) |
| gouine (na) : poupée (jouet) - (57) |
| gouine : poupée, femme de mauvaise vie - (48) |
| gouine : poupée. (RDM. T IV) - B - (25) |
| gouine : poupée. Vient du celte Gwine : Vénus. - (62) |
| gouine n.f. (v. fr.). Prostituée. - (63) |
| gouine, femme de mauvaises mœurs. - (04) |
| gouine, fille de mauvaise vie... - (02) |
| gouine, n.f. vieille poupée. - (65) |
| gouine, s. f. femme ou fille de mauvaise vie. - (08) |
| gouine, s. f., fille, femme de vie méprisable. - (14) |
| gouine. Femme de mauvaise vie. - (03) |
| gouine. s. f. Femme sale et crapuleuse. - (10) |
| gouine. : Fille de mauvaise vie. Les Anglais ont importé ce mot chez leurs alliés les Bourguignons, au commencement du xve siècle, sous Philippe-le-Bon. Ils écrivent quean et prononcent kouine, ce qui signifie truande. Les Anglais ont un autre mot qu'ils révèrent, qu'ils prononcent de la même manière, mais qu'ils écrivent queen. Ceux qui confondraient les deux expressions, pourraient dire ma reine à la première femme venue. - (06) |
| gouinfré (s') : v. pr. Se goinfrer. - (53) |
| gouingne, sf. femme de mauvaise vie. - (17) |
| gouin-ner, gouain-ner : se plaindre, gémir. - (56) |
| gouisar : une serpe à grand manche - (46) |
| gouisô. Serpette… - (01) |
| gouisòt, s. m., et gouisòte, s. f., serpette de vigneron. - (14) |
| gouisotte : une serpette - (46) |
| gouize (n.f.) : croissant en forme de faucille - (50) |
| gouïze : grosse faucille à grand manche - (39) |
| goujard (un) : une serpe à manche long pour élaguer les haies - (61) |
| goujard : serpe à manche long pour couper les branches, et munie d’un ergot pour les tirer. - (52) |
| goujard : sorte de serpe à long manche pour tailler les haies (volant) - (60) |
| goujard : serpe à manche plus long, plus fort que le voulant et avec un doigt au dos pour tirer les branches coupées. On coupo les épeunes aveuque le goujard : on coupait les épines avec le goujard. - (33) |
| goujard : n. m. Serpe à long manche. - (53) |
| goujard. s. m. Guigne. - (10) |
| goujarlier. s. m. Guignier, arbre qui produit les guignes. (Montillot). - (10) |
| goujat n.m. (v. fr.). Apprenti maçon. - (63) |
| goujat, s. m. manœuvre qui sert les maçons et gâche le mortier. - (08) |
| goujon, s. m., barreau d' une échelle. - (40) |
| goulafrai : s'empiffrer. - (33) |
| goulafre : gourmand (feurlot) - (60) |
| goulafre : gourmand, goinfre. - (56) |
| goulafrer. v. n. Manger beaucoup, s'empifrer. - (10) |
| goulaine : double menton - (39) |
| goulayon : pomme d’Adam - (44) |
| goûle, s. f., gueule. Se dit désobligeamment pour bouche. - (14) |
| goulée, goulerée. s. f. Bouchée, gorgée, gueulée. Du latin gula. - (10) |
| goulée, s. f., gueulée, gorgée, grosse bouchée : « Gare ! si Toinot s'met en coulâre, ô n'f ra d'toi qu'eùne goûlée. » - (14) |
| goulée. Bouchée. - (03) |
| goulère : gorge - (44) |
| goulère, subst. féminin : gorge. - (54) |
| gouleriotte, s. f., petit filet d'eau d'une fontaine (en été). - (40) |
| goulerot : Gouttière par laquelle le vin coule d'un pressoir à grand point. - (19) |
| goulerot, s. m. ouverture, rigole où l'eau s'écoule. - (08) |
| gouleròt, s. m., goulot, ouverture par où l'eau s'écoule, petit canal de pierre pour conduire les eaux. - (14) |
| gouleròte, s. f., pli dans le terrain pour l'écoulement des eaux pluviales. - (14) |
| goulerotte, petit canal, pli de terrain où les eaux s'écoulent. - (08) |
| gouleuriotte : orifice ménagé dans un récipient pour le vider. (RDM. T IV) - B - (25) |
| gouliafre, s. m., qui mange avec excès, sans mesure et avec avidité. - (11) |
| goulifrer : v. n., vx fr. goulafrer, goinfrer. - (20) |
| goulipard. s. m. Goulu, gourmand, qui mange avec avidité. - (10) |
| gouliper. v. a. Manger avidement, goulûment. (Brienon). - (10) |
| goulmée, s. f. gorgée, bouchée, ce qu'on avale d'un seul coup. - (08) |
| goulô, orifice d'une bouteille... - (02) |
| goûlon, gôlon, gueûlon, bouchée ; goûlon d'pèn, bouchée de pain. - (16) |
| goûlon, s. m., même sens que Goûlée. (V. ce dernier mot.) - (14) |
| goulotte : tuyau sans robinet d'où s'écoule quelque chose (eau, argent) au propre comme au figuré. Être sous la goulotte : profiter d'une distribution, d'avantages. On dit aussi : picherotte. - (33) |
| goulotte, s. f., conduite d'eau terminale d'une fontaine ou d'une pompe. - (40) |
| goulotte. n. f. - Petite fenêtre sans vitre : la goulotte d'un poulailler, d'une écurie, etc. - (42) |
| goulotte. s. f. Ruelle couverte, passage étroit, trou, petite fenêtre. La goulotte d'un fenil, d'un grenier à fourrage. – Il existe, à Moneteau, un endroit de la rivière ou le chenal resserre, étroit et rapide, prend le nom de Goulette de Léteau. - (10) |
| goul'rotte : tuyau d'écoulement - (48) |
| goulu ! goulu ! : appel des canards - (39) |
| goulu (nom masculin) : jeune canard. Gourmand. - (47) |
| goulu, s. m. jeune canard ainsi appelé sans doute à cause de son avidité. Pour rassembler leur bande de canards, les femmes crient : goulu ! goulu ! - (08) |
| goulu. adj. Gourmand. Du latin gulosus. - (10) |
| goulu. n. m. - Dindon. - (42) |
| gouluse n.f. et adj. Goulue. - (63) |
| gouluse : adj. f., goulue. - (20) |
| goumé, v. n. lambiner. - (22) |
| goumeau : mélange à base d'oeufs, de lait, de sucre et de farine. C'est une sorte de millet, le millet ayant en plus de la semoule. On dit également coumeau - (46) |
| gounafier : gourmand - (44) |
| gounale, s. f., haricot nain ; lesbienne. - (40) |
| gounalle : fille grande et mince. Ailleurs : robe (gonelle), fille peu dégourdie (godiche), voire haricots aux cosses longues et minces. - (62) |
| gounalle, s.f. poupée mal habillée. - (38) |
| gounasse (n. f.) : goût (ça l'a ni goût ni gounasse (se dit d'un aliment insipide)) - (64) |
| gounéle, s. f., robe, dans le sens peu élégant. Se dit aussi d'une fille mal attifée, sale, effrontée et de conduite équivoque. - (14) |
| gounelle, fille sale, de mauvaise vie. - (05) |
| gouneller, vivre avec des gonnelles. - (05) |
| gouni. s. m. Nom donné par les maçons au maître de la maison ou ils travaillent. (Vertilly). - (10) |
| gouniaude : s. f., soupe au vin. - (20) |
| gouniô, s. m., casanova de village. - (40) |
| gounole : femme peu sérieuse. (B. T IV) - S&L - (25) |
| goupil' n.m. Renard. - (63) |
| goupiller (se). v.- Se trémousser. (Saint-Sauveur, selon M. Jossier) - (42) |
| goupiller. v. n. Se trémousser. (Saint-Sauveur). - (10) |
| gour : creux dans une rivière où l'on peut se baigner - (61) |
| gour, dans le sens de conduit souterrain, destiné à l'écoulement des eaux pluviales et ménagères. - (11) |
| gour, subst. masculin : lavoir. - (54) |
| gour. Mare d'eau malpropre, boueuse. - (49) |
| gourain : Libertin, coureur, débauché. - (19) |
| gourbiner : v. n.. fourmiller, picoler. Ça me gourbine dans les doigts (j'ai les doigts gouras, engourdis). - (20) |
| gourd : doigts engourdis par le froid. - (09) |
| gourd : s. m., endroit d'une rivière où l'eau ne court pas. - (20) |
| gourdalle (un’ne) : frelon. - (62) |
| gourder : v. n., boire à la gourde ; boire un coup (aux bains de Saône). - (20) |
| gourder, v., quêter de l'eau ou du vin. - (40) |
| gourdiflot : bête, stupide. - (56) |
| goure, gore. n. f. - Jeune truie. - (42) |
| gourgandine (courir la). L'expression « courir la gourgandine » veut dire : rechercher les femmes de mauvaise vie. - (49) |
| gourgandine, guergantine, s. f. femme ou fille débauchée, coureuse, prostituée de bas étage. - (08) |
| gourge, sf. gorge. - (17) |
| gourgouillon (on) : charençon - (57) |
| gourguillon : s. m., lat. gurgulio, charançon. - (20) |
| gourguœllion, s. m. charançon de la fève. - (22) |
| gouri : cochon en terme enfantin. A - B - (41) |
| gouri - cochon, mais surtout petit cochon. - Les petiots gouris sont chers en ce manmant qui. - To les gouris que sont lâchai !... Côre don aipré ! - (18) |
| gouri (Chal., Br., Char.), gouret, gourou (C.-d.). – Cochon ; du mot goret, la truie se prononçant treue. Ce mot ne rentre pas dans la catégorie de ceux que nous cherchons à rassembler dans ce recueil et nous ne le citerions pas si Littré ne l'avait donné comme bourguignon. - (15) |
| gouri : Goret, petit cochon. « T'es sale c'ment in ptiet gouri man ami ». - (19) |
| gouri : porcelet - (48) |
| gouri : un cochon (voir aussi couchon) - (46) |
| gouri : porcelet. - (33) |
| gouri petit cochon, goret non sevré (celt. gourig : dernier né, petit bébé) ? - (32) |
| gouri, gori n.m. Cochon. - (63) |
| gouri, gouri, gouri ou gouri, gouri, tchau Cri pour appeler les cochons. - (63) |
| gouri, n. masc ; porc. - (07) |
| gouri, petit porc. - (16) |
| gouri, porc... - (02) |
| goûri, s. m., goret, porc. On emploie volontiers ce mot pour qualifier un enfant sale : « Oh! le p'tiot gouri ! va t'en! » Ce mot sert encore à appeler les pourceaux. - (14) |
| gouri, sm. porc. - (17) |
| gouri, subst. masculin : petit cochon, porcelet. - (54) |
| gouri. Goret, petit cochon, au propre et au figuré, ou simplement cochon. Etym. vieux français goreau, pore, gore, truie. - (12) |
| gouri. Goret, petit porc. Ce mot est employé pour appeler les porcs : « gouri ! gouri ! ». - (49) |
| gouri. Porc, du vieux mot goret. - (03) |
| gouri. s. m. Cochon, goret. - (10) |
| gourichon, gorin n.m. Brûlé. - (63) |
| gourichonner v. Griller, roussir. Syn. de beûçi, frrilli. - (63) |
| gourier. s. m. Gosier. (Domecy-sur-le-Vault). - (10) |
| gourillon. s. m. Morceau de bûche coupée ou cassé. De goué, serpe, et billon, petite bille, petit rondin de bois. Sur les ports de la Haute-Yonne, lorsqu'on fait l'extraction des bois de flot, les goubillons sont attribués aux hommes qui travaillent à cette opération. - (10) |
| gourin : odeur de corne ou de poil brûlé apparue lorsque le cochon (= gouri) est beuchi*. A - B - (41) |
| gourin : s. m., vx fr. goron et gorin, cochon. - (20) |
| gourin, adj. et s. m. libertin, lubrique (du vieux français gorin, porc). - (24) |
| gourin, adj. et s. m. libertin, lubrique. - (22) |
| goûrin, adj., coureur, vagabond, libertin. - (14) |
| gourin, gourine : adj., personne débauchée. - (20) |
| gourin, s. m., homme sexuellement brutal. - (40) |
| gourin, subst. masculin : cochon adulte. Au sens figuré, homme coureur de jupons. - (54) |
| gourin. Synonyme de Goret. (Voyez ce mot.) - (13) |
| gouriné : qui a subi une brûlure. A - B - (41) |
| gouriner : v. n., se conduire en gourin. - (20) |
| gouriner, v. intr., vagabonder, rôder, libertiner. - (14) |
| gouriner, v., faire l'amour brutalement. - (40) |
| gourion, guerlon. n. m. - Bourdon. - (42) |
| gourlasson (nom masculin) : bourse qui se portait autrefois à la ceinture sous les cotillons. - (47) |
| gourlasson, s. m. grande poche de toile. Les femmes de la campagne ont souvent sous leur robe deux « gourlassons » retenus par une ceinture. - (08) |
| gourle : une guêpe (voir : gourlon). - (56) |
| gourlée : enflure qui vient sous la mâchoire du mouton - (60) |
| gourlis. Courlis. Fig. Savetier et par extension, cordonnier. - (49) |
| gourlon : bourdon. IV, p. 27 - (23) |
| gourlon : frelon - (60) |
| gourlon : bourdon (insecte volant) de couleur noire et au vol lourd. Inoffensif. - (58) |
| gourlon, gorlon, s. m. bourdon, insecte. - (08) |
| gourlon. s. m. Frelon, grosse mouche qui fait son nid dans un trou de souris, dans les champs, et qui produit un miel assez doux. De gorle, trou. (Perreuse, Saint-Sauveur). - (10) |
| gourlon-lombard, lombard : frelon. (On dit aussi "arcier", voir ce mot). Piqûre redoutée. Ex : "J'ons un nid d'lombard dans l'guernier !" - (58) |
| gourlonner, gourlouner. v. n. Fredonner, bourdonner comme un frêlon, comme un gourlon. (Etais). - (10) |
| gourlouner : bourdonner (comme un gourlon) . Figuré : parler seul en marmonnant. Ex .1 - "T'entends-t-y les guèpes goulouner su ta confiture ?" (On ne dit pas guèpe, on dit guépe) Ex. 2 - "Qu'ès t'as don à gourlouner coum' ça". - (58) |
| gourlouner, gorloner, v. a. bourdonner à la manière du bourdon; chanter tout bas sans prononcer de paroles : fredonner. - (08) |
| gourlouner, gourlonner. v. - Fredonner, marmonner. - (42) |
| gourlu (n. m.) : courlis - (64) |
| gourman : mauvaise pousse - (44) |
| gourmand, n.m. mauvaise pousse de la vigne, celle qu'il faut tailler. - (65) |
| gourmanderie. Gourmandise, friandise. - (49) |
| gourme, s. m. gros bout des tiges coupées de blé ou d'avoine. - (22) |
| gournaille : grenouille. - (62) |
| gourot, s. m., lavoir sur la rivière. - (40) |
| gourrain, libertin, sale comme cochon. - (05) |
| gourratier, marchand de cochons. - (05) |
| gourrer (Se) : v. r., vx fr. gorrer (se), s'habiller. Voir dégourrer (Se). - (20) |
| goûrri : petit cochon - (37) |
| gourri, gourin. n. m. - Porcelet qui tète encore sa mère. - (42) |
| goûrrin : cochon adulte - (37) |
| goûrrin : homme « coureur de jupons », « ne pensant qu’à ça » - (37) |
| gourriner, libertiner, vivre en gourrain. - (05) |
| goursailler. v. - Gaspiller, gâcher, souiller. (Perreuse, selon M. Jossier) - (42) |
| goursailler. v. a. Gaspiller, gâter, salir, souiller, cochonner. De goure, truie. (Perreuse). - (10) |
| gourter, v. a. bousculer quelqu'un, prendre au collet en poussant ; entraîner par force un animal qui regimbe. - (08) |
| goûs (n.m.pl.) : gousses de légumineuses (aussi haricots verts) - (50) |
| gousi (on) : gosier - (57) |
| gousié, s. m. gosier, gorge. - (08) |
| goûsier (n.m.) : gosier - (50) |
| goûsier : Gosier. « O n'a pas le goûsier teurdu » : il n'a pas le gosier tordu, il avale bien un verre de vin. « Avoir mau au goûsier » : avoir mal à la gorge. - (19) |
| goûsier, s m., gosier. D'un qui mange dru : « Ah! le boufre ! ôl a eun rude gousier ! » - (14) |
| gousier, sm. gosier. - (17) |
| gousier. Gosier. Vient du vieux français. On retrouve ce mot dans Gargantua. - (49) |
| gouspain. s. m. Gamin, polisson, mangeux de pain pardu. (Puysaie). - (10) |
| gouspiller (se), s'arranger. Ex.: comment ça se gouspille. (Sens péjoratif, implique un doute sur la régularité de l'arrangement). - (27) |
| gouspin. n. m. - Gamin, polisson. (M. Jossier, p. 76) - (42) |
| goussai. Gousset. Ce mot qui signifie plusieurs choses, est pris ici pour odeur d'aisselle puante. Nos étymologistes ont cherché avec beaucoup de peine l’origine de gousset dans celte signification. Rien n'était plus facile à trouver. Ce morceau de toile nommé gousset, qui sert à faire tenir le corps de la chemise avec la manche à l'endroit de l'aisselle, ne pouvant manquer de contracter l'odeur de cette aisselle qui touche, on a dit de là sentir le gousset pour exhaler une odeur semblable à celle qu'exhale ce gousset… - (01) |
| gousser, v. n. porter des gousses, des cosses. - (08) |
| goussiau. s. m. Insecte qui naît et vit dans les lentilles. (Cessy). - (10) |
| gousso, gousset, petite poche. - (16) |
| goustré : habillé sans goût, mal fagoté. (RDV. T III) - A - (25) |
| goût (avoir du). exp. verb. - Avoir du plaisir, être content : « J'ai passé la jagraphie, l'histoire, j'ai bien répondu, ah ! Que j'ai du goût !» (Colette, Claudine à l'école, p.l21) - (42) |
| goût (on) : odeur - (57) |
| goût : Gros rat, rat d'égout. - Odeur. « Y sint in dreule de goût » :ça sent un drôle de goût (ça pue !). - (19) |
| gout : s. m., rat d'égout. - (20) |
| goût, s. m., odeur : « Queû drôle de goût qu'ça sent por iqui ! » - (14) |
| goutable (goûtable) : adj., vx fr. goustable, en état d'être goûté. - (20) |
| goûtè : déjeuner (repas de midi) - (48) |
| goutelion (goûtelion), s. m., goûter, casse-croûte. - (20) |
| goutelionner (goûtelionner) : v. n., faire un goûtelion. - (20) |
| goûter (l’) : (le) repas de midi - (37) |
| goûter (nom masculin) : repas de midi. - (47) |
| goûter (nom) : diner - (51) |
| goûter (verbe) : diner - (51) |
| goûter : (nm) repas - (35) |
| goûter : manger - (61) |
| goûter : repas de-midi - (43) |
| goûter : (gou:tè - v. intr.) prendre le repas de midi. Vin: gou:tè! "A table!" (viens manger). - (45) |
| goûter : déjeuner, c'est-à-dire repas de midi. Ex "Te vins-t-y goûter ben tou ?" (Ben tooou = bientôt). Ex "J't'attendons d'main pour goûter". - (58) |
| goûter, n.m. repas du midi. - (65) |
| gouti, v. n. se dit d'un pain qui n'est pas assez cuit et qui forme pâte à la surface. - (08) |
| goutro : une goutte d'eau qui tombe du chéneau - (46) |
| goutrot : dessus du mur sur lequel repose la sablière - (48) |
| gou-tsapé : loir, lérot - (43) |
| goutt' : n. f. Goutte. - (53) |
| gouttailler : v. n., tomber des gouttes de pluie. Y va gouttaiiler comm’ ça tout' la nuit. - (20) |
| goutte (nom féminin) : alcool provenant de la distillation traditionnelle des fruits ou du marc de raisin. (Z’allez ben bouère un’ ch’tit’ goutte, ça vous réchauffera). - (47) |
| goutte : alcool de fruits distillés - (43) |
| goutte : Eau de vie de marc. « Fare la goutte » : distiller le marc de la récolte. - « Les vignerans beuvant leu ptiète goutte le métin devant (avant) de s'en aller traveilli ». « La machine à goutte » l'alambic. - (19) |
| goutte : eau de vie - (48) |
| goutte : eau-de-vie de fruits distillés - (37) |
| goutte, gotte n.f. Eau-de-vie, niôle. - (63) |
| goutte, s. f., eau de vie de marc de raisin. - (40) |
| gouttereau, s. m. muraille de façade qui relie les pignons d'une maison. - (08) |
| gouttes : s. f. plur., goutte (maladie). - (20) |
| gouttire (na) : gouttière - (57) |
| gouvanée. Gouvernée, gouvernées. - (01) |
| gouvarner : Conduire. « O ne sait pas se gouvarner » : il n'a pas une conduite régulière. - (19) |
| gouvernance : s. f., vx fr. governance, gouvernement ; manière de gouverner une maison. En s' mariant il est bien tombé ; il a trouvé une bonne gouvernance. - (20) |
| gouya, s. m. serpe à long manche pour élaguer. - (22) |
| gouyâ. Flaque d'eau boueuse. Etym. comparez le breton gouyan, mauvaise saison, hiver, temps boueux. - (12) |
| gouyàfre (C.-d., Chal.), gouliafre, galafre (Br.), goulafre (Y.). - Goinfre, glouton. Corruption du mot goulu, qui vient lui-même de gulosus, formé par gula. Il existe aussi le verbe goulafrer (bâfrer, s'empifrer). - (15) |
| gouyard (n.m.) : serpe à long manche pour tailler les haies - (50) |
| gouyard (nom masculin) : sorte de serpe à long manche dont on se sert pour entretenir les haies. - (47) |
| gouyard : croissant, vonge : outil à main à manche long pour élagage des haies (« pour râpage des boûchûres ») - (37) |
| gouyé*, v. n. flirter. - (22) |
| goûye, boue ; goûya, amas de boue. - (16) |
| gouyet (m), flaque d'eau. - (26) |
| gouyi, v. n. gêner par l'adhérence de la terre mouillée collant à l'outil. - (24) |
| gouyœt’e, s. f. serpette à vendanger. - (22) |
| gouyot : petit morceau - (60) |
| gouzette : serpette, petit vouge. - (32) |
| gouzeute, serpette de vigneron. - (27) |
| gouzote, serpette. - (16) |
| gouzotte - petite serpette pour tailler la vigne, les arbres. - Lai gouzotte â le moillou des utis pour teiller lai vigne pu proprement. - Le sécateur aivoinge joliment pu que lai gouzotte. - (18) |
| gouzotte, s. f., serpe de vigneron (à deux tranchants). - (40) |
| gouzotte, serpette. - (28) |
| gôvarner, v. tr., gouverner, diriger. - (14) |
| govèrnement n.m. 1.Gouvernement. 2. Epouse autoritaire. - (63) |
| govillé, vt. même sens que gonné. - (17) |
| govillon, sm. ouvrage mal fait. - (17) |
| goy : s. m., vx f., goi, espèce de hache dont la lame est de forme carrée et le manche de la longueur d'une poignée ordinaire. Le goy sert dans Ies boucheries et dans les ménages à différents usages. — Goy coudé, outil de tonnellerie. - (20) |
| goy, homme sale et puant. - (05) |
| goya (voudze) : vouge - (51) |
| göya : (nm) flaque « un gôÿâ d’jau » : une flaque d’eau - (35) |
| göyâ : (nm) serpe à long manche - (35) |
| goyair : goyard, volant, vonge - (48) |
| goyaix, n. masc ; serpe à long manche. - (07) |
| goyar, s. m. espèce de volan ou de vouge. - (08) |
| goyard : croissant pour émonder les arbres. Le goyard servait d’arme au Moyen-âge. Du bas latin gubia. Voir vauge. - (62) |
| goyard : s. m., vx fr. goiard, goyarde à long manche. - (20) |
| goyard, goyon n.m. Grande serpe courbe à long manche, voudze. - (63) |
| goyard, grosse serpe à long manche. - (05) |
| goyarde : s. f., goy dont l'extrémité est recourbée en forme de serpe. Sert à tailler les arbres. - (20) |
| goyarde, serpe en forme de faucille. - (05) |
| gôyas : endroit boueux - (39) |
| gòyat, s. m. 1. serpe à long manche pour élaguer (du vieux français gouet, gouart). — 2. Flaque d'eau après la pluie. - (24) |
| goye : ballon de foot dégonflé - (44) |
| gôye : boue - (39) |
| go-ye, s. m., pousse de bois ou de haricot. - (40) |
| goyet : flaque d’eau. - (21) |
| goyette : croissant à long manche servant à râper* (= tailler) les buissons. A - B - (41) |
| göyette : (nf) petite serpe emmanchée - (35) |
| goyette : croissant, serpe à grand manche, servant à tailler les haies - (34) |
| goyette n.f. (lat. gubia, serpe). Serpette pour la vigne. - (63) |
| goyette : s. f., serpette à manche fixe. - (20) |
| goyette. Petite serpe. - (49) |
| goyeute : tirelire. - (66) |
| goyeutte (f), porte-monnaie. - (26) |
| goyon (ö), sm. femme mal habillée, malpropre. - (17) |
| goyon : serpe - (34) |
| goyon : serpe à petit manche - (43) |
| goyon, goyard n.m. (lat. gubia, serpe). Croissant à long manche. Voir voudze. - (63) |
| goyöte (ö), sf. petit sac; bourse, trésor caché. - (17) |
| goyôte (prononcez goyeute), bourse. - (02) |
| goyòte, s. f., poche, bourse, gousset. - (14) |
| goyôte. : Bourse. - (06) |
| goyotte - expression familière pour dire bourse. - Laiche lai fâre vais, ile é lai goyotte bein gairnie. - Pôre goyotte, ile é le vente bein plat ! - (18) |
| goyotte . Poche de vêtement. Par extension : bourse. Les Dijonnais prononcent goyôte. - (13) |
| goyotte : bourse - (44) |
| goyotte : bourse. (C. T III) - B - (25) |
| goyotte : porte-monnaie, bourse, portefeuille - (37) |
| goyotte en piau d’heûrchon : porte-monnaie des gens avares - (37) |
| goyotte. Bourse. « Avoir une bonne goyotte » c'est être riche. - (49) |
| gozanche : voir gadanche - (21) |
| gôze; s. f. motte de terre dure. - (22) |
| gr’naude : grenouille. (C. T IV) - S&L - (25) |
| grâ de paille : paillasse rembourrée avec des feuilles de panouilles de maïs. A - B - (41) |
| gra de paille : paillasse rembourrée avec des feuilles de maïs - (34) |
| grabeu : petit corps étranger pénétrant dans l'œil. A - B - (41) |
| grabeû : (nm) grain de poussière - (35) |
| grabeu : corps étranger dans l'œil - (44) |
| grabeu : petite saleté, impureté - (51) |
| grabeu : poussière dans un œil, faisant pleurer - (43) |
| grabeu n.m. (v. fr. grabeler, passer au cribe). Chassie, poussière dans l'oeil. Voir bite. - (63) |
| grabeuter : Gratter, remuer. « J'entends grabeuter au geurné » : j'entends remuer au grenier. - (19) |
| grabeux : poussière dans un œil et faisant pleurer - (34) |
| grabot n.m. Personne qui fait un travail inutile. - (63) |
| grabot, grabeut : s. m., bas-lat. grabotum, petit corps étranger donnant le besoin de se gratter, et, par extension, ce besoin lui-même. Avoir un grabot dans l'œil. - (20) |
| graboter : se dit du grattement d'un animal. (VSLD. T II) - S&L - (25) |
| graboter : toucher sans geste brusque, chatouiller - (51) |
| graboter v. 1. Gratter. 2. Travailler inutilement. Voir grabeu. - (63) |
| graboter, v. a. gratter superficiellement. - (24) |
| graboter, v. gratter, tisonner, gratter doucement avec les ongles. - (65) |
| graboter, v. tr., retourner le bois, attiser le feu dans le poêle. — Greùbe voulant dire : bûche, ne serait-ce pas greùboter ? - (14) |
| graboter, v., gratter avec les ongles, - (40) |
| graboteux, -euse adj. Rugueux, poussiéreux. - (63) |
| grabotter : (vb) gratter, fureter - (35) |
| grabotter : bricoler, gratter - (34) |
| grabotter : gratter, fureter - (43) |
| grabotter : v. a., gratter, remuer. - (20) |
| grabotton : s. m., personne qui grabotte. - (20) |
| grabouté, v. a. gratter superficiellement. - (22) |
| graceler. v. n. Grassayer ; parler entre ses dents, de manière à n'être pas compris. (Etivey). - (10) |
| grâcer, v. a. gracier, faire grâce : il m'a « grâcé » de cette dette ; ah, « grâcez-le » de venir ici. - (08) |
| grâces (faire des), loc, faire la coquette, l'aimable. - (14) |
| gracieux : de bonne humeur - (61) |
| gracieux : s. m., gracieuseté. - (20) |
| grade : s. m., charge, emploi, fonction. - (20) |
| graelle. n. f. - Petit caillé du lait. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| grâfan : Greffon, bourgeon ou jeune rameau de vigne ou d'arbre destiné à être greffé sur un sujet. - (19) |
| grâfe : Greffe. « Fare des grâfes » : greffer des plants de vigne française sur un plant américain. - (19) |
| grâfer : Greffer d'une façon générale et principalement greffer de la vigne ; en parlant de toute autre greffe on dit de préférence : enter. - (19) |
| grafer, v. tr., agrafer : « Eh! p'tiote, v'tu m'grafer ma robe ? J'en peu pas v'nî à bout. » - (14) |
| graffigner (verbe) : griffer. - (47) |
| graffigner. v. a. Egratigner. - (10) |
| graffiner : gratter légèrement. - (56) |
| grafigner : egratigner - (60) |
| grafigner, grafiner : v. a., vx fr. grafigner, égratigner. Voir égrafigner, égrafiner. - (20) |
| grafigner, v. griffer, pour parler des animaux (chat) ou des plantes (ronces). - (65) |
| grafigner. v. - Égratigner. Mot directement issu de l'ancien français grafigner, égratigner ou griffer. L'origine grécolatine (graphium, poinçon pour écrire) se retrouve aujourd'hui dans le mot graffiti. - (42) |
| gràfiner (C.-d., Chal.), greffigner (Y., Br.), égrafiner (C.-d, Morv .). - Egratigner, du vieux français graphiner, venant du bas latin sgrafignare, dont le radical est le grec graphein, écrire. C'est de là que vient le mot aigrefin, et non pas de faim aigre, comme le dit Littré : on devrait, d'ailleurs, écrire : égrefin. - (15) |
| grâfoux : Greffeur. - (19) |
| gragelé, vn. caqueter : se dit des poules. - (17) |
| grageler, caqueter. - (26) |
| grai : gras. - (33) |
| grai. Gré. - (01) |
| graibeûille : long tisonnier en fer, employé par le mécanicien de la machine à battre pour remuer le foyer de la « chaudière » - (37) |
| graibeûiller : procéder à cette opération, « piquer le feu » - (37) |
| graibeûiller : rechercher, remuer des affaires - (37) |
| graibuge - voyez gribuge. - (18) |
| graibuge. Grabuge, discorde, querelle. Grabuge, qu'on croit vieux dans notre langue, n'y était pas connu il y a cent ans. - (01) |
| graice. Grâce, grâces. - (01) |
| graiche - (39) |
| graiche (n.f.) : graisse - (50) |
| graiche : graisse - (48) |
| graiche : Graisse. « De la graiche blianche » : du saindoux. « De la mauvâse graiche » : de la boursouflure. « I simb'lle qu'ol est gras mâ y est de la mauvâse graiche ». « Se pliaindre de graiche » : se plaindre à tort, se plaindre que la mariée est trop belle. - « De la graiche de bavoux » : de la salive. - (19) |
| graîche d’ouaie : flatterie exagérée - (37) |
| graiche, s. f. graisse, fumier, engrais, ce qui engraisse, fertilise. - (08) |
| graicher : graisser - (48) |
| graicher : graisser - (39) |
| graicher, v. a. graisser, se servir de graisse : « graicher » une voiture. - (08) |
| graichi v. Graisser. - (63) |
| graichot, ote, adj. un peu gras, grassouillet. - (08) |
| graicieux (-euse) (adj.m. ou f.) : de bonne humeur, content (-e) - (50) |
| graignatte (pour grignotte). s. f. Petite quantité, un brin, une miette. (Plessis-Saint-Jean). - (10) |
| graigne ou greigne. : (Pat.), gringne, (dial.) triste, chagrin, maussade. - En Bourgogne comme dans l'Ile-de-France, graigne ou gringne signifiaient : de chétive apparence. - (06) |
| graigne, greigne et grigne, triste, maussade, chagrin ; et grignenie, tristesse... - (02) |
| graigne: graine - (48) |
| graillé (se), vt. se rouler au soleil. - (17) |
| graille n.f. Dépôt du vin sur les parois des fûts. - (63) |
| graille : s. f., dépôt du vin sur les parois des fûts. - (20) |
| grailler (se), s'étirer au lit. - (28) |
| grailler : manger - (44) |
| grailler, v. n. grasseyer, parler gras. - (08) |
| graillon, subst. masculin : crachat. - (54) |
| graillonner, verbe intransitif : cracher. - (54) |
| graillonou : graisseux - (44) |
| graillouner, v. n. bégayer, parler peu distinctement. Se dit d'un petit enfant qui commence à parler. - (08) |
| graillounies. n. f. pl. - Graillons, mauvaise cuisine : « On mange pas cheux eux des graillounies ni d'la lavasse de ratatouille. » (Fernand Clas, p.226) - (42) |
| graillounonde : mets lourd et gras, de peu de qualité, mais destiné à apaiser la faim. - (62) |
| graimenter (v.t., v.pr.) : se lamenter, se plaindre (a.fr., gaimenter) - (50) |
| grain : Grain. « In sa de grain ». - (19) |
| grain d'cul : n. m. Cynorrhodon. - (53) |
| grain de sel. Tatillon, qui fourre son nez partout et met son grain de sel dans tous les plats ; embarras de cuisine ! - (12) |
| grain d'orze : bouton au coin des yeux - (39) |
| grain : s. m. grain. - (21) |
| grain : s. m., ancienne mesure de poids, correspondant au 1/8 du scrupule et valant 0 gramme 053. - (20) |
| grainche - difficile d'humeur, de manières. - Al é don un caractère grainche !... C'à gros demaige. - Tâche don de corrigeai ton air grainchou. - (18) |
| graing (n.m.) : grain - (50) |
| graing : grain - (39) |
| grainge (na) : grange - (57) |
| grainge, s. f., grange. - (14) |
| grainge. Grange, granges. - (01) |
| grainger, s. m., métayer qui exploite une propriété rurale. - (14) |
| graingne, adj. grognon. - (17) |
| graingne, s. f. grain, graine : « a i é chérantie seur lai graingne. » - (08) |
| graingne. s. f. Graine. Des graingnes de luzarne et de sainfoingne.(Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| grainguenaudes. : Bribes. (Del.) - (06) |
| grainguenotai, fredonner. On dit en Bourgogne : Lé rossignô grainguenôte. - (02) |
| grainjons, et grinjons, s. m., petits joncs, oseraies qui poussent au long des rivières, et dont sont garnis les bords des Ilons et du Petit-Doubs. - (14) |
| graîn-ne (na) : graine - (57) |
| grain-ne : n. f. Graine. - (53) |
| grain-ni, pol : coq - (43) |
| grains « rwé » : qui se détachent mal au battage. (B. T II) - B - (25) |
| graipe, sf. grappe. - (17) |
| graipeignan. Grapignan, nom d'un jeune procureur avide et fripon, introduit en diverses scènes françaises de la Matrone d'Ephèse, comédie italienne. De là tous les fripons de cette espèce, recouvreurs de dettes, gabeleurs et autres maltotiers, peuvent être nommés Grapignans. - (01) |
| graipichot : montée, raidillon - (48) |
| graipin - petite fourche de fer pour arranger le feu. - Prends voué le graipin pou remuai le feu. - Teins pliaice le graipin vé lai polie et les pincettes à coin de lai chevenée. - (18) |
| graipin : tisonnier. - (31) |
| graipin, s. m. grappin, croc. (Voir : grifon.) - (08) |
| graipin, s. m., grappin, tisonnier : « Là vou donc c'é qu't'as foré l'graipin du poêle ? » - (14) |
| graipin, sm. talus très raide, « coup de cul ». - (17) |
| graipiner, v. a. cueillir, arracher l'herbe avec force et vivacité. - (08) |
| graipissot : montée - (39) |
| graippin : grappin (crochet à 3 branches) - (48) |
| graip'ter : grapiller. - (31) |
| graisse : graisse du fumier = ses éléments fertilisants. VI, p. 42-16 - (23) |
| graisse : s. f., se plaindre de graisse, se plaindre d'un mal alors qu'on jouit manifestement du bien opposé. Ex. : un « nouveau riche » qui parle de sa pauvreté ; un individu qui « pète de santé » et qui se dit toujours malade. - (20) |
| graissé. Graisser. « Quan lai Mor vénré graissé no bôte », quand la Mort viendra graisser nos bottes pour le dernier voyage. Le peuple, sans y penser à mal, tire cette façon de parler. - (01) |
| graissée. n. f. - Tartine de beurre, de confiture, etc. (Sommecaise, selon M. Jossier) - (42) |
| graissée. s. f. Tartine de beurre, de confiture ou autre chose semblable. (Sommecaise). - (10) |
| graisser : v. a., le ciel se graissé, le ciel s'embrume, blanchit, ou moutonne légèrement. - (20) |
| graissi : graisser - (43) |
| graissou, adj. crasseux. Avare. - (17) |
| graitan. Gratan. - (01) |
| graite, s. f. grate, gale, démangeaison. - (08) |
| graiteûiller : gratter à plusieurs reprises - (37) |
| graitillon, s. m. chatouillement, démangeaison. Avoir le « graitillon «, signifie quelquefois avoir la gale, mais ne sous-entend le plus généralement qu'un mal passager. - (08) |
| graiton : rillon. - (31) |
| graitté, vt. gratter. - (17) |
| graitte-cul : églantier, fruit de l'églantier (cynorhodon) - (48) |
| graitte-cul : fruit de l’églantier - (37) |
| graitte-cul. Baie de l'églantier ; on l'appelait autrefois boton et bouton... Les graittes-culs et les peunelles sont les derniers fruits de l’année... - (13) |
| graitter : gratter - (48) |
| graitter lai couenne (s’) : (se) raser - (37) |
| graivalle : gravelle, petit caillou - (48) |
| graive, s. f. entaille, rainure faite avec une pointe, et surtout avec l'instrument appelé bouvet, parce que l'outil, dans la raie qu'il creuse, ressemble à un petit bœuf dans son sillon. - (08) |
| graive. Grève, grèves, l'os du devant de là jambe. Graiveire, blessure qu'on se fait quand on vient à se heurter en cet endroit. - (01) |
| graivelle (lai) : forêt près d’onlay - (37) |
| graivelle : petit caillou - (37) |
| graivelle : gravelle, gravier - (39) |
| graivelon, frelon, grosse guêpe, homme méchant. - (27) |
| graivelou : se dit d'un chemin gravillonneux ou de fruits grumeleux - (39) |
| graiveman. Gravement. - (01) |
| graiver, v. a. creuser en général, et en particulier creuser avec le bouvet. - (08) |
| graiveule, femme méchante. - (27) |
| graiveulon, sm. petit gravier. Sobriquet des gens de Minot habitant le « mont », par opposition aux « Craipaus des Vaux ». - (17) |
| graivi. Gravi, grimpé, gravir, grimper. - (01) |
| graivicher (v.t.) : monter en faisant des efforts (de Chambure note : gravicher) - (50) |
| graivichot (n.m.) : 1) petite montée (de Chambure note : gravichat) - 2) lierre (pour de Chambure : gravissot) - (50) |
| graivilleau : raidillon. - (66) |
| graiv'lou : graveleux - (48) |
| graivole - grain de gravier, petite pierre gravelée. - Vos pourrains passai ceute terre qui qu'à pliaine de graivoles que vos mettrain dans l'ailée de vote jairdin. - En y é ine graivole dans mon soulé, en faut qui l'ôtâ. - (18) |
| graivolle : n. f. Gravelle. - (53) |
| graivolon - tout petit grain de gravier, petit objet dur que l'on trouve sous la dent en mangeant. Enfant chétif. Espèce de guêpe. - En mégeant de lai salade i ai trouvai in graivolon que m'é fait chouer in bout de dent. - I sens in graivolon dans mon bas. - Pôre petiot graivolon, vais ! - Les graivolons, c'â des guêpes méchantes. - (18) |
| graivonné, vt. gratter le sable. - (17) |
| graivoûter : gratter - (48) |
| graiyon*, s. m. petit seau. - (22) |
| grâle : Grêle. « Eune beurée de grâle » : un orage accompagné de grêle. - Grêlon. « I cheuyait des greusses grâles » : il tombait de gros grêlons. – « Ol est mauvâ c'ment la grâle » : il est très méchant, redoutable comme la grêle. - (19) |
| grâler : Grêler. « Vla eune vilain-ne beurée (un vilain orage) i pourrait bin grâler ». - « Etre grâle » être marqué par la petite vérole. « O ne sarait pas enco bien peut si o n'était pas si grâlé » : il ne serait pas encore trop laid s'il n'était pas si marqué par la petite vérole. - (19) |
| grallé. Trembler, greloter de froid. Grullé est aussi infinitif. - (01) |
| grambotte (faire). Donner à quelqu'un un coup de genou sur la jambe, par derrière, généralement dans le jarret, ce qui fait souvent tomber celui qui le reçoit. Etym. crampi, vieux français, courbe, crochu, plie ; quand on fait grambotte, les jambes se replient. - (12) |
| gramole : (nf) chiendent - (35) |
| gramole : chiendent - (43) |
| gramole : s. f., mauvaises herbes et spécialement le chiendent. - (20) |
| gramoler, égramoler : v. a., bas-lat. grammulare, enlever la gramole, sarcler. - (20) |
| gran. Grand. Gran singulier et pluriel devant tout substantif, même féminin commençant par une consonne. Grant singulier et pluriel devant une voyelle. - (01) |
| grance. : Dette d'une chose achetée à crédit. Faire grance c'était faire crédit, charte de 1229. - (06) |
| granci ou grinci : Gronder, montrer les dents. « Son chin (chien) m'a granci j'ai bin crayu (cru) qu'ol allait me meudre (me mordre) ». - (19) |
| grand (ma) : grand-mère - (57) |
| grand (mon) : grand-père - (57) |
| grand , aïeul, grand-père. - (05) |
| grand : Aïeul, aïeule. « Man grand » mon grand-père. « J'y ai bin toje entendu dire à ma grand » : je l'ai toujours entendu dire par ma grand-mère. - (19) |
| grand coup (a), loc. moissonner, par exemple, « à grand coup » signifie faire ce travail d'une manière continue et à l'exclusion de tout autre. - (24) |
| grand fait (y a), loc. c'est bien sûr. - (24) |
| grand lardze : grande ouverte - (43) |
| grand neit loc. Nuit noire. - (63) |
| grand onsc'ille (on) : grand-oncle - (57) |
| grand pecaule*, s. f. tintement annonçant le commencement de la messe. - (22) |
| grand vent : (nm) vent fort soufflant du sud, aussi appelé « vent de la pyou » - (35) |
| grand' : adj. f. et n. f. Grande. - (53) |
| grand : s. m., grand-père. - (20) |
| grand, s. m. ou f. grand-père ou grand-mère : mon grand ou ma grand. - (22) |
| grand, s. m. ou f. grand-père ou grand-mère : mon grand ou ma grand. - (24) |
| grand, s. m., et grand', s. f. : « Mon grand, ma grand' » s'emploient elliptiquement pour : mon grand-père, ma grand'mère. - (14) |
| grand’ : s. f., grand-mère. - (20) |
| grand'bonne heure (De) : Ioc. adv., de grand matin. - (20) |
| grand-chouse : grand-chose - (57) |
| grande : Guêpe. « Dépichi in nid de grandes » : détruire un guêpier. - Guimbarde, sorte de jouet, petit instrument qu'on tient entre les lèvres et qui est pourvu d'une languette d'acier que l'on fait vibrer avec le doigt. - (19) |
| grandent (fare les) : porter, manger, posséder quelque chose ostensiblement pour tester quelqu'un beaucoup moins pourvu. (RDM. T IV) - B - (25) |
| grandes dents : (avoir ou donner les) Avoir les dents agacées subitement. Ex : "Qand té passes ton coutiau sul’ vérre, té m’dounes les grand dents". - (58) |
| grandi - frogi – profiter : grandir - (57) |
| grandi. v. - Grandir. - (42) |
| grand-mur (Le) : nom qu'on donne à Mâcon au mur de soutènement des terrains de la Compagnie P.-L.-M., rue Bigonnet. J'ai passé par le Grand-Mur pour aller à Saint-Clément, et puis je suis revenu par les Marans. - (20) |
| grandou : grandeur - (43) |
| grandou : Grandeur « Qu'est maître est maître, la grandou n'y fa ren ». - (19) |
| grands cœurs, s. m., fils de chanvre de la première finesse. - (14) |
| grandze : (nf) grange - (35) |
| grandze : grange - (43) |
| grandze : grange - (51) |
| grandze n.f. Grange. - (63) |
| grandzi : métayer. A - B - (41) |
| grandzi : métayer - (34) |
| grandzi : métayer - (43) |
| graneziau. s. m. Vairon, petit poisson de rivière. (Courgis). - (10) |
| grangi : Métayer, celui qui cultive une propriété à moitié fruits. - (19) |
| granmaire (n.f.) : grammaire - (50) |
| granmaire, s. f. grammaire. - (08) |
| granment, adv. grandement, beaucoup : tu t'es « granment » trompé, mon garçon. - (08) |
| gran'ment, adv., grandement. - (14) |
| granmerci ! les anciens ne disent jamais : merci, tout court. Granmerci ke, grâce à ce que... - (16) |
| grante - pour grande; assez fréquemment employé. – Oh ma lai Pierrette, ç'â déji ine grante feille. - Ine grante ovrére. - (18) |
| granti, vn. grandir. - (17) |
| granzale : Groseille. « Des greusses granzales » : des groseilles à maquereau, ribes grossularia. « Des ptiètes granzales », ribes rubrum, « Des granzales de dames » des petites groseilles blanches. - (19) |
| granzalé : Groseillier, ribes. « Ol a plianté des granzalés ». - (19) |
| granzaller : groseillier. D’où le fruit : la granzalle. - (62) |
| granze (n.f.) : grange - (50) |
| grap’ner : (vb) passer au croc à fumier - (35) |
| grape*, s. f. petite fourche à attiser le feu. - (22) |
| grapé, grappiller, cueillir les raisins échappés aux vendangeurs. - (16) |
| grape, s. f. petite fourche à attiser le feu (vieux français). - (24) |
| grape, s. f., ustensile en fer, à trois dents courbes, pour la pêche. - (14) |
| grapegni, v. a. gratter en sourdine, ou faiblement et patiemment. - (24) |
| grapegni, v. a. gratter en sourdine. - (22) |
| grapeneuse : extirpateur, déchaumeuse - (43) |
| grâpiai : crêpe au lard - (48) |
| grapiau (Mhère) ou crapiau (Brassy) : crêpe au lard. - (52) |
| grâpiau (n.m.) : galette du genre crêpe - (50) |
| grapiau : sorte de crêpe ou beignet (sansiau) - (60) |
| grapiau : espèce de grosse crêpe épaisse, proche de l'omelette pour l' apparence. Sauf erreur : confectionné aussi avec quelques restes. Ex : "A'ss s'ouèr, j'té fée un grâpiau !" Sauf erreur encore, cela n'annonce pas un régal . - (58) |
| grâpiau, crêpe épaisse - (36) |
| grapigner : v. a., effilocher. - (20) |
| grapilli : gratter (utilisé couramment pour un chien creusant la terre). A - B - (41) |
| grapilli : grapiller - (57) |
| grapillô, terme châtillonnais pour exprimer une rampe de terrain. Dans l'idiome breton, krapa signifie gravir. (Le Gon.) ... - (02) |
| grapillon : (nm) sentier escarpé - (35) |
| grapillon : s. m., grimpillon. sentier escarpé. - (20) |
| grapillot : cher à André Mary : un raidillon. - (66) |
| grapillou, rugueux (comme la langue du chat) . - (28) |
| grapin : (nm) croc à fumier - (35) |
| grapin : crochet - (44) |
| grapin, n.m. crochet, tisonnier. - (65) |
| grapine (la) : pioche à 3 dents, plus grande que le grappin, plate et pointue - (43) |
| grapner : enlever les racines des mauvaises herbes (chiendent...) avec un grappin - (43) |
| grapner v. Arracher les racines, les mauvaises herbes, avec un grappin. - (63) |
| grappe : Tisonnier, petit grappin en forme de fourche. « Tuje dan le fû ave la grappe » : attise donc le feu avec le tisonnier. - (19) |
| grappe : s. f. instrument à deux dents pour attiser le feu. - (21) |
| grappe : s. f., vx fr. grape, grappin ; fourche à feu. - (20) |
| grappe, grappin, ustensile de feu. - (05) |
| grappe, n.f. pioche à trois dents pour charger la vendange. - (65) |
| grappe, s, f., pioche à trois dents et à manche très court, pour charger ou décharger la vendange. - (40) |
| grappe, s.f. bigot à manche court servant à détacher la genne qui a été pressée sur le pressoir. - (38) |
| grappe, s.f. tisonnier : la grappe, la polle a le soufflou (le tisonnier, la pelle et le soufflet) faisaient partie de l'équipement des cheminées. - (38) |
| grapper : v. a., vx fr. graper, s'emparer de quelque chose, grappiller. - (20) |
| grapper, v., vider une ronde (cuve) avec une grappe. - (40) |
| grappeter v. a. Grappiller. - (10) |
| grappeter. v. - Grapiller. - (42) |
| grappetot (n.m.) : roitelet - aussi rapeutret - (50) |
| grappetot : roitelet - (60) |
| grappetot. s. m. pl. Petites grappes de raisin qui restent dans les vignes après la vendange. (Mailly-la-Ville). - (10) |
| grappetter (grap'ter) : v. n., grappiller. Voir grumetter. - (20) |
| grappeture, s. f., raisin resté pour le grappillage. - (40) |
| grappiliy : gratter, chien qui gratte la terre - (34) |
| grappillage, s. m., vendange tardive des raisins et des conscrits. - (40) |
| grappin : pioche à 3 dents recourbées, croc à fumier - (43) |
| grappin : tisonnier. - (62) |
| grappin : s. m., tisonnier recourbé aux deux extrémités, fourche à feu ; bigorne. Grappin à foin. Voir tire-foin. - (20) |
| grappin. Fourche minuscule en fer, dont le manche est terminé par un crochet, et qui sert soit à tisonner le feu, soit à manier les vases qui sont dessus. - (12) |
| grapte. s. f. Grappe. (Domecy-sur-le-Vault). - (10) |
| grapter (v. tr.) : grappiller - (64) |
| grapter, v. grappiller. - (38) |
| grapteur, s.f. grappillage. - (38) |
| graptou, s.m. grappilleur. - (38) |
| graptouiller : églantier. - (09) |
| grap'yi : (vb) marauder ; cueillir des baies - (35) |
| grap-yi : gratter, chien qui gratte la terre - (43) |
| grapyi, grimpyi : grimper - (43) |
| gras fondu : s. m., diabète. - (20) |
| grâs : adj. Gras. - (53) |
| grasiller, v., se dit des poules qui veulent aller pondre. - (40) |
| grasse (terre), s. f., terre glaise. Utilisée pour les tuiles. - (14) |
| grâssè : graisser - (46) |
| grassè è coup : boire un coup - (46) |
| grassis, s. m., impureté sur le saindoux. - (40) |
| grassot. : C'est ainsi qu'on dénomnait à Châtillon le dimanche qui précédait le mardi de carnaval. (Cout. de Châtillon de 1371.) - (06) |
| grasuyer, gratter son nez, la croûte d'une plaie. - (27) |
| gratan : Résidu qu'on obtient quand on fait fondre du saindoux ou du lard gras. - (19) |
| grate, s. f., démangeaison. - (14) |
| gratecu, s. m., fruit de l'églantier et du rosier, surtout la bourre piquante qui entoure ses graines. La jeunesse des campagnes, habituée aux grosses farces, répand parfois de ce singulier duvet dans les lits des jeunes mariés. On est toujours riche en mauvaises plaisanteries. - (14) |
| graton : résidu comestible de la cuisson du lard de porc pour obtenir le saindoux. A - B - (41) |
| graton : gras de porc rissolé en petits morceaux, que d’autres nomment : grattelons ou grillons. - (62) |
| graton, gratton, subst. masculin : résidu de panne de fondue et pressée. - (54) |
| graton, s. m., petit morceau de viande rissolé, résidu du lard qu'on a fait fondre. Les enfants s'en régalent : « Manman, donne-moi des gratons ! » - (14) |
| graton. Résidu de graisse de porc fondu, sans doute de gras. - (03) |
| gratons et graitons. Ce qui reste du gras de porc après qu'on a fondu le saindoux. - (13) |
| gratta-tchu (on) : cynorhodon - (57) |
| gratta-tchu (on) : églantier - (57) |
| gratta-tchu (on) : gratte-cul - (57) |
| gratte (A) : loc. Etre à gratte, n'avoir fait encore qu'un seul point dans une partie de jeu. Voir baise (A). - (20) |
| gratte : Gratelle, maladie de la peau caractérisée par de continuelles démangeaisons. « Ol a ésu la gratte » : il a eu la gratte. - (19) |
| gratte : s. f., vx fr. grate, gale. - (20) |
| gratte. n. f. - Gale. - (42) |
| gratte. s. f. Gale. C'est l'effet pour la cause. – Se dit pour certains petits bénéfices, plus ou moins légitimes, que trouvent moyen de réaliser quelques petits fonctionnaires ou employés dans les positions qu'ils occupent. Le traitement n'est que de tant, mais il y a de la gratte. - (10) |
| gratte-cul : cynorrhodon : le fruit de l’églantier. - (62) |
| grattecul : Cynorrhodon, fruit du rosier sauvage. « Balle rose devint grattecul » : telle femme qui a été belle dans sa jeunesse devient laide en vieillissant. « Du boire de gratteculs » : boisson que les pauvres gens font avec de l'eau dans laquelle on met macérer des grattteculs. « Philippe prétend qu'o fa de la bonne boisson en mentant in grattecul dans eune fillette de vin vieux ». - (19) |
| gratte-cul n.m. Nom populaire du fruit du cynorrhodon ou églantier. - (63) |
| gratte-cul, n. masc ; fruit de l'églantier. - (07) |
| gratte-cul, n.m. fruit de l'églantier. Désigne souvent l'églantier. - (65) |
| gratter. v. n. Prélever, réaliser de petits bénéfices en dehors des appointements fixes et réguliers. Avez-vous quéques retours de bâton ? Oh non ! il n'y a rien à gratter. - (10) |
| gratte-saillée. n. f. - Emmerdeuse : « La Liliane, ça fait trois foués qu'a vint m'demander des ougnons ! Te parles d'eune gratte-saillée ! » (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| gratte-t’iu, s. m. gratte-cul, fruit de l'églantier. - (22) |
| gratte-t'iu, s. m. gratte-cul, fruit de l'églantier. - (24) |
| grattillot. s. m. Grattement léger, chatouillage. Faire gratilltot, chatouiller. (Andryes). - (10) |
| gratton : s. m., vx fr. graton, petit morceau de viande ou de lard grillé. - (20) |
| grattons, n.m.pl. morceaux de lard frit (grignaudes). - (65) |
| grattons, résidu de graisse fondue. - (05) |
| grattons, s. m., pl., résidus de fonte pressés. - (40) |
| grattouaîr (on) : grattoir - (57) |
| grau (n.f.) : corbeille ronde en paille - (50) |
| grau : (grô: - subst. m.) (mot vieilli) récipient. Usité seulement dans l'expression grô: d' sô:, "récipient à sel". A l'origine, le grô: d'sô: était une sorte d'écuelle en bois ; puis il fut supplanté par la boîte à sel murale, ce qui fit que la locution, n'étant plus comprise, donna lieu à un contresens : pour certains témoins en effet, relativement jeunes, le grô: d' sô: désigne le gros sel. - (45) |
| graû, s. m., mortier à sel (de bois épais). - (40) |
| grau. s. m. Egrugeoir. (Ménades). - (10) |
| graufe : s. f. gaufre. - (21) |
| graufe, s. m. gaufre : un graufe au lait. - (22) |
| graule, et grôle, s. f., grêle. Pris adjectivement dans le même sens que gale : « Ah ! que ch'tite graule que ça fait, que c'te coraude iqui ! » - (14) |
| graule, la grêle. - (02) |
| graule. Grêle. - (01) |
| graûler : secouer un arbre ainsi que les branches avec une perche pour en faire tomber les fruits à terre (« gaûler lâs calâs ») - (37) |
| grauler, et grôler, v. intr., grêler. - (14) |
| graûler, groûler (v.t.) : secouer un arbre pour faire tomber les fruits - (50) |
| graulotte : petite casserole. - (09) |
| gravale : Gravier, petit caillou. « J'ai eune gravale dans man sulé (soulier) ». - (19) |
| gravale : s. f., vx fr. gravele, aspérité, rugosité du sol. - (20) |
| gravale, s. f. petit caillou. - (22) |
| gravale, s. f. petit caillou. - (24) |
| gravale. Petit caillou. Gravelle est un vieux mot. - (03) |
| gravalle : gravelle. Dans les sabots o évo souventdes gravaolles : dans les sabots il y avait souvent des gravelles. - (33) |
| gravalle, graivale (n.f.) : gravelle, gravier, sable - (50) |
| gravalle, petit caillou, gros gravier. - (05) |
| gravalon (Br.), graivaulon (Aux.). – Frelon ; paraît venir du latin crabro, même sens, par le vieux français cravalon. Dans certaines régions de l'Auxois gravauler signifie aussi trembler, par analogie sans doute avec grelotter. - (15) |
| gravalon, n.m. frelon. - (65) |
| gravalon. Frélon. - (03) |
| gravalot, gravelot, gravaton, gravillon : s. m., petit gravier. - (20) |
| gravaloux, gravalouse : adj., graveleux, rugueux. - (20) |
| gravaloux, -ouse adj. Graveleux, rugueux. - (63) |
| gravandue. s. f. Dégradation. (Trucy-sur- Yonne). - (10) |
| gravate (na) : cravate - (57) |
| gravater : cravater - (57) |
| gravaule. s. f. Sorte de salade. (Germigny). - (10) |
| gravèle, menu gravier et maladie de la pierre. - (16) |
| gravéles, s. f., petits cailloux, gravier : « T'as cori sur les bords de l’iau ; v'qui tes sabots pleins de gravéles. » - (14) |
| gravelle, graivale, s. f. gravelle, gravier, sable, parcelle de granit en décomposition. - (08) |
| gravelle, n.f. petit caillou qui se glisse dans la chaussure. - (65) |
| gravelle, subst. féminin : petit caillou, gravier. - (54) |
| gravelle. n. f. - Petit gravier. Mot directement issu de l'ancien français du XIIe siècle : gravel ou gravelle signifiait sable, gravier ou plage. On l'employait aussi pour un calcul aux reins (ce dernier sens a été conservé par le français médical). On dit encore en français d'une terre qu'elle est graveleuse si elle contient du gravier. - (42) |
| gravelle. Petite pierre. Dôte-moï don lai gravelle qu’ast entrée dans mon soulé... - (13) |
| gravelles, petits cailloux. - (27) |
| graver (v. int.) : gravir, grimper - (64) |
| graver, gravi, gravicher. v. - Gravir, grimper : graver la côte. Graver ou gravir s'employait en ancien français du XIIIe siècle pour avancer avec effort sur une pente montante. L'origine de ce mot serait le gradus latin : degré, marche. - (42) |
| graver. v. n. Grimper, monter, gravir. Les rats gravent après les murs. - (10) |
| gravi : Gravir, grimper. « Ol a gravi le sinté à Laurent toje corant » : il a gravi le « sentier à Laurent » (c'est une forte côte) en courant tout le temps. - (19) |
| gravicher, graviller. v. a. et n. Grimper, gravir peniblement. (Saint-Sauveur, Arcy-sur-Cure). - (10) |
| gravicher, v. a. gravir avec effort, monter une ponte escarpée. - (08) |
| gravicher, v. tr. et intr., gravir, grimper, monter : « Que brise-tout ! ô m'dévore ses culottes à gravicher su les âbres. » - (14) |
| gravicher. Grimper, fréquentatif de gravir. On appelle gravicho le lierre. Dans le Morvand, gravissot. - (03) |
| gravicho. Lierre. - (49) |
| gravichot : petite montée - (61) |
| gravichot : sentier difficile. - (09) |
| gravichot, s. m. montée difficile, pente escarpée, petite montagne, endroit d'une route où l'on monte rapidement. - (08) |
| gravichòt, s. m., lierre, parce qu'il grimpe après les arbres et les murs. — Les enfants donnent aussi ce nom à l'épi de blé qu'ils s'introduisent sous la manche de chemise, et qui graviche tout seul jusqu'à l'épaule. - (14) |
| gravichot. s. m. Petit sentier, rude, escarpé, pierrieux, comme il s'en trouve souvent dans les vignobles et le pays de montagnes. - (10) |
| gravichoù, s. m., enfant qui monte aux arbres. Le grimpereau est surnommé gravisson. - (14) |
| gravière, s. f., sablière, carrière de sable. - (14) |
| gravigner. v. a. Tarir au moyen d'un crochet. (Béru, Villiers-Saint-Benoît). - (10) |
| gravisson. s. m. Grimpereau, oiseau qui grimpe le long des arbres. (Villiers-Saint-Benoît). - (10) |
| gravissot, s. m. lierre. - (08) |
| gravitso : lierre (en B : cotère). A - (41) |
| gravois : menus décombres de démolition. - (55) |
| gravolon, frelon. - (28) |
| gravolon, grosse guêpe. - (16) |
| gravolon, s. m., grêlon. - (40) |
| gravoner, v., gratter avec le pied de devant (cheval). - (40) |
| gravoner. Grimper avec effort. - (13) |
| gravonner : grimper. - (31) |
| gravoter : grelotter de froid. - (62) |
| gravouillée. s. Journalière. - (10) |
| gravouiller, chatouiller ou piquer la peau (à la suite de la présence d'une puce, d'un pou ou d'un autre insecte). - (27) |
| gravouiller. v. n. Chatouiller doucement. (Vertilly). - (10) |
| gravouiller. v. n. Grimper comme un rat. (Perreuse). - (10) |
| gravoutai : chercher, fouiller, gratter. - (33) |
| gràye, s. f. tartre de futailles. - (22) |
| gràye, s. f. tartre de futailles. - (24) |
| grazelai, crier comme fait la volaille ; en latin, gracillare... - (02) |
| grazelai. : Glousser comme la poule, (du latin gracillare.) - (06) |
| grâzeyer : se dit à propos d'une poule qui fait des gazouilles - (39) |
| gre’mlon : pli, bourrelet - (43) |
| grebaloux, raboteux, inégal. - (05) |
| grebe, souche de bois. - (05) |
| grebe. Souche de bois. La veille de Noël, on met au feu la grebe que l'enfant Jésus emplit de friandises pour les enfants sages. - (03) |
| grèbeuchot : (grèbeucho - subst. m.) petit raidillon très abrupt. - (45) |
| grebeusse : une grenouille - (46) |
| grebi : transi - (46) |
| grebon, s. m. ou gròbe, s. f. grosse souche de bois noueux. - (24) |
| greboton : être à greboton, c'est être à genoux - (46) |
| grêche. s. f. Grange. (Sacy). - (10) |
| grecque. Une grecque , dans quelques villages de la Bourgogne et notamment à Aignay et à Etalente (Côte-d'Or), signifie une femme. C'est un reste évident de la langue gauloise dans ces pays de montagne ; car le mot breton grék ou grég (Le Gon.) signifie femme, épouse... - (02) |
| gredau : Gros pou. - (19) |
| gredeau (gr'deau) : s. m., gredin. Ch'tit gr'deau ! - (20) |
| gredeler : trembloter, trembler - (43) |
| gredeler : v. n., grelotter. Voir greler. - (20) |
| gref, -effe adj. (vx.fr. grief, dur, résistant) Dur, résistant. - (63) |
| gref, greffe : adj., vx fr. grief, dur, résistant. Sol gref. Noix greffes. - (20) |
| gréfe : n. f. Greffe. - (53) |
| gréfeton, s. m. greffe, sujet que l'on implante sur un sauvageon. - (08) |
| greffe, adj. agressif, hargneux. - (22) |
| greffée adj. Enceinte. La Tonine, alle a bin l'air d'éte greffée ! - (63) |
| greffée : adj. fém., enceinte. La Toinon, elle a ben l'air d'êt’ greffée. - (20) |
| greffion, griffon : s. m., vx fr. grafion, grosse cerise, bigarreau. - (20) |
| greffouaîr (on) : greffoir - (57) |
| gregir, grechir : v. a., vx fr. gresgi (adj.), griller. - (20) |
| grégne : (grégn' - adj. inv.) de mauvaise humeur, morose. - (45) |
| grègne, grigne : grincheux, malgracieux, de mauvaise humeur, triste - (48) |
| gregnou : grognon - (43) |
| greigne, adj. ; triste. - (07) |
| greigne. Triste, affligé. Greigne est masculin et féminin. Quand un homme a quelque chose qui le chagrine, ou comme on parle en bourguignon, qui le chaigreigne, on dit « qu’el a greigne »… - (01) |
| gréille : lard frit, lardon grillé - (48) |
| greille : tranche de lard frite (beursaude). - (33) |
| gréille : (gréy’ - subst. f.) 1- grille. 2- morceau de lard grillé, lardon. Par extension, sexe masculin. - (45) |
| greille : n. f. Grille. - (53) |
| greille(s) : lardons - (39) |
| gréille, grêle (n.f.) : petit morceau de lard grillé ( aussi grillaude, gueurliâle) - (50) |
| greille, grille, grillade. s. f. Tranche de lard grillée et, par extension, toute tranche ou morceau de lard, en général ; d'où cette locution usitée à Saint-Germain-des-Champs : la soupe à la grille, pour la soupe au lard. - (10) |
| greille, s. f. petit morceau de lard grillé qui figure en nombre dans la soupe. - (08) |
| gréiller (v.t.) : griller - (50) |
| gré'iller : griller - (48) |
| greiller, v. a. griller, faire rôtir. se dit aussi de l'action du soleil ou de la gelée. - (08) |
| gréilliot : grillon du foyer, des champs, ou cricri. O l'éto coume un gréilliot : il était comme un grillon. - (33) |
| greillon(s) : lardons et côtes d'une pile de bois - (39) |
| gréillot (n.m.) : grillon - (50) |
| greillot : voir grillot - (23) |
| greillot : grillon - (39) |
| greillot, s. m. grelot. - (08) |
| greillot, s. m. grillon, le cricri du foyer. - (08) |
| grêle (aine) : (ain) bouton de fièvre sur la lèvre - (37) |
| gréle : tranche de lard frite (beursaude). - (52) |
| grêle : n. f. Tranche de lard frite et pressée. - (53) |
| grêle, subst. féminin : gratton, résidu de panne de porc fondue et pressée. Au sens figuré, heureux comme un poisson dans une casse de grêles se dit d'une personne qui a l'air mal à l'aise ou mal dans sa peau. - (54) |
| grelé, v. n. 1. Trembler, grelotter. — 2. Grêler. - (22) |
| grêlé. : Frappé de la grêle. On dit d'une personne marquée de petite vérole qu'elle est grêlée, à cause des empreintes creusées sur sa face. - (06) |
| greler : v. n., vx fr. grenier, grelotter. Greler le froid. Voir gredeler. - (20) |
| greler, v. n. i. trembler, grelotter : un vieillard tout grelant ; on grelait de froid (vieux français). — 2. Grêler. - (24) |
| grêles, morceaux de lard fondu - (36) |
| grelet : voir grillot - (23) |
| greleute (na) : seau (pour traire les vaches) - (57) |
| grêliau. n. m. - Grêlon. - (42) |
| grelin, s. m., avorton, adj., déficient. - (40) |
| grélis : fané, desséché. - (09) |
| gré'llot : grelot du collier du chien. - (33) |
| grêlon. s. m. Résidu croquant des lardons et de la graisse de porc après qu'on l'a fait fondre. (Auxerre). – En général, lardon frit. - (10) |
| grelot de cerises : grappe de cerises - (43) |
| grelot n.m. Jeu consistant à faire deviner le nombre de billes cachées dans une main. La formule consacrée étant : Grelit, grelot, cobin dz'ai d'piârres dans mo chabot ? Qui a varié les boute ! - (63) |
| grélot - petit vase de ménage pour le sel. - Voyez gréreu. - (18) |
| grelot : s. m., grelottement, tremblement. - (20) |
| grélot. Petit vase en terre, diminutif de grès pris dans le sens de vaisselle. - (12) |
| grelu : à la manière des gueux (pauvres) - (43) |
| grelu ou gueurlu. : Homme de rien, homme minime, dans le sens figuré. Le latin gracilis signifiant mince et grêle répond, dans le sens propre, à l'application morale qu'on en a faite.- Le diminutif greluchon est l'épithète que les femmes de mauvaise vie donnent à ceux qu'elles favorisent gratis.- En Champagne une grelette est une brebis maigre. (Grosl.) - (06) |
| grelu, greluse : adj., vx fr. grésli, chétif, malingre. - (20) |
| grelu, m. homme pauvre et timide. - (24) |
| grelu, que certains prononcent gueurlu, signifie un pauvre, un gueux.Un homme greuli (grêle), c'est un homme de rien. Le diminutif est greluchon, épithète que les femmes de mauvaise vie donnent à ceux qu'elles favorisent gratis en se faisant payer par d'autres... - (02) |
| grelu, s. m. homme pauvre et timide. - (22) |
| grelu. Pauvre, comme qui dirait grelu, par opposition à gras et à gros dans la signification de riche et puissant. - (01) |
| greluchet, greluchon, greluchot : s. m., dim. de grelu. - (20) |
| gremaie : noyau, pépin, grumeau - (48) |
| gremais - noyau. - N'aivole don pas les gremais, ci ne vaut ran. - Aivou les gremais de pêches, en fait de lai bonne liqueur. - (18) |
| gremais. s. m. Noyau. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| gremalou. Sale, raboteux. - (03) |
| gremaloux : Rugueux. « J'ai les mains totes gremalouses ». - (19) |
| gremater : Vendanger une vigne dont la récolte est presque nulle, où on ne ramasse que des « gremeuts ». - (19) |
| gremau (on) : amande (dans les noyaux) - (57) |
| gremau, s. m., noyau de fruit. - (14) |
| greme : Prononcer greum'. Grume, grain de raisin. « Les raijans « millerets » ant des totes petiètes gremes ». « De la greme vars » : des grains de raisin qui commencent à mûrir, à changer de couleur. « Piquer la greme » : manger du raisin en prenant un grain ici, un grain là, sans cueillir la grappe. - (19) |
| grème., greume, grume. s. f. Grain de raisin et de tous les fruits à grappe, en général. Du latin grumus, étymologie bien simple, que MM. Littré, Beaujean et Cie n'ont pas su trouver. - (10) |
| gremeix, n. masc. ; noyau de courge, de cerise. - (07) |
| gremélons, s. m., petites saillies, d'une espèce particulière, que l'on remarque sur la terre après une forte pluie d'orage mêlée de grèle. - (14) |
| gremelot. s. m. Grumeau. (Etivey). Voyez gremillon. - (10) |
| grémenter : (vb) se plaindre - (35) |
| grémenter : geindre, se plaindre en grognant dans sa barbe - (51) |
| grémenter, guémenter : se plaindre - (43) |
| gremer, v. ; barbouiller quelqu'un pendant les vendanges avec un raisin écrasé ; farce jouée par les vendangeurs. - (07) |
| gremet. s. m. Gourmet, courtier, facteur en vins. Monsieu Moreau le gremet. (Joigny). - (10) |
| gremeut : Raisin très petit, qui n'a que quelques grains. - (19) |
| gremia, noyau. - (28) |
| gremiâ, pépin ou noyau de fruit. - (27) |
| gremia. Noyau de fruit. Du latin gremium, milieu. - (13) |
| gremiau : noyau s'agissant d'un fruit, ou grumeau s'agissant d'une sauce. On planto parfois un gremiau : on plante parfois un noyau. - (33) |
| gremïau. s m. Noyau. (Accolay). –Dans quelques endroits, on dit grimiau. - (10) |
| gremichau, s. m. pelote de fil. Verbe engremicholer (du vieux français gremissel. Latin glomiscellus, diminutif de glomus). - (24) |
| gremichaut : Peloton. « In gremichaut de fi roge (de fil rouge) ». - (19) |
| gremillan : Petit grumeau. On dit que le beurre est en gremillans quand il est prêt à se prendre en pâte. Vieux français, gremillon. - (19) |
| gremille. Petit poisson. - (03) |
| gremillon - tout petit grain, tout petit morceau. - In gremillon, c'â encore moins qu'in graivolou. - (18) |
| gremillon : grumeau - (39) |
| gremillon : n. m. Grumeau. - (53) |
| gremillon, gremion, gremiâ. Grumeau. Le mot grumellus est passé directement du latin dans le bourguignon sans forme intermédiaire. - (12) |
| gremillon, s. m. petit gremeau de farine mal délayée dans une sauce. - (40) |
| gremillon. s. m. Parcelles coagulées d'une substance farineuse ou onctueuse qui, en cuisant dans un liquide, ne se sont pas délayées et n'ont pas fondu suffisamment. - (10) |
| gremillons, s. m., petits grumeaux, parcelles coagulées : « Ton lait veint d'torner dans ton café ; ôl é plein d’gremillons. » - (14) |
| gremillot : Grémil, lithospermum. Gremillot paraît être un diminutif de greme, les graines luisantes de cette plante, qu'on appelle aussi herbe aux perles, étant de petites gremes. - (19) |
| grémiot (n. m.) : noyau - (64) |
| gremiot, grimiot. n. m. - Noyau, pépin. - (42) |
| gremisséa, paquet, peloton. - (02) |
| gremissea. : Paquet, peloton. (Del.) Ein gremisseà defi, un peloton de fil. - (06) |
| gremisseau : s. m., vx fr. gremissel, peloton. - (20) |
| gremissiau, s. m. pelote de fil. Verbe : gremissoulé. - (22) |
| gremòchon, m. petit raisin. - (24) |
| gremouchon, s. m. petit raisin. - (22) |
| gremuchau, s. m., peloton, petit paquet de fil. - (14) |
| gremuchau. Peloton de fil. - (03) |
| grenailler. v. - Racler, gratter jusqu'à la dernière miette. (Saints, selon D. Levienaise-Brunel) - (42) |
| grené (cochon), ladre. - (05) |
| grené : Granuleux. On dit d'un porc qu'on vient de tuer qu'il est grené lorsque les boyaux nettoyés pour servir à la confection du boudin présentent des granulations. En parlant de personnes quand on dit : « Ol est grené » cela signifie qu'il est atteint de la poitrine. Vieux français, grené. - (19) |
| grené : part, pass., atteint de maladie quelconque (par extension du cas du porc grené, c'est-à-dire atteint de ladrerie). De quelqu'un qui est vigoureux on dira : Ah ! i n'est pas grené, çui-là ! - (20) |
| grené, se dit du porc dont la chair est tachetée de points noirs. - (16) |
| grenée : ensemble des graminées ou ensemble des graines contenues dans le foin - (43) |
| grenei. Grenier, greniers. - (01) |
| greneille : le grenier, on utilise également le mot grenè - (46) |
| grener, v. n. abonder, foisonner au battage des récoltes : ce blé grœne bien. - (24) |
| grenette (la) : halle (aux grains) - (57) |
| grenette : s. f., vx fr., halle aux grains. - (20) |
| grenette. Marché aux grains. - (49) |
| greni : grenier - (43) |
| grenin, grenier. - (26) |
| grenipilles : personnes ou choses sans valeur, mauvaises gens. - (30) |
| grenisser : v. a., grincer de. Grenisser les dents (Annales de l’Académie de Mâcon, 2e série, t. III, 1881, p. 92). - (20) |
| grenon se dit, dans le Châtillonnais, pour exprimer les restes d'un mets adhérent aux casseroles, et, par extension, peu de chose. Krien ou krienen (Le Gon.), dans le breton, est ce qu'en français on appelle gratin, partie de la bouillie qui reste attachée au fond du poêlon. - (02) |
| grenon, sm. ce qui reste au fond des marmites, gratin de bouillie et de gaudes dont les enfants sont friands. - (17) |
| grenouiller, v. traîner, aller de café en café. - (65) |
| grenouillet, mare, petit étang. - (05) |
| greno-ye : grenouille - (43) |
| grèpeu, raidillon à pente accentuée. - (27) |
| grepœlles, s. f. broussailles sur un terrain en forte pente. - (22) |
| grèppe : une grappe - (46) |
| greppin (on) : croc - (57) |
| greppin (on) : grappin - (57) |
| greppin d'poêle (on) : tisonnier - (57) |
| greppo ou grepisso - petite montée dans un chemin. - Quand tu seré â dessu du grépisso te m'aitandré. - En fauro vraiment bein aidouci le greppo de lai rue du Verdais, a n'â pas asille. - (18) |
| greppot : chemin pentu. - (32) |
| grèpuchot : raidillon, grimpette, montée - (48) |
| gréreu ou grérot - petit vase de ménage, sorte de mortier en bois dans lequel on écrase le sel. - Note gréreu à fendu, pensons don d'en aichetai in aute ai lai fouaire. - Es autes fouai en diso grélot, métenant en dit gréreu ou grérot. - (18) |
| grëro, vase pour le sel. - (16) |
| gresalle è lé rialle, groseille sauvage. - (27) |
| gresalle, groseille. - (27) |
| gresallé, groseiller. - (27) |
| gresi (du) : grésil - (57) |
| grésî n.m. Grésil. - (63) |
| gresilli : grésiller - (57) |
| grésillon : s. m., vx fr. grésille, grain de grésil. - (20) |
| gresillon, charançon. En patois picard, ce mot exprime l'état d'une personne qui a froid. - (02) |
| gresillon. : Charençon; d'où le mot gresillai pour exprimer l'affluence de ces insectes. On dit tôt i gresille. - (06) |
| grésin. Granitique; sablonneux. - (49) |
| grète-cu, églantier. - (26) |
| gretœlles; s. f. bouse séchée en plaques sur les flancs du bétail mal tenu. - (22) |
| gretœyes, s. f. 1. bouse séchée en plaques sur les flancs du bétail mal tenu. — 2. Graines de bardane, dont les petits crochets font qu'elles s'accrochent facilement aux vêtements. - (24) |
| greton : le graton - (46) |
| greton, s. m. dernier reste d'un pain ; extrémité de ce pain fait surtout de croûte : couper le greton. - (24) |
| greton, s. m. dernier reste d'un pain. - (22) |
| gretoner, v. n. détacher à la charrue de grosses mottes de terre, comparables à des « gretons ». - (24) |
| gretouné, v. n. détacher à la charrue de grosses mottes de terre, comparables à des « gretons ». - (22) |
| greu : berceau à balançoire. A - B - (41) |
| greû : (nm) berceau - (35) |
| greu : berceau à balançoire - (34) |
| greû : berceau. (RDB. T III) - S&L - (25) |
| greu de tsâ : contenu de l'intérieur des darêches*. A - B - (41) |
| greû n.m. Berceau. - (63) |
| greu : s. m. berceau. - (21) |
| greû, greûsse : gros, grosse - (43) |
| greu, s, m. berceau. Verbe : greuté, bercer. - (22) |
| greu, s. m. berceau. Verbe greuchi, bercer. - (24) |
| greube (na) - tronche (na) : souche - (57) |
| greube (na) : grume - (57) |
| greube : une souche - (46) |
| greùbe, s. f., souche, grosse bûche, fragment de tronc, que l'on choisit pour mettre au feu avant la messe de minuit, qu'on arrose de libations de vin, devant laquelle on réveillonne en chantant des Noëls, et qui pisse bonbons et friandises pour les enfants sages. On dit à un enfant lourd : « Te n'bouges pas pus qu'eùne greùbe » et d'une personne grosse et molle : « La grosse greùbe ! » - (14) |
| greube, souche d'arbre. - (28) |
| greube. La souche de Noël. Etym. introuvable. - (12) |
| greûche (n.f.) : écrevisse - (50) |
| greuche : grenouille - (44) |
| greuche : n. f. Écrevisse. - (53) |
| greuche, s. f. écrevisse. - (08) |
| greûche, s. f., écrevisse de rivière. - (40) |
| greuche, subst. féminin : écrevisse ou grenouille. - (54) |
| greuchi : bercer un bébé. A - B - (41) |
| greuchi : bercer un bébé - (34) |
| greûchi v. (gallo-romain crottiare, secouer). Bercer. - (63) |
| greûère : gruyère, odeur de doigts de pieds - (37) |
| greugne : grosse branche. - (30) |
| greûgnot : faux pissenlit, ventre de femme enceinte - (37) |
| greuil : (nm) grillon - (35) |
| greuiller : chercher dans un recoin, fureter. (MM. T IV) - A - (25) |
| greuiller : creuser. (S. T III) - D - (25) |
| greuiller : fouiller. - (66) |
| greûiller : pinailler, travailler mais sans résultat - (48) |
| greuiller, chercher dans une noix, dans une dent creuse. - (28) |
| greuiller, gratter. - (26) |
| Greuillot : je ne dirai rien, les Châtillonnais me comprendront !!!! - (66) |
| greuillot : peu intelligent(VDS. T IV) - VdS - (25) |
| greuillot, grillot : (nm) grelot - (35) |
| greujon. s. m. Sabotier. (Armeau). - (10) |
| greule : (nf) grêle - (35) |
| greûlè secouer - y von greûlè l'caloteil pou faire cheur lè calots, nous allons secouer le noyer pour faire tomber les noix - (46) |
| greule : s. f. gueurlér v. grêle. - (21) |
| greule. Ce mot signifie à la fois grêle et tremble, arbre d'un bois tendre. - (02) |
| greûler : secouer, vaciller. (E. T IV) - VdS - (25) |
| greules : grosses chaussures. - (62) |
| greûlot : genre de petit chignon - (37) |
| greùmage, s. m., grappillage. La vente du raisin en détail demeurait interdite, ainsi que le greùmage, avant l'expiration des quinze jours qui suivaient la vendange (le ban de vendange était jadis d'une grande importance en Bourgogne) - (14) |
| greûmai - voyez gômai. - (18) |
| greumai (n.m.) : noyau, amande - (50) |
| greume - grain d'une grappe de raisin, de groseille, de raisin surtout. – Lai greume de ce nouveau plian qui à bein pu grosse. – Les greumes quemençant de nairci. - Les greumes de greusales. - (18) |
| greume (n.f.) : grain de raisin - (50) |
| greume (na) : grume (grappe de raisin) - (57) |
| greume : (nf) grain de raisin - (35) |
| greume : grain de raisin. « Greume de râ’yin » : grume de raisin. - (62) |
| greume : grume de raisin - (43) |
| greume : s. f. grain de raisin. - (21) |
| greume : grain de raisin, grume. - (33) |
| greumè : (greumê: - subst. m.) grumeau. - (45) |
| greume : n. m. Grain ou grume de raisin. - (53) |
| greùme, et grume, s. f., grain de raisin : « Ah ! l'biau râïn ! donue-moi-z-en eùne ou deux grumes. » - (14) |
| greume, gréme, s. f. grume, grain de raisin. Une grappe qui a beaucoup de « greumes », qui a de grosses « greumes. » - (08) |
| greume, s.f. grume (grain de raisin) ; greume ves-re : raisin qui commence à mûrir. - (38) |
| greume. Voyez grème. - (10) |
| greumeai, s. m. noyau de fruit, pépin, amande. - (08) |
| greûmer (y) : (y) déguster (un vin, un alcool) - (37) |
| greumi, greumiyo, petite graine fine et farine en toutes petites boules. - (16) |
| greumia : grumeau. - (29) |
| greumiller, gueurmller, v. n. se mettre en grumeaux, se ramasser, être coagulé. - (08) |
| greumillon : s. m. Diminutif de greume. - (21) |
| greumillon, gueurmillon, s. m. petit grumeau. - (08) |
| greumillot, gueurmillot, s. m. grumeau, partie caillée ou durcie du lait, du sang, etc. - (08) |
| greumillou (ouse) : (greumi-you -ou:z' - adj.) grumeleux, qui comporte beaucoup de grumeaux. - (45) |
| greumiot (n.m.) : nopau, amande - (50) |
| greumiot, s. m. noyau, amande. - (08) |
| greumo, greumyâ, noyau de fruit. - (16) |
| greuna (grenée) : graine de foin - (51) |
| greûnaude : (nf) grenouille - (35) |
| greunée (greuna) : graine de foin - (51) |
| greûnée : (nf collectif) graminées - (35) |
| greuner : grainer - (51) |
| greûni : (nm) grenier - (35) |
| greuni : grenier - (51) |
| greuniau : croûton de pain, quignon. - (52) |
| greuniot : croûton de pain, quignon. Le greuniot n'o jamais pas perdu : le quignon n'est jamais perdu. - (33) |
| greuniot : 1 n. m. Croûton de pain. - 2 n. m. Quignon de pain. - (53) |
| greunö, sm. grenier. - (17) |
| greus : Gros. « in greus livre ». - Riche, important. « Ol a voulu aller dave les greus, y est c'ment cen qu'ol a miji san butin » : il a voulu fréquenter des gens riches c'est ainsi qu'il s'est ruiné. - Beaucoup : « Ses enfants li ant greus fait de misares » : ses enfants lui ont causé bien de l'ennui. « Y est greus fait qu'ol ait fait cen » : c'est étonnant qu'il ait fait cela. « De greus en greus » : sommairement. Au féminin : greusse. « Eune greusse fane » : une grosse femme. « Eune fane greusse »: une femme enceinte. - (19) |
| greusale et greusalé - groseille et groseiller. - Vos velez veni méger des greusales su les greusalés, mère Tontine ? - Les greusales blianches sont bein pu douces que les rouge s; à faisant des moillou confitures. - (18) |
| greusancio : angine, mal de gorge. - (30) |
| greuse, grief, plainte. - (05) |
| greuselle : groseille - (43) |
| greuselli : groseillier - (43) |
| greuser (se) : Se fâcher « T'arais bin teu de te greuser » : tu aurais bien tort de te fâcher. - (19) |
| greuser (se), se plaindre. - (05) |
| greùser (se), v. pr., se plaindre, raconter ses ennuis, ses misères. Dans le même sens, on dit aussi : « Faire ses greùses, » (V. ce dernier mot.) - (14) |
| greuser (Se). faire des greuses, se plaindre, vieux mot. - (03) |
| greuser (Se). Se mettre en colère. Usité à Meursanges et à Marigny. - (13) |
| greùses, s. f., ennui, contrariétés, griefs, plaintes, lamentations : « Ol a été li faire ses greùses. » - (14) |
| greûsi (n. m.) : grésil - (64) |
| greusi : grésil - (43) |
| greûssi : (vb) bercer - (35) |
| greussi : bercer - (43) |
| greussi : grossir - (43) |
| greussier : Grossier, mal élevé. « Ol est greussier c'ment du pain d'orge ». - (19) |
| greussou : Grosseur, tumeur. « Ol a eune greussou au geneu » : il a une tumeur au genou. - (19) |
| greut : Berceau. « Alle laiche in ptiet qu'est enco dans le greut » : elle laisse un enfant qui est encore au berceau. - (19) |
| greut, creut, s. m., berceau. Tout le monde connaît le greut d'autrefois, consistant en une caisse en bois, munie à la tête et au pied de patins ou cintres qui permettaient le bercement. Quand la mère était debout, elle berçait avec le pied ; quand elle était au lit, elle tirait le verdon (voir ce mot). Greut et creut sont à rapprocher du bas-lat. grota (grotte) et crotum (creux) et du vx fr. grebbe (crêche). - (20) |
| greûtè : bercer - (46) |
| greuter : bercer. (A. T II) - D - (25) |
| greuter : v. : bercer. - (21) |
| greuter, groter, grouter, greucher, greusser, grousser, v. a., vx fr. groer, bercer le greut. Voir sagroter. - (20) |
| greûtots : doigts de pieds - (37) |
| greuvai, greuve, greuvero – divers temps du verbe ennuyer, contrarier. - Si vos saivains combein ci me greuve de me dérainger ! – Oh ! i crouai que ci liô greuvero bein de nos aicordai cequi. - (18) |
| greuve (pour grève). s. f. Ligne, raie qui sépare les cheveux sur le haut de la tète. Dès le temps de la chevalerie, ce nom de grève se donnait à la chevelure ainsi partagée. Il y avait des personnes qui portaient la grève, c'est-à-dire les cheveux longs, avec raie séparative, en signe de deuil. Depuis, l'usage s'est modifié, car aujourd'hui, en joie comme en deuil, au village aussi bien qu'à la ville, tout individu, qui n'est pas chauve, se plaît à faire sa raie, sa grève ou sa greuve, sans s'inquiéter beaucoup de la forme du mot ou de la manière dont il doit être prononcé. - (10) |
| greuve : (nf) grive - (35) |
| greuvé ; è m'greuve, il m'est pénible..,, il m'en coûte de faire telle chose. On dit aussi : greuvè de charges, d'impôts. - (16) |
| greuver, v. a. grever, faire de la peine, chagriner, faire du tort. - (08) |
| greuzale : groseille. - (29) |
| greûzale, groseille ; greûzalé, groseillier ; greûzale poûyouse, groseille à maquereau, grosse groseille. - (16) |
| greuzi, grésil. - (26) |
| greûzin : (nm) grésil - (35) |
| grevai. Ce mot, qui veut dire grever, peiner, blesser, s'emploie au physique comme au moral ; il vient du latin gravare. - (02) |
| grevai. : Peiner, blesser. Ce verbe s'emploie à l'actif comme au passif (lat. gravare et gravari), I son grevai de gaibelle. - Son mau m'a bé grevai. - (06) |
| grèvale : (grèval' - subst. f.) petit caillou, gravier. - (45) |
| grevalle. s. f. Gravier, gravelle. (Etivey). Par transposition de l'e et de l'a. - (10) |
| grevalon : grosse guêpe. (PSS. T II) - B - (25) |
| grève : la cheville - (46) |
| grève : (grèv' - subst. f.) partie antérieure de la jambe. - (45) |
| grevé : v. t. Ennuyer. - (53) |
| gréve, s. f. os de la jambe. S’emploie aussi pour la jambe : se chauffer les « grèves. » - (08) |
| grève, s. f. raie dans la chevelure : il a bienfait sa grève (vieux français). - (24) |
| grève, s. f. raie dans la chevelure : il a bien fait sa grève. - (22) |
| grevé, v. n. faire une chose avec regret et contrariété. - (22) |
| grève. Le devant de la jambe, la face antérieure du tibia. Etym. le vieux mot grève signifiait l’armure de la jambe, et quelquefois la jambe elle-même ; nous l'avons conservé dans un sens voisin, comme on voit. - (12) |
| grève. s. f. Dessus, devant de la jambe. L'hiver, à force de se chauffer, on se brûle quelquefois les grèves. Suivant Ducange, l'armure de fer qui protégeait les jambes des chevaliers était appelée greva. - (10) |
| grever : v. a., vx fr., contrarier, gêner. - (20) |
| grever : v. n., syn. de grouer. - (20) |
| grever, peiner. - (05) |
| grever, regretter. - (26) |
| grever, v. a. 1. vexer : il l'a grevé avec ses paroles méchantes. — 2. faire une chose avec regret et contrariété : se lever tôt grœve bien (vieux français). - (24) |
| grever. Peiner, chagriner, vieux mot. - (03) |
| gréver. Rainer ; assembler par une rainure. - (49) |
| gréves (les): jambes (les) - (48) |
| greveut : Frisson. « La fièvre li donne le greveut ». - (19) |
| greveuter : Frissonner, grelotter. « Fa dan voir in ptiet bout de fû, an greveute de fra » : fais donc un peu de feu, on grelotte de froid. - (19) |
| grevillè : monter à une échelle, un arbre, etc. (semble venir de gravir) - (46) |
| greville. n. m. - Pissenlit. - (42) |
| grèviller : grimper. (A. T II) - D - (25) |
| grévire : (nf) lopin de terre caillouteux - (35) |
| grévolles : graviers (gaulois, gravos : graires). - (32) |
| grevolon : un frelon, grosse guèpe - (46) |
| grèvuter : (grèvu:tè - v. trans.) enlever en grattant, râcler. - (45) |
| gre-ye : grillon - (43) |
| gre-yo : grelot - (43) |
| gre-yot, souneute : sonnette - (43) |
| grezin, s. m. grésil. - (22) |
| grezin, s. m. grésil. - (24) |
| gri, légèrement ivre et celui dont les cheveux sont gris. - (16) |
| griâle, grillard, gratton. Lardon fondu, grillé. - (49) |
| griau ou gueriau : Seillet, petit seau dont on se sert pour traire les vaches. « Sa vaiche li donne des plieins griaux de lait ». - (19) |
| grïau, gruau, et gruïau, s. m., seau de sapin, petit baquet, destiné, dans tous les ménages, à recevoir de l'eau, du linge à laver, etc. Ce mot, qui désigne le contenant, désigne aussi le contenu : « Ein grïau d'iau. » - (14) |
| griau, seau de sapin, vieux mot. - (03) |
| griaudes, s.f., lardons grillés. - (40) |
| gribeûiller : très mal écrire - (37) |
| grîbeûlle : casquette plate - (37) |
| gribiche, grince, grinche. Capricieux, d'un caractère difficile. S'emploie au masculin et au féminin. - (49) |
| gribiche, s. f., femme méchante, maligne : « C'te peùte-là, y et eùne vieille gribiche ; all' ne décesse de dire du mau des gens. » - (14) |
| griblaude (n.f.) : griblette, « gratton » - les griblettes (vx.) étaient des morceaux de viande qui se grillaient entourées de lard (Tout en Un, Larousse,1921) - (50) |
| griblaudes : résidu de la graisse fondue - (39) |
| griblaudes, s. f. plur. déchet de la graisse de porc fondue et grillée, ce qui reste au fond du vase. - (08) |
| griboïlli : Gribouiller, griffonner. « Tache voir de ne pas griboïlli tan cahier ». - (19) |
| gribouillé, adj. tourmenté, tracassé. Un homme qui a perdu sa bourse et qui ne la retrouve pas est fort « gribouillé. » - (08) |
| gribouiller, v. tr., tracasser, tourmenter, obséder: « Ah ! j'ai ben la tête prou gribouillée c'ment c'qui. » - (14) |
| gribouilli : gribouiller - (57) |
| gribouilli ou grifouilli, tout trempé d'eau... - (02) |
| griboûillon : signature illisible - (37) |
| gribouillon, s. m., gribouilleur, griffonneur. - (14) |
| gribouilloner, v. tr., gribouiller, mal écrire, griffonner : « Le p'tiot é r'venu d'I'école ; ma, le ch'ti, ôl avôt gribouilloné tous ses devouérs. » - (14) |
| gribouillou (ain) : celui qui écrit peu lisiblement - (37) |
| griboulai. : Trembler de froid. - (06) |
| gribuche : dispute, querelle. - (29) |
| gribuche ; être en gribuche, c'est-à-dire, être en désaccord, en contestation avec quoiqu'un. - (16) |
| gribuche ou graibuge - querelle, dispute, ordinairement de mauvaise foi. - C'â ine béte insupportable, que cherche gribuche ai to le monde. - Si vos disez quique chose en y airé des gribuches, ç'â sur. - (18) |
| grîç’ou : mal mis, mal habillé - (37) |
| gricer. v. a. Grincer les dents. (Sommecaise). - (10) |
| griche (n.f.) : petite quantité - (50) |
| griche, s. f. gouttelette, reste de liquide, petite quantité en général. - (08) |
| grichoux, grichouse : adj., grisâtre, incolore. Une figure grichouse. - (20) |
| gricin. adj. Taquin, querelleur. (Villeneuve-les-Genêts). - (10) |
| grieau, seau. - (05) |
| grièfe : Difficile à éplucher, se dit des noix dont le contenu est difficile à retirer de la coque. « Ces calas (noix) sant grièfes ». - (19) |
| griélot, s. m., petit grïau, vase de bois dans lequel on reçoit le lait trait des vaches. (V. Grïau.) - (14) |
| grieute : Griotte, cerise à saveur acide. « Aller cudre (cueillir) des grieutes ». - (19) |
| grieuté : Griottier, cerasus caproniana. - (19) |
| griffan : Variété de cerise, grosse cerise presque blanche. - (19) |
| griffe : fourche à dents recourbées pour gratter la terre ou décharger le fumier - (39) |
| griffonné : Cerisier qui produit le griffan. - (19) |
| grifnace : mélange d'orge et d'avoine pour semer - (39) |
| grifon, s. m. grappin muni de plusieurs crochets dont on se sert pour retirer les seaux lorsqu'ils tombent au fond des puits. - (08) |
| grifouiller, v. tr., griffonner. - (14) |
| griglin : Bruit agaçant. « Ces enfants fiant in griglin ! ». - (19) |
| Grignar. Nom de famille très répandu dans le pays. - (08) |
| grignaud, aude. adj. - Grincheux, de mauvaise humeur. Mot d'origine francique, directement issu de l'ancien français grigneux : grimaçant, grognon. Grigner signifiait au XIIe siècle grincer des dents, montrer ses dents en signe de mécontentement. - (42) |
| grignauder. v. n. Grogner, gronder, faire voir qu'on est de mauvaise humeur. - (10) |
| grignaudes, n.m.pl. morceaux de lard frit (grattons). - (65) |
| grigne (n. f.) : petite quantité (syn. grignon, langrigne) - (64) |
| grignè : montrer les dents - (46) |
| grigne : petit morceau (par exemple, de pain) - (61) |
| grigne : peu - (60) |
| grigné ; grigné lë dan, grincer les dents en signe de moquerie et de mécontentement. - (16) |
| grigne : graincheux - (39) |
| grigne, adj., maussade, grincheux, chagrin : « Dépeû qu'ôl a été rnauportant, ôl é grigne en diâbe... » - (14) |
| grigne, maussade. - (04) |
| grigné, regrigné, vt. ... les dents ou des dents. Grincer les dents, montrer sa denture en signe de mépris, de colère ou de défi. - (17) |
| grigne, s. et adj. maussade, de mauvaise humeur, mécontent. - (08) |
| grigne. adj. des deux genres. Maussade, (Mailly-la-Ville). - (10) |
| grigne. n. f. - Miette, petit morceau, presque rien. Ce sens est probablement influencé par l'expression « s'en soucier comme d'une guigne », très peu, pas du tout : « Moué coumme les autres, j'croyais ça, si ben qu 'i n'm'en rest' pus eun' grigne ... » (Fernand Clas, p.71) - (42) |
| grigne. s. f. Portion, petite partie d'un objet. Chose de peu de valeur. C'est une forme ou un diminutif de grain. - (10) |
| grigne.- Selon M. le comte Jaubert, veut dire parcelle d'une chose, par exemple le chanteau du pain bénit.- D'après l'éditeur du vocabulaire du Berri, le mot grigne est un terme de chapellerie énonçant les parties endommagées du feutre. L'expression grenon s'emploie en Bourgogne dans le sens de résidu de casserolles. - Le mot allemand greinen signifie presser ou rapprocher les dents supérieures sur les inférieures. - (06) |
| grignedent : courge évidée en forme de tête - (46) |
| grignedent, adj., rechigné, de mauvaise humeur, aigre, qui grince des dents. - (14) |
| grigner des dents : montrer les dents, être mécontent. - (66) |
| grigner les dents. Les montrer par humeur ou menace. Etym. grigne, miette de pain qu'on détache en grignottant, c'est-à-dire en montrant les dents; allemand greinen, grincer les dents. - (12) |
| grigner, greigner (dans toute la Bourg.). - Etre maussade, chagrin, grincheux, en parlant des personnes, et se plisser, se rider, en s'appliquant aux objets par exemple : un grain de raisin ou une pomme en train de sécher, une étoffe froissée. Vient du vieux français grigne qui a formé chagriner, grincer, grogner, grièche et dont le radical pourrait bien être le latin grunnire, grogner. Littré cite : grigne, irrégularités du feutre, venant du Berrichon grigner, employé pour grincer (des dents) lequel aurait produitle verbe grignotter. D'autre part, il donne comme étymologie du verbe grincer le picard grincher. A comparer avec l'anglais to grin, grimacer. Voir regrigner plus loin. - (15) |
| grigner, v. intr., grincer : « O la treùve si peùte, qu'ô li grigne des dents. » - (14) |
| grigner, v. montrer les dents (pour un chien). - (65) |
| grigner. Grincer, vieux mot. - (03) |
| grigner. v. n. Avoir l'air maussade, rechigné. – Grigner des dents, les montrer, quand on est en colère, par suite de la rétraction nerveuse des lèvres. - (10) |
| grignet, ette adj. Menu, menue. - (63) |
| grignon (n. m.) : petite quantité (beurre, beurre, fais-toué don, que j'en mange un p'tit grignon (chanson qui accompagne la fabrication du beurre)) - (64) |
| grignon, sm. petit morceau de pain. - (17) |
| grignon. s. m. un homme maussade, de mauvaise humeur. - (08) |
| grignotai, manger par petits morceaux. (Voir au mot graigne.) - (02) |
| grignôtai. : C'est rompre les bords d'un pain vers la croûte la plus cuite ; c'est manger des grains de raisin un à un. (Le vieux mot français grignoun signifie pépin de raisin, dit Lacombe.) - (06) |
| grignotte. s. f. Miette, parcelle, petite grigne ; d'où grignotte. - (10) |
| grignoux : Ridé « In vieux qu'a la piau grignouse » : un vieillard dont la peau est ridée. - (19) |
| grigou, homme pendable... - (02) |
| grigou, sm. vaurien soupçonné de rapine. - (17) |
| grigri (faire), v. chatouiller un enfant. - (65) |
| griguenaudes : bressaudes. (REP T IV) - D - (25) |
| grijer, v. a. griser, faire boire à l'excès, enivrer. - (08) |
| grijouner, v. a. être à demi ivre. - (08) |
| grilaillon : adj. Tremblotte. - (53) |
| grîlé : v. i. Frissonner, trembloter. - (53) |
| griler : trembler. (RDM. T III) - B - (25) |
| grillade : Viande de porc grillée ou en ragoût. « Le jo qu’an tue le cochan an mije (on mange) la grillade ». - Epi de maïs à moitié mûr que l'on fait griller sur la braise. - (19) |
| grillade : s. f., panouille grillée. - (20) |
| grillaison, grille : s. f., grillage des feuilles ou des fruits par coup de soleil. - (20) |
| grillaize (n.m.) : grillage - (50) |
| grillat : grillon. - (21) |
| grillater : Sonner comme un grelot. « Ol a quate sous qu'o fa grillater dans sa peuche (poche) ». - (19) |
| grillaude (nom féminin) : partie solide qui reste lorsqu'on a fait fondre le lard de poitrine et que l'on peut incorporer dans une pâte briochée pour obtenir la « pompe à la grillaude ». - (47) |
| grillaude. n. f. - Galette de pâte à pain cuite avec des résidus de lard grillés (Saints, selon G. Pimouille). Se dit grignaude à Sougères-en-Puisaye. - (42) |
| grillaudes (n.f.pl.) : petits monceaux de lard grillés - (50) |
| grillaudes, s. f. petits morceaux de lard qui ont été grilles dans la poêle. (Voir : greille, griblaudes.) - (08) |
| grille : Gril. « Ments (mets) voir in ban morciau de boudin su la grille ». - (19) |
| grille : s. f., rangée d'épis de maïs suspendus et conservés sous les avant-toits des maisons. - (20) |
| grille, grillet, grillette, grillot, grillotière : s. m. et f., grillon mâle et femelle. - (20) |
| grille. Forme féminine de gril. Même sens. - (12) |
| grillée. s. f. Sorte de galette très-mince que l'on fait cuire sur les charbons à l'entrée du four, avant d'enfourner. (Lainsecq). – A Saint-Martin-sur-Ouanne, se dit d'une galette à l'huile cuite au four. - (10) |
| griller : la terre après le labour est souvent humide et par vent et soleil elle sèche, blanchit, et s’effrite facilement on dit que ça grille. - (59) |
| griller : v. a., griller quelqu'un, afficher sa publication de mariage au tableau grillagé de la mairie. Syn. de pendre. - (20) |
| griller. v. n. Ce mot, qui signifie brûler d'une ardeur excessive, se dit, à Etivey, pour trembler, sans doute par antiphrase, l'un étant tout à la fois le contraire de l'autre. – Employé figurément, griller exprime surtout la convoitise, un désir violent. On grille d'envie, par exemple, d'avoir telle ou telle chose. - (10) |
| grillet : s. m., hochet. Berceuse : « Un petit grillet d'argent Pour guérir le mal de dents...» - (20) |
| grîlli - frîlli : griller - (57) |
| grilli : Griller. « Y n'est pas par ta que le boudin grille » : ce n'est pas pour toi que le boudin grille, ce n'est pas toi qui profiteras de l'aubaine. - (19) |
| grîllions (dâs) : cellules pressées de la panne cuite de porc (certains disent aussi « dâs graittons », « das gréles ») - (37) |
| grillô. : Grillon du foyer. - T'a pri grillô signifiait: te voici à ma disposition. - (06) |
| grillon, s. m. cube de bois qui termine et maintient une pile plus ou moins considérable placée sur le port du flottage. - (08) |
| grillon. s. m. Terrain dont le sous-sol est pierreux ou imperméable. – Nom donné, dans le commerce et l'industrie, à une quantité d'objets de même nature et de même dimension, qui, pour être comptés plus facilement, sont régulièrement empilés par couches superposées de cinq ou de dix, disposées les unes en long, les autres en travers, et formant comme une espèce de grille. - (10) |
| grillot (on) : sonnette (du vélo) - (57) |
| grillot (on) : timbre (sonnette) - (57) |
| grillot : Grelot. « Man chin a pardu san grillot ». - Ampoule aux pieds ou aux mains. « T'as les mains treu (trop) tendres pa teni le mange de pieuche (le manche de pioche) i te farait veni des grillots ». - Grillon. « Grillot, grillot, sô de ta beurne ou sinan je t'ébeuille » : formula à laquelle les enfants attribuent le pouvoir de faire sortir le grillon de son trou. - Plante parasite des prés, à fleurs jaunes - Crête de Coq - Rhinante. - (19) |
| grîllot : grillon - (37) |
| grillot : grillon. III, p. 42 ; IV, p. 28 - (23) |
| grillot : 1 n. m. Grillon. - 2 n. m. Grelot. - (53) |
| grillot : s. m. petit baquet. - (21) |
| grillot : s. m., vx fr. grelet, baquet en bois, de forme ronde, servant aux mêmes usages que le cœur. - (20) |
| grillot : seau à bec. (CH. T II) - S&L - (25) |
| grillòt, et grûlòt, s. m., grelot : « O s'émuse à fâre souner son grillòt. » - (14) |
| grillot, grillon, grelot. - (05) |
| grillòt, s. m., grillon : « L’grillòt é dans la ch'vinée ; ô chante darrei les cenises. » - (14) |
| grillot, s.m, 1) grillon. 2) ampoule sous le pied. - (38) |
| grillot, subst. masculin : grillon. - (54) |
| grillot. Grillon. Etym. gryllus, griilon. - (12) |
| grillot. s. m. Se dit, dans certains cas, pour grillon, insecte, et, dans d'autres, pour grelot, petite sonnette. - (10) |
| grilloter, v. bruit que font les plantes sèches dont les graines font du bruit quand souffle le vent. - (65) |
| grilloter, v. intr., faire du bruit à la façon d'un grelot. - (14) |
| grilloter. Faire du bruit, comme un grillot, grelot. - (03) |
| grillotter, grillouter. v. n. Se dit des objets qui, étant secoués, font un bruit semblable à celui d'un grelot qu'on agite. On vend pour les enfants des hochets qui grillottent. - (10) |
| grîlot : 1 n. f. Plante graminée. - 2 adj. Tremble (ce qui tremble). - (53) |
| grimace (n.f.) : orge sauvage, orge dégénérée - (50) |
| grimace : mélange d'orge et d'avoine pour l'alimentation des animaux. - (52) |
| grimace : mélange d'orge et d'avoine. (SS. T IV) - N - (25) |
| grimace, n.f. mélange de céréales, souvent l'orge et l'avoine. - (65) |
| grimace. s. f. Mouture, mélange de blé, de seigle et d'orge. - (10) |
| grimaice, sf. grimace. - (17) |
| grimasse, grimousse : mélange d'orge et d'avoine pour l'alimentation des animaux. - (33) |
| grimasse, s. f. orge dégénérée. - (08) |
| grimôlai, grommeler, murmurer. On appelle en Bourgogne un grimolon celui qui a l'habitude de se plaindre, ou, comme il est dit dans le langage des Trouvères, de geindre... - (02) |
| grimölé, vn. trembler, frissonner de froid. - (17) |
| grimôle. Grommelé, grommèles, grommèlent. Grimôlai, grommeler. - (01) |
| grimoler, grimouler. v. n. Murmurer, grogner. - (10) |
| grimoler, v. a. disputer, discuter avec vivacité, se quereller en parlant. - (08) |
| grimon - chiendent ou sa racine. - Mon champ des Luas à mégé du grimon. - Le grimon et le piépou ci ne vaut dière mieux l'un que l'aute. - (18) |
| grimon (m), racines d'herbes sèches. - (26) |
| grimon : le chiendent, on dit également traînasse. - (46) |
| grimon, .sm. chiendent. - (17) |
| grimon, chiendent (herbe) ; égrimoné, arracher le chiendent. - (16) |
| grimon, chiendent, gramen. - (05) |
| grimon, chiendent. - (27) |
| grimon, n.m. chiendent. - (65) |
| grimon, s. m., chiendent. - (14) |
| grimon, s. m., chiendent. - (40) |
| grimon. Chiendent, triticum repens, du latin gramen. - (03) |
| grimon. Chiendent. Notre patois est plus conforme à l’étymologie que le français : il dérive du latin gramen. En morvandeau, grimon est de l'orge dégénérée : le chiendent porte le nom de grouache. Dégrimoner : arracher le chiendent. J'ons évu ben de lai pone pour dégrimoner note plante. - (13) |
| grimon. Le chiendent et en général toutes les mauvaises herbes qui sont un peu tenaces. Etym. grimper. - (12) |
| grimonè : enlever le grimon, le chiendent - (46) |
| grimoule. n. f. - Résidu de graisse fondue. (Sommecaise, selon M. Jossier) - (42) |
| grimoule. s. f. Résidu de graisse fondue. (Sommecaise). - (10) |
| grimousse, grimouène. n. f. - Semence composée de blé et d'avoine, destinée à l'alimentation du bétail. - (42) |
| grimousse. s. f. Mélange d'orge et d'avoine. (Chastenay). - (10) |
| grimpe ! (y) : (ça) monte ! - (37) |
| grimpe-chien, subst. masculin : tabouret, petit escabeau. - (54) |
| grimpillon n.m. Raidillon. - (63) |
| grincé. Grincer, grincez. - (01) |
| grinche. Difficile à écorcer. Eune noix grinche. Au figuré, une femme grinche est celle qui a le caractère difficile et la voix désagréable. L'Académie dit grincheux et grièche, et le patois de Dijon greigne. - (13) |
| grinci : grincer - (57) |
| grinci : Grincer. « Grinci les dents de colare », gronder. Voir granci. - (19) |
| grinci v. Grincer. - (63) |
| gringalet. Jocrisse et Gringalet étaient des comédiens de place publique ; le dernier a laissé son nom aux gens maigres, souffreteux, faibles de corps et d'esprit. Gringoire était un poète satyrique français du commencement du XVIe siècle. - (13) |
| gringe, adj., qui s'applique au blé. Le blé est gringe quand les épis sont maigres et les grains petits. - (14) |
| gringe, grange. - (16) |
| gringe. s. f. Grange. - (10) |
| gringnaler, v. trembler. - (38) |
| gringne (n.et adj.m. et f.) : grognon - (50) |
| gringne : (grin:gn' - subst. f.) céréale en général, graine. - (45) |
| gringne, adj. grognon, maussade, triste : « n'm'dié ran, i seu tô gringne », ne nie dites rien, je suis tout maussade. - (08) |
| gringner : (grin:gné - v. intr.) rendre, produire du grain. - (45) |
| gringué, vt. secouer des objets sonores, petits grelots ou sonnettes. Secouer, tripoter. Taiche de ne pas gringué mes gaichötes : menace à un gars un peu trop entreprenant auprès des filles. - (17) |
| gringuenaler : Produire un bruit irrégulier et désagréable en s'entrechoquant. « T'as pas fini de fare gringuenaler tes sabeuts ». - (19) |
| gringuenauder : fureter. - (30) |
| gringuenaudes : s. f. pl., gringuenaude, débris d'aliment ; hardes. Lyonnais : gringuiniotte, menus restes d'un pâté, d'une tourte, d'une brioche. - (20) |
| gringuenotai. : Fredonner, chanter comme le rossignol, le pinçon. - (06) |
| gringuenoter, v, intr., gringotter, fredonner, chanter comme le pinson, comme le rossignol. - (14) |
| gringuenotter. Intraduisible par un mot exactement correspondant ; gringuenotter se dit du bruit que font de menus objets en s'entrechoquant, ou contre les parois du récipient dans lequel ils sont renfermés. Etym. onomatopée. Gringuenotter a fait gringuenottes, menus objets qui gringuenottent. - (12) |
| grinjon : osier sauvage dans une rivière. - (31) |
| grin-ne : f. graine. - (21) |
| grinze : grange. - (52) |
| griolis. s. m. Grésil, petite grêle. (Vertilly). - (10) |
| grionche, maussade. (Voir au mot graigne.) - (02) |
| griottî n.m. Griottier ou cerisier aigre. - (63) |
| griotti: (nm) cerisier sauvage - (35) |
| gripai, prendre avec avidité , soustraire lestement... - (02) |
| gripai. : Prendre furtivement. Ce verbe peut donner l'idée des réduplicatifs si usités en Bourgogne : on disait, en effet, regripai, saisir de nouveau, et resegripai, ressaisir une 3e fois. - (06) |
| gripe, s. f., grippe, catarrhe épidémique. Au fig. femme brusque, mauvaise, emportée : « Voui, ces fonnes iqui, y é des vrâ gripes. » - (14) |
| gripe. Fille OU femme brusque, emportée, prête pour un rien agripper au colet les personnes qui lui parlent. « C’at éne gripe », c'est une pétulante ; et au pluriel « c'a dé gripe », ce sont de brusques femelles. - (01) |
| gripe. Griffe. - (03) |
| gripe. : Fille brusque, pétulante et prête a sauter au collet des gens (Del.). - (06) |
| gripi. Grippai, grippas, grippa. Griper ne signifie pas, comme je pense, ravir subtilement, mais vite, et de force. - (01) |
| grippat, grippot. s. m. Petite côte, petite montagne, que gravit un chemin étroit, un sentier rude, ditficile. (Soucy). - (10) |
| grippe-tout-nu : s. f., sage-femme. La Mère Grippe-tout-nu. - (20) |
| gris - grige : Gris, féminin grige. « Eune reube grige ». - (19) |
| gris gris : « Fare les gris gris » : chatouiller légèrement, pour s'amuser. - (19) |
| grisemotte n.m. Fruit résultant de la seconde floraison dans les vignes jeunes et très vigoureuses. - (63) |
| grisemotter v. Procéder à une 2ème récolte de raisins. - (63) |
| grisené, vn. grisonner. S’assombrir. - (17) |
| grisôle, s. f. groseille. - (22) |
| grisôtte, grisette, jeune ouvrière... - (02) |
| grispigne : hargneux, méchant. (VSLD. T II) - S&L - (25) |
| grispin, adj., disposé à griffer : « Méfie-te : y et eùne grispine. » - (14) |
| grispine : voir crispine. - (20) |
| grispine, s. f. petite fille d'humeur difficile, qui a bec et ongle pour se défendre. - (08) |
| grispine, s. f., femme ou fille méchante. - (40) |
| grispiner, v. a. saisir avec les mains ou plutôt avec les ongles dans un mouvement de colère. On dit d'un enfant hargneux qu'il « grispine » sans cesse. - (08) |
| grispiner, v. tr., saisir des mains et des ongles. - (14) |
| grissoler, v. tr., rissoler, jaunir. Faire grissoler un morceau de viande, c'est le « faire revenir », le dorer au feu. - (14) |
| gristille : voir cristille. - (20) |
| gristilli : Grignoter. « Te gristilleras bin in cac'eut » : tu grignoteras bien un « cac'eut ». - (19) |
| griugalé, enfant petit, maigrelet. - (16) |
| griv ale et grivolo. Tacheté. En vieux français grivolé - (03) |
| grivalon, s.m. onglée. - (38) |
| grive, adj. de couleur rouge avec quelques parties blanches : une vache « grive », un veau de poil « grive. » - (08) |
| grivelé, adj. se dit du bois dont les tissus végétaux sont attaqués de la gelivure. - (08) |
| grivoi. Un grivois, c'est un gaillard, un drôle. - (01) |
| grivolòt, adj., grivelé, tacheté de gris et de blanc, comme la grive. - (14) |
| grivot, grivotte, nom de bœuf ou de vache au poil grive. (Voir : grive.) - (08) |
| griye, gril et clôture de barreaux. - (16) |
| griyé; el on griye d'anvie, il en a fortement envie. - (16) |
| gro (gro de sel) : mortier pour le gros sel - (48) |
| gro : vase où l'on écrase le sel. (MM. T IV) - A - (25) |
| grö, grè, sm. sébille en bois, pour le sel. [Cf. graal ?] - (17) |
| grô, s. m. vase de forme arrondie et ordinairement creusé dans un petit bloc de bois. Ce vase sert à divers usages et entre autres à renfermer la pâte avant la cuisson du pain. - (08) |
| grô, très, beaucoup ; grô saivan, très savant ; el à grô m'lède ! il est bien malade. - (16) |
| gro. Gros. - (01) |
| gro-ale : grêle. (B. T IV) - S&L - (25) |
| grobe : s. f., grobon : s. m., vx fr. grebion, souche de bois. - (20) |
| gròbe, s. f. chicot d'arbre mal abattu (du vieux français grebion). - (24) |
| grodiller (v. tr.) : grignoter - (64) |
| grodiller. v. - Croquer, grignoter. - (42) |
| grôdissime, adj. superlatif de gros, exprimant chez nous le maximum des choses avec une emphase toute locale. - (08) |
| grœle, s. f. grêle. - (24) |
| grœlliai ou guœrlice, s. m. grillon. - (22) |
| grœlliòchon, s. l'n. petit grelot. Verbe grœlliòchi, faire un bruit de grelot. - (24) |
| grœlliœ, m. grillon. - (24) |
| grœlliouchon, s. m. petit grelot. Verbe : grœlliouchi. - (22) |
| grœm’vaire, s. f. première apparition de maturité du raisin, quand la « grœme » « vairit » : j'ai vu de la grœm’vaire. - (22) |
| grœme, s. f. grain de raisin. Avoué sa grœme, loc. être gai par commencement d'ivresse. - (24) |
| grœmlou*, s. m. chiendent. - (22) |
| grœm'vaire, s. f. première apparition de maturité du raisin, quand la « grœme » « vairit » : j'ai vu de la grœm’vaire (du vieux français vair, bigarré. Latin varius). - (24) |
| grœpe, adj. agressif, hargneux. - (24) |
| grœp'llioeu, adj. rugueux. - (22) |
| groeu, adj. gros. Féminin greusse. - (24) |
| groeu, adj. gros. Féminin : grousse. - (22) |
| groeu-lan-groeu (de), loc. provisoirement et hâtivement : faire de groeu-lan-groeu un travail pressé. - (22) |
| grœumicho : s. m. peloton de fil. - (21) |
| groeu-zen-groeu (de), loc. provisoirement et hâtivement : faire de groeu-zen-groeu un travail pressé. - (24) |
| grogalou (ouse) : (grogalou - adj.) rêche, rugueux. - (45) |
| grogèle, sf. groseille. - (17) |
| grogelö, sm. groseiller. - (17) |
| grognâd (on) : grognard - (57) |
| grognalou : plein de trou et de bosses - (51) |
| grognasse : s. f., tête de cochon ; viande inférieure. - (20) |
| grognasse, s. f. replis de la peau du cou : quelle grognasse ! - (24) |
| grogne : souche de haie. A - B - (41) |
| grogne : bosse - (51) |
| grogneuté, vn. émettre de petits grognements. Se dirait par ex. d'un orgue de barbarie. - (17) |
| grogni : Bouder. « Y a bin langtemps qu'i se grognant » : il y a longtemps qu'ils se boudent, qu'ils s'adressent plus la parole. - (19) |
| grogni : grogner - (43) |
| grogni : grogner - (57) |
| grogno : chicorée sauvage. (E. T IV) - S&L - (25) |
| grognô, s. m., panicaut des champs. - (40) |
| grognoû, et grougnoû, adj., grognon, grondeur, pleureur. Une femme grogneuse, grondeuse, on l'appelle Marie-Grognou. - (14) |
| groguer, v. a. croquer, manger quelque chose qui croque sous la dent. - (08) |
| groin d’âne : pissenlit à feuilles velues. Appelé aussi barkhausie ou « mourre du porc », il relève le goût des salades. - (62) |
| groin d'âne, s. m., même sens. - (40) |
| groin, le mufle d'un animal, et, par une extension grossière, la figure d'une personne irritée. Ainsi, être en groin, ou faire le groin, c'est être dans un état d'hostilité flagrante avec quelqu'un. En latin, grunnire, grogner. - (02) |
| groin. : Être en groin c'est être en état d'hostilité, de grognerie (rac lat. grunnire) avec quelqu'un. - (06) |
| groindane : (nf) sorte de pissenlit à larges feuilles - (35) |
| groin-d'ane : variété de chicorée que l'on met en salade avec des lardons grillés. (CH. T II) - S&L - (25) |
| groinge (n.f.) : grange - (50) |
| groinge : grange. - (29) |
| groinge : grange. On rentre le foin dans la groinge : on rentre le foin dans la grange. - (33) |
| groinge, s. f. grange. - (08) |
| groinge. s. m. Grange. (Domecy-sur-le-Vault, Givry, etc.). - (10) |
| groingner, v. a. grogner, murmurer entre ses dents en grondant. - (08) |
| groingnerie, s. f. gronderie, murmure ou parole d'humeur, de mécontentement. (Voir : grignar, grignon, gringne, groingner.) - (08) |
| groingnon, s. m. grognon, celui qui murmure entre ses dents en grondant. - (08) |
| groingnot. s. m. Qui flatte le groin et, par extension, croûton de pain, parce que, quand il est frais, il a quelque chose de délectable pour le groin d'un gourmand. (Etivey). - (10) |
| groinze : grange - (39) |
| groitte, n. fém. ; cerise sauvage. - (07) |
| groitter, n. masc. ; cerisier sauvage. - (07) |
| Gro-Jan. Gros-Jean, nom du vigneron mari de Breùgnette, dans la chanson en dialogue imprimée à la suite des Noêls. Gros-Jean, d'ordinaire, est un synonvme de rustre… - (01) |
| grôlâ(s) : petit(s) grêlon(s) - (39) |
| grôlâ, s. m. grêlon, grain de grêle. - (08) |
| grolasse, groulasse : voir grouasse. - (20) |
| grolat, grésil - (36) |
| grôle (n.f.) : grêle - (50) |
| grôle : grêle - (48) |
| grôlè : grêler - (46) |
| grole : Vieille chaussure. « Eune pâre de groles ». - (19) |
| grôle : (grô:l' - subst. f.) grêle. - (45) |
| grôle : grêle - (39) |
| grôle, grêle ; grôlé, grêler. - (16) |
| grôle, s. f. grêle. - (08) |
| gròle, s. f. vieille chaussure. Diminutif grôlon (vieux français). - (24) |
| grôle, s. f., grêle. - (40) |
| grôle, s.f. grêle ; le Grôlé est le surnom d'une personne qui a eu la petite vérole ; grôler : v. grêler. - (38) |
| grôlé, agiter, secouer, par exemple, un arbre, pour en faire tomber les fruits mûrs. On dit aussi d'un homme qu'il est grôlé, quand sa figure est tachetée de marques de vérole. On dit d'une dent ébranlée qu'elle grôle. - (16) |
| grôlé. adj. Grêlé, marqué de la petite vérole. - (10) |
| grôle. s. f. Grêle. (Domecy-sur-le-Vault, Givry, etc.). - (10) |
| grôlée. s. f. Riz, vermicelle ou pois frits, que les mariés de l'année et les étrangers nouvellement domiciliés sont tenus de distribuer aux enfants dans certains villages, à Chastenay, par exemple, le premier dimanche de carême ou dimanche des Brandons. De groler, rissoler, griller. Voyez guernaulée. - (10) |
| grôler (v.imp.) : grêler - (50) |
| grôler (verbe) : bouger, trembler. (Le p'tit Jean une dent qui grôle, al va pas tarder à tomber). - (47) |
| grôler : bercer (crouler). - (32) |
| grôler : bercer, par extension : secouer - (60) |
| grôler : grêler - (48) |
| grôler : secouer, bercer. IV, p. 59-d - (23) |
| grôler : Secouer, remuer. « Grôler in preumé » : secouer un prunier pour en faire tomber les fruits. On dit de quelqu'un au comble de la satisfaction : « O cra (croit) que le Ban Dieu li grôle des pêches ». - (19) |
| grôler : secouer. « Grôler l’calâter » : secouer le noyer…pour faire tomber les noix. - (62) |
| grôler : (grô:lè - v. imp.) grêler. - (45) |
| grôler : grêler - (39) |
| grôler, v. impers. grêler. Se dit de la grêle qui tombe. - (08) |
| grôler, v. se dit en parlant d'un, objet qui n'est pas fixé sur sa base et qui remue ; d'une dent dans son alvéole. - (38) |
| groler. v. - Dorloter, caliner. (Arquian) - (42) |
| grôler. v. a. et n. Grêler. - (10) |
| gròli, s. m. cordonnier ambulant qui est censé raccommoder surtout des « gròles ». - (24) |
| grollasser : v. n., traînasser la grolle. - (20) |
| grollasson : s. m., syn. de grolle. - (20) |
| grolle : lambin. - (30) |
| grolle n.f. (lat. pop. grolla). Vieille chaussure. - (63) |
| grolle : s. f., vx fr. grole, vieux soulier, savate. - (20) |
| groller : v. n., aller, marcher, traîner la grolle. - (20) |
| grolleur, grollier (vx fr. grolier), groulli, grollassoux : s. m., savetier. Voir regrolleur. - (20) |
| grolli-grollant : Ioc. adv., marchant tout doucement, en traînant la grolle. La voilà qui s'amène grolli-grollant. - (20) |
| grollon : s. m., syn. de grolle. - (20) |
| grôlon : (nm) grosse chaussure - (35) |
| grolon : frelon. (RDM. T IV) - B - (25) |
| grôlon : grêlon. - (29) |
| grôlon : grosse chaussure - (43) |
| grôlon : (grô:lon: - subst. m.) grêlon. - (45) |
| grôlon(s) : grêlon(s) - (39) |
| grolot. Vase ou écuelle en bois. Te vas ailler queri du vin blanc doux dans le grôlot.... A Autun on dit grôlotte et à Lons-le-Saunier grelot. - (13) |
| grolotte (nom masculin) : petite échelle. - (47) |
| grolotte : petite écuelle - (48) |
| grolotte : petite écuelle, porte-monnaie. - (33) |
| grôlotte : bourse - (39) |
| grolotte, n. fém ; boîte en bois. - (07) |
| grolotte, s. f. écuelle ou vase de bois. - (08) |
| grolotte. n. f. - Écuelle en terre, au bord décoré d'une bordure marron. - (42) |
| grolotte. s. f. Petite écuelle de terre. Une grolotte d'un sou. - (10) |
| gromette. s. f. Mentonnière. C'est une altération de gourmette, chainette de fer attachée à la bride du cheval et qui passe sous la ganache ou mâchoire inférieure. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| grômiau : (nm) fanon de la vache - (35) |
| gromlœ, s. m. chiendent. - (24) |
| grommellon : (nm) plis, bourrelet - (35) |
| gromna : bourdon - (44) |
| grond - brouillerie, rancune. - Le Colas Bairbier et le père Chauvenet sont en grond, i ne sai pâ d'où voint. - I n'eume pâ éte en grond, mouai, pâ moinme d'aivou in enfant ; c'a don si béte ! - (18) |
| gronde (na) - gravallon (on) : frelon - (57) |
| gronde : (nf) guêpe - (35) |
| gronde n.f. (de gronder). Guêpe, mais aussi, terme générique désignant abeille, guêpe et frelon. - (63) |
| gronde : guimbarde - (39) |
| gronde : s. f., guêpe ; guimbarde (instrument de musique). - (20) |
| gronde, frelon dont le bourdonnement paraît avoir formé ce vocable. - (11) |
| gronde, grond'na: Frelon. Fig. Personne méchante, difficile à contenter. - (49) |
| gronde, s. f. guêpe. - (22) |
| gronde, s. f. guêpe. - (24) |
| gronde, subst. féminin : guêpe, bourdon, mouche à bouses de vache. - (54) |
| grondée, s. f., gronderie, reproche, réprimande : « D'avou lu, tôjor des grondées ! » - (14) |
| grondenard, s. m., bourdon noir. - (40) |
| gronder (se), se bouder. - (27) |
| gronder (se). Etre brouillés ensemble. - (12) |
| grondnâ, subst. masculin : bourdon ou frelon. - (54) |
| grond'ner. Murmurer méchamment. - (49) |
| gron-gron (faire), loc. à l'usage des enfants. Grogner, gronder. - (08) |
| groniot, subst. masculin : laiteron, groin d'âne, plantes ressemblant à des pissenlits. - (54) |
| gronner (pour grogner). v. n. Se dit d'un chien qui aboie sourdement, ou d'une personne qui grommelle entre ses dents. (Chastenay). Du latin grunire. - (10) |
| gronzalaï, s. m., groseillier. - (40) |
| gronzalai, s.m. groseiller. - (38) |
| gronzale, s. f., groseille. - (40) |
| gronzale, s.f. groseille. - (38) |
| gros - beaucoup, outre le sens du français. - A m'en velant gros pais ce qui ai dit que dans c't'aifâre lai a n'en pas étai francs. – C'a in gairson qu'à gros bein, i sera fier ne l'aivoir pour genre. C'â in gros malheur. - (18) |
| gros adv. Beaucoup. - (63) |
| grôs baivard (l’) : (l’) almanach annuel intitulé « le gros bavard » - (37) |
| gros comme une pointe (à tracer) : maigre, fluet. - (54) |
| gros de mur : Terme de maçon « Eune piarre que fâ gros de mur » : une pierre qui a toute l'épaisseur du mur. « Pa qu'eune meuraille sait bin solide i faut des gros de mur ». - (19) |
| gros de mur : s. m., mur de refend ; grosse pierre entrant dans la construction d'un mur, dont elle a toute la largeur, et quelquefois même en dépassant les parements. - (20) |
| gros de, adv., beaucoup. - (40) |
| gros d'hai : bien insupportable. (PSS. T II) - B - (25) |
| gros tarin : terre argilo-calcaire. A - B - (41) |
| gros tarrain, tarre grasse : terre argilocalcaire - (43) |
| gros : adv., très, beaucoup, bien. Il est gros bête. - (20) |
| gros : s. m., ancienne mesure de poids, correspondant au 1/8 de l'once, comme le treizeau, et valant 3 grammes 824. - (20) |
| gros, adv., beaucoup : « Y é gros bon ; j'y ainme gros ! » - (14) |
| grôs, grôss' : adj. Gros, grosse. - (53) |
| gros, s. m. gros, grand, fort, riche, puissant. - (08) |
| grôsailé, grousaillé : n. m. Groseiller. - (53) |
| gros-cul : tabac gris, « caporal ordinaire », renfermant souvent des « bûches » - (37) |
| grosses dents (parler des), loc., parler sévèrement : « Alle étôt ben penaude ; son pâre l'i a parlé des grosses dents. » - (14) |
| grossier, adj. épais, rustique. S’emploie en parlant des personnes. Une femme « grossière » est une grosse femme mal bâtie, d'épaisse encolure. - (08) |
| grossier, grossière, adj., gros, grosse. - (20) |
| grotan : Chanteau de pain. « Donner le grotan de pain bénit » : donner le chanteau de pain bénit à la personne qui doit offrir le dimanche suivant. - Au figuré, donner un exemple à suivre : « Alle na veut pas tarder de se mairier sa voisine li a donné le grotan ». « Le grotan des conscrits » miche de pain que les jeunes gens qui venaient de tirer au sort passaient aux « sous-conscrits » (futurs conscrits) qui la conservaient jusqu'à l'année suivante. - (19) |
| grote, cerise, en général ; groté, cerisier. - (16) |
| gròter, v, tr., bercer : « Jean-néte, veins groter l' petiot, qu'ô peùrne ein còp l'seûme. » - (14) |
| grotter, bercer. - (05) |
| grotter. Bercer. - (03) |
| grottes et grotté, pour griottes - petites cerises sauvages. - Les enfants aibimant les cerilliers que sont su le pâtier pour cueillai les grottes. - In grotté ne sert ai ran, entez mouai don dessus des bonnes ceries. - (18) |
| grottoir, hachoir en forme de berceau. - (05) |
| grou : tas de gerbes dans le champ avant la mise en dzerbire* à la ferme. A - B - (41) |
| grou (adjectif) : gros. Au féminin : grousse. - (47) |
| groû : gros. - (52) |
| grou : tas de gerbes de sarrasin rassemblées dans un champ avant d'être mises en gerbiers - (43) |
| groû : gros. - (33) |
| grou de sarrasin : moyette de sarrasin - (43) |
| groû, groûsse : gros, grosse - (48) |
| grouâche (n.f.) : chiendent (aussi vingron, vigron) - (50) |
| grouâche, s. f. chiendent, plante qui abonde dans nos terrains granitiques. - (08) |
| grouaïlle, s. m., poule qui couve sur le nid. - (40) |
| grouali, grouaillier, greusailler. s. m. Groseillier. (Girolles, Coutarnoux, Etivey). - (10) |
| groualle, greusalle. s. f. Groseille. - (10) |
| grouasse (nom féminin) : poule qui demande à couver. On dit aussi grousse. - (47) |
| grouasse, groulasse, grolasse : s. f., poule qui groue ou qui demande à grouer. - (20) |
| grouasser, groulasser, grolasser : v. n., demander à grouer. - (20) |
| groube*, s. f. chicot d'arbre mal abattu. - (22) |
| groucher (se), v. réfl. s'enorgueillir, se targuer de quelque chose : se faire gros ? - (08) |
| groué (p.p.) : p.p. du verbe grouer = couver - un u groué = un oeuf couvé - (50) |
| groue : (nf) gros paquet de gerbes - (35) |
| groue : meule de paille entreposée avant le battage - (51) |
| groué : renfermé (sentir le —) - (30) |
| groue n.f. (de grouer). Meule (surtout de colza et de sarrazin), tas de gerbes dans un champ ou une cour, de forme arrondie comme une poule qui groue. Voir dzerbîre. - (63) |
| grouè : n. m. Couver. - (53) |
| groué, adj. couve : un œuf « groué », œuf qui a été mis sous la couveuse. Ne s'emploie guère que dans cette locution. - (08) |
| groué. Corrompu. Du vin groué, de l’iâ grouée. La petite ville de Mamers a une grande place non pavée et marécageuse : on l'appelle place de grouas. - (13) |
| grouêche : poule couveuse (en A : croque*). B - (41) |
| grouêche : poule couveuse - (34) |
| grouèche : Poule qui demande sans cesse à couver. - (19) |
| grouèche n.f. Poule couveuse, femme protectrice pour ses enfants et agressive pour protéger ses petits. - (63) |
| grouée : n. f. Eau croupie. - (53) |
| grouée : s.f., couvée. - (20) |
| grouée. n. f. - Couvée. (Arquian) - (42) |
| grouègner : grogner - (48) |
| grouelle, s. f. groseille, fruit du groseillier. - (08) |
| grouer : couver. A - B - (41) |
| grouer (s’) : (se) câliner - (37) |
| grouer (v.t.) : couver - (50) |
| grouer : (vb) couver - (35) |
| grouer : blottir dans un coin douillet, cajoler ; aimer se faire grouer : aimer se pelotonner, pour être cajolé (sens d'origine : couver). - (56) |
| grouer : couvée - (60) |
| grouer : couver - (34) |
| grouer : couver - (43) |
| grouer : couver - (44) |
| grouer : couver - (51) |
| grouer : couver des oeufs. A noter que le verbe anglais « to grow » signifie : naître et croître, grandir. - (62) |
| grouer : couver, protéger, flatter - (37) |
| grouer : couver. - (31) |
| grouer : couver. (C. T III) - B - (25) |
| grouer : Couver. « Ma pouleille groue » : ma poule couve. Au figuré « Grouer eune malédie » : couver une maladie. - (19) |
| grouer ou grouver. Couver. - (03) |
| grouer v. (lat. pop. grodare, couver, mot d'or. gaul.). Couver. Aga-don la Paulette, vlà-ti pas qu'alle groue ! Regarde la Paulette, elle est enceinte ! - (63) |
| grouer : couver - (39) |
| grouer : couver. (CH. T II) (BY. T IV) - S&L - (25) |
| grouer : v. couver. - (21) |
| grouer : v. n., couver (au prop. et au fig.), et, par extension, être pleine ou grosse. - (20) |
| grouer, couver des œufs. - (05) |
| grouer, se dit de l'eau qui séjourne à une faible profondeur, dans certains terrains marécageux. - (11) |
| grouer, v. couver (un œuf). - (65) |
| groûer, v. tr., couver : « N'vas pis déranger not' poule ; all’ groue. » - (14) |
| grouer, v., couver. - (40) |
| grouer, verbe intransitif : couver ou demander à couver. - (54) |
| grouer,v. se dit d’une poule qui, couvant, fait entendre un chant particulier ; poule qui groue : poule qui couve. - (38) |
| grouer. Couver. - (49) |
| grouesse (n.f.) : poule couveuse (aussi courosse) - (50) |
| grouesse, grouïre, groute : poule couveuse - (43) |
| grouesse, groûsse : poule qui couve - (37) |
| grouesse, gröyesse : (nf) poule couveuse - (35) |
| grouesse, n.f. poule pondeuse. - (65) |
| grouette : griotte - (48) |
| grouette : poule couveuse. - (30) |
| groueuse. Couveuse. - (49) |
| grougelin, groseillier. - (26) |
| grougi : ronger, grignoter. A - B - (41) |
| grougner, v. grogner. - (38) |
| groûgner, v. tr. et intr., gronder, grogner. - (14) |
| grougno : croûton de pain. (T. TIV) - Y - (25) |
| grougnon, s. m. morceau de pain, croûte, croûton. - (08) |
| groûgnot : pissenlit. - (32) |
| grougnot : bord croustillant de galette - (39) |
| grougnot. s. m. Petit morceau de pain rompu d'une tartine. (Courgis).-Roquefort donne grognon, grignotte, morceau de pain, miette, menue parcelle. - (10) |
| grougnou : grincheux. - (62) |
| grouillai, remuer. Tout y grouille, c.-à-d. tout y remue. (Voir au mot craulai.) ... - (02) |
| grouillè : se dépêcher - grouille te don, dépêche-toi donc - (46) |
| groûiller (se) : dépêcher (se) - (48) |
| grouiller : v. a., creuser un fruit, par ex. pour en enlever le noyau, une portion gâtée, etc. - (20) |
| grouiller. v. n. Pulluler, remuer, s'agiter pêle-mêle, frétiller. – Se grouiller. v. pronom. Se remuer, s'agiter, se secouer, se donner du mouvement. Grouille-toi, pour aller plus vite. - (10) |
| grouilli (se) : se dépêcher - (43) |
| grouilli (se) v. (du moy. néerl. grollen, gronder). Se dépêcher. - (63) |
| groûilli : grouiller - (57) |
| grouillon : (nm) noyau, pépin - (35) |
| grouillon : cerneau de noix - (51) |
| grouillon : noyau, pépin - (43) |
| grouillon : s. m., amande contenue dans le noyau d'un fruit, et, par extension, le noyau lui-même. - (20) |
| grouillot : personne bonne à tout faire - (44) |
| grouinge : (grouin:j' - subst. f. ) grange. - (45) |
| grouinge : grange - (48) |
| grouinge : grange. (B. T IV) - D - (25) |
| grouinge : n. f. Grange. - (53) |
| grouire (tssoctire) : poule qui couve - (51) |
| grouisse(asse) : poule couveuse - (60) |
| groujélî n.m. Groseillier. - (63) |
| groujelle n.f. Groseille. - (63) |
| groujon : morceau de pain. A - B - (41) |
| groûlan (n. m.) : bourdon, grosse abeille - (64) |
| groule, s. f. vieille chaussure. Diminutif : groulon. - (22) |
| groule, s. m. le groule est l'époque du passage des bécasses au printemps. - (08) |
| groûlée, et grôlée, s. f., forte secousse donnée à un arbre chargé de fruits : « Oh ! la ball' groulée ! toutes les peùrnes ont chu. Si t'en veù, en v'là. » - (14) |
| grouler : secouer un arbre pour en faire tomber les fruits. A - B - (41) |
| grouler : (vb) secouer (un arbre fruitier) - (35) |
| grouler : cahoter - (43) |
| grouler : gargouiller. (F. T IV) - Y - (25) |
| grouler : gauler. - (30) |
| grouler : secouer - (44) |
| grouler : secouer - (51) |
| grouler : secouer, trembler. - (31) |
| grouler : v. secouer (les arbres). - (21) |
| grouler : voir crouler. - (20) |
| groûler, croûler v. Secouer. - (63) |
| groùler, et grôler, v. tr., secouer un arbre pour en faire tomber les fruits : « Dis donc, Jacot, veins-tu grouler l'poirei? » - (14) |
| grouler, v. a. concasser, briser à demi, grossièrement. On « grouie » l'avoine, l'orge, pour la nourriture des animaux. - (08) |
| grouler, v. secouer. - (65) |
| groûler, v., secouer les branches pour faire tomber les fruits. - (40) |
| groûler, verbe (in) transitif : ébranler, secouer. - (54) |
| grouler. Agiter. J’aillons fâre des confitures, an faut grouller not’ peurner... - (13) |
| grouler. Crouler, secouer. - (49) |
| grouli, s. m. cordonnier ambulant qui est censé raccommoder surtout des « groules ». - (22) |
| groullion, s. m. noyau d'un fruit. Verbe grouyi, extraire un noyau en creusant ; toute action de creuser. - (24) |
| groullion, s. m. noyau d'un fruit. Verbe : grouyi, extraire un noyau en creusant ; toute action de creuser. - (22) |
| groulon : voir gourlon - (23) |
| groulotte et gruillotte : gelée de cuisine. Mai tante, baillez-moi de lai groulotte dévou mon jambion. - (13) |
| groulotte, s. f., gelée obtenue, en faisant cuire un os. - (40) |
| grouniau. s. m. Noyau de fruit. - (10) |
| grouosse, s. f., poule qui se cache pour couver. - (40) |
| groupé : v. t. Grouper. - (53) |
| grouper. v. a. Empoigner quelqu'un, se colleter avec lui, le culbuter et tomber dessus, c'est un groupe. Aussi le malin, à qui l'on cherche querelle, ne manque de dire prends garde à toi, j'vas te grouper. - (10) |
| groupessèce (group'sèce), groupes-sêche, gropessèce : s. f., tas d'ordures. A rapprocher des mots bas-latins gropa (amas) et grossicies (immondices). - (20) |
| groupi : Croupir. « De l'iau groupie ». - (19) |
| groûs (on) : gros - (57) |
| groûs : gros - (57) |
| grous : gros. - (32) |
| grous, grousse (n. et adj.m. et f.) : gros, grosse - (50) |
| grous, grousse : gros, grosse - (61) |
| grous, grousse. adj. et n. - Gros, grosse. - (42) |
| grous, grousse. adj. Gros, grosse. Un grous mouciau de couchon. Une grousse femme. - (10) |
| grousailler : groseillier. - (33) |
| grousale, s. f. groseille. - (24) |
| groûsalle : groseille - (48) |
| grousallé : groseiller - (48) |
| grousalle. s. f. Groseille. - (10) |
| grousaller, grusaller. s. m. Groseillier. - (10) |
| grousèle. s. f., groseille. - (14) |
| grouselei, s. m., groseillier. - (14) |
| groûsse (na) : grosse - (57) |
| groûsse : 1. grosse. Ène groûsse treuffe : une grosse pomme de terre. 2. enceinte : El-l'ot groûsse. - (52) |
| groûsse : grosse - (57) |
| groûsse : grosse. Une groûsse treuffe : une grosse pomme de terre. Elle o groûsse : elle est enceinte. - (33) |
| grousse, s. f., poule couveuse ou qui demande à couver. - (11) |
| groûssi : grossir - (57) |
| groussier, groussière et groussiée. adj. m. et f. Grossier, grossière. - (10) |
| grouter, grousser : voir greuter. - (20) |
| grouter, v. bercer. - (65) |
| grouyi v. Creuser un fruit pour enlever le noyau ou une portion gâtée. - (63) |
| grouyon n.m. (du lat. carulium, l'amande de la noix). Noyau de petit fruit. - (63) |
| grouz’li : (nm) groseillier - (35) |
| grouzale (n.f.) : groseille - (50) |
| grouzale, s. f. groseille. « Groualle ». - (08) |
| grouzalé, s. m. groseillier. « Grouaillé ». - (08) |
| grouzaler (n.m.) : groseiller (aussi grouzalé) - (50) |
| grouzeulle : (nf) groseille - (35) |
| groyé, vt. gratter, éplucher. Fouiller minutieusement. - (17) |
| grû, s. m., brôme {bromus secatinus), parasite du seigle, qu'il rend moins farineux. Donne un fourrage vert abondant, mais durcit à sa maturité. - (14) |
| gruache, s. f., chiendent, d'où le verbe dégruacher, arracher le chiendent dans un champ. - (11) |
| gruche : pré très pentu - (61) |
| gruche, gruchon : brioche. - (30) |
| gruchi : Bercer. « J'ai sone je va aller me couchi a peu je répands que je n'arai pas faute de gruchi » : j'ai sommeil je vais aller me coucher et je te certifie que je n'aurai pas besoin d'être bercé. - (19) |
| grue, s. f., plante vénéneuse. - (14) |
| grue. Meulon. S'emploie surtout pour désigner un meulon de colza. - (49) |
| gruettes : voir queues de pouééle - (23) |
| grugelle (gruzelle) : groseille - (51) |
| grugelli (gruzelli) : groseillier - (51) |
| grugnon (on) : croûton - (57) |
| grugnot, croûton de pain. - (05) |
| grûgnòt, s. m., morceau de pain, ce qui reste de la miche, ou du morceau que l'on grignote. - (14) |
| grugnoter, manger doucement. - (05) |
| grûgnoter, v. tr., grignoter, manger lentement, mordiller. - (14) |
| gruillè : trembler, grelotter - (46) |
| gruillé, vn. trembler, grelotter. - (17) |
| grûiller : trembler, remuer fébrilement. - (32) |
| gruiller, trembler de froid. - (28) |
| gruiller, trembler sous l'action du froid. - (27) |
| gruiller. Trembler, c'est le vieux mot grouiller. - (03) |
| gruilliot - grillon ou grillot, insecte. - Que train les gruillos faisant dans les prais ; c'â signe de chaud. - C'à bein embêtant, ailé ! tote lai neu les gruillots que chantant vé note feu ! - (18) |
| gruillöt, sm. grelot. Ampoule, cloque due à une talure. - (17) |
| gruillotte : le fromage de tête de sanglier - (46) |
| grujai, manger ou dissiper l'avoir de quelqu'un... - (02) |
| grujé du sel : le piler. Grujé se dit aussi de celui à qui l'on a fait tort, en lui faisant payer plus qu'il ne devait. - (16) |
| grûler - croûler - crûler : gauler - (57) |
| grûler - crûler : crouler (secouer) - (57) |
| grûler, v. intr., trembler, greloter : « A c'maitin, l'vent a torné. Y é la bise ; i'grûlons d'frèd. » - (14) |
| grullai, trembler. (Voir au mot craulai.).. - (02) |
| grulle. Tremble. Grullé, trembler… - (01) |
| gruller : grelotter. - (66) |
| gruller : trembler. - (29) |
| grulliai - grelotter, trembler. - En fait bein froid ajedeu ; vraiment, i gruille. - I grulliains préque dan note lai. - Ce que vos disez lai me fait gruillai. - (18) |
| grullò. Tremblait de froid. « On grulle et tô de pôô », tremble aussi de peur. Les deux II se mouillent dans le verbe grullé. - (01) |
| grûlot, s. m., ampoule. Analogie avec la sphéricité du grelot. - (14) |
| grumaler (gr'maler) : v. n., grainer, faire graine, être enceinte. - (20) |
| grume (C.-d., Chal., Br.). greume (C.-d., Y.), grème (Morv.). - Grain de raisin, du latin grumus, qui signifie grumeau ; par analogie le patois possède gremeau qui veut dire noyau, pépin, et gremechau, gremeciau, peloton de fil. Le français a le mot grume pour désigner le bois de charpente non écorcé. Mais il n'y a aucun rapport entre les deux expressions et l'origine de la dernière est inconnue. - (15) |
| grume : s. f., vx fr., grain de raisin ; larme. T'as la grume à l'oeil, hein ? - (20) |
| grume, n.f. grain de raisin. - (65) |
| grume. Dans le Châtillonnais, on donne ce nom aux grains du raisin. En breton kroum (Le Gon.), en Cornouailles crum, en pays de Galles crwmm, signifient courbe et arrondi. En Irlande, crommigh veut dire se courber. (Price.) Dans le Châtillonnais, à Chaumont-le-Bois, on appelle grumiau le noyau ou partie ligneuse du fruit enveloppée par la pulpe. - (02) |
| grume. Grain de raisin. A rapprocher de gremia. Les lutins disaient : grumus salis. - (13) |
| grumechon (gr'm'ehon), crumochon : s. m., grumette venue sur un cep de deuxième année. - (20) |
| grumelòt, s. m., grumeau, petit grumeau. - (14) |
| grumer : v. a., déguster (du vin). - (20) |
| grumer : v. n., pleurer. - (20) |
| grumeton (A) (à gr'm'ton) : loc adv., à croupeton. - (20) |
| grumette (gr'mette) : s. f., grappillon qui reste après la vendange. Voir agrais. - (20) |
| grumetter (gr'm'ter), grumotter : v. n., grappiller. Voir grappetter. - (20) |
| grumeur : Dégustateur, amateur de bon vin qui sait reconnaître le cru à la dégustation. « Les mâconnais sant de bans grumeurs ». - (19) |
| grumeur : s. m., appréciateur de vin, dégustateur. - (20) |
| grumevaire (gr'm'vaire) : voir vaire. - (20) |
| grumevelle, s. f., signe avant-coureur de la maturité de la vigne. - (40) |
| grumiot, grimiot. n. m. - Grumeau. - (42) |
| grum'velle : veraison. (S. T IV) - B - (25) |
| grun. Raisin tardif que le froid empêche de mûrir. I ferons eune fillette de boire d'évou nos gruns. (Nous ferons une feuillette de piquette avec nos gruns.) Ce mot me parait d'origine burgonde, car ses similaires sont restés dans les langues germaniques : grünn, verdure, en allemand ; green, vert, en anglais. - (13) |
| grunette : Petite quantité. « Donner grunette à grunette » : donner petit à petit, au fur et à msure des besoins et comme à regret. - (19) |
| gruon – morceau de pain, surtout le croûton, ou même des débris, des restes. - I l'ions beillé in gros gruon de pain. - C'â que te vas méger ce gros gruon de pain qui ! - (18) |
| gruotaÿ, s. m., griottier. - (40) |
| gruotte, s. f., gruotte. - (40) |
| gruotte. Mets national à l'usage des chasseurs bourguignons ; sorte de civet fait avec le foie, le cœur et les poumons des cerfs, sangliers ou chevreuils, que l’on mange, en général, au rendez-vous de chasse, le jour où la bête est tombée. Etym. inconnue. - (12) |
| grûsalle (na) : groseille - (57) |
| grûsalli (on) : groseillier - (57) |
| grûter : bercer - (57) |
| grûtot, substantif masculin : orteil, doigt de pied. - (54) |
| gruyé, grelotter, trembloter sous l'action du froid. - (16) |
| grùyé, v. a. couver. - (22) |
| gruyer, trembler. - (26) |
| grûyer, v. a. couver : la poule grûye ; il doit grûyer quelque maladie ; le feu a grûyé longtemps avant d'éclater ; la dispute grûyait depuis plusieurs jours. - (24) |
| gruyeu : grelot. (B. T IV) - D - (25) |
| gruyo, griyo, grillon (insecte). On appelle aussi gruyo la gelée de viande. - (16) |
| gruyotte : cerise. - (29) |
| gruzelle (grugelle) : groseille - (51) |
| gruzelli (grugelli) : groseillier - (51) |
| gruzer : gruger, tromper, ne pas « donner son compte » - (37) |
| grûziller, v. intr., avoir froid, trembler de froid. Dim. de grùler. (V. ce mot.) - (14) |
| gu’nâlé, gu’nellé : vidé de sa substance, desséché - (37) |
| gu’nâpper : attraper - (37) |
| gu’nelle : poire séchée au soleil - (37) |
| gu’nîlles : vieux vêtements usagés - (37) |
| gu’nîlloux : loqueteux - (37) |
| gu’yon : (nm) courroie de fixation du joug - (35) |
| guai. : Interjection signifiant malheur à ! (Dial.) Le verbe du dialecte guementer signifie se plaindre. - (06) |
| guaige, guége. s. m. Gage. (Domecy-sur-le-Vault). – A Ménades, on dit gaize. - (10) |
| guaiger, guéger. v. a. Gager, donner un gage. – A Ménades, gaizer, guaingue. – Voyez guingue. - (10) |
| guainchai, pencher, gauchir... - (02) |
| guaireau : n. f. Petite pluie de courte durée. - (53) |
| guairibandène. : Ce mot date du temps des bandes de guerre qui dévastaient la Bourgogne au XIVe et au XVe siècle sous le nom de Grandes Compagnies, Écorcheurs, etc. Cauri la guairibandène, c'était s'associer à ces bandes qui dévastaient les caves et les greniers. Voici des mots de même farine que guairibandène : gueureà, par exemple, gueux refait, mauvais soudard de guerre, et guernipille, pillard de blé, dévastateur de greniers. (On disait alors ghernier, gheurnier et guernier, et on écrivait le mot de ces trois manières.) [Comte Jaub.) - (06) |
| guairirandeine ou guairibandène (courir la). On dit dans le même sens courir la pretantaine ou pertentaille... - (02) |
| gualippe. n. f. - Terre grasse, difficile à travailler, laissant de grosses mottes de terre derrière la charrue. Se dit également de la terre tombée des roues d'un tracteur et jonchant la route. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| guangouaillè : v. t. Gouailler. - (53) |
| guâri(r) (v.) : guérie - participe passé du verbe guérir : guâri (-e) - (50) |
| guarre: Guerre « Que fait votre fils Madame ? Mâ man brave mossieu ol est à l'armée de la guarre. - Et quel est son grade ? - Man fa je sais pas si ol est caporal ou général : o va devant a peu o fa ran tan plan ». - (19) |
| guarrier : Guerrier. « Quand ol a bu san ptiet cô ol a l'ar guarrier ». - (19) |
| guâtre : Guêtre. « Eune pare de guâtres ». « J'avais des guâtres de tredaine (de tiretaine) - des mieux bâties - que je botenais (que je boutonnais) bin san gêne - et san tiri et sans tiri », vieille chanson. - (19) |
| guche (n. m.) : perchoir pour les volailles - (64) |
| guche, guiche. n. f. - Perchoir pour les poules. - (42) |
| guche. s. f. Juchoir et, par extension, poulailler, endroit préparé pour faire percher les poules. (Villeneuve-les-Genêts). - (10) |
| gucher (v. int.) : jucher - (64) |
| gucher. v. - Percher : les poules sont guchées. - (42) |
| gucher. v. n. Jucher, percher. – Faire gucher les poules, les faire rentrer au poulailler, en criant : Guche ! guche ! - (10) |
| gue : s. f., vx fr. gise, aiguillon à piquer les bœufs. - (20) |
| guebille ou gueubille : Gobille, bille. « Padant que les ptiètes filles sautant à la corde les dreules (les garçons) juant à la guebille ». - (19) |
| guéchintte, fille. - (26) |
| guédan : grosse toile utilisée pour couler la lessive. (RDM. T III) - B - (25) |
| guedé (-e) (adj.m. et f.) : rassasié (-e), bourré (-e) - (50) |
| guedé, part, passé. Bourré, rassasié à l'excès, soûlé. - (08) |
| guédeignes. Jambes maigres comme celles d'une chèvre. Le mot gade, chèvre, est resté dans le patois wallon. En Bourgogne, on appelait guédan, une couverture de lit fabriquée avec du poil de chèvre. - (13) |
| guéder (se) : se gaver - (60) |
| gueder, v. a. paire manger jusqu'à la satiété, bourrer de nourriture. S’emploie principalement en parlant des enfants. - (08) |
| guédion : grande pièce de toile. (B. T IV) - D - (25) |
| guédion, couverture ou sac dans lequel on mettait autrefois les cendres sur la lessive. - (27) |
| guèdjè : garder - guèdje-me mon chûn ! Garde-moi mon chien ! - i guèdj'reû ton chûn si i èveû l'temps, je garderais ton chien si j'avais le temps. - (46) |
| guédon : quelques gouttes tombant d'un gros nuage noir menaçant - y'è chu un guédon, il est tombé une petite pluie - (46) |
| guédon, toile grossière, couverture de lit, souvent décorée de dessins par le teinturier. - (16) |
| guée : chemin dans une forêt ; limite faite à la passée dans les prés. - (31) |
| guée, adv. guère, peu, pas beaucoup : « a n'y en é guée », il n'y en a guère. - (08) |
| guée, gjée. adv. - Guère. - (42) |
| guée, sentier dans la forêt. - (28) |
| guée. Chemin forestier, tracé pour la desserte des coupes de bois. - (13) |
| guéér : adv. Guère. - (53) |
| guéére : n. f. Guerre. - (53) |
| guegni : bouger en raison d'un mauvais ajustement. A - B - (41) |
| guegni (boudzi) : bouger - (51) |
| guegni : bouger - (34) |
| guegni, v. a. mouvoir faiblement. - (22) |
| guegni, v. n. mouvoir faiblement : il est si fatigué qu'il ne peut plus guegni. - (24) |
| guegnòchi, v. a. imprimer de faibles secousses : guegnòchi le manche d'un outil afin de le retirer. - (24) |
| guegnon, s. m. grosse tranche de pain, quignon. - (22) |
| guegnotsi : bouger légèrement, sans arrêt - (43) |
| guegnouchi, v. a. imprimer de petites secousses. - (22) |
| guéhâ, s. m. guéret, terre labourable, champ en culture. - (08) |
| gueignot. s. m. Bigot. - (10) |
| gueignoter. v. n. Faire le bigot. - (10) |
| gueignoterie. s . f. Bigoterie. - (10) |
| gueillard arde, adj., qui demande sans cesse, demandeur de profession. - (11) |
| gueillarder, v. a., demander habituellement. - (11) |
| gueille : excrément du nez - (39) |
| gueille, guègnerais : (géy’, gègn’rê: - subst. f.) la géy' est la morve (cf. gnaque). D'où l'adj. géyou en parlant d'un enfant morveux, qui a des chandelles sous le nez, ce qu'on appelle des pieds d'ègnê: (des pieds d'agneau tels qu'ils paraissent quand la brebis met bas). - (45) |
| gueillou (adj) : gélatineux (par extension) - (39) |
| gueillou (nom) : se dit de quelqu'un qui a le nez qui coule, excrément de nez - (39) |
| guèje, gage, ce que l'on met en gage et ce que l'on gagne annuellement au service d'autrui. - (16) |
| guèjé, gager : guèje ke, pour : je gage que... Guéjure, action de gager. - (16) |
| guéler. v. n. Courir, errer sans but, flâner. (St-Maurice-aux-Riches-Hommes). - (10) |
| guélin : mouton, guéline : brebis. (P. T IV) - Y - (25) |
| guélin, e. n. m. - Jeune agneau, agnelle. S'emploie affectueusement en parlant d'une personne. «As-tu faim, ma guéline ? Ton chocolat t'attend depuis sept heures et demi. » (Colette, Claudine à Paris, p.284) - (42) |
| guélin, guélot. s. m. Jeune agneau. (Sainpuits, Saint-Sauveur, Saint-Martin-sur-Ouanne). - (10) |
| guéline. n. f. - Jeune agnelle. - (42) |
| guéline. s. f. Jeune agnelle. - (10) |
| guelirotte, goulotte. - (26) |
| guemaillon. s. m. Guenille. (Annay surSerein). - (10) |
| guémenter : v. n., vx fr. guaimenter, geindre, se lamenter. C'est pa' une vie d'être avec ces gens-là qu’ sont toujours après guémenter. - (20) |
| guêmer. v. a. Prendre adroitement, subtilement. (Bléneau). - (10) |
| guenâ : Niais, naïf, qui à l'air stupide, lent trainard. « Quel grand guenâ ! ». - (19) |
| guenache, sf. guenille. Femme de rien. - (17) |
| guenachou, sm. guenilleux. Vaurien. - (17) |
| gueneille(s) : chiffon(s) - (39) |
| gueneille, s. f. guenille, loque, chiffon. - (08) |
| gueneillon(s) : chiffon(s) - (39) |
| gueneillon, s. m. guenille, haillon. Se dit injurieusement d'une personne sans énergie, mollasse. - (08) |
| gueneillou, ouse, adj. guenilleux ; celui ou celle qui porte des guenilles, des vêtements déchirés, qui a l'air misérable. - (08) |
| guenêlé : ridé, en parlant d'un fruit ou d'une pomme de terre. - (56) |
| guenélé : tout ridé, transi de froid. - (52) |
| guenélle (n.f.) : poire séchée au four (aussi daguenélle) - (50) |
| gueneteau. s. m. Petit sac en toile pour contenir des graines. (Annay-sur-Serein). - (10) |
| gueneter (pour graineter). v. n. Semer à la volée en suivant la charrue. (Annaysur-Serein). - (10) |
| guèneton, guenneton. s. m. Hanneton. Germigny, (Coulours). - (10) |
| guénette, ganache et galatte. s. f. Mauvaise brebis. (Pasilly). - (10) |
| guenette, par abréviation gnette - vieille brebis ou encore brebis maigre. - Note pôre boucher, le père Chaland, ne vend que de lai gnette. – C'a in bout de guenette que te nos sers qui, en peut ai pogne lai copai. - (18) |
| guénette. n. f. - Viande dure, coriace, d'une vieille brebis. - (42) |
| gueneuille n.f. Guenille. - (63) |
| gueneuille, patte : chiffon - (43) |
| guenevèle, sf. jambe. - (17) |
| guenevelles : jambes. - (66) |
| guenille : s. f., vieille guenille, vieille fille. - (20) |
| guenillon (un) : serpillère, chiffon à ménage - (61) |
| guenillon : vieux chiffon - (60) |
| guenillou, en haillons. - (26) |
| guenillou, sm. guenilleux. - (17) |
| guenilloux : en guenilles - (60) |
| guenilloux. Habillé d'habits en lambeaux, en guenilles. - (49) |
| guenipe, s. f. femme malpropre et de mauvaise vie. Courir la guenipe (ou la guenale) mener une vie de libertin. - (24) |
| guenipe. s. f. Femme malpropre, mal vêtue, souillon, salope. – Se dit aussi d'un homme de rien, d'un mauvais sujet. - (10) |
| guennetembou guennetonbou. s. m. Hanneton. (Lasson). - (10) |
| guenneton : hanneton. (F. T IV) - Y - (25) |
| guennevalles. s. f. pl. Grandes jambes mal conformées. (Coutarnoux, Etivey). - (10) |
| guenotte. s. f. Pour huguenote, marmite sans pieds, petite soupière. (Bessy). - (10) |
| guenuche n.f. 1. Vieille poupée. 2. Femme trop fardée. - (63) |
| guenuche, guernuche, grenuche. s. f. Grain de poussière qui gêne dans l'œil ou fait obstacle dans la roue d'une montre, dans un objet quelconque. (Diges). – En général, tout grain de poussière que soulève le vent. (Puysaie). – A Auxerre, on entend par guenuche, une femme mal tournée, mal peignée, d'une honnêteté douteuse. – C'est aussi, à Lainsecq, un terme de mépris qui s'adresse à certaines petites filles coureuses, et qui est une manière indirecte de leur dire petite saloperie, petite ordure. – Dans ces deux dernières acceptions, guenuche pourrait être conslderé aussi comme un dérivé, un diminutif de guenon. - (10) |
| guenuche. n. f. - Poussière, petite saleté : « J'a attrapé une guenuche dans l'oeil. » - (42) |
| guenuche. s. f. Sorte de brouette employée dans les tuileries. (Sommecaise). - (10) |
| guépe : guêpe - (48) |
| guépe : guêpe - (39) |
| guêpre, sm. guêpe. - (17) |
| guêpröre, sf. guêpier. - (17) |
| güer, v. tr., écorcer l'orge sous la meule verticale du battoir. - (14) |
| guérane. s. f. garenne. (Argenteuil). - (10) |
| guéraude : voir gaudre - (23) |
| guéraude : vieux sac ou jupon dontt on enveloppait le balai - (39) |
| guéraude, s. f. gros chiffon servant à nettoyer le four. « Guéhaude ». - (08) |
| guerdau. Pou. - (49) |
| guerdaud. s. m. Coquin, gredin. – Guerdaud fieffé, gredin de la pire espèce. - (10) |
| guerdeau ou gueurdeau. Altération de gredin avec métathèse, et finale locale ; même sens, mais très attenue ; on donne même ce nom à de simples lourdauds; il me parait que primitivement, il désignait plutôt les mendiants, les misérables. - (12) |
| guerdi. adj. - Engourdi par le froid. - (42) |
| guerdiller. v. - Grelotter. - (42) |
| guerdon et guerredon. : (Dial et pat.), récompense, salaire. D'où les verbes guerredoner, reguerredonner ou reverdoner. - (06) |
| guéreau : une petite averse. - (56) |
| guéreau : petite pluie de courte durée. - (33) |
| guéreau et gareau. Pluie d'orage. Aittends un p’chot : le temps vai s’éclairci, ç'ast un guéreau. On devrait écrire gare-eau. - (13) |
| guéreau, guérot (n.m.) : averse de courte durée - (50) |
| guéreille : guenille, vieux chiffon - (39) |
| guéreille : n. f. Guenille. - (53) |
| guéreille, goueille, s. f. guenille, chiffon usé ou déchiré. (Voir : dégoueiller.) - (08) |
| guèreilles : habits (mauvais), guenille, chiffon - (48) |
| guéreillon, s. m. haillon, lambeau d'étoffe. - (08) |
| guéreillou : personne mal habillée - (39) |
| guéreillou, goueillou, adj. se dit d'une personne en guenilles, aux habits déchirés : « eune fon-n' tote guéreillouse ou goueillouse. » - (08) |
| guereuilles : coquilles d'œufs. (MM. T IV) - A - (25) |
| guèréyé, adj., crotté, couvert de boue. - (14) |
| guergeote : voir aguergeote - (23) |
| guergosson : (gêrgoson - subst..m.) charançon. Le mot est maintenant quasi désuet, évincé par son équivalent français. - (45) |
| guerguesses (les). Le pantalon, la culotte; forme locale de grègues. Etym. la même que grègues (voir Littré). - (12) |
| guéri : part, pass., se dit d'un défaut qu'on n'a jamais eu. Il est ben guéri d'êt’ bête. - (20) |
| gueriau : s. m., celui qui gueriaude. - (20) |
| gueriauder : v. n., courir les rues, battre le pavé. - (20) |
| guérijan : Guérison. « Veux-tu boire in cô ? Cen ne se demande pas, an ne demande pas à in malède si o veut la guérijan ». - (19) |
| guérin : Usité dans cette expression : « A la saint Guérin que jamâ ne vint. Vendre payé pa la Saint-Guérin » : vendre à quelqu'un qui ne paiera jamais. - (19) |
| guerio : grillon. Sonnette. A - B - (41) |
| guerionde : guêpe. A - B - (41) |
| guerionde : guêpe - (34) |
| gueriot : grillon, sonnette - (34) |
| guériote : griotte - (61) |
| gueriote : voir aguergeote - (23) |
| guériote, s. f. griotte, cerise sauvage assez commune dans le pays. - (08) |
| gueriotte : griotte - (48) |
| gueriotte, guerlotte. s. f. Griotte, merise. - (10) |
| gueriotté, s. m. griotier, cerisier sauvage qui produit les griottes. - (08) |
| gueriottes : griottes - (39) |
| gueriottier, guerlottier. s. m. Griottier, merisier. - (10) |
| guérisseux n.m. Guérisseur. - (63) |
| guerjot. s. m. Sombre, jachère. (Arcy-sur-Cure). - (10) |
| guerlet : voir grillot - (23) |
| guerlet. Petit, tout petit. - (49) |
| guerleu, étui en bois pour mettre les aiguilles. - (27) |
| guerli (faire) : chatouiller (guerlichoter) - (60) |
| guerli ! Exclamation exprimant une sorte d'étonnement admiratif, dans le genre de celui-ci : comment, petit, faible, chétif, rabougri, estropié, invalide comme il l'est, il a pu faire ça ! Guerli ! - (10) |
| guerlichoter : chatouiller (guerlir) - (60) |
| guerlins, gueurlins. s. m. pl. Grésil, petits grêlons. V'là qui tombe des gueurlins. - (10) |
| guerlir : chatouiller - (60) |
| guerlit : chatouilles - (60) |
| guèrlln, s. m., onomat., bruit d'une sonnette, d'un grelot. - (14) |
| guerlon : voir gourlon - (23) |
| guerlot (n.m.) : étui à aiguilles - (50) |
| guerlot, guerlotier, guerloquier. s. m. Grelot, et, par extension, homme qui travaille sans suite, seulement quand on le pousse, quand on le secoue comme un grelot. (Perreuse). - (10) |
| guerlot. n. m. - Grelot. - (42) |
| guerlot. s. m. Etui à aiguilles. - (10) |
| guerlot. s. m. étui à aiguilles. (Voir : garlot.) - (08) |
| guerlotter. (pour grelotter). v. n. Travailler sans suite, tantôt à un ouvrage, tantôt à un autre, suivant le caprice du moment, ainsi que fait un enfant qui quitte et reprend son grelot. – Guerlotter de froid, grelotter, trembler de froid. - (10) |
| guerlotter. v. - Plusieurs usages : 1. Bavarder. (Arquian) 2. Grelotter de froid. 3. Secouer des grelots. 4. Travailler ici ou là, sans goût. (M. Jossier, p. 79) - (42) |
| guerlottière : hochet. - (32) |
| guerloup. s. m. Loup-garou. - (10) |
| guerlu, ue. adj. Qui est vêtu d'habits pauvres, d'habits râpés. – Se dit aussi des vêtements eux-mêmes. Les pour's gens, i ne sont gué riches ; il avont tertous des habits ben guerlus. - (10) |
| guerlu,s.m. faiseur de mauvais tours. - (38) |
| guerlu. Pauvre, sans le sou. - (49) |
| guerluette. n. f. - Petite parcelle de terre ou de bois. (Sougères-En-Puisaye) - (42) |
| guerluettes. s. f. pl. Mauvaises terres. (Etais). De guerlu, maigre, aride. - (10) |
| guermillon (n. m.) : grumeau (syn. miglon) - (64) |
| guernai - grainer, fournir du grain surtout en parlant du blé. - Les bliets ant bein gueurnai, ç'â remairquâbe. - I ons déji écouai quéque arries, ci ne gueurne pas mau. - (18) |
| guernai, guerner, v. produire beaucoup de grains. - (38) |
| guernai, s.m, grenier. - (38) |
| guernaulée, guernôlée. s. f. Pois, haricots que, dans la Puysaie, on fait griller dans une poêle, le dimanche des Brandons, et qu'on distribue aux jeunes gens qui se sont masqués le jour de carnaval. Ce sont les jeunes mariés de l'année qui sont obligés de servir la guernaulée, avec accompagnement de beignets, et qui doivent en outre fournir le bois nécessaire pour le feu des brandons. - (10) |
| guernauler, guernêler. v. a. Faire brûler dans un four l'écorce qui enveloppe un morceau de bois destiné à faire un aiguillon, un manche d'outil quelconque. (Perreuse). – En général, signifie, griller. - (10) |
| guernauler. v. - Griller, grésiller. - (42) |
| guerne , graine, gueurne. - (04) |
| guerné, grenier - (36) |
| guernée. Graine de graminée. Se dit de la viande de porc contenant des œufs de ténia et d'une personne phtisique. - (49) |
| guernêler (v. int.) : griller - (64) |
| guernetif, adj. arbre ou plante qui produit beaucoup. - (38) |
| guerniau, gremiau. n. m. - Noyau. - (42) |
| guernier : grenier. - (58) |
| guernier, guergnier. n. m. - Grenier. - (42) |
| guernier, gueurgnier. s. m. Grenier. - (10) |
| guernier. Grenier. - (49) |
| guernipie, guernipille. s. f. Mauvais petit polisson, petit vagabond, mauvais garnement. – Troupe d'enfants sales, déguenillés. – Vermine grouillante. (Cuy, Perreuse). - (10) |
| guernipie. n. f. - Enfant sale, mal élevé, vaurien. - (42) |
| guernipille (g'rnipille) : s. m. et f., vaurien, fripouille. Va donc, ch'tite guernipille ! - (20) |
| guernipille : S'emploie pour désigner des choses ou des gens de peu de valeur. « Y a pas moyen de se débarasser de s'te guernipille ». Voir gueurnipille. - (19) |
| guernipille, race de basse extraction... - (02) |
| guernipille. Diminutif et altération de guenipe (voir ce mot dans Littré) avec le même sens. - (12) |
| guernipille. Petit polisson, mauvais sujet. - (49) |
| guernoille ou guernouille : grenouille. IV, p. 27 - (23) |
| guernoille : s. f. grenouille. - (21) |
| guernoille. s. f. Grenouille. - (10) |
| guernôlée. n. f. - Poêlée de haricots que l'on fait griller. (M. Jossier, p.79) - (42) |
| guernôlée. s. f. Voyez guernaulée. - (10) |
| guernôler. v. - Frire, griller. - (42) |
| guernouilla. Grenouillère. Flaque d'eau sur un chemin, dans un fossé. - (49) |
| guernouille (une) : une grenouille - (61) |
| guernouille, guernode. Grenouille. - (49) |
| guérnouille. n. f. - Grenouille. - (42) |
| guernouiller, guernoiller. v. n. Remuer, gambader, sauter, frétiller. Se dit en parlant d'une troupe de gamins qui s'agitent et qui sautent comme des grenouilles effarouchées au bord d'une mare ou d'un étang. (Perreuse). - (10) |
| guernouiller. Gargouiller. Produire un bruit semblable à l'eau qui s'échappe d'une bouteille. « Le ventre me guernouille ». - (49) |
| guernouiller. v. - S'agiter, sauter : sauter comme une guernouille. - (42) |
| guernouillère, guernoillère. s. f. Grenouillère, mare hantée par des grenouilles. - (10) |
| guernouillère. n. f. - Mare envahie de grenouilles. - (42) |
| guernouillot. s. m. Qualification donnée assez souvent, dans les villages, aux enfants vagabonds qui vont patauger dans les mares, dans les grenouillères. - (10) |
| guernouler. v. n. Grelotter. (Fresnes). - (10) |
| guernu. adj. Bien grené, bien fourni en grain. C't'année, la récolte n'est gué belle, les blés sont pas guernus du tout. - (10) |
| guèrô : averse - (48) |
| guérot, s. m. averse de courte durée. La terre est trop sèche, il nous faudrait un bon « guérot. » - (08) |
| guerpir et werpir. : (Dial.), déguerpi (pat.), quitter abandonner. M. Burguy fait dériver ce mot de l'ancien saxon werpen, jeter, rejeter. - (06) |
| guerrade (è lè) : l'un après l'autre. (ALR. T II) - B - (25) |
| guerrer (v. tr.) : quereller - (64) |
| guerri, guerrier, v. a. tourmenter, malmener, agiter en divers sens. On dit que la fièvre « guerrie » les malades, que le vent « guerrie » une chandelle allumée. - (08) |
| guersil. Grésil. - (49) |
| gueruillot. s. m. Gorge, gosier. (Etivey, Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| guet - guette : prononcer yette. Vif, en bonne santé, actif. Ex. 1 "La Yolande, c'est ène gamine qu'est ben guette !" Ex. 2 "L'pée Laclasse, il est pas ben guet " (pée = père). Cela peut sous-entendre (également) qu'il n'en a pas pour longtemps... - (58) |
| guète ou ghète : Agathe. « Ol a fait dansi la Guète ». - (19) |
| guéthià, gâteau on général. - (16) |
| guétou, celui qui guette, qui épie, qui écoute aux portes. - (16) |
| guëtte : goutte d’alcool, marc. - (66) |
| guette. : Tocsin, conai lai guette, c'est-à-dire, sonner le tocsin. (Del.) - (06) |
| guette-au-trou (nom masculin) : sage-femme. - (47) |
| guette-au-trou : s. f., sage-femme. Voir Vise-au-trou. - (20) |
| guetter v. Regarder, observer, mais sans discrétion aucune. - (63) |
| guetter : v. a., regarder. - (20) |
| guettou (on) : guetteur - (57) |
| gueu. Déformation du mot Dieu dans les jurons : « nom de gueu! ». - (49) |
| gueudé (éte) : avoir trop mangé, trop bu - (39) |
| gueudè : rassasié, repu - (48) |
| gueude : rendement. Un bon rendement en moisson, en vendanges on dit : ça gueude. - (33) |
| gueudé : (geudè - v. trans.) (ne s'emploie qu'au part. passé passif) gavé, rassasié. - (45) |
| gueudé : 1 v. t. Rassasier, avoir bien mangé. – 2 exp. Bien aller. - (53) |
| gueude. s. f. Gourde. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| gueuder, v. n. faire du vin au-delà de son attente. - (08) |
| gueudes, adj. employé pour qualifier les mains engourdies par le froid. - (07) |
| gueudie, n. fém. courge ; ne prononcez pas le i. - (07) |
| gueudons : fesses - (44) |
| gueudye : courge. (MM. T IV) - A - (25) |
| gueuezi, s. m. grésil, petite grêle. - (08) |
| gueugaingne, sf. trempusse, soupe au vin. - (17) |
| gueugnai et gueuniais - variante de gômai ou gueumai : Voyez donc là. - Faire le paresseux, perdre son temps à ne rien faire qu'à flaner. - Quoi que te fâs don qui, chien de gueuniais ! - Vais don travailler putot que de gueuniai quemant cequi tote lai jornée. - A m'é portant fait gueuniai tote lai maitenée. - (18) |
| gueugne (jouer à la), locution verbale : nom d'un jeu de billes. - (54) |
| gueûgne n.f. Guigne, malchance. - (63) |
| gueûgné, rester longtemps à attendre avec déplaisir. - (16) |
| gueûgne, s. f., syn. de beùgne. C'est aussi le nom d'une sorte de jeu de gobilles : « V'tu jouer à la gueugne ? » - (14) |
| gueugne, subst. féminin : nid de poule, trou, cavité. - (54) |
| gueugner (faire). Attendre ; faire attendre, désirer. - (49) |
| gueugner (v.t.) : attendre avec impatience - (50) |
| gueûgner : attendre. (VDS. T IV) - VdS - (25) |
| gueûgner : quémander, mesurer chichement - (37) |
| gueugner : traîner. (SB. T IV) - C - (25) |
| gueugner, v. a. attendre avec impatience, languir d'attente. « Gueugner » la faim, « gueugner » la soif, se dit pour mourir de faim, de soif. - (08) |
| gueùgner, v. intr., attendre longtemps, traîner, lambiner : « Dis donc, hier t'é pas v'nu ; t'm'as joliment fait gueùgner, pus d'eùne heûre. » - (14) |
| gueugner, v., attendre en rouspétant. - (40) |
| gueugner. Attendre inutilement. An faut le laisser gueûgner ai lai pôrte. Dans les villages de la plaine, on dit jugner. A Dijon, gueûgner signifie : regarder avec indiscrétion... - (13) |
| gueugner. Etre indolent, flâner, origine inconnue. On joue à la gueugne, variété du jeu de billes que nous appelons gobilles. - (03) |
| gueugner. Regarder avec indiscrétion, fouiller un intérieur du regard. C'est le mot guigner avec une prononciation et un sens locaux. - (12) |
| gueugner. v. a. Synonyme de gueugner, faire le gueux, mendier. Se dit, en mauvaise part, de ceux qui mendient par fainéantise. (Auxerre). - (10) |
| gueugner. v. n. Aller de porte en porte, mendier, faire le gueux, au lieu de travailler. (Mont-Saint-Sulpice, Sermizelles). - (10) |
| gueûgnes : Terme de jeu de « guebille ». celui qui a les gueugnes subit certaines punitions comme de rester inactif pendant que les autres jouent. - (19) |
| gueugni : à la manière des pauvres (gueux). A - B - (41) |
| gueugni : à la manière des gueux - (34) |
| gueugni : Attendre, se morfondre, croquer le marmot. En parlant du bétail, attendre la provende devant le ratelier vide. « Va donner à miji es bâtes, ne les laiche pas gueugni ». - (19) |
| gueugni : dodeliner de la tête - (43) |
| gueûgni v. (de guigner). Bouger, branler. Dans l'expression gueûgni les sous, être pauvre, il - (63) |
| gueûgnon, s. m., jeu de gobilles. (V. Gueùgne.) - (14) |
| gueugnou, flâneur, peu pressé de se mettre au travail. - (27) |
| gueûgnyi : (vb) dodeliner de la tête - (35) |
| gueuille : vieille truie - (43) |
| gueuillon, gu'nillou, g'nillou : n. m. Guenille (personne en). - (53) |
| gueulâ : Gueulard, qui crie. « T'as de la chance d'avoi des ptiets que ne sant pas gueulâs ». - Gourmand. « Y est in greus gueulâ » : c'est un gros gourmand. - (19) |
| gueulâ : poche intérieure d’une veste. Vient peut-être de gueulard : ouverture au dessus (d’un fourneau, d’une fosse…) ? - (62) |
| gueula, criard. - (27) |
| gueulabe (adj.) : mangeable (c'est pas gueulabe (c'est immangeable)) - (64) |
| gueulâd (on) - dgeulâd (on) : gueulard - (57) |
| gueulai, dans le sens de pleurer. Ce mot a son analogue chez les Bretons... - (02) |
| gueulander. v. n. Faire un gueuleton, festiner. - (10) |
| gueulâr ; celui qui semble crier en parlant. - (16) |
| gueular, s. m. petit fossé limitrophe entre les propriétés boisées. - (08) |
| gueulard, criard. - (05) |
| gueulard. s. m. Braillard; gourmand. - (10) |
| gueulbiner. v. n. Faire un bon repas, manger à pleine gueule. (Tormancy). - (10) |
| gueule (ât’e) : (être) avare - (37) |
| gueule : En parlant du bétail avoir bonne gueule signifie ne pas être difficile à nourrir. « C'te (s'te) vaiche a bonne gueule, aile meut (elle mord) su la peille assi bin que su le foin ». En parlant des personnes, « avoir eune sale gueule » signifie être mal embouché, tenir des propos grossiers. - (19) |
| gueule : entrée du fenil par où on décharge le foin - (48) |
| gueule d’eimpagne : langue « bien pendue » - (37) |
| gueule : (geul' - subst. f.) gueule des animaux, mais aussi bouche et visage de l'être humain. - (45) |
| gueule : s. f. Bas de la gueule, niais, qui parle à tort et à travers. Haut de la gueule, fort en gueule. - (20) |
| gueule, bouche ; couze laigueule ! tais-toi (grossier) ; gueulé, crier fort. - (16) |
| gueule-chaude : galette sèche, cuite aussitôt le pain défourné et qui se mange chaude. (P. T IV) - Y - (25) |
| gueule-chaude. s. f. Galette large et peu épaisse, faite à l'huile ou à la crème, qu'on met cuire à l'entrée du four pendant qu'on le chauffe, et qu'on mange toute chaude, au risque de se brûler. (Etais, Perreuse). – Faire la gueulechaude. Locution ironique à l'adresse de celui qui fait l'empressé, qui arrive intempestivement là ou personne ne le demande ni ne le désire. - (10) |
| gueulée : Bouchée. « T'as dan bin des balles cheriges ? I sant c'ment les cheriges à Liaude Guillemaud : y a deux gueulées dans eune ». - (19) |
| gueulée, gueultée. n. f. - Grosse bouchée ; en avoir plein la bouche, plein la « gueule ». - (42) |
| gueulée, gueul'tée. s. f. Plein la bouche, plein la gueule. (Perreuse). - (10) |
| gueulée, s. f. bouchée, ce qui peut tenir dans la bouche. Une « gueulée » de pain, de soupe, etc. - (08) |
| gueuler : Crier, pleurer, gueuler. « T'as pas faute de gueuler si feu je sus pas chordiau » : tu n'as pas besoin de crier si fort je ne suis pas sourd. « Va dan donner à teter à tan ptiet au lieu de le laichi gueuler (pleurer) dans san greut ». - Expression : « Se prendre de gueule » se disputer, s'injurier. - (19) |
| gueules. Ne se dit que dans cette expression : « avoir les doigts gueules, » pour avoir les doigts saisis de froid, gourds. - (12) |
| gueuleu : s. m., trou creusé en terre pour jouer aux billes. Syn. de pot. - (20) |
| gueuliron,sm. goulot. S’applique surtout au bec d'un vase à large ouverture, pot à eau, seau à traire, buire. Orifice d'écoulement d'un chéneau, d'une conduite d'eau. - (17) |
| gueulot. s. m. Goulot. (Percey). - (10) |
| gueuloue. s. f. Poche de jupon. De gueulle, bourse, gibecière. - (10) |
| gueulouer. v. n. Manger et boire goulûment. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| gueûluç’e : « fille des rues » - (37) |
| gueulye : s. f. boue. - (21) |
| gueûme : Bosse. « Ol a cheu su sa tête, o s'est fait eune gueûme ». - (19) |
| gueumè : en parlant d'un plat qui attend, stagne, pourrit, traîne sur le feu (d'où une mauvaise cuisson) - y a l’feu qui gueume, le feu ne prend pas bien, couver en parlant d'une maladie - (46) |
| gueumé ; une chose qu'on laisse longtemps dans l'eau y gueume. Faire gueumé quelqu'un est le faire attendre longtemps, à la même place. Une maladie gueume quand elle couve à l'intérieur. - (16) |
| gueumé : v. t. Rissoler doucement. - (53) |
| gueumé, se dit d'une soupe qui s'est épaissie. - (26) |
| gueumé, vt. gommer. - (17) |
| gueumer : être peu vigoureux à la suite du froid ou à l'approche d’une maladie. (G. T II) - D - (25) |
| gueumer : se dit d'une casserole qui traine sur le feu avec quelque chose dedans. - (66) |
| gueûmer : traîner, croupir. (E. T IV) - VdS - (25) |
| gueumer, mijoter outre mesure. - (28) |
| gueumer, v. n. attendre longtemps inutilement : il m'a fait gueumer. - (24) |
| gueumou : un gars qui n'avance pas dans son travail, on dit également knillotou et leurot. - (46) |
| gueunche, sf. femme de rien. - (17) |
| gueunelle (adjectif) : ridé. (Mes pouères valent pu rien, al sont toutes gueuneIIes). - (47) |
| gueunelle : jeune file assez délurée. (CLB. T II) - C - (25) |
| gueuner, v., faire la gueule. - (40) |
| gueùniyou, s. m., guenilleux, mendiant sale, vêtu de guenilles. - (14) |
| gueurais - paresseux, doguin. - Quée chien de gueurais te fâs don ! - C'â des gueurais cequi, ce n'â pâ des ovrés. - Voyez en suivant. - (18) |
| gueuralai, aller de côté et d'autre sans but précis, flâner. - (27) |
| gueuralé, adj. se dit d'un plat trop cuit, mais mangeable. - (40) |
| gueuraler : attendre. (RDB. T III) - S&L - (25) |
| gueuraller, v. mijoter trop longtemps sur le feu, se dessécher (en parlant d'un mets). - (38) |
| gueurbolou : granuleux, irrégulier. Qualifie généralement un état de surface. - (62) |
| gueurdais - paresseux, gredin. - Les gens que côrrant les pays quemant cequi ce n'â pâ aute chose que des gueurdais. - Petiot gueurdais, vai ! – Voyez l'article précédent, qui est une variante. - (18) |
| gueurdaler v. (de grole, chaussure de mendiant). Grelotter. - (63) |
| gueurdau : mendiant, clochard - (34) |
| gueurdaud n.m. Mendiant. Le gueurdaud n'est pas un vagabond comme le gueuriaud. - (63) |
| gueurdaut. s. m. Gredin - (10) |
| gueurdeau : clochard - (44) |
| gueurdeau, sm. farceur, tireur de carottes. - (17) |
| gueurdeler : trembler - (51) |
| gueurdeule : (nf) gélatine ; tremblote - (35) |
| gueurdiller (Se). v. pron. Se plisser. (Véron). - (10) |
| gueurdillies. s. f. pl. Plis dans une étoffe. (Véron). - (10) |
| gueurdin, gredin ; se dit parfois comme plaisanterie. - (16) |
| gueurdin, ine, s. m. et féminin gredin, gredine. - (08) |
| gueùrdin, s. m., gredin, franc mauvais sujet. - (14) |
| gueurdo : mendiant, clochard. A - B - (41) |
| guêurdo : gredin, coquin, (voir ancien français gourd = fourberie). (R. T IV) - Y - (25) |
| gueurdo : pou. (RDB. T III) - S&L - (25) |
| gueurdon n.m. Edredon. - (63) |
| gueurdot (franc) : homme culotté. - (66) |
| gueurdze : gorge - (43) |
| gueuréa, un gueux refait... - (02) |
| gueurginer : bouillir à petit feu, bouillonner (avec un faible bruit). - (56) |
| gueûrià, gueux, très pauvre. - (16) |
| gueuriâ, s. m., mendiant miséreux. - (40) |
| gueuriale : lard grillé portant encore sa couenne. A - B - (41) |
| gueûriât : polisson - (37) |
| gueuriau : (nm) vagabond - (35) |
| gueuriau. Gueux ; polisson. « Ce ch'tit gueuriau d'amour le tracaichot » ; trimardeur. - (49) |
| gueuriaud : Mendiant, chemineau. « Ol est bin déguenilli, an dirait in vrâ gueuriaud ». - (19) |
| gueuriaud : vagabond, voleur - (43) |
| gueûriaud n.m. Mendiant, clochard, traîne-ruisseau, qui court à droite et à gauche. - (63) |
| gueuriauder : vagabonder - (43) |
| gueûriauder v. Traîner par-ci, par-là. - (63) |
| gueurièchi v. Traîner, courir les bals, les cafés, les filles. - (63) |
| gueurio : vagabond, voleur. A - B - (41) |
| gueurio, subst. masculin : polisson, mauvais drôle. Au sens figuré, désigne un clochard ou une personne négligée. - (54) |
| gueuriodée : vagabondage, vie dissolue. A - B - (41) |
| gueurioder (corri les feuilles) (corri l'guilledou) : courir les filles - (51) |
| gueurionde n.f. Guêpe, frelon. Voir gronde. - (63) |
| gueuriot (de çrises) n.m. Grappe de cerises. - (63) |
| gueuriôt (on) : seau (servant à donner à boire aux veaux) - (57) |
| gueuriot n.m. Grillon. - (63) |
| gueuriot, grelu : misérable, mendiant - (43) |
| gueuriote : n. f. Grillotte, variété de petite cerise. - (53) |
| gueùriôte, s. f., griotte, cerise aigrelette. - (14) |
| gueuriotte (n.f.) : griotte - (50) |
| gueuriotte : petite cerise, griotte. - (52) |
| gueuriotte : petite cerise, griotte. - (33) |
| gueuriotte, s. f., crevette d'eau douce. - (40) |
| gueûriottes : griottes. genre de minuscules crevettes vivant au fond des puits très profonds. on en « remonte » parfois dans le seau en puisant de l’eau. leur présence est un signe d’eau très potable et très fraiche, d’où l’expression qui suit : ât’e frôç’e c’mment aine gueûriotte : « respirer la santé » - (37) |
| gueurlais. s. m. et gueurlasse (pour grêlasse). s. f. Grésil. (Chassignelles). - (10) |
| gueurlande (d'la) : hure - (57) |
| gueurlande (na) : fromage de tête - (57) |
| gueurlandier : le sens de ce mot est difficile à préciser désigne, peut-être, un bon vivant un coureur de grands chemins - (39) |
| gueurle (d'la) : grêle (glace) - (57) |
| gueurle : guêpe - (48) |
| gueurle ; des doigts gueurle sont des doigts engourdis par le froid. - (16) |
| gueurle ou gueurlée : Gelée de viande. - (19) |
| gueurle : s. m.: lierre. - (21) |
| gueurle. adj. Engourdi. J'ai les mains gueurles de froid. (Serrigny). - (10) |
| gueurler : grêler - (57) |
| gueurler : trembler - (57) |
| gueurler : Trembler. « Alle avait si bin peu qu'aile gueurlait » : elle avait si peur qu'elle en tremblait. - (19) |
| gueurlér v. grêler. - (21) |
| gueurlet : chétif. A - B - (41) |
| gueurlet : chétif - (34) |
| gueurlet : chétif - (44) |
| gueurlette : brebis. (F. T IV) - Y - (25) |
| gueurleute, ouverture de forme variable par où sort un liquide (par ex, la gueurleute d'un pressoir). - (27) |
| gueurli : chatouille - (44) |
| gueurli, guerli. s. m. Gresil. (Accolay, Arcy-sur-Cure). - (10) |
| gueurli. adj. Flétri, fané, ridé. (Chassignelles). - (10) |
| gueurliâle (n.f.) : petit morceau de lard grillé (aussi greille, gréle, grillaude) - (50) |
| gueurlin. s. m. Petite grêle. (Collan). - (10) |
| gueûrline : petite, menue, mal habillée - (37) |
| gueurline, subst. féminin : crotte de chèvre. Au sens figuré, ce terme s'applique à tout ce qui est inférieur à la norme. - (54) |
| gueurlingeons : pompons - (60) |
| gueurlir, guerlir, gherlir (pour grelir). v.n. Se flétrir, se faner, devenir grèle, par manque de sève et de nourriture. (Etivey). - (10) |
| gueurlit, gourmand, goulu. - (16) |
| gueurlo : grelot. - (29) |
| gueurlode : de petite taille - (51) |
| gueurlon (pour gourion). s. m. Frelon. (Mailly-la-Ville). - (10) |
| gueurlon : frelon - (44) |
| gueurlon : frelon - (48) |
| gueûrlons : frelons - (37) |
| gueurlot : frelon - (48) |
| gueurlot n.m. Hochet. Berceuse : Un ptiet gueurlot d'ardzent, P'guéri le mau és dents. - (63) |
| gueurlot, s. m. grelot : un « gueurlot » de chien, de cheval. - (08) |
| gueurloté, grelotter. - (16) |
| gueurloter, v. a. grelotter, trembler de froid. - (08) |
| gueùrloter, v. intr., greloter. - (14) |
| gueurloter. v. n. grelotter. Se dit du petit bruit que fait l'eau en tombant goutte à goutte. - (08) |
| gueurlotter : grelotter - (57) |
| gueurlouter. v. - Grelotter. - (42) |
| gueurlouter. v. n. Grelotter. - (10) |
| gueurlu : misérable. A - B - (41) |
| gueurlu - homme de peu de morale ; quelquefois un pauvre, un mendiant. - Te ne sais pas ? eh bein mouai i te dis que ce Bidaut lai c'â in gueurlu. - Ne t'i fie pâ ai ce mâtin lai, c'â in vrai gueurlu. - (18) |
| gueurlu (n.m.) : sans argent, désargenté - (50) |
| gueurlu : garnement, drôle. Viendrait du latin gracilis : grêle,chétif. - (62) |
| gueurlu : homme évaporé, un « numéro ». (A. T IV) - S&L - (25) |
| gueurlu : misérable - (44) |
| gueurlu : Sans le sous, miséreux, de peu de valeur. - (19) |
| gueurlu : simplet - (48) |
| gueurlu ou guerlu. Terme de mepris, mais peu énergique, individu de mince importance, sans considération. - (12) |
| gueurlu : n. m. Pauvre diable. - (53) |
| gueurlu, adj., goinfre et assoiffé chronique. - (40) |
| gueurlu, guerlu. Pauvre ; besogneux ; sans le sou. - (49) |
| gueûrlu, gueûriaûd : sans argent, pauvre, misérable - (37) |
| gueurlu, homme peu courageux s'attardant au cabaret. - (28) |
| gueurlu, s. m. mauvais sujet, vaurien, homme de rien. - (08) |
| gueùrlu, s. m., drôle, garnement. - (14) |
| gueurlu, -use adj. (vx.fr. gresli) 1. Chétif, malingre, grêle. 2. Pauvre. 3 Avare. - (63) |
| gueurlucheu : terrain recouvert de petites mottes de terre. A - B - (41) |
| gueurluchon, s. m. morceau de bois sec détaché d'une souche d'arbre, éclat de bois sec. - (08) |
| gueùrluchon, s. m., péjoratif du mot précédent, amant de cœur des drôlesses, Alphonse de province. - (14) |
| gueurluchon, sm. farceur bête. - (17) |
| gueurluto, s. m., gorge, gosier. - (40) |
| gueurme : grappe de raisin. A - B - (41) |
| gueurme : grappe de raisin - (34) |
| gueurme n.f. 1. Grume, grain de raisin. 2. Larme. - (63) |
| gueurme, greume n.f. Grume. - (63) |
| gueurméillon (n.m.) : grumeau - (50) |
| gueurmer v. Grener (idée d'abondance), produire. - (63) |
| gueurmette n.f. Petite grume, petite grappe. - (63) |
| gueurmter v. Ramasser les grappes restées après la vendange. - (63) |
| gueurnadyé, grenadier (soldat). - (16) |
| gueûrnaille : petites graines des plantes ayant poussé à travers les épis et éliminées par le « trieur » - (37) |
| gueurnâïon, s. f. grenaison ou plutôt grainaison, formation de la graine. - (08) |
| gueùrnaïon, s. f., grenaison, développement du grain. - (14) |
| gueurnasselle. s. f. Grenouille. (Pasilly). - (10) |
| gueurnate : Petit crotte. « Des gueurnates de cabre, des gueurnates de lapin ». - (19) |
| gueurnaude : grenouille - (51) |
| gueurné - grenier. - Vos viez bein que ces sai ne sont pâ qui ai lô pliaice, montez-les à gueurné. - Défiez-vo, les poumes pourraint gelai su le gueurné. - Les raites en fait du dégat ai in tas de bliet su le gueurné. - (18) |
| gueurne (n.f.) : graine - (50) |
| gueurné : grenier - (48) |
| gueurné : grenier. - (62) |
| gueurné : grenier. - (29) |
| gueurné : Grenier. « Ol a eune bonne taupère (un bon tas) de blié dans san gueurné ». - (19) |
| gueûrne d’traf’ye (d’lai) : (de la) graine de trèfle - (37) |
| gueurné : n. m. Grenier. - (53) |
| gueurne, graine - (36) |
| gueurné, grenier. - (16) |
| gueurné, s. m. grenier, lieu où on dépose le grain. - (08) |
| gueurne. s. f. Graine. Des gueurnes de luizarne. Des gueurnes de sainfoingne. (Accolay). - (10) |
| gueurnée : Balayures de graines de foin. « Y a in carre (un coin) de man prè qu'est désencemenci je vas y mentre de la gueurnée ». - (19) |
| gueurnée : des épis nombreux dont les grains sont denses . Une mouechon ben gueurnée : une bonne moisson. - (33) |
| gueurnée n.f. Graine du foin ramassée sur les fnaux qu'on semait pour refaire les prés. - (63) |
| gueurnée : (gueurnè - adj.) chargé de grains (en parlant des petits pois ou des céréales) ; on dit aussi, dans ce sens, grin:gné. - (45) |
| gueurnepillerie, mauvaise graine, enfants insupportables - (36) |
| gueurner (gueurnier) : grenier, céréales bien en grains - (39) |
| gueurner (n.m.) : grenier - (50) |
| gueurner : Donner beaucoup de grains. « Les bliés de c't (s't) an-née ant bien gueurné ». - (19) |
| gueurner : grainer - (57) |
| gueurner : grainer, faire beaucoup de grain - (48) |
| gueurner : grenier. - (52) |
| gueurner, v. n. grainer, être grenu, avoir beaucoup de grain : les avoines sont bien « gueurnées « cette année : par le vent du nord les blés « gueurnent » bien - (08) |
| gueurnes : ce mot désigne un oiseau qui fait « grr-grr-grr » - (39) |
| gueurnette : Halle aux grains. « Ol a fait mener san blié à la gueurnette » : il a fait conduire son blé à la halle aux grains. - (19) |
| gueurni (on) : grenier - (57) |
| gueurnî n.m. Grenier. - (63) |
| gueurnié (nom masculin) : grenier. - (47) |
| gueurnier : grenier. Le gueurnier sert de débarras : le grenier sert de débarras. - (33) |
| gueùrnier, et gueùrnei, s. m., grenier. - (14) |
| gueurnier, s. m., grenier. - (40) |
| gueurnipille - enfant ennuyeux, petit polisson. - Qué gueurnipilles que to ces petiots lai !c'â si mau élevai. - Détornez-vo don', tâs de gueurnipilles !... Fichez-moi le camp. - (18) |
| gueurnipille (n.f.) : femme ou fille de mauvaise conduite - (50) |
| gueurnipille : Gens ou choses de peu d'importance ; marmaille. « Y a pas moyen de se débarasser de c'te (s'te) gueurnipille ». - (19) |
| gueurnipille, garnipille (C.-d., Chal., Y.), guernifille (Char.l, guenipié (Y.). - Marmaille, polisson, maraudeur, vagabond. Vient probablement de garnement combiné à gueux, guenille ou bien encore, comme le pense Cunisset-Carnot, pourrait être une simple altération du mot français guenippe… - (15) |
| gueurnipille, s. f. femme ou fille de mauvaise conduite, coureuse de grands chemins : « ç'ô aune fon-n' d'ran, eune gueurnipille », c'est une femme de rien, une coureuse. - (08) |
| gueùrnipille, s. m. et f., vaurien, homme de peu, coureuse : « Tous ces ch'tis drôles, qui nous fesont des niches, y é d'la vrâ gueùrnipille. » - (14) |
| gueurnipille, s. m., bandit de grand chemin. - (40) |
| gueurnoler, gueurnouyer : lambiner. - (29) |
| gueurnon. s. m. Grumeaux, râclon, partie d'un fricot, d'une fricassée, attachée au fond du vase qui a servi à la cuisson. (Percey). - (10) |
| gueurnot : n. m. Petit grain cassé. - (53) |
| gueurnote : (gueurnot' - subst. f.) nom collectif des déchets lourds que laisse le vannage : ce sont les graines des graminées parasites. Synonyme : crin:s' (voir ce mot). Locution : è lè gueurnot' : un à un (littéralement "à la grenette" , en égrenant) - (45) |
| gueurnote : 1 n. f. Organisation, sans organisation. - 2 adv. Peu à peu. - (53) |
| gueurnoter : pleuvoir légèrement. (S. T IV) - B - (25) |
| gueurnoter, v. n. passer grain à grain. - (08) |
| gueurnotte(s) : petite(s) crotte(s). À sa naissance il fallait parfois dégueurnotter le poulain constipé par la rétention de méconium. - (62) |
| gueurnotte, s. f., crotte de bique. - (40) |
| gueurnotter, v., tomber les uns après les autres. - (40) |
| gueurnoueillâ, s. m. réservoir fangeux, mare, terme méprisant pour désigner une pièce d'eau propre seulement à nourrir des grenouilles. - (08) |
| gueurnoueillous, s. m. globules gélatineux dans lesquels se trouvent et se nourrissent les œufs ou embryons de grenouilles. - (08) |
| gueurnouillat (nom masculin) : large flaque d'une eau sale. - (47) |
| gueurnouillat. s. m. Lieu marécageux, grenouillère. (Annay-sur-Serein). - (10) |
| gueûrnouille : grenouille - (37) |
| gueurnouille : grenouille. - (52) |
| gueurnouille : voir guernouille - (23) |
| gueurnouillé : 1 n. f. Mare à grenouilles. - 2 n. m. Pêcheur de grenouilles. - (53) |
| gueurnouille : n. f. Grenouille. - (53) |
| gueùrnouille, et gueùrnoille, s. f., grenouille : « Non, moi j'n'ainme pas l'iau ; ail' vous met des gueùrnouilles plein l'ventre. » - (14) |
| gueurnouiller : pêcher en fraude. (VDS. T IV) - VdS - (25) |
| gueurnouiller : pleuvoir légèrement. - (31) |
| gueurnouiller, fréquenter les cafés et délaisser son ouvrage. - (27) |
| gueùrnouiller, v. intr., aller de ci de là, perdre son temps : « Te crès qu'ô travaille ? Ah ben ouiche ! ô gueùrnouille tout l’long des rues. » Dans ce cas, ce mot contient aussi l'idée de buvocher. (V. Veùrneùler.) - (14) |
| gueurnouilleux. s. m. Qui boit sans soif. (Vertilly). - (10) |
| gueurno-ye, s. f., grenouille. - (40) |
| gueurno-yer, v., grenouiller, pour parler des bruits involontaires de l'estomac. - (40) |
| gueurô, s. m., odeur de vieux cuir, crasseux et mouillé. - (40) |
| gueurot, s.m. mauvaise odeur de linge sale : "ça sent le gueurot". - (38) |
| gueurouer: couver. (B. T IV) - S&L - (25) |
| gueurpillon, greupillon n.m. Sentier escarpé. - (63) |
| gueurriâ, traînard, lambin. - (27) |
| gueursi : Grésil « Y a cheu du gueursi ». - (19) |
| gueursi : grésil. - (29) |
| gueursi : transi. Je suis gueursi de froid : je suis transi de froid. - (33) |
| gueursiller. v. n. Grelotter. (Ménades). - (10) |
| gueursilli : Grésiller, tomber du grésil. « Y a gueursilli c'tu (s'tu) sa paru qu'i negèle pas demain le métin » : il est tombé du grésil ce soir pourvu qu'il ne gèle pas demain matin. - (19) |
| gueursse : graisse - (51) |
| gueurssi : graisser - (51) |
| gueuruâche : (gœrüâch' - subst. f.) chiendent. - (45) |
| gueurver : Affliger, faire de la peine. « I me gueurve bin d'yrenanci » : il m'est pénible d'y renoncer. - (19) |
| gueûrz’ette : grenouille de rosée (rainette) - (37) |
| gueûrzeil’es : groseilles - (37) |
| gueurzi – grésil. – En é fait les quatre temps, vraiment : le sulo, lai plieue, le broillair, le gueurzi ; c'â les giboulées de mars que se faisant en feuvré. - En é choué du gueurzi, que c'éto queman ine petiote gréle. - Ce n'â rân ; du gueurzi, quoi ! - (18) |
| gueurzi (n.m.) : grésil - (50) |
| gueurzi (nom masculin) : grésil. - (47) |
| gueûrzi : grésil - (37) |
| gueurzi : grésil - (48) |
| gueurzi : grillé. Des épis gueurzis par la sécheresse : des épis grillés par la sécheresse. - (33) |
| gueurzi : très sec - (39) |
| gueùrzi, et greûzi, s. m., grésil. - (14) |
| gueurzi, grésil ; gueurzillé, grésiller. - (16) |
| gueurzillé : très sec - (39) |
| gueurziller (v.imp.) : tomber du grésil - (50) |
| gueùrziller, et greùziller, v. intr., grésiller : « Dà, y a gaeùrzillé su nos vignes ; j'n'àrons pas grand vin c't'an-née. » - (14) |
| gueûrzîller, gueûriotter (en lai poêle) : grésiller (dans la poêle) - (37) |
| gueurziller, v. n. grésiller. Se dit du grésil qui tombe. - (08) |
| gueurzonner : Accompagner à mi-voix une personne qui chante. - (19) |
| gueute, goute ; on dit : i n'i voè gueute, pour : je n'y vois rien. - (16) |
| gueyde. : Aujourd'hui gaude (reseda luteola, plante de la famille des capparidées). Les teinturiers en laine de Châtillon en faisaient grand usage. (Cout. de Châtillon de 1371.) - (06) |
| guéyo : flaque d'eau. (RDM. T IV) - B - (25) |
| guézes, s. f. habits, vêtements. Ce mot ne s'emploie qu'au pluriel. - (08) |
| guézillat. s. m. Roitelet. (Turny). - (10) |
| guèzouèyer : remuer de l'eau. (RDM. T IV) - B - (25) |
| gugne (un) : une aiguille. - (56) |
| Gui dit Barôzai. C'est l'ami de Blaizôte, et l'auteur de ces Noëls, intitulés par cette raison : « Noei de Gui Barôzai », Gui est le nom, Barôzai le surnom. - (01) |
| guia ! à gauche, en parlant aux chevaux. - (05) |
| guiâ, glas des morts (prononcer en une seule syllabe). - (16) |
| guiab, guiable. n. m. - Diable. - (42) |
| guiâbe, s. m. diable. « L’guiâbe », le diable. - (08) |
| guiable (nom masculin) : diable. - (47) |
| guiai (n.m.) : verglas - (50) |
| guiaice (n.f.) : glace (aussi yaice) - (50) |
| guiaice : glace - (48) |
| guiaice, glace ; guiaiçon, glaçon. Guiaicé : el â guiaissé, il est tout froid. - (16) |
| guiaicer, v. n. glacer, se convertir en glace, se congeler. Les chemins, les étangs sont « guiaicés. » - (08) |
| guiaiçon : glaçon - (48) |
| guiaiçon, s. m. glaçon, morceau de glace. - (08) |
| guiaijo, iris (fleur) ; on dit aussi : glaio. - (16) |
| guiaine, guieune, s. f. glane, poignée d'épis ramassés dans un champ après la récolte. - (08) |
| guiainer, guieuner, v. a. glaner, ramasser les épis qui restent dans le champ après la moisson. - (08) |
| guiais. s. m. Glas. (Yassy-sous-Pisy). - (10) |
| guian, gland. - (16) |
| guiand : gland - (48) |
| guiand : (gyan - subst. m.) ou ègyan - gland, fruit du chêne. - (45) |
| guiand, iandot : n. m. Gland. - (53) |
| guiandaux, s. m. épillets de l'avoine. - (08) |
| guiapée : (gyapé: - subst. f.) grande quantité de liquide. Œn gyapé: d' soup' " une bonne assiettée, une bonne marmite de soupe". - (45) |
| guiaper : (gyapè - v. intr.) éclabousser. - (45) |
| guiapes. s. f. pl. Petites pierres que les maçons placent dans l'intérieur d'une couverture en laves. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| guiapotte : (gyapot' - subst. f.) neige en cours de fonte, à peu près synonyme de livot'. - (45) |
| guiapou (ouse) : (gyapou, -ou:z' - adj.) sursaturé d'eau ; se dit d'un terrain trop mouillé, ainsi que d'un fromage mal égoutté qui rend encore de l'eau. - (45) |
| guiâpou, ouse, adj. gluant, poisseux, qui s'attache aux pieds ou aux mains. S’emploie principalement pour désigner un sol argileux et humide : un terrain « ghiâpou », une terre « ghiâpouse. » - (08) |
| guiapouillou, de consistance molle et gélatineuse. - (27) |
| guiapoux : très humide, boueux, gluant - (48) |
| guiapoux, guiapouse. Gluant, qui s'attache aux doigts comme un corps gras. - (13) |
| guiarde, treûe : truie - (43) |
| guiâtrou, ouse, adj. ce qui colle, ce qui poisse. Du pain « ghiàtrou », de la galette « ghiâtrouse. » (Voir : guieu.) - (08) |
| Guiaude. Nom d'homme : Claude : « a fau viâ queurier l'guiaude », il faut vitement appeler le Claude. La prononciation est Ghiaude. - (08) |
| guiâver, v. n. souffrir par défaut de nourriture, ne pas manger suffisamment : « al é ghiâvé, l’poure gâ », il a eu faim le pauvre garçon. - (08) |
| guiavonner. v. n. Produire des bulles de savon en savonnant, en lavant du linge. (Maligny). - (10) |
| guibe. s. f. Jambe. - (10) |
| guibole : jambe. - (62) |
| guibole, s. f., jambe longue, mince. Se dit ironiquement. - (14) |
| guibole. s. f. Jambe. L'abbé Corblet écrit guibaule. - (10) |
| guiboles - jambes qui ne sont pas fortes, qui embarrassent presque dans la marche. - I ne peu pu ran fâre de me deux guiboles, quoi ! - Vois don ce qu'â ressanle aivou ses grandes guiboles ! – Pores guiboles, vais ! – C'est une expression familière. - (18) |
| guiboles. Jambes. - (13) |
| guibolle. Jambe. - (49) |
| guibrée. n. f. - Désigne un certain nombre de personnes, une guibrée de monde. (Mézilles, selon H. Chéry) - (42) |
| guichair : frelon - (48) |
| guichair. s. m. Frelon. (Ménades). - (10) |
| guichard : frelon. - (52) |
| guichard : frelon. - (33) |
| guichard : frelon - (39) |
| guîchard : frelon. IV, p. 27 - (23) |
| guîché : voir guîchard - (23) |
| guiche, jucheoir. Du latin jugum. - (02) |
| guiché, s. m. frelon. Le même mot se prononce « guichon » dans quelques parties du Morvan - (08) |
| guiche. : Juchoir. (Du latin jugum, treillage et berceau, selon Columelle.) - (06) |
| guichon voir guîchard - (23) |
| guichon, ,sm. f. individu habillé à la hâte, sans goût. - (17) |
| guichon, s. m. valet de trèfle au jeu de cartes. Dans quelques localités, le «guichon » est le sept de cœur. Il sert d'atout dans le jeu appelé la partie. - (08) |
| guidai. Guidé, guidés, guider. - (01) |
| guide : s. f., gouvernail de chaloupe. - (20) |
| guide, guidon : s. m., poteau indicateur de route. De nombreux lieux habités, dans le département de Saône-ct-Loire, se nomment Le Guide et Le Guidon. - (20) |
| guides : courroies - (37) |
| guidon : étendard des gens d'armes. Porteur d'étendard. - (55) |
| guienne. s. f. Glane. - (10) |
| guienner. v. a. Glaner. - (10) |
| guienneux, euse. s. m. et f. Glaneur, euse. - (10) |
| guiesse : glace. (B. T IV) - D - (25) |
| guièsse : la glace, - (46) |
| guiesson : un glaçon - (46) |
| guieu : glui (seigle préparé pour la toiture ou la confection de liens) - (48) |
| gui'eu : glui. Paille longue de seigle ou de blé avec laquelle on faisait les toits de chaume ou les liens des bottes de paille. - (33) |
| guieu : (gyeu - subst.m.) glui, belle paille de seigle, non cassée, qu'on a obtenue en battant les épis à la main sur un tonneau appelé poin:son: (cf. ce mot) - (45) |
| guieu, petit paquet de paille de seigle, pour accoler la vigne; on dit aussi : un glu. - (16) |
| guieu, s. m. glui, paille de seigle qui n'a pas été brisée par le fléau et avec laquelle on couvre les bâtiments ruraux. - (08) |
| guieu, s. m. osier : « al ô été côper deu ghieu », il a été couper de l'osier. Le « guié « ou « guiet » est la racine, le tronc qui reste en terre lorsque la pousse a été enlevée. - (08) |
| Guieu. n. m. - Dieu. - (42) |
| guieu. s. m. Glui. (Ménades). - (10) |
| guieulo : (gyeulo - subst. m.) petite poignée de glui, dont on bourrait le trou du fond d' un cuvier, lors de la "bue", pour filtrer l'eau de lessive, (le luchu). C'est également d'un guieulo, enflammé cette fois, qu'on se munit pour flamber les soies du porc fraîchement tué. - (45) |
| guieune : (gyeun’ - subst. f.) glane, poignée d'épis glanés après la moisson et qu 'on donne tels quels aux volailles, sans les battre. - (45) |
| guieuzi, s. m., grésil (giboulée de mars). - (40) |
| guige : grand bâton muni d'un aiguillon servant à guider un attelage de bœufs. Longue baguette flexible. A - B - (41) |
| guige : grand bâton muni d'un aiguillon servant à conduire un attelage de bœufs - (34) |
| guige. Pique-bœuf. On dit aussi : « aiguillon ». Longue gaule de bois avec un aiguillon pour conduire les bœufs au travail. - (49) |
| guignai, regarder de côté en clignotant les yeux... - (02) |
| guignan : Malheur. « Faut-i avoi du guignan ! » : faut-il avoir du malheur ! - (19) |
| guigne (une) : cerise - (61) |
| guigne : malchance - (44) |
| guigne : Quignon, gros morceau de pain. « Y a passé in pauvre, je li ai donné eune guigne de pain ». - (19) |
| guigne coue : Hoche-queue, bergeronnette. Le hoche queue s'appelle aussi « chauche motte » parce-qu'il suit la charrue en sautillant sur les mottes de terre comme pour les « chauchi » les tasser. - (19) |
| guigne de pain, gros morceau de pain. Evoi d'lai guigne, avoir de la malchance. - (16) |
| guigné. : Cligner des yeux, regarder de côté. Ce mot est d'origine étrangère au latin. On dit guigner en hollandais (l'abbé Corb.). Aller de guingoi ou de quignoi c'est-à-dire de côté, de travers, paraît provenir de ce verbe. - (06) |
| guigne-queue : s. m., hoche-queue, bergeronnette. - (20) |
| guigner : bouger. - (30) |
| guigner : v. a., remuer, agiter. Ça guigne toujours ! - (20) |
| guigner. Regarder, vieux mot. - (03) |
| guigner. v. a. Regarder de côté, regarder d'un œil, observer quelqu'un en faisant semblant de regarder ailleurs. – Guigner le bien d'autrui, le convoiter, essayer de s'en emparer. - (10) |
| guigneuchi : Secouer avec mouvement de va et vient. « J'ai biau guigneuchi je peux pas voi le bout d'arrégi (d'arracher) c'te (s'te) cheville ». - (19) |
| guigneux. s. m. Qui regarde en fermant un oeil, ou qui regarde en-dessous, de côté. - (10) |
| guigni : guigner - (57) |
| guigni : Remuer, n'être pas solide. « Tot ce que guigne ne cheut pas » : tout ce qui n'est pas solide ne tombe pas. « Tâte voir si le nez te guigne » : se dit ironiquement dans le sens de compte là dessus ! - (19) |
| guîgni v. (fr. guigner) Convoiter, viser. - (63) |
| guignier. n. m. - Cerisier. (Arquian) - (42) |
| guignocher : trembler au moindre souffle, secouer la tête en marchant. - (30) |
| guignocher, v. n., fréquentatif de guigner. - (20) |
| guignochon : s. m., qui guignoche, qui s'agite. Voir bougeon. - (20) |
| guignon, ennui, désappointement. (Voir au mot anguignônai.) - (02) |
| guignotement. s. m. Clignotement. (Villiers-Bonneux). - (10) |
| guignoter. v. n. Clignoter. (Ibid.). - (10) |
| guignotse n.f. Chien du fusil. - (63) |
| guignotsi : bouger légèrement, sans arrêt. A - B - (41) |
| guignotsi : bouger légèrement, sans arrêt - (34) |
| guignotsi v. Gigoter sans arrêt. - (63) |
| guignotson n.m. Qualifie celui ou celle qui s'agite beaucoup, qui a la bougeotte. Voir boudzon. - (63) |
| guigouâ : n. m. Travers, de travers. - (53) |
| guigouaignai : lutiner. - (33) |
| guiguitte, n.f. éphippigère, insecte dangereux pour la vigne. - (65) |
| guije n.f. (de guisarme, lance avec crochet) Long bâton muni d'une pointe de fer pour aiguiller les bœufs. - (63) |
| guilaie, s. f. glace, eau congelée par le froid. - (08) |
| guili (faire) ou (faire des) guilis : faire la chatouille. - (54) |
| guili n.m. Chatouille. - (63) |
| guili, s. m. le «guili» est le chatouillement du cou ; faire à quelqu'un le « guili », c'est chatouiller une personne sur le cou en jouant ou pour exciter le rire. - (08) |
| guiliche (n. f.) : chatouille (té m'fais la guiliche (tu me chatouilles)) - (64) |
| guillandai, errer çà et là... - (02) |
| guillandai. : Vagabonder. L'expression couri le guilledou signifie, selon Grosley, être en bonne fortune. Je crois la définition trop à l'eau rose. Ce mot a un autre sens chez Rabelais. - Guildin, dans le dialecte signifie haquenée et au figuré une femme de débauche dont le lieu de refuge s'appelait vraisemblablement guildou. - (06) |
| guillandeu, conduite plus ou moins régulière (courir son—). - (27) |
| guillandeu, s. m. on donnait ce nom aux clients d'une bonne maison, aux individus, fermiers, métayers, locataires, qui, le premier jour de l'an, apportaient, à charge de revanche, quelques compliments, le plus souvent, accompagnés de quelques honnêtetés ou cadeaux à leur «mon-sieu » ou à leur « dame. » - (08) |
| guillanné, aguilanneuf, étrennes du premier jour de l'année, quête du carnaval, mascarade. - (08) |
| guillannée. s. f. Serte d'aumône que les enfants pauvres viennent demander, à Joigny, la veille et le jour des Rois, en chantant un cantique de circonstance, qu'ils terminent toujours par ces mots « La guillannée, la part à Dieu, ma bonne dame ! » Cette coutume, qui existe encore en beaucoup d'autres endroits, est un ressouvenir de ces vieilles fêtes gauloises qui se célébraient au commencement de chaque année, et dans lesquelles on criait « A gui l'an neuf ! » La guillonnée n'est pas autre chose qu'une altération de ce mot. - (10) |
| guillaumié, guillaumet, s. m. pinson, la fringille célibataire. - (08) |
| guille : truie. - (30) |
| guille, sf. quille. - (17) |
| guille. Crotte de petits animaux. Guilles de ratte, crottes de souris, nom d'un petit bonbon rond à la réglisse. Etym. probablement l'allemand Kegel, petite boule. - (12) |
| guille. Excrément humain. - (13) |
| guille. s. f. Entrave suspendue au cou d'une bête à cornes pour l'empêcher de se sauver. (Percey). - (10) |
| guilledou (courir le) (Cette locution, que tout le inonde comprend, viendrait, selon Ménage, de gildonia (anciennes gildes germaines), sorte de confrérie où se faisaient des agapes souvent licencieuses. Pasquier, Le Duchat, etc., la font venir de « courir l'aiguillette » : on sait qu'on entendait autrefois par « aiguillettes » les cordons qui attachaient le haut-de-chausses, d'où « nouer l'aiguillette », maléfice conjugal dont nos sorciers usent encore aujourd'hui). - (04) |
| guilledou (courir le), loc. hanter les lieux de débauche, mener une vie déréglée avec les femmes. - (08) |
| guilledou (Courir le). S'amuser à toutes les fêtes de village, danser et faire la cour aux filles. Je pense que ce mot nous vient du flamand : une gbilde de jeunesse est une société, une confrérie de plaisir ayant ses réunions, ses statuts, son administration. Il y avait autrefois des gbildes d'archers, d'arbalétriers, de paulmiers. Il y avait aussi les ghildes des métiers, c'est-à-dire des drapiers, des cordouanniers, des ferronniers, etc. Al ai coru son guilledou teute lai neut, et pu a ne peu pas traiveiller. - (13) |
| guilledou, lieu de débauche. On dit courir le guilledou. Dans le Vocabulaire breton, gwillioudi signifie accoucher. (Le Gon.) - (02) |
| guillemette, v. f. épouvantail. - (24) |
| guillenlé. Ce sont les souhaits du jour de l'an, le Gui l’an neuf des druides, dont l'obscure tradition s'est conservée jusqu'à nous... - (13) |
| guilleret : joyeux - (44) |
| guilleron, s. m., petit étang. - (11) |
| guillerou, adj. guilleret. - (22) |
| Guillô. Guillot, nom propre formé de Guillaume par corruption. Guillaume, Guillemot, Guillot… - (01) |
| guillocher, v., faire des ricochets dans l'eau, avec des cailloux. - (40) |
| guillon : cheville pour boucher le trou du tonneau par lequel on met le robinet. - (30) |
| guïllons n.m.pl. (or. inc.). Courroies de fixation en cuir passées entre les cornes des bœufs en dessinant un huit et attachées aux extrémités du joug. - (63) |
| guillou : morveux (nez) - (48) |
| guimbarde. n. f. - Rehausse placée sur les ridelles d'une charrette. - (42) |
| guinauder. v. n. Fainéanter, flâner. (Lasson). – Demander sans cesse, sans besoin, avec effronterie, avec impudeur. (Soucy). - (10) |
| guinche. s. f. Pervanche. (Argenteuil). - (10) |
| guincher, v. n. balancer, faire un mouvement de côté et d'autre. - (08) |
| guincher. v. n. Incliner, pencher, baisser de travers. - (10) |
| guinchiller, v. a. balancer. Diminutif de guincher. - (08) |
| guinchouée, s. f. balançoire. - (08) |
| guindale : récipient de cuisine. - (56) |
| guindé : fier de sa personne - (44) |
| guinder : Viser. Au tir. - (19) |
| guindole (une) : un récipient - (61) |
| guindôle, s. f., vase contenant une portion exagérée : « O mainge, ô mainge... I l'y faut des guindôles de sope! » - (14) |
| guindolée, s. f., contenu de la guindôle. - (14) |
| guindouille. s. f. Fille ou femme maladroite, de peu d'intelligence et surtout de peu d'énergie. - (10) |
| guindrelle : fille délurée. - (33) |
| guindrole : ustensile de cuisine - (44) |
| guingne: (gin:gn' -subst.f.) trappe qui fait communiquer le fenil avec l'étable, et par où on jette le foin destiné aux vaches dans le "quart" qui est un emplacement spécial situé dans le coin de l'étable. - (45) |
| guingnot. s. m. Envie, besoin de nonchaloir, de flâner, de paresser, dont on est pris extraordinairement, et qui vous tient plus ou moins longtemps. « Tu ne fais donc rien aujourd'hui"? – Ah ben non, j'ai le guingnot! » – C'est un synonyme de flemme. - (10) |
| guingoi, être de travers. Je crois qu'on devrait dire de guainchoi. (Voir au mot guainchai.) - (02) |
| guingoi. De guingoi. De travers. On dit qu'une chose va de guingoi, comme si on disait qu'elle va de guignois, du verbe guigner qui vient de cuigner en écrivant cuin à la picarde pour coin, parce que guigner c'est regarder du coin de l'œil… - (01) |
| guingois (de), de travers - (36) |
| guingois, de travers, gingois. - (04) |
| guingue. s. f. Pli fait à un vêtement trop long. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| guinguette : Etre en guinguette, être légèrement gris, avoir bu un coup de trop. « Ces jeunes gens fiant dan bin du train ! Oh i sant in ptiet bout en guinguette » : ces jeunes gens font bien du bruit ! Oh ils sont un peu gris ! - (19) |
| guinguin, quinquin. s. m. Le petit doigt. (Guy). - (10) |
| guiode : (gyod’ - adj. inv.) se dit d'un tubercule gorgé d 'eau, à la suite d'un "coup de gelée". - (45) |
| guioffé : n. m. Bruit d'un pied mouillé qui patauge. - (53) |
| guion : cordes liant les cornes et le joug - (43) |
| guiôtou, ouse, adj. aqueux, qui contient de l'eau épaisse ou grasse. se dit des pommes de terre qui ne sont point farineuses, du pain dont la pâte est humide et molle, et en général de tous les aliments surchargés d'eau. - (08) |
| guioufé, vn. se dit du bruit de l'eau dans les chaussures. - (17) |
| guioufer : (gyôfè - v.intr.) se dit du bruit que fait l'eau qui a pénétré dans les chaussures. - (45) |
| guiousser. v. n. Glousser. (Lainsecq). - (10) |
| guiouti : (gyouti, gyuti - subst. m.) endroit très marécageux. - (45) |
| guipe, guip-ye : guêpe - (43) |
| guise (Brionnais) : aiguillon. - (30) |
| guise : grand bâton muni d'un aiguillon servant à conduire un attelage de bœufs - (43) |
| guisi : fausset - (60) |
| guisotte. Serpette. Etym. très probablement c'est un mot celtique qui désignait un instrument tranchant, car les Bretons appellent encore aujourd'hui guisel, un ciseau. - (12) |
| guitée, gluitée. n. f. - Poignée de paille de seigle utilisée pour la confection de liens. « L'v'la parti eveuc sa guimbarde pleune d'guitée et d'échalas ... » (Fernand. Clas, p. 55) - (42) |
| guitso : porte (guichet) ménagée entre l'étable et la grange permettant de faire passer le foin dans le râtelier. A - B - (41) |
| guitso : porte ménagée entre l'étable et la grange pour faire passer le foin - (34) |
| guitsot n.m. Guichet de passage du foin de la grange à l'étable. Voir feûron et caluron. - (63) |
| guittées. s. f. pl. Poignées de gui, de glui, pour accoler les vignes, pour lier les gerbes à la moisson. (Lainsecq). - (10) |
| guivre. : (Dial. et pat.), givre, vivre et wivre, serpent. (Du latin vipera). - Le nom de bois de vesvres, cest-à-dire bois aux couleuvres est très fréquent dans diverses localités. - (06) |
| guize : (nf) aiguillon pour mener les vaches - (35) |
| gula, gueule. - (54) |
| gummer : v. n., rester stationnaire ou stagnant. Se dit surtout des liquides. - (20) |
| gu'neille, g'nellè : v. t. Défraîchir. - (53) |
| gu'néillou : mal habillé, habits déchirés, en guenilles. - (33) |
| gu'nette, brebis ; odeur du suint des moutons. - (27) |
| gu'nette, brebis. - (28) |
| gu'nillou, g'nillou, gueillon : adj. et n. m. Guenilles (personne en). - (53) |
| gu'nillou, raisin qui n'étant pas mûr se ratatine, - (38) |
| gunmé : plat réchauffé. - (66) |
| guœllmœt’e, s. f. épouvantail. - (22) |
| guœllyrœ, adj. guilleret, joyeux. - (24) |
| guœrle, s. f. grêle. Le grêlon lui-même. Verbe : guœrlé. - (22) |
| guœrné, v. n. abonder, foisonner au battage des récoltes : ce blé guœrne bien. - (22) |
| guolon, golon du roi. Bouchée, le morceau que l’on peut circonscrire avec ses dents. Le golon du rey est, parmi les bouchées que l’on a sur son assiette, celle qui sera la plus savoureuse, celle que les gourmands ne mangent que la dernière, morceau de roi ! - (12) |
| guordzeron d'tssemise : pour les hommes récipient improvisé en sortant le pan avant de sa chemise et en le tenant relevé vers l'avant pour y mettre par exemple des fruits pendant la cueillette - (51) |
| guornailli : boire sans limite - (51) |
| Gustin : nom de bœuf. III, p. 30-o - (23) |
| gutâ, gheutâ, nom de loc. gouttière. - (08) |
| gutte, goutte, s. f. gouttière, écoulement d'eaux. - (08) |
| guttis - petites sources sans écoulement, ne donnant que des gouttes en quelque sorte, et formant un terrain un peu marécageux. - En dairo bein aissaini les endroits pliains de guttis que rendant les terres grasses et maulâsilles, et pu aitot gâtant gros les prais. - (18) |
| g'vau, s. m. cheval. - (08) |
| h - cette lettre n'est jamais aspirée dans le patois, ainsi par exemple : Ceute parsonne qui n'é point d'honte. - Ce n'â pâ lai science que l' i é fait trouvai cequi, vais c'â l'hasair. – A sont bein héroux ces gens lai.- On peut donc écrire avec ou sans l'h, car le patois n'a pas d'autre orthographe que celle de la prononciation. Par conséquent, contentons-nous de donner quelques mots seulement avec la lettre française. - (18) |
| h : Dans le patois la lettre H n'est jamais aspirée. « Des harnas » des harnais prononcez : des zarnas. - (19) |
| h : est généralement muette quand elle devrait être aspirée (hachon, hachis, etc.), et au contraire aspirée quand elle devrait être muette (hameçon, etc.). - (20) |
| h, dans notre patois est une lettre parasite. Elle ne s'aspire jamais. Nous disons l'ache, l'aine, l'ardiesse, l'asard, l'onte, pour la hache, la haine, la hardiesse, le hasard, la honte. - (08) |
| h, le patois n'aspire jamais la lettre h. - (16) |
| h, l'h étant toujours muet, voir a, e, o, etc. - (22) |
| h, on trouvera ici peu de mots commençant par h, l'orthographe ancienne ayant été restituée à la plupart d'entre eux. Ceux où l'aspiration est attestée sont précédés d'un astérisque (*). - (17) |
| h. : Le patois n'admet aucune aspiration de cette lettre ; on dit je l'haï, au lieu que le français dit je le hais. On dit l'haser pour le hasard. (Del.) - (06) |
| hà, s. m. age de charrue. - (08) |
| hab’yi : (vb) habiller - (35) |
| habeuillment n.m. Habillement. - (63) |
| habeursat. s. m. Havre-sac ; par conversion du v en b et re en eur. - (10) |
| habeuy’ment : (nm) les habits : « l’habeuy’ment du dimantse » - (35) |
| habile ! excl., vite ! va vite ! : « Allons, habile ! cors ! Le mâtre te d'mande. » - (14) |
| habile : Leste. « Quand an vint vieux an est plieu guère habile ». « Co (cours) voir après liune te le rattraperas. Je pourrai pas, ol est pu habile que ma ». - (19) |
| habile : adj., actif, prompt, expéditif. I sera d'abord là ; il est habile à marcher. - (20) |
| habilli - vitre (se) : habiller - (57) |
| habilli : Habiller et au figuré critiquer. « An a parlé de ta tot le temps a peu je te répands qu'an t'a bin habilli ! » : on a parlé de toi tout le temps et je te garantis qu'on t'a beaucoup critiqué ! - (19) |
| habilli v. Habiller. - (63) |
| habiyé, s'habiyé, prendre des habits de fête, les habits du dimanche. - (16) |
| hâbre (le grand). Point trigonométrique situé dans la commune d'Alligny-en-Morvan. La montagne du Grand-Hâbre est une des plus élevées du pays, 685 mètres au-dessus du niveau de la mer. - (08) |
| habyi (s’) : habiller - (43) |
| hachahouiller, hacher. v. - Saboter, pour un travail fait sans goût, irrécupérable. - (42) |
| hachan : Hachette, petite hache. « Coper du beu d'ave eun hachan » : couper du bois avec une hachette. - (19) |
| hache (fâre) : Se dit d'un terrain qui fait encoche sur un autre. - (19) |
| hachepère. s. m. Pingre, grippesou, qui, pour de l'argent, hacherait père et mère. - (10) |
| hachon (âchon) : s. m., hachette. - (20) |
| hâchon, s. m., petite hache à bûches. - (40) |
| hachon, s. m., petite hache, pour couper tiges, branchettes et autres menues pousses. Le paysan, bien entendu, n'aspire pas la première lettre du mot, et dit : « L’hachon, mon n-hachon. » - (14) |
| hâë, s. f., haie, buisson, clôture d'épines. - (14) |
| haenge. : (Dial), haine. Dérivation du complément latin adhoesionem parce que la haine s'attache avec ténacité au cœur. - (06) |
| hahaha. Interjection redoublée qui marque le rire… - (01) |
| hahusson. n. m. - Hérisson. - (42) |
| hai. Ha, ah. - (01) |
| haibi. Habit, habits. - (01) |
| haibieument, s. m. habillement, vêtement. - (08) |
| haibile : habile - (39) |
| haibileté : habileté - (39) |
| haibille : habile - (48) |
| haibillé de soie, loc. on donne ce nom pompeux aux cochons, sauf votre respect. C’est le terme le plus usité et le plus général dans le Morvan. - (08) |
| haibillé de souais - cochon. - Se dit par les personnes qui croiraient manquer aux convenances et à la politesse en employant le mot cochon. - Bonjour, Mossieur ! combein vote haibillé de soie ? - I ons aichetai in haibillé de souais hier, ai lai fouaire. - (18) |
| haibille, ll mouillées, adj. habile, actif, prompt, expéditif : «haibille, haibille»! vite, vite! Interjection usuelle pour susciter l'activité de quelqu'un. - (08) |
| haibillement : habillement - (39) |
| haibiller : habiller - (48) |
| haibiller : habiller - (39) |
| haibit : habit - (48) |
| haibit : habit - (39) |
| haibit : n. m. Habit. - (53) |
| haibit, sm. habit. - (17) |
| haibitchué : n. m. Habitué. - (53) |
| haibiteude, s. f. habitude, coutume. - (08) |
| haibitouiller, v. a. habituer, accoutumer. Pour être bien quelque part, il faut d'abord « s'haibitouiller. » - (08) |
| haibitude (n.f.) : habitude - (50) |
| haiche : n. m. Hache. - (53) |
| haichon (n’) : hâche (petite) - (57) |
| haichon : Hache. - (62) |
| haichon, hache à manche court. - (05) |
| haïe, s. f. haine, animosité : il y a de « l'haie » entre ces deux personnes, c’est à dire ils se haïssent. - (08) |
| haïer* (ā), sm. hangar, remise, - (17) |
| haignie. s. f. Hernie. (Ménades). - (10) |
| haila. Hélas. - (01) |
| hailler (pour hallier, par transposition de l'i). s. m. Hangar rustique, fait de perches et de branchages. (Arcy-sur-Cure). - (10) |
| haillon (pour hallon, en mouillant les deux l). s. m. Hangar, abri, petite halte. - (10) |
| hainche (n') : hanche - (57) |
| haine* (en), toc. en haïssant. - (17) |
| hain-ne (d'la) : haine - (57) |
| hainnou - haineux, rancunier. - Ceute fonne lai, ile é in caractére tot ai fait hainnou. - Que c'â drôle, ces hainnou lai ! an n'osuro les tuchai du bout du petiot doigt. - (18) |
| haïr v. Haïr. Au présent de l'indicatif : dz'haïs, t'haïs, ôl haït, etc. - (63) |
| haïr : v. a. L'indicatif présent se conjugué : j'haïs, t'haïs, il haït, pour je hais, tu hais, il hait. Oh ! J' t’ haïs t’i, je l'haïs t’i ! - (20) |
| hairai. Enfant… - (01) |
| hairan, s. m. hareng, poisson de mer. Dans notre patois l'h n'est pas aspirée. : « dé-z-airans. » - (08) |
| hairdi : hardi - (48) |
| hairdi p’tit ! : tant que ça peut ! - (37) |
| hairdi, adj. hardi, courageux : « eun hon-m' airdi. » — hairdi ! Interjection pour stimuler l'énergie. - (08) |
| haireng (n.m.) : hareng - (50) |
| haireng : hareng - (48) |
| haireng : hareng - (39) |
| hairicot : haricot - (48) |
| hairnaiç’é (ât’e brâment) : porter sur soi plusieurs sacs ou « musettes » en bandoulière - (37) |
| hairnaique : fatigue - (37) |
| hairnaiqué : fatigué - (37) |
| hairnaique : vol, tromperie - (37) |
| hairnaiqué : volé, « roulé » - (37) |
| hairnais : harnais - (48) |
| hairné : fatigué d’avoir dû travailler longtemps sous la pluie, qui a fini par pénétrer à l’intérieur des vêtements - (37) |
| hairnoicher (verbe) : harnacher. - (47) |
| hairnoicher, v. a. garnir un animal, une voiture, de tout ce qui est nécessaire à l'attelage. - (08) |
| hairnois (nom masculin) : harnais. - (47) |
| hairnois, s. m. harnais, tout ce qui sert à l'attelage des chevaux ou des bœufs. L’h n'est point aspirée : « des-z-airnois. » - (08) |
| hairponner : saisir au collet - (37) |
| haïss ! Voy. aïce. - (05) |
| haïssion, haine. - (27) |
| haïsson, heusseron, husson, hausson. s. m. Hérisson. - (10) |
| haïssoo. Haïssais, haïssait. Haïr se prononce haï en bourguignon, et n'aspire point son H, le bourguignon n'admettant généralement aucune aspiration… - (01) |
| haïssu p.p. de haïr. D'achtôt naissu, dz'l'ai haïssu ! - (63) |
| haïssu, part, de haïr. - (14) |
| haït, v. tr., pour hait : « Oh! j'I'haï-t-i ! » Très usité, mais guère à d'autres temps. - (14) |
| haiyâr : hier - (37) |
| hâl : (â:l - subst. m.) vent sec. On parle surtout de l’â:l de mêr, le « hâle de mars », vent sec qui souffle en mars, le plus souvent du nord. - (45) |
| hala !hélas ! - (38) |
| hâle (sous l’hâle) : sous la halle. Dans l'époque contemporaine, l'hâle désignait le rez-de-chaussée de la mairie, endroit de réunion publique par mauvais temps, ou lieu d'échange commercial, marché, etc. Ex : "N'a pas ben longtemps, j'ai biché la Léone sous l'hâle qu'a v'nait vend' ses eux. N'en v'la ène qu'est ben gente ..!" (Vendre ses œufs). - (58) |
| hâle : petit vent sec - (48) |
| hâlé : sec - (37) |
| hâle : vent d'est. - (32) |
| hâlé, adj., sec. - (40) |
| halein-ne (n’) - sousc'ille (on) : haleine - (57) |
| halener. v. a. Sentir l'odeur, éventer, dépister. Se dit surtout des chiens, quand ils prennent l'odeur d'une bête, qu'ils sont sur la piste. – Se dit aussi, à Pasilly, des sangliers qui ont découvert un champ de pommes de terre. Les sangliers ont halené un champ de pommes de terre. Du latin anhelare. - (10) |
| hâler : sécher, s’évaporer du fait du vent et du soleil - (37) |
| hâler : (â:lè - v. tr.) sécher, dessécher (en parlant de la terre, des récoltes)... - (45) |
| hâler, v. a. dessécher, flétrir par le hâle. Ce vent de soulaire « hâle » les sarrasins. - (08) |
| hâler, v. se dessécher. En parlant d'un tonneau. - (65) |
| hallon. s. m. Hangar, petite halle. - (10) |
| haloigne. s. f. Haleine. (Vassy-sousPisy). - (10) |
| haloubi. adj. - Gourmand. (Perreuse, selon M. Jossier) - (42) |
| haloubi. adj. Gourmand. Se dit par euphonie et par adoucissement du g de galoubi. (Perreuse). - (10) |
| hamiau : Hameau. « Chormes est eun hamiau de Manci ». - (19) |
| hammements. s. m. pl. Vaisselle. (Montillot). – Se dit sans doute pour aisements, qui a le même sens. - (10) |
| han ! interj. han appartient à toutes les langues et à tous les patois. - (08) |
| han neau : grenier à foin (s’écrit aussi « en-n’haut ») - (37) |
| hanas. n. m. - Vaisselle grossière. (Villiers-Saint-Benoît, selon M. Jossier) - (42) |
| hanas. s. m. Vaisselle grossière. (Villiers-Saint-Benoit). Se dit pour hanap, hanaps, vase à boire, coupe, tasse, etc. ; du bas latin anas, hanaphus, hanapus. - (10) |
| hânau : n. m. Grenier à foin. - (53) |
| hante : Honte. « T'es tojo le daré (le dernier) de ta classe te devrais avoir hante! ». - (19) |
| hantoux : Honteux, s'emploie dans le sens de timide. « O n'est pas hantoux » il n'est pas timide, il a de l'aplomb. - (19) |
| hâpion : délicat, « petite nature » - (37) |
| haquenée, cheval de petite taille et peu fort... - (02) |
| haragner, exciter un ou plusieurs chevaux pour les faire avancer, au besoin en les frappant. - (27) |
| harandale : Hirondelle. Au figuré les hirondelles de Savoie, les ramoneurs. Ce nom leur vient de ce qu'on les voit arriver au commencement de l'hiver, comme les hirondelles au début du printemps. - (19) |
| hârasser. v. a. tracasser, tourmenter, importuner. L’h n'est point aspirée : je t'àrasse, tu m'ârasses, il m'ârasse. - (08) |
| hârbe (d’l’) : herbe - (57) |
| harbe : herbe. - (52) |
| harbe : Herbe. « Harbe à la cliaire », éclaire, chelidonium majus. - (19) |
| harbe : herbe. Le matin on marche dans l'harbe humide : le matin on marche dans l'herbe humide. - (33) |
| harbe à l'aspic, mélampyre des bois. - (05) |
| harbe ai lai jument : herbe sauvage qui donne une impression de brûlure en l'écrasant. Autrefois on se servait parfois d'herbe comme papier hygiénique. Si on prenait de celle-là on pouvait se mettre à courir, comme une jument - (39) |
| hârbe de crapiaud n.f. Mercuriale, renouée. - (63) |
| hârbe n.f. Herbe. - (63) |
| harbe : herbe - (39) |
| harbe : n. f. Herbe. - (53) |
| harbe, herbe ; harbeû, lieu produisant beaucoup d'herbes. - (16) |
| harbe, herbe. Primes harbes, petites herbes. - (05) |
| harbe, s. f. herbe. - (08) |
| hàrbe, s. f., herbe, herbage. - (14) |
| harbe, s.f. herbe. - (38) |
| harbe. Herbe, herbes. - (01) |
| harbe. n. f. - Herbe. - (42) |
| harbe. s. f. Herbe. Harbe rouge, sainfoin. (Perreuse). - (10) |
| hârbes (ptiètes) n.f.pl. Fines herbes. - (63) |
| harbi : faire manger la 1ère herbe - (39) |
| harbi, adj. s'emploie dans un double sens. Un pré « harbi » est un pré dont l'herbe a été mangée par les animaux ; un boeuf « harbi » est un bœuf qu'on a mis à l'herbe, au vert. - (08) |
| harbi, v. a. faire manger l'herbe d'un pré. - (08) |
| harbillir, habiller. - (05) |
| harbisseure (nom féminin) : action qui consiste à faire paître l'herbe d'un pré. - (47) |
| harbisseure, s. f. action de faire « herbir » un pré, d'en faire manger l'herbe. - (08) |
| hàrbou, adj., herbu, herbeux : « J"veins d'mon pré ; ôl é prou harbou. » - (14) |
| harbou, ouse, adj. herbu, où il y a beaucoup d'herbe. - (08) |
| hârboux, -ouse adj. Vu tot c'qu'i pyout, to pré sra bin hârboux. - (63) |
| harcandage : action de harcander. - (58) |
| harcander - arcander : action de travailler non productivement. Bricoler sans résultat notable. - (58) |
| harcandier : celui qui harcande. Bricoleur éventuellement actif, mais désordonné et sans efficacité. On peut le dire aussi de quelqu'un plus motivé sur le secondaire que sur le principal, sur le superflu que sur l'essentiel. Se dépenser pour rien ou pour pas grand-chose. - (58) |
| harce, harche. n. f. - Herse. - (42) |
| harchage. n. m. - Hersage. - (42) |
| harchage. s. m. Hersage. - (10) |
| harche, harchir, herse, herser. - (05) |
| harche. Herse. On a dit harse. Nous disons harcher, pour herser. - (03) |
| harche. s. f. Herse. Conversion de l'e en a, et de l’s en ch. – Voyez arche. - (10) |
| harcher. v. a. Herser. Voyez harche. - (10) |
| harcule : Homme doué d'une force extraordinaire. « I a ésu eun harcule à Manci, o s'appalait Marcel Lamotte ». (voir à Paraïllou). - (19) |
| hardemenz. : (Dial.), courage. (Job.) - (06) |
| hardes : barreaux perpendiculaires au fond de la voiture à deux roues, épointés au sommet, qui la bordent sur chaque côté - (37) |
| hardi ! excl. pour exhorter, stimuler : « Courage ! allons ! rondement ! Malheureusement ce mot sert souvent à exciter les personnes qui se querellent ou se battent : « Hardi ! hardi les enfants !... » - (14) |
| hardi tin bon : expr. Énergiquement, sans cesse. - (53) |
| hardiasse : Hardiesse. « I n'est pas l'hardiasse que li manque ». - (19) |
| harditinbon : énergiquement (hardi, tiens bon !). - (32) |
| hardi-tin-bon : énergiquement, tiens-toi bien. - (33) |
| haregner, chercher querelle. - (05) |
| hargnant. Taquin, hargneux, querelleur. - (49) |
| hargner. Taquiner, quereller. - (49) |
| hargner. v. n. Hennir. (Chevillon). - (10) |
| harguignai. : Taquiner, fatiguer quelqu'un par des reproches ou des plaisanteries sans fin. La véritable orthographe du mot est arguignay parce qu'il vient du latin arguere ou plutôt argutare, redire, ressasser quelque chose. - Les Picards disent et écrivent arguchet· (l'ab. Corb.). Aux Fourgs, en Franche-Comté, on dit arguenai. (Tiss.) - (06) |
| harguigné, importuner par des insultes ou par des provocations. Dans l'idiome breton, le mot harc'hein (Le Gon.) signifie japper, aboyer ; racine harz, aboiement. - (02) |
| harguigner : énerver. - (66) |
| haria (aria) : s. m., vx fr. hariage, embarras. Ah ! que ça me fait donc d'harias ! - (20) |
| harià, s. m. embarras, tracas, contrariété, tribulation : avoir de « l'hariâ » ; être dans les « harias. « les riches ont de grands « harias », mais les pauvres n'en manquent pas non plus. - (08) |
| harias. Clameurs, discussions, embarras. Ce terme est fort usité dans la Côte-d’Or et dans l'Yonne... - (13) |
| haridelle, mauvais cheval qui boite. D'après Lepelletier, le mot breton harighella signifie chanceler. - (02) |
| harié et arié. Interjection qui exprime la déconvenue et la mauvaise humeur. Quéque te vins fâre vée nos, harié ?.. - (13) |
| harier, tourmenter, harias, tracas, embarras. - (04) |
| harigailles : voir arrigailles. - (20) |
| hàrigner (C.-d., Chal.), hàrguigner (C. -d.), hàrgner (Y.). - Chercher querelle, railler, agacer, harceler. Du même mot hargner, vieux français qui s'est perpétué en Bourgogne et vient lui-même de hargne, lequel a produit les mots français hargneux et hernie, mais dont l'étymologie est inconnue… D'autre part, le patois du Morvan emploie fréquemment le verbe àrâgner ou airâgner dans le sens d'exciter, stimuler, par exemple arâgner les boeufs, pour aiguillonner les bœufs, ou bien arâgner les chevaux pour : fouetter les chevaux. Ce verbe n'a qu'un rapport de consonance avec harigner, car il vient d'un vieux mot français qui signifiait interpeller quelqu'un, le raisonner, l'arraisonner, comme on disait alor s; le sens en est tout différent. - (15) |
| harigner, v. tr., tracasser, chercher querelle : « Olé mauvais coume eùne teigne ; ôl harigne tout l'monde. » - (14) |
| harigner. Chercher querelle, harceler. Du vieux mot hargne ou hergne, d'où est venu hargneux. Nous - (03) |
| harignoù, s. m., hargneux, qui cherche querelle, mauvais coucheur. - (14) |
| harna : Attelage. On dit d'un fermier qui est bien pourvu de bétail de trait : « Ol a in feu harna ». « Deux bans bûs d'harna » : deux bons bœufs de trait. - (19) |
| harnaichi : Harnacher, atteler. « Ol est après harnaichi san chevau » : il est en train de garnir son cheval de ses harnais, il attelle. Au figuré : habiller. « Ol est tojo dreulement harnaichi » : il est toujours habillé de façon ridicule. - (19) |
| harnaijan : Mal de reins, lumbago. « J'ai étrapé eune harnaijan, je peux pas me baichi » : j'ai mal aux reins, je ne peux pas me baisser. - (19) |
| harnais (n. m.) : se dit d'un enfant ou d'un individu turbulent, énergumène (c'est un drôle d'harnais) - (64) |
| harnatsi v. Harnacher. - (63) |
| harné : épuisé - (61) |
| harné adj. Harassé de fatigue. - (63) |
| harné. adj. - Fourbu, exténué. - (42) |
| harné. adj. Qui est infirme, affaibli, sans force, afflige d'une harne (hernie). – Se dit, par extension, de toute personne qu'un excès de lassitude a privée momentanément de ses forces, de sa vigueur, de son énergie. Un homme accable de fatigue dit : Je suis harné. - (10) |
| harnicher. v. - Harnacher. - (42) |
| harnicher. v. a. Harnacher. (Mailly-la-Ville). - (10) |
| harnichue (pour harnichure). s. f. Harnachement. (Mallly-la-Ville). - (10) |
| harnie. Hernie. - (49) |
| harnoi, s. m., harnais. Se disait jadis pour toutes sortes d'appareils de pêche, d'agriculture, de mine, etc. - (14) |
| harnoicher, v. tr., harnacher, accoutrer. - (14) |
| harnois : bon à rien. - (33) |
| harnouais : harnais - (39) |
| harou ! harou ! interj. : au renard! au renard ! harou ! harou ! « harou » est la commune clameur de haro dans les campagnes. - (08) |
| harpailler (s'). v. - Se disputer en s'agrippant, se crêper le chignon. (Villiers-Saint-Benoît, selon M. Jossier) - (42) |
| harpailler (S'). v. pron. Se colleter, se houspiller, se prendre aux cheveux, en parlant des galopins qui se harcèlent, qui se bousculent, même pour jouer. (Villiers-Saint-Benoît). - (10) |
| harpe. Ce mot, qui devrait peut être s'écrire arpe, signifie griffe. Synonyme harpion. - (03) |
| harpi (arpi) : s. m., harpin, croc des bateliers. Se dit aussi de la rame de fond. - (20) |
| harpiaux. n. m. pl. - Gamins turbulents. - (42) |
| harpiaux. s. m. pl. Gamins des rues, polissons, fils de harpies. (Villiers-Saint-Benoît). - (10) |
| harpiller (verbe) : (Se). se quereller, se disputer. - (47) |
| harpion, s. m., orteil. - (40) |
| harse : herse (ou rateule). - (52) |
| harse : Herse. « Donner in cô d'harse à eune tarre » : herser un champ. « Roler c'ment eune harse » : rouler difficilement. « Te farait bien d'engraichi in ptiet bout tan chai o role c'ment eune harse » : tu ferais bien de graisser un peu ton char, il roule difficilement. - (19) |
| harse, s. f., herse. - (14) |
| harsi : Herser. « Harsi des fèves » : passer la herse sur un terrain où l'on vient de semer des fèves. - (19) |
| hasard (d'), loc. adv. peut-être. - (17) |
| hasard : s. m. Attendre le hasard, flâner avec l'espoir d'une rencontre agréable, d'un spectacle curieux, d'une nouvelle intéressante, etc. Contempler le hasard, regarder le hasard, stationner en attendant le hasard. - (20) |
| hasse. s. Herse. (Menades). - (10) |
| hasser. v. a. Herser. (Menades). - (10) |
| hâte (n.f.) : planche de potager ensemencée (ex. : une hâte de pastonade) - (50) |
| hâte : billon (labour en ados) - (48) |
| hâte : mesure agraire - (48) |
| hâte ; n. fém. ; portion de 10 sillons labourés ; les sillons du milieu sont plus élevés que ceux de l'extrémité. Une terre qu'on laboure est divisée en plusieurs hâtes. On dit une hâte de blé, une hâte de luzerne. - (07) |
| hâte : planche de légumes - (39) |
| hâte, s. f. mesure agraire qui, dans l'usage, n'a rien de fixe et qui dans quelques parties du Morvan n. s'applique même à une planche de jardinier : une « hâte » de carottes, une « hâte » d'épinards. - (08) |
| hate. Broche, ou broches de cuisine… - (01) |
| hâte. s. f. Réunion de quatre sillons séparés par des rigoles. - (10) |
| hate. : Broche de cuisine. (Du latin hasta.) - (06) |
| hâtée (n. f.) : division d'un champ destinée à faciliter le labour ou le fauchage – planche de légumes dans un jardin - (64) |
| hatereau : voir atreau. - (20) |
| hatereauder : voir atreauder. - (20) |
| hâtse n.f. Hache. - (63) |
| hatsi : bouton-d'or - (43) |
| hâtsi v. Hacher. - (63) |
| hatsi, pipo, pidpo : renoncule - (43) |
| hâtson : (nm) cognée - (35) |
| hatson : hache - (43) |
| hâtson n.m Hachette. - (63) |
| hau. Haut. - (01) |
| hauboi. Hautbois. - (01) |
| haulebade. Hallebarde, Hallebardes. - (01) |
| haut (monter en), loc. redondante et fautive. Quand on monte, c'est toujours en haut. - (14) |
| haut, e, adj. s'emploie pour désigner une hauteur et sans aspiration de l'h : « l'au » des champs, « l'au « des bois. - (08) |
| haut-la-queue. s. m. Orgueilleux, vaniteux, toujours prêt à faire la roue, à faire le beau, à dresser sa queue. (Saint-Florentin). - (10) |
| haut-mal. Épilepsie, mal caduque. - (49) |
| hautou : hauteur - (43) |
| hautou : Hauteur « O s'est cassé in bré (bras) en cheuyant (tombant) de san hautou ». « Craindre l'hautou » avoir le vertige. - (19) |
| hauts-gouts (ôgoûts) : s, m. pl., épices et autres aromates culinaires. - (20) |
| hauturot. Petite élévation de terrain : j'aillons dôter les hauturots pour ben niveler not’ jardin. C'est un diminutif de hauteur. (V. Theurot). - (13) |
| hazair, s. m. hasard, aventure. L’h n'est pas aspirée : « ai l'azair », au hasard. - (08) |
| hazar. Hasard, chance. - (01) |
| hé ? int. plaît-il ? - (24) |
| hébergeages, bâtiments des bestiaux et des récoltes. - (05) |
| hébergi - logi : héberger - (57) |
| hèbile. Habile. - (49) |
| hébillé de soie, s. m., porc. - (14) |
| hébiller, v. tr., habiller. - (14) |
| hèbit : un habit - (46) |
| hèbit, s. m., habit, vêtement quelconque. - (14) |
| hébit. n. m. - Habit. - (42) |
| hèbitant. Habitant. - (49) |
| hèbitchuè : habitué à... - (46) |
| hèbiter. Habiter. - (49) |
| hébitume : Habitude. « L’hébitume fâ tout » : tout est affaire d’habitudes ! - (62) |
| hêche n.f. Herse. - (63) |
| hêchi v. Herser. - (63) |
| hégron. s. m. Voyez aigueron. - (10) |
| hei. Hé,eh. - (01) |
| héiar (n.m.) : hier - (50) |
| héiar : hier - (39) |
| hein : Hein ! Exclamation familière qui signifie qu'est-ce tu dis ? Quand on veut être plus poli on dit : « plia-ti ? » : plaît-il ? - (19) |
| hein. Cette exclamation interrogative est très usitée dans la ville et dans les environs de Beaune ; elle a le sens de ce n'est-ce pas » et de « comment dites-vous ? » Meire, i fairons des gaufres dimoinche, hein ? - (13) |
| heinche : n. f. Hanche. - (53) |
| hêïsse : (nf) herse - (35) |
| hêïssi : (vb) passer la herse, herser - (35) |
| héla : Hélas ! « Héla qu'i fa dan chaud ! ». - (19) |
| héla, hâla! interj. hélas : « hâla, héla don ! mai vaiche ô périe. » - (08) |
| helasse-moi. Interjection plaintive imitée de l'italien « ahi lasso me ». Ce lasso vient du latin lassus, las, fatigué… - (01) |
| hémeurdiller. v. a. et n. Casser les mottes. (Tronchoy). - (10) |
| henniger (verbe) : hennir. - (47) |
| héraude, héraudie, souquenille, mauvais vêtement, guéraude, guenille. - (04) |
| herbe à cotson : (nf) renouée, trainasse - (35) |
| herbe à crapaud : renouée persicaire. A - B - (41) |
| herbe à crapaud : renouée persicaire - (43) |
| herbe à la croûyotte : voir herbe sainte - (23) |
| herbe à la forcée : pervenche. III, p. 19-1 - (23) |
| herbe à la saignotte : voir saigne-langue - (23) |
| herbe à robin : (ou tsande sauvadze) chanvre sauvage. B - (41) |
| herbe à robin : chanvre sauvage ; plante nuisible des terrains siliceux - (34) |
| herbe de lè torterelle. Mercuriale (Mercurialis annua), plante de la famille des Euphorbiacées. - (49) |
| herbe d'envorne : voir envorne - (23) |
| herbe sainte : stellaire. VI, p. 44 - (23) |
| herbe salée : s. f., oseille sauvage (rumex acelosa). - (20) |
| herbe salée. s. f. oseille. - (24) |
| herbeire, s. m. herbier, panse des ruminants, premier ventricule de ces herbivores. - (08) |
| herbeler, herboler, harboler : v. n., vx fr. herbeler, désherber, couper de l'herbe, arracher de l'herbe. - (20) |
| herbes (Petites) : s. f. pl., fines herbes. - (20) |
| herbi : qui a été mangé (se dit pour un pré) - (48) |
| herbicheure. s. f. Action d'introduire dans une incision faite au poitrail des jeunes aumailles envoyées au pâturage pour la première fois, certaines herbes ayant la vertu d'attirer l'humeur à la surface. – Collection des herbes employées à cet usage. - (10) |
| herbir. v. a. Faire aux jeunes bêtes à cornes envoyées au pâturage pour la premièie fois, l'opération de l'herbicheure. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| herbotè : arracher l'herbe - (46) |
| hercheux. Ouvrier qui pousse les wagonnets dans le puits de mine. Terme minier apporté pendant la guerre de l9l4 par les mineurs évacués du Nord. - (49) |
| hére : atmosphère desséchante - (39) |
| hére, adj. rude, desséché, durci. - (08) |
| hereticle. Hérétique, hérétiques. On a de même vu ci-devant Catolicle pour catholique. Le peuple aime ces sortes de corruptions. - (01) |
| héreux (euse) - (39) |
| héri. interrogation. Plaît-il ? A Champcevrais, lorsqu'une personne fait une question à une autre, si celle ci n'a pas entendu ou n'a pas bien saisi, elle dit : Héri ? et l'autre réitère sa question. - (10) |
| hérier, v. a. hériter. - (24) |
| hérigueux : morceau de bois pointu après avoir été coupé soit sur un arbre ou restant en souche. - (66) |
| hériquié, s. m. héritier. - (08) |
| hérisson : s. m., cylindre de bois garni de chevilles destinées à porter les bouteilles vides qu'on fait égoutter ; petit écouvillon servant à nettoyer les bouteilles ; écale de la châtaigne. - (20) |
| héritaige : héritage - (48) |
| héritaige, s. m. bien qui vient par succession : propriété rurale: champ, terrain en culture : « voiqui eun boun héritaige », voici un bon champ. - (08) |
| héritaize (n.m.) : héritage - (50) |
| héritaize : héritage - (39) |
| héritance, héritation. n. f. - Héritage. - (42) |
| héritance, s. f. , héritage, transmission qui ne va pas toujours toute seule dans les campagnes. - (14) |
| héritatian : Héritage. « Ol a fait eune greusse héritation ». - (19) |
| héritation, s. f. héritage, ce que l'on reçoit par succession : « al é fé eune boune héritation. » - (08) |
| héritation. Héritage. - (49) |
| héritation. s. f. Héritage, ce qu'on a recueilli d'une succession. « Il a fait eine petit' héritation qui l'o bé mis à soun' aie. » - (10) |
| hérite. : (Du latin hoereticus), se disait de tous ceux qui subissaient le supplice du feu. (Voir au mot raim.) - (06) |
| herloge, erloge, heurloge. s. m. Horloge. Dans les environs d'Auxerre, on dit un r'loge. - (10) |
| herloge, heurloge. n. f. - Horloge. - (42) |
| hernaison, hernière : s. f., lumbago. A rapp. du bas-lat. harna, coup, blessure. - (20) |
| herné (j’es) : je suis fatigué, fourbu. - (66) |
| herne : espèce de chiendent - (60) |
| hernè : adj. Très fatigué. - (53) |
| herné, hernée : adj., atteint de lumbago. J’ suis t'herné. - (20) |
| hernie n.m. Hernie. - (63) |
| Herôde. Hérode. On dit proverbialement viettx comme Hérode, à cause d'Hérode Ajscalonite, qu'on appelle d'ordinaire le vieil Hérode, par rapport à ses descendants. - (01) |
| héroi, n. masc. ; huile ou graisse pour la soupe ou les mets ; ma mére, vote soupe ne vaut ran : an y ait point d'héroi dedans. - (07) |
| hérondalle. s. f. Hirondelle. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| hërou, heureux ; bèn hërou, celui à qui tout réussit. - (16) |
| hérouette. n. f. - Badine. - (42) |
| héroux : Heureux. « Alle n'est pas hérouse en ménage ». Proverbe : « Si te veux être héroux eune heure, saoule te ; si te veux être héroux in jo, mairie te, si te veux être héroux eune semain-ne, tue tan cochan ; si te veux être héroux le raste de tes jos, fa te curé ». - (19) |
| hersenure : haie. (A. T II) - D - (25) |
| hérû (-use) (adj.,n.m. et f.) : heureux, heureuse - (50) |
| heruschon, s.m. hérisson. - (38) |
| héruss-hon, hérisson. Voy. éruss'hon. - (05) |
| herzan-ner : braire. Le bourrou herzan-ne : l'âne brait. - (52) |
| hésiter de : voir de. - (20) |
| hesse : herse - (43) |
| hessi : herser - (43) |
| héteriot, héteuriot, hétésiau, hétriot. s. m. Hottereau. (Argenteuil, Tronchoy, etc.). - (10) |
| hétriâ, s.m. hotte. - (38) |
| heûcher, et houcher, v. tr., hucher, appeler d'une voix perçante et de loin. - (14) |
| heucher, hucher, heuger. v. a. Héler, crier fort, appeler. - (10) |
| heucher, v. a. hucher, appeler quelqu'un au loin en criant ; interpeller : « al ôdan i' corti, heuchez-lu. » - (08) |
| heûchi : Faire des efforts pour vomir. - (19) |
| heucle. : Trompeur, fourbe, qui cherche hoquelle. (Lac.) - (06) |
| heue, s. f. heure. « ai lai boune heue », à la bonne heure. - (08) |
| heu'e. n. f. – Heure : « Y'a ben eune heu'e qu'alle est partie. » - (42) |
| heugaj. : Interjection qui exprime la douleur comme une autre interjection hique exprime l'impression du froid. - (06) |
| heuille, heule, hueille. v. a. Huile. Du latin oleum. - (10) |
| heuiller. s. m. Huilier. (Montillot). - (10) |
| heuillerie. s. f. Huilerie. - (10) |
| heûlai: crier fort, hurler. Pou appelai au loin on heule : pour appeler au loin on hurle. - (33) |
| heulé*, vn. hurler. Voir huyé. - (17) |
| heûle, huile. - (16) |
| heule, s. f. huile, « heulerie », huilerie. - (08) |
| heûler (v.t.) : hurler - (50) |
| heûler : crier, hurler - (48) |
| heuler : hurler - (39) |
| heuler, holer. Héler, appeler. - (49) |
| heuler, v. a. huiler, couvrir ou remplir d'huile. - (08) |
| heuler, v. n. hurler, crier, et quelquefois appeler avec force. - (08) |
| heulla. Expression pour ainsi dire intraduisible. Exprime une idée de doute, de méfiance ou de surprise : « Heulla-t-y possible ! Une baignoire pour jeune éléphant, et deux cuvettes profondes comme l'étang des Barres. » (Colette, Claudine à Paris, p.245) - (42) |
| heume, houme, homme. On croit que le pronom impersonnel on dérive de homo, par contraction. - (16) |
| heumèje, hommage. - (16) |
| heupe : huppe (oiseau) - (48) |
| heupe, s. f. huppe, oiseau de l'ordre des passereaux. L’h n'est pas aspirée : « eune eupe. » - (08) |
| heuppe : (nf) partie supérieure de la houe ; huppe - (35) |
| heuppe : huppe - (51) |
| heuppe : Huppe. « Sale c 'ment eune heuppe » : extrêmement malpropre. La huppe passe pour faire son nid dans les ordures. - (19) |
| heuppe n.f. Huppe - (63) |
| heuppe : huppe - (39) |
| heuppe, pupute. Huppe, oiseau. - (49) |
| heuquelle, chicane. Dans l'idiome breton, héga veut dire agacer, irriter, provoquer. - (02) |
| heur (pour heurt). s. m. Rocher, tertre, petite montagne, angle, tout ce qui peut faire heurter. (Soucy). - (10) |
| heûrché : fatigué, épuisé par un long effort - (37) |
| heurché : ivre - (44) |
| heurché : saoul. - (66) |
| heurche n.f. Coup de vent, bourrasque. - (63) |
| heurché : très las - (39) |
| heurché, adjectif qualificatif : très fatigué, rompu, fourbu. Au sens figuré, se dit de quelqu'un qui est ivre. - (54) |
| heurché, ivre à ne plus pouvoir se tenir debout - (27) |
| heurché, presque ivre mort. - (28) |
| heurche, s. f., herse - (40) |
| heurche, sf. herse. - (17) |
| heurché, vt. herser. - (17) |
| heurcher, v., herser. - (40) |
| heurchi (heursi) : hérisser - (51) |
| heurchon : hérisson - (44) |
| heûrchon : hérisson, homme mal peigné, hirsute - (37) |
| heurchon : hérisson. - (59) |
| heurchon n.m. 1. Hérisson. 2. Pilier de bois garni de chevilles destiné à faire sécher les bouteilles rincées. 3. Heurchon d'tseumnée : hérisson de ramonage. - (63) |
| heurchon : hérisson - (51) |
| heurchon : hérisson (au sens figuré : petite insulte gentille) - (39) |
| heurchon : n. m. Hérisson. - (53) |
| heurchon, s. m., hérisson. - (40) |
| heurchon. Hérisson. - (49) |
| heurchonner (s') Se hérisser. - (63) |
| heûre (l’) : heure - (57) |
| heûre n.f. Heure. - (63) |
| heure : s., f. voir l'heure, voir les heures, prévoir, désirer vivement, attendre impatiemment. J’ voyais l'heure qui-z-allaient s’ fout' des coups. - (20) |
| heûre, s. f., heure, division de la journée que le paysan devine sans montre ni horloge. - (14) |
| heurecé, part, passé du verbe « heurecer » qui n'est pas usité avec le sens actif. Hérissé, ramassé en boule à la manière du hérisson, ou armé de piquants comme cet animal - (08) |
| heurecer (se), v. réfl. se hérisser, se ramasser, se mettre en boule comme le hérisson. - (08) |
| heureçon, s. m. hérisson. L’h n'est pas aspirée : « eun eurson. » - (08) |
| heureloge, s. m. horloge : « eun eurlôge. » « Reloize. » - (08) |
| heureloigé, s. m. horloger. - (08) |
| heurichan : Hérisson. Au figuré : personnage hargneux et mal endurant. « I n'est pas c'meude à s'entendre d'ave liune (avec lui) y est in véritab'lle heurichan ». - (19) |
| heurlè : v. i. Hurler. - (53) |
| heûrler : Hurler, pleurer fort. - (62) |
| heurler v. Hurler. Heurler au loup. Hurler à la mort. - (63) |
| heûrler, v. intr., hurler, crier avec force. - (14) |
| heurler. Hurler. - (49) |
| heurler. v. n. Hurler. - (10) |
| heurloge : horloge - (48) |
| heurmoie, heurmoise. s. f. Armoire. (Vincelottes, Maligny). - (10) |
| heurou. : (Pat.), aurou ( dial.), heureux. - (06) |
| heurse : (nf) bourrasque - (35) |
| heursè : hérissé - (48) |
| heurse : herse - (51) |
| heurser (se), v. ; se hérisser. - (07) |
| heurser. v. a. Hérisser. - (10) |
| heursi : herser - (51) |
| heurson (n.m.) : hérisson (aussi heurchon) - (50) |
| heurson (n’) : hérisson - (57) |
| heurson (un) : un hérisson - (61) |
| heûrson : (nm) hérisson - (35) |
| heurson : hérisson - (43) |
| heurson : hérisson - (48) |
| heurson : hérisson. - (33) |
| heurson. s. m. Hérisson. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| heute, hotte ; heutë ; ce que contient une hotte. - (16) |
| heûtsi v. Vomir. Voir äyeuter. - (63) |
| heutte : Hotte. Il est rare que le vigneron s'en aille au travail sans prendre sa hotte, il y met ses outils, son « séchot de marande », son indispensable baril. - (19) |
| heutté : Porteur de hotte pendant les vendanges. « Les heuttés gagnant des bonnes jomées ». - (19) |
| hexon. n. m. - Héron. - (42) |
| hexon.s. m. Héron. (Armeau).– Jambes d'hexon, se dit, à Saint-Sauveur, de quelqu'un qui a de longues jambes, des jambes de héron. - (10) |
| héza : Hasard « Y est bin d'héza si te lo rencantre » : c'est bien rare que tu le rencontres, ce serait bien par hasard. - (19) |
| hézarder : Hasarder, risquer. « Que n 'hézarde ren n'a ren » : qui ne risque rien n'a rien. - (19) |
| hi[y]ar : hier. - (52) |
| hiâ : hier - (57) |
| hiappoux. Gourmand ; qui happe, qui fait du bruit en mangeant. - (49) |
| hïâr, adv. de temps, hier. - (14) |
| hiar, adv. de temps. Hier. - (08) |
| hiarre, hierre. s. m. Lierre. Du latin hedera. (Merry-la-Vallée). - (10) |
| hiau : haut - (43) |
| hiaût (on) : haut - (57) |
| hiaût : haut - (57) |
| hiâvre, s. m. lierre. - (08) |
| Hiber, pour Hubert : la Saint-Hiber pour la Saint-Hubert. - (08) |
| hieble, sorte de sureau herbacé. Du latin ebulus, sureau. - (02) |
| hieble. : Sorte de sureau herbacé qui croît sur le bord des chemins. Du latin ebulus. - (06) |
| hien. s. m. Lien, par conversion d’l en h. - (10) |
| hierre, hiarre, s. m. lierre : planter du « hierre », nos bois sont peuplés de « hierre. » - (08) |
| hierre, subst. masculin : lierre. - (54) |
| hiette, iette. s. f. Tiroir ; abréviation de layette. (Etais). - (10) |
| higener. Se dit du cri du cheval, hennir. Fig. Pousser des cris semblables à ceux du cheval ; des cris de joie. - (49) |
| higer, higeur. adv. Hier. (Ménades, Domecy-sur-le-Vault). - (10) |
| hignement. s. m. Hennissement. (Rugny). Du latin hinnitus. - (10) |
| higner, hinner. v. n. Hennir. (Merry-la-Vallée, Hugny). Du latin hinnire. - (10) |
| higuenot. Huguenot. - (49) |
| hihieu, adj. heureux. (Voir : hûreu.) - (08) |
| hijner v. Hennir. - (63) |
| hilar, adv. hier (prononcer hi-iar). - (38) |
| himeur. Humeur. - (49) |
| hinche : Hanche. D'une personne qui se croit malade et se plaint à tout propos on dit : « Oh sti la alle est c 'ment la pouleille bliainche, alle a toje mau au cu ou à l'hinche! ». D'une personne maigre, taillée en manche à balai : « Alle n'a ni cu ni hinches ». - (19) |
| hin-ha. Cri de l'âne… - (01) |
| hintse : (nf) hanche - (35) |
| hintse n.f. Hanche. Notons ici l'expression : Alle est cment l'oie byintse, qu'a toudze mau au bec, au cul ou à la hintse. Elle se plaint toujours de quelque chose. - (63) |
| hiole : hièble - (60) |
| hiouste. s. f. A Soucy, on appelle de ce nom un jeu consistant a faire sauter un morceau de bois avec des bâtons. Ce doit être unc variété du bistoquet usité dans plusieurs de nos campagnes. - (10) |
| hirté, participe, hérité. - (38) |
| hisnel ou isnel. : (Dial.), prompt, agile. - (06) |
| hissé, ée ou Issé, ee. adj. Agacé. J'ai les dents hissées d'avoir mange des groseilles vertes. – A Chablis, on dit hérissé ; à Saint-Florentin, eglissé (gl mouillé) ; à Bléneau, harissé lequel de tous ces mots est le meilleur? - (10) |
| histouaie (n.f.) : histoire - (50) |
| histouaîre (n’) : histoire - (57) |
| histouère : histoire - (48) |
| histouére de, loc. familière : « Conte-nous donc c'qui, histouére de rire. » - (14) |
| histouère n.f. Histoire. - (63) |
| histouère : histoire - (39) |
| histouère, histouée. n. f. - Histoire. - (42) |
| hivâ (n’) : hiver - (57) |
| hivâ, s.m. hiver. - (38) |
| hivar (n.m.) : hiver - (50) |
| hivar : hiver - (39) |
| hivar : n. m. Hiver. - (53) |
| hivar, s. m. hiver. - (08) |
| hivâr, s. m., hiver. - (14) |
| hivarnaige, s. m. action de nourrir les animaux pendant l'hiver : un long « hivarnaige ». - (08) |
| hivarner (verbe) : nourrir les animaux à l'étable pendant l'hiver. - (47) |
| hivarner : Hiverner. « Etre bien hivarné » : avoir d'abondantes provisions pour l'hiver. - (19) |
| hivarner, v. a. entretenir pendant l'hiver, nourrir pendant la mauvaise saison. il n'a pas de foin pour « hivarner » son bétail. - (08) |
| hivé : Hiver. « In greu hivé » : un hiver rigoureux. Proverbe : « A la SaintVincent (22 janvier) l'hivé s'en va ou se reprend. - L 'hivé est dans eune besaiche (besace) si o n'est pas d'in côté ol est de l'autre » : l'hiver arrive toujours tôt ou tard. - (19) |
| hiver : s. f. Toute l'hiver. - (20) |
| hivernage : s. m., exposition au froid. - (20) |
| hivernage, n.m. côté de la maison exposé au nord. - (65) |
| hiveurnâdze : (nm) côté exposé au nord - (35) |
| hiveurnôdze : lieu tourné au nord. A - B - (41) |
| hiveurnodze : lieu tourné au nord - (34) |
| hiveurnodze n.m. Hivernage. Lieu exposé au nord, au vent froid d'hiver. - (63) |
| hiveurnon : porc de 41 kg environ qui a été élevé en liberté et prêt à être engraissé. A - B - (41) |
| hiveurnon : porc pouvant atteindre 40 kg, élevé en liberté, qui est prêt à l'engraissement - (34) |
| hivrenodze, hivrenadze : lieu tourné au nord - (43) |
| hiya : Hier. « Y était hiya le marchi à Tôrneu ». « Avan-z-hiya » avant-hier. - « O n'est pas fait d'hiya » : il n'est pas né d'hier, il n'est pas novice. - (19) |
| hl ! hi ! fu ! fi ! fou! fou ! ... Cris stridulants étranges, mystérieux, poussés par les jeunes gens en signe de joie, à une noce, une fête. - (49) |
| ho ! hu ! ho !,cri pour faire, tourner un cheval à droite. - (40) |
| hô, hô là : cri destiné à arrêter un cheval - (46) |
| hoap, hop ou heup, cri pour appeler une personne éloignée. En Bretagne, hoper signifie crier. On disait aussi en vieux français houper. - (02) |
| hocedé, « L » aujourd'hui, hoc die. - (04) |
| hôcedé, adv. aujourd'hui. - (08) |
| hôche, interj. dont se servent les charretiers ou les laboureurs pour arrêter leurs bœufs. On appuie fortement sur la première syllabe - (08) |
| hochi : hocher - (57) |
| hocler (v. int.) : secouer vigoureusement le loquet d'une porte pour se faire ouvrir (hocler à la porte) - (64) |
| hœure : n. f. Heure. - (53) |
| hœureux : n. f. Heureux. - (53) |
| hognerie, murmure. Hocha, en breton, signifie grogner comme font les porcs. - (02) |
| hognerie. : (Dial. et pat.), grognement, murmure. Le verbe hogner ou hoigner, dans le dialecte, signifie gronder. On dit, dans le patois: Ène hognerie de pliainte. (Del.) - (06) |
| hognier, hougnier. v. - Grogner, ronchonner. Ce mot est directement issu de l'ancien français du XIIe siècle hogner : grogner, murmurer entre ses dents, se plaindre. - (42) |
| hogo, hogo donc ! Aga, aga donc ! Exclamation de blâme et d'impatience, comme si l'on disait : Voyons, voyons, vas-tu t'arrêter, vas-tu finir! (Perreuse). - (10) |
| hoinche : hanche. - (29) |
| hojedeu, adv. ; aujourd'hui. - (07) |
| hola ! hélas ! Hola don ! plainte exprimant une forte douleur. - (16) |
| holer. Jouler ; héler; appeler. - (49) |
| hôler. v. - Poursuivre : « Bien qu'on nous hôle et qu'on en hogne, nous gardons l'amour du pays. » (Fernand. Clas, p.l47) - (42) |
| hôler. v. a. Hêler appeler en criant fort. Hôle-le donc. Je l'ai hôlé. Du latm ululare. - (10) |
| hòme, et houme, s. m., mari : « Ben sûr, all' va y dire à son houme. » - (14) |
| home. Homme, hommes. - (01) |
| hômeige. Hommage, hommages. - (01) |
| hommâdze n.m. Hommage. - (63) |
| homme : Mari. « Alle a laichi san homme » : elle s'est séparée de son mari. « Etre eun homme » : être vigoureux, solide. « Te peux pas chodre (tu ne peux pas soulever) in râ (une benne pleine de raisins) t'es pas eun homme. T'es-t-eune om'lette ! ». « Marchand d'hommes », courtier qui fournissait des remplaçants pour le service militaire. - (19) |
| homme, houme. s. f. Ouvrée, ce qu'un homme peut piocher, cultiver de terrain dans une journée. (Annay-sur-Serein). - (10) |
| homme, n.m. homme, mari. - (65) |
| honateta, s.f. honnêteté. - (38) |
| hongrois : s. m., romanichel du type blond. Voir bohémien. - (20) |
| hon-me : homme. - (52) |
| honme : homme. - (33) |
| hon-me : homme - (39) |
| honme, s. m. homme. « Houme. » - (08) |
| honmée, houmée, s. f. mesure de superficie pour la vigne. - (08) |
| honnate, adj. honnête. - (38) |
| honneu : Honneur. « O co après les honneus » : il recherche les honneurs. - (19) |
| honnœur : n. m. Honneur. - (53) |
| honoraule. : (Dial. et pat.), honorable. C'est la dérivation naturelle du latin honorabilis. - (06) |
| hontable. Honteux. - (49) |
| honte (avoir point d'), locution verbale : être hardi ou ne pas avoir d'amour-propre. - (54) |
| honte, s. f. timidité. Honte se lie avec l'article : « a n'é pâ d'onte », signifie, le plus souvent, il n'est pas craintif, timide. - (08) |
| honteux : adj., timide, sauvage. C't enfant, il est rien honteux du tout. - (20) |
| hontou(se) : honteux (euse) - (39) |
| hontou, adj., honteux, timide : « Ta p'tiote n'ose pas parler ; alle é hontouse devant l’monde. » - (14) |
| hontou, ouse, adj. honteux, confus, timide. L’h n'est pas aspirée. - (08) |
| hontoûs : honteux - (48) |
| hontoux, -ouse adj. Honteux, timide. - (63) |
| hontoux. adj. Honteux. (Avallonnais). - (10) |
| hontû (-use) (n.et adj.m. et f.) : honteux, honteuse - (50) |
| hôpitau (n.m.) : hôpital - (50) |
| hôpitau n.m. Hôpital. - (63) |
| hòpitau, s. m., hôpital. Suit la même règle que ch’vau et autres. - (14) |
| hoqueler, hoquelle. Loqueter, chercher à ouvrir une porte en agitant le loquet ou tout autre appareil de fermeture. Ce verbe a donné naissance au substantif hoquelle, personne hésitante, qui ennuie par ses réticences. Etym. alteration de loqueter, le vieux français avait hocqueleur, marchandeur, chicaneur. - (12) |
| hoquelis, houquelis. s. m. pl. Légers chocs répétés. - (10) |
| hôquelle. Chicaneur, chicaneurs… - (01) |
| hoquilles. s. f. pl. Guenilles. (Vassy-sous-Pisy). ). - (10) |
| hoquö, oquö, loquö, sm. hoquet - (17) |
| hor. Hors. - (01) |
| horche (n’) : herse - (57) |
| horche : herse - (48) |
| horchè : herser - (46) |
| horché : ivre-mort. - (31) |
| horchè : sale - (48) |
| horchè : saoûl, ivre - (48) |
| horche : herse (ou rateule). Après les semailles les champs étin horchés : après les semailles les champs étaient hersés. - (33) |
| horché : se dit d'un homme ivre. Ol o horché : il est saoul. Signifie aussi : très sale, dégoulinant de pluie ou de boue. - (33) |
| horchè soul : ivre à ne pouvoir tenir debout - (46) |
| horchè, ratelè : 1 v. t. Herser. - 2 adj. Ivre, saoul. - (53) |
| horche, rateule : 1 n. f. Herse. - 2 n. f. Semaille. - (53) |
| horcher : herser - (48) |
| horchi : herser - (57) |
| hordet, hordet donc ! Voyez ordet. - (10) |
| hore : Maintenant, tout de suite. « J'y va drat hore » : j'y vais tout de suite, sur l'heure. - (19) |
| horlasse (n. f.) : personne qui crie souvent - (64) |
| horler (v. int.) : hurler, pousser des cris aigus et violents - (64) |
| horlie (n. f.) : hurlement (pousser des horlies pendabes) - (64) |
| horloge, n.m. horloge mais du genre masculin (un horloge). - (65) |
| hornias : arbre mal venu ou étêté laissé en angle comme borne pour marquer une limite. - (33) |
| Horrieû ! : Arrière ! Ordre de conduite d’un cheval. Et bien sur « Hue » pour : en avant ! « Ho » pour : arrêt ! - (62) |
| horsin. n. m. - Étranger au village, marchand ambulant, forain. (Villiers-Saint-Benoît, selon M. Jossier) - (42) |
| horsin. s. m. et adj. Etranger, forain, qui vient du dehors. Marchand horsin, marchand forain. (Villiers-Saint-Benoît). - (10) |
| hos'dé, aujourd'hui - (36) |
| hôt, s. m., cep de vigne. - (40) |
| hot, s.m. cep (latin "hortus"). - (38) |
| hoté, homme qui porte la hotte. - (38) |
| hoté, maison... - (02) |
| hoté. : (Pat.), hostéis, hosteix, osteis, maison. (Du latin ostium.) - Les Languedociens disent oustal ; lesFrancs-Comtois outeau ; les Champenois osté. - (06) |
| hotée, s. genre ? éphippigère. - (38) |
| hòtelée, s. f., hottée, le contenu d'une hotte. - (14) |
| hòtriau, s. m., hotte plus mince et plus allongée que la hotte ordinaire ; surtout la hotte de vendange. - (14) |
| hottaÿ, s. m., hotte à vendanges. - (40) |
| hotte : s. f. hotte (origine germanique). - (21) |
| hottier. s. m. Hotteur. (Argentenay). - (10) |
| hottou, s. m., celui qui porte la hotte en vendanges. - (40) |
| hottriâ, s. m., hotte basse, avec laquelle on travaille toute l'année. - (40) |
| houbeziau. n. m. - Renfrogné, de mauvaise humeur, mal luné. - (42) |
| houbilles. n. m. pl. - Vieux vêtements. (Lainsecq, selon M. Jossier) - (42) |
| houche (ouche) : s. f., hoche, taille de boulanger. - (20) |
| houche ! Cri que l'on pousse pour écarter ou faire détournrr les porcs et autres animaux. (Perrigny-lès-Auxerre). - (10) |
| houche : Taille de boulanger, petite réglette de bois sur laquelle on marque par des entailles la quantité de marchandises livrée à crédit. - (19) |
| houcher. v. a. Hocher, secouer. Houcher un arbre pour en faire tomber les fruits. (Perrigny-lès-Auxerre). - (10) |
| houcler, houqueler. v. a. Pousser, remuer, secouer, asticoter. As-tu bientôt fini d'houcler c'te porte ? - (10) |
| houcler. v. - Secouer, remuer : « L'crucifix couvert de rubans, ils houclont à toutes les portes. » (Fernand. Clas, p.l62) - (42) |
| houe, cri des chasseurs qui découvrent un sanglier... - (02) |
| hougner, hogner. v. n. Pleurnicher, pousser un grognement sourd, lent, continu faire ce que, à Auxerre, on appelle chougner. - (10) |
| houla !interjection aïe ! - (38) |
| houlées. s. f.pl. Giboulées. (Tronchoy). - (10) |
| hoûler : Hurler. « San chin a hoûlé tote la né » : son chien a hurlé toute la nuit. - (19) |
| houme : Homme. La femme est la fone. - (62) |
| houme : homme. Très usité, et pas spécifiquement pour l'adulte dans la force de l’âge. Ex : "C'est moun' houme" (qui peut être ici homme ou enfant), ou bien en s'adressant à un petit garçon : "Eh ben ! moun' houme...". Valorisant pour l'enfant qui entend. C'est bon signe. - (58) |
| houme, homme - (36) |
| houme, s. m. homme. - (08) |
| houme,s.m. homme. - (38) |
| houme. s. m., homme, mari. - (40) |
| houmée : hommée. Mesure de travail et de temps confondus. Le travail que peut accomplir, en le terminant, un homme aux champs dans sa journée (entre 350 et 400 m²). Le terme a été conservé surtout dans le travail de la vigne dont les surfaces plantées étaient, par le morcellement, de faible surface chacune. - (58) |
| houmme (n.m.) : homme - (50) |
| houmme : homme - (61) |
| houmme, homme : homme - (48) |
| houmme. n. m. - Homme. - (42) |
| hounête : honnête - (39) |
| hounète, et hounàte, adj., honnête : « Vos êtes ben hounàte, not' moussieu, » répond invariablement, en portant la main à son bonnet de coton, le vigneron ou le fermier au passant qui lui dit bonjour et lui demande de ses nouvelles. - (14) |
| hounêteté : honnêteté - (39) |
| hounéteté, loc. cadeau, présent de courtoisie que nos paysans s'empressent d'offrir en certaines circonstances. Ces « honnêtetés » ont le plus souvent la forme de perdrix, bécasses, canards sauvages, écrevisses ou truites. - (08) |
| hounèt'tê, s. f., cadeau, présent. - (14) |
| houneur, s. m., parfois f., honneur, politesse : « Vos êtes ben boune, not'dame ; vos me faites ben d'l’houneur. » - (14) |
| hounnête adj. Honnête, poli. - (63) |
| hounnête. adj. - Honnête. - (42) |
| hounneu (n’) : honneur - (57) |
| hounneur n.m. Honneur. - (63) |
| hounourâbe, adj. honorable. - (08) |
| houpé*, vt. appeler de loin. - (17) |
| houpée (à la), loc. a la criée dans le sens du cri houppe par onomatopée. Vendre « à la houpée », c’est à dire en bloc, par masse. - (08) |
| houper, v. a. faire houppe, houppe ! Crier en articulant ce cri. - (08) |
| houpette (na) - coque (na) : huppe (touffe de cheveux) - (57) |
| houpeutte : huppe. (REP T IV) - D - (25) |
| houpilles, houbilles, haubilles. s. m. pl. Vieux habits. (Arcy-sur-Cure, Lainsecq, Auxerre). - (10) |
| houpotte : une huppe - (46) |
| hourcé, trempé, mouillé - (36) |
| hourcher. v. a. Herser. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| houre : Heure. Ce mot a vieilli, aujourd'hui on dit heure, excepté dans cette locution, d'houre, qui signifie de bonne heure. « I faut se couchi d'houre pa se lever métin ». - (19) |
| houriée, housiée. s. f. Osier. De l'hourier jaune. Des belles housiées. - (10) |
| hourrissé : adj. Dégoûtant, très sale. - (53) |
| hous. Se dit à un chien qu'on chasse. On dit aussi à un chien pour le chasser : veux-tu couri. Pour les appeler au contraire, on crie : toue, toue. - (03) |
| houspailler, houspiller. - (27) |
| houspailler. Synonyme patois de houspiller. - (13) |
| houspiller ou houspailler. : (Dial et pat.), tourmenter une personne, la rudoyer. En agir ainsi c'est proprement prendre quelqu'un par sa housse ou housselin, qui était une sorte de couverture dont se servaient les villageois pour se garantir du froid. - Une remarque. à faire, c'est que le même mot houspiller a, en Franche-Comté, le sens de voler, - (06) |
| houspilleries. s. f. pl. Guenilles. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| houssa. n. m. - Houx. - (42) |
| houssat. s. m. Houx. - (10) |
| housse ! Cri poussé pour faire avancer les animaux de ferme, principalement les porcs. - (49) |
| housse ! excl. impérat., va-t'en ! file ! S'adresse surtout aux gamins, aux enfants qui vous fatiguent : « Y a prou longtemps que t'é là ; t'm'ennuies. Allons, housse ! » Cette injonction s'adresse aussi aux chiens que l’on veut renvoyer. On leur dit également : « V'tu côri ! » - (14) |
| housse ! Exclamation dans le sens de hors d'ici, arrière, va-t'en. Etym. probablement hou ! - (12) |
| housse ! : Cri pour chasser les cochons. - (19) |
| houssine. Branche de houx. Par extension, tout ce qui peut servir à chasser, à battre les animaux. Si te ne veux pas m’obei, i vas prenre lai houssine ! - (13) |
| housteau. s. m. Maison, logis, domicile. Forme primitive d'hôtel. - (10) |
| houteriau, houteuziot, houtriau, houtiot, houquiot. s. m. Petite hotte, hottereau. - (10) |
| houteux. s. m. Hotteux, porte-hotte, nom donné à la cigale, parce que, aux vendanges, elle vit dans les vignes comme les houteux, comme les hommes qui transportent à la hotte les raisins vendangés. (Courgis). - (10) |
| houtou exclam. Ouste ! Va-t-en ! - (63) |
| houtte, s. f. hotte, panier qu'on attache derrière le dos. - (08) |
| houtte. n. f. - Hotte. - (42) |
| houtter. v. - Hotter. - (42) |
| houtteriau. n. m. - Petite hotte. - (42) |
| houtteux. n. m. - Porteur de hotte. - (42) |
| houtu : expr. Formule de rejet. - (53) |
| houyau. s. m. Hoyau. (Villiers-Bonneux). - (10) |
| hoyi : hangar. (E. T IV) - VdS - (25) |
| hu ! Interjection aux chevaux. - (05) |
| hu et dia sont deux interjections impératives adressées aux bêtes de somme. Mai bourrique ast ben têtue : il torne ai hû quand an li quémande d'aï lier ai dia. Le premier terme signifie « va à droite » ; le second, « détourne à gauche »... - (13) |
| hu oh ! Interjection pour diriger les chevaux à droite. - (05) |
| huant : s. m., chat-huant. - (20) |
| huche: houche - (48) |
| huchée : portée de voix. III, p. 15-4 - (23) |
| hucher : appeler en criant (celt. hucher : crieur). - (32) |
| hûcher : appeler de loin. - (09) |
| hucher : appeler. III, p. 16-4 - (23) |
| hucher : crier - (61) |
| hucher : v. a., jucher ; vomir. - (20) |
| hucher : voir lucher, même signification mais d'un emploi moindre. - (58) |
| hucher, heucher, heuger. v. a. et n. Héler, crier fort, appeler. - (10) |
| hucher. Crier d'une voix aiguë et en signe de joie, vieux mot français. - (03) |
| hûcher. v. - Hurler, crier, pleurer très fort. « J'veux qu'il hûche d'sa voix la plus forte : papa, mon papa, me r'vela ! » (Fernand. Clas, p.l93). Huer, hucher signifiaient au XIIe siècle crier, appeler à haute voix. Le poyaudin a conservé ce sens, alors que le français l'a limité au vocabulaire de la vénerie, appeler un animal en sifflant ou en criant. - (42) |
| hucher. : (Dial. et pat.), crier; du bas latin hucciare. (Duc.) « Li veriteiz huchet à mi et à toz les aitres. » (S. B.)- Ces interjections hue, heup, et houe, cri des chasseurs du sanglier, sont différentes manières de hucher. - (06) |
| huchi : hucher - (57) |
| hue ! : à droite ! - (43) |
| hue (à) : à droite (pour un attelage) - (48) |
| hue : avance (pour le cheval) - (48) |
| hue : en avant (attelage de chevaux). - (33) |
| hue-dia, cri pour faire tourner les chevaux à droite ; ailler ai dia, aller à droite ; ailler ai hue, aller à gauche. - (07) |
| huguenot, s. m. homme sans croyances, sans religion. Une « huguenote », une femme impie. L’h n'est point aspirée. - (08) |
| huguenote. s. f. Marmite sans pieds, écuelle. - (10) |
| huguenotée. s. f. Contenu d'une marmite, d'une huguenote. - (10) |
| huguenotte : grande marmite sans pieds. (F. T IV) - Y - (25) |
| hui - (devant une consonne) huit. - Les Gatey ant hui petiots, dont cin feilles. - Le mairché es bétes n'éto ran, an i aivo hui vaiches seulement. - Hui francs, c'â to ce que ci vaut. - Quelques fois devant une voyelle, par exemple : Hui oeufs. - (18) |
| hui, s. m. huis, porte. - (08) |
| huiche : houche, terrain attenant à la maison. Les majons étint entourées d'huiche : les maisons étaient entourées d'houche. - (33) |
| huïer* (ū), vn. hurler. Un soûlaud à un meneur de réunion électorale (hist.) : A c'qu è faut ' huier ? Vos m'ferez singne, quand è sré tems. - (17) |
| huile, n.m. huile mais du genre masculin (un huile). - (65) |
| huille, n. genre? ; huile. - (07) |
| huis, Porte... Ce mot parait dérivé du latin ostium. Le mot outeau a persisté dans quelques villages ; nous avons à Chorey la vigne de l’outaut, située près de la porte du château. Ostaut et oustaut sont des termes de caserne qui désignent la salle de police. Les mots hostel et hostellerie, que l’on écrivait sans h au moyen-âge, ont peut-être la même origine. - (13) |
| huisse : ouche (pré ou terrain attenant à la maison). - (52) |
| huit : Huit se prononce hui sauf devant une voyelle. « J'étins sa ou hui » : nous étions sept ou huit. « D'aujord'heu en hui » : dans huit jours. - (19) |
| huitaîn-ne (na) : huitaine - (57) |
| humanitai. Humanité. - (01) |
| humelle. s. f. Mauvaise lame de couteau. (Percey). - (10) |
| huméne. Humaine. - (01) |
| humider, v. n. devenir humide, rendre mou. - (08) |
| humœur : n. f. Humeur. - (53) |
| Huô ! : A droite ! Ordre de conduite du cheval. - (62) |
| huo : tourne à droite (ordre donné à un attelage). - (52) |
| huoche, cri pour faire avancer le bétail. - (07) |
| hure (n.f.) : heure - (50) |
| hûreu, hireu, euse, adj. heureux. - (08) |
| hûreusement, adv., heureusement. - (14) |
| hureux (hûreux) : adj., heureux. On dit de même hûreusement. - (20) |
| hûreux adj. Heureux. - (63) |
| hûreux, et heûrou, adj., heureux. - (14) |
| hureux,adj. heureux. - (38) |
| hureux. adj. - Heureux. - (42) |
| hûreuzment adv. - (63) |
| hurlis. n. m. pl. - Hurlements terribles. Hurler ou uller, du latin ululare, signifiait au XIIe siècle pousser des cris, en parlant des loups et des chiens. Hurlis est dérivé de hurle ou hurlei, hurlement en ancien français. - (42) |
| hurlu (à l') (loc. adv.) : approximativement, grosso modo - (64) |
| hurter, v. a. heurter, donner un choc. - (08) |
| husserie (hûsserie) : s. f., étude d'huissier. Qu'est-ce qu'i fait donc vot’ propriétaire ? — I tient une hûsserie. - (20) |
| hussier (hûssier) : s. m., huissier. - (20) |
| hussier n.m. Huissier de justice. - (63) |
| hussier : Huissier. « I faudra bin qu'o me paye, les hussiers sant pas pa les chins » : il faudra bien qu'il me paye, les huissiers ne sont pas faits pour les chiens. - (19) |
| hussier, s. m. huissier : « i t'enveré l'hussié. » - (08) |
| hûssier, s. m., huissier, peu aimé dans les campagnes. - (14) |
| hussier. Huissier. - (49) |
| hutain (hûtain) : s. m., hautain de vigne. - (20) |
| hutain, s. m. rang de vigne isolé dans un champ, généralement conduit sur fils de fer attachés à des piquets, littéralement « hautain ». Synonyme de tire. - (24) |
| hute : juron courant, avec un « U » long. Assimilable à Zut ou m... Ex : "Allez don’ toué chien, huuute." (On s’adresse à ce moment-là au chien qui se met en travers du chemin). A propos d’une maladresse : Ex : "Oh ben ! Huuute !... Si j’mé tournais à l’adret !..." Ou pour exprimer un désaccord ! Ex : "Huuute, il est brament imbicile."(Dans ce cas, le mot prend de la force). - (58) |
| hûteau, et housteau, s. m., hutte, baraque, maison : « Entrer à l’hûteau. » - (14) |
| hutin : Plant de vigne qui se taille à long bois et produit des raisins à gros grains donnant un vin de médiocre qualité. « Plianter eune ranche d'hutins » : planter une rangée de hutins. - (19) |
| huvarner : v. labourer( en automne et en hiver) le terrain qui produira au printemps. - (21) |
| huyant. adj. et partic. pr. Hurlant. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| huyer. v. n. Hurler. (Ibid.). - (10) |
| hvdropique : s. f., hydropiste. Elle a une hydropique. - (20) |
| hydreupique : Hydropique. - (19) |
| hydreupisie : Hydropisie. - (19) |
| hyoupe. s. f. Contraction d'hysoupe, pour hysope. (Merry-la-Vallée). - (10) |
| hyvar. Hiver. - (01) |
| i (ou I) (pron.pers. 1ère pers.mas, f.) : je - (50) |
| i : 1°) Il, pronom neutre. « i plio » : il pleut, « i fâ chaud » : il fait chaud. 2°) Ils ou elles. « I vant à la foire » : ils ou elles vont à la foire. - (19) |
| i : il (forme impersonnelle) « i seûfeuille ain vent ai dâcorner lâs beûs ! » - (37) |
| i : je, nous (sujet) - (48) |
| i : je. Se prononce [y] devant voyelle. I seu : je suis, mais y'étau : j'étais. - (52) |
| i : je. I vas : je vais. - (33) |
| i pr. pers. Il impersonnel : i piout. - (63) |
| i – je et nous, dans différents temps des verbes. - I ferai vote commission bein exactement, vo povez y comptai. - Vos saivez que c'â demain fête ai dévotion ; i ne manqueront pas d'ailai és offices le maitin. - I y vâs, prononcer : (Jui) lli vâs. - (18) |
| i : 1 pron. pers. Je. - 2 pron. pers. Il. - (53) |
| i : En patois bourguignon, i et je sont synonymes. On confond aussi le singulier avec le pluriel ; on dit, par exemple, i maing eon ou je maing eon; i n'on nun vü, nous n'avons vu personne. Le patois emploie el et i pour il, et al et ai pour elle. Ex : Se pote ti bé ? Nennin. - Et sai fanne ? - El y é troi moi qu'al é mailaide, et petétre an meuré t'ai. - (06) |
| i : je - (39) |
| i, ine, adj. numéral. Un, une : « i via, ine vaice », un veau, une vache. - (08) |
| i, pour : je ; i di, je dis. I, pour : le ; i vè i j'té, je vais le jeter. - (16) |
| i, pr. pers., je, il : « I seû bé content d'vous vouer. » - (14) |
| i, pron. pers. de la première personne du sing. et du pluriel des deux genres, je, nous; « i seu, i é », je suis, j'ai ; « i son, i on », nous sommes, nous avons. - (08) |
| i, pronom indéfini ; employé pour "c", i aut ben "c'est bien". - (38) |
| i, pronom, il, ils. - (40) |
| i, pronom, je, - (40) |
| i. pr. personn. Se dit très-fréquemment pour il, par retranchement de l’l dans la prononciation. I pleut. I va à Paris. I n'est pas sage. I ieux a dit de venir. - (10) |
| i. Pronom de la première personne. I vas m'en ailler. Devant une voyelle il redevient le je élïdé du français : j’euveure lai pôrte, (j'ouvre la porte.) Le pronom i j sert également pour le pluriel : i fions aujed'heu laï feite, mas demain, j’irons écouer. La seconde personne du singulier est te, pour tu : ast-ce que te vins vée moi ? La seconde du pluriel est, suivant les pays, vos ou veus : an dirot que vos eites mailaide ? Quoi don qu’ast airrivé chez veus ? La première forme prévaut dans la région qui confine au Morvan. La troisième personne est a pour les deux nombres : A m'ai dit qu'a partirint teut ai l’heure. Devant une voyelle a devient al, pour éviter un hiatus. Al ast venu qu'al aivint déji soupé. A est remplacé par an dans les verbes impersonnels. « Il faut manger, il fait des éclairs, il va pleuvoir, se traduisent par an faut mainger, an éleide, an vai pleuvre. - (13) |
| i. Pronom synonyme de je. En bourguignon, i mainge, je mainge, sont équivalents pour signifier en français, je mange… Quelquefois les Bourguignons mettent i pour il, comme quand ils disent : « Se pote-t-i bé ? Nainin, el y é troi moi qu'el a mailaide, et petétre an meurré-t-i ». Se porte-il bien ? Non, il y a trois mois qu'il est malade, et peut-être en mourra-t-il. - (01) |
| i’. pron. per. - Il. Se prononce « il» uniquement devant une voyelle : « I’ va-ti v'ni' ! Il a rein mangé ! » (Voir, f..P. Chapat, p.l21) - (42) |
| iâ : eau. - (32) |
| ia : elle - (57) |
| ia ia : Dans le langage enfantin faire ia ia signifie caresser doucement les joues avec la main. « Fa ia ia à la dame » : caresse les joues de la dame. - (19) |
| iâ : n. f. Eau. - (53) |
| ià, eau. - (16) |
| ia, eau. - (27) |
| ià, s. f., eau. - (40) |
| ia, s.f. eau. - (38) |
| iâ, s.m. liard. - (38) |
| iâche, iàchon, s. tique. - (38) |
| iader, se dit en parlant d'ouvriers qui, voulant faire un extra pour leur boisson, envoyaient chercher quelques litres de vin par un jeune garçon. - (27) |
| iae, eau. - (26) |
| iage, adj. aise. - (17) |
| ïa-ïa (faire), loc, caresser, particulièrement passer doucement la main sur les joues : « Allons, mon genti p'tiot, fais-me ïa-ïa, » dit la maman à son bébé. - (14) |
| iaie, iau. s. f. Eau. Une écassée d'iau. - (10) |
| iandot : n. m. Gland. - (53) |
| iant, cueille-fruits - (36) |
| iâper, v., tomber à l'eau. - (40) |
| iâpi : bête, borné - (37) |
| iâr : adv. Hier. - (53) |
| iard : s..m., liard. Voir liard de beurre. - (20) |
| iarder, v. n. payer sa part d'une dépense faite en commun. - (08) |
| ïâs, s. m. glas. - (08) |
| iasse, s. f. liasse, lien de paille pour attacher les gerbes. (Voir : Iein.) - (08) |
| iasse. n. f. - Ensemble de tiges de blé ou de seigle, liées entre elles et utilisées pour attacher les gerbes. - (42) |
| iatte, s.f. petit placard creusé dans l'épaisseur du mur ; tiroir sous une table ; la "iatte de la taôle" est un souvenir de l'époque où le mobilier était rare ; les paysans étaient gens de main-morte et leurs meubles appartenaient au seigneur. - (38) |
| iau (n.f.) : eau - (50) |
| iau : (nf) eau - (35) |
| iau : eau. - (09) |
| iau : eau. On dit « un siau d’iau » pour un seau d’eau. - (62) |
| iau n.f. Eau. - (63) |
| iau ou iaue : Eau. « Pougi eune saille d'iau » : puiser un seau d'eau. A quelqu'un qui n'est pas dégourdi ou qui ne trouve pas une chose cependant peu cachée on dit : « Te ne trouerais pas de l'iau en Seune (Saône) ». « Savoir attiri - (19) |
| iau : eau - (39) |
| iau : s. f. eau. - (21) |
| ïau, et ïâ, s. f., eau : « Ol ôt maugé ; en travarsant l'Doubs, tout çansien a chu dans l’ïau. » Comme en bien d'autres syllabes, prononciation très mouillée. - (14) |
| iau. Eau. - (49) |
| iau. n. f. - Eau. - (42) |
| iaubénité : Bénitier. « O se démene c 'ment in diabe dans eun iaubénité ». - (19) |
| iaubn'ite, s. f. eau bénite. - (08) |
| iaudo : mauvais couteau. (RDM. T IV) - B - (25) |
| iaue, s. f. eau. « de l’iaue, de la bonne iaue ». - (08) |
| iaut, te, adj. haut, te. - (17) |
| i'avand'lé, iavaud'lé, adv. là-bas. - (38) |
| iâvre, s. m,, lièvre. - (40) |
| iàvre, s.m. lièvre ; iâvrosse, s.f. femelle du lièvre. - (38) |
| Ichars (les). Nom de deux hameaux, l'un appartenant à la commune de Saint-Léger-De-Fougeret, l'autre à celle de Gouloux. - (08) |
| ichi (adv.) : ici - (50) |
| ichi, adv. de lieu. Ici - (08) |
| icho !, oui, oui, compte là-dessus - (36) |
| icho, ècho, cho : si, mais si - (36) |
| icho, part. d'affirmation, oui, en effet : « i é fé ç'iai, icho », j'ai fait cela, oui. - (08) |
| Ici : adv., ci. Ces jours ici. - (20) |
| ici. adv. Ci : « A c't'heure ici. » - (42) |
| icin, adv. ici. Por icin, pô icin, par ici. Ci (après un nom précédé du démonstratif). - (17) |
| icin. : Ici. - Dans le dialecte, les finales in se prononçaient i. - (06) |
| idë ; eune idë, très peu ; béyë mz'an eune idë, donnez-m'en tant soit peu. - (16) |
| idée (une), adv. de quantité, un peu, fort peu, un soupçon : « J'tâterai ben d'ton vin blanc ; ma j'n'en veù pas lourd, tant s' ment eùne idée. » — « Ol ét eùne idée pu grand que sa seûre. » (V. Miette (eùne). - (14) |
| idée (une), locut. ad v., un peu. Ex. : voulez-vous de la soupe ? J'en prendrai seulement une idée. Même sens que frisée. - (11) |
| idiée, sf. idée. - (17) |
| îdoutab', inoutab' : expr. Qu'on ne peut pas enlever. - (53) |
| idy-inle, idiot. - (26) |
| ie, ie n' : adj. et adj. num. Un. Le « n' » est rajouté pour faire la liaison avec les voyelles. - (53) |
| i'é, i'ô, c'est. - (40) |
| ieau : eau. - (52) |
| ieau : eau. On pourtot l'ieau aiquand un siau : on portait l'eau avec un seau. - (33) |
| ieau, eau. - (05) |
| iéév’e : lièvre - (37) |
| iein. n. m. - Lien confectionné avec une petite branche flexible, servant à réunir une gerbe. - (42) |
| ien : un - (43) |
| ien : lien - (39) |
| ien : n. m. Lien. - (53) |
| ier : lier - (39) |
| ier, adv. hier. - (17) |
| iér, hier. - (26) |
| iér, v. a. lier, attacher avec un lien. - (08) |
| ierche : une herse - (46) |
| ièsse. Glace. - (49) |
| ïé-t-i ? loc. interrogative, est-ce ? c'est-il ? « T'las pas vu ginguer ? Yé-t-i donc qu'ôl é fou ? » - (14) |
| iêtre, s. f. tiroir de table. On prononce quelquefois guiètre. - (08) |
| ieu, adj. poss. des deux genres. Leur : « i va ieu die », je vais leur dire. - (08) |
| ieu, adj. poss. leur. - (38) |
| ïeû, pr. pers., leur, à eux : « Attends, attends ! j'm'en vas ïeù-z-j dire... » - (14) |
| ieu, zieu. Œil. - (49) |
| ieux. pro. pers. - Leur, leurs : « T'ieux as-ti dounné la pièce ? » - (42) |
| ieux. Se dit par euphonie pour leur, pour à eux. Quoi que tu ieux as douné ? J'z'ieux ai douné un mouciau de paingne, et pis j'z'ieux ai dit de n'pas r'veni si souvent. - (10) |
| iéve : lièvre - (44) |
| iéve, s. m. lièvre : « i vourô prenre eun iéve », je voudrais prendre un lièvre. - (08) |
| iève, s. m., lièvre. - (14) |
| ièvre : s. m., lièvre. Un ièvre (pron. sans liaison). - (20) |
| iévre, (ë), .sm. lièvre. - (17) |
| ièvre, ièv'e. Lièvre. - (49) |
| iévre, lièvre. - (26) |
| ifame, loc. injurieuse. Infâme ? - (08) |
| igal, adj. egal, pareil, indifférent : « ç'iai m'ô bin igal. » tous les hommes sont « igals » devant la mort. - (08) |
| igener : hennir. A - B - (41) |
| ignan : Oignon. « Mens y dan de l'ignan Barthan » : mets-y donc de l'oignon Philiberte. « Eune chain-ne d'ignans » une botte d'oignons. - (19) |
| igneau. s. m. Agneau. – Fait, au feminin, ignelle. - (10) |
| igneçan, simple d'esprit. - (26) |
| igneuçent, innocent, naïf, peu intelligent. - (27) |
| igneûssan, innocent comme un enfant, faible d'esprit. - (16) |
| igniquitai. Iniquité, iniquités. La syllable gni se prononce comme dignité. - (01) |
| ignôcaman. : Innocemment. On découvre, dans la prononciation qui précède, la tendance générale des Bourguignons à mouiller leur voyelle i comme ils le faisaient pour leur consonne l. - (06) |
| ignôçamman. Innocemment. Le gn se prononce comme dans le mot igniquitai. - (01) |
| ignôçan. Innocent, innocents. Les Ignôçan, les Innocents. - (01) |
| ignôçance. Innocence. - (01) |
| ignon, oignon. - (05) |
| iguer, v. égaliser des objets, des rondins, en les assemblant d'une façon régulière. - (38) |
| ijar, adv. de temps. Hier, la veille du jour où l'on est. - (08) |
| ijo, interj. qui sert à exprimer l'étonnement ou la satisfaction. - (08) |
| iki, ici ; vèn iki, viens ici (c'est le hic latin). - (16) |
| il, du latin illa, elle : il è di, elle a dit. - (16) |
| ilà, opposé d'ici. - (04) |
| ilai - là, variante de lai. - Laivou don arré qu'â c'te piaiche ?... Ilai, teins, regairde don. - Al aivo pliantai le pouairé ilai moinme ; à n'éto pâ bein. - Raipeule tai bein, i le met ilai. - (18) |
| ilai (adv.) : là - (50) |
| ilai : là - (48) |
| ilai : là - (39) |
| ilai, adv. de lieu, là : « O n'fait, jar, pas grand ôvrage ; ôl é tôjor por iqui, por ilai. » - (14) |
| ilai, adv. de lieu. là, par opposition avec « iqui », ici. - (08) |
| ilai. Là, Par iqui, por ilai, par ci par là… - (01) |
| ile - elle on met assez facilement une l euphonique devant le mot suivant commençant par une voyelle. Voyez d'ailleurs à a et à al. Ile traiveille fort ceute fonne lai, en n'â vrai qu'ile é quaite enfants ai neuri. - Ile endure gros de mauvais traitements. - I aivains grand besoin de c'te plieue qui ; ile à venue ai point. - (18) |
| ilé, là. - (27) |
| ile. S’emploie pour elle, pron. pers. 3e pers. du fémin. sing. lorsqu'elle est sujet : « ile ô été peunie d' sai ch'titeté ; ile n'étô pâ iqui », elle a jeté punie de sa méchanceté ; elle n'était pas ici. - (08) |
| ille, pronom pers. elle. - (38) |
| illiéard (prononcez Ihiéard). s. m. Bélier servant à la reproduction. Des deux mots latins ilia et ardent, ardent du ventre, ardent du flanc. - (10) |
| ill'mèce. Limace. - (49) |
| ilons (les), dénomination locale de terrains situés aux extrémités de Saint-Jean, et qu'entouraient jadis des bras factices du Doubs, aujourd'hui desséchés. Là se trouvent l'Allée des Cordiers, la Levée de Chauvort, etc. - (14) |
| imâdze n.f. Image, dessin, peinture, photo. - (63) |
| image : Dessin, gravure, chromo, peinture, etc. « Etre sage c'ment eune image » : être bien sage, bien tranquille. - (19) |
| image : s. f., tout ce qui appartient aux arts du dessin, depuis le tableau de maître jusqu'à l'image d'Epinal. - (20) |
| imageigne. Imagine, imaginent. - (01) |
| imaige, sf. image. - (17) |
| imaige. Image, images. - (01) |
| imbécille, adj. imbécile. - (17) |
| imbrée n.f. Tronc d'osier élagué. - (63) |
| imbres n.m.pl. (de ambre, l'osier étant du même jaune que l'ambre). Tiges d'osier. - (63) |
| imeûdes : (npl) glas - (35) |
| imeùr, s. f., humeur, au sens physique et au sens moral ; « O n'é pas ben ; ôl a des imeùrs plein le côr. » — « Alle é prou gentite ; aile é tôjor de bonne imeùr. » - (14) |
| imfourmer, v. a. informer, instruire, donner des renseignements. - (08) |
| imibécileté. s. f. Imbécillité, bêtise. (Villiers-Saint-Benoît.) - (10) |
| imiter, v. a. ressembler à. Cet enfant « imite » son père, c’est à dire ressemble à son père, physiquement parlant. - (08) |
| imitier, vt. imiter. - (17) |
| immachèré. : Immaculé, non souillé. Le latin immaceratus a, au physique, le même sens. - (06) |
| immodité, emodité. s. f. Haine, rancune, animosité. (Maillot). - (10) |
| imobille, adj. immobile. - (17) |
| imparfait, adj., mal élevé. En parlant d'un enfant, on dit : « Qu'ol é donc imparfait, c'morveux-là ! ô n'fait qu'des malices à tout l'monde. » - (14) |
| impeurchabe : imputrescible - (48) |
| impôlissure. Impolitesse. Impôlissure est un mot factice. - (01) |
| impossibye n. et adj. Impossible. - (63) |
| impouïable, adj. inépuisable. Du verbe « pouïer » qui signifie puiser, prendre de l'eau. (Voir : pouïer.) - (08) |
| impoussibe, adj. impossible : « fére son impoussible », c'est emphatiquement faire tout ce que l'on peut. - (08) |
| imprimeu. Imprimeur. Le vrai bourguignon de Dijon veut qu’on dise Imprimeu, non pas Imprimou, qui sent le village… - (01) |
| impure, s. f. épure. Les charpentiers ont fait leur « impure. » - (08) |
| in' (pr.pers. 1ère pers.m. et f.pl.) : nous - (50) |
| in : Un. Le féminin de un est « eune », quant à in il s'emploie seulement devant une consonne : « in chin, in martiau », devant une voyelle ou un h on emploie eun « eun ujau, eun homme ». - (19) |
| in, ine - un, une. - In champ de treuffes. - Ine voiture de foin. - Voyez au commencement du vocabulaire l'article sur les nombres, par exemple pour le féminin ainne. - (18) |
| in, un, in homme, "un homme". - (38) |
| in. s. m. et adj. In, deux. In homme. - (10) |
| inancent. Idiot, par une charmante métaphore, innocuus. - (03) |
| inbranlabe. adj. - Inébranlable, impossible à bouger. - (42) |
| inbranlable. adj. Se dit, à Bléneau, pour inébranlable, mais par antiphrase, en parlant d'un ivrogne qui ne peut plus garder son équilibre, qui ne peut plus se tenir sur ses pieds. - (10) |
| inçartingn', adj. des deux genres. Incertain. - (08) |
| inceindier : reprocher véhémentement - (37) |
| incendier de sottises, loc. abreuver d'injures. - (24) |
| incertain : s. m., en-tout-cas. Le temps ne sait pas ce qu'il veut faire ; je vas prendre mon incertain. - (20) |
| inch’truijou : instituteur - (37) |
| inche, s. f. hanche : « l'inche m' fé mau », la hanche me fait mal. - (08) |
| inche. s. f. Hanche. (Argenteuil). - (10) |
| inchy : enflé - (43) |
| incisions, vexations, demandes injustes. - (05) |
| incmodé (pour incommodé). adj. Atteint d'une hernie ou de quelque autre infirmite. (Poilly-sur-Serein). – Donné aussi par Jaubert. - (10) |
| incompotent, adj. malingre, en mauvaise disposition de santé. - (08) |
| incomprenable : adj., vx fr., incompréhensible. Y est incomprenable. - (20) |
| incomprenable. adj. - Incompréhensible. Ce mot n'est pas un barbarisme par dérivation logique ; il est la reprise exacte de l'adjectif.incomprenable, employé à la Renaissance à partir du verbe comprendre. Le mot incompréhensible, du latin incomprehensibilis, n'était usité au Moyen Âge qu'en langage philosophique ou savant. - (42) |
| incomprenable. adj. Incompréhensible. (Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes). - (10) |
| incougnu - incognu : inconnu - (57) |
| incougnu (n’) - incognu (n’) : inconnu - (57) |
| incougnu : Inconnu. « O ne m'est pas incougnu » : il ne m'est pas inconnu, il me semble l'avoir déjà vu. - (19) |
| incoumôdé, adj. infirme, qui est affligé de quelque maladie ou lésion d'un organe essentiel : « l’poure honme al ô bin incoumôdé », signifie il est bien infirme. - (08) |
| incoumodé, adj., malade, infirme : « Not' pauv'Jacot, ôl a chu du foineau ; ôl é ben incoamodé . » - (14) |
| incouneu, adj. inconnu, que l'on ne connaît pas. - (08) |
| incrayab'lle : Incroyable. « Y est eune affare incrayab 'lle ». - (19) |
| incre (pour âcre). adj. Vif, ardent. Chien, feu incre. (Argentenay). Du latin acer. – A Etivey, on prononce ancre. - (10) |
| incre. : D'une humeur difficile. (Del.) Cette orthographe, quoique reçue, est fautive. Le mot vient du latin acer et doit s'écrire aincre. - (06) |
| increyabe. adj. - Incroyable . - (42) |
| indicter, v. a. indiquer, montrer, annoncer, faire connaître : il m'a « indicté » mon chemin. - (08) |
| indier : aider - (48) |
| indiffarent : Désagréable, insupportable. « Que ce dreule est indiffarent ! » : que cet enfant est insupportable ! - (19) |
| indigessian : Indigestion. « Ol a ésu eune indigessian que l'a fait bien malède ». - (19) |
| indigestion : s. f. Fausse indigestion, fausse digestion, indigestion légère. - (20) |
| indigne : Insupportable. « Ces enfants sant indignes ! » ces enfants sont insupportables ! - (19) |
| indigne, adj. ennuyeux ; i aut indigne, "c'est ennuyeux". - (38) |
| indigne, adj. insupportable : quel enfant indigne ! - (24) |
| indigne, adj. insupportable. - (22) |
| indiole, niais. Ce mot se rapproche beaucoup du latin indolentia. - (02) |
| indiole. : (Pat.), indiot ( dial), niais; du latin idiota. (Roq.) - (06) |
| indiot, inguiot, ote. adj. et s. Idiot, etc. Moun inguiote. - (10) |
| indiquié, vt. indiquer. - (17) |
| indjot. adj. - Idiot. - (42) |
| inducation : s. f., éducation. - (20) |
| inducation, s. f. éducation, instruction, savoir. - (08) |
| inducation, s. f., éducation, que nos braves gens confondent avec instruction. - (14) |
| inducation. n. f. - Éducation. - (42) |
| induge. : Délai (du latin inducioe trêve). Coutume de Châtillon de 1371. - (06) |
| induit, adj. indu. - (17) |
| induite : Indue. « Je cra bin qu'y est déjà tâ, y est bien temps de dévailli. - Oh y est pas des heures induites » : je crois qu'il est déjà tard, il est temps de finir la veillée. Oh, il n'est pas une heure indue ! - (19) |
| induqué : part, pass., éduqué. - (20) |
| induquer, v. tr., éduquer, élever et instruire. - (14) |
| induse : adj. f., indue. - (20) |
| ine, une, ine fone, "une femme". - (38) |
| infacté (y s’ot) : (ça s’est) infecté - (37) |
| infacté (y’en ot) : (c’en est) infesté - (37) |
| infarnal : Infernal, extrêmement désagréable. « Mâ demore dan voir tranquille, t'es bien infarnal ! » : reste donc tranquille, tu es par trop désagréable ! - (19) |
| infarnal, adj. infernal. l'l ne sonne ordinairement pas : un tapage « infarnâ. » - (08) |
| infiâbe : infaisable - (48) |
| infligi : infliger - (57) |
| ingence. s. f. Idée. Se dit par syncope d'intelligence, à Arcy-sur-Cure. Ah! ma pour' fille, que t'n'as donc gue d'ingence ! - (10) |
| ingeron, injeron. s. m. Ajonc. (Diges, Saint-Martin-sur-Ouanne). - (10) |
| ingigneu, s. m. ingénieur : « eun ingigneu ; dé-z-ingigneus. » - (08) |
| ingnia : agneau. - (29) |
| ingrat : adj., avare. - (20) |
| ingrö, öte, adj. ingrat, aie. - (17) |
| inguériences. n. m. - Ingrédients. (Rogny, selon M. Jossier) - (42) |
| inguériences. s. m. pl. Ingrédients. (Rogny). - (10) |
| inguier (S'). v. pron. S'habiller sans goût, sans soin. (Etivey). - (10) |
| injeustice. Injustice, injustices. - (01) |
| injonc. s. m. Ajonc (Villeneuve-les-Genêtb). - (10) |
| inkyiner. v. a. Incliner. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| in-micho, adj., un peu. - (40) |
| inn'chô, loc. je ne puis, cela ne se peut ; impossible. Négation en usage dans quelques parties du Morvan - (08) |
| inniöçent, adj. innocent. - (17) |
| innocent (pour innoscent). s. et adj. m. Niais, simple d'esprit, ignorant, sans malice. (Saint-Florentin). Du latin ignoscere, ignoscens. - (10) |
| in-nocent, adj., dépourvu d'intelligence, idiot. A le même sens dans plusieurs localités. - (14) |
| innocent, idiot, imbécile. - (05) |
| innoucent : simplet, débile - (61) |
| inô : non, mais non - (39) |
| ino, èno : non, mais non - (36) |
| inoculation : introduction d'un virus dans l'organisme. - (55) |
| inoutab', îdoutab' : expr. Qu'on ne peut pas enlever. - (53) |
| inquant : s. m., vx fr. incanler (v. a.), encan. - (20) |
| inquiéter de (S’) : v. r., s'occuper de quelque chose, s'intéresser à quelque chose, s'informer de quelqu'un. Il s'inquiète de peinture, de musique. - (20) |
| insèke n.m. Insecte. - (63) |
| inservable : inutilisable - (61) |
| inseûlance, s. f., insolence. - (14) |
| inseûlent, adj., insolent. - (14) |
| insôlance. Insolence, insolences. - (01) |
| insolenter : Insulter, dire des injures. « Te sais ne vins pas m'insolenter ». - (19) |
| insolenter v. Insulter. - (63) |
| insolenter : v. a., injurier. - (20) |
| insolenter. v. a. Insulter. (Mouffy). - (10) |
| insouffrable : insupportable - (61) |
| institeur : s. m., instituteur. « Mon cadet a été bien montré par l'institeur. C'est un premier pour la chiffre. » - (20) |
| institeur, -trice n. Instituteur. - (63) |
| instreûment, s. m., instrument, et parfois ustensile. - (14) |
| instru - instruit. - L'Alfred â in homme bein instru ; c'â étai dans les écôles, vo viez ben. - Al à aissez instru, en parait. - (18) |
| instruisou : un instituteur - (46) |
| instruisou, s. m., maitre d’école. - (40) |
| instruisoûe : instituteur - (48) |
| instrure : Instruire « Tot le mande n'a pas les moyens de fare instrure ses enfants ». - (19) |
| instrure, vt. instruire. - (17) |
| instruré. Instruiras, instruira. - (01) |
| instrut : Instruit. « Tos ses enfants ant été à l'écôle, i sant tretos bien instruts » : tous ses enfants sont allés à l'école, ils sont tous bien instruits. - (19) |
| insurportable. Insupportable. - (49) |
| intara : Intérêt, avarice, désir d'amasser. « Tot ce qu'o fa ol y fa pa intara » : tout ce qu'il fait, il le fait par intérêt. - (19) |
| intarassé : Trop attaché à ses intérêts personnels, avare. - (19) |
| intchiètude (n’) : inquiétude - (57) |
| intendants : représentant du pouvoir royal dans une province. - (55) |
| interveni : intervenir - (57) |
| intrépide (ât’e) : ne rien craindre, « aller de l’avant » - (37) |
| intrépide : Travailleur infatigable, acharné au travail. « Y est eun intrépide, cen traveille tant que le jo doure » : c'est un « intrépide », ça travaille autant que dure le jour. - (19) |
| intrever (S'). v. pronom. S'intéresser, s'informer. (Poilly-sur-Serein). - (10) |
| intrigué (s'), v. r. être entreprenant et ardent au travail. - (22) |
| intriguer (s'), v. r. être entreprenant, débrouillard et actif au travail : à force de s'intriguer il s'est enrichi. Adjectif intrigant. - (24) |
| intruman. Instrument, instruments… - (01) |
| intrure. Instruire. - (01) |
| inventioner, v. tr., inventer, découvrir. - (14) |
| inventou (n’) : inventeur - (57) |
| inverti n.m. Homosexuel. - (63) |
| invitance, s. f., invitation, provocation : « Cheû la Jean-ne va y avouer le batein-me du p'tiot ; je compte ben su l’invitance. » - (14) |
| inviter de : voir de. - (20) |
| in-ye, œil. - (26) |
| iô - eux, leur. - En io z-en fait endeurai de toutes les couleurs… C'â malheureux cequi, en é bais dire. - Vos ne manqueras pâ de iô dire de mai pairt qu'à m'écrivains ; cequi presse. - Voyez liô. - (18) |
| iô : l'eau - (46) |
| io, pronom. Je : « io v'bin », je veux bien. - (08) |
| i'o. C'est « i'o lu», c'est lui. - (49) |
| ion : un - (57) |
| ionne, ieune. Petite gerbe. - (49) |
| ionze, adj. num. onze. - (17) |
| iot. s. m,. Io, œil ; l'io, l'œil ; les rios (les zios), les yeux. (Domocy-sur-le-Vault). - (10) |
| iôte, adj. poss., leur : « Iòte mâïon ; iòte chin. » (V. leù, leû.) - (14) |
| ioter. Lutter, terrasser. - (49) |
| iotte, adj. « lotte » parait signifier ouverte. On ne l'emploie guère que dans cette phrase ou autre équivalente : « lai pôte ô iotte », la porte est ouverte. - (08) |
| iou-cou-cou ! cri de joie, qui termine la plupart des chansons et des danses. - (14) |
| iouler v. Aboyer à la mort. - (63) |
| ioup-là-là ! autre cri de joie, que poussent fréquemment les jeunes gens, quand ils courent, et surtout quand ils dansent. - (14) |
| iqui - ici, celui-ci. - Hier â sont venu torto iqui ; al étaint nai environ. - Mettez vos aifares iqui, tenez, a seran en suretai. - I vâ me premenai por iqui ; i ne sai pâ laivou. - C'â c't'iqui qu'à lai bonne. - Voyez qui ; qui est une abréviation et que l'on emploie très souvent. - (18) |
| iqui : ici - (48) |
| iqui : ici - vin vouèr iqui ! viens voir ici - (46) |
| iqui : ici. - (29) |
| iqui : ici. Comme certains disent cinqui pour ceci. - (62) |
| iqui : adv. Ici. - (53) |
| iqui(C.-d., Chal.), ichi (Morv.), itchi (Y.). - Ici. Ce mot n'a pas d'autre intérêt, outre son fréquent usage, que de montrer la façon particulière dont chaque département fait dévier la prononciation d'un mot français ; ici vient de bic. - (15) |
| iqui, adv. de lieu, ici : « Eh ! dis donc, veins-tu por iqui ? » - (14) |
| iqui, adv. de lieu. ici, en ce lieu : « eun hon-m' d'iqui », un homme d'ici. - (08) |
| iqui, adv., ici. - (40) |
| iqui, ici ; on dit aussi itii. - (38) |
| iqui, ici. - (05) |
| iqui, ici. - (27) |
| iqui, itchi, ischi. adv. Ici. - (10) |
| iqui. Ici. - (03) |
| iqui. Ici… - (01) |
| iqui. Prononciation patoise de ici... - (13) |
| ir. : Dans les verbes de la 2e conjugaison, lesquels se terminent ainsi, le patois bourguignon supprime la consonne r : ainsi il prononce et écrit meuri pour mourir, s'égrailli pour s'égraillir, etc. - (06) |
| iragne : (nf) araignée - (35) |
| iragne : araignée - (43) |
| iragne, aragne n.f. Araignée. - (63) |
| iragni : (vb) enlever les toile d’araignée - (35) |
| iragni : enlever les toiles d'araignée - (43) |
| irâs, iré, irot. - I iras bein encore ai Montoillot, âjedeu. - T'iré cherchai du treuffe pour les chevaux, ine bonne voiture. - Al iro quéri le médecin to de suite, que ce sero prudent. - Tous temps du verbe très irrégulier : aller. - (18) |
| ire : Colère. Le mot ne s'emploie que dans l'expression : « Prendre en ire », « Alle l'a pris en ire, alle ne peut ni le voir ni le sintre (ni le sentir) ». - (19) |
| ire, haine, colère, méchanceté. - (05) |
| ire, : "prendre quelqu'un en ire", c'est être fâché contre lui. - (38) |
| ire. Ce vieux mot français est toujours en usage dans l'Auxois, et notamment à Thoisy-Ia-Berchère. I étâs tot en ire : à Beaune nous dirions : i étâs teut en coulâre. - (13) |
| iréparabje, adj. irréparable. - (17) |
| ireû : bouder. - (66) |
| iritabje, adj. irritable. - (17) |
| irriti. Irritai, irritas, irrita. - (01) |
| is : ils - (51) |
| is, i' pron. pers. ils ou elles. Is mandzant : ils ou elles mangent. I'ant mandzi : ils ou elles ont mangé. Le s, signe du pluriel est remplacé par une apostrophe pour permettre la bonne prononciation. - (63) |
| iserable, userable, usërauble : s. m., érable champêtre (acer campestre). - (20) |
| isiau, s. m. oiseau. - (22) |
| isque, s. m., X, lettre de l'alphabet. - (14) |
| issar, s. m. terrain vague, espace gazonné, lieu défriché. - (08) |
| it’iai, adv. ici. - (22) |
| itcheu : ici - (57) |
| itcheu : là - (57) |
| itchi : ici - (37) |
| itchi : ici - (39) |
| itchi, adv. de lieu. ici. (voir : ichi, iqui.) - (08) |
| itié : (adv) ici - (35) |
| itié : aussi, ainsi, ici (Brionnais). - (30) |
| itié : Ici. « Vins voir itié » : viens voir ici. Ironiquement en voyant traîner par terre un objet qui devrait être mieux soigné : « Y est assi bin itié qu'à bas » : c'est aussi bien ici que par terre. « Par itié » : probablement. « Y est par itié Piarre qu'a fait cen » : c'est probablement Pierre qui a fait cela. « Par itié » a aussi parfois le sens de « environ ». « Y a par itié eune trentain-ne de kilomètres pa aller à Chalon ». - (19) |
| itié adv. Ici. Voir drot-itié. - (63) |
| itié, di-ce, dritié : ici - (43) |
| it'iœ, adv. ici. - (24) |
| itou : aussi (eto en Charollais). - (30) |
| itou : aussi. - (09) |
| itou : aussi. III, p. 15-5 - (23) |
| itou, étou, atou, adv., aussi : « Te vas à la fouére, moi itou. » — « T'en as baillé au p'tiot ; baille-moi-z-en étou. » - (14) |
| itou, itout. adv. Aussi. - (10) |
| itou. adv. - Aussi. - (42) |
| iun, iunne, adj. num. un, une (employés isolément). - (17) |
| îvaliditè : n. f. Invalidité. - (53) |
| iveron, tarière. - (05) |
| iveur, s. m. se dit d'une personne et particulièrement d'un enfant dissipé, taquin, de mauvais caractère : « ç'o eun iveur que n' fâ jeumâ qu' dé ch'titetés », c'est un vilain qui ne fait jamais que des méchancetés. - (08) |
| ivouaîre (d’l’) : ivoire - (57) |
| ivouaîrien (n’) : ivoirien - (57) |
| ivrâ (n.m.) : ivraie - (50) |
| ivrâ, ivraue. s. m. Ivraie. (Lainsecq, Merry-la- Vallée). - (10) |
| ivrâ, s. f. ivraie, plante de la famille des graminées. « ivrô. » - (08) |
| ivra. n. f. - Ivraie. - (42) |
| ivrasse : s. f., ivrognesse. - (20) |
| ivrer (S') : v. r., vx fr., s'enivrer. Le médecin m'a dit que si je continuais à boire je perdrais la vue. Eh ben ! j'ai assez vu, mais j'ai pas assez bu. J'aime mieux fermer la fenêtre et que la porte reste ouverte. - (20) |
| ivrer (s'), s'enivrer. - (05) |
| ivrer (s'), v. pr., s'enivrer : « Qu'vous-tu fâre de lu ? O s'ivre quasiment tô les jôrs. » - (14) |
| ivrer (S'). S'enivrer ; d'ebriari, comme enivrer d'inebriari. - (03) |
| iyè : hier - (46) |
| iyeu : hier. - (29) |
| Izaïbes. Isabeau. Le nom Elisabeth a ftouflert diverses altérafrançais. On a dit non seulement Isabeau, mais Isabelle, Babeau, Babon, Belon, et peut-être d'autres que fignore. A dijon, outre Izaibea, le petit peuple dit très souvent Lizabar… - (01) |
| ized, pour z, dernière lettre de l'alphabet. - (16) |
| j’an. En. C'est une élégance en bourguignon de dire : J'an veci, j'an velai, pour en voici, en voilà. - (01) |
| j’ment (na) : jument - (57) |
| j’mouilli : geindre - (57) |
| jà (pas). adv. - Mot intraduisible, utilisé pour insister sur une négation : « En pour i ' m'a dounné des calons, mais c'est pas jà la même choue ! » Ou bien: « Aveuc une ourage coumme ça, la paille est pas jà rentrée ! » - (42) |
| ja : Déjà. « Te v'la ja ! ». La forme ja a vieilli. On emploie maintenant la forme déjà. - (19) |
| jâ : Jars. Mâle de l'oie. « Ne t'appreuche pas des oies le jâ te meudrait » : ne t'approche pas des oies le jars te mordrait. - (19) |
| jà, adv., déjà, maintenant, à présent. - (14) |
| jâ, mousse qui se produit sur un vin nouveau agité. - (16) |
| ja, s. m. dard d'un serpent, d'une guêpe, d'un lézard. - (22) |
| ja, s. m. dard d'un serpent, d'une guêpe, d'un lézard. - (24) |
| jà. adv. Déjà, encore. Du latin jàm. - (10) |
| jabeut : Jabot. Au figuré : « O s'est bien remp'lli le jabeut » : il a mangé beaucoup. - (19) |
| jabeuter : Jaboter, bavarder. « Quand les fannes sant au bé i ne sant pas d'arrate de jabeuter » : quand les femmes sont au lavoir elles ne cessent pas de bavarder. - (19) |
| jâbi - arrangé ordinairement dans un sens moqueur, un peu comme gônai. - Mon pôre gairson, que t'é don mau jâbi ! - Ma ,mai chère Gogotte, qui t'ée don jâbie queman cequi ? - (18) |
| jabi (mau), mal vêtu. - (28) |
| jâbi (mô) : habillé (mal) - (48) |
| jâbi, e, adj. fait à la hâte, sans soin, sans goût, gâché. - (08) |
| jabi, habillé, employé surtout péjorativement ; mal jabi, mal habillé, portant des vêtements mal ajustés, sans goût. - (27) |
| jabi, ie. s. m. et f. Mal arrangé, mal habillé, mal fichu, mal ficelé. – Se dit aussi pour niais. Mon pour' jabi. – S'emploie quelquefois adjectivement. V'là-t-i qu't'es ben jabi ! - (10) |
| jabi, vt. saboter un travail; pp. : mal habillé. Voir gonné. - (17) |
| jâbi. Mal fait, mal arrange, mal ficelé. Etym. inconnue. - (12) |
| jabier : mal habiller. (EDSEA. T II) - A - (25) |
| jâbir : travailler à la hâte. (S. T III) - D - (25) |
| jab'lle : Jable. « Ma fillette piche su le jab'lle » : ma feuillette est presque vide, le liquide n'a plus la force de couler plus loin que le jable. - (19) |
| jabot, s. m., estomac : « Hïâr ôl étot d'noce. Ol a maingé, ôl a maingé... ô s'en a fouré plein l’jabot. » - (14) |
| jaboter. v. - Avoir un renvoi. - (42) |
| jaboter. v. n. Se dit en parlant des contractions, des soulèvements qui se produisent dans la poitrine, dans l'estomac, dans le jabot. Le cœur me jabote. - (10) |
| jabou. s. m. Petit poisson à grosse tète, espèce de têtard, qu'on trouve sous les pierres dans les ruisseaux. (Chablis). - (10) |
| jabout. n. m. - Jabot, gésier. - (42) |
| jabout. s. m. Jabot, gésier. (Lainsecq). - (10) |
| jacâiller, v. jacasser. - (38) |
| jacasse. s. f. Femme bavarde. Du verbe jacasser, et de l'italien gazza, pie. - (10) |
| jacassi : jacasser - (57) |
| jâché (ā), vt. gercé ; pp. jâché, ie. - (17) |
| jachie, sf. race, engeance. - (17) |
| jachon, sm. dard d'insecte venimeux. - (17) |
| jacin : Dard de reptile ou d'insecte. « Y a eune grande que m'a piqué le jacin a demoré dans la piau » : j'ai été piqué par une guêpe, l'aiguillon est resté dans la peau. - (19) |
| jàcin, s. m., aiguillon d'abeille, et même de serpent. On le dit aussi d'une mauvaise langue de femme. - (14) |
| jacin, s. m., langue fourchue des serpents. - (40) |
| jacin. Aiguillon d'abeille, de serpent, du latin jaculum, dard. Jacer, piquer, de jaculari. - (03) |
| jacin. Dard d'un insecte et langue d'un serpent. Ce mot ne viendrait-il pas de gœsum qui était, comme on sait, l'arme de trait des Gaulois. Au figuré on a appliqué jacin à une femme bavarde, une méchante langue. Lai meire Manette ai un fameux jacin. - (13) |
| Jaco. Enfant nommé Jacques… - (01) |
| Jaco. Jacob, patriarche. « Le Dei de Jaco », le Dieu de Jacob. - (01) |
| jacobine : s. f., bergeronnette. - (20) |
| jacot (on) : geai - (57) |
| jacot : geai. L’oiseau corvidé. - (62) |
| jacôte, s. f., jaquette, vêtement. - (14) |
| jacote, s. f., pie. On baptise de ce nom la femme babillarde. - (14) |
| jâcque - geai (oiseau) ; fromage blanc. - Note petiote é trouvé in nid de jâcques ; qu'an y aivo trouas œufs dedans. - Mouai, i eûme assé le jàcque, le tiaque-bitou queman qu'an dit encore. - (18) |
| jacque (n.m.) : geai - (50) |
| jacque : (jâ:k' - subst. m.) geai. - (45) |
| jacquée : (jâké: - subst. f.) portion (importante) de nourriture qu'on sert à table : en effet la gloutonnerie du geai est proverbiale. - (45) |
| jacqueillon. Jupon de grosse laine, pour l'hiver... L'habit masculin correspondant est une jacquette. C'était le vêtement populaire, celui des Jacques. - (13) |
| jacquelion : s. m., gâchette de l'arc et du fusil. - (20) |
| jacquerieau, geai. - (05) |
| jacques : geai - (44) |
| jacques : geai - (48) |
| jacques : geai. Faire le jacques : faire l'imbécile. - (52) |
| jacques : geai. - (33) |
| jacques : geai - (39) |
| jacques : s. m., geai. - (20) |
| jacques, jacquot, s.m. geai. - (38) |
| jacques, n.m. geai. - (65) |
| jacques, subst. masculin : geai. - (54) |
| jacques. Geai. - (49) |
| jacquette : Pie. « Les jacquettes ant fait leu nid à la cuche du peup'lle ». - (19) |
| jacquette, jacquotte : s. f., pie. - (20) |
| jacquette, n.f. pie. - (65) |
| jacquette, pie. - (05) |
| jacquillan : Gâchette de fusil. « Fa bien attention, tan feusi (fusil) est doux à la détente, o parte siteut qu'an ment (met) le da su le jacquillan ». - (19) |
| jacquillon, s.m. sorte de cotte (mot vieilli). - (38) |
| jacquillon. s. m. Petit jupon, petit jaque. (Pasilly). - (10) |
| Jacquot : Nom d'homme : Jacques. « Jacquot Pachoux » : Jacques Pachot. - Geai. - (19) |
| jacquot, geai. - (05) |
| jacqu'tance : bavardage, éloquence - (48) |
| jacqu'ter : bavarder - (48) |
| jàcriau, et jaque, s, m., geai. - (14) |
| jacrio. Geai. Nous disons aussi jaque et jacquerai, et jaquette pour pie. - (03) |
| jacter : bavarder - (44) |
| jacule. s. f. et jaculon. s. m. Dernier né d'une famille, d'une couvée d'oiseaux. (Turny), Voyez joudru. - (10) |
| jaculon : dernier né (ou le culo). (F. T IV) - Y - (25) |
| jade : jatte. Grand récipient évasé, généralement en terre, faïence ou porcelaine. Ex : "Oh vaaa ! Al' avait pas apargné la salade, la Lucie, n'en avait brament ène pleine jade, t'entends ben !" - (58) |
| jadi (nom masculin) : se dit du mâle qui s'accouple. - (47) |
| jàdi, adv., jadis. - (14) |
| jâdi, v. n. côcher, faire le jars. Se dit du mâle qui s'accouple. - (08) |
| jadié : n. f. Action amoureuse d'animaux. - (53) |
| jadin, jardin. - (26) |
| jadin, jardin. - (27) |
| jadin. Jardin. - (01) |
| jadjin, sm. jardin. - (17) |
| jâdôlle : n. m. fam. Amour de chien. - (53) |
| jadore : (jâ:dô:r' - subst m.) rut, période des amours (pour les mâles). Cela se dit surtout à propos des chiens. En parlant des chiennes, on dira qu'elles mènent lè lé:ch' (recherche du mâle). - (45) |
| jadot : cuvette. - (32) |
| jâdou, ouse, adj. timide, honteux, craintif. « Zâdou » et au féminin « zâdoure ». - (08) |
| jâdouée, s. f. organe de la génération chez les animaux et particulièrement chez les oiseaux de basse-cour. - (08) |
| jadoure (nom masculin) : cri des oiseaux durant le temps de l'accouplement. - (47) |
| jâdoure, s. f. cri des animaux et particulièrement des oiseaux au temps de l'accouplement : « mener lai jâdoure », faire entendre le cri ou le chant des amours. - (08) |
| jadrin. s. m. Jardin. - (10) |
| jafe. Grosses joues. - (03) |
| jaffe : Os maxillaire inférieur du porc. Quand on fait la lessive on place au fond du cuvier, devant le trou par lequel doit s'écouler le « lichu », une jaffe destinée à empêcher le linge d'obstruer ce trou. « As tu mis la jaffe au boiri (au cuvier) ? ». - (19) |
| jaffes, grosses joues. - (05) |
| jaffle. adj. Acide. - (10) |
| jâfoueiller, v. a. fouler, flétrir, souiller avec les pieds ou avec les mains. - (08) |
| jâfre : Rugueux. « T'as dan bin les mains jâfres ! » : tu as les mains bien rugueuses ! - (19) |
| jâfre, adj. acre. Se dit surtout en parlant des fruits sauvages appelés « blossons » dans le pays. - (08) |
| jâfre, s. gruau épais. - (38) |
| jagdillou, ouse, s. m. et f. celui qui fouille en piquant, en poussant une pointe dans un trou, dans un creux. - (08) |
| jagouiller : couper maladroitement. (E. T IV) - VdS - (25) |
| jagouiner (sans doute pour sagouiner). v. a. Raccommoder, réparer une chose grossièrement, sans goût, sans soin. (Laduz). - (10) |
| jagueucher : remuer. - (59) |
| jagueucher, verbe intransitif : secouer, remuer fortement. - (54) |
| jagueugné : v. i. Bouger. - (53) |
| jaguigné, zaguigné, vn. hésiter, temporiser. - (17) |
| jaguigner. v. n. Remuer toujours, ne pas pouvoir rester en place. (Yassy-sous-Pisy). - (10) |
| jâguiller, v. n. fouiller dans un trou en cherchant quelque chose ; sonder avec une baguette ou un instrument quelconque. - (08) |
| jaguzer : couper de petits morceaux. (REP T IV) - D - (25) |
| jâher, v. a. jaser, causer, babiller : « n' jâa pâ tan bounhoume ! », ne bavarde pas tant, bonhomme! On dit de même « cauher » pour causer, par suite de la chute de l's médial. - (08) |
| jâhotte (n. f.) : sorte de raclette qui servait à niveler le sol en terre battue des habitations paysannes - (64) |
| -j'ai vu courir des rats bardots sur le mur du préau. - (54) |
| jai : jars. (REP T IV) - D - (25) |
| jaicaisse - de jacasser, bavarder. - N'écoutez pas totes ces mères jaicaisses lai. - C'â Marie jaicaisse. - (18) |
| jaicaissé : v. i. Jacasser. - (53) |
| jaicaisse, s. f. femme ou fille bavarde. - (08) |
| jaicaisser, v. n. bavarder avec volubilité. - (08) |
| jaicer, v. a. sucer avec le « jaiçon. » se dit des serpents qui tètent les vaches avec leur langue appelée improprement dard. - (08) |
| jaiceron, s. m. dard, aiguillon. - (08) |
| jaichon, n. masc ; dard des abeilles, langue du serpent. Au figuré, mauvaise langue. - (07) |
| jaiçon (n.m.) : dard des guêpes, etc. (aussi gesson) - (50) |
| jaiçon. s. m. langue de serpent, dard de l'abeille, de la guêpe, etc., au figuré mauvaise langue, langue venimeuse. - (08) |
| jaicôpin. Jacobin, jacobins. On a prononcé longtemps Jacopin à la manière du Giacopo ou lacopo des Italiens, parmi lesquels, cependant, Giacomo n'est pas moins usité… - (01) |
| jaicôte. Jaquette, sorte de robe ou souquenille… - (01) |
| jaidi. Jadis… - (01) |
| jaiffion - dard des abeilles, des couleuvres. - Ine guépe m'é piquai, et pu son jaiffion m'é restai dans mon doigt, que cequi me fait mau, vraiment. - I ons rencontrai ine serpent ; si vos l'aivoin vuer quemant ile nos tirot son jaiffion ! ci fait in pecho pô, ailé. - (18) |
| jaigueuché : v. i. Danser. - (53) |
| jaigueûcher, juingueûcher, juinquecher : ne pas être fixé solidement (« branler dans le manche »), remuer exprès - (37) |
| jaigueussé : 1 v. t. Essayer. - 2 v. t. Tripoter. - (53) |
| jaille : s. f., jaillat, jaillot, jaillout : s. m., branchette, partie extrême d'une branche d'arbre ou d'arbuste. - (20) |
| jaille : s. f., jailleron : s. m., collet de veau (partie comprise entre la tête et l'épaule). - (20) |
| jaillet (faire le), chatouiller. - (11) |
| jaillet, chatouillot, gligli, guerli. Chatouillement. On dit : « faire le jaillet, le gligli » etc. - (49) |
| jaillis. s. m. pl. Chuchotements, babillages. (Saint-Florentin). - (10) |
| jaillon, s. m. jalon, petit piquet dont on se sert pour marquer un alignement. « ol é mettu sé jaillons dan mon çan », il a mis ses jalons dans mon champ. - (08) |
| jaillon. s. m. Jalon. (Mouffy, Parly). - (10) |
| jaillot (n. m.) : massette, sorte de roseau - (64) |
| jaillouner. v. a. et n. Jalonner. - (10) |
| jailou, adj. jaloux. - (17) |
| jaimâ : adv. Jamais. - (53) |
| jaima, adv. jamais. - (17) |
| jaimâ, jamais. - (16) |
| jaimas (adv.) : jamais - (50) |
| jaimas, jamas, jemas, jeumas, jonnas. adv. Jamais. - (10) |
| jaimoi. Jamais. - (01) |
| jaipe : bagout - (48) |
| jaippe : n. m. Bagout. - (53) |
| jaippé : v. i. Japper, aboyer. - (53) |
| jaipper , v. a. japper, aboyer. « zaipper. » - (08) |
| jaipper : japper, aboyer - (48) |
| jaiquereaa. : Pie.- On a donné toutes sortes de noms à cet oiseau qui est généralement considéré par la superstition comme de mauvais présage. On l'appelle aussi dame Jaicôte, Matagesse, Margot, et entln Aigaisse. Cette dernière dénomination vient vraisemblablement de l'Italien gazza. - (06) |
| jaiquillon, sm. petite jupe. - (17) |
| jair (n.m.) : jars - (50) |
| jair (nom masculin) : jars. - (47) |
| jair : jars - (48) |
| jair, particule affirmative. (Voir : jar.) - (08) |
| jair, s. m. jars, mâle de l'oie. - (08) |
| jairdin : jardin - (48) |
| jairdrin, s. m. jardin. - (08) |
| jairgille, jairgillerie : gesse sauvage - (48) |
| jairgillerie, s. f. gesse sans feuilles et autres plantes adventices qui poussent dans les blés ; zizanie. - (08) |
| jairgon, n. masc. ; langue, langage ; Y ne chouros comprenre le jairgon des maigniens. - (07) |
| jairgon, s. m. bruit de paroles comme dans une querelle ou un colloque très animé ; langage inintelligible. - (08) |
| jairgoner, v. a. jargonner, parler un langage prétentieux ou inintelligible, faire beaucoup de bruit en parlant. - (08) |
| jairgouin : patois, langage difficile à comprendre - (37) |
| jairjeillerie : (jêrjey'ri: - subst. f.) ivraie, zizanie. - (45) |
| jairle, jalle : récipient en terre cuite où l’on fait cailler le lait pour obtenir du fromage frais - (37) |
| jairnindié - sorte de jurement qui veut dire : je renie Dieu. - Il a fini avec nos grands-pères, avec le père Raveau, que l'on surnommait le père Jairnindié parce qu'il le prononçait souvent. - Veux-tu bein t'en ailai, jairnindié. - Jairnindié, voilai mai pioche cassée ! - (18) |
| jairon, n. masc. ; morceau de gros bois dans les fagots. - (07) |
| jairrey, adverbe affirmatif.; aussi, allons donc. - (07) |
| jairser (verbe) : action de s'accoupler chez les volatiles. - (47) |
| jairser, v. a. se dit de l'accouplement des oies et en général des oiseaux. - (08) |
| jairtére, s. f. jarretière, ruban ou courroie pour attacher les bas. - (08) |
| jairtouéiller : se heurter les mollets en marchant - (48) |
| jaisse : avoir la bouche agacée, au contact astringent des prunelles (baillè lè jaisse) - (46) |
| jaisson, jasson : dard (de l'abeille) - (48) |
| jaivale, s. f. javelle, petite gerbe de blé, de seigle, d'avoine, etc. on prononce « zaivalle » dans une partie du qui applique aussi le terme aux petits fagots de sarment de vigne. - (08) |
| jaivaler, s. f. mettre en javelle, réunir une certaine quantité de poignées de céréales pour en former de petites gerbes. - (08) |
| jaivalle : javelle - (48) |
| jaivelle : n. f. Javelle. - (53) |
| jaivelle. Javelle, javelles. - (01) |
| jaiv'leuse : n. f. Javeleuse - (53) |
| jajoitter. v. n. Ricaner. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| jâke, geai. - (16) |
| jale : s. f. touffe végétale. - (21) |
| jalé, geler ; jalë, gelée. - (16) |
| jale, s. f. touffe d'herbe au de jeunes arbres. - (22) |
| jaler, gealer, v. geler. - (38) |
| jaler, v., geler. - (40) |
| jaler. v. a. et n. Geler. (Saint-Germain- des Champs). O jale, il gèle. (Guillon, Saint-Brancher). - (10) |
| jâllière : adj. Coriace, dur. - (53) |
| jalloignée, ce que les deux mains approchées l'une de l'autre peuvent contenir. - (27) |
| jalousement : adv., de manière à rendre jaloux. - (20) |
| jalouserie, s. f., jalousie. - (14) |
| jalouseté : s. f., jalousie. - (20) |
| jalousté. n. f. - Jalousie. - (42) |
| jaloux, jalouse : adj., qui provoque la jalousie. Année jalouse, celle dont le rendement a été inégal dans des propriétés voisines, ce qui conduit les cultivateurs moins favorisés à jalouser les autres. - (20) |
| jamâ : Jamais. « Mieux vaut tâ (tard) que jamâ ». - (19) |
| jamâ : jamais. On remarque une altération courante de« ai(s) » en « â ». - (62) |
| jamà, adv., jamais. - (14) |
| jamâs : damais - (39) |
| jamâs, adv. jamais. - (38) |
| jambade. n. f. - Gambade, saut, cabriole. - (42) |
| jambade. s. f. Gambade. (Villeneuve- les-Genets). - (10) |
| jambe de varne : jambe de bois - (61) |
| jambe : s. f. Tenir la jambe à quelqu'un, le cramponner. Voir charrette. - (20) |
| jambette, pièce de bois en charpente. - (05) |
| jambian : Jambon « Eune bonne sope (soupe) au jambian ». - (19) |
| jambion Jambon, jambons. - (01) |
| jambjin. Terme injurieux, sot, imbécile. Origine introuvable. - (12) |
| jambotée : Giboulée. « Y a cheut eune jambolée de gueursi ». - (19) |
| jaminer. v. n. Murmurer. (Bazarnes). - (10) |
| jampai. : Lancer, (Del.) - (06) |
| Jan de Var. Jean de Vert, fameux commandant des troupes impériales, pris au mois de mars 1658 par le duc de Veimar dans une bataiile près de Rhinfeld, et de là mené prisonnier au bois de Vincennes… - (01) |
| j'an veci, j'an velai. : Façon recherchée de langage pour en voici, en voilà (Del.). - (06) |
| Jan. Jean, nom propre que nos humanistes latin expriment plus voionliers par Janus que par Joannes… - (01) |
| jance, semblant. A Châtillon , on dit faire cance de, c.-à-d. faire semblant de. En langue romane , jangie signifie caquet, badinage, discours. - (02) |
| janci, e, adj. moisi. - (08) |
| janciot : qui a les gencives énervées - (39) |
| jandôle : n. f. Vie dissolue. - (53) |
| jâne, s. f. gêne, difficulté. - (08) |
| jânei, adj., moisi : « Ton pain n'é pas hé cueùt ; ô sent l’jànei. (V. Nazé.) - (14) |
| jâner, v. a. gêner, causer de la gêne. - (08) |
| janète, narcisse (fleur) et chanlatte pour la conduite des eaux d'un toit. - (16) |
| jangeiller, v. a. couper grossièrement, sans soin, en laissant des brèches, des entailles, comme avec une scie. - (08) |
| jangle. : Médisance, bavardage. Ce mot à le même sens que jonglerie. Ils viennent tous deux du latin joculatio. - (06) |
| jangouillater : (jan:gouyatè - v. neutre) bavarder, babiller. - (45) |
| jangouiller. Bafouiller, mal prononcer les mots. - (49) |
| jan-jan, adj., ironique, niais, imbécile. (V. Colas.) - (14) |
| janjeiller : (jan:jéyé - v. tr.) 1-couper en dépit du bon sens, abîmer en coupant mal. 2-saccager (un champ de céréales). - (45) |
| janjoïlli : Tourner dans la bouche longtemps avant d'avaler. « J'ai biau y janjoïlli je peux pas y envaler ». - (19) |
| janlognai et janlorginai, faire le niais ou le badaud. On dit encore, dans les campagnes, faire le janjan. - (02) |
| janlognai ou janloignai. : Faire le niais ou le badeau.- On dit aussi faire le Jean-Jean. - (06) |
| Janne, Jeanne (prononcer Jan-ne ; jan, comme Jean). - (16) |
| jan'nette : marguerite des champs (ou jonquille ?). - (33) |
| jan'nette : n. f. Jonquille. - (53) |
| Jan-ninte, jeannette. - (26) |
| janpé, vn. sauter à la barbe. Jaillir inopinément. S’élancer d'un bond. - (17) |
| janse ; béyé lë janse, faire désirer vivement à quoiqu'un de manger quelque chose de bon dont on mange soi-même, sans lui en faire part. Un fruit vert, de l'oseille crue donnent les janse, comme en excitant les gencives. - (16) |
| jansson : dard d'abeille ou langue de serpent. - (09) |
| jantais, gentil. Parler jantais, c'était, chez les Bourguignons, parler français, c.-à-d., comparativement à leur langue nationale, c'était parler un langage recherché... - (02) |
| jantais. Mot particulier de Dijon, où palai jantais, c'est parler, où moins tâcher de parler bon français… - (01) |
| jantais. : Gentil, orné. Parler jantais signifiait, en Bourgogne, parler français, c'est-à-dire, un langage gent, poli, agréable (en latin gentilis). - (06) |
| janti. Gentil. - (01) |
| janvier (Père) : s. m., personnage imaginaire qui est censé apporter leurs etrennes aux enfants dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. A Cluny, le Père Janvier, qu'on appelait Janvier Garguille (greguille, gr’gui), caquait autrefois des dragées sur le toit de l'église Notre-Dame. - (20) |
| janvier : Le père Janvier, personnage imaginaire qui est censé apporter aux enfants les étrennes du Jour de l'An. - (19) |
| jaou (nom masculin) : petite pioche. - (47) |
| jâou, zâou, s. m. instrument dont on se sert pour sarcler et qui ressemble un peu à la rasette flamande. Le « jàou « est le sarcloir usité aux environs de Lormes. - (08) |
| japetasser, v., bavarder, jacasser. - (40) |
| japigner (altération de jaspiner). v. n. Causer trop et mal à propos. - (10) |
| japillard, japiller, japper souvent. - (05) |
| japillard, s. m., petit chien qui aboie toujours, qui ne cesse de japper. - (14) |
| japiller, v. intr., japper souvent. Se dit des petits chiens qui se font toujours entendre. - (14) |
| japiller. Fréquentatif de japper, qui n'est pas sans grâce, d'où japillard, petit chien qui aboie sans cesse. - (03) |
| jappai : aboyer, se dit aussi d'un homme qui a du bagout : ol é de la jappe. - (33) |
| jappe : s. f. Mener sa jappe, caqueter, bavarder. Fermer sa jappe, cesser de caqueter. - (20) |
| jappe-à-la-lune, jappe-la-lune : s. m. et f., personne vantarde et causant à tort et à travers. - (20) |
| japper, v. aboyer. - (65) |
| japper. v. n. Sauter pour s'amuser. - (10) |
| jappet, japette : s. et adj., m. et f., bavard, bavarde. - (20) |
| jappette. Bavard, criailleur, semblable à un roquet qui jappe pour rien. - (12) |
| japsoupe : gros gourmand - (60) |
| jâque (fâre l’) : faire le « zigotto » - (37) |
| jaque (le) : un geai. - (66) |
| jâque : geai, personnage un peu trop malin - (37) |
| jâque : un geai, on dit aussi jâquot - (46) |
| jaque : n. m. Geai. - (53) |
| jaque, geai. - (26) |
| jâque, s. m. geai : un jaque, des jaques. - (08) |
| jâque, s. m., geai. - (40) |
| jaque. Geai. Ce nom n'est qu'une onomatopée, imitant le cri de l'animal. - (12) |
| Jaque. Jacques. Jacobus, On peut aussi écrire Jaque en français, surtout en vers… - (01) |
| jaquette (na) : pie - (57) |
| jaquette : pie. On dit aussi agasse ou ashe. - (62) |
| jaquœt’e, s. f. pie. - (22) |
| jaquœt'e, s. f. pie. - (24) |
| jàr (C.·d., Chal., Morv.), jor (C.·d ). jârre (C.-d.), jâré (Morv.) jà (Y.).- Beaucoup plus intéressant que le précédent, ce mot est également d'un usage très fréquent. C'est une locution explétive signifiant : donc, en effet, assurément, maintenant, déjà… - (15) |
| jar : marque le superlatif (ex : i seu jar ben aille : je suis très contente). (RDM. T II) - B - (25) |
| jâr : vraiment (« ai l’ot jâr fiâr ! ») - (37) |
| jâr bin, exclamation (pour approuver). - (40) |
| jar, adv. de temps. Hier. - (08) |
| jar, expression équivalente à ma foi. - (27) |
| jar, jâré. Cette particule explétive signifie en effet, en vérité, assurément, ou maintenant déjà, à présent, à cette heure. Une partie de la région prononce jair : « ç'ô jair vré », c'est en effet vrai. - (08) |
| jar, pourtant, donc. - (38) |
| jâr, s. m. mâle de l'oie. (Voir : jair.) - (08) |
| jâr, s. m., oie mâle. - (14) |
| jâr. Petit mot parasite ajoute un peu partout pour accentuer un dire. Ex. : « C’est jâr bien fait que tu sois tombé, ça t'apprendra à désobéir ! ». Etym. abréviation de jarni, qui est lui-même une abréviation de jarnilleu, jarnidieu, exclamation venue par contraction du juron : je renie Dieu (Littré). - (12) |
| jar. : Oie male. - (06) |
| Jarai. Jared, patriarche. - (01) |
| jaraïllâ : Qui marche en « jaraïllant ». - (19) |
| jaraïlli : Marcher en portant les pieds en travers, la pointe en dehors. - (19) |
| jaran : branche de fafiot sans brindilles. (S. T III) - D - (25) |
| jaran : Gros brin de bois d'un fagot « Pa fare in fagueut (fagot) de « millier » i faut au moins deux bans jarans d'ave le ptiet beu (avec le petit bois) ». - (19) |
| jarbe (n.f.) : gerbe - (50) |
| jarbe : gerbe. Ex : "Pour lier les jarbes, il a bien d'l'adret". - (58) |
| jarbe, gearbe : gerbe. - (32) |
| jarbe, s. f. gerbe : une « jarbe » de froment, de seigle. « Zarbe. » - (08) |
| jarbe, s. f., gerbe, spécialement celle du blé. - (14) |
| jarbe, sf. gerbe. - (17) |
| jarbée, s. f., gerbée, botte de paille. - (14) |
| jarbellion : étincelle. - (32) |
| jarber, v. n. faire de la gerbe, fournir beaucoup de gerbes. - (08) |
| jarber, v. tr., mettre en gerbes. Fin fêtée des moissons. - (14) |
| jarbére : s. f. tas de gerbes, souvent dehors. - (21) |
| jarbillon, gearbillon. s. m. Gerbillon, petite gerbe. (Puysaie). - (10) |
| jardaigne. s. m. Jardin. (Lucy-surCure). - (10) |
| jardéé : n. m. Jardin. - (53) |
| jardigné, vn. jardiner. - (17) |
| jardigniée : carabe doré. 1V, p. 29 - (23) |
| jardinage : s. m., produits maraîchers. - (20) |
| jardinage, s. m., réunion de fruits, de légumes : « Un plat de jardinage. » - (14) |
| jardinège, ce que l'on récolte dans un jardin. - (16) |
| jardinier, jardinière : s. m. et f., carabe doré (carabus auratus) ; courtilière (gryllotalpa vulgaris). - (20) |
| jardiniére (na) : jardinière - (57) |
| jâre - mot explétif qui exprime l'étonnement ou bien l'impatience. - En voiqui jâre ainne qu'en vau bein deux ! - Ah ! pour le co, voiqui qui se rencontre jarre en ne peut pâ pu mau ! - (18) |
| jàre, adv., jà, certes, ma foi! pardieu ! Excl. complétive à sens multiples : « Y é jàre ben vrâ ! » — « J'en ons jàre prou ! » etc. - (14) |
| Jareau, jarreau : récipient en boisellerie, petite jarre. - (32) |
| jàrelòt, et jarlòt, s. m., sorte de baquet : « Y é prou engageant, ma fi ! Je n'ii prêterai puran ; ô m'a crevé mon jàrelòt. » - (14) |
| jareter. Donner des coups de fouet dans les jambes, de jarret. - (03) |
| jargeillot : gesse sauvage. - (33) |
| jargeot : qui ne comprend rien - (39) |
| jargilie, ervilie. - (05) |
| jargillerie (n.f.) : mauvaise herbe, ivrai, gesse (a.fr. jargerie = ivrai) - (50) |
| jargillerie : vesce sauvage, grimpante (aux tiges des céréales). - (62) |
| jargillerie, s. f. espèce de vesce sauvage qui envahit les blés. - (11) |
| jargillöt, sm. jargillerie, sf. vesce des champs. - (17) |
| jargoin : Jargon. « Neguin ne camprend ren à son jargoin» : personne ne comprend rien à son jargon. - (19) |
| jargouiller : v. n., vx fr. jargoillier, gazouiller ; jargonner. - (20) |
| jargouilli, v. n. gazouiller (se dit d'un enfant). - (22) |
| jargouiner : Baragouiner. « Qu'est-ce que te jargouines ? » : qu'est-ce que tu baragouines ? - (19) |
| jargoulate, s.f. gorge. - (38) |
| jargouner, v, intr., jargonner, parler un langage corrompu. - (14) |
| jargòyi, v. n. gazouiller (se dit d'un enfant). - (24) |
| jargueiller, v. a., remuer, s'agiter en tout sens, même sens que le verbe jaupiller, donné dans le Glossaire du Morvan, p. 472 . - (11) |
| jarguet, s. m. mauvais couteau, couteau de pacotille qu'on appelle en français eustache. - (08) |
| jargueute : Carotte sauvage, plante de la famille des ombellifères. - (19) |
| jarjilie. Plante qui infeste les blés et s'y accroche par ses vrilles filamenteuses, ervum ervilia, formé sans doute par corruption de ce dernier mot. - (03) |
| jarjiller : gâcher par maladresse - (60) |
| jarjillerie : Vesce sauvage des blés. « Mari blié est etoffé pa la jarjillerie » : mon blé est étouffé par la jarjillerie. - (19) |
| jarjillet, n.m. vesce sauvage. - (65) |
| jarjillon : s. m. vesce sauvage qui pousse dans les blés et les étouffe. - (21) |
| jarjiya, pois sauvage grimpant, très commun dans les blés. - (16) |
| jarjot : maladroit - (60) |
| jarle (nom féminin) : vase en terre ou taillé dans le bois. - (47) |
| jarle : baquet. (F. T IV) - Y - (25) |
| jarle : Grande benne qu'on mettait sous le « goulerot » d'un pressoir à grand point. - (19) |
| jarle et jarlot. Du bas-latin gerla, cuve. Vaisseau de bois que l'on met à côté de la selle, sous le cuvier a lessive. Fais ben aittention en coulant lai bue : ton jarlot vai borger. - (13) |
| jarle : n. m. Gros baquet en bois monté avec des douelles. - (53) |
| jarle, s. f. jale, vase en bois ou en poterie qu'on place sous le cuvier de lessive pour recevoir les eaux qui en sortent. - (08) |
| jarle. Baquet de bois. Jatte. - (49) |
| jarle. s. f. Jale, jarre, jatte, tine, baquet. (Dollo, Villechétive, etc.). - (10) |
| jarlée. s. f. Contenu d'un jarle. (Villiers-Bonneux). - (10) |
| jarlo : s. m. : sorte de petit baquet. - (21) |
| jarlot : s. m., vx fr. jarle et gerle ; seillet ; cuvier à lessiver, chaire à prêcher. - (20) |
| jarlot. s. m. Petit baquet, petite jarle. (Sens). - (10) |
| jarloter : v. n., remplir l'emploi de jarlotier. - (20) |
| jarlotier, jarlotière : s. m. et f., celui ou celle qui porte les jarlots de chaque vendangeur et les vide dans la benne. - (20) |
| jarlotte (nom féminin) : récipient destiné à recevoir de l'huile. - (47) |
| jarlotte, s. f. baquet de cave sans oreillons (du vieux français jar/e). - (24) |
| jarlotte, s. f. petite jarre, vase dans lequel on renferme l'huile ou autre liquide. Diminutif de jarle. - (08) |
| jarloute : s. f. petite benne. Voir jarlo. - (21) |
| jarloute, s. f. baquet de cave. - (22) |
| jarlouti : s. m. l'homme qui décharge le raisin avec les jarloutes. - (21) |
| jarme, sm. germe. - (17) |
| jarmé, vn. germer. - (17) |
| jarnée. Touffe de bois sortant d'une même souche, quelquefois fagot. Etym. inconnue. - (12) |
| jarner : v. germer. - (21) |
| jarni! et jarnidié ! juron assez familier aux campagnards. - (14) |
| j'arni. : Apocope de je renie. (Del.) - (06) |
| jarnie. Je renie… - (01) |
| jarnon : s. m. germe des pommes de terre, etc. - (21) |
| jarnon, s. m. germe. Verbe jarner. - (24) |
| jarnon, s. m. germe. Verbe : jarné. - (22) |
| jaro’illi : déchiqueter - (57) |
| jâron, s. m., grosse branche dans un fagot. - (40) |
| jàron, s. m., nom de chacune des deux grosses branches constituant la partie principale du fagot. - (14) |
| jarrai. Jarret. - (01) |
| jarre : vraiment, véritablement. (S. T III) - D - (25) |
| jârre : adv. Vraiment. - (53) |
| jarre, s. m. jarret, jambe, mollet. « Zarre » : « i m' seu breulé lé zarres. » - (08) |
| jarre. C'est une de ces particules que les grammairiens nomexplétives… Jarre parait extension de ja, que le menu peuple emploie souvent, « vous ne l’aurez ja »… - (01) |
| jàrréard, adj., claudicant, qui, par suite de vicieuse conformation naturelle, se dandine en marchant. (V. Gambi, Tortampion.) - (14) |
| jarreter : v. n., battre le briquet (se heurter les chevilles en marchant). - (20) |
| jarreter, fouetter les jambes. - (05) |
| jarretére : Jarretière. « La jarretére de la mairiée » pendant le repas des noces un des convives se glissait sous la table, près des nouveaux époux et ressortait en tenant à la main un long ruban qu'il présentait comme étant la jarretière de la mariée. On coupait ce ruban en petits bouts et chaque garçon de la noce en mettait un à sa boutonnière comme une décoration. - (19) |
| jarretu, adj. celui qui a le pied bot. un homme « jarretu », un pied bot. - (08) |
| jarron : (jâ:ron: - subst. m.) on désigne sous ce nom du petit bois dont la grosseur dépasse de peu celle du pouce, et qu'on peut débiter à la serpe. - (45) |
| jarrot (on) : jarret - (57) |
| jarrouiller. v. a. Mâcher, tortiller ses aliments longtemps dans sa bouche, quand on n'a plus de dents. Se dit surtout des vieillards. (Migé). - (10) |
| jarroule. n. f. - Gesse : plante grimpante, cultivée comme fourragère. (Perreuse, selon M. Jossier) - (42) |
| jarroule. s. f. Gesse, jarosse, plante fourragère connue aussi sous le nom de vesce. (Perreuse). - (10) |
| jarrreton. s. m. Qui a les jarrets de travers. – Se dit quelquefois pour coureur, pour niais, et alors c'est un terme injurieux. Grand jarreton ! (Perreuse). - (10) |
| jarr'tire (na) : jarretière - (57) |
| jarte (na) : fouette - (57) |
| jarté, v. a. cingler les jarrets. - (22) |
| jàrteire, s. f., jarretière. - (14) |
| jarter : éliminer - (44) |
| jarter : fouetter (les jambes) - (57) |
| jarter, v. a. cingler les jarrets : je vais te jarter ! - (24) |
| jàrter, v. tr., mettre des jarretières. A côté de cette acception propre, s'emploie couramment au figuré par les rouliers et conducteurs de voitures, quand ils ont à menacer un gamin qui les ennuie : « Attends, morveux! Si te n't'en vas pas, j'm'en vas te jàrter, » c'est-à-dire t'envoyer un coup de fouet qui te fera des jarretières. - (14) |
| jàrtoû, adj., cagneux, qui a le pied bot, la jambe tordue à l'endroit des jarretières. - (14) |
| jas, jasser, dard, piquer. - (05) |
| jàsées, s. f., causeries, syn. de Jasons. On réunit souvent les deux ; « Depeû quéque temps, n'y é cheû nous qu'des jasons et des jasées. » ce que nous appelons encore des disons-disettes. (V. Jàsons.) - (14) |
| jasein. Jasions, jasiez, jasaient. Ce mot pourrait bien venir de geai qui se prononce jai. - (01) |
| jasmèn, jacinthe (tleur). - (16) |
| jasmin : Scille à deux feuilles (bulbe). Fleurs bleues, poussant dans les bois au printemps. Jacinthe. - (19) |
| jaso. Jasais, jasait. - (01) |
| jason, jaisson - employé quelquefois pour jaiffion. - (18) |
| jason, langue de la vipère, à laquelle on attribuait faussement le mal que fait ce reptile. - (27) |
| jàsons, s. m., syn. et souvent complément du précédent, causeries, bavardages, cancans. Fournissent une occupation assez assidue aux ménagères. (V. Jàsées.) - (14) |
| jàsoû, adj., jaseur, babillard, potinier. - (14) |
| jasou, ouse, s. celui qui aime à jaser, à babiller. - (08) |
| jaspiner (se). v. - Se chamailler, se quereller. - (42) |
| jaspiner, et jaspiller, v. intr., bavarder. - (14) |
| jaspiner. Bavarder. (Argot). - (49) |
| jaspiner. v. - Bavarder, parler à tort et à travers. - (42) |
| jaspiner. v. n. Bavarder, causer à tort et à travers. Se jaspiner. v. pron. Se quereller, se taquiner. (Villeneuve-lesGenèts). - (10) |
| jasse : s. f. nœud ou boucle qu'on faisait au bout du fuseau avant de le laisser prendre. - (21) |
| jasse : Sorte de nœud simple qui sert à raccourcir une corde. - (19) |
| jasser : Fendre, gercer. « Apporte eune botaille, j'ai sa j'en jasse » : apporte une bouteille, j'ai soif, mon gosier est comme la terre que la sécheresse fait crevasser. - (19) |
| jasseure : Gerçure due à l'excès de sécheresse. - (19) |
| jassi, s. m., sensation désagréable dans les gencives, quand on a mangé une pomme verte. - (40) |
| jasson ou jaisson. La langue fourchue des reptiles, qu'ils sortent de leur gueule et agitent avec rapidité ; les gens du peuple la prennent pour un dard dangereux. Etym. jacere, jeter, lancer. - (12) |
| jasson, janson, jinson. s. m. Dard de l'abeille, du frelon, de la guêpe, etc. – Figurement et par extension, langue de commère, de femme bavarde. Elle en a un jasson, celle-là. - (10) |
| jasson, n.m. dard (l'abeille m'a laissé son jasson) ; langue de serpent. - (65) |
| jasson, n.m. langue de humaine bien pendue (il a un bon jasson). - (65) |
| jateire. Jarretière, jarretières… - (01) |
| jatlli, v. a. chatouiller. - (22) |
| jatllyi, v. a. chatouiller. - (24) |
| jau - jo : coq de basse-cour. Le mari de la poule. Ex : "Pour la Fête, j'vons ben tuer l'jau ! C'est l'moument !" (Tuer, prononcer : kuer). La Fête c'est la Fête foraine patronale annuelle. Par extension, surnom, après patronyme : Untel-le Jau, pour le distinguer des autres Untel de la parentèle, surnommés éventuellement d'un autre sobriquet. Il serait imprudent, indiscret, et malséant ici de citer un nom propre...mais on en connaît ! On pouvait hériter du surnom par filiation sans avoir nécessairement capacité de le justifier.... - (58) |
| jau (n. m.) : coq - (64) |
| jau (n.m.) : coq (aussi pouillau, zau) - (50) |
| jau (nom masculin) : coq. - (47) |
| jau (un) : un coq - (61) |
| jau : coq (geau) - (60) |
| jaû : coq, homme viril - (37) |
| jau : coq. III, p. 60-h - (23) |
| jau : gros coq. - (32) |
| jau, coq - (36) |
| jau, jou, jouc. s. m. Poulailler, juchoir. (Saint-Florentin). Du latin jugum. - (10) |
| jau, s. m. coq, mâle de la poule. - (08) |
| jaû, s. m., coq, et personnage qui fait l'important. - (14) |
| jau. n. m. - Coq. On trouve dès le Xe siècle jal, jau, ou gal pour désigner le coq, par dérivation du latin gallus. - (42) |
| jau. : Jeu. -Abréviation de joculus, comme gau est l'apocope de gaudium. - (06) |
| jaubie, s. f. jonchère, lieu rempli de joncs, touffe enracinée de plantes de marais. - (08) |
| jaubouler. v. a. Secouer fort. (Migé). - (10) |
| jaudier : remplir. (S. T IV) - B - (25) |
| jaudraler : gambader, folâtrer - (48) |
| jaudruiller : (jo:dru:yé - v.intr.) batifoler, faire le fou. - (45) |
| jaudruiller : (jô:druyé - v. intr.) voir dru. - (45) |
| jauge : s. f. Avoir la jauge, être de jauge, tenir la jauge, être capable de se remplir l'estomac sans fatigue. - (20) |
| jauge. s. f. Tranchée, ouverture faite dans un terrain d'après certaines dimensions, soit pour une plantation, soit pour une extraction d'ocre, de lateux, ou pour toute autre cause déterminée. – Régulateur d'une charrue, servant à donner au soc la profondeur voulue. (Sommecaise, Vilhers-Saint-Benoit). - (10) |
| jaugi : jauger - (57) |
| jaugouiller, v. a., bégayer, parler avec hésitation. - (11) |
| jaule. Gèle. - (01) |
| jaulée, s. f., gelée. - (14) |
| jauler, v. intr., geler. - (14) |
| jaullon. : Jaloux. - (06) |
| jaullou, jaloux. - (02) |
| jaume (pour chaume). s. m. Pied des céréales qui reste en terre après la moisson. (Joigny, Merry-la-Vallee, etc.). - (10) |
| jaume. n. f. - Chaume. - (42) |
| jaumer. v. a. et n. Arracher du chaume déchaumer un champ. - (10) |
| jaumeuse (pour chaumeuse). s. f. Arracheuse de chaume, femme qui déchaume un champ. A Joigny, ce terme est une injure Vois-la donc, c'te grande jaumeuse ! - (10) |
| jaunette. s. f. Petit escargot jaune. (Bessy. Lucy-sur-Cure). - (10) |
| jaunisson. Personne au teint pâle, maladif, jaune. - (12) |
| jaunô : un louis d'or - (46) |
| jaunotte : une pièce d'or (aussi champignon girolle) - (46) |
| jaunotte ; n. f. Girolle. - (53) |
| jaupiller (v.t.) : sauter, remuer, s'agiter - (50) |
| jaupiller : jouer. - (32) |
| jaupiller : sauter, s'agiter - (48) |
| jaupiller ou jôpiller. Remuer en jouant, agiter les membres gaiement, c'est à peu près le sens de gambiller dont jaupiller me semble être une corruption locale. - (12) |
| jaupiller, joupiller. Jouer, gigoter. - (49) |
| jaupiller, se dit surtout des enfants qui sautent et prennent leurs ébats sur la paille, le foin. - (27) |
| jaupiller, v. n. agiter, remuer en tous sens les bras ou les jambes. Cet enfant ne fait que « jaupiller » dans son lit. - (08) |
| jaupillou, ouse, adj. celui qui remue, qui s'agite, qui se débat, des pieds principalement. - (08) |
| jauter : (jô:tè - v. neutre) peiner, faire de grands efforts (cf. koesè, koeltè) - (45) |
| javâgner. v. - Rabâcher. (Lainsecq, selon M. Jossier) - (42) |
| javâgner. v. a. Reprendre, gronder, racointer à propos de choses insignifiantes et comme par habitude. (Lainsecq). - (10) |
| javale, javelle. - (16) |
| javaler, v. mettre les échalas en javelle à l'automne ; on "dépâle" les vignes pour éviter que l'échalas pourrisse l'hiver ; au printemps, on "empâle". - (38) |
| javalère, s. f., paquet de 33 paisseaux, en hiver. - (40) |
| javales, s. f. sarments coupés à la taille de la vigne, débris de l'émondage de la vigne. - (08) |
| javalis. s. m. Hangar. (Annay-la-Côte). - (10) |
| javalle, j'valle, jivalle. s. f. Javelle. (Sacy). - (10) |
| javéles (tomber en), loc. Se dit d'un objet formé de douves et entouré de cercles (tonneau, cuvier, baquet, etc.), et qui, par suite de sécheresse, se disjoint et laisse tomber ses planchettes de côté et d'autre. (V. Givéle.) - (14) |
| javelle : foin ou gerbes rassemblés en tas bien faits, esthétiques (en somme !) et pratiques, suivant des canons précis d'exécution. Les gerbes : plusieurs posées sur le sol - toujours un même nombre - verticalement en cercle, épis en haut + une gerbe posée sur le dessus et penchée pour l'écoulement de l'eau de pluie (puisque la récolte n'était pas engrangée nécessairement au fur et à mesure). - (58) |
| javelle, s. f., ce qui tombe avec un coup de faulx. - (40) |
| javelle, s.f. javelle, échalas mis en tas sur deux piquets à l'automne dans les vignes pour passer l'hiver. - (38) |
| javelot, jaivelot, s. m. javelle ou petite gerbe de blé, de seigle, d'avoine, etc. - (08) |
| javillau, s. m. homme remuant et inconstant, qui ne peut demeurer en place. - (08) |
| javiller, v. n. être en mouvement, aller de côté et d'autre ; ne pas demeurer en repos. - (08) |
| Javotte. s. f. Abréviation de Geneviève. - (10) |
| javouiller. Parler en bredouillant. Au figuré : dire des bêtises. Ce verbe a signifié « remplir de liquide. » On dit encore dans certains pays « ouiller le vin, » c'est-à-dire remplir le tonneau... - (13) |
| javouiner. v. n. Se plaindre (Saint-Valérien). - (10) |
| javoulliat, adj. qui cause à tort et à travers. - (22) |
| javòyat, adj. qui cause à tort et à travers. - (24) |
| javoyer : bredouiller. - (29) |
| javoyer, v., aller et venir, sans beaucoup travailler. - (40) |
| jayat : s. m., geai. - (20) |
| jàye, s. f. touffe de jeunes arbres dans des bois. - (24) |
| jazeran. Collier tissu, brodé. - (01) |
| jàzeron, s. m., jaseran, chaîne de cou à mailles fines en or. Bijou de fondation, dont le nombre de rangs indiquait la fortune du ménage. - (14) |
| je : Je, pronom personnel, première personne du singulier : « Je sus » je suis. - Nous, comme sujet des verbes à la première personne du pluriel. « Je vins au marchi » : nous allons au marché. « Je vendangerins la semai-ne que vint » : nous vendangerons la semaine prochaine. - (19) |
| je : nous par substitution. Cette manière de prendre Je pour Nous, se rencontre dans « J’éti(o)ns, J’avi(o)ns…».Voir En. - (62) |
| je velai. Voilà… - (01) |
| je, dze. Joug ; appareil que l'on pose sur la tête des bœufs pour les atteler. - (49) |
| je, pr. pers., nous : « Voui, voui, j’la marions ; dans huit jôrs je fons la noce. » - (14) |
| je, se dit pour : nous, à la première personne du pluriel des verbes ; j’alon, nous allons ; j’feson, nous faisons. - (16) |
| jé. pron. pers. - Je : « Un yeuve de dix lives ! Jé l'ai ben approuché, mais il était trop loin pou' l'tirer ! » - (42) |
| Jean (Herbes de la Saint). Plantes consacrées qui servaient de préservatifs chez les Gaulois. Cette superstition s'est conservée jusqu'à notre époque. La veille de la Saint-Jean, avant le lever du soleil, les gens du Vernoy récoltaient des branches d'Enula et les joignaient aux boutons d’or et aux pâquerettes pour en faire des bouquets que l’on faisait bénir en les consacrant à Saint Jean et à Sainte Barbe, Ces fleurs séchées préservaient de la foudre, au moyen de cette incantation : « Saint Jean écoutez-nous, Saint Jean exaucez-nous, Saint Jean préservez-nous. Sainte Barbe, belle fleur, qui portez la croix du Sauveur ; si je le dis pendant trois fois, point la foudre ne tombera. » A Saint-Loup-de-la-Salle, on fait encore bénir des bouquets de l'herbe à Saint Roch. On dit en parlant d'un ragoût trop assaisonné : Te y ai don mis teutes les barbes de lai Saint Jean. - (13) |
| Jean Guillemain : Jeu enfantin. Les joueurs forment un cercle autour duquel l'un d'eux tourne en tenant à la main son « Jean Guillemain », sorte de bâton très court, il chantonne en même temps : « Je porte man Jean Guillemain daré chez quéquin, je le porte, je le tins » à un moment donné il laisse tomber son bâton. Celui derrière qui il est tombé doit se hâter de ramasser l'objet avec lequel il poursuit le premier joueur jusqu'à ce qu'il lui ait fait prendre place dans le cercle et alors celui qui a ramassé le bâton, porte à son tour le Jean Guillemain. - (19) |
| jean-fillette. n. m. - Petit garçon qui joue à la poupée. Autre sens : adolescent tardif, encore immature. (F.P. Chapat, p.l24) - (42) |
| jean-foutre. Individu sans valeur morale, qui se moque de tout. - (49) |
| jean-jean. n. m. - Pas malin, innocent. À la Renaissance, un Jean (du nom propre Jean ou Jehan) désignait par dérision un mari trompé ; faire Jean voulait dire rendre cocu ; un jeannot était un niais, un sot. Le mot poyaudin jean-jean a gardé ce dernier sens, que le français familier a également utilisé pendant la première moitié du XXe siècle. - (42) |
| Jean-ne : Jeanne. « La Jean-ne-Marie ». - (19) |
| Jeannet, Jeannot, Jeannin, diminutif de Jean. L’usage dans nos campagnes est de mettre l'article devant le nom de baptême. Nous disons donc le Jeannot, le Jeannet. - (08) |
| jean-néte, s. f., narcisse, fleur. - (14) |
| Jean-nette : Jeannette ou Jeanne. - Jonquille, narcissa jonquilla. « In boquet de jean-nettes » un bouquet de jonquilles. - (19) |
| jean-nette : jonquille. - (52) |
| jeannette : petite fleur - (39) |
| Jeannette, diminutif du nom de Jeanne. On prononce Jean-nett'. - (08) |
| jeannette, jean'nette : marguerite, jonquille - (48) |
| jeannette. Narcisse, fleur. - (03) |
| jeannette. Narcisse. - (49) |
| jeanvoyau. s. m. Petit entonnoir en ferblanc. (Migé). - (10) |
| jèbin, jabot. - (26) |
| jècre et mècre (jeter). Etre en colère et crier très haut. Origine inconnue. - (12) |
| jèdien : un jardin - aûto d'lè méson è 1’jèdien, autour de la maison, il y a le jardin - si yèveû l'temps i eût’reû les herbes dans 1’jèdien, si j'avais le temps, j'enlèverais les herbes du jardin - (46) |
| jédin : jardin. (B. T IV) - D - (25) |
| jèfe. Très acide. S'emploie pour qualifier un fruit âpre, non mûr. - (49) |
| jege : cage à poussins. (MM. T IV) - A - (25) |
| jegneux. s. m. Sorte de tasse, de petit pot, ainsi appelé parce qu'il avait sans doute la contenance d'une ancienne mesure dite en bas latin jalogueus, et qu'en Franche-Comté, suivant l'abbé Corblel, on appelle encore aujourd'hui jaloignie. - (10) |
| jègueucher : (jègœché - v. neutre.) voir zaguer. - (45) |
| jei. Déjà… - (01) |
| jeinguai : donner un coup de pied (en parlant d'un animal). - (33) |
| jèmas : jamais. - (52) |
| jémas : jamais. - (33) |
| jement : Jument. - (19) |
| jement, jument. - (05) |
| jemma (adverbe) : jamais. - (47) |
| jène, marc de raisin. - (16) |
| jènèrô, général d'armée ou singulier et au pluriel. - (16) |
| jénesse. n. f. - Jeunesse. - (42) |
| jérbe : s. f. gerbe . - (21) |
| jèrle : (jêrl' - subst. f.) sorte de récipient, formé par la moitié d'un tonneau partagé en deux dans le sens de la largeur. - (45) |
| jers (pour jars). s. m. Mâle de l'oie. - (10) |
| jers. n. m. - Jars. - (42) |
| jerter. v. - Couvrir, s'accoupler, en parlant d'une volaille. - (42) |
| jerter. v. a. et n. Saillir, en parlant du jars. (Villiers-Saint-Benoît). - (10) |
| jertie. s. f. Jarretière. (Girolle). - (10) |
| Jerusalam. Jérusalem… - (01) |
| jésillon, jasier. Jabot. - (49) |
| jession. Aiguillon, dard de certains insectes, de l'abeille, de la guêpe, par exemple. On appelle aussi par erreur la langue des serpents « jession ». - (49) |
| Jesu. Jésus. - (01) |
| jésui. n. m. - Jésuite. - (42) |
| jésuitre, s. m. jésuite. Membre de l'illustre compagnie de Jésus. - (08) |
| jésus, n.m. rectum du porc ; gros saucisson coulé dans le rectum. - (65) |
| Jésus-Cri : Jésus-Christ - (57) |
| jetailai - jeter là ; généralement pour se débarrasser. Il faut voir à l'article Ch'tailai, qui est l'abréviation pour la prononciation. - (18) |
| jetan : Essaim. « In jetan de môches » : un essaim d'abeilles. - (19) |
| jeter (lai mouche jeute) : essaimer (les abeilles essaiment) - (48) |
| jeter : essaimer. IV, p. 25 - (23) |
| jeter : Jeter. « Jeter à bas » : renverser, abattre. « Ol a jaté à bas san noué » : il a abattu son noyer. - Essaimer, en parlant des abeilles. - (19) |
| jeter : j'tè (i jeut') (v.trans.) jeter, à tous les sens du terme français. (v.neutre) en parlant d'une ruche, produire un essaim, essaimer. - (45) |
| jeter : v. a., lancer. Jeter une gifle. Des chèvres me poursuivaient en me jetant des coups de corne. - (20) |
| jeter, v. n. essaimer. S’emploie absolument en parlant d'un essaim d'abeilles qui sort de la ruche : « lé moches an j'té ôjedeu. » - (08) |
| jeter, v., essaimer (en parlant d’une ruche). - (40) |
| jeter. S'emploie pour essaimer. On dit : « nos mouches à miel ont jeté ». - (49) |
| jetoir, jetoire : s. m. et f., seilleton muni d'un long manche, qu'on emploie pour couler la lessive. - (20) |
| jeton (de mouches), s. m. essaim d'abeilles. - (24) |
| jeton (n.m.) : essaim (aussi j’ton, a.fr., geton = essaim) - (50) |
| jeton, jiton. s. m. Essaim d'abeilles qui abandonne la ruche-mère. - (10) |
| jeton, n.m. essaim. - (65) |
| jetteler, v. a. jeter çà et là. - (08) |
| jetti. Jetai , jetas, jeta. - (01) |
| jeu - poulailler. On n'emploie plus guère ce mot à présent on dit plutôt Genier, plutôt encore Juché. Voyez donc là les exemples. - (18) |
| jeu (pour ju, juc, jou). s. m. Juchoir ou perchent les volailles. (Vassy-sousPisy). - (10) |
| jeu : s. m., corps gras destiné à donner du jeu aux outils. Boîte de jeu, récipient contenant ce corps gras. - (20) |
| jeu, jour. - (05) |
| jeu, lieu du poulailler où se juchent les poules. - (16) |
| jeu, poulailler. - (28) |
| jeù, s. m., jeu. Prononciation très ouverte ; comme feù. - (14) |
| jeù. Jeu, jeux. - (01) |
| jeubi : Mal fait, mal arrangé. « T'y as bien mau jeubi » : tu as bien mal fait cela. - (19) |
| jeûç’e, zûç’e : perchoir des poules la nuit dans le poulailler - (37) |
| jeuche, jeuce (n.f.) : perchoir pour les volailles (aussi jeusse) - (50) |
| jeuche, s. f. juchoir, perche ou grillage sur lequel se perchent les volailles. « Zeuce. » - (08) |
| jeûché, zûç’é : perché - (37) |
| jeucher, jeucer (v.t., v.pr.) : se jeucher : se percher pour les volailles - (50) |
| jeucher, v. n. jucher. Se dit des volailles qui sont sur le juchoir et d'une personne qui est placée sur un lieu élevé. - (08) |
| Jeudaïcle. Judaïque. - (01) |
| jeue. adj. Se dit par contraction et par suite d'une mauvaise prononciation pour juste, qui, dans certains cas, signifie, égal, uni. Les blés sont joues, c'est-à-dire les épis sont d'égale hauteur, sont de même niveau. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| jeumâ, adv. de temps. Jamais, en aucun temps. - (08) |
| jeumâs : jamais - (48) |
| jeun : n. m. Juin. - (53) |
| jeunasse : Jeunesse. « Si jeunasse savait, si veillasse pouyait ». - (19) |
| jeûne (on) : jeune - (57) |
| jeune : adj., court, insuffisant. Au jeu de cartes ; « Je coupe ! — Un peu jeune ; je surcoupe. » - (20) |
| jeune, n.f. marc de raisin. - (65) |
| jeuner, v. a. manquer de..., être privé de... « a jeune » le bois, le linge, etc., pour il manque de bois, de linge, etc. - (08) |
| jeûnesse (na) : jeunesse - (57) |
| jeûn-ner, v. intr., manquer de... : « L'pauv' ! Sa fonne li fait jeùn-ner l’pain. O b'sogne portant prou ! » Pour la prononciation pourrait s'écrire jun-ner, comme un. - (14) |
| jeuns. : (Dial.), du latin jejunus. – Estre jeuns signifie être à jeun. - (06) |
| jeûr, s. m., le jour. - (40) |
| jeurai : jurer. - (33) |
| jeuré : v. t. et v. i. Jurer. - (53) |
| jeurée foué (mai), loc. ma foi jurée : « mai gran jeurée foué » est la parole d'honneur du Morvandeau. - (08) |
| jeurement, s. m. juron, blasphème. (Voir : jeuron.) - (08) |
| jeùrement, s. m., jurement, juron, serment. - (14) |
| jeurer : jurer - (57) |
| jeurer : jurer - (48) |
| jeurer : Jurer, blasphémer, prononcer des jurons. - Disputer, réprimander. « Ol a train-né à la foire, o s'est fait jeurer par sa fane ». - (19) |
| jeurer, v. a. jurer, émettre un serment ou un juron. « zeurer. » - (08) |
| jeùrer, v. intr., jurer, faire serment. - (14) |
| jeurer, v., jurer. - (40) |
| jeùriau, et jeùroû, s. m., jureur, qui a l'habitude de jurer. - (14) |
| jeurmer, v. n. germer, projeter le germe hors de terre. - (08) |
| jeurmon, s. m. germe d'une plante. Usité principalement en parlant des germes de la pomme de terre qui pousse dans les caves ou « crôs. » « zeurmon. » - (08) |
| jeuron (on) : juron - (57) |
| jeuron, s. m. juron. (Voir : jeurement.) - (08) |
| jeurou, ouse, adj. jureur, celui qui jure, qui blasphème. « zeurou, zeuroure. » - (08) |
| jeusqu' : loc. conj. Jusque. - (53) |
| jeùsqu'à temps que, loc., jusqu'à ce que : « Te resteras iqui jeùsquà temps que j'aie moudu mon grain. » - (14) |
| jeusqu'ai l'heure, loc. jusqu'alors, jusqu'à présent. Cet enfant est sage « jeusqu'ai l'heure » - (08) |
| jeusqu'ai tant que, loc. jusqu'à ce que. - (08) |
| jeusque - jusque. - A sont ailai jeusqu'à bout du champ, su les bords de lai rivère. - Al ant étai jeusque vé le réservoir de Chazilley. - (18) |
| jeûsque : Jusque. « Si an ne le revaillait pas o deurait jeûsqu'au mède » : si on ne le réveillait pas il dormirait jusqu'à midi. - (19) |
| jeusque, jusque ; jeusk'ai kan ? jusqu'à quand ? - (16) |
| jeusque, jusque. - (38) |
| jeûsque, prép., jusque. - (14) |
| jeusque. Jusque. Plusieurs disent « jeuque », mais jeusque, employé par nos anciens poètes bourguignons les plus célèbres, est beaucoup meilleur. - (01) |
| jeusse (nom féminin) : poulailler. - (47) |
| jeussé : perché. - (33) |
| jeusse : perchoir dans le poulailler. - (33) |
| jeusser : se percher. - (59) |
| jeûste : Juste. « La jeûstice n'est pas tojo jeûste » : la justice n'est pas infaillible. « Je va te racanter cen au pu jeûste » : je vais te raconter cela aussi exactement que possible. - (19) |
| jeûste, adj., juste, d'accord. - (14) |
| jeuste. Juste, justes. - (01) |
| jeusteman. Justement. - (01) |
| jeûstement, adv., justement, exactement. - (14) |
| jeûstice : Justice. - (19) |
| jeute, s. f. auge que l'on met dans la crèche des bêtes à cornes ou des chevaux pour leur donner une nourriture particulière ; petite mangeoire. - (08) |
| jeux pron. pers. Eux, elles. - (63) |
| jèvais : la javelle : une brassée de céréales (3 javelles font une gerbe et 5 gerbes font une maillette) - (46) |
| jevale : Javelle. « Dépôchine no de torner les jevales padant qu'i fâ chaud» : dépêchons nous de retourner les javelles pendant qu'il fait beau temps. - Petit fagot de sarment. « La jevale de la cûe » : petite javelle de sarment qu'on place au fond de la cuve, devant l'orifice par lequel doit sortir le liquide afin d'empêcher que le marc se mêle au vin. - (19) |
| jevale, s. f. petite javelle de sarments entortillés ensemble. Verbe enjevaler, mettre en « jevales ». - (24) |
| jevale, s. f. petite javelle de sarments entortillés ensemble. Verbe : enjevalé, mettre en « jevales ». - (22) |
| jevalère : Javelle, autre forme de jevale. - (19) |
| jevalire, f. javelle de blé. - (24) |
| jevalire, s. f. javelle de blé. - (22) |
| jévalle : javelle. (B. T IV) - D - (25) |
| jevalle : s. f., javelle, gerbe, faisceau de sarments provenant de la taille de la vigne. - (20) |
| jèvèle, javelle. - (26) |
| jevreu : givre. - (29) |
| jéyan : géant, colosse. - (29) |
| jiarde, djarde. Dartre. - (49) |
| jiccle. Petite seringue des enfants faite en sureau, diminutif jiclote. - (03) |
| jicle, s. f., petite seringue en sureau, qui sert d'amusette aux enfants. - (14) |
| jiclée, s. f., jet, jaillissement : « En passant proche de la voiture à Jacot, j'tai étrapé eùne jiclée !!... » - (14) |
| jicler ou gicler (C.-d., Br., Chal.), giller {Y.), jighier (Morv.).- Jaillir vivement, sauter, partir brusquement, s'éclipser. S'applique surtout aux liquides lancés par un jet. Corruption du mot jaillir ou onomatopée. Littré ne parle que du giclet, plante dont le nom vient, dit-il, du vieux français gicler, qui signifie lancer, et vient luimême de jaculari, (lancer, jeter) ou de ejaculare, même sens. Le patois peut donc revendiquer le verbe jicler. - (15) |
| jicler, v. tr., lancer de l'eau, de la boue, etc., et v. intr. jaillir avec force d'un jet d'eau, d'une petite seringue, d'une flaque. Très imitatif. - (14) |
| jicler. Se dit d'un liquide comprimé qui s'échappe. On l’emploie au figuré dans le sens de s'élancer. Le ieuve ai jiclé entremi mes jambes... Un jiclot est une éclaboussure. Probablement du latin ejaculare. - (13) |
| jicleròte, s. f., petite seringue que se façonnent les enfants, à l'aide d'un tube de sureau et de tampons de chanvre humide. Comme cet instrument ne peut avoir le luxe d'une douille, on pratique un trou près du haut du tube, qui par ce moyen aspire très bien l'eau et la renvoie encore mieux. - (14) |
| jiclette. Seringue fabriquée avec un morceau de branche de sureau vidée de sa moelle. Elle est armée d'un piston et sert à lancer de l'eau. - (49) |
| jiclo’ : hoquet. - (62) |
| jiclot : targette. (PSS. T II) - B - (25) |
| jiclòt, s. m., et jiclòte, s. f., petit jet d'eau, ce que peut envoyer une jicle, ou un corps frappant dans l'eau ; tache de boue qu'on se fait en marchant, ou qu'envoie la roue d'une voiture, le sabot d'un cheval, etc. - (14) |
| jiclot, s. m., hoquet. - (40) |
| jicloure, seringue faite avec du bois de sureau vidé de sa moelle. - (27) |
| jighi', s. f. tube creusé dans le bois du sureau et dont les enfants se servent pour lancer de l'eau. C’est en un mot une petite seringue. - (08) |
| jighier, v. a. éjaculer, lancer avec force. « zicler. » - (08) |
| jighiot, s. m. jet d'eau forcée, éclaboussure. - (08) |
| jigler, v.; gicler, pour parler de l'eau. Cette eau m’a jiglé à la figure ; a rn’ai jiglé au nez son gremaix de gueude (son pépin de courge). - (07) |
| jiglotte, n. fém. ; petite seringue en bois que font les enfants pour s'amuser. - (07) |
| jiglure, n. fém. ; éclat d'eau qui a jiglé. - (07) |
| jigogné : v. t. Remuer. - (53) |
| jigouègner (zigouègner) : secouer en gigotant - (39) |
| jigouégner : lutiner. - (32) |
| jigougner (zigougner) : secouer en gigotant - (39) |
| jijié, jiji, jabot de la volaille et des oiseaux. - (16) |
| jikié, jiklé, lancer de l'eau avec une pompe. Jikio d'borbe, tache de boue sur un vêtement. - (16) |
| jiller - giyer : le mot viendrait-il de gigue (la danse) ? Bondir brusquement. Se sauver très rapidement. Ex : "L'gamin à la Simone, il est ben toût jillé à la pêche !" (Ben toût = bientôt, c'est à dire qu'il n'atermoie pas). - (58) |
| jin : juin - (51) |
| jin : juin - (57) |
| jin : juin - (39) |
| jînée : petite pluie brève - (39) |
| jingneu : encombrer, gêner. - (29) |
| jingo (d’), jingoua (d’) : (d' jingô:, d' jin:gouâ: - loc. adv.) de travers, sans ordre ni méthode. So: tô d jin:gô: "ce n'est ni fait ni à faire". - (45) |
| jingouâ : n. m. Travers (de). - (53) |
| jinguè : sauter, verbe qui sous-entend beaucoup de mouvements (aussi r’junguè) - (46) |
| jingué : v. t. Donner un coup de pied. - (53) |
| jinguer - enraigi : chahuter - (57) |
| jinguer (verbe) : ruer. - (47) |
| jinguer : donner des coups de pied (animal) - (48) |
| jinguer : regimber. - (31) |
| jinguer : sauter - (44) |
| jinguer. Ruer en parlant des bovins. Fig. Lancer des coups de pied. - (49) |
| jinguer. v. n. et n. Danser, sauter, ruer en donnant des coups de pied de côté et par derrière. - (10) |
| jiolées : réjouissances précédant les noces. V, p. 39 et p. 42 - (23) |
| jiolees. s. f. plur. fêtes et réjouissances qui accompagnent un mariage. On prononce en beaucoup de lieux « ziolées » par le changement ordinaire du j en z. - (08) |
| jipe. : Sarrau ou blaude. (Voir au mot gipai.) - (06) |
| jiper, s'amuser (en parlant des animaux jeunes). - (26) |
| jirlicouée : 1 n. f. Grand nombre de gens. - 2 n. f. Grosse nichée. - (53) |
| jirliquouée : bande de jeunes. (RDM. T II) - B - (25) |
| jiter. v. - Jeter. - (42) |
| jiter. v. a. Jeter. - (10) |
| jityeu : gicler. - (29) |
| j'lée (na) : gelée - (57) |
| jlée : v. geler. - (21) |
| j'lée bi'illainche (na) : gelée blanche - (57) |
| j'lée : n. f. Gelée. - (53) |
| jlée, gelée. - (26) |
| j'ler : geler - (57) |
| j'lesses (des) : gesses - (57) |
| jman, jument. - (16) |
| j'ment : jument. Animal de trait par excellence. Plus rapide que le bœuf, abandonné. Plus répandue que le cheval (le ch'va) dans les écuries, pour la raison que la jument poulinait, apportait donc une plus-value utile dans le cheptel. Plus docile, aussi, en général. - (58) |
| j'ment, s. f., jument. Le paysan n'emploie jamais l’u dans ce mot : « Ma j'ment. » - (14) |
| j'mouilli : gémir - (57) |
| jnâbe : genévrier - (48) |
| j'net (on) : genêt - (57) |
| j'néte : genêt - (48) |
| j'nou (on) - geonet (on) : genou - (57) |
| j'nouillére (na) : genouillère - (57) |
| jo (on) : jour - (57) |
| jo : Jour. « Le jo de l'an ». « La pique du jo » : l'aube. « I fâ jo » : il fait clair. - (19) |
| jô : un jour - i â pâssè vu jo è lè clinique, j'ai passé huit jours à la clinique - (46) |
| jo d'l'an (on) : jour de l'an - (57) |
| jo d'lan : le jour de l'an - lè goutte de jô d'lan, la goutte du jour de l'an - (46) |
| jo : s. m. jour. - (21) |
| jo, s. f. joue : « i é mau ai lai jô », j'ai mal à la joue. - (08) |
| jô, s. m. joug, appareil qui sert à l'attelage des bœufs. Plusieurs prononcent « joû. » - (08) |
| jo, s.m. jour. - (38) |
| jo. Coq pour la reproduction. - (49) |
| job n.m. Tête, uniquement dans l'expression "monter le job", tromper, mentir. - (63) |
| jobette. s. Petite fille. (Saint-Florentin). - (10) |
| jochou : s. m. perchoir “juchoir”. - (21) |
| joco (ou joko) : n. m. Pain long de 400 grammes. - (53) |
| Jodain. Jourdain, fleuve de Judée. - (01) |
| jodrais, jourale, adj. joueur, qui aime à s'amuser : un garçon « jourais », une fille « jourale. » - (08) |
| jôe : Joue. « O li a fait mimi su les deux jôes » : il l'a embrassé sur les deux joues. « 0l a les jôes c'ment les fasses d'in paure homme » : il a les joues pleines ; c'est qu'à Mancey on considérait qu'un pauvre homme était plus gras qu'un riche, s'il était pauvre c'est qu'il ne travaillait pas tandis que le riche était toujours à l'ouvrage et n'avait jamais le temps de se reposer ; c'est encore vrai actuellement. - (19) |
| jôë, s. f., joue, que notre jeunesse montre si souvent fraîche et rosée. - (14) |
| jœt’e, s. f. rejet d'un arbre ou d'un arbuste. - (22) |
| jœt'e, s. f. rejet d'un arbre ou d'un arbuste. - (24) |
| jœunesse : n. f. Jeunesse. - (53) |
| joeuyioeu, s. m. et adj. joueur. - (22) |
| joguai - attendre avec impatience, pendant plus ou moins longtemps. - I ons joguai ai lai porte à moins ine heure de temps, tant le service se fait mau. - Vos vouaisras que vos jogueras su lai pliaice in temps infini. - Joguez, joguons ! dit lai chanson ; pour vos c'â aissez bon. - (18) |
| joguer : (joguè - v. trans.) donner à qqun de violents coups de tête. Se dit surtout des vaches, des veaux, qui secombattent front à front. - (45) |
| joguer. Croquer le marmot, se morfondre en attendant. Etym. inconnue. - (12) |
| joguignai - passer long temps après une chose sans guère en rien faire. C'est une autre forme de gigognai. – Voyez donc ce mot. - (18) |
| joie. Comment admettre que ce mot vienne directement du latin gaudium, lorsque le mot gaulois conservé par les Bretons est joa (Le Gon.), satisfaction, plaisir ? ... - (02) |
| joignu, du verbe joindre ; j'on joignu lë deû bou, nous sommes arrivés à vivre, sans rien devoir, au moyen d'économies. - (16) |
| joignu, part, de joinre, joint, réuni. - (14) |
| joinde - joindre. - Ces deux pliainches ne joindant pâ si bein qu'â joindaint, vais. - En sero bon, pou le froid qu'an fait, que lai porte joindeusse mieux. - (18) |
| joindre (se), v. r. se ranger : voici une voiture, joins-toi. - (24) |
| joindre (se), v. r. se ranger : voici une voiture, joins-toi. - (22) |
| joindu, part, passé du verbe joindre que nous prononçons joinre. Joint, assemblé, réuni. - (08) |
| joing, zoing (vieux). Morceau de panne de porc, conservé dans une enveloppe formée d'un fragment du péritoine. Le « vieux joing » était un remède empirique qui passait pour guérir certaines maladies de la peau : engelures, enflures, inflammations, etc. - (49) |
| joinre, v. tr., joindre, réunir. - (14) |
| jointeillaige, s. m. action de jointoyer ; le produit même du travail. - (08) |
| jointeiller, v. a. jointoyer, remplir de mortier les joints des pierres. - (08) |
| joints, s. m. ados que la charrue forme dans un champ : labourer « à joints », sillonner un champ de raies qui se relèvent en billons. - (08) |
| joiÿoû, adj., joyeux. - (14) |
| joké, jogué, se morfondre à attendre. - (16) |
| joli (ne pas faire), faire joli (ironiquement) : Ioc, manifester vivement du dépit, de la contrariété, de la colère. - (20) |
| Joli : nom de bœuf. III, p. 30-o - (23) |
| Jôli, Jôuli. Nom de bœuf qu'on réserve souvent au plus bel animal de l'étable. - (08) |
| jôli. Ce mot n'a pas le même sens qu'en français, car il signifie, dans le bourguignon, content de, et il a absolument cette même signification dans la langue romane d'Oïl. (Voir Roquefort.) ... - (02) |
| jôli. : Ce mot du patois n'avait pas la même acception qu'en français. Il voulait dire : content, satisfait de. L'expression joliôte (joyeuse) est un diminutif. - (06) |
| jôliai. Joliet, joliets. - (01) |
| jôlie. Jolie. - (01) |
| joliment, adv., beaucoup, exagérément : « Dis donc, ô n'é pas gein-né; quand on li a offri des dragées, ôl en a joliment pris ! » - (14) |
| jôliote. Joliette. On dit aussi en bourguignon jôliette, mais jôliôte est plus élégant… - (01) |
| jolite : adj. f., jolie. - (20) |
| jolite, et joulie, adj., analogue de gentite. - (14) |
| jompiller : sauter, s'agiter (voir : jaupiller). - (56) |
| jona : s. m. genou. - (21) |
| jonceu. n. f. - Endroit humide où prolifèrent les joncs. - (42) |
| jonchi : joncher - (57) |
| jondre, vt. joindre. - (17) |
| jonée, journée. - (26) |
| jonée. Journée, journées. - (01) |
| jonesse, s. f. jeunesse : « eune jonesse », une jeune fille. - (08) |
| jonfer, comprimer à demi sa colère, sa douleur, en gémissant. - (05) |
| jonfer, v. intr., occasionner une douleur sourde, que l'on comprime. On dit d'un mal de dents : « Ça m’jonfe. » - (14) |
| jonfer. On dit d'une douleur sourde aux dents, ça me jonfe, origine inconnue. - (03) |
| jonfler, v. intr., souffler, respirer, ronfler. Se dit en parlant d'une fiarde, d'un diable, d'une toupie. - (14) |
| jonfler. v. n. Ronfler. (Quenne). - (10) |
| jonier. Perchoir pour la volaille dans le poulailler. - (49) |
| jonnau, sm. journal. Journal, mesure de superficie. - (17) |
| jonnèe, sf. journée. - (17) |
| jono, journal. - (26) |
| jonquière, jontière (pour jonchère, joncière). s. f. Lieu humide où croissent des joncs. (Argentenay). - (10) |
| joper. v. n. Sauter pour s'amuser, en parlant des enfants. - (10) |
| jopillai - se remuer, agiter les membres, particulièrement en parlant des enfants. - Qué enfant ! al à tojeur ai jopillai. - T'é don quemant les petiots ?... te jopille tôjeur. - (18) |
| jopiller. Littéralement : jouer avec les pieds, jocari pedibus. An li ai fait prenre du café; a ne fait ran que jopiller dans son let. - (13) |
| joqua : corbeau. (MM. T IV) - A - (25) |
| joquer, v. ; donner un coup de corne. - (07) |
| joquet, jouquet, jouquiet. s. m. Hoquet. - (10) |
| joqueter : bringuebaler - (61) |
| joquot, hoquet - (36) |
| joquot, s. m. hoquet. - (08) |
| jor (en), loc. on dit que les poules sont « en jor » lorsqu'elles sont rentrées pour la nuit et perchées sur le juchoir - (08) |
| jor : jour - (48) |
| jor et jar. Adverbe affirmatif. I vourâs jor ben qu’al épauset lai Jean-nie. C'est l'abréviation d'un jurement qui est encore en usage : jour de Dieu !.. - (13) |
| jôr : n. m. Jour. - (53) |
| jor, jar, vraiment ; s’â jor bèn biâ ! c'est vraiment bien beau. - (16) |
| jor, jour. - (16) |
| jor, jour. Le peuple, en Bourgogne, ne dit pas l'autre jour, mais bien l'autre des jours... - (02) |
| jor, s. m. jour, lumière, espace de temps. « zôr. » - (08) |
| jòr, s. m., jour, clarté, lumière : « V’tu ben te l'ver, feignant ; y fait grand jòr. » — « Qué brusine ! I n'fait tant s'ment pas jòr pou lire. » - (14) |
| jor. Jour, jours. Au lieu de jor, on prononce quelquefois jo, ce qui a un petit air rustique qui ne déplait pas. Bon jo pour bonjour. - (01) |
| jor. : Jour. (Du latin diurnum, ou de l'italien giorno). -On dit en Bourgogne l'altre des jors, comme le provençal dit l' atrou das dzous. - (06) |
| joran : gros fagot. (SY. T II) - B - (25) |
| jordannai – commander à tort et à travers les uns d'un côté, les autres de l'autre. - Chez le Caillet en ne sait ai qui entende, to le monde jordanne ai lai fouai. - Quand vos nos é rencontrai a jordanno, qui ne me raipeule pu ce qu'à m'é dit. - (18) |
| jormain, jormaingne. s. et adj. Germain. Saint Jormain d'Auxerre. Frère jormain. Couhin jormaingne. - (10) |
| jormain. àdj.- Germain : un cousin jormain. - (42) |
| jormer : germer - (48) |
| jormer, v. germer. - (38) |
| jormon : germe - (48) |
| jornaïer, s. m. journalier, ouvrier qui travaille à la journée. - (08) |
| jornaillèze. s. m. Journalier. (Saint-Maurice-aux-Riches-IIommes). - (10) |
| jornau : journal. Mesure agraire, variable (~1/3 ha), égale à ce qui était labouré par un homme en 1 jour. Journée. - (62) |
| jôrnau : 1 n. m. Journal. - 2 Ce qu'un homme peut labourer dans une journée (113 d'ha environ). - (53) |
| jornau, s. m. journal, mesure agraire, étendue de terrain qu'on peut labourer dans un jour avec des bœufs. - (08) |
| jôrnau, s. m., journal. - (40) |
| jornë, journée de travail; ailé an jornë, aller travailler à la journée. - (16) |
| jorneau : journal (mesure agraire pour les champs valant 22 ares 85) - (48) |
| jorneau : 1/3 d'hectare. Ce qu'un homme pouvait labourer en une journée. - (33) |
| jornée (pour journée). s. f. Mesure agraire de convention, équivalant à l'étendue de terre ou de vigne qu'un homme peut cultiver dans sa journée. (Savigny-en-Terre-Plaine). - (10) |
| jornée : journée - (48) |
| jornée : Journée. « Eune balle jornée » : une journée de beau temps. « Cause à la jornée »: bavard qui parle tout le temps comme s'il était payé à la journée pour le faire. - (19) |
| jornée s. f. journée. - (21) |
| jôrnée : n. f. Journée. - (53) |
| jornée, s. f. journée, la durée d'un jour de travail et le salaire acquis par ce travail : aller en « jornée » ; travailler à la « jornée » ; gagner de bonnes « jornées » : - (08) |
| jòrnèe, s. f., journée : « La pauv'fille, alle va en jòrnée ; ma à n'gagne pas gros. » Indépendamment de jornée, nous avons journau. (V. ce dernier mot.) - (14) |
| jornée, s. f., journée, - (40) |
| jôrnée, s.f. journée. - (38) |
| jornée. n. f. - Journée. - (42) |
| jornô : un journal, soit 1/3 d'hectare de terre ou de prairie cultivée - (46) |
| jornô, journal, ancienne mesure agraire de trente-quatre ares vingt-quatre centiares. - (16) |
| jôs, pr. eux. - (24) |
| Josa, prénom, Joseph. - (38) |
| José : Joseph. - (19) |
| Jôsé, Joseph. - (16) |
| josé, jousé, apocope de joseph. - (08) |
| Josey : prénom. Joseph. - (53) |
| jostiser (se). : Se rendre justice. (Priviléges de Rouvre, 1215.) - (06) |
| jòt (à), jou (à), juc (à), loc. adv., juché. S'emploie en parlant des oiseaux qui sont sur le juchoir : « La poule ét à jòt. » - (14) |
| jòt, jou, juc, s. m., juchoir, perchoir. - (14) |
| joter, joûter, bégayer. - (05) |
| joter. Bégayer, en quelques lieux jouter. - (03) |
| jotter : bégayer - (57) |
| jou (à). Se dit des oiseaux qui sont juchés , nous disons jouchou pour juchoir. - (03) |
| jou (aller à), loc. aller se percher, pour les poules. - (22) |
| jou : le poulailler - (46) |
| jou : s. m. joug. - (21) |
| jou, juchoir. - (05) |
| jou, pr. pers., je. - (14) |
| jou, s. m. œil, organe de la vue; avoir du « mau es jous », avoir les yeux malades. - (08) |
| jou, sm. joug. - (17) |
| jou'. n. m.- Jour. - (42) |
| jouaie (n.f.) : joie - (50) |
| jouaîe (na) : joie - (57) |
| jouâiller : jouer bêtement - (37) |
| jouailler. v. - Jouer distraitement aux cartes, sans s'intéresser au jeu. - (42) |
| jouailler. v. n. Jouer sans cesse. - (10) |
| jouâillon : « petit » joueur - (37) |
| jouaillon : n. m. Individu qui joue mal mais pas tricheur. - (53) |
| jouaillon, jouasson. n. m. - Qui joue mal, distraitement, sans conviction. - (42) |
| jouaillon. s. et adj. m. Qui aime le jeu, qui joue continuellement ; se dit principalement des enfants. - (10) |
| jouasser. v. n. Jouer sans attention, tout de travers. - (10) |
| jouasson, jouassat. s. m. Qui joue mal, sans attention, tout de travers. - (10) |
| jouassou : petit joueur, se dit également d'un enfant qui aime jouer - (48) |
| jouassou : mauvais joueur. - (33) |
| jouayi, v. n. chanter et rire sur un ton aigu et bruyant. - (24) |
| joucher, v. intr., jucher, se hisser sur le perchoir. - (14) |
| jouchou (on) : juchoir - (57) |
| jouchou (on) : perchoir - (57) |
| jouchou : perchoir. (CH. T II) - S&L - (25) |
| jouchoû, s. m., juchoir. - (14) |
| joudri ou judru. Saucisson national fait de viande de porc et enveloppe dans le gros intestin de l'animal. (Oserai-je indiquer que frit dans l'huile avec de la crème fraiche et un filet de vinaigre, ce mets obtient tous les suffrages). - (12) |
| joudri, gros saucisson. - (27) |
| joudru. s. m. Le plus faible des oiseaux d'une nichée. (Mont-Saint-Sulpice). - (10) |
| joudu. adj. - Joufflu. - (42) |
| joudu. adj. Joufflu. (Puysaie). - (10) |
| jouè : voir u (œuf). - (21) |
| joue : voir pressoir. - (20) |
| jouée, s. f. joue. - (22) |
| jouée. n. f. - Joie. - (42) |
| jouement. Jeu. - (49) |
| Jouer de la musique, loc. redondante, jouer d'un instrument quelconque. - (14) |
| jouer : v. a. Faire jouer le télégraphe, télégraphier au moyen du télégraphe aérien de Chappe. S'est dit longtemps, par habitude, en parlant de la télégraphie électrique. - (20) |
| joueraie : quelqu'un qui aime jouer - (39) |
| jouerie, s. f., jeu, amusement: « L'feignant, ô n'ain-me que les joueries. » (V. Jeù.) - (14) |
| joueû, adj., joueur. - (14) |
| joueux. Joueur. - (49) |
| jouflard, adj., jouflu, rebondi des joues, bien nourri. - (14) |
| jouillou (on) : joueur - (57) |
| jouinée. s. f. Jointée, tout ce que les deux mains peuvent saisir et porter d'herbe, de paille ou de menu bois, en faisant le mouvement de les joindre, de les rapprocher l'une de l'autre. Par extension tout ce qu'une femme peut faire tenir et porter dans son tablier relevé. Une jouinée de coupiaux. Une jouinée d'harbe. Du latin junctio. - (10) |
| jouir : Se faire obéir. « Ses enfants sant bien seuts, alle n'en peut pas jouir » : ses enfants sont polissons, elle ne peut pas s'en faire obéir. - (19) |
| jouir de : loc, avoir de la tranquillité, de la satisfaction, du fait de quelqu'un ou de quelque chose. Ce ch'tit morveux, i faut toujours qu'i fasse du mal partout ; y a pas moyen d'en jouir. - (20) |
| joûler : émettre un son modulé en soufflant (le vent « joûle » sous la porte fermée) - (37) |
| jouli, adj. joli. - (17) |
| jouli, joli. - (16) |
| jouli, joli. - (26) |
| joulotte, s. f. petit joug auquel on attelle un seul bœuf : « ailé ai lai joulotte », travailler avec un seul bœuf attelé au petit joug. - (08) |
| jouœur : n. m. Joueur. - (53) |
| jouou - joueur. - C'â in jouou enraigé ; al y perd son temps et son airgent. - Vote gairson fréquente les jouou ; i vô le dis, al â foutu. - (18) |
| jouper : sauter - (37) |
| jouper : sauter à pieds joints. Ill, p. 61-n ; V, p. 3-7 - (23) |
| jouper : sauter - (39) |
| jouper, sauter - (36) |
| jouper, v. a. sauter à pieds joints. - (08) |
| jouper, v. intr., gambader, sauter. - (14) |
| jouper, zouper (v.t.) : sauter à pieds joints - (50) |
| joupillé : v. t. Sautiller. - (53) |
| joupiller : jouer en sautillant dans les jupes - (37) |
| joupiller : s'agiter - (44) |
| joupiller, jaupiller. Jouer. - (49) |
| joupiller, v. s'agiter joyeusement dans un berceau, en parlant du bébé. - (65) |
| jou-piller, v., s'agiter joyeusement dans le berceau. - (40) |
| jouquer. v. - Donner des coups de tête en parlant d'un enfant ou d'un animal qui tète. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| jouquer. v. n. Jucher ; monter, grimper. (Andryes, Parly). Du latin jugare. - (10) |
| jouquiaux. s. m. pl. Grosses joues, bien rouges, bien rebondies. - (10) |
| jouquoué. s. m. Juchoir. (Parly). - (10) |
| jour de l'an : s. m., etrennes du jour de l'an. Mon grand m'a donné un plein sac de gobilles pour mon jour de l'an. - (20) |
| jourelle : enfant qui aime le jeu, qui aime s'amuser. - (56) |
| Jourey : prénom : Joseph (ou Jousé). - (33) |
| jourie : s. f., bas-lat. joeria, lien, courroie à l’aide de laquelle on relie les deux cordés du joug. - (20) |
| journal : s. m., ancienne mesure de surface pour les terres, correspondant à ce qu'un homme peut labourer en un jour. Il contenait, à Mâcon comme à Dijon, 360 perches carrées de 9 pieds 1/2, c'est-à-dire 8 coupées 2/3, et valait 3i ares 284. - (20) |
| journal, n.m. mesure de superficie (de 17 à 34 ares). - (65) |
| journal. Mesure agraire qui variait selon les pays. A Beaune, le journal contenait trente-quatre ares vingt-huit centiares : une journée de laboureur. - (13) |
| journaliste : s. m., marchand de journaux. « Les braves femmes l'appelaient « le Journaliste ». C'était un marchand de journaux en gros. » (Nouvelliste, 28 janv. 1906). Nous avons entendu parfois appeler le journaliste « le marchand de mensonges ». - (20) |
| journau (ain) : (un) journal - (37) |
| journaû (on) : journal - (57) |
| journau : s. m., journal. - (20) |
| journau, et jornau, s. m., journal, feuille périodique. - (14) |
| journau, et jornau, s. m., journal, mesure agraire d'environ cinquante ares. Équivaut à peu près à ce qu'un homme peut labourer en un jour. - (14) |
| journau. Journal ; ancienne mesure de surface (dérivé de « jour », surface que l'on peut labourer en un jour). De même, on dit : « un chevau ». - (49) |
| journayé. n. m. - Journalier. - (42) |
| journées (Etre a ses) : loc, travailler à la journée. - (20) |
| joûro, celui qui se livre trop au jeu. - (16) |
| Joûsé (l’) : (le) Joseph - (37) |
| Jousé : Joseph - (48) |
| jouté. adj. - Alité. - (42) |
| joutée : 1 n. f. Poussée. - 2 n. f. Rasade. - (53) |
| joûter, v. intr., bégayer : « J'li dirai son fait sans joûter. » — « Quand ôl a qu'ét'chous' qui l'tracasse, ô ajoute, ô ajoute, qu'ô n'peut pu parler. » - (14) |
| joutrat. s. m. Vieux couteau. - (10) |
| jouû (n.m.) : joueur - (50) |
| jòyerat, s. m. et adj. joueur, qui aime à jouer. - (24) |
| Jôzai. Joseph. - (01) |
| j'té : v. t. Jeter. - (53) |
| j'té, jeter ; une plaie jette quand elle suppure. - (16) |
| j'ter – jeuter : essaimer - (57) |
| j'teu d'sort : jeteur de sort - (61) |
| jtièlé, jeter à terre ou dehors, par exemple, un mets gâté. - (16) |
| j'ton (on) : essaim - (57) |
| j'ton (on) : jeton - (57) |
| j'ton : essaim. IV, p. 25 - (23) |
| ju (aller a), loc. aller se percher, pour les poules. - (24) |
| ju (pour juc), jou (pour joue). s. m. Juchoir, pris ici pour poulailler ; c'est le contenu pour le contenant, la partie pour le tout. Le ju aux poules. Du latin jugum. - (10) |
| jû : Jeu. « Savoir tiri san éping'lle du jû » : savoir tirer son épingle du jeu. - (19) |
| jû : joug. - (32) |
| ju : poulailler. (F. T IV) - Y - (25) |
| ju : joug, pièce de bois pour atteler les bœufs ou les vaches. - (33) |
| ju, juerieau, jeu, joueur. - (05) |
| ju, pronom. Je. - (08) |
| jû, s.m., joug. - (40) |
| ju’illet : juillet - (57) |
| juaïllan: Joueur maladroit, qui ne sait pas jouer. - (19) |
| juan. Jouant. - (01) |
| juchai. : Placé au-dessus de quelque branchage. Jugum, en latin, signifie treillage. (Quich.) - (06) |
| juché - lieu où se couchent, où se perchent les poules. - Le juché â rempli de pôilles ; nos poules en sont dévorées. - Te dairas bein rempliaicer les bâtons du juché ; les poules n'y sont vraiment pâ solides. - En fau cueurrai le juché, ci empôyeune. - (18) |
| juché : perchoir (pour les volailles) - (48) |
| juche : poulailler - (48) |
| juché : poulailler. (RDC. T III) - A - (25) |
| juche : n. f. Maison des poules. - (53) |
| juché : v. i. Percher. - (53) |
| juche, gelinière, poulailler. - (27) |
| juché, placé haut... - (02) |
| jucher, v., percher, mettre en haut. - (40) |
| juchi : jucher - (57) |
| juchi : Verbe, jucher, percher. « La pouleille nare est juchie su la meureille » : la poule noire est perchée sur le mur. - Nom, perchoir. « La né les pouleilles dremant su leu juchi » : la nuit les poules dorment sur leur perchoir. - (19) |
| juchö, sm. perchoir. - (17) |
| juchot, jussot. s. m. Jus de fumier, purin. - (10) |
| juchou, juchoir de poule. - (05) |
| judiciére : judiciaire - (57) |
| judru, .sm. cœcum de porc. Grosse andouille faite avec ce viscère. Grosse femme courte. - (17) |
| judru, gros saucisson de ménage. - (16) |
| judru, s. m., gros saucisson de porc. - (40) |
| judru, s. sorte de gros saucisson de ménage ; on dit aussi "Jésus". - (38) |
| judru. Gros saucisson de ménage. Jondu signifie joufflu, dans le patois de l’Yonne. Chez les Morvandeaux, un gidron est une grosse andouille. - (13) |
| jue : jouer. - (29) |
| jué, jouer ; é jue, il joue ; é juén, ils jouaient. - (16) |
| jue, juai, juaint – divers temps du verbe Jouer. - Moi i n'eume pas jue és cairtes. - Mon enfant, en fait trop froid pour ailai juai es gobilles. - Oh, dis don, qu'à juaint don bein de lai flûte et pu du viôlon ! - (18) |
| jué, vn. jouer. Jouer (du violon), voir mené. - (17) |
| jue. Jeu. Jouer aux broches c'est tirer à la courte paille ; pider, c'est mesurer de l'oeil ; chiquer, c'est lancer la bille ; frouiller, c'est tricher ; frouillon ou frouilleur, tricheur, etc.; pour joueur nous disons juriau. - (03) |
| jue. Joue, jouent. - (01) |
| jué. Jouer, joué, jouez. - (01) |
| juein. Jouions, jouiez, jouaient. - (01) |
| juer : Jouer. « La treue se jue dave des tarleuches ». - (19) |
| jueraint, jûrot - divers temps du verbe Jouer. - A jueraint tote lai neu si an velo les souffri. - C'â in homme ai jue jueusqu'ai son derré so… quée passion ! - (18) |
| jueu. Joueur, joueurs. - (01) |
| jugeòte, s. f., jugement, sens droit, intelligence : « Que v'tu qu'ô fasse ? n'a pas por deux yards de jugeòte ! » - (14) |
| jugi : juger - (57) |
| jugi : Juger. « I ne faut pas jugi le mande su la mine ». - (19) |
| jugi. Jugeai, jugeas, jugea. - (01) |
| jugne : s. f. génisse. - (21) |
| jui -jouilli : jouer - (57) |
| jui, s. m. juif. - (08) |
| jûi, v. intr., jouir. - (14) |
| jui, v. n. jouir : « i veu jui d' mon bin », je veux être en jouissance de mon bien. - (08) |
| Jui. Juif, Juifs. Les paysans des environs de Paris prononcent de même Jui… - (01) |
| juiet : n. m. Juillet. - (53) |
| ju'illet : juillet - (48) |
| jüillet n.m. Juillet. - (63) |
| juillöt, sm. juillet. - (17) |
| juindre : Joindre. « Via bien des an-nées que les vignerans trapissant pa juindre les deux bouts » : voilà bien des années pendant lesquelles les vignerons ont peine à joindre les deux bouts. - (19) |
| juinguer : détendre nerveusement les mains et les pieds en étant couché dans le lit - (37) |
| juinguer partout : courir le guilledou - (37) |
| juint : Joint. « T'as troué le juint » : tu as trouvé le joint, tu as trouvé la solution. - (19) |
| juissance, s. f. jouissance. - (08) |
| jûissement, s. m., jouissance. - (14) |
| jujeau, s. m. jus de fumier, purin. Environs d'Avallon. - (08) |
| jullè : juillet - (46) |
| jumalles (pour jumelles) : boutons de manchettes. Jumelles est employé par les architectes et charpentiers en condition de parallélisme ou de symétrie. - (62) |
| jumalles, s.f. montants d'un pressoir à arbre :on dit aussi les counailles. - (38) |
| jun : juin - (48) |
| jun n.m. Juin. - (63) |
| jun, juin. - (16) |
| jun, s. m. juin, le sixième mois de l'année. - (08) |
| juniére : poulailler - (48) |
| jun-ner, jeûner. - (26) |
| jupe-ronde - blouse. - Note homme é aichetai ai lai fouaire ine jupe-ronde qu'à in pecho trop grande. - (18) |
| jurer (se faire) : se faire disputer bruyamment. Ex : "T’as déchiré ta culotte, té vas t’fée jurer par ta mée". - (58) |
| jurer (verbe) : réprimander. - (47) |
| jurer. v. - Gronder : « Nadette alle est en r'tard, a va s'jai'e jurer pa' la grand-mée ! » - (42) |
| juriau : Joueur qui a la passion du jeu. « La borse du juriau n'a pas faute de sarriau » : la bourse du joueur n'a pas besoin de cordon. - (19) |
| jurié encontre. : (Dial.), conjuré contre. - Cette locution a un avantage sur la forme française, parce que dans conjuré contre la préposition fait pléonasme. - (06) |
| jus : (nm) café - (35) |
| jûs n.m. Café. On dit aussi câfé. Mais les jus de fruits sont des dzûs. - (63) |
| jusse : perchoir des poules et des dindes - (61) |
| jusse, juste. s. m. Caraco, justaucorps. - (10) |
| justice (Faire) : loc, tuer (un porc). C'est autour de Noël qu'on fait justice au Mossieu. - (20) |
| justucru, sm. mystificateur. - (17) |
| juye, s. f. joue. - (24) |
| Ju'yèn, Julien. - (16) |
| Juyien (l’) : (le) Julien - (37) |
| jvalé : s. m. javelle. - (21) |
| j'valler. v. n. Javeler, faire des javelles. - (10) |
| j'von r'ssi : je vais déjeuner (à midi). (MLV. T IV) - B - (25) |
| k, en patois, le k et le c se sont écrits souvent l'un pour l'autre. - (16) |
| kaibeuche, caboche, tête d'enfant qui n'apprend rien. - (16) |
| kairner. (voir : quairyier.) - (08) |
| kairnet. (voir : quairnet.) - (08) |
| kairniau. (voir : quairniau.) - (08) |
| kairteille. (voir : quairteille.) - (08) |
| kakouïe ou, plutôt, kakouille, kakoure. s.f. Hanneton. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| kaloté : noyer. (LCSS. T IV) - S&L - (25) |
| kanbeûle, bosse, gonflement provenant de coups reçus, de piqûre d'insectes. - (16) |
| kankoye (f), hanneton. - (26) |
| kanse; faire kanse est faire semblant de... - (16) |
| kapo : mot masculin désignant une coiffure portée par les maraîchères, en toile et carton, destinée à protéger le visage du soleil et du vent - (46) |
| kâr ; regarder de kâr : regarder quelqu'un de mauvais oeil, parce qu'on ne l'aime pas. - (16) |
| karênme, Carême ; iai karênme, le temps du Carême. - (16) |
| karmantran, carnaval grotesquoment vêtu ; se dit aussi d'une personne dont les vêtements sont mal ordonnancés ou dont la figure est malpropre. - (16) |
| karpiner : ramper, gesticuler vainement en étant à terre - (39) |
| karre. (voir : quarre.) - (08) |
| katëcime, catéchisme. - (16) |
| kâziman, quasi, presque. - (16) |
| kèché, cacher ; faire une chose en kèchote, en évitant d’être vu ; kèchote se dit aussi d'une chose cachée ou qu'on ne veut pas faire connaître. - (16) |
| kécher, cacher. - (26) |
| kécher, keucher. v. a. Cacher. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| kéchotte, keuchotte. s. f. Cachette. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| kéchottoux. s. m. Cachottier. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| kéfille, cosse. - (26) |
| kège, cage. - (16) |
| kége. s. f. Cage. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| kéhi. (voir : quéhi.) - (08) |
| keille. (voir : queille.) - (08) |
| keillerotte. (voir : queillerotte.) - (08) |
| kèilli : s. m. lait caillé. - (21) |
| kéinre : cuire. (CLF. T II) - D - (25) |
| kék, quelque ; kékun, quelqu'un. - (16) |
| kékchinze : quelque chose. (PLS. T II) - D - (25) |
| kel'male : coulemelle (lépiote élevée) - (48) |
| kelon, le dernier d'une couvée, plus chétif. - (26) |
| kelot. Le plus jeune, le plus petit de la nichée. - (49) |
| kenelin, cornouiller. - (26) |
| keper, couper. - (26) |
| kepoue d'boe, bûcheron. - (26) |
| kéque, kiéque : n. m. Couvercle. - (53) |
| kérâme. s. m. Carême. – Semailles de printemps. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| kérier. Crier. - (49) |
| kérier. v. n. Crier, pleurer en criant. - (10) |
| kerkoualle. s. m. Hanneton. (Etivey). - (10) |
| kermillèze. s. f. Crémaillère. (Sacy). - (10) |
| kerpetons (à). À croupetons. - (49) |
| kerpion. Croupion. - (49) |
| kerre. (voir : querre.) - (08) |
| kersch : Kirsch. « In ptiet varre de kersch » : un petit verre de kirsch. - (19) |
| kersi. adj. - Trop brûlé, en parlant d'un plat préparé. (Sougères-En-Puisaye) - (42) |
| kersi. adj. Sale. (Etais). - (10) |
| kèsse, poêle. - (26) |
| kesse. (voir : quesse.) - (08) |
| ketillon, cotillon. - (26) |
| kéton : grumeau dans une pâte mal cuite. (VDS. T IV) - VdS - (25) |
| keton, coton. - (26) |
| keû, keute : (p.passé) cuit (e) ; prêt (e) ; malin (igne) - (35) |
| keu. (voir : queu.) - (08) |
| keuch'e : s . m. couvercle. - (21) |
| keûche n.f. Cuisse. - (63) |
| keuche, keuchot. Sommet d'un arbre. On dit souvent : « la fine keuche » pour la partie la plus élevée de l'arbre. - (49) |
| keuche. (voir : queuche.] - (08) |
| keuche. Cuisse. - (49) |
| keuchener. (voir : queuchener.) - (08) |
| keuchin (par corruption de coussin). s. m. Oreiller. (Fléys). - (10) |
| keûchin n.m. Coussin. - (63) |
| keuchon n.f. Cuisson. - (63) |
| keudre. (voir : queudre.) - (08) |
| keugne. (voir : queugne.) - (08) |
| keular. (voir : queular.) - (08) |
| keûlât : (nm) petit dernier d’une nichée (ou d'une famille) - (35) |
| keûlat n.m. (du v. fr. culot, dernier né d'une couvée). Petit cochon chétif, dernier né d'une famille. - (63) |
| keûle n.f. (de culot). Souche, bûche. - (63) |
| keulin. (voir : queulin.) - (08) |
| keulle (f), tronc d'arbre. - (26) |
| keulle : tronc d'arbre. - (66) |
| keulot : n. f. Le plus petit. - (53) |
| keume, combe. - (26) |
| keume, comme ; keume k'è s'trêton ! comme ils se traitent ! en parlant de gens qui s'insultent, - (16) |
| keume. (voir : queume.] - (08) |
| keumintte, combotte. - (26) |
| keunô, mélange de crème, d'oeufs, étendu sur une pâte. - (16) |
| keupé, couper. - (16) |
| keuper : cracher - (48) |
| keuper. (voir : queuper.) - (08) |
| keûraillon n.m. (de culot). Ce qu'on peut curer au fond de la marmite ou de la casserole, reste de nourriture. - (63) |
| keurche : s. f. crèche. - (21) |
| keurchot : trou pratiqué dans le plancher du fenil au-dessus de la crèche. - (21) |
| keurde : (nf) courge, potiron - (35) |
| keûrde n.f. Courge. - (63) |
| keûré : (nm) curé - (35) |
| keûre n.f. Cure (logement du curé). - (63) |
| keûré n.m. Curé. - (63) |
| keûre v. Cuire. Ôl est pas bié keût, chtu-là, i lu manque un fagot! Cette analogie avec le pain cuit au four s'utilise encore pour parler d'un individu qui n'est pas très fûté. Les-haricots qu'keuillant, y'est p'chtu sa ? Les haricots qui cuisent, c'est pour ce soir ? - (63) |
| keûre, cuire ; l’pèn â keu, le pain est cuit ; keute, au féminin ; eune poume keute, une pointue cuite. On dit aussi: eune keute de pèn, pour une fournée de pain. - (16) |
| keure. (voir : queure.) - (08) |
| keureille. (voir : queureille.) - (08) |
| keûrer : (vb) nettoyer l’étable, curer - (35) |
| keurer v. Curer, nettoyer. - (63) |
| keurer. (voir : queurer.) - (08) |
| keurette n.f. Ustensile pour curer les sabots, grattoir. - (63) |
| keurier. (voir : queurier.) - (08) |
| keuriou. (voir : queuriou.) - (08) |
| keurneille. (voir : queurneille.) - (08) |
| keurni : terni. (VDS. T IV) - VdS - (25) |
| keurni. (voir : queurni.) - (08) |
| keurnôle, cornouille; keurnôlé, cornouiller. - (16) |
| keurotte : outil pour nettoyer le soc de la charrue - (48) |
| keurotte : pied, jambe - (48) |
| keurpe. (voir : queurpe.) - (08) |
| keurpeton (à) Accroupi. - (63) |
| keurpoton. (voir : queurpoton.) - (08) |
| keurre, cueillir. - (26) |
| keurson, cresson, - (16) |
| keurtaller v. Crotter, en parlant de la chèvre, du mouton ou du lapin. Voir cataller. - (63) |
| keurtelle n.f. Crotte de lapin, de chèvre. Voir catalle. - (63) |
| keurter v. (p.ê. de cureter) Perdre au jeu, se faire battre, se faire plumer. - (63) |
| keurtien, chrétien. - (16) |
| keurtijaud, keurtijaude adj. De Curtil (Keurtil). - (63) |
| Keurtil Lieu-dit : Curtil. Du latin cohortile, cour. Latin populaire curtis. Dès le milieu du VIIIème s. on nomme courtil l'enclos contenant la maison, la cour et le jardin. - (63) |
| keurtou adj. 1. Crotté. 2. Avare. - (63) |
| keurtou(ze) : (n.adj) crotté(e) ; avare - (35) |
| keûrtse n.f. Crèche, mangeoire. Voir crètse. - (63) |
| keurvaisse. (voir : queurvaisse.) - (08) |
| keusance. (voir : queusance.) - (08) |
| keusine n.f. Cuisine. - (63) |
| keusse : (nf) cuisse - (35) |
| keusse, cuisse. - (16) |
| keut, keute. Cuit. - (49) |
| keute. (voir : queute.) - (08) |
| keuter, heurter. - (26) |
| keuton, sm. grumeau, boulette de farine mal délayée. - (17) |
| keutre. (voir : queutre.) - (08) |
| keuvé, vn. couver. - (17) |
| keuvercle, keuvötje, sm. couvercle. - (17) |
| keuvö, sm. couvet, [vx f. couvoir], chaufferette ancienne. - (17) |
| keûvri : (vb) couvrir ; couvert - (35) |
| keuvri, vt. couvrir ; pp. keuvri. - (17) |
| keûyé, cueillir. - (16) |
| keûyi: (vb) cueillir - (35) |
| keûyire : (nf) cuiller - (35) |
| kever, couver. - (26) |
| kéye, caille. - (16) |
| kéyé, lait caillé, coagulé. - (16) |
| kéyo, caillot, petite masse de sang coagulé. - (16) |
| kéyou, caillou. - (16) |
| keyoue, cueilloir. - (26) |
| kéziau. s. m. Membiane desséché de l'estomac de veau, dont on fait la présure. (Saint-Florentin). Du latin caseus. - (10) |
| kharistaler : glaner, récupérer. Écrit ainsi (faute de mieux) car on pense que le sens de charité et de quête apparaît mieux dans ce grec ancien. « Joseph ô allé kharistaler d’l’harbe pou’ les lapins ». - (62) |
| kherpoint : voir guîchard - (23) |
| khiakhia : grive. III, p. 26-h - (23) |
| khiconkère : jouet en forme de moulin. IV, p. 23-5 - (23) |
| khieukhio : rustaud. III, p. 26-h - (23) |
| kiac-bitou : n. m. Fromage blanc. - (53) |
| kiacotè : v. i. Bavarder. - (53) |
| kiai. (voir : quiai.) - (08) |
| kiaie : portillon - (48) |
| kiaisson. (voir : quiaisson.) - (08) |
| kiakia. s. m. Oiseau du genre étourneau, qui s'abat par volées sur les vignes à l'époque de la maturité. – Voyez tiatia. - (10) |
| kiampoing. s. m. Poignée. Un kiampoing de chanvre. (Etais). – Voyez clampoing. - (10) |
| kianponner. (voir : quianponner.) - (08) |
| kiaper. (voir : quiaper.) - (08) |
| kiaque (eune) : claque (une) - (48) |
| kiaque (un) : chapeau claque - (48) |
| kiaque (un) : fromage (un) - (48) |
| kiaque. s. f. Claque. (Fléys). - (10) |
| kiaquer. (voir : quiaquer.) - (08) |
| kiaquer. v. a. et m. Claquer. - (10) |
| kiâr : adj. Clair - (53) |
| kiar. (voir : quiar.) - (08) |
| kiâre : v. t. Eclairer. - (53) |
| kiarté. (voir : quiarté.) - (08) |
| kiâsse : classe - (48) |
| kiau. (voir : quiau.) - (08) |
| kiauler : voir tiauler - (23) |
| kiavolée : n. f. Grippe, maladie assez sérieuse. - (53) |
| kibye : s. m. crible du vannoir. - (21) |
| kié ou quié. s. f. Clé. (Etais). - (10) |
| kièche : cloche - (48) |
| kiécle. (voir : quiécle.) - (08) |
| kiédot. (voir : quiédot.) - (08) |
| kièke : couvercle - (48) |
| kièque. s. m. Couvercle. (Etais). - (10) |
| kièr : clair - (48) |
| kiérâme. (voir : quiérâme.) - (08) |
| kiérer : clairer (feu) - (48) |
| kiérer. (voir : quiérer.) - (08) |
| kieu : clou. (REP T IV) - D - (25) |
| kieulé : cloué. (REP T IV) - D - (25) |
| kîgnèche n.f. 1. Criailleuse. 2. Chanteuse "à voix". - (63) |
| kîgni v. Couiner. - (63) |
| kikiliquoue : chant du coq - (39) |
| kilo (Au) : loc adv., le double. « Ah! c'est pas lourd c't' affaire ; y en a combien ? quatre livres ? — Oui, au kilo. » — « Combien donc qu'y a de Mâcon à Romanêche ? Deux lieues ? — Oui, au kilo. » - (20) |
| kilo : Kilogramme. « Compter au kilo » : compter double ; le kilogramme étant le double de la livre, seule unité de poids longtemps employée à la campagne ; compter au kilo c'est compter double. « T'en as pas causu prou (presque assez) grand gormand ! Oh ! pa eune dozaine de chataignes que je mige ! (que je mange). Oué! eune dozaine au kilo ». - (19) |
| kingne : mauvais chiens - propre à rien. (SB. T IV) - C - (25) |
| kinke, cigale. - (16) |
| kinkerniau. (voir : quinquerniau.) - (08) |
| kinrre, cuire. - (26) |
| kinson, pinson. - (16) |
| kinson. (voir : quinson.) - (08) |
| kinsse, cuisse. - (26) |
| kioc (phonétique) : Quoi interrogatif. Ex : "Kioc té fésé don' chez nout' vouésine, vieux couraquier ?" - (58) |
| kioché. (voir : quioché.) - (08) |
| kioche. n. f. - Cloche. - (42) |
| kioche. s. f. Cloche. - (10) |
| kiocher. n. m - Clocher - (42) |
| kiocher. s. m. Clocher. - (10) |
| kiochette. n. f. - Clochette. - (42) |
| kiochette. s. f. Petite cloche. - (10) |
| kioker. (voir : quioquer.) - (08) |
| kiok'sé. (voir : quioq'sé.) - (08) |
| kion. s. m. Contraction de clayon, petite claie, porte à claire-voie. (Maligny). - (10) |
| kiope : chien (mauvais chien) - (48) |
| kiope : cigarette - (48) |
| kioque : cloque - (48) |
| kioquè : le cri de la poule qui appelle ses poussins - (46) |
| kioquer : émettre un gloussement (par la poule) pour appeler ses poussins - (48) |
| kiorde. (voir : quiorde.) - (08) |
| kiou : clou - (48) |
| kiou : furoncle - (48) |
| kiou. (voir : quiou.) - (08) |
| kiou. Clou. - (49) |
| kiou. n. m. - Clou. - (42) |
| kiou. s. m. Clou, furoncle. - (10) |
| kiouler clouer - (48) |
| kiouler. (voir : quiouler.) - (08) |
| kiouler. v. - Clouer. - (42) |
| kiouler. v. a. Clouer. - (10) |
| kiue. (voir : quiue.) - (08) |
| kîvè : cribler - y èlon kîvè les p'tiots oignons, nous allons cribler les petits oignons - (46) |
| kive. s. m. Crible. (Fléys). - (10) |
| kiver, cribler. - (26) |
| kleuko : n. m. Ramequin, petit récipient allant au four. - (53) |
| kmouèchi : v. commencer. - (21) |
| knillotou : quelqu'un qui n'avance pas dans son travail, on dit également leurot et gueumou - (46) |
| kno, merisier dont les fruits servent à faire un excellent ratafia. - (16) |
| ko : s. m. cour. - (21) |
| koloté : noyer. (RDT. T III) - B - (25) |
| kouillez-vô : taisez-vous. (RDF. T III) - A - (25) |
| kra : s. f. 1° tartre ; 2° monticule déboisé. - (21) |
| kri (aller). Chercher : « aller kri ». - (49) |
| kri, vt. quérir, chercher. - (17) |
| kri, quérir ; va l'kri, va lui dire de venir ; dans chercher quelqu'un, chercher n'a pas le sens de : chercher une chose perdue. - (16) |
| k'ri. (voir : qu'ri.) - (08) |
| krikri (onomatopée), grillon (insecte). - (16) |
| krotou, celui qui conserve sur sa figure des traces de vérole. - (16) |
| kroumir, n.m. boisson faite avec de l'eau chaude et du sucre, sur les marques de raisin, les prunelles ou les poires. - (65) |
| kroumir, s. m., boisson faite avec de l'eau chaude et du sucre, sur les marcs de raisin, les prunelles ou les poires. - (40) |
| kseigne. s. m. Contraction du cousseigne, pour coussin, oreiller. (Menades). - (10) |
| kuaie : barrière - (39) |
| kukue : ciguë. (BEP. T II) - D - (25) |
| kuvoté, celui qui a perdu au jeu tout ce qu'il possédait d'argent. - (16) |
| kùye, s. f. queue. - (22) |
| kyake, claque. - (16) |
| kyanchi v. Dessécher, ratatiner. - (63) |
| kyâsse n.f. Classe. - (63) |
| kyâssement n.m. Classement. - (63) |
| kyâsseu n. Classeur. - (63) |
| kyâssi v. Classer. - (63) |
| kyassificâchon n.f. Classification. - (63) |
| kyè n. et adj. Clair. Alle woit pyus kyè. - (63) |
| kyé n.f. Clé. - (63) |
| kyë, clé. - (16) |
| kyèché : (subst. m.) clocher. - (45) |
| kyèché : clocher. (B. T IV) - D - (25) |
| kyëné, incliner, pencher une chose ; s'kyëné, se pencher. - (16) |
| kyèr, clair; é fé kyèr, il commence à faire jour ; o kyèr de lai leune, à la clarté de la lune. - (16) |
| kyeu, clou. - (16) |
| kyeuil : clou. (LEP. T IV) - D - (25) |
| kyigni v. Cligner. - (63) |
| kyignotant n.m. Clignotant. - (63) |
| kyin d'yeu n.m. Clin d'oeil. - (63) |
| kyoche, cloche ; kyoché, clocher. Le nom de la cloche est une onomatopée, parce qu'il indique les coups que la cloche reçoit de son battant. En anglo-saxon, la cloche se dit claege qui a de l'analogie avec nos mots claque et claquer, contenant l'idée de bruit. Le glas, son funèbre de la cloche, a sans doute, comme le nom suivant, la même étymologie. - (16) |
| kyokè, cloquer, se dit du gloussement d'une poule qui demande à couver. - (16) |
| kyôtse n.f. Cloche. - (63) |
| kyôtsi n.m. Clocher. - (63) |
| kyou n.m. Clou. - (63) |
| kyoûter v. Clouer. - (63) |
| kyrie. Ce mot veut dire ici litanies, parce qu*elles commencent toutes, suivant la prononciation vulgaire, par « Kyrie eleison », mots grecs que l’Eglise latine a conservés… - (01) |
| l - euphonique, se met quelquefois devant certains mots commençant par une voyelle, pour rendre plus coulante la prononciation. - D'aipré ce que vos é dit lai Luison ile l'â venue me trouvai ai ce maitin, cair ile l'é aivu po que vos n'aint pâ compris. - (18) |
| l’ : art. déf. Le. - (53) |
| l’en-haut : sur le grenier à foin - (37) |
| l’ké, lequel ? lë ké ? lesquels ? - (16) |
| l’maice : limace - (43) |
| l’maiçon : limaçon - (43) |
| l’maisse : n. f. Limace. - (53) |
| l’mon : limon - (43) |
| l’oûte dâ-coûté : l’autre côté - (37) |
| l’vant (le) : l’est (où se lève le soleil) - (37) |
| l’vée : digue. C’est la levée servant souvent de route (surélevée), certains diront « chaussée d’étang ». - (62) |
| l’voù : où - (37) |
| lâ (du) : lard - (57) |
| la (là) (Etre) : Ioc, être dans un état stationnaire. « Dites donc, comm' donc qu' va la mère Jeannette à c' matin ? — Eh ben!... Vous savez... Elle est là... » En 1916 : « Qu'est-ce que vous dites de la guerre ? — Ben quoi... c'est là... » . labourer : v. a., travailler, malmener, dénigrer. Elle laboure toutes ses amies quand elles ne sont pas là, et puis quand elle les voit elle leur saute au cou. - (20) |
| lâ : Lard. « J'ins miji eune bonne sope au lâ » : nous avons mangé une bonne soupe au lard. « In ban lâ » : un porc bon à mettre au saloir. Dans cette locution on prend la partie pour le tout. - (19) |
| la : L'article « la » s'emploie devant les prénoms féminins tandis que « le » ne s'emploie qu'exceptionnellement devant les prénoms masculins. « La Louise, la Françoise ». - (19) |
| la : Lé, terme de couture, morceau d'étoffe de toute la largeur de la pièce. « I li afallu deux las d'indienne pa fare san c’eutillan (cotillon) ». - (19) |
| lâ : Lier. « Lâ des gearbes » : lier des gerbes. « Lâ les bûs » : lier les bœufs, les atteler au joug. - (19) |
| lâ : las, fatigué. Ol o lâ : il est fatigué. - (33) |
| la celle, pr. dém., celle-là. - (14) |
| lâ don ! - bien ; je suis content ; c'est assez. - Vos m'aiportez l'airgent, lâ don ! - Voiqui ine meuseure d'orge, voiqui le sai de treufes, voiqui ine botte de foin… lâ don. - Lâ don, voiqui qui ai bein fini ! - (18) |
| La lieue carrée de Dijon et de Mâcon valait 23 kilomètres carrés 741783 mètres carrés. - (20) |
| la même que dans le mot français "béchevet" (de bes- venu du latin bis- + chevet). - (45) |
| la vou (là voû) : Ioc. Voir voù. - (20) |
| la vou ? : où ? à quel endroit ?. « La vou qu’ô va ? » : Où va-t-il ? - (62) |
| la vou don'. loc. - Où donc. « La vou don' qu'est passé l'chien ? » - (42) |
| la vou. loc. conj. - Où. « L'Andrée la vou qu'alle est partie ? » - (42) |
| la voù. Pour là où, et pour où Ex. : « Là vou donc que vous allez, Mame Chavansot ? Je vais à l'Arquebuse, la voù que mon mari m'attend. » - (12) |
| lâ, lard. - (16) |
| là, s.m. lard. - (38) |
| lââs : adj. Las, fatigué. - (53) |
| laâvan, loc. adv. là-bas, au loin : « al ô laâvan», il est là-bas, au loin, il est parti. (voir : aiuan.) - (08) |
| laâvant : adv. Là-bas. - (53) |
| labâ ! indique un lieu éloigné, même élevé. - (16) |
| laberei. Laboureur, laboureurs. - (01) |
| labô : (nm) labour - (35) |
| labô n.m. Labour. - (63) |
| labo. Labour. Jachère, dans ce cas on dit : « une terre en labo ». - (49) |
| laboïer. v. a. Labourer. (Menades). - (10) |
| laboïeux. s. m. Laboureur, (lbid.). - (10) |
| labopin. Aubépine. - (49) |
| labor : labour - (43) |
| labôr, s. m., labour. - (14) |
| labôrage, s. m., labourage. - (14) |
| laboratouaîre (on) : laboratoire - (57) |
| laborer : labourer - (43) |
| laborer : labourer - (51) |
| laborer : labourer - (57) |
| labòrer, v. tr., labourer. - (14) |
| laborer. Labourer. - (49) |
| labòreu, s. m., laboureur. - (14) |
| laboreux, labouéreux. s. m. Laboureur. (Chigy, Etivey). - (10) |
| labori : (vb) labourer - (35) |
| labori à rgueu, rgüer v. Labourer en faisant des sillons adossés, en opposition. - (63) |
| laborî n.m. Laboureur. - (63) |
| labori v. Labourer. - (63) |
| labori, laborou : (nm) laboureur - (35) |
| laboria (na) : labour - (57) |
| laborou (on) : laboureur - (57) |
| laborou : laboureur - (43) |
| labouère. s. m. Labour. - (10) |
| labouérége. s. m. Labourage. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| labouérer : labourer - (48) |
| labouérer : labourer - (39) |
| labouérer. v. a. Labourer. (Etivey, Sainl-Germain-des-Champs). - (10) |
| labouéroû : laboureur - (48) |
| labourer. : (Dial). Ce verbe, dans le dialecte employé par saint Bernard, signifie se livrer au travail, comme le verbe latin laborare dont il émane. Ce même mot n'a été spécialement appliqué à la culture de la terre que beaucoup plus tard. On disait auparavant areir, arer (du latin arare). - (06) |
| labourey, laboureur. - (16) |
| labourier, laboureur. - (27) |
| labourin : laboureur. (PLS. T II) - D - (25) |
| labourin, laboureur. - (26) |
| labourrou : laboureur - (39) |
| labredàye*, adj. étourdi, distrait. - (22) |
| labri - nom ordinaire des chiens de bergers, de pâtre quelconque. - I vos procurerai in bon labri. - Aipeule le labri et pu vai en champ tot de suite. - Tau, labri ! tau ! tau !... veins mon chien. - (18) |
| lâcer (v.t.) : lâcher - (50) |
| lacette : s. f., ganse, galon de laine ou de soie qui sert à border les vêtements ; soutache, lacet étroit en fil, en coton ou en soie, que l'on applique sur une étoffe pour l'orner. - (20) |
| laché, vt. laisser. - (17) |
| lâcher (v.) : laisser. Ne pas confondre avec "faire sortir" - (50) |
| lâcher (verbe) : mener les animaux aux prés. - (47) |
| lâcher : laisser. - (66) |
| lâcher de l'iau, loc., uriner. J'ai entendu souvent les paysans d'une localité voisine dire : « Faire de l'iau. » - (14) |
| lâcher, laisser. - (26) |
| lâcher, v. a. « lâcher » le bétail, pour faire sortir les animaux de leurs étables et les mettre en liberté dans les pâturages. - (08) |
| lachetai. Lâcbelé, lâchetés. Se mettre cinq contre un c'est une grande lâcheté, et de là, en bourguignon, « faire lai lachetaitai », c'est commettre le pécbé de mollesse. - (01) |
| lâchi : Lâcher, détacher, cesser de retenir. « Y est temps de lâchi les vaiches ». - (19) |
| lâchi : Lécher. « Ol a fait lâchi san assiètte à san chin ». - « A lâche da » : parcimonieusement. « Y est bin sovent qu'o n'a pas le sou, san père ne li en donne ren qu'à lâche da ». - (19) |
| lacie - lassie, même prononciation : grenier où l'on entrepose le foin, ou les gerbes avant le battage. Souvent constituée d'un plancher ou plus simplement de lattes espacées. - (58) |
| lacis. : Réseau de fil ou de soie très fin, interdit aux servantes par édit somptuaire de la municipalité de Dijon en 1580. - (06) |
| laçòt, s. m,, lacet, à l'usage des corsets, et aussi filet pour prendre certain gibier. - (14) |
| laçot. s. m. Lacet. ( Domecy-sur-le-Vault]. Du latin laqueus. - (10) |
| laddeu, adj. louangeur, celui qui fait des compliments un peu à tort et à travers. - (08) |
| lade : plante chélidoine (herbe aux verrues). - (33) |
| ladié, vt. larder. - (17) |
| Ladre : diminutif de Lazare - (48) |
| ladre : adj., atteint d'insensibilité cutanée. Celte insensibilité, si remarquable dans la forme anesthéslque de la lèpre, avait une grande importance diagnostique au moyen âge, temps où l'on soumettait les personnes suspectes à une épreuve dite d'insensibilité. - (20) |
| Lâdre, nom d'homme. Lazare. - (08) |
| ladre. adj. - Mou, lambin, pas nerveux (Sougères-en-Puisaye). Le ladre du Moyen-Âge était un lépreux, puis un mendiant ; au XVIIe siècle, il devint un personnage avare ou insensible. L'usage poyaudin l'affaiblit encore davantage en ne désignant qu'une personne sans vivacité. - (42) |
| ladre. adj. Insensible à la douleur physique ; sans doute parce que les ladres ou lépreux avaient le tact émoussé. - (10) |
| ladri, lardi. n. m. - Mésange. - (42) |
| ladri. s. m. Mésange. (Lainsecq). – Petit enfant vif et mignon. (Perreuse). - (10) |
| lagne : Longue perche, branche de taillis qui vient d'être abattue. « Ol a ésu dans sa pa de beu in ban chai de lagnes » : il a eu dans son lot de bois un bon char de branches de taillis. - (19) |
| lago : (lago - subst. m.) purin. - (45) |
| lago, purin. - (28) |
| lagô, s. m. creux rempli d'eau ; flaque, écoulement de purin ou d'eaux pluviales. - (08) |
| lago, petite flaque d'eau bourbeuse. - (16) |
| lago. Flaque d'eau. Italien lago, lac. - (03) |
| lagocher, v. n. répandre de l'eau pour laver, laver sans cesse, tripoter dans l'eau en lavant. - (08) |
| lagochie, s. f. se dit de toute souillure sur une nappe, sauce, vin ou autre chose liquide répandue avec malpropreté. - (08) |
| lagosser, v. tr., laver, mais mal : « V'là du joli linge, ma fi ! y é prou lagossé. » - (14) |
| lagot : flaque d’eau. - (62) |
| lagot : purin (jus de fumier). Lagot de fémé. - (33) |
| lagot : un trou de purin ou d'eau sale - (39) |
| lagot, laguier, pièce d'eau, lavoir. - (05) |
| lagot, laigot : purin, eau sale - (48) |
| lagot, n. masc. ; eau d'égout du bétail, purin. - (07) |
| lagòt, s. m., lavoir, petite pièce d'eau, flaque. - (14) |
| lagot, s. m., lisier du porc. - (40) |
| lagot, s.m, creux d'eau. - (38) |
| lagot. Egout, flaque d'eau. Il serait plus rationnel d'écrire l’agot, car la racine de ce mot parait être aigue... - (13) |
| lagouri : mot masculin désignant de l'eau renversée sur le sol et qui gêne - (46) |
| laguerée, s. f. une petite quantité de liquide : une « laguerée » devin, d'eau : « beillé-m'en eune laguerée », donnez-m'en une gorgée. (voir : lâgo.) - (08) |
| lagueuchi : Laver sommairement dans de l'eau plus ou moins propre. « Ce linge est bin mau lavé ; ol est lagueuchi ». - (19) |
| lagueut : Flaque d'eau. « La sarvante a varsé sa saille (a renversé son seau), y a fait in lagueut dans la maijan ». - (19) |
| laguot,lagô (n.m.) : creux rempli d'eau (de Chambure écrit : lagô) - (50) |
| lai - la ; là. - I ons étai to ai lai messe ; le pôre vieux â restai to sou pour gairdai. - Voiqui que vos raiportez les utis… mettez-les lai. - (18) |
| lai (art.fém.sing.) : la - (50) |
| lai (de), de là. - (05) |
| lai : la - (37) |
| lai : là - (48) |
| lai : ma (« y’ot dâs confiteûres faisues pair lai fonne ») - (37) |
| lai ceu (pron.dém.) : celle - (50) |
| Lai Fouairée : n. pr. La Forêt, hameau d'Épinac. - (53) |
| Lai Gairenne : n. pr. La Garenne, quartier d'Épinac. - (53) |
| lai main pourte érivage, la main apporte ce qui assaisonne, c'est-à-dire l'aisance dans la vie. - (38) |
| Lai Prée : n. pr. La Prée, lieu-dit aux environs d'Épinac. - (53) |
| lai qu'al ô ? loc. où est-il ? où cela ? cette locution se décompose ainsi : là que il est ? - (08) |
| lai r'cipe : exp. Terme minier pour dire qu'il reste du boisage. - (53) |
| lai : 1 art. déf. La. - 2 adv. Là, ici. - (53) |
| lai : la - (39) |
| lai, adv. démonst. là par opposition avec ici. quelques parties de la région ajoutent une désinence parasite : « c'te fon-n'-iaite », cette femme-là. - (08) |
| lai, art. et adv., la, là. Plus usité dans la Côte-d'Or. - (14) |
| lai, elle, à la fin d'une phrase; s'â lai, c'est elle. - (16) |
| lai, lai longe a l’gigot : expression que l'on dit à quelqu'un qui n’en finit pas de se préparer (t'eus lai longe a l'gigot). - (38) |
| lai. La, article féminin, ou Ià adverbe local. C’est auati du lait, lac. - (01) |
| lai. : (Dial et pat.), là adv. et la art. fém. ; le patois dit lai vou et le dialecte lai où. - (06) |
| laibôr. s. m. labour, culture de la terre par la charrue. - (08) |
| laibouéraige, s. m. labourage, action de labourer, de cultiver la terre. - (08) |
| laibouérer, v. a. labourer, cultiver la terre. - (08) |
| laibouérou, s. m. laboureur, celui qui travaille la terre avec la charrue. - (08) |
| laibourieu, euse, adj. laborieux, celui qui aime le travail. - (08) |
| laibourö, sm. laboureur. - (17) |
| laicé, vt. lacer. - (17) |
| laîche n.f. Refus (herbe dédaignée par les bêtes). - (63) |
| laiché : v. t. et v. pr. Laisser. - (53) |
| laiché, laicheussaint, laichot - divers temps du verbe Laisser. - Vos laicherâ lai charrue le long de lai meurée. - Mon père velo qui laicheussaint ce petiot bout qui pou demain. - Si ne m'étâ portant pâ trouvai lâvan â laicho lai porte euvrie tote lai neu. - (18) |
| laicher (v.t.) : laisser - (50) |
| laicher : laisser - (48) |
| laicher : laisser. - (32) |
| laicher : laisser - (39) |
| laicher, v. a. laisser, quitter, abandonner ; « laiche-lu », laisse-le, quitte-le. - (08) |
| laicher. Laisser. On dit : « laiche-me don tranquille » pour laisse-moi donc tranquille. - (49) |
| laîcher. v. a. Laisser. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| laichi : Laisser. « Laiche me dan tranquile ». - Abandonner. « Sa fane l'a laichi ». - (19) |
| laîchi v. Laisser. - (63) |
| laichotte : une petite quantité de nourriture ou de boisson, on dit également lichotte - (46) |
| laide : espèce de chicorée sauvage. - (30) |
| laier. : (Dial.), et lâcher (pat.), abandonner un objet. Les deux expressions viennent du latin laxare. Laier fait au futur lairai. - (06) |
| laiet, s.m, lait (en patois de Buxy) ; à Chamirey : lat. - (38) |
| laïeure : s. f.. liure, lien. - (20) |
| laige. lée, ou mieux l’aige. Chemin. Ce mot n'est plus usité dans !e langage bourguignon habituel, mais il est resté dans plusieurs noms géographiques de nos environs : la chapelle Je Notre-Dame de Lée est située dans la plaine nuitonne, à proximité de la voie romaine. Le hameau de Lée, commune de Culêtre, se trouve sur une ancienne voie allant à Arnay, etc... - (13) |
| laigne. n. f. - Laine. - (42) |
| laigneux. adj. - Laineux. - (42) |
| laigot - purin de fumier. - Ci sero demaige de laiché perde ce laigot qui. - De temps ai aute rejeute don le laigot su le feumé. - (18) |
| laigot (n.m.) : purin - (50) |
| laigot, ligot : n. f. Purin. - (53) |
| laiji ou légi : Loisir. « A cause dan que te n'est pas veni ? Je n'ai pas ésu le laiji ». - (19) |
| lailler les vatses : mettre le joug aux vaches - (43) |
| lailli : lier - (57) |
| lâillot: (Iâ:yo - subst. m.) petit couteau qui coupe mal. - (45) |
| laillots. Nom donné aux Morvandeaus par les vignerons de la côte. A l'époque des vendanges, les Beuquins (V. ce mot), envoient dans nos vignobles des essaims de travailleurs, mais il en vient encore de plus loin. Le pays granitique des environs d'Autun et de Saulieu renferme la population des Laillots... Il n'est pas impossible que les Laillots descendent des Huns : mais leur nom me paraît avoir une origine plus récente. Quand un vigneron s'abouche avec le chef d'une de ces bandes de vendangeurs et qu'il lui demande de quel pays il est : Nous sommes de là hiaut, répond-il. Un Beuquin aurait dit : nous sommes de l'âvant. Telle est, je pense, l'étymologie fort prosaïque du mot LaiIlot... - (13) |
| laillou (on) : lieur - (57) |
| laîne (n. f.) : nielle, plante poussant dans les moissons - (64) |
| laingne, s. f. laine. - (08) |
| laingne. s. f. Laine. - (10) |
| laingneux. adj. Laineux. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| laîn-ne (na) : laine - (57) |
| lainne (prononcez lain-ne). s. f. Laine. - (10) |
| laiñne : (nf) laine - (35) |
| lain-ne : laine - (43) |
| laiñne n.f. Laine. - (63) |
| lain-ne : n. f. Laine. - (53) |
| lain-ne, s. f., laine. Cité pour la prononciation nasale. - (14) |
| laiñneux adj. Laineux, mais aussi, doux, moelleux. - (63) |
| lainviôt : petit morceau, petit ver - (37) |
| laipée : n. f. Lapin. - (53) |
| laiqiuer (pour laitier). s. m. Petit lait. (Poilly-sur-Serein). Dans le Doubs, on dit laitia ; Littré donne laitiot. - (10) |
| laiquée (pron.relat.fém.) : laquelle - (50) |
| laiquée : laquelle - (48) |
| laiquée : laquelle - (39) |
| laiquier, laitchier, laquier, latier. n. m. - Laitier. - (42) |
| lair : s. m., loir. - (20) |
| laird (n.m.) : en général cochon. Un groûs laird = un gros cochon - (50) |
| laird : lard - (48) |
| lairde : coupure, estafilade - (37) |
| lairder : larder - (48) |
| lairme (n.f.) : larme - (50) |
| lairme, s. f. larme. - (08) |
| lairmer, v. n. tomber goutte à goutte comme les larmes. - (08) |
| lairmié, s. m. larmier, soupirail de cave, petite ouverture qui éclaire une construction souterraine - (08) |
| lairmier : larnier de cave, soupirail - (37) |
| lairmier : soupirail - (48) |
| lairrer. v. a. Laisser. Si vous n'en v'lez pas, vous l'lairrez. Ce verbe était fort employé par les écrivains des XVe et XVIe siècles ; Corneille lui-même dit, dans le Cid : Vous lairra par mort don Sanche pour époux. - (10) |
| laisea. : Lait, et laisseaa, petit-lait. Delmasse dit qu'on nomme laitie le babeure ou lait de beurre, c'est-à-dire la crême. En Franche-Comté le lait de qualité inférieure se nomme laitiot. (Tiss.) - (06) |
| laissè : le lait - (46) |
| laissé. Laissez. - (01) |
| laisséa, lait... - (02) |
| laissea. Lait, proprement le lait que vendent les laitières. .Prenez un choveau de laisseau, disait une dame à sa servante. - (01) |
| laissi : laisser - (43) |
| laissi : laisser - (51) |
| laissi : laisser - (57) |
| laissiâ, lait. - (16) |
| laissia. Synonyme bourguignon de lait. I ne vas pus ai Biâne les maitins ; not' vaiche n'ai pus guère de laissia. - (13) |
| laissi-aller (on) : laisser-aller - (57) |
| laissieau, lait. - (05) |
| laissu, eau résiduelle de lessive. - (26) |
| laistic (deu) : (du) caoutchouc - (37) |
| lait : Lait. - Délivrance (placenta) de la vache. « Y est fini, la vaiche a fait san lait ». - (19) |
| lait d’poisson : laitance. Laitance de poisson mâle parfois consommée cuite (pas celle du brochet qui est toxique). - (62) |
| lait d’poule : émulsion de lait et d’œuf. Reconstituant composé de jaune d’œuf battu dans du lait chaud sucré. - (62) |
| lait d’sarpent : sève de l’euphorbe. L’euphorbe est une plante commune, à latex blanc. - (62) |
| lait d'beurre : babeurre - (48) |
| lait de beu. Cette locution pittoresque a le sens de bourde, menterie, promesse irréalisable. Je ne croit rien à tes belles promesses : tout ça c’est du lait de beu. En langue verte : c'est de la blague ! - (13) |
| lait de bigue : chèvrefeuille - (39) |
| lait : s. m. 1° lait. 2° rangée de blé dans l'aire. - (21) |
| lait : s. m., laitance. Carpe au lait, carpe mâle. Carpe aux œufs, carpe femelle. - (20) |
| lait : s. m., laite, s. f., salsifis des prés. Voir bibamboche et calaneue. - (20) |
| laitaige, s. m. laitage : « i n'eume pâ l’ laitaige », je n'aime pas le lait. - (08) |
| laitan : Cochon de lait. « Ol a vendu les laitans d'ave la treue » : il a vendu les cochons de lait avec la truie. - (19) |
| laitanse, sperme de poisson. - (16) |
| lait-bergeaud. n. m. - Mauvais lait, venant d'une vache qui vient de vêler. - (42) |
| lait-clai (pour lait clair). s. m. Petit lait. - (10) |
| laitée : Petit lait. « Alle ment (met) tote sa laitée dans le boire es cochans ». - (19) |
| laithie, petit lait que donne le fromage blanc frais. - (16) |
| laitie : babeurre. - (29) |
| laitie : l'eau du lait, le petit lait - (46) |
| laitie : petit lait. - (31) |
| laitie – petit lait ou eau qui reste du lait changé en fromage. – Ne perds pâ lai laitie ; moi, i l'eûmes to pliain. - Lai laitie c'a bein bon pou les couchons ; ci les raifraichi, et pu don pour les gens eux moinme ! - (18) |
| laitie : petit-lait. (CH. T II) - S&L - (25) |
| laitie : portée de petits porcs - (39) |
| laitie : s. f., petit lait. - (20) |
| lait'ie, s. f. petit-lait du fromage. - (24) |
| laitie, s. f., petit lait coulant du fromage blanc. - (40) |
| laiting (n.m.) : latin - (50) |
| laitingn', s. m. latin. - (08) |
| laiton (n.m.) : porcelet encore à la mamelle, cochon de lait - (50) |
| laiton (nom masculin) : porcelet ou poulain qui tète encore. - (47) |
| laiton : animal qui vient d'être sevré, poulain - (48) |
| laiton : cochon de lait - (48) |
| laiton : jeune animal juste après le sevrage. - (33) |
| laiton : cochon de lait - (39) |
| laiton, s .m., poulain non débourré. - (40) |
| laiton, s. m. porcelet, poulain. - (08) |
| laiton. Jeune porc encore allaité. Une fois sevré, on l'appelle « nourrain ». - (49) |
| laiton. n. m. - Poulain qui n'est pas sevré. - (42) |
| laituchan : Laiteron, sonchus oleraceus. On donne aussi quelquefois ce nom à divreses variétés d'euphorbes à cause de leur suc laiteux. - (19) |
| laitusson, s. m., tithymale, plante qui se mêle au foin, et qu'il faut en séparer au moment de la récolte, parce qu'elle lui communique une mauvaise qualité. - (14) |
| laitusson, tithymale, ésule des prés. - (05) |
| laivai. Laver, lavé, lavez. - (01) |
| laivaige, s. m. lavage, action de laver : produit du lavage. - (08) |
| laivaillot : chicorée sauvage. - (31) |
| laivaîsse : boisson trop étendue d’eau, pluie battante sur les habits - (37) |
| laivaisse, ondée abondante, et, au figuré, réprimande sévère. - (02) |
| laivaisse. : Au propre, ondée abondante, et, au figuré, réprimande sévère. (Rac. lat. lavare.) - (06) |
| laivan, lavan (adv.) : là-bas,au loin (de Chambure écrit: laâvan) ex. : "al ô laivan" : il est parti - (50) |
| laivandeise. Lavandière, lavandières. - (01) |
| laive. Lave, lavent. - (01) |
| laiveman (n.m.) : lavement - (50) |
| laiver, v. a. laver. - (08) |
| laiveure : n. f. Pâtée pour cochon. - (53) |
| laivier ou lavier - évier, endroit où on lave la vaisselle. - Mets cequi dans le laivier. - En faut raingeai ces aîllements qui dans le lavier. - C'â dans le laivier tôjeur qu'en fau échaudai. - (18) |
| laivier, lavier (le) : l'évier. - (66) |
| laivoû - Lavoir. – Le laivoû de lai fontaingne de Douotte demande des réparations. - I n'eume dière ailai à laivoû du Gay. - (18) |
| laivoù (adv.) : où - (50) |
| laivou : où - (48) |
| laivou : voir vou - (23) |
| laivou que, loc. où, là où, à l'endroit : « i va laivou qu'ô dié », je vais là où vous me dites d'aller. - (08) |
| laivou : adv. et pron. relat. Où. - (53) |
| laivou, lâ où - où ? dans quel endroit ? - I seu ailai laivou que vos m'é dit. - Laivou don que vai le père Lili ? - (18) |
| laivou, s. m. lavoir, endroit où on lave le linge. on dit aussi « laivoué », qui est la notation locale de lavoir. - (08) |
| laivou, sm. laveur. - (17) |
| laivoure, s. f. laveuse, ou plutôt lavandière, femme ou fille qui lave le linge. - (08) |
| lali-lala, lali-lanlan : adv., couci-couça, médiocrement. - (20) |
| lal'tiée, l'tchiée, liquiée. n. f. - Litière de paille pour les animaux. - (42) |
| Lamai. Lamech, patriarche. - (01) |
| lambaîn’ne : fanon de la vache. Repli de peau qui pend sous le cou de la vache .On dit aussi cravate. - (62) |
| lambeillot : nombril - (39) |
| lambeillot, s. m. nombril, cicatrice du cordon ombilical. « lambeillot » est pour lambillot. - (08) |
| lambero : nombril. - (62) |
| lambeuri : Nombril. - (19) |
| lambiche (n. f.) : tranche ou bande mince - (64) |
| lambiche : bande étroite - (60) |
| lambiche : mouillette de pain. (P. T IV) - Y - (25) |
| lambiche : mouillette de pain (plutôt longue). Ex : "Manger soun' eu avec des lambiches, c'est qu'il aime ça, l'gamin !". (Eu = œuf). - (58) |
| lambiche, lombiche. n. f. - Mouillette : petit morceau de pain que l'on trempe dans l'œuf.à la coque. - (42) |
| lambigneau. n. m. - Lambin. (Arquian) - (42) |
| lambigner. v. n. Lambiner. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| Lambin. C'est le nom d'un professeur du XVIe siècle. Il était fort lent, fort minutieux (fort nunu, comme disent les Belges,) et s'appesantissait sur les plus petites choses. De lui serait venu l'adjectif lambin et le verbe lambiner. - (13) |
| lambôt : l'orvet - (39) |
| lambrillot, s .m., nombril. - (40) |
| lambris : Volige, planche mince. « Ol a fait mentre san peup'lle en lambris » : il a fait scier son peuplier en planches minces. - (19) |
| lambroche, s. m., lambruche, petit raisin sauvage (Mervans). - (14) |
| lambroche. Fruit de la vigne sauvage. - (03) |
| lâme (na) : lame - (57) |
| lament : seulement - (57) |
| lamentabye adj. Lamentable. - (63) |
| lames, laumes. s. f. pl. Nom donné, dans le canton de Chablis, à des terres argileuses situées dans la plaine du Serein. Suivant M. Michou, on donnerait, à Saint-Florentin, le nom de lames, à des terrams secs, très-brûlants, composés de deux couches perméables : la supérieure, qui n'est que poussière ; l'autre, compacte ou graveuse. - (10) |
| lâmon, s. m. jeune pousse d'arbre ou d'arbuste au printemps - (08) |
| lâmouè : hélas ! - (46) |
| lamoué : patraque - (46) |
| lampâ, s. m. palais, intérieur de la bouche. - (08) |
| lampai - tirer la langue de soif et de fatigue ; attendre avec une vive impatience. - Pore chien, queman qu'a lampe ! – Qu'an fait don chaud, en en lampe ! - AI à bein long ai venir ; vraiment ce n'a pâ bein de fâre lampai quemant cequi son monde. - (18) |
| lampais : (Ian:pê: - subst. m.) partie supérieure de la bouche, palais. - (45) |
| lampas : Soif excessive. En français lampas signifie gorge. En patois, « J'ai le lampas » signifie : j'ai la gorge sèche et grande envie de l'humecter. - (19) |
| lampas. n. m. - Gorge, gosier. Depuis le XIIIe siècle, lampas a cette signification ; dérivé du verbe laper, ce mot est d'origine onomatopéique. - (42) |
| lampas. s. m. Partie supérieure du dedans de la bouche. - (10) |
| lampe à coue : Chaleil, petite loupe de cuivre utilisée autrefois, elle se composait d'une tige verticale. - (19) |
| lampe à queue : s. f., crésieu. - (20) |
| lampe, vn. flamber, brûler en jets violents. Comme çai lampe ! - (17) |
| lampée – ce qu'un chien boit en un coup de langue et au figuré. - En ine lampée ton chien, oh lai vilaine câgne ! é bue to le lai de note petiot chai. - Al ant bu lote bouteille en deux ou trois lampées. - (18) |
| lampée : gorgée - (39) |
| lampée, grande verrée d'eau ou de vin ; en latin lambere, s'abreuver... - (02) |
| lampée, s. f. lampe pleine, comble : une lampée d'huile. - (08) |
| lampée. s. f. Le contenu d'une lampe remplie d'huile, et, par extension, tout le vin contenu dans un verre et qu'un buveur avale d'un seul coup. Ainsi, on entend souvent dire d'un ivrogne : il en prend, celui-là, des lampées ! - (10) |
| lampée. : Grande verrée d'eau ou de vin, pour traduire ce mot par une expression vulgaire, mais très intelligible. Il doit son origine au verbe latin lambere, comme le mot français laper. - (06) |
| lamper (verbe) : se dit d'un animal qui tire la langue sous l'effet de la fatigue ou de la chaleur. - (47) |
| lamper : être essoufflé, tirer la langue - (48) |
| lamper : tirer la langue - (39) |
| lamper, v. n. se dit des animaux et particulièrement des bêtes à cornes qui tirent la langue par suite d'altération ou de fatigue. - (08) |
| lamper, v., nettoyer une assiette avec la langue. - (40) |
| lamper. Nous employons ce mot, qui n'est qu'une forme nasillée de laper, dans son sens habituel, mais nous l’appliquons aussi à ce que fait le chien quand il tire la langue par la grande chaleur. Ex. : « Oh ! ce pauvre Fox, voyez donc comme il a chaud, comme il lampe ! » - (12) |
| lamper. Tirer la langue. Regarde doit quemant not’ chien lampe : al ai ben soi (soif). Ce verbe a formé le substantif latnpiâ : lai grau chaleur beille le lampiâ... - (13) |
| lamper. v. a. Mot populaire, qui exprime l'action d'avaler vivement un grand verre de vin C'est un emprunt fait au langage des frères lampiers, qui, lorsqu'ils étaient en débauche et qu'ils s'emplissaient de vin, appelaient cela lamper, terme qu'ils avaient l'habitude d'employer quand ils emplissaient d'huile les lampes des églises, dont ils avaient l'entretien. Suivant quelques-uns, ce mot viendrait du latin lambere, boire ; nous préférons l'autre étymologie. - (10) |
| lampéron*, s. m. petite lampe. - (22) |
| lampiau. s. m. Guenille. (Courgenay). - (10) |
| lampiron. s. m. Godet de lampe à tringle. (Vertilly). - (10) |
| lampö, sm. chandelier. - (17) |
| lampougne, s. f. poignée de fer à repasser, petit coussin en cuir qui préserve la main de la chaleur. - (08) |
| lan, sm. larve des poux. - (17) |
| lancé, part. passé. Élancé. Se dit d'un arbre qui s'élève avec peu de branches et dont la tige est droite. - (08) |
| lance, s. f. arbre de réserve dans une haie vive et qui est propre à fournir du bois de moule. - (08) |
| lance-dalle, subst. masculin : lance-pierre. - (54) |
| lance-peute, subst. masculin : lance-pierre. - (54) |
| lancer (se), v. réfl. Se dit d'un arbre qui pousse vigoureusement, dont la tige s'élève droite, haute et sans branches. - (08) |
| lancer, verbe transitif : élancer, produire une sensation de douleur. - (54) |
| lanceron (n.m.) : jeune brochet - (50) |
| lanceron, n. masc. ; petit brochet . - (07) |
| lanceron, s. m. jeune brochet. - (08) |
| lances : soldat qui combattait avec une lance. - (55) |
| lanceu, linceul. - (02) |
| lanceu. : Linceul. (Du latin linteum, linge.) - (06) |
| lanche : tranche de pain, tartine - (60) |
| lanci : lancer - (43) |
| lanci v. Lancer. - (63) |
| lançu (on) : drap - (57) |
| lançu, linceul, drap de lit. - (05) |
| lande, s. f., lente, œuf de pou, que les mères ne craignent pas assez et laissent sur la tête des enfants. - (14) |
| landemain. Lendemain. - (01) |
| landi, s. m. grand chenet unique soutenant les bûches dans les anciens foyers, landier. - (24) |
| landi, s. m. pièce de fer soutenant les bûches dans les anciens foyers, landier. - (22) |
| landié (nom masculin) : sortie de claie sur laquelle on saignait le cochon. - (47) |
| landié, s. m. petit bûcher, appareil de bois sur lequel on couche les porcs pour brûler le poil lorsqu'ils sont tués : « être sur le landié », être mort, ou être sur son lit de mort. - (08) |
| landiers. Chenets. Les inventaires du XVe siècle mentionnent fréquemment les grands landiers de fer de fonte et les hauts landiers de fer (V. Andains). - (13) |
| landin, s. m., landier, ancien chenet à tige, dont l'extrémité évasée pouvait recevoir une tasse où tenir chaude une boisson quelconque. Mot qui a pris l'article. - (14) |
| landné, èlandné, vn. épier, se dit de l'avoine. - (17) |
| landore, s. m. un landore, une landore, un homme endormi, une femme langoureuse, sans activité, sans énergie. - (08) |
| landou, sm. épi d’avoine. - (17) |
| landze n.m. Lange. - (63) |
| landzi v. Langer. - (63) |
| lang : Long. « T'as les cheveux treu langs ». « Quand an ne deut pas an troue la né bien lange » : quand on ne dort pas on trouve la nuit bien longue. - (19) |
| langâdze n.m. Langage. - (63) |
| langaige, s. m. langage, manière de parler. - (08) |
| langar (le) : hangar. - (29) |
| langar : un hangar, on prononce un langar - (46) |
| langar, hangar. - (27) |
| langeou : Longueur. « Ol a cheu, o s'est étendu de tote sa langeou » : il est tombé de tout son long. - (19) |
| langoreux, -euse adj. Langoureux. - (63) |
| langrigne (n. f.) : petite quantité (syn. grigne, grignon) - (64) |
| langtemps : Longtemps. « Y a langtemps qu'ol est parti ». - (19) |
| langue (repasser sa), loc., babiller à cœur joie. Manière de dire imagée et bien dans la couleur, dans l'esprit du pays. C'est comme le régusou, qui repasse son couteau pour qu'il coupe mieux. - (14) |
| langue de bceuf. s. f. Nom donné à diverses plantes à feuilles rudes de la famille des Borraginées. (Sommecaise). - (10) |
| langue de pic, espèce de carex. - (05) |
| languer : v. a., langueyer. - (20) |
| languerais, s. m. bavard, indiscret : celui qui parle à tort et à travers. - (08) |
| languerelle : parcelle tout en longueur - (61) |
| langueur : s. m., langueyeur. - (20) |
| langui (s') S'ennuyer. - (63) |
| languir, v. intr., désirer, attendre impatiemment, ou douloureusement : « J’languis d'vous vouér. » - (14) |
| laniére (na) : lanière - (57) |
| lanlaire (nenvyi faire) Envoyer promener, se débarrasser de quelqu'un qui importune. - (63) |
| lanlais. s. m. Non-chalant. (Ronrhères). – A Châtel-Censoir, on dit lanlas. - (10) |
| lanlas : lent et bête. - (09) |
| lanlire. s. m. Homme indolent, paresseux. (Vertilly). - (10) |
| lanlöre, sf. lisière d'une pièce de drap enlevée pour en faire de grosses tresses, des jarretières. Au plur., fig. histoires gaies, égrillardes. - (17) |
| lansquener, v. uriner. - (65) |
| lansquener, v., uriner. - (40) |
| lansron : voir gensron - (23) |
| lansu : s. m. drap. - (21) |
| lantarne (n.f.) : lanterne - (50) |
| lantârne (na) : lanterne - (57) |
| lantarne : Lanterne. « Y fa bien na (noir) prends ta lantarne ». Au figuré, « avoir eune lantarne dans le ventre » : avoir faim. - Quand dans un ciel couvert de nuages il ne reste qu'une petite éclaircie on dit : « Si la lantarne se bouche an est bin seur d'avoi la plio (on est sûr d'avoir la pluie) ». - (19) |
| lantarne : lanterne - (39) |
| lantàrne, s. f., lanterne, d'un usage constant pour aller en veillée les soirs d'hiver. - (14) |
| lantarne. n. f. - Lanterne. - (42) |
| lante, sf. barre de bois horizontale qui s'attache aux poteaux dits bonshommes pour former clôture. soutien de palissade. - (17) |
| lantiberner. v. n. Flâner, musarder. [Villeneuve-sur- Yonne). - (10) |
| lantou, adv. autour. - (22) |
| lanturlu-lanture. Refrain d'un fameux vaudeville qui eut grand cours en 1629. L'air en étant brusque et militaire, des vignerons séditieux attroupés l'année suivante à Dijon, un jeudi au soir, 28 de février, et tout le jour du lendemain premier de mars, furent le là nommés Lenturlus, parce qu'ils faisaient battre cet air sur le tambour par la ville pendant leur marche. Ils pillèrent plusieurs maisons, et cette sédition, quand on en parle, est encore apellée le Lanturlu de Dijon. - (01) |
| lanturlu-lanture. : Refrain d'un vaudeville de 1629, adopté par les vignerons révoltés, en février 1630, contre un édit de taxes. - (06) |
| l'anvâ (à) : inverse - (57) |
| lanvau. s. m. Reptile d'un décimètre de longueur environ, très-fragile, qui hante les cimetières et les prés humides, et qui passe pour n'avoir qu'un œil. On dit que sa morsure n'est pas venimeuse. (Perreuse). – Dans quelques communes, on donne ce nom à l'orvet. - (10) |
| lanviau (n.m.) : orvet - (50) |
| lanviau : voir borgne - (23) |
| lanviau, s. m. orvet, anguis fragilis. Petit serpent qu'on rencontre assez fréquemment dans les prairies humides. - (08) |
| lanviau, subst. masculin : orvet et tout petit serpent inoffensif. - (54) |
| lanviot : orvet - (48) |
| lanviot : n. m. Orvet. - (53) |
| lanviot, lanvau. n. m. - Orvet. - (42) |
| lanvo : voir borgne - (23) |
| lanvo, lambo : orvet. - (33) |
| lanvoi : voir borgne - (23) |
| lapaingne (nom masculin) : lapin. - (47) |
| lape : gaillet gratteron (syn. rdon*). A - B - (41) |
| lapê : lapin. (B. T IV) - D - (25) |
| lape, pignolo. Bardane (Arctium lappa). - (49) |
| lâpée (ai lai). A la lapée, avec gourmandise, avec avidité. Se dit de celui qui mange sans mâcher, d'un seul coup, comme le chien lape avec sa langue. - (08) |
| laper : plaquer en collant. A - B - (41) |
| laper (se) : (s'Iapè : v. pron.) s'atteler, se mettre (à un travail). - (45) |
| laper v. (onom.) Coller au palais en parlant d'aliments sucrés. - (63) |
| laper, v. n. se prendre fortement à quelque chose, à un travail, à une besogne quelconque. - (08) |
| laper. Adhérer, coller. Fig. « Se laper » c'est se mettre activement au travail ; faire des efforts. - (49) |
| laperea. : Levraut, et aussi bec-de-lièvre, c'est-à-dire lèvre terminée en museau de lièvre. - (06) |
| laperon ou loupias. s. m. Bardane. (Argentenay). - (10) |
| lapeux, adj., se dit d'une viande qui a traîné par temps humide et chaud. - (40) |
| lapin : s. m., élève qui, dans un lycée ou collège, suit les cours de l'enseignement classique, c'est-à-dire de « latin ». Voir fromage. - (20) |
| laping (n.m.) : lapin - (50) |
| lapingne, lapeigne. s. m. Lapin. Fait, au féminin, lapigne. - (10) |
| lappe (n.f.) : fruit de la bardane (lat., lappa, puis a. fr., lappe) - (50) |
| lappe : redon, gaillet, gralleron - (34) |
| lapper : boire avec la langue. - (09) |
| lapper : coller - (34) |
| lapper v. n. Etre gluant, coller. Ça lappe aux doigts. (Chablis). Se dit sans doute pour happer, s'attacher, se prendre, se coller à. Ça happe à la langue. - (10) |
| lappes : petites boules hérissées de piquants de la bardane. - (30) |
| lâpre, s.f. lèpre. - (38) |
| laquais, s. m. petit épi de blé qui accompagne le principal nommé en Morvan « l'épi mâtrosse. » - (08) |
| laquedrille. Coquin de laquais, terme de mépris pour laquais comme soudrille pour soldat. Ce sont des diminutlifs à l’espagnole. Laquedrille est fort usité à Dijon pour petit laquais… - (01) |
| laquedrille. : Petit laquais ; mot autrefois usité à Dijon pour exprimer un coquin de laquais, un flaneur, comme on disait soudrille pour qualifier un vaurien de soldat, vagabond et pillard. Le verbe patois drillai, vagabonder, est la racine de ces mots. - (06) |
| laquier, latier (pour laitier). s. m. Scorie vitrifiée provenant de la fonte du fer. (Tannerre, Mezilles, Villiers-Saint-Benoît). - (10) |
| laquô : laquelle - (57) |
| laquô : quelle - (57) |
| làr. s. m., lard, et au figuré embonpoint. D'un qui engraisse : « O fait son làr. » - (14) |
| lâraigner (se) : raser les murs - (48) |
| lâraigner : bourrer le foin sous le toit - (48) |
| lard, s. m. lard, porc prêt à être tué ou lors qu'il est dans le saloir. Nous disons « saigner son lard » pour tuer son cochon. - (08) |
| lard. Porc engraissé dans chaque famille, tué, salé et conservé pour les besoins de la maisonnée. - (49) |
| lardanche : Mésange. « In nid de lardanches ». - (19) |
| lardanche : mésange. - (21) |
| lardanche, mésange bleue. - (05) |
| lardanche, s. f., mésange bleue. Espèces nombreuses. - (14) |
| lardanche, s. f., mésange. - (40) |
| lardanche, s.f. mésange. - (38) |
| lardanche. Mésange. Origine inconnue. Il s'agit de la mésange à tête noire ; on nomme brechillote une autre variété. - (03) |
| lardasse : coupure importante - (48) |
| lardasse, s. f. grosse écorchure ou coupure, quelquefois égratignure. Une grande « lardasse » sur la figure. - (08) |
| larde : Balafre. « Ses bûs (bœufs) se sant battus, y en a in qu'a reçu in cô (coup) de corne que li a fait eune bonne larde ». - (19) |
| larde de cochon : s. f., crépide à feuilles de pissenlit, vulgairement groin d'âne (crépis taraxacifolia). - (20) |
| larde : s. f., pissenlit, laiteron (taraxacum dens leonis). - (20) |
| lardeinche, s. f. mésange. - (22) |
| larderanche, lardenne (larden') : s. f., vx fr. larderele, larderôn, mésange. - (20) |
| larderi : mésange. II, p. 31 - (23) |
| larderie, lardri (n.f.) : mésange - aussi maricheau - (50) |
| lardesse : n. f. Coupure. - (53) |
| lardesse : plaie - coupure - (39) |
| lardesser : se couper, se piquer - (39) |
| lardiche. Mince tranche de lard. - (49) |
| lardinche (na) - guigne à tchua (on) : bergeronnette - (57) |
| lardinche (na) : mésange - (57) |
| lardri. Bouvreuil. - (49) |
| lardri. s. m. Mélange. (Diges, Montillot). - (10) |
| lardrit (nom masculin) : animal ou enfant chétif, souffreteux. - (47) |
| lârdze adj. Large. - (63) |
| lardzesse n.f. Largesse. - (63) |
| lardzeû n.f. Largeur. - (63) |
| lardzou : largeur - (43) |
| larégné (s’) : (s'lâ:rényé - v. pronom.) se faufiler, passer en tâchant de ne pas se faire voir. - (45) |
| larégne : (Iâ:rény' - subst. f.) pente du toit, sous laquelle on bourre le foin en le tassant avec les pieds pour gagner de la place. - (45) |
| larégner : (lâ:rényé - v. trans.) bourrer le foin sous une lâ:rény'. - (45) |
| lâreigne, s. f. espace vide qui se trouve le long des murs, sous le toit. - (08) |
| lâreigner (se) (v.pr.) : se faufiler - (50) |
| lâreigner, v. n. longer les murs en se dérobant ; se faufiler le long des murailles. - (08) |
| lârge : large - (57) |
| lârge : large, une grande superficie. « I en fiant lârge a zo deux » : ils exploitent une grande superficie à eux deux. - (19) |
| largeotte : herbe laiteron. - (66) |
| largeotte : le laiteron, herbe appréciée par les lapins - (46) |
| largeou (na) : largeur - (57) |
| largeou : Largeur. « In la de cotone à grande largeou » : un lé de cotonnade de grande largeur. - (19) |
| lâri, lârei, s. m. nom de lieu qui figure souvent dans la toponomastique rurale. - (08) |
| larigot (Boire à tire-). Les chercheurs du siècle dernier ont forge une demi-douzaine d'étymologies... Larigot signifie gosier ; il est encore usité dans ce sens en Bourgogne. Ce mot, qui a formé larynx et ses dérivés, s'appliquait spécialement à cette partie de la gorge qu'on appelle la pomme d'Adam et qui fait un mouvement très prononcé chaque fois que l’on avale. Quand on a très soif on boit vite, et quand on boit vite on tire le larynx. - (13) |
| larigot. s. m. Fifre, flûte, clarinette. –Boire à tire larigot, boire à longs traits, à l'orifice d'une bouteille dont on tient le col et comme si l'on flûtait dedans. – Par extension. Boire à plein verre, siffler, flûter un bon verre de vin. - (10) |
| larme, petite quantité d'un liquide ; une personne sobre à laquelle on offre de la liqueur forte dit : bèyë m'z'an eune larme. - (16) |
| larme, s. f., goutte, petite quantité : « V'là du bon riquiqui ; peùrnez-en eùne larme. » - (14) |
| larmé, vn. larmoyer, pleurnicher. - (17) |
| larme. Larmes. - (01) |
| larmei, coin de l'œil... - (02) |
| larmei. : Coin de l'oeil d'où ruissellent les larmes. - (06) |
| larmi : (nm) soupirail de cave - (35) |
| larmî n.m. Soupirail. - (63) |
| larmié, soupirail de cave. - (16) |
| larmier (de cave), subst. masculin : soupirail. - (54) |
| larmier : auvent pour éloigner la pluie d'une ouverture —soupirail (Brionnais). - (30) |
| larmier : soupirail de cave - (43) |
| larmier : n. m. Soupirail. - (53) |
| larmier : s. m., soupirail de cave. - (20) |
| larmier, s. m., soupirail de cave. - (14) |
| larmier. Soupirail de cave. - (13) |
| larmier. Soupirail de cave. - (49) |
| larmise : lézard gris fréquentant les dépendances des fermes. - (30) |
| larmise : s. f., lézard gris des murailles. - (20) |
| larmuse, s. m., lézard gris, lézard de muraille. - (14) |
| larnailler, v., travailler sans entrain. - (40) |
| larner (v.) : traîner sans rien faire - (50) |
| larner : traîner sans rien faire - (39) |
| larrace. s. f. Gouttière. (Courgenay). - (10) |
| larrê : coteau. - (29) |
| lârré : terrain en forte pente dans le sens de la largeur - (48) |
| larré. Terrain inculte en pente rapide. Par extension : pâturage, champ ou vigne sur le penchant d'une montagne. On disait autrefois laris... - (13) |
| larrecenousement. : (Dial.), à la façon d'un voleur. En latin latrocinaliter. (Voir au mot runement.) - (06) |
| larret, coteau. - (27) |
| Larret, larrey : coteau cultivé (vieux français : larritz, même sens). - (32) |
| larrey. Coteau ; soit le coteau tout entier, soit la partie moyenne du coteau. Plusieurs localités de la Côte-d’Or se nomment Larrey. - (12) |
| larris, terres en friche. Il y a une contrée de ce nom, à l'ouest de Châtillon, où l'on ne trouve que pierrailles et roches... - (02) |
| larris. : (Pat.), loaris (dial.), terres en friches. Il y a une contrée de ce nom à l'ouest de la ville de Châtillon (Côte-d'Or). Ces mots viennent du latin loca arida ; et, en effet, cette dénomination s'applique toujours à des lieux pierreux où la culture est impossible. - (06) |
| lârron (on) : larron - (57) |
| larze (adj.m. et f.) : large - (50) |
| las ! : Hélas ! « Ol est bin malède, cen pauvre ! las ! » : hélas ! il est bien malade le pauvre. - (19) |
| las (art.m. et f.pl.) : les - (50) |
| lâs : las, fatigué. El ot lâs : il est fatigué. - (52) |
| lâs : les - (37) |
| las : les - (48) |
| las d'aller, lasse d'aller : Ioc, personne mollasse. Oh ! c'te grande lasse d'aller !» Voir dargnasse. - (20) |
| lâs(se) : las(se), fatigué(e) - (48) |
| las, lais. s. m. Plaint des cloches dans les glas funèbres ; en général, plaint douloureux. – A Saint-Florentin, on entend plus particulièrement par lais, les petites heures de l'office des morts qui se chantent à l'église, tandis que le corps du défunt est encore à la maison mortuaire. Du latin lessus, lamentation. - (10) |
| las, plur, de l'art, le, la : « las feilles, las fonnes », les filles, les femmes. (Voir : das.) - (08) |
| las. s. m. Endroit d'une grange où l'on dépose le blé, l'orge et autres grains. (Etivey). Voyez lassiée. - (10) |
| lassa : fatigué. - (29) |
| lassai. Las, lassez, lasser. - (01) |
| làsser, v. tr., laisser : « Làsse-me donc tranquille ! » - (14) |
| lâssi (se) v. Se lasser. - (63) |
| lassiâ : lait. - (29) |
| lassie : grenier à foin - (60) |
| lassie : grenier à foin. III, p. 31-r - (23) |
| lassiée. n. f. - Emplacement où sont déposées les balles (enveloppes des graines de céréales) (Perreuse, selon M. Jossier) - (42) |
| lassiée. s. f. Réduit ménage au fond d'une grange par le dépôt des pailles, des balles, des poussiers. (Perreusc). – Jaubert donne lassée, lassie, bas-côtés d'une grange ; et Roquefort, lascéure et lassière, travée, endroit d'une grange ou l'on entasse les gerbes. Du latin laqueus. - (10) |
| lat. s. m. Lait. (Givry). – Par son orthographe et sa prononciation, ce mot se rapproche bien plus du latin, lac, que notre mot lait. - (10) |
| lateigne. s. m. Latin. (Menades). - (10) |
| lateux. s. m. Terre argileuse. A Joigny, le lateux est très recherché des vignerons, qui, dans certains cas, croient utile d'en mettre aux pieds des ceps. - (10) |
| latiner, v, n. parler avec affectation, faire le beau parleur. se prend toujours en mauvaise part. - (08) |
| lâtre, s. f., lettre. - (40) |
| latrée : quantité de... - (29) |
| lâtrée : une grosse quantité (ex : de bois, de nourriture... ) - (46) |
| lâtrée. Grosse quantité de bouillie ou de liquide Ex. : « Comme il disait qu'il avait faim, je lui ai d'abord fourré une latrée de tapioca ! » Etym. dans ce sens, latrée peut venir de lavatrina, bain ; mais il a aussi le sens de correction, voile de coups. L'Etymologie de latrée avec cette dernière signification m'est inconnue. - (12) |
| latrée. Mets trop abondant et mal préparé. Eune lâtrée de soupe. - (13) |
| latrée. : Châtiment. (Del.) Ce mot n'appartient-il pas plus spécialement au vocabulaire du théâtre ? car latrée a tout l'air de signifier une volée de coups de lattes à la sganarelle. - (06) |
| lâtse n. et adj. Lâche. - (63) |
| lâtsi : faire sortir le bétail de l'étable (tr. lit. : lâcher). A - B - (41) |
| latsi : faire sortir les bestiaux de l'étable - (34) |
| latsi : faire sortir les bestiaux de l'étable - (43) |
| lâtsi : lâcher - (51) |
| lâtsi v. Faire sortir les bestiaux de l'écurie (lâcher). - (63) |
| latsi, leutsi v. Lécher. - (63) |
| lâtsté n.f. Lâcheté. - (63) |
| lattre : Lettre. « O m'a écrit eune lattre de quat 'pages». « Lattre moulée » : caractère d'imprimerie. « O ne sait pas lire l'écriture mâ o sait lire la lattre moulée ». - (19) |
| lau (pron.pers.,adj.pos.) : leur - laus = leurs - (50) |
| lau. Eau. Vieux mot. - (03) |
| lauche (n. f.) : bande de terre retournée par le versoir de la charrue - (64) |
| lauche : laiche ou carex. Plante des marais qui a donné son nom aux prairies humides : les Lauches,…lieu-dit : Lauchère. - (62) |
| lauche : laiche, carex. « La lauche vint dans les prés mo'llini (humides), i fa du mauvâ foin ». - (19) |
| lauche : sillon - (60) |
| lauche : une tranche de pain fine - (46) |
| lauche, laiche des marais. - (05) |
| lauche, lèche, tranche de pain mince. - (05) |
| lauche. n. f. - Bande étroite d'un objet, d'un tissu, etc. Autre sens: sillon (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| lauche. s. f. Bande étroite d'un objet quelconque. Une lauche de terre, notamment, quand elle est relevée par la charrue. Une lauche d'étoffe. Une lauche de pain, de veau, de mouton. Parmi les ménagères d'Auxerre, il y en a qui disent une loiche de veau, une longe de mouton. A Diges, louèche, se dit de la bande de terre soulevée et retournée par la charrue. - (10) |
| laûches, s. f. pl., roseaux utilisés pour rempailler les chaises. - (40) |
| laude : sornette, ânerie, mensonge - (48) |
| laudes : (lô:d' - subst. f. pl.) sornettes, balivernes, propos en l'air. - (45) |
| lauége : hangar. - (29) |
| laulue. s. f. Chose insignifiante. (Tormancy). – Voyez lolue. - (10) |
| laume (C.-d., Morv.), laumée (Y.). – Roseau et, en général, toute herbe poussant dans les terres humides et argileuses appelées laumes ; du bas latin lama, lamina, qui a le même sens. De là vient probablement le mot lame (d'épée), par analogie avec une feuille de roseau. C'est la véritable étymologie de la vallée des Laumes près Montbard, autrefois bas-fond peuplé de roseaux… - (15) |
| laume (n.f.) : roseau en général ; iris - (50) |
| laûme : iris sauvage, roseau, grandes feuilles d'iris - (48) |
| laume : plante, iris sauvage. - (33) |
| laume : roseau - (39) |
| laume, n.f. plante des marais à feuilles allongées et coupantes (iris, laîches). - (65) |
| laume, s. f. roseau en général. - (08) |
| laumée. s. f. Herbe des bois. Aller à la laumée. (Mouffy). – Doit s'entendre, en général, des herbes qui croisent dans les laumes, sorte de terres argileuses assez communes, qui se rencontrent, notamment, dans la vallée du Serein. - (10) |
| laumes : (Iô:m' - subst. f. pl.) roseaux. On les utilise principalement pour le rempaillage des chaises, plutôt que la paille, qui est moins souple. - (45) |
| laumet, s. m. pousse, rejet des végétaux, tige du blé, du seigle, etc., des graminées. - (08) |
| launai, launou - Parler beaucoup pour ne dire que des futilités, des mensonges amusants. - A passe son temps ai launai. - AI en conte cetu lai. vais !.. c'â in launou de premier choix. - Quoi qu'à vos launant tôjeur, ces doguins lai ? - (18) |
| launer : aller sans but défini. - (66) |
| launer : (Iô:nè - v. intr.) tarder à travailler, ne rien faire . - (45) |
| launer, launou. Flâner, perdre son temps, ne pas en finir. Launou, flâneur, musard. Etym. très probablement une corruption des mots flatter, flaneur. - (12) |
| launeries - farces, bêtises que l'on dit pour s'amuser, quelquefois indécentes. - A ne dit que des launeries. - Voyez launai. - (18) |
| launes. Mare d'eau laissée par une rivière quand elle se retire après avoir débordé. - (49) |
| launou, flâneur. - (28) |
| laur (lai) (pr.pos.f.) : la leur - (50) |
| laur (le) (pr.pos.m.) : le leur - (50) |
| laurdiau (-de) (adj. et n.m. et f.) : lourdaud, lourdaude - (50) |
| laurniâ, s. m., paresseux, lambin. - (40) |
| laus (pron.pers., adj.pos.) : leurs - (50) |
| laûs : épuisé - (57) |
| laûs : las - (57) |
| laûssant : fatigant - (57) |
| laûsse : lasse - (57) |
| laûsser : épuiser - (57) |
| laûsser : fatiguer - (57) |
| laûsser : lasser - (57) |
| l'aute des jors : l'autre jour. L'aute des jors, i seus été ai la fouère : l'autre jour je suis allé à la foire. - (33) |
| lauve. C’est le nom du ruisseau de La Doix. On devrait écrire l’auve, c'est-à-dire l'eau.... - (13) |
| laûyotte, leûpiotte, lûyotte : lampe à lueur faible, vacillante - (37) |
| lavâdze n.m. Lavage. - (63) |
| lavage, s. m. gâchis d'eau répandue. - (22) |
| lavage, s. m. gâchis d'eau répandue. - (24) |
| lavaiche : Lavasse. « Qu'est-ce que te no fa boire? Y est pas du café, y est de la lavaiche ». - (19) |
| lavaille : eau de vaisselle (l'eau de vaisselle, le son, les pommes de terre, les grains, le chou et le petit-lait étaient mis à cuire dans la chaudière en fonte de 100 litres environ et servi aux cochons et aux poules) - (43) |
| lâvan - là-bas ; que voilà. - A sant ailai lâvan, tenez. - Pote cequi lâvan. - Qui ça don que ces hommes lâvan ? - (18) |
| la-van : ailleurs. - (29) |
| lavan-bas (adv.) : là, en bas, au loin, plus loin - (50) |
| lavandelle, adv., là-bas. - (40) |
| lavandiée, s. f. celle qui dans les noces est chargée de laver la vaisselle. Les grosses noces ne se font jamais sans une « lavandiée » et un « bouteillé. » - (08) |
| lavan-haut (adv.) : là, en haut, là-haut, plus loin - (50) |
| l'avant. Contraction pour là en avant, pas loin, très-près. J'vas l'avant, je vais là-bas. (Villechétive, Soucy). - (10) |
| lavasse, s. f., forte ondée, et aussi soupe, tisane, boisson trop allongée : « O m'a fait bouére eun cop ; y étôt, ma fi ! d'la vrâ lavasse. » - (14) |
| lavasse. Pluie d'orage. « Quant à leurs orges, avoynes, poids, fèves et tremitages, ils ont esté entièrement ruynés par la dite gresle, lavace et inondation de la Deune. » (Procès-verbal d'une grêle chue à Santenay en 1652 ». - (13) |
| lavassée (nom féminin) : grande quantité d'eau tombé du ciel. - (47) |
| lavassier, lavassi : s. m., caisse dont le fond est un plan incliné et qui sert à faire égoutter les fromages frais. - (20) |
| la-vau, adv., là-bas, au loin. - (14) |
| lavau, là-bas. - (05) |
| lavau. Là-bas. La lettre l doit être euphonique; en delé, au-delà, a le même sens. - (03) |
| lavaud, s.m., grande oseille sauvage, rumex. - (40) |
| laväye : (nf) eau de vaisselle - (35) |
| lâve 1C.-d., Chal, Morv.). - Pierre plate servant à couvrir les toits dans le Morvan, la Côte et le Jura ; elle prend avec le temps une teinte grise et ne contribue pas peu à donner aux chaumières bourguignonnes un aspect pittoresque et particulier à la région. C'est un calcaire feuilleté qui se lève par couches ou bancs, et se taille comme l'ardoise ; il n'a aucune analogieavec la lave des volcans et tire probablement son nom de l’opération par laquelle on procède à son extraction, c'est-à-dire qu'on le lève (en patois, lâve) dans des carrières appelées lavières en d'anciennes chartes Les mots lave, laive, lesve étaient couramment employés au moyen âge pour désigner les pierres plates dont il s'agit. - (15) |
| lave : s. f., pierre plate servant à couvrir les toits. De la pierre de lave. - (20) |
| lave, n.f. pierre plate dont on couvre les maisons. - (65) |
| lave, s. f. pierre de grès plate et de forme irrégulière qui existe par bancs dans quelques parties du Morvan bourguignon. Les laves servent à faire les bordures des toits et quelquefois les toitures entières des maisons. - (08) |
| lave, s. f. pierre plate à couvrir les toits. - (22) |
| lave, s. f. pierre plate à couvrir les toits. - (24) |
| lave, subst. féminin : lauze, pierre plate dont on fait les toitures. - (54) |
| lave. Couche supérieure de certaines roches calcaires de la Côte-d’Or, Elles se lèvent en feuilles plus ou moins épaisses et servent à couvrir les toits, à former des revers d'eau et à faire des bordures dans les cortils... - (13) |
| lâve: Pierre plate et mince dont on se servait autrefois pour couvrir les maisons. « A Manci y a encore bien des veilles maijans crevies (couvertes) à lâves ». - (19) |
| lavenbas. adv. là en bas, au loin, plus loin, en aval. - (08) |
| lavenhau, adv. là en haut, là haut, plus loin en amont. on prononce « lavan-nau. » - (08) |
| lâver - r'lâver : laver - (57) |
| laveriâ (du), s.m. de la pierraille (de lave). - (38) |
| laverie. s. f. Lavoir. (Etaules). - (10) |
| lâves, lâvère – pierres plates dont on se sert pour couvrir les toits. – Su note mâvon en y ai bein des lâves que manquant. - I vas queri ine voiture de lâves. - Le Denis Daird é envie de fâre ine lavére dans son champ. - (18) |
| laveure : aliment cuit pour le bétail. - (31) |
| lavier : évier - (44) |
| lavier, n.m. évier. - (65) |
| lavier, n.m. ouvrier couvreur qui utilise les laves. - (65) |
| lavier, s. m., évier. Encore de la famille des mots qui ont pris l'article : l'évier, levier, lavier. - (14) |
| lavier, sm. evier. - (17) |
| lavier. Evier, endroit où on lave la vaisselle. Notre mot est aussi logique qu'évier. Etym. lavier vient de lavare et évier du vieux français ev, eau. - (12) |
| lavier. n. m. - Évier; néologisme exprimant l'endroit où l'on lave. - (42) |
| lavier. s. m. Evier. - (10) |
| lavier. Synonyme patois d'évier. C'est l'endroit où les ménagères lavent leur vaisselle. Même racine que lauve. - (13) |
| lavière, n.f. carrière de laves. - (65) |
| lavochai - laver sans goût, mal. - Quoi que te lavoche don ai tot manmant ? - Ote-tai don, teins ce n'â pâ laivai cequi, c'â laivochai. - C'â les enfants que lavochant queman cequi. - (18) |
| lavocher. Laver a petits coups, mal laver, comme pignocher, pour peindre sans grande haleine. Etym. voyez le mot lavier. - (12) |
| lavocher. v. a. Laver légèrement. (St-Florentin). - (10) |
| lavochis, lavachis. s. m. Se dit d'une boisson sans saveur, parce qu'elle est trop étendue d'eau. – A Auxerre, on dit lavis dans le même sens. - (10) |
| lavoù - quouâ : où - (57) |
| lavou (adv.) : où (lavou on qu'té vâs ?) - (64) |
| lâvou (on) : laveur - (57) |
| lavou : où - (48) |
| lavou : où - (51) |
| lavou : où, où est-ce ? - (52) |
| lavou : où, où est-ce ? T'es mis mes aiffaires lavou ? : où as-tu mis mes affaires ? - (33) |
| lavou ? : où ? - lavou queil sont ? Où sont-elles ? - lavou don qu'tu vè ? Où vas-tu donc ? - d'lavou don qu'tu d'vin ? D'où viens-tu ? - la von qu'on les met ? Où les met-on ? - (46) |
| lavou ? adv., interrogatif, où ? - (40) |
| lavou don : où donc ? leutsi (ltsi) : lécher - (51) |
| lavou pour où ; lavou k't'ë ! où es-tu? d'lavou k'te d'ein ? d'où viens-tu ? - (16) |
| lavou qu’te vé : où vas-tu ? - (66) |
| lavou : où - (39) |
| lavou : où, où donc ? Ex : "Lavou qu'té vas, coum' ça ?" - (58) |
| lavou : s . m. lavoir. - (21) |
| là-vou, là-vou c'que ? adv., où, là où, où est-ce que ? « Là-vou c’qu’é la p'tiote ? All' patevôle cor por iqui, bé seùr ! » - (14) |
| lavoù, lavoù don adv. Où, où donc. Lavoù don qu'ôl est ? - (63) |
| lavou, où : lavousqu'i'aut ? où est-il ? - (38) |
| lavou, où. - (27) |
| lavou. Où. « Lavou qu'te vais ? ». - (49) |
| lavouaîr (on) : lavoir - (57) |
| lavoué. s. m. Lavoir. - (10) |
| lavouère : lavoir - (48) |
| lavouère : lavoir - (39) |
| lavouse : Laveuse. « Des lavouses de beue » : des laveuses de lessive. On dit d'un bavard : « o cause c'ment eune lavouse de beue ». - (19) |
| lavousque adv. Où. Voir quoî. Mas bah, lavousque qu'ôl est don ? Mais, où est-il ? A le même sens que : mas bah, quoî qu'ôl est ? - (63) |
| lavouze, laveuse. - (16) |
| lavre : Lèvres. « Ol a des greusses lavres, autant des orles (bords) de peut de chambre ». - (19) |
| lâvre, lave; lâvëre, lâvière, lieu d'où l'on extrait la lave. - (16) |
| lâvre, s.f. lèvre. - (38) |
| lavue. n. f. - Eau de vaisselle. - (42) |
| lavûre, boisson composée d'eau, de son, etc., pour le bétail. - (16) |
| lavure, n.f. nourriture des porcs. - (65) |
| lavure, pâtée de betteraves et de pommes de terre pour les porcs. - (28) |
| lawoî n.m. Lavoir. - (63) |
| laÿ, pronom, elle (tonique). - (40) |
| la-yer : lier - (43) |
| layette et l’ayette. Tiroir d'une table. Euveure don voi l’ayette, te prenvez les coutiâs pour mette su lai taule. Le mot ais, planche, me paraît être la racine de layette : un fabricant de coffrets est encore appelé un layetier... - (13) |
| layeus, jeunes garçons vidant les paniers de vendange de leurs layeutes. - (27) |
| layeute, vendangeuse. - (27) |
| läyi : (vb) lier - (35) |
| läyi v. Lier. Voir yier. - (63) |
| lâyo, lâyote, vendangeur et vendangeuse mettant dans le même panier les raisins qu'ils cueillent. - (16) |
| làyoeure, s. f. ligature. Verbe : làyé. - (22) |
| làyoure, s. f. ligature. Corde de joug. Verbe lâyer. - (24) |
| layoux : Lieur, celui qui lie les gerbes au temps de la moisson. - (19) |
| Lazaire, Lazare, nom d'homme et de femme quelquefois. - (08) |
| Lazaret. Nom d'homme qu'on prononce souvent Nazaret. diminutif de Lazare ; au féminin Lazarette, nom très répandu. - (08) |
| Lazéére : prénom. m. Lazare. - (53) |
| l'ceû : celui - (48) |
| l'chu : eau de lessive. - (33) |
| l'chu. s. f. résidu de la lessive, eau chargée des sels et autres matières en dépôt. Syncope de luchu. (Voir : lussu.) - (08) |
| l'cifar. Ce mot entre dans une exclamation usitée en Morvan « ma çô don l'cifar ! » ce terme est une contraction de Lucifar, l'e prononcé a selon la coutume de la contrée. - (08) |
| l'çon (na) : leçon - (57) |
| lé - elle. - C'â lé, lai Lisabette, qu'é fait ceute jolie flieur. - Ce live qui c'â dai lé ; ile â tot ai fait saivante. - Voyez lu. - (18) |
| lé : elle (complément), la (complément) - (48) |
| lé : elle. - (66) |
| lè : la - (52) |
| lê : lit. - (29) |
| lé cens (pron.dém.m. et f.pl.) : ceux, celles - (50) |
| le ceu (pron.dém.) : celui - (50) |
| le ceu, lai ceu, pron. démonst. celui, celle ; « lé ceu », ceux, celles ; « cetu-qui » ou « ctiqui », celui-ci; « cté-qui », celle-ci; « ctilé », celui-là ; « ctéléte », celle-là ; « cé-léte », ceux-là ; « cé-lé » celles-là. - (08) |
| le meune, lai meune : le mien, la mienne - (48) |
| le nonte : le nôtre - (48) |
| le sène, la sène : le sien, la sienne. Ex : "La vache qui court, yé lé rio ? C’est la sène a la Delphine. Y savons pas garder y’eu bêtes !" - (58) |
| le senne, lai senne : le sien, la sienne - (48) |
| le tenne, lai tenne : le tien, la tienne - (48) |
| le vôte : le vôtre - (48) |
| lé : pron. pers. f. Elle. - (53) |
| le, la, et leur, contraction au, du. Ces deux articles se mettent aussi bien devant les noms propres que devant les mots ordinaires. Ex. :« Le Paul a demandé au Jacques s'il avait écrit au Pierre. » - (12) |
| le, la, les : art. Sur sa suppression dans certains cas, comme dans en rue, en Saône, etc., voir les mots En, Semaine (Sur), etc. - (20) |
| lé, lei (pron.pers. f. 3ème pers.) : elle - (50) |
| lé, lei, pron. pers. 3e pers. du féminin au sing. S'emploie pour elle. - (08) |
| lé, lit. - (16) |
| lé. Les, article pluriel devant les mots qui commence par une consonne, car devant ceux qui commencent par une voyelle, on écrit lés. « Lé nazade, lés horion ». - (01) |
| lèche (n. f.) : inflammation des commissures des lèvres (syn. perlèche, pourlèche – avouèr la lèche) - (64) |
| lèche frite, et loichefrite. Récipient en tôle que l’on place devant le feu, au-dessous de la broche à rôtir... - (13) |
| léche : (lé:ch' - subst. f.) seulement usité dans la locution m'nè lè lé:ch' "être en chaleur", qui ne s'emploie qu'à propos des chiennes. Pour les autres mammifères de la ferme, (y compris les femmes !) on dira "mener les boeufs". - (45) |
| lèche : s. f., tranche mince et longue. Lèche-de pain, lèche de viande. - (20) |
| lèche, et louche. Tranche mince. Te couperai ben des loiches de pain pour fare eune bonne soupe. Cet ancien nom de la langue a formé le verbe loicher... Lèche et loiche signifient spécialement tranche de pain et de lard... - (13) |
| lèche, liche : inflammation du coin des lèvres - (60) |
| lèche, loiche ; loiche de pèn, petite tranche mince de pain. - (16) |
| lèche. s. f. Mal aux lèvres, ainsi appelé parce que ceux qui en sont atteints ont l'habitude de se lécher, de se passer la langue dessus. - (10) |
| léchée, léchette, léchotte. s. f. Tartine, ce qu'on lèche. Une léchée de Cotignac. – Signifie, en général, petite quantité. Une léchotte de terre. - (10) |
| léchepot. n. m. - Index. - (42) |
| léches (mener les), loc. Mener les chiens. - (08) |
| lêchi - lâchi : lâcher - (57) |
| lêchou (on) - lâchou (on) : lâcheur - (57) |
| lèdzendaîre adj. Légendaire. - (63) |
| lèdzende n.f. Légende. - (63) |
| ledzi : léger - (43) |
| lèdzi, -ire adj. Léger. - (63) |
| lèë, s. f., lé d'étoffe, de toile, etc. : « J'engraisse; i m'faut mét'nant eùne lèë d'pus à mes jupes. » - (14) |
| leèce. : (Dial.), réjouissance. (Du compl. lat. loetitiam.) - (06) |
| léedi. s. m. Lundi. (Etais). - (10) |
| léege : n. m. Linge. - (53) |
| léege. s. m. Linge. (Id.). - (10) |
| légne : (lény' - subst. f.) (terme de bûcheronnage) espace compris entre deux filets (cf. filet) et qu'on divise en deux cantons. - (45) |
| légnot, s. m. petit tas de fumier déposé en lignes pour être répandu sur le sol : « épincher eun légnot d' feumé. » - (08) |
| lègo : purin. (RDF. T III) - A - (25) |
| lêgot : eau qui stagne, et sale ; d'où endroit lègoteux : endroit où se trouvent des flaques d'eau ou des liquides sales ; et verbe « lègoter » : stagner (voir : lagô). - (56) |
| léhard : lézard. IV, p. 33 - (23) |
| lei - lit. - Vos é vu le tor de lei de lai Françoise Lucotte ? A n'a pâ de mon gout, moi, quoiqu'â sait de lai mode. - Dans les villes et chez les mossieurs en é des lei de ran ; vive les nôtes que sont hauts, bein hauts. - (18) |
| lei. Elle. Les Italiens disent aussi lei dans la même signification. Lei, de plus, signifie lit cubile, un lei, des lei, un lit, des lits. - (01) |
| leil, leilles : elle, elles - (46) |
| leiller : v. lier. - (21) |
| leilloure : s. m. lien pour attacher les bœufs. - (21) |
| lein, s. m. lien de bois ou de paille tordus, avec lequel on attache un fagot, une gerbe - (08) |
| leire la, leire lanleire. Cest un refrain burlesque aasez ancien… - (01) |
| leisir : s. m., vx fr. lesir, loisir. Avoir leisir, avoir le temps de. - (20) |
| lem : vendre du bétail à lem : vendre en bloc, sans estimation de poids - (34) |
| lema, s.f. limace. - (38) |
| lemace. s. f. Limace. (Yassy-sous-Pisy). - (10) |
| lémaice (n.f.) : limace - (50) |
| lémaice, s. f. limace. - (08) |
| lemaichan : Limaçon. « La gelée a bin fait retiri les côrnes es lemaichans » : la gelée a obligé les limaçons à rentrer leurs cornes, elle les a détruits. - (19) |
| lemaiche : Limace. « J'ai mis des cendres su mes pliants de salade pa détorner les lemaiches ». - (19) |
| lemaiche, s. f. limace. - (24) |
| lemaicheure : Fièvre aphteuse, cocotte. Cette maladie occasionne entre les deux ongles de sabot des ruminants une boursouflure qui a l'aspect d'une limace. - (19) |
| lemaiçon, sm. limaçon. - (17) |
| lème : vendre du bétail à lème = le vendre à l'unité ou en lot, sans se référer au poids. A - B - (41) |
| Lème : prénom : Edme. - (33) |
| lemècot : (l'mèso - subst. m.) limace. - (45) |
| lemeire. Lumière, lumières. - (01) |
| lemèle, sf. mamelle - (17) |
| lemère : Lumière. « Sofflier la lemère » : souffler la lampe. - (19) |
| lemire*, s. f. lumière. - (22) |
| lemire, f. lumière. - (24) |
| lemire, lemère : lumière - (43) |
| lende : Lente, larve de pou. « La tête de san ptiet est plieine de lendes ». - (19) |
| lende : s. f., lente, larve du pou. - (20) |
| lend'main : n. m. Lendemain. - (53) |
| lene : s. f. lune. - (21) |
| lène. s. f. Nielle, plante qui croit dans les blés ; Maladie des grains, qui convertit l'intérieur de l'épi en une poussière noire et fétide. - (10) |
| lénne, lune, laine. - (26) |
| lens ou lente. : OEuf d'où naît la vermine. (Du latin lens, graine, lentille.) - (06) |
| lens, dont le Dictionnaire de l'Académie a fait lente, œuf d'où naît de la vermine. Dans l'idiome breton, laouen signifie pou. - (02) |
| lent : Odeur de renfermé. « I sent le lent » : cela sent le renfermé. - (19) |
| lent, adj. légèrement imprégné d'humidité : des habits tout lents. - (24) |
| lent, adj. légèrement imprégné d'humidité. - (22) |
| lentibardaner : v. n., flâner. - (20) |
| lényo (subst. m.) 1 - dans un champ, enfilade de petits tas de fumier. 2 - ligneul, sorte de gros fil enduit de poix dont se servent les bourreliers. - (45) |
| lèpin, lapin. - (26) |
| lequé (pron.rel.) : lequel - (50) |
| lequé, laiquelle, adj. lequel, laquelle. - (08) |
| lequée : lequel - (48) |
| lequée : lequel - (39) |
| lequeu, lequel. - (38) |
| lequeùl, laqueùle, pr. rel., lequel, laquelle. - (14) |
| lequô : lequel - (57) |
| lequô : quel - (57) |
| lequœ, s. m. loquet. - (22) |
| lèr : (lêr - subst. m.) lard ; on le consomme comme une véritable friandise, cru ou grillé ... - (45) |
| lerd. s. m. Lard. (Ménades). - (10) |
| lèrdase : (lêrdas' - subst. f.) coupure longue et profonde ; balafre. - (45) |
| lèrdaser : (lêrdasè - v. trans.) lacérer, larder de coups de couteau. - (45) |
| lère (ein) : un porc gras à lard. (RDT. T III) - B - (25) |
| lerme. s. f. Larme. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| lèrmuze : (nf) lézard gris (arch.) - (35) |
| léron : rat ou loir - (60) |
| Lérot : diminutif de Hilaire - (48) |
| lérot : loir - (37) |
| Lérot. diminutif de Hilaire, nom d'homme. - (08) |
| lerze. adj. Large. (Ménades). - (10) |
| lerzement. adv. Largement. (Ménades). - (10) |
| lerzeur. s. f. Largeur. (Ménades). - (10) |
| lés : les - (48) |
| les ceû : ceux - (48) |
| les ceùs, pr. dém., ceux-là. - (14) |
| Les Clausiats : n. pr. Les Clausiats, lieu-dit entre La Forêt et Saisy. - (53) |
| Les Cul de Boûgni : Les Guttes Bonin - (48) |
| leschaivon. : Dévidoir. - (06) |
| lési n.m. Loisir. - (63) |
| lesquées : lesquelles - (48) |
| lesqués : lesquels - (48) |
| lesquôs : lesquels - (57) |
| lesquôs : quels - quelles - (57) |
| lessi, lissu. Eau de lessive. - (49) |
| lessis (l'si) : s. m., vx. fr. lessif, eau de lessive. Voir lissieu. - (20) |
| lessu (C.-d., Chal., Y.), lessi (Char.), lissu (Br.), leuchu (Morv.) lochu (Y.). - Eau de lessive, vient du vieux français lessiu, lessu, eau de lessive, venant lui-même du latin lixivus (qui a servi à la lessive). - (15) |
| lessu : eau de lessive. - (09) |
| lessu, eau de lessive. - (27) |
| lessu, l'chu, lechu, lochu. s. m. Eau de lessive. Du latin lix, lixivium. - (10) |
| lessu, n.m. eau de lessive. - (65) |
| lessus ou luchu. Eau de lessive. Luchu est une altération de lessus. Etym. lexivia, lessive ; Lixu, Luxeuil, station balnéaire ou on se lessive ! - (12) |
| lessus. n. f. - Eau de lessive. - (42) |
| lesves. : C'est ce qu'on nomme aujourd'hui laves, extraites de couches minces de calcaire pour couvrir des bàtiments. (Cout. de Châtillon , 1371.) - (06) |
| lét'e, s. f., lettre de l'alphabet, épître, missive. - (14) |
| létége. s. m. Laitage. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| lètieu : s . f. petit-lait. - (21) |
| letire : Litière. « Apporte dan in fagueut de peille pa fâre la letire es bâtes ». - « Etre su la letire » être malade, couché sur la litière, et au figuré en parlant des personnes, être fatigué au point de garder le lit. - (19) |
| lèton : s. m. petit cochon. - (21) |
| létse (à la —!) : en très mince quantité. - (30) |
| letsi : lécher - (43) |
| lette n.f. Lettre. - (63) |
| lette, s. f. lettre. - (08) |
| leû : (adj possessif) leur (s) - (35) |
| leu adj. poss. Leur. - (63) |
| leû, et leûs, pr. pers., leur, à eux : « Je leùs-y dirai. » - (14) |
| leu, ivraie ; en latin lolium... - (02) |
| leu, lent, leû : eux, leur, leurs - (46) |
| leu, leur, au singulier comme au pluriel ; leuz, devant une voyelle. - (16) |
| leu, leux : Leur, leurs. « Les sayous ant porté leu marande » : les faucheurs ont emporté leur diner. - (19) |
| leu, s. m. lieu, plan, endroit. Saulieu, ville frontière du Morvan, se prononce Sauleu : « en çaique leu », de place en place. - (08) |
| leû, s. m., lieu, endroit, pays. - (14) |
| leû, yeu : pron. pers. ind. et adj. poss. Leur. - (53) |
| leu. Ivraie. - (03) |
| leù. Lieu. An leù, au lieu. Leù est aussi de l’ivraie, loliium. - (01) |
| leu. Sureau, yèble (Sambucus ebulus). « Leu » désigne aussi le loup. - (49) |
| leu. V. llieu. - (05) |
| leu. : Ce mot a deux sens : il signifie lieu (du latin locum), et ivraie (du latin lolium). Ène mèche tôte de leu. ( Virg. vir. ch. VI.) - (06) |
| leuard. s. m. Sournois. Provenance inconnue. - (10) |
| leudiau.s. m. Délier. (Tharot). – A Montillot, on dit luyau. - (10) |
| leûe, ivraie. - (16) |
| leugement : Logement. « Les mossieux ant des biaux leugements » : les bourgeois, les riches ont de beaux logements. En parlant de quelqu'un qui a un nom bizarre : « Ol a in nam à couchi defô (dehors) d'ave in billet de leugement ». - (19) |
| leuger : lézard - (60) |
| leuger : voir léhard - (23) |
| leugi : Loger. « O n'est pas mau leugi » : il n'est pas mal logé. « Je sins leugis à la mouême enseigne » : nous sommes dans la même situation. - (19) |
| leùgne. Lune. - (01) |
| leugner : regarder dans une direction (lorgner ?). Surveiller, épier, guetter. En principe, action déshonorante ou pour le moins réprouvée (mais faisable...si on n'est pas vu !). Ex : "Argad'don la Mélie qui leugne darriée ses riyaux !" - (58) |
| leugnon. s. m. Intérieur de la noix, ce qui se mange. (Ourson, Migé). – C'est, une altération de neuillon. - (10) |
| leugnot : peu dégourdi. (LS. T IV) - Y - (25) |
| leuguè, purin. - (27) |
| leuguet : purin. (S. T III) - D - (25) |
| leuhard : voir léhard - (23) |
| leuhiau, s. m. bélier. (voir : lureau, lureai.) - (08) |
| leuillotte : n. f. Petite lumière éclairant très peu. - (53) |
| leujard : bélier. - (33) |
| leujard. s. m. Bélier. (Saint-Germain-des-Champs). - (10) |
| leujardai : mal voir. - (33) |
| leujöte, sf. logette. - (17) |
| leujotte. s. f. petit lézard gris qui habite les fentes des murs. - (08) |
| leumaisse : limace - (48) |
| leumé, v. a. éclairer. - (22) |
| leûmeire (éleùmer la), loc., allumer la lampe, la bougie. - (14) |
| leûmeire, s. f., lumière. - (14) |
| leûmeròte, s. f., lumignon, petite lumière, petite lanterne. - (14) |
| leûmesse, yimesse : (nf) limace - (35) |
| leumiére (n.f.) : lumière - (50) |
| leûmire : (nf) lumière - (35) |
| leun' : n. f. Lune. - (53) |
| leune (n.f.) : lune - (50) |
| leune (nom féminin) : lune. On dit aussi luine. - (47) |
| leune : (nf) lune - (35) |
| leune : la lune - lè pleine leune, la pleine lune - (46) |
| leune : lune - (43) |
| leune : Lune. « I fa clia de leune » : il fait clair de lune. « I faut plianter la salade en leune deure pa l'empôchi de monter » : il faut planter la salade quand la lune est au dernier quartier (lune dure) pour empêcher qu'elle monte en graine au lieu de pommer. - (19) |
| leune n.f. Lune. - (63) |
| leunè : adj. Luné (bien ou mal luné). - (53) |
| leune, lune. - (16) |
| leune, s. f. lune : « c'étô eun poure hon-m' que gairdô lai leune dé lous », c'était un pauvre homme qui gardait la lune contre les loups. Se dit d'un niais qui fait un ouvrage inutile. Trou du grenier à foin, ouverture du fenil. - (08) |
| leûne, s. f., lune : « Au clar de la Ieûne... » Au figuré, trou, vide, etc. A un qui n'avait pas mangé depuis la veille : « Vos devez avouer eùne fameuse leùne dans l'ventr'. » - (14) |
| leûner : errer - (57) |
| leûner : flâner - (57) |
| leunette n.f. Lunette. - (63) |
| leupe : fainéant - (39) |
| leupe, s. f. huppe, oiseau qui a une touffe sur la tête. - (08) |
| leupe, s. f. s'emploie comme terme de mépris appliqué aux chiens dans cette exclamation usitée pour les chasser : « tessi peute leupe ! » : file, vilaine carogne ! - (08) |
| leuppe (eune) : une chienne sans race. (EDSEA. T II) - A - (25) |
| leuque : Loque. « Ses habits sant en leuques ». - (19) |
| leuquer : Branler, être mal attaché. « Ol a tojo in fé que leuque » : il a toujours un fer qui cloche, il a toujours quelque chose qui cloche, il est comme un cheval dont les fers tiennent mal. - (19) |
| leur se dit souvent pour eux, pronom personnel. Ainsi, leur deux, pour eux deux. - (10) |
| leura : bélier. (SY. T II) - B - (25) |
| leurâi : bélier. (MM. T IV) - A - (25) |
| leûre (n.f.) : loutre - (50) |
| leûre : Loir. « Ol est gras c'ment in leûre ». - (19) |
| leûre : Longue courroie de cuir servant à fixer le joug sur la tête des bœufs. La leûre qui est fixée au joug par une cheville est encore allongée par une corde appelée coûdeleure (coue de leûre). - (19) |
| leûre, s. f. loutre, animal de la famille des martres, très commune dans notre pays de rochers, d'étangs et de petites rivières poissonneuses. - (08) |
| leure. Loutre. - (03) |
| leûrne (faire la) : bouder. (RDB. T III) - S&L - (25) |
| leurne (faire la) : faire la moue. (S. T IV) - S&L - (25) |
| leurre : loutre. A - B - (41) |
| leurre : loutre. (C. T IV) - S&L - (25) |
| leurre. Blaireau. « Gras c'ment in leurre » pour « bien gras » est très employé. - (49) |
| leus, leus-tés adj. poss. Leurs. - (63) |
| leussu, eau qui a passé sur les cendres d'une lessive ; en latin lexivium. C'est à tort que, dans le Châtillonnais, on dit léchu, comme en Champagne... - (02) |
| leussu. : Eau qui a passé sur les cendres d'une lessive (en latin lexivium). On dit aussi léchu (Châtillonnais) ; en Bresse, on dit lissu. (Guill.) - (06) |
| leuter (se), v. réfl. se lutter, essayer ses forces dans une lutte, se prendre corps à corps : il n'est pas si fort que moi, nous nous sommes déjà « leuté. » - (08) |
| leuter. v. n. Fouiller, chercher partout. - (10) |
| leutin, s. m. lutin, esprit malin, petit démon qui est un spécialiste en ce qu'il s'occupe surtout à friser pendant la nuit le poil ou le crin des animaux. - (08) |
| leutot, luteriot : luette. - (32) |
| leûtot, lûtot : gosier - (37) |
| leutré : 1 adj. inv. Malfaire. - 2 v. pr. Se vautrer. - (53) |
| leutré, adj., souillé, sali, fatigué - (40) |
| leutré, e, adj. se dit d'une scie qui est mal dirigée et qui ne coupe pas d'aplomb. - (08) |
| leutrer (se), v., se salir. - (40) |
| leutsi, latsi v. Lècher. - (63) |
| leuvè, l'vè : v. t. et n.m. Lever. - (53) |
| leuve. Lève. Ai se leùve, il se lève. - (01) |
| leuve-cul n.m. Insecte qui relève son abdomen, le plus connu est le staphylin noir appelé aussi "diable". C'est un excellent auxiliaire du jardinier, il ne pique pas mais il peut mordre. - (63) |
| leuvée, s. f. levée, chaussée d'étang. - (08) |
| leùver (se), v. pr., se lever, sortir du lit : « O s’leuv’ tard, é pi ô va bouére... » - (14) |
| leùver, v. tr., lever, soulever. - (14) |
| leuver. v. - Lever. - (42) |
| leuver. v. a. lever, soulever : « a leuve bin lai tête », il est bien fier. - (08) |
| leux (yeux) : leurs - (51) |
| leux : leur - (51) |
| leuyard : voir lehard - (23) |
| leuzer : voir léhard - (23) |
| leuzotte. s. f. Lézard. (Courgis). - (10) |
| leu-z-y loc. prép. Le leur. - (63) |
| levaing (n.m.) : levain - (50) |
| levaingn', s. m. levain du pain. - (08) |
| levan, Levant. - (01) |
| lève-cul : s. m., nom générique donné à certains coléoptères dont l'abdomen est souvent relevé, surtout pendant la marche. Le plus commun est le staphylinus oleus. - (20) |
| levée : digue d'un étang - (44) |
| levée, n.f. digue de l'étang. - (65) |
| lévené, s. f. lève-nez, fille évaporée qui a le nez en l'air, curieuse, impudente. - (08) |
| lève-nez, jeune fille effrontée. - (27) |
| lever : Lever. « Y est pas le tot de se lever le métin, i faut se trouer à l'heure » : ce n'est pas le tout de se lever le matin, il faut être arrivé à l'heure. C'est une variante du proverbe : rien ne sert de courir, il faut partir à point. - « Lever le cul » ruer. « La j'ment a levé le cul » : la jument a rué (voir ginguer). - (19) |
| lever : v. a., enlever. Lever une tache. - (20) |
| lever. v. a. Accoler, attacher la vigne aux échalas. (Plessis-Saint-Jean, Souey). - (10) |
| léveur : pâtée pour volaille et porcs. (RDM. T III) - B - (25) |
| leveur. s. m. Synonyme de biquier, de coquetier. – Se dit aussi des ouvriers qui cordent, qui lèvent, qui empilent régulièrement le bois et le charbon dans les ventes. - (10) |
| lévié, s. m. évier. La pierre de « lévié » est une pierre creuse à l'une de ses extrémités d'où s'écoulent les eaux de vaisselle. - (08) |
| lèvier n.m. Evier. - (63) |
| lévier : s. m., évier, et, par extension, souillarde. Le lévier. - (20) |
| lévier, évier. - (27) |
| lévier. Évier. (Agglutination de l' -avec évier-). - (49) |
| levin, s. m. alevin, jeune élève, nourrisson. - (08) |
| levon, s. m., bouillon blanc. - (40) |
| levot, leveussaint - divers temps du verbe Lever. - Es aute foi â levo in quairtau sans se geingnai ; ma le temps passai n'â pu. - Lote père n'â pas rasonabe ; â vouro que ses enfants leveussaint in sai pliain. - (18) |
| lévou ou lavou. Adverbe de lieu. Lévou don qu’al ai choi signifie : où donc est-il tombé. - (13) |
| levrauter, levrouter : v. n., prendre la couleur du lièvre, se bronzer. Se dit en parlant des fruits, notamment du raisin blanc. - (20) |
| levrete : mâche, doucette - (43) |
| levrette : s. f., mâche. Voir poupée. - (20) |
| levrette, n.f. mâche. - (65) |
| lévriot. s. m. Levraut. - (10) |
| levrœte, s. f. mâche, doucette des vignes. - (22) |
| levrœte, s. f. mâche, doucette des vignes. - (24) |
| levrouté, adj. se dit des raisins arrivant à maturité extrême : la vendange levroutée donne du vin riche en sucre. - (24) |
| levrouté, v. n. se dit des raisins arrivant à maturité extrême. - (22) |
| lèvure : la pâtée - (46) |
| Lexî (l’) : (l’) Alexis - (37) |
| léyé, lier. - (16) |
| lez, prés de. Ce vieux mot ne s'applique plus qu'aux noms de villages ou de hameaux : Montagny-lez-Beaune ; Saint-Prix-lez-Arnay. - (13) |
| lez. Ce mot, qui signifie près de, est plus vieux que notre idiome bourguignon ; car, dans l'idiome breton, lez (au pluriel lézou) signifie bord, limite. (Le Gon.) Lez ar mor, près de la mer. - (02) |
| lézârde (na) : lézard - (57) |
| lézi, loisir. - (16) |
| lezi. : Loisir. - (06) |
| l'herbe annonce un fourrage abondant pour le moment où l'on mettra le bétail au pâturage. - (20) |
| li - à lui, à elle (en mouillant un peu l’l). - I li ai dit les véritai qu'à mérito. – A li ant recommandai de veni ai cinq heures. - Vos airâ soin de li défende carrément. - Dans ce cas ci, on mouille ordinairement beaucoup. - (18) |
| li (fleur de), s .f. fleur du lis. - (24) |
| li (fleur de), s. f. fleur du lis. - (22) |
| li : (pr. pers. complément) elle ; « vé li » chez elle - (35) |
| li : A lui, à elle. « Dis banjo à c'te dame a peu donne li cinq sous » : dis bonjour à cette dame et tends lui la main. « Demande li sa nom » : demande lui son nom. - (19) |
| li : elle - (51) |
| li : lui - (57) |
| li pour le lui ; j'li diré, je le lui dirai. - (16) |
| li pron. pers. Elle. Y'est peur li, y'est pas peur lu. - (63) |
| li : s. m. lit. - (21) |
| li, leu. pronom, personnel. Lui. Ç’o leu tout décréché, c'est tout à fait lui, c'est lui tout craché. - (10) |
| li, lu pron. Pers. Lui. Ô li dit qu'y'est malgré lu. Il lui dit que c'est malgré lui. - (63) |
| li, pr. pers., lui, elle : « J'vons li dire. » - (14) |
| li, pron. de la . 3e personne du sing. rég. indirect du verbe. Lui, elle. - (08) |
| lî, s. m., lit (le distinguer des deux mots suivants). - (14) |
| li, sm. lis ; souvent oignon de lis. - (17) |
| li, temps de verbe, lu : « J'ai li ma leçon. » - (14) |
| li, vé li, yé li : elle, chez elle, c'est elle - (43) |
| li. Lui, au datif. Les Italiens le disent de même. C’est aussi l’aoriste du verbe lire. J'ai li, j'ai lu. - (01) |
| li. pro. pers. - Lui. - (42) |
| liâ : Liard. « Mâ ol est dan bin cheti (polisson), o ne vaut pas deux liâs ! ». « O n'est pas pu haut que deux liâs de beurre » : il est tout petit, pas plus haut que deux liards de beurre. - (19) |
| liâche : Plante sauvage, famille des chardons. « Des liâches pa les lapins ». - Liâche peunarde - Lataca Serriola. Plante nuisible dans les champs. A mauvaise odeur. Voir peunâ. - (19) |
| liage fourou, s. f., clématite sauvage. - (40) |
| liain-ne : Elle. « Tot cen est à lian-ne » : tout cela est à elle. On emploie également la forme lyine. Voir ce mot. - (19) |
| liaitte, tiroir... - (02) |
| liaitte. : Layette, tiroir d'un meuble. En vieux français liéton signifie petit coffre. (Lac.). - C'est par extension qu'on a donné au mot layette le sens de nippes d'un nouveau-né, en appliquant le contenu au contenant. Ce mot nous a été importé au commencement du XVe siècle par les Anglais avec certain nombre d'autres signalés dans ce vocabulaire. - (06) |
| liaper : Laper. « Donne voir eune assiétte de sope au chin ol ara bin asseteut fait de la liaper ». - (19) |
| liapoux : Gluant. « Je n 'aime pas ce qu 'est liapou ». - Bardane, plante dont les grains s'attachent aux vêtements. - (19) |
| liard de beurre : s. m. servant à indiquer un volume minime. Voir once de beurre. - (20) |
| liare tèrése. Lierre terrestre. - (49) |
| liàre-lharèse, lierre-thérèse. s. m. Lierre terrestre. (Guerchy, Mouffy, Argentenay). - (10) |
| liarne : Lierne, terme de construction, pièce de bois qui relie d'autres pièces. - (19) |
| liasse. s. f. Jarretière. (Turny). - (10) |
| liau : Employé seulement dans l'expression « jeter liau » qui signifie jeter loin, se débarrasser. « Qu'est-ce que te veux que je fiais de cen ? Jete z-y liau ». - (19) |
| Liaude : Claude. Au féminin : Liaudine. Autrefois : Dôdan ; Dôdiche. La foire de la Saint-Liaude (6 Juin) est l'une des plus importantes foires de Brancion. Plus récemment on disait Glaude, la Glaudine. - (19) |
| liauvans. V. lavau. - (05) |
| liàvan, adv. de lieu, là-bas. - (14) |
| liavent : Là-bas. « Apporte me dan man pané (panier) qu’est liavent au bout de la vigne ». « Liavent d'lé » signifie, là-bas de l'autre côté. - (19) |
| liavroux : adj., syn. de gasi. Du pain liavroux. - (20) |
| libarâbye adj. Libérable. - (63) |
| libarer v. Libérer. - (63) |
| libarté : Liberté. « L'abre de la libarté » arbre planté en 1848 sur une place publique. - (19) |
| libarté n.f. Liberté. - (63) |
| libarté, s. f. permission, licence : prendre la « libarté » de parler à son maître. - (08) |
| libàrté, s. f., liberté, permission, hardiesse. - (14) |
| libartin : Dissipé, qui aime s'amuser et néglige son travail. « Les garçans d'aujord'heu sant in ptiet bout treu libartins » : les jeunes gens de notre époque aiment un peu trop à s'amuser. - (19) |
| libartin, libertin, ine, adj. espiègle, dissipé, étourdi : un garçon « libartin », une fille « libartine. » - (08) |
| libartiner, v. n. jouer, se dissiper en amusements folâtres. - (08) |
| libatin. Libertin, libertins… - (01) |
| libe : dalle de pierre. - (66) |
| libe adj. Libre. - (63) |
| liberquin. s. m. Vilebrequin. (Parly, Lainsecq, Perreuse). - (10) |
| libertingne. s. m. et adj. Libertin, dans le sens d'étourdi, léger, aimant un peu trop le jeu ; n'implique en aucune façon le dérèglement des mœurs. (Savigny-en-Terre-Plaine). - (10) |
| libo : crapaud. (E. T IV) - S&L - (25) |
| libot : 1 n. m. Crapaud. - 2 n. m. Petit bonhomme rond et trapu. - (53) |
| libot. Sorte de crapaud. Je pense que l'article s'est agglutiné avec le substantif : libot pour le bot. Ce dernier mot est le cri monotone du batracien. - (13) |
| libou, s.m. crapaud. - (38) |
| libre : disponible - (61) |
| libre, adj., déluré, leste, étourdi : « Alle é prou gentite ; ma alle é trop libre. » - (14) |
| lic’ée, loç’ée : léchée, embrassée - (37) |
| lic’er, loç’er : lécher, embrasser - (37) |
| lic’ette : petit morceau - (37) |
| lichate : Loquette, mince tranche. « Cope me voir eune ptiète lichate de jambian ». Une lichate est une tranche coupée en glissant, en lichant. - (19) |
| liche (d'la) - sagne (d'la) : laîche - (57) |
| lichée : lapée ( ?). Ce qu’on peut prendre avec la langue en lapant. Ce n’est pas tout à fait la lampée. - (62) |
| lichée, s. f., lapée, lippée, ce que la langue prend en léchant, en buvant, en lapant : « Je l'y é tendu la tasse ; ô vous en a pris eùne fameuse lichée. » - (14) |
| licher : boire. - (31) |
| licher : lécher, boire - (48) |
| licher ou lichî : glisser. « ôl’a lichi su’ un’marde » : il a glissé sur une crotte. - (62) |
| licher : lécher - (39) |
| licher, v. a. lécher, passer la langue sur quelque chose. « licer » ou « lisser. » - (08) |
| licher, v. intr., glisser : « Prends garde ! y a pleùvu, y é mau ; t'pourôs ben licher. » - (14) |
| licher, v. tr., lécher, avaler, boire avec trop de complaisance : « Le gas, ôl a liché toute la boutoille! » - (14) |
| licher, v., boire. - (40) |
| licher. Lécher. Fig. « Se licher », c'est manifester le plaisir éprouvé en mangeant ou en buvant quelque chose de bon. On dit aussi « se relicher » ; « s'en relicher les babines ». - (49) |
| licher. v. - Lécher. - (42) |
| licheròte, s. f., glissoire : « Si t'voux, en sortant d'clâsse, y a eùn endrèt oùsqu'y a jaulé ; j'y pousserons eùn licheròte. » - (14) |
| lichette - (39) |
| lichette. Morceau de pain très mince. Par extension, petit morceau. - (49) |
| lichette: petite quantité - (48) |
| licheu : s. m. eau de lessive. - (21) |
| licheute : une petite goutte. - (66) |
| lichi : Glisser. « Y a du varglié (verglas) prends gârde de lichi ». - (19) |
| lichi : lécher - (57) |
| lichi : licher - (57) |
| lichôle : Glissade, glissoire. « Fare la lichôle » : glisser après avoir pris son élan. La lichôle est la piste marquée par les sabots des glisseurs. - (19) |
| lichot-corant : Noeud coulant « Ol a étranlli in lièvre au lichot-corant » : il a étranglé un lièvre au moyen d'un noeud coulant. - (19) |
| lichotte : une petite quantité de nourriture ou de boisson, on dit aussi laichotte - (46) |
| lichotte, s. f. petite quantité. - (40) |
| lichou, s. m. gourmand, sensuel de la bouche, ivrogne. - (08) |
| lichoû, s. m., lécheur, qui aime à boire, qui caresse trop souvent la bouteille. - (14) |
| lichu : Eau de lessive. « T'as bien mis des cendres su le boiri, tan lichu pourrait bin être treu ancre » : tu as mis beaucoup de cendres sur le cuvier, ton eau de lessive pourrait être trop acide. - (19) |
| lico (on) : licou ou licol - (57) |
| lico, licou, licol. - (16) |
| licò, s. m., licou, ou licol. - (14) |
| licô. Licou. - (01) |
| liçon. s. f. Leçon. (Ménades). - (10) |
| licot - loquet d'une porte. - Pour euvri en faut pésai fort su le licot ; car al à dur. - Te mettrez in bout de bô su le licot pour qu'en ne peuve pâ le levai. - (18) |
| licote, licotte (n.f.) : ancien verrou dont la poignée se soulève - (50) |
| licòte, s. f., loquet de porte ; suffit aux paysans. - (14) |
| licote. s. f. Pièce de terre de minime étendue et de peu d'importance. (Perrouse). – Se dit pour loquotte, de loque, pièce, parcelle, morceau. - (10) |
| licòter, v. intr., osciller, se dit d'une porte dont la licòte a trop de jeu. — Signifie aussi : soulever le loquet de la porte. - (14) |
| licoter, v. n. se dit d'une porte qui remue, qui s'agite par l'effet du vent ou de toute autre cause, lorsque la « licote » a trop de jeu et ne la maintient pas fixe. - (08) |
| licotte (n. f.) : petit champ de faible superficie - (64) |
| licotte : loquet de fermeture de porte - (48) |
| licotte : (likot' - subst. f.) sorte de loquet formé d'une clenche qui s'engage de son propre poids dans un mentonnet fixé au chambranle, ou s'en dégage sous l'action d'un petit levier. On appelle un chouâchou: d'likot' (litt. "un presseur de loquet") un homme peu sérieux, et volontiers parasite, qui, au lieu de vaquer à ses travaux, préfère importuner tout le voisinage par ses visites fréquentes. Cela peut être aussi un coureur de dot ! - (45) |
| licou : licol - (48) |
| lictue, s. f. lecture, action de lire. - (08) |
| lie : s. m., lie. Du lie de vin. Voir alie. - (20) |
| lie. Elle. - (49) |
| lie. v. - Lire. - (42) |
| liee, adj. libre : « a n'ô pâ libe », il n'est libre. - (08) |
| Liénar, Linair. Nom d'homme, usité pour Léonard. - (08) |
| lienne : voir meuhaigne - (23) |
| liens : faire les liens (prononcer yens...comme chien !). Ceinturer une gerbe avec une poignée de paille avec ses épis, en prélevant dans le blé coupé la quantité nécessaire au lien. Se pratiquait avant l'arrivée de la moissonneuse-lieuse à traction hippomobile (et encore pendant, l'outil étant rare, car coûteux). Marques : Mac Cormick ou Deering. Ex : "Attention tes doués, dans les yens n'a ben du chardon !" (Doués = doigts). - (58) |
| lier, v. a. mettre sous le joug. Se dit en parlant des bœufs, parce que le joug est fixé avec de longues courroies. Lier et délier les bœufs ou les vaches est le terme usuel pour exprimer l'action d'atteler ou de dételer ces animaux. - (08) |
| lierge. Nom bourguignon de la plante appelée laiteron. - (13) |
| lierre : s. f., lierre. Ne pas confondre la lierre avec la lièvre. - (20) |
| liérrû (-use) (adj.m. et f.) : plein de lierre - (50) |
| liette : Tiroir. « J'ai rangi tan cutiau dans la liette » : j'ai rangé ton couteau dans le tiroir. - (19) |
| liette, litte : s. f., vx fr. layette, tiroir. - (20) |
| liette, s. f. tiroir (du vieux français layette). - (24) |
| lieu, leu, pron. pos. leur, à eux. Se lie à la voyelle qui suit par un z : « i vâ lieu ou ieu-z-i-dire », je vais le leur dire. - (08) |
| lieu, leur : en lieu vouet lieu côtes, disait la femme de Boiret à son mari, en parlant de ses chevaux (on leur voit leurs côtes). - (38) |
| lieu, nom de loc. Le substantif lieu marquant la résidence, la demeure. - (08) |
| lieue carrée : s. f., ancienne mesure de surface en général. La lieue carrée de Paris valait 24 kilomètres carrés 992. - (20) |
| lieue : s. f., ancienne mesure de longueur pour les chemins. La grande lieue de Paris ou lieue de poste, de 12,000 pieds, valait 3,898 m. 073. La petite lieue de Paris était moitié de la grande. La lieue de Mâcon, de 15,000 pieds, valait 4,872 m. 585. La lieue de Dijon, de 18,000 pieds, valait 5,847 m. 103. - (20) |
| lieur de (au), lieur que (au). locution adverbiale. Au lieu de, au lieu que. - (10) |
| lieures - liures, liens. - Lai peille, ceute année, n'â pâ aissez grande pou fâre des bonnes lieures. - Lai corrère â in pecho trop dure ; peurnez don pou fâre vos lieures tot simplieument des grands joncs. - (18) |
| Lieutmer (la). Petit lac en forme d'entonnoir situé à un kilomètre de Moulins-Engilbert. - (08) |
| liévrasse. s. f. Femelle du lièvre. (Savigny-en-Terre-Plaine). - (10) |
| lièvre (un’e) : lièvre (un). L’inversion des genres est à remarquer (Comme pour vipère et serpent). On prononcera souvent « la ièvre » et on dira aussi capucin pour la forme de capuche donnée par les oreilles rabattues. - (62) |
| lièvre : s. f. La lièvre. - (20) |
| lièvre, n.f. lièvre mais du genre féminin (la lièvre). - (65) |
| ligé, léger ; Sèn Ligé, saint Léger. - (16) |
| ligé. adj. - Léger. - (42) |
| ligée-terre. n. f. - Terre légère, facile à travailler. (Sainte-Colombe-sur-Loing) - (42) |
| ligei. Léger, légers. C'est aussi quelquefois un nom propre. Saint Ligei, saint Léger, S. Leodegarius… - (01) |
| ligei. : Léger. - (06) |
| ligeire. Légère, légères. - (01) |
| ligeou : partie pivotante devant le chariot. - (33) |
| liger, e, adj. léger, légère. (voir : ailiger.) - (08) |
| liger. adj. m. et ligée. adj. f. Léger, légère. Semer en terre ligée. (Lainsecq). - (10) |
| lignaige. Lignage, race. - (01) |
| ligne carrée : s. f., ancienne mesure de surface en général, valant 5 millimètres carrés 085. - (20) |
| ligne cube : s. f., ancienne mesure de volume en général, qui valait 0 mètre cube 000000011420, c'est-à-dirè près de 11 millimètres cubes 1/2. - (20) |
| ligne : s. f., ancienne mesure de longueur en général, qui était le 1/144 du pied, comprenait 12 points et valait 0 m. 002. - (20) |
| ligneau, s. m. ligneul, gros fil dont se servent les cordonniers pour coudre les chaussures ou pour y mettre des pièces. - (08) |
| ligneau. s. m. Plante grimpante, espèce de volubilis sauvage. – Se dit aussi pour ligneul ou fil poissé des cordonniers. (Sainpuits). - (10) |
| ligneut : Ligneul, fil frotté de poix à l'usage des cordonniers. « Tiri le ligneut » : exercer la profession de cordonnier. - (19) |
| ligneux : s. m., ligneul (de cordonnier). - (20) |
| ligno, ligneul, gros fil de cordonnier. - (16) |
| ligno. Poli, uni. La glace est lignote. - (03) |
| lignòl, s. m., ligneul, fil poisseux des cordonniers. La prononciation supprime volontiers le l, ce qui, à l'oreille, fait ressembler ce substantif à l'adjectif lignât, qui suit. - (14) |
| lignot : lisse - (57) |
| lignòt, adj., poli, uni, glissant : « Méfie-te ! t'vas licher ; la gliace é ben lignòte. » - (14) |
| lignot, poli, uni. - (05) |
| lignot. n. m. - Ligneul, fil poissé du cordonnier. - (42) |
| lignot. Uni, sans aspérité. J'aiIlons glisser su lai mare, lai glièce ast ben lignote. - (13) |
| lignu, ligneul des cordonniers. - (05) |
| ligoche. s. f. Limace. (Arcy-sur-Cure). - (10) |
| ligot, laigot : n. m. Purin. - (53) |
| ligote, s. f. loquet qui se soulève en pesant et qui, à défaut de serrure, ferme les portes dans nos campagnes. - (08) |
| ligöté, vt. ligoter. - (17) |
| lihon : voir liron - (23) |
| lihoutris. s. m. Bourbier. (Saint-Florentin). - (10) |
| lii, lui. - (38) |
| Liierge, s. f. chardon blanc. - (11) |
| lîjâ n.m. Lézard gris. - (63) |
| lijeu : glisser. - (29) |
| lijou : (lijou: - subst. m.) lisoir, pièce de bois transversale, à laquelle est assujetti l'essieu avant du char, et sur quoi pivote le "tournoir" ; l'ensemble compose le "plotage" avant. - (45) |
| lijou: train pivotant du chariot - (48) |
| likéte, tranche très mince et très petite de pain. - (16) |
| li-lai (pr.dém.m.) : celui-là - (50) |
| limace du foie, loc. (V. Dauge.) - (14) |
| limaçure, limassure : s. f., limace, limasse, maladie des bovidés qui les fait boiter et même les empêche de marcher ; lenteur, mollesse, chez les personnes. - (20) |
| limas : limace. IV, p. 31 - (23) |
| liméro, luméro. n. m. - Numéro. - (42) |
| liméro, luméro. s. m. Numéro. - (10) |
| limèro. Numéro. - (49) |
| limoge : s. f., coton à marquer. - (20) |
| limoge, s. f. coton rouge à marquer le linge. - (24) |
| limon d'scie : oiseau annonciateur de la pluie - (46) |
| limon, s. m. raie ou sillon dans nos labours pour l'écoulement des eaux. - (08) |
| limonère : mot féminin désignant le limon (le timon + les brancards) - (46) |
| limonire : limonière - (51) |
| limonîre n.f. Partie d'une voiture attelée formée de deux limons ou brancards. - (63) |
| limou (on) : limeur - (57) |
| limouge, s. f. coton rouge à marquer le linge. - (22) |
| limougnat (du) : bave d'escargot - (61) |
| limougner. s. m. Limonier, cheval de limon. - (10) |
| limousine, s. f. manteau de laine grossière et rayée dont se couvrent les charretiers en hiver ou en voyage. - (08) |
| limoutzi : mésange. (BEP. T II) - D - (25) |
| lîn (on) : lien - (57) |
| lin : (nm) lien - (35) |
| lin : lien - (43) |
| lin : Lien. « In fagueut de peille à deux lins ». - (19) |
| lin : s. m. lien. - (21) |
| lin d’bôs : (nm) lien de fagot, de gerbe (cf « rôte » infra) - (35) |
| lin : lit. (PLS. T II) - D - (25) |
| lin, lit. - (26) |
| lina : Lilas, syringa vulgaris. Lina n'est guère employé que par les enfants dans la formule de jeu de boudot : « boudot, lina, cruge de cala ». Voir boudot. On dit plutôt lilas. - (19) |
| Linair, Linard : diminutif de Léonard - (48) |
| Linard : prénom : Léonard. - (33) |
| Linard. s. m. Diminutif de Léonard (Perreuse). - (10) |
| linas, lilas. - (05) |
| linces : larves dans les bois, le fromage; petits vers. - (30) |
| linceul : s. m., drap de lit. - (20) |
| linceul, s.m, linceul : drap que l'on mettait autrefois sur le cercueil, et qui restait la propriété du prêtre ; plus tard on mit le cercueil sous une belle pièce de drap noir avec une croix blanche comme on ne voyait plus le linceul, il fut de plus en plus usé et les curés firent des réclamations. - (38) |
| lincher. Synonyme patois de glisser. - (13) |
| linciò, s. m., linceul, drap de lit. A Saint-Usuge, une mariée reçoit toujours, de sa mère, le matin de ses noces, une pièce de toile, destinée à lui servir de linceul. Malheur à qui la taillerait pour s'en faire du linge ! - (14) |
| linçu, s. m. drap de lit (du vieux français linceul). - (24) |
| linçùye, s. m. drap de lit. [Linceul]. - (22) |
| lindi : Lundi. « Fare la saint Lindi » : aller au cabaret le lundi au lieu de travailler. - (19) |
| lindze : linge - (51) |
| lindze linge - (43) |
| lindze n.m. Linge. - (63) |
| linge (du) : habit - (57) |
| lingre, adj. étroit, grêle, mince. - (08) |
| lingröte, sf. petite bande de terrain très étroite. - (17) |
| lingue (n.f.) : langue - (50) |
| lingue de boeû (n.f.) : orchis des champs - (50) |
| lingue : (lin:gn' - subst. f.) laine. Lin:gn' bouèj', laine brute. - (45) |
| liniöt, öte, sm. f. linot, linotte. - (17) |
| linme, sf. lime. - (17) |
| lin-ne, s. f., laine. - (40) |
| lin-nére s. f. lanière. - (21) |
| linsu : Linceul, drap de lit. « Alle mis eune pare de linsus preupes (propres) dans san lit ». - (19) |
| linze : linge - (39) |
| linzé, vn. glisser. - (17) |
| linzer : glisser ou faire un faux pas sur une pente lisse. (CLB. T II) - C - (25) |
| linzer, glisser. - (26) |
| lio et lo - eux, leur, à eux. - C'â lô bêtes qu'an aibimai le prai. - A croyant vraiment que ci liô z-â dû. - En liô z-é beillé quéque so. - Vo liô diras qu'à me peurnaint en passant. – En lio z-en dit de tote les couleurs. - Quelquefois au lieu de l’l dans lo on met un z, ainsi c'â z-ô deux, au lieu de câa l'ô deux. - On peut voir Lor et Lotte. - (18) |
| liœt’e*, s. f. tiroir. - (22) |
| Lionne (la), nom de rivière : l'Yonne. elle , prend sa source à Glux-En-Glenne, non loin de Château-Chinon. - (08) |
| Lionore : Eléonore. « L’homme à la Lionore » : le mari d'Eléonore. - (19) |
| liotte ou, plutôt, yotte, qu'on prononce ainsi pour glotte, en mouillant le gl. Se dit d'une personne bavarde, qui a trop de langue. – Se dit ausst pour luette. J'ai la yotte enflée. - (10) |
| liotter. v. n. Contraction de lisotter. Commencer à lire. (Sommecaise). - (10) |
| liovo : Là bas au loin, indique un lieu plus éloigné que « liavent ». « I est jusque liovo » : c'est là bas très loin. - (19) |
| lipai, lécher. Lipa en breton. (Le Gon.) - (02) |
| lipe, sf. dalle, roche plate taillée pour couvrir une muraille. - (17) |
| lipiaux. n. m. pl. - Vêtements : « A c't'heu'e, alle pourtons su la piau des lipiaux en touèl d'araignée ». (Fernand Clas, p.l81) - (42) |
| lîpoûgraîs : dépôt de marc de café au fond de la cafetière ou de la tasse (peu usité) - (37) |
| lippe-lappai. : (Onomatopée), trembler, tremblotter. Littéralement, agiter ses lèvres, les lécher. - (06) |
| liqué : (nm) loquet - (35) |
| liqué : loquet - (43) |
| liquet n.m. Loquet de porte. - (63) |
| liquet, n.m. loquet. - (65) |
| liquet. Loquet. - (49) |
| liquette. Pan de chemise ; sens étendu : chemise, vêtement, habit. - (49) |
| liquette. Toute petite tranche, petit morceau d'une chose. Etym. diminutif de lèche, qui s'écrivait autrefois lesche, d'où leschette, puis lischette, enfin liquette. - (12) |
| liqueut : Loquet. « La pôrte est fremée au liqueut ». - (19) |
| liqueuter : Secouer le loquet. « Qu'u (qui) dan est veni liqueuter à ma porte? ». - (19) |
| liquiée. s. f. Litière. - (10) |
| liquot, s. m., loquet. - (40) |
| liquoter : v. a. et n., loqueter, secouer, tâtonner, agir avec hésitation ou par des voies indirectes. Auras-tu bientôt fini de liquoter cette serrure ? — Il est toujours à liquoter après les femmes des autres. - (20) |
| liquotte : s. f., vx fr. toquette, loquet, verrou. - (20) |
| lire de... : loc, lire quelque chose qui a été communiqué par... - (20) |
| lîre, lire ; j’l’é li, je l'ai lu ; j’lizi, je lus. - (16) |
| lirette : faire une chose à la — c'est la faire rapidement, souvent en dépit du bon sens. Soupe à la lirette: soupe vite faite, souvent parce qu'elle est réchauffée. - (30) |
| lîrette : oignon, échalote - (37) |
| liron : rat. IV, p..33 - (23) |
| lisàr, s. m., lézard : « Le p'tiot drôle! ô s'chaufe au soulô c'ment eùn lisàr. » - (14) |
| lisard : lézard vert. IV, p. 33 - (23) |
| lischer,v. glisser ; lécher. - (38) |
| lischotte, s.f. glissade. - (38) |
| lischu, s.m. eau de lessive faite avec de la cendre mélangée à l’eau dans le baquet. - (38) |
| lisé, vn. nettoyer les gerbes des végétations qui encombrent le pied des chaumes. - (17) |
| liseré , bordure d'une étoffe. En breton, liser signifie drap... - (02) |
| lisette : lézard gris. IV, p. 33 - (23) |
| lisette : lézard. (B. T IV) - D - (25) |
| lisette : petit lézard des champs. - (30) |
| lisette : petit lézard gris - (60) |
| lisette. s. f. Planche sur laquelle les femmes lavent le linge à la rivière. (Armeau). - (10) |
| lisiée. n. f. - Lisière : la lisiée du bouè. - (42) |
| lisiére (na) : lisière - (57) |
| lisoir : s. m., pièce de bois qui, dans un char, est superposée au massout. - (20) |
| lisoir, s. m., ensemble articulé d'un train avant de char. - (40) |
| lisou (-ouse) (n.m. ou f.) : liseur (-euse), ceui ou celle qui lit, lecteur (-trice) - (50) |
| lisoû, s. m., liseur, mangeur de livres sans profit. On cite plaisamment lisarde, que nous ne recueillons cependant pas. - (14) |
| lisoux, lisouse : adj., liseur, liseuse. A rapprocher de cette déclaration de principe, entendue dans un salon de Mâcon : « Mon mari n'est pas lecturier, et mol, j' suis pas lisarde. » - (20) |
| lisse (Avoir bonne). Locution très usitée à Auxerre. Se donner beaucoup de peine inutilement, avoir de la patience, tolérer, souffrir courageusement et même, quelquefois, bêtement, sans se lasser. Ta bonne lasse, ma poure enfant. - (10) |
| lissieu : s. m., v. fr. lessif, syn. de lessls. - (20) |
| lissieu, s. m. eau de lessive. - (22) |
| lissive, lessive; lissivé du linge. - (16) |
| lissive, s. f., lessive : « La Jean-néte s'é métu à couler sa lissive. » - (14) |
| lissiver, v. tr., faire la lessive. - (14) |
| lissiveuse, s. f., laveuse, lavandière, femme qu'on loue pour donner ses soins à la lessive. - (14) |
| lisson, s. f. leçon, chose apprise, semonce. - (08) |
| lissu : (nm) l’eau de la lessive - (35) |
| lissu, eau de cendres lessivées. - (05) |
| lissu, l’si : eau de la lessive - (43) |
| lissû, lissou, liç’u, luç’u : jus de la première lessive dans laquelle a trempé le linge très sale - (37) |
| lissu, lussu, et lussiau, s. m., eau de lessive. - (14) |
| lissu, subst. masculin : eau de lessive. - (54) |
| lissu. Eau cendrée dans laquelle on fait tremper le linge à lessiver. Nous disons lissive et lissiver, plus conformes au latin lixivium. - (03) |
| lisu (-e) (p.p.) : participe passé du verbe lire - (50) |
| lisu, part., de lire : « Mon live ôt tout lisu. » Quand il faut dire : lu, le paysan dit : liau ; mais quand il faut dire : lui, le paysan dit : lu, ou li. - (14) |
| lit d’coin : lit installé dans un angle de la pièce mais monté sur roulettes, et que l’on pouvait « avancer » sur des sortes de petits rails dépliants afin d’y aménager provisoirement entre lui et le mur une « ruelle » dans laquelle on se glissait pour le « refaire » - (37) |
| lit d'vaiche : placenta expulsé après le vêlage - (48) |
| lit' : n. m. Litre. - (53) |
| lit. (voir : mére.) - (08) |
| lit’e : litre - (37) |
| litchet (on) : loquet - (57) |
| lité, adj. de très bonne qualité, très bon, excellent. Se dit en parlant des choses et quelquefois des animaux. - (08) |
| lite. n. m. - Litre. - (42) |
| lite. s. f. Choix, élite. C'est avec la lite du blé qu'on fait la semence. - (10) |
| liteire. Litière, stramentum. Les pauvres gens disent : « El y é troi moi qu'el a su lai liteire », il y a trois mois qu'il est allié. Liteire est aussi une litière, lectica. - (01) |
| liter. v. a. Choisir, trier. - (10) |
| litére : n. f. Litière - (53) |
| litëre, litière. - (16) |
| litiannie, sf. litanie. - (17) |
| litiée : litière. Faite avec de la paille battue, également liée en gerbes en cours de battage, dans la botteleuse attelée à la batteuse. Ex : "Faut qu'j'allaient (pron j'allins) fée la litiée aux vaches, al est sale !" La litiée ramassée avec les excréments était conduite au fumier avec la bérouette. - (58) |
| litiére, s. f. paille étendue dans les étables ou écuries et sur laquelle les animaux se couchent. - (08) |
| litiöre, sf. litière. - (17) |
| litô, les deux règles de bois sur lesquelles glisse la planche d'un tiroir. - (16) |
| litron : s. m., ancienne mesure de capacité pour le sel, formant le 1/8 de octave, c'est-à-dire le 1/64 du mlnot, et contenant 0 litre 814. - (20) |
| liu : Lui. « O ne so pas de chez liu » il ne sort pas de chez lui. - (19) |
| liu ou lu : Lieu ; usité seulement dans cette locution : « En neguin liu » ou « En neguin lu » : en aucun lieu, nulle part. dans les autres cas lieu se dit andra. - (19) |
| liune : Lui. « Y en a guère c 'ment liune » : il n'y en a pas beaucoup comme lui. - « Cen liune » : ce qui lui appartient. « O ne traveille que cen liune » : il n'exploite que ce qui lui appartient. - (19) |
| livarnais. s. m. Nivernais. Se dit par vice de prononciation. - (10) |
| live : livre - (48) |
| live : livre - (39) |
| live, s. m. livre. - (08) |
| liv'e, s. m., livre. - (14) |
| livette, s. f. excoriation sèche qui se lève sur la peau dans le voisinage des ongles et qui est très sensible. - (08) |
| livotte : mets ou liquide sans goût, lavasse - (48) |
| livotte : (Iivot' - subst.f.) neige en cours de fonte. Synonyme de gyapot' - (45) |
| livre : s. f., ancienne mesure de poids, comprenant 16 onces et valant 89 grammes 505, c'est-à-dire presque un demi-kilogramme. - (20) |
| livrée de terre. : Bien-fonds, produisant une livre de revenu. (Franchises de Salmaise de 1265.) - (06) |
| livret : s. m., transparent d'écolier, au dos duquel est imprimée la table de multiplication appelée couramment « livret ». - (20) |
| livrô. Livret, livrets, petit livre, petits livres. - (01) |
| livròt, s. m., petit livre. Ici le r se prononce. - (14) |
| lîye, pr. elle. - (24) |
| lizâ : (nm) lézard - (35) |
| liza : lézard - (43) |
| lizard, lizarde : s. m. et f., lézard. - (20) |
| lizârne : Luzerne, medicago sativa. « Ol est allé sâ eune heutée de lizârne pas ses bâtes » : il est allé faucher une hottée de luzerne pour son bétail. Champ ensemencé en luzerne, luzernière. « Ol a atfié eune bonne lizarne » il a crée une bonne luzernière. - (19) |
| lizé, glisser... - (02) |
| lizé, glisser. - (16) |
| lizé. Lisez legite, ou legitis vous lisez. - (01) |
| lizé. : Glisser, et lizeu, glissoire, endroit glissant et uni, pratiqué sur la glace par les écoliers ; ces mots viennent de l'ancien haut allemand lise, d'où le mot français lisse (Littré), ou de l'allemand moderne leise (Diez) ; le dicton : al é su le lizeu, signifie il est dangereusement malade. - (06) |
| lizeire. Lisière… - (01) |
| lizer. Glisser sur la glace. Prononciation locale précieuse et affectée. - (12) |
| lizerarde, s. f. lézard gris. - (22) |
| lizëre, lisière. - (16) |
| lizeu. Glissoire. Comme on est en grand danger de tomber quand on est sur une glissoire, on a dit de là en bourguignon, par manière de proverbe, « qu’on a su le lizeu », qu'on est sur la glissoire, quand on est dangereusement malade. Lizeu signifie aussi un homme qui lit, et ne se dit guère que d'un homme qui lit beaucoup sans en devenir plus savant, « ç’at un lizeu », c'est un liseur. - (01) |
| lizeu. : Personne qui lit beaucoup mais sans profit. - (06) |
| lizou. Glissoire. Voir lizer. - (12) |
| lizou. : Mauvais lecteur dans le sens du débit. - (06) |
| ljquot, s.m. loquet de porte ; licol. - (38) |
| lliache ... lliache, ricin, insecte. - (05) |
| lliaice. V. gll. - (05) |
| lliaite, tiroir de table à manger. - (05) |
| lliandu. V. gll. - (05) |
| lliau, ivraie. - (05) |
| lliauvrelai, adv. là-bas. - (22) |
| lliener. V. gll. - (05) |
| llieux, eux ; chez llieux, chez eux. - (05) |
| llieux, llius. V. gll. - (05) |
| lliœmòsse, s. f. limace. - (22) |
| lliœné, v. a. glaner. - (22) |
| lliòsse, s. f. eau congelée, glace. - (22) |
| l'mace : limace. - (33) |
| l'maice, limace ; se dit aussi d'une personne lente au travail. - (16) |
| lmaice, sf. limace. - (17) |
| lmëre, lumière. - (16) |
| lmîre n.f. Lumière. - (63) |
| lô - eux, leur. – C’â lô petiots que jeurant queman cequi !... Que le Bon Dieu l'iô perdonne ! – I les ai vu lô deux qu'a causaint bein fort. - A laivant souvent la trouas ensemle. - (18) |
| lô, adj. poss. des deux genres. Leur : « i n' se pâ lô nom », je ne sais pas leur nom. - (08) |
| lo, article masculin, disparu vers le début du XIXe siècle. - (38) |
| lo, loir. - (26) |
| lö, sm. lit. - (17) |
| lô, sm. loir. - (17) |
| lo. Le, pronom, leurs quand la chose est au pluriel ; lo devant une consonne, los devant une voyelle ; lo peire, leurs pères, los anfan, leurs enfants. - (01) |
| lobe, s. f. compliment, louange de raillerie, de moquerie, de plaisanterie vide de sens. - (08) |
| lôber, v. a. louer en plaisantant, en goguenardant, en raillant - (08) |
| lôbeur, s. m. celui qui se moque, qui raille en parlant, qui aime à plaisanter aux dépens d'autrui. - (08) |
| loc. Ce mot primitif, très usité en Bretagne, a formé le Bas de Loc, lieudit de la commune de Lusigny : c'est la vallée pittoresque où la rivière d'Ouche prend sa source... - (13) |
| loc’er(y) : (y) lécher - (37) |
| locance, facilité de parler (du latin loqui, parler). - (16) |
| locât’rie : petite exploitation agricole - (37) |
| locatcher. Locataire. - (49) |
| locaterie : location - (44) |
| locaterie : petite ferme. - (30) |
| locaterie, s. f. résidence d'un ouvrier travaillant à la terre avec dépendances, louée à prix d'argent ou pour certaines redevances ; petite maison ; à peu près synonyme de manœuvrerie. - (08) |
| locaterie. Petite ferme. - (49) |
| locateure (n.f.) : petite ferme - (50) |
| locatif (pour lucratif). adj. Avantageux. Plaider, toujours plaider, c'est pas ben locatif. (Villeneuve-les-Genêts). - (10) |
| locatrie n.f. Petite ferme. - (63) |
| locature (nom féminin) : terre ou fermette de faible importance donnée en location. On dit aussi locatrie. - (47) |
| lochan. Léchant. - (01) |
| loche (ō), sf. [lèche]. tranche de pain. - (17) |
| lôche : (laiche) herbe poussant dans les endroits humides - (46) |
| loche, subst. féminin : crachat. - (54) |
| loché, vt. lécher. - (17) |
| loche. Brindille de genêt ou de bouleau employée pour faire des balais. - (49) |
| lochefroo, ou lochefrô. Lèchefrite… - (01) |
| lochefroo. : Léchefrite. (Lamon.) - (06) |
| locher, rouaic’er, touairc’er : essuyer, rendre net le fond d’un plat avec sa langue (« man ! y’y loc’e ? ») - (37) |
| locher, v., perdre un fer (en parlant du cheval). - (40) |
| locher, verbe transitif : peaufiner, fignoler un travail. - (54) |
| lochet (pour louchet). s. m. Bêche. (Girolle). - (10) |
| lochevin. Léchevin, terme burlesque pour signifier échevin… - (01) |
| lochî : lécher. Et aussi boire avidement. - (62) |
| lochu (ō), sm. lessu, eau de lessive. - (17) |
| lode. Lourde, lourdes. - (01) |
| lodeu : marotte. (E. T IV) - VdS - (25) |
| lôdio : le tournis (le vertige) - évouè le lôdio, avoir le tournis - (46) |
| lodze : hangar - (43) |
| lodzi : loger - (43) |
| lodzi v. Loger. - (63) |
| lodzis n.m. Logis. - (63) |
| lodzment n.m. Logement. - (63) |
| lœche det (à), loc. parcimonieusement, à « lèche-doigt ». - (24) |
| lœche dò (à), loc. parcimonieusement, à « lèche-doigt ». - (22) |
| lœche, s. f. tranche très mince de pain ou de viande comme serait celle qu'on peut emporter en léchant. - (22) |
| lœche, s. f. tranche très mince de pain ou de viande comme serait celle qu'on peut emporter en léchant. - (24) |
| loenais, adj. qual. ; malade en parlant d'un agneau ; cet aignais est leonais (il est atteint d'une maladie qui le fait tourner sur lui-même. - (07) |
| lœssi, s. m. eau de lessive (du vieux français lessu). - (24) |
| lofè : adj. Pas net. - (53) |
| lofré (subst. m.) imbécile, benêt (la lippe pendante étant traditionnellement symbolique de la bêtise). - (45) |
| lofre : (lofr' - subst. f.) lippe. Fê:r' lè lofr' " faire la lippe, faire la moue". - (45) |
| lofré, adj. qui a de grosses lèvres, goinfre : grand « lofré », avale-tout. Au féminin « lofrouse » et quelquefois « lofrére. » - (08) |
| lofre, s. f. lèvre proéminente, qui fait la moue. on dit à un enfant grognon : « caiche té lofres. » (voir : lofré.) - (08) |
| lôfre. Lèvre, lèvres. Des lôfre, proprement, sont de grosses lèvres, telles qu'on dit vulgairement que sont celles de la maison d'Autriche, touchant l'origine desquelles on rapporte qu'en 1530… - (01) |
| loga (un) : une flaque d'eau. (MM. T IV) - A - (25) |
| loge : petit hangar. - (31) |
| loge, n.f. cabane de bûcheron. - (65) |
| logé. Loger, logez. - (01) |
| loge. s. f. Hangar, remise ; petite cabane dans les champs. - (10) |
| logeot, logeriot. n. m. - Petit cabanon, petite remise, où l'on entreposait le bois ou les outils. - (42) |
| loger. v. a. Louer, prendre, donner à louage ou à gages. – Se Loger. v. pron. Se louer, se mettre en condition. Du latin locare. - (10) |
| logeriau, logeriot. s. m. Hangar, petite loge. (Baint-Martin-sur-Ouanne). - (10) |
| logi : loger - (57) |
| logi, sm. loisir. - (17) |
| loginte (f), casier où pond la poule (o long). - (26) |
| logis, auberge, cabaret. - (05) |
| logne : pièce de bois reliant les deux trains d'un chariot. - (31) |
| logne : pièce maîtresse du chariot (armature, châssis) - (46) |
| logne : voir pan. (VDS. T IV) - VdS - (25) |
| logué : purin. (MLV. T III) - A - (25) |
| loi. s. m. Voyez louet. - (10) |
| loibri : roitelet. I, p. 20-1 ; II, p. 28-1 ; II, p. 31 - (23) |
| loibri. n. m. - Roitelet. - (42) |
| loibri. s. m. Roitelet. - (10) |
| loicer, loicher, loisser. v.a. Lécher. (Bazarnes, Ménades). – Loicher sa lauche, lécher sa tartine. (Civry). - (10) |
| loiche, s. f. lèche, tranche de pain coupée très mince et sur laquelle on met du beurre, du miel, etc., pour les enfants. - (08) |
| loiche, s. f., lèche, tranche de pain assez mince, pour tremper ou faire rôtir. - (14) |
| loicher, louécer (v.t.) : lécher - (50) |
| loicher, v. a. lécher, promener la langue sur quelque chose. - (08) |
| loicher, v. tr., lécher. - (14) |
| loichou, adj. celui qui lèche, qui passe la langue sur quelque chose. s'emploie souvent pour gourmand : « eun loichou, eune loichouse. » - (08) |
| loige, s. î. loge, cabane construite avec des branches d'arbres à l'usage des bûcherons et des pâtres. - (08) |
| loiger, loigier. v. a. et n. loger comme en français. - (08) |
| loin (être), loc. être parti [au loin] : quand il sera loin, je te parlerai. - (22) |
| loin (être), loc. être parti [au loin] : quand il sera loin, je te parlerai. - (24) |
| loin (un) : lien. Communément d’osier ou de paille. - (62) |
| loin du plat pour saucer (Etre). Locution proverbiale. Etre loin du but qu'on se propose d'atteindre. (Perrigny-lès-Auxerre). - (10) |
| loin, adv., longtemps : « Ol é proche de descendre ; ô n'en a pas pour loin. » - (14) |
| loin, lien. - (05) |
| loinceron : tique - (39) |
| loinge, louainge : n. f. Couche, lange de nourrisson. - (53) |
| loingé, louaingé : v. t. Langer. - (53) |
| loingeai : langer son enfant. - (33) |
| loingeot : lange. - (33) |
| loinzer : langer - (39) |
| loinzot : lange de bébé - (39) |
| loipines. s. f. pl. Tétines, mamelles d'une truie, d'une chienne, des femelles en général. (Saint-Privé). - (10) |
| loire ou leire. : (Dial.), dérivation du latin licere, être permis. « Il ne lur loist mie entendre » (Job.), c'est-à-dire, il ne leur est pas permis d'entendre. - (06) |
| loirotte : pierre à affûter. (MLV. T IV) - B - (25) |
| loirotte. Petite serpette dont les enfants se servent pour vendanger. - (13) |
| loisi, s. m., loisir, bon temps. - (14) |
| loison (à), à loisir. - (27) |
| loixi. Loisir. - (01) |
| loké, instrument de fer qui sert à ouvrir une porte, en pesant du pouce sur lui. - (16) |
| loké, l’loké, le hoquet. - (16) |
| lolo - lait, quand on parle aux petits enfants. - Pôre petiot enfant, te vourà aivoir ton lolo ! – Main mère, beillez moi don du lolo. - (18) |
| lolo, lait (enfantin). - (16) |
| lolòt, s. m., lait; quelquefois pour indiquer une boisson douce. - (14) |
| lolues. n. f. pl. - Paroles inintéressantes, inutiles, parler pour ne rien dire. (Diges, selon M. Jossier) - (42) |
| lôlues. s. f. pl. Paroles insignifiantes. Tout ça c'est parler pour ne rien dire, c'est des lôlues. (Diges). - (10) |
| Lombar, nom de bœuf. - (08) |
| lombard : désignation abrégée du gourlon-lombard. Pour prévenir d'un danger, il faut faire bref ! (Soit gourlon, soit lombard). Ex "Oh, un lombard, un groooou !" (Un gros). - (58) |
| lombarde : s. f., syn. d'alogne dans certaines communes (Saint-Point, etc.). - (20) |
| lombri : nombril - (48) |
| lon de (au), prép. à coté : e préfère se coché au l'on d'louvraige putiot que d'traivaillé. En comparaison de : Jaque a bé riche au lon d'son frère. Lai du lon, tout le long. - (17) |
| lon, pour long... - (02) |
| lon. Long, longs. - (01) |
| lon. : (Pat.), léans (dial.), du latin illic intus et signifiant: là dedans. - (06) |
| londi : lundi - (57) |
| londze : (adj) féminin de « long » - (35) |
| londze : corde pour attacher les veaux - (43) |
| londze : féminin de « long » - (43) |
| londze n.f. Longe. - (63) |
| lônè : traîner, s'attarder, flaner - (46) |
| lône : s. f., bras mort d'une rivière; creux d'eau voisin d'une rivière. - (20) |
| lôner : lambiner, paresser. (E. T IV) - VdS - (25) |
| lôner, flâner. - (27) |
| lônerie : blague, plaisanterie. - (29) |
| lônerie : une conversation inutile - (46) |
| lôneries, conversations plus ou moins spirituelles ou sérieuses pour amuser et passer le temps. - (27) |
| lônes (raiconter) : bêtises, sottises (raconter) - (48) |
| long - dans divers sens. - Mettez ces pierres qui à long du mur. - Pliaicez-moi cequi, tenez à long de lai voiture. - Vos trouras le Liaude, lâvan, à long de note champ. - Signifie aussi : comparé à… - I ai soixante quaite ans ; ce n'â ran au lieu de vo qu'en aivez quaitre vingt chisse. - (18) |
| long (au). adv. de lieu. - Auprès de, contre : « Va don' garer l'échelle au long du mur. » - (42) |
| longains. s. m. pl. Longues charpentes fixées en travers sur des pieux plantés en rivière pour former les côtés de la passe d'un pertuis. - (10) |
| longe : longue - (57) |
| longi : longer - (57) |
| longie. n. f. - Lenteur. Se dit d'un travail qui n'en finit pas : c'est la longie ! (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| Longin (Saint-). s. m. Celui qui fait tout avec lenteur, qui n'en unit jamais. (Bligny-en-Othe et un peu partout). - (10) |
| longin, s. m. un peu long, lambin. - (08) |
| longis. n. m. - Majeur. - (42) |
| longnö, sm. tas de bois à brûler. (cf. vx f. leigne, lat. lignum.) - (17) |
| longtemps (il y a), il y a grand temps : loc, il est certain. Y a longtemps qu'on est mieux à la campagne qu'à la ville. - (20) |
| longue-haleine. s. f. Celui qui est peu habile, qui est lent dans tous ses mouvements. (Festigny). - (10) |
| lonné, vn. hésiter. Lambiner. Voir tanuser. - (17) |
| lonneries (ōn), sf. histoires interminables. Qqf. Plaisanteries salées. - (17) |
| lonnou, sm. traînard, lambin. - (17) |
| lônou : qui ne travaille pas vite, c'est le cas de la Saône qui fait des méandres à Saint-Jean-de-Losne (en vieux français, losne est un marécage). On dit également lôniâ - (46) |
| lônou, flâneur. - (27) |
| Lontine (lai) : (la) Léontine - (37) |
| loper : lapper, boire - (48) |
| loper : (lopè - v. trans.) (fréquentatif de "boire") siroter. - (45) |
| loper : boire beaucoup, manger avec bruit - (39) |
| loper, v. n. terme usité dans le jeu de « la gamouèche » pour exprimer le contact du morceau de bois ou bouchon avec le palet lancé par le joueur. L’adversaire « délope » la « gamouèche » lorsqu'il réussit à la dégager. - (08) |
| loper, v. tr., boire beaucoup, avec excès. - (14) |
| lopette : (lopet' - subst. f.) boisson en général ; terme vaguement dépréciatif. - (45) |
| lopou, ouse, adj. et subst. celui ou celle qui aime à boire, qui boit beaucoup. - (08) |
| lopoù, s. m., qui boit trop, ivrogne. - (14) |
| loquance, caquet ; en latin loqui. El ai de lai lôquance signifie il a du babil... - (02) |
| lôquance. Les bonnes gens, à Dijon, pour dire qu'un homme a de l'éloquence, disent qu'« el é de lai lôquance », ce qui, à le bien prendre, signifie qu'il a du caquet. On dit encore aivoi une belle lôquance, pour avoir le talent de s’exprimer avec grâce… - (01) |
| lôquance. : Caquet. El ai de lai lôquance, signifie il a du babil. - (06) |
| loquebantur. s. m. Mauvais laboureur. (Etivey). M. Michou a lu loquebantier. - (10) |
| loquence - habileté de parler forte voix pour parler haut et longtemps. - Quienne loquence al é ! - C'â lu qu'é de l'ai loquence !... â pairlero ine jornée entère. - (18) |
| loquence (al ai ben d'lai) : éloquent, qui est très bavard - (48) |
| lòquence, s. f., éloquence, beau parler. - (14) |
| loquence. s. f. Voix forte ; facilité d'élocution. - (10) |
| loquer, bruire par dislocation. - (05) |
| loquer, v. tr., boire, lever le coude : « Lu ? la jôrnée durant, ôl a loqué d’avou les aimis. » (V. Loper.) - (14) |
| loquet, s. m., hoquet. Encore une fois l'article fondu avec le nom. - (14) |
| loquet. Hoquet. - (49) |
| loqueter, v. n. boire à tout propos, à tout moment. - (08) |
| loquette, fragment d'une chose. Donner à un pauvre une loquette de fricot, c'est lui faire l'aumône de quelque petit reste de viande. - (02) |
| loquette, loquotte. s. f. Petite pièce, petit morceau s'entend généralement dans les campagnes des petites parcelles de terre. A-t-il quéqu' chose, c't'homme-là ? – Heu, il a queuques louquottes, pas grand' choue ! De loque. - (10) |
| loquette. : Fragment de quelque chose. Donner à un mendiant une loquette de fricot, c'est lui faire l'aumône de quelque morceau de viande. Loquette, diminutif de loque, vient de l'allemand loc qui signifie chose pendante. Les Picards appellent loquetier un chiffonnier parce qu'il ramasse et vend des loques, des chiffons (Héc.). - Le mot lopin signifie aussi un morceau de quelque chose. Il vient du latin lobus ou lobinus. - (06) |
| loquö, sm. local pour le bois ; bûcher. - (17) |
| lor - leur, à eux. - Vos é du remairquai in champ d'aivogne superbe ; c'a le lor. - Vo viez ces champs que juant vé lai porte des Forey ? le pu grand c'â le lor, l'aute c'â le nôte. - Voyez Lotte. - (18) |
| lor (pron.pers.pl. des 2 genres) : leur - (50) |
| lôr, adj. celui qui est sujet au vertige. Se dit surtout du mouton qui a le tournis ou tournoiement. Au féminin « lôrde. » le mot s'appliquait aux personnes avec le sens de niais, sot, idiot. - (08) |
| lôr, adj., lourd, qui a le vertige. Se dit du mouton qui a le lordòt. (V. ce mot.) - (14) |
| lor, pron. pers. plur. des deux genres. Leur. - (08) |
| lor. Eux, pronom. « Ai se môqui de lor », il se moqua d'eux. Ce lor est un italianisme, di loro. - (01) |
| lor. : Leur. Cet article perd sa consonne devant un mot commençant par une autre consonne ; ainsi leur père et leur mère se traduisent par : lo peire et lo meire. - Le même article prend s au pluriel devant un substantif commençant par une voyelle ; ex. : los éfan, leur enfants. - Leur, devant un substantif féminin commençant par une consonne, se rend par lote. - (06) |
| lôrdais, dale, adj. lourdaud, idiot, étourdi. - (08) |
| lordê: (adj.) un peu simplet, lourdaud. - (45) |
| lordiâ, surdité passagère. - (16) |
| lordiau : Lourdeau, peu agile. « En venant vieux an vint lordiau ». - (19) |
| lordo (le) - vouaîr du breûillâ : vertige - (57) |
| lordo : vertige. - (29) |
| lordo : vertige. (RDB. T III) - S&L - (25) |
| lordo : 1 adj. m. et n. m. Bénet. - 2 n. m. Étourdissement n. m. Vague à l'âme. - (53) |
| lordo. Pesanteur de tête qui résulte de l'ivresse ; de l'italen lordo, lourd. - (03) |
| lordo. Vertige, « a voir le lordo ». - (49) |
| lordon, ordon : n. m. Rangée. - (53) |
| lordôt (C.-d., Chal., Br.), lourdiau (Char.), lordais (Morv.). - Lourdeau, individu lourd, étourdi ; avoir un lordot, être étourdi, avoir le vertige, se prend aussi dans le Chalonnais au sens d'être capricieux. - (15) |
| lordot : Vertige. « Ol est sujet à prendre le lordot » : il est sujet au vertige. - (19) |
| lordot : vertige. Aussi pour gueule de bois et maladie épidémique du porc. - (62) |
| lordot, s. m., migraine, vertige après boire. - (40) |
| lordòt, s. m., vertige des moutons. Les bêtes ont les indispositions des gens, et les gens les indispositions des bêtes. - (14) |
| lordot, vertige, tournis des moutons. - (05) |
| lordot. Étourdissement. - (13) |
| löre, vt. lire. - (17) |
| lorette, s. f. laurier-rose. - (24) |
| lorgnâ : enfant qui regarde d'un air bête. (CT. T II) - S&L - (25) |
| lorgnâ, lordo : 1 adj. m. et n. m. Benêt. - 2 n. m. Dadai. - (53) |
| lorgnat, lourgnat : s. m., vx fr. lorgnart, lourdaud. - (20) |
| lorgni : lorgner - (57) |
| lorgniâ : imbécile. (E. T IV) - S&L - (25) |
| lorgnote, lorniote : n. f. Longue vue. - (53) |
| lorier. Loriot. - (49) |
| lormier. : (Du latinlorum, rêne), sellier. (Cout. de Châtillon de 1371.) - (06) |
| lorne : « Fare la lorne » bouder. - (19) |
| lôrot : quelqu'un qui perd son temps, qui n'avance pas dans son travail - (46) |
| lôrotè : perdre son temps - (46) |
| los, accus, plur. de l'art, le, la, les au masc. et au féminin « vié-lu, vié-lei, vié-los », voyez-le, voyez-la, voyez-les. - (08) |
| los. Voyez lo. - (01) |
| los. : (Dial.), héritage. Ce qu'on donne ou prend à loyer. Le terme féodal était lod. - (06) |
| losenge. : (Dial.), flatterie. L'idée de louange (en latin laudationem, et dans le dialecte los ou loz) comporte nécessairement l'idée de flatterie. - (06) |
| Losner, lôner : lambiner, flâner. - (32) |
| losse, s. f. outil de charpentier, grosse tarière avec laquelle on perce à fond les trous ébauchés par le « beurchou. » - (08) |
| lot : (nm) troupeau : « un lot d’vatses » - (35) |
| lot, n.m. troupeau. - (65) |
| lote, pour leur, comme on dit : note pour nôtre, vote pour vôtre. - (16) |
| lote. Leur, pronom quand le nom est au singulier. « Tote lote raice ne vau ran », toute leur race ne vaut rien. - (01) |
| lôte. Lote, sorte de poisson. - (01) |
| lôterie. Loterie, loteries… - (01) |
| loti - qui a un lot, une part ; se dit généralement dans un sens défavorable. - Le voilai bien loti, le pôre gairson ! - Me voilai loti queman qu'en faut !... ma, aipré to i men fiche. - (18) |
| lotte - leur, à eux. Voyez Lor. - Ceute groinge qui, vos viez, c'a lai lotte. - I ons envie note petiot, c't-année qui, â catésime aivou c'tu des Boissiaux ; ma le lotte à bein pu saivant. - Nos voisins que sont venus, c'a des braves gens, ma lotte caractère n'â pâ asille. - (18) |
| lou d’bôs : (nm) tique du chien - (35) |
| lou d'bô : (pou de bois) mot désignant une tique - (46) |
| lou vairou - espèce de juron ; expression de mécontentement. - Chien de lou vairou, vais ! – Lou vairou ! voiqui que lai cheville à cassée ! - (18) |
| lou, loue : leur - (48) |
| lou, pronom personnel masculin qui se place après le verbe : baille-ma-lou, dis-lou , fais-lou, jette-ma-lou ; encore utilisé dans le patois moderne. - (38) |
| loù, s. f., loup, et personne qui vit retirée : « On n'le vouét jamâ ; y et ein vrâ loù. » - (14) |
| lou. pronom possessif. Leur. ( Saint-Brancher). - (10) |
| louâ, louache (n.f.) : tique - (50) |
| louâ, s. m. pou de bois. - (08) |
| louâceron, s. m. insecte qui s'attache entre cuir et chair au corps des animaux. (voir : luâchon.) - (08) |
| louâche : n. f. Laîche, roseau. - (53) |
| louache, (ā), sf. pou des moutons. Pou de bois. - (17) |
| louâche. n. f. - Tique du chien. Au figuré : gnangnan, mou. - (42) |
| louâche. s. m. Insecte parasite du chien de chasse et des animaux qui vivent dans les bois'. (Villiers-Saint-Benoît). - (10) |
| louâcher, v., bêcher. - (40) |
| louâchère : n. f. Endroit où pousse les louâches. - (53) |
| louai (n.f.) : loi - (50) |
| louaî (na) : loi - (57) |
| louaicer, lécher - (36) |
| louaichai - lécher (et au figuré). - C'â drôle quemant les chaits louaichant lô petiots. - Note Médor me louaiche le mau qui ai â doigt ; en dit que c'â bon. - T'é tôjeur ai embraissai, ai louaichai ton petiot ! - (18) |
| louaiché : v. t. Lécher. - (53) |
| louaige : louage, location - (48) |
| louainge, loinge : n. f. Couche, lange de nourrisson. - (53) |
| louaingé, loingé : v. t. Langer. - (53) |
| louainge, s. f. louange. - (08) |
| louainger, v. n. louanger, donner des louanges. - (08) |
| louâlli - loisir. - Vos reveinras demain, i n'ai pas louàilli àjedeu. - C'â in doguin, ailé ; à troue bein le louâilli d'ailai prenre ine demi tasse chez le Sordet. - (18) |
| louâsse, s. f. petite tranche, tranche mince : « eune louâsse d' paingn'. » (voir : loiche.) - (08) |
| louasse. s. f. Lien. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| louat, n. masc. ; tique, pou de bois. - (07) |
| louâteure, s. f. lien de paille qu'on emploie pour les petites gerbes. - (08) |
| louâyi (n.f.) : loisir - (50) |
| louâyi, s. m. loisir : « i f'ré ç'lai ai louâyi », je ferai cela à mon loisir ; « i n'é pâ l' louâyi », je n'ai pas le temps. - (08) |
| louàÿi, s. m., loisir, délassement. - (14) |
| louche (oū), sf. laiche, carex des marais. - (17) |
| loucher. v. a. Remuer vivement, secouer par corruption de hocher.(Venoy). - (10) |
| louchi - biscier : loucher - (57) |
| loûchot, s. m., bêche à défoncer. - (40) |
| loûchoû : celui qui louche - (37) |
| louè : loi - (48) |
| loué, ée. part. pr. et adj. Lié. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| louè, sm. lien. - (17) |
| loué, vt. lier. - (17) |
| loué. Louer, louez. - (01) |
| loue. s. f. Louve, femelle du loup. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| louébri (n. m.) : roitelet - (64) |
| louèce (n.f.) : tartine - (50) |
| louéchai: lécher. - (33) |
| louèchè : lécher - (46) |
| louèche : tranche de pain - (48) |
| louéché, lécher. - (16) |
| louècher : lécher, boire - (48) |
| louêcher, loicher. v. a. Lécher. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| louée (lai) : (le) jour de la foire à l’occasion de laquelle se « louaient » les domestiques des fermes - (37) |
| louée (nom féminin) : assemblée annuelle où se retrouvaient, à la campagne, les ouvriers agricoles en recherche d'un employeur. - (47) |
| louée : jour où se louaient les domestiques, souvent à l'occasion d'une foire. - (33) |
| louée, loue : syn. d'affermage. Place de loue, place où se réunissent les gens qui veulent s'affermer. - (20) |
| louée, s. f. foire, apport, marché où se réunissent les garçons et les filles qui offrent leurs services. - (08) |
| louée. n. f. - Jour où les domestiques se louaient à un patron, de la Saint-Jean en juin à la Saint-Martin en novembre. - (42) |
| louège : cabane, loge de charbonnier ou de bûcheron - (48) |
| louège : remise. (RDT. T III) - B - (25) |
| louége. s. f. Loge, hangar. (Girolle). - (10) |
| loüein, s. m., lien, attache. - (14) |
| louer ou léyer. Lier, du vieux verbe loier. Nous disons loin pour lien. - (03) |
| louer, lier. - (05) |
| louer, v. a. louer, amodier, prendre en location une personne ou une chose. - (08) |
| loüer, v. tr., lier, attacher. - (14) |
| Louère : Loire - (48) |
| louère : trou servant de piège à loups. III, p. 16 - (23) |
| louère ou louire. : Lien pour serrer les gerbes. - (06) |
| louessar, adj. louche, celui qui regarde de travers ; au féminin « louessarde. - (08) |
| louesser : lécher - (39) |
| louet. s. m. Loup. – Vieux louet, vieux loup, et, figurément, vieil avare, parce que l'avare est insatiable, affamé comme un loup. - (10) |
| louèze - (39) |
| loufer : péter - (44) |
| loufou - loup fou : fantaisiste. Individu faisant une action inattendue, inhabituelle, originale, qui surprend. Selon l'intonation, le mot peut exprimer l'admiration, quelquefois, être aussi un signe d'affection. Rarement vindicatif. Ex : "Ah ben ! c'est un loufou !" ou bien encore "Eh ! vieux loufou !". - (58) |
| lougaïon (prononcer : lougayion) : dérivé du précédent, et plus fort, avec une nuance de colère et le sens de voyou, ou d'un signe de hardiesse excessive, réprouvée. L'expression est d'autant plus forte que les syllabes du mot sont bien détachées. Ex : "C'est brament un lou-ga-yion". - (58) |
| louger, et loiger, v. tr. et intr., loger, habiter. - (14) |
| loui. Louai, louas, loua. - (01) |
| louïa..., première partie de trois locutions fondamentales employées par les mariniers dans la direction de leurs bateaux : Louïa d’avant, maille en avant ! Louïa d’amitan, maille au milieu ! Louïa d'arriè, maille en arrière ! Celle-ci retient quand l'équipage traverse un courant. - (14) |
| louingeot : (louin:jo - subst. m.) lange d 'enfant. - (45) |
| louïot. s. m. Loriot. (Trucy). - (10) |
| louis, s. m. notre louis d'or vaut vingt-quatre francs. (voir : pistole.) - (08) |
| Louiseau. Nom d'homme, diminutif de Louis. - (08) |
| louisœte, s. f. fente, petit jour laissant passer un peu de lumière (Côte-d’Or «luzote », petite lampe) - (22) |
| louisœte, s. f. fente, petit jour laissant passer un peu de lumière. - (24) |
| loujarde. s. f. Lézard. (Civry). - (10) |
| louline. s. f. Sorte de petite rigole, naturelle ou factice, et plus ou moins contournée, qui sur un terrain en pente sert aux enfants pour jouer aux billes, à la toquette. – Vl'à une belle louline. Jouons à la louline. (Auxerre). - (10) |
| loulou, fouérou : homme à se méfier - (37) |
| louottes, luottes. s. f. pl. Guêtres à l'usage des vignerons. ( Sougères-sur-Sinotte, Perrigny-Ies-Auxerre). – Ce mot nous semble une altération évidente de houzottes, petites guètres, petites bottines légères montant plus ou moins jusqu'à mi-jambe. On trouve dans Scarron houzeau, pour haut de chausses, et, dans Littré, houseaux (au pluriel), sorte de chaussures de jambes contre la pluie et la crotte. Vojez anloupiaux. - (10) |
| loup d’ bô : tique. De loup-de-bois ( ?). Certains disent pou de bois d’où « pou d’bô ». - (62) |
| loup d’bouais : insecte pénétrant sous la peau d’animaux - (37) |
| loup d'beû, piou d'beû : tique - (43) |
| loup d'bôs n.m. Tique. On dit aussi piou d'bôs et yampote. - (63) |
| loup de bô, s.m., tique du chien. - (40) |
| loup de bois : tic - (44) |
| loup de bois, subst. masculin : tique du chien. - (54) |
| loup vairou ou loup voirou. : Loup-garou, homme qui erre pendant la nuit transformé en loup.- Dans le dialecte, on appelait gerol, garoul et garou un sorcier qui, selon la croyance populaire, pouvait prendre la forme d'un loup. - (06) |
| loup varrou , loup-garou ; cf, danois "Varulv" (loup de guerre). - (38) |
| loup : s. m. Innocent comme un loup de sept ans, se dit ironiquement d'une personne, plus généralement d'un enfant, qui se défend d'être coupable. - (20) |
| loup : voir pressoir. - (20) |
| loup-d'boûs (on) : tique - (57) |
| loup-gaou. s. m. Pour lou-barau, loup-garou, lupus varius ; par conversion du v en b ou en g. S'emploie, à Perreuse, comme exclamation : O loup-gaou ! Oh queu malheur ! La g'Iée nou' a tout fricassé dans noûes pouv' vègnes. - (10) |
| loupiâ : n. m. Petit diable. - (53) |
| loupiner. v. n. Téter avec avidité. (Migé). - (10) |
| loupines. n. f. pl. - Tétines, mamelles. (Saint-Privé, selon M. Jossier) - (42) |
| loupiotte (aine), (aine) leûyotte, (aine) lûyotte : lanterne à lueur faible et vacillante - (37) |
| loupiotte : lumière. - (66) |
| loupiotte : petite lampe - (44) |
| loûpiotte : petite lampe - (48) |
| loupiotte, s. f., petite lanterne fermée. - (40) |
| loup-vârou ou vérou, s. m. loup-garou, sorcier qui emprunte la forme d'un loup pour battre la campagne et aller en garouage. - (08) |
| loup-vérou ! (mon) : interjection familière s’adressant à son interlocuteur - (37) |
| louquat, louquiet. s. m. Loquet.(Lucy-sur-Cure, Merry-la- Vallée). - (10) |
| louquiau, loutiau. s. m. Louveteau. (Contraction de). (Puysaie). - (10) |
| louquier, loutier. s. m. Se dit par contraction de louvetier, nom que l'on donne dans la Puysaie à une espèce de sorcier, qui passe pour avoir des intelligences avec les loups. - (10) |
| louquotte, loquotte, licotis. n. f. - Petite pièce, petit morceau, petite parcelle de terre. - (42) |
| louqu'tter. v. - Frapper à la porte. - (42) |
| lourd, lôrde : (lour, lôrd' - adj.) lourd, pesant. (au seul féminin) en proie à un vertige subit, étourdi. - (45) |
| lourdau, s.m. vertige. - (38) |
| lourde : s. f., lourdain : s. m., lourdeur, pesanteur de tête. - (20) |
| lourdias. s. m. Lourdaud. (Domecy-sur-le-Vault). - (10) |
| lourdiau, adj., lourdaud, simple, idiot. Épithète qu'on ne ménage pas à qui la mérite. - (14) |
| lourdot (ain) : (un) homme à l’esprit peu vif - (37) |
| lourdot : mal de tête, migraine - (37) |
| lourdot, subst. masculin : étourdissement ou mal de tête. - (54) |
| loure (n.f.) : louve - (50) |
| loure, s. f. louve, femelle du loup. « oll heulot toot c'ment aine loure », elle hurlait comme une louve. - (08) |
| Lousine (Mère). Monstre habitant les puits et les fontaines et servant d'épouvantail aux enfants. Ne t'aivise pas de croicher dans not’ pouet, lai meîre Lousine te maingerot... - (13) |
| lousse, losse. s. f. Tarière, bondonnière, outil à l'usage des tonneliers pour percer le trou des bondes. - (10) |
| lousseron. s. m. Dessous d'un chandelier. (Mahgny). Dans Roquefort, on trouve lusseron, mèche, lumignon. Du latin lucere. - (10) |
| lou-sté. pronom démonstratif. Celui. – La-stée, celle. (Béru). - (10) |
| lout : Loup. « Ol a vu peter le loup su la piarre de beu » : il a vu des choses extraordinaires, rien ne saurait l'étonner. - (19) |
| loutaule, adj. fréquenté par les loups. - (08) |
| loute : Louve. « J'ins tué le lout et la loute ». - (19) |
| louterie : enfants nombreux issus d'un couple et vivant tous ensemble. Analogie probable, sinon certaine, avec le mot "loup", animal redouté qui vit en bande et qui parcourait encore le pays au début du XIX ème siècle. Le mot "louterie" a une connotation péjorative. Ex : "Dans yeu p'tite maison y logeaient ben toute yeu louterie !" - (58) |
| loutier : meneur de loups. III, p. 17 - (23) |
| loutier, loutchier, louquier. n. m. - Poignée de porte. Ce mot vient du« loquet», autre type de fermeture d'une porte. - (42) |
| loutole, loutaule (adj.) : endroit fréquenté par les loups - (50) |
| loù-vairou, s. m., loup-garou, loup errant. Et sorcier, dont le rôle a défrayé bien des légendes. Il errait, voulait-on, la nuit, transformé on loup. Au figuré, individu farouche et fuyant le monde. - (14) |
| louvèrou : juron morvandiau - (48) |
| louvérou : n. m. Enfant espiègle. - (53) |
| louvèrou, sm. et int. loup garou. Louvérou de louvèrou ! louvérou de mâtin ! - (17) |
| lou-voirou ou garou, êtres imaginaires ; hommes méchants et cruels, disait-on, qui avaient été condamnés par le sort à prendre des formes d'animaux malfaisants... - (02) |
| louvre. Lucarne de grenier. Ce mot, très usité en Bourgogne, nous vient peut-être de la Flandre : les habitants de ce pays ont loof, regard, et loof venster, regard de fenêtre. Un compte de 1453 mentionne les réparations faites aux louvres du château de Rouvres-les-Dijon. - (13) |
| louyerde - lézard. - En voi les louyerdes â pied des roiches, qu'à se chauffant es premés sulots ; c'â que le bon temps aipruche. - Prends gairde, ine louyerde que monte aipré le mur. - (18) |
| louziot. louziou, liousiou. s. m. Loriot. (Gravant, Monéteau). - (10) |
| lovri (jò), loc. jour de la semaine autre que le dimanche, jour ouvrier. - (24) |
| loÿer, v. tr., lier, attacher. - (14) |
| loÿeûre, s. f., lien, attache. - (14) |
| lòyœte, s. f. pomme d’Adam. - (24) |
| lozadje, sf. lézard. - (17) |
| l'quée. s. f. Litière. Aller à la l'quée. - (10) |
| l'ssi (nom masculin) : eau de lessive tiède. - (47) |
| lssi n.m. (de l'anc.fr. lessif, eau de lessive) Eau de lavage de draps blancs, lessive en général. - (63) |
| lssiveuse : lessiveuse - (51) |
| lsu (n. m.) : eau de lessive, dans laquelle le linge a bouilli - (64) |
| l'sus : la première eau de la lessive - (46) |
| l'tièze. s. f. Synonyme l’quée. (Hebourseaux). - (10) |
| ltîre n.f. Litière. - (63) |
| ltire : s. f. litière. - (21) |
| lu - lui. - C'â ai lu moinme que vos diras cequi. - Lu, teins, a fairé bein lai commission : a n'â pâ bête. - La femme dit souvent Lu pour désigner son mari ; c'â lu. - En n'i é que lu que pouré vo fare cequi. - Et l'homme dit Lé pour désigner sa femme : c'â lé. - (18) |
| lu (pron.pers. 3ème pers. du sing.) : lui - (50) |
| lu : (nm) lieu : « en n’gun lu » : nulle part - (35) |
| lu : (pr.pers.) lui - (35) |
| lu : brille - (43) |
| lu : lui - (46) |
| lu : lui - (48) |
| lu : lui - (51) |
| lu : le (pronom complément) - (48) |
| lu, li pron. pers. Lui. Y'est pas à lu, mas dz'va li dère tot d'miñme. Ce n'est pas à lui, mais je vais le lui dire tout de même. - (63) |
| lu, lui, à la fin d'une phrase : s'â lu, c'est lui. - (16) |
| lu, lure, luot - divers temps du verbe luire. - Le sulo lu, ç'â bon ; i pourons sorti tantot pour ailai voué les graingnes, ce qu'à faisant. - Assitot que le jor quemance de lure, en faut décampai : l'ovraige presse. - Son regair luot queman du feu. - (18) |
| lu, l'y : pron. pers. Lui. - (53) |
| lu, pr. pers., lui. N'empêche pas, dans certains cas, la prononciation lui. (V. ce dernier mot.) - (14) |
| lu, pron. sing. de la 3e pers. rég. direct. Lui, soi : « ç'ô ai lu », c'est à lui ; « i parlin d' lu quan al ô v'ni », nous parlions de lui quand il est venu. - (08) |
| lu. C'est le pronom personnel lui dont lé est le féminin. Çast lu quai aippourté les draigies ai sai nièce : tins ! qu'a m'ai dit, voiqui pour lé. - (13) |
| lu. Lui. - (01) |
| lu. pro. pers. m. - Le. Aga-lu, regarde-le. - (42) |
| luâchon, s. m. pou de bois. (voir : louâceron.) - (08) |
| luarder, v., verdir, en parlant de la vigne. - (40) |
| Lubeigne. Lubine, nom de bergère. Lubin, en latin Leobinius nom d'un saint qui était évèque de Chartres au milieu du sixième siècle. - (01) |
| lucane. Lucarne… - (01) |
| lucarner, bicarner v. Apparaître puis disparaître en parlant du soleil. L'solei qu'lucarne à la Tsandleuse hiberne quarante dzos. L'hiver se prolonge. - (63) |
| Luce, Sènte Luce, sainte Lucie. - (16) |
| lucette : s. f., lucot : s. m., petite lampe. - (20) |
| luchat. s. m. Jus de fumier. (Germigny). - (10) |
| lucher : parler fort (voir hucher). III, p. 15-4 - (23) |
| lucher : crier fort (ne se dit pas pour la douleur). En général pour se faire entendre, et aussi de loin. Ex : "Luche pas tant ! J'entend ben ! Y peut dont ben pas parler sans lucher !" - (58) |
| lûcher, v., glisser sur l'herbe sèche ou sur la glace et la neige. - (40) |
| lucher. v. - Crier. Synonyme de hucher. - (42) |
| lucher. v. a. et v. n. Appeler ; crier fort. (Sainpuits). – Tu vas faire lucher après toi, tu vas faire gronder, crier après toi. (Perreuse). - (10) |
| luchi, s. m. résidu de la lessive. (voir : l'chu, lussu.) - (08) |
| luchu - eau de lessive. - Pour jetai lai bue en ne fau pâ que le luchu sait trop chaud. - Oh ! mère Colette, vote luchu à doux, lai bue seré bonne. - (18) |
| luchu : eau de lessive - (48) |
| luchu : (luchu - subst. m.) eau de lessive, qu'on récupérait sous le cuvier, à sa sortie par le trou d'évacuation, et qu'on remettait à chauffer pour la verser ensuite à nouveau sur le linge. - (45) |
| luchu : n. f. Eau de rinçage de linge lavé. - (53) |
| Lucifar. Lucifer… - (01) |
| lucifer, le diable ; une mère irritée contre son enfant va jusqu'à l'appeler Lucifer. - (16) |
| Luçotte, « lusotte » : petite lumière (lat. luce). - (32) |
| lue (n. f.) : grosse chaîne - (64) |
| luer, briller, luire ; v. ; sulot luant, soleil levant. - (38) |
| lues. s. f. pl. Contraction de liures, branches d'osier à lier. (Mouffy). - (10) |
| lugea : Inaptitude à la reproduction : « Eune female qu 'a le lugea » : une femelle stérile. « Fare le lugea » : piocher profond pour enlever les racines des plantes et les rendre ainsi incapable de se reproduire. - (19) |
| lugneau. s. m. Sot, nigaud, bêta ; insensé soumis aux influences de la lune. (Villiers-Saint-Benoît) - (10) |
| lugnot. n. m. - Nigaud, peu dégourdi, toujours dans la lune. - (42) |
| lugnôte. Lunettes, soit petites à mettre sur le nez pour lire plus aisément, soit grandes, à observer les astres… - (01) |
| lugnòtes, et lunòtes, s. f., lunettes, besicles : « T'n'y voués d'jà pas prou ; mets donc tes lugnòtes. » - (14) |
| luhiar, s. m. bélier. env. de Lormes. (voir : lureai.) - (08) |
| lûhotte : voir lunette - (23) |
| lui, art., le : « I faut lui empôcher d'faire ça. » Très exceptionnel, mais très local et très usité chez les paysans. - (14) |
| luïâ, s. f. petite croix que les enfants fabriquent avec les tiges de chanvre. - (08) |
| luïarde, s.f. lézard. - (38) |
| luïarder, v. verdir. - (38) |
| luïerne : (lu:yêrn' - subst. f.) gros lézard vert. - (45) |
| luïerne, s. f. lézard. quelquefois « luerne et luiarne ». (voir : luiserne.) - (08) |
| luïerner, v. n. faire le lézard, aller et venir sans autre but que la flânerie, jouer au soleil. (voir : luiserner.] - (08) |
| luine : voir meuhaigne - (23) |
| luïot, lu-yot, s.m. petite lueur. - (38) |
| luïòte, s. f., lueur légère, lumière naissante ou mourante. - (14) |
| luiòtte (Chal., Morv.), luzotte (C-d.). – Petite lueur, lumière faible. - (15) |
| luiotte, lu-yotte, s.f. petite lampe qui éclaire très mal. - (38) |
| luïotte, s. f. petite lueur, lumière pâle. - (08) |
| Luise, Lisonne, prénoms, Louise. - (38) |
| luiserne (n.f.) : lézard - (50) |
| luiserne, s. f. lézard. une partie de la contrée prononce « luisarne ». - (08) |
| luiserner (v.t.) : luire par intervalles, par intermittence (aussi luyerner) - (50) |
| luiserner, v. n. luire par intervalles. Se dit du soleil lorsqu'il se montre et se dérobe tour à tour. - (08) |
| Luison, prénom, Louis. - (38) |
| luizarder. v. - Luire (Grandchamp, selon M Jossier) - (42) |
| luizarder. v. n. Luire. (Grandchamp). - (10) |
| luizerner (Chal., Morv.), luzâner (C-d.). - Luire faiblement ; charmante expression qui vient du vieux mot luzerne, luizerne, dont l'étymologie est le latin lucerna, lampe. Le nom de la ville de Lucerne n'a pas d'autre origine, en raison du phare qu'elle avait autrefois à rentrée de son port. - (15) |
| luizerner, v. intr., luire faiblement et par intervalles. - (14) |
| luja. Lézard. - (49) |
| lujar, s. m. lézard. - (08) |
| lujarde : Lézard gris. « O se chauffe au sole c'ment les lujardes » : il prend un bain de lézard. - (19) |
| lujarde, s. f. lézard gris. - (24) |
| lujarne. s. f. luzerne. - (08) |
| lujarne. s. f. Luzerne. (Domecy-sur-le-Vault). - (10) |
| lujater : Luire faiblement ou par intermittence. « Man fu n'est pas crave o lujate enco in ptiet bout » : mon feu n'est pas mort il luit encore un peu. - (19) |
| lûjèrne n.f. Luzerne. Le mot d'usage principal est le triolet. - (63) |
| lujotte, n. fém. ; ver luisant ; petite lampe . - (07) |
| lulu. s. m. Espèce de crapaud, ainsi appelé à Percey, par onomatopée sans doute, à cause du cri qu'il fait entendre dans les nuits d'été. - (10) |
| lumas : voir limas - (23) |
| luméro : Numéro. « Ol a tiri in ban luméro » : il a tiré un bon numéro. Autrefois le conscrit qui tirait un bon numéro était exempt du service militaire. - (19) |
| luméro, numéro. - (16) |
| luméro, s. m. numéro. - (08) |
| lumiére (na) : lumière - (57) |
| lumiére : n. f Lumière. - (53) |
| lumignaire. Luminaire. - (01) |
| lunatte, linotte, s.f. lunette. - (38) |
| lundji, sm. lundi. - (17) |
| lune ou leune : Hièble ou petit sureau, sambucus ebulus. « Eune fois qu'y a des lunes dans une tarre i est maulagi à s'en défare » : quand une terre est infestée d'hièble il est difficile de s'en débarasser. - (19) |
| lune : s. f. Lune tendre, lune croissante. Lune dure, lune décroissante. On croit devoir tailler les bois tendres en lune tendre et les bois durs en lune dure. Bois de lune, bois coupé la nuit, c'est-à-dire volé. Voir cul de la lune. - (20) |
| lune : s. f., lunure, altération affectant tout ou partie d'un végétal et qu'on attribue à l'influence de la lune. - (20) |
| luné, lunée : adj.. altéré par la lune. Voir lune (lunure). - (20) |
| luné, ue. adj. Capricieux, fantasque, lunatique. (Etais). - (10) |
| luner : v. n., faire des lunes, avoir des caprices. - (20) |
| lunet ou lunay : Nom masculin. Ancienne étoffe ou toile robuste employée pour la confection de solide sac à grain. « In sa de lunet » : il pouvait contenir 6 à 7 doubles décalitres de grains. - (19) |
| lunette : escargot jaune. IV, p. 30 - (23) |
| lunette : Linotte. « In nid de lunettes ». - (19) |
| lunette, linotte. - (05) |
| lunette. Linote. Nous disons aussi linot pour linote. - (03) |
| luniöte, sf. lunette. - (17) |
| lunne, sf. lune. - (17) |
| lunòt, lunòte, et lunéte, s. m. et f., linot, de ce que, dit-on, cet oiseau aime la graine de lin. Le masculin Lunòt nous suffit parfois pour les deux genres. La prononciation va de lunòt à lugnòt. - (14) |
| lunotte, lunette. Linotte. - (49) |
| luns. s. m. pl. Légumes semés et cultivés dans les jachères. (Etais). - (10) |
| lupaule, adj. se dit d'un lieu fréquenté par les loups ; c'est un endroit bien « lupaule. » - (08) |
| lura : bélier. - (29) |
| lurâ, s. m. bélier. - (08) |
| lurai, laron (n.m.) bélier, agneau (aussi lureau) - (50) |
| lurais - bélier. - Vos é lai in gros joli lurais ! – En faut en conveni, in lurai quemant cequi refait bein in tropais de berbis, ailé. - (18) |
| lurais, n. masc. ; bélier ; note lurais m’ai joqué. - (07) |
| lurê : bélier - (48) |
| lure : flamber (brûler) - (57) |
| lure : luire - (57) |
| lure : Luire. « Le sola lu pa tot le mande » : le soleil luit pour tout le monde. - (19) |
| lure, luire, éclairer. - (05) |
| lure, luraint - divers temps du verbe Luire. Voyez d'ailleurs a Lu, Luot, etc… - Ces lanternes luraint d'autant pu que lai neu sero pu noire. - (18) |
| lûre, v. a. luire, briller, donner de la lumière. - (08) |
| lûre, v. intr., luire. - (14) |
| lûre, v., luire. - (40) |
| lureai, s. m. bélier, mâle de la brebis. - (08) |
| lureau, bêlier - (36) |
| lureau, luriau, leuhiau, s. m. bélier. - (08) |
| lure-lure (à), à peu près, au hasard, sans réflexion (par exemple, faire un travail à lure-lure). - (27) |
| lure-lure : sans ordre. - (09) |
| lurette - ce mot (outre le sens français de Luron au masculin et au feminin), exprime un étonnement de dédain, d'indifférence. - Ce que vos no disez lai, ah ! en i é belle lurette, c'a vieux quemant les rues. - En i é belle lurette ! - (18) |
| lurette (Belle). Voyez bellurette. - (10) |
| luria : bélier. (RDM. T IV) - B - (25) |
| lûria : n. m. Bélier. - (53) |
| lurlure (A). Locut. adv. Au hasard. - (10) |
| lurlure. adv. - À vue de nez, approximativement : « Cécile ? Combein d'farine te mets-ti pou' fai'e ton roubigneau ? À la lurlure te vois ben ! » (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| luron (nom masculin) : bélier. - (47) |
| luron, homme fait. Dans l'idiome breton, lureu ou lureus (Rost. et Lepel.) signifie un paresseux qui force les autres de faire sa besogne... - (02) |
| luron, leuron. s. m. bélier, agneau mâle. - (08) |
| luron, n. masc. ; garçon fort. - (07) |
| luron. Ce mot a signifié louveteau. Lure était le nom de la louve et lurette celui d'une petite louve. En patois du Morvan lure, luriau signifient bélier. On a appliqué ce mot à un jeune homme fort et hardi. Cette dernière acception est seule usitée dans les environs de Beaune. - (13) |
| luron. : Jeune garçon robuste et bon vivant, et qui amuse son monde par des contes et des sornettes, ce qui est le sens des expressions lures et lurettes. - (06) |
| lurot : Lumignon, petite lueur. « Allema dan tan lurot » : allume donc ton lumignon. - (19) |
| lusater : briller faiblement - (57) |
| lusier (pour liurier). s. m. Pied d'osier, arbuste qui porte les lues, les liures. - (10) |
| lusot (on) : lueur - (57) |
| lusotte ou luseutte. Petite lumière. Etym. lucere, qui a d'abord fait le vieux français luisir. - (12) |
| lussu, eau de lessive. - (16) |
| lussu, s. m. le « lussu » ou « luchu », suivant la forme locale, est l'eau mêlée de cendre qui découle du cuvier de lessive. c'est aussi le dépôt vaseux qui demeure au fond. - (08) |
| lûssu, s. m., eau de lessive. - (40) |
| lut (l’solé) : (vb) (le soleil) brille - (35) |
| lutarne. Animal imaginaire appelé aussi « daroux », vivant, disait-on, caché au fond des bois... - (49) |
| lutaud, e. n.et adj. - Pas malin, benêt. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| luteau, lutot. s. m. Gros crapaud. Du latin lutosus, bourbeux, limoneux, sans doute parce que le crapaud vit dans les marécages, dans l'eau bourbeuse des marais. (Mont-Saint-Sulpice). - (10) |
| lùter, v. tr., terrasser, vaincre. Lutter quelqu'un, pour lutter contre quelqu'un, mais avec l'idée de succès. - (14) |
| lutére - litière. - Soignez surtout lai lutére des vaiches pour qu saint propres. - Ine bonne lutére c’â le mannége des bêtes. - Les pôres bêtes, â se reposant si bein su ine lutére fraiche. - (18) |
| lûteriau : voir chûlot - (23) |
| luterne. Nom d'un animal national qui n'existe pas ! Etym. soit lutra, loutre ; soit lutine, esprit nocturne des Normands. - (12) |
| lûtot : gosier, gorge - (48) |
| lutre, lutrelle. s. f. Couche, drapeau, morceau de toile dont on enveloppe un enfant et par-dessus lequel on pose le lange. (Saint-Bris, Auxerre). - (10) |
| lutrot (n.m.) : gosier - (50) |
| lutrot, s. m. gorge, gosier. (voir : garlutrot.) - (08) |
| Luy, Louis; Sèn Luy, saint Louis ; Lûyse, Louise. - (16) |
| lûyant : luisant - (48) |
| lûyarde : lézard - (39) |
| lu-yarde, s. f., ver luisant. - (40) |
| luyarner (prononcer lü-yarner) : flâner, traîner (voir : luïerner : faire le lézard). - (56) |
| lùyœte, s. f. pomme d’Adam. - (22) |
| luyot. Œil. Mauvaise lampe. Ce mot s'emploie surtout pour désigner une lampe peu éclairante. - (49) |
| luyote : (lu:yot' - subst. f.) lanterne, lampe portative. - (45) |
| luyote, subst. féminin : faible lueur, lumière lointaine. - (54) |
| lûyotte : petite lampe - (48) |
| luyotte : petite lumière. (A. T IV) - S&L - (25) |
| lûyotte : ver luisant - (48) |
| lûyotte : 1 n. f. Lampe. - 2 n. f. Lueur. - (53) |
| lûyotte : ver luisant - (39) |
| lu-yotte, s. f., petite lumière vacillante. - (40) |
| luyotte. Feu peu ardent. On disait : « in-ne luyotte de feu ». - (49) |
| lu-yotter, v., apparaître (en parlant de la lumière du jour). - (40) |
| luzade, petit lézard. - (27) |
| luzanai, regarder d'un œil vif et perçant... - (02) |
| luzanai. : Regarder d'un oeil vif et flamboyant. - Dans le dialecte, le verbe luzir signifie luire, éclairer, et en latin lucerna veut dire lampe. Dans ces acceptions, luzôte se disait, en patois, d'un feu de paille ou feu d'avare. Il signifiait aussi ver luisant. - Luzotte, avec cette diflérence d'orthographier le mot, est le nom d'une plante laxative de la famille des euphorbiacées: c'est la mercuriale (mercurialis annua). - (06) |
| luzane. Regarde, regardes, regardent. L’infinitif c’est luzanai, qu'on croit qui signifie proprement regarder d'un œil vif et perçant, comme qui dirait luzarnai, parce que le lézard, que les Bourguignons appellent luzar, a l'œil fort vif… - (01) |
| luzârne (d'la) : luzerne - (57) |
| luzarne (n.f.) : luzerne - (50) |
| luzarne, luizerne. n. f. - Luzerne. - (42) |
| luzârne, s. f., luzerne. - (40) |
| luzarne, s.f. luzerne. - (38) |
| luzeu (avoir son), commencer à être pris de boisson. - (27) |
| luzeu : éméché. (P. T III) - B - (25) |
| luzeute, petite lampe qui éclaire insuffisamment. - (27) |
| luziau. s. m. Sorte de pois gras, de légumineuse qui vient dans les blés. (Puysaie). - (10) |
| luzo : mot masculin désignant une ivresse légère - (46) |
| luzo. Petite lumière, du latin lucere. Nous disons le « soulei lû », pour le soleil luit. - (03) |
| luzot (avoir son), être ivre. - (40) |
| luzòt, et luzòte, s. m. et f., petite lumière, lampe qui donne peu de clarté, tison restant du feu, lumignon restant de la chandelle : « Dépôche-te d'ralleùmer ton feù ; n'y a pus qu'eùn luzòt dans les c'nises. » — « N'y avòt qu'eine luzòte su la taule, j'n'y vouéyòs pus ran. » - (14) |
| luzot, petit feu, petite lumière. - (05) |
| luzöte, luzote, sf. lumignon, petite lampe. Nom vulgaire de la mercuriale annuelle ou foirolle. - (17) |
| luzote, petite lumière ; espèce de gesse à graines luisantes qui ôte au blé de sa valeur et ver-luisant. - (16) |
| luzotte - petite lampe qui éclaire très peu. - C'â ine luzotte cequi, en ne peu pâ traiveillai d'aivou. - Vos riez de mai petiote lusotte ? ci vau mieux que ran, ailé. - On appelle aussi Luzotte les vers-luisant - Regairdez don quemant ceute luzotte lai relu !... tenez, dans l'herbe. - (18) |
| luzotte : (nf) lucarne - (35) |
| luzotte : petite lueur d'une lampe. (RDV. T III) - A - (25) |
| luzotte : une petite ampoule, une lumière chétive - (46) |
| luzôtte, la luzotte (Mercurialis annua), plante dioïque de la famille des euphorbiacées. Son nom vient du breton lousou, et, à Vannes, leuseu (Rost.), herbages. Cette plante est très-comme des paysans comme éminemment laxative. - (02) |
| luzotte. n. f. - Lézard. - (42) |
| luzotte. Petite lumière, et, par extension, petite lampe. Jaimâs te ne voirai aissez cliair pour coudre, d'évou eune luzotte quemant c'té-qui ? C’est aussi le nom patois du ver luisant. Les Italiens disent luciola. - (13) |
| lvain : levain - (51) |
| lvain n.m. Levain. - (63) |
| l'vè, leuvè : v. t. et n. m. Lever. - (53) |
| lvé, lever ; leuve le, lève-le ; Dyeu l'vé, l'élévation de l'Hostie, à la messe. - (16) |
| l'vée (na) - levia (la) : levée - (57) |
| l'vée (na) - levia (na) : digue - (57) |
| l'ver : lever - (57) |
| l'ver l'cu : ruer - (48) |
| lver v. 1. Lever. Dans la conjugaison, le "è" se change en "eu". Leuve-te ! Lève-toi ! Part. Lvant, lvé. 2. Prélever (la crème à la surface du lait cru). - (63) |
| lver v. Lever. - (63) |
| lvin : s. m. levain. - (21) |
| l'vure (na) : levure - (57) |
| lvûre n.f. Levure. - (63) |
| lvûre, pain non cuit, fermenté, qu'on mélange à la farine pétrie, pour la faire lever. - (16) |
| l'y, li, lu : pron. pers. Lui. - (53) |
| lyine : Elle. « Ol a dansi d'ave lyine tote la soirée » : il a dansé avec elle toute la soirée. - (19) |
| lyron : gros rat - (60) |
| m' : pron. pers. Me. - (53) |
| m’cheu (un) : un peu. - (66) |
| m’cho (un) : un peu. - (29) |
| m’chon : moisson - (35) |
| m’étonne. Je me demande si. Ex. : « M’étonne voir s'il fera beau temps aujourd'hui ! » - (12) |
| m’lin (ain) : (un) moulin - (37) |
| M’lin’ (ai) : (à) Moulins-Engilbert - (37) |
| m’lottes. s. f. pl. Partie de la panse d'un bœuf ou d'une vache dans laquelle se trouve ce que les tripières d'Auxerre appellent le gras-double gris. - (10) |
| m’n’ârm* ! interj. mon ami ! - (22) |
| m’né, mener ; i meune, te meune, é meune, qui se rapprochent plus de mener que : je mène, tu mènes, etc., par la prononciation. - (16) |
| m’ner au mâle : aller faire remplir un récipient - (37) |
| m’ner lâs beûs : pour un humain, être très excité par la boisson - (37) |
| m’ner lâs beûs : se dit d’une vache qui « demande » le taureau - (37) |
| m’ner, v. tr., jouer, exécuter un air pour mener une danse, une marche. S'applique au musicien (tambour, fifre, ou violon) : « Allons ! le v'là qu’ô va m'ner la marche de la mariée. » - (14) |
| m’neuzi : menuisier - (43) |
| m’nia : douillet - (43) |
| m’nûyier : menuisier - (37) |
| m’ri, mourir ; é n'vo fô pâ m'ri, ne mourez pas (bon souhait à un malade). - (16) |
| M’tsi : (NP) Michel - (35) |
| m’zaîye dâs couéç’ots (lai) : (la) nourriture, préparée, cuite et moulinée, pour les porcs - (37) |
| m’zer, meûzer : manger - (37) |
| m’zer, v. a. manger. (voir : méger.] - (08) |
| mâ ! interjection ; eh ! bien ! - (38) |
| mâ (adv.) : plus, davantage (issu de mais, en a. fr., plus) - (50) |
| mâ (na) : mare - (57) |
| ma : (pr pers) moi - (35) |
| mâ : beaucoup plus - (37) |
| ma : mais - (48) |
| mâ : mais. - (66) |
| mâ : Mais. « Je voudrais bin mâ je peux pas ». - Davantage. « I n'en faut pa mâ » : il n'en faut pas davantage. - « Je n'en peux mâ » je n'y peux rien. - (19) |
| ma : moi - (43) |
| ma : moi - (51) |
| ma : Moi. « Ce livre est à ma ». « Vins-tu d'ave ma ? » : viens-tu avec moi ? - (19) |
| Mâ : Nom propre : Marc Dicton : « A la Saint Geôrges sonne (sème) tan ôrge, à la Saint Mâ y est treu tâ (trop tard) ». - (19) |
| mâ : plus (+) - (48) |
| mâ : plus. Dounne m'en un pçot mâ : donne-m’en un peu plus. - (52) |
| ma : un bisou de bébé - (46) |
| mâ : une mare - (46) |
| ma fi ! excl., ma foi ! revient fréquemment dans les conversations : « Ma fi voui ! ma fi non. » - (14) |
| mâ ke, lorsque ; mâ k’vo vînrë, lorsque vous viendrez. - (16) |
| ma pron.pers. Moi. - (63) |
| ma que - Quand, lorsque. - Voyez l'article ma. - (18) |
| mâ que, conj. lorsque : « mâ que » mon bœuf sera vendu, je te paierai. - (08) |
| mà que, conj., pourvu que. - (14) |
| ma – mais. - I veu bein que vos venain, ma vos saivez ai quée condition. - Comme exclamation : mâ ! - Nos grands-pères disaient encore dans le sens de alors que, quand. – Ma que vos ains fini, i paislerons de c't-aifâre lai. - Ma que vos pourras, venez to de suite. - (18) |
| ma : (ma - conj.) (mâ: - adv. de quantité) la conjonction de coordination est le "mais" français . L'adverbe de quantité correspond à "plus" placé devant un adj. et à "davantage" placé après un verbe : Y eum' bio lè Marie,.ma y eum' â:tan lè Clémence, èl'lo: mâ: corèjou:z' "J'aime bien la Marie, mais j'aime mieux Clémence : elle est plus belle"- R'bèy' mouè zen vouèr èto mouè, t y en é bèyé mâ: qu'è mouè "Redonne-m'en, tu lui en as donné davantage qu'à moi". - (45) |
| mâ : adv. et conj. Mais. - (53) |
| ma, adv. davantage : ma coure ; courir davantage. - (22) |
| mà, adv. davantage : mà coure, courir davantage. - (24) |
| mâ, adv. plus, davantage, une plus grande quantité : « i gll'i en é beillé mâ », je lui en ai donné davantage. - (08) |
| ma, conj. mais. Voir man 2. - (17) |
| ma, conj., mais. - (14) |
| mâ, mais (magis) ; mâ! ben i aut ben ! ah ! bien, ce n'est pas mal. - (38) |
| mâ, mais. - (16) |
| mâ, mârs' n.m. Mars. - (63) |
| ma, pronom personnel, se place après le verbe ; baille-ma, prôte-ma, épourte-ma. - (38) |
| ma, s,m. (mois de ) mai. Erable. - (38) |
| ma, s. f. pétrin ; maie du pressoir (du latin magide). - (24) |
| ma, s.f. pétrin à pain. - (38) |
| ma, s.m. meix ; jardin près de la maison. - (38) |
| mà. adv. Voyez mas. - (10) |
| mâ[y]on : maison. - (52) |
| maau, maô, mal. - (38) |
| maboule n. et adj. (de l'arabe mahbul, fou, sot, stupide). Fou. Voir marteau. - (63) |
| mabre (mâbre) : s. m., marbre. - (20) |
| mabre (mâbre), marbre : s. f., bille de marbre. - (20) |
| mâbre n.m. Marbre. - (63) |
| mâbre, s. m. marbre. - (08) |
| mâbre, s. m., marbre, au propre et au figuré. - (14) |
| mâç’eûré (l’) : (le) mécanicien de la machine à battre - (37) |
| mâç’eûré : noirci par de la suie, par du « noir » - (37) |
| mâç’eûron : matière qui noircit (charbon, fonds de casseroles) - (37) |
| mâcainique : mécanique. terme employé surtout pour désigner le frein à vis et à manivelle, placé à l’arrière d’un véhicule hippomobile - (37) |
| mâcânichien : mécanicien. celui des trois hommes accompagnant la machine à battre pendant toute la campagne de battage, est plus spécialement responsable de la « chaudière » (la locomobile) - (37) |
| macarons, crottins de cheval. - (05) |
| macciner. Vacciner. - (49) |
| macenège. s. m. Maçonnage. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| macener. v. a. Maçonner. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| mâceurer, mâcheurer (v.t.) : mâchurer, maculer - (50) |
| mâceuron, mâcheuron (n.m.) : se dit de la suie qui salit en noircissant - (50) |
| mâch’madiö, sm. terme assez vague désignant un contenant quelconque, buire, boîte. - (17) |
| mâchan : Bouchée d'aliments à moitié machés ? - (19) |
| machan : Moisson. « J'érains vo voir après machan » : nous irons vous voir après la moisson. « Aller en machan » aller se louer comme journalier pour faire la moisson. - (19) |
| machau : petit tas de foin roulé. (F. T IV) - Y - (25) |
| machau, machaut, machot. s. m. Petite meule, petit tas de gerbes ou de foin dans les champs. (Sénonais). Du latin machale. - (10) |
| mâchavoine. s. m. Celui qui négocie un mariage. - (10) |
| mâche – gerbe ou fagot de chanvre en tige. - Voiqui qui menons chi mâches de chenôve à nâyou. - An i é ine douzaingne de menevois dans chèque mâche ; pu a ne nâyeraint pâ quemant qu'en fau. - (18) |
| mâche : Grosse poignée de chanvre encore pourvue de son écorce. « Eune mâche de chande » : un faisceau de brins de chanvre. - (19) |
| mâché ; é n'mâche pà s'ké veu dire, il dit crûment ce qu'il veut dire. - (16) |
| mâche, doucette, herbe à salade ; on dit aussi du vin qu'il a de la mâche, quand il a du corps. - (16) |
| mâche. s. f. Réunion en botte de plusieurs poignées de chanvre pour le rouissage. (Percey) Ce doit être une altération de masse, par conversion des deux ss en ch. - (10) |
| mâche-à-vide. s. m. Gourmand, pique-assiette. (Saint-Florentin). - (10) |
| machedru (mange-fort), gourmand, vorace. - (02) |
| mâchedru, adj., mâche-ferme, qui mange avec avidité, gourmand. - (14) |
| machedru. Gourmand, gourmands, mot formé de mâcher et de dru… - (01) |
| machedru. : Mangeur avide, comme l'exprime le mot dru. C'est l'opposé du mot machouilleur ou machailleur, c'est-à-dire qui broie longtemps et avec peine ses aliments. - (06) |
| machefé : Machefer. « Le tarrain a été gaugi, à présent qu y est so y est deu c'ment du machefé » : le terrain a été piétiné, maintenant qu'il fait sec il est dur comme du machefer. - (19) |
| machelotte. s. f. Piège. Ainsi appelée sans doute, parce que ces sortes de piéges contiennent un assommoir. (Collan). - (10) |
| mâcher (à bref). v. a. Faire des taches, des empreintes, des marques de contusion, de meurtrissures sur la peau, en assommant, en frappant à coups de bâton. (Perreuse). Du latin massu, massue, et macellare, assommer, frapper avec la massue. Voyez machelotte. - (10) |
| mâcher (mâcher) : v. a. Mâcher le vin, le goûter, apprécier ses qualités de corps. On dit dans le même sens qu'un vin a de la mâche. - (20) |
| macher. v. - Faire des bleus, des marques sur la peau. - (42) |
| macherai. Barbouillé de noir, charbonné, vulgairement machuré. Les imprimeurs disent qu'une feuille est machurée quand elle n'est pas tirée nette, et appellent machurats les apprentis, parce qu'ils sont sujets à gâter les feuilles qu'ils tirent… - (01) |
| macherai. : Celui qui a le visage noirci. L'octave des Rois se nomme à Metz les Rois Machurez. En italien masrhera signifie masque et mascherare se masquer la figure. - (06) |
| mâcherin, mâch'zin. s. m. Charbon brûlé. (Chéu). - (10) |
| mache-tu ! : interjection pour calmer un chien - (35) |
| mache-tu !, interj. va-t’en ! (en parlant à un chien). - (22) |
| mache-tu !, intèrj. va-t-en ! (en parlant à un chien). - (24) |
| macheunon. s. m. Toute substance pouvant servir à noircir : charbon, suie, noir de fumée, etc. – Se dit aussi de celui qui est macheuré. A Etivey, par exemple, les forgerons sont appelés macheurons. - (10) |
| macheurai - noircir, tacher avec de la suie, du charbon. - Laive tai don, té macheurai su lai joue. - Regaide don, teins, quemant t'é macheurai tes haibits. - (18) |
| macheuran : Suie ou toute autre substance pouvant « macheurer ». - (19) |
| macheuré (pour machuré). adj. Noirci, barbouillé de charbon, de suie ou d'autre chose de même couleur. Les charbonniers, les forgerons, les chauffeurs de machine ont toujours la figure et les mains macheurées. - (10) |
| mâcheurè : (mâ:choerè - participe employé comme adj.) taché de noir, barbouillé ; l'infinitif existe mais la forme adjectivale est la plus courante. - (45) |
| mâcheuré : v. t. Barbouiller en noir. - (53) |
| mâcheùre, s. f., barbouillage de noir, tache quelconque. - (14) |
| mâcheurer : barbouiller. - (56) |
| macheurer : Machurer, barbouiller de noir. « Oueva dan que te sô ? t'es macheuré c'ment in rac'chevenée » : d'où sors-tu donc ? tu es noir comme un ramoneur. - (19) |
| mâcheurer : mâchurer, barbouiller, couvrir de traces noires - (48) |
| mâcheûrer v. (de cheure, cendre). Barbouiller de cendre. - (63) |
| mâcheurer, v. a. mâchurer, barbouiller, noircir, salir. - (08) |
| màcheùrer, v. tr., mâchurer, barbouiller de noir. Avant l'invention des masques, on se barbouillait de lie de vin. - (14) |
| macheurer. Mâchurer ; noircir avec de la suie. - (49) |
| mâcheuron : (mâ:choeron) se dit d'une femme ou d'un enfant dont le visage est sali. - (45) |
| mâcheuron, s. m. se dit d'un objet qui salit et principalement qui noircit. Un morceau de suie ou de charbon. - (08) |
| màcheùron, s. m., tout objet qui devient noir, suie, lumignon, papier brûlé, etc. - (14) |
| machi (ă), adv. merci. Quand quelqu'un dit merci, l'interlocuteur répond souvent : È n'faut ran, il n'y a pas de quoi. - (17) |
| mâchi : Mâcher. « Quand te mije des mousserans faut bien les machi » : quand on mange des mousserons il faut bien les mâcher. « Quand an a plieu de dents an a du mau pa mâchi ». - (19) |
| machicaud. n. m. - Terme de mépris. (Villiers-Saint-Benoît, selon M. Jossier) - (42) |
| machicaud. s. m. Terme de mépris à Villiers-Saint-Benoît. - (10) |
| machillö, sm. mariage, état conjugal. Une telle veut se faire religieuse. — Vous croyez cela ? Elle se fera religieuse au couvent de machillö, les quate saibôs devant l'löt (les quatre sabots devant le lit). - (17) |
| machin' : n. f. Machine. - (53) |
| machin, s. m. surnom qu'on donne à un individu ou à un objet dont on ne dit pas le véritable nom. - (08) |
| machin. s. m. Mot généralement employé pour désigner toute espèce de personnes ou de choses dont le nom échappe. - (10) |
| machine (la) : ensemble constitué par la batteuse et sa locomotive à vapeur (ou locomobile). Le nom recouvrait aussi la fonction de l'entrepreneur itinérant qui allait de grange en grange, de même que l'activité qui en découle. Ex : "Dans deux jours, j'aurons la machine !" - (58) |
| machine à battre : batteuse - (61) |
| machine à battre : batteuse mécanique - (43) |
| machine n.f. Nom donné à la chaudière tractée puis à la locomobile servant aux battages ou à la cuisson des pommes de terre. C'est un des rares mots dont le "ch" d'origine n'est pas remplacé par "ts". - (63) |
| machoïlle (ō), sf. hellébore fétide. - (17) |
| mâchoïlli : Mâcher lentement et négligeamment. « Qu'est-ce que t'es dan après à mâchoïlli ? » : qu'est-ce que tu es donc en train de mâchonner. - (19) |
| mâchoiyé, mâcher lentement. - (16) |
| machon (mâchon) : bouchée de viande, de pain, etc., qui a été mâchée; « gueuleton ». . . - (20) |
| mâchon (n. m.) : résidu des fruits que l'on a pressés pour en extraire le jus - (64) |
| mâchon, n.m. repas, pique-nique. - (65) |
| màchon. s. m. Eloge qu'on fait d'une personne ou d'une chose. (Etivey). – Se dit ironiquement, par allusion à ce que les éloges sont courts et se font par mots entrecoupés et comme mâchés entre les dents. Mâchouner, suivant Jaubert, veut dire parler entre les dents. - (10) |
| machonner : Moissonner. « Les bliés commanchant bien à jauni n'i v'la causu temps de machonner » : les blés commencent à bien jaunir voilà qu'il est presque temps de moissonner. - (19) |
| machonnoux : Moissonneur. « Va dan porter la marande es machonnoux » : va donc porter le diner aux moissoneurs. Au féminin : machonnouse. - (19) |
| machons. n. m. pl. - Pulpe de fruits pressée, pommes ou poires, après le passage au pressoir. - (42) |
| màchoû, adj., qui mâche, qui remue quelque chose entre ses dents : « Que qu'te voux qu'ô parle ben, c'vieux màchoù-là ! » - (14) |
| mâchou, s. m. celui qui mâche, qui tient quelque chose entre ses dents. Se dit quelquefois pour glouton : « eun grô mâchou. » au féminin « mâchouse » et en quelques lieux « mâchoure. » - (08) |
| mâchouaîre (na) : mâchoire - (57) |
| mâchouéiller : mâchouiller, mastiquer - (48) |
| mâchouére, s. f. mâchoire. - (08) |
| machouére. Mâchoire. - (49) |
| mâchouillé, vt. triturer lentement ; mâcher sans appétit. Déchirer (une étoffe) en mordillant. Une vache a mâchouillé un drap qui séchait. - (17) |
| machouiller (mâchouiller), v. a., mâchonner, mangeotter. Que qu’ t'as donc dans la bouche ? T'es toujours après mâchouiller. - (20) |
| màchouiller, v. tr., mâcher difficilement, sans appétit, mâchonner : « Dépeû qu'ôl a été enrheûmé, ôl a tôjor quête chouse qu'ô mâchouille. » - (14) |
| machouiller. Mâcher longtemps et difficilement. Du vieux verbe machoiller. - (03) |
| machouiller. Mâchonner. Ce verbe a donné le substantif machouilloux, celui qui machouille, diminutif de mâcheur. Mâchonner n'a pas forme de substantif, ce qui est une lacune. - (12) |
| machouiller. Mâchonner. Fig. Parler bas et peu distinctement. - (49) |
| mâchouilli : mâchouiller - (57) |
| machouillon. Individu parlant indistinctement. Fig. S 'emploie pour désigner celui qui parle à tort et à travers. - (49) |
| machouyi, v. a. mâcher longuement. - (22) |
| machòyi, v. a. mâcher longuement. - (24) |
| machtu : exclamation utilisée pour faire fuir un chien. A - B - (41) |
| machtu interj. Se crie au chien pour qu'il cesse d'aboyer ou de menacer le visiteur. (Possible déformation de "mais, cestui ", mas çhtu ! ). - (63) |
| machurai, noirci , barbouillé , ou ayant des égratignures... - (02) |
| machuré (adjectif) : maculé, barbouillé. - (47) |
| machuré : avoir le visage sali, noirci - (34) |
| machuré : noircis - (44) |
| mâchuré, celui qui a des taches accidentelles de noir. - (16) |
| mâchurer (C.-d., Chal.), mâcheurer (Y., Morv.). -Noircir, barbouiller, salir. Du vieux français machurer, qui avait le même sens et venait lui-même de l'italien mascbera, masque, les masques ayant été noirs primitivement. - (15) |
| machûrer : salir le visage. - (66) |
| mâchurer, v. ; souiller de noir de fumée. - (07) |
| machurer. Noircir, barbouiller. Al ast mâchuré quemant an ramonâ. Le roman de Garin le loherain renferme le mot mascurer. - (13) |
| mâchuron : qui est noirci par la fumée. (S. T III) - D - (25) |
| machuron, sm. personne à visage brun ou noirci accidentellement. - (17) |
| mâchuron, tache de noir sur les mains, sur la figure. - (16) |
| machuron. Forgeron... - (13) |
| macque, maque. adv. Quand. Macque a' s'ri lè, quand elle sera là. (Pasilly). - (10) |
| macredi : mercredi. - (29) |
| macria, sorte de grosse groseille nommée groseille à maquereau... - (02) |
| mâdé, bientôt. Ex.: je n'en ai pas pour mâdé, longtemps. - (27) |
| madecin : Médecin. « Ce que n'est pas ban au malède est ban au madecin ». - (19) |
| madeçin*, s. m. médecin. - (22) |
| madecine : Médecine, drogue, remède. « Je n'ame pas les madecins à peu enco bin moins les madecines » : je n'aime pas mes médecins et encore bien moins les médecines. - (19) |
| madelein-ne (na) : madeleine - (57) |
| Madelein-ne : Madeleine. « A la Madelain-ne la noix est plieine » : la fête de la Sainte-Madeleine est le 22 Juillet, à cette époque les noix commencent à être bonnes. C'est aussi la saison des bains de rivière et comme chaque année il se produit des acccidents fatals aux nageurs imprudents on dit en apprenant la première noyade de l'année : « Y est la Madelain-ne qu'amène san étrain-ne ». - (19) |
| Madelon, Madelaine. - (16) |
| Madelon. Diminutif de Madeleine. Malon, que certaines gens disent pour Madelon, n'est ni reçu, ni presque connu… - (01) |
| madériser : v, n. Se dit du vin blanc Iorsqu'en vieillissant il prend un goût analogue à celui du madère. - (20) |
| madeu : pour le moment à venir. (C. T IV) - A - (25) |
| mâdeu, adv. aujourd'hui, après midi, ce soir, tantôt ; « démâdeu », dès à présent, tout de suite. - (08) |
| madeugne. adv. Beaucoup. (Menades). - (10) |
| mâd'heu - désormais, de ce moment. - Ci ne vos airiveré mâd'heu pu. - Oh ! nos voiqui deu mâd'heu tranquilles de ce côtai. - (18) |
| madje, sf. merde. - (17) |
| Mador, Mares-d'Or, vignoble renommé à Dijon. - (02) |
| mador. C'est ainsi que, par corruption de marc d'or, est nommé un célèbre vignoble du Dijonnais. - (01) |
| madraguer. Altérer quelque chose par mélange ou par sophistication, faire perdre la qualité d'un liquide en l'agitant. - (12) |
| mâdrier (on) : madrier - (57) |
| madrouiller, mélanger des denrées, surtout le vin, avec des produits plus ou moins naturels. - (27) |
| mâe : Maie, pétrin. « Rac'lle voir bien la mâe pa fare eune greusse épogne » : racle bien la maie pour que « l'épogne » soit grosse. - « Mâe de pressoi » : la plate forme sur laquelle on met le marc destiné à être pressé. - (19) |
| maeur,adj. mûr ; en patois moderne : meur. - (38) |
| mafi, ma foi, juron de femme ; ma fi voui ! mafi nan ! - (16) |
| mafiance (n.f.) : méfiance - (50) |
| mafiant (-te) (adj.m. et f.) : méfiant, méfiante - (50) |
| mafier (se) (v.pr.) : se méfier - (50) |
| magain : (nf) poupée - (35) |
| magain : s, f., guenon. Se dit Jes poupées laides et des femmes idem. - (20) |
| mâgau, s. m. le jeu du « mâgau » est un jeu de billes comme le jeu dit : « à la masse. » - (08) |
| magebrou, s. m. salsifis des prés. - (22) |
| mâgette : voir lunette - (23) |
| maglice. Malice, malices. La syllabe gli se mouille. - (01) |
| magna, s. m. 1. jeune homme adulte : c'est un beau magna. — 2. Amoureux, prétendant : elle a un magna. - (24) |
| magna; s. m. 1. Jeune homme adulte : c'est un beau magna. — 2. Amoureux, prétendant : elle a un magna. - (22) |
| magnat : s. m., garçon, luron, amoureux, fiancé. - (20) |
| magne (Je, Tu, Il). Ind. prés, du verbe magner. (Manier). – Se Magner. v. pron. Se maniérer, faire ses embarras. (Soucy). - (10) |
| mâgné (s'), dépouâché (s') : v. pr. Se dépêcher. - (53) |
| magne : lit de mauvaise qualité, grabat - (61) |
| mâgne : vieille maison. - (09) |
| magne : vieille masure. III, p. 17 ; III, p. 31 - (23) |
| magne, mayon : masure, maison - (36) |
| mâgne, s. f. masure, maison en ruine, tas de décombres. - (08) |
| magnée, magniée, maignée. s. f. Grande troupe d'enfants. (Percey). – En général, ce qui constitue la maison, la famille, maîtres, enfants, domestiques, toute la maisonnée, comme on dit vulgairement. Du bas latin mansionata,mangneya, mainagium, et du latin manere. Voyez maignée, dans Roquefort. - (10) |
| magnée. n. f. - Manière. - (42) |
| magnefier. : (Dial.), exalter, glorifier quelqu'un (du latin magnificare). - (06) |
| Mâgnenette (la) nom de loc. Dans la commune de Corancy. - (08) |
| magner (s') (v. pr.) : agir, se comporter de telle ou telle manière (s'magner mal (agir avec maladresse, en parlant d'une personne ou être mal agencé en parlant d'une chose)) - (64) |
| mâgner (se), v. pron. se mettre en train, agir avec vivacité, avec vigueur, avec effort : « ço eun bon ovré, ai s' mâgnie bin », c'est un bon ouvrier, il se démène bien. - (08) |
| mâgnes (contraction de maheingnes, maheignos). s. f. pl. Ruines, débris de murailles. De manaigner, mehaigner, blesser, mutiler, disloquer, et du bas latin, mahennare, mahainium. - (10) |
| mâgni : manier - (57) |
| magnien (n.m.) : rétameur ambulant, chaudronnier - (50) |
| magnien : (nm) rétameur ambulant - (35) |
| magnien : s. m., étameur ambulant; escargot. - (20) |
| magnien, chaudronnier. - (04) |
| magnien. : (Dial. et pat.), chaudronnier ambulant. - (06) |
| mâgnier (s’) : (se) dépêcher - (37) |
| magnin : étameur, zingueur. A - B - (41) |
| magnin : chaudronnier, rétameur. - (32) |
| magnin : chaudronnier-étameur ambulant. Vient du vieux français et s’écrit parfois « magnien ». - (62) |
| magnin : étameur, zingueur - (34) |
| magnin : étameur, zingueur - (43) |
| magnin n.m. Rémouleur, chaudronnier, étameur ambulant. - (63) |
| magnin, espèce de chaudronnier. - (05) |
| magnin, magnan, magnier, s. m., chaudronnier ambulant : « As-tu des castroles à rac'moder ? V'là l’magnin qui passe. » - (14) |
| màgnin, màgnien, mânien (C.-d., Chal., Br., Char.), maignin (Morv.). – Chaudronnier nomade ; du même mot en vieux français, venant du bas latin magninus, même sens. L'étymologie de ce dernier mot est probablement manus ; dans ce cas, l'orthographe manien serait la meilleure. - (15) |
| magnin, s. m. 1. Étameur ambulant. — 2. Petit escargot jaune, non comestible. - (22) |
| magnin, s. m. 1. étameur ambulant. — 2. Petit escargot jaune. - (24) |
| magnin, s. m., étameur ambulant. - (40) |
| magnin. Chaudronnier. - (03) |
| magnin. Étameur ambulant. - (49) |
| magnin. Etameur ambulant. Etym. le bas latin magninus, chaudronnier. - (12) |
| magnoter (v. tr.) : manier avec peu de soin - (64) |
| magot, se dit d'un singe ou d'une figure grotesque, et aussi d'un trésor qu'on a grossi peu à peu... - (02) |
| mâgre : maigre - (46) |
| mâgre : Maigre. « Ol est mâgre c'ment in cent de clios (clous) ». « Le mécredi (mercredi) des Cendres est in jo mâgre ». - (19) |
| màgre, adj., maigre, défait. - (14) |
| magre, maigre (ê), adj. maigre. - (17) |
| magri, vn. maigrir. - (17) |
| mâgriot : maigriot - (46) |
| mâgueiller : (mâ:kèyé - v. intr.) mâcher, en affichant des difficultés à réduire en bouillie ce qu'on mâche. - (45) |
| maguignan : Maquignon. « Pa fare in ban maguignan in ne faut pas être treu honnête » : pour faire un bon maquignon il ne faut pas être trop scrupuleux. - (19) |
| maguin. s. f. Jeune fille étourdie. (Annay-sur-Serein). – A Fresne, petite fille : J'ai grondé la maguin. - (10) |
| mahonner. v. n. Parler d'une voix entrecoupée, prononcer d'une manière vicieuse. (Saint-Florentin, Villechétive). – Donné aussi par Corblet, dans le même sens. - (10) |
| mahonneux. s. m. Celui qui mahonne. (Saint-Florentin). - (10) |
| mahoute, amahoute. s. f. Matricaire, grande camomille très-puante qui s'emploie pour infecter l'endroit ou s'est posé un essaim vagabond, afin de l'obliger à gagner la ruche qu'on lui a préparée. (Puysaie). - (10) |
| mai : épouvantail dans un champ. A - B - (41) |
| mai - ma. - C'â lé qui m'é fait mai robe. - I ai fait mai prière du sair pendant qui étâ dans l'église. - Voyez mainne et met. - (18) |
| mai (adj.pos.fém.sing.) : ma - (50) |
| mai (un) : tradition au 1er mai. Planter un mai : une branche d’arbre devant ou sur la maison d’une fille à marier. Ramasser nuitamment tout ce qui traine près des maisons et le rassembler sur la place du village. - (62) |
| mai : Arbre que les jeunes gens plantent dans la nuit du 30 Avril au 1er Mai à la porte ou sur la cheminée du toit de leur bonne amie. Chaque essence d'arbre a sa signification « Chagne je t'ame, orsio je te veux mau, charmèche je te rembrache, lilas te me déplias » : chêne je t'aime, cytise je te hais, charmille je t'embrasse, lilas tu me déplais. - (19) |
| mai : fantôme, épouvantail dans un champ - (34) |
| mai man : ma mère - (37) |
| mai n.m. Epouvantail. - (63) |
| mai : adj. poss. f. Ma. - (53) |
| mai, adj. poss. f., ma. - (14) |
| mai, coffre à pétrir le pain... Mai a encore une autre application : on dit piantai lo mai, c.-à-d. planter un arbre, au premier jour de mai, devant la maison des jeunes filles à marier; dans cette acception on dit un mai... - (02) |
| mai, s. f. meuble où l'on pétrit le pain et où on l'enferme lorsqu'il est cuit. - (08) |
| mai, sf. pétrissoire ; huche à pain. - (17) |
| mai. Branche d'arbre, ornée de rubans et de fleurs, placée le 1er mai devant la porte d'une jeune fille, par les garçons du village... - (13) |
| mai. Pronom personnel féminin devant une consonne : Mai meire, mai tante, mai borse ; on dit néanmoins toujours ma foi en jurant, à moins qu'on ne fasse précéder une épithète, comme mai daigne foi ; mai est aussi verbe, je mai, tu mai ; ai mai, je mets, tu mets, il met. L'impératif mai reçoit, en certaines rencontres, une s finale : mais-y lai main, mets-y là inain… - (01) |
| mai. : (Dial. et pat.), huche à pétrir. – En Champagne met ; en Picardie maie ou moie ; dans le Jura maid ; en Franche-Comté meû. Ce sont autant de dérivés du latin magis, génit. magidis, ou du latin mactra. (Aulugelle.) Tous ces mots signifient coffre, huche, pétrin. - (06) |
| maiç’ine ai batt’e (lai) : (la) machine à battre (l’événement de l’été dans chaque village) - (37) |
| maiç’iner : organiser, préparer, combiner - (37) |
| maîç’nîller : mâcher lentement - (37) |
| maîç’oûillé : machouillé, réduit en pulpe, en bouillie - (37) |
| maîç’oûiller : mâcher longuement - (37) |
| maiceau, s. m. maréchal ferrant. - (08) |
| maichan : Maçon. « In martiau de maichan » : un marteau de maçon. - Expression : « De la sope de maichan » de la soupe au pain, très épaisse. - (19) |
| maïchau. s. m. maréchal. (Accolay). - (10) |
| maîche, n. fém. ; réunion de plusieurs paquets de chanvre. - (07) |
| maicherâ, maischerot - divers temps du verbe marcher (prononcer bien mais et non pas mai). - Vos deux vos maischerâ devant. - A maischerot bein s'a velo, ailé. - (18) |
| maiçon, sm. maçon. - (17) |
| maie (f.), pétrin avec placard inférieur. - (27) |
| maie : voir arche - (23) |
| maie et mayon. C’est le pétrin dans lequel on réduit la farine en pâte. C'est aussi la plate-forme du pressoir, sur laquelle les raisins sont massés. - (13) |
| maie : voir pressoir. - (20) |
| maie, mai (n.f.) : meuble où l'on pétrit le pain (de Chambure a écrit mai et Déchard écrit mé) - (50) |
| maie, met, pétrin, huche. - (04) |
| maie, n.f. pétrin. - (65) |
| maïe, pâtière, pétrin, pétrissoire. - (05) |
| maie, s. f., grand récipient en bois, dans lequel chaque ménagère pétrit le pain de la maison. - (14) |
| maie, s. f., pétrin, avec deux portes en dessous. - (40) |
| maïeutse : maillet de bois - (51) |
| maige. Mage. Les mages qui vinrent adorer le Sauveur. - (01) |
| maigistra. Magistrat. - (01) |
| maignance, s. f. maniance, maniement ; ce que l'on a entre mains, ce dont on est chargé, ce que l'on administre. - (08) |
| maigne. : Mine. Faire lai maigne grise, c'était montrer un visage sévère ou peu avenant. - (06) |
| maigneau, maîneau. n. m. maignotte. n. f. - Dans une coupe de bois, désigne un arbre qui a environ quarante ans. - (42) |
| maignen (un) : escargot ou chaudronnier (région de chaulgnes) - (61) |
| maigne-touai ! : dépêche-toi ! - (37) |
| maigniâble, adj. maniable, qu'on peut saisir avec la main. se dit aussi en parlant des personnes : « ç'ô eun ch'ti, a n'ô pà maigniâble », c'est un méchant, il n'est pas traitable. - (08) |
| Maignié. Magnien, nom propre d’un prêtre connu à Dijon par ses brusqueries. Dans le temps qu'il y était vicaire de la cure de Saint-Etienne, s'étant avisé de déclamer dans un de ses prônes très mal à propos contre les pères jésuites, il fut obligé de se rétracter publiquement le dimanche suivant… - (01) |
| maignien : escargot, chaudronnier. IV, p. 30 ; V, P. 23 - (23) |
| maignien : rétameur, ferblantier (ambulant) - (37) |
| maignien, n. masc. ; chaudronnier ambulant. - (07) |
| maignin : Etameur, raccommodeur de faïence, de parapluies, etc… « Ol est in ptiet bout maignin » : il est un peu raccomodeur, il s'entend à toutes sortes de petites réparations. Nom de lieu : « La tarre du Maignin ». - (19) |
| maignin, s. m. magnier, chaudronnier nomade qui parcourt les campagnes pour réparer les ustensiles de cuivre ou d'étain. - (08) |
| maignotte. s. f. Arbre de l'âge supérieur au baliveau, réservé dans une coupe de bois. - (10) |
| maigre (nom féminin) : main. - (47) |
| maigrëchine, maigre échine, personne ou animal très maigre. - (16) |
| maigrichon, onne, adj. et subst. maigre, chétif, malingre. - (08) |
| maigrichon. s. m. Enfant très-maigre, fiévreux, maladif. - (10) |
| maigrillot. Maigrelet. - (49) |
| maigriòt, adj., maigret, maigrelet, chétif, qui a mauvaise mine. - (14) |
| maigritiöte, sf. marguerite. - (17) |
| maihiaize, s. m. mariage. - (08) |
| maihïer, s. m. marguiller. - (08) |
| maihier, v. a. marier : « une maihiée », une mariée. - (08) |
| maihounée. s. f. Maisonnée. - (10) |
| mai'ille : maille - (48) |
| maiitenée, s. f. matinée, le temps qui s'écoule depuis le lever du soleil jusqu'à midi. - (08) |
| maijan : Maison. « Demorer à la maijan » : rester chez soi. « La maijan commune » : la mairie. « Eune bonne maijan » une famille dans l'aisance. « L’escargueut (escargot) porte sa maijan su san deu ( sur son dos) ». - (19) |
| maijon n.f. Maison. - (63) |
| mail pairti ! (y ot) : (c’est) voué à l’échec ! - (37) |
| mail’ fiçu : pas bien portant - (37) |
| mailaide : malade - (48) |
| mailaide, adj. malade. Sobriquet : les chès mailaides d'Etalente (les chiens enragés). - (17) |
| mailaide. adj. malade. - (08) |
| mailaide. Malade, malades. - (01) |
| mailaidie : maladie - (48) |
| mailaidie, s. f. maladie. - (08) |
| mailaidou, ouse, adj. maladif, sujet à être malade. « melaideu. » - (08) |
| Mailaileai. Malaléel, patriarche. - (01) |
| mailiç’e (aivouair) : (avoir) honte, (être) « embêté » - (37) |
| maillâ : le canard mâle - (46) |
| maillà, s. f., terme de marine fluviale, corde tirée par l'équipage de chevaux remorqueurs. - (14) |
| maillacé, maillassé, adj. Tacheté, moucheté, bigarré. (Villeneuve-les-Genêts, Villiers-Saint-Benoit). - (10) |
| maillassé. adj. - Moucheté, tacheté de couleurs différentes. - (42) |
| maille (n.f.) : ancien nom de la cataracte - (50) |
| mâille (na) : maille - (57) |
| maille : maillet à long manche - (43) |
| maille, ancien nom de la cataracte, taie sur l'œil. - (04) |
| maille, mailla, maillette : s. f., câble de halage. Tire à la maillette ! est un commandement que l'on entend souvent sur les bords de la Saône. - (20) |
| maille, n.f. pioche plate avec deux dents. - (65) |
| maille, pioche à deux dents. - (28) |
| maille, s. f. maille, taie sur l'oeil, tunicaocularis, ancien nom de la cataracte. - (08) |
| maille, s. f., pioche plate à col de cygne, avec deux dents. - (40) |
| mâille, s.f. sorte de houe à long fer triangulaire servant à la culture de la vigne ; "tirer la maille", ce qui indique qu'on la tire à soi en labourant la terre à la façon d'une charrue ; la maille a disparu des coteaux chalonnais vers 1800-1830, mais est encore utilisée en Côte-d'Or. - (38) |
| maillé, vn. bourgeonner, pousser après l'hiver. - (17) |
| maille. Obole, monnaie valant un demi-denier. - (01) |
| maille. s. f. Trou d'eau, mare résultant de quelque excavation faite pour l'extraction de la marne. (Molesme). De mail, marne. – Roquefort donne mailière, maillière, marlière, fosse ou l'on tire la marne. - (10) |
| maillée. s. f. Grande quantité. Une maillée d'enfants. (Saint-Florentin). - (10) |
| maillette : 5 gerbes de céréales font une maillette - (46) |
| maillette n.f. (dérivé du lat. metam, tout objet pointu). Javelle. Voir dzvelle, dzuelle, dzuellon. - (63) |
| maillette : n. f. Gerbe faite mécaniquement. - (53) |
| maillette, s. f., partie de gerbe (trois Javelles font une maillette ; trois maillettes font une gerbe). - (40) |
| mailleuche : Maillet. « Eune mailleuche de tonnelier ». Quand un vieillard semble avoir dépassé les limites de la vie humaine on dit en manière de plaisanterie : « I faudra fare béni eune mailleuche autrement an ne s'en débarassera pas » : il faudra faire bénir un maillet pour pouvoir l'assommer impunément sans cela on ne s'en débarrassera pas. - (19) |
| mailleuche : masse - (48) |
| mâilleur, mâillou, s.m. batteur à la grange (à Buxy) ; probablement aussi ceux qui tiraient la maille. - (38) |
| mailleusse : masse - (39) |
| mailleut : Gros maillet à long manche. « Taper dessus à grands côs de mailleut » : taper dessus à grands coups de maillet. - (19) |
| maillo : Meilleur. « Le vin de s't'an-née est maillo que s'tu de l'an-née passée » : le vin de cette année est meilleur que celui de l'année dernière. - (19) |
| maillô. Maillot, le maillot d'un enfant… - (01) |
| mailloche (n.f.) : grosse masse en bois pour enfoncer les pieux - (50) |
| mailloche : s. f., petit maillet à main. - (20) |
| mailloche, malloche, mailluche et malluche. s. f. Gros maillet en bois ; figurément, tête sans cervelle, tête dure. - (10) |
| mailloche, s. f., grosse masse en bois, pour enfoncer les piquets de vigne ou de clôture. - (40) |
| maillocher. Frapper avec un maillet, une « mailloche ». - (49) |
| maillolet : s. m., vx fr.. pièce de calicot qui sert à emmailloter l'enfant nouveau-né. - (20) |
| mâillon - autre orthographe de mâyon. - (18) |
| mâillon (n. m.) : centaurée, plante herbacée commune dans les prés - (64) |
| maillon (n.f.) : neige fine et congelée qui tombe quand le temps est froid - (50) |
| maillon (nom féminin) : maison. - (47) |
| mâillon, mâ'yon : maison - (48) |
| maillon, s. m. branche de bois flexible dont on se sert pour lier un fagot ou une gerbe. - (08) |
| maillon, s. m. neige fine et congelée. le temps est froid, il tombe du « maillon. » environ de Gacôgne, Lormes, etc. - (08) |
| maillons. s. m. pl. Gravois, débris de démolitions. (Saint-Florentin). - (10) |
| maillot (on) : maillet - (57) |
| maillòt, s. m., maillet, petit marteau solide. - (14) |
| maillot,s.m. maillet. - (38) |
| maillotse n.f. Maillet, mailloche. - (63) |
| maillotsi v. Frapper avec un maillet. - (63) |
| maillotté. adj. Ligny. – Voyez maillassé. - (10) |
| maillou : meilleur - (57) |
| mailluche : gros maillet à long manche. Pou fendre le bois o féyo une mailluche : pour fendre le bois il fallait une mailluche. - (33) |
| mailluèche, ll mouillées, s. f. grosse masse pour enfoncer les coins de fer en fendant le bois. - (08) |
| mailusse : mailloche, masse en bois - (37) |
| maimeûjer : jouer (« man ! y vai maimeûjeur ! ») - (37) |
| main : Main. Dicton : « Ol a mau à la main que donnne » : il ne donne jamais rien, c'est un avare. - (19) |
| main- me, adj. et adv., même. - (14) |
| main : s. f. main. - (21) |
| main, mainne - mien, mienne. - A s'en ailo tranquillement es champs d'aivou ine piaiche et… c'éto lai mainne. - I dirai ce qui ai main mére. - Ce n'est, je crois, que quand on parle de sa mère que l'on dit main, sans doute par euphonie, ce qui n'empêche pas de dire aussi mai. - (18) |
| main. n. f. - Gant de toilette. - (42) |
| mainche (na) - mainge (na) : manche (de l'habit) - (57) |
| mainche, s. f., manche de vêtement. - (14) |
| mainche, s. m., manche d'outil. - (14) |
| mainchòt, s. et adj., manchot. - (14) |
| maindzi : manger - (43) |
| maîneau. s. m. Réserve ayant environ 40 ans. (Villiers-Saint-Benoit). – Voyez maignotte. - (10) |
| mainevea ou menevea. : Poignée de chanvre à décortiquer. Maineveau de chanvre signifie ce qu'on peut en tenir dans la main. (Du latin manipulus ou manu vectum.) - (06) |
| mainfait. adj. Mat fait, difforme. - (10) |
| main-faux. n. m. - Manche de la faux. - (42) |
| maing (n.f.) : main - (50) |
| maing : main - (39) |
| maingé. Mangé, manger, mangez. - (01) |
| mainge. Mange, manges, mangent. - (01) |
| maingean. Mangeant. - (01) |
| maingeoire. : (Pat.), maingéure (dial.), crèche. - (06) |
| maingeon. Mangeons. - (01) |
| maingeoû, et migeoû, s. m., mangeur. - (14) |
| mainger la cape à Diou, loc, se dit d'une personne sans ordre, d'un dissipateur : « Lu ? On l'iaiss'rôt fâre, ô mangeròt La cape à Diou. » Sent son méridional. - (14) |
| mainger, et miger, v. tr., manger, absorber, faire disparaître. - (14) |
| maingeu. Mangeur, mangeurs. - (01) |
| mainghen. adj. Voyez manguin. - (10) |
| maingn' s, f. main. « en zoignant sas deus maingnes chu soun astoomach », enjoignant ses deux mains sur sa poitrine. - (08) |
| maingn’: main. - (52) |
| maingne. s. f. Main. - (10) |
| maingnué (n.f.) : minuit - aussi mimnuait - (50) |
| mainguerlet. adj. Maigrelet. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| mainiére (n.f.) : manière - (50) |
| mainigaiiee. Manigance : « Lai mainigancê du rambo », signifie l’affaire de la pomme fatale… - (01) |
| mainiganç’es : entreprises sournoises - (37) |
| mainigance, artifice, machination. Ce mot a de la conformité avec mainiance. Avoir tout à ùaniance, c'est disposer de tout. Deux expressions latines y répondent : manu agere et manu gerere. - (02) |
| mainigance. : Artifice, jeu d'une personne qui agit à la dérobée. - (Rac. lat. manu gerere.) Ce sens-là n'a été donné que par extension au figuré ; car, au propre, il signifie maniement d'une chose, d'un bien, d'une affaire. - (06) |
| mainigances : manigances, tractations sournoises - (37) |
| mainjé, manger ; mainjou, gros mangeur. - (16) |
| mainjoure : mangeoire. - (29) |
| main-mement, adv., mêmement. - (14) |
| mainmorte : état des serfs qui étaient attachés à la glèbe et privé de la faculté de disposer de leurs biens. - (55) |
| maiñnant adv. Maintenant. - (63) |
| main-ne : mien - (57) |
| mainnée. manlée, manvée, s. f. poignée, ce qui peut tenir dans la main d'un moissonneur. - (08) |
| main-net : minuit - (57) |
| mainneu, minuit ; comme on disait mainjor, mijor, et enfin midi.En latin, medium noctis, médium diei. - (02) |
| mainneu. : Minuit (en latin medium noctis), comme on dit mainjor ou mijor pour le milieu du jour ou midi. - (06) |
| mainnieu – minuit. - A n'é rentrai qu'ai mainnieu. - En éto taird, songez que mainnieu senot qui entrains à pays. - (18) |
| mainteni : maintenir - (48) |
| mainteni : maintenir - (39) |
| maintin : maintien - (48) |
| maintîn : maintien - (39) |
| maintin, s. m. maintien, entretien. un cheval, un bœuf d'un bon « maintin », c’est à dire facile à nourrir, à maintenir en santé, en embonpoint. - (08) |
| mâïon : n. f. Maison. - (53) |
| mâïon, mâ-yon,s.f. maison. - (38) |
| màïon, s. f. maison, habitation. dans une partie du on prononce « majon. » - (08) |
| màïon, s. f., maison, habitation, intérieur : « T'é pas gein-née, toi ; t'vas t'preùmener pendant que j'garde la màïon. » - (14) |
| mai'on. n. f. - Maison. - (42) |
| mai'ounée. n. f. - Maisonnée. - (42) |
| maipriyer : mépriser - (39) |
| maiqueigne - un peu maladif, qui ne se sent pas bien portant. - I ne sai pâ ce qui ai, i seu tô maiqueigne. - Depeu quéque jors â ne peu pas traiveillai des andées, al à to maiqueigne. - (18) |
| maiquerea. Maquereau, injure qu'on apprend aux oiseaux qui parlent ; sur quoi certain curé disait un jour dans son prône qu'il vaudrait bien mieux leur apprendre de bons oremus. - (01) |
| maiqueurdi - mercredi. - C'à tojeur le maiqueurdi qui eûme mieux laiborai note champ de lai Prée. - (18) |
| maiqueurdi : n. m. Mercredi. - (53) |
| mair (n.m.) : mars - (50) |
| mair, s. m. mars, le troisième mois de l'année. - (08) |
| mairâ, s. m. marais, terrain rempli d'eau stagnante. - (08) |
| mairaize : mariage - (39) |
| mairanda : repas. (S. T IV) - B - (25) |
| mairande : rarement, ce mot remplace le « goûter » et veut dire principalement comme lui le repas du midi , mais je ne l’ai entendu que très peu dire dans le haut-morvan (le soir, c’était « lai seûpe ») - (37) |
| mairande : n. f. Manger, repas. - (53) |
| mairande : repas - (39) |
| mairande, marande : repas, nourriture - (48) |
| mairander : même remarque – prendre son repas de midi - (37) |
| mairander : manger - (39) |
| mairaude : maraude, ramassage de tout ce qui « traine » - (37) |
| mairc’and d’meûsique, coumédien : menteur - (37) |
| mairç’aux : maréchal-ferrant - (37) |
| mairc’er d’son pied : marcher à pied - (37) |
| maircau (n.m.) : chat mâle, matou - (50) |
| maircau, s. m. chat mâle, matou. (voyez marcau.) - (08) |
| mairchan, ande, adj. marchand, bien conditionné, de bonne qualité, de bonne vente. - (08) |
| mairchandie, s. f. marchandise. Se dit de toutes les productions susceptibles d'être vendues. - (08) |
| mairchandise : n. f. Marchandise. - (53) |
| mairchaû : maréchal, maréchal ferrant - (48) |
| mairchaux : forgeron (maréchal). - (32) |
| mairché : marché - (48) |
| maircher : marcher - (48) |
| mairdi : mardi - (48) |
| mairdi, s. m. mardi, le troisième jour de la semaine. - (08) |
| maire de Charolles : loc., neuf de pique, Presque partout cette carte est dite le maire d'une commune voisine. On sait que dans la cartomancie un présage défavorable s'attache au neuf de pique. - (20) |
| maire, s. f. mare avec l'insertion dialectale de l'i. - (08) |
| mairèchau, sm. maréchal. - (17) |
| maire-may-may. : De plus en plus. Comme si l'on avait voulu traduire en les abrégeant les mots latins de majore ad majorem rem. - (06) |
| maireneire, mareneire, mairenier et maronne. : Pantalon. Lamonnoye a donné dans son glossaire l'étymologie de ce mot. - Maïronné un enfant c'est lui mettre sa première culotte (expression de bas étage mais qui a cours). - (06) |
| mairenière, mareneire et même maronière et maironnié, pantalon... - (02) |
| mairerie (n.f.) : mairie - (50) |
| mairerie : mairie - (39) |
| mairerie, s. f. mairie, maison où le maire exerce ses fonctions. - (08) |
| mairerie. Mairie. - (49) |
| mairesse. Femme du maire. - (49) |
| mairgealle : margelle - (48) |
| mairgonner : « rouspéter » entre ses dents - (37) |
| mairgossé (tô) : 1 exp. Tout mouiller. - 2 exp. Tout tremblant. - (53) |
| mairgossè : sale, couvert de boue - (48) |
| mairgotin d’quait’e chous : petit morceau de bois de faibles dimensions - (37) |
| mairgoulette : figure - (48) |
| mairgoulin (n.m.) : coureur de grand chemin, vagabond - (50) |
| mairgoulin, s. m. coureur de grands chemins, vagabond. - (08) |
| mairi. Mari, maris. - (01) |
| mairiage : Mariage. « Ol a fait in ban mairiage » : il s'est marié richement. - (19) |
| mairiage. Mariage… - (01) |
| mairiai. Marier, marié, mariez. - (01) |
| mairiaige (n.m.) : mariage - (50) |
| mairiaige : mariage - (48) |
| mairiaige, s. f. mariage. - (08) |
| mairié (n.m.) : marié - (50) |
| mairié (on) : marié - (57) |
| maî'rie : mairie - (48) |
| Mairie : Marie - (48) |
| mairiè : v. pr. Se marier. - (53) |
| mairié(e) : marié(e) - (39) |
| Mairie. Marie, la Vierge Marie… - (01) |
| mairié. Pluriel de la seconde personne de l'indicatif du verbe marier. - (01) |
| mairiée (na) : mariée - (57) |
| mairiée, sf. mariée. - (17) |
| mairier - (39) |
| mairier : marier - (48) |
| mairier : marier - (57) |
| mairier : Marier. « A cause dan (pourquoi donc) que te t'mairie pas ? Mâ i faut êt'deux pa se mairier ! O ment (met) ses mains darré san deu (derrière son dos) ol a tot mairié ses filles », réflexion qui signifie : il a réussi à marier ses filles, il peut maintenant mettre les mains derrière son dos ou se croiser les bras. - (19) |
| mairier, v. a. marier. - (08) |
| mairillö, sm. marguillier. - (17) |
| mairillöre, sf. marguillière. - (17) |
| mairiöge, sm. mariage. - (17) |
| Mairion. Diminutif du nom Marie, Marion… - (01) |
| mairiou (on) : marieur - (57) |
| mairiou, sm. marieur. - (17) |
| mairious (les) : mariés (couple) - (57) |
| mairioux : Marié. Féminin mairiouse. Ces termes ne s'appliquent aux mariés que le jour du mariage. « As tu vu passer les mairioux ? » : as-tu vu passer les mariés ? - (19) |
| mairisseau : maréchal-ferrant - (39) |
| mairmeûjer : répéter des potins, des « bruits qui courent » - (37) |
| mairmite, s. f. marmite, vase en fonte dont on se sert dans nos campagnes pour faire cuire les aliments. Les marmites ont des pieds tandis que les chaudrons n'en ont pas. - (08) |
| mairmitée, s. f. une pleine marmite, tout ce qu'une marmite peut contenir. (voir : pénerée.) - (08) |
| mairmitte : nom affectueux employé par le mécanicien de la machine à battre pour parler de sa « chaudière », la locomobile - (37) |
| mairmitte, ç’audiére : gros poêle de forme ronde, à grande contenance, à couvercles, à cercles s’emboitant pour la cuisson de la nourriture des porcs - (37) |
| mairon, maihion. s. f. Maison. - (10) |
| maironne débouclée (Ai) : il rit à gorge déployée. (AS. T II) - S&L - (25) |
| maironner : regretter, maugréer - (37) |
| mairquô : matou - (48) |
| mairquouâ, mairqûaud : chat, matou - (37) |
| mair-rie : mairie. - (52) |
| mair-rie : mairie (prononciation abandonnée dans la 2ème moitié du 20ème siècle). - (33) |
| mair'rie : (mê:r'ri: - subst. f.) mairie, selon une prononciation ancienne, encore attestée au XIVe siècle. - (45) |
| mair'rie : n. f. Mairie, prononciation jusqu'à la deuxième moitié du XXème siècle. - (53) |
| maîrrons d’raits : marrons d’inde - (37) |
| mairtaie : marteau - (48) |
| mairteai, s. m. marteau : « eun cô d' mairteai », un coup de marteau. « marquiau. » - (08) |
| maïs (paille de), loc. On appelle paille de maïs les feuilles qui servaient d'enveloppe à la grappe. On les fait sécher, et on les emploie à rembourrer les paillasses. - (14) |
| mais : plus, davantage. II, p. 26-4 - (23) |
| maîs adv. Plus, davantage. Dz'en voux maîs : j'en veux davantage. Dz'en poux maîs : je n'en peux plus, je m'avoue impuissant. L'expression française n'en pouvoir mais, remonte au XIIè s. ; à l'époque, mais était aussi un adverbe signifiant plus ou davantage. - (63) |
| maîs qu'd'un loc. adv. Plus d'un. Y'en a maîs qu'd'un qu'voudrot éte à ta pyèce ! Il y en a plus d'un qui voudrait être à ta place ! - (63) |
| mais : adv., vx fr., plus. - (20) |
| maisement que (loc.adv.) : pendant que - (50) |
| maisement que, loc. conj. pendant que, tandis que, en même temps que, au fur et à mesure que. - (08) |
| maishui : adv,. vx fr., aujourd'hui, maintenant, désormais, - (20) |
| maisonnement. s. m. terme collectif très usité dans les terriers et les actes notariés du pays pour désigner les différents corps de bâtiment, les divers « châs » (voir : châ) d'une habitation rurale - (08) |
| maiss-hon, maiss-hener, moisson, moissonner. - (05) |
| maissue, sf. massue. Scabieuse. Herbe à longues feuilles ? - (17) |
| maît' d'écôle (ou mâte) : Instituteur. « Ol est assi savant qu'in maît 'd'écôle » : il est aussi instruit qu'un instituteur. On disait plus anciennement : mâte d'école, aller à mâte. - (19) |
| maitaing, matin - (36) |
| maitée : n. m. Matin. - (53) |
| maiteire. Matière. - (01) |
| maitenant, adv. maintenant. On dit fréquemment aussi ai çt'öre. Tö maitenant. Tout de suite. Voir cesse. - (17) |
| maitenée : matinée - (39) |
| maitenot, s. m., le matin, à la pointe du jour. - (11) |
| Maithieusalai. Mathusalem, patriarche. - (01) |
| maitin (on) - metin (on) : matin - (57) |
| maitin : matin - (48) |
| maitin, s. m. matin. On prononce « métingn' » - (08) |
| maitin, s. m., matin, de très bonne heure. - (14) |
| maitin, sm. matin. - (17) |
| maitin. Matin. - (01) |
| maitinaule (adj.) : matinal - (50) |
| maitinaule, adj., matinal. - (14) |
| maiting (n.m.) : matin - (50) |
| maiting : matin - (39) |
| mait'nant, et mét'nant, adv., maintenant, à présent. - (14) |
| mait'nau : vent du Sud. (RDM. T IV) - B - (25) |
| mait'naule : matinal - (48) |
| mait'née : matinée - (48) |
| mait'née, s. f., matinée. - (14) |
| maitnée, sf. matinée. - (17) |
| maito - matou, chat en général. - Tote lai neu les maitot an fait le sabat dans note jairdin ; l'aute jor c'éto su le gueurné. - (18) |
| maiton, s. m. maton, tourteau formé du résidu des graines oléagineuses. Les matons servent à l'engraissement des animaux. Presque tous les meuniers du pays ont une huilerie qui convertit en matons les navettes, chenevis, noix, faines, etc. - (08) |
| maitou, s. m. matou, chat mâle. - (08) |
| maitoû, s. m., matou. Appellation moins bienveillante que minot, minoù. - (14) |
| maitrasse : Maîtresse « Y est sa fane qu'est la maitrasse » : c'est sa femme qui porte la culotte. Les domestiques, les vignerons appellent leurs patrons : « neut 'maître, neut 'maitrasse ». - (19) |
| maître (à). Au service de quelqu'un. - (12) |
| maitre (maître) (A ou En) : Ioc, en service. Aller à maître. Voir champ (Aller en). - (20) |
| maître : Maître, patron, employeur. « Oué neutmaître » : oui patron. « Aller à maître » : se placer comme domestique. « Maître en treu » : celui qui commande au pressoir, (treu treuil) - (19) |
| maitriji (se) : Se maîtriser. - (19) |
| maitton, tourteau de navette de colza. - (28) |
| maix, meix ou mex. : (Dial.), est le pourpris qui entoure une habitation, une mason ou mageon, deux autres mots patois dérivant du régime mansionem. - (06) |
| maiyettes : portions d’épis de blés dont plusieurs, rassemblées, constitueront une gerbe - (37) |
| majastre, sm. figure de vieillard ridicule. Sorte de majesté bouffonne. Masque. - (17) |
| majat, majet. s. m. Gros crapaud. (Mont-Saint-Sulpice). - (10) |
| majestai. Majesté. - (01) |
| majeu. adv. Encore. Du latin magis. (Rugny). - (10) |
| majö, adv. [meshui]. désormais. Plus, davantage. - (17) |
| majon : maison. Les affaires se rapourtin toutes è la majon : les affaires se rapportaient toutes à la maison. - (33) |
| mâjon, maison. - (26) |
| mâjon, s. f. maison. « maïon » et « mâjon » la première domine. - (08) |
| mal (vouloir) : loc., vx fr. malvoloir, vouloir du mal à quelqu'un. Il lui veut mal. Il lui veut gros mal. Vouloir mal quelqu'un, même sens, et aussi avoir de l'antipathie pour quelqu'un, de sorte qu'on peut vouloi mal quelqu'un sans lui vouloir du mal - (20) |
| mal cadu : épilepsie. - (32) |
| mal chaussé, mal chaussée : s. m. et f., mal gôné quant aux chaussures. - (20) |
| mal commode : s. m. et f., incommode. - (20) |
| mal de fait : loc, s'emploie en réponse à des affirmations qui ne peuvent pas comporter de doute. - (20) |
| mal gôné, mal gônée : s. m. et f., syn. de mandrllloux, mandrlllouse. - (20) |
| mal poli, mal polie : s. m, et f., impoli, incivil, mal élevé. - (20) |
| mal tourné, mal tournée : s. m, et f., personne ou chose de travers, au prop. et au flg. Tout le monde, à Mâcon, a connu « Mal assis » et connaît « la Mal tournée ». - (20) |
| mal : adv. Très bien mal, excessivement mal. - (20) |
| mal : s. m. Tomber du haut mal, expression employée par certaines personnes pour signifier « se trouver mal, perdre connaissance ». - (20) |
| mal, s. m. mal, plaie, abcès. Ne s'emploie dans ce sens qu'au pluriel : « al é dé mais », il a des plaies, des boutons, etc. - (08) |
| malâ : Mâle du canard. - (19) |
| maladai : être malade. Il n'a pas maladé longtemps : Il n'a pas été longtemps malade. - (33) |
| malade : adj., se dit du temps quand il devient lourd et qu'il fait prévoir de la pluie et des orages. Ce temps veut pleuvoir ; il est malade... - (20) |
| maladieux, maladif, melaideux. - (04) |
| maladrache : Maladresse. « Si te t'es fait pincer y est bin de ta maladrache » : si tu t'es fait prendre c'est bien par ta maladresse. - (19) |
| maladrait (on) : maladroit - (57) |
| maladrait'ment : maladroitement - (57) |
| maladrat : Maladroit. « Y n'est pas premis (permis) d'êt' si maladrat que cen » : il n'est pas permis d'être si maladroit. - (19) |
| maladret, s. m. et adj. Maladroit. ombrageux, difficile. (Perreuse). - (10) |
| maladret. n. m. - Maladroit. - (42) |
| maladroiteté. n. f. - Maladresse. (Bléneau, selon M. Jossier) - (42) |
| maladroiteté. s. f. Maladresse. (Bleneau). - (10) |
| maladrot n. et adj. Maladroit. Voir dagt d'veuche, dagt d'laiñne, dzagot, gautse, empji. - (63) |
| malagauche. adj. - Maladroit. Néologisme formé sur le mot «gauche», à partir de « maladroit ». - (42) |
| malagauche. adj. et s. Qui manque d'adresse. (Puysaie). - (10) |
| malaisié. adj. - Malaisé, difficile. Il s'agit de la forme médiévale de l'adjectif.malaisé ; au XIIe siècle, on utilisait malaisier pour « être gêné ». - (42) |
| malaisié. adj. Difficile, pas commode. La mée malaisiée. - (10) |
| malandre : maladie. - (32) |
| malandre. adj. Souffreteux, maladif. - (10) |
| malandres : pustules, enflures. III, p. 19-1 ; VI, p. 43 - (23) |
| malandrou (-ouse) (n. ou adj m. ou f.) : malingre, chtif (-ve), de mauvaise mine - (50) |
| malandrou, ouse, adj. malingre, chétif, de mauvaise mine. - (08) |
| malaquis. n. m. - Annulaire. - (42) |
| mâlard. s. m. Mâle du canard. Du bas latin mallardus. (Perreuse). - (10) |
| maldiement. : (Dial. ), dérivé de maledictionem et ayant même signification. - (06) |
| malechance, s. f. mauvaise chance, malheur, guignon - (08) |
| malède : malade - (43) |
| malède : Malade. « I ne faut pas tant s'épanter i ne morra que les pu malèdes » : il ne faut pas tant s'effrayer seuls les plus malades mourront. « An ne demande pas à in malède si o veut la santé » : on ne demande pas aux gens s'ils veulent d'une chose dont on sait qu'ils ont grande envie. - (19) |
| malède, m’lède : (adj) malade - (35) |
| malède, mlède n. et adj. Malade. - (63) |
| malement. adv. - Mal : « Coumment te vas-ti ded 'pis l'aut' jou ' ? Ah malement, toujou' c'te douleu' dans l'doûs ! » La forme adverbiale malement, formée sur l'adjectif.mal (e), est une construction logique. Au contraire, le français, en employant « mal » comme adverbe, fait une exception à la règle générale de formation des adverbes à partir des adjectifs et du suffixe -ment. - (42) |
| malement. adv. Pas bien, mal. (Sommecaise). - (10) |
| malendurant, adjectif qualificatif : impatient, irascible. - (54) |
| malendurant. n. m. - Celui qui ne supporte rien. - (42) |
| malène : (adj. fém.) méchante - (35) |
| maléoiz. : (Dial.), maudit, dérivation du latin maledictus. - (06) |
| malère, s. f., tige de chanvre mâle. - (14) |
| malesauce : un vieux saule - (46) |
| malesauge. Saule à oreillettes, de marsalix. - (03) |
| malescience, s. f. ignorance, défaut de savoir, de connaissance. - (08) |
| malestrier. : Dérivation du latin male strictus, mal ceint, mal vêtu, malotru. (Coutumes de Châtillon, 1371.) - (06) |
| malette, s. f. panier rond garni d'une anse et d'un couvercle. - (08) |
| maleutse : maillet - (43) |
| malfacteur : Malfaiteurs. « Tos les gueuriaux ne sant pas des malfacteurs » :tous les chemineaux ne sont pas des malfaiteurs. - (19) |
| malfaicteur, s. m. malfaiteur, vaurien, vagabond. - (08) |
| malgracieux : de mauvaise humeur - (61) |
| malhéreux(euse) : malheureux (euse) - (39) |
| malhéru, malûreu (-use, -euse) (adj.m. et f.) : malheureux, malheureuse - (50) |
| mâlheu (du) : malheur - (57) |
| malheu : Malheur. « Le malheu des ins ne guérit pas s'tu des autres ». « Y est in ptiet malheu ! » : le mal n'est pas grand. - (19) |
| malheure ! interj. qui équivaut à une plainte, à un gémissement, avec le même sens que misère ! - (08) |
| malhïeu, adj. malheureux, qui a du malheur. - (08) |
| malh'reûx : malheureux - (57) |
| malh'reux, malhureux. Malheureux. - (49) |
| malhueux. adj. Malheureux. (Andryes). – A Fléys, on dit malhuseux. - (10) |
| malhuheux : malheureux. Sens propre et figuré. Ex : "L'Bernard, ç'atait un pour' malhuheux". - (58) |
| malhûr n.m. Malheur. - (63) |
| malhureux (malhûreux) : adj., malheureux. On dit de même malhûreusement. - (20) |
| malhûreux, -euse n. et adj. Y'est-ti pas malhûreux d'woi çan ! - (63) |
| malice : (nf) « y m’fait malice » : j’ai honte - (35) |
| malice : contrariété, embarras. « Y’a pas malice ! » : il n’ya ni petites méchancetés, ni taquineries, ni moquerie. - (62) |
| malice : Méchanceté. « O fa cen pa malice » : il fait ça par méchanceté. - Ruse. « Ses malices sant cousues de fi blianc » : ses ruses sont faciles à découvrir. - (19) |
| malice n.f. Gêne, contrariété. Y m'fait malice. - (63) |
| malice : s. f., faire malice, être désagréable. Si j' suis obligée d'aller à ce mariage, y m' fra malice. A la malice, au mal, du mauvais côté, « Va-t-il pleuvoir, père Dupont ? — Pens' pas, M'sieu ; le temps n'est pas à la malice. » - (20) |
| malice, peine morale ; s'ki m'fé malice, cela me fait peine. - (16) |
| malice, s. f. malice, vive contrariété, chagrin, peine. - (08) |
| malice, s. f., contrariété, vexation : « Ah! qu'j'ai donc malice que vous seûtes venue, la chamb' pas faite ! » - (14) |
| malice, subst. féminin : honte teintée de remords. - (54) |
| malicieux : Malin, rusé, futé. « Ol a in ptiet dreule qu'est bougrement malicieux » : il a un petit garçon qui est diablement futé. - (19) |
| malin : Méchant. « Qu'est-ce qui sarve d'êt' si malins, an ne vit pas si langtemps ». - Rusé. « Y est un malin ! ». - (19) |
| malin : s. m., mal. Elle a le malin de faire son p'tiot (elle est en mal d'enfant). - (20) |
| malin ; s'n'à pâ malin, ce n'est pas difficile, ne suppose pas beaucoup d'esprit. - (16) |
| malin, 1. adj. méchant : un chien malin. — 2. s. m. rusé. - (24) |
| malin, 1. adj. Méchant. — 2. s. m. Rusé. - (22) |
| malin, adj. méchant. - (17) |
| malin, s. m. un des noms du diable. avoir vu le malin, c'est avoir été au sabbat. « malingn'. » - (08) |
| maline : méchante - (43) |
| maline, adj. maligne. - (08) |
| maline, féminin de malin. - (16) |
| maline. Maligne. « Fièvre maligne » ou « mauvaise fièv'e » ; s'emploie pour désigner la fièvre typhoïde. - (49) |
| maling (-igne) (adj.m. et f.) : malin, maline - (50) |
| malinge. s. f. Mésange. (Poilly-sur-Serein, Rugny). - (10) |
| maljâbi. Plus encore que jâbi, plus mal ficelé, plus fagotté encore. Voyez jâbi. - (12) |
| mâlle (na) : malle - (57) |
| malliòlœ, s. m. maillot d'enfant (du vieux français maillolet). - (24) |
| mallus, mot latinisé, puis francisé, pour l'intelligence de l'histoire. Mall, chez les Bretons, signifie encore hâte, empressement. On sait que les Mallus étaient des assemblées politiques ou religieuses chez les Gaulois, et où le dernier arrivé était immolé en sacrifice sur l'autel sacré. - (02) |
| malojöte, sf. cage d'oiseau grossière faite avec une caisse. - (17) |
| mâlon (n.m.) : centaurée (fleur) - (50) |
| malon : plante, jacée. - (33) |
| mâlon : (mâ:lon: - subst. m.) centaurée jacée, dite ailleurs (ancien normand et moyen fr.) matefelon. - (45) |
| malon, s. m. centaurée jacée, appelée vulgairement maillon, tête d'alouette. - (08) |
| malote, sf. petit maillet de bois. - (17) |
| malrmonner, marmouner. v. a. et n. Murmurer, grogner, gronder entre ses dents. - (10) |
| malrou : malheureux - (43) |
| mal'roux : Malheureux. « I faut laichi pliaindre les pus mal'roux » : il faut laisser gémir les plus malheureux, il faut se contenter de son sort en pensant qu'il y a plus malheureux que soi. - (19) |
| malsauce, marsauce, marsaul et marsaule. s. m. Saule Marceau, Marseau, Marsault. - (10) |
| malsauge, marseau. - (05) |
| maltrû, habile, instruit dans son art. - (05) |
| maluche (n. f.) : tête - (64) |
| maluche : maillet, par extension : tête dure - (60) |
| maluche : masse en bois. - (09) |
| maluche. n. f. - Gros maillet à long manche, utilisé pour enfoncer les piquets ou fendre les bûches. - (42) |
| malûr, s. m., malheur. - (14) |
| malûreu, euse, adj. malheureux. - (08) |
| malûreux, adj., malheureux. - (14) |
| maluser, méluser. v. n. Mésuser. - (10) |
| malzaudé, adj. mal arrangé, mal vêtu, mal monté, mal équipe. - (08) |
| mamée-dame. : Mon aimée femme, (Charte de Saulx-le-Duc du XIIIe siècle). - (06) |
| mâmer : s'empresser de. (RDB. T III) - S&L - (25) |
| mamer, v. a. manger, terme enfantin, « mame, p'tiô, mame ! » on dit encore « faire mame mame. » - (08) |
| m'amie, s. m. et f., mon ami, mon amie. Appellation caressante, qu'échangent réciproquement le frère et la sœur, le mari et la femme, etc., et sans différence pour les deux genres : « Veins-tu, m’amie ? Marci, m'amie ! » — « Faire des m’amies. » caresser, cajoler. On écrit aussi ma mie, mais c'est moins correct. - (14) |
| mamman. Maman… - (01) |
| man (n.f.) : maman - (50) |
| man : gésier. Le mot serait d’origine germanique (estomac se dit magen en allemand). - (62) |
| man : le gésier des volailles - (46) |
| man, ma que, conj. [mais que]. lorsque. - (17) |
| man, petite bourse dure des intestins des oiseaux, de la volaille. - (16) |
| man, sm. estomac de volaille, gésier. - (17) |
| man. Enveloppe musculeuse de l’estomac chez les volailles. Etym. inconnue. - (12) |
| manachou : romanichel. - (33) |
| manaige. Ménage. - (01) |
| manat : souricière. - (09) |
| mance, s. f. planche d'habit ou de robe. - (08) |
| mancelle. n. f. - Mâchoire. - (42) |
| mancelle. s. f. Bouche, mâchoire. (Perreuse). - (10) |
| mancéne, s. f. mancienne, viorne commune, vihurtmm lantana. On l'emploie à fabriquer des liens parce qu'il est très flexible. - (08) |
| mancené, s. m. viorne commune. Le mancené arbuste est encore appelé « peute varne ». - (08) |
| manchehiaux. s. m. pl. Mancherons d'une charrue. (St-Martin-sur-Ouanne). - (10) |
| mancheriaux. n. m. pl. - Mancherons : ensemble formant la fourche et les poignées de la charrue. - (42) |
| mancheûrer : mâchurer, barbouiller, noircir. - (62) |
| mancho, maladroit, comme peut l'être celui qui n'a qu'une main. - (16) |
| mancillon. s. m. Grande boucle en fer qui s'accroche au collier d'un cheval pour l'atteler. (Saint-Martin-sur-Ouanne). - (10) |
| Mancy ou Mancie : Mancey. « Les habitants de Mancy sont des Mancillans ». - (19) |
| mande : Monde. « Y avait bien du mande à la foire ». « Le brave mande » : les honnêtes gens. « Le chtit mande » : les malfaiteurs. « Neutés mandes » : nos parents. « Je sins allés à la fête chez neutés mandes ». « Le mande est bougre ! » : cri d'admiration devant les progrès de la science. « Aujord'heu le mande va en chemin de fé, en bicyclette, en auto, ah ! le mande est bougre ! ». - (19) |
| mandement : s. m., demande, prière. Je suis venu à son mandement. - (20) |
| mander : Trier, éplucher. « Mander des calas » : débarrasser de leur coquille les noix destinées à être portées à l'huilerie. - Emonder. « Mander eune vigne » : enlever les rameaux improductifs. - (19) |
| Mandieu. Mon Dieu… - (01) |
| mandigot. s. m. Maladroit. - (10) |
| mandjin. n. m. -Manchot. (Mézilles, selon H. Chéry) - (42) |
| mandrille : s. f.. guenille ; vêlement misérable. Voir démandriller. - (20) |
| mandrille. n. m. - Vêtement en guenilles, en lambeaux. (Bléneau, selon M. Jossier) - (42) |
| mandrille. s. f. Vètement en lambeaux. (Chichery, Bléneau). – Se dit, dans le Doubs, pour mendicité. – Du languedocien mandrilis. - (10) |
| mandrille. s. m. Gueux, vaurien, fainéant. Sans doute parce que les gueux et les fainéants sont vêtus de loques et de guenilles. (Percey). - (10) |
| mandrilloux : s. m., individu en mandrllles. - (20) |
| mandrin (C.-d., Chal., Morv.). - Gueux, bandit, vaurien… Dans rYonne, on dit mandrille pour désigner des vêtements en loques, des guenilles. - (15) |
| mandrin : brigand - (44) |
| mandrin : coquin. - (29) |
| mandrin : Morceau de bois cylindrique muni à une extrémité de trois pointes métalliques qu'on enfonce dans une rognure de merrain dont on veut faire un « boqueriau » (une broche), le mandrin servant de gabarit. - Vaurien, du nom du célèbre voleur Mandrin. - (19) |
| mandrin : un bandit - (46) |
| mandrin : un panier pour ramasser les légumes (4 mandrins remplissaient un sac de 50 kg). On dit aussi è panier mandrin - (46) |
| mandrin, s. m. bandit, voleur, misérable, individu couvert de guenilles. - (08) |
| mandrin, s. m., galopin, voleur sympathique. - (40) |
| mandrinau, s. m. chemineau, coureur de routes, comme mandrin. - (22) |
| mandrinau, s. m. chemineau, coureur de routes, comme mandrin. - (24) |
| mandrineau : s. m., jeune mandrin. - (20) |
| mandrins (dâs) : (des) voleurs de grands chemins, (des) détrousseurs - (37) |
| mandze n. Manche. - (63) |
| mandzi : (vb) manger - (35) |
| mandzi : manger - (51) |
| mandzi v. Manger. - (63) |
| mane. Manne. Les biberons appellent le bon vin une bonne manne. - (01) |
| maneau. s. m. Hochet, jouet que les enfants tiennent à la main. (Lasson). Du latin manus. - (10) |
| manéte, s. f., anse, poignée transversale qui termine le manche du rochet ; est posée à l'ouverture d'un vase, d'un panier. N'est point le diminutif de manne. - (14) |
| manette : Partie du manche d'un outil que l'on tient dans la main. « Eune manette de dâ (faux) ». - (19) |
| manette : s, f., poignée ; partie d'un objet par laquelle on le saisit. - (20) |
| maneûvre, manouvrier. - (16) |
| manfa ! : Ma foi ! Interjection affirmative ou négative. « Manfa oué, manfa nan ! ». - (19) |
| mangain : manchot. (LS. T IV) - Y - (25) |
| mangale, (injure) mauvaise gale. - (26) |
| mange : Manche. « Eune mange de chemije » : une manche de chemise. « In mange de forche » : un manche de fourche. « In cutiau à deux manges » : instrument de tonnelier. « Se torner du côté du mange » : se tourner du côté du plus fort. - (19) |
| mange, manche. - (26) |
| mange,s.m. manche. - (38) |
| mangeoire, crèche d'écurie. - (05) |
| mangeou (on) : mangeur - (57) |
| mangeouiller : v. a., mangeotter. - (20) |
| mange-pain-pardu. n. m. - Pique-assiette, fainéant, qui mange de bon appétit un repas qu'il n'a pas vraiment mérité. - (42) |
| manger (Se) : v. r., se ruiner, manger son avoir. - (20) |
| manger la soupe : diner. - (59) |
| manger l'jau. exp. - Faire les fiançailles, manger le coq. - (42) |
| mangeûre (na) : mangeoire - (57) |
| mangi : manger - (57) |
| mangi sac et bretelles, loc. gaspiller, dilapider jusqu'à la ruine. - (24) |
| mangier. : Ménage, dérivation de manationem, ce qui révèle que le latin vulgaire avait fait le substantif manatio, du verbe manere. - Ce mot mangier est dans une charte de franchise de Villargoix de 1279. - (06) |
| mangne. s. f. Main. (Sacy). - (10) |
| mangognots (pour mangoniaux, mangoneaux). s. m. pl. Ordures déposées au coin des rues. – On désignait, autrefois, par ce mot, les pierrailles et débris de toute sorte que les défenseurs d'une ville assiégée lançaient sur l'ennemi au moyen d'une machine de guerre appelée du même nom, mangoneau, et dont les assiégeants faisaient également usage. - (10) |
| mangoner. v. n. Bégayer, bredouiller, zézayer. (Percey). - (10) |
| mangonier. s. m. Qui a l'habitude de bégayer, de bredouiller ou zézayer en parlant. (Percey). L'abbé Corblet donne mangon, dans le même sens. - (10) |
| mangoñner v. Emmancher, ajuster, assembler. - (63) |
| mangonner : v, a., emmancher, ajuster, monter les pièces composant un objet. Voir démangonner. - (20) |
| mangouin, s. m. celui qui parle du nez, nasillard. - (08) |
| mangue (un), mantse : manche (d'un outil) - (43) |
| mangue : (nm) manche (d’un outil) - (35) |
| manguin : manchot, estropié. - (09) |
| manguin ou, plutôt, manghen. adj. Estropié, privé d'une main, manu gehennatus. Voyez mainghen. – Jaubert donne mauguin, que nous écririons, nous, maughen, c'est-à-dire mal gêné, malè gehennatus, comme il y en a qui disent mal malade. - (10) |
| manguin, e, adj. manchot, estropié du bras. - (08) |
| maniain ou magnin - chaudronnier ambulant. – Voiqui in maniain, beille l'i voué lai caisse ai raiquemaudai et les cuilléres ai ètamai. - Te fâs quemant les magnins, quoi ! te mets lai piéce ai côtai du trou. - (18) |
| maniance – conduite d'une chose ; pouvoir d'arranger de faire ; tenue. - C'â lô qu'ant to en maniance. - S'ile en aivo lai maniance, ci iro bein sûr mieux, car ile n'â pâ béte ! – A n'é pâ de maniance du tot, le pôre gairson ! - (18) |
| maniance. Maniement. Se dit surtout et presque exclusivement avec le verbe avoir. Ex. : «Maintenant que c'est sa femme qui a l'argent en maniance, il n'y en a pas pour longtemps ! » - (12) |
| maniclon : s. m., cordonnier, ouvrier qui se sert de la manicle. - (20) |
| manicoquier : petit exploitant, bricoleur sans grands moyens. Expression peu flatteuse ! - (58) |
| manicoquier, manicotier. s. m. Petit marchand ambulant, vendeur de toute sorte de choses, faiseur de trente-six métiers. Synonyme d'arcandier, de bricollier. (Puysaie). - (10) |
| manicotier : petit agriculteur - (60) |
| manicotier, manicoquier, manicotcher. n. m. - Petit marchand ambulant, petit vendeur. Désigne aussi un paysan exploitant une petite ferme. (Mezilles, selon H. Chéry) - (42) |
| manien. Etameur, chaudronnier ambulant. Veus ne croirins pas que c’petiot ébécille ai passé teute sai jornée ai regarder les maniens. Les Berrichons disent minion et les Bretons rnannouner. Racine munus : main. - (13) |
| maniére (na) : manière - (57) |
| manifait : couturné, mal fait. - (09) |
| manigan, s. m. celui qui vit du travail de ses mains, manoeuvre. - (08) |
| manigancer (v.t.) : comploter ; agir sournoisement - (50) |
| manigances n.f.pl. Cachoteries, combinaisons, manoeuvres. - (63) |
| maniganci v. Comploter, dissimuler. - (63) |
| manigot, minagot. n. m. - Escargot. - (42) |
| manigot. s. m. Escargot. (Bléneau). - (10) |
| manille (n. f.) : ficelle de lieuse - (64) |
| maniquer. v. a. Mettre une chose en train, l'arranger, la faire marcher. - (10) |
| manman, maman. - (16) |
| manmie (mon amie}, formule de tendresse qu'une mère adresse à ses enfants. - (07) |
| manmie, loc. mon amie, terme d'amitié. - (08) |
| man-m'leuter, mâchonner. - (26) |
| mannaige, s. m. ménage, ouvrage de la maison : « fére son man-naige. » - (08) |
| mannée, sf. [vx f. Maisné]. Enfant chétif. Pröv' mannée. - (17) |
| mannége - ménage. - C'â in trésor, ine fonne que teint proprement son mannége. - Le Dimoinge en faut se levai pu maitin pou fâre le mannége devant lai messe. - Prononcer man-nège. - (18) |
| mannenô, massiô - mais non, mais si. - T'é don ailai ai Clombé aivan hier ?... Mannenô. – An m'é dit que te n'aivâ pâ fait ton ovraige ?... Oh, massiô. - (18) |
| mannequin, s. m. panier d'osier et de forme carrée chez nous. - (08) |
| manneté ! Interj. affirmative. Ma foi ! – Manneté oui, ma foi, oui ! – Manneté non ! ma foi, non ! – Manneté si fait ! ma foi, si ! (Perreuse). - (10) |
| manneté. interj. - Ma foi ! - (42) |
| manneuvro, sm. manouvrier. - (17) |
| manniance, sf. maniance, usage libre et actif de la main. Aujdö mon brais n'é pas de manniance. - (17) |
| manoeuvre, manouvrier, journalier. - (05) |
| manœuvrerie. s. f. Dans la Puysaie, propriété dépendant d'une ferme, et composee d'une maison avec grange et étable, le tout d'une contenance moyenne de dix hectares. - (10) |
| manoeuvrie, manoeuvrerie. n. f. - Petite exploitation, petite ferme. - (42) |
| Manou,prénom, Marie. - (38) |
| manouaîr (on) : manoir - (57) |
| manouper. v. - Manipuler, manier. (Sommecaise, selon M. Jossier) - (42) |
| manouper. v. a. Manipuler, manier. (Sommecaise). Du latin manus et opus. - (10) |
| manouvrier : ouvrier, ouvrière qui travaille de ses mains et à la journée. - (55) |
| manquablement : adv., immanquablement. - (20) |
| manque, s. f. faute, défaut, lacune, vide, déchet : il y a beaucoup de « manques » dans cet ouvrage. - (08) |
| manquer (se) v. Se brouiller. - (63) |
| manquer, v. intr., acception particulière de être absent : « Y a ben longtemps d’jà qu'ton fieù manque de cheû vous. » - (14) |
| manquer, v. n. manquer, avoir besoin, être dans l'indigence. - (08) |
| manquiau, s. m. manteau. - (08) |
| manquo. Manquais, manquait. - (01) |
| manre et menre. : (Dial. et pat.), dérivation du latin minorem, complément de minor. - (06) |
| mansaire : (nm) valet de ferme - (35) |
| mansaire : s. m., valet de ferme, et, par extensions successives, drôle, vaurien. A la campagne, le père donnait quelquefois ce nom aux fils qui remplissaient chez lui le rôle de valets de ferme. La « louée aux domestiques » s'appelle encore dans certains villages la « foire aux mansaires ». - (20) |
| mansene (manseu-ne), s.f. branche flexible avec laquelle on liait les sarments. C'est aussi un arbuste à fruits rouges en corymbes. - (38) |
| manseune - viorne (arbuste). - En me faut de lai mariseune pou fàre des liens. - Le gairde m'é permi de copai des manseune. - (18) |
| manseune : (manseun' - subst. f.) la viorne, qu'on appelle aussi "vigne folle". La viorne se fumait sous forme de tronçons de la grosseur et de la longueur de l'index. Voir aussi rèmati. - (45) |
| manssaire, s. m. homme de mauvaise mine, rôdeur. On dit surtout « un grand manssaire ». - (22) |
| manssaire, s. m. homme de mauvaise mine, rôdeur. On dit surtout « un grand manssaire ». - (24) |
| mansseigne, liens provenant d'un arbrisseau à branches flexibles, et servant à assembler en gerbes les blés dans la moisson. - (02) |
| manssène. : Le vrai mot est mancienne. C'est l'arbrisseau appelé viburnum-lantana, de la famille des caprifoliacées. Il sert à faire des liens pour des gerbes et des fagots. - (06) |
| mansseune : (man:seun' - subst. f.) mancienne, viorne commune. - (45) |
| manssou : char à quatre roues en usage dans le Brionnais, et constitué avec des planches sur les côtés et pouvant servir de tombereau. - (30) |
| mantaigna : Montagnard. Les mantaignas sont les habitants de la région accidentée où la vigne est cultivée ; les mantaignas affectent de dédaigner les gens de la plaine, les brachans (bressans) ; parce-que ces derniers ne récoltent pas de vin, ils prétendent « qu’eune pognée de gène suffit pa soûler in brachan ». - (19) |
| mantaigne : Montagne. « Les brachans venant charchi du vin en la mantaigtie » : les bressans viennent chercher du vin dans la région de la montagne. « Su la mantaigne » : La Croix Léonard, hameau de Tournus. « En dlé la mantaigne » : de l'autre côté de la montagne, c'est à dire la vallée de la Grosne. - Proverbe : « N'y a que les mantaignes que ne se rencantrant pas, mâ les braves gens pouyant se rencantrer ». - (19) |
| mantaignoux : Montagneux. « Le Morvan est bien mantaignoux ». - (19) |
| mantcheaû (on) : manteau - (57) |
| mantcheau : manteau - (51) |
| mantchiau : manteau - (39) |
| mantéa, manteau... - (02) |
| mantea. Manteau, manteaux. - (01) |
| manterie, et dans certains endroits mante, mensonge. Ai vos é di dé mante, il vous a dit des mensonges... - (02) |
| manterie, mensonge ; manterie, mot dérivé du latin mentiri, mentir, traduit plus à la lettre ce mot latin que mensonge. - (16) |
| manteure : Monture. « Les lunettes à Jean Boriau n'avint point de varres, ren que la manteure ». - (19) |
| manti : s. m. nappe. - (21) |
| mantiau (n.m.) : manteau - (50) |
| mantiau : manteau - (43) |
| mantiaû : manteau - (48) |
| mantiau : Manteau. « Si y fâ chaud prends tan mantiau, si y pliô prends le si te veux ». « In mantiau à poi (poils) » une fourrure. - (19) |
| mantiau : marteau - (43) |
| mantiau en pouai d’bigue : manteau en poils de chèvre (on dit aussi : « mantiau en piau d’bigue ») - (37) |
| mantiau n.m. Manteau. - (63) |
| mantiau, s. m., manteau. - (14) |
| mantigueule : mâchoire - (48) |
| mantigueule : mâchoire - (39) |
| mantille, s. f. manteau de femme avec un capuchon qui est cousu ou attaché au vêtement. - (08) |
| mantné (preûve) : pauvre petit. (N. T IV) - C - (25) |
| mantou, menteur ; manlouze, menteuse. - (16) |
| mantse : manche - (51) |
| mantse : manche (la) - (43) |
| mantse, mandze n.m. Manche. - (63) |
| manzoire (Brionnais) : fourmi. - (30) |
| manzoire, manzouére. Fourmi. - (49) |
| manzoiré. Fourmilier. - (49) |
| manzouère : fourmi. A - B - (41) |
| manzouéré : fourmilière (en B : manzouari). A - B - (41) |
| manzouere : fourmi - (34) |
| manzoueri : fourmilière - (34) |
| maque, n. genre indéfini partie mal labourée dans un champ ; partie mal fauchée dans un pré. - (65) |
| maque. conjonct. Lorsque. (Etivey). – Voyez macque. - (10) |
| mâqueaux, mâquaux. s. m. pl. Se dit, à Joigny, de tous les débris de démolitions, immondices et résidus quelconques déposés au coin des bornes, sur la voie publique. - (10) |
| mâqueiller (v.) : mâchonner - (50) |
| maquéiller (v.t.) : mâchonner - (50) |
| mâquéiller : mâchonner, mordiller, croquer - (48) |
| mâqueiller : mâchonner - (39) |
| mâqueiller, v. a. mâchonner, mouvoir les mâchoires avec lenteur, en mangeant ou même à vide. - (08) |
| mâqueillou : quelqu'un qui mâchonne - (39) |
| maquilli - s'fârder : maquiller - (57) |
| mâr (n.m.) : mars - on pourrait aussi conserver le français, mais l'autochtone le modulerait en mâr ou mair - (50) |
| mar : (nm) mars - (35) |
| mâr : n. m. Mars. - (53) |
| mar, mare ou marre. : Charpente du sol des caves pour placer les muids. - Dans la coutume de Beaune 1370 on lit : merrien esquairé (merrain équarri). - (06) |
| mar, mare. - (26) |
| mâr, mer et pièce de bois sur laquelle reposent les fûts en cave. Enmâré, placer les fûts sur les mâr. - (16) |
| màr, s. f., mer. Peu usité, les voyages lointains n'étant pas dans les goûts du pays. - (14) |
| mar, s.f. mer. - (38) |
| mar. Assemblage de deux madriers accouplés sur lesquels reposent les futs dans la cave. Dans le Lyonnais on appelle ces appareils des marchons. Etym. merrain, marrain, bois de charpente qui, lui-même, vient du bas latin madriacus ou mercium, mairacum, madrier, poutre, avec apocope. - (12) |
| mar. Mer. On appelle aussi à Dijon mar les pièces de bois sur lesquelles on range les tonneaux de vin dans les caves : « El é cinquante queuë de vin su se ma »r; on dirait à Paris : il a cent poinsons sur le chantier ; mar, de plus, signifie le marc, soit des raisins, soit des olives. - (01) |
| mâr’rie (lai) : (la) mairie - (37) |
| mar’yi : marguillier - (43) |
| marabou, s. m. petite marmite sur trois pieds et en fonte. le « marabou » Morvandeau n'a point d'anse. - (08) |
| marage. s. f. Mésange. (Canton de Saint-Florentin). - (10) |
| maragouègner : marmonner, bougonner - (48) |
| maragouégner : (maragouényé - v. intr.) exprimer son mécontentement ou sa désapprobation en bougonnant sans articuler de reproches. - (45) |
| maraie : (nf) laîche, plante qu'on trouve au bord de l'eau et qui sert à rempailler les chaises) - (35) |
| mârain, s. m. merrain, bois scié pour la tonnellerie et quelques autres usages. - (08) |
| maraîn-ne (na) - coumére (na) : marraine - (57) |
| maraîs n.m. Laîche, roseau. - (63) |
| maran : s. m., marais, prairie basse et humide - (20) |
| marandaïl, v., manger la marande. - (40) |
| marande : repas de midi (utilisé surtout dans la région de Saint Bonnet de Joux). A - B - (41) |
| marande (na) : déjeuner (midi) - (57) |
| marande (na) : repas (de tous les jours) - (57) |
| marande : (nf) nourriture, repas - (35) |
| marande : déjeuner. - (59) |
| marande : midi. (MLB. T II) - S&L - (25) |
| marande : repas de midi. C’est aussi la nourriture de ce repas. Au bistrot, on peut lire : « On peut épourter sa marande ». - (62) |
| marande : Repas et plus particulièrement le repas que l'on fait à midi. Les mets qui composent le repas. « De la bonne marande ». « Fâre à marande » : faire la cuisine, préparer le repas. - (19) |
| marande : un bon repas - (44) |
| marande n.f. (du lat. merendam, ce qui doit être mérité). 1.Repas de midi. 2. Cuisine. La Cathrine fayot d'la bonne marande. - (63) |
| marande : s. f. provisions que l'on porte aux champs, pour manger ; d'où repas en général. - (21) |
| marande : s. f., vx fr., goûter. Casser la maraude, casser une croûte. - (20) |
| marande, marander, repas de midi. - (05) |
| marande, mérande, s. f. repas du milieu du jour, goûter. - (08) |
| marande, n.f. repas. - (65) |
| marande, s. f. repas de midi. Verbe marander (vieux français). - (24) |
| marande, s. f. repas de midi. Verbe : marandé. - (22) |
| marande, s. f., nourriture cuisinée. - (40) |
| marande, s. f., repas de midi. - (14) |
| marande, subst. féminin : nourriture ou repas. - (54) |
| marande. Gros morceau de pain ; les aliments pour le déjeuner se nomment aussi « marande », ainsi que le déjeuner lui-même. - (49) |
| marande. Repas du midi. - (03) |
| marander (verbe) : déjeuner (midi) - (57) |
| marander (verbe) : déjeuner. - (47) |
| marander : dîner. (F. T IV) - S&L - (25) |
| marander : Dîner. « Mède est sonne i faut aller marander » : midi sonne il faut aller dîner. « Marander de quatre heures » : goûter à quatre heures. - (19) |
| marander : manger. Verbe en principe intransitif, du latin merenda : qui a été mérité. - (62) |
| marander v. Manger le repas de midi. - (63) |
| marander : v, n., vx fr., goûter, casser la croûte. - (20) |
| marander, mérander (v.t.) : prendre le repas de midi - (50) |
| marander, mérander, v. n. goûter, prendre le repas du milieu du jour. - (08) |
| marander, v. déjeuner à midi ; la marande est le déjeuner. - (38) |
| marander, v. intr., dîner, faire le repas de midi. - (14) |
| marander, v. préparer le repas. - (65) |
| marander, verbe transitif : manger. - (54) |
| marander. Déjeuner. - (49) |
| marandou : (nm) convive - (35) |
| marandoux : Convive. « J'ins ésu au mède du marandoux que je n'attendins pas ». - (19) |
| marau : mauvais boucher - (34) |
| maraude (n.f.) : repas du milieu du jour (aussi mérande) - (50) |
| marauder : déjeuner ou dîner. (A. T IV) - S&L - (25) |
| marauler, miauler. - (26) |
| marbe : Marbre. « Eune chevenée (cheminée) de marbe ». « Eune guebille de marbe » : une gobille en pierre dure. - (19) |
| marc : s. m., ancienne mesure do poids, comprenant 8 onces et valant 214 grammes 752, c'est-à-dire presque une demi-livre. Poids de marc, poids compté sur la base de la livre de Paris qui contenait 16 onces et que le duché de Bourgogne adopta en 1388. - (20) |
| març’ot ben ! (ai) : il s’est éloigné vite ! il n’a pas « demandé son reste » ! - (37) |
| marcage, lieu impénétrable par suite de l'abondance des ronces et des épines. - (11) |
| marcaille : matou. (REP T IV) - D - (25) |
| marcander : marchander, faire le commerce ambulant - (60) |
| marcandier : marchand, commerçant ambulant - (60) |
| marcandier. s. m. Marchand-colporteur et, par extension, coureur, flâneur, lanternier. Du latin mercator. (Saint-Florentin). - (10) |
| marcar : bouvier. (F. T IV) - Y - (25) |
| marçau (n.m.) : maréchal-ferrant (aussi marceau) - (50) |
| marcau (nom masculin) : chat. - (47) |
| marcau, maircau, s. m. chat mâle, matou - (08) |
| marcaud : matou. VI, p. 45 - (23) |
| marcé (n.m.) : marché - (50) |
| marcelot : Banquiste, petit mercier ambulant. « Mener eune vie de marcelots » : avoir une existence agitée, une vie faite de querelles et de raccomodements. - (19) |
| marcelot : colporteur en mercerie. VI, p. 72 - (23) |
| marcelot : s. m., vx fr. mercerot et mercelot, mercier ambulant, nomade. - (20) |
| marcelot. s. m. Porte-Balle, petit mercier, petit marchand ambulant. Du latin merx. - (10) |
| marcer (v.t.) : marcher - (50) |
| marcerie : Mercerie. « Alle tint eune ptiète boutique de marcerie ». - (19) |
| marchais. n. m. - Point d'eau, mare, petit étang. - (42) |
| marchais. s. m. Petit étang, mare, abreuvoir. La commune de Marchais-Beton. Le Marchais-aux-Pourceaux, dans Ies bois de Joigny. - (10) |
| marchand : Commercant. « Va dan charchi ce qui te faut chez la marchande ». - (19) |
| marchand d'pattes, subst. masculin : chiffonnier. - (54) |
| marchandé : part, pass., qui n'admet pas la discussion. « Viens apprendre tes leçons. Allons, as-tu compris ? Je ne plaisante pas, moi ; je suis tout marchandé. » - (20) |
| marchander : Discuter. On dit d'une personne d'un caractère entier et avec laquelle il n'y a pas à discuter : « Alle est tote marchandée ». - (19) |
| marchandije : Marchandise. « La bonne marchandije n'est jama treu chère ». - Ordure. « Ol a foulé (marché) dans la marchandije. - (19) |
| marchau, aude, s. m. et f. maréchal ferrant. - (08) |
| marché : Nom commun. Marché. « Fare in mauva marchi à l'autel » : faire un mauvais mariage. « Ol i payera pu cher qu’au marchi » : il s'en repentira. - (19) |
| marche : s. f., syn. de corne. - (20) |
| mârché : v. i. Marcher. - (53) |
| marche, limite. Ce nom, très-commun dans la géographie de France, vient de l'idiome breton marz, frontière. (Le Gon.) - (02) |
| marche. exp. - Expression appuyant une idée d'agacement, de résignation : « l' veut pa' v'ni' aveuc nous pou' cueillie des c'ries ! Eh ben marche ! Qui vienne pas en réclamer ! » ou « Il est pas ben grand pou' soun âge, marche ! Il a ben l'temps de grandi'. » - (42) |
| marcher à la sirène, locution verbale : être pressé. - (54) |
| marcher à pied salopin : expression locale. Salir avec ses chaussures ou avec ses sabots un carrelage qui vient d'être lavé. Ex : "J'vins d'fini, et té v'la à marcher à pied salopin sur moun' ouvrage !" - (58) |
| Marcheseu : n. propre Marcheseuil, village de Côte-d'Or. - (53) |
| marchi (aller) : marcher (aller) - (57) |
| marchi (on) : marché (aux volailles) - (57) |
| marchi : Verbe. Marcher. « J'ins marchi tote la matenée (matinée) ». - (19) |
| marchiau. s. m. Marteau. (Môlay). - (10) |
| marcho. Marchais, marchait. - (01) |
| marchon : s. m., vx fr., chantier de cave. - (20) |
| marchon, s. m. pièce de bois supportant les fûts à la cave. - (22) |
| marchon, s. m. pièce de bois supportant les fûts à la cave. - (24) |
| marchon, s.m. pièce de bois carrée qui sert à charger le pressoir. - (38) |
| marchonner : v. a., poser des marchons. - (20) |
| marchoû, s. m., marcheur. Le piéton est un marchou. - (14) |
| marchoux : Marcheur. « In ban marchoux, eune bonne marchouse ». - (19) |
| marci ! s. m., merci ! remerciement. - (14) |
| marci : Merci. « As-tu dit marci à s 'te tante que t'as donné du ban ? » : As-tu dit merci à cette dame qui t'as donné des friandises ? - (19) |
| marci, merci. - (38) |
| marci. Merci. - (01) |
| marci. n. m - Merci : marci ben - (42) |
| marcier : voir marcelot - (23) |
| marcier, et mercier, v. tr., remercier : « Vlâ l'afatiau qu'vous m'aveins prôté ; j'vous marcie ben. » - (14) |
| marco : matou. - (52) |
| marcôt : mâtou - (39) |
| marcot, chat - (36) |
| marcot, marcaud, marcou. s. m. Chat mâle. - (10) |
| marcot, marcou. n. m. - Chat mâle et entier, matou. - (42) |
| marcot, n.m. baguette de bois pour marquer la vigne. - (65) |
| marcot, s. m., baguette de bois pour marquer la vigne. - (40) |
| marcou : chat. (MLV. T III) - A - (25) |
| marcou, sm. mâle. - (17) |
| marcs, n.m.pl. grosses poutres parallèles qui, dans les caves, supportent les tonneaux. - (65) |
| Mârd ; Sèn Màrd, pour saint Médard. - (16) |
| marde : merde - (48) |
| marde : Merde. « De la marde de coucou » : espèce de gomme que secrètent le cerisier, le prunier etc - (19) |
| marde ! : merde ! (interjection spontanée) - (37) |
| marde : merde - (39) |
| marde, meurde. n. f. - Merde : « Si t'en veux pas, mange don' d'la marde ! » Cette expression est toujours bien vivante en Puisaye. - (42) |
| mardéle, et maréle, s. f., margelle de puits. - (14) |
| mardelle. n. f. - Affaissement de terrain dû à l'extraction de matériaux dans des galeries souterraines. (Villiers-Saint-Benoît, selon M. Jossier) - (42) |
| mardelle. s. f. Terrain affaissé par suite d'extraction de pierres, de marne ou de sable. (Villiers-Saint-Benoît). - (10) |
| mardié, mardienne. interj. Qui pour le sens correspond à parbleu, pardi, et qui est une formule d'affirmation. - (08) |
| mardiéne ! interj., parbleu ! pardi ! etc. - (14) |
| mardou (doure) : merdeux (euse) - (39) |
| mardoux : Terme de mépris, petit gamin. « De qua est-ce que te te môle ptiet mardoux ? » : de quoi te mêles tu sale gosse ? On dit d'une personne extrêmement grincheuse : « Y est in vrâ batan mardoux an ne sait pas de qué bout le prendre ». - (19) |
| mardzaîlle n.f. Margelle du puits. - (63) |
| mare (ā), sm. maire. - (17) |
| mâre (C.-d., Chal., Br., Morv.). – Pièce de charpente sur laquelle on place les futailles dans les caves, c'est-à-dire un chantier. Ce mot, comme celui de merrain, qui désigne le bois de chêne fendu en menues planches et destiné à faire des douves de tonneaux, vient de madrier, lequel vient lui-même du bas latin madriacus, mairiacum qui signifiait bois de construction. Ne pas confondre mâre (de cave) avec marc (de raisin), dont l'orthographe et l'étymologie sont différentes. - (15) |
| mâre (noût’) : (notre) maire - (37) |
| mâre : maire - (37) |
| mâre : Maire. « Quand man grand père (son grand père c'était Charles Millot époux Montangerand décédé en 1871) a ésu donné sa démission de mâre les gens de Manci l'appalint tojo neut 'mâre, le vieux mâre ». « Le mâre de Charolles » le neuf de pique. - (19) |
| mâre laipine : femme prolifique - (37) |
| mâre, et mère, s. f., mère. On donne ce nom à toute vieille femme : « Eh! mâre eùne téle. » - (14) |
| mâre, s. f., mère. - (40) |
| mâre, s. m. assemblage de deux pièces de bois sur lesquelles on pose les futailles dans une cave. - (08) |
| mâre, s. m. maire, celui qui administre une commune. - (08) |
| mâre, s. m., maire : « Y ét-i bentôt, Jean-not, que j'vons aller d'vant mousieu l’mâre ? » - (14) |
| mare. Maire. - (49) |
| mare. n. m. - Maire. - (42) |
| maréchal : s. m., se dit du forgeron et du serrurier aussi bien que du maréchal ferrant. - (20) |
| maréchau : s. m., maréchal. - (20) |
| maréchau, s. m. forgeron. - (22) |
| marèchau, s. m. forgeron. - (24) |
| maréchau. n. m. - Maréchal-ferrant. (Arquian) - (42) |
| marèchô : le maréchal-ferrant - (46) |
| mâre-grand', s. f., grand'mère. - (14) |
| marelle. s. f. Pan de bois dont les intervalles sont remplis par de la mauvaise maçonnerie. (Auxerre). - (10) |
| mareneire. Culotte, haut-de-chausses… - (01) |
| marer (verbe) : presser, écraser. - (47) |
| mârerie : Mairie. « Le secretâre de ma mârerie » : le secrétaire de mairie. - (19) |
| mares. Pièces de bois équarries et munies d'une sorte de poignée, pour aplatir les raisins mis en tas sur le pressoir. L’âbrot, grosse pièce de bois fixée à la vis, vient appuyer sur les mares. On donne aussi le nom de mares aux chantiers en bois destinés à supporter les tonneaux dans les caves. Le diminutif merrain, s'applique aux bois fendus ou sciés avec lesquels on fabrique les douelles des futailles. Ce mot n'a aucun rapport avec le marc du raisin, qui dérive du latin marcere. - (13) |
| marétsau : (nm) maréchal ferrant - (35) |
| marétsau : maréchal ferrant - (51) |
| marétso, maleutso : maréchal-ferrant, forgeron - (43) |
| mareutse : graminée des marais utilisée pour le paillage des chaises. A - B - (41) |
| mareutse : genre de graminée des marais, employé pour pailler les chaises - (34) |
| margalou, maquignon. - (05) |
| margalou. Petit maquignon. - (03) |
| margaucer, v. a. mouiller, salir, souiller de boue. - (08) |
| margazu (nom masculin) : effets personnels. - (47) |
| margeale (na) : margelle - (57) |
| margealle : s . f. margelle du puits. - (21) |
| margelé, adj. le bois « margelé » est le bois dont la fibre est altérée par un accident organique ou par une maladie. - (08) |
| margoïllat : Flaque de boue liquide On dit aussi « goliet ». - (19) |
| margòlon, s. m., homme d'affaires véreuses, marchand de vieux chevaux, mauvais boucher, etc. ; en général terme de mépris. - (14) |
| margonné : v. i. et v. t. Bougonner. - (53) |
| margonner. Bougonner, grogner, parler seul en cas de mauvaise humeur. On dit aussi « morgonner ». - (49) |
| margosser, v. ; mouiller. - (07) |
| Margot : nom de mule. VI, p. 16 - (23) |
| margot : pie. II, p. 31 - (23) |
| margot, s. f., plante (viorne) qui sert à faire des liens de fagot. - (40) |
| margotaïl, v., lier avec des margots. - (40) |
| margoton n.f. Femme de mauvaise vie. - (63) |
| margotte. Grosse gerbe de blé, de paille, etc. - (49) |
| margouéillâ, s. m. margouillis, cavité, trou rempli de boue. - (08) |
| margouéner : bougonner - (44) |
| margouillâ, margouille : n. m. Marais humide. - (53) |
| margouilla. Mare. - (03) |
| margouillat : pièce de bois de pressoir. - (09) |
| margouillat : s. m., margouillis. A rapprocher du vx fr, margoillier (v.). - (20) |
| margouillàt, s. m., margouillis. Même sens que gouillàt. (V. ce mot.) - (14) |
| margouillats. s. m. pl. Pièces de bois équarries qui, au nombre de 8 ou 10, mises les unes sur les autres en sens contraires, servent à comprimer la maie d'un pressoir. – Se dit aussi, au singulier, de toute terre boueuse, de tout gâchis qui tient aux pieds. - (10) |
| margouille : mercuriale. - (30) |
| margouille, boue liquide. - (26) |
| margouille. n. f. - Endroit boueux. Se dit également d'une terre collante. - (42) |
| margouille. s. f. Endroit boueux. - (10) |
| margouiller. v. a. Gâcher. (Saligny). - (10) |
| margouilli, ordures... - (02) |
| margouillis. : Pour flaque boueuse d'eau, est un barbarisme ; le vrai mot est gargouilli. (Voir au mot Gadoi.) - (06) |
| margoujat, s.m.valet d'hôpital en temps de peste (vieux). - (38) |
| margoulate, s.f. gorge. - (38) |
| margouléte, s. f., mâchoire : « O t'I'i a flanqué eùne monifle par la margouléte... » - (14) |
| margoulette : figure - (44) |
| margoulette : figure ; se casser la margoulette : tomber. - (56) |
| margoulette : mâchoire - (39) |
| margoulette, gosier. (Voir gairguillô.) ... - (02) |
| margoulette, s. f. mouchoir qu'on attache sous le menton. - (08) |
| margoulette, s. f., gorge, gosier. - (40) |
| margoulette. s. f. Menton, mâchoire. - (10) |
| margoulin, s. m., vaurien, vagabond, qui rôde et court les chemins. - (14) |
| margouner : bougonner. - (56) |
| margouner, v. n. bougonner, gronder sans articuler de sons distincts. (voir : marmonner.) - (08) |
| Margouton, prénom, Marguerite. - (38) |
| margoye : (botanique) - (51) |
| margué : pardieu ! - (09) |
| marguigner : tritouiller. - (30) |
| marguiller. Jeu d'enfant. Chacun des joueurs possède trois pions qu'il fait manœuvrer sur une figure géométrique carrée remplie de lignes croisées obliquement... - (13) |
| marguillier : membre de la fabrique d'une paroisse. Laïc s'occupant de la garde et de l'entretien d'une église. - (55) |
| marguillier : s. m., sonneur de cloches, vx fr, marreglier ; jeu de la marelle assise, vx fr, merclier. - (20) |
| Marguite : Prénom Marguerite. « L’homme à la Marguite » : le mari de Marguerite. - Fleur, grande pâquerette, chrysanthemum leucanthemum. « In boquet de marguites ». - Au figuré : cheveux qui commencent à blanchir. « I li a bien poussé des marguites dépeu que je l'ai pas vu » : il a bien blanchi depuis que je l'ai vu. - Coccinelle ou bête à bon Dieu. « Marguite, Marguite vole, du côté que je me mairierai ! » et l'incantation se répète jusqu'à ce que la coccinelle prenant son vol rende l'oracle attendu. - (19) |
| mâri (-e) (adj.m. et f.) : affligé(-e), attristé(-e) - de l'a. fr., marrir = affliger, attrister - (50) |
| mâri, part. passé de l'anc. verbe marrir qui signifiait affliger, attrister : « i seu bin mari de ç'lai », je suis bien chagrin de cela. - (08) |
| mâri, peiné, contrit ; mârie, au féminin. - (16) |
| mariadze : mariage - (43) |
| mariâdze n.m. Mariage. - (63) |
| mariage. s. m. Se dit, à Perreuse, pour mari. - (10) |
| Mariane, Manète, Marie. - (16) |
| marichau : maréchal-ferrant, mésange. II, p. 31 - (23) |
| marichau : taupin. IV, p. 27 - (23) |
| marichau, maréchal. - (27) |
| marichau, s. m., maréchal-ferrant. - (14) |
| marichau. Maréchal. Nous disons marichauder pour travailler le fer. - (03) |
| marichaud : petit insecte ou taupin - (60) |
| marichaud. Maréchal. - (49) |
| marichauder, v. tr., faire métier de maréchal, travailler le fer, forger. - (14) |
| marichauder. Marteler le fer travailler le fer avec un marteau. - (49) |
| marienne : sieste, méridienne. - (62) |
| mariennée, mériennée, méziennée,mézionnée. s. f. Le milieu du jour, de midi à 3 heures. – Temps accordé pour le repos après midi. - (10) |
| mariennée. n. f. - Matinée. - (42) |
| marière. n. f. - Mariée. (Bléneau, selon M. Jossier) - (42) |
| marière. s. f. Mariée. (Bléneau). - (10) |
| marieux. n. m. pl. - Désigne les mariés. - (42) |
| marignier, s. m., marinier. - (14) |
| marii v. Marier. - (63) |
| marii v. Ramer. On marie les pois ou les haricots. - (63) |
| marîïer, s. m., marguiller. - (14) |
| marillé - marguiller, bedeau. - Le Bochot ne convaindrô pâ pou éte marillé ; al â trop étordi. - In marillé, pou éte quemant cequi âtor de mossieu le curai, dai éte in homme bein convenabe. - (18) |
| marillier : Marguiller, bedeau, sonneur de cloches. « Le marillier a ésu des étrain-nes ol a bien trézallé » : le sonneur de cloches a eu un bon pourboire, il a bien carillonné. - Marelle simple, jeu d'enfant ; se joue avec trois petits cailloux qu'il s'agit de placer sur une même ligne d'un carré coupé de deux lignes médianes perpendiculaires aux côtés de deux diagonales. - (19) |
| marillier, marguillier. - (05) |
| marillier. s. m. Marguiller. (Andryes). – Est aussi donné par Jaubert. - (10) |
| Marin : nom de bœuf. Sous le joug le couple de bœufs était souvent nommé : Rondot – Marin parfois Bayard. - (62) |
| marin, adj. ce mot qui se montre quelquefois dans les noms de lieu, s'applique en nivernais ou en Morvan à un terrain marécageux. - (08) |
| maringot, s. m. coquetier, celui qui parcourt les campagnes pour acheter les œufs et les volailles. - (08) |
| maringòte, s. f., sorte de voiture longue, autre qu'un camion, et employée jadis par les charretiers des maisons de roulage. - (14) |
| marioler, v. marier. - (38) |
| marion : s, m., rame de bateau. - (20) |
| marion, n.m. rame de haricot. - (65) |
| marion, s. m. petit faisceau d'écorce. - (08) |
| marionnée. s. f. Mot par lequel on désigne, à Villemer, le travail fait avant midi, J'ai fait aujourd'hui une bonne marionnée, c'est-à-dire une bonne matinée. Nous croyons qu'il doit y avoir la erreur, et que marionnée, qui est une variante de mariennée et de mézionnée, signifie bien plutôt après-midI, le travail fait après midi. - (10) |
| mariou, -se, marié, mariée. - (38) |
| marioulée. v. a. Marier ; se dit par plaisanterie ou par mepris. (Mont-Saint-Sulpice). - (10) |
| marious (les) : mariés. Le couple de la noce. - (62) |
| marisson, tristesse ; en basse latinité, marritio, et en bon latin, mœror. Dans le vieux français, marrir signifie s'affliger, se plaindre. Il a le cœur tout marri, c.-à-d. tout contristé. - (02) |
| marivole : coccinelle (en Berry). VI, p. 16-8 - (23) |
| Marivole : nom de mule. VI, p. 16 - (23) |
| mari'yé, marguillier, sacristain. - (16) |
| Marjolet, nom de bœuf. - (05) |
| marjouir (Se). v. pronom. S'attendrir, en parlant des fruits. (Cuy). - (10) |
| marjoulain, marjoulaingne. subs. m. Thym, marjolaine. (Mouffy, Sacy). - (10) |
| marké; è n'marke pâ bèn, il a mauvais air, il n'indique rien de bon sur sa figure. - (16) |
| marlasse : s. f., vx fr. merlesse, merlette, femelle du merle. - (20) |
| marlat, mierlet (n.m.) : merle - (50) |
| mârle (on) : merle - (57) |
| mârle : (nm) merle - (35) |
| mârle : merle - (43) |
| marle : merle. - (52) |
| marle : merle. Dans les savées le marle siffle : dans les haies le merle siffle. - (33) |
| marle : s. m., merle. - (20) |
| marle, marluche (n.m.) : merle - aussi merluche - (50) |
| mârle, s. m. merle. - (22) |
| mârle, s. m., merle. On dit d'un triste garçon : « Y et ein biau mârle ! » - (14) |
| marle. Merle : de là le Marlet, nom de famille à Dijon pour « le Merlet »… - (01) |
| marle. n. m. - Merle. - (42) |
| marle. s. m. Merle. Le marle blanc est un oiseau rare, hé dificile à rencontrer. - (10) |
| marleuche. Gros maillet, du latin malleus. - (03) |
| marlifiche (n. f.) : merveille (fée marlifiche (faire merveille)) - (64) |
| marlin : merlin - (48) |
| marlin, marluche, massue de fer. - (05) |
| marling : merlin - (39) |
| marllyi, s. m. marguiller. - (22) |
| marloinje : mésange. - (29) |
| marloû, s. m., rusé, retors ; aussi souteneur. - (14) |
| marlou. s. m. Vieux richard. (Percey). – La véritable orthographe de ce mot est marloup : il signifie loup mâle, et, par extension, dans le langage populaire, entremetteur de marchés honteux, souteneur de louve (de femme prostituée). - (10) |
| marlouée. n. f. - Filet pour attraper les oiseaux, les marles. - (42) |
| marlouée. s. f. Filet pour prendre les oiseaux. et particulièrement les marles (merles). (Sommecaise). - (10) |
| marloufe. s. m. Maroufle, par transposition de l’l. (Saint-Florentin). - (10) |
| marluche, s. f., gros maillet, mailloche. - (14) |
| marlusaigne. : Mère Lusine. Nos pères regardaient la fée Mélusine comme la tige de la maison de Lusignan. Elle apparaissait, disait-on, lorsque quelqu'un de cette famille devait mourir, et elle faisait alors retentir l'air de gémissements. On dit encore en Bourgogne pousser des cris de mère Lusine. (Del.) - (06) |
| marmaille. s. f. Troupe d'enfants, de marmots. - (10) |
| marmeute : Mâchoire. « Guigni la marmeute » remuer la mâchoire, manger. - (19) |
| marmeuter : Marmotter, parler confusément entre ses dents. - (19) |
| marmeutine : Sorte de fichu à franges qui recouvrait la tête et se nouait sous le cou. - (19) |
| marmeuzer, v. a. murmurer, colporter à mi-voix. - (24) |
| marmeuzi, v. a. murmurer. - (22) |
| marmiouner, marmuser. Marmotter. - (49) |
| marmitje, sf. marmite. - (17) |
| marmonné : v. i. Marmonner. - (53) |
| marmot, enfant au maillot. Dans l'idiome breton, marmouz signifie singe, d'où est venu encore notre mot marmouset pour exprimer des figures grotesques. - (02) |
| marmot. s. m. Mâchoire inférieure, menton. – Claquer le marmot, claquer des dents. C'est à tort que beaucoup de personnes disent, croquer le marmot. - (10) |
| marmote : caisse où les galvachers conservent leurs vivres. VI, p. .9-20 - (23) |
| marmotin : grognon. (CH. T III) - S&L - (25) |
| marmotte. s. f. Fichu, mouchoir que les femmes mettent sur leur tête pour se tenir chaud aux oreilles, et dont les cornes s'attachent sous le menton, sous le marmot. - (10) |
| marmotter : rouspéter - (57) |
| marmoue, s. f. moue, grimace des lèvres, grognement sourd : « fére lai marmoue «, faire la moue, grogner. - (08) |
| marmouner : marmonner - (39) |
| marmouner, v. a. marmotter entre ses dents, murmurer, grommeler. - (08) |
| marmounner. v. - Marmonner. Se dit marmoulonner à Arquian. - (42) |
| marmouser, murmurer maussadement, marmuser. - (04) |
| marmousser, murmurer - (36) |
| marmuer, v. n. on dit que le temps « marmue » lorsque le ciel se couvre et donne à prévoir un changement, un remuement atmosphérique. - (08) |
| marmujeu : chuchoter. - (29) |
| marmure. Murmure, tantôt verbe, tantôt nom. - (01) |
| marmuser (v.t.) : chuchoter, parler bas, murmurer - (50) |
| marmuser : colporter des nouvelles confidentielles. (DC. T IV) - Y - (25) |
| marmuser : murmurer - (60) |
| marmuser v. (vx.fr. marmouser) Marmotter, chuchotter, murmurer. - (63) |
| marmuser : v. n., vx fr. marmouser, marmotter. - (20) |
| marmuser, v. ; murmurer. - (07) |
| marmuser, v. a. murmurer, parler bas, chuchotter, dire à l'oreille quelque chose de défavorable sur le compte d'autrui : cette jeune fille est une évaporée, le monde en « marmuse. » - (08) |
| marmuser. Chuchoter. C'est proprement faire le mouvement des lèvres. - (03) |
| marmuser. v. - Murmurer. (Villeneuve-les-Genêts, selon M. Jossier) - (42) |
| marmuser. v. n. Murmurer. (Villeneuve-les-Genêts). - (10) |
| marnat. s. m. Terrain marneux. (Soucy). - (10) |
| marnaÿ, v., travailler dur. - (40) |
| marné, ée. adj. Qui contient de la marne, qui est blanchi par la marne. – Soupe marnée, soupe dans laquelle on a mis un peu de lait, qui la blanchit de même que la marne blanchit la terre. - (10) |
| marner. v. a. Attacher les perches de la vigne aux paisseaux. (Chassignelles). - (10) |
| marnére : s. f. 1° pantalon en étoffe grossière pour travailler aux champs. 2° guêtres. - (21) |
| marnière : s. f., culotte. A rapprocher du vx fr. marnée, fourche. - (20) |
| marnife, et mornife, s. f., mornifle, soufflet, coup de la main sur la joue. - (14) |
| marô : mauvais boucher. A - B - (41) |
| marôdou, maraudeur. - (16) |
| maröguingné, vn. grogner, marmotter, être de mauvaise humeur. - (17) |
| maroné signifiait mettre la première culotte à un enfant ; et rire à maronnes débloukées, c'était rire à se tenir le ventre. - (02) |
| maroner, v. a. grogner sourdement, se plaindre à voix basse, avec mauvaise humeur. - (08) |
| maroner, v. n. avoir la couleur marron. - (08) |
| màronier. s. m., marchand de marrons. L'homme qui les vend a pris le nom de l’arbre qui les produit : « J'vons mainger des mârons ; l’mâronier a v'nu. » (V. Frigolés.) - (14) |
| maronné, vn. grommeler ; parler tout bas. - (17) |
| maronner : rouspéter en douce. - (66) |
| maronner, v. ; murmurer. - (07) |
| maròt, s. m., marais : « Por aller la vouér, j'ons pris par le pré des maròts. » - (14) |
| marougner. v. n. Maronner. (Coutarnoux). - (10) |
| marouillée (eau) : trouble. - (66) |
| marouinge. s. f. Mésange. (Courgis). - (10) |
| maroûner : bougonner - (39) |
| marquau : matou. - (33) |
| marquau, s. m. baguette marquant la place d'un chapon ou jeune plant de vigne. - (24) |
| marqué, marquée : part, pass., Imprimé ; qui a un casier judiciaire. D'abord qu'y est marqué dans le journal, c'est qu'y est vrai. - (20) |
| marquer : « Marquer la vigne » : planter en terre de petites fiches (marques) pour indiquer la place que devra occuper chaque plant de vigne. « Du papier marqué » du papier timbré - (19) |
| marquer mau v. Avoir mauvaise allure, faire mauvais effet. - (63) |
| marquer v. Tacher. - (63) |
| marquiau, merquiau. s. m. (Etivey). - (10) |
| marquou : marqué. - (32) |
| marrain : Merrain, bois avec lequel on fait les tonneaux. - (19) |
| marrans : Crottin de cheval. « Les marrans de chevau fiant du ban femé (du bon fumier) ». - (19) |
| marre ou mare, pièce de bois destinée à placer des muids. El é cinquante quoue de vin su sé mar. - (02) |
| marren, dans la langue romane, signifie bois de charpente... - (02) |
| marren. : Dans le dialecte français, signifie bois de charpente (Roq. ). - (06) |
| marrer : serrer (surtout avec les mains) - relativement peu usité. Ex : "Marre don pas ta pouée coum' ça, te vas la taler !" - (58) |
| marres, s. f. pl., double poutre qui porte les fûts. - (40) |
| marron : (nm) excrément - (35) |
| marron : excréments (s'utilise pour les porcs et les chevaux) - (43) |
| marron d'cotson n.m. Excrément du cochon. - (63) |
| marron d'tsvau n.m. Crottin de cheval. - (63) |
| marron : s. m. Marron de cheval, crottin de cheval. - (20) |
| marron : s. m., tête. voir châtagne et crouler. - (20) |
| marron, n.m. crottin de cheval. Généralement employé au pluriel. - (65) |
| marron-de-chevau, s. m. crottin de cheval. - (22) |
| marron-de-chevau, s. m. crottin de cheval. - (24) |
| marroner, murmurer à la suite d'une déception, d'un échec. - (27) |
| marroni : marronnier - (51) |
| marronner (verbe) : ronchonner. Manifester Sa colère intérieurement. - (47) |
| marronner. Bisquer, éprouver du dépit. - (49) |
| marronni (on) : marronnier - (57) |
| marroñnî n.m. Marronnier. - (63) |
| marrounaïl, s. m., marronnier. - (40) |
| marsaule. Bois blanc et flexible d'essence forestière... - (13) |
| marsausse : verne. - (32) |
| marseau, massauce : saule - (48) |
| marser : marcher - (39) |
| marsiaule (n.m.) : marsault (saule qui pousse près des eaux) - (50) |
| marsiaule, s. m. saule marseau, salix aurita ou à oreillettes. - (08) |
| martaler : Marteler. « Martaler in dâ su l'enchap'lle » marteler la faux sur l'enclume. - Taler. «Qu'est-ce qu'ant dan ces poires y est la grale que les a martalées ». - (19) |
| martchaud. Marteau. - (49) |
| martchauder : frapper avec un marteau. A - B - (41) |
| martchauder : marteler - (44) |
| martchauder. Marteler. - (49) |
| martcheau (on) : marteau - (57) |
| martcheau (on) : molaire - (57) |
| martcheau : marteau - (51) |
| martchepi : marchepied, servant aussi de coffre à sel. - (21) |
| martchiau : marteau - (39) |
| marteai, s. m. marteau. - (08) |
| marteau n. et adj. Fou. - (63) |
| Martée : prénom. Martin. - (53) |
| marteleur, s. m. celui qui a la charge de mettre la marque de l'acquéreur sur les bûches de moule avant le flottage. - (08) |
| marthiâ, marteau. - (16) |
| martià, s. m., marteau. - (40) |
| martiâ,s.m. marteau. - (38) |
| martiau (n.m.) : marteau - (50) |
| martiau : (nm) molaire - (35) |
| martiau : Marteau. « In martiau de mérichaud » : un marteau de forgeron. - Molaire. « J'ai eune dent que me fa mau, y est in martiau » : j'ai une dent qui me fait mal c'est une molaire. On donne aussi le nom de martiau à une grosse fraise. - (19) |
| martiau : molaire. Bien que la molaire tienne son nom de meule, notre patois a choisi pour cette dent : le martieau. - (62) |
| martiau : marteau. - (33) |
| martiau n.m. Marteau. - (63) |
| martiau : marteau. - (21) |
| martiau : n. m. Marteau. - (53) |
| martiau, s. m., dent molaire. Dans quelques localités on dit correctement : marteau. - (14) |
| martiau, s. m., marteau : « Faura donc t'fâre entrer c'qui dans la tête à côps d’martiau ? » - (14) |
| martiau. n. m. - Marteau. - (42) |
| martiauder v. Marteler. - (63) |
| martieau : marteau. - (52) |
| Martin vit : Jeu enfantin ; il consiste à se passer de main en main un tisson allumé en disant : « Martin vit. Vit-il toujours ? Toujours il vit ». Le joueur dans la main duquel le tison s'éteint donne un gage. - (19) |
| martinet : s. m., petit traîneau que les enfants font marcher à l’aide de deux bâtons armés de pointes de fer. - (20) |
| martinet : voir pressoir. - (20) |
| martœne, s. f. chaussure lourde et grande (langage plaisant). - (22) |
| Martra, lieu-dit, en montagne, très exposé au vent ; coin de Mellecey. - (38) |
| martsand n.m. Marchand. - (63) |
| martsander : marchander - (43) |
| martsander v. Marchander. - (63) |
| martsau n.m. Maréchal-ferrant, forgeron. - (63) |
| martsauder : frapper avec un petit marteau - (43) |
| martsauder v. Marteler du fer chauffé. - (63) |
| martse : marche - (43) |
| martse n.f. Marche. - (63) |
| martselô : petit marchand. A - B - (41) |
| martselot : petit marchand - (34) |
| martsi : marché - (43) |
| martsi : marché - (51) |
| martsi : marcher - (43) |
| martsi : marcher - (51) |
| martsi n.m. Marché. - (63) |
| martsi v. Marcher. - (63) |
| martson : (nm) poutre de cave - (35) |
| martson : marche qui descend à la cave - (43) |
| martson n.m. Chevron soutenant les tonneaux dans la cave. - (63) |
| marulei. : Marguillier. - Delmasse dit que ce mot vient du latin matricularius, parce que le marguillier, présidant aux intérêts temporels de l'église, en tient les livres ou registres. - (06) |
| marullai et marillei ; en langage roman des Trouvères, marillier. La dénomination actuelle est marguillier ; quelques-uns pensent que ce mot vient du latin matricularius, parce que le marguillier préside aux intérêts matériels d'une église... - (02) |
| marvaille : Merveille. « Y est cen qu’est eune balle marvaille ! » : voilà une belle merveille ! - (19) |
| marveille, s. f., merveille, toute chose extraordinaire. - (14) |
| marveilloû, adj., merveilleux. - (14) |
| marvillou. : Merveilleux. Même mot au patois qu'au dialecte. - (06) |
| marvuilli : v . se dit des porcs qui défoncent le terrain avec leur groin. - (21) |
| maryi : (nm) marguillier - (35) |
| maryi : (vb) marier - (35) |
| maryî n.m. (vx.fr. marreglier) Marguillier, sonneur de cloches. - (63) |
| maryi, m. marguiller. - (24) |
| mas (adj.pos.m. et f.) : mes - (50) |
| mâs (adv., conj.) : mais - (50) |
| mas : (conj) mais - (35) |
| mas : (nm) mois « l'mas d'dzin » - (35) |
| mas conj. Mais, cependant, toutefois. Lorsque "mais" est employé comme adverbe dans le sens de davantage il se prononce "mè" et on l'écrira "maîs". - (63) |
| mas : mais - (39) |
| mâs : plus - (39) |
| mâs, « L » davantage, magis. - (04) |
| mas, mas bah, mas bin interjection. Eh, mais, eh bien. Placé au début de nombreuses phrases. Mas bin oui. Effectivement. Mas ch'tu. Mais, celui-là. Mas bah qui qu'y pout faire. Mais bon, qu'est-ce que ça peut faire. - (63) |
| mâs, plus - (36) |
| mâs, s.m, pièces de bois sur lesquelles sont placés les tonneaux dans une cave. - (38) |
| mas. adv. - Beaucoup : «J'y ai donné mas de lait pour assurer, et la pauvre belle ne s'est pas fait prier. » (Colette, Claudine à Paris, p.203) - (42) |
| mas. conjonct. et interject. Mais. Très usité. - (10) |
| masaige. : Métairie, du latin mansionem. (Charte de Chanceau de 1272.) - (06) |
| mascander : tacher, salir - (60) |
| mascognai, toucher quelqu'un indiscrètement , froisser une chose sans précaution... - (02) |
| mascogné. : Froisser ce qu'on tient, importuner une femme par des attouchements. Ailleurs on dit macasser et, en Berri, mascander. - On a déjà pu remarquer dans le patois l'alliance de deux mots, pour rendre une idée plus énergique : ansi masser signifie palper, exercer une pression sur un corps, et cogner veut dire mettre, pousser ou retenir quelqu'un dans un coin. - (06) |
| mascougner. v. a. Secouer. Le radical mas semblerait indiquer que ce mot serait synonyme de masturber. (Courgis). - (10) |
| mase : voir froumi - (23) |
| maseù. Désormais… - (01) |
| mâseure : masure - (48) |
| màseûre, s. f., masure, bicoque. - (14) |
| mas-hon, maison. - (05) |
| mashuan signifie la même chose que maseù. Il est formé de ces trois mots mas hu an, c'est-à-dire plus de cette année, magis hoc anno… - (01) |
| masibler : abîmer - (60) |
| masibler, masibier. Cribler de coups, mettre en marmelade. - (49) |
| masibler, verbe transitif : bâcler, mal faire un travail. - (54) |
| mâsiére, s. f. masure, maison pauvre ou en ruine. - (08) |
| masille. n. f. - Menue monnaie, ferraille, petite somme d'argent. - (42) |
| masille. s. f. Argent de poche, menue monnaie. (Armeau, Lindry, Villiers-Saint-Benoît). - (10) |
| masouille : s. f., vx fr. masel (s. m.), fourmi. - (20) |
| masouire, marotte (Charollais): fourmi. - (30) |
| mâsque (on) : masque - (57) |
| masque. Masques : « Lé masque core an seurtai », les masques courent en sûreté. Ici « lé masque » signifie les personnes masquées… - (01) |
| masque. : On lit au glossaire de Lamonnoye : lé masque core en seurtai. Les déguisements et les imbroglio faisaient le charme de la cour de nos ducs : aussi la ville ne pouvait manquer de se rendre imitatrice, et, dès que la fête de Noël s'était accomplie, on se livrait, sous le masque et les déguisements les plus variés, à toute la joie possible, sans causer le moindre ombrage à la très paternelle administration de la cité. - (06) |
| masques (còri les), loc., se déguiser, en Carnaval, aller par les rues, et pénétrer par bandes dans les maisons. Tous les travestis ont ce privilège durant les jours gras, et ils sont toujours bien reçus. - (14) |
| masques (mots ébillés en), loc., mots défigurés par une prononciation fautive(au point de vue des gens) : « Ah ! c'té-là, quand all'parle, tous les mots sont ébillés en masques. » - (14) |
| massacre, celui qui brise tout. - (16) |
| masse : Messe. « La masse de miné » : la messe de minuit ; la messe qui se célèbre dans la nuit du 24 au 25 Décembre. Au retour de cette messe tout le monde se met à table, maîtres et serviteurs, et on réveillonne avant d'aller au lit, on n'oublie même pas le bétail dont on va garnir le ratelier en mémoire du bœuf et de l'âne qui ont réchauffé de leur haleine l'enfant Jésus dans la crèche. - (19) |
| mâsse : s . f. fagot de chanvre. - (21) |
| mâsse. s. f. Tourteau de chènevis ou d'autres graines oléagineuses. – Réunion de plusieurs petits paquets de chanvre. Du latin massa. - (10) |
| masselle. : (Dial.), joue, mâchoire. (Du latin maxilla.) « Le pertuihs de la masselle », a dit le livre de Job, c'est-à-dire, l'ouverture de la bouche. - (06) |
| mâsseron : quelqu'un qui est noir et sale - (39) |
| masseuche. adj. Lourd, massif. – A Vassy-sous-Pisy, on dit, substantivement, d'un lourdaud, que c'est un masseuche. - (10) |
| massicoter. v. a. Couper. (Grandchamp). - (10) |
| massouére : machoire - (39) |
| massourer : barbouillé de noir - (39) |
| massout, massot : s. m., pièce de bois qui, dans un char, se trouve entre le lisoir et l'essieu. - (20) |
| massue. s. f. Jeu d'enfants, consistant à frapper, à faire rouler avec un gros bâton recourbé au gros bout une petite boule de bois appelée minée. (Perreuse). - (10) |
| mastoque, adj. des deux genres. lourd, épais, grossier. - (08) |
| mastoque. adj. Epais, lourd, informe. (Chablis). - (10) |
| mât : Employé en compositon dans « mâts de cave », pièces de bois sur lesquelles on place les futailles pleines. - (19) |
| mat, ate. adj. Humide. Mai chemise ot mat. (Savigny-en-Terre-Plaine). - (10) |
| mât’e : maître - (37) |
| mat’nau : (nm) vent d’est - (35) |
| matafan (on) : crêpe - (57) |
| matafan, crêpe. - (05) |
| mataflan : matefaim. Crêpe épaisse coupe-faim, appelée ailleurs crâpiau. - (62) |
| mataflan, et matefaim, s m., sorte de crêpe, que nos ménagères sautent habilement dans la poêle, et qui paraît fréquemment sur la table. - (14) |
| mataflan, s. m., crêpe très épaisse, avec de la farine. - (40) |
| mataflan. Crêpe. - (03) |
| matai, tenir quelqu'un en échec. On dit aussi, familièrement, qu'un individu est maie quand il se laisse mener... - (02) |
| matant : Tourteau. «Matan de calas » : tourteau provenant de la fabrication de l'huile de noix. - (19) |
| matchauder : frapper avec un marteau - (34) |
| mâte - maître. - C'â in bon mate que teint bein ses domestiques. - I demandai lai commission ai mon mâte. - Voiqui mon drôle qu'à déji grand, â vai ailai ai mâte beintô. - La femme, en parlant de son mari, dit quelquefois : C'â note mâte. Et l'homme en parlant de sa femme, dit : C'â note mâtrosse. - (18) |
| mâte (n.m.) : maître - (50) |
| mate : (nf) tas - (35) |
| mâte : maître - (48) |
| mâte : Maître. Voir Maît'. - (19) |
| mate : meule de foin. Ce mot,connu mais non utilisé chez nous, peut concerner la paille et le fumier en Dauphiné. - (62) |
| mate : meule de paille. (PSS. T II) - B - (25) |
| mâte : meule. (E. T IV) - VdS - (25) |
| mate : tas - (43) |
| mâte : maître (mâtrosse : patronne). Demande ai la mâtrosse : demande à la patronne. - (33) |
| mâte : (mâ:t' - subst. m.) maître, patron. L'expression èlè é: mâ:t' se dit d' un commis de ferme qui est embauché chez un patron. La femme du fermier parle du mâ:t' pour désigner son mari. - (45) |
| mâte : 1 n. m. Instituteur. - 2 n. m. Maître. - 3 n. m. Patron. - (53) |
| mâte : maître - (39) |
| mate : meule. (BEP. T II) - D - (25) |
| mate, matte, matole, mattole : s. f., vx fr. mote, tas, amas. Voir cuchon. - (20) |
| matè, métö, sm. marteau. - (17) |
| mate, meule de foin, gerbes, fagots. - (05) |
| mate, s. f. meule de fagots, tas régulier de fourrage. Verbe enmater (du vieux français motte). - (24) |
| mate, s. f. meule de fagots, tas régulier de fourrage. Verbe : enmaté. - (22) |
| mate, s. f., meule. Des mates de foin, de blé, de paille, etc. - (14) |
| mate, un peu tiède ; de l'eau mate, de l'eau dont la température est peu élevée. - (16) |
| mate, v. mettre. - (38) |
| mate. Humide, collant. Se dit de la neige ; de la figure : « être mate de sueur » . Meule de foin, de paille ou de fumier. - (49) |
| mate. Meule de foin ou de blé. - (03) |
| mate. Se dit d'une étoffe légèrement mouillée : c'est le synonyme de moite. Dans quelques villages, lorsqu'on a été trempé par la pluie, on dit : i sens mate. Cela est certes moins étrange que dire comme les bonne gins d'Avesnes-sur-Helpe : je suis tout crû. - (13) |
| matefaim : crêpe (peut être de cerises, de sarrasin, de treufes*). A - B - (41) |
| matefaim (de cerises, de sarrasin, de pommes de terre) : crêpe sucrée ou salée - (43) |
| mate-faim : (nm) sorte de crêpe épaisse - (35) |
| matefaim : crêpe épaisse - (51) |
| matefaim : Large crêpe de pâte de froment qui tient tout le fond de la poële. - (19) |
| matefaim n.m. Crêpe. Voir épogne. - (63) |
| matefaim : s. m, vx fr., crêpe épaisse. - (20) |
| màtefaim, màtefin, màtàflan (Chal., Autun., Br.), màdefin (Char.). - Sorte de crêpe épaisse, dont le nom s'explique de lui-même, car elle sert à apaiser la grosse faim. Le moyen âge connaissait cette pâtisserie également appelée, par une sorte de prononciation méridionale, matafam, dont le Chalonnais a fait mataflan, le mot flan lui présentant un sens plus compréhensible. Dans le Charollais, le matefin, qui se prononce madefin, reçoit aussi le nom de tortiau, par analogie sans doute avec le mot tarte. - (15) |
| mate-faim, n.m. grosse crêpe. - (65) |
| matefaim, tortchau, tortiau. Crêpe. - (49) |
| matelas (n.m.) : grands roseaux des étangs - (50) |
| matelas, s. m. grand roseau des étangs. - (08) |
| matelas. n. m. - Épi du roseau, de la massette à larges feuilles ; l'épi cotonneux était utilisé autrefois par les familles les plus modestes pour la confection de matelas. - (42) |
| matelas. s. m. Massette à larges feuilles de boreau, sorte de roseau (celui de l'ecce Homo), à l'extrémité duquel pousse un épi contenant une espèce de bourre, de duvet, dont les pauvres gens se font des matelas. C'est donc par synecdoche que cette plante est ainsi appelée. - (10) |
| matelats - épi d'une sorte de jonc (la massette, je crois) qui, pour la forme, ressemble à une chandelle. - Les petiots an en cueillé des matelats ; â se battaint d'aivou. - Lai mère Goisset dit qu'en fait des matelats d'aivou ces joncs lai. - (18) |
| matelin. s. m. Tourteau de noix. (Lindry). - (10) |
| matenau : vent du sud. (SB. T III) - S&L - (25) |
| matene (maten') : s. m., matines, angelus du matin. Je m' suis levé en entendant sonner le matene. - (20) |
| matené : Matinal. « T'es dan bin matené aujord'heu ? » : tu es donc bien matinal aujourd'hui ? - (19) |
| mateneau : Le vent d'Est. « La girouatte regarde le mateneau i ne veut pa tarder de pliu » : la girouette est à l'Est il ne veut pas tarder de pleuvoir. - (19) |
| matenée : Matinée. « I faut se lever d'houre (de bonne heure) pa fare eune bonne matenée ». - (19) |
| matenô : vent fort du sud-est. A - B - (41) |
| matenot : le vent de la pluie - (44) |
| matenot : vent d'est - (43) |
| matenot, s. m., vent du sud-est, qui vient de la Saône. - (40) |
| matéraux, s. m., matériaux : « O va fâre bâtir ; ôl a d'jà tous ses matéraux. » - (14) |
| matére : Matière, matériau. « Pa fare de la bonne ovrage i faut emplya (employer) de la bonne matére ». - (19) |
| matereaux. s. m. pl. Matériaux. - (10) |
| matériau : s. m., matériel. - (20) |
| mathieussalé : Mathusalem. « O va veni vieux c'ment Mathieussalé ! », altération plaisante de Mathusalem. - (19) |
| mâti, adj. fané. - (38) |
| mati, plateau avec rigole sur son pourtour, sur lequel on presse les raisins ; quelques vieux pressoirs ont des mati de pierre. - (16) |
| mati, s.m. plateau de pressoir sur lequel on écrase le raisin. - (38) |
| matiére (na) : matière - (57) |
| matin : s. m. matin. - (21) |
| mâtin : Sapristi ! Diable. « Mâtin qu'y est aré !» : Sapristi que c'est mauvais! - (19) |
| mâtin, polisson. - (26) |
| mâtin, s. m., polisson. - (40) |
| Matin. Martin : « Lai Sain-Matin », la Saint-Martin. - (01) |
| matinal, matinau (mat’nau), matenot (?) : s, m., vx fr, matinct, vent d'est (matin). - (20) |
| matinal, n.m. vent d'est. - (65) |
| matinaule, adj. celui ou celle qui se lève de bonne heure, matinal. - (08) |
| matinier, matinière : adj., vx fr., matinal, matineux. - (20) |
| matinôle. adj. Matineux. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| matlassire : (nf) « matelassière » - (35) |
| matnau n.m. (de matinal) Vent du matin, vent d'est. L'matnau boffe trois dzos p'un bachin d'iau : quand il souffle il ne pleut quasiment pas. - (63) |
| matnau :vent d'Est. - (21) |
| matnau, s. m. vent de l’est, du matin. - (22) |
| matnau, s. m. vent de l'est, du matin (du vieux français matinet). - (24) |
| matnau, s.m. vent d'est (de matinal). - (38) |
| matô : Matou. « Le mâto a migi le moniau » : le matou a mangé le moineau. « Sapré nam de Matô », juron très atténué. - (19) |
| Matô : NL Matour - (35) |
| matôle : Bloc de neige qui se forme sous le talon des chaussures. - (19) |
| matole : boule de neige - (43) |
| matole : neige qui colle sous les chaussures - (43) |
| matòle, s. m. boule de neige ; neige ou terre collée à la chaussure. Verbe matòler. - (24) |
| matoler (se) : se lancer des boules de neige - (43) |
| matoler : (vb) la neige (la boue) coller aux chaussures « y matole » - (35) |
| matôler : Se dit de la neige quand elle adhère sous les chaussures. « La nage matôle aujord'heu » : la neige adhère aux chaussures aujourd'hui. - (19) |
| matoler, mattoler : v. n., matonner, se prendre en mates. La neige matole sous mes sabots. - (20) |
| matolle : grosse botte de paille. - (30) |
| matolle, n.f. botte de paille. - (65) |
| màton (C-d., Chal.), Maiton IMorv.). - Tourteau, espèce de gâteau formé du résidu de plantes oléagineuses après leur pressuration. C'est encore un mot du vieux français, venant du verbe mattein cité plus loin au mot met. Dans l'Yonne, le mot maton signifie encore, comme au moyen âge, grumeau de lait ou de farine. - (15) |
| maton : tourteau - (44) |
| maton n.m. Tourteau. - (63) |
| maton, matton : s. m., vx fr, maton, tourteau provenant de la fabrication des huiles. - (20) |
| maton, n.m. tourteau. - (65) |
| maton, s. m. tourteau d'huile ; toute matière très agglomérée. - (22) |
| maton, s. m. tourteau d'huile ; toute matière très agglomérée. - (24) |
| maton, tourteau d'huilerie. V. truillots. - (05) |
| maton. Résidu de plantes oléagineuses. - (03) |
| maton. Tourteau. - (49) |
| matons, s. m., grumeaux du lait tourné, d'une sauce id., du savon non dissous dans l'eau, etc. - (14) |
| matons, s. m., tourteaux formés du résidu des fruits, et des plantes oléagineuses dont on a extrait l'huile. Les Bressans les utilisent, pendant l'hiver, à augmenter la qualité nutritive de leurs foins. Ce fait se produit par la quantité de matière caséeuse ou albumineuse que contiennent les tourteaux. Le maton de calas est surtout recherché par les enfants comme gourmandise. - (14) |
| matons. s. m. pl. Grumeaux de farine non délayée qui se trouvent quelquefois dans le pain. (Saint-Florentin). - (10) |
| Matorin (ine) : (nm.f) habitant (e) de Matour - (35) |
| matou ou métou ou mintou : Menteur. Voir mintou. - (19) |
| matou. s. m. Chat mâle. - (10) |
| matoule, s. f. boule de neige ; neige ou terre collée à la chaussure. Verbe : matoulé. - (22) |
| mâtra, fumier ; mâtrassé une terre, la fumer. - (16) |
| matras, fumier. - (05) |
| matras. Fumier. Matrasser veut dire graisser le sol avec du fumier. - (03) |
| matras. : Fumier. (Du latin materia.) - (06) |
| matrasser : Mettre de l'engrais, du fumier. « Ol a bien matrassé ses tarres » : il a bien fumé ses terres. - (19) |
| mâtre : grosse corde. - (31) |
| mâtre : grosse corde. (BD. T III) - VdS - (25) |
| mâtre, maître ; mâtrosse, maîtresse de maison. - (16) |
| mâtre, maître. - (27) |
| mâtre, mâtrosse : maître ou patron, patronne. - (52) |
| mâtre, matrosse, maitre, maîtresse. - (05) |
| mâtre, s. m. maître. le « mâtre » est le chef de la maison, le père de famille. La femme appelle son mari « not' mâtre », et le mari par réciprocité la nomme « not' mâtrosse. » - (08) |
| màtre, s. m., maître. - (14) |
| mātre, sm. maître. Ai mâtre : au service, en condition. - (17) |
| mâtresse, s. f., maîtresse. - (14) |
| mâtrie (n.f.) : maîtrise - (50) |
| mâtrie : direction, maîtrise - (39) |
| mâtrie, s. f. maîtrise, qualité et autorité du maître. prendre « lai mâtrie », c'est prendre le gouvernement, l'administration entre ses mains. - (08) |
| matroce ou maitrosse. : Prestation qui était versée entre les mains de la duchesse de Bourgogne. (Priviléges de Rouvres, 1215.) - (06) |
| matroner. v. n. S'arranger, se convenir, s'entendre ensemble, se fréquenter. (Pereey). – Se dit surtout des relations qu'un homme et une femme peuvent a voir ensemble. - (10) |
| mâtrosse (n.f.) : maîtresse - (50) |
| mâtrosse : maîtresse - (37) |
| mâtrosse : maîtresse - (48) |
| mâtrosse – maîtresse. - (18) |
| mâtrosse : maîtresse - (39) |
| mâtrosse : maîtresse. - (32) |
| mâtrosse : n. f. Patronne. - (53) |
| matrosse, maîtresse. - (27) |
| mâtrosse, s. f. maîtresse, la maîtresse de la maison, la mère de famille, femme ou fille à laquelle on fait la cour. - (08) |
| matrosse, sf. maîtresse. - (17) |
| mâtrôsse. s. f. Maîtresse. (Saint-Brancher). - (10) |
| mâtseuré : mâchuré - (43) |
| mâtsi : mâcher - (43) |
| mâtsi v. Mâcher. - (63) |
| mâtson n.m. Casse-croûte consistant (de veillée surtout). - (63) |
| matsteûron : (nm) suie - (35) |
| mâtt’e son grain d’sé (v’ni) : intervenir dans la discussion - (37) |
| matte : meule de foin. (BD. T III) - VdS - (25) |
| matte : tas - (51) |
| matte : une meule de paille, on dit aussi tisse - (46) |
| matte n.f. (du lat. mattam, natte, couverture de chaume ou du pré-celtique mutta, éminence arrondie) Pile. Eune matte de bôs, de fagots, de fmî. La taille de la matte de fmî était un bon indicateur de la richesse des propriétaires.Y'avot-ti eune grosse matte de fmî ? - (63) |
| matte : s. f. tas (de bois). - (21) |
| matte, meule de paille. - (28) |
| matte, s. f., meule de gerbes ou de paille. - (40) |
| mattefaim : crêpe; matefaim de cerises, de sarrasin, de treufes - (34) |
| mattenau : grand vent sec du sud-est - (34) |
| matton : tourteau (alimentation des animaux) par extension aliment taqué - (51) |
| maturiô, matériaux, ce qui sert à construire. - (16) |
| mau (avoir) : avoir mal, d'où c'est mau fait : mal fait, dommage, regrettable. - (56) |
| mau (n.m. ; adv.) : mal - (50) |
| maû (on) : mal - (57) |
| mau (préfixe de nombreux composés) mal. - (45) |
| mau : (n, adj) mal - (35) |
| maû : mal - (37) |
| mau : mal - (51) |
| mau : mal - (48) |
| mau : mal. - (52) |
| mau : Mal. « Alle a in grand mau de tête ». « Voula mau » haïr. « Mau de fait », locution qui s'emploie en réponse à des affirmations qui ne peuvent comporter de doute. - (19) |
| mau n. Mal, difficulté, misère, malheur. Y'a point d'mau que bin en veunne. A quelque chose malheur est bon. Littéralement : il n'y a point de mal que bien n'en vienne. Nos ans aiju bié des maux ! Nous avons eu bien des malheurs. - (63) |
| mau – mal. – Ce mot entre dans beaucoup de composés. Ainsi dans Maugré, dans Maulin, Maulo, dans Maugueurnai, etc. - (18) |
| mau : mal - (39) |
| mau : s. m., mal. Avolr mau, avoir mal. - (20) |
| mau, adj., malade : « Oh! l'pauv' garçon! ôl é bé mau ; ô n' passera pas la neùt. » - (14) |
| mau, adv. mal. - (17) |
| maû, adv., mal. - (40) |
| mau, et moû, adj., mouillé : « Je r'veins par la pleûe ; ma cote é tote maule. » — « A la fête, not' Cath'rine a dansé... alle en étôt moule. » - (14) |
| mau, mal, au singulier, comme au pluriel. Ce mot a des sens nombreux. É y'é bèn du mau, se dit, par exemple, d'une vigne gelée ou grêlée follement. Evoi bèn dë mau, avoir bien de la peine, être obligé à des travaux difficiles et multipliés ; él é évu bèn de mau d'I'évoi, il a eu beaucoup de peine à l'obtenir. Mau, mal, adverbe ; s'â mau fé, c'est mal fait. - (16) |
| mau, s. f., mal, maladie, empêchement : « Les dents me font mau. » — « Ol a ben du mau à joind' les deux bouts. » - (14) |
| mau, s. m. mal, douleur, maladie : « ile é deu mau ès aireilles », elle a du mal aux oreilles. - (08) |
| mau. Mal et maux. Ou disait autrefois ma, pour mal adjectivement… - (01) |
| mau. Mal, substantif. - (03) |
| mau. Mouillé, vieux mot. - (03) |
| mau. s. m. Mal. J'ai ben mau dans les reins. - (10) |
| mau. : Mal. - Ce mot pris adverbialement accompagne nombre de composés. - (06) |
| maubian, mal-blanc, panaris. - (16) |
| maublan, s. m. uni blanc, tumeur, abcès. « maubian. » - (08) |
| maubon : mauvais (temps) - (57) |
| maubon, adj., mauvais (mal-bon), mais qui renchérit sur le sens de ce mot, méchant. - (14) |
| maubon, mauvais. - (05) |
| maubué. En linge sale, car la langue française n'a point d'adjectif qui puisse représenter celui-là. Buer, vieux mot, signifie mettre à la lessive. Un homme maubué est un homme dont on ne blanchit le linge que rarement. Voyez Buie. - (01) |
| maubué. : (De buée, lessive), mal lavé, mal blanchi. - (06) |
| maucalé, adj. mal coiffé. s'applique surtout aux femmes. une personne « maucalée » a son bonnet de travers ou les cheveux en désordre. - (08) |
| maûch’fâ (du) : mâchefer - (57) |
| mauchançou, ouse, adj. malchanceux, euse. - (17) |
| mauchaussé, adj. s'emploie quelquefois substantivement, celui qui est mal chaussé, qui a de mauvaises chaussures : le « mauchaussé », une « mauchaussée » s'applique ironiquement aux va-nu-pieds. - (08) |
| maûchi : hâcher - (57) |
| maûchi : mâcher - (57) |
| maucoifée, adj., mal-coiffée, mais surtout femme de mœurs trop faciles. - (14) |
| maucontent, adj. mécontent, qui est de mauvaise humeur. - (08) |
| maucontent, adj. mécontent. - (17) |
| maucontent, adj., mécontent. - (14) |
| maucontent, mécontent. - (04) |
| maucoué (Mal couvé). adj. Mal venu, mal constitué. (Etivey). - (10) |
| maudefai ! loc. par exemple ! Il ne manquait plus que cela ! - (22) |
| maudefai ! loc. par exemple ! Il ne manquait plus que cela ! - (24) |
| maudi. Participe masculin de maudire, tant singulier que pluriel, c'est aussi le singulier des trois personnes du même verbe au présent de l'indicatif… - (01) |
| maudi. : Mal dit. - Bréviaire maudi, c'est-àdire, lu avec distraction. - Sans songer à mal, les Bourguignons s'amusaient de ce genre d'équivoques. - (06) |
| maudire : v. a., vx fr. maldit (adj.), médire. Que les maudisants soient maudits ! (c'est-à-dire que l'on médise également d'eux). - (20) |
| maudirein. Maudirions, maudiriez, maudiraient. - (01) |
| maudisson. s. m. Malédiction. De maudire. - (10) |
| maudition, s. f. malédiction. - (08) |
| maudru, s. m. le « maudru » est le plus petit des oiseaux d'une couvée, celui qui est éclos depuis peu de temps. Le « maudru » n'a pas encore de duvet. - (08) |
| maufageant, adj. malfaisant. - (17) |
| maufaichant : Malfaisant. « Du bestiau maufaichant » : du bétail qu'on a peine à empêcher de commettre des dommages, d'aller « es maufaits ». Voir maufait. - (19) |
| maufaiçon, sf. malfaçon. - (17) |
| maufait : Méfait, délit, dommages. « Aller es maufaits », se dit du bétail qui va pâturer dans la propriété du voisin ou dans tout autre endroit où il peut causer du dommage. « Va dan viri ta vaiche, alle est es maufaits » va donc faire revenir ta vache, elle est en train de causer du dommage. - (19) |
| maufait, adj., malfait. - (14) |
| maufait, méfait. - (05) |
| maufait, s. m. échappée de bétail dans un lieu défendu (expression de berger). - (24) |
| maufait, s. m. échappée de bétail dans un lieu défendu, expression de berger. - (22) |
| maufé, adj. mal fait, mal bâti, mal conforme dans ses diverses acceptions. - (08) |
| maufére, v. n. mal faire, faire mal : « c' p'tiô n' sunge qu'ai maufére », cet enfant ne songe qu'à mal. - (08) |
| maufesant, adj., malfaisant. - (14) |
| maufet, mal fait. - (04) |
| maufézan, ante, adj. malfaisant. celui ou celle qui aime à faire le mal. - (08) |
| mauflei. : Mendiant, estropié, pauvre diable (du latin male afflictus.) - (06) |
| maugé (C.-d., Chal.). - Malchanceux, maladroit. Etre maugé, c'est avoir du guignon, être prédestiné à la malchance De molum gerere, agir mal. Pris activement, mauger signifie ensorceler quelqu'un ; par contre démauger veut dire ôter la malchance. - (15) |
| maugeman, mélange. - (02) |
| mauger, ensorceler, jeter un sort. - (05) |
| mauger, v. tr., ensorceler, jeter un sort : « N' m'en parlez pas ; j'crais qu'ô m'a maugée. » - (14) |
| mauger. Ensorceler, jeter un sort. - (03) |
| mauger. N'avoir pas de chance ; et quand on dit être maugé du coucou, c'est qu'on passe par la plus rare déveine. Etym. mau, mal et gerere. - (12) |
| maûgner, v., manger du bout des dents. - (40) |
| maugouvert, malgouvert (abbaye de) : société plaisante qui, à Mâcon, au XVIe et au XVIIe siècles, prélevait, pour ses plaisirs et pour des œuvres de bienfaisance, sur les veufs ou veuves qui se remariaient, un droit dit de folvieille, grâce auquel les vieux époux se rachetaient du charivari ou tracassin. Voir L. Lex, L'Abbaye de Maugouvert de Mâcon (1581-1625), 1897, In-8. - (20) |
| maugracieux – renfrogni : renfrogné - (57) |
| maugracieux, mal gracieux. - (05) |
| maugrai. Malgré… - (01) |
| maugraiçou, ouse, adj. disgracieux, grognon, maussade. - (08) |
| maugraissou, maugressou (-ouse) (adj.m. ou f.) : disgracieux (-euse), grognon (-onne), maussade (de Chambure écrit maugraiçou) - (50) |
| maugré : (prép.) malgré - (35) |
| maugré : Malgré. « Ol y est allé maugré ma ». « Maugré ban gré » bon gré malgré. - (19) |
| maugré prépos. Malgré. - (63) |
| maugré, malgré ; maugré lu, malgré lui. - (16) |
| maugré, malgré. - (04) |
| maugré, prép. malgré, en dépit de : j'irai «maugré » lui ; il a fait cela « maugré » nous. - (08) |
| maugré, prép. malgré. - (17) |
| maugré, prép., malgré. - (14) |
| maugréé, manifester son mécontentement. - (16) |
| maugueurnai - maugréer, grommeler. - Qué drôle d'homme tôjeur ai maugueurnai – Le Jean â in vrai maugueurnou. - (18) |
| maul, mal : maulévisé, maul âïé. - (38) |
| mauladrèt, adj., maladroit. - (14) |
| maulai - mêler. - Tot â maulai ai ne pâ y ran connâte du tot. - En ne faut pas que vos maulains cequi ; faisez y aitention. - (18) |
| maulaibille, ll mouil. adj. des deux genres. malhabile, celui ou celle qui manque d'habileté, d'adresse. - (08) |
| maulaidroi. Maladroit. Au figuré, un homme maulaidroi c'est un homme difficile, bizarre, fâcheux. « Un tam maulaidroi » par rapport à la constitution de l’air, c'est un mauvais temps, un temps incommode, fâcbeux, tel que les faiseurs de Noêls supposent que fut le temps de la naissance de Jésus-Christ, quoiqu'il y ait lieu de croire qu'il ne faisait pas alors trop froid à Bethléem, puisqu'au rapport de saint Luc, les bergers du voisinage gardaient en ce temps-là leurs troupeaux à l'air en pleine campagne. - (01) |
| maulaidrot, adj. maladroit. - (17) |
| maulaidroué, drouéte, adj. et subst. maladroit, gauche. - (08) |
| maulaigi, ie, adj. malaisé. - (17) |
| maulaiji adj. Difficile, malaisé. - (63) |
| maulaipris, ise, adj. malappris, mal élevé, grossier : « couye-té don maulaipri » ! tais-toi donc malhonnête ! - (08) |
| maulaji : Malaisé, difficile. « Y est la coue (queue) qu'est le pu maulaji à écorchi » : c'est l'achèvement d'une œuvre qui offre le plus de difficultés. - (19) |
| maulancombre. Mauvais obstacle ; c'est proprement ce que signifie malencombre, vieux terme gaulois devenu burlesque… - (01) |
| maulande : Mélange, mélange de paille et de regain utilisé pour la nourriture du bétail. Au figuré : « An dit que les fanes causant pu que les hommes. Oh ! la maulande est bin faite ! » : on dit que les femmes sont plus bavardes que les hommes. Oh, il y a des deux, c'est mélangé. - (19) |
| maulard, mâlard. n. m. - Canard. - (42) |
| maulâsié, adj. malaisé, incommode, difficile ; au féminin « maulâsiére ». - (08) |
| maulâyé (adj.) : mal à l'aise, mécontent - (50) |
| maulâyé : malaisé, difficile - (37) |
| maulàye, adj. mal à l'aise, mécontent, malade. On prononce « maulâge » en « i seu maulâge », je suis mal à l'aise. - (08) |
| maule - mélange, surtout en parlant du foin avec la paille, la bouffe. - Vos fairas du bon maule pou les bétes. - Vos ne mettras qu'in quairt de peille dans le maule. - (18) |
| maule graisse, mauvaise grâce. C'est le latin malagratia. - (02) |
| maule. Mêle, môles, mêlent : « Dei s’an maule », Dieu s'en mêle. - (01) |
| maulédroit. s. m. et adj. Maladroit. - (10) |
| maulégé, maulégère. adj. Malaisé, ée. - (10) |
| maulegraice. : Mal gracieux. Al é maulgraice c'est-à-dire, il est peu avenant. C'est à tort que Delmasse écrit maullegraisse. Si l'on sépare les mots il faut dire de maule-graice, maule étant pour male c'est-à-dire, mauvaise. - (06) |
| maulendeùrant, adj., malendurant. - (14) |
| maulentendu, s. et adj., malentendu, parole mal interprétée, et personne peu intelligente. - (14) |
| maulépris, adj., mal appris. - (14) |
| mauler : Mêler. « Mauler du regain d'ave de la peille », voir si dessus. « Si les autres se battant ne t'en maule pas ! » : conseil qu'on attribue à la mère d'un jeune soldat appelé à la frontière. - (19) |
| mauler, et môler, v. tr., mêler, emmêler, confondre. - (14) |
| maule-raige. Male-rage, composé de rage, et de maie, féminin del’ancien adjectif mal, qui se reconnait encore dans quelques mots, tel que malan, malengin, malheur, maltalent. Voyez mau. - (01) |
| mauli-maulo : En désordre « Y est tot mauli-maulo, y a pas moyen de s'y recougnâtre » : c'est en désordre, il n'y a pas moyen de s'y reconnaître. - (19) |
| maulin-maulò, adv., mêli-mêlo. - (14) |
| maulin-maulô, pêle-mêle. En Lorraine, malin-mala, et en Allemagne, mish-mash , dont on a fait en France mic-mac. - (02) |
| maulin-maulô. Espèce d'adverbe élégant, qui signifie pêle-mêle. - (01) |
| maulin-maulô. : Pêle-mêle. En Lorraine on dit malin-mala, et en Allemagne misch-masch, d'où on a fait en France mic-mac. - (06) |
| mauloché, adj. mal léché. - (17) |
| maulon : fleur bleus des prés (?). - (31) |
| maulvais, n. masc ; réunion de plusieurs daignes (tiges) de chanvre. - (07) |
| maumarche. n. f. - Faux-pas, suivi d'une entorse, selon M. Jossier. - (42) |
| maumarche. s. f. Faux pas, entorse qui en résulte. (Ferreuse). - (10) |
| maumuer (s') (v.pr.) : se dit du temps qui se détériore (étym. se muer en mal) - (50) |
| maupaitient, ente, adj. impatient, peu endurant : « taise toué maupaitient », tais-toi homme sans patience ! - (08) |
| maupardu, adj., mal employé : « D'avou toutes ces bavétes qu'all’ s'en va tôjor taillant, en v'là-t-i du temps maupardu ! » - (14) |
| mauparlant, adj., médisant, et aussi grossier, brusque. - (14) |
| maupas (n.m.) : passage dangereux - (50) |
| maupas, s. m. passage difficile, dangereux. - (08) |
| maupenser, v. a. penser mal, imaginer à tort, mal à propos. - (08) |
| maupiaisant, adj. malplaisant. - (17) |
| maupiâzan, malplaisant. - (16) |
| maupléant. adj. - Déplaisant, désagréable, renfrogné. - (42) |
| maupléant. adj. Mal plaisant, bourru, fantasque. (Perreuse). - (10) |
| maupourtan, ante, adj. celui ou celle qui se porte mal, qui a une mauvaise santé : « not' mâtre ô maupourtan », mon mari se porte mal. - (08) |
| mauprenre (se). S'y prendre mal pour faire quelque chose, se méprendre. - (08) |
| maupròpe, adj., malpropre, répugnant. - (14) |
| maur. : (Dial.), plus grand. Comparatif alternativement simplifié, de maür, maiour et major, rac. lat. primitive. - L'adjectif maiirteiz, maturité, vient du latin maturitatem. « A la fois siet la tristece, la maurteiz del cuer. » (Job.) - « Nos faisons totes choses solunc maurteit de consoil. » - (06) |
| maurâle, s.f. provision de fruits. - (38) |
| maure, pâle ; en latin, marcens ou marcescens signifie qui se flétrit. - (02) |
| maurienne : faire la sieste - (39) |
| mauroge et demauroge. : Vif, qu'on ne peut retenir ou maîtriser. - (06) |
| mauroge, vif, qu'on ne peut tenir, qui fait enrager ses parents ou ses maîtres... - (02) |
| mausaiselou, ouse, adj et subst. maussade, grognon, de mauvaise humeur, disgracieux. - (08) |
| mausaivelou (-ouse) (adj.m. ou f.) : maussade, grognon (-onne), de mauvaise tnunerr - (50) |
| mausaivelou : (mô:sèvlou) de mauvaise humeur, grognon, malgracieux. - (45) |
| maûssade : difficile (qui n'aime rien) - (57) |
| maussaige. Mal sage. - (01) |
| maussain : Malsain, humide. « Ol a in leugement bien maussain ». « In pré maussain » : un pré humide. - (19) |
| mautraitier. v. a. Mal traiter, mal nourrir. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| mauvâ, aille, adj. mauvais, méchant, dangereux : « eun mauvâ hon-m', eune mauvâille fon-n'. » - (08) |
| mauvage : mauvaise. Ol o mauvas : il est méchant. Ol é eu une mauvage grippe : il a eu une mauvaise grippe. - (33) |
| mauvaie. n. f. - Poignée de blé tenue en main, plusieurs mauvaies forment une gerbe. - (42) |
| mauvaie. s. f. La poignée de blé que l'on tient, quand on moissonne. Un certain nombre de mauvais forment une javelle plusieurs javelles réunies font une gerbe. (Perreuse). – Au Val-de-Mercy, on dit mauvée, et ce mot s'applique à toute poignée de laumée, d'herbe ou de blé que l'on coupe avec une faucille. – A Etivey, ce méme mot s'écrit et se prononce manvée. ce qui, à raison de sa signification, montre qu'il dérive du latin manus. C'est, au reste, une syncope, une forme du vieux français manevis. Roquefort donne manée dans le même sens. Conséquemment, il résulte de ces circonstances que mauvaie et mauvée sont l'un et l'autre une altération de manvée. - (10) |
| mauvaise fièvre. Fièvre typhoïde. - (49) |
| mauvaiseté. n. f. - Méchanceté. (Bléneau, selon M. Jossier) - (42) |
| mauvaiseté. s. f. Méchanceté. (Bléneau). - (10) |
| mauvâs (adj.) : mauvais - (50) |
| mauvas (aille) : mauvais(e) - (39) |
| mauvâs : mauvais - (48) |
| mauvâs : Mauvais, méchant. « I fa bien mauvâs temps ». « Méfie tu de c'te (s'te) bâte, alle est mauvâse » : méfie toi de cette bête, elle est méchante. « In mauvâs chin » : un chien enragé. - (19) |
| mauvâs couç’eû : « mauvais coucheur », homme « à histoires » - (37) |
| mauvâs, âge. adj. Mauvais, aise. (Domecy-sur-le-Vault). - (10) |
| mauvâs, mauvaîlle : mauvais, mauvaise. - (52) |
| mauvâseté : Méchanceté. « O fa cen par mauvâseté » : il fait cela par méchanceté. - (19) |
| mauvâye (adj.f.) : mauvaise - (50) |
| mauvâ-ye, s. f., grosse chenille. - (40) |
| mauvée, poignée de blé coupée par la faucille et alignée sur la javelle. - (27) |
| mauvenan, ante, adj. mal venant, qui vient mal, qui ne réussit pas. - (08) |
| mau-vetu. Mal vêtu. - (01) |
| mauvi, s. m., mal vif, peu ingambe, invalide. - (14) |
| mauvie (n.f.) : grive - (50) |
| mauvie : grive. VI, p. 55-3 - (23) |
| mauvie, mauvis (C.-d., Br., Y.). - Grive, du même mot employé en vieux français et venant, disent les uns, de mala vila (mauvaise vie), à cause des déprédations que la grive exerce dans les vignes au moment des vendanges, et suivant d'autres (surtout Littré qui l'écrit mauvis, commeau moyen âge), de malum vitis, fléau de la vigne, pour la même raison. Quoi qu'il en soit, l'étymologie, en bas latin, est maviscus. - (15) |
| mauvie. s. f. Mauviette, petite grive. (Montillot). – Roquefort écrit mauvis, et fait dériver ce mot du latm malvitius. - (10) |
| mauviotte (n.f.) : mauve des bois - (50) |
| mauvis, s. m., grive d'automne. - (40) |
| mauvis, s.m, grive. - (38) |
| mauvis. Mauviette. On prononce également « mauvue ». - (49) |
| mauvitu, adj. mal vêtu, mal habillé, mal couvert. - (08) |
| mauvivre, v. n. vivre mal, avoir une mauvaise nourriture. - (08) |
| mauvoi. Mauvais. On écrit mauoi devant une consonne, mouvois devant une voyelle. - (01) |
| mauvoillan, ante, adj. malveillant, hostile. - (08) |
| mauvoulance, s. f. mauvais vouloir, malveillance, volonté hostile. - (08) |
| mauvoulance, s. f., malveillance, mauvais vouloir, humeur contraire. - (14) |
| mauvoulant, adj., malveillant. - (14) |
| mauvouloir, s. m. mauvaise volonté. - (08) |
| mauvue (avoir la). Être maladif ; avoir du malheur. - (49) |
| mauvue (n.f.) : 1) mauvaise vue - 2) mauvais sort - (50) |
| mauvue, s. f. mauvaise vue : avoir la « mauvue » c'est être atteint de myopie ou avoir les yeux malades. - (08) |
| mauvue, voir mal - (36) |
| mauwais adj. Mauvais, méchant. - (63) |
| maux (avoir des) : peiner avoir des difficultés. - (66) |
| maux (avoir des), locution verbale : avoir du mal. - (54) |
| maux blancs : mals blancs. - (32) |
| maux. Difficulté. Ex. : « J'ai eu bien des maux pour en venir à bout. » - (12) |
| maux. Mal : « aul è maux è l'estomac ». - (49) |
| maxiner. Vacciner. - (49) |
| mäye : (nm) maillet - (35) |
| mayette. Moyette. - (49) |
| mayeuche : n. m. Gros maillet à long manche. - (53) |
| mâyion : maison - (37) |
| mâyon - maison. - En y é des jolies mâyons ai Sainte-Saibine. - Lai mâyon du Guillemaird é des chambres hautes. - Les mâyons des aute fouai étaint bein mau bâties. - (18) |
| mâyon (n.f.) : maison - (50) |
| mayon (nom féminin) : maison. - (47) |
| mayon : (mâ:yon - subst. f.) maison, logis; le mot désigne l' unique pièce carrée où vivait le paysan ; aussi disait-on "balayer lè mâ:yon". - (45) |
| mâyon : maison - (39) |
| mâyon : maison. - (32) |
| mâyon, maison - (36) |
| mayon, méjon. Maison. - (49) |
| mâ-yon, s. f., maison. - (40) |
| mayre, s. f. renversement du vagin. on dit des vaches, des brebis, etc., qu'elles font la « mayre » du ventre, lorsqu'elles sont sujettes à ce grave désordre qui est un cas rédhibitoire. - (08) |
| mazagran, s. m., gobelet de terre pour faire champorot (cf. ce nom). - (40) |
| mâzâr, insecte nuisiblo à la vigne. - (16) |
| Mazarin : nom de cheval. VI, p. 16 - (23) |
| maze (n.f.) : grosse fourmi - (50) |
| maze : fourmi - (60) |
| mâzète, interjection exprimant la surprise et homme sans valeur. - (16) |
| mazette - exclamation. - Mazette ! Que t'é don jolie, mai feille ! - Mazette ! i nô serains bein passai de cequi ! - Eh bein, mazette, i en voirai mon cœur cliair. - (18) |
| mazette. Petit polisson. - (49) |
| mâzeu, désormais. - (16) |
| mazeu. adv. De bonne heure. Y est enco mazeu, il est encore de bonne heure. (Poilly-sur-Serein). - (10) |
| mazeuille : fourmi - (43) |
| mâzeuille n.f. (p.ê. de mâchouiller). Râclure de casserole.Voir culot, keuraillon, ragotat. - (63) |
| mazibler (verbe) : briser, mettre en pièce, faire un mauvais travail. - (47) |
| mâziére : masure - (39) |
| mâzille (n. f.) : rognure, déchet - (64) |
| mazoîre, mazouère n.f. (d'un vieux mot germ. maïtan, couper). Fourmi. - (63) |
| mazoîrî n.m. Fourmilière. - (63) |
| mazon : maison. - (29) |
| mâzon, maison. - (16) |
| mazor. : Mangeur. Dans le dialecte maz signifie mets, ragoût. Le mot latin mazonomus veut dire une assiette, un plat. (Quich.) - (06) |
| mazouère : (nf) fourmi - (35) |
| mazouéri : (nm) fourmilière - (35) |
| mazoyi : fourmilière - (43) |
| m'cheu (i), un peu. - (27) |
| m'chin, un peu. - (26) |
| m'cho (in) - un peu. - C'est par euphonie pour Pecho (in). - I me contenterai d'in m'cho seulement. - Beillez moi z'en ran qu'in m'cho, si pecho que vos vouras. - (18) |
| m'chon : (nf) moisson - (35) |
| mchon : moisson - (51) |
| mchon n.f. Moisson. - (63) |
| mchonner : moissonner - (51) |
| mchoñni v. Moissonner. - (63) |
| m'chòt, s. m., un peu, adoucissement de p'chòt. (V. ce dernier mot.) - (14) |
| m'dzi, mji. Manger : « i faut bien m'ji ! ». - (49) |
| mé : (adv) plus, davantage - (35) |
| mé : maie, coffre sur pied où on pétrissait et conservait le pain. La mé fit ensuite office de buffet. - (52) |
| mé : mieux, plus - (51) |
| mé : plus - (44) |
| mê : verger. - (29) |
| mé qu’ d'un coup : plus d'une fois - (51) |
| më, meix, champ ou verger attenant à une maison. - (16) |
| mè, pétrin. - (16) |
| mé. Mes. Mé devant une consonne : Mé pairan, mes parents. Méi devant une voyelle : Mes anfan, mes enfants. M’é, avec une apostrophe, signifie m'a : Pierre m'a bien reçu, « Piarre m'é bé reçu ». - (01) |
| mé. Plus. « Aul est mé riche que moi ». - (49) |
| meau : mal. On peut avoir meau n'importe où : on peut avoir mal n'importe où. - (33) |
| meau-virot : mal blanc au doigt, panaris. - (33) |
| mécanique : frein (de chariot, de tombereau) - (48) |
| mécanique : Frein de voiture. « Sarrer la mécanique » : serrer le frein. « Eune mécanique de corset » : un busc de corset. - (19) |
| mécanique : frein sur un chariot, une charrette, une voiture à âne ou à cheval. - (52) |
| mécanique : frein sur un chariot . En descente on sarro la mécanique : en descente on serrait le frein. - (33) |
| mécanique : n. m. Frein sur chariot. - (53) |
| mécanique, s. f. machine à battre : demain on aura la mécanique. Frein d'une voiture. - (24) |
| méchamment, adverbe : beaucoup ou pour peu que. - (54) |
| méchan, gosse. - (26) |
| mëchan, mauvais, souffreteux. - (16) |
| mêchant : un petit enfant - (46) |
| méchant – tous les sens du français et, en outre, pas fort, maladif. - Ah ! i seu bein méchante depeu trois semaingnes. - T'é don l'air méchant !... Est ce que te souffre ? - Pôre méchant, vais ! - (18) |
| méchant : adj., intelligent, éveillé, rusé. - (20) |
| méchant, adj. mauvais. - (17) |
| méchant. Dans l'acception de chétif, se trouve au moyen-âge avec ce sens. On dit encore aujourd'hui mal et méchamment. On dit fréquemment, comme termes de pitié , le « poure méchant ». - (03) |
| méchie : mélange de paille et de foin donné aux vaches quand elles n'avaient plus de lait - (43) |
| méchin et méquin. Personne maladive et de mauvaise mine. Ast-ce que t'es melaide : t'ai l'air teut méquin... - (13) |
| méchine. Jeune fille, servante. J’aivons un valot pour les beux et eune méchine pour teni lai mâson... - (13) |
| méchllié, v. a. mêler, mélanger. - (22) |
| mèchllier, v. a. mêler, mélanger. - (24) |
| méchon : gerbe faite avec les débris de paille - (39) |
| méçhyie : (nf) mélange de paille et de foin - (35) |
| mècle, mèclée : s. f., xx fr, mescle, mesclée, mélange de foin et de paille qu'on donne à manger au bétail. Voir bréle mêcle. - (20) |
| mêcler : v. a., vx f., mescler, mêler. - (20) |
| mécopé (mécopè voir cô:) se dit du bois qui est coupé de biais. - (45) |
| mécopé(e) : (mé:copè, -é: - adj.) se dit d'une pièce de bois dont l'axe n'est pas parallèle au sens des fibres, ce qui en compromet la résistance. - (45) |
| mécopé, part, passé d'un verbe mécouper. Mal coupé. Se dit du bois qui est coupé de biais. Le bois « mécôpé » est plus cassant. - (08) |
| mécôple, adj. qui n'est pas couplé, mal couplé, dépareillé, en nombre impair. - (08) |
| mécredi : mercredi - (35) |
| mécredi : mercredi - (43) |
| mècredi : mercredi - (46) |
| mécredi : mercredi - (51) |
| mécredi : mercredi - (57) |
| mécredi, mèkerdi. mequeurdi. Mercredi. - (49) |
| mécredi, mercredi. - (38) |
| mècredi, sm. mercredi. - (17) |
| mécroire, ne pas croire à la parole de quelqu'un ; le français a conservé le mot mécréant, incrédule, dérivé de mécroire. - (16) |
| mécru, s. m. individu suspect en matière de religion ou de morale, entaché de sorcellerie. - (08) |
| méde ou méd'ille : Midi. « Y est méde au clieuchi » : il est midi au clocher. « Dremi au mède » : faire la sieste après le repas de midi. « En mède » : au midi, au sud. - (19) |
| méde, mes-de, midi ; mes-dron, s.m. sieste. - (38) |
| méde, s. f. excrément, fiente de tous les animaux. - (08) |
| médi (les), loc., tournure redondante usitée concurremment avec le mot précédent : « Dépôche-te ; les médi sont sounés. » Parfois aussi : « Les médi ont souné. » — « Su les médi. » - (14) |
| mëdi, midi. - (16) |
| mèdi, s. m., midi : « Su l'cô d'médi v'nez m' vouer ; j' f’rons la marande. » - (14) |
| médi. Midi. Plus rationnel à cause du vieux latin medidies. - (03) |
| médio : repas de midi. (S. T IV) - B - (25) |
| médio : sieste d'après repas de midi. - (32) |
| médion, sieste de midi. - (27) |
| médiot, s. m., midi, milieu de la journée. - (11) |
| mediot, s. m., sieste au milieu de la journée. - (40) |
| médiot. Milieu du jour. Sonner le médiot, c'est sonner l'angelus de midi. — Repos du midi, aprés lequel le vigneron fait un somme en été. A dreume de son médiot est synonyme de : il fait sa méridienne. - (13) |
| médisance : s, f., erreur. S'il n'y a pas de médisance, la récolte sera belle. - (20) |
| medoise, toute sorte d'herbages de bonne qualité, meloise. - (04) |
| mée (n.f.) : mère - (50) |
| mée : mère - (61) |
| mée : mère. « Doumèze que lè mée sâ morte, on n'en fé pus de pareille ! » dit un jour Roger, excédé par les louanges que ma tante se décernait, se comparant à sa bru. Grand-mée : grand-mère. - (52) |
| mée : mère. Dans le sens de mère (de famille) ou de désignation d'une personne. Ex : "La mée Marie, ç'atait ène boune parsounne !" - (58) |
| mée, s. f. mère : « mai mée », ma mère. - (08) |
| mée. n. f. - Mère. - (42) |
| méédi : n. m. Midi. - (53) |
| méédio : n. f. Sieste. - (53) |
| méfai. Péché, péchés. - (01) |
| méfaiture. Faute. Les mots méfaiture, impôlissure, fointure, quoique nouveaux dans le patois et hasardés, ne font pas de peine, parce qu'ils sont clairs, qu'ils n'ont pas mauvaise grâce, et qu'ils sont d'ailleurs en petit nombre. - (01) |
| méfére, v. a. gâter, altérer, nuire, diminuer la valeur d'une personne ou d'une chose. - (08) |
| méfié (se), vt. se méfier. - (17) |
| mégaffe. s. m. et adj. Impai r; toute unité en dehors des nombres ronds. 3, 5, 7, 9, 11. etc. sont des nombres mégasses. Quand les gamins font entre eux quelque partage, il y en a toujours un qui a soin de dire à l'avance : A moi le mégaffe ! Le cas échéant, il a cela de plus que les autres. - (10) |
| mégard : s. m., vx fr. mesgard, mégarde. - (20) |
| mègé, vt. manger, en parlant des animaux. Pour les personnes on dit digné. Mègez don ! — A ce que vo m'prenez po ène béte ? - (17) |
| mégeaille : mangeaille, nourriture - (48) |
| mégelé, adj. se dit du bois lorsqu'il est gelé a l'intérieur, gâté par un nœud ou autre accident naturel : ce chêne est impropre au service, il est « mégelé. » - (08) |
| mégeou, migeou, mingeou, ouse, adj. mangeur : « eun grô mégeou, eune p'tiote migeouse ou mingeouse », un gros mangeur, une petite mangeuse, c’est à dire d'un gros ou d'un faible appétit. - (08) |
| méger : manger - (48) |
| mèger : manger. - (66) |
| méger : manger. - (32) |
| méger, manger. - (26) |
| méger, manger. - (27) |
| méger, miger, minger, v. a. manger. - (08) |
| méger, mégerot, méjeussaint – divers temps du verbe manger. - Est-ce que te mége bein lai crôte, toi ? - En faurot que les bétes méjeussaint dés les quaitre heures. - (18) |
| mégnien, magnien. - (16) |
| mègnin : (mègnin: - subst. m.) chaudronnier, rétameur qui allait de porte en porte pour réparer les casseroles, rétamer les couverts de fer et ainsi empêcher qu'ils rouillent. Le mot est devenu le surnom de ceux qui ont exercé ce métier même temporairement. - (45) |
| méguenne, méguennée. s. f. Après-midi. Doivent être une syncope et une forme de mériguenne, mériguennée, prononciation altérée de méridienne, méridiennée. - (10) |
| mehaignai, estropier, et meihan, blessure... - (02) |
| mehaignai. : Estropier, blesser ( dial. et pat.). - Le substantif meihan signifie blessure. - (06) |
| méiceau, maréchal-ferrant - (36) |
| meidi, s. m. midi, le milieu du jour. - (08) |
| méïèze. s. m. Mariage. (Ménades). - (10) |
| meigle.s. f. Petite pioche à pointe, sans palette, pour la culture de la vigne. (Annay-sur-Serein, Chablis). - (10) |
| Meignarve. Minerve, enseigne du sieur Ressayre, libraire et imprimeur à Dijon. C'est lui qui a donné les deux premières éditions des Noêls du Tiilô et de lai Roulôte. - (01) |
| meigne. Mine, en quelque sens que ce soit. - (01) |
| meignerie, batterie de cuisine. - (02) |
| meignerie. : Batterie de cuisine. (Del.) - (06) |
| meignie ou maingnie, et quelquefois mehnée. : (En bas latin masnada, selon M. Littré dans son dictionnaire), famille, maison, ménage, valets. Dans le dialecte le mot est maisnie, magnie, mesnil, tous vocables traduits par notre mot familier maisonnée qui vient lui-même du bas latin mansionata. La racine de ces mots est le verbe latin manere et son substantif rég. mansionem. - (06) |
| meignie. Mégnie, vieux mot qui comprend toutes les personnes d'une maison, père, mère, enfants, domestiques, de mansionia. - (01) |
| meignot, s. m. manche du fléau, instrument à battre les grains. En plusieurs lieux « m'neau. » - (08) |
| mèille (n. f.) : nèfle - (64) |
| meille. La meille est une pioche à long bec recourbé ; on l'appelle dans le nord une rasette. L'Académie écrit mègle. - (13) |
| mêille. n. f. - Nèfle. - (42) |
| meille. s. f. Nèfle. (Rogny). - (10) |
| meillenot, s. m. maillot, lange pour envelopper les enfants. - (08) |
| mêiller. n. m. - Néflier. - (42) |
| meîller. s. m. Néflier. (Rogny). – Du vieux français mêlier, meslier, qui est une syncope du latin mespilus. - (10) |
| meilleu : meilleur (moilliou) - (46) |
| mèilleuche : (mèyeuch' - subst. f.) mailloche, gros maillet de bois ; à l'origine, grosse masse de chêne pour enfoncer des coins du même bois et le fendre. Par extension, grâce au progrès technique, l'instrument peut être en fer. - (45) |
| mèillier (n. m.) : néflier - (64) |
| meilloche : s. f. petit maillet. - (21) |
| meillœur, meillœure : adj. Meilleur, meilleure. - (53) |
| meillonot : Maillot. « San pu jeune est encore dans le meillenot » : le plus jeune de ses enfants est encore au maillot. - (19) |
| meillot. s. m. Maillet. - (10) |
| meilloû, adj., meilleur. - (14) |
| meillouche. s. f. Mailloche. - (10) |
| meine, s. f., mine, air, figure. - (14) |
| meineu, s. m. minuit, le milieu de la nuit. on prononce dans quelques localités « mingneu, minneu », et même « menu. » - (08) |
| meingme, habitation de toute une famille. En vieux français, maignée, du latin manere, demeurer, habiter. Il y a des endroits en Bourgogne où l'on dit maisonnée... - (02) |
| mein-m'ment, adv., mêmement, même. - (14) |
| meire, mère... - (02) |
| meire. Mère. - (01) |
| meire. : Mère. Nous avons vu précédemment que l' e ouvert (è) se changeait en ei. - (06) |
| meire-gôte. Mère-goutte, vin qui de lui-même sort des grappes dans la cuve… - (01) |
| mé-ï-ssau : maréchal-ferrant (et forgeron). - (52) |
| meitérée, meiturée : s. f., bas-lat. mayteriata, vx fr. meitere, ancienne mesure de surface pour les terres, correspondant à ce que l'on peut ensemencer avec une « metcaria » (v. Du Cange) de grain. La meitérée contenait 6 coupées mâconnaises, c'est-à-dire 22,500 pieds carrés, et valait 23 ares 742. De la on peut inférer que la «metcaria » de grain contenait 6 coupes. - (20) |
| meix (C.-d., Chal., Morv.). - Ce mot, qui se prononce mé, et désignait jadis en Bourgogne les habitations rurales, attenantes à un jardin ou à un verger, sert aujourd'hui à désigner des clos de vignes…. Dans la coutume de Bourgogne, meix se prend non seulement pour la maison et ses dépendances, mais pour tout autre héritage sis au même lieu. Ce mot vient du latin mamus qui a le même sens, dont le synonyme est mas, en Provence, et metz, en Lorraine. - (15) |
| meix : maison, hameau. Equivalent du Mas en Provence. Exemple : le Meix Bouroux. - (62) |
| meix, maison, hameau. - (05) |
| meix, mex, metz, may, maz, s. m. un « meix » était en bourg, et en nivernais une habitation rurale. - (08) |
| meix. Clos tenant à l'habitation. I sens aillé dans not’ meix cuyer des peîches. Ce mot paraît venir du latin mansus et du verbe maneo : j'habite ; il a formé de nombreuses appellations locales et de lieuxdits : meix Durand, meix Porron, meix à Gote, meix Laurent. Dans quelques pays, on dit mas. Les noms propres Dumas et Dumeix n'ont pas d'autre origine. - (13) |
| Meix. Nom de lieu très-répandu en bresse - (03) |
| méjon : s. f. 1° maison, 2° chambre d'habitation. - (21) |
| mèjou, sm. mangeur. Mèjou d'madje désigne qqun qui mange petitement, en épluchant. - (17) |
| mèjoure, sf. mangeoire. - (17) |
| mékeurdi n.m. Mercredi. Mékeurdi qu'vint. Mercredi prochain. - (63) |
| mékeurdi, mercredi, jour consacré au dieu Mercure ; d'où mékeurdi qui vaut mieux que mercredi. - (16) |
| mela : canard mâle. (REP T IV) - D - (25) |
| melaide (n. et adj.m. et f.) : malade - (50) |
| mélancôlie. Mélancolie. - (01) |
| mèlandrou, ouse, adj. malandreux. Malingre, maladif. - (17) |
| mélandze n.m. Mélange. - (63) |
| mélandzi : mélange - (43) |
| mélandzi v. Mélanger. - (63) |
| mélangi : mélanger - (57) |
| mêle : nèfle - (60) |
| méle : nèfle - (39) |
| mêlé, mêlié, s. m. néflier, arbre qui porte les nèfles. - (08) |
| mêle, mesle (n.f.) : nèfle - (50) |
| mêle, s. f. nèfle. - (08) |
| mèle, s. f., nèfle. - (14) |
| mélècasse. Verre de liqueur composé de cassis et d'eau-de-vie ou de marc. - (49) |
| mélède, malade. - (26) |
| mélède. Malade. - (49) |
| mêlée n.f. Mélange de deux ou trois céréales semées pour le bétail et récoltées ensemble. - (63) |
| mêlerette : s, f., femme qui se mêle de ce qui ne la regarde pas. - (20) |
| mêlette, s. f. petit panier qu'on porte suspendu comme un carnier. (voyez malette.) - (08) |
| mêléyot, ote. adj. et s. Qui se mêle de ce qui ne le regarde pas. (Perreuse). - (10) |
| mêlier (n.m.) : néflier - (50) |
| mèlier, s. m., néflier. - (14) |
| melin - moulin. - En i é pu d'aie à melin. - Le melin ai lai vapeur de Bligney fait in gros tort es autes. - Le derré melin ai vent de Sainte-Saibine à étai détru vé 1875 ai peu prée. - (18) |
| melin : moulin - (48) |
| melin : s. m. moulin. - (21) |
| melin, et m'lin, s. m., moulin. - (14) |
| melin, moulin. - (05) |
| melin, moulin. - (26) |
| melinchon (m'Iinchon) : s. m., commis de nouveautés, calicot, et, par extension, gommeux. - (20) |
| melinchon, adj. maigrelet, souffreteux. Féminin melinchône. - (24) |
| melinchon, adj. maigrelet. - (22) |
| melingn', s. m. moulin. l'e ne sonne pas : « m'lingn'. » - (08) |
| mêlis. n. m. - Mélange : « L'chat il a souté dans la bouéte à coutue ; te parles d'un mêlis ! » - (42) |
| mêlis. s. m. Mélange. Mêlis Mêlas. - (10) |
| mellance. : (Dial.), agglutination. (Rac. lat., mel, miel.) - (06) |
| melliésson, s. m. raisin à très petits grains. - (22) |
| méllioulœ, s. m. maillot d'enfant. Verbe : enméllioulé. - (22) |
| mélôdie. Mélodie. - (01) |
| meloise (n.f.) : prairie ou pâture humide - (50) |
| meloise, s. f. prairie ou pâture humide. - (08) |
| melotte, s. f. plante des marécages qui produit un petit fruit semblable à la groseille rouge et fort acide. - (08) |
| mélret, -ette n. Personne qui se mêle de ce qui ne la regarde pas. - (63) |
| membrance, s. f. souvenir, mention, mémoire d'une chose : faire « membrance », faire mention, remettre en mémoire, prendre en considération, tenir compte. - (08) |
| membrance. s. f. Souvenir, mémoire, ce qu'on se rappelle. I en a pas membrance, il n'en est rien resté dans la mémoire, personne ne se souvient de cela. Les Anglais ont le mot remembrance, qu'ils emploient dans le même sens. Du latin memoria. - (10) |
| membroyê : nombril. (C. T IV) - S&L - (25) |
| mêmé : Grand-mère dans le langage enfantin. « Dis banjo à ta mêmé ». - (19) |
| méme : même - (57) |
| mêmer, embrasser. - (05) |
| mémer, v. tr., embrasser : « Mémer papa, manman. » Semble contenir le mot aimer (m'aimer). - (14) |
| mêmer. Embrasser ; formé de aimer ; de même on dit vulgairement faire des mamours. - (03) |
| mémère, subst. féminin : diminutif affectueux de grand-mère, mamie. - (54) |
| mêmou (li), lui-même. - (05) |
| mémouaire (n.f.) : mémoire - (50) |
| mémouaîre (na) : mémoire - (57) |
| mémouaire : n. f. Mémoire. - (53) |
| mémouère. Mémoire. - (49) |
| mémouère. n. f. - Mémoire. - (42) |
| mémouine : 1 n. f. Mauvaise femme. - 2 n. f. Bizarre. - (53) |
| mèn, tèn, sèn, le mien, le tien, le sien ; les jeunes, croyant mieux parler que les anciens, disent : le miène, le tiène, le siène. - (16) |
| ménadze : ménage - (43) |
| ménâdze : ménage - (51) |
| ménâdze n.m. Ménage. - (63) |
| ménadzi : ménager - (51) |
| ménadzi v. Ménager. - (63) |
| ménageon : s. m., ménage d'enfant ou de poupée. - (20) |
| menai - mener. Tous les sens du français et, en outre, faire de la musique. - A meune le viôlon. - Quand al éto jeune, a meno lai flûte.- A menero lai musique es fêtes. - (18) |
| menai. Mener, mené, menez. - (01) |
| menaichi : Menacer. « Le temps menaiche » : l'orage menace. - (19) |
| menaier, menayer : v. a., vx fr. manier, caresser de la main, peloter. - (20) |
| ménaigi : Ménager. « Je ne l'ai pas ménaigi » : je ne l'ai pas ménagé, je lui ai dit son fait. - (19) |
| ménaize (n.m.) : ménage - (50) |
| menat’ius*, s. m. pl. ornements en arabesques. - (22) |
| menat'ius, s. m. pl. ornements en arabesques. Zig-zags dans un travail mal aligné. - (24) |
| menau. s. m. Perron. (Domecy-surCure). - (10) |
| menbreure, s. f. membrure, gros bois de sciage. - (08) |
| mendjent. Mendiant. - (49) |
| mendji : mendier - (57) |
| mené peste et rage, loc. fulminer, faire grand bruit. - (22) |
| mène, meune. pron. poss. - Le mien, la mienne, sans distinction entre masculin et féminin. - (42) |
| mène, pron. mien, mienne. - (17) |
| mené, v. a. jouer d'un instrument de musique : il menait de la vielle. - (22) |
| mené, vt. mener du piston, du tambour, de l'orgue = jouer. Jué se dit seulement du violon. - (17) |
| méne. Mien : le méne, le mien ; lai méne, la mienne; lé méne, les miens, ou les miennes. - (01) |
| menein. Menions, meniez, menaient. - (01) |
| mener (m'ner) les bœufs : être en chaleur (vache) - (48) |
| mener : Mener. « Mener sa vaiche au marchi ». « Mener la fête » : jouer d'un instrument de musique. « Mener sa gueule » : bavarder à tort et à travers. « Couge te sacré mene gueule » : tais-toi sacré bavard. - Etre en rut en parlant des animaux. « La bardate mene les bus (les bœufs) ». - (19) |
| mener la jappe, loc. parler étourdiment et sans arrêt. - (24) |
| mener lai feite. Faire de la musique à la tête d'un cortège. Les anciennes confréries étaient précédées d'un meneîtré qui menot lai feîte. Dans la vallée de la Saône, les noces de villages sont précédées d'un tambour et d'un fifre dont les airs primitifs ne manquent pas d'originalité. - (13) |
| mener peste et rage, loc. fulminer, faire grand bruit. - (24) |
| mener : v. a., vx fr., jouer d'un instrument de musique. Il mène l’orgue à l'église. - (20) |
| mener, v. a. jouer d'un instrument de musique : il menait de la vielle. - (24) |
| mener. Jouer de. Ex. : « Venez donc, venez donc vite sur la place Saint-Pierre, voilà les soldats qui vont mener la musique! » - (12) |
| mener. Se dit pour jouer d'un instrument ; mener un bruit. Cette métaphore vient, je suppose, de ce que les menetrés, ou joueurs de violon, mènent les noces. - (03) |
| menet, m'net. Mouton. (Langage enfantin). - (49) |
| menêtré : Ménétrier, musicien de campagne. « An a bien dansi, i avait in ban menêtré » : on a bien dansé, il y avait un bon ménétrier. - (19) |
| menétré - musicien de village qui joue du violon pour faire danser aux fêtes et aux noces. – Le menétré de Vandenesse conveint bein ; quand al é jue al aibuye son monde. - (18) |
| ménetré, s. m. ménétrier, celui qui joue d'un instrument de musique. On prononce « menn'tré » ou « meunn'tré. » - (08) |
| ménetrei, s. m., ménétrier. - (14) |
| menetrei. Ménétrier, ménétriers, autrefois ménestrel et ménestrandier. - (01) |
| menetrer (n.m.) : ménétrier, musicien (aussi meunetrer) - (50) |
| menétri*, s. m. ménétrier, musicien. - (22) |
| menétri, s. m. ménétrier, musicien. - (24) |
| ménétrier : joueur de violon ou d'autre instrument, qui fait danser dans les villages. - (55) |
| menette. Menotte. (Langage enfantin). - (49) |
| méneu : minuit. - (29) |
| meneù. Minuit. - (01) |
| mêneûe : minuit - èl â mèneûe moins l'quart, il est minuit moins le quart - (46) |
| méneut (la) : moitié de la nuit. - (09) |
| méneùt (les), redondance qui fait pendant à les médi : « Vé les méneùt. » - (14) |
| méneùt, s. m., minuit : « J'irons à la messe de méneùt, é peu, en rentrant, j'ferons rossignon. » - (14) |
| meneux de loups : meneurs de loups. III, p. 17 - (23) |
| menevéa, poignée de chanvre que tient une personne qui tille. (Voir au mot tillai.) - (02) |
| menevéa. : Poignée de chanvre à décortiquer. (Du latin manu vecta.) - (06) |
| meneviau. s. m. Poignée de chanvre, ce que la main peut tenir. (Etivey). – Dans le Doubs, suivant M. Ch. Beauquier, on dit ménevée. Du latin manus, manipulus. - (10) |
| menigeon, n. fém. ; semailles d'automne. - (07) |
| menillon : semences d'automne. (RDC. T III) - A - (25) |
| ménin, minuit. - (26) |
| menine, s. f. main (en parlant à un enfant). - (24) |
| menïon, s. f. époque où se font les dernières récoltes d'avoine et de blé noir en même temps que les semailles d'automne. - (08) |
| meniyon, manïon (n.f.) : époque où l'on fait les dernières récoltes d'avoine et de blé noir en même temps que les semailles d'automne (ne pas confondre avec lai moichon, mouéchon ; de Chambure écrit : merlon) - (50) |
| menne (l’) : (le) mien - (37) |
| menne (lai) (pr.pos.f.sing.) : la mienne - (50) |
| menneveau. Une poignée, ce qui peut tenir dans la main. Du latin manus. Spécialement : poignée de tiges de chanvre liées en paquet. Comben que veus ez tillé de mennevias de chenôve hier à seir ? Les Flamands appellent manove le bout du fil par lequel on finit un écheveau et que l’on tourne en ligature. - (13) |
| menoies (pour menoires). s. f. pl. Les timons d'une voiture, ce avec quoi on la mène. - (10) |
| menoille, menouille, s. f. nom de lieu, terrain humide. (voir : meloise.) - (08) |
| menoinge ou, par abréviation, m'noinge - vendange. Voyez mieux Venoinge, bien que l'on prononce plus souvent Menoinge. - (18) |
| menoinge, s. f. vendange. «menanze, menoinze. » - (08) |
| menoingeou, ouse, s. vendangeur, vendangeuse. - (08) |
| menoinger, v. a. vendanger. - (08) |
| menoinze (n.f.) : vendange (menoinge pour de Chambure) - (50) |
| menon, s. m. 1. Chat (langage plaisant). — 2. Chaton de noisetier, de noyer au printemps. - (22) |
| menot, menote : adj., mignon, mignonne. - (20) |
| menöt, sm. minuit. - (17) |
| menotte, n.f. poignée de faux. - (65) |
| menou – meneur. - C'â in menou de musique. - (18) |
| menou, conducteur. Dans nos campagnes, ce nom s'appliquait au menestrel, menestrier, menetrei, parce qu'il menait la noce, à la tête de laquelle il jouait de son instrument. Par extension encore, on a dit au village : mener d'un instrument, pour jouer d'un instrument. Ai menne lai fête signifie il joue du violon ou du hautbois. Ai menne lai vie veut dire il fait vie joyeuse... - (02) |
| menou, s. m. celui qui mène, qui conduit, qui dirige : « eun m'nou d' lous », un meneur de loups. - (08) |
| menou. : Qui mène, qui dirige, qui est à la tête d'autres personnes. Il ne faudrait pas faire du menou un descendant des ménestrels, et encore moins des bardes. Quand le menou, de notre temps conduit une noce et mène (pron. meune) d'un instrument, en menan lai {éte, on l'appelle menetrei. - On dit aussi au figuré : Ai mene bé lai vie. On appelait menou d'ors, un conducteur d'ours. - (06) |
| menouille. s. f. Argent. (Cuy). - (10) |
| mensondze : mensonge - (43) |
| mensondze n.m. Mensonge. Mentrie est beaucoup plus utilisé. - (63) |
| mensonge : s. m., carré de carton ou de papier plié, autour duquel on enroule du fil, de la soie, etc., comme sur une bobine, - (20) |
| mensonge, s. m., petit carré ou petite étoile de carton ou de bois mince, sur quoi l'ouvrière pelotonne le fil de son « échevéte ». - (14) |
| ment’ries : mensonges - (37) |
| mentchoû (on) - mentoû (on) : menteur - (57) |
| mente : mensonge - (60) |
| mente : s. f., vx fr., menterie. - (20) |
| mente, sf. mensonge. - (17) |
| mente. s. f. Menterie, petit mensonge. - (10) |
| mente. : Mensonge. Ai vos é di dé mente (Del.), il vous a dit des mensonges. - (06) |
| menterie (n.f.) : mensonge - (50) |
| menterie : mensonge - (44) |
| menterie : mensonge. - (52) |
| menterie(s) : mensonge(s) - (39) |
| menterie, n. fém. ; mensonge. - (07) |
| menterie, s, f. mensonge. - (08) |
| menterie. S'emploie exclusivement pour mensonge. - (03) |
| menteries, n.f.pl. mensonges. - (65) |
| mentes. n. m. pl. - Mensonges : « Eh man ! La Mimi, alle arrête pas die des mentes ! » - (42) |
| menteux n. et adj. Menteur. - (63) |
| mentigueule. Etoffe, mouchoir, foulard passé sous le menton et noué sur la tète. Etym. menton et gueule. - (12) |
| mention (être), loc. être question : il a été mention de le faire partir. - (24) |
| mention (être), loc. être question : il a été mention de le faire partir. - (22) |
| mentir (faire) : loc, prouver à quelqu'un qu'il est dans l'erreur. - (20) |
| mentni, maintenir ce qu'on a dit ; mèntèn, tenue du corps. - (16) |
| mentonnette. Coiffure de paysanne, en percale à rebords empesés et tuyautés, s'attachant sous le menton avec un large ruban de percale ou de soie. - (49) |
| mentonnière (lai) : (l’) attache pour le seau à l’extrémité de la chaine du puits - (37) |
| mentonnière : voir pressoir. - (20) |
| mentôu (-ouse) (adj.m. et f.) : menteur, menteuse - (50) |
| mentou : menteur (mentouse au féminin) - (46) |
| mentou : menteur. - (52) |
| mentou : menteur. - (66) |
| mentou : menteur. - (33) |
| mentou : menteur - (39) |
| mentou, adj. menteur. - (17) |
| mentou, mentouse : menteur, menteuse - (48) |
| mentou, ouse, adj. et subst. menteur, menteuse. - (08) |
| mentoû, s. et adj., menteur, diseur de bourdes. - (14) |
| mentoux, mentouse : s. m. et f., menteur, menteuse. « Le Toine est un mentou lorsqu'il traite les cultivateurs de chers confrères... » (Courrier de Saône-et-Loire, 19 fév, 1921). - (20) |
| mentoux, -ouse, menteur, -euse. - (38) |
| mentoux. s. m. Menteur. (Savigny-enTerre-Plaine). - (10) |
| mentre : Mettre. « Je m'en mentrais pas ma main au fû (au feu) ». « Eune bâte qu’a tot mis » : une bête qui a toutes ses dents et dont on ne peut plus connaître l'âge à l'inspection de la mâchoire. - (19) |
| mentrie (na) : mensonge - (57) |
| mentrie : mensonge - (48) |
| ment'rie : mot féminin désignant un mensonge - (46) |
| mentrie n.f. Mensonge. P'les mentries ôl est pas l'dèri. - (63) |
| ment'rie : n. m. Mensonge. - (53) |
| mentu : n. m. Menteur. - (53) |
| menu. s. m. Partie du fléau qui frappe sur le grain. - (10) |
| menue pensée : voir pensée. - (20) |
| menuji : Couper à menus morceaux. - (19) |
| menusè : émietter - (46) |
| menuse. Carpe du premier âge que l'on élève dans les étangs. - (03) |
| menuser. Couper en petits morceaux. Dêpouâche-tai de menuser de lai corge. - (13) |
| menuserie : s. f., menuiserie. - (20) |
| menuserie. s. f. Minutie. (Courgis). Jaubert donne menusserie dans le même sens. - (10) |
| menûsier : Menuisier. « Le mertûsier m'a bien rarangi man buffet » : le menuisier a bien réparé mon buffet. - (19) |
| menusier : s. m., menuisier. - (20) |
| menusserie, s. f., minutie, bagatelle : « Bah ! ô s'émuse à des menusseries qui ne sarvont d'ran. » - (14) |
| menutieux : Minutieux. « In ovrage menutieux » : un travail long et délicat. - (19) |
| menûyai, par abréviation m'nuyai. - Beaucoup de personnes prononcent l'u d'un ton un peu nazillard comme si on y ajoutait un n. - Couper ou casser en tout petits morceaux. - Menuye voué ces bouts de pain qui, teins. - En faut menuyai les treufes pour les beillai es bétes. - Tot ai l’heure note drôle menuyot des brainches de faigots. - (18) |
| menu-yer, v., couper en petits morceaux. - (40) |
| menyon,menîyon (n.f.) : dernière récolte d’avoine et de sarrasin (pour de Chambure : menon) - (50) |
| mépi : néflier - (51) |
| mépié. Nèfle ; on dit aussi « cul de singe ». - (49) |
| mépier. Néflier. - (49) |
| mépille : nèfle. A - B - (41) |
| mépilli : néflier. A - B - (41) |
| mèple : s. f., lat mespilum, nèfle. - (20) |
| mèple, n.f. nèfle. - (65) |
| méplier : s. m., lat. mespilus ; néflier. - (20) |
| mèplle, s. f. nèfle. - (22) |
| mèplli, s. m. néflier, - (22) |
| méprigi : Mépriser. « Les pauvres sant sovent méprigis ». - (19) |
| méprisi : mépriser - (43) |
| méprisi : mépriser - (57) |
| mèpye : (nf) nèfle - (35) |
| mèp-ye : nèfle - (43) |
| mépye : nèfle - (51) |
| mèpye n.m. Nèfle. - (63) |
| mépye : s. f. nèfle. - (21) |
| mèpye, s. f. nèfle. - (24) |
| mèpyi : (nm) néflier - (35) |
| mèp-yi : néflier - (43) |
| mèpyier, s. m. nèflier. - (24) |
| méquerdi, méqueurdi. s. m. Mercredi. - (10) |
| méqueurdi (n.m.) : mercredi - (50) |
| méqueurdi : mercredi - (48) |
| méquèurdi s. m., mercredi. - (14) |
| méqueurdi. mercredi, le quatrième jour de la semaine. - (08) |
| méqueux, subst. masculin : vaniteux, orgueilleux. - (54) |
| méquier. n. m. - Métier. - (42) |
| méquingne, qui a mauvaise mine, malade ; se dite en parlant des animaux comme des personnes. - (27) |
| mér, mère. - (26) |
| mérande : repas principal (celt. Meren : manger). - (32) |
| mèrande, marande : le déjeûner, le repas ; faire une peutte mèrande : préparer un mauvais repas, peu savoureux. - (56) |
| mérange. s. f. Mésange. - (10) |
| mercau : (mêrcô: - subst. m.) chat mâle, matou ; puis par extension tout chat. - (45) |
| mèr'chaud (on) : maréchal-ferrant - (57) |
| merdaillon, s. m., blanc-bec, bambin, bonhomme qui fait l'important et n'est que ridicule. - (14) |
| merdasson : s. m., vx fr, merdas, excrément. Merdasson est le nom d'un ruisseau qui traverse Cluny et que Chavot (op. cit.), appelle Médasson. A Saint-Clément, faubourg de Mâcon, il y a un chemin dit des Merdassons. - (20) |
| merde de coucou : gomme de cerisier, ou de prunier. - (62) |
| merde de coucou, n.f. gomme du cerisier. - (65) |
| merde de coucou, ou pain de coucou. Gomme qui suinte des pêchers et des pruniers. - (03) |
| merde de coucou, s. f., gomme que l'on recueille sur certains arbres, principalement sur les pêchers et les pruniers. - (14) |
| merde d'ûjeau n.f. Fiente. - (63) |
| mére (na) : mère - (57) |
| mére : mère - (48) |
| mére du vente - (39) |
| mère en gueule : monstre attirant les enfants dans les puits ou les marres (légendes charolaises). A - B - (41) |
| mére en gueule : dans les légendes charolaises, monstre qui attire les enfants au fond des puits - (34) |
| Mère en gueule : génie des eaux. Être imaginaire destiné à dissuader les enfants de s’approcher des mares et des puits, comme la Vouivre (Vesvre chez nous), la Galafre ailleurs (et chez nous deux lieux-dits). Voir « vévre ». - (62) |
| mère en gueule : Monstre imaginaire qui est censé vivre au fond de l'eau et dont on menace les enfants pour les empêcher de trop s'approcher du puits ou de la rivière. « T'appreuche pas du pouit la mère en gueule te tirerait au fond ». - (19) |
| mère en gueule : monstre qui attire les enfants au fond des puits dans les légendes charolaises - (43) |
| Mère Engueule n.f. Monstre qui attire les enfants au fond des puits ou qui fait peur aux enfants qui s'approchent trop près des puits pour leur éviter d'y tomber, selon les villages. - (63) |
| mère lousine : personnage imaginaire vivant dans l'eau créé pour faire peur aux enfants - (46) |
| Mère Traiñne Cabas Personnage de la mythologie locale, pendant féminin du père fouettard, susceptible d'emporter les enfants désobéissants. - (63) |
| mére : mère - (39) |
| mére : n. f. Mère. - (53) |
| mère : s. f., tubercule mère de pomme de terre, etc., qu'on plante pour la reproduction. - (20) |
| mëre, mère. On appelle aussi mère une pomme de terre qui a produit ses fruits. - (16) |
| mére, s. f. matrice des femelles et principalement des vaches, arrière-faix ou placenta. - (08) |
| Mère-Engueule, cf. Engueule. - (40) |
| mère-en-gueule, subst. féminin : personnage mythique qui vit dans les puits ou les trous d'eau. - (54) |
| mère-sage : s. f., sage-femme. - (20) |
| mèrevoi. : Du latin mirum videri), expression qui, sous une forme exclamative, répond à celle-ci : chose étonnante à être vue, ou : je m'étonne si. - (06) |
| merfer, meurger, mergis, meurgis. s. m. Tas de menues pierres enlevées d'un champ et déposées à l'une de ses extrémités. On dit proverbialement, à Irancy : Les pierres vont toujours au meurgis. - (10) |
| mergotte. s. f. Marcotte. (Gy-l'Evêque). - (10) |
| meri ou m'ri - mourir. Voyez Meuri. - (18) |
| mèri, mari ; s'mèrié, se marier; é s'mèrian, ils se marient. - (16) |
| meriaine, après-dînée, méridienne. - (05) |
| mériaine. Après midi. Contraction de méridienne. - (03) |
| mérichaud : Maréchal-ferrant, forgeron. « Ramasse tes teneilles mérichaud ! »: se dit à un ouvrier qui laisse tomber ses outils. - (19) |
| mérichauder : Forger, réparer des outils. « O s'entend à mérichauder » : il est habile à réparer les outils. - (19) |
| mèrichô, maréchal. - (16) |
| mèricho, maréchal. - (26) |
| Mèrie, Marie. - (16) |
| mérienne : après-midi. (LCSS. T IV) - S&L - (25) |
| mérier, vn. estimer, évoluer. S'informer de. S’inquiéter de. - (17) |
| meriguier. s. m. Marguiller. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| merije : Merise. « En mentant tremper des merijes dans de l'iau de vie an fa eune bonne liqueur ». - (19) |
| meriji : Merisiser, cerasus avium. « Eune pipe en meriji » : une pipe en bois de merisier. - (19) |
| mérite (y), (y) vaut l’coup : c’est intéressant à faire - (37) |
| meritier, vt. mériter. - (17) |
| merliner. v. n. Travailler lentement, faire comme celui qui fend les bois noueux avec un merlin. - (10) |
| merlot. s. m,. Mulot. (Plessis-Saint-Jean, Soucy). - (10) |
| merlusine, et mère-lusine, s. f., corruption de Mélusine, fée qui apparaissait lorsqu'un membre de la famille de Lusignan devait mourir. Alors elle remplissait l'air de ses gémissements. - (14) |
| mèrmoigne : marmot. (RDT. T III) - B - (25) |
| mermusai - murmurer, chuchoter. - Quoi don qu'il é de tojeur mermusai quemant cequi ?... Mâtin ! le peut genre. - I ne peux pas, moi, supportai des gens que mermusant tôjeur po derré. - (18) |
| mermuser (ou marmuser) : (mêrmu:zè - v. intr.) être songeur ; c'est ruminer des projets, une vengeance ; de quelqu'un qui mêrmu:z' on dit que c'est un songe-creux. Si ces projets s'expriment de façon à peine intelligible on dit que l' individu maronne. - (45) |
| meroeure, s. f. pierre à bâtir. - (22) |
| mérote, s. f., dimin. de mère, petite mère, nom caressant que les enfants donnent à leur maman. - (14) |
| mérotte : s. f., fillette qui se donne de l'importance vis-à-vis d'autres enfants et veut jouer le rôle de petite mère. - (20) |
| merque, s. f. marque, signe au propre et au fig. on fait des « merques » ou entailles sur un morceau de bois pour établir un compte, un chiffre total, en certaines circonstances. - (08) |
| merquer, v. a. marquer, faire une marque. - (08) |
| merrain, s. m., chêne débité, destiné à la tonnellerie. - (40) |
| mertais, mertiau. s. m. Marteau. (Girolles, Coutarnoux). - (10) |
| mervo (ë), vt. empl. adv. [vx fr. mervoil, indic. prés, du v. mervoillier]. Mervo que, mervo si, (je) m'étonne que, si. Absol. : qu'est-ce ? que signifie ? Est-il possible ? - (17) |
| mês : mieux (plus) - (57) |
| mês : plus (quantité) - (57) |
| mès d'eu. Désormais. C'est absolument l'ancien mot meshui, en remarquant que nous disons aujed'heu pour aujourd'hui. - (03) |
| mès que, dès que. - (04) |
| mésaise, adj., mécontent. - (14) |
| mesatandue. : Mésintelligence, dispute. (Franchises de Molesmes, 1260.) - (06) |
| mesaulner. : Mesurer une étoffe frauduleusement. - (06) |
| méscia (d'la) - méilla (d'la) : mêlée (mélange de céréales) - (57) |
| méscier : mélanger (des choses) - (57) |
| mésc'ille (na) : nèfle - (57) |
| mésc'illi (on) : néflier - (57) |
| mes-de, midi. - (38) |
| mèsd'eu, désormais. - (05) |
| meser : manger. - (56) |
| meseure (n.f.) : mesure - (50) |
| meseuré : mesuré - (43) |
| meseure : mesure (la mesure de blé de Matour permet de semer approximativement 12 ares) - (43) |
| meseure : Mesure. « Eune meseure de lait » : le contenu du vase de fer blanc dans lequel les laitiers mesurent le lait (un demi litre). « Fare bonne meseure » : donner largement son compte. « Prendre sa meseure » : tomber de tout son long. - (19) |
| meseurer : Mesurer. « Meseurer les autres à san aune » : attribuer à autrui ses propres défauts. - (19) |
| méshu, dès aujourd'hui. - (05) |
| méshui. adv. Encore, dorénavant, désormais. (Rugny). - (10) |
| mesle, (mespilum), nèfle. - (04) |
| mesles, nèfles - (36) |
| mèsment que : (mèsmen que - conj. de subordination) pendant que (on dit aussi pendimen que). - (45) |
| messaige, s. m. message, commission transmise par un messager. - (08) |
| messaigé, s. m. messager, celui qui porte un message. - (08) |
| messe : mot féminin désignant un épi de maïs avec le grain, on dit aussi une panouille - (46) |
| messi chacun. locution qui signifie l'un et l'autre, le premier venu, n'importe qui, tout le monde. Un messi chacun, tout un messi chacun sans doute pour chaque messire. - (10) |
| messieu. Messieurs. - (01) |
| messire chécun. : Expression de la plus singulière originalité pour qualifier chaque magistrat assis sur son siége au parlement de Bourgogne. - (06) |
| Messire. Dit comme par ignorance pour Messie… - (01) |
| mèsson, maçon. - (26) |
| messou (nom masculin) : personne qui va régulièrement à la messe. Pratiquant, voire bigot. - (47) |
| messuelle. s. f. Langue de bœuf, nom générique de diverses plantes à feuilles rudes de la famille des borraginées. (Etivey). - (10) |
| m'est devis. loc. verb. - À mon avis, il me semble. On employait à la Renaissance la locution il m'est advis pour signifier il me semble. Usitée jusqu'à la fin du XIXe siècle sous la forme réduite m'est avis, cette locution est retenue par la langue poyaudine sous la variante m'est devis. - (42) |
| mésu - dommage, perte. - Des bêtes an entrai dan note champ de treufe lai neu ; a y ant, ma foi, causai encore bein du mésu. - (18) |
| mésu, s.m. tort, dégâts : du mésu ; verbe : mésuser. - (38) |
| mésu. adv- Volontiers. (Poilly-s-Serein). - (10) |
| mesure : voir coupe. - (20) |
| mesure, s. f., nom spécial d'un petit vase cylindrique en fer blanc, muni d'une longue queue à crochet, et dont se servent les laitières pour puiser le lait et le mesurer aux pratiques : « Comben d’mesures vous faut-i ? » - (14) |
| mesurée. s. f. Mesurage du grain provenant de la tâche des batteurs en grange. Faire la mesurée. (Saint-Martin-sur-Ouanne). - (10) |
| mesurette : s. f., ancienne mesure de capacité pour le sel, formant le 1/16 du litron, c'est-à-dire le 1/1024 du mlnot, et contenant 0 litre 050. - (20) |
| mésuse, s. f., abus, mauvais usage. - (14) |
| met – pétrin ou pétrissoire. - En nô fau préparai lai met pour fâre le pain demain deu le maitin. - Sarre lai miche dans lai met qu'ile ne se dessoiche pâ tant. - (18) |
| met (C.-d., Br., Chal.), mai (Morv.). - Huche à pétrir le pain ; du vieux français maict, venant du grec mactra, même sens, formé par le verbe mattein, pétrir. Ce mot, très usité en Bourgogne, l'est encore dans plusieurs autres provinces avec la même prononciation, Picardie, Normandie, Bretagne. Dans le Nord on prononce mée. - (15) |
| mét :(lai) meuble bas et allongé en bois, s’ouvrant à sa partie supérieure par un grand couvercle pivotant. dans la « mét’ », on rangeait le pain, les « restants d’goûter, les fromages secs - (37) |
| met. Coffre à pétrir le pain. - (03) |
| métailler : v. a., vx fr, mestailller, rompre la poche des eaux (en parlant des animaux). - (20) |
| metain-nes : mitaines - (43) |
| métal. n. m. - Méteil, mélange de froment et de seigle semés et récoltes ensemble. Pratique ancienne attestée par le français du XIV siècle, où mesteil signifiait mélange. - (42) |
| métal. s. m. Méteil, mélange de froment et de seigle. - (10) |
| métau, s. m. méteil, mélange de froment, de seigle, d'orge, etc. - (08) |
| métau. s. m. Synonyme de métal. (Bazarnes). - (10) |
| métei - besoin. - Al en ant bein métei, les pôres gens. - (18) |
| Métei. Métier, profession. « El an fon métei », ils en font profession. Métei se prend aussi pour besoin, comme dans le noêl où il est dit « j’an aivein métei », nous en avions besoin. On disait de même en vieux français, « si métier est », pour si besoin est. - (01) |
| metei. : Ministère, office, nécessité, besoin. J'ai von metei de celai, c'est-à-dire nous avons besoin de cela, est une phrase où le mot metei a le même sens que dans cette expression du dialecte si mestier est, c'est- à-dire si besoin est. Metei et mestier viennent du latin ministerium. - (06) |
| méteil : le méteil était un mélange de seigle et de froment semé dans le même champ. - (55) |
| méteil : mélange de céréales semés ensemble. - (59) |
| métenant : adv. Maintenant. - (53) |
| méteni, v. a. maintenir, tenir à sa place : un enfant difficile à « mét'ni », c'est-à-dire à contenir. - (08) |
| meti, s. f. moitié. - (22) |
| met'iein, s. m. milieu. - (22) |
| métier, s. m. besoin, utilité. avoir « bon métier » d'une chose, en avoir grand besoin. - (08) |
| mètin : le matin - (46) |
| métin : Matin. « Les bon 'ovrés se levant de ban métin » : les travailleurs se lèvent de bon matin. « En métin » : à l'Est. « San pré juint le min-ne en métin » : son pré joint le mien à l'est. - (19) |
| mètin, matin. - (26) |
| mét'nan, adv. de temps. maintenant, à présent. - (08) |
| met'nan, maintenant, de nos jours. - (16) |
| mét'ni, v. tr., maintenir. - (14) |
| mèton, tourteau de noix. - (27) |
| m'étou, syncope de moi-étou, moi-itou, moi aussi. - (14) |
| métsant adj. Méchant. - (63) |
| mett' : v. t. Mettre. - (53) |
| mettant que (loc.) : sans doute, sûrement - (50) |
| mette : mettre - (48) |
| mette v. Mettre. - (63) |
| mette : mettre - (39) |
| metterie : Bobine à dévider faite d'un morceau de carton sur lequel on enroule le fil. - (19) |
| metton - pain de chenevis, de navette, après que l'huile est faite. - L'huile m'é rendu de beins bons mettons de chenevet. - I va fâre mégé du metton ai nos bétes, cequi los â bon. - (18) |
| mettoux n. et adj. Menteur. Y'est mettoux et copanie ! C'est menteur et compagnie ! - (63) |
| mettre à l'abade : sortir les vaches de l'étable - (43) |
| mettre en capots : grouper plusieurs graines à planter - (43) |
| mettre en raveune : énerver, exciter - (43) |
| mettre en roules : former les andains. - (59) |
| mettre nézi : mettre le chanvre à rouir - (43) |
| mettre ses dents : loc, faire ses dents. - (20) |
| mettrie n.f. Menterie. Chtu-là, ô dit qu'des mettries. Celui-là, il ne dit que des mensonges. - (63) |
| mettu (ail’ l’aivot) : (il l’avait) mis - (37) |
| mettu : mis, posé - (37) |
| mettu : part, pass,, mis. - (20) |
| mettu, metta, metteussain - divers temps du verbe mettre. - Ile é mettu sai soupe su le feu. - Te mettras le vais dans le prai. - An sero bon qu'a metteussaint lote petiot ai mâte. - (18) |
| mettu, mis - (36) |
| mettu, part, passé du verbe mettre. Mis : « al é mettu son haibi. » - (08) |
| mettu, -ue p.p. de mette. Alle li a mettu eune yappe ! - (63) |
| mettues : mises - (37) |
| métu, part., mis : « Te n'crains pas l'iau ? — Non ; j'my é métu tout d'gò. » — « Ol n'é pas manchot ; ô s'é métu tout drèt à son ôvrâge. » - (14) |
| met'yi, s.f. moitié : donner la met'yi d'une pomme. - (24) |
| met'yié, s. m. milieu : s'arrêter au met'yié. - (24) |
| meû (adj.) : mûr (des pernes meûes (des prunes mûres)) - (64) |
| meû : (adv) mieux, plus - (35) |
| meu : mieux - (51) |
| meu : mieux, plus, davantage - (43) |
| meû : Mort. « San homme est meû » : son mari est mort. En parlant d'un vin trop acide ou d'une liqueur trop forte : « I farait reveni in meû » : cela ressusciterait un mort. « Y est la meû que le mene » : se dit d'une presonne déjà âgée ou malade et qui s'acharne au travail. - (19) |
| meu : Mûr, féminin meure. « Eune poire bien meure ». - (19) |
| meu : mur. (B. T IV) - D - (25) |
| meu d'vià, mou de veau. - (16) |
| meu : mûr (féminin : meue). Ex : "Les poum' ? Al sont pas meu !" - (58) |
| meû, adv., mieux. - (14) |
| meu, eue. adj. Mûr, ûre. - (10) |
| meu, meue, adj. mûr, mûre, qui a la maturité. - (08) |
| meû, meurte : (adj) mûr(e) - (35) |
| meu, mot. - (16) |
| meù. Mieux, c'est aussi un muid, ou des muids. - (01) |
| meub'ille (on) : meuble - (57) |
| meub'iller : meubler - (57) |
| meubje, sm. meuble. - (17) |
| meuble, n.m. armoire. - (65) |
| meub'lle : Meuble. « Ol est rûné, an a vendu ses meub'lles » : il est ruiné on a vendu ses meubles. « Le meub 'lle » la grande armoire où on serre le linge. (Les armoires s'appellent meub'lles ou cabinets). - (19) |
| meubye n.m. Meuble. - (63) |
| meuche. Meule de paille ou de foin. - (49) |
| meûches (dâs) : (des) tas faits avec le foin coupé et séché, destinés à être ramassés à la fourche pour être chargés sur le chariot à quatre roues - (37) |
| meud. s. m. Muid. Un bon meud de vin de Palotte. (Irancy). - (10) |
| meude : Mode, coutume. - (19) |
| meûder : (vb) se promener - (35) |
| meûder : se promener - (43) |
| meudre : Mordre. « Prends garde au chin (chien) o va te meudre ». - Démanger. « Gratter quéqu'in queva i le moud » : faire à quelqu'un les compliments auxquels il est sensible. - (19) |
| meue : moue - (60) |
| meue, s. f. moue, grimace, mine refrognée : « fére lai meue », faire la moue, être maussade, triste. - (08) |
| meuffle - vessie d'animal, de cochon surtout. - Te ne sai pâ ce que que c'â qu'ine meuffle ?... ma c'â lai veuchie - Teins, petiot, enfle lai meuffle du couchon et pu ci te fairé in tambour (l mouillée). - (18) |
| meufion : gros nez - (44) |
| meûfion : mufle d’un animal, nez d’un humain - (37) |
| meûfion : mufle du bœuf. (RDV. T III) - A - (25) |
| meufion. s. m. Groin. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| meuflon, feugnon : 1 adj. et n. m. Mufle. - 2 n. m. Nez. - (53) |
| meugetiau (nom masculin) : sorte de muselière pour empêcher les veaux de téter. - (47) |
| meugetiau, s. m. muselière au moyen de laquelle on empêche les veaux de téter. - (08) |
| meuglai. : (Pron. meugliai), beugler, mugir. - (06) |
| meugliai, pousser des mugissements comme font les bœufs... - (02) |
| meûgnâ n.m. Pleurnichard. - (63) |
| meûgnâ, m’gnâ : (nm) personne qui se plaint pour rien - (35) |
| meûgnat : personne qui se plaint pour rien - (43) |
| meugne : (nf) (faire la) moue - (35) |
| meugne : faire la moue - (43) |
| meûgne n.f. Moue. - (63) |
| meugneau (nom masculin) : museau, groin. - (47) |
| meugneau, s. m. museau, groin. - (08) |
| meugner : manger du devant de la bouche - (60) |
| meugner. Meugler, mugir. Fig. Pleurer. - (49) |
| meugni : pour les bovins, beugler légèrement. A - B - (41) |
| meûgni : Meugler « Va donner à miji es bâtes, an les entend meûgni, i est qu 'i antfaim » : va donner à manger au bétail on l'entend meugler parce-qu'il a faim. - (19) |
| meugni : vache beuglant légèrement - (34) |
| meugni : vache beuglant légèrement pour appeler son veau - (43) |
| meûgni v. Meugler doucement. - (63) |
| meugnier, faire le simulacre de mastiquer. - (27) |
| meugnon : museau. A - B - (41) |
| meugnon (n.m.) : museau, groin (pour de Chambure : meugneau) - (50) |
| meûgnon : (nm) museau - (35) |
| meugnon : museau - (34) |
| meûgnon n.m. Mufle, museau, visage d'enfant. - (63) |
| meugnon, bafeunion : museau - (43) |
| meugnon. Museau. - (49) |
| meûgnotte : petite main - (37) |
| meugres, hièbles. - (05) |
| meuguet (n.m.) : muguet - (50) |
| meuguet, s. m. muguet. - (08) |
| meûguet, s. m., muguet. - (14) |
| meuhaigne : musaraigne. IV, p. 33 - (23) |
| meuillant. Clientèle d'un meunier. - (03) |
| meuillenot, s. m., linge dans lequel on lace un nouveau-né. - (14) |
| meuilli, adj. moisi. - (38) |
| meuillin, tiersseule : tiercelet - (43) |
| meujâ. s. m. Museau. (Ménades). - (10) |
| meûjate. s. f. Mulot, rat des champs. (Sormery). - (10) |
| meûji : Moisi. « Man pansan a in gout de meûji » : mon tonneau a un goût de moisi. - (19) |
| meûji v. Moisir. - (63) |
| meul : mulet - (43) |
| meulaide (m'laide) : malade - (39) |
| meulaidie : maladie - (39) |
| Meûlati (re) : (nm.f) habitant (e) de Meulin - (35) |
| meûle (n.f.) : tas de foin - (50) |
| meule : Moule. « In meule de beu » : un moule de bois, cube de 1m33 de côté. - « In meule de boudin » : un petit entonnoir dont on se sert pour la confection du boudin. Au figuré : « Monter le meule au gueurné (au grenier) », se dit d'un ménage qui ne veut plus avoir d'enfants.- Mule. « Alle est têtue c'ment eune meule ». - (19) |
| meûlé : tondu à ras - (37) |
| meulé(re) : meunier(ère) - (39) |
| meûlé, et meûnei, s. m., meunier. - (14) |
| meule, s. m. amas, tas; « mettre en meule », c'est mettre en tas. - (08) |
| meulé, s. m. meunier. - (08) |
| meûler (-ère) (n.m. et f.) : meunier, méunière - (50) |
| meuler : il fait très froid - (44) |
| meuler : saler avec excès - (39) |
| meules (das) (loc.) : beaucoup - (50) |
| meûles (dâs) : (des) tas, (des) rassemblements, (un) grand nombre - (37) |
| meuleur (mola), meunier, meulé. - (04) |
| meulière : molaire. - (32) |
| meulin (on) : moulin - (57) |
| meulin : moulin - (43) |
| meulin : moulin - (51) |
| meûlin n.m. Moulin. - (63) |
| meulin, sm. moulin. - (17) |
| meuling (n.m.) : moulin - (50) |
| meuling : moulin - (39) |
| meulner, v, écraser. - (38) |
| meulon, s. m. petite meule de foin, de paille, etc. - (08) |
| meulot (e) : mulot (bovin hyper-conformé) - (51) |
| meulot : Mulet. « Ol est chargi c'ment in meulot ». - (19) |
| meulouère, s. f., provision de fruits, cachés par les gardiens de vaches. - (40) |
| meultchiau : muselière - (39) |
| meun, meune, adj. poss. mien, mienne ; « teun, teune » = tien, tienne ; « seun, seune » = sien, sienne. - (08) |
| meune (le, lai), meunes (les) : mien (le), mienne (la), miens (les), miennes (les) - (48) |
| meûnè : faire la moue - (46) |
| meûné, meunére : meunier, meunière - (48) |
| meune. Mène, mènes, mènent. - (01) |
| meune-cul n. Personne autoritaire. - (63) |
| meune-gueule n. Vantard, fanfaron. - (63) |
| meune-meune n. Désigne une personne hyper-active. Syn. boudzon. - (63) |
| meuner, v. a. mener, conduire. indic. présent : i meune, teu meune, a meune ; i m'non, vô m'né, a m'nan. — infin. meuner et m'ner. (voir mouner.) - (08) |
| meunevais - petit paquet ou grosse poignée de tiges de chanvre. - I ai bein tirai ine cinquantaingne de menevais ai ce maitin. - Lai mère Bochot fait ses meunevais trop gros. - (18) |
| meunevö, sm. menneveau, petite gerbe, en part., menu paquet de chanvre non tillé. - (17) |
| meûni : (nm) meunier - (35) |
| meunier, n.m. poisson, principalement la lotte. - (65) |
| meunier. Gros hanneton paraissant couvert de farine. Ce mot est aussi employé dans le Mâconnais. - (49) |
| meunotte : n. f. Flûte enfantine. - (53) |
| meun'tré. s. m. Ménétrier. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| meuon, mûon (pour mûron). s. m. Mûre sauvage. - (10) |
| meuplat. Sur le plat. Ex. « nous v'là arrivés su le meuplat ». - (49) |
| meûplier : Nêflier, mespilus germanica. « Eune varlope en meûplier » une varlope en bois de néflier. - (19) |
| meûp'lle : Nêfle. « Les meûp'lles sant causu meures (presque mûres) ». - (19) |
| meuqué (se), vr. se moquer. - (17) |
| meuquou, (oū), adj. moqueur, euse. - (17) |
| meur (-e), mû (-e) (adj.m. ou f.) : mûr (-e) - (50) |
| meur : mur - (43) |
| meur n.m. Mur. - (63) |
| meùr, adj., mûr : « Catli'rine, faut miger c'te pouére; alle é meùrte. » - (14) |
| meur, e, adj. mûr, en point de maturité. - (08) |
| meûr, meûrte adj. Mûr, mûre. - (63) |
| meûr, mûr ; meûri, mûrir ; lë ràzin meûrissan, les raisins mûrissent. - (16) |
| meur. adj. Mûr. Les râsins sont ben meurs. (Joigny). - (10) |
| meura : s. m. tertre, petit tas (de terre ou de pierre) sur le bord du chemin. - (21) |
| meûraijon n.f. Maturation. - (63) |
| meuraîlle n.f. Muraille. - (63) |
| meuraille, s.f. mur, muraille, en bonne comme en mauvaise part. - (38) |
| meuraisso (nom masculin) : mur de pierres sèches. - (47) |
| meuraissô, s. m. mur à sec, mur où l'on n'emploie pas de mortier. On a réuni en un seul ainsi prononcé les trois mots meur (mur) ai (à) sô (sec) . - (08) |
| meurcelons, s. m. plur. groupe de petits marchands ambulants. - (08) |
| meurcelot, romanichel - (36) |
| meurdeûre : Morsure, piqûre. « Des meurdeûres de puges » : des piqûres de puces. - (19) |
| meurdre, niaquer : mordre - (43) |
| meurdzi : gros tas de pierres, éboulis de roches. A - B - (41) |
| meurdzi : (nm) mur de séparation entre deux lopins de terres - (35) |
| meurdzi : gros tas de pierres, éboulis de roches - (34) |
| meurdzi : gros tas de pierres, éboulis de roches, mur délimitant les propriétés - (43) |
| meurdzi n.m. (de murger) Tas de pierres retirées des champs. - (63) |
| meûre (adj) : mûre. À maturité. - (62) |
| meûre (d'la) : saumure - (57) |
| meûre : mûr - (48) |
| meure : s . f. saumure. - (21) |
| meûré : sale (très) - (57) |
| meurè : salé (trop) - (48) |
| meûre : saumure. - (62) |
| meûré : exp. Trop assaisonner, trop saler. - (53) |
| meuré, adj. trop salé ; de la meure, de la saumure. - (38) |
| meuré, adj. trop salé, parfois aussi trop sucré ! - (65) |
| meûré, adj., trop salé, trop sucré. - (40) |
| meuré, adjectif qualificatif : sucré ou salé à l'extrême. - (54) |
| meure, anciennement muyre. Eau salée qu'on retire des puits de Salins. Tai soupe ast sailée quemant de lai meure. En français : saumure. Certaines abbayes et même certains particuliers de la Bourgogne touchaient annuellement des buillons de muyre. - (13) |
| meuré, meurené, adj. salé avec excès, très salé. - (08) |
| meure, muire, saumure. - (05) |
| meûre, s. f., mûre, fruit du mûrier et de la ronce : « Y fait biau l’long des foussés ; vons-jou cuÿer des meûres ? » - (14) |
| meûre, s. f., saumure. - (14) |
| meûre, saumure dans laquelle trempe le lard. - (16) |
| meure, v. n. mourir : « a vé meure », il va mourir. - (08) |
| meuré. Mourez. - (01) |
| meure. Saumure, du latin muria. - (03) |
| meurée - haie vive. – Lai meurée â percée dan deû endroits ; les bétes pourraint y passai. - I nos sons mis ai l'aivri derré lai meurée. - Des grands âbres dan ine méurée, ci fait bein. - (18) |
| meurée, s. f. provision de fruits cueillis prématurément et conservés pour mûrir. - (08) |
| meùrei, s. m., mûrier. - (14) |
| meureille : Mur, muraille. « Ol a sauté pardessus la meureille ». - (19) |
| meureille : s. f. mur. - (21) |
| meureille, s. f. muraille : « daré lai meureille » , derrière le mur. « muheille. » - (08) |
| meureilli : Verbe. Construire grossièrement, en pierre sèche. - (19) |
| meureire. Coffre rempli de bouffe et de menues pailles, dans lequel on faisait mûrir les fruits d'hiver. Par extension, provision de pommes, de nèfles, de poires, de noix... et même provision d'argent. Quand ton parrain serai mort, ç'ast toi qu'hériterai de sai meureire. - (13) |
| meurer (v.t.) : saler avec excès - (50) |
| meûrer : Mûrir. « I vaut mieux bien laichi meûrer les raijins que de vandangi treu d'houre » : il vaut mieux laisser bien mûrir les raisins que de vendanger trop tôt. - (19) |
| meurer : saler exagérément. - (56) |
| meurer, v. a. saler avec excès. on dit d'un mets trop salé ou trop épicé, qu'il est « meure. » - (08) |
| meûrer, v. intr., mûrir : « Y aura pas gros d'vin c't'an-née ; les raïins n'meûront pas. » - (14) |
| meurer, v. mûrir. - (38) |
| meûrer, v. mûrir. - (65) |
| meurer. Mûrir, vieux mot. Nous disons meur pour mûr, comme autrefois. - (03) |
| meuret n.m. Muret. - (63) |
| meûréte (flairer la), loc., chercher à découvrir quelque chose, et aussi tâcher de se faire inviter à diner : « Qué qu'te vouròs ben savouér, que t’veins c’ment c’qui flairer la meûréte » C'est l'analogue de : tourner autour du pot, tâter le terrain. - (14) |
| meurète se dit des oeufs, des poissons cuits dans une sauce où le vin domine. - (16) |
| meûréte, s. f., préparation de poissons assaisonnés au vin rouge. - (14) |
| meùrette (C.-d., Chal., Br.), morette (Morv.). - Sorte de matelote de carpes… - (15) |
| meurette : Matelotte au vin rouge. « Eune carpe en meurette ». - (19) |
| meurette : sauce au vin - (51) |
| meûrette : sauce au vin rouge - (37) |
| meurette, étuvée de poisson. - (05) |
| meurette, s. f. poisson cuit à l'étuvée, marinade. - (08) |
| meurette, s. f., sauce au vin rouge. - (40) |
| meurette, subst. féminin : sauce au vin, matelotte. - (54) |
| meurette. Manière d'accommoder le poisson au vin. - (03) |
| meurette. Matelote. - (49) |
| meurette. Plat de poisson national qui se rapproche assez de la matelotte, et se fait surtout avec un mélange de carpe et de brochet, mais ou la carpe entre pour la plus grande part. -Etym. le patois meure, mure, qui veut dire saumure, eau salée, qui a fait le latin muria, même sens ; meurette existait dans le vieux français. - (12) |
| meureûre : Pierre à bâtir. « Ol est allé charchi eune voiure de meureûres dans la parraire de la Breuche » : il est allé chercher une voiture de pierres à bâtir dans la carrière de la Breuche. - (19) |
| meurgé - tas considérable de pierres dans les champs. - Le meurgé dans note champ des Luas geingne bein pou laiborai. - I ons des meurgés qu'en dit c'â des ruines de mâillons. - (18) |
| meurgé : tas de pierres (souvent retirées d'un champ et déposées en limite) - (48) |
| meurgé, meurgey, murger (C.-d., Morv., Chal.).- Tas de pierres qu'on trouve au milieu des champs et des vignes, ayant parfois de grandes dimensions et se composant en général de toutes les pierrailles arrachées ou retirées de la terre par les cultivateurs, qui s'en débarrassent ainsi dans un coin improductif, n'ayant pas de décharge à proximité où ils puissent les transporter… - (15) |
| meurgé, murger, petite muraille à sec. - (16) |
| meurgé, s. m. tas de pierres en général. « meurzé. » - (08) |
| meurgeai, meurgeaille,s.m. tas de pierres dans les vignes ; du latin Mercurius ; ces murgers étaient dans l'antiquité consacrés à Mercure. - (38) |
| meurgeaille, s. f., petit amoncellement de pierres. - (40) |
| meurgeaille, s.f. margelle de puits. - (38) |
| meurgealle, s. f. margelle de puits. - (08) |
| meurgei et murgei. : (Pat. et dial. ), monceaux provenant d'épierrements et formant comme un mur. Murus jactus, mur jeté, ne traduit-il point cet amoncellement produit par le jet successif des pierres. - (06) |
| meurgei ou murgei, monceaux faits quand on épierre un champ... - (02) |
| meurger : amas de petites pierres. - (09) |
| meurger et murger. On devrait peut-être écrire murjet. C'est une sorte de rempart, de mur à sec, sur lequel on jette les pierres des vignes ou des champs. Ce mot est aussi usité dans le Morvan : un écrivain de Château-Chinon fait venir « meurger » de mercurii agger et le consacre au protecteur des chemins et du commerce. - (13) |
| meurger : (mœrjé - subst. m.) tas de pierres tirées du sol et, en général, jetées sur le rouèyon entre deux propriétaires. - (45) |
| meurger, murger. Tas de grosses pierres empilées dans les champs. Ce mot est commun avec plusieurs régions voisines. - (49) |
| meurger, s. m., gros tas de cailloux organisé. - (40) |
| meurgi : Murger, tas de cailloux. - (19) |
| meurgi : s. m. petit mur de pierres sèches. - (21) |
| meurgi, s. m. murger, gros tas de pierres accumulées. - (22) |
| meurgi, s. m. murger, gros tas de pierres accumulées. - (24) |
| meuri (v.t.) : devenir mûr - (50) |
| meûri : (vb) murir - (35) |
| meuri : mourir - (43) |
| meuri : mourir - (51) |
| meuri : mourir - (57) |
| meuri : mourir - (48) |
| meuri : Mourir. « O s'est laichi meuri » : il s'est laissé mourir. - (19) |
| meûri : mûr - (37) |
| meuri ou par abréviation m'ri, meûrot – divers temps du verbe mourir. - II faut tenir compte de l'accent circonflexe, car le même mot se prononce tantôt long, tantôt bref. - I croi qu'a vai meuri lai neu. - Ile meûrot lai heu qui n'en serâ pas surpris. - Ne traiveille don pâ tant, te t'en fairé portant m'ri. - Ce petiot lai meûré beintôt. - (18) |
| meuri v. Mourir. - (63) |
| meuri, mourir. - (26) |
| meuri, v. mourir. - (38) |
| meuri, v. n. devenir mûr. - (08) |
| meuri, v. n. mourir, cesser de vivre. - (08) |
| meuri, v. n. mourir. - (22) |
| meuri, v. n. mourir. - (24) |
| meuri, v., mourir. - (40) |
| meuri, vn. mourir. - (17) |
| meuri. Mourir ; c'est aussi je mourus, tu mourus, il mourut. - (01) |
| meurier. n. m. - Monticule de pierres à l'extrémité d'un champ ; ces pierres ont été déposées par les paysans au long des siècles, afin d'en débarrasser les terres. - (42) |
| meurjouir. v. n. Commencer à mûrir. (Soucy). – Voyez marjouir. - (10) |
| Meurjuru : Nom de lieu, Meurjuru est un endroit où il existe un grand nombre de « meurgis ». - (19) |
| meurlin (on) : merlin - (57) |
| meurmau, s. m., raisin de grappillage, mal mûri. - (40) |
| meurmau, s.m. "mûre-mal" ; raisin qui mûrit après les vendanges ; on va grappiller les "meure-mau". - (38) |
| meurnè : (meu:rnè - adj.) trop salé, à l' image de la saumure ; sô:meu:r' est une sorte de pléonasme puisque sau vient de sai "sel" et mure de muria "saumure". On peut entendre dire lè soupe ô: meuré: sèlé. - (45) |
| meuro : perron couvert auquel on accède par un escalier. (RDB. T III) - S&L - (25) |
| meurô : s. m. mur. - (21) |
| meûrôle : Tas de fruits qu'on a mis dans un coin pour les laisser mûrir. « Eune bonne meûrôle de pommes beures (grises) ». - (19) |
| meûron : (nm) mûre - (35) |
| meuron : mûre - (51) |
| meûron n.m. Mûre sauvage. - (63) |
| meuron, moure : n. f. Mûre. - (53) |
| meuron, mouron : mûre - (43) |
| meuron, muron, mouron. Fruit de la ronce. - (49) |
| meûron, s. m., mûre sauvage : « Ol a migé des meûrons en s'preùm'naut ; ôl en a la bouche toute gafouillèe. » - (14) |
| meuron, subst. masculin : mûre. - (54) |
| meurot (on) : monticule - (57) |
| meurot : Mur bas qui borde l'égalerie. Voir égalerie. - (19) |
| meurot : voir murat. - (20) |
| meurot, mûrot, élévation du sol. - (05) |
| meurot, s. m., mûr bordant le balcon des maisons vigneronnes. - (40) |
| meurot, s.m. terrasse de pierre devant l'entrée d'une maison de vigneron à laquelle on accède par un escalier en pierre de taille. - (38) |
| meurot: palier d'entrée sur galerie. (MLB. T II) - S&L - (25) |
| meûrré : ivre mort - (37) |
| meûrré : saturé (trop sucré, trop salé) - (37) |
| meûrri : mourir - (37) |
| meûrri, callanché : v. i. Mourir. - (53) |
| meurrier. s. m. Tas de menues pierres dans les champs. – Voyez merger. - (10) |
| meurrons : mures - (44) |
| meûrs (lâs) : (les) murs - (37) |
| meursange, s. m., saule marsault. - (40) |
| meurselon (Mhère), meursillon (Brassy) : bohémien. Synonyme : pacant. - (52) |
| meurte : morte - (43) |
| meurte, adj., mûr, à point. - (40) |
| meurti : Meurtrir. « Sang meurti » : ecchymose. « Pa tiri le sang meurti y a ren pâra qu'eun empliâtre de pain mâchi » : contre les ecchymoses il n'y a pas de meilleur remède qu'un emplâtre de pain mâché. - (19) |
| meurveuille n.f. Merveille. - (63) |
| meurzeille, s. f. masure. - (08) |
| meurzére, s. f. amas de pierres. - (08) |
| meuscat : Muscat. « In raijin meuscat » « In chot de meuscats » : un cep de vigne muscate. - (19) |
| meuse, adj. sans corne, à propos de la chèvre. - (65) |
| meuse, s. f. moue : faire la meuse. - (22) |
| meuse, s. f. moue : faire la meuse. - (24) |
| meuse. s. f. Mûre, fruit de la ronce ou mûrier. (Saint-Bris). - (10) |
| meusetiau (n.m.) : muselière pour les veaux et les bœufs - (50) |
| meusette (n.f.) : musette - (50) |
| meusi - moisi, réfrillé. - Note pain â meusi en n'en fauré pâ fâre tant ine aute fouai. - Te nos sers du fremaige qu'â meusi. - En fait bein froid, en é l'air tot meusi. - Pour ce sens, voyez Raimeusi. - (18) |
| meusi : moisi - (43) |
| meusi : moisir - (57) |
| meusi, adj. moisi. - (22) |
| meusi, adj. moisi. - (24) |
| meusi, vn. moisir. - (17) |
| meusi. Transi, pénétré de froid ; aspect de la personne qui a froid. Etym. meusi en patois bourguignon veut dire moisi ; c'est le même mot appliqué à une chose qui a perdu de ses qualités et de son aspect, non par la moisissure, mais par le froid. - (12) |
| meûsiau, s. m., museau, laide figure. - (14) |
| meusiqhi', s. f. musique, son d'un instrument et, par extension, l'instrument lui-même. - (08) |
| meùsique, s. f., nmsique, tout son plus ou moins discordant. - (14) |
| meùsir, v. intr., moisir. - (14) |
| meusir. v. n. Mourir ; par conversion de l'o en e et de l'r en s. (Fleys). - (10) |
| meusissure (na) : moisissure - (57) |
| meusissure, sf. moisissure. - (17) |
| meusque : Couleur puce. « Alle a vêti san c'eutillan à ras meusques » : elle a mis son cotillon à rayures puce. - (19) |
| meus'rè, se meus'rè : v. t. Mesurer, v. pr. se mesurer. - (53) |
| meussai (se) - s'humilier, être honteux, timide. - C'â li é étai d'ine bonne éleçon ; en feillot voué quemant qu'a a se meussot. - Depeu celai al â tot meusse. - Pore gairson, â n'é pu qu'ai se meussai. - (18) |
| meussai (se), se coucher, se taire... - (02) |
| meussai. Cacher : « Se meussa »i, se cacher, du latin mussare, parler entre ses dents, à basse voix, et même se taire, parce que ceux qui se meussent n'osent parler de peur d'être découverts. - (01) |
| meussai. : Se taire et aussi se cacher. Le verbe latin mussare a ce dernier sens dans Plaute (Quich.), d'où le solô meussan signifie le soleil couchant. - Meusse signifie silencieux et, par extension, triste, chagrin. Qu'a çu que t' ié don, t'a l'air meusse. (Del.) - (06) |
| meusse (adj.m. ou f.) : honteux (-euse), penaud (-e), triste - (50) |
| meûsse (ât’e) : (être) bête - (37) |
| meusse (pour mousse). adj. Honteux, confus, interdit, désappointe. (Annaysur-Serein). - (10) |
| meussé (se), vr. [mucer]. se cacher (avec une idée de honte), baisser la tête, s'humilier. - (17) |
| meusse : décontenancé. (RDM. T II) - B - (25) |
| meusse : penaud. - (31) |
| meusse : penaud. (C. T III) - B - (25) |
| meusse : triste. Ol o tou meusse : il est tout triste. - (33) |
| meusse : 1 adj. Penaud. - 2 adj. Triste. - (53) |
| meussé : 1 v. pr. Se blottir. - 2 v. t. Épargner. - 3 adj. Recroquevillé. - (53) |
| meusse, adj. [mousse]. sans cornes : se dit des moutons. - (17) |
| meusse, adj. abattu, fatigué. - (38) |
| meusse, adj. des deux genres. honteux, confus, penaud, triste. - (08) |
| meùsse, adj., déconfit, penaud, décontenancé, mortifié, attrapé, boudeur : « Quand aile a vu c'qu'alle avôt fait, ah ! voui, qu'alle a été meùsse ! » — « O veint d'casser son biau vâre ; ôl en é cor tout meùsse. » - (14) |
| meusse, s'meussé, se disent d'un enfant qu'on a repris et qui garde le silence, en se cachant. - (16) |
| meussé, tapi. - (26) |
| meusse. Aplati, affaissé, sans force et sans énergie. Etym. le patois se meussai, qui n'est autre que le français se musser, mais qui ne veut pas rien que dire se cacher, comme celui-ci, il signifie encore s'effacer, se coucher, se faire petit au physique et au moral. - (12) |
| meusse. Honteux, pris en faute. Du vieux verbe se musser, se cacher. On dit encore dans les environs de Beaune : ce lieuvre s'ast emeussé... - (13) |
| meusser (se) : se blottir. (G. T II) - D - (25) |
| meusser (se) : se dit d'une personne qui se tapit ou se renfrogne. - (66) |
| meusser (se), triste, maussade - (36) |
| meùsser (se), v. réfl., se taire, se cacher, se coucher. - (14) |
| meusser (se), v., se cacher. - (40) |
| meusser, v. a. musser, cacher, écarter, dissimuler. - (08) |
| meussé-vo dan queique carrenô, cachez-vous dans quel que petit coin. - (02) |
| meussion (on) : moucheron - (57) |
| meusso. Jaunâtre. Origine inconnue ; l'expression triviale « être meusse », pour être confus, doit être congénère, et a du rapport avec cette autre, rire jaune. - (03) |
| meussœ, adj. qui a une pointe courte, trapue, émoussée. - (22) |
| meussot (-otte) (adj.m. ou f . ) : diminutif de musse : miteux (-euse), confus (-e), silencieux (-euse), triste - (50) |
| meussot : capon. (RDR. T III) - A - (25) |
| meussot, otte, adj. dimin. de «meusse» pour musse. honteux, confus, embarrassé, triste, silencieux. - (08) |
| meustaie. s. f. Muselière pour les chiens. (Guillon). - (10) |
| meustê : (meu:ztê: - subst. f.) muselière garnie de pointes pour dissuader les vaches de se laisser téter par des veaux sevrés. Par métonymie, museau. - (45) |
| meutadje, sf. moutarde. - (17) |
| meute, motte. - (16) |
| meuter. v. n. Se dit d'un curieux, d'un indiscret, qui, introduit dans un appartement, passe en revue, palpe et semble inventorier tout ce qui s'y trouve. - (10) |
| meûto : pas très ouvert, peu communicatif, qui parle peu - (46) |
| meuton, monton, sm. mouton. - (17) |
| meuton, mouton. - (16) |
| meuton, mouton. - (26) |
| meutraie : objet très gros - (48) |
| meutrè : très gros - (48) |
| meutré, s. m. meurtrier, piège à rats qui les assomment par la chute d'un poids. - (08) |
| meutréyer, v. a. meurtrir, blesser. - (08) |
| meutro. Élévation de terre. - (03) |
| meûye'rouze : (nf) chiendent - (35) |
| meu-yir, v. moisir. - (40) |
| meuz'aille : nourriture - (39) |
| meuzer (m'zer) : manger - (39) |
| meuzeure : mesure, double décalitre - (48) |
| meûzi : (p.passé) moisi - (35) |
| meûzi, moisi. - (16) |
| meuzias et mézeaux. Ladres et lépreux. La léproserie de Beaune était souvent appelée « maladrerie ez mezeaux. » Il était interdit aux lépreux de boire aux puits et aux fontaines publiques. On leur désignait de petites sources : le village de Bouze avait la fontaine des Laidres, et celui de Chorey, la fontaine des Meuziâs. - (13) |
| meuz'rer : mesurer - (48) |
| meuz'taie : muselière en grillage pour empêcher les veaux de lait de manger - (48) |
| mévaillue, s. f. diminution de valeur, dépréciation. - (08) |
| mèye, instrument pour cultiver la vigne. - (16) |
| meye. : (Dial.), pron. meie, dérivant de medicus comme mire, qui a le même sens, dérive de medicarius. - (06) |
| mêyer : néflier - (60) |
| meyeu, miyeu. n. m. - Milieu. - (42) |
| méyre (f) : saumure dans laquelle le lard est salé. (CST. T II) - D - (25) |
| mezer, m'zer (v.t.) : manger - (50) |
| mézienne, mariennée, mériennée. n. f. - Sieste. - (42) |
| mézizi, adj. malingre : un petit garçon méfiai (du vieux français mésaisé). - (24) |
| mézizi, adj. malingre. - (22) |
| mézu, s. m. mauvais usage, abus, et par extension, dommage : « aller en mézu », aller en dommage. - (08) |
| mezuer (v.t.) : mesurer (aussi m’zuer) - (50) |
| mézuzer, gaspiller. - (26) |
| m'geai : manger. On passe à table pou m'geai : on passe à table pour manger. - (33) |
| mî (du) : miel - (57) |
| mi : (nm) miel - (35) |
| mi : miel - (51) |
| mî n.m. Miel. - (63) |
| mi, my (pr.pers. 1ère pers.s.) : moi, me - (50) |
| mi, my, pron. moi, me, mes. - (08) |
| mi, s. m. miel. - (22) |
| mi, s. m. miel. - (24) |
| mi. Nom donné aux mineurs du nord de la France évacués chez nous pendant la guerre de l9l4. Ils furent ainsi nommés parce qu'ils prononçaient « mi » pour moi. - (49) |
| mi. : Apocope de midi. (En latin medium diei.) Les vignerons disaient: el a mi, nôtre ovreire a dressai la sôpe, c'est-à-dire : il est midi, notre femme a préparé la soupe. - (06) |
| mia : douillet. A - B - (41) |
| mia (nom masculin) : clafoutis. - (47) |
| mia : douillet - (34) |
| mia : douillet - (44) |
| miâ adj. (onom.). Douillet. Ôl est don miâ ! Qu’il est donc douillet ! - (63) |
| miâ. n. m. - Sorte de grand clafoutis, avec des petites merises noires. (F.P. Chapat, p.136) - (42) |
| miaile. Merle. - (03) |
| miâle : un merle - (46) |
| miale, sm. merle. - (17) |
| miâler (miâner) : miauler - (39) |
| mialer (verbe) : miauler. On dit aussi mianer. - (47) |
| miâler : miauler - (37) |
| mialer : miauler - (43) |
| miâler : Miauler. « Euvre dan (ouvre donc) le chat que miâle à la porte ». - (19) |
| miâler, verbe intransitif : parler d'un ton geignard, se plaindre. - (54) |
| miàlet, s. m., homme de petite stature. - (14) |
| mialle (fém), merle. - (27) |
| mialle, merle. - (26) |
| miâlou : celui qui imite le cri du chat - (37) |
| Miance : quête de mai. VI, p. 38 - (23) |
| miance, s. f. collation champêtre, repas sur l’herbe que les habitants de quelques localités faisaient en partie de plaisir le 1er mai. - (08) |
| miançon (n.f.) : gesse tubéreuse - (50) |
| miançon, s. m. gesse tubéreuse appelée aussi vulgairement anottes, boulue, saignes. Les tubercules sont très recherchés des porcs et des sangliers. elle est assez commune dans les terrains argileux. - (08) |
| miâner (v.t.) : miauler - (50) |
| miâner : miauler - (48) |
| miâner, v. n. miauler, faire des miaulements comme le chat. En quelques lieux « miâler. » - (08) |
| mianer. Miauler. Onomatopée aussi. On a dit miauder. - (03) |
| mianer. v. n. Miauler. (Avallonnais). - (10) |
| miânou (miâlou) : se dit d'un chat qui miaule sans cesse - (39) |
| miânou, ouse, s. m. et féminin miauleur, celui qui miaule. se dit du chat par antonomase. - (08) |
| miarle : merle - (37) |
| miarle : merle. - (29) |
| miarle : Merle. « O sub'lle c 'ment in miarle » :il siffle comme un merle. - « Pose tan miârle » cesse de siffler. - (19) |
| miarle : merle. « Suÿe beau miarle !» : siffle beau merle ! - (62) |
| miarle : un merle. - (56) |
| miarle : merle - (39) |
| miarle : n. m. Merle. - (53) |
| miarle, merle (miarle). - (05) |
| miarle, merle. - (16) |
| miârle, s. m., merle. - (40) |
| miarle, s.m, merle. - (38) |
| miarle. Merle. - (49) |
| miasse. n. f. - Mélasse. - (42) |
| miasse. s. f. Mélasse. - (10) |
| miatanner : mâchonner, remâcher. - (30) |
| miatte, miotte (n.f.) : miette - (50) |
| miau - miot : miette. Ex : "La Joséphine, al a tout ramassé, même les miaux". - (58) |
| miau (on) : tas - (57) |
| miau : (nm) tas de foin - (35) |
| miau : tas de foin dans la prairie, en fin de séchage - (34) |
| miau : tas de foin. - (30) |
| miau n.m. (du lat. metam, meule de foin). Gros tas de fourrage en plein champ. Ne pas confondre avec comiau, tas de céréales. - (63) |
| miau, fortsé : tas de foin dans la prairie, en fin de séchage - (43) |
| miau, meulot. Petite meule de foin, d'herbe : moyette. - (49) |
| miau, s. m. amande des noisettes et des noyaux en général. - (08) |
| miau, s. m. tas : un miau de pierres. - (24) |
| miau, s. m. tas : un miau de pierres. - (22) |
| miaulée. n. f. - Résidu liquide du miel. Se dit également pour tout liquide épais et très sucré. - (42) |
| miaulou : se dit d'un chat ou d'une personne qui miaule - (46) |
| miauner, et miâler, v. intr., miauler : « C'matou ét enniuant ; ô n'fait qu' miauner. » - (14) |
| miaunoû, adj., miauleur. Se dit d'un chat, ou d’un qui imite le chat. - (14) |
| miaux (n. m. pl.) : petits morceaux, débris - (64) |
| miaux : petits débris - (61) |
| miaux. n. m. pl. - Débris de paille que l'on récupérait sous la presse à battage. - (42) |
| mîcer (v.) : mincer, mettre en petits morceaux - (50) |
| micer : émincer - (48) |
| micer, v. a. mincer, réduire en petits morceaux, en miettes. - (08) |
| michaicun, pron. distrib. chacun, « tô michaicun », chacun de son côté, chacun à part. - (08) |
| michament, adv. méchamment. se dit pour un peu, passablement, petitement. S'il m'aidait « michament » j'en viendrais à bout ; « michament » qu'il travaille, il pourra vivre ; comment vous portez-vous ? « michament. » - (08) |
| michan, adj. méchant, de peu de valeur, misérable. le « michan », le méchant, le diable. - (08) |
| miche (Manger de la). Locution ironique usitée dans la Puysaie, et qui signifie plaider, être en procès. – Jaubert donne manger de la mie, dans le même sens. - (10) |
| miche ou mèche à la chieuve. n. f. - Viorne. - (42) |
| miche : adj.. se dit des raves, radis et autres légumes semblables, quand ils deviennent creux. Marie vous n'achèterez plus de petites raves ; elles sont toutes miches maintenant. - (20) |
| Miché, Michel, nom d'homme. - (08) |
| miche, michotte. Pain rond et plein qui a beaucoup de mie, mica, par opposition aux couronnes, flûtes et croissants, qui n'ont que de la croûte... - (13) |
| miche, pain blanc de froment. - (05) |
| miche, s. f. pain de froment ou de seigle fait avec la fleur de la farine, en général le meilleur pain. On prononce «mice» dans une grande partie du Morvan - (08) |
| miche-à-la-chieuvre. s. f. Mancienne, plante, espèce de viorne. (Perreuse). - (10) |
| michéte (faire), loc., caresser la figure avec les mains. On dit aux enfants : « Allons, ma p'tiote, fais-me michéte. » - (14) |
| micheterme, adj. mi-terme. Se dit d'une vache pleine depuis trois ou quatre mois, qui est à la moitié du temps de la gestation. - (08) |
| michotte : mot féminin désignant un grain de maïs éclaté (le pop corn) - (46) |
| michotte. n. f. - Petite miche de pain. - (42) |
| michotte. Petite miche. - (12) |
| michotte. s. f. Petit pain rond. (Perreuse). - (10) |
| michoux : Creux. « Des radis michoux ». - (19) |
| michu. s. m. Mouchoir. (St-Valérien). - (10) |
| micionner, v. a. mincer très menu, réduire en petites parcelles. - (08) |
| mic-mac. (Voir maulin-maulô.) - (02) |
| midale : Médaille. « Alle a eune brave midale » : elle a une belle méaille. - (19) |
| midi n.m. Angelus de midi. Vlà l'midi qu'soûne ! - (63) |
| midi : s. m., angélus de midi. V’là l’midi qu’ sonne. - (20) |
| midiette : nom donné aux vaches tachetées. - (21) |
| midre. s. f. et midré. s. m. Objet sur lequel sont déposées les pièces de monnaie ou enjeux des joueurs. (Etivey). - (10) |
| midret (Grand). s. m. Niais, nigaud, fainéant. (Percey). - (10) |
| mie - placée, mise. - Il s'â mie to pré de lu. - A les an mies tote deux vé lai porte. - (18) |
| mié (n.m.) : miel - (50) |
| mie : miel - (43) |
| mié : miel - (48) |
| mié : Miel. « Eune reutie de mié » : une tartine de miel. « Eune môche à mié » : une abeille. - (19) |
| mie n.f. Jeune enfant. - (63) |
| mie, miel. - (05) |
| mié, s. m. miel : « a n'ié pâ d' mié dan l' reuchon «, il n'y pas de miel dans la ruche. - (08) |
| miée : miel. Les abeilles font le miée : les abeilles font le miel. - (33) |
| miée – Miel. - C't-année en y é bein des flieurs, en y airé bein du miée. - Ine moche ai miée m'é piquai. - (18) |
| miée : miel - (39) |
| miéé : n. m. Miel. - (53) |
| mienne, adj. mien. « le mienne, le tienne, le sienne », pour le mien, le tien, le sien. - (08) |
| mier. : Miel, comme cier pour ciel, comme aivocar pour avocat, opérar pour opéra, etc. – Les Bourguignons repoussaient les consonnes molles de la fin des mots pour leur en substituer de dures. - Miellée ou mignée sont aussi du patois, pour exprimer quelque mélange où il entre du miel. - (06) |
| mierle (n.m.) : merle - (50) |
| mierle : merle - (48) |
| mierle, s. f. merle. « miarle. » - (08) |
| mierlet, s. m. merleau, jeune merle. - (08) |
| mièshe : brioche commune. - (62) |
| miétasse, mélasse, résidu du sucre raffiné. - (16) |
| miéte (eùne), adv. de quantité, un peu : « Te n' m'ain mes pas tant s'ment eùne miéie. » (V. eùne idée.) - (14) |
| mieul : miel. - (29) |
| mieuler, v. n. aller mieux, être en meilleur état, en meilleure situation de fortune ou de santé. - (08) |
| mieus : mieux - (57) |
| mieusse, adj., fatigué, usé. - (40) |
| mieute : miette de pain. - (66) |
| mieuton, sm. miette, petit morceau. - (17) |
| mieutte, miette. - (26) |
| miez. s. m. Miel. C'est un des mots romans dont l'usage s'est perpétué dans les campagnes. - (10) |
| mîgé : v. t. Manger. - (53) |
| mige. s. f. Moitié d'une chose. Roquefort donne miey, miex, mige, qui est au milieu, à moitié, à demi du latin médium. - (10) |
| mi-genne : voir pressoir. - (20) |
| migeotai, faire bouillir à petit feu. Au figuré, il signifie aussi caresser, dorloter. - (02) |
| migeou, -ouse, mangeur, -euse. - (38) |
| miger (v.) : manger - aussi mijer, m'zer - (50) |
| miger, v. ; manger. - (07) |
| miger, v. manger. - (38) |
| miger, v., manger. - (40) |
| migî : manger, dissiper. «Ô migero la cape à Dieu’ » : il est dépensier, sans ordre, prêt à tout dilapider. - (62) |
| Migieu. De Migieu, nom du président au parlement de Bourgogne, appelé dans la chanson Demidieu, à cause de son bon vin de Savigny… - (01) |
| miglon (n. m.) : grumeau (syn. guermillon) - (64) |
| miglons. n. m. pl. - Pampilles, barbichettes sous la gorge de la chèvre. - (42) |
| miglons. s. m. pl. Boules qui se forment dans la farine qu'on détrempe, lorsqu'on n'a pas soin de la délayer convenablement. (Courgis). - (10) |
| mignairder (v.t.) : faire le câlin comme les jeunes enfants - (50) |
| mignairder, v. a. faire le câlin comme les jeunes enfants qui cherchent les caresses ou qui veulent obtenir quelque faveur. - (08) |
| mignairdon, s. m. enfant gâté, dont on s'occupe sans cesse - (08) |
| mignarder, v. tr., parer, mettre en toilette : « La Glady vout aller au bal ; faut vouer c'ment all' se mignarde. » - (14) |
| mignée, eau miellée. - (02) |
| mignein : étameur. On pourto les ustensiles é rétamer au mignein : on portait les ustensiles à rétamer à l'étameur. - (33) |
| migner, v. a. manger. - (08) |
| mignerai, minerai de fer. - (02) |
| migneut : Calin, caressant. « Ces ptiets sant bien migneuts ». - (19) |
| migneuter : Caliner, caresser « Les enfants amant bien se fare migneuter ». - (19) |
| migneutises, petits œillets roses de mai. - (27) |
| mignin : rétameur (en général ambulant) - (48) |
| mignin : voir maignin - (23) |
| mignin : rémouleur, rétameur, traînard - (39) |
| mignin, s. m. chaudronnier ambulant. - (08) |
| Mignon : nom de bœuf. III, p. 30-o - (23) |
| mignon, gentil, délicat, recherché... - (02) |
| mignôt, adj., gentil, gai, caressant. - (14) |
| mignot, n. masc. ; polisson, qui aime à s'amuser ; le petiot cadet est ben mignot. - (07) |
| mignot. Enfant caressant... - (13) |
| mignotai. : Flatter, caresser de la main un mignot, c'est-à-dire un enfant joli, délicat, mignon. Faire mignan mignan, c'est faire beaucoup de caresses à quelqu'un. - (06) |
| mignoter (verbe) : (Se). prendre soin de sa personne. - (47) |
| mignoter, v. tr., caresser, cajoler, flatter, faire des bonnes grâces. - (14) |
| mignotter, v. ; s'amuser ; ces petiots chats mignottent. - (07) |
| mignute. Minute. Le gn se prononce comme dans cygne. - (01) |
| migon. Jeune chat. - (03) |
| migounerie. n. f. - Gentillesse, câlinerie : « l's'errangeait pour la rencontrer pou' un rien et y faisait des tas d'migouneries pou' la mieux paumer. » (Fernand Clas, p.342) - (42) |
| migué, miguée : adj., moisi, pipé. A rapprocher du lat, mucidus et mucosus. - (20) |
| miguée, adj., moisie (en parlant de l'étoffe). - (40) |
| miguée, miel, raisins très mûrs et sucrés comme du miel. - (27) |
| miguer, verbe intransitif : moisir, piquer de petites taches d'humidité. - (54) |
| miguer. Moisir. - (49) |
| miguet : moisi (le ) - (30) |
| miguet : Muguet, convallaria majalis. « Au printemps y est in pliaiji d'aller cudre du miguet dans le beu » : au printemps il est agréable d'aller cueillir du muguet dans les bois. - (19) |
| miguet. Muguet. - (49) |
| miguette : Nom qu'on donne à une vache presque blanche, couleur de muguet. - (19) |
| migueulotte, tourteau de noix. - (28) |
| mihâqhi', s. m. miracle. - (08) |
| mi-ieu, mèilleu. Milieu. - (49) |
| mîje n.f. Mesure de capacité de 5 litres. - (63) |
| mije tôt : Prodigue. « O sera bin vite rûné (ruiné) y est in mije tot ». - (19) |
| miji : Manger. « Vins miji la sope » : viens manger la soupe. Au repas de noce pour encourager les convives : « Miji dan les filles, miji dan les garçons ; miji dan tot le mande ». Au figuré : « Miji san butin » : manger son bien. - (19) |
| mijoré. Quelques-uns écrivent mijauré. Dans la langue des Troubadours, miejas her, demi-héritier ou cadet de famille, semblerait devoir faire remonter ce mot au XIIe siècle. En effet, mijoré signifie qui affecte des prétentions et de petites manières... - (02) |
| mijoter. v. a. et n. Laisser cuire tout doucement. – Au figuré, mijoter une affaire, la préparer lentement, doucement, de manière à en assurer le succès. - (10) |
| mijou, loc. la mi-août : je vous paierai « à la mijou. » - (08) |
| Milan : diminutif de Emiland - (48) |
| milenot, s. m. manche du fléau à battre les céréales. (voir : m'iet.) - (08) |
| miliasse, s. f. millier. il y a des « miliasses » d'années que le monde est fait. - (08) |
| Millan, nom de baptême. Diminutif de Émiland, corruption de Émilien. - (08) |
| millard, millésime, date. - (05) |
| millasser : v. n.. se dit du raisin lorsqu'il reste à l'état de millasson. - (20) |
| millasson : s. m., raisin millerand, c'est-â-dire dont le grain est resté très petit. - (20) |
| mille (l mouillé), adj. num. mille. - (17) |
| milléche : Gâteau de maïs. « Enforner de la milléche » : mettre au four des gâteaux de maïs. « Plieurer la milléche » : lésiner sur la nourriture. - (19) |
| milléchére : Grand plat de terre dans lequel on fait cuire la bouillie de maïs. - (19) |
| millèchire : s. f. grand plat à millets. - (21) |
| millée, s. f., mélange d'œufs et de lait, cuit au four. - (40) |
| mille-gueules. s. m. et f. Bavard, bavarde. - (10) |
| millepartus : (Il non mouillées). Millepertuis, hypericum perforatum. « Eune trope (touffe) de millepartus ». - (19) |
| mille-potus, mille-pertuis. - (27) |
| miller. Crier d'une manière perçante ; rémiller, qui en est l'augmentatif, est plus expressif encore. Le simple est une onomatopée. - (03) |
| milleret : Raisin dont les grains sont restés petits. « Les millerets fiant bin du ban vin mâ i en fa guère » : les millerets font bien du bon vin mais ils n'en font guère. - (19) |
| milleret : s. m., syn, de millasson. - (20) |
| milleri. : Terme augmentatif pris du nombre mille. - (06) |
| millery ou milleri, terme augmentatif, pris du mot mille... - (02) |
| millet : Bouille de maïs ou de froment cuite au four dans la milléchére. - (19) |
| millet : gâteau au lait versé bouillant sur de la farine, des œufs, de la fécule…puis cuit au four. - (62) |
| millet : s. m., flan. - (20) |
| millet, bouillie de maïs, ou de riz, ou de froment, cuite au four. - (05) |
| milleur, adj. meilleur. (voir : mouéillou.) - (08) |
| mîlli : crier (cri aigu) - (57) |
| millias : galette aux prunes - (60) |
| milliasse, pain de maïs, jadis de millet. - (05) |
| milliasse. s. f. Mot qui se dit par les enfants pour milliard, et par lequel, généralement, ils expriment une quantité considérable indéfinie. Des milliasses de millions. - (10) |
| milliassière (trappe), vase à millet. - (05) |
| milliassière, s. f., plat en terre. - (40) |
| Millien : diminutif de Emilien - (48) |
| Millienne (lai) : (l’) Émilienne - (37) |
| millier : Mille livres ou 500 kilog. « In millier de foin » : 500 kilog de foin. - « In fagueut de millier » : un fagot de gros bois lié de deux liens. - (19) |
| milliot. Paquet de linge et de bardes destiné au lavage. A rapprocher de maillot, linge d'enfant. - (13) |
| milloche : s. f., oseille des prés (ruinex acetosa). - (20) |
| millon n.m. Million. - (63) |
| millor. Milord, Milords. Nous nous servons du mot milord en France pour désigner un gros seigneur ; aussi vient-il de my, qui, en anglais, signifie mon, et de lord, seigneur. Les deux II du bourguignon millor se prononcent comme dans meilleur. - (01) |
| millot : Mil, millet, panicum milliaceum. « In grain de millot » : un grain de mil. - (19) |
| milon : charrue Milon - (43) |
| milsipipi (à), loc. adv., bien loin, au diable. Manière de parler prise du nom du Mississipi, qui, en effet, n'est pas très proche, ou plutôt allusion à la Cie du Mississipi, établie en 1716 par Law, et qui jeta une si terrible perturbation dans tout le royaume. - (14) |
| mimi : Baiser. « In greu mimi » : un gros baiser. « Fare mimi » : embrasser. « mimi à la pincette », voir pincette. - (19) |
| mim-mer : embrasser - (57) |
| mimnuait (n.m.) : minuit - (50) |
| mimouére, s. f. mémoire, faculté de conserver le souvenir des choses. - (08) |
| min (le) (pr.pers.m.) : le mien - (50) |
| min, menne, pron. poss. mien, mienne : « l' min, l’ tin, l' sin », pour le mien, le tien, le sien ; « l’ menne, l' tenne, l' senne », pour la mienne, la tienne, la sienne. (voir : meun.) - (08) |
| minable (Avoir l'air). C’est ressembler à un mendiant ; c'est avoir mauvaise mine. - (13) |
| minâble, adj. misérable, déguenillé. Se dit d'un pauvre en haillons : il est « minable », il manque de tout. - (08) |
| minâble, pauvre très mal vêtu. - (16) |
| minable. adj. des deux genres. Mal vêtu, misérable, faisant pitié. J' n'ai pus rien à mettre, j' suis minable. - (10) |
| minable. Malheureux, misérable. - (49) |
| minage : s. m., action de miner, défonçage du sol. - (20) |
| minage, s. m. droit perçu sur les grains mesurés par mine, ancienne mesure qui contenait 78 litres 73. - (08) |
| minagot. s. m. Un des noms de l'escargot dans les campagnes de la Puysaie. - (10) |
| minai, s. m. minuit. - (22) |
| minai, s. m. minuit. - (24) |
| minan : Minet, jeune chat. « Oh le brave ptiet minan ! » : Oh le joli petit minet ! - (19) |
| mînç’er : couper en petits morceaux peu épais et très fins - (37) |
| mince, adj. facile, indulgent, calme. Pas mince : agressif, moqueur, turbulent. - (17) |
| mince-bettes, mince-blette. n. m. - Coupe-racines à manivelle. - (42) |
| mince-blettes (n. m.) : appareil servant à hacher les betteraves - (64) |
| mincer (v. tr.) : émincer (mincer les blettes) - (64) |
| mincer. s. a. Mettre en menus morceaux. On dit aussi démincer. - (10) |
| mincer. v. - Broyer, déchirer, détruire : «Alors j'ai rendu à Luce sa lettre mincée. – Déchirée ! - Oui, mincée à morceaux. » (Colette, Claudine à Paris, p.218). On emploie ce sens depuis le XIe siècle où mincer signifiait couper en menus morceaux. On ne retrouve cette idée en français que dans le vocabulaire culinaire : «émincer». - (42) |
| minceurdi : mercredi - (39) |
| minche, sf. manche. - (17) |
| minche. s. m. Manche. Minche de pieuche. (Poilly-sur-Serein). - (10) |
| mincheurer : mâchurer (noircir) - (57) |
| minchöt, sm. manchot. - (17) |
| mîné : Minuit. « Quand an veu se lever de ban métin i ne s'agit pas de vailli jeusqu 'à mîné ». - (19) |
| miné, s'miné, s'épuiser en faisant des choses difficiles. Ce mot traduit le verbe minuere, amoindrir, briser. - (16) |
| minée. s. f. Voyez massue. - (10) |
| mineit : (nm) minuit - (35) |
| mîneit n.m. Minuit. - (63) |
| minet, minuit. - (05) |
| minéte, s. f., petite luzerne. - (14) |
| minette (n.f.) : petite luzerne ou luzerne lupuline - (50) |
| minette : luzerne lupuline - (48) |
| minette : luzerne. - (33) |
| minette n.f. Luzerne lupuline (medicago lupulina). - (63) |
| minette : luzerne - (39) |
| minette, n.f. luzerne lupuline. - (65) |
| minette, s. f. nom vulgaire de la petite luzerne. - (08) |
| mineur, adj. et subst. mineur, celui qui n'est pas majeur : un enfant mineur, un mineur. en plusieurs lieux le féminin est « mineurte. » - (08) |
| mineus. s. m. Minuit. (Accolay). - (10) |
| mineut : minuit. - (32) |
| mineux : Mineur. « Alle a laichi quatre enfants mineux. Y est liune (c'est lui) qu'est le tuteur de la mineuse ». - (19) |
| minge (on) : manche (poignée) - (57) |
| mingè : manger - èlle é beyè è mingè é poules, elle a donné à manger aux poules - (46) |
| mingeouère : une mangeoire - (46) |
| minger, miger. v. a. Manger. (Lucy-sur-Cure). - (10) |
| mingne, sf. mine. - (17) |
| mingnin : étameur. - (29) |
| mingnué, min-neu, c'te gnué, c'te neu : minuit, cette nuit - (36) |
| minguiante. s. f. Personne maladive. (Etivey). - (10) |
| Minique n. Dominique. - (63) |
| ministâre : Ministère. « Qua dan que t'en dis du noviau ministâre ». - (19) |
| ministre, s. m. ane. Baudet. S'applique en général aux bêtes asines qui ont du mérite soit par leur taille soit par leur énergie. - (08) |
| mînme (adj.) : même - (50) |
| minme : même - (43) |
| miñme adv. Même. - (63) |
| min-me : même - (39) |
| minme, même ; minme ke, de plus, en outre. - (16) |
| min-mie : Mon ami, ma mie. « Vins vè ma min-mie » : viens près de moi ma mie. - (19) |
| min-min : Maman. « Choupe ta min-min » : appelle ta maman. - (19) |
| minnager. adj. Qui est économe, qui a soin des choses. - (10) |
| min-ne : mien - (43) |
| min-ne : Mien, mienne. « Tan cutiau ne cope pas si bin que le min-ne » : ton couteau ne coupe pas aussi bien que le mien. « Ta sarpe (ta serpe) cope mieux que la min-ne. Je ne voudrais pas changi cen min-ne cant' cen tin-ne » : je ne voudrais pas changer ce qui est à moi contre ce qui est à toi. - (19) |
| min-net, minuit. - (38) |
| min'neut : minuit - (48) |
| min-neut : minuit. Ai Nouai on vait ai la messe de min-neut : à Noël on va à la messe de minuit. - (33) |
| min-neut : miniut - (39) |
| min-neut : n. m. Minuit. - (53) |
| minœur : n. m. Mineur, ouvrier travaillant à la mine. - (53) |
| minon (n.m.) : chaton des fleurs mâles du noisetier - (50) |
| minon (on) : chaton (fleur du noisetier ...) - (57) |
| minon : chaton (petit chat) - (48) |
| minon : chaton de saule, de noisetier - (48) |
| minon : petit paquet de poussière (souvent sous les lits) - (48) |
| minon : fleur du saule et du noisetier. - (33) |
| minon n.m. Chaton des noisetiers, peupliers, poussières agglomérées des maisons. - (63) |
| minon : 1 n. m. Fleur de saule. - 2 Fleur de noisettier. - 3 n. m. pl. Amas de poussière, chatons. - (53) |
| minon : s. m., chaton des noisetiers, peupliers, etc.; boa de plumes ou de fourrure que les femmes portent nutour du cou ; flocon poussiéreux qui se forme sous les meubles et dans les angles des appartements. - (20) |
| minon, chaton de saule, d'osier, de noyer, etc. - (16) |
| minon, n.m. chaton du noisetier ou du saule. - (65) |
| minon, n.m. paquet de poussière. - (65) |
| minon, s. m. 1. chat (langage plaisant). — 2. Chaton de noisetier, de noyer au printemps. - (24) |
| minon, s. m. chaton des fleurs mâles du noisetier, du saule, etc. Minon et chaton se disent également d'un petit chat. - (08) |
| minon, subst. masculin : chaton de saule ou de noisetier. Au sens figuré, il désigne aussi un amalgame de poussière légère par analogie avec l'aspect du minon de noisetier. - (54) |
| minon. Chaton, et par extension chat. - (49) |
| minon. Fleur mâle du noyer et du noisetier, a cause de sa ressemblance avec un petit chat, appelé également minon... - (13) |
| minons. n. m. pl. - Chatons, fleurs mâles du noisetier, du châtaignier ou du saule. Employé au pluriel, minons, mot d'origine onomatopéique, désignait les chatons (c'est-à-dire les inflorescences en épi souple comparables à la queue d'un chat). Au singulier, minon signifiait chat. Le poyaudin a conservé directement ce mot du vocabulaire de la Renaissance. - (42) |
| minot : s. m., ancienne mesure de capacjté pour le sel, faisant le 1/4 du setier et comprenant 4 coupes. Sa contenance était donc de 52 litres 132. - (20) |
| minôt, adj., tout ce qui est velu et doux, comme le velours, comme les chatons des fleurs mâles des amentacées (ormes, bouleaux, saules). - (14) |
| minòt, et minoû, s. m., minet, petit chat : « Veins, mon p'tiot minòt ! » — « Peùte chate lait d' joulis minòts. » - (14) |
| minote, petite main d'enfant (familier). - (16) |
| minòte, s. f., menotte, petite main d'enfant, de fillette. - (14) |
| minotte, n. fém. ; petite main. - (07) |
| minotte, s. f. menotte, petite main, main d'enfant. - (08) |
| minquerdi. n. m. - Mercredi. (Merry la Vallée, selon M. Jossier) - (42) |
| minquerdi. s. m. Mercredi. (Merry-laVallée). - (10) |
| mïns, minse, pp. de mettre. - (17) |
| minsè, sf. mise. - (17) |
| minterie : Menterie, mensonge. « Tache voir de ne point me dire des minteries » : fais en sorte de ne pas me dire de mensonges. - (19) |
| minti : Mentir. «T'en as minti » : tu en as menti. - (19) |
| mintou : Menteur « Y est in mintou. Ol est mintou c 'ment eun arréjou de dents » : il est menteur comme un arracheur de dents. - (19) |
| minuite, minute. - (16) |
| minusrie, minuties. - (16) |
| minute : Plat de poisson. - (19) |
| miô : tas de foin rassemblé en fin de séchage. A - B - (41) |
| mio : beaucoup - (44) |
| mio : meule. (B. T IV) - S&L - (25) |
| mio : muet - (46) |
| mio : tas. (BY. T IV) - S&L - (25) |
| mio. Muet. En vieux français mueau. - (03) |
| miôle, s. f., mulet. - (40) |
| miole. s. f. Mule. (Percey). - (10) |
| miolée : eau du miel. - (09) |
| miôlée. n. f. - Boisson à base de vin et de miel. - (42) |
| miollot - tout petit morceau. - Beille moi z-en in miollot seulement pour goûtai. - Mets to ce qui en miollots pour les pussins. - (18) |
| mion, s. m. déchet de la cire après qu'on en a extrait le miel. - (08) |
| miône : Moelle. « De la miône de seuré » : de la moelle de sureau. - (19) |
| miôné, demander une chose avec instance ; mione se dit d'une petite fllle qui ne cesse de demander des friandises, des jouets... - (16) |
| mionmion, s. m. tronçon qui demeure lorsqu'on a coupé un membre du corps humain, un doigt, un bras, une jambe, etc. on dit encore un « mionmion » en parlant du chicot d'une branche cassée ou coupée. - (08) |
| mionner, v. a. s'emploie au propre dans le sens de miauler avec insistance et au figuré de convoiter quelque chose avec ardeur. Un enfant « mion-ne » pour avoir ce qu'il désire, un bonbon, un joujou. - (08) |
| miot : Muet. « Te ne répands ren, est-ce que t'es miot » : tu ne réponds rien, es-tu muet ? - (19) |
| miòt et muòt, adj., muet. - (14) |
| miôt : s. m., mi-août. - (20) |
| miot, ote. adj. et s. Muet, elle. (Avallonnais). - (10) |
| miot, otte, adj. muet, celui qui ne parle pas : « lai clieuce atot miotte », la cloche était muette. - (08) |
| miôte, s. f., miette, parcelle de pain, d'un corps quelconque. - (14) |
| miöte, sf. miette. - (17) |
| miotée. s. f. Œillet de poète. (Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes). - (10) |
| miots : criblures de grains. - (09) |
| miots. n. m. pl. - Débris de paille que l' on ramassait sous la presse à battage. - (42) |
| miots. s. m. pl. Epis et pailles brisés par le battage, qui sont donnés en nourriture aux bestiaux. (Perreuse). - (10) |
| miotte (n. f.) : miette - (64) |
| miotte : miette - (37) |
| miotte : miette - (48) |
| miotte : une miette. - (56) |
| miotte : miette, pain ou gâteau, une petite quantité. - (33) |
| miotte : miette - (39) |
| miotte : n. f. Miette de pain, de gâteau. - 2 n. f. Petite quantité. - (53) |
| miotte, s. f. miette : « eune miotte de pain. » - (08) |
| miotte, s. f., miette de pain. - (40) |
| miotte. n. f. - Miette. - (42) |
| miotte. s. f. Mie, miette. Ce mot se dit plus particulièrement de brins de pâte menus, qui se font cuire dans du lait comme les galottes. Voyez ce mot. - (10) |
| miottons. s. m. pl. Mets consistant en grosses boullettes de farine qu'on fait prendre et cuire dans du lait. (Percey). - (10) |
| mioûlée (n. f.) : boisson miellée ou excessivement sucrée - (64) |
| mioulée. s. f. Pain émietté dans du vin. - (10) |
| mioûler – miârler : miauler - (57) |
| miouler : (vb) miauler - (35) |
| mioûler v. Miauler. - (63) |
| miouner, mialer, ramiouner. Miauler. Fig. Pleurer. - (49) |
| miourner. v. n. Manger lentement, sans appétit. (Chastenay). - (10) |
| miournon. s. m. Petit enfant pleurnicheur. (Courgis). - (10) |
| mirac'lle : Miracle. « Ol a pu fait de tours que de mirac'lles » : il a fait plus de mauvaises actions que de bonnes, ou, il en dit plus qu'il n'en fait, c'est un vantard. - (19) |
| miragot. s. m. Escargot. (Bligny-en-Othe). – Voyez minnagot. - (10) |
| mirakje, sm. miracle. - (17) |
| mirâkye, miracle ; il suffit qu'un événement soit quelque peu rare pour qu'on le qualifie de mirakye ; un enfant brise une vaisselle : t'é fé ein biâ mirakye, tu as fait un beau miracle, lui dit ironiquement sa mère. - (16) |
| miran : Chaton, fleur mâle du noyer et du noisetier. « Des mirans de noués » : des chatons de noyer. - (19) |
| mirando : Balle de vitrier. - (19) |
| miraque (n.m.) : miracle - (50) |
| mîraud : celui qui a mauvaise vue - (37) |
| mire : Chatte. - (19) |
| mire, personne qui préserve du mal... - (02) |
| Miré, s. m. nom de bœuf. - (08) |
| mirelaid. s. m. Miroir. (Puysaie, Joigny). C'est une espèce de jeu de mots. - (10) |
| mireulé, bariolé de plusieurs couleurs (ex, une vache mireulée). - (27) |
| mirguée s. m. Miroir. (Lucy-sur-Cure). - (10) |
| mirlicouton, s.m. sorte de pêche. - (38) |
| mirliguet, s. m., primevère sauvage de couleur jaune, connu aussi sous le nom de coucou. - (11) |
| mirô, et son diminutif mirôlô, miroir, du latin mirari... - (02) |
| mirô. : Miroir. Il y a un diminutif qui est mirolô. - (06) |
| mirogau. s. m. Vêtement de femme, camisole. (St-Martin-sur-Ouanne). - (10) |
| miroi : Miroir. « Les fanes amant bien se regarder au miroi » : les femmes aiment à se mirer, elles sont coquettes. - (19) |
| mirolai - varié, bariolé de diverses couleurs. - Ile aivot in haibit to mirolai. - Vos é lai pou sarrai vos aifares ine jolie boîte tote mirolée. - (18) |
| miroler : astiquer, rendre joli. - (32) |
| miroler, v. a. couvrir de dessins, d'arabesques un objet quelconque : un sabot « mirolé », c’est à dire orné de dessins. (voir : brigolé.) - (08) |
| miroler. Barioler. Etym. riole, riule, raie en vieux français, avec le préfixe mi admiratif, alors que le préfixe ba est péjoratif. - (12) |
| mirou (oū), sm. miroir. - (17) |
| miroû, s. m., miroir, souvent un fragment de glace cassée. - (14) |
| mirou, s.m, miroir, glace. - (38) |
| mirouaîr (on) : miroir - (57) |
| mirouaiter : miroiter - (57) |
| miroucle. n. f. - Poire séchée au four; synonyme de daguenelle. (Villeneuve-les-Genêts, selon M. Jossier) - (42) |
| miroucles. s. f. pl. Poires séchées au four, poires sèches en général. (Villeneuve-les-Genêts). - (10) |
| miroué, s. m. miroir, petite glace. - (08) |
| mirouère, miroué, mirelaid. n. m. - Miroir. - (42) |
| misare : Misère, peine, pauvreté. « An a bin de la misare pa gagni sa vie » : on a bien de la peine à gagner de quoi vivre. « Ol a laichi ses enfants à la misère » : il a laissé ses enfants dans la pauvreté. « Doze métiers, trâze misares » : douze métiers, treize misères, celui qui change souvent de métier ne s'enrichit pas, c'est une forme de pierre qui roule n'amasse pas mousse. - (19) |
| mise : Brin de ficelle mise à l'extrémité d'un fouet. « Ol a tot eusé (usé) la mise de sanfouat en le fiant claquer ». « Mise d'huile » : la quantité de noix que l'on fait presser par l'huilier pour la provision d'huile d'une année. - (19) |
| mise, s. f., corde fine et serrée, que charretiers et cochers mettent au bout de leurs fouets. - (14) |
| mise, s. f., mèche du fouet de charretier. - (40) |
| mise. Mèche de fouet. - (49) |
| miser, v. tr., mettre l'enchère sur quelque chose : « J'n'ai ran misé à c'te vendue. » - (14) |
| misérabje, adj. misérable. - (17) |
| misère (De) : loc. adv. Venir de misère, croître ou pousser chétivement - (20) |
| misére n.f. Misère. - (63) |
| misère, s. f., peine, mal : « Jarnigué ! que j'ai donc èvu d’misère pour m'en r'veni ! » - (14) |
| misèrer (faire), v. intr., occasionner de l'ennui, de là peine à quelqu'un : « Ah! le ch'ti gas ! ô m'a prou fait misèrer d'après lu ! » - (14) |
| misérer (verbe) : être dans le dénuement. Avoir du mal à « joindre les deux bouts ». - (47) |
| miserer : éprouver des difficultés - (44) |
| misérer v. Peiner, s'échiner à une tâche ingrate et peu lucrative. - (63) |
| misérer, v. éprouver des difficultés. - (65) |
| misérer. v. - Peiner, souffrir la misère. - (42) |
| misericôde. Miséricorde. - (01) |
| misi : miser - (57) |
| misse (ï), vt. mettre en menus morceaux, en tranches (des betteraves, du pain etc..) - (17) |
| misse : miette du pain (autrefois bon pain blanc) - (39) |
| missier. s. m. Messier, garde-champètre. Du latin messis. - (10) |
| Missierjan, Messire-Jean, sorte de poire. - (16) |
| missipipis, s. plur. ne s'emploie que dans la locution mettre en « missipipis », c'est-à-dire en mille morceaux, en mille pièces. - (08) |
| missouè'iller : émietter, réduire en menus morceaux - (48) |
| mistanflute (A la). locut. adv. Tout de travers. - (10) |
| mistifrisé : adj., vx fr, miste, tiré à quatre épingles. - (20) |
| mistifrisé, adj., élégant, muscadin, beau, petit-maître, tiré à quatre épingles. - (14) |
| mistifrisé, -ée adj. Tiré à quatre épingles. - (63) |
| mistifrisé, enjolivé... - (02) |
| mistifrisé. adj. Attifé, paré à l'excès. Du vieux mot miste {mixtus), joli, paré, et de frisé. - (10) |
| mistifrisé. : Enjolivé, bien ajusté. - (06) |
| mistifriser (verbe) : (Se). se faire coquette en vue d'une sortie. - (47) |
| mistoupon. s. m. Peigneur de chanvre. Voyez ferteux. - (10) |
| mitaïe. n. f. - Métairie. (Perreuse, selon M. Jossier) - (42) |
| mitaignes, s. f. mitaines, gants en laine tricotée qui ne couvrent pas les doigts ou au contraire gants arrondis à l'extrémité et dont le pouce est isolé. - (08) |
| mitaihie. s. f. Métairie. (Perreuse). - (10) |
| mitaimne (n.f.) : mitaine - (50) |
| mitaîn-ne (na) : mitaine - (57) |
| mitain-ne. Mitaine. - (49) |
| mitais, s. m. Métayer. (Id). - (10) |
| mitais. n. m. - Métayer. - (42) |
| mitan (au — de) : milieu. - (29) |
| mitan (n.m.) milieu - (50) |
| mitan : (nm) milieu - (35) |
| mitan : milieu - (37) |
| mitan : milieu - (48) |
| mitan : milieu. - (09) |
| mitan et moitan. Milieu, du latin medio stans. Nous disons moitanté, moitantére, pour une chose qui est au milieu. - (03) |
| mitan n.m. Milieu. - (63) |
| mitan : (mitan - subst. m.) milieu, centre ; l'adjectif mitantyé en est dérivé pour désigner ce qui est au milieu, un cheval, une gerbe. - (45) |
| mitan : milieu - (39) |
| mitan : n. m. Milieu. - (53) |
| mitan, et moitan, s, m., milieu : « Mets c'qui au mitan d'la taule. » — « J'vons partager c'gâtiau pô l’mitan. » — « Ol a chu au biau mitan du gouillat. » - (14) |
| mitan, milieu - (36) |
| mitan, milieu ; o bon mitan, bien au milieu. - (16) |
| mitan, milieu. - (04) |
| mitan, s. m. milieu. « mutan. » - (08) |
| mitan, s. m., milieu. - (40) |
| mitan. Milieu… - (01) |
| mitan. Moitié ou milieu. Al ai élé jeuqu’au mitan du bôs. Les Francs-Comtois disent moitant et les Allemands, « mittag ». Cette dernière forme si rapprochée de la nôtre pourrait faire supposer que ce mot est d'origine burgonde. - (13) |
| mitan. s. m. Milieu. - (10) |
| mitance (faire), loc. ètre insupportable, longuement : il m'a fait mitance. - (24) |
| mitance (faire), loc. être insupportable, longuement. - (22) |
| mitance, mitanche : s. f., vx fr, tence, querelle, contrariété. Faire mitance à quelqu'un (quereller quelqu'un). Y m’ fait mitance (ça m'embête), - (20) |
| mitancier, mitancher : s. m., vx fr. tenceor, querelleur. - (20) |
| mitandié, mitandier (-ière) (adj.m. ou f.) : de milieu, intermédiaire - (50) |
| mitant : adj., moyen. Vin mitant, vraisemblablement vin de seconde cuvée, par opposition à « vin pur » ou vin de première cuvée. - (20) |
| mitant : s. m., vx fr., milieu. - (20) |
| mitanteire, mitoyen; comme si l'on disait milieu-tien. Les Bretons disent metou, et, dans la langue tudesque, mitan signifie milieu. - (02) |
| mitanteire, s. f., moitié, ce qui est au milieu, intermédiaire : « Faut côper c'te bande, é peu en prend'e la mitanteire. » - (14) |
| mitanteire. : Mitoyen, comme si l'on disait : milieu tien, en latin medium tuum. - (06) |
| mitantié(ére) : se dit de quelqu'un qui est au milieu - (39) |
| mitantié, ére, adj. de milieu, moyen, ce qui est intermédiaire. - (08) |
| mitantier : se dit d'un enfant situé au milieu (par ex. 2ème sur 3, 3ème sur 5) - (48) |
| mitayé, s. m. métayer, celui qui partage avec le propriétaire les produits d'un domaine dont les frais de culture sont à sa charge. - (08) |
| mit'chaule : adj. Caline. - (53) |
| mite n.f. Chassie. Voir bite, grabeu. - (63) |
| mite : s. f., vx fr., mitaine. - (20) |
| mîte, s. f. mie de pain. - (22) |
| mite, s. f. mie de pain. - (24) |
| mite, s. f., mitaine : « Por sa fouére, j'li ai écheté eùn jouli paire de mites. » - (14) |
| mite. Gant. - (49) |
| mitéyin, enne, adj. mitoyen, ce qui est au milieu : un mur « mitéyin », une haie « mitéyenne. » - (08) |
| mitian : Milieu. « Je sais pas si je pourrai bin sauter pardessus ce goliet (cette flaque de boue). Ah bin mens le pi (mets le pied) au mitian te seras la moitié passe ». - (19) |
| mitiasse : bouillie écœurante. - (30) |
| mitié, s. f. moitié, l'une des deux parties qui forment un tout : « peurné ç'lai é beillé-m'en lai mitié. » - (08) |
| mitié. Moitié. - (01) |
| mitoinché, s. m. métayer, colon partiaire. - (08) |
| mitoluné, v. a. mettre en petits morceaux. Soupe mitounée, panade. - (22) |
| miton, s. m. manche du gilet que portent les hommes. - (08) |
| miton, s. m., chat, et aussi manchon. - (14) |
| miton. s. m. Homme qui se mêle un peu trop des détails de son ménage. (Auxerre). – Jaubert donne miteux, curieux ; qui s'occupe des affaires qui ne le regardent pas. - (10) |
| mitonée, s. f., panade, soupe mitonnée. Quelques personnes disent aussi panée. (V. ce dernier mot.) - (14) |
| miton-mitaine. (Onguent). Remède inoffensif, mais inutile. Au figuré, tout expédient qui ne sert à rien. En réalité, c'est un emplâtre de pain mitonné. - (13) |
| mitonnade, mitronnade : s. f, soupe mitonnée, panade. - (20) |
| mitonné : Mijoté. « De la sope mitonnée », sorte de panade. - (19) |
| mitonner, v. a. laisser s'attiédir, s'adoucir, ce qui est trop chaud : une soupe « mitonnée». - (08) |
| mitonner, v. a. mettre en petits morceaux, soigneusement. Soupe mitonnée, panade. - (24) |
| mitou : (nm) chevreau hermaphrodite - (35) |
| mitouche, et non point nitouche. Dans l'idiome breton, mitouik signifie patelin, artificieux. (Le Gon.) Sainte Nitouche est un abus de mots. - (02) |
| mitouche, pour nitouche, hypocrite qui semble n'oser toucher quoi que ce soit. - (16) |
| mitoué : métayer, fermier. - (33) |
| mitoué, s. m. mitayer. (voir : mitoinché.) - (08) |
| mitoue. n. f. - Petite mare, trou d'eau, synonyme de crot. - (42) |
| mitoue. s. f. Trou d'eau, mare, citerne rustique. (Marchais-Beton, Rogny, Grand-champ, Puysaie). - (10) |
| mitouérie. s. f. métairie, propriété rurale soumise au métayage. - (08) |
| mitouêyen : mitoyen - (57) |
| mitouêyenn'té (na) : mitoyenneté - (57) |
| mitouiller : pétrir — faire de la mauvaise cuisine. - (30) |
| mitoûnnée : soupe épaisse légèrement refroidie - (37) |
| mitoux adj. (de mite). Chassieux. Voir bitoux. - (63) |
| mitrailli : mitrailler - (57) |
| mitreilhi, v. a. molester, opprimer, écraser. - (08) |
| mitte : mie de pain. - (21) |
| mixieux (adj.) : minutieux, méticuleux - (64) |
| miÿasse, s. f., gâteau de maïs, jadis de millet, plus petit et un peu plus ferme que le miyet. (V ce mot.) - (14) |
| miÿassière, s. f., vase en terre, d'un certain diamètre, très plat, et dans lequel on fait cuire, au four, le miyet. - (14) |
| mi'yè, sorte de gâteau à la semoule et au lait ; miyassiëre, vase à faire cuire le mi'yé. - (16) |
| miÿet, s. m., grand flan, mou, prépaé avec des oeufs, du lait et de la farine du froment ou de maïs, et cuit au four. - (14) |
| miyeu (n.m.) : milieu - (50) |
| mi'yeu : milieu - (48) |
| mi-yeu : milieu - (39) |
| miyieu n.m. Milieu. - (63) |
| mize-treûffes (l’) : (la) bouche - (37) |
| miziaine, mizienne. s. f. Méridienne. (Bléneau). - (10) |
| mizot : mot masculin désignant la mèche du fouet - (46) |
| mizoué. s. m. Miroir. - (10) |
| miz'râble, très pauvre et celui qui a commis un crime. - (16) |
| m'jeû : Mi-août, fête de l'Assomption. « I sant allés à la m'jeù à Collanges » : ils sont allés à la fête patronale de Collonges qui a lieu le 15 Août. - (19) |
| m'lasé. adj. Contraction de Malaisé. (Etivey). - (10) |
| m'lède : malade. - (52) |
| mlède, malède adj. et n. Malade. - (63) |
| m'lédeux, malade - (36) |
| m'leigne. s. m. Moulin. (Savigny-enTerre-Plaine). - (10) |
| mlèn, moulin. - (16) |
| m'let, s. m. manche du fléau avec lequel on bat les céréales. la partie mobile qui frappe la gerbe se nomme la verge. (voir : courze, enteurlin, milenot, varge, voirge.) - (08) |
| mlgnair, adj. gentil, câlin. se dit d'un petit enfant gracieux et caressant. - (08) |
| m'lin : moulin - (48) |
| m'lin : Moulin. « An ne peut pas vendre le m 'lin a peu reteni l'iau » : on ne peut pas vendre une chose et retenir les accessoires qui en sont le complément indispensable. « Attiri l'iau à san m'lin» : savoir se procurer des affaires lucratives. « Ne pas pouya être au fo (four) a peu au m 'lin » : ne pas pouvoir être à la fois à deux endroits différents, ne pas pouvoir faire deux choses en même temps. - (19) |
| m'lin, s.m. moulin. - (38) |
| mlon, gros raisin blanc donnant un vin commun. - (16) |
| m'naci : menacer - (57) |
| mnaice, sf. menace. - (17) |
| m'nange, s. f., vendange. - (14) |
| m'nangeoû, s. m., vendangeur. - (14) |
| m'nanger, v. tr., vendanger. - (14) |
| m'nangeròr. s. m., petit panier servant à recevoir le raisin coupé pendant la vendange. (V. V’nangeròt.) - (14) |
| m'nanze, s. f. vendange. - (08) |
| m'nanzer, v. a. vendanger. (voir : menoinger.) - (08) |
| m'nâyé : facile - (39) |
| m'nè : v. t. Mener. - (53) |
| m'née (na) : menée - (57) |
| mner : mener - (51) |
| m'ner : mener - (57) |
| mner v. Outre les sens habituels tels que conduire, diriger on relève mner l'harmonium (en jouer), mner les conscrits (les accompagner en tant que ménétrier). Eune vatse que meune ou que meune les bûs : une vache qui réclame le taureau. Un tsin que meune : un chien qui poursuit un gibier. Un meunegueule : celui qui "la ramène", un fanfaron. Mner du breut : faire du bruit. Mner la vie : faire la fête. - (63) |
| m'ner. v. - Mener. - (42) |
| m'neu : i m'neu, cela m'ennuie, me coûte. - (38) |
| mneux n.m. Musicien menant la musique. - (63) |
| m'neux. Meneur : « un m'neux d'ours ». - (49) |
| m'neux. n. m. – Meneur ; le m'neux d'loup serait un personnage légendaire, qui autrefois parcourait la campagne la nuit, avec ses loups, et semait la terreur. - (42) |
| m'nî, v. intr., venir : « J'ain-me ben meû m'en m’nir iqui. » - (14) |
| M'nicot. nom d'homme. Dominique. (voir : dimanche.) - (08) |
| mnigeon. s. f. Semaille. - (10) |
| m'nion, menion – temps des semences, vers Septembre et Octobre. - I ons qui in joli temps de m'nion ; c'â précieux pou les laiborés. - Lai menion se fait bien, ci beille ai espairai. - (18) |
| mnot, mnote adj. Mignon, mignonne. - (63) |
| m'noû, s. m., meneur, celui qui dirige une noce, une fête, une danse, conducteur. - (14) |
| m'nu : manche du fléau (?) ou débris de paille, petit, menu. O lo ben m'nu : il est bien petit. - (33) |
| m'nu : adj. Menu. - (53) |
| m'nu, part., venu. (V. M'nî.) - (14) |
| mnûjî n.m. Menuisier. - (63) |
| m'nuser, v. tr., menuiser, faire des choses menues, rompre en petits morceaux. - (14) |
| m'nuserie. Menuiserie. - (49) |
| m'nusi (on) : menuisier - (57) |
| m'nusier. Menuisier. - (49) |
| m'nus'rie (na) : menuiserie - (57) |
| m'nuzier : menuisier - (39) |
| m'nuzin, menuisier. - (26) |
| m'nûzon, petit morceau. - (16) |
| mô : (Part. passé de moïlli). Mouillé, féminin môle. « Y est treu mô » : c'est trop mouillé. « Ma chemige est môle » : ma chemise est mouillée. - (19) |
| mô : le mal - iè mô au caberlot, j'ai mal au crâne - (46) |
| mô : mal - (43) |
| mô : mort (môtch au féminin) - èl â mô, il est mort - (46) |
| mô bian : mal blanc, panaris - (48) |
| Mo foi ! : Sur ma foi !. Locution permettant d’éviter le péché en précédent un avis ou une expression : « Allant ben, mo foi, y’ô c’ment j’va vous y dire… » : Et bien, sur ma foi, c’est comme je vais vous le dire… - (62) |
| mô n.f. Mort. - (63) |
| mo tout, loc. moi aussi. - (22) |
| mô vri : mal réveillé, levé du pied gauche - (43) |
| mô : 1 n. m. Mal, n. f. douleur. - 2 exp. Mal à l'aise (être). - (53) |
| mô, adj. mou, mouillé, humide : « i seu tô mô », je suis tout mouillé ; « lai terre ô môle », la terre est humide. - (08) |
| mo, adv. mieux. - (17) |
| mo, dans mo foi : ma foi. - (38) |
| mo, môle : (mô, mô:l' - adj.) mouillé, humide ; le glissement de l'idée de terrain mou parce qu' il est mouillé à la notion d'humidité semble expliquer ce sens. - (45) |
| mo, môle, adj. mouillé, humide, le fém. est peu employé. - (17) |
| mo, mon adj. poss. Mon. Mo vèlo, mon auto, woilà tot mon bié, ma feunne a pris tot l'réste. - (63) |
| mô, mort ; el â mô, il est mort ; ill'â môthye, elle est morte. - (16) |
| mô, môrte : (adj.nm) mort (e) - (35) |
| mo, parole ; grô mo, mot injurieux. - (16) |
| mò, s. m., mot, parlé on écrit. - (14) |
| mo, môle – mouillé, mouillée, etc. - Lai plieue nos é pris qui traiversains le bô ; i sons mo, trempai quemant des caines. - C'â in pecho mo pou laiborai ; ci fairo de lai goîlle. - (18) |
| mô. Mot, mots. Mô a plusieurs significations. Il est adjectif quand on dit du linge mô, pour moite, mouillé ; du fromaige mô, du fromage mou ; un homme mô, un homme mou, qui n'a pas de résolution. Mais il est substantif quand c'est mô, mot, ou mô, mou, poumon de bœuf. - (01) |
| mô. : A deux sens. Il signifie mouillé et muid, vaisseau de capacité pour le vin. - (06) |
| moacter. v. -Miauler. - (42) |
| moaisse, s. f. petit paquet d'osiers fins. - (24) |
| mobille, meubille, adj. mobile. - (17) |
| mobiller (on) : mobilier - (57) |
| mobiyier : mobilier - (37) |
| mô-blanc : n. m. Panaris. - (53) |
| mochai, mochot, mocheras. – Moucher, et divers temps du verbe. - D'aivou le rhume en faut tojeur le moché ai lai main. - Te mocheras pu souvent ton enfant, ce sero pu propre, vais. - Voiqui les mouchettes, te mocherez lai chandelle. - (18) |
| mochais, n. masc. ; morceau. - (07) |
| mochan : Moucheron. « J'ai in mochan dans l'yeu (dans l'oeil) ». « Y est in mochan dans la gueule d'in lout » c'est très insignifiant, c'est une goutte d'eau dans la mer. - Extrémité d'une mèche qui charbonne. « Quand y a des mochans su la lampe y est signe de galands » : quand la mèche de la lampe charbonne cela présage que la fille de la maison aura des amoureux. - (19) |
| môchau : (nm) morceau - (35) |
| moche - méche. - Aitûye voué lai moche de lai lampe, qu'ile ne fait diére cliair. - Voiqui du coton de vieux bas, i fas des moches d'aivou. - On dit aussi Moche pour Mouche, mais avec un accent circonflexe Môche. - (18) |
| moche (ō), sf. mèche. - (17) |
| môche (prononcez meuche), pain ou brioche... - (02) |
| moche : Dépourvu de cornes. « Eune cabre moche » : une chèvre qui n'a pas de cornes. - (19) |
| môche : Mouche. « Eune môche à mié » une abeille. « Eune môche cantharine » : une mouche cantharide. La mouche cantharide est un petit vesicatoire à base de cantharide (insecte), c'est un « topique » comme celle de Milan. « Eune môche à nisans » : une mouche à viande (voir nisan). « Eune môche de Milan » un petit vésicatoire. « Môche pliate » : genre d'insecte ou de mouche se tenant sur les animaux domestiques et les fumiers. - (19) |
| môche, s. f. mouche. - (08) |
| môche, s. f., mouche, insecte et femme finaude : « Y et une fine môche. » - (14) |
| môche, s.f, mouche. - (38) |
| moche. Laid, vilain. (Argot moderne). - (49) |
| môche: (mô:ch' - subst. f.) abeille, mouche à miel ; le terme "mouche", employé absolument pour désigner l'abeille, est ancien et très répandu dans les parlers régionaux. La Chandeleur est la fête des môches, quand on prend les môches, c'est-à-dire quand on doit récolter le miel. - (45) |
| mocheau : morceau - (51) |
| mocheau n.m. Morceau. C'est une exception à la règle qui veut que les terminaisons en -eau, se prononcent et s'écrivent -iau. - (63) |
| mocheu : monsieur bourgeois local - (51) |
| môchiau : morceau - (43) |
| mochlöt, sm. morceau. - (17) |
| mochné, vt. moissonner. - (17) |
| moch'ner, moissonner. - (26) |
| moch'ner. Moissonner. - (49) |
| moch'neux. Moissonneur. - (49) |
| mochon, moisson. - (26) |
| mochon, sf. moisson. - (17) |
| mochon. Moisson. - (49) |
| mochou, morveux - qui a besoin de se moucher. - T'é in petiot mochou ; in petiot morveux, vais. - (18) |
| modarne (un) : moderne, arbre de réserve. De taille intermédiaire entre baliveau et ancien, dans une coupe, généralement d’espèce de «haut jet». - (62) |
| modarne : vieux chêne - (60) |
| modarne : n. m. Moderne, terme de bûcheron pour désigner le fût de l'arbre commercialisable. Les ayants-droit se partageaient la frâte (tête de chêne). - (53) |
| modarne. adj. - Moderne. - (42) |
| mode, moude, meude, mude : s. m., sortie, voyage, trajet, étape. Terme en usage surtout chez les bateliers du Rhône et de la Saône. - (20) |
| môde, s. f. coutume, usage, façon d'agir. - (08) |
| mode, s. f., trajet déterminé fait sur la rivière par les mariniers de là Saône: « J'ons fait une mode, deux modes. » disent-ils. - (14) |
| möde, sf. mode. - (17) |
| môde. Modes : Lai mode, la mode ; lé veille mode, les vieilles modes… - (01) |
| moder (v.) : faire un tour, un "viron" - aussi en lyonnais - (50) |
| moder : v. n., vx fr., sortir, partir, voyager, aller se promener. - (20) |
| modèrne. Baliveau. - (49) |
| modiure, sf. morsure. - (17) |
| môdj, modju : mordre, mordu - (46) |
| modjre, vt. mordre ; pp. modiu. - (17) |
| modrâ, moderot - divers temps du verbe Mordre, qui est du reste assez régulier. - N'aipruche pâ tant du chien, a te modro. - Vos modrains ai belles dents, hein ! dans in poulot queman cequi ! - (18) |
| môdre : mordre. Notons que la place du « r» à l’infinitif «gêne » la conjugaison : ô môrd (mord), ô môdro (mordrait)… - (62) |
| môdre : Moudre. « Ol a fait môdre in sa de blié » : il a fait moudre un sac de blé. « Y vaut mieux môdre san café que l'ageter tot molu (que de l'acheter tout moulu) - (19) |
| mödre, möre, vt. moudre ; pp. mödu, moudu. - (17) |
| môdre, v. moudre. - (38) |
| môdre, v. tr., moudre. - (14) |
| môdre, v., moudre. - (40) |
| môe : Moue. « Fare la môe » : faire la moue. « Quelle môe te nos fâ ! totes les pouleilles de Corlâ tindraient ajo (juchées) dessus ». - (19) |
| moè : mol - (39) |
| moë, s. f., moue, grimace, mauvaise humeur. - (14) |
| mœche, 1. s. f. tout pain de boulanger, quelle qu'en soit la forme, même en couronne ou en pain long. — 2. adj. creux; se dit d'un radis, d'une rave. - (24) |
| moèche, mouèche. s. f. Mèche. - (10) |
| mœche, s. f. tout pain de boulanger, quelle qu'en soit la forme. - (22) |
| moéchon : moisson. - (32) |
| mœge, adj. creux ; se dit d'un radis, d'une rave. - (22) |
| moègneau : un moineau - (46) |
| mœlliésson, s. m. raisin à très petits grains. - (24) |
| moéllux (-use) (adj.m. et f.) : moelleux, moelleuse - (50) |
| moeu, 1. adj. mûr. Verbe : moeuri, ou moeuraître. - 2. s. m. et adj. mort. Verbe : meuri. - (22) |
| mœur, mœure : adj. Mur. - 2 n. f. Mûre. - (53) |
| moeurire, s. f. provision de fruits mis à mûrir dans le foin. Par analogie, cachette d'argent. - (22) |
| moeuron, s. m. fruit de la ronce. - (22) |
| moéyèn, aisance, fortune ; évoi lë moéyèn, avoir de la richesse. - (16) |
| môflan, ante. adj. bouffant, qui se gonfle. - (08) |
| môfle. môfe, s. m. mufle, museau, face d'animal, visage difforme. - (08) |
| moflo (te) : (môflo - adj.) gonflé, bien levé ; se dit d'un pain, d'un gâteau, mais aussi de la laine cardée. - (45) |
| môflô, rebondi, joufflu... - (02) |
| môflô. : (Pron. meuflieu), joufflu, rebondi. Ce mot vient vraisemblablement de l'allemand muffel, qui qualifie un chien moufflard à grosses lèvres pendantes. (Littré, dictionn.) - (06) |
| môflot, otte, adj. gonflé, boursouflé. se dit principalement du pain lorsque la pâte est bien levée et, par extension, du bon pain en général. - (08) |
| môghe. : (Pron. meuche), couronne de pain. En Picardie, miche, du bas latin micha, dit M. l'abbé Corblet. - D'après Sheler, le mot miche, usité aussi en Bourgogne, viendrait du flamand micke, signifiant pain de froment large et épais. - (06) |
| mognan : Moue. « Fare le mognan » : faire la moue. Moins employé que « fare la môe ». - (19) |
| mògne, s. f., force et adresse du joueur de billes : « Ol a d'la mogne ; à poque de joliment loin. » - (14) |
| mogne. Terme enfantin du jeu de billes. Faire mogne est l'action de rentrer le pouce de la main droite dans le poing ferme pour lancer la bille : la main ressemble alors à un moignon. - (13) |
| moi tô, loc. moi aussi. - (24) |
| Moi. Mois. - (01) |
| moi. : (Dial.) Ce pronom personnel joue dans le dialecte bourguignon le même rôle que miki dans le latin. Il fait fonction de complément indirect sans exiger la préposition comme en français. - (06) |
| moichenai - moissonner. - I ons bein pour trouas semaingnes ai moichenai. – En faurot que vos moicheneussains ce champ lai àjedeu. - (18) |
| moichener, mouécheneb, v. a. moissonner, faire la moisson. - (08) |
| moichenou, mouéchenou, ouse, s. moissonneur, moissonneuse. mouchenou. - (08) |
| moichenoux. s. m. Moissonneur. (GuilIon). - (10) |
| moich'ner. v. a. Moissonner. (Girolles, Avallonnais en général). - (10) |
| moichon, mouéchon, s. m. moisson, récolte des céréales. « mouchon. - (08) |
| moichon. s. f. Moisson. - (10) |
| moicter (v. int.) : cancaner, en parlant du canard - (64) |
| moïen, sm. moyen. - (17) |
| moïeu : moyeu - (51) |
| moigner (v.t.) : mener - (50) |
| moigner, v. a. mener, conduire : « moigne-moué ai m'lin », mène-moi au moulin. - (08) |
| moigniau : moineau - (60) |
| moignin : beaucoup. (RDR. T III) - A - (25) |
| moigre. Maigre, maigres. - (01) |
| moijette, moïette, moijotte, moïotte et moujotte. s. f. Jaune d'œuf. Se dit pour mieuf, moieuf, milieu de l'œuf, qui en effet est composé du jaune. - (10) |
| moijotte : voir : lambiche. - (58) |
| mo-illard. Mouillé, humide ; marécageux. - (49) |
| moïlle n.f. Endroit humide. - (63) |
| moïlle n.f. Pré humide, zone humide en général. - (63) |
| moille, ll mouil. s. f. mûre, fruit de la ronce. - (08) |
| mo-ille. Terrain humide, marécageux. - (49) |
| moilli : mouiller - (51) |
| moïlli d'pyou loc. Trempé par la pluie. - (63) |
| moïlli d'tsaud loc. En sueur. - (63) |
| moïlli v. Mouiller. - (63) |
| moilli : v. mouiller. - (21) |
| moïllire n.f. Pré humide ; on dit aussi une moïlle. - (63) |
| moillô : s. m. gros tas. - (21) |
| moillou - meilleur. - Tenez, peurnez ce moton qui c'â le moillou, croyez-moi. - Lai chicorée, à, selon moi, lai moillouse des salades. - (18) |
| moilloux : meilleur. - (32) |
| moilou, oure, adj. morveux. environ de Lormes. - (08) |
| moim’ment, adv. même, de même, même-ment. - (08) |
| moime. Même. - (01) |
| moin, Moins. - (01) |
| moince, s. f. mouche : «aine miçante moince », une mauvaise mouche. - (08) |
| moinche : manche (de vêtement) - (48) |
| moinche : manche. - (29) |
| moinche, manche. - (02) |
| moinche, s. f. manche d'un vêtement. le manche d'un outil se prononce « moinge. » « mance. » (voir : moinge.) - (08) |
| moinchot, minchot, otte, adj. et s. manchot, celui qui est estropié de la main ou du bras. (voir : manguin.] - (08) |
| moindre : s. m, et f., cadet, cadette. - (20) |
| moindri - même sens que Foindu, surtout pour dépérir. - Depeu lote malheur qui lioz-é airivé, al é bein moindri. - (18) |
| moine : s, m., sabot, toupie qu'on fait tourner avec un fouet. - (20) |
| moine, mouène. n. m. - Toupie en bois. - (42) |
| moiné, n. masc. ; jeune enfant ; note moiné, al ost ben gentil. - (07) |
| moine, robe d'enfant. - (05) |
| moine, s. m. Toupie. - (10) |
| moine, s. m., appareil pour chauffer le lit. - (40) |
| moine, subst. masculin : toupie en forme de champignon que l'on fait tourner en la fouettant. - (54) |
| moineai, s. m. petit enfant, le plus jeune, le plus petit : «mon p'tiô moineai ». - (08) |
| moinge - manche. - Le moinge de mon coutais à mairquai ai mon nom. - Regairde don quemant té déchirai lai moinge de tai veste. - (18) |
| moinge (n.m.) : manche d'outil - (50) |
| moinge : manche (d'outil) - (48) |
| moinge : le manche d'un outil. - (33) |
| moinge, s. m. manche d'outil, poignée que l'on adapte à un instrument ou à un ustensile quelconque. - (08) |
| moinge. s. f. Manche. - (10) |
| moingeotte, noinzotte. s. f. Manche. (Ménades, Domecy-sur-le-Vault). - (10) |
| moingerons. s. m. pl. Sorte de demi-manches qui se mettent par dessus celles de l'habit pour les garantir. - (10) |
| moingne, s. m. robe d'enfant, robe que portent les petits garçons jusqu'à l'âge où ils prennent les vêtements de leur sexe. - (08) |
| moinme (adj.) : même (aussi mouême) - (50) |
| moinme , adj. des deux genres. même, qui n'est pas différent : « ç'ô l' moinme haibi qu'i é mettu oj'deu », c'est le même habit que j'ai mis aujourd'hui. - (08) |
| moin-me ou moin-ment : Même. « Ol est toje la moi-me ». - (19) |
| moinme - même. – Ile â venue lé moinme nos cherchai. - Vos éte arrivai ai lai moinme heure que z-eux. - (18) |
| moinmeman (adv.) : de même, mêmement - (50) |
| moinnard, mouinard. s. m. Celui qui nasille, qui parle du nez. – Se dit aussi d'un enfant qui a l'habitude de sucer son pouce, son poignet, son mouchoir ou autre du même genre. - (10) |
| moîn-ne (on) : religieux - (57) |
| moin-né : minuit - (43) |
| moinre : malingre - (39) |
| moinre, adj. comp. des deux genres. moindre : « l’ pu moinre », le plus petit, le plus jeune. - (08) |
| moinre, adj., nuindre, diminué. - (14) |
| moinreté, s. f. faiblesse, défaillance. - (08) |
| mo-in-rou, malheureux. - (26) |
| moins ! interj. puisqu'il le faut ! Se place à la fin d'une phrase : finiras tu par consentir ? — oui, moins ! - (24) |
| moins ! interj. puisqu'il le faut ! Se place à la fin d'une phrase : finiras-tu par consentir ? — oui, moins ! - (22) |
| moins (au) : loc, adv. Au moins il fait, au moins il veut faire. Au moins on a, au plus on dépense. Voir plus. - (20) |
| moins cinq..., moins deux..., moins une (sous-entendu minute) (être) : loc. s'employanl au sens impersonnel, être sur le point de. - J' l'ai pas engueulé, mais c'était..., - Moins cinq, n'est-ce pas ? - Non, moins une... » - (20) |
| mointe. Mainte. C'est le féminin de maint, vieux mot qui a encore bonne grâce dans le sublime enjoué… - (01) |
| mointenan. Maintenant. On dit que maintenant vieillit ; mais, peut-être, ne dira-t-on de longtemps : il est vieux. - (01) |
| moinze - (39) |
| moiquian, moitian. s. m. Milieu. (Etivey). - (10) |
| moire : s. m., vx fr. moie (fém.), foule, multitude. - (20) |
| mois d'avri : Poisson d'avril, farce qui consiste à charger un naïf d'une commission absurde, par exemple l'envoyer chercher « In meule de boudin dans eune heute ». - (19) |
| moise : voir pressoir. - (20) |
| moise, s.f. partie d'un arbre à pressoir. - (38) |
| moise. n. f. - Fange, excrément liquide en putréfaction. (Champcevais, selon M. Jossier) - (42) |
| moise. s. f. Fange, excréments liquides en putréfaction. (Champcevrais). - (10) |
| moiseaul. : (Du mot latin macellum, venant lui-même du grec), marché. (Coutumes de Châtillon, 1371.) - (06) |
| moison. Maison, maisons. - (01) |
| moison. s. f. Loyer d'une terre payé en nature, moyennant une quantité de grains déterminée. Du bas latin moiso, et de mois, traité par lequel un laboureur s'oblige à cultiver et ensemencer les terres d'une métairie, à condition d'en partager les fruits avec le propriétaire. - (10) |
| moisse : s, f., paquet. Une moisse de villons. - (20) |
| moisse, adj., moite, humide : «Alle a métu dans son ormoire son linge tout moisse. » - (14) |
| moisse; s. f. petit paquet d'osiers fins. - (22) |
| moisse-ner : (vb) moissonner - (35) |
| moiss'né, moissonner. - (16) |
| moissonous, moissonis : moissonneurs - (43) |
| moitan, milieu, moitié. - (05) |
| moitan. s. m. Milieu. (Rugny). - (10) |
| moitéon. : (Du rég. latin modium), mesure de grains.- Mettre le blé dans la trémie s'exprimait par amboisier (in bocca pulsare). - (06) |
| moitie, moitié. - (05) |
| moitier. : (Dial.), mesurer. (Du latin metiri.) - (06) |
| moitre. Maitre, maitres. - (01) |
| moiyou, meilleur. - (16) |
| moi-z-i, moi-z-en, euphonies très usitées : « Dis-moi-z-i ; baille-moi-z-en. » - (14) |
| mola : meule de pierre - (51) |
| molâ : Monticule. Nom de lieu : « Su le Molâ ». - (19) |
| molâ[y]é : malaisé, difficile, incommode. - (52) |
| môlàdresse, maladresse. - (16) |
| moladze, totato : farine grossière, concassage - (43) |
| mol'âgé : malaisé, difficile. Le manche mal fait o mol'âgé : le manche mal fait est malaisé. - (33) |
| molaî n.m. Talus, haut d'un pré. - (63) |
| môlai. Mollet, mollets : Siège môlai, siège mollet. Mais quand on dit « un ô môlai », alors c’est un os moëlleux… - (01) |
| molaidroit - maladroit, outre les sens ordinaires du français : difficile, incommode. - Les chemins sont molaidroits quemant tot pour quéque gottes de plieue qu'ant choué hier. - Vos faisez lai in ovraige bien molaidroit ; moi i n'en vourâ point. - (18) |
| molaidroit : (mô:lèdrouè) maladroit. - (45) |
| molaidrouet (n.m.) : maladroit - (50) |
| môlaige (n.m.) : mêlange - (50) |
| môlaige, n. masc. ; mélange. - (07) |
| môlaige, s. m. mélange, réunion préparée ou fortuite de choses diverses ; confusion. - (08) |
| molaille : (môlâ:y’ - adj. inv.) mal à l'aise, embarrassé. Le mot a un sens essentiellement physiologique, et s'emploie surtout en parlant de troubles digestifs. - (45) |
| molain, molot. - Divers temps du verbe Môre. - (18) |
| molaisé : (môlâ:zé - adj.) difficile, abrupt. - (45) |
| môlaisse. Mollesse, mollesses. - (01) |
| molasille - malaisé, difficile à faire. - Ne l'i beillez pâ cequi c'â trop molasille ai fâre pour lu. - An n'y é ran de pu molasille ai écorchai que lai quoue. - Oh ! ç'â in caractère tot ai fait molasille. - (18) |
| molassou : mou - (48) |
| môlater : (vb) moudre, mouliner - (35) |
| môlater : moudre, mouliner - (43) |
| mòlaton, s. m. petite meule de moulin. - (24) |
| môlayé - (39) |
| molâyé : (mô:la:zyé) difficile. - (45) |
| molâyé, molâsié : difficile, malaisé - (48) |
| môlâziye, malaisé. - (16) |
| molé : monticule (en B : moli). A - (41) |
| môlé : (nm) colline, talus - (35) |
| môle : Meule « Eune môle de foin » : une meule de foin. « Aiguji in cutiau su la môle » : aiguiser un couteau sur la meule. « Eune môle de m'lin » : une meule de moulin. - (19) |
| môle : n. m. Moule. - (53) |
| môlé, mêler, mélanger ; s'môlé d'une affaire, s'entremettre pour sa réussite. - (16) |
| môle, s. f., meule à moudre, à aiguiser. - (14) |
| môle, s. m. mélange, à peu près le même sens que « môlaige. » Se dit principalement du foin et de la paille qu'on mêle ensemble pour la nourriture du bétail : faire le « môle », donner du « môle. » - (08) |
| môlé, vt. mêler. - (17) |
| mole. s. m. Assemblage, amas de choses semblables réunies en un même corps. Un mole de cercles. Du latin moles. - (10) |
| môlée (pour mêlée). s. f. Méteil, mélange de froment et de seigle. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| môlège : mélange d'orge et d'avoine) - (48) |
| môlège : mélange - (48) |
| môlège : (mô:lèj' - subst. m.) mélange d'avoine et d'orge ; voir aussi kèrâ:m'. - (45) |
| môler (v.t.) : mêler - (50) |
| môler : mêler, mélanger - (48) |
| môler : mélanger - (39) |
| môler, v. a. mêler, mélanger, emmêler, confondre. - (08) |
| môler, v. mêler. - (38) |
| môler, v. tr., mêler, brouiller, confondre. - (14) |
| molère : terrain marécageux (en B : molire). A - (41) |
| molési : difficile, malaisé - (43) |
| môlet : colline, talus - (43) |
| molet : petite butte - (51) |
| molette : languette de pain allongée pour tremper dans l'œuf à la coque, ou pour une sauce. - (30) |
| molette : rotule. - (32) |
| molette : s. f., pain (petite meule) de beurre. - (20) |
| môleure, s. f. mélange de foin et de paille qu'on donne aux animaux. (voir : môle.) - (08) |
| môleure. s. f. Paille et foin mêles. - (10) |
| môlie, sf. mêlée. - (17) |
| môli-môlo se dit de personnes et de choses très mélangées. - (16) |
| môli-môlo, pèle-mêle. - (38) |
| molin : (nm) moulin - (35) |
| mòlin, 1. s. m. moulin. — 2. adj. se dit d'un terrain facilement humide et saturé d'eau. - (24) |
| môlin-môlo, adv. mêli-mêlo, mélange confus. - (08) |
| molin-molot. Synonyme patois pêle-mêle... - (13) |
| molire : dépression humide dans un pré - (43) |
| molleton n.m. Tissu destiné à emmailloter un bébé préalablement revêtu d'une pointe. - (63) |
| molli : monticule - (34) |
| mo'lli ou mou'llin : Mouiller. « I plio fin mâ i mo'lle greu » : il tombe une pluie fine qui mouille beaucoup. - Le verbe a deux participes : mô, « Je sus mô » : je suis mouillé. Féminin môle, « Ma reube est môle » ; mouilli, « J'ai mouilli ma chemise ». - (19) |
| mo'llin : Humide. « In pré mo'llin » : un pré humide. - (19) |
| mo'lliot : Ce que l'on met dans la bouche pour provoquer la salivation et se rafraîchir. « Chuche dan eune greume de raijin pa te fare mo'lliot » : suce donc un grain de raisin pour te rafraîchir la bouche. Autrefois les fileuses avaient sur la tablette de leur « chambalère » une provision de cerises séchées au four qui leur servaient de « mo 'lliots ». - (19) |
| mollire : terrain marécageux - (34) |
| mollot, moullot, otte. adjectif. Mou, mouillotte synonyme de blosse. Une poire mollotte. - (10) |
| môloinge. s. m. Mélange. (Vassj-sous-Pisy). - (10) |
| môlon : (nm) mie du pain - (35) |
| môlon : mie de pain - (43) |
| mòlon, s. m. la mie du pain. - (24) |
| molosse, moulosse, nom de loc. une des formes locales de meloise. dans q.q. parties du Morvan-Nivernais on prononce « m'lôllhe. » (voir : meloise, mouéillaisse.) - (08) |
| Molot. Lieu dit de la commune de Savigny, situé près de la voie romaine.... - (13) |
| môlou : endroit pour mélanger le foin entre le fenil et l'étable - (39) |
| molû (n.m.) : mêloir, coin de l'écurie où l'on emmagasine le foin qui vient du fenil pour le distribuer aux animaux (aussi abat-foin) - (50) |
| mòlûye, s. m. le jaune de l'œuf. - (24) |
| moman, subst. féminin : maman. - (54) |
| momayoux : Brumeux. « I fa in temps mornayoux » : il fait un temps brumeux, un peu triste. - (19) |
| môme, adj., sot, stupide : « C'tu gas ? Y é ben l'pu môme de cheû nous. » - (14) |
| môme, s. m., enfant, gamin. - (14) |
| Mome. Nom de famille dans la contrée. - (08) |
| momener : (mô:m'nè) malmener, maltraiter. - (45) |
| mômengn'. s. m. moment un instant. - (08) |
| momnsieur (n.m.) : arum tacheté (on peut aussi écrire mon-sieur) - (50) |
| momuer. v. - Changer, en parlant du temps ; « l'temps i' s' momue. » (Sougères-en-Puisaye). Néologisme formé sur le verbe muer. - (42) |
| mon Dieu ! se dit souvent pour hélas ! El à don teûjo m’lède ? demande-t-on en parlant d'un malade et parce qu'il continue à l'être, on répond : Mon Dieu voui ! Dans cette réponse il y a quelque chose de plus sentimental que dans voui, tout court. Autre signification : on demande à quelqu'un s'il veut faire une chose et parce qu'il ne veut pas la faire, il répond ironiquement : Mon Dieu voui, pour certainement non ; dans le même sens on dit : Prenez-y garde ! - (16) |
| mon n’heûrloze : mon horloge - (37) |
| mon, mo dj. poss. Mon. Voir mo. - (63) |
| mon. Mont : Le mon Carmai, le mont Carmel. - (01) |
| monard : (prononcer mon - nard) canard. Ex : "Ils sont bin beaux mes mon-nards à c'tan - née !" - (58) |
| monche : une mouche (voir : môche), mouche à mises (prête à pondre des œufs). - (56) |
| monche à miez. s. f. Mouche à miel. (Perreuse). - (10) |
| monche. n. m. - Mouche. - (42) |
| monchieûrs (dâs) : (des) gens riches, (des) châtelains - (37) |
| monde : les gens - (61) |
| monde de Dieu, l'univers ; an n'é jaimà vu s'ki au monde de Dieu. - (16) |
| monde : s. m. S'emploie comme nom collectif au singulier et au pluriel, sans accord forcé avec le verbe. Du ch'tit monde. — Des grands mondes (de grandes personnes). - (20) |
| monde : signifie les gens - (39) |
| monde, ce mot reste inexpliqué dans cette locution : é trévoéye tan k'au monde el é d'force : il travaille autant qu'au monde il a de force. - (16) |
| mondé, ée. adj. Qui vient au monde, qui donne des signes de vie. Se dit, à Etivey des graines qui sont levées, d'un enfant qui remue dans le sein de sa mère, d'une fleur, d'un fruit qui se forme. - (10) |
| monde, n.m. famille (demain, je reçois mes mondes). - (65) |
| monde, s. m. collection de gens : c'est du bon « monde » ; c'est du « monde de ran ». - (08) |
| mondé, séparer le fruit de la noix des coquilles brisées. Ce mot dérive du latin mundare, nettoyer, purifier. - (16) |
| monder v. Emonder. - (63) |
| monder : v. a., vx fr., émonder. - (20) |
| monder, v. sortir la noix de sa coquille. - (38) |
| monder, v. tailler (la vigne). - (65) |
| monder, v., sortir la noix de sa coquille. - (40) |
| monder. v. n. Faire le triage, le cassage et le nettoyage des noix ; ce qui s'opère dans les soirées d'hiver. (Lindry). Du latin mundare. - (10) |
| mondises. n. f. pl - Débris de démolition, gravats. (Perreuse, selon M. Jossier) - (42) |
| mondises. s. f. pl. Débris de démolitions. (Perreuse). C'est une syncope d'immondices. - (10) |
| mondon : s. m., sarment stérile qu'on coupe ou monde pour renforcer les branches fructifères. - (20) |
| mongir, manger. - (05) |
| moni, caricature, personne mal faite... - (02) |
| môni, moñni, mouñni n.m. Meunier. - (63) |
| moniau : Moineau. « In piége à moniaux » : un piège pour prendre les moineaux. - (19) |
| moniau n.m. Moineau. - (63) |
| moniau. Moineau. - (49) |
| môniment, s. m. monument : « ain biau môniman. » - (08) |
| monio : moineau - (43) |
| monisse, religieuse... - (02) |
| Monla : Montlay-en-Auxois - (48) |
| monme, meinme, pron. même. - (17) |
| monnaite. Monnaie, argent. Terme fourni par les Polonais travaillant à la mine pendant la guerre de l9l4. - (49) |
| mon-ni : meunier - (43) |
| monnoie : Monnaie. « J'ai pas in sou de monnoie ». - (19) |
| mons, s. m. s'emploie quelquefois pour monsieur et dans une acception mélangée de respect et de familiarité. - (08) |
| Monsieu Peti. Sur ce que la maison de M. l’avocat Petit, homme fort poli, était à rentrée de la rue de la Roulôte, le poète prend de là occasion de feindre qu’il s'en était éloigné le plus qu'il lui avait été possible, fuyant, comme un air dangereux pour lui, le voisinage d'un puriste. - (01) |
| mon-sieu : monsieur - (39) |
| monsieu : monsieur. Personnage notable. Egalement dérive ironique. Ex "Y'a pas d'sous, mais y font les Monsieuuu". - (58) |
| monsieu, s. m. on prononce mon-sieu en traînant sur la première syllabe. - (08) |
| monsieu. Monsieur : « Dé monsieu », pour des messieurs. Le menu peuple de Paris, et les villageois des environs, ne parlent pas autrement. - (01) |
| monsieur, mossieu : s. m., cochon. Not' Mossieu se dit à la fois du cochon et du... propriétaire. - (20) |
| monsieur, n.m. orgelet. - (65) |
| mont (A). Locut. adv. A la montée ; dans le courant de. A mont de l'escalier. A mont de l'année. (Annay-sur-Serein). - (10) |
| mont (è), en montant. - (27) |
| mont, s. m. dans plusieurs locutions le mot signifie haut. - (08) |
| montagnâ (on) : montagnard - (57) |
| montagnard : s. m., vairon, - (20) |
| montain. s. m. Petite montée. (Soucy). - (10) |
| montaingne, sf. montagne. - (17) |
| montaivi, adj. persuadé, disposé à croire : « i seu montaivi qui l'é veu », je suis persuadé que je l'ai vu. - (08) |
| montan. Montant. - (01) |
| montcha (na) : montée - (57) |
| montè : v. i. Monter. - (53) |
| montée (ai lai), loc. prép. en haut, en montant, en avant. - (08) |
| montée, s. f. montagne. - (08) |
| monténgne, montagne ; monténgnon, montagnard. - (16) |
| monter ai pairis : aller à paris pour s’y établir - (37) |
| monter l'job loc. Monter la tête (à quelqu'un). Tromper, mentir, duper, arnaquer. Seul cas d'emploi de job pour tête. - (63) |
| montire. Montâmes, montâtes, montèrent : « Ne montire pas fraise », pour dire ne purent tant soit peu résister ; façon de parler empruntée du proverbe dont on se sert à Dijon lorsque, pour exagérer l'appétit d'un grand mangeur, on dit qu'une longe de veau ne tiendrait pas plus de place en son estomac qu'une fraise en la gorge d'un loup. - (01) |
| montrai. Montrer, montré, montrés. - (01) |
| montrance. s. f. Echantillon de blé, d'orge ou d'avoine, dont la vente est proposée et qu'on s'oblige à livrer conforme. Vendre, acheter sur montrance, vendre, acheter sur échantillon. - (10) |
| montre, s. f. ce qu'on montre, échantillon qu'on propose aux acheteurs : « i é deu bon soueille, i vô-z'-en pourteré d' lai montre », j'ai du bon seigle, je vous porterai un échantillon. - (08) |
| montré. Montrez. - (01) |
| montrein. Montrions, montriez, montraient. - (01) |
| montrion. Petite montre. - (49) |
| moque : s. f., vx fr., moquerie. Faire la moque à quelqu'un. - (20) |
| môque, moquerie. - (02) |
| mòque, s. f., moquerie, raillerie, grimace : « Voui, quand ô vous dit qu'éte chouse, y é tôjor eùne mòque. » - (14) |
| moque. s. f. Moquerie, raillerie. Aux moqueux la moque, dit un proverbe très répandu. - (10) |
| moqueu. : (Moqueur). On disait lé moqueù de Dijon, à cause de l'institution de la Mère folle qui censurait les ridicules. - (06) |
| moqueux : moqueur. Moqueux d'bétes : qui aime à se moquer des imbéciles. - (52) |
| moqueux adj. Moqueur. - (63) |
| moquieu. s. m. Monsieur. Moquieu, i me fait mau. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| môquo. Moquais, moquait… - (01) |
| moquou (on) : moqueur - (57) |
| moquôu (re) : moqueur (euse) - (39) |
| moquoû : moqueur - (48) |
| moquou : moqueur, ironique. - (62) |
| moquoû, adj., moqueur, gouailleur. - (14) |
| moquou, ouse, adj. moqueur, celui qui se moque, qui raille, qui se joue de quelqu'un. - (08) |
| moquoux : Moqueur. « Ol a toje l'ar moquoux» : il a toujours l'air de se moquer des gens. Au féminin : moquouse. - (19) |
| moquû, moquoû (-ouse) (n.m. ou f.) : moqueur (-euse) (moquûs, moquoûs, s ou x pour le pluriel) - (50) |
| mor : Groin. « In mor de cochan » : un groin de porc. - (19) |
| môr, adj., mort. Se dit déjà d'un moribond. - (14) |
| mor. Mort, morts. - (01) |
| môr. s. f., la mort, fort appréhendée des paysans malades. - (14) |
| mora, mûre. - (54) |
| morain, moraine : adj., blanc et noir. Se dit de la robe des animaux de l'espèce bovine. - (20) |
| moraler. Donner des conseils de morale. Réprimander. - (49) |
| morçais : morceau - (48) |
| morcea. Morceau, morceaux. - (01) |
| morceai, s. m. morceau, fragment : « eun morceai d' pain ; eun morceai d' terre. » « mourciau, mouciau. » - (08) |
| morceaillon : voir morsaillon. - (20) |
| morcei. Mercier, marchand, merciers, marchands. - (01) |
| morchâiller, morchiller, mâchonner. - (38) |
| morchailler, v., machouiller. - (40) |
| Morchétiau : Nom de lieu. Morchétiau est une colline assez élevée située à l'Est du village de Mancey et d'où l'on domine les ruines du château de Dulphey. - (19) |
| morchiller, v. tr., mordiller, mordre à petites dents : « O n'a point d'opétit ; quand ô mainge, ô morchille. » - (14) |
| morciau (on) : morceau - (57) |
| morciau : Morceau. « In morciau de lâ » : un morceau de lard. - (19) |
| morciau, et mourciau, s. m., morceau, fragment. - (14) |
| mordé (n.m.) : chiendent - (50) |
| môrde v. Mordre. Mordu du tsin, mordu du loup... C'est du pareil au même. - (63) |
| mordé, s. m. chiendent. - (08) |
| môrde, v. tr., mordre. - (14) |
| mordiantre - exclamation, espèce de juron. - En ne feillo pu que cequi !... mordiantre !! - Synonyme de Mordié qui veut dire mort de Dieu, et que l'on a remplacé par Mordiantre qui signifie mort du Diable. - (18) |
| mordon : mouron. - (30) |
| mordue. s. f. Morsure. - (10) |
| môre, môrot – moudre. Dans divers temps l'r est remplacé par une l ; ainsi Molot, Moleussaint, et dans ce cas on ne met point d'accent circonflexe. - En fauro de lai plieue pour môre ; les rivéres sont ai so. - Le munier molot de l'orge quand i sons venus aivou note bliet. - Si a velaint a môraint bein ajedeu. - I vourâ bein que vos me moleussains tot de suite. – A melin de lai Bussiére en môrot mieux. - (18) |
| moréee : talus - (44) |
| môrer (v. tr.) : mordre - (64) |
| morfouiner : embrasser à pleines lèvres. - (30) |
| morgeoillon, morgeoillonne : s, m, et f., dim, de morgeon, morgeonne. - (20) |
| morgeon : enfant malingre. (CH. T III) - S&L - (25) |
| morgeon, morgeonne : s. m, et f., enfant, Ch'tit morgeon. - (20) |
| morgiller : déchiqueter avec les dents - (60) |
| morgognai, diminutif de morguai, c.-à-d. fixer avec impertinence ses regards sur une personne qui nous reprend. - (02) |
| morgogner, marmotter entre ses dents des choses désagréables pour manifester sa mauvaise humeur ou son mécontentement. - (27) |
| morgonai ou morguenai – murmurer (ordinairement tout seul), se plaindre avec mécontentement. - Le drôle de caractère! tôjeur é morgonnai !... chien de morgonou ! et de morgonou, aito !! – Ecoute lai, lai morguonouse ! - (18) |
| morgonè : ronchonner, marmotter entre ses dents - (46) |
| morgoné, murmurer en reprenant quelqu'un ou en se plaignant d'une chose. - (16) |
| morguiller, déchiqueter avec les dents (par ex.: une pomme). - (27) |
| morguoner : ronchonner, parler entre ses dents - (51) |
| möri, vn. mûrir. - (17) |
| moriale : (nf) aster - (35) |
| moricaud, -aude n. (de more). Péj. Arabe, individu au teint basané. - (63) |
| moricaud, s. m., métis à teint basané. - (40) |
| morico ou moricho. : Raisin d'un noir foncé. - On donne aussi ce nom aux enfants dont la figure est noircie ou malpropre et aux vendangeurs qui se teignent la face avec le moût de raisin. - (06) |
| morico, raisin très-noir, couleur d'un Maure. On donne aussi ce nom à ceux qui ont les lèvres ou la figure teintes du moût de raisins. C'est encore l'épithète que les mères donnent à leurs enfants quand ceux-ci ont la figure malpropre. - (02) |
| morillon. s. m. Petit mors de cheval. (Armeau). - (10) |
| morillonner. v. a. Mettre morillon, museler. (Saint-Florentin). - (10) |
| mòrjon, s. m. terme de mépris adressé à un enfant. - (24) |
| morle n.m. Support du corbillon, assemblage préparatoire à sa confection. - (63) |
| morle, moule : moule de corbeille employé au début de sa fabrication et coupé ensuite - (43) |
| mornan : Chasselas. « Eune traille de mornans » : une treille de chaselas. - (19) |
| mornant : s, m., raisin blanc de treille. - (20) |
| morne : Anneau qui sert à fixer la faux à sa monture. - (19) |
| mòrne, s. f. anneau fixant la faulx à sa monture (vieux français). - (24) |
| mornichâ, mornichoux n. ou adj. Morveux. - (63) |
| morniche n.f. Morve. Voir poreau. - (63) |
| mornicher v. Renifler. - (63) |
| mornicher, mornifler : v. n., renifler. - (20) |
| morniffe : gifle - (39) |
| morniffle, coup sur la face... - (02) |
| mornifle : gifle, humiliation - (60) |
| mornifle, s. f., gifle, claque. - (40) |
| mornifle. s. f. Soufflet, gifle. - (10) |
| mornifle. Soufflet, tape, coup de poing dans la figure. - (49) |
| moron et mouron. Mûre sauvage. - (03) |
| môron, mouron (petite herbe). - (16) |
| môron, s. m., mouron « pour les petits oiseaux » - (14) |
| Morpiarre : Nom de lieu. La Morpiarre est près de Morchétiau. On a découvert à la Morpiarre, il y a quelques années de nombreuses sépultures gallo-romaines. - (19) |
| morsaillon, morceaillon : s. m., vx fr. morsillon et morcillon : petit morceau. - (20) |
| morsiller : v. a., vx fr., mordiller. - (20) |
| mort, s. m. travailler à mort, c'est travailler avec énergie, avec l'emploi de toutes ses forces. - (08) |
| mortaille, s. f. mortaise, entaille dans le bois. « mortôllhe, mortoie, mortôje. » - (08) |
| mortaille, s.m. mortier à sel. - (38) |
| mort-a-pêche (mortapêche) : s. f., crin de Florence. - (20) |
| mort-a-vers (moraver) : s. f., syn. de contre-vers (voir ce mot). - (20) |
| mortcher. s. m. Mortier. (Béru). Par conversion de l'i en ch. - (10) |
| mortchier : mortier - (39) |
| morté : Mortier. « Le sab'lle roge de Drefy ne fa pas du ban morté » : le sable rouge de la carrière de Dulphey ne fait pas du bon mortier. - Egrugeoir. Autrefois le morte était l'un des ustensiles de ménage les plus indispensables : à la campagne on n'avait que du gros sel qu'on égrugeait avec un pilon de buis dans un mortier en pierre. - (19) |
| morte, s. f. eau stagnante ordinairement cachée sous l'herbe des prairies, terrain mouvant et formant une espèce de puits où l'eau dort. - (08) |
| morte. Petite étendue de terrain marécageux et mouvant. - (49) |
| morteler. v. n. Préparer le mortier. Se dit quelquefois par les maçons. - (10) |
| môrtes : tourbières, vasières, centre de la mouille - (43) |
| morti (du) : mortier - (57) |
| mòrti, s. m. 1. mortier de maçon. — 2. Mortier à piler le sel. - (24) |
| mortier (nom masculin) : grand cuvier en bois de chêne dans lequel on faisait autrefois la lessive. - (47) |
| mortoise : Mortaise. - (19) |
| morts (Les) : s. m. pl. Les Grands Morts, la fête de Tous les Saints (1" novembre). Les Petits Morts, la Fête des Morts (2 novembre). - (20) |
| mortuaire : s. m, acte mortuaire. - (20) |
| mortuel, s. m. extrait mortuaire, pièce authentique constatant le décès d'un individu : on ne sait ce qu'il est devenu et on attend son « mortuel. » - (08) |
| mortuel. adj. Mortuaire. Acte mortuel, acte de décès. (Sommecaise). - (10) |
| mortuelle : s. f., vx fr. (Littré, v Mortuaire), syn. de mortuaire. - (20) |
| moru, morue : adj., morveux, morveuse, qui a de la morve au nez. - (20) |
| moru, s. m. et adj. qui a besoin d'être mouché. - (24) |
| morvaille. Merveille ; on dit aussi en bourguignon marveille… - (01) |
| morvaloux n.et adj. Morveux. - (63) |
| morvaloux, morvalouse : adj., morveux, morveuse. - (20) |
| morvan : vent du nord-ouest. A - B - (41) |
| morvan n.m. Vent du Morvan (nord-ouest) appelé aussi la travérse. - (63) |
| Morvan. quelques auteurs contemporains, infidèles en cela à la tradition, écrivent Morvan avec un d. c'est une innovation qui ne s'appuie sur rien et que rien ne justifie… - (08) |
| morvande, s. f., vent du Morvan. - (40) |
| Morvandeau, s. m. Morvandelle, s. f. homme, femme ou fille du Morvan. — Morvandelle, s. f. bûche qui est trop grosse pour entrer dans la pile de moule avant qu'elle ait été fendue. (voir : gorne.) - (08) |
| morvandélle (n. et adj.f.) : morvandelle - (50) |
| morvandiau : s. m., vent du nord-ouest. - (20) |
| morvandiau, delle, s. m. et f., habitant du Morvan. - (14) |
| morvandjeaû : morvandeau - (57) |
| morvandjo : conducteur de bœufs ou débardeur, originaires du Morvan. A - B - (41) |
| morvange (n.m.) : vent d'ouest aux environs d'Autun - (50) |
| morvange, s. m. on trouve quelquefois ce mot dans les anciens actes pour désigner le vent du Morvan, c’est à dire le vent d'ouest par rapport à une partie de la région. Le terme était notamment usité aux environs d'Autun. - (08) |
| morvange, s.f. vent du nord-ouest (de Morvan). - (38) |
| morvasse, s. f. morveuse. se dit d'une petite fille très amicalement. - (08) |
| morvasse. s. f. Petite fille des rues, gamine, morveuse. - (10) |
| morvelle, morvellon, mourvillon. Morve ; humeur visqueuse qui s'écoule du nez. - (49) |
| morvellou (ze) : (adj) morveux (se) - (35) |
| morvellou : une personne dont le nez coule - (44) |
| morvelloux. Morveux. Fig. Jeune homme pédant. - (49) |
| morvelou : personne mal mouchée, ayant le nez qui coule. A - B - (41) |
| morver, v. n. rejeter de la morve, des mucosités. - (08) |
| morviat (n. m.) : morve qui coule du nez - (64) |
| morviau, mourviau. Même sens que « morvelle ». - (49) |
| morviau, s. m., morveau, amas de morve. - (14) |
| morvoû, adj., morveux, mal mouché. - (14) |
| morvou, ouse, adj. morveux, morveuse. - (08) |
| mos (ō), sm. mois. - (17) |
| moseure, s. f. masure. - (22) |
| moson, s. f. maison. La cuisine seule. - (22) |
| môsse : mousse - (43) |
| mossieu : Monsieur, citadin, bourgeois. « Mossieu le Mâre ». « J'étais habilli de pi en tête tot c'ment in mossieu ». - (19) |
| môssieu. Monsieur. - (49) |
| môssieur n.m. Monsieur. - (63) |
| mossieur : n. m. Monsieur. - (53) |
| mot, adj. qual. ; mouillé. - (07) |
| mot, s. m. mot. le Morvandeau bourguignon prononce « mô. » s'emploie toujours au pluriel dans ces loc. usuelles : se dire des mots, avoir des mots, en venir aux mots, loc. qui signifient se quereller, se disputer. (voir : moût.) - (08) |
| möt, sm. mot. - (17) |
| motailloux : terrain recouvert de petites mottes de terre - (43) |
| motan : Menton. « Avoir de la barbe au motan » : avoir de la barbe au menton, être un grand garçon. « Habile du motan, habile du talon » : agile pour manger, habile pour travailler. - (19) |
| motché : moitié - (51) |
| mote, morte. - (27) |
| mote, motte : façon, manière, mode ; d'où faire à s' motte : faire à sa façon. - (56) |
| mòte, s. f., gazon. - (14) |
| mote. Morte, mortes. - (01) |
| motei. Mortier, en quelque sens que ce soit. - (01) |
| motenaille - les moutons, les bêtes à laine. - En y aivo bein de lai motenaille ai lai foire. - Lai motenaille à ine aifâre encore gros chanceuse ; lai mailaidie s'y met, ma foi, aissez souvent. - (18) |
| motené – Berger ; qui soigne les moutons. - Vos é lai in petiot motené que ne gairde diére bein. - Les motenés s'aibuyant ensenle, et les berbis devenant ce qu'a pouvant. - In bon motené c’â aissez rare. - (18) |
| moteûr ai crottin : cheval de trait - (37) |
| motiant, moitiant, sm. milieu. - (17) |
| motié, sf. moitié. - (17) |
| môton : (nm) mouton - (35) |
| moton : mouton - (43) |
| moton n.m. Mouton. - (63) |
| moton. Mouton. - (49) |
| motou : menteur. - (62) |
| motou : menteur. (LCSS. T IV) - S&L - (25) |
| motre, v., mettre. - (40) |
| motse adj. Moche. Ôl'don motse, l'poure gârs ! Qu'il est donc moche le pauvre garçon ! - (63) |
| môtse beusène : (tr. litt. : mouche à bouse) mouche plate des bovins (syn. en b : môtse canqueline). A - B - (41) |
| motseux. Mouchoir. « Un motseux de potse » (poche). - (49) |
| motsi : moucher - (43) |
| motsu : (nm) mouchoir - (35) |
| motte (na) : tertre - (57) |
| motte, matte. Tas de fumier. - (49) |
| motter. v. n. Parler, dire des mots. S'emploie presque toujours avec la négation. Il n'a pas motté, il n'a pas dit un mot. – Voyez moufller. - (10) |
| motterie : menterie. (T. T IV) - S&L - (25) |
| motyan, milieu. - (26) |
| mou (monté à), loc. grimper contre. - (22) |
| mou : humide - (61) |
| moû : mouillé - (37) |
| mou : mouillé (au féminin : moule). IV, p. 37-7 - (23) |
| mou tripé : très humide, trempé - (61) |
| mou : adj. m, (inusité au féminin en ce sens), mouillé. J’ suis sûre que t'as les pieds tout mous. - (20) |
| mou : mouillé. Ex : "Change don ton tricot, t'es tout mou !" - (58) |
| moù, moùe. adj. Mort, morte. Ail' ot moue, elle est morte. - (10) |
| mou, s. m. et adj. mort. Verbe meuri. — 2. adj. mûr. verbe mouri et mouraître. - (24) |
| mou, s.m. mot. - (38) |
| mou. adj. - Mouillé, détrempé: « l' fait trop mou pou' biner les blettes ! » - (42) |
| mouâ (on) : mort - (57) |
| mouâdre : mordre - (57) |
| mouai (pr.pers.1ère pers.s.) : moi - (50) |
| mouai : moi - (57) |
| mouai : pron. pers. Moi. - (53) |
| mouaichon : moisson. - (33) |
| mouaichon : n. f. Moisson. - (53) |
| mouaie (na) : maie - (57) |
| mouai-étou : moi aussi. - (33) |
| mouaigneau (nom masculin) : moineau. Petit oiseau. - (47) |
| mouainé : chétif. (RDR. T III) - A - (25) |
| mouaine : toupie à fouet, cruchon chaud dans le lit - (37) |
| mouaine-(n.m.) : moine - (50) |
| mouaineau (on) : moineau - (57) |
| mouainge : n. m. Manche d'outil. - (53) |
| mouainme : adj. Même. - (53) |
| mouaîn-ne (on) : moine - (57) |
| mouaire : pas beau, qui a mauvaise mine. (RDR. T III) - A - (25) |
| mouais (n.m.) mois - (50) |
| mouais (on) : mois - (57) |
| mouais. n. m. - Mois. - (42) |
| mouaiss'ner : moissonner - (57) |
| mouaiss'nou (on) : moissonneur - (57) |
| mouaisson (na) : moisson - (57) |
| mouaissonneuse : n. f. Moissonneuse. - (53) |
| mouaitchan (on) : milieu - (57) |
| mouaitché (na) : moitié - (57) |
| mouaiyin, mouéyin (adj.m.) : moyen - (50) |
| mouard’e : mordre (pique de ses rayons lorsqu’il s’agit du soleil) - (37) |
| mouard’e chu du fâr rouze (en) : (en) trépigner de colère - (37) |
| mouarde (v.t.) : mordre - (50) |
| mouârte (na) : morte - (57) |
| mouâsse : mouasse, village entre château-chinon et moulins-engilbert - (37) |
| mouch’ner : moissonner à la faucille - (37) |
| mouch’neûse-yieûse (lai) : (la) moissonneuse-lieuse - (37) |
| mouch’neûse-yieûse : moissonneuse-lieuse mécanique - (37) |
| mouchai, éteindre... - (02) |
| mouchan, moisson - (36) |
| mouche (na) - mouche à mi (na) : abeille - (57) |
| Mouché : nom de bœuf. III, p. 29-o - (23) |
| mouche à mi : s. f. abeille . - (21) |
| mouche à miel : abeille. IV, p. 25 - (23) |
| mouche à miel, mouche à miez. n. f. - Abeille. - (42) |
| mouche à miel, n.f. abeille. - (65) |
| mouche ai mié : abeille - (48) |
| mouche chatouillotte : Nom local et évidemment non scientifique. Cet insecte se plaçait dans l'aine des chevaux. La piqûre ou le mouvement de la bestiole provoquait une extraordinaire agitation du cheval jusqu'à le rendre presque fou et ruant avec violence. Il fallait prendre le risque de retirer l'insecte en le pinçant entre les doigts. C'était un accident très rare, mais spectaculaire, et très dangereux pour l'homme qui intervenait dans cette agitation. - (58) |
| mouche vérotte : mouche se mettant à la base de la queue des vaches - (48) |
| mouche : s. f. Mouche à bœufs, taon des bœufs. Mouche honteuse, type de mouche domestique qui recherche les endroits obscurs. - (20) |
| moûche é myé, abeille ; moûche se dit aussi pour : la rûche. - (16) |
| mouché, mouchoir. - (26) |
| mouchè, sm. mouchoir. - (17) |
| mouché. Moucher, mouchez. - (01) |
| mouchener, v. a. moissonner, couper les céréales. (voir : moichener.) - (08) |
| mouchenou, oure, ouse, s. m. moissonneur, celui qui coupe ou abat les blés, etc. (voir : moichenou.) - (08) |
| moucher, v. a. donner une correction à quelqu'un, rudoyer, corriger en frappant, battre. - (08) |
| moucheralle. s. f. Mésange. (Sermizelles). - (10) |
| moucherià, s. m., morve, humeur visqueuse qui sort du nez. - (14) |
| mouches, abeilles. - (26) |
| mouches, s. f. pl., abeilles. - (40) |
| mouches-vérottes : mouches verdâtres se mettant autour du derrière des bêtes, et après les bêtes qui vont mourir - (39) |
| mouchetagner, v., rogner la vigne. - (40) |
| mouchetron, s. m. cousin, insecte de la division des némocères. - (08) |
| mouchetron, s. m. moucheron, champignon, lumignon, bout de mèche allumée. - (08) |
| moucheur, moucheu : s. m., mouchoir. Un moucheu d' caffe, - (20) |
| mouchi (on) : rucher - (57) |
| mouchi : moucher - (57) |
| mouchi : Moucher « Qui se sint mourvoux se mouche » : qui se sent morveux se mouche. « Te vas te fare mouchi » tu vas te faire corriger. - (19) |
| mouchis. s. m. Petit glui : gerbe dont les épis sont égrenés. (Maligny). - (10) |
| mouch'ner (verbe) : moissonner. - (47) |
| mouch'ner : moissonner. - (52) |
| mouch'ner : moissonner - (39) |
| mouch'neu, moissonneux - (36) |
| moucho (on) : épervier (oiseau) - (57) |
| moucho. Amas, bouquet. - (03) |
| mouchoi, mouchoir ; mouchou, morveux, gamin. - (16) |
| mouchon (nom féminin) : moisson. - (47) |
| mouchon : moisson. - (52) |
| mouchon : moisson - (39) |
| mouchon : s. m., vx fr., moucheron, fumeron d'une chandelle, d'une bougie, d'une lampe. - (20) |
| mouchon, moisson - (36) |
| mouchon, mouhon, s.f. moisson. - (38) |
| mouchon, s. f. moisson, récolte des grains semés. - (08) |
| moûchon, s. ln. moucheron. - (24) |
| mouchon, s. m. chute, choc de la tête contre le sol : prendre un mauvais mouchon. - (22) |
| moûchon, s. m. moucheron. - (22) |
| mouchon, s. m., moucheron, bout de mèche non éteinte : « Ol a bentôt fait ; d'avou ses dèts ôl ôte le mouchon d’la chandéle. » - (14) |
| mouchot (on) - émouchot (n) : tiercelet - (57) |
| mouchot (on) : bouquet de fruits ou d'herbe - (57) |
| mouchot (on) : faucon - (57) |
| mouchot (on) : touffe (d'herbe - de cerises) - (57) |
| mouchot, monceau, amas. - (05) |
| mouchòte, s. f., mouchettes : « Passe-me la mouchòte, que j'côpe l'nazo d'la chandéle. » - (14) |
| mouchou (on) - mouch'nez (on) : mouchoir - (57) |
| mouchou : morveux - (48) |
| mouchou : morveux. - (62) |
| mouchou : Mouchoir de poche. « Fare in nout à san mouchou » : faire un noeud à son mouchoir. - (19) |
| mouchou : un mouchoir - (46) |
| mouchou d'cou (on) : foulard - (57) |
| mouchou : s. m. mouchoirs. - (21) |
| mouchoû, adj., morveux. Petite injure adressée à un enfant malpropre, mal mouché. - (14) |
| mouchou, morveux. - (05) |
| mouchou, ouse (oū), adj. moucheux, qui a besoin d'être mouché : nez mouchou. 'i vaut mô laché sai granmère mouchouse que d'lli airaiché l'nez. - (17) |
| mouchou. Terme injurieux, morveux. - (03) |
| mouchouair : n. m. Mouchoir. - (53) |
| mouchoué : mouchoir - (39) |
| mouchoué, s. m. mouchoir. - (08) |
| mouchouée : mouchoir - (48) |
| mouchoux. Au propre et au figuré, même sens que morveux. - (12) |
| mouchû, s. m., mouchoir de poche. - (14) |
| mouciau (n.m.) : morceau, fragment - (50) |
| mouciau : morceau. - (52) |
| mouciau : morceau. - (33) |
| mouciau : morceau - (39) |
| mouciau, s. m. morceau, fragment, portion : « ain mouciau d' paingn'. » - (08) |
| mouciau. n. m. - Morceau. - (42) |
| moûciaux : morceaux - (37) |
| moucle. Huitre d'eau douce, du latin musculus. - (03) |
| moudarne, s. m. moderne, arbre de réserve dans les bois exploités, plus vieux que le surtaillis et plus jeune que l'ancien. - (08) |
| moudarniau. s m. Moderne, chêne réservé et laissé sur pied dans une vente. - (10) |
| moûde (y’ot lai) : (c’est la) mode - (37) |
| moude v. Moudre. - (63) |
| moude : moudre - (39) |
| moudu, part., moulu, fatigué, brisé : « L'mûgnier a moudu tout son grain. » — « J'ai sié é peu monté du bôs tôte la jornée ; j'n'en peux pu ; j'sis moudu. » - (14) |
| moudure, s. f., mouture. - (14) |
| moué : moi - (61) |
| mouè : moi - vin d'èveû mouè, viens avec moi - vin vai mouè ! viens vers moi ! - (46) |
| mouè : moi - (48) |
| moué : moi. - (52) |
| moue : mûre. - (52) |
| mouè : s. m. mois. - (21) |
| moué d'âvri, loc., poisson d'avril : « On li fait encroire tout c'qu'on vont ; on li a baillé ein fameux moué d’âvri. » - (14) |
| moué : s. m. gros tas. - (21) |
| moué, arié : quant à moi - (36) |
| moué, pron. pers., moi. - (14) |
| moue, s. f. mûre. - (08) |
| moué, s. m., mois. - (14) |
| moué. pro. pers. - Moi. - (42) |
| mouéç’e : mouche - (37) |
| mouéç’u : mouchoir - (37) |
| mouéce bourdougnée, s. f. la mouche bourdonnante est, je crois, le taon des bœufs dont le vol bruyant cause une véritable terreur aux animaux qu'elle poursuit. « môche, mouéce, moince », trois formes pour mouche. - (08) |
| mouèce, moince (n.f.) : mouche (mouéce pour de Chambure) - mouèce à mié = abeille - (50) |
| mouécer (se) (v.pr.) : se moucher - (50) |
| mouécer, v. a. moucher avec un mouchoir ou autrement. Dans la région « mouéce », mouchoir, « s' mouécer », se moucher. - (08) |
| mouèche de guieu : moyette de glui - (48) |
| mouéche, s. f. mèche de chandelle, de lampe, etc. - (08) |
| mouéchener (v.t.) : moissonner - (50) |
| mouéchenou (n.m.) : moissonneur - (50) |
| mouèch'ner : moissonner - (48) |
| mouèchner : v. moissonner. - (21) |
| mouèchon : moisson - (48) |
| mouéchon, mouchon (n.f.) : moisson - (50) |
| mouéchon. s. m. Manche. - (10) |
| mouèchotte : petite moyette - (48) |
| mouéchotte, s. f. petite mèche de glui. les couvreurs en chaume réparent les toitures en piquant des « mouéchottes » aux endroits faibles. Mouéchotte se dit pour une petite quantité, une poignée de paille préparée en glui. - (08) |
| mouéçû (n.m.) : mouchoir - (50) |
| mouée : mûre (le fruit). Ex : "A c'souèr, j'vons aller aux mouées !" - (58) |
| mouègi : v. manger. - (21) |
| mouégneau, moigneau, mogneau. n. m. - Moineau ; ce mot est utilisé pour dire oiseau. - (42) |
| mouégner : mener - (39) |
| mouègner, m'ner : mener - (48) |
| mouégnotte. n. f. - Jeune moineau. - (42) |
| mouèignai : mener. On mouégno les bestiaux aux champs : on menait les bêtes aux champs. - (33) |
| mouéillâ, s. m. endroit marécageux, terrain mouvant. - (08) |
| mouéillaisse, s. f. endroit marécageux, fangeux, où l'on enfonce. - (08) |
| mouéillaisser, v. n. devenir mou, mouvant, très humide. - (08) |
| mouéillaissou (mouèyasou) très humide. - (45) |
| mouéillaissou, ouse. mou, humide. Se dit d'un endroit où l'eau est dormante comme d'un terrain rempli de sources : un pré « mouéillaissou », une terre « mouéillaissouse. » - (08) |
| mouéillât : partie humide d'un pré - (48) |
| mouéille : zone humide dans un champ, tourbière, pré humide - (48) |
| moueille : partie très humide d'un pré - (39) |
| moueillé : v. t. Mouiller. - (53) |
| mouéille, s. f. mouille, terrain mouvant sous lequel se trouve une eau souterraine. - (08) |
| mouéiller : mouiller - (48) |
| moueiller : être mouillé - (39) |
| mouéiller, v. a. mouiller, humecter. - (08) |
| moueillottes : une gerbe qui fait cape sur un tas de gerbes - (39) |
| mouéillou (-ouse) (adj.m, ou f.) : meilleur - (50) |
| mouéillou, adv. meilleur, qui est au-dessus du bon. - (08) |
| mouèillou, mouèillouse : meilleur, meilleure - (48) |
| mouéjotte, moijotte, mojotte. n. f. - Jaune d'œuf - (42) |
| mouelle. n. f. - Moelle. Autre sens : forme, santé, force. Avoir ou ne pas avoir la mouelle. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| mouèllou : qui a le nez qui coule - (39) |
| mouéllou, reûç’ou : celui qui est morveux, dont les narines coulent - (37) |
| mouéme : même - (37) |
| mouême ou moin-me : Même « Ol est toje le mouême » : il est toujours le même. - (19) |
| mouème, mouinme : même - (48) |
| mouène : moine (cruchon ou religieux) - (48) |
| mouéner, v. a. mener, conduire ; « mouéne-lu via », mène-le vite. - (08) |
| mouèner, v., moissonner. - (40) |
| mouèneutte : s. f. manette (de la faux). - (21) |
| mouéré (-e) (adj.m. et f.) : trop salé (-e) - (50) |
| mouére : mûre - (39) |
| mouési : moisi - (48) |
| mouéson, s. f. maison. Mouéson basse, pièce d'habitation sise au rez-de-chaussée. - (24) |
| mouesse : poignée de paille, pour couvrir ou pour faire brûler le cochon ou les chaises - (39) |
| mouesse, mouche - (36) |
| mouesse, s. f. trou dans une haie, ouverture qui sert de passage aux lièvres, lapins et autres petits animaux sauvages. - (08) |
| mouess'noû, s. m., moissonneur. - (14) |
| mouèsson, s. f., moisson. - (14) |
| mouésson. n. f. - Moisson. - (42) |
| mouessotte : poignée de paille, pour couvrir ou pour faire brûler le cochon ou les chaises - (39) |
| mouèssouner, et mouèss'ner, v. tr., moissonner. - (14) |
| mouètian : milieu - (48) |
| mouètié : moitié - (48) |
| mouèton : s. m. milieu. - (21) |
| mouêyen : moyen - (57) |
| mouèyen : moyen - (48) |
| mouéyen : moyen - (39) |
| mouêyennant : moyennant - (57) |
| mouêyenne (na) : moyenne - (57) |
| mouêyens (des) : moyens - (57) |
| moufes, s. m., moufles, gros gants de peau fourrés, servant à ceux qui coupent les épines dans les baies. Les doigts, excepté le pouce, ne sont pas séparés. - (14) |
| mouffer, mouffler, mouver.v. n. Parler, remuer les lèvres, faire un signe quelconque. Je lui ai dit ce que je pensais de lui, il n'a pas mouffé. Du latin movere. - (10) |
| moufflon ou mouflot. Doux au toucher, rebondi, lisse, joufflu. Etym. moufle, car cette partie de l'habillement est arrondie, gonflée souvent en peau velue, ou en étoffe à poils doux au toucher. - (12) |
| moufle, vessie de pore et ampoule. - (16) |
| moufle. Sorte de gant en laine ou en peau fourrée. Ce mot ne serait-il pas une forme de mitoufle, qui avait autrefois le même sens et d'où est venu le verbe emmitoufler. Nous avons aussi en Bourgogne l'adjectif mouflot, chaud, doux au toucher. Te choisirai eune miche de pain frais ben mouflotte. - (13) |
| moufle. Vessie sèche et gonflée d'air, ampoules aux pieds ou aux mains. Etym. similitude des tissus gonflée avec la moufle de peau qu'on se met aux mains. - (12) |
| moufler : v, a., vx fr. mofler, gonfler, boursoufler. De la pâte qui moufle. Une omelette bien mouflée. Un édredon moufle. - (20) |
| mouflo. Fourré, doux au toucher. - (03) |
| mouflòt, adj., doux, gonflé, joufflu, fourré, rebondi. Se dit des joues d'un enfant, d'un gâteau, d'un édredon, etc. - (14) |
| mouflot, doux au toucher, fourré. - (05) |
| mouflou : moelleux, léger - (39) |
| mougner, v. a. mener, conduire. (voir : aimougner, enmougner.) - (08) |
| mougniâ, s. m., adolescent pas encore conscrit. - (40) |
| moûgniotte : souris (peu usité) - (37) |
| mougno. Moue ; par extension museau ; moue en est certainement l'étymologie. - (03) |
| mougnon, et mògnon, s. m., moignon. - (14) |
| mougnot, moue, museau, moignon. - (05) |
| mouie, mouire : mure, fruit de la ronce. Ço bon la confiture de mouires : c'est bon la confiture de mures. - (33) |
| mouillance, état d'une terre arable trop détrempée par la pluie pour pouvoir être labourée dans ce sens, on dira qu'il ne fait pas bon labourer par la mouillance. - (11) |
| mouillance, pluie - (36) |
| mouillasse, s. f., bruine, petite pluie, ondée légère. - (14) |
| mouille : terrain humide. Donne son nom aux champs humides : lieu-dit Les Mouilles. - (62) |
| mouillé : adj. Mouillé de chaud, en transpiration. Mouillé de pluie, mouillé par la pluie. Voir trempe. - (20) |
| mouille : n. f. Endroit humide. - (53) |
| mouille, n.f. pré ou partie de pré humide. - (65) |
| mouille, subst. féminin : pré humide et marécageux, terrain mouvant. - (54) |
| mouille. s. f. Effet de la pluie ou du contact d'un liquide, dommage qui en résulte. La farine, le son, les sucres, etc., craignent la mouille. - (10) |
| mouillère, s. f., creux d'eau dans les champs. - (40) |
| mouilleri, petite flaque d'eau. - (28) |
| mouilleté, moulleté. s. f. Grande humidité. (Bleneau, Villeneuve-les-Genêts). - (10) |
| mouillette (n. f.) : moyette, petit tas de gerbes qu'on dresse dans les champs après la moisson - (64) |
| mouillette, mouillette. - (26) |
| mouillette. n. f. - Groupe de gerbes dressées sur pied en tas de cinq, neuf, dix ou treize. Jusqu'au milieu du XXe siècle, le français utilisait moyette pour désigner cette petite meule ; la mouillette poyaudine en est une altération naturelle. - (42) |
| mouilli : mouiller - (57) |
| mouillou (oū), adj. meilleur. - (17) |
| mouillou, adj. mieux. - (38) |
| mouin : adv. Moins. - (53) |
| mouiner. v. n. Sucer son pouce, nasiller, parler du nez. - (10) |
| mouire, moure, mouére : mûre (fruit de la ronce) - (48) |
| Mouise. Moyse… - (01) |
| moujotte, s. f. jaune de l'œuf. - (08) |
| mouké, s'mouké, s'meukè, se moquer ; menkrie, moquerie. - (16) |
| moulage, s. m. action de mouler le bois à feu, c’est à dire d'abattre les arbres et de les débiter en bûches d'une longueur déterminée. - (08) |
| moulan, pâturage non clos et produit naturellement par une eau souterraine qui n'a pas d'écoulement. - (11) |
| mouland : mouillère, petite zone très humide dans un pré où parfois il y a une source. - (59) |
| moulasson, adj. mou et lent au travail. - (24) |
| moulaton, s. m. petite meule de moulin. - (22) |
| moule : mesure de bois de chauffage correspondant au volume d'un cube de 1,33 mètre de côté (ou 4 pieds). A - B - (41) |
| moûle (du) : (du) gros bois entier ou une seule fois fendu - (37) |
| moûle (na) : meule (pierre) - (57) |
| moule : (nf) meule - (35) |
| moule : mesure de bois de chauffage correspondant à un cube de 1,33 m de côté (ou 4 pieds) - (43) |
| moule : mesure de bois. Équivalent à 2,413 stères. Une bille de moule : tronçon de 1,40 m (4 pieds) entrant dans le moule. - (62) |
| moule : mouillée (tripée) - (60) |
| Moulé : nom de bœuf. III, p. 30-o - (23) |
| moule à agueuzi : meule à aiguiser - (43) |
| moule de bô : un moule de bois (2,33 stères) - (46) |
| moule de bôs n.m. Tas de bois coupé de 1,33m x 1,33 x 1,33 soit 2,35 stères, correspondant à une tonne de chêne moyennement sec. - (63) |
| moule n.f. Meule. - (63) |
| moule : n. m. Moule ou une moulée, ancienne mesure, volume d'un cube de bois de 4 pieds d'arête (soit 1,33m) donc il correspond à 2,253 stères. - (53) |
| moule : s. m., ancienne mesure de volume pour le bols de chauffage. Il avait 4 pieds de côté, soit 64 pieds cubes, et valait 2 stères métriques 193 décimètres cubes. Le stère métrique vaut done 0 moule 455, c'est-à-dire près d'un demi-moule. - (20) |
| moule, n.m. mesure pour le bois, généralement arrondie à 2 stères. - (65) |
| moule, s. f. meule à aiguiser. - (24) |
| moûle, s. f. meule. - (22) |
| moule, s. m. chaque pied d'arbre se compose de deux parties, « le moule » et « la rame. » - (08) |
| moule, s. m., mesure de capacité pour le bois à brûler : « J'ons éch'té eùn moule de bôs por note hivâr. » Équivaut à un mètre cube. On le mesure à l'aide de deux tiges verticales et d'une horizontale, chacune d'un mètre et ajustées l'une dans l'autre. Elles servent ainsi de cadre aux bûches, longues également d'un mètre. De cette manière, on obtient naturellement le mètre cube. - (14) |
| moulée, s. f. bois moulé ou fabriqué par les bûcherons. - (08) |
| mouler : Baisser, en parlant du prix des denrées. « Les prix des vins ant bien moulé ». « Des lettres moulées » : des caractères d'imprimerie. - (19) |
| moûler : faire du bois - (39) |
| mouler : v. a., mollir, laisser aller, lâcher doucement, et, d'une manière générale, diminuer de quantité ou d'Intensité. - (20) |
| mouler, abaisser, diminuer de prix. - (05) |
| mouler, v. n. beugler, pousser des mugissements. se dit principalement des bêtes à cornes. - (08) |
| mouler. v. a. fabriquer le bois de moule. - (08) |
| moûles : mouillées (« dâs ç’aûç’es moûles » : des chaussettes mouillées) - (37) |
| mouleton, s, m., molleton. - (14) |
| moulette (na) : omelette - (57) |
| moulette, omelette. - (05) |
| moulette. s. f. Poulie, rotule. (Merry-la-Vallée). - (10) |
| mouleur, s. m. celui qui moule le bois, qui le fabrique. - (08) |
| mouléyer, v. a. écraser, broyer. s'emploie plutôt au figuré : « sai mailaidie l' mouléyô », sa maladie le broyait. - (08) |
| moulin, adj. humide, marécageux. - (22) |
| moulin, adj., humide. - (40) |
| moulin, moulin a van : s. m., tarare. - (20) |
| mouliture. s. f. Grande rosée, humidité. (Villiers-Bonneux). - (10) |
| moullotte. s. f. Jaune d'œuf. - (10) |
| moulon, s. m. la mie du pain. - (22) |
| moulotte, s. f. molette, petit os de forme arrondie. - (08) |
| moulu p.p. de moude. Ecrasé, broyé. - (63) |
| moulue d'eau (nom féminin) : forte averse. - (47) |
| moulue, s. f. volume d'eau nécessaire pour moudre, pluie très abondante : il est tombé une « moulue » d'eau. - (08) |
| moulùye, s. m. le jaune de l'œuf. - (22) |
| moument (n.m.) : moment - (50) |
| moument : moment - (39) |
| moument, s. m., moment. - (14) |
| moument. n. m. - Moment. - (42) |
| moun (adj.pos.m.sing.) : mon (rare) - (50) |
| moun : mon, devant voyelle. Moun onc[y]e. - (52) |
| moun, adj. pos. mon devant une voyelle : moun éraille,mon oreille. - (38) |
| moun, et men, pr. pers., mon. - (14) |
| moun. adj. poss. - Mon : « L' brandevinier, c'est moun onque ! L' fre' d'la grand-mée. » - (42) |
| mouna homme de petite taille. (VC. T II) - A - (25) |
| mounâ, mounô, mounoie, mounouas. s. f. Monnaie. (Avallonnais). - (10) |
| mounaï, s.m. moissonneur. - (38) |
| mouné : petit (en s'adressant à un petit garçonnet). (V. T IV) - A - (25) |
| mouné, mounai (C. -d.).- Petit, vient sans doute de menu. On dit, en Côte-d'Or, « un mounai gaichon » pour : un petit garçon, « mounai pécha », un petit peu (dans l'Yonne, peu se dit p'chon, pochon ; étymologie : paucus). Mounai ou mounée, employé seul signifie un enfant. - (15) |
| mouner : mener grand train…par exemple. - (62) |
| mouner les bœufs : être en chaleur (vache). A noter qu’on dit bœufs… quand il faut penser taureaux ! - (62) |
| mouner, v. a. mener, conduire : « a n' moune pâ d' bru », il est d'humeur tranquille. (voir : mougner.) - (08) |
| mouner, v. mener. - (38) |
| mouner, v. moissonner. - (38) |
| mouner, v. tr., mener, conduire. - (14) |
| mouni : meunier - (51) |
| mouni : meunier —hanneton mâle. - (30) |
| moûni, moñni n.m. Dans certaines communes du Charolais on parle encore du coponî. Ce mot, inconnu à Sivignon, désigne également le meunier ; il a pour origine le ou les coupons (d'une valeur d'environ six litres de blé) prélevés, voici quelques siècles déjà, par le meunier, au profit du seigneur. - (63) |
| moûniau, et mògniau, s. m., moineau. Au fig., d'un gas prétentieux : « V'là-t-i pas eùn ben biau moùniau, ma fi ! » - (14) |
| mounier : meunier - (61) |
| mouniou : un petit garçon. - (56) |
| mounnaie (n.f.) : monnaie - (50) |
| mounoie, s. f. monnaie, argent en général. - (08) |
| moûran : Mûres des haies, fruit de la ronce (rubus fruticosus) « Le ptiet Dénoyer fiait de l'iau de vie de moûrans » : le petit Dunoyer (ancien aubergiste de Mancey) fabriquait de l'eau de vie en distillant des moûrans. - (19) |
| mourçais, moucias. s. m. Morceau. (Saint-Brancher). - (10) |
| mourciau (un) : un morceau - (61) |
| moûre (n.f.) : mûre sauvage (aussi mûron) - (50) |
| moure (v.) : moudre - (50) |
| moure : moudre - (48) |
| moure, meuron : n. m. Fruit du murier, de la ronce. - (53) |
| moûre, mûre sauvage des buissons, aussi bien que le fruit du mûrier. - (16) |
| moure, n.f. mûre (fruit). - (65) |
| moure, s. f. mûre sauvage, fruit de la ronce qu'on appelle quelquefois la mûre à poux. - (08) |
| moure, subst. féminin : mûre, fruit de la ronce. - (54) |
| moure, v. a. moudre, broyer le grain au moulin. - (08) |
| moure, v. n. mourir : « a vé moure », il va mourir. (voir : muri.) - (08) |
| moure,s.f. mûre des haies, fruit de la ronce. - (38) |
| moure. s. m. Mufle, museau, visage. - (10) |
| moure. v. a. Moudre. (Rugny). - (10) |
| mourer : v. mûrir. - (21) |
| mouret (Brionnais) : museau. - (30) |
| mourguer. v. a. Mettre le poing vivement sous le nez, sur le moure a quelqu'un. Attends, j'te vas mourguer le nez. - (10) |
| mourî, et meùrî, v. intr., mourir. - (14) |
| mouricaud : Moricaud. « In vilain mouricaud » : un individu d'une grande laideur ou d'un caractère très désagréable. - (19) |
| mouricaud. Moricaud. - (49) |
| moûrienne : après-midi (méridienne), signifie aussi le bourdonnement sourd et intense des mouches et insectes à l'heure la plus chaude de la journée, bourdonnement souvent annonciateur d'orage. - (33) |
| mourienne, s. f. méridienne, le milieu du jour, le temps qui s'écoule entre la matinée et la soirée. Pour un pâtre, faire la « mourienne », c'est garder son bétail aux champs du matin au soir. - (08) |
| mourillion. s. m. Museau, petit moure. – Se dit aussi pour muselière. - (10) |
| mourillon, s. m. morve, humeur qui découle du nez - (08) |
| mourire, s. f. provision de fruits mis à mûrir dans le foin. Par analogie, cachette d'argent. - (24) |
| mouritre, v. n. mourir. s'emploie avec le pronom : « s'mouritre» : « a s'ô laiché mouritre », il s'est laissé mourir, il est mort. (voir : moure, mûri, péritre.) - (08) |
| mourjon, s. m. terme de mépris adressé à un enfant. - (22) |
| mourne, s. f. anneau fixant la faulx à sa monture. - (22) |
| moûron (on) : mûre (fruit) - (57) |
| moûron (un) : mûre (une). Fruit de la ronce ou du murier. Du latin morum. - (62) |
| moûron : mûre - (21) |
| mouron : s. m., vx fr. meuron, mûre, fruit de la ronce. - (20) |
| mouron, mûre sauvage de ronce. - (05) |
| mouron, s. m. fruit de la ronce. - (24) |
| mouron, s.m. ronce. - (38) |
| mourre : museau. - (09) |
| mourre : s. m., vx fr., museau, visage. - (20) |
| moûrres (dâs) : (des) mûres (fruits) - (37) |
| mourru : mort - (44) |
| mourti, s. m. 1. Mortier de maçon. — 2. Mortier à piler le sel. - (22) |
| mouru p.p. de mourir. Ôl a mouru çhte neit. On dit aussi meuri. - (63) |
| mouru : part, pass., mort. On dit : « Il a mouru », comme on imprime : « L'AImanach Vermot est paru, » - (20) |
| mouru, adj. qui a besoin d'être mouché. - (22) |
| mouru, part., mort : « L'pauv' diâb e! ôl é ben vite été mouru ! » - (14) |
| mourvoux : Morveux, gamin. « Qu'est-ce que te veux, cheti mourvoux ? ». Du temps qu'on s'éclairait à la chandelle il arrivait qu'en la mouchant trop court on l'éteignait, on disait alors : « vaut mieux laichi l'enfant mourvoux que de li coper le nez ». - (19) |
| mouse, s. f., moue, maussaderie, mauvaise humeur. - (14) |
| mouser, v. n. muser, bouder, faire la moue, la grimace. - (08) |
| mouser, v. tr. et intr., bouder quelqu'un, faire la moue. - (14) |
| moushion : moisson. - (62) |
| mousine : une petite pluie fine - (46) |
| mousquai, se fâcher, grommeler comme la mouche bourdonne... - (02) |
| mousque, mouche ; en latin musca. Mousque ai mié, mouche à miel, abeille... - (02) |
| mousque. :Du latin musca), mouche.- Nos villageois disent d'une abeille ène mousque ai mié, c'est-à-dire une mouche à miel. - Du bourdonnement de la mouche est venue, au figuré, l'expression de se mousquai, c'est-à-dire, se courroucer, grommeler, murmurer ; d'où, par extension encore, le dicton français prendre la mouche, et sans doute aussi le proverbe italien la muscha vi salta al naso. - Dans les chartes du XIII" siècle, mouchotte (du latin muscarum casa) signifie ruche. (Coutumes de Châtillon, 1371.) - (06) |
| mousqueton : (nm) anneau que l'on mettait dans le groin d'un porc pour l'empêcher de retourner la terre - (35) |
| mouss- hon, mouss-hener, moisson. - (05) |
| moussais - monceau ; tas. - Al é raimassai les pierres en moussai le long de lai rouâ de champ. - Les vieux Fôrey, les grippe-sou, al ant des moussais d'écus, en parait. - (18) |
| mousse, jeune garçon employé dans une entreprise aux menus travaux et aux courses. - (27) |
| mousseline (déchirée, la) , loc. parler avec prétention et gaucherie, c’est à dire manier grossièrement quelque chose de délicat. se dit des revenants de paris qui imitent le beau langage et l’écorchent à plaisir. - (08) |
| mousser, v. a. garnir de mousse. on mousse un bâtiment pour boucher les trous. - (08) |
| mousseran : Mousseron, agarie comestible. « Ol est allé ramasser des mousserans su Morchétiau ». - (19) |
| mousseriÿon, s. m., petit moucheron : « Au bord de l'iau, vou ben dans le p'tiot bois, y en a des mousseriÿons ! on en é dévoré. » (V. Mousseron.) - (14) |
| mousseron, s, m., moucheron, cousin. Notre ceinture de deux rivières nous en fait naître parfois des nuées. Alors, gare aux peaux douces ! - (14) |
| moussieu, s.m. monsieur. - (38) |
| moussiller, mussiller : réduire en fines parties entre ses doigts (voir : mouciau = morceau). - (56) |
| moussiyon, toute espèce de moustiques, de moucherons. - (16) |
| moustafa, s. m., moustachu, gaillard qui a de fortes moustaches. Ironique. - (14) |
| moustoufiou, sm. farceur, mystificateur. - (17) |
| mousu, adj., qui fait la moue, boudeur. - (14) |
| mout n, ver de la cerise. - (16) |
| mout, mô (n.m.) : mot - (50) |
| mout, s. m. mot, parole. - (08) |
| moutade. Moutarde… - (01) |
| moutait’chou : le plus petit de la bande (terme employé en morvan, mais de lointaine provenance arabe) - (37) |
| moutale, s. f., goujon. - (40) |
| moutale, s.f. goujon. - (38) |
| moutan : Mouton. « Le moutan blianc » : animal imaginaire, sorte de fantôme qu'on croyait voir la nuit, au Pendant, sur la route de Mancey à Dulphey. - Vers de cerises. « Ces cheriges sant treu meures (trop mûres) i pourrait bin y avoir des moutans ». - (19) |
| moutardelle : s. f., mortadelle. - (20) |
| moute : motte de terre herbeuse, tas de foin - (39) |
| Mouté, nom de bœuf au pelage tacheté. (voir : moulelé.) - (08) |
| mouteille, s. f. moutelle, nom de la lotte et loche franche, cohitis barhatula. La « mouteille » est très répandue dans les eaux vives du pays. - (08) |
| mouteille, s. f., moutelle, petite lotte. - (14) |
| moutelé, adj. marque de jaune et de blanc et quelquefois d'autres couleurs. - (08) |
| moutèle, motelle, petit poisson. - (16) |
| moutelle : petit poisson de ruisseau, proche du vairon - (37) |
| moutelle : poisson chat - (48) |
| moutelle, n.f. poisson, généralement la loche. - (65) |
| moutelle, sorte de petit poisson qui se cache sous les pierres dans la rivière. - (27) |
| moutelle. Petit poisson ressemblant au goujon, cobitis barbatula ; du latin mustela, lamproie. - (03) |
| moutelle. Petit poisson sans écailles très commun dans les ruisseaux de la Bourgogne, Ce mot paraît venir du latin mustela. Entre la moutelle et la belette, il y a cette ressemblance que toutes deux s'échappent dans de petits trous, et s'échappent des mains qui tentent de la saisir et se mussent entre les caillons des ruisseaux. Dans les environs de Beaune, on appelle les haricots des moutelles de Pernand. Ce village, dont le terrain est sec et pierreux, n'a pas de poissons. On y trouve peu de moutelles, mais beaucoup de haricots. - (13) |
| moutelle: petit poisson des ruisseaux ; nom courant : la loche. - (59) |
| moutenaille (nom féminin) : troupeau de moutons. - (47) |
| moutenaille, s. f. troupeau de moutons, l'espèce en général : la « moutenaille » est chère. - (08) |
| mouteule. Goujon, en bourguignon mouteule, du latin mustela, qu'on explique communément par lamproie, et comme on en suppose de trois sortes, savoir, de très petites, de moins petites et de grandes, il faut conclure que les mouteules sont de la plus petite espèce. - (01) |
| moutié, s. f. moitié. (voir : mitié.) - (08) |
| moutiner, savourer. - (26) |
| mout'nei, s. m., petit berger, jeune gardeur de moutons : « T'sais pas qui y é qu'a fait c'qui ? Y é le p'tiot mout’nei du père François. » - (14) |
| mouton , ver, larve des cerises. - (05) |
| Mouton : nom de mulet. VI, p. 16 - (23) |
| mouton : voir pressoir. - (20) |
| mouton, s. m., petit ver, larve qu'on trouve dans les cerises noires : « Je n’ maing’ pas de tes cerises ; y a des moutons d'dans. » - (14) |
| mouton. On appelle ainsi dans tout le Chalonnais la larve qu'on trouve dans les cerises, peut-être à cause de sa couleur. - (03) |
| moutonné : frisé - (44) |
| moutonner. s.n. Bouder. (Villiers-Saint-Benoît). - (10) |
| mou-tripé : complètement mouillé. Après une grosse pluie ou un orage. Ou encore après une chute dans une mare ou dans le ruisseau. Ex : "J'seus sorti du champ, j'atais mou-tripé !" - (58) |
| moutrôt, s. m., petite élévation de terre, monticule. Dans les environs de Tournus, des éminences de terre, qu'on suppose être des sépultures, sont dénommées meuròt, muròt. - (14) |
| moutse : (nf) mouche - (35) |
| moutse : mouche - (43) |
| moutse : mouche - (51) |
| moutse à mi : (nf) abeille - (35) |
| moutse à mi : abeille - (51) |
| moutse à mî n.f. Abeille. Voir gronde. - (63) |
| moutse à mie : abeille - (43) |
| moutse n.f. Mouche. - (63) |
| moutse piatte catharine : mouche plate - (43) |
| moutse pyate n.f. La moutse pyate, appelée aussi à Sivignon moutse bezaiñne, moutse catharine, moutse cathrine et moutse canqueline, est une mouche dotée d'une carapace très dure, vivant sur le bétail. - (63) |
| moutsi v. Moucher. - (63) |
| moutson n.m. Fumeron d'une chandelle, d'une bougie ou d'une lampe. Ce mot, inconnu à Sivignon, et employé au XIXe s. dans la région, a été forgé sur le verbe moutsi (moucher). - (63) |
| moutsu v. Mouchoir. - (63) |
| moutte : une grosse motte de terre recouverte d'une herbe abondante. - (33) |
| moutte, s. f. motte, tranche de gazon plus ou moins épaisse qu'on lève sur le terrain et dont on se sert pour différents usages, entre autres pour couvrir le faite des bâtiments en chaume. - (08) |
| moutte. n. f. - Motte. - (42) |
| moutter, v. a. motter, garnir de mottes, de tranches de gazon. - (08) |
| mouttou, ouse, adj. motteux, où il y a beaucoup de mottes ; un champ « mouttou », une terre « mouttouse. » - (08) |
| moutue : pain d'moutue = pain fait avec de la farine de blé et d'orge. III, p. 31-u - (23) |
| moutue. s. f. Mélange d'orge et de blé. Pain de moutue, pain fait de farines d'orge et de froment melangées. - (10) |
| mouvant : s. m., amorceur, personne qui, dans une vente, est chargée de pousser les enchères pour stimuler les amateurs. - (20) |
| mouvâs : adj. Mauvais. - (53) |
| mouver (v. int.) : bouger, remuer - (64) |
| mouviotte. s. f. Mauviette. (Villiers-Saint-Benoît). - (10) |
| mouyau : Monceau, tas. « In mouyau de piarres » : un tas de pierres. « In mouyau de mande » : une foule de gens. - (19) |
| mouÿer, v. tr., mouiller, humecter. - (14) |
| mouyou, meilleur. - (26) |
| mouzai ou mousai. : Bouder, faire la moue. (Del.) - (06) |
| môvais : méchant - (57) |
| môv'zan, malfaisant. - (16) |
| moÿa : mouillé, détrempé - (51) |
| Moyance. L'électeur de Mayence en 1701. - (01) |
| moyau, moau, muau : s. m., vx fr. moie et moiel, meule de foin. - (20) |
| moye : (nf) dépression humide dans un pré - (35) |
| moÿen n.m. adj. Moyen. - (63) |
| moyen, n. masc. ; beaucoup : vais chercher des treuffes ; aippoutyes-en moyen. - (07) |
| moyen, n. masc. ; biens ; al ost riche ; al ait bin du moyen. - (07) |
| moyettes : toutes petites gerbes de glui en bordure d'une couverture de paille - (39) |
| möyeu : (nm) moyeux - (35) |
| moÿeu n.m. Moyeu. - (63) |
| möyi : (p.passé) mouillé - (35) |
| mo-yi : mouillé - (43) |
| möyon : (nm) nœud de la gerbe - (35) |
| m'ri : mourir - èl èllè m'ri, mais on l'è sauvè, il allait mourir, mais on l'a sauvé - (46) |
| m'rîse (na) : griotte - (57) |
| m'rise (na) : merise - (57) |
| m'rîsi (on) : griottier - (57) |
| m'risi (on) : merisier - (57) |
| m'rizi : (nm) merisier - (35) |
| m'rizin, merisier. - (26) |
| mseure (n.f.) : mesure - (50) |
| mtaiñne n.f. Mitaine. - (63) |
| muate, adj. muette. - (38) |
| mucer, musser : v, a., vx fr. mucier, cacher. - (20) |
| muche (pour musse). s. f. Cachette. Vendre du vin à la muche, vendre du vin à cache-pot. - (10) |
| muche. s. m. Mioche, enfant. - (10) |
| mûcher, et musser, v. tr. et pr., cacher, se cacher ; pour le soleil, se coucher : « Soulò mûchant. » - (14) |
| mûchéte, s. f., cachette, petite cache. - (14) |
| muchi : Se coucher, s'emploie surtout en parlant du soleil. On dit aussi d'un cheval « O muchit les orailles », il couche ses oreilles en arrière, ce qui est un signe inquiétant. « Le chevau que muchit les orailles » va ruer ou s'emballer. - (19) |
| mûchiau, s. m., tas d'épines à brûler. - (40) |
| mue : cage grillagée posée sur le sol pour les volailles - (60) |
| mue : sorte de panier. VI, p. 40-10 - (23) |
| mueille,mureille.s. f. Muraille.(Sacy). - (10) |
| muence. : (Dial.), changement (du latin mutationem). - (06) |
| muène : voir meuhaigne - (23) |
| mûgnié, meunier. - (16) |
| mugnié, s. m. meunier. - (08) |
| mûgnier, s. m., meunier. - (14) |
| muhi, mouhi, v. a. mourir. (voir : muri.) - (08) |
| muid : ancienne mesure de capacité. Tonneau de cette capacité. - (55) |
| muid : s. m., ancienne mesure de capacité pour le sel, comprenant 12 setiers, c’est-à-dïre 48 minots. Sa contenance était de 2502 litres 336. - (20) |
| muigne. s. f. Musareigne.(Diges). C'est une contraction de musigne, qui lui-même en est une de musareigne. Du latin musaraneus. - (10) |
| muine : voir meuhaigne - (23) |
| mujique n.f. Instrument de musique. - (63) |
| mujotte. s. f. Musareigne (Rugny). - (10) |
| mule, s. f. engelure au talon. - (08) |
| mûle, s. f., engelure : « J'ai les mûles au talon. » - (14) |
| mule. n. m. - Petite meule de foin au milieu d'un champ synonyme de cachon. - (42) |
| mûle. s. f. Meule, tas de foin. – Dans plusieurs endroits, ce mot est masculin. - (10) |
| muleteau. s. m. Mulot jeune ou de petite taille. - (10) |
| muloche. s. f. Petite meule, petit tas de foin. (Mont-Saint-Sulpice). - (10) |
| mulôt, s. m., mulet. - (14) |
| mulot, s. mulet, mule. - (08) |
| mulot, s.m. mulet. - (38) |
| mulot. s. m. Larve de hanneton. (Diges). - (10) |
| mult. : (Dial.), beaucoup. - Une singularité, c'est l'alliance de ce mot avec son contraire peu. - (06) |
| mûné : Meunier. « San père était mûné » : son père était meunier. « Nâ le mûné » : noyer le meunier, mettre trop d'eau dans le pétrin quand on fait le pain. - (19) |
| muniö, sm. meunier. - (17) |
| muosse, s. f. trou, petite ouverture dans une haie vive, passage de la volaille ou du gibier. (voir : mouesse.) - (08) |
| muot, muet. - (05) |
| muquiau. s. m. Muselière. (Andryes). Se dit ainsi pour mutiau, musiau, museau. - (10) |
| mur (mûr), mure (mûre) : adj. Bois mûr, pousse de l'année qui a atteint son plein degré d'évolution. - (20) |
| muraillat : s, m., moineau franc. - (20) |
| muraison : s. f., maturation. - (20) |
| murat, murot, meurot : s. m., vx. fr. murat et muraut, tumulus, funéraire ou non, de pierres ou de terre. - (20) |
| mure : Saumure. « Y est salé c'ment de la mure ». - (19) |
| mûre, s. f., saumure du saloir. - (40) |
| mureau, murot. s. m. Petit mur. (Argenteuil, Quincerot). - (10) |
| murette : étuvée au vin spécialité du Brionnais. - (30) |
| murgei, et meúrgei, monceau, tas : « Eùn murgei de piâres » est un tas de pierres qu'on forme dans les vignes en défrichant. - (14) |
| murger, n.m. tas de pierres retirées des champs et utilisées pour marquer les limites des champs et des pâtures. - (65) |
| muri (v.t.) : mourir — on écrit aussi meuri - (50) |
| mûri : mourir - (39) |
| muri, v. n. mourir, cesser de vivre. - (08) |
| muroéye, muraille. - (16) |
| murole, meurole, moroule : s. f., vx fr, meurole, cachette pratiquée dans un mur. - (20) |
| mûron, meûron. n. m. - Mûre. - (42) |
| mûron, s. m. mûre, fruit du mûrier. - (08) |
| muroure, s. f. pierre à bâtir. - (24) |
| murte. adj. f. Mûre. Des ceries murtes. (Saint-Bris). - (10) |
| murtri, e, part. pass. meurtri, blessé : « al ô murtri d' côs », il est meurtri de coups. - (08) |
| murure : adj. f., mureuse. Pierre murure, pierre de construction, par opposition a la « pierraille ». - (20) |
| musardai, avoir le nez en l'air, épier, examiner. Dans l'idiome breton, musa signifie flairer, sentir, et, au figuré, épier, examiner. (Le Gon.).. - (02) |
| muscher, v. cacher. - (38) |
| muschiau, s.m. tas. - (38) |
| muse : s. f., vx fr., moue. « Oh ! c'te muse que t’ fais ! Y a d' quoi faire ch... un poulet. » - (20) |
| museille (pour mureille, par conversion de l'r en s). Muraille. (Fléys). - (10) |
| museleau, s. m. muselière. - (08) |
| muser (v.t.) : se promener en fouinant - (50) |
| musetiau, s. m. muselière que l'on met aux boeufs qui servent à l'exploitation des bois. - (08) |
| musette : s. f., vielle; pressoir à vis horizontale. Voir fouloir. - (20) |
| musette. n. f. - Ivresse: « A la fouée d'Saint-Sauveur, j'ons rencontré l'Bébert. Et ben ! Il en t'nait eune sacrée musette ! » - (42) |
| musiau (n.m.) : museau - (50) |
| musiau (pour museau). s. m. Corde qui sert à rattacher un bateau à la remorque d'un autre bateau. (Navigat. de l'Yonne). - (10) |
| musiau : Museau. « Cen n'est pas pa tan vilain musiau » : cela te passera loin du bec. - (19) |
| musiau : vannerie en châtaignier pour empêcher les bêtes de manger - (43) |
| musiau, s. m., museau : « Oh ! l'maulépris ! v'tu ben meûsser ton peùt musiau ! » - (14) |
| musicle. Musique… - (01) |
| musicoux : s. m., musicien. - (20) |
| musieau (on) : museau - (57) |
| musin. Flâneur, homme qui s'amuse. Muser, perdre son temps... - (13) |
| musiot. n. m. - Museau. - (42) |
| musique : s, f., instrument de musique. I m’ tourmente pour avoir une musique ; j'i ai dit d'êt ben sage, que l’ Père Janvier li en apporterait une pour son jour de l'an. - (20) |
| musô : la muselière - (46) |
| muson (n.m.) : lambin, paresseux, qui aime traîner - (50) |
| muson, s. et adj., musard, lambin, flâneur. - (14) |
| muson, s. m. lambin, flâneur, paresseux - (08) |
| musòte, s. f., musette, jadis choyée des danseurs. - (14) |
| musse (une) : un trou fait par le passage d'un animal dans une haie - (61) |
| musse : trou dans une haie, passage - (60) |
| musse : passage très étroit (et pas toujours bien visible). Ex : "Nos vaches ? Elles ont ben trouvé ène musse dans la bouchue, les loufous !" - (58) |
| musse. n. f. - Galerie étroite, petite sente dans une haie ou un tas de foin, formée par le passage régulier d'un petit animal. Ce mot est directement conservé de l' ancien français ; une musse (muce, musance ou museure) était au XIIe siècle une cachette, un lieu secret ; puis il désigna à la Renaissance le passage étroit dans une haie pour les lièvres et autres gibiers. Dans le français de la première moitié du XXe, on utilisait aussi le mot musse pour cachette (et musser pour se cacher). - (42) |
| musse. s. f. Passage étroit, caché, petite sente dérobée dans un blé, dans une haie ; trou de rat ou de souris dans un mur. Vient du latin mus, rat, souris. - (10) |
| musser (s') (v. pr.) : se glisser, se fourrer - (64) |
| musser (se) : se cacher (voir : meusser). - (56) |
| musser (se), se cacher, meusse, triste, maussade. - (04) |
| musser (v. tr.) : introduire, glisser un objet dans un endroit généralement étroit ou caché - (64) |
| musser : passer par un trou étroit. (P. T IV) - Y - (25) |
| musser : se faufiler - (60) |
| musser v. (v. fr.). Cacher. - (63) |
| musser : (ou, variante : se musser). Se glisser, se faufiler dans un passage très étroit. - (58) |
| musser. Cacher, vieux mot. - (03) |
| musser. v. - Enfiler, glisser : « Allez Jacques, musse tes bottes ! On va aller vé' les vaches! » Se musser : se faufiler, se glisser. - (42) |
| musser. v. a. Cacher, soustraire, dérober aux yeux, ne pas faire voir. – Se musser. v. pronom. S'esquiver, se soustraire aux regards par des passages secrets, par des ouvertures cachées. Les rats, les souris se mussent dans les trous des murs. - (10) |
| muss-hant (soleil), couchant. - (05) |
| mut, ute. adj. Muet, ette. Dulatin mutus. (Saint-Florentin, Puysaie). - (10) |
| mutan (a) : au milieu. (S. T IV) - B - (25) |
| mutan – milieu. - Jetelle don cequi â mutan de lai rue, ci ne vaut ran du tot. - A sont airivai â mutan de lai neu. - (18) |
| mutan, s.m. milieu. - (38) |
| mutant ou mitan : milieu - (60) |
| muteleau. s. m. Muselière. - (10) |
| muteler (verbe) : mettre une muselière aux bœufs. - (47) |
| muteler, v. a. museler, mettre une muselière aux bœufs de charroi. - (08) |
| muteler. v. - Museler. - (42) |
| muteler. v. a. Museler. Du latin mutus, mutulare. - (10) |
| mutin, taciturne. - (05) |
| mûtiot (n. m.) : muselière - (64) |
| mutiot, mutchot. n. m. - Muselière portée par les veaux, pour éviter qu'ils ne mangent de la paille. - (42) |
| muÿî : moisir et moisi. - (62) |
| muz-hi, moisi. - (05) |
| muziô, museau. - (16) |
| my, pron. moi, me. (voir : mi.) - (08) |
| myâlé, miauler, se dit du chat. Mya'on, miaulement (onomatopée). - (16) |
| myalle : merle. (B. T IV) - D - (25) |
| myé, miel. - (16) |
| myere. Myrrhe. - (01) |
| myo, myote, muet, muette. Myote se dit aussi pour : mie de pain et pour : petit morceau de pain. - (16) |
| mystare : Mystère. « Y a pas de qua fare tant de mystare, an en a bin déjà autant vu ! ». - (19) |
| mysteire. Mystère, mystères. - (01) |
| m'zaule, adj. où l'on mange, où l'on se régale. fête « manjouére » ou « m'zaule », en = fête patronale. - (08) |
| m'zeille, s. f. mangeaille, nourriture des animaux et particulièrement des porcs. - (08) |
| m'zer : manger. - (52) |
| m'zer, manger - (36) |
| mzer, mijer (v.) : manger - aussi miger - (50) |
| m'zeure (na) : mesure - (57) |
| mzeure n.f. Mesure. - (63) |
| m'zeurer : mesurer - (57) |
| mzeurer v. Mesurer. - (63) |
| m'zou, ouse, s. m. et f. mangeur, mangeuse. le féminin m'zouse se prononce en quelques lieux m'zoure. - (08) |
| m'zue, s. f. mesure. - (08) |
| m'zuer, v. a. mesurer, prendre mesure ou régler une quantité déterminée en mesurant. - (08) |
| m'zuhaige, s. m. mesurage, action de mesurer. - (08) |
| n' : adv. Ne. - (53) |
| n’a. N'est : « Ce n’a ran », ce n'est rien. - (01) |
| n’airò. N'aurais, n'aurait. - (01) |
| n’aivé. N'avez. - (01) |
| n’é. N'a : N’é-t’i pas tor ? n'a-t-il pas tort? - (01) |
| n’gun : (pronom) personne « y a n’gun » ; « en n’gun lu » : nulle part - (35) |
| n’tailli (se) : délivrer (se) (pour un animal) - (57) |
| n’vou : neveu - (43) |
| n’voûse : nièce - (43) |
| nâ (prononcer : nnâ), non. - (16) |
| na : noir - (51) |
| na : Noir. « In bû na » un bœuf noir. « Le temps est na c'ment du boudin » : le ciel est obscurci de nuages noirs. « O n'est pas si diabe qu'ol est na » : il n'est pas aussi diable qu'il est noir, il n'est pas aussi méchant qu'il en a l'air. - (19) |
| nâ : Noyer. « O s'est nâ dans la Seune » : il s'est noyé dans la Saône. « Tiens via qu'i plio mâ la premère gotte ne m'a pas nâ » : tiens voilà qu'il pleut mais la première goutte ne m'a pas noyé. - (19) |
| na : une - (57) |
| nâ, nère : (adj.) noir (e) - (35) |
| na, nère adj. Noir, noire. - (63) |
| nâbo, se dit, par ironie, à un enfant. - (16) |
| nâbot - petit enfant, ordinairement faible de santé. - C'â in pôre petiot nâbot. - Veins, mon nâbot, qui t'embressâ. - (18) |
| nabot ou nainbot. : Petit nain. - Le dialecte a pour positif nabe et pour diminutif nabet, le patois a pour diminutif nabotin. Roquefort pense que le mot latin napus, navet, est la source de ces mots. - (06) |
| nabout. n. m. - Nabot. - (42) |
| nabout. s. m. Nabot, homme très-petit. Il est grand comme un nabout. (Lainsecq). - (10) |
| nâcion, se dit souvent pour : famille. - (16) |
| nacotes : voir gnacotes - (23) |
| nacré (adj.) : se dit d'une personne qui ressemble à une autre de façon frappante (c'est son pée tout nacré (c'est tout le portrait de son père)) - (64) |
| nacré : exprime une forte ressemblance - (61) |
| nacter (des dents) : trembler. (DC. T IV) - Y - (25) |
| nadau, nadou. s. m. Gros crapaud. (Sainpuits, Saint-Sauveur). - (10) |
| nadou, nadaud. n. m. - Gros crapaud ; synonyme de ti 'vache. - (42) |
| nadouillè : tripoter l'eau avec les mains - (46) |
| nadouiller, agiter les mains dans l'eau. - (28) |
| nadouiller, barboter dans l'eau. - (26) |
| nadouiller. Au propre, jouer dans le ruisseau ou avec de l'eau, s'y tremper les mains en éclaboussant les voisins. Au figuré, flâner, n’en pas finir de faire une chose, s'attarder à la même occupation. Etym. inconnue. - (12) |
| nadouillou : qui est imprégné d'eau (nadouillouse au féminin), quelqu'un qui joue avec l'eau - (46) |
| nadouilloux. Qui nadouille, substantif venu de nadouiller. - (12) |
| nadze n.f. Nage. - (63) |
| nadzi : nager - (43) |
| nadzi v. Nager. - (63) |
| nagé (ā), naisé, vn. rouir (en parlant du chanvre). - (17) |
| nage (d'la) : neige - (57) |
| nage : Neige. « I a cheu eune bonne fornée de nage » : il est tombé une bonne fournée, une grande quantité de neige. « Les écoliers sant cantents de pouya se carreuchi à côs de boles de nage » : les écoliers sont contents de pouvoir se lancer des boules de neige. - (19) |
| nage : s. f., espace parcouru à la nage. « L'épreuve du C. P. S. M. comporte une nage d'au moins 100 mètres sans reprendre pied. » (Union du Dimanche, 14 jull. 1918). - (20) |
| nageottes : panais. - (66) |
| nageou (on) : nageur - (57) |
| nageouaîre (na) : nageoire - (57) |
| nageoux : Neigeux, couvert de neige. « San chépiau (son chapeau) est tot nageoux ». - (19) |
| nagerat : s. m„ nagerel, barque à tond plat dont l'arrière est carré et l'avant en arête. Voir barquot et farquette. - (20) |
| nagi : nager - (57) |
| nagi : neiger - (57) |
| nagi : Neiger. « Le temps est bin na, i va nagi ». « I ne veut pas nagi pa chauffer in fo » : il ne tombera pas assez de neige pour chauffer un four. - (19) |
| nâgueiller (v.) : mâchonner, mordre sans manger - (50) |
| nagueiller : grignoter - (39) |
| nâgueiller, v. a. mâchonner, mordre avec négligence sans manger. « naguiller. » - (08) |
| naguiller : grignoter, mordiller - (48) |
| naguiller, mordiller - (36) |
| nâhïer, v. a. taquiner, contrarier, tourmenter. - (08) |
| nahillard, naïllard. s. m. Nasillard. - (10) |
| nahiller, naïller (pour nasiller). v. n. Criailler, disputer sans cesse, gronder. – S'amuser a des choses futiles au lieu de travailler. (Ferreuse, Arcy-sur-Cure). - (10) |
| nahilleux, nailleux (pour nasilleux). adj. et s. Criailleur, disputier. (Perreuse, Sainpuits). - (10) |
| nâhïou, ouse, adj. taquin, contrariant, d'humeur difficile. - (08) |
| nai - neuf. Mis à peu près indifféremment pour neu, mais toujours quand c'est le dernier mot d'une phrase ou d'un sens. Voyez du reste Neu et Naive. - Ci nos é cotai nai francs. - I l’i ai demandai combein en y aivo de chevaux ; a m'é dit nai. - (18) |
| nai (on) : noir - (57) |
| nai : noir - (57) |
| nai. Net, nets. - (01) |
| naibot : n. m. Nain. - (53) |
| naichance (n.f.) : naissance - (50) |
| naichu : né. - (32) |
| naïer, nâ-yer, v. mouiller, tremper. - (38) |
| naige (ai), loc. a nage, être trempé de sueur, être en nage. - (08) |
| naige : Nage. « Ol a travarsé la revire à la naige » : il a traversé la rivière à la nage. - (19) |
| naige, s. f., nage, action de nager : »Por ratrapai l’batiau, ô s'é j'té à la naige. » - (14) |
| naigeou, s. m. routoir, rouissoir, lieu où l'on rouit le chanvre. - (08) |
| naiger, neiger, néger. v. a. Noyer, inonder, submerger. – Se naiger. v. pron. Se noyer. - (10) |
| naiger, v. ; faire rouir le chanvre. - (07) |
| naiger, v. a. boucher hermétiquement, fermer en bourrant, en calfeutrant. On « naige » un trou, une fente avec de la filasse, de la mousse,de la terre glaise ou toute autre matière qui remplit le vide d'une ouverture. - (08) |
| naiger, v. intr., nager. - (14) |
| naigi : Nager. « O naige c'ment les chins » : il nage comme les chiens, en battant l'eau. - (19) |
| naigir, naisir. Rouir ; « faire naigir le chande » (chanvre). - (49) |
| naîji : Rouir. « Fare naiji du chande » : faire rouir du chanvre. - S'abîmer par un long séjour dans l'eau « Alle a les mains naîjies d'avoir lavé la beu » : elle a les mains abîmées d'avoir lavé la lessive. - (19) |
| naîji v. (du lat. nasiare) Rouir le chanvre. - (63) |
| naîjoir n.m. Endroit destiné au rouissage. - (63) |
| naîjure n.f. Paquet de chanvre naîji. - (63) |
| nâillai - rouir. - I menons nâillai note chenôve dans les crots de Fliaigey. - Le chenôve ne nâille pâ bein dans l'aie corante. - (18) |
| nâillé, noueillé : v. t. Mouiller. - (53) |
| naillé, s. m., fontaine, source, lieu marécageux. - (11) |
| nailler (verbe) : être mouillé. - (47) |
| nâiller : mouiller, tremper, noyer - (48) |
| nâiller : (nâ:yé - v. trans.) (ne s'emploie qu'au part. passé) i seu nâ: yé : trempé jusqu'aux os. S'employait pour le chanvre qu'on trempait avant de le tèyé (le peigner) - (45) |
| nailli (être) : être mouillé. (SB. T III) - S&L - (25) |
| nailli (on) : noyé - (57) |
| nailli : noyer (verbe) - (57) |
| nâillou, ouse, adj. grognon, maussade, celui qui va toujours grommelant. (voir : nâhïou, nareillou.) - (08) |
| naing (n.m.) : nain - (50) |
| nainin. Nenni, qu'on prononce nani, terme populaire pour dire non… - (01) |
| nainin. : C'est-à-dire, non, non.- Les Bourguignons sont forts pour certains réduplicatifs. On les entend souvent répéter jusqu'à trois fois le signe de l'affirmation ou de la négation : si, si, si ; non, non, non. - (06) |
| nainni - non. - Te veinré tantot, n'eusse pâ ?... nainni, i ne surâ. - Oh ! nainni, bein sûr ; vos pouvez éte tranquille. - (18) |
| nainton. s. m. Qui est très-petit, qui tient du nain. (Joigny). - (10) |
| naipe, s. f., nappe : « L'côsin veinra gôter ; faut méte la naipe. » - (14) |
| naipe, sf. nappe. - (17) |
| Naipôlïon. c'est ainsi que nos campagnards prononcent le nom du grand homme. - (08) |
| naippe, s. f. nappe. - (08) |
| naiquai. : Ça lu, ça son peire tô naiquai, vou tô creiché. Vrai style d'écraignes, pour dire il ressemble en tout à son père. - Nos ancêtres les Bourguignons ne se faisaient pas faute de comparaisons ou de sentences triviales. - (06) |
| naiquou, enfant qui veut faire l'important... - (02) |
| naîrailli : noircir - (57) |
| nairàyer, v. n. devenir de couleur noirâtre, insensiblement : le ciel se nairàye. - (24) |
| naîre (na) : noire - (57) |
| naireigne, les narines. - (02) |
| naireigne. : Narines. - (06) |
| nairer - parcourir un endroit quelconque avec curiosité ; fréquenter trop souvent un lieu sans raison. - Quoi qu'ile veint don nairer qui, c'tée lai ? - Les voilai, teins, que nairant po lai cor, quemant tojeur. - (18) |
| nairer, rôder (en mauvaise part). - (27) |
| nairi, v. a. noircir. - (24) |
| nairiaûd (on) : noiraud - (57) |
| nairou, rôdeur, qui parcourt les champs pour trouver quelque chose et au besoin pour dérober. - (27) |
| naiser ou nâjer. Rouir, faire tremper très longtemps dans l'eau, dans le naisoir. Etym. notre mot, sous une forme vicieuse, n'est autre chose que le mot nager, être entoure d'eau, être trempé, être en nage. - (12) |
| naiser : v. a., rouir. - (20) |
| naiser. Faire rouir le chanvre. Vieux mot. - (03) |
| naisir, et nâzir, v. intr., moisir, sentir l'aigre. - (14) |
| naiso, roüissoir, ou rutoir pour le chanvre. En langue d'Oïl, nais. - (02) |
| naisô. : Rouissoir, lieu pour faire séjourner le chanvre dans l'eau. - (06) |
| naisoir ou nâjoir Rouissoir, creux où l’on fait rouir le chanvre, substantif tiré de naiser. - (12) |
| naisoir : s. m., endroit destiné au rouissage. - (20) |
| naisseaux (nom masculin) : nouveau-né. - (47) |
| naissu, part, du v. nâtre, né. - (14) |
| naisure : s. f., paquet de chanvre naisé. - (20) |
| nait : nuit (la). « Y fâ nait » : il fait nuit. - (62) |
| naiteurélle (adj.f.) : naturelle - (50) |
| naito - non plus, pas davantage. - En ne fauré pâ qua y aile, ni toi naito, t'entend ! – I ne le fairai pâ naito, moi. - (18) |
| naiture : n. f. Nature. - (53) |
| naiture. Nature. - (01) |
| naive - neuf. Mis souvent pour nai ou neuve, devant une voyelle. - Lai petiote n'é que naive ans. - Vos veinras vé les naive heures. - (18) |
| naivète, sf. navette. - (17) |
| naivotte (n.f.) : navette, plante oléagineuse - (50) |
| naivotte : navette (oléagineux) - (48) |
| naivotte, s. f. navette, plante oléagineuse. - (08) |
| naiyé (âte), (âte) nâyé : (être) noyé, (être) trempé par de l’eau alors que l’on est habillé - (37) |
| nai'yer, nâyer, nèyer : noyer (verbe) - (48) |
| naize (âte ai) : (être en) transpiration - (37) |
| naizer (v.t.) : faire rouir le chanvre - (50) |
| naizi : (vb) rouir le chanvre - (35) |
| naizu (n.m.) : bassin de rouissage du chanvre - (50) |
| najou (ā), naisoir, sm. routoir. - (17) |
| nake, mucus du nez ; nakou, celui qui a du mucus au nez et, par ironie, un enfant qui prend des airs d'homme. - (16) |
| nam : Nom « O ne sait pas seureument signer san nam » : il ne sait pas seulement signer son nom. - (19) |
| nan : non - (57) |
| nan : non ! - (46) |
| nan : Non. « O ne sait pas dire nan » : il ne sait pas dire non, il fait tout ce qu'on veut. - (19) |
| nan s'â, locution curieuse, pour : c'en est ; nan s'â pâ, ce n'en est pas. - (16) |
| nan : 1 adv. Non, indique la négation. - 2 n. m. inv. Non, expression de refus. - (53) |
| nan, nan ni, non. - (38) |
| nan, nanni, nênni, non. - (16) |
| nan, s. m. essaim. il y a des ruches qui essaiment deux fois par an, qui jettent deux « nans. » - (08) |
| nancier, v. n. avoir souci, avoir cure de… - (08) |
| nanfro. Qui parle du nez. Ce mot est presque une onomatopée ; on ne peut le prononcer sans nasiller. - (03) |
| nan-nan : Oncle, tonton, dans le langage enfantin. « Dis banjo à tan nan-nan ». - (19) |
| Nannatte, prénom, Annette, Anne. - (38) |
| nanne (faire), goûter à 16 heures. - (40) |
| nan-ne (faire), loc., dîner, faire le repas de midi. - (14) |
| nanne (Faire). Prononcez comme dans Nantes. Diner. - (03) |
| Nan-nète, Anne. - (16) |
| Nan'nette : diminutif de Annette - (48) |
| Nannette. Nom de femme pour Annette, diminutif de Anne : « va queurier Nan-nett' », va appeler Nannette. - (08) |
| nan-ni, adv., nenni, non. - (14) |
| nanni, nenni. - (38) |
| nano. Terme enfantin pour bercer. - (03) |
| nantillé. Qui a des taches de rousseur. - (49) |
| nantille. Tache de rousseur. Lentille. - (49) |
| napan. Redingote, paletot, vêtement habillé que l’on met les jours ou l’on s'endimanche. Etym. habit a pan, un habit à pan, par abréviation un à pan (habit) sous-entendu ; puis un napan, des napants en empruntant l’n de un. - (12) |
| napi : cerisier probablement de la variété napoléon - (51) |
| napp' : n. f. Nappe. - (53) |
| napper : traîner les chemins - (39) |
| napperais : traîné chemin - (39) |
| nappi : très mouillé - (39) |
| nappiau, nappion, nappillon. s. m. Mouchoir sale ou déchiré. T'as là un joli nappion. ll n'est pas permis d'avoir un nappion si sale que ça. Du latin nappa. - (10) |
| napÿe : cerise probablement de la variété napoléon - (51) |
| naqua. : Un laquais (Del.).- Du temps où les jeux de paume étaient en vigueur, on appelait naquet le garçon de salle, lequel faisait le service des joueurs. - Dans le langage familier on disait naiquou ou morveu aux petits bons-hommes qui tranchaient de l'homme fait. - (06) |
| naquai. Faire sortir de son nez l'excrément nommé en français morve, en bourguignon naque. On dit d'un morveux qu'ai ne foi que naquai, et naquai alors est infinitif, qui devient participe lorsque, par exemple, au lieu de dire d'un enfant qui ressemble extrêmement à son père que « ç’a le peire tô creiché », on dit, à peu près dans une même idée, que « ç’a le peire tô naquai ». - (01) |
| naque (n. f.) : dent, dans le langage enfantin - (64) |
| naqué (tout), loc. bien ressemblant, tout pareil. - (22) |
| naque, nacotte. s. f. Petite dent d'enfant. – Tend-Naque, qui tend les dents, qui baye aux corneilles en regardant, qui ne fait rien. (Percey). - (10) |
| naqué, part., craché. Se prend dans un sens figuré. Pour exprimer, par exemple, qu'un enfant a les traits de son père : « Eh ! dit- on, coume ô le ressembe ! Y é lu tô naqué. » - (14) |
| naque, s. f., morve, mucosité qui sort du nez d'un enfant : « Mouch' donc ton p'tiot ; la naque li tombe dans l'bec. » - (14) |
| naque, sf. morve, sécrétion des fosses nasales. - (17) |
| naque. Quinte, caprice soudain, changement brusque d'humeur. Etym. naquer. - (12) |
| naquer, maquiller : mordre, mordiller. (F. T IV) - Y - (25) |
| naquer, naqueter des dents, claquer des dents par le froid, par l'effet de la peur ou de la fièvre. - (10) |
| naquer. Claquer des dents soudain, par extension changer de figure, changer d'attitude, d'humeur. Ce verbe existait dans le vieux français où il avait parfois, outre cette signification, celle d'attraper. Etym. comparez l'allemand nagen, ronger, et necken, taquiner. - (12) |
| naquer. Faire jaillir de la boue ou de l'eau contre soi ou contre quelqu'un. - (03) |
| naqueter, nouqueter. v. - Claquer des dents, des nacottes. - (42) |
| naquette, cervelle (expression usuelle, Qu'as-tu dans la maquette ? lorsqu'on est surpris par les idées ou les actions bizarres, irraisonnées de quelqu'un). - (27) |
| naquette, naquotte ou niaquette, niaquotte. S'emploie pour désigner les dents des petits enfants. - (49) |
| naquette, naquotte, s. f. petite dent, dent d'enfant. - (08) |
| naquotte : dent (enfant) - (48) |
| naquotte : une dent. - (56) |
| naquou, ouse, adj. morveux. Vaniteux. - (17) |
| naquoû, s. m. et adj., morveux, et au fig. gamin qui fait l'important, de ceux dont on dit : « On li tordrôt l'nâze, qu' y en sortiròt côre du lot. » - (14) |
| nar (adj.m.) : noir (aussi nouair) - (50) |
| nar, e, adj. noir : « aine zeuman nare », une jument noire. - (08) |
| nar, narfe. s. m. Nerf. - (10) |
| nâre : Noire, féminin de nâ. « Alle a vêti sa reube nâre » : elle a mis sa robe noire. Malpropre, salie par l'usage. « Sa chemige est nâre » : sa chemise est sale. - (19) |
| nâréillou (n.m.ét adj.f.) : moqueur, taquin - (50) |
| nareillou, ouse, adj. celui qui grogne, qui gronde sans cesse. Le véritable sens du mot est moqueur, taquin. - (08) |
| narfeux. adj. Nerveux. Il est narfeux comme un loup. - (10) |
| nargi : Noircir. « N'y a ren que vos nargit les mains c'ment d'écheilli des calas » : il n'y a rien qui noircit autant les mains que d'écaler des noix. - (19) |
| nâri v. Noircir. Y s'nârit dès cinq heures. - (63) |
| naris, nariles. s. f. pl. Narines. (Lainsecq). – Du latin nares. - (10) |
| narquoi. Narquois. On entend par ce mot, en bourguignon, un trompeur, un filou : c'est aussi la signification qu'on lui donne en français ; et comme ces narquois se sont fait un langage particulier, ce langage a été dit le narquois. Plusieurs l'appellent l'argot, le jargon des gueux, et simplement le jargon… - (01) |
| nascu (natus), né, nassu. - (04) |
| nase. s. f. Humeur qui découle du nez. (Saint-Florentin). Du latin nasus. - (10) |
| naser. Se dit du chanvre que l’on fait rouir. Par extension : mouiller. I seus nasé des pieds ai lai teite. Un nâsoir, en patois nâsou, est un creux d'eau destiné au rouissage. On appelle noue, la partie d'un toit où se réunissent les eaux pluviales. Ce mot est d'origine germanique : en allemand naessen signifie mouiller. - (13) |
| naseux. s. m. Gamin, nez-sale. (SaintFlorentin). Voyez nase. - (10) |
| nasiau, s. m., naseau : « L' voués tu d'avou son ch'vau ? I t'li fiche des cops su l’nasiau qu'la pauv' béte en saingne. » - (14) |
| nasillé, sn. hésiter ; lambiner. Épier. - (17) |
| nâsou, trou plein d'eau où l'on mettait rouir le chanvre. - (27) |
| n'aspi : vipère - (57) |
| nâssance, s. f. naissance. - (08) |
| nâssu (ât’e) : (être) né - (37) |
| nassu, né - (36) |
| nâssu, partie, passé du verbe naître. Né, germé, levé. S'emploie surtout en parlant des grains semés qui commencent à sortir de terre : « ain biau blé bin nâssu » , un beau blé bien levé. - (08) |
| nât’e : naître - (37) |
| natarou (être en), être en activité intense pour préparer une fête. - (40) |
| nâte, v. n. naître. - (08) |
| nater. v. n. Renifler. (Courgis). - (10) |
| nateure : Nature, naturel. « Y est eune bonne nateure » : c'est une personne d'un bon naturel. - Parties sexuelles des femelles. - (19) |
| nativitai. Nativité. - (01) |
| Natouze : Ruisseau qui traverse les communes de Mancey, Vers et Boyer. « Ol est allé pauchi (pêcher) des escrevisses dans la Natouze ». - (19) |
| nâtre (v.t.) : naître - (50) |
| nâtre, v. intr., naître. - (14) |
| natron, niatron : enfant. - (33) |
| naus (pron.pers. 1ère pers.pl.) : nous - (50) |
| navatte, s.f. navette. - (38) |
| naveaux, naviaux. s. m. pl. Navets. O mon grand pée, les bons naviaux (histor.) ! - (10) |
| navette : chou à huile. - (66) |
| naviau : (nm) chou-rave - (35) |
| naviau, s. m., navet, et au fig. objet de peu d'importance ; « Ça ? y et eùn naviau ! » - (14) |
| navieu : Navet. « Eune tarre de navieux » : un champ de navets. Peu usité. - (19) |
| naviô : navet (spécialité de Beaubery). A - B - (41) |
| naviot : navet - (44) |
| naviot : un navet. - (56) |
| naviot n.m. Navet. - (63) |
| Navoie : Nom de lieu, c'est celui de la montagne qui sépare Mancey d'Etrigny. - (19) |
| navòte, s. f., navette, outil du tisserand. - (14) |
| navòte, s. f., navette, plante dont la graine fournit l'huile de ce nom. - (14) |
| navotte - (39) |
| navrer. v. - Être transi, saisi par le froid : « C'matin i' fait eune fré d'loup, cheu navré ! » Le poyaudin a conservé avec navrer un mot remontant au passage des Vikings en Gaule... Très longtemps vivant en dialecte normand, ce mot est utilisé par le poyaudin en le limitant à une douleur physique due au froid. - (42) |
| navrer. v. n. Eprouver une vive sensation de froid. – Se navrer, se jeter à l'eau pour le bain, afin de moins sentir la brusque transition du chaud au froid. (Puysaie). - (10) |
| na-yé : noyé - (43) |
| nâ-yé, adj., trempé jusqu'à la peau. - (40) |
| nâyé, adjectif qualificatif : mouillé, noyé. - (54) |
| nâyer (se) (v.pr.) : se noyer - (50) |
| nayer, noyer. - (04) |
| nâyer, v. a. noyer, enfoncer dans l'eau, submerger. - (08) |
| näyi : (nm) noyer - (35) |
| nâ-yon, s. m., flaque d'eau. - (40) |
| nâyou, s. m. routoir, rouissoir, lieu où l'on fait rouir le chanvre. De nâyer = noyer, submerger. (voir : naigeou.) - (08) |
| nâ-you, s. m., celui qui fait tremper le chanvre. - (40) |
| Nazarai. Nazareth, petite ville de Galilée, où l'on croit que naquit la Vierge Marie, et que Jésus-Christ fit avec elle sa demeure jusqu'à l'âge de trente ans. - (01) |
| nâzé, adj., qui a mauvaise odeur, moisi. - (14) |
| nâze, et nazô, s. m., nez. - (14) |
| nazé, mouillé. - (26) |
| nâzè, rouir, faire baigner le chanvre dans l'eau ; nâzoir, creux d'eau où l'on fait nâzé le chanvre. - (16) |
| nazir, v., rouir le chanvre. - (40) |
| nazoir, s. m., rouissoir. - (40) |
| nazoue, lieu où l'on fait rouir. - (26) |
| né : noyé. A - B - (41) |
| né : noyé - (34) |
| né : nuit - (43) |
| né : Nuit « Entre le jo et la né y a point de barrère » : entre le jour et la nuit il n'y a pas de barrière, la fin du jour, la tombée de la nuit sont des expressions vagues. - (19) |
| ne plus, ne moins, ni plus, ni moins. - (04) |
| ne vò*, loc. une fois : il y avait ne vò... - (22) |
| nè : s. f. nuit. - (21) |
| nè, adj., net, propre, clair, luisant. - (14) |
| ne, nos : nous - (43) |
| né. Nez, nasus. - (01) |
| néan, s. m. croûte qui se forme sur la tête des enfants par suite de maladie ou de malpropreté. - (08) |
| nécessitai. Nécessité, nécessités. Voyez vatu. - (01) |
| ned'yinlùye, loc. nulle part, en nul lieu : je n'en ai trouvé ned'yinlùye. - (24) |
| ned'yiun, pr. ind. personne : il n'y a ned'yiun (du vieux français négun). - (24) |
| née - noyer. - Al é portai née dans le ruchais to les petiots chaits. - Al é choué dans lai rivére ; an lé retirai, ma al éto déji née. - Voyez Neyer. - (18) |
| née : nuit - (51) |
| née. Nez. On dit plus souvent à Dijon née que né, surtout à la fin des phrases, pour signifier le nez… - (01) |
| néer (se) v. Se noyer. - (63) |
| néfia : nénuphar. (E. T IV) - S&L - (25) |
| néfier. n. m. - Néflier. - (42) |
| néfion - on appelle ainsi, par mépris, le nez du chien du cochon, et même quelquefois des personnes. – Sâle que t'é, n'embraisse don pâ le néfion de c'te bête. - Oh ! le vilain néfion ! – En faut portant qu'a foure son néfion pertot. - (18) |
| négi : rouissage du chanvre. A - B - (41) |
| négi : rouissage du chanvre - (34) |
| negi : v. neiger. - (21) |
| négligi : négliger - (57) |
| nég'lligi : Négliger. « San butin est bien nég'lligi » : ses propriétés sont bien négligées, ses terres sont bien mal cultivées. - (19) |
| negon, pr. ind. personne : il n'y a negon. - (22) |
| negonlùye, loc. nulle part, en nul lieu : je n'en ai trouvé negonlùye. - (22) |
| négresse (la), s. f., marmite dans laquelle font la soupe les mariniers d'un équipage. (V. Pérole.) - (14) |
| neguin : personne. (F. T IV) - S&L - (25) |
| negun : personne. (SB. T III) - S&L - (25) |
| neill' : n. f. Nielle. - (53) |
| neille : (néy' - subst. f.) nielle, sorte de plante parasite du blé particulièrement envahissante, et dont la semence est noire. - (45) |
| neille, s. f. nielle par métathèse, la nigelle arvine. - (08) |
| neille. Aileron de l'amande d'une noix, On dit aussi neuillon. Ces mois me paraissent dériver de nucellus, petite noix. - (13) |
| neiller : se noyer, être très mouillé - (39) |
| neiller. v. - Noyer. - (42) |
| neintœyes, s. f. taches de rousseur du visage, lentilles. Verbe : neintllyi. - (22) |
| neit : (nf) nuit - (35) |
| neit n.f. Nuit. - (63) |
| neize : neige - (39) |
| néjé, nager. - (16) |
| néjou : s. m. creux plein d'eau où l'on fait rouir le chanvre. - (21) |
| nékyo (s’) : laiteron. (RDT. T III) - B - (25) |
| néle, nielle, plante dont la graine déprécie le blé. - (16) |
| némôte. : Petite personne de rien. C'est le mot latin nemo féminisé avec la plus singulière hardiesse. - (06) |
| némôtte, personne de peu d'importance ; en latin nemo. - (02) |
| nempi : remplir - (51) |
| n'empôche que, loc., contractive, cela n'empêche pas que... - (14) |
| n'en chaut ben. locut. adv. Je m'en moque bien, je m'en fiche pas mal. ( Etivey). - (10) |
| nen, pron. pers. on, l'on : « nen fé deu bru », on fait du bruit. - (08) |
| nénin, s. f. nourrice dans le langage enfantin : une bonne « nénin » ; cet enfant aime beaucoup sa « nénin. » - (08) |
| nenni, non... - (02) |
| nenni. négat. Non pas, non, pas du tout. Oh que nenni ! Nenni dà ! Du roman nennil et du latin nihilum. - (10) |
| nenni. Se prononce nain-ni et nan-ni dans le patois bourguignon. Au moyen-âge, on écrivait nanyl... - (13) |
| nentâ : Nettoyer. « Ol a bien nentâ san assiète » : il a bien nettoyé son assiette, il n'y a rien laissé. « Du blié bien nentâ » : du blé bien nettoyé, bien vanné; bien propre. - (19) |
| nenteuye, néteuye : (nf) tâche de rousseur ; aphte - (35) |
| nentille (na) : tache (de rousseur) - (57) |
| nentille : Lentille, ervum lens. « In pliat de nentilles » : un plat de lentilles. - Lentigo, tache de rousseur. - Dicton : « N'y a point de balle fille sans nentilles » : il n'y a de belle fille sans tache de rousseur, il n'y a pas de beauté parfaite. - (19) |
| nentille, n.f. tache de rousseur. - (65) |
| nentille, s. f. lentille. - (08) |
| nentille, s. f., lentille, légume. On donne aussi ce nom aux taches de rousseur : « Y ôt bé vrâ ; la Toinon serôt cor pu brâve, si all' n'avôt pas des nentilles plein la figure. » - (14) |
| nentille. s. f. Ancienne prononciation et ancienne orthographe de lentille, suivant Mesnage et Bernard de Pasilly. - (10) |
| nentilles, lentilles. - (04) |
| nentilli : Marqué de taches de rousseur. « Alle ne serait pas vilain-ne si aile n'était pas si neutillie ». - (19) |
| nentœyes, s. f. taches de rousseur du visage, lentilles. Verbe nentllyi (du vieux français nentilles). - (24) |
| nenv’yi : (vb) envoyer - (35) |
| nenvi : envoyer - (51) |
| nenvié, v. a. envoyer. - (22) |
| nenvier : jeter - (43) |
| nenvier, v. a. envoyer. - (24) |
| nenvyi v. Envoyer. - (63) |
| nêpe, niêpe. s. f. Nèfle. - (10) |
| népe, s. f. nèfle, fruit du néflier. - (08) |
| néphiâ, nymphiâ : n. m. Nénuphar. - (53) |
| népi, s. m. néflier, apocope de népier. - (08) |
| népier, népié (n.m.) : néflier - (50) |
| nêpier, niêper. s. m. Néflier. - (10) |
| nèple. Nèfle. - (03) |
| nequin, personne, nul. - (05) |
| nère : noire - (51) |
| nère adj. Noire. - (63) |
| nère, nâ : noir - (43) |
| nerf : s. m. Avolr un nerf entresauté, avoir les nerfs noués sur l'estomac, Ioc. désignant deux maladies indéfinissables, très communes et bien connues du public, quoique absolument ignorées des médecins. - (20) |
| nerreux, euse. adj. Qui contient des nerfs. De la viande nerreuse. - (10) |
| nerri : noircir - (51) |
| nervou : nerveux - (43) |
| nési, v. a. rouir, pour le chanvre (du vieux français naiser). — détremper longuement. - (24) |
| nési, v. a. rouir, pour le chanvre. — Détremper longuement. - (22) |
| nésia : personne qui raconte des choses invraisemblables. A - B - (41) |
| nésia : qui raconte des choses invraisemblables - (34) |
| nésille, s. f., noisette. - (11) |
| nesille. : Noisettes. (Du latin nucula, petite noix.) On dit aussi nozel. - (06) |
| net (na) : nuit - (57) |
| net, neit, s.f. nuit. - (38) |
| nèt, nuit. - (05) |
| nétéger v. a. Nettoyer. (Jussy). - (10) |
| nétéger, v. a. nettoyer, rendre propre. - (08) |
| nétéïer, v. a. nettoyer, rendre net, propre. - (08) |
| nétéyement, et néteyage, s. m., nettoiement, nettoyage. - (14) |
| nétéyer, v. tr., nettoyer : « All' vous nétéye ça qu'y é prope coume cinq sous. » - (14) |
| netteyer. Nettoyer. - (49) |
| neu - neuve, neuf. - Dans le sens français de neuf, c'est-à-dire qui n'est pas vieux mais ici il ne s'agit que du sens de nombre. Voyez aussi nai et naive. - I vourâ aivoir encore neu motons de pu. - Lote drôle é aipruchant neuve ans. - (18) |
| neu - nuit. - En à neu de bonne heure métenant. – Traiveillons pendant qu'a fait jor, lai neu veinré qu'an ne pourré ran fâre. - (18) |
| neû : Féminin neue. Neuf, nom de nombre. « Tra et tra sant chi et tra sant neû » : trois et trois font six et trois font neuf. - Neuf, nouveau. « Ol a vêti san gaban neu » : il a mis sa blouse neuve. « Qu'estce que tu racante de neû ? » : qu'est-ce que tu racontes de nouveau ? Au féminin, neue. « Eune neue reube » : une robe neuve. - (19) |
| neû : neuf (qouai de neû ? quoi de neuf ?) - (46) |
| neu : neuf - (48) |
| neû : neuf. « Des nippes toutes neûes ». - (62) |
| neu : nuit - (48) |
| neu : nuit. La neu tous les chats sont gris : la nuit tous les chats sont gris. - (33) |
| neu d'épœne, s. m. tranche de porc prise à la place des vertèbres et destinée à être offerte en cadeau. - (24) |
| nêu : n. f. Nuit. - (53) |
| neu, adj. neuf. - (38) |
| neû, adj., neuf : « Son onque veint d'li bailler eùn hébit tout neù. » - (14) |
| neu, e, adj. neuf, neuve. au féminin on fait légèrement sentir l'e muet dans neue : « al é mettu sé chausses neû' », il a mis ses bas neufs. - (08) |
| neû, neûe (adj.m. et f.) : neuf, neuve - (50) |
| neu, neuf. - (38) |
| neu, nuit ; é fé neu, il fait nuit. - (16) |
| neu, s. f. nuit : « ai l'entré d' neu », à la brune ; « al ô neu », il est nuit. - (08) |
| neu'. adj. - Neuf, neuve. - (42) |
| neu. Neuf dans toutes ses significations, soit de novem, soit de novus. - (01) |
| neù. Nuit, nuits, nox, noctes ; c’est aussi le singulier des trois personnes de nuire au présent de l'indicatif. - (01) |
| neû[y]on : noyau. - (52) |
| neuche, nuche, s. f. souche, tronc d'arbre. - (08) |
| neuchou(se) : (neuchou(ouz') - adj.) noueux en parlant d'un arbre. - (45) |
| neûdze : (nf) neige - (35) |
| neudze : neige - (43) |
| neudze n.f. Neige. - (63) |
| neûdzi : neiger - (35) |
| neudzi : neiger - (43) |
| neudzi v. Neiger. - (63) |
| neudzou : neigeux - (43) |
| neûe : la nuit - è fa neûe, il fait nuit - (46) |
| neue, nieue. Nuit, « y vai faire nieue ». - (49) |
| neuf, neuv adj. num. Neuf. - (63) |
| neufion : nez - (48) |
| neugne : n. m. Qui ne vaut rien, n'est rien. - (53) |
| neuil : nuit. (LEP. T IV) - D - (25) |
| neuillé, s. m. amas de balayures, tas d'immondices, retrait où l'on jette les ordures de toute sorte. (voir : neuilles.) - (08) |
| neuiller, regarder secrètement. - (28) |
| neuilles, s. f. plur. balayures d'une maison, immondices. - (08) |
| neûillon (n. m.) : chair de la noix - (64) |
| neuillon (n.m.) : amande de la noisette et des autres fruits à écales - (50) |
| neuillon : Cerneau de noix. Ex : "Quand on délie des calons coume ça avec ceux neuillons-là, ça veu die qu'j'aurons trop ben d'huile à c't'an-née. Cré m'en !..." - (58) |
| neuillon : noyau - (39) |
| neuillon, s. m. amande de la noisette et des autres fruits à écale. - (08) |
| neuillon. n. m. - Cerneau de noix ou de noisette. - (42) |
| neuillon. s. m. Amande de noix ou de noisette. – Se dit particulièrement des amandes de noix épluchées et préparées pour faire de l'huile. Une houttée de neuillons. (Courgis). - (10) |
| neûn : personne. N’y a neûn : il n’y a personne. - (66) |
| neurain : bétail. - (09) |
| neurain : Nourrain, jeune porc. « In banneurain » : un jeune porc déjà fort. - (19) |
| neurain : petit porc. (S. T III) - D - (25) |
| neure : Nuire. « Cen ne peut pas neure » : cela ne saurait nuire. - Gêner, ennuyer. « I me neut bien d'y aller » : cela m'ennuie beaucoup d'y aller. - (19) |
| neûre, nuire; s'ki m'neu, cela me nuit. - (16) |
| neure, v. n. nuire, être préjudiciable : « c' qui va m' neure », ceci va me faire du tort. - (08) |
| neure. v. n. Nuire. (Domecy-sur-leVault). - (10) |
| neuri - nourir. Le participe passé s'emploie dans le sens de jeune bétail élevé, nourri principalement pour la vente. - Croyez-moi, en gâgne tot de bein neûri les bétes. - Vos neuriras vos bétes sans pogne, ceute année. - L'occasion à bonne, i ailons fâre tot pliain de neuri. - (18) |
| neuri : nourrir - (43) |
| neuri : nourrir - (51) |
| neûri : Nourrir, allaiter. « O gagne quarante sous par jo mâ ol est neûri » : il gagne quarante sous par jour et sa nourriture. « Alle neûrit » : elle élève son enfant au sein. - (19) |
| neûrî, et nôrî, v. tr., nourrir. - (14) |
| neuri, vt. nourrir. - (17) |
| neùri. s. m. Jeune bétail. - (10) |
| neûriç’es (lâs), (lâs) « nounous » : (les) femmes morvandelles qui, lorsqu’elles venaient d’accoucher, partaient à paris (cela étant prévu bien longtemps à l’avance) pour allaiter au sein un petit enfant de dame « riche » né en même temps que le sien… tandis que ce dernier, resté à la maison, était élevé au lait de la vache du morvan… (à paris, la « nounou » n’était astreinte à aucun autre « travail » dans la maison…) - (37) |
| neûrice, et nôrice, s. f., nourrice. Réputées sont les fraîches et saines nourrices de la Bourgogne. - (14) |
| neurice, sf. nourrice. - (17) |
| neùrichant. partic. pr. de neûri. - (10) |
| neûrin - petit cochon, ou même tout autre petit animal que l'on se propose de nourrir. - On peut voir Neuri. - Voiqui cin petiots neûrins qui ai aichetai ai lai foire. - I vos vendra bein note vais, ma i ai envie d'en fâre in neûrin. - (18) |
| neurin (n.m.) : bétail d'élevage - (50) |
| neurin (nom masculin) : bétail d'élève. On dit aussi neurson. - (47) |
| neurin : gros bétail qui vient d'être sevré (veau) - (48) |
| neûrin : porcelet. - (29) |
| neûrin : porcelet. - (52) |
| neurin : bétail après sevrage (gros bovins). - (33) |
| neurin : n. m. Porcelet après sevrage. - (53) |
| neurin : s. m. cochon de deux ou trois mois. - (21) |
| neûrin, nourrisson de la truie. - (16) |
| neurin, s. m. bétail d'élève. Une ferme prospère lorsqu'elle a beaucoup de « neurin ». On dit « un ché d' neurin » pour une tête de bétail. - (08) |
| neuring : bétail - (39) |
| neurisson, nourrien, sm. nourrisson. - (17) |
| neuriteure : Nourriture. «O n'est pas difficile su la neuriteure » : il n'est pas exigeant pour la nourriture. - (19) |
| neûriteùre, et nôriteùre, s. f., nourriture. - (14) |
| neurot : noiraud. Très brun. Vient du latin burrus : de couleur sombre, burra : étoffe sombre. Il y a le « pinot beurot ». - (62) |
| neûrraîn (on) : nourrain - (57) |
| neûrrain n.m. Jeune animal, porc ou bœuf, à engraisser. - (63) |
| neurrain, neurran, neurraingne. s. m. Bétail. (Tharot, Athie, etc.). - (10) |
| neurrain. Nourrain. - (49) |
| neurri (v.t.) : nourrir - (50) |
| neûrri : nourrir - (57) |
| neûrri v. Nourrir. - (63) |
| neurri, neùri (l'r ne se prononce pas). v. a. Nourrir. - (10) |
| neurri, v., nourrir. - (40) |
| neurri,v. nourrir. - (38) |
| neûrrin : (nm) (collectif) l’ensemble des animaux que l’on élève - (35) |
| neurrin, n. masc. ; bétail que l'on nourrit. - (07) |
| neurriteure (n.f.) : nourriture - (50) |
| neurson (n.m.) : animaux de toute espèce que l'on élève - (50) |
| neurson : petit bétail, animaux de basse-cour. - (33) |
| neurson : volaille (ensemble des bêtes de la ferme) - (39) |
| neurson, s. m. nourrisson, par syncope de neureçon. Les « neursons » d'un domaine sont les animaux de toute espèce qu'on élève, aussi bien le bétail à cornes que les moutons, les porcs et les volailles. - (08) |
| neùsance, s. f., nuisance, tort, préjudice. - (14) |
| neusie : n. f. Noisette. - (53) |
| neusille. Synonyme patois de noisette... - (13) |
| neusilles, neusillé - noisettes, noisetier. - Ailons don cueillai des neusilles à bô. - Combein de neusilles, c'tannée !... En fairé de l'huile tré bein ; et c'a que çà de l'huile fine, cequi ! - (18) |
| neusilles, noisettes; du latin nucellœ, petites noix... - (02) |
| neusillotte - oseille. - Beillez-moi in pecho de neusillotte pou fâre cueure aivou des épinais. - Lai neusillotte monte ; i vas lai beillai ai nos couchons. - (18) |
| neusillotte, oseille sauvage. - (28) |
| neusillotte. Oseille. Vai-t-vitement dans le cortil, cuyer (cueillir) de lai neusillotte pour fâre lai soupe. On devrait dire eusillotte, diminutif d'oseille. - (13) |
| neut (neue) : nuit - (39) |
| neut' : Notre. « Neut’maitre » notre maître Les gens de la campagne disent volontiers : « Neut’fane » au lieu de « Ma fane » (ma femme). - (19) |
| neut : nuit. - (09) |
| neut : nuit. - (32) |
| neùt, s. f., nuit : « Bonsouér, compeire ; i fait neùt ; j'vons dremî. » - (14) |
| neût, s. f., nuit. - (40) |
| neut. s. f. Nuit. - (10) |
| neutare : Notaire. « I est c’ment si le neutare y avait passé » : c'est comme si l'affaire avait été faite pardevant notaire, c'est irrévocable. - (19) |
| neutés : Nos. « J'ins mené neutés bûs à la foire » : nous avons mené nos bœufs à la foire. « Neutés mandes, neutés gens » : nos parents. « J'ins été voir neutés mandes » : nous sommes allés voir nos parents. - (19) |
| neûtre (le) : Notre (le). « I ant ésu leu pâ je voulins la neûtre » : ils ont eu leur part, nous voulons la nôtre. - (19) |
| neutre, noton : notre - (43) |
| neutse : (vb) niche (du chien) - (35) |
| neuvate, nouvelle. - (16) |
| neuvè, adj. nouveau. - (17) |
| neuviain-me : Neuvaine. « San garçan a amené in ban luméro. - Pardie alle li avait fait dire eune neuviain-me ! » : son fils a tiré un bon numéro. Ce n'est pas étonnant, elle avait fait dire une neuvaine à son intention. - (19) |
| neuvyà, nouveau. - (16) |
| neûye, les cuisses d'une noix ; noiyon, moitié de la neûye. - (16) |
| neûyer, s. m., noyer, arbre. - (14) |
| neûyon (n.m.) : noyau, amande - (50) |
| neûyon : n. m. Noyau. - (53) |
| neûyon, noûyon : noyau - (37) |
| neuyon, nouyon. Noyau. On emploie encore couramment le mot « os ». Ex. : « un os de perne » (un noyau de prune). - (49) |
| neuyon, s. m., noyau de fruit. - (40) |
| neuzillaÿ, s. m., noisetier. - (40) |
| neuzille (na) - nuzille (na) : noisette - (57) |
| neuzille : Noisette, nux avellana. « Aller chachi des neuzilles dans le beu » : aller au bois cueilli la noisette. - Oseille, oxalis acetoselle. « Eune trope de neuzille » : une touffe d'oseille. - (19) |
| neuzille : une noisette. - (56) |
| neûzille, s. f., noisette : « Vons nous preùmener sur la levée, por miger brament nos neùzilles. » - (14) |
| neuzille, s. f., noisette. - (40) |
| neuziller : noisetier ou encore coudrier. Une neuzille est une noisette. - (62) |
| neuziller : un noisetier. - (56) |
| neûziller, s. m., noisetier. - (14) |
| neuzilli (on) - nuzilli (on) : noisetier - (57) |
| neûzi'ote, oseille. - (16) |
| neuzire (d’la) : coudrier - (57) |
| neûziye, noisette. - (16) |
| neveur : s. m., neveu. - (20) |
| neveur, neveu. - (05) |
| neveùr, s. m., neveu : « Ol é ben le neveur à son onque, » dit-on pour constater l'identité de quelqu'un. - (14) |
| neveur. Neveu. - (49) |
| nèvotte : (nèvot' - subst. f.) navette oléagineuse. - (45) |
| nevou : Neveu. « Ol a laichi tot san butin à san nevou » : il a laissé tout son bien à son neveu. Au féminin : nièce. - (19) |
| neyè : noyer -, è s'é neyè dans lè Seûne, il s'est noyé dans la Saône - (46) |
| néyé ; s'néyé, se noyer ; s'néyé, longtemps français, valait mieux que se noyer, parce qu'il ne déformait pas, comme noyer, se noyer, le mot né, ney, vieux nom de l'eau dont noyer et néyé dérivent. - (16) |
| néÿe-chrétien, s. m., périssoire. - (14) |
| neyer - noyer. - Les temps changent beaucoup. - I neyrâ ou bien i neirâ. Voyez, du reste, Née. – Le Gosset é neyé son chien dans lai crainte qu'a feu enraigé. - Vos neyrâ totes les cancouâgnes. - (18) |
| nèyer (se) : se noyer. - (56) |
| neyer (verbe) : noyer. - (47) |
| néyer : noyer (verbe) - (61) |
| nèyer : noyer (verbe). - (52) |
| néÿer, v. tr., noyer, faire périr par immersion. - (14) |
| néyer. Noyer, vieux mot. - (03) |
| nez tarou (avoir le), se trouver attrapé - (36) |
| nèzeur : s. f. fagot de chanvre. - (21) |
| nézi : rouir le chanvre - (43) |
| nez-tée. n. f. - Très mauvaise odeur : « Jacques i' vint d'vider la fausse à purin, on en a pris eu ne sacrée nez-tée ! l' fasait pas bon à rester dans la cour. » (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| ngain : dans le Clunysois (ou petite Bourgogne), personne ou chose insignifiante. B - (41) |
| n'gain : personne, chose insignifiante - (43) |
| n'guin : Pas un, personne. « J'ai bin été taper à sa pôrte mâ i n'y avait n guin à la maijan » : j'ai bien été frapper à sa porte mais il n'y avait personne à la maison. - (19) |
| n'guin lu : Nulle part. « Je vas charchi du miguet. - Y est enco treu d'houre, te n'en troueras en n 'guin lu » : je vais cueillir du muguet. - C'est encore trop tôt, tu n'en trouveras nulle part. - (19) |
| ngun pron. et n. (du lat. nec unus, pas un). 1. Aucun, personne. Y'a ngun. 2. Bon à rien. L'Ûgène, y'est un ngun ! - (63) |
| n'gun, pronom , personne. - (38) |
| ni goût ni gougnasse. expr. - Se dit d'un plat fade, sans goût : « Quoi dun 'qu'c'est qu't' as mis d'dans ? C'a ni goût ni gougnasse ! » (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| ni, pour ne le ; j’ni fré pâ, je ne le ferai pas. - (16) |
| niabochon : personne de petite taille - (44) |
| niabot. Nabot. - (49) |
| niace. s. f. Pie. (Chevillon). - (10) |
| niacottai : faire marcher ses mâchoires. O niaccotto des dents mon n'enfant : mon enfant claquait des dents. - (33) |
| niacou : morveux. - (66) |
| niacou, niaque. - morveux, morve. - Moche-tai don petiot niacou. - Ceute fonne lai n'é dière de cœur, diére d'inducation ; ile laiche ses enfants tot niacou, tot déchirés. Al é tojeur lai niaque à nez. - Ces mots ne s'emploient guère que pour les enfants, et encore ils ne sont pas de bon ton. Non plus que le suivant. - (18) |
| niacoué : bavard, menteur. A - B - (41) |
| niacouet : bavard, menteur - (34) |
| niacouet : qui dit n'importe quoi, à qui on ne peut faire confiance - (43) |
| niaffe, s. f. égratignure longue et profonde. - (24) |
| niafron, p'tchiot : n. m. Enfant. - (53) |
| niagué : v. t. Mordre. - (53) |
| niaguer : discuter acerbement. (RDM. T IV) - B - (25) |
| niaguer : mastiquer avec bruit (voie : nagueiller). - (56) |
| niaguer : mastiquer, mâchouiller, mordiller - (48) |
| niaguer : (nyagè - v. trans.) mâchonner avec les canines (donc à distinguer de mâ:quèyé et de tyafè), sans trop d'efficacité. - (45) |
| niaguon : (nyagon - subst.m.) reste de viande qu'un enfant laisse dans son assiette. - (45) |
| niaguoter : (nyagotè - v. trans.) même sens que niaguer, avec peut-être cependant un aspect légèrement plus duratif. - (45) |
| niais - beurdin (on) - nioniot (on) - dodot (on) : simplet - (57) |
| nialé : Abîmé par la nielle « Les bliés sant nialés ». En parlant des personnes : chétif, rachitique. « In cheti nialé ». - (19) |
| nialé : foutu - (44) |
| niale : Nielle, maladie des blés que l'on attribue au brouillard. - (19) |
| nialé, adj. chétif (comme est le blé envahi par les nielles). - (24) |
| niale, niaque : morve - (48) |
| niâle, s. f., nielle des prés, à forte odeur. - (40) |
| niale, s.f. nielle des blés. - (24) |
| niâle, s.f. plante à odeur forte ; ombellifère herbacée à fleur blanche en corymbe qui pousse dans les terrains vagues pierreux. - (38) |
| nialé. Terme d'injure, comme qui dirait gâté par l'ivraie, la nielle. - (03) |
| nialer : (vb) (fruit) couler, mal venir - (35) |
| nialet : petit fruit, petite semence - (43) |
| niallé adj. (de nielle). Pas épanoui, petit, rabougri. - (63) |
| nialler v. Abîmer, gâter. - (63) |
| nialou (n.m.) : enfant - (50) |
| nialou (nez), niaquou : morveux - (48) |
| nialou : bébé. - (33) |
| nianniöt, öte, adj. petit, chétif. Voir mannée. - (17) |
| niant-nîot : lambin, douillet - (37) |
| niantoux : personne sans énergie. - (30) |
| niaquai - ressemblant, tout pareil. – Oh ! vois-tu c'â son père tot niaquai ! – D'où vient cette expression ? Je ne sais. On exprime la même pensée en disant aussi c'est son père tout craché. - (18) |
| niaquai : mordre. - (33) |
| niaque : mâchoire. A - B - (41) |
| niaque : mâchoire - (34) |
| niaque : (nyak' - subst. f.) morve. - (45) |
| niaque, naque (C.-d., Chal., Morv.). - Morve, humeur qui sort des narines. Il vient du vieux français nasque pris pour nez, dont l'étymologie est le latin nasus. Niacou, niacouse signifient morveux, morveuse et, par extension, mouchoir. - (15) |
| niaque, niaquou : la morve, un morveux - (46) |
| niaque, s. f. naque, morve, humeur qui sort des narines. - (08) |
| niaque. Morve. Sérosité qui s'écoule du nez. Niaquoux, qui a le nez malpropre. Reniaquer, éternuer. Voiqui eune fomme que n'ai gueîre de soin : en teut temps ses p’tiots sont niaquoux. On admet généralement que ces mots dérivent de nasus, nez... - (13) |
| niaque. Mucosité du nez. Etym. inconnue. - (12) |
| niaquer (v.t.) : déchirer en mordant ; mordiller - (50) |
| niaquer : mordre - (44) |
| niaquer : mordre. - (52) |
| niaquer v. (onom.) Mordre par surprise. - (63) |
| niaquer : mordiller - (39) |
| niaqueter : chez le cheval, faire semblant de mordre. A - B - (41) |
| niaqueter : cheval qui fait semblant de mordre - (34) |
| niaqueter : cheval qui fait semblant de mordre - (43) |
| niaquette (n.f.) : dent d'un enfant - (50) |
| niaquou (-ouse) (n.m.) : celui, celle qui niaque - (50) |
| niaquou : adj. et n. m. Morveux. - (53) |
| niaquou(oure) : se dit de quelqu'un ou d'un animal qui mordille - (39) |
| niaquou, ouse, adj. morveux, celui qui a de la morve au nez. se dit d'un enfant. - (08) |
| niaquouet n.m. (de niaquer). Bavard, menteur, djeux d'ren (diseur de rien). - (63) |
| niaquoux -ouse adj. et n. Qui montre les dents, hargneux. - (63) |
| niaquoux. Mai mouché adjectif venu de niaque. - (12) |
| niaquouze : une perche goujonnée - (46) |
| niar, niarou(se) : (nyar, nyarou(ouz') - adj. substantivé) petit enfant en général mal soigné. - (45) |
| niar, s. m. nerf. - (08) |
| niâr, s. m., nerf : « Quà ç'a-t-i qu'alle avôt fait ? L'butôr ! ô t'li flanquôt des cops de niâr de beû. » - (14) |
| niarcoter (gnarcoter) : agacer, agresser en agaçant - (51) |
| niarcoter (se) v. (de niâr à l'origine de nichet). Se quereller, se chamailler. - (63) |
| niare, nière. Nerf. - (49) |
| niarf : Nerf. « O n'est pas grand mâ ol a du niarf » : il n'est pas grand mais il a du nerf, il est nerveux, fort. - (19) |
| niarfe, s. f. égratignure longue et profonde. - (22) |
| niargue. Musette. Niargou, joueur de musette. Étymologie inconnue. - (03) |
| niargue. Vielle (ancien instrument de musique). - (49) |
| niarguer, provoquer quelqu'un en cherchant à l'exciter par des moqueries. - (27) |
| niarguer, v. tr., narguer, gouailler, persifler. - (14) |
| niarguer. Narguer. - (49) |
| niarou : pleurnichard - (44) |
| niarou se, adj., mou, paresseux, propre à rien. Se prononce gnidrou. - (11) |
| niaroux. Douillet ; qui se plaint ou qui pleure constamment. - (49) |
| niarqué, vt. manger. - (17) |
| niarton. n. m. - Petit enfant. - (42) |
| niau - œuf qu'on laisse dans le nid pour engager les poules à venir régulièrement y pondre. - Les poules al ant cassai lote niau. - I ne laichons point de niau, no, et les poules venant tôjeur. - (18) |
| niau (Morv.), nié (Y.), niot (Br.), gnieu (Chal.). - OEuf, naturel ou artificiel, qu'on laisse dans le nid pour attirer les poules et les engager à pondre. Ce mot vient de nidus, nid, et non de nihil, rien, comme l'ont prétendu quelques auteurs. La langue française a le mot nichet pour exprimer la même chose (Littré, Bescherelle), mais alors l'origine est nicher. - (15) |
| niau (n.m.) : oeuf factice pour inciter les poules à pondre (aussi grau) - certains appliquaient aussi le mot à l’oeuf en bois qu'on utilisait pour repriser les chaussettes (selon Roger Dron) - (50) |
| niau : nichet. Œuf factice placé au nid pour inciter la poule à pondre. - (62) |
| niau : (nyô: - subst. m.) 1 - faux œuf pour inciter les poules à pondre dans un endroit donné. 2- (péjoratif) enfant. - (45) |
| niau, nion : vx fr, nieu, s. m., nichet. - (20) |
| niau, œuf laissé dans le nid pour engager les poules à pondre ; en latin du moyen-âge , nidasius avait ce sens ; d'où les mots nice, mioche, et enfin niais. - (02) |
| niau, s. m. nichet, œuf qu'on laisse dans le nid pour attirer les poules. - (08) |
| niaû, s. m., oeuf en terre pour attirer les poules. - (40) |
| niau, sm. œuf laissé dans un nid de poule pour provoquer la ponte. - (17) |
| niau, subst. masculin : nichet, oeuf en plâtre ou en faïence que l'on met dans les nids. Au sens figuré, il désigne de petites économies, des pièces que l’on met de côté. - (54) |
| niau. Œuf placé dans l'endroit où l’on veut faire pondre les poules. On l'a dérivé du latin nihil, mais il pourrait venir de nid. - (13) |
| niau. : Œuf mis dans un nid pour attirer une poule pondeuse, et, par extension, dernier-né d'une couvée. Du latin nidamentum sortent : le mot nigaud, l'expression bourguignonne nioche ; les mots niauque et nioque de Genève, ninoche ou ninouche de Valenciennes et sans doute jusqu'au mot niquedouille, qui tous expriment ainsi que niau un sot, un hébêté, un niais. - (06) |
| niaud : œuf pourri, ou œuf en porcelaine (leurre) pour inciter les poules à pondre - (34) |
| niaud : mioche. - (33) |
| niaud n.m. (d'une racine niâr puis du lat. pop. nidale, nichet). 1. Oeuf pourri ou œuf en plâtre ou en bois, pour inciter les poules à pondre, nichet. 2. Nid de poule. - (63) |
| niaud. Œuf naturel, ou en bois qu'on met dans le nid pour tromper les poules et les faire pondre dessus ; au figuré, magot, argent cache. Etym. nid. - (12) |
| niauderie : bêtise. (E. T IV) - VdS - (25) |
| niaulé (-e) (p.p.,adj.) : tacheté (-e) de noir - (50) |
| niaule : Coquelourde, lychnide, lychnis githago. « In blié plien de niaule ». - (19) |
| niaupe : (nyôp' - subst. f.) (péjoratif) lit, couche. - (45) |
| nibuleu, euse, adj. nébuleux, trouble : du vin « nibuleu », de l'eau « nibuleuse. » - (08) |
| nicasser : ricaner sottement. (F. T IV) - Y - (25) |
| nice , niche, niais, nicot. - (04) |
| nice, adj. sans courage ; éreinté ; fainéant. - (17) |
| nice, sm. ver de viande. - (17) |
| nice. adj. Niais ou, tout au moins, simple, novice, ignorant, sans expérience. Du latin nescius. - (10) |
| nicessaire, adj. nécessaire : « a n'é pà son nicessaire », il manque de tout. - (08) |
| nicet, adj. malingre et difficile à nourrir. - (22) |
| nicet, adj. malingre et difficile à nourrir. Féminin nicette. - (24) |
| nichaubé : ça ne fait rien. - (66) |
| niche, farce (en parlant surtout de celles que font les enfants entre eux). - (27) |
| niche, nize, s. f. œuf que les mouches déposent sur la viande et qui n'est pas encore éclos. - (08) |
| nichi : nicher - (57) |
| nichi : Nicher. « Des tepins pa fare nichi les moniaux » : des pots à moineaux. - (19) |
| nicho bé (bé mah) : cela m'est égal. (N. T IV) - C - (25) |
| nichobé : tant pis (n'y chaut bien = cela n'a pas d'importance). (S. T III) - D - (25) |
| nichouaîr (on) : nichoir - (57) |
| Nicôdéme. Nom de ce magistrat pharisien qui eut de nuit avec le Sauveur l’entretien rapporté par saint Jean, chap. 3… - (01) |
| nicodème. s. m. Grand garçon, niais et mal bâti. - (10) |
| niçon. s. f. Jeune fille simple et candide. - (10) |
| Nicot : diminutif de Dominique - (48) |
| nicot, s. m. simple, niais, nigaud, maladroit. - (08) |
| Nicot. Jean Nicot était un perruquier de Beaune, qui vivait au commencement de ce siècle.. - (13) |
| nicotte. s. f. Dent. (Joigny, Auxerre). – A Villiers-Saint-Benoit, Nicaude. - (10) |
| Nicoulâ, Coulâ, Nicolas. - (16) |
| nicroche, difficulté. - (05) |
| nid : Nid. Dicton : « Chèque ujau troue san nid biau » : chaque oiseau trouve son nid beau, chacun trouve parfait ce qui lui appartient. « In nid de grandes » : un guêpier. - (19) |
| nié : v. t. Noyer. - (53) |
| nié, niau. s. m. CEuf naturel ou artificiel laisse dans le nid des poules pour les engager à y pondre. – Economie réunies, entassées en secret. Ah ! le vieux, Il est riche ; si j'avais son niau !... On prononce plus généralement gniau. - (10) |
| niée (n. f.) : nichée - (64) |
| niée : (nf) nichée - (35) |
| niée n.f. Nichée. - (63) |
| niée. Nichée. « ln-ne niée de p'sins ». - (49) |
| nielle (na) : brume - (57) |
| nielle : s. f., coulure (des fruits). - (20) |
| nieller : v, a., abîmer, gâter, fruit niellé, fruit qui a coulé, ou qui est mal venu par suite de coulure. - (20) |
| nieller, arracher la nielle du blé. - (05) |
| nielles, brouillards d'été. - (05) |
| niemporte. n'importe. (Courson). - (10) |
| nien, nion, personne, nul. - (05) |
| niépe, s. f. guêpe. env. d'Avallon. - (08) |
| nier : (nyé - v. trans.) noyer. - (45) |
| nier, neyer (se). Noyer. - (49) |
| nieû (ai) : (à) nouveau - (37) |
| nieue. Nuit. - (49) |
| nieût (brai) : très noir, nuit épaisse - (37) |
| nieût (lai) : (la) nuit - (37) |
| nièvra : noueux. Qualifie un terrain très humide. Vient de Nièvre où le sol est réputé (par les nôtres) très…meuble. - (62) |
| niévrou, ouse. se dit quelquefois dans la région sur le ton plaisant pour désigner un habitant ou une habitante de la Nièvre. - (08) |
| nif. adj. Clair, pétillant. Vin nif. Du latin niveus. - (10) |
| nifetant, nivetant. adj. Qui est ennuyeux, rebutant, qui exige beoucoup de précaution et de patience, absolument comme les opérations de nivellement, qui, lorsqu'on les répète souvent et sur une grande échelle, doivent être fort insipides pour ceux qui les font, surtout s'ils sont peu habiles dans le maniement du niveau. (Ferreuse). Voyez niveleux. - (10) |
| niflet ! excl. nég., non, non ! pas du tout ! Du vocabulaire des écoliers : « Ah! t'crais que j'vas t'en bailler ? Niflet ! » - (14) |
| niguedouille, s. m. simple, naïf. - (22) |
| niguedouille, s. m. simple, naïf. - (24) |
| niguedouye, niais. - (16) |
| niguette. s. f. Paquet de noix à la même branche. (Mâlay-le-Vicomte, Paron, Saint-Martin-du-Tertre). - (10) |
| niguiaire (nom féminin) : se dit d'une vache séparée de son veau. - (47) |
| niguiaire, adj. se dit d'une vache lorsqu'on l'a séparée de son veau pour la traire : vache « niguiaire », vache dont le veau est éloigné ou sevré. (voir : niquedouille.) - (08) |
| nihon : voir liron - (23) |
| ni-in : Niais. « Ol est pu ni-in que malin » : il est plus bête que méchant. « Jean le ni-in », personnage imaginaire à qui on attribue toutes les gaffes les plus invraisemblables. « Jean le ni-in », voir au mot foin-né. - (19) |
| niinserie : Niaiserie. « Te dis des niinseries ». - (19) |
| nillée, nichée. - (05) |
| nilli, v. a. guetter patiemment : un chat nillant un poussin. - (22) |
| nillon, 1. s. m. nichet, vieil œuf laissé dans le nid pour y retenir les pondeuses. — 2. adj. sans appétit, difficile à nourrir (même sens que nicet). - (24) |
| nillon, 1. s. m. nichet, vieil œuf laissé dans le nid pour y retenir les pondeuses. — 2. adj. sans appétit, difficile à nourrir. - (22) |
| nin (ï), adv. non. Oh ! bé, ma nin. Oh ! bien, mais non. - (17) |
| nin (ĭ), sm. nid. - (17) |
| nin : personne - yèvè nîn è lè cérémonie, il n'y avait personne à la cérémonie - (46) |
| nin, nuit. - (26) |
| ninçon : œufs de mouches sur la viande ; petits asticots - (34) |
| ninçon n.m. Asticot. - (63) |
| nine : s. et adj. f., naine. - (20) |
| nine, s. et adj. f., naine, petite femme. - (14) |
| nine. Naine. - (49) |
| nine. s. f. Naine. - (10) |
| ninfia, s. m., nénuphar. - (14) |
| nin-ni : Nenni, non. « Je périe qu'y est ta qu'as ébarchi ma sârpe. - Oh ! nin-ni bin, je l'ai pas touchie » : je parie que c'est toi qui as ébréché ma serpette. Oh ! nenni je ne l'ai pas touchée. - (19) |
| nin-ni : adv. Nenni, terme ancien de négation. - (53) |
| ninni, particule négative. nenni, non. on prononce « nin-ni, » - (08) |
| ninson : œufs de mouche sur la viande. Petits asticots. A - B - (41) |
| nintille. Lentille. - (49) |
| niô : œuf pourri. Œuf en porcelaine servant de leurre dans le poulailler. A - B - (41) |
| niô : un nichet, un œuf en plâtre ou autre matière placé sur les nids pour inciter les poules à pondre - (46) |
| nio : un œuf en plâtre qu'on mettait au poulailler pour inciter les volailles à pondre. - (66) |
| nio : nichée. - (33) |
| niô, nion : (nm) œuf en plâtre, nichet ; panier à œufs - (35) |
| nio, œuf factice pour inciter les poules à pondre. - (26) |
| nio. Œuf couvé ou factice, placé dans un nid pour inviter les poules à venir pondre. - (49) |
| niôch' : n. m. Mioche, petit enfant niais, affectueusement. - (53) |
| nioche – sot, imbécile. - Qu'ile â don nioche ! lai pôre Paponne ! - Hélas ! a n'inventeré pâ lai quoue des renoîlles ; c'a in vrai nioche. - Qui seu don nioche ! - (18) |
| niòche, adj. empoté, peu débrouillard : que t’es niòche ! - (24) |
| niòche, adj., sot, niais, nigaud : « Ol a ben été li dire l'afâre ; ôl é prou niòche, ma fî ! » Par une sorte de réduplicatif plaisant, on dit aussi : nionio. - (14) |
| nioche, niais. - (16) |
| nioche, s. m. nigaud, niais, nul. - (08) |
| nioche. s.et adj. Niais, badaud. (Athie). Du latin nescius. - (10) |
| nioche. Sot, niais. Par corruption du vieux mot nice. Nous disons également nionio. - (03) |
| nioderie : niaiserie, une bêtise, une absurdité, une parole sans intérêt - (46) |
| niole meurotte, n.f. brume apparaissant au moment des vendanges. - (65) |
| niôle n.f. (de hièble). Eau-de-vie, goutte. - (63) |
| niole, n.f. brume. - (65) |
| niolle : nuage,(C. T III) - B - (25) |
| niolle, gniolle. s. f. Conte, faille, niaiserie. Conter des niolles. – Au masculin, se dit pour niais. - (10) |
| niolle, s. f. l'yèble, sambucus ebulus de Linné. - (11) |
| niom (on) : nom - (57) |
| nion : œuf en porcelaine ou en argile, pour inciter les poules à pondre - (43) |
| nion : personne (négation) - (57) |
| nion, nedion : s, abstrait m., vx fr. negun, personne. - (20) |
| nioniot (on) : niais - (57) |
| nioniot, nioche, niais. - (05) |
| nioniotte - un rien, une bagatelle. - C'â de lai nioniotte, ne m'en pairlez pâ. - (18) |
| niope : lit - (48) |
| nioquè, zaguè : v. t. Choquer, heurter v. i. cogner. - (53) |
| niot (n. m.) : nichet, objet en forme d'oeuf que l'on place dans les nids des poules pour les inciter à pondre - (64) |
| niot : Oeuf qu'on laisse dans le nid pour inciter les poules à y venir pondre. Au figuré, petite somme qu'on tient en réserve. - (19) |
| niot, œuf laissé au nid. - (05) |
| niot. On appelle ainsi, dit Ménage, en Anjou et dans les provinces voisines, l'œuf qu'on laisse dans le nid des poules. - (03) |
| niou. Nœud. On a dit noud. - (03) |
| niouche, adj. empoté, peu débrouillard. - (22) |
| nioûd, et nûd, s. m., nœud : « N'y a si gros nûd qu'on ne défasse. » - (14) |
| nioud, nœud. - (05) |
| nioûle n.f. Nielle, plante nuisible, maladie du blé. - (63) |
| niouquer. v. a. et n. Se dit en parlant d'un enfant qui donne des coups de tête dans le sein de sa mère en tétant. (Courgis). - (10) |
| nipe, s. f. portion d'une chose comestible, de galette, de pain : il a emporté une grosse « nipe » du gâteau. - (08) |
| nipé, vêtu ; èl â bèn nipé, il est bien vêtu. - (16) |
| nipien, s. m. vaurien, mauvais sujet. - (08) |
| nippé, adj., habillé, équipé. - (40) |
| nique : s. f., nigaude. - (20) |
| nique, mieux niche. Mauvaise plaisanterie, espièglerie. - (01) |
| nique. s. f. Moquerie. Faire la nique à quelqu'un, se moquer de lui. Du latin nicere, nictari. - (10) |
| niquedauille (n.f.) : niais, imbécile (de Chambure note niquedouille) - (50) |
| niquedouille - un sot, un nigaud. - Les dictionnaires le donnent, mais le patois ajoute la variante Niquedandouille. - (18) |
| niquedouille, s. m. niais, imbécile. ce terme existe presque partout. - (08) |
| niquedouille, s. m., simple, niais, imbécile : « Oh ! l’grand niquedouille ! ô n'sait tant s'ment ran dire ! » - (14) |
| niquedouille, sm. naïf, peu dégourdi. - (17) |
| niquedouille. s. m. Espèce d'imbécile, de Nicodème. (Auxerre). - (10) |
| niquer : donner des coups de tête - (39) |
| niquer, v., faire l'amour. - (40) |
| niquet, sm. difficile, écrémé, dans la loc. fare le niquet, faire la petite bouche. E fa l’niquet : on dirot è chè qui mège è guêpre. - (17) |
| niquet. Mouvement de la tête. Une personne qui s'endort étant assise fait le niquet. « Faire le niquet » c'est envoyer de loin un bonjour amical. II s'agit ici, bien évidemment, de la nuque du cou, et non pas de la nusque du nez dont nous avons parlé. (V. niaque)... - (13) |
| niquote, nuquote : nuque - (36) |
| niquote, s. f. nuque : « lai niquotte » du cou. - (08) |
| niquotte : la nuque - (39) |
| niquou(re) : qui donne des. coups de tête, veau en tétant - (39) |
| nisan : Larve que la mouche bleue dépose dans la viande, on appelle cette mouche: « La môche à nisans ». - (19) |
| nischio - nisciou : délicat - (57) |
| nise (mouche de) : mouche à viande - (48) |
| nîse : œuf de mouche - (37) |
| nise : œuf de mouche - (48) |
| nise, subst. féminin : larve de mouche. - (54) |
| nison, s. m. groupe de larves dans la viande, le fromage. - (22) |
| nison, s. m. groupe de larves dans la viande, le fromage. - (24) |
| nisses : (nis' - subst f. pl.) œufs de mouche. Quê:t' vouêr s a y é poin: d'nis, "regarde donc s'il n' y a pas d'œufs de mouche" (sur un morceau de fromage, par exemple). - (45) |
| nitée. s. f. Nichée, le contenu d'un nid. Du latin nidus. - (10) |
| n'itou, loc. adv., non plus : « Y a eùn bal ; mâ, à cause de la Jaqueline, ô n'veut pas y aller. . . et moi n’itou. » Itou voulant dire : aussi, n'itou est conséquemment : non itou. Mieux vaut donc l'écrire n'itou que nitou. - (14) |
| nitout, netout. adv. négat. Non plus. (Mouffy). - (10) |
| nitse : niche - (43) |
| nitse : niche (nitse au tsin) - (51) |
| nitse n.f. Niche. - (63) |
| niuage, s. m., nuage, nue, nuée. - (14) |
| niveleux, niveteux. adj et s. Terme de mépris sous lequel, dans l'orlgine, les paysans désignaient les géomètres chargés des opérations cadastrales dans nos contrées, parce que, les voyant ivrognes, lambins et généralement peu habiles dans l'usage du niveau et de leurs instruments, autour desquels ils semblaient tourner sans rien faire, ils les considéraient comme des espèces de fainéants ; de telle sorte que ces mots sont restés dans plusieurs communes, dans celles de la Puysaie notamment. et qu'on les y emploie encore aujourd'hui comme synonymes de lanternier, de lambin, de musard, de paresseux. - (10) |
| nivelle. s. f. Morve. - (10) |
| niveter, niveler. v. n. Lanterner, tournailler, vétiller, regarder autour de soi en ayant l'air de chercher ce qu'on doit faire. - (10) |
| niviau : Niveau. « In niviau de maichan » : un niveau de maçon. - (19) |
| niviau, s. m., niveau, égalité. - (14) |
| nivlà prép. Voilà. - (63) |
| niv'lement, s. m. nivellement, aplanissement : « i niv'l, teu niv'l, a niv'l », pour je nivelle, etc. - (08) |
| nix ! et niscô ! excl. nég., non ! non pas ! Le premier est la prononciation adoucie du nichtz allemand. - (14) |
| nix, niscot. Interject. Non ! Pas du tout ! Par corruption de l'allemand nichts. - (10) |
| nîyer, v. a. noyer, plonger dans l'eau. - (08) |
| nize (n.f.) : oeufs que déposent les insectes - (50) |
| nize, s. f. œuf que déposent les insectes. - (08) |
| nizon : ver dans les planches, petit asticot - (43) |
| n'nâ. n'nô – abréviation de An-n'o. - Voyez ce mot. - (18) |
| n'o : nuisible, redoutable. O n'o pas n'o : il n'es pas méchant. - (33) |
| no ou nos : Nous. « Galants venez chez no car Dieu marci y a de tôt » (vieille chanson). « Y ara bin moyen de nos arrangi » : il y aura bien moyen de nous entendre. - (19) |
| no sia. : Corruption du non sit latin, négation plus accentuée que la simple particule no. - (06) |
| nô, adj. méchant, disposé à faire mal, à nuire. - (08) |
| no, nore (ō). adj. noir, noire. - (17) |
| no, o no. négat. Non. (Avallonnais). - (10) |
| no, partie, négat. non. On prononce en beaucoup de lieux « anno ». - (08) |
| nô, y : pron. pers. Nous. - (53) |
| no. Nous, et nos, pluriel de nôtre. Voyez vo. - (01) |
| nôbeut : nabot. (E. T IV) - VdS - (25) |
| Nobiau : nom de bœuf. III, p. 29-o - (23) |
| nobice. Novice. - (49) |
| noble, adj., fort, grand, mais presque toujours ironique et en mauvaise part. - (14) |
| noblesse. s. f. Femme noble. (Puysaie). - (10) |
| nobliasse : Noblesse. « De la veille nobliasse » : de la vieille noblesse. - (19) |
| Nob'lle : Nobles Nom de lieu, écart de la commune de Brandon. « Le chétiau de Nob’lle » : le château de Nobles. - (19) |
| noce à la popette : mariage un peu bâclé. (VSLD. T II) - S&L - (25) |
| nôce. Noce, noces… - (01) |
| noçoux. s. m. Noceur. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| Noë (n.propre) : Noël - (50) |
| Noë : Noël - (39) |
| Noé. Noël, fête de la naissance du sauveur et, par extension, fête religieuse ou de réjouissance en général. - (08) |
| Noéi, chants de Noël. Les noëls étaient, avant la grande explosion des journaux en France, la véritable gazette dijonnaise. Il n'y avait pas d'événement dans la cité, pas de ridicules bourgeois, et point d'aventures graveleuses qui ne devinssent les éléments périodiques de cette presse grivoise des Avents de Noël... - (02) |
| noei. Ce mot, quand il n'est que d'une syllabe, signifie une noix ou des noix : Une noei grionche, dé noei grionche, une noix angleuse, des noix angleuses ; mais Noëi, quand il est comme ici de deux syllabes, signifie la Fête de Noël, un Noël ou des Noëls à chanter. Dans la vieille Bible des Noëls, on trouve « chanter No » pour chanter Noël… - (01) |
| Noei-turelure. C'est le Noël qui a pour refrain Noei turelure, et qui est le premier que l’auteur ait composé. - (01) |
| Noel (Noël) (Petit) : s. m., enfant Jésus, qui est censé apporter des papillotes et autres cadeaux aux enfants dans la nuit du 24 au 25 décembre. - (20) |
| Noels (Noëls) (Faire ses) : loc., communier à Noël, comme on dit faire ses Pâques. - (20) |
| noése. adj. Noir. (Mâlay-le-Vicomte). - (10) |
| nœur, neure. s. m. Nœud. (Bagneaux, Soucy, Màlay-le- Vicomte). - (10) |
| nœurri : v. t. Nourrir. - (53) |
| noge, neige (o long). - (26) |
| noge, sf. neige. - (17) |
| nogé, vn. neiger. - (17) |
| noge. Neige. - (01) |
| noger : voir calougnier - (23) |
| noger, nouger. s. m. Noyer. (Perreuse, Val de-Mercy). - (10) |
| nogligence. s. f. négligence. - (08) |
| nogligent, adj. négligent, qui a de la négligence. s'emploie aussi substantivement : « ç'ô eun négligent. » - (08) |
| nogueillon, s. m. toute chose noueuse, raboteuse, qui offre des aspérités. - (08) |
| nogueillou, ouse, adj. noueux, raboteux. - (08) |
| nôïe, s.f. noix sortie de sa coque ; on dit aussi nô-yon. 'ine no-ye de calat' : un morceau de noix. - (38) |
| no-ier, nouer. Noyer. - (49) |
| noige : neige. Et on dira noigî pour neiger. - (62) |
| noige, neige, noize. - (04) |
| noige, neige. - (05) |
| noige, nouége, s. f. neige. « noize. » - (08) |
| noige, s.f. neige ; noigeou, -ouse, neigeux, -euse. - (38) |
| noiger, nouéger, v. n. neiger. - (08) |
| noiger, v. neiger. - (38) |
| noihottier. s. m. Noisetier. (Merry-la-Vallée). - (10) |
| noircitude, nuit profonde et très mauvaise action. - (16) |
| noirien, s.m.pinaud ; cépage qui donne le vin fin. - (38) |
| noirin, noirien, raisin pinot noir. - (16) |
| noirir, noircir ; lë râzin noirissan, les raisins noircissent. En comparant noirir avec bleuir, jaunir, etc., nous aimons mieux noirir que noircir dont nous ne comprenons pas le c. - (16) |
| noirotte, nouéotte. s.m. Noisette. ( Val-de-Mercy). - (10) |
| noisetté, nouesté : n. m. Noisetier. - (53) |
| noix est masculin. (F. T IV) - Y - (25) |
| noix pereux : voir calon - (23) |
| noix : s. m. Un noix, parce qu'on dit un cala (voir ce mot). - (20) |
| nom (ptiet) n.m. Prénom. - (63) |
| nom dai Diou d’bon Diou ! : juron classique atténué - (37) |
| nom du Père : loc, signe de la croix. Faire le nom du Père, faire le signe de la croix. Dire le nom du Père, dire les paroles qui accompagnent le signe de la croix. - (20) |
| nombeillot, s. m. nombril. - (08) |
| nombeureau, nombril. - (05) |
| nomée. : (Dial. ), renommée. - (06) |
| non : nous (complément) - (48) |
| non pâ ke, ce n'est pas que... - (16) |
| non pas de : loc. exclamative, plutôt que de... « Il est allé manger à Paris tout ce qu'il avait.. Oh ! Et pis il aurait ben mangé la cape à Dieu... - Non pas de rester tranquille chez soi ! » - (20) |
| non pas, loc., redondante : « O côr meû que non pas son freire. » - (14) |
| non, négation dans l'expression : Non pas don ? n'est ce pas ? - (17) |
| non, nom ; dire dë non, donner des surnoms offensants, des sobriquets injurieux. - (16) |
| non, pron. pers. ind. on : « non dit, non chante, non se dispute », pour on dit, on chante, on se dispute. (voir : nen.) - (08) |
| non, sm. nœud. - (17) |
| nonchaillanceté. s. f. Nonchalance. (Etais). - (10) |
| nonchaillant. adj. et s. Nonchalant. (Etais). - (10) |
| noncheillan, ante, part, prés., avec la négative, se soucier de, avoir Cure de... - (08) |
| noncheillance, s. f. nonchalance, insouciance, incurie. - (08) |
| noncheillance. subst. f. Nonchalance. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| nône, n. fém. ; bourdonnement des insectes dans l'après-midi ; Y entends lai nône. - (07) |
| nongains : côtés du perthuis. - (09) |
| nonnon : oncle (affectueusement) - (37) |
| nonon (n. m.) : oncle, dans le langage enfantin - (64) |
| nonostan. Nonobstant. Le bourguignon nonostant suit la prononciation italienne nonostante. - (01) |
| nonostant, prép., nonobstant, malgré. - (14) |
| nonot. s. m. et adj. Même signification que gandoulin, avec ceci en plus, peut-être, c'est que le nonot essaye quelquefois de raisonner, et qu'il le fait toujours bêtement. Quiens (tiens), tais-te donc ; t'es-t-un nonot. Faire le nonot, faire la bêle, simuler la bêtise, quelquefois pour faire rire. – Dans certains endroits, nonot s'entend d'un gros crapaud. - (10) |
| nonots et nénets. Mamelles de la femme. C’est l'onomatopée d'un enfant qui commence à balbutier Une nain-nain est une nourrice. Nan-nau, est le cri d'un bébé qui voit et qui désire sa nourriture. En Bourgogne, on applique ce mot nanan à un met savoureux et à la viande. A Paris du nanan, c'est du bonbon. - (13) |
| non-pis, loc. nu-pieds. On dit de même : non-tête, nu-tête, et non-chambes, nu-jambes. - (22) |
| nonque : n. m. Oncle. - (53) |
| nonseilleté, s. f. nonchalance, négligence, incurie. - (08) |
| nonseillou, ouse, adj. nonchalant, paresseux. Nonseillou = noncheillou par le changement ordinaire de ch en s. - (08) |
| nonte (le, lai), nontes (les) : nôtre (le, la), nôtre (les) - (48) |
| nonte : nôtre (pronom possessif). Ço pas la voûte, ço la nonte : ce n'est pas la nôtre c'est la vôtre. - (33) |
| nontre, adj. poss. des deux genres. notre. on prononce « nontre » lorsque l'adj. possessif n'est pas accompagné du substantif. On dit : « not' fonne », et « ç' p'tiô ô l' nontre », notre femme, cet enfant est le nôtre. - (08) |
| nori, vt. noircir. - (17) |
| norichon, sm. noirichon, noiraud. Figure brune. - (17) |
| normau adj. Normal. - (63) |
| normau : s. m., élève de l'école normale primaire des garçons. - (20) |
| noröt, adj. noiraud. - (17) |
| nos : nous - (51) |
| nos pron. pers. Nous, on. - (63) |
| nos, pron. de la première pers. pl. des deux genres sujet et rég. Nous : « ç'iai n'ô pâ por nos. » - (08) |
| nôs, pron. pers., nous. N'est pas toujours employé. Vient plus volontiers au début de la phrase : « Nôs v'ions ben. » - (14) |
| nosàyé, v. a. devenir de couleur noirâtre, insensiblement : le ciel se nosàye. - (22) |
| nosi, v. a. noircir. - (22) |
| nossû : n. m. Noceur, fétard. - (53) |
| nos-tés adj. poss. pl. Nos. Nos-tés bûs : nos bœufs. - (63) |
| not : notre - (51) |
| nôt' : pron. poss. Notre. - (53) |
| not, notte, adj. net, propre, nettoyé, lavé. Dans le masculin « not », le t ne se prononce pas. - (08) |
| not, notte. adj. Bête. O n'ot pas not, il n'est pas bête. (Sainl-Germain-des-Champs). - (10) |
| nöt, sf. nuit. - (17) |
| notaire : s, m., type de l'homme instruit. Il est savant comme un notaire. - (20) |
| notairerie : s. f., étude de notaire. - (20) |
| note - notre. - A traiveille dans note jairdin depeu médi. - Note champ de lai Meurée â pu joli qui ne lai jaimâ vu. - (18) |
| noté : (adj possessif) nos - (35) |
| note, et noute, adj. poss., notre : « Noute fonne ; note fieu. » - (14) |
| note, neute, nôtre. - (16) |
| note, noute adj. poss. Notre. - (63) |
| nôte. Note de musique. - (01) |
| note. Notre : « Ai note eide », à notre aide. Note est ici plus doux que ne serait notre, qui, en d'autres endroits, remplit mieux l'oreille, comme en celui-ci du Noël « Vote bontai »… - (01) |
| notés : nos - (51) |
| notéyaige, s. m. nettoyage, action de rendre propre, net. - (08) |
| notèyè : nettoyer - (46) |
| notéyer, v. a. nettoyer. (voir : nétéier.] - (08) |
| noton : (adj. Possessif arch.) notre - (35) |
| Notre-Dame n.f. Fête de la Vierge (15 août). - (63) |
| nottiai, nottieussaint, nottiot - divers temps du verbe nettoyer ou Nottie. Voyez ce dernier article. - (18) |
| nottie - nettoyer. - I vas nottie in pecho note écurie ; nos pôres bêtes ne daivant pas éte bein. - Est-ce que nos soulés sont notties ? - (18) |
| nou : nœud - (48) |
| nou : noeud. - (52) |
| noû : nœud. - (33) |
| nou : s. m. morceau d'échine de porc. - (21) |
| nou, noeud ; nous trouvons nou dans nouer, faire un noeud, un nou. - (16) |
| nou, nœud. - (27) |
| nou, noun. s. m. Noeud Du latin nodus. - (10) |
| nou, s. m. nœud avec ses diverses signifie. - (08) |
| nou, s.m. nœud. - (38) |
| nou. n. m. - Noeud. - (42) |
| noû’er (l’) : (le) noyer - (37) |
| nouâ (s'), v. se noyer. - (38) |
| nouâ, nouaille, s.m. noyer. - (38) |
| nouâge, s. f., neige - (40) |
| nouâger, v., neiger. - (40) |
| nouair : n. m. Noir. - (53) |
| nouaix (on) : noix - (57) |
| nouaize, neige - (36) |
| nouante, quatre-vingt-dix. - (16) |
| nouay, s. m., noyer sauvage. - (40) |
| nouayau (on) - caillou (on) : noyau - (57) |
| nouayi (on) : noyer (arbre) - (57) |
| noubette. n. f. - Surnom ; donner une noubette, donner un surnom. - (42) |
| noubette. s. f. Surnom, sobriquet. Donner une noubette, donner un surnom. (Perreuse, Lainsecq). - (10) |
| noubye : (nf) oseille sauvage (« herbe à crapaud ») - (35) |
| noûd (ain) : (un) nœud - (37) |
| noud : (nm) nœud - (35) |
| noud : nœud - (43) |
| noud : nœud - (39) |
| noud, nœud. - (04) |
| noué - noyer. - Les noués sont gèlai c't-année, en n'y airé diére de calots. - Ceute airmoire qui à tote en noué. - (18) |
| Noué (Ptiet) n.m. Enfant Jésus, censé apporter des papillotes et autres petits cadeaux aux enfants dans la nuit du 24 au 25 décembre. - (63) |
| Noué : (NP) Noël - (35) |
| noue : contre-bas humide dans un pré où poussent joncs et laiches - Sur les toits, fissure par où entre la pluie. (VDS. T IV) - VdS - (25) |
| Noué : Noël - (46) |
| Noué : Noêl - (57) |
| Nouè : Noël - (48) |
| Noué : Noël. - (29) |
| Noué : Noël. « La cheupe de Noué » : la bûche de Noël. « N'avoi pas pu de vartu que les vardeunes à Noué » : être engourdi comme les lézards (vardeunes) pendant l'hiver. - (19) |
| nouè : noir (nouère au féminin) - l'temps â nouè, è va grôlè, le temps est noir, il va grêler - (46) |
| noué : Noyer, juglans regia. « Chaplier in noué » : gauler un noyer. - (19) |
| noue : essaim de mouches annonçant l'orage. - (33) |
| Noué n.m. Noël. - (63) |
| Noué ! (ai) : (à) Noël ! - (37) |
| noué : (noué - subst. m.) noyer. Ce mot est concurrencé, quoique assez faiblement, par kèlâ:té (voir ce mot). - (45) |
| noue : prairie humide (gaulois : nauda). - (32) |
| noué, noyer, essence d'arbre (prononcer en une seule émission de voix). - (16) |
| nouë, s. f., source naturelle, rigole, et aussi prairie marécageuse - (14) |
| noué, s. m. noyer, arbre qui produit les noix. - (08) |
| noué, vt. noyer. - (17) |
| noue. s. f. Terrain à surface déprimée, frais et humide, abondant en herbes, dans lequel on mène paître les bestiaux. - (10) |
| noué. s. m. Noix. - (10) |
| nouée - Noël. - I ailons beintot éte ai nouée. - Lai fête de nouée a été bein chaude c't'année.- En dit ai nouée les mocherons, ai Paques les gliaissons. - (18) |
| nouée, nouère. adj. - Noir, noire. - (42) |
| nouée, s. f. noisette. on dit « cala » pour noix. - (08) |
| nouège : la neige - (46) |
| nouège : neige - (48) |
| nouège : neige. (B. T IV) - D - (25) |
| nouége s. f. Neige. (Vassy-sous-Pisy, Sacy). - (10) |
| nouège : (nouèj' - subst. f.) neige. - (45) |
| nouège : n. f. Neige. - (53) |
| nouége, noige (n.f.) : neige - (50) |
| nouége, s. f., neige : « J'ons été pris ; j'pouvions pas rentrer du marché : y avôt d'ia nouége pa dessur les saibots. » - (14) |
| nouèger : neiger - (48) |
| nouéger, v. intr., neiger : « Y é prou joli, quand on vouét c'ment c'qui nouéger tout blanc dans les prés. » - (14) |
| nouéje, neige; nouéjé, neiger. - (16) |
| nouél (chandelle de), dénomin. locale. Chandelle bariolée, multicolore, enjolivée de reliefs, que les femmes et les enfants portent et allument à la messe de minuit. Dans certains ménages, on en laissait toujours une neuve dans chaque chandelier, comme ornement sur la cheminée. - (14) |
| nouél, s. m., Noël, la fête et les cantiques. - (14) |
| nouël. n. m. - Noël : « On va fai'e la Nouël aveuc les grands-parents. » - (42) |
| nouelle leûne (lai) : (la) nouvelle lune - (37) |
| nouer n.m. Noyer. - (63) |
| nouér', adj. noir : « eun hon-m', eune fon-n' nouer'.» « nouérot, » diminutif. - (08) |
| nouér, adj., noir, au fig. triste. - (14) |
| nouer, v. n. nager, aller dans l'eau en nageant. - (08) |
| nouer. v. n. Nager. (Accolay). – Signifie aussi, noyer. – Se trome dans Roquefort. - (10) |
| nouèrci : noircir - (48) |
| nouerci : noircir - (39) |
| nouérci, v. a. noircir, rendre noir. - (08) |
| nouère : noire - (48) |
| nouère : noire - (39) |
| nouèrte, adj., fém. du précédent, noire. - (14) |
| Noués (faire ses) loc. Communier à Noël, comme on dit faire ses Pâques. - (63) |
| nouesté, noisetier. - (16) |
| nouesté, noisetté : n. m. Noisetier. - (53) |
| nouet, noet, s. m. petit paquet, nœud dans un mouchoir, un drap, chose nouée en général. - (08) |
| nougelin, noisetier. - (26) |
| nougeotte : noisette. - (33) |
| nougeotte. s. f. Noisette. (Domecy-sur-le-Vault). - (10) |
| nougeotter. s. m. Noisetier. - (10) |
| nougeottier : noisetier. Sous les nougeottiers on ramasse les nougeotes : sous les noisetiers on ramasse les noix. - (33) |
| nouger : voir calougnier - (23) |
| nouger, nôuger : noyer ou calatier. L'ombre du noûger o fraiche : l'ombre du noyer est fraiche. - (33) |
| nougeutte, noisette. - (26) |
| nouier, nouhier, nonhier. s. m. Noyer. (Malay-lo- Vicomte, Villiers-Bonneux). - (10) |
| nouillon. s. m. Noyau. (Cuy). - (10) |
| nouillotte : (nou:yot' - subst. f.) noisette. - (45) |
| noûillotté : noisetier - (48) |
| noûillotte : noisette - (48) |
| nouillotte, noisette - (36) |
| nouillotte, nouotte, s. f. noisette. la saison des « nouillottes » est une des époques de l'année. « noujotte. » - (08) |
| nouillotter : (nou:yoté - subst. m.) noisetier. Ce mot est en concurrence avec co:ré:r', mais une spécialisation de sens a fait que le premier désigne l'arbre porteur de fruits et le second plutôt le matériau qu'il représente, en particulier pour la vannerie. - (45) |
| nouillotter : noisetier - (39) |
| nouillottes : noisettes - (39) |
| noujé, s. m. noyer. - (08) |
| noujetiel, s. m. noisetier. - (08) |
| noujöte, sf. noisette. - (17) |
| noujtö, sm. noisetier. - (17) |
| noumer. v. - Nommer. - (42) |
| noune,s.f. repas de midi ; nouner, v. manger à midi. - (38) |
| nounou, s. f. nourrice dans le langage enfantin : « eune brave nounou », une bonne nourrice. - (08) |
| nouö, sm. noyer. - (17) |
| nouœur : n. m. Noueur. - (53) |
| nouqueter. v. n. Claquer des dents par l'effet du froid. (Sommecaise). – Voyez naquer. - (10) |
| nourin, s. m., jeune porc d'élevage. N'a pas le même sens que neurin, donné clans le Glossaire du Morvan, p. 593, qui s'applique seulement à l'espèce bovine. - (11) |
| nourrain (n.m.) : jeune porc - (50) |
| nourrain : (affectueusement) petit enfant - (37) |
| noûrrain : petit cochon, petit veau encore à l’allaitement - (37) |
| nourrain, n.m. jeune porc. - (65) |
| nourrain, s. m., jeune porc castré. - (40) |
| nourrain. n. m. - Jeune cochon que l'on engraisse, pour être tué dans l'année. - (42) |
| nourrain. Porc d'élevage. Ensemble des bovins d'une ferme. On le dit encore souvent pour « grosses bêtes ». - (49) |
| nourrain. s. m. Jeune cochon qu'on nourrit pour l'engraisser et le tuer ensuite. – Se dit, en gêneral, de tout bétail qu'on élève. - (10) |
| nourrains, jeunes cochons. - (05) |
| nourre. Infin. et indicat. présent du verbe nourrir. Quand on a à nourre une femme et quatre ou cinq enfants, faut ben travailler, ben trimer. – C'est un garçon qui se nourre ben. (Puysaie). - (10) |
| nourri. s. m. Distance qui doit être laissée au-delà d'un fossé séparatif par celui qui le creuse, et qui ne peut être moindre de la moitié de la profondeur du fossé. (Seignelay). – A Flogny, ou dit nourriture, dans le même sens. – Nourri s'entend, à Saint-Florentin, de l'élevage des bestiaux. Faire du nourri, c'est élever des bestiaux. - (10) |
| nourri. s. m. se dit surtout des herbages qui servent à la nourriture des animaux : herbes des prairies en général. - (08) |
| nourrin : (nm) jeune porc (jusqu’à 40 kg) - (35) |
| nourrin : nourrisson. - (32) |
| nourrin : porcelet - (48) |
| nourrin : porcelet après sevrage. - (33) |
| nourrin : cochon à l'engrais. Ex : "Vas don douner la beuvée au nourrin !" - (58) |
| nourrin : s. m., vx fr. norrln, cochon de lait. - (20) |
| nourrin, alvin de poisson. - (03) |
| nourrin, neurin : n. m. Porcelet après sevrage. - (53) |
| nourritue (syncope de nourriture). s. f. Porc à l'engrais. – Jaubert donne nourreture, bétail qu'on engraisse. - (10) |
| nourrô, finage de Nuits, devant son nom, comme les norroi d'ailleurs, aux noyers. - (16) |
| nouruture : pâté liquide pour les cochons. - (33) |
| nouruture : n. f. Pâté liquide pour les cochons. - (53) |
| nous deux. Expression très usitée chez nous pour dire que l’on est avec une autre personne. Ex. : « Nous sommes sortis nous deux le Paul. » - (12) |
| nous s’ain vions ! : nous nous en allons ! - (37) |
| nous. adj. poss. - Nos : «Nous pour bétes, alles ont pus rein à manger' » - (42) |
| nout : Nœud. « Les greusses cordes ant des greus nouts » : les grosses cordes ont des gros nœuds, quand on a une grosse fortune on est obligé à de grosses dépenses. « Fare le ban nout » : se marier. - (19) |
| nout'. adj. et pron. poss. - Notre. - (42) |
| noût’: notre (adjectif possessif). Nôut’mâ[y]on : notre maison. - (52) |
| nouta (féminin) : notre - (57) |
| noutaire. n. m. - Notaire. - (42) |
| noute (adj.pos.f.s.) : notre - (50) |
| noute (adjectif) : notre. - (47) |
| noûte (lai) (pr.pos.f.) : la nôtre - (50) |
| noûte (le) (pr.pos.m.) : le nôtre - (50) |
| noute : notre - (48) |
| noûte : nôtre (adjectif possessif). Noûte vèche éto en champ : notre vache était en champ. - (33) |
| noute : notre - (39) |
| noute, adj. poss. notre : « voiqui noute feille, noute genre ou zenre », voici notre fille, notre gendre, etc. - (08) |
| noute, note adj. poss. Notre. - (63) |
| noute. adj. possess. Notre. - (10) |
| noutés : nos - (57) |
| nouton (masculin) : notre - (57) |
| noutoux : Noueux, qui a des nœuds. « Du beu noutoux, eune planche noutouse ». - (19) |
| noûtres (les) : nôtres (les) - (57) |
| nouvalle (na) : nouvelle - (57) |
| nouve : neuf - (43) |
| noûve : neuf - (57) |
| nouveau : s. m., nouvelle. Quels nouveaux rapportes-tu de ville ? - (20) |
| nouveûle, s. f., nouvelle : « Dis donc, sais-tu pas ben la nouveùle ? La Dodiche, all' se marie d'avou son boun aimi. » - (14) |
| nouvia, nouvias. adj. et s. Nouveau. (Ménades, Domecy-sur-le-Vault). - (10) |
| nouviau, adj., nouveau : « Eh ! vouésin, y a du nouviau cheû vous ? — Ben voui, ein gros p'tiôt, si genti, vrâment ein amor d'ange. » - (14) |
| noûyatte, noûyotte (n.f.) : noisette - (50) |
| noûyatter, noûyotter (n.m.) : noisetier - (50) |
| nouyé, s. m. noyer. - (22) |
| nouyer (n.m.) : noyer (arbre) (aussi noujer) - (50) |
| noûyer (noûyi) : noyer - (39) |
| noûyoter : noisetier. - (52) |
| noûyotte : noisette - (37) |
| noûyotte : noisette. - (52) |
| nou-yotte, s. f., amande de la noisette. - (40) |
| nouyottes, noisettes - (36) |
| novale : Nouvelle. « Eune bonne novale » : une bonne nouvelle. « Y est eune novale que t'as appris au bé » : c'est un potin que tu as appris au lavoir. - (19) |
| novale, adj., terre novale, précédemment en bois ou pàquiers défrichés, et nouvellement rendue à la culture. - (14) |
| novalle. s. f. Nouvelle. - (10) |
| nôvea. Nouveau, nouveaux… - (01) |
| nôvea-nai. Nouveau-né. Nai pour né ne se dit que dans ce mot composé. Partout ailleurs, le Bourguignon prononce à la française né. - (01) |
| novelle : nouvelle - (43) |
| novelle, s. f. nouvelle, événement. on donne aussi ce nom aux journaux : avez-vous lu les « novelles. » - (08) |
| nôvelle. Nouvelle, nouvelles. - (01) |
| novembe (n.m.) : novembre - (50) |
| nôviau : (adj.) nouveau ; (nm) nouvelles - (35) |
| noviau : nouveau - (43) |
| noviau : Nouveau. « Du vin noviau » : du vin nouveau, du vin de la dernière récolte. « Tot noviau tot biau » : tout nouveau, tout beau. - (19) |
| noviau adj. Nouveau, neuf. - (63) |
| nôviau, nauviau (adj.m.) : nouveau - (50) |
| noviaux n.m.pl. Nouvelles, évènements locaux. - (63) |
| noÿau : noyau - (51) |
| noÿau n.m. Noyau. - (63) |
| noÿe (cala) : noix - (51) |
| nöyé : (nm) noyer - (35) |
| no-yer : noyer (l'arbre) - (43) |
| noÿer : noyer - (51) |
| noyer : v. a., vx fr. nayer, étouper, boucher hermétiquement. Noyer une fuite d'eau. - (20) |
| noyotte, noisette. Ce mot est usité dans la montagne, les gens de la plaine disent neusille. (V. ce mot)... - (13) |
| nô-yotte, s.f. noisette. - (38) |
| nôyottes – petites noisettes. - Ceute année, les neusilles n'ant pâ réussi, ce n'â diére que des noyottes. - Teins des noyottes, mon enfant. - (18) |
| noze (lai), (lai) naize : (la) neige - (37) |
| noze du coucou : neige du coucou (la dernière, en principe, qui tombe alors que l’on commence d’entendre les premiers chants du coucou) - (37) |
| n'tsaquet – tsaquet : quelque chose - (57) |
| nu : (adj.) neuf (fém ; identique) - (35) |
| nû d'daigt (on) : jointure (d'un doigt) - (57) |
| nû n.m. Habillement neuf. L'coqtî avot mis tot son nû dans l'miñme panî. Le coquetier avait mis tous ses habits neufs dans le même panier. - (63) |
| nu : n. m. Nœud. - (53) |
| nu, adj. et s. personne, nul, aucun, pas un « i n'é nu veu ilai », je n'ai vu personne là. - (08) |
| nû, e adj. Nouveau, neuf, neuve. - (63) |
| nu, nûré, neuré, neurot - divers temps du verbe re.nui - C'que t'é dit lai é bein nu ai lote aifâre. - Ci a faisant ce qui â povant éte sûrs que ci liô nûré gros. - (18) |
| nu, s. m. 1. Nœud. — 2. Tranche de porc prise à l'emplacement des vertèbres. - (22) |
| nu, s. m. nœud. Verbe nùyer. - (24) |
| nua (na) : nuée - (57) |
| nuadze : nuage - (43) |
| nuadze : nuage - (51) |
| nuadzou : nuageux - (51) |
| nuaige. Nuage, nuages. - (01) |
| nuait (n.f.) : nuit - (50) |
| nuaize : nuage - (39) |
| nuaize, nuaige (n.m.) : nuage - (50) |
| nubbité. s. f. Obscurité. - (10) |
| nubelleté, nubleté. s. f. Grande obscurité. - (10) |
| nuble, nubbe. adj. Noir, obscur. Il fait nuble. - (10) |
| nuche : gros morceaux de bois très durs (sens figurée personne têtue, à la tête dure) - (39) |
| nud (n.m.) : noeud - (50) |
| nud (on) : nœud - (57) |
| nué : nuit. - (52) |
| nûe : personne - (48) |
| nué. s. m. Noyer. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| nuée, gnuée, s. f. nuit : « lai nuée ô chouée », la nuit est tombée. - (08) |
| nuèger : (nouèjé - v. neutre) neiger. - (45) |
| nuéje, nuage ; nuéjeû, nuageux. - (16) |
| nuer : nouer - (57) |
| nuèze. s. m. Nuage. (Menades). - (10) |
| nuèzeux, euse. adj. Nuageux. - (10) |
| nufat. s. m. Jus de fumier, purin. (Turny). - (10) |
| nugerenche ou nurenche : Chiendent, voir à détrure. - (19) |
| nuïeu, loc. nul lieu, nulle part, en aucun endroit. On ne le trouve « nuieu », on ne le trouve nulle part. - (08) |
| nuisaule (adj.m.) : nuisible - (50) |
| nuisaule. : (Dial. et pat.),nuisible.- Les noms et adjectifs terminés en able changeaient cette terminaison en aule dans les deux langages, comme ceux en ible changeaient cette terminaison en iule. - (06) |
| nuit. s. m. Noyer, arbre. (Domecy-sur-le-Vault, Girolle). - (10) |
| nuitreneil. : (Dial.), nocturne (du latin nocturnalis, compl. nocturnalem). - (06) |
| nuizaule, nûyaule. Adjectif : nuisible, qui peut nuire ou gêner. - (08) |
| nujire : Noisetier, coudrier, corylus avellana. « In bâtan de nujire » : un bâton de coudrier. - (19) |
| nullous. : Nullouse, au féminin (dial.), personne inerte et sans valeur. Le livre de Job dit une nullouse assemblée .- Un autre substantif nualhos, nualios, indolent, paresseux, et l'adjectif correspondant nualha, nualia sont fréquents dans le langage des troubadours. (Voir au glossaire de Rochegude.) - (06) |
| nun - nu. - On ajoute ordinairement un n devant certains monosyllabes, comme : nun-pieds, nun-tête. - (18) |
| nun - personne. - En n'y é nun dans lai mâillon ! - En fait si froid qu'en ne voit nun dans les rues. - (18) |
| nun (adj., pron. ind.) : personne, aucun ; contraction de l’a.fr. negun (lat., nec unus) - (50) |
| nun (négation), personne ; é gné nun, il n'y a personne. - (16) |
| nun (ū), adj. nu, nue. - (17) |
| nun (ŭ), pr. ind. nul. Personne. N’i ai nun. - (17) |
| nun : personne - (48) |
| nun, adj. et s. personne, nul, aucun : « i n'y évô nun ai lai maion », il n'y avait personne à la maison. - (08) |
| nun, nuns, personne, aucun... - (02) |
| nun, personne. - (27) |
| nun, pron. indéf., personne : « J'seû été cheû les Simon, j'ons treùvé nun », ou « y avòt nun. » - (14) |
| nun. Nul. L'Italien dit niuno, et même neuno. - (01) |
| nun. Personne ; se prononce nin ; du latin ne unus. - (03) |
| nun. Personne. An n’y ai nun dans lai mâson. Du latin nullus ou nec unus. - (13) |
| nun. : Personne, aucun. - (06) |
| nunce. s. m. Nom donné au crapaud. (Hebourseaux). - (10) |
| nuns. s. m. Nul, aucun. I a nuns, il n'y a personne. Du latin nullus. (Argentenay, Etivey). - (10) |
| nunu n.f. Sifflet obtenu au printemps avec une jeune feuille de houx épluchée. - (63) |
| nunu : sorte de mirliton réalisé avec des feuilles de houx - (39) |
| nunzaule - nuisible, contrariant. - Ce n'â pâ que ci sai méchant, précisément mauvais, ma c'â tôjeur nunzaule, ailé. - (18) |
| nurenche : chiendent. Graminacée vivace, nuisible aux cultures. Certains disent « grimont ». - (62) |
| nûri, v. a. nourrir, élever. quelques parties du prononcent « neuri » d'où « neurin », bétail d'élève. - (08) |
| nurice, neurice, norice, s. f. nourrice. On trouve les trois formes suivant les localités. - (08) |
| nuriteure, s. f. nourriture. s'emploie particulièrement pour exprimer la durée d'un allaitement. Nos nourrices font une ou plusieurs « nuriteures » à Paris dans leur jeunesse. - (08) |
| nuroter. v. n. Travailler lentement. (Plessis-Saint-Jean). - (10) |
| nûsille : s. f. noisette. - (21) |
| nuzille, noisette. - (05) |
| nuzille. Noisette, du vieux mot noisille. - (03) |
| n'vou (on) : neveu - (57) |
| ny tomberait ben des dards : expression locale. Rien ni personne n'est capable d'arrêter la personne qui prononce ces mots, même s'il tombait des faux. Ex : "Ny tomberait ben des dards, faut qu'jallint à la Fouée" (à la foire). - (58) |
| ny. : Faire ny, c'est-à-dire nier, apocope du latin facere negationem. (Coutumes de Beaune de 1370.) - (06) |
| nyêr : (niai:r - subst. m. pl.) nerfs. - (45) |
| nyeû, s. m., œil : « Eh! mon chat, j'avons donc babo à nos p'tiòts nyeùx-nyeùx » (V. Œuÿe-, Uyòt, Zieù.) - (14) |
| nyi, v. a. guetter patiemment : le chat a nyi le poussin. - (24) |
| nymphiâ, néphiâ : n. m. Nénuphar. - (53) |
| ô - troisième personne du verbe être, comme A, mais bien moins usitée. - Al ô pôre ma honnête. – Ile ô venue tot ai l"heure. - (18) |
| o (conj.) : ou (ou bien) - aussi vou - (50) |
| ô : il. 3ème personne du singulier ! et « é » ou « al » pour elle. - (62) |
| ô : Or. « Eune mantre en ô » : une montre en or. - (19) |
| o : s. m. 1° os. 2° noyau. - (21) |
| o conjonct. Ou. - (63) |
| o dio : il disait. - (33) |
| ô – août. - Les mois d'ô et de septembre c'â les mouas des grandes récoltes, quemant dans lai vie les quarante ans. - En y é quéque petiotes denrées en retair, ma lai pousse d'ô vai fâre du bein. - (18) |
| ô : 1 n. m. Os. - 2 conj. Ou. - (53) |
| ô, 3e pers. de l'indic. du verbe être. est : « al ô mailaide », il est malade. - (08) |
| ò, et òt, 3ème pers. s. indic. prés, du v. être : « Ol ò vrâment bé brave. » — « Allé òt érivée qu'alle évôt mau. » S'emploie concurremment avec é. - (14) |
| o, ol : Il. O s'emploie devant une consonne. « O deu » : il dort, « O viendra », il viendra. Ol s'emploie devant une voyelle. « Ol a faim » : il a faim, « Ol a fra » :il a froid. - (19) |
| ô, ôl pron. pers. Il : ô devant une consonne, ôl devant une voyelle. - (63) |
| o, os (o long). - (26) |
| o, ot : est (3ème p. du sing. du v. éte à l'ind.prés.) - il semble que le tournure ost soit plus répandue - (50) |
| ô, pr. pers. m., il. S'emploie devant une consonne : « Ô veint ; ô m'dit ; ô s'en va. » On entend parfois ò, mais rarement. - (14) |
| o, pronon, il, elle, ils, elles. - (40) |
| o, y : il - (43) |
| ô, os ; é n'é k'lai piâ é lëz ô, il n'a que la peau et les os, se dit en parlant d'une personne très maigre. - (16) |
| o. Or: « O ç’ai », or çà. - (01) |
| o. pron. pers. Il. O noige, il neige. (Avallonnais). - (10) |
| o. : s'emploie : 1er pour or, jonée c'est-à-dire journée (Lam.) ; 2e pour eur, comme lor et lote au lieu de leur (id. ); 3e pour ou : ainsi, no, vo, se disent au lieu de nous, vous, et retor au lieu de retour, etc .; 4e pour ei. Exemple : pone au lieu de peine, etc. - L'o s'accentue de diverses manières. L'accent circonflexe annonce que cette voyelle se prononce eu, comme pairôle (paireule), maillô (mailleu), fiôlan (fieulan). [Lam.] - L'accent simple (ó) indique que l'o est long. - L'o double est comme l'oméga des Grecs, il indique une accentuation très marquée. - (06) |
| o’virot : col du fémur - (37) |
| obéi : Obéir. « O n'a jamâ savu à se fare obéi » : il n'a jamais su se faire obéir. - (19) |
| obei, morelle, plante à bois amer et sucré, tour à tour, dans la bouche. - (16) |
| obéii, vn. obéir. - (17) |
| obéise. v. n. Obéir ; par conversion d’r en se. (Mûlay-le- Vicomte). - (10) |
| obéré, chargé de plus de travail qu'on ne peut en faire... - (02) |
| ôbier : oublier - (48) |
| obin conjonct. Ou, ou bien. - (63) |
| obis : clématite. IV, p. 26-f - (23) |
| oblâyé : v. t. Obliger. - (53) |
| obli, s. m. oubli : « al é mettu ç'lai en obli », il a oublié cela. - (08) |
| òbli, s. m., oubli, négligence. - (14) |
| obliai, oblio, oblieussaint - divers temps du verbe oublier. - Le François obliot d'ailai prévenir mossieu le Curai ; moi i l'i ai raipelai. - En sero ai souhaitai qu'à l'oblieussaint tot ai fait. - (18) |
| obliai. Oublier, oublié, oubliez. - (01) |
| obliance, s. f. oubli, défaillance de la mémoire. - (08) |
| òbliance, s. f., manque de mémoire, à peu près synonyme du mot précédent. - (14) |
| oblidzi : obligé - (43) |
| òblie, s. f., oublie, cette petite pâtisserie mince et en cornet, que font tirer les marchandes de plaisir, et qui fait la joie des enfants. - (14) |
| oblier, obïer, v. a. oublier, mettre en oubli : « nu n'é jaimâ oblié ou obié d' mûri », nul n'a jamais oublié de mourir. - (08) |
| òblier, v. tr., oublier, négliger. - (14) |
| obligatouaîre : obligatoire - (57) |
| obligi : obliger - (57) |
| oblirai. Oublierai. - (01) |
| oboïtre, obéir. Il semble que les Bourguignons aient préféré traduire obediens esse plutôt que l'infinitif obedire. - (02) |
| oboïtre. : Obéir. Le mot français obéir est la vraie dérivation de l'infinitiflatin obedire, tandis que le mot patois n'en est qu'une distorsion. - (06) |
| obôle. Obole, oboles. - (01) |
| obsarver : Observer, tenir compte de. « Obsarver le Carême » : jeuner pendant le Carême. - (19) |
| observatouaîre (n’) : observatoire - (57) |
| obsie : viorne. (RDT. T III) - B - (25) |
| obuïer, obu-yer, v, amuser ; obu-yon amuseur. - (38) |
| obuseau, et obuÿau, s. m., amusette, jouet, joujou, à l'usage des enfants. - (14) |
| obuser. Amuser, par corruption. Obusau, amusette. - (03) |
| obuÿî : amuser. Et donc «obuÿottes » pour des jouets. - (62) |
| ôbyé, oublier. - (16) |
| ocaler, v. agacer, plaisanter quelqu'un. - (38) |
| ocâsion, s. f., besoin : « J'ons d'la bé brave tèle ; n'en av'ous pas ocâsion ? » - (14) |
| occajon n.f. Occasion. - (63) |
| occajoñner v. 1. Attribuer à. 2. Donner l'occasion de. - (63) |
| occasionner : v. a. Occasionner à, attribuer à. Pourquoi donc que c'te femme battait son mari dans la rue ? — J' vas vous dire... J' n'en sais rien... Mais j' l'ai occasionné à ce qu'i rev'nait pus soûl qu' d'habitude... - Occasionner de, donner l'occasion de. S'il avait quelqu'un avec lui, ça l'occasionnerait peut-être de faire le voyage. - (20) |
| ôche : n. f. Ouche. - (53) |
| ocho. v. n. Houx. (Rugny). - (10) |
| oclage et osclage, présent de noce que le mari faisait à sa future en lui donnant un baiser, osculum. - (02) |
| oclai, tromper au jeu. Dans la langue romane, ocleur ou hocqueleur signifie fourbe , querelleur. - (02) |
| oclai. : Tromper au jeu. C'est à tort que le patois écrit ainsi ce mot. Il vient de hocquelle, dispute, et doit s'écrire par une h comme dans le vieux français, c'est-à-dire hocler, qui est une abréviation de hocqueller. Autrement on confondrait le mot ôclai avec ocle qui comporte un sens tout différent. - (06) |
| ocle, cadeau de noce fait à une veuve pour son deuil... - (02) |
| ocle, s. m. cadeau de noces, douaire. - (08) |
| ocle. : (Dial. et pat.), cadeau fait à une veuve pour son deuil. Oclage c'était le présent de noce. Ces deux mots viennent du latin osculum, baiser de deuil ou de tendresse. - (06) |
| octave : s. f., ancienne mesure de capacité pour le sel, formant le 1/2 de la coupe, c'est-à-dire le 1/8 du mânot, et contenant 6 litres 516. - (20) |
| octob' : n. m. Octobre. - (53) |
| octobe (n.m.) : octobre - (50) |
| octrouai (n’) : octroi - (57) |
| octroyai et autroyai, accorder une faveur, un droit, un privilége ; se dit eu parlant des princes. Dans l'idiome breton, autrou signifie seigneur. - (02) |
| odeu : égout. - (29) |
| odeu, s. m., trou pour éliminer l'eau d'une cave. - (40) |
| odiotte (n.f.) : envie, jalousie - (50) |
| odiotte, s. f. envie, jalousie. Une femme vantant son bon cœur disait : « oh moue, i n' vis pâ d'odiotte », oh ! moi, je ne vis pas de jalousie. - (08) |
| odjin : aujourd'hui. (PLS. T II) - D - (25) |
| odjon, ordon, sm. tâche ; travail désigné. Chantier. - (17) |
| odjure, sf. ordure. - (17) |
| odon, assemblage d'ordures. Il se dit au moral... - (02) |
| odon. Tas d'ordures… - (01) |
| odon. : On ne peut expliquer la double signification de ce mot qu'en rétablissant son orthographe, c'est-à-dire en l'écrivant par la pensée ordon. D'une part il vient du latin horridum et signifie, comme dit Delmasse, un tas d'ordures. D'autre part, odon signifie rang, ordre, disposition, et dérive du régime latin ordinem. Dans ce cas il signifie, en Bourgogne comme en Champagne, soit une rangée de vendangeurs, soit un rang de javelles, soit un andain de fauchaison, comme dans le Berri, soit, enfin, si on le prend dans le sens moral, une portion de tâche quelconque. - (06) |
| œ, sm. œuf . - (17) |
| œge, sf. haie. - (17) |
| œil, öils, sm. œil, yeux. - (17) |
| œilles. Les yeux. - (12) |
| oeillot : œil - (48) |
| oeillot, n. masc. ; œil. - (07) |
| oeillot. (n.m.) : oeil - (50) |
| oeillot. s. m. Oeil. - (10) |
| oeillots : les yeux, reziper les oeillots : remuer les yeux (voir : reboulle-oeillots = qui tourne ses yeux en tous sens, l'air étonné). - (56) |
| œre, sf. fleure. - (17) |
| œrou, adj. heureux. - (17) |
| oeû (ai l’ail’) : se dit de la poule qui est prête à pondre - (37) |
| oeû (aivouair l’) : (pour un humain) être ivre - (37) |
| oeu (n.m.) : oeuf - pl. oeus, eus - das roeus, das reux = des œufs - (50) |
| œu : oeuf - (39) |
| oeu : œuf - (48) |
| œu, s. m. œuf : « eun œu, dé-z-œus. » - (08) |
| oeu, s. m. os. - (22) |
| oeu. n. f. – Œuf.: eune oeu. - (42) |
| œufs (faire des), v. pondre. - (65) |
| oeuille, s. f. huile. - (22) |
| oeûillette : navette, plante oléagineuse - (37) |
| oeullyi, s. m. aiguillon à bœufs. - (22) |
| oeûs en meûrette : œufs frits, accompagnés d’oignons et de sauce au vin rouge - (37) |
| œuvre : s. f., filasse de chanvre ou de lin. Avoir de lœuvre à sa quenouille, avoir beaucoup d'ouvrage. - (20) |
| œuvre, filasse de chanvre. - (05) |
| œuvre, filasse de chanvre. - (27) |
| œuvre, s. f. filasse de chanvre. - (08) |
| œuvre. Écorce de chanvre qui vient d'être ouvrée, travaillée, peignée par les fortoux. On la divise en paquets noués appelés poupées, puis on l'enroule sur la quenouille au moment de la filer. On dit figurément «avoir de l'œuvre à sa quenouille » cela signifie : avoir beaucoup de travail et de responsabilité, être encore loin du repos. D'évou ses chis (six) enfants al ai ben de l’œuvre dans sai quenoille. - (13) |
| oeûvrée : journée de travail. Mesure agraire (environ 4,28 a) moins utilisée que « jornau » et réservée au milieu viticole. Ouvrée. - (62) |
| œuvrée. Ancienne mesure de surface équivalant à la surface de terrain qu'un ouvrier peut labourer dans sa journée ; ouvrée. - (49) |
| œuvrer. Travailler. - (49) |
| œuvres (faire ses). Se louer pendant la fenaison et la moisson. Le paiement s'effectuait en blé et non en argent. - (49) |
| œuvres (les), travaux de la fauchaison et de la moisson, qui sont l'oeuvre par excellence du cultivateur morvandeau : faire ses oeuvres, aller à ses oeuvres, se dit d'un journalier qui a loué le travail de ses bras au fermier d'une grande exploitation agricole pour toute la durée de la fauchaison et de la moisson. - (11) |
| œuÿe, s. m., œil. On dit, assez grossièrement : « Pisser des œuÿes » pour : pleurer. - (14) |
| ofance. Offense, offenses, substantif féminin ; c'est aussi le singulier des trois personnes du verbe offenser au présent de l'indicatif et le pluriel de la troisième personne au même présent. - (01) |
| òf'ar, et òfri, part, du v. òfrî, offert. - (14) |
| ofar. Offert, offerts. - (01) |
| ofeurlingn', s. m. orphelin, par metathèse : « ain ofeurlingn' d' pée é d' méo », un orphelin de père et de mère. - (08) |
| offri : offrir - (43) |
| offri v. Offrir. Le p.p. est identique à l'infinitif. - (63) |
| ofice. Office, offices. - (01) |
| ofrande. Offrande, offrandes. - (01) |
| ofrein. Offrions, offriez, offraient. - (01) |
| ofri, offrir. - (16) |
| òfri, v. tr., offrir, présenter. - (14) |
| ofron. Offrons. - (01) |
| ogeleu : oiseau. - (66) |
| ogeleu : oiseau. (N. T IV) - C - (25) |
| ogelöt, sm. [alvi-ell-ittum] auget. Boîte à balayures. Sorte d'auge ouverte, d'un côté. Oiseau des maçons. - (17) |
| ogelöt, sm. [aucell-ittum]. oiseau. - (17) |
| ogiau. s. m. Oiseau. (Saint-Florentin). - (10) |
| ogie, ogille, sf. oseille. - (17) |
| ogille, oseille. - (26) |
| ognes n.m.pl. Jeu de billes pratiqué en Bourgogne du Sud dans lequel il fallait déloger la bille de l'adversaire tenue entre le médius et l'annulaire placés verticalement sur le sol. Celui qui exposait ses doigts aux coups de billes "recevait les ognes". - (63) |
| ognes : s. m. plur., jeu de billes dans lequel le ou les gagnants s'efforcent de faire tomber avec leurs billes celle que le perdant doit tenir entre le médius et l'annulaire de sa main placée verticalement sur le sol. On devine que les coups portent plutôt sur les doigts du perdant que sur sa bille ; c'est ce qu'on appelle recevoir les ognes. - (20) |
| ogre, orgue et nom d'un personnage imaginaire dont on menace les enfants pour les rendre tranquilles. Ogre so dit aussi pour gros mangeur. - (16) |
| ogres, s. m., orgues. - (14) |
| ogreulé : houx. (RDM. T II) - B - (25) |
| ogreulé : houx. (RDM. T IV) - B - (25) |
| ogueigne, n. fém. ; individu contrariant ou homme qui ne fait rien. - (07) |
| oguignâ, s. m. ouvrier qui travaille lentement, qui emploie mal son temps, qui muse, (voir : oguigner.) - (08) |
| oguignat. s. m. Homme incapable d'un ouvrage sérieux. - (10) |
| oguigne : individu manquant de parole avec lequel il ne faut pas traiter. (V. T IV) - A - (25) |
| oguigne : noise, chicane. (RDV. T III) - A - (25) |
| oguigne : vache maigre. (VDS. T IV) - VdS - (25) |
| oguigne et oquigne. Mauvais cheval, maigre et vieux. On disait autrefois une oquète. Pierre Clémencet, qui fut maire de Beaune, écrivait en 1474 : je nai qu'une petite oquète qui n'est que pour aller à l'entour de cette ville... - (13) |
| oguigne ou aiguigne - vieille bête ou bête sans force et maigre ; franc paresseux. - Le chevau qu'al é aichetai c'a ine vraie oguigne. - C'â sai manie de n'avoir que des oguignes ; ç'â moillou mairché, m'a ci ne fait ran, c'â in mauvais calcul. - Le Daudi Deroi, oh ! c'â ine oguigne. - (18) |
| oguigne ou ogueigne. Individu agacant, maladroit, un peu chicaneur qui fait mal ce qu’il fait, ou avec lequel on ne peut conclure aisément une affaire. Etym.?? - (12) |
| oguigne, mauvais cheval, bête chétive, mal nourrie. - (16) |
| oguigner : taquiner, chicaner. (RDV. T III) - A - (25) |
| oguigner, v. ; ne rien faire ou mal travailler. - (07) |
| oguigner, v. a. travailler avec lenteur, en musant. - (08) |
| oguigner. v. n. Faire une chose maladroitement, faire des bagatelles, des onvrages de minime importance. (Coutarnoux, Savigny-en-Terre-Plaine). - (10) |
| oguiner (v.) : travailler lentement - (50) |
| oguiner : chahuter - (39) |
| oguinou : chahuteur - (39) |
| oh ! : Interjection sans signification précise et dont on fait précéder une réponse. « Vindras-tu ?- Oh ! j'saispas ! » : viendras-tu ? Je ne sais pas. - (19) |
| oi. : Par les mêmes raisons de prononciation qui ont été données en leur lieu pour la désinence en er et en ir des verbes, celle en oir se change en oi. - (06) |
| oïau, ousiau, et ôsià, s. m., oiseau. Un gas disait à une fille entreprenante : « T'sais prou chanter, bel oïau !... mâ... » Et il la plantait là. - (14) |
| oie (masc), oie. - (27) |
| oïesse : pie - (51) |
| oigne, s. m., oignon. - (40) |
| oignes : les oignons, un plat cuisiné aux petits oignes ; d'où, par ext, faire cela aux petits oignes : mijoter une affaire, la préparer avec soin. - (56) |
| oille. : (Du latin ovilis), brebis ou chèvre. (Coutumes de Beaune, 1370.) - (06) |
| o-illon, ouillon. Oison ; on dit encore « bibi ». - (49) |
| oing, s. m. graisse de porc que l'on conserve pour s'en servir comme d'un onguent contre les douleurs. - (08) |
| oingle (gle mouillé), oingne. s. m. Ongle. (Ménades, Girolles, Saint-Germain-des-Champs). - (10) |
| oingt : saindoux. - (32) |
| oinre, v. a. oindre, se servir d'oing ou graisse de porc et, par extension, d'une matière grasse. - (08) |
| oint, n. masc. ; du vieux oint, de la vieille graisse. - (07) |
| oin-ye (on-ye) : ongle - (39) |
| ôïô, ô-yau, s.m. oiseau. - (38) |
| oiseau. Boite à ordures qui n’a que trois côtés, le quatrième étant ouvert pour qu'on puisse aisément y pousser les chenils avec le balai. - (12) |
| oiseau. Petite caisse de bois, munie d'une poignée, sur laquelle on balaie les ordures et les chenis. Auge portative en bois, dans laquelle les maçons placent le mortier. On devrait écrire et prononcer aiseau, car le mot ais (planche) a formé ce substantif... - (13) |
| ojdeu : aujourd'hui. - (29) |
| ôj'deu, aujourd'hui, de notre temps. - (16) |
| oj'din, aujourd'hui. - (26) |
| ojedeu, âjedeu, adv. et subs. aujourd'hui. « ozedeu, azedeu. » - (08) |
| okeupé, occuper ; s'okeupé, s'occuper, travailler ; é n'â pâ okenpé, Il n'a pas de travail à faire. - (16) |
| ol (pr.pers. 3ème pers.s.) : il - (50) |
| ol : il. Ol'eto : il était. - (33) |
| ol, pron. masc. 3e pers. du sing. il. - (08) |
| ôl, pronom pers. il, ils. - (38) |
| ol’ temps laî (d’) : (de) ce temps-là - (37) |
| olaïllon n.m. (p.ê du lat. oleum, l'huile). Chénopode, épinard sauvage. Voir tsou rmau. - (63) |
| olayon : chénopode - (43) |
| ole (n.f.) : aile - (50) |
| ole : aile de volatile, bras humain - (37) |
| ôle : aile. - (62) |
| ole : une aile (de volaille). - (56) |
| ole : n. f. Aile. - (53) |
| ole, orle : aile, bras - (48) |
| ole, s. f. aile, membrane dont se servent les oiseaux pour voler. « orle. » - (08) |
| olibrius. Terme de mépris, appliqué à un homme extravagant... - (13) |
| oliéte, s. f., œillette, tête de pavot blanc, dont on fait de l'huile. Cette huile sert généralement pour les fritures, de préférence au saindoux. - (14) |
| òlL, et ôl, pron. person. m., il. S'emploie devant une voyelle : « òl érive ; ôl entre. » - (14) |
| olle - aile. - An faut copai les olles ai vos poules, qu'à ne venaint pâ dans le jairdin. - Regaide don les hirondelles quée grandes olles al ant. - Teins voilai in panpillon qu'é s'é breulai les olles ai lai lampe. - Ah ce gâs lai, vais, à vôle bein sans aivoir des olles. - (18) |
| olöte, sf. ailette, quart de l'amande d'une noix. - (17) |
| ombrager : v. a., porter ombrage à quelqu'un. - (20) |
| ombraigeou, ouse, adj. ombrageux, qui prend de l'ombrage, susceptible, emporté, violent. - (08) |
| ombraigeoux : Ombrageux, qui a peur de son ombre « In chevau ombraigeoux ». Qui a crû à l'ombre. « Eune pomme ombraigeouse ». - Remarque : on, om se prononcent toujours an, am, dans nos patois, le mot précédent aurait donc du s'orthographier ambrageoux. - (19) |
| ombre, s. f. on dit qu'un troupeau de moutons « fait ombre » lorsque ces animaux se ramassent en peloton , la tête dirigée vers le centre du groupe. - (08) |
| ombréje, ombrage, crainte, gène inspirée par la présence d'une personne qu'on n'a pas l'habitude de voir. - (16) |
| ombréte, s. f., ombrelle. - (14) |
| omelette : s. f. Terme du Jeu de quinet, qui s'emploie lorsque le bâtonnet est tombé dans un trou. Le joueur dont c'est le tour, dit : Pas d'omelette ! pour avoir le droit de sortir le bâtonnet avec la main. L'autre joueur prive le premier de ce droit s'il dit avant lui : Omelette ! - (20) |
| om'nette. n. f. - Omelette. - (42) |
| ômoulate, s.f. omelette. - (38) |
| omoulette : Omelette. « Ma fane a fait eune greusse omoulette » : ma femme a fait une grosse omelette. - (19) |
| omption. s. f. Honte. (Veron). - (10) |
| on : nous (sujet) - (48) |
| on petion, loc. adv. un peu. - (22) |
| on. Ont, habent : « Ai mon di », ils m’ont dit. J’on, habemus. On dit en Bourgogne également j’on et j’aivon. - (01) |
| on. Prononciation nationale de en, an, dans tous les mots. Ex. : « Nous autres, onfonts de Dijan, nous nous faisans gloire d'être Bourguignans ! » - (12) |
| on’ye (n.m.) : ongle - (50) |
| onal (Br.), orvale (Morv.). - Désastre, fléau, malheur. Vieux mot très usité jadis… - (15) |
| onc[y]e : oncle. - (52) |
| once de beurre : s. f. servant à indiquer un poids minime. Il ne pèse pas une once de beurre. Voir liard de beurre. onguent de Saint Fiacre : s. m., bouse de vache. - (20) |
| once : s. f., ancienne mesure de poids, correspondant au 1/16 de la livre et valant 30 grammes 594. - (20) |
| once, sm. ongle. Voir ungle. - (17) |
| onche n.m. Oncle. - (63) |
| onçhye : (nm) oncle - (35) |
| onch-ye : oncle - (43) |
| oncion, s. f. onction, action de pénétrer, d'imbiber à fond. - (08) |
| oncore : encore - (57) |
| ondäyi : (vb) baptiser (en cas d’urgence) - (35) |
| onghi', s. m. ongle. - (08) |
| onghiee, s. f. onglée, engourdissement des doigts causé par le froid. - (08) |
| onghye, ongle (prononcer dur gh). - (16) |
| ongle (onglie). s.m. Ce mot n'est donné ici qu'à cause de sa prononciation, qui se fait en mouillant le gl, à la manière italienne, de même que dans beaucoup d'endroits on dit aveuille pour aveugle, sanhier pour sanglier, Yaude pour Claude, étranhier pour étrangler. - (10) |
| ongle : onguie - glace : guièsse - glaçon : guiesson - aveuglé : èveûguiè - (46) |
| ongon, lit. onguent. - (24) |
| ongue, s. m., ongle. - (14) |
| onguïe. s. m. Ongle. Le cahier de Vassy-sous-Pisy, dans lequel nous trouvons ce mot, ne nous indique pas la manière de le prononcer ; cependant, nous croyons qu'en l'écrivant ainsi l'auteur a entendu figurer la prononciation du gl mouille. - (10) |
| ongulé. Ongle. (S'emploie au féminin). - (49) |
| onguye : un ongle - (46) |
| on'ille (n’) : ongle - (57) |
| onkhi', s. m. oncle : « boque ton oncki' », embrasse ton oncle. - (08) |
| onkie : un oncle - (46) |
| onkye, oncle. A Nuits, au lieu de Monsieur, Madame, les enfants disent : mon onkye, mai tante, même aux personnes étrangères à leur parenté ; cet usage rend les enfants plus aimants et plus respectueux envers ces personnes. A Nuits encore, on dit oncle, tante aux cousins et cousines du père et de la mère, et les grand-oncle et grand'tante sont les frères et soeurs des aïeux. - (16) |
| onque - oncle. - Bonjour, mon onque ; voiqui des peurnes que main mère vos envie. - Vais dire ai ton onque Jean qui vourâ bein le voué in petiot manmant. - (18) |
| onque (n.m.) : oncle - (50) |
| onque, s. m., oncle. - (14) |
| onque, sm. oncle. - (17) |
| onque. n. m. - Oncle : « André, c'est moun onque, l’frée à la grand-mée.» - (42) |
| onquïe. s. m. Oncle. Il est à peu près impossible de figurer la prononciation de ce mot. L'orthographe Onquïe, qui nous est donné par l'instituteur de Menades, est très-défectueuse ; nous préférerions onquieu, mon onquieu, en ne faisant sentir, dans la prononciation, l’u que très faiblement. - (10) |
| onquye : oncle - (37) |
| onramer (S'). Prononciation vicieuse de s'enramer. Se dit du soleil sur son déclin, alors qu'il commence à disparaître derrière les rames, les branches des arbres. Vlà le soûlai qui s'onrame. (Sommecaise). - (10) |
| onramer (s'). v. - Se coucher, en parlant du soleil qui disparaît derrière les rames. (Sommecaise, selon M. Jossier) - (42) |
| ons - avons, première personne du présent du verbe avoir, au pluriel. - I ons fait bein de l'ovraige dans lai maitenée ; ci nos aivoingeré. - (18) |
| ons (j’), et j’avons, 1ère pers. pl. du prés. du v. avouér, nous avons. - (14) |
| onsc'ille (n') - nonon (on) : oncle - (57) |
| onte, honte ; évoi onte, être intimidé. Ontou, ontouze, celui, celle qui a honte d'avoir mal fait ou qu'intimide la présence d'une personne, Évoi onte de son përe, se dit d'un jeune homme orgueilleux, sorti de la condition de son père et qui rougit de se trouver avec lui. - (16) |
| onte. Honte. Le patois bourguignon écrit onte au lieu de honte, parce que, non plus que le menu peuple de Paris, il n'aspire aucun mot, pas même ceux où, par des raisons d'usage, il garde l'h. - (01) |
| onye : (nm) ongle - (35) |
| on-ye : ongle - (43) |
| oñye n.m. Ongle. - (63) |
| onze heures (sur) : loc, de côté. Mettre un fût sur onze heures, le placer de telle façon que la bonde soit à gauche de la verticale, comme la petite aiguille d'un cadran qui marque onze heures. Cette position donnée au fût a pour but d'en assurer l'étanchéité. On dit aussi : mettre la broche sur onze heures. - (20) |
| onzer (v.t.) : oser - (50) |
| onzer. Oser. - (49) |
| oo, ou simplement ò. C’est l'impératif ou subjonctif singulier du verbe avoir : O soin, aie soin ; n’ò pas pôë, n'aie pas peur ; ce n’a pa que j'oo ou que jò, ce n'est pas que j'aie. - (01) |
| ooche ! Cri des bouviers pour arrêter leur attelage, (Avallonnais). - (10) |
| openiâtre, adj. têtu, buté, contrariant. Verbe openiâtrer. - (24) |
| opèré : v. t. Opérer. - (53) |
| opertaillies. n. f. pl. - Fouillis, désordre. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| opeti. Appétit, par corruption. - (03) |
| opétit, et op'tit, s. m., appétit. - (14) |
| opitô, hôpital. - (16) |
| opôser, v. tr., empêcher ; mais, ici, employé intransitivement : « Te crais qu' t'es l'pus fort ; n’opôse que j'te flanquerai eùne raclée. » - (14) |
| opprimé adj. Oppressé, au niveau respiratoire.. - (63) |
| opprimé : part, passé, oppressé, au point de vue respiratoire. - (20) |
| opulent : adj., arrogant, se dit de quelqu'un qui a de la morgue comme un « nouveau riche ». C'est des mondes qu'est ben opulent. - (20) |
| oqueille : objet à jeter, chose inutile - (39) |
| oqueillerie : objet à jeter, chose inutile - (39) |
| oquéle, s. f., difficulté, discussion, paroles : « Oh ! v’là ben des oquéles pou ran ! » - (14) |
| oquelle : objet sans valeur - (48) |
| ôr, s. m., or, richesse. - (14) |
| ora ! : arrête ! (se dit pour un attelage) - (43) |
| ora ! : interjection (à l’attelage) arrête ! - (35) |
| ora ! interj. arrête ! (en s'adressant à un attelage de bœufs ou de vaches). - (24) |
| ora ! interj. arrête ! En s'adressant à un attelage de bœufs au de vaches. - (22) |
| orâdze n.m. Orage. - (63) |
| oradzou : orageux - (43) |
| oragan, s. m., ouragan. - (14) |
| orage : Vent violent. « Y a fait de l'orage s'te né » : il a fait un grand vent cette nuit. - (19) |
| orage : s. m., grand vent. Il fait de l'orage. - (20) |
| oraige : l'orage - (46) |
| oraige. Orage. - (01) |
| oraïlle : Oreille. « San père li a tiri les orailles ». « Oraïlle de charrue » : le versoir. « Je n'entends pas clié (clair) de s't'oraïlle » : je n'accepte pas, je fais la sourde oreille. - (19) |
| oraîlle n.f. Oreille. - (63) |
| oraille. Oreille… - (01) |
| oraillons n.m.pl. Oreillons. - (63) |
| orakje, sm. oracle ; faiseur d'embarras, docteur de village. - (17) |
| orâkye, oracle, celui qui est cru sur tout ce qu'il dit. - (16) |
| orandze : orange - (43) |
| orandze n.f. ou adj. Orange. - (63) |
| orâyon (n.f.) : oraison - (50) |
| orbanié, vt. surfiler un bord de toile. - (17) |
| orbillot. n. m. - Ardillon : pointe de métal au milieu de la boucle de ceinture. (Sainpuits, selon M. Jossier) - (42) |
| orbillot. s. m. Ardillon. (Sainpuits). - (10) |
| orcal, grosse pluie battante qui ravine les terres. - (16) |
| orceau : s. m., cytise. - (20) |
| orché (-e) (adj.m. et f.) : ivre mort (-e) - (50) |
| orché : ivre. (RDV. T III) - A - (25) |
| orche ou eurche, orcher - herse, herser. - Lai terre me paraît in pecho trop moillée pou orcher âjedeu. - Te laicheré l'orche à bout du champ. - (18) |
| orché, adj. ivre-mort. se dit de celui qui suit à la lettre le très mauvais conseil de la chanson. - (08) |
| orché, herser un champ ; une vigne mal cultivée est dite : orchë. Ce mot veut dire encore : piétiner une terre, une vigne nouvellement cultivée, sur laquelle il a plu. - (16) |
| orche, s. f. herse. - (08) |
| orcher, v. a. herser, travailler avec la herse. - (08) |
| ôrde n.m. Ordre. - (63) |
| orde, s. f. ordre : « en orde «, en rang, régulièrement. - (08) |
| orde, s. m., ordre : « Ol é ben planté d'avou sa béle ; all’ n'a pas d'orde pou deux yards. » - (14) |
| ordet, ordet donc (pour ardez, ardez donc) ! Voyez, voyez donc ! Exclamation qui exprime l'étonnement, une surprise qu'on veut faire partager, et par laquelle on appelle sur un fait singulier l'attenlion de ceux qui vous entourent. (Perreuse). – C'est une syncope de regardez. - (10) |
| ordi, v. a. ourdir, mettre en rang, en ligne. Le tisserand « ordit » ses fils sur son métier. - (08) |
| ordie ! exclamation par laquelle on excite au travail quelqu'un qui semble lent ou fatigué de ce qu'il a déjà fait ; ordie équivaut à hardiment, courage. - (16) |
| ordignaire. Ordinaire. - (01) |
| ordille. s. f. Voyez ardille. - (10) |
| ordir, v. faire les quatre premières bennes de vin par fût pour mélanger le vin. - (38) |
| ordir. v. a. Ourdir. - (10) |
| ordissoué, s. m. ourdissoir, instrument où se fait l'ourdissage de la toile. - (08) |
| ordon - rang du moissonneur, l'espace en largeur qu'il mène devant lui. En général et au moral, rang, tâche que l'on a à faire. - Finissons note ordon et pu i fairons les quaitre heures. – Té in rude ordon ai menai devan toi, mon cher aimi. – C'te fonne lai é in terribe ordon aivou ses enfants. - (18) |
| ordon (n. m.) : dans un champ de betteraves, de pommes de terre, ... ensemble de deux ou trois rayons que l'on travaille dans une même progression - (64) |
| ordon (n.m.) : travail, tâche menée régulièrement - (50) |
| ordon : embarras. (SY. T II) - B - (25) |
| ordon : ouvrage, travail - (48) |
| ordon : rangée - (48) |
| ordon : une rangée dans le jardin. Un ordon de treuffes : une rangée de pommes de terre. - (33) |
| ordon ; quand deux ouvriers piochent une vigne, chacun d'eux suit son ordon, c'est-à-dire, sa tâche. - (16) |
| ordon Rang que l’on suit en coupant les moissons, en cueillant des fruits, en plantant ou en arrachant des légumes ; au figuré façon dont on conduit sa vie. Etym. ordre. - (12) |
| ordon : largeur de travail des moissonneurs - (39) |
| ordon : rang de vigne. - (32) |
| ordon, lordon : n. m. Rangée, une rangée de pomme de terre. - (53) |
| ordon, ourdon s. m. Ce qu'une personne peut piocher devant elle en une fois ; andain de fauchaison ; portion de tache ; rayon, sillon coupé par chaque moissonneur d'un bout à l'autre du champ. – A Collan, on entend, par ordon, l'étendue de vigne qu'un vigneron peut piocher dans sa journée. Du latin ordo, ligne, rangée, sillon. - (10) |
| ordon, ourdon, s. m. rangée, ligne régulière. - (08) |
| ordon, parcelle de bois à couper. - (27) |
| ordon, s. m., rang de vigne. - (40) |
| ordon. Rang de ceps de vigne, travail en ligne droite d'un vigneron, d'un vendangeur ou d'un laboureur. Tache que l’on impose à un ouvrier, ou que l'on s'impose à soi-même... - (13) |
| ordouée. n. f. - Ardoise. - (42) |
| ordouée. s. f. Ardoise. (Etais). - (10) |
| ordr' : n. m. Ordre. - (53) |
| orduze. s. f. Ordure. (Rebourseaux). – Nous donnons ce mot comme exemple de la manière dont se prononce l'r, quelquefois, dans la dernière syllabe des mots. On dit aussi ornièze pour ornière, ouzièze pour osière, tabatièze pour tabatière, etc. - (10) |
| ôrdze n.f. Orge. - (63) |
| oré. : (Dial.), vent doux (du latin aura). - (06) |
| orée : oreille - (51) |
| oreille : s. f. oreille. - (21) |
| oreille : (èrèy' - subst. f.) oreille - (45) |
| oreillée, oreillie : s. f., vx fr. oreilliée, gifle sur l'oreille. - (20) |
| oréje, orage ; oréjeû, orageux. - (16) |
| oreries : Bijoux. « Alle a mis totes ses oreries » : elle a mis tous ses bijoux. - (19) |
| oreries, or' ies. n. f. pl - Bijoux clinquants, tape-à-l'oeil. - (42) |
| oreries.s. f. pl. Bijoux en or. (Villiers-Saint-Benoit). - (10) |
| oreu : adv. maintenant. - (21) |
| orgânder : rôder, chercher çà et là. (E. T IV) - VdS - (25) |
| ôrge : s. f. orge. - (21) |
| ôrge, s. genre ? orge. - (38) |
| orgelot, s. m. orgelet appelé vulgairement grain d'orge, tumeur inflammatoire qui se développe au bord des paupières. - (08) |
| orgelòt, s. m., orgelet, petite tumeur au bord des paupières, et qu'on appelle vulgairement : compère loriot, graind'orge. - (14) |
| orges (faire ses), loc., faire finement ses affaires, tirer bon parti d'une chose. - (14) |
| orgneau, s. m. gros arbre rabougri qui est le plus souvent découronné. Se dit aussi des personnes ou des animaux de mauvaise venue. - (08) |
| orgoil. : (Dial. ), orgueil. - (06) |
| orguillou, ouse, adj. orgueilleux, euse. - (08) |
| oribje, adj. horrible. - (17) |
| orié ! : en arrière ! - (46) |
| orillé : (nm) oreiller - (35) |
| orillé, oreiller. - (26) |
| orille, s. f., oreille : « On en a prou dit su toué, va ; les orilles ont dù t' seûner. » - (14) |
| orillé, s. m. oreiller de lit, coussin, tout objet sur lequel on appuie la tête, lorsqu'on se repose. - (08) |
| oriller, s. m., oreiller. - (14) |
| orillon. s. m. Petit entonnoir. (Givry). - (10) |
| orio. Loriot. Plus rationnel que le mot français ; du latin oriolus. - (03) |
| oriôle - érable. - C'â in bon bô l'oriôle, et pu joli pou les menusiers que faisant des jolis meubles d'aivou. - En fauré qu'i pliantâ quéque pieds d'oriôle dans l'haie vive du prai Robin. - (18) |
| orion, on écrit mieux horion, gourmade, taloche... - (02) |
| orion, s. m. petite bande de terrain longeant le côté d'une vigne. - (24) |
| oriot, loriot. - (05) |
| oriot, s. m., loriot. - (14) |
| oripiaux n.m.pl. Oripeaux. - (63) |
| orjaune, sm. érable. - (17) |
| orjû, s. m., feu-follet. Longtemps on a cru que ces exhalaisons des cimetières étaient les âmes des trépassés. - (14) |
| orju. Feu follet. - (03) |
| orjue, feu follet. - (05) |
| orlâ : bout d'aile, enfant chétif - (39) |
| orle : aile. - (29) |
| orle : aile. - (52) |
| orle : Ourlet, bord. « L’orle de sa culotte est tot effringi » : l'ourlet de sa culotte est effrangé. Orle est masculin. - (19) |
| orlé : saoul, ivre. - (52) |
| orle : aile - (39) |
| orlé, ourler et ourlé. - (16) |
| orle, s. f. aile. - (08) |
| orle, s. f. ourlet, pli de couture au bord d'une étoffe. - (08) |
| ôrle, s.f. aile ; ôrle d'ôvrèz : "un rang d'ouvrée de vigne". - (38) |
| orle. s. f. Aile d'oiseau. (Tormancy). - (10) |
| orle. : (Dial.), bord, extrémité (du bas latin orlum), d'où le mot français ourlet, pli d'une étoffe. - (06) |
| orler : ourler - (48) |
| orler : Ourler. « Orler des mouchoux de peuche » : ourler des mouchoirs de poche. - (19) |
| orler : ourler - (39) |
| orler, v. a. ourler, faire un ourlet. - (08) |
| ôrler, v. tr., ourler. - (14) |
| orlion : s. m., bord d'une rase, bande de terre comprise entre la dernière rangée de ceps et la raie suivante. A rapprocher des mots fr, orle, ourlet, orne. - (20) |
| orlon : bout d'aile, enfant chétif - (39) |
| orlot, s. m., ourlet. - (14) |
| ormale, s.f. armoire. - (38) |
| orman-na, s.m. almanach. - (38) |
| ormea. Ormeau, orme. - (01) |
| ormeteau : s, m., vx fr. ormetet, ormeau. Un hameau de Tournus porte ce nom. - (20) |
| ormiau, s. m., orme, ormeau. - (14) |
| ormise (n.f.) : remise, grange - (50) |
| ormise, s. f. remise, hangar où l'on abrite les harnais, le bois de chauffage, etc. - (08) |
| ormise, s. f., remise, hangar pour les provisions, les chevaux, les voitures. - (14) |
| ormoire, armoire. - (04) |
| ormoire, s. m., armoire : « Son armoire, ôl é plein de linge. » C'est là un des luxes de la province. - (14) |
| ormoire, une armoire... - (02) |
| ormoire. : Ce mot est un exemple du changement de lettres que se permet assez fréquemment le patois bourguignon. Les autres patois font de même ; ainsi l'on dit en Champagne aumaire (Grosl.) et en Lorraine amerle. L'origine du mot est armorium (bas latin), meuble où on serrait les larmes. - (06) |
| ormoise, ormouée. s. f. Armoire. - (10) |
| ormouée (n. f.) : armoire - (64) |
| ormouée, ormouère, armouée, ourmoie. n. f. - Armoire. - (42) |
| ormouére (n.f.) : armoire - (50) |
| ormouére, armouére. Armoire. - (49) |
| ormouére, s. m. armoire : « eun ormouére. » - (08) |
| ormyâ, orme. - (16) |
| ôrne (à l') loc. A la suite, dans l'ordre. - (63) |
| orne : Rangée de vigne. « Plieuchi eune orne » : piocher une rangée de vigne. - « I est in bon ovré o mene bin san orne » : c'est un bon ouvrier, il ne reste pas en arrière. - (19) |
| orne : s. m. et f., vx fr., rang, rangée, sillon. - (20) |
| orne, s. f. dans une vigne, largeur de terrain pouvant être piochée en une seule fois (vieux français). - (24) |
| ornére : Ornière « La route est bin mauvase y arait bin faute de bouchi les ornères » : la route est en bien mauvais état, il y aurait grand besoin de combler les ornières. - (19) |
| ornére : ornière. - (21) |
| ornia : un arbre pas joli, difforme qui va dans tous les sens, mort ou à demi-mort. - (33) |
| orniaû : arbre informe - (48) |
| orniaû : objet ou personne sans valeur - (48) |
| orniau : vieille souche d'arbre - (39) |
| orniaut, sm. original, sot et ennuyeux ; gêneur. - (17) |
| ornie. Voici un mot dont la signification est un mystère, même pour Roquefort, qui, tout en le citant dans son Glossaire, assure qu'il n'existe pas. Lacombe dit que ce mot signifie voisine. Toutefois, dans la langue romane, oro, venant d'oraculum, c.-à-d. oratoire, signifiait aussi église... - (02) |
| orniére (n’) : ornière - (57) |
| orniller, ourniller. v. n. Remuer sans cesse. (Sens, Auxerre). - (10) |
| orniller, v. a. tracasser, fatiguer par des importunités. - (08) |
| ornillou. ouse, adj. tracassier importun, celui qui fatigue autrui. - (08) |
| ornire : (nf) ornière - (35) |
| ôrnîre n.f. Ornière. - (63) |
| oroille. : (Dial. et pat.), oreille. - (06) |
| oroiye, oreille. - (16) |
| oroloige, horloge, reloize. - (04) |
| orreur, s. f. erreur : « i é fé orreur dan not' compte. » - (08) |
| orreur. s. f. Mauvaise prononciation d'erreur. - (10) |
| orsio : Cytise, cytisus laburnum, abrisseau à fleurs en grappe de couleur jaune. - « In boquet d'orsio ». - (19) |
| orsure. Ursulines, ou, comme on parle à Paris, Urselines, quoique de sainte Ursule, que ces religieuses ont reçue pour leur patronne, elles ne dussent régulièrement être nommées qu'Ursulines. - (01) |
| ortchier : piquer avec des orties - (39) |
| ortille, otrille. s. f. Ortie. - (10) |
| ortiller : piquer avec des orties - (48) |
| ortillons, s. m., doigts des pieds, le gros surtout. Peut passer pour un diminutif d'orteil. - (14) |
| ortion (m) : ragoût trop épais, galette ou pain mal cuit. (CST. T II) - D - (25) |
| ortire : ortie - (39) |
| ortiye, ortie. - (16) |
| orval, orvale : s. m. et f., vx fr. orval et orvale, désastre, accident. Orvale de temps, tempête, ouragan. Voir ouvre. - (20) |
| orval. Sinistre, malheur ; vieux mot. - (03) |
| orvale (n.m.) : sinistre, désastre - (50) |
| orvale : Accident. « La sarvante a laichi cheu eune pile d'assiettes, i sant en mille briques, i est cen qu’est eune brave orvale » :la servante a laissé choir une pile d'assiettes, elles sont en mille porceaux, quel accident ! - (19) |
| orvale, s. m. sinistre, désastre. - (08) |
| orvale, s.m. orage. - (38) |
| orvale, violent orage avec grêle. - (40) |
| orvau : s. m., orvale, sauge des prés (salvia pratensis) et autres espèces de sauge. - (20) |
| orvé. s. m. Crochet pour retirer les sceaux tombés dans un puits. (Armeau). - (10) |
| os (os' ?), sm. os virö, haut de la cuisse dans le porc, insertion du fémur dans l'os du sacrum. Ailé ès os guenillous : se disait des enfants du village qui allaient en bande demander aux cuisinières des noces les reliefs du repas. se dit par ext. des parasites, des pique-assiettes qui l'ont visite à la fin du dîner pour attraper un morceau. - (17) |
| os, os à ronger : s. m., insolence, injure. Il me Jette tout le temps des os. Il m'envole des os à ronger. - (20) |
| os. S'emploie pour désigner un noyau de fruits : « un os de pêche ». - (49) |
| osaille, s.f. oseille. - (38) |
| oscouer, v. a. secouer en renversant, renverser. On « oscoue » un tombereau, une brouette pour les vider. - (08) |
| oscur, adj. obscur, sombre, noir. Le Morvandeau bourguignon prononce en beaucoup de lieux « oskeur » : la nuit est « oskeure » ; on marche dans « l'oskeurité. » - (08) |
| ôselot, s. m., oiselet, petit oiseau. Diminutif d'oisel. - (14) |
| ôseraï, s.f. oseraie. - (38) |
| osére : n. m. Osier. - (53) |
| osiau, ouésiau, voyeau. n. m. - Oiseau. - (42) |
| osiau, oujeau. s. m. Oiseau. (Pasilly, Rugny). - (10) |
| osière (dans toute la Bourgogne).- Osier, brin d'osier. - (15) |
| osière, s. f., oseraie, lieu planté d'osiers. - (14) |
| osille. s. f., oseille : « Quand all' vous parle, on dirôt qu'air veint d'miger d’l’osille. » - (14) |
| osseraie. s. f. Hotte. (Girolle, Annay la-Côte). - (10) |
| ôssine, oussine : n. f. Petite baguette flexible. - (53) |
| ossio. adv. C'est ainsi, c'est vrai. Du latin etiam ou, plutôt, est sic. - (10) |
| ostau, oustau, hostau. s. m. Maison, logis. Roquefort donne ostal, ostel. Du latin hospitium, et du bas latin ostallaria. - (10) |
| ostinai- obstiné, entêté. - Si a s'ostine, en ne peut pu ran fâre de lu ; c'â ine vraie tête de mulet. - C'a in ostinai, ine béte ! - (18) |
| ostiné, adj., entêté : « N’m'en parlez pas ; j'n'en pouvons ran fâre. Y et eun ostiné du diâbe. » - (14) |
| ostiner, v. tr., ennuyer, contrarier, tourmenter : « Là là ! qu'ô m’ostine donc ! » — La forme réfléchie restreint ses acceptions à s'obstiner, s'entêter. - (14) |
| ostrogo, homme drôle, singulier. Ce nom est pris des Ostrogoths qui, jadis, habitaient le nord de la Germanie. C'est ainsi que le mot trivial bougre est pris du nom des Bulgares et Ogre, de celui des Hongrois. - (16) |
| osura, osuraint - divers temps du verbe oser. - Si te n'osâs toi, al osurant bein z-eux, vais. - Quant en pense qu'al é bein ôsu se montrai ! - Ces gens lai n'ant point d'honte, ci osuro tot. - (18) |
| òt, terminaison (ait) de la 3ème pers. du sing. de l'imparfait : « O fesòt, ôl allò, ô venòt, » etc. S'applique à ce temps de tous les verbes. - (14) |
| otata (ă-ā), int. fare otata, tomber assis sur son séant ; par ext. avouer sa ruine. - (17) |
| otchie : une ortie - (46) |
| otie. Ortie, orties. - (01) |
| oton : épis brisés. (F. T IV) - Y - (25) |
| otraige. Outrage, outrages. - (01) |
| ou - oue : os. Ex : "J'ons tout mangé, j'ons juste laissé les oues !" (pas de liaison : les - oues). - (58) |
| ou[y]au : oiseau. - (52) |
| ou[y]e : oie. - (52) |
| ou[y]on : oison. - (52) |
| oua : voir - (43) |
| ouâ, s.f. oie (moderne) ; le mot ancien était ouaille. - (38) |
| ouâge - auge. - Te tirerez de l'aie pliain l'ouâge pour fâre bouère les chevaux. - Pote cequi dans l'ouâge des couchons. - (18) |
| ouâge (n.f.) : auge - (50) |
| ouage (nom féminin) : auge. - (47) |
| ouâge : auge - (48) |
| ouage : auge. - (29) |
| ouage : eau. (MM. T IV) - A - (25) |
| ouâge : n. f. Auge. - (53) |
| ouâge, ouaige. s. f. Auge. (Givry, Saint-Prancher). - (10) |
| ouâge, s. f. auge, pierre ou bois creusé où l'on met la boisson et aussi la mangeaille des animaux. - (08) |
| ouaie (n.f.) : oie - (50) |
| ouaîe (n’) : oie - (57) |
| ouaille (nom féminin) : mouton. - (47) |
| ouaille (une) : un mouton - (61) |
| ouâille : brebis - (48) |
| ouaîlle : fidèle (à l'église) - (48) |
| ouaillé, élûté : exp. Faire des efforts pour vomir. - (53) |
| ouaîlles : paroissiens de monsieur le curé - (37) |
| ouainge : ange. - (32) |
| ouaite (d'la) - couton (du) : ouate - (57) |
| ouaite, sf. ouate. - (17) |
| oüaite. Ouate. - (01) |
| ouârge (d'l') : orge - (57) |
| ouart*, adj. ouvert : la porte est ouarte. - (22) |
| ouassa : petit être chétif. - (33) |
| ouasse (n. f.) : pie (un nid d'ouasse) - (64) |
| ouasse (une) : une pie - (61) |
| ouasse : personne ou animal maigre - (48) |
| ouasse : pie - (60) |
| ouasse : pie. - (09) |
| ouasse : pie. III, p. 41 - (23) |
| ouasse : pie (aigasse). Les aouasses ont une grande couée : les pies ont une grande nichée. - (33) |
| ouasse : pie (l'oiseau). Ex : "Aga, les ouasses sont dans les c'ries !" (cerises) - (pas de liaison entre l'article et le nom commun : les - ouasses). - (58) |
| ouasse, oujasse, vouasse. n. f. - Pie. - (42) |
| ouasse. s. f. Pie. - (10) |
| ouasser. v. n. Faire l'ouasse, c'est-à- dire imiter le corbeau ou la pie, et, par extension, aboyer. - (10) |
| oubesiot. n. m. - Personne renfrognée, de mauvaise humeur, sournoise. - (42) |
| oubeziau. s. m. Personne sournoise, boudeuse. Faire l'oubeziau, bouder. (Saint-Martin-sur-Ouanne). - (10) |
| oûbier : oublier - (48) |
| oubier, v. a. oublier. (voir : oblier.) - (08) |
| oubier. v. a. Se dit dans beaucoup de communes par contraction d'oublier. - (10) |
| oubieu, euse, adj. celui ou celle qui oublie, qui n'a pas de mémoire. - (08) |
| oub'iller : oublier - (57) |
| oublie et oblie. Pâtisserie sucrée très mince et très légère : ou la fait cuire dans un petit gaufrier circulaire au sortir duquel on la roule en cornet. Du latin oblisus, écrasé... - (13) |
| oublier : v. a. Oublié, se dit, comme guéri, d'un défaut qu'on n'a jamais eu. Il a ben oublié d’êt’ bête. - (20) |
| oubyi : (vb) oublier - (35) |
| oubyi v. Oublier. - (63) |
| oubzet, s. m. objet. - (08) |
| oûç’îne : verge flexible en osier - (37) |
| ou-ce-que : Ioc, où est-ce que ? Cette définition condamne à nos yeux la graphie « oùsque ». - (20) |
| Ouche (cracher dans l’). La rivière qui passe à Dijon s'appelle l’Ouche ; elle sort de la ville en longeant la promenade du Pare, et l’on prétend que si quelqu'un va cracher dans l'Ouche du haut du parapet qui termine le Parc sur la rivière, il sera marié dans l'année. - (12) |
| ouche (nom féminin) : petit champ réputé fertile situé près de la maison. - (47) |
| ouche : Voir houche. - (19) |
| ouche : voir houche. - (20) |
| Ouche, et en ajoutant l'article, l'Ouche, en latin Oscarus ou Oscara, suivant les divers manuscrits de l'Histoire de Grégoire de Tours, avant lequel nous n'avons nul auteur qui ait parlé de cette rivière… - (01) |
| ouche, n. fém. ; portion de terrain situé près de la maison. - (07) |
| ouche, s. f. ouche, terrain ordinairement situé dans le voisinage des habitations et qui est en général plus fertile que les autres. « ouice, ouéce. » - (08) |
| ouche, s. f. taille de boulanger. - (22) |
| ouche, s. f. taille de boulanger. - (24) |
| ouche, s. f., jardin, terrain facile à cultiver. - (40) |
| ouche, terre labourable et close. - (04) |
| ouche, terre labourable... - (02) |
| ouche. 3° pers. indicat. du verbe imperson. Oucher, être, exister. On ne l'emploie jamais que d'une manière ironique, équivalant a une négation. Y en ouche ! c'est-à-dire il n'y en a pas, est-ce qu'il y en a ? - (10) |
| ouche. Nicot dit : Osche, petite taillade et crénelure qu'on fait en nombrant sur une petite taille de bois, qui est la façon des villageois et de ceux qui prennent des denrées à crédit chez quelque marchand. Ménage dérive ce mot de coche, qui est l'entaillure qu'on fait à l'arbre d'une arbalète. - (03) |
| ouche. Prairie ou jardin clos de haies. Ce mot est usité dans le Morvan et dans tout l'Auxois : dans les environs de Beaune on emploie les termes clos ou meix. On pourrait trouver l'origine de cette appellation dans le latin oscillum, petite ouverture. On pénètre dans les ouches par une ouverture, pratiquée dans la haie et fermée par une simple barrière. Le latin du moyen-âge traduisait ce mot par olea et oschia. - (13) |
| ouche. s. f. Bouche d'un pont. Du latin os. - (10) |
| ouche. s. f. Terre labourée entourée de fossés ; enclos planté d'arbres fruitiers, jardin, verger à proximité d'une habilation rurale. Du bas latin occatus, suivant Corblet, et de olca ou olcha, suivant Corblet. - (10) |
| ouches, s f., entailles, crénelures faites sur un double morceau de bois (à l'instar des boulangers), pour marquer les denrées prises à crédit. On marque de cette façon le nombre des verres d'eau que les buveurs absorbent à Santenay. D'autres en tiennent compte à l'aide de petits cailloux posés sur la table, près du vase. - (14) |
| ouchi, adv. aussi. env. de Château-Chinon. - (08) |
| oucler. v. a. Remuer, secouer. Oucler une porte, une chaise. - (10) |
| oucli. s. m. Secousse, remuement ennuyeux, insupportable. Se dit des personnes et des choses. Quel oucli que cet enfant-là. – Se dit, en général, de tout ce qui est ennuyeux et gênant. - (10) |
| oudeur, s. f. odeur : « eune mauvaille oudeur. - (08) |
| oué : Oui. « Y est-i ta ?- Oué y est ma » : est-ce toi ? - Oui c'est moi. « Alle s'est décidé à dire oué » : elle s'est décidée à se marier. On dit aussi « voué », voir ce mot. - (19) |
| oué, s. f. oie, oiseau de basse-cour. - (08) |
| ouè[y]e : brebis. - (52) |
| ouéce (n.f.) : ouche, petite pièce de terre autour de la maison - (50) |
| ouée - oie. - Meune les ouées sur le pâtier. - En é vu ces jors qui des ouées sauvaiges ; ç'â signe de froid, vos vouairâs. - Il â béte quemant ine ouée. - (18) |
| ouée : oie - (48) |
| ouée : oie. Pour Noël on se procure une ouée. - (33) |
| ouée : n. f. Oie. - (53) |
| ouée : oie - (39) |
| ouéë, s. f., oie : « Veins-tu d'avou ? J'vons porter à note dame l'ouéë d'la Saint-Martin. » - (14) |
| ouée. n. f. - Oie. - (42) |
| ouée. Oie. - (49) |
| oueille (n. f.) : brebis - (64) |
| ouéille (n.f.) : brebis - (50) |
| oueille : brebis - (60) |
| oueille : brebis. (SS. T IV) - N - (25) |
| oueille : brebis. - (33) |
| oueille : brebis - (39) |
| oueille : brebis. Ex : "L’oueille qu’ èt’ voué la, c’est un bérriat qui m’la dounée". - (58) |
| oueille : n. m. Mouton. - (53) |
| oueille, brebis - (36) |
| oueille, brebis. - (04) |
| ouéille. Ouaille ; brebis. - (49) |
| oueille. s. f. brebis : « aine oueille biance », une brebis blanche. On prononce « voueille » dans quelques localités. - (08) |
| oueille. s. f. Oreille. - (10) |
| oueilles, voueilles : moutons - (37) |
| oueilles. s. f. pl. Ouailles, brebis. - (10) |
| ouéons : oie, plutôt utilisé pour les poussins de l'oie. - (58) |
| ouèseau : un oiseau - (46) |
| ouésse (l’) : (l’) ouche, petite pâture enclose, la plus rapprochée de la maison d’habitation - (37) |
| ouéti, oiti. s. m. Outil. (Soucy, Chigy). - (10) |
| ouéyau : oiseau. Ex : "J'ons mis des guénilles pour fée peu aux ouéyaux" (pas de liaison : aux -oué). - (58) |
| ouèze : auge - (39) |
| ouffrande, s. f. prière dite à certaine intention pour obtenir une guérison, une conversion, etc. Faire ses " ouffrandes » ce n'est pas faire des présents, mais faire des prières qu'on offre à dieu. - (08) |
| ouffri, v. a. offrir. - (08) |
| ougeais. s. m. Oiseau. (Athie, Sermizelles). - (10) |
| ougeaix, n. masc. ; oiseau. - (07) |
| ougelin : oiseau. (PLS. T II) - D - (25) |
| ougelin, oiseau. - (26) |
| ougeon. s. m. Oison. (Domecy-sur-le-Vault). - (10) |
| ouger, v. a. oser. - (08) |
| ougia, oiseau... - (02) |
| ougnan, ougnon. s. m. Oignon. - (10) |
| ougnat (A l’). locut. adverb. Tout simplement, sans manière, sans prétention. - (10) |
| oûgnion, s. m., oignon. - (14) |
| ougnon (n.m.) : oignon - (50) |
| ougnon : oignon. - (62) |
| ougnon, eugnon, oignon, - (16) |
| ougnon, n.m. oignon. - (38) |
| ougnon, s. m. ognon. L'ognon est un emblème de propreté. - (08) |
| ougnon. n. m. - Oignon. - (42) |
| ougnotte. s. f. Ergot de coq, de poule ; ongle de porc, de bœuf, de vache, etc. - (10) |
| ouha ! cri d'étonnement. - (38) |
| ouhille, ousille, ousie. s. f. Oseille. (Puysaie, Soucy). - (10) |
| oui : Voir plus loin. - (19) |
| oui. Singulier des trois personnes du verbe ouir à l'aoriste de l'indicatif. - (01) |
| ouïau : oiseau - (39) |
| oûiau, oûïai, oûïa, s. m. oiseau. - (08) |
| ouiau, oujau. Oiseau. - (49) |
| ouice, s. f. ouche, terrain de choix ordinairement situe près des habitations. Aux environ d'Anost « uice. » (voir : ouche.) - (08) |
| ouiche! particule exclamative, oui ! bah ! Ne s'emploie qu'ironiquement et négativement. Se dit concurremment avec vouiche. Affaire d'euphonie. - (14) |
| ouillâ : n. f. Auge à brancard de maçon pour porter le mortier. - (53) |
| ouille : brebis - (43) |
| ouille : brebis - (51) |
| ouille : mouton. - (30) |
| ouille n.f. (du vx fr. ouaille). Brebis. - (63) |
| ouille : s. f. aiguillon. - (21) |
| oûillê, oûjê : oiseau - (48) |
| ouillé, vt. Rassasier ; rebuter. J'en sé ouillé, j'en ai assez. - (17) |
| ouîlleau : qualificatif péjoratif pour un homme : « l’y yot t ain sâpré oûilleau ! » - (37) |
| ouilleau : n. m. Oiseau. - (53) |
| oûillée, s. f. oseraie, lieu planté d'osiers. (voir : ouzière.) - (08) |
| ouilles. s. f. pl. Ouailles, brebis. - (10) |
| ouillon (nom féminin) : oison. - (47) |
| oûillon : oison - (48) |
| ouîllon : oison (petit de l’oie) - (37) |
| ouillon : oison. Jeune oie, de l’ancien français oue, du latin auca, ont donné (ailleurs) ouillotte pour l’oie. - (62) |
| ouillon : n. m. Oison. - (53) |
| ouïllon : oison - (39) |
| ouillon, oison - (36) |
| ouillons. n. m. pl. - Oreillons. - (42) |
| ouillons. s. m. pl. Oreillons, maladie des oreilles. (Perreuse). - (10) |
| ouillôt, subst. masculin : oiseau. - (54) |
| ouillotte : oie. - (66) |
| ouillotte : une oie - (46) |
| ouillotte, jeune oie - (36) |
| ouinche : hanche - (48) |
| ouiner (verbe) : crier, pousser des cris stridents. - (47) |
| ouiner. v. n. Tomber de cheval. (Roffey). - (10) |
| oûïon, s. m. oison, petite oie. Dans quelques parties du « oujon. » - (08) |
| ouïotte : jeune oie - (39) |
| oûïotte, s. f. petite oie femelle. « oujotte. » - (08) |
| ouipe. s. f. Hysope. (Etais). - (10) |
| ouja : auge de maçon portée à dos d'homme avec des brancards pour monter le ciment sur l'échafaudage. - (33) |
| oûjâ, oujai, s. m. oiseau. - (08) |
| oujas : oiseau. Dans les âbres ol y ai des oujas : dans les arbres il y a des oiseaux. - (33) |
| oujas. s. m. D'oujasse. Gamin criard comme un corbeau, comme une pie.(Accolay, Arcy-sur-Cure). – Oiseau, en général. - (10) |
| oujasse, ougeasse. s. f. Pie, corbeau, corneille. – Ougeasse bâtarde, pie-grièche. (Laduz). - (10) |
| oujeau, ûjeau n.m. Oiseau, sexe masculin. - (63) |
| oujon : oison. - (33) |
| oujon s. m. Oison (Argentenay). - (10) |
| oujon, n. masc. ; oie. - (07) |
| oujote : oie. (MM. T IV) - A - (25) |
| oula ! cri de douleur. - (38) |
| oule (C.-d., Chal., Mâc.), ole (C.-d.), eule (Br.), toule, toulon (Morv.). - Pot, marmite de terre où l'on fait cuire la soupe. Du même mot vieux français oule, encore usité dans plusieurs autres provinces et notamment dans le Midi. Ce mot vient, suivant du Cange, du bas latin olla. - (15) |
| oule : Mare, creux rempli d'eau stagnante, à proximité de la maison. L'oule n'existe plus, on l'a fait disparaître par mesure d'hygiène. - (19) |
| oúle, s. f., marmite, vase en terre, dans lequel se font la soupe, les gaudes, etc. - (14) |
| oule. : Huile. En latin oleum. - (06) |
| oulerie : pièce en total désordre - (61) |
| oulle, olle, eulle : s. f., lat. olla, marmite. - (20) |
| oumiller. v. n. Faiblir sous un poids, sous une charge. Du latin humiliari, s'abaisser. - (10) |
| oumme, s. m. homme. A l'oumme apondu, à califourchon sur les épaules, c'est-à-dire comme un homme qu'on aurait « apondu » (ajouté) à un autre. - (22) |
| oun. pron. indéf. - On. - (42) |
| ounâte, honnête ; ounât'té, invitation à un repas. - (16) |
| ouö, adv. oui. Voir sia. - (17) |
| oupette - houpette, petite houppe. – Voyez Choupette. Ousse – exclamation pour chasser dehors, en s'adressant surtout aux chiens. - Ousse ! chienne de câgne !... - Allons, petiots drôles, tas de gueurnipilles que vos êtes, ne m'embêtez pas pu longtemps… ousse ! - (18) |
| ouqueton. s. m. Enfant chétif. (Etivey). - (10) |
| ouquier. s. m. Personne peu ardente, peu habile dans le travail. (Etivoy). - (10) |
| our : voir vour. - (20) |
| ouraille : oreille. - (62) |
| ouraille. Oreille. - (49) |
| oûraîlles : oreilles - (37) |
| ourailles, s. f., oreilles. - (40) |
| ourdé (adj.) : ivre mort - (64) |
| ourdé. adj. - Plein, rempli, couvert : « Des peurnes on en a ! Guade don’ c'tabre il en est ourdé. « (Druyes-les-Belles-Fontaines) - (42) |
| ourdi (adj.) : fatigué - (64) |
| ourdon : besogne - (60) |
| ourdon : ligne d'un champ. - (09) |
| oûre : s . f. heure. - (21) |
| oûre : s. f. vent . - (21) |
| ourgnée, s. f. ornière, sillon plus ou moins profond. - (08) |
| ourgnot, ourniot. n. m. - Personne bourrue, de mauvaise humeur ; synonyme d'oubesiot. - (42) |
| ourgueillou, ouse, adj. orgueilleux, orgueilleuse. (voir : orgaillou.) - (08) |
| ouriaule (n.m.) : érable - (50) |
| ourillon, sm. oreiller. Qqf. édredon. - (17) |
| ourise. Ouragan, orage. Ce mot est employé dans le village de Thoisy-la-Berchère. - (13) |
| ourissè, oursè : v. t. Salir de boue. - (53) |
| ourisse. s. f. ouragan, tourbillon, tempête de vent. - (08) |
| ourisser (s’) : se salir. (E. T IV) - S&L - (25) |
| ourisses : n. f. pl. Averses de printemps. - (53) |
| ourléron, s. m. petite bande de terrain longeant le côté d'une vigne. - (22) |
| ourlieu : s. f. « oreille ». - (21) |
| ourne, s. f. dans une vigne, largeur de terrain travaillée par le piocheur en une seule fois. - (22) |
| ournementée. n.f. - Ornée. (Leugny, selon F. Clas) - (42) |
| ourniée, orniée. n. f. - Ornière. - (42) |
| ours : ours (prononcer : our-se). Molle injure. Drôle d'individu (provisoirement ou définitivement), ou bien attitude originale, ou encore qualification d’une réponse inattendue. Peut aussi exprimer une nuance admirative. Jamais le sens de renfrogné, quelquefois dans celui de mauvais coucheur. Mot très usité, usage un peu universel (ce qui a eu pour résultat de l'affadir). Ex : "Oh ben, c'est ène ourse !", ou encore : "Oh ben, t'es ène ourse !" - (58) |
| oursè, ourissè : v. t. Salir de boue. - (53) |
| oursé, trempé - (36) |
| oursée (n. f.) : correction, raclée (syn. avouénée) - (64) |
| ourser (v. tr.) : infliger une correction, une raclée (syn. avouéner) - (64) |
| ourser : battre sévèrement - (61) |
| ourser : battre (quelqu'un). Ex : "Oute toué dé d'la, sinon, té vas t'fée ourser, t'entend ben !" - (58) |
| ourser : très mouillé - (39) |
| ourser. v. - Corriger, rosser : « T'as déchiré ton pantalon ! Te vas p't être ben t’fai'e ourser pa' ta mée. » - (42) |
| ourseries (faire des). n. f. - Faire des méchancetés, des bêtises. - (42) |
| ourses : n. f. Règles menstruelles. - (53) |
| ourter (contraction d'avourter). v. n. Avorter. - (10) |
| ourticaire : urticaire - (37) |
| ourtie (n.f.) : ortie (aussi ortige) - (50) |
| ourtie : ortie - (44) |
| ourtie, s. f., otie. - (40) |
| ourtie. n. f. - Ortie. - (42) |
| ourties (nom féminin) : orties. - (47) |
| oûrties : orties - (37) |
| ourtige, s. f. ortie. - (08) |
| ourtiger, v. a. frapper, fouetter quelqu'un avec des orties. - (08) |
| ourtiller, v., fouetter avec des orties fraîches. - (40) |
| ourtiner (s’) : (se) piquer les mains et les jambes dans les orties - (37) |
| ourvari. Charivari. Fig. Bruit assourdissant. - (49) |
| oûs (n’) : os - (57) |
| ous : os - (61) |
| ous, s. m. os : " ain grou-z-ous. » - (08) |
| ous. n. f. - Os : « L'gars à Serge, i' s'est cassé eune ous en tombant du ch'veau. » - (42) |
| ous. s. m. os. Un petit. Des gros ous. - (10) |
| ousai : oser. Dans certains cas on n'ouse pas : dans certains cas on n'ose pas se permettre de…. - (33) |
| ouse : clavette maintenant la roue du char sur l'essieu. A - B - (41) |
| ouseille. Oseille. - (49) |
| ouseran : pied d'osier. (BD. T III) - VdS - (25) |
| ousère, s. f., plant d'osier. - (40) |
| ouserièze. s. f. Oseraie. (Malay-le- Vicomte). - (10) |
| ousi : (genre ?) oseille - (35) |
| ousiâ : oiseau. - (32) |
| ousiau. s. m. Oiseau. Instrument à l'usage des maçons, pour porter le mortier sur les épaules. (Etivey). - (10) |
| ousier : osier - (61) |
| oûsier : osier - (48) |
| ousier. n. f. - Osier. - (42) |
| ousière (n.f.) : osier - (50) |
| ousille (n.f.) : oseille - (50) |
| oûsille : oseille - (48) |
| ousille : oseille. - (33) |
| ousille. n. f. - Oseille. - (42) |
| ousiou. s. m. Loriot. (Turny, Percey). – A Lasson se dit pour hibou. - (10) |
| ouspiller : réprimander - (44) |
| ouspiller : réprimander - (48) |
| ousque : où donc ? - (09) |
| ousque, où ; là vousqu'i ôt ? où est-ce ? - (38) |
| ousse que ? Où est-ce que ? « Ousse que te vais? » (où vas-tu ?). - (49) |
| oussier. s. m. Marchand d'os. (Saint-Maurice-aux-Riches-Homme). - (10) |
| oussine : badine, petite baguette - (48) |
| oussine : baguette flexible - (44) |
| oussine : une petite baguette - (46) |
| oussine : petite baguette, badine. - (33) |
| oussine : petite baguette flexible - (39) |
| oussine, ôssine : n. f. Petite baguette flexible. - (53) |
| oussine, s. f., baguette pour guider le bétail. - (40) |
| oussine. Verge avec brindilles, employée pour faire avancer les porcs ; on s'en sert aussi pour corriger les enfants. - (49) |
| oussiner : frapper avec une baguette flexible - (39) |
| oussiner. Frapper avec une oussine. Ce mot s'emploie aussi pour dire corriger : « tu vais te faire oussiner » (tu vas te faire corriger). - (49) |
| ousteau. (V.Huis). - (13) |
| oustiau, sm. demeure sordide, bouge. - (17) |
| ousu, part. pass. du verbe ouser pour oser. osé : « a n'é pâ ousu », il n'a pas osé. - (08) |
| out : n. m. Rejet – familièrement : « du chien! ». - (53) |
| out, s. m. août, le huitième mois de l'année : au mois d' « out. » - (08) |
| outai : ôter. Outai ses souïllers : ôter ses souliers. - (33) |
| oûté : ôté, enlevé - (37) |
| oûté : v. t. Ôter. - (53) |
| outer : enlever - (61) |
| oûter : ôter - (48) |
| oûter : ôter, enlever - (39) |
| outer : ôter, enlever. Ex : "Oute toué dé d'la !" - (58) |
| oûter, v. a. oter. - (08) |
| oûter. v. - Oter, retirer : « Oûte toué don' d'mes jambes, te vas m'fai'e tomber ! » - (42) |
| outî : homme à se méfier (« peûrnez-r’en ben gairde ! l’y y’ot t’ain outî ! ») - (37) |
| outî : outil pour travailler - (37) |
| oûti : usagé, « fusé », prêt à s’effilocher en parlant d’un tissu - (37) |
| outi : vermoulu - (48) |
| outi : usé, qui tombe en miette - (39) |
| outi, uti, adj. usé par un long service ou par l'humidité, gâté, altéré : du linge « outi », du bois « uti. » - (08) |
| outil : .s. m., Instrument; individu. - (20) |
| outou interj. Ouste. - (63) |
| outraige, s. m. dommage, tort, préjudice, méchanceté. - (08) |
| outraigeou, ouse, adj. et subst. celui qui jure, qui profère des paroles grossières ou blasphématoires. - (08) |
| outrâment, adv. outrément, outre mesure, à l'excès. s'emploie en bonne et en mauvaise part : ce champ a été vendu « outrâment » cher ; j'ai du vin « outrâment » vieux ; c'est un bavard qui parle « outrâment. » - (08) |
| outré, part. pass. de l'ancien verbe outrer, passer outre, dépasser la mesure. - (08) |
| outre-bein. adv. - Très bien, plus que bien. - (42) |
| outre-ben. adv. Très-bien, plus que bien. (Etais). Du latin ullrà bené. - (10) |
| outs'ke ? où est-ce que...? - (16) |
| outu : exclamation utilisée pour faire fuir un chien. A - B - (41) |
| outu : exclamation servant à faire fuir un chien - (34) |
| ouvarte. adj. - Ouverte. - (42) |
| ouvàrture, s. f., ouverture. - (14) |
| ouver : v . pondre. - (21) |
| ouverier (jour), s. composé m., jour ouvrable, où l'on peut ouvrer. (V. ce dernier mot.) - (14) |
| ouverier, et ouvrei, s. m., ouvrier. - (14) |
| ouverier. Ouvrier. - (49) |
| ouvert : part, pass. pris pour infinitif, ouvrir. C'est lui qu'est venu m'ouvert la porte. - (20) |
| ouvoeuvri : v. t. Ouvrir. - (53) |
| ouvrâdze n.f. Travail. - (63) |
| ouvràge, et ôvràge, s. f., ouvrage : « De la béle, de la boune ouvràge. » - (14) |
| ouvrageux : qui demande du travail - (61) |
| ouvrageux, euse. adj. Qui donne lieu à beaucoup de travail. (Auxerre). - (10) |
| ouvraige : travail. O l'é fait d'la boune ouvrage : il a fait du bon travail. - (33) |
| ouvraige, ôvraige : ouvrage, travail - (48) |
| oûvré (ain) : (une) surface qu’un ouvrier de la terre est susceptible de pouvoir « travailler » dans sa journée (en moyenne 4 ares, 28 centiares) - (37) |
| ouvre : s. f. filasse. - (21) |
| ouvre : s. m., orage. Voir orvat. - (20) |
| oûvré, ouvrére, ôvré, ôvrére : ouvrier, ouvrière - (48) |
| ouvre, s. f. chanvre préparé, prêt à être filé, œuvré (du vieux français œuvre). - (24) |
| ouvre, s. f. chanvre préparé, prêt à être filé, ouvré. - (22) |
| ouvré, s. m. ouvrier, celui qui travaille. au féminin « ouvrére » surtout lorsqu'on emploie le mot avec une qualifie : une bonne, une mauvaise « ouvrére. » Isolément, une « ouvrére » est ordinairement une personne qui travaille à l'aiguille. - (08) |
| ouvrée de vigne. Cette mesure agraire, contenait quatre ares vingt-huit centiares. On disait autrefois œuvrée. C'est en effet l'œuvre d'un homme travaillant toute une journée. Les Angevins disent, dans le même sens, une hommée... - (13) |
| ouvrée, s, f., ancienne mesure de surface pour les terres (vignes), correspondant à ce qu'un homme peut piocher en un jour. L'ouvrée, huitième du journal, contenait 45 perches carrées de 9 pieds 1/2, et valait 4 ares 285. - (20) |
| ouvrée. : Dans les chartes on trouve operata vinex, journée de vigne. (Voir euvrée.) - (06) |
| ouvrer, v. intr., travailler. - (14) |
| ouvri (à l’), loc. à l’abri du vent. - (22) |
| ouvri (pour ouvert). Ouvrie (pour ouverte). adj. Béant, ante.(Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| ouvri : ouvert - (46) |
| ouvri : ouvert - (57) |
| ouvri : ouvrier - (51) |
| ouvri : ouvrir - (48) |
| ouvrî : ouvrir. - (52) |
| ouvri : ouvrir. Ouvri la porte : ouvrir la porte. - (33) |
| ouvrî n.m. Ouvrier. - (63) |
| ouvri : part pass., ouvert. - (20) |
| ouvri, euvri. Ouvrir. - (49) |
| ouvri, part, d'ounvrî, ouvert : « Y é trop tôt por entrer ; y é pa ouvri. » - (14) |
| ouvri, part. pass. du verbe ouvrir. On prononce de même à l'infinitif et au participe passé : « ouvri » une porte ; une porte « ouvrie. » - (08) |
| ouvrî, v. tr., ouvrir. - (14) |
| ouyais - oiseaux. - Les ouyais quemançant de chantai, çâ bon signe. - I eumeras bein, moi, aivoir ine grande caige, quemant ine voliére pour y mette to pliain d'ouyais de tote sorte d'espèce. - (18) |
| oûyau (n.m.) : oiseau - (50) |
| ou-yau, s. m., oiseau. - (40) |
| ouye : (nf) brebis - (35) |
| ouyiau*, s. m. aissette de cave. - (22) |
| ouyo : oiseau. - (62) |
| oûyon (n.m.) : oison (pour de Chambure : ouïon) - (50) |
| ouyon, o-ion. Petit de l'oie. - (49) |
| ouyote, petite oie. - (16) |
| oûyotte (n.f.) : jeune oie femelle (pour de Chambure : oûiotte) - (50) |
| ouyotte (nom féminin) : jeune oie femelle. - (47) |
| ouze : clavette maintenant la roue du char sur l'essieu - (34) |
| ouzeran : osier. - (29) |
| ouzeran et ouzereau. C’est le synonyme patois d'osier. On appelle ironiquement teite d'ouzeran, un enfant dont la tête malpropre est couverte de cheveux hérissés. - (13) |
| ouzerôlle : un érable, à rapprocher de la ferme de l'Ouzerôlle. A Chevigny, on dit yzerôlle - (46) |
| ouzeuille n.f. Oseille. - (63) |
| ouzière : Osier, salix viminalis. « Eune pognée d'ouzières. - (19) |
| ouziére, s. m. osier, arbrisseau aux jets flexibles. - (08) |
| ouzièze. s. f. Osier. - (10) |
| ouzille : oseille - (39) |
| ouzille, s. f. oseille. - (08) |
| ouziô, ouzyà, oiseau. - (16) |
| ouz'ran, pied et plantation d'osier. - (16) |
| ovar. Ouvert, ouverts. - (01) |
| ovartement, adv. ouvertement, franchement. - (08) |
| ovature. Ouverture, ouvertures. - (01) |
| ovrage : Ouvrage, travail, besogne. « J'érins vo voir après les ovrages » : nous irons voir quand les travaux seront terminés. - (19) |
| ôvrage, ouvrage, travail dans la vigne. - (38) |
| ôvraige : n. m. Ouvrage. - (53) |
| ovraige. Ouvrage, ouvrages. - (01) |
| ovraize (n.m.) : ouvrage - (50) |
| ôvraize : ouvrage - (39) |
| ovre : faire les ovres : ouvrier saisonnier embauché pendant les foins et les moissons. A - B - (41) |
| ovre (faire les) : ouvrier saisonnier s'embauchant le temps des foins et des moissons - (34) |
| ôvre : Filasse de chanvre. « Eune réte d'ôvre » : une poignée de filasse. « Avoir de l'ôvre à sa quonaille » : avoir fort à faire. - (19) |
| ovré : Ouvriers. « Les chetits ovrés n’ant jamâ des bonn'eutils » : les mauvais ouvriers n'ont jamais de bons outils. - (19) |
| ôvré : n. m. Ouvrier. - (53) |
| ovrée : Ouvrée, ancienne mesure agraire. « Eune ovrée de vigne ». Autrefois l'ovrée était la surface occupée par cinq cents ceps plantés à vingt-huit pouces l'un de l'autre, maintenant qu'on plante à un mètre et plus, on compte l'ovrée pour quatre ares. - (19) |
| ôvrée, ôveraille, s.f. mesure de superficie de la vigne (4,28 a.). - (38) |
| ovrei - ouvrier. - L'homme de lai Luise â in tot ai fait bon ovrei. - Les ovrei d'ajedeu, ç'â difficile quemant tot ; en ne sait pâ quemant les neuri. - (18) |
| ovrei. Ouvrier, ouvriers : Jor ôvrei, jour ouvrier, jour ouvrable. Un vigneron, un paysan, un manœuvre, appelle en Bourgogne sa femme « son ôvreire ». - (01) |
| ovrei. : Ouvrier. Les vignerons appelaient leurs femmes lote ôvreire, c'est-à-dire, leurs ouvrières. - (06) |
| ovrenôge (â l'), loc. placé dans un endroit sombre et frais. - (24) |
| ôvrer : ouvrier - (39) |
| ovri : adj. Ouvert. - (53) |
| ovrise. v. a. Ouvrir ; par suppression de l’u et conversion de l'r en se. (Malay-le-Vicomte). - (10) |
| ovrœte, s. f. étincelle : les ovrœtes emportées par le vent. - (24) |
| oyan : Oison. « Eune couée d'oyans » : une couvée ou une bande d'oisons. - (19) |
| oyasse (oïasse) : s. f., pie. - (20) |
| oyasse : passereau gris-rouge qui chasse les gros insectes - (60) |
| oyasse : pie - (44) |
| oyasse : pie. - (30) |
| oyasse. Pie. - (49) |
| ôye : brebis. A - B - (41) |
| oye : (nf) oie - (35) |
| oye, oie. - (05) |
| oyesse : pie (en B : oyasse). A - (41) |
| öyesse : (nf) pie - (35) |
| oyesse : pie - (34) |
| o-yesse : pie - (43) |
| oyesse : pie. (C. T IV) - S&L - (25) |
| oÿesse n.f. Pie. On dit aussi dzacquotte. - (63) |
| oyiau, s. m. aissette de cave. - (24) |
| oyon : oison. A - B - (41) |
| oyon - oison, petite oie. - Lai pôre petiote Claudine, ile é tote ine bande d'oyons ai gairdai. - En ne faut pas menai les grandes ouées d'aivou les oyons ; à les bosculant trop. - (18) |
| oyon (oïon) : s. m., oison. - (20) |
| öyon : (nm) oison - (35) |
| oyon : oison - (34) |
| o-yon : oison - (43) |
| oÿon : oison - (51) |
| oÿon n.m. Oison. - (63) |
| oyon, oison. - (05) |
| ôÿon, s. m., oison. On ne se gêne pas pour donner ce nom aux gens simples : « Te n'comprends pas c'qui ? Y é portant pas déficile... Oÿon, va ! » - (14) |
| oyon. Oison. Plus rationnel qu'oison, venant directement du vieux mot oye. A Paris on appela longtemps les rôtisseurs oyers. - (03) |
| oyotte. : Petite haie. (Franch. de Tart, 1275.) - (06) |
| oyoyoïl, int. exprime la douleur, la fatigue. A Sacquenay on dit ayayaïl ; à Fays-Billot : ouyouyouil. - (17) |
| oysevier. : (Dial.), quitter l'ouvrage, muser, musarder (bas. lat. otiari). - (06) |
| ozea. Oiseau, oiseaux ; on disait anciennement oisel… - (01) |
| ozéa. : (Prononcez oziaa), oiseau. - (06) |
| ozedé, ozourdé, s. m. aujourd'hui. (voir : hocedé, ojedeu.) - (08) |
| p', peu, peur prép. Pour. - (63) |
| p', peur adv. et prép. Par. - (63) |
| p’assez, loc. adv., contraction de : pas assez : « J'ai ben faim de sòpe ; te n'm'en baille p'assez. » - (14) |
| p’chée (pour abechéee, béchée). – A Villeneuve-les-Genèts, on dit p'chie. - (10) |
| p’chon : (nm) poisson - (35) |
| p’ler : (vb) piler - (35) |
| p’ler : éplucher - (43) |
| p’ler, peler v. - (38) |
| p’loce : prunelle - (43) |
| p’losse : (nf) prunelle - (35) |
| p’lossi : (nm) prunellier - (35) |
| p’lou : (nm) racloir à écorce - (35) |
| p’nâ : qui sent la punaise. « oeû p’nâ » : œuf pourri qui dégage l’odeur de la punaise. - (62) |
| p’naîlle : punaise - (37) |
| p’sin, s. m., poussin. - (40) |
| p’sou, s. m., autre non du fessou (cf. ce mot). - (40) |
| p’ssin : poussin. - (62) |
| p’tâ : (nm) digitale ; pétard ; flatulences - (35) |
| p’ta : digitale - (43) |
| p’tiet, p’tiète : petit (e) - (35) |
| p’tion (un) : peu (un) - (43) |
| p’tion (un) : un peu - (35) |
| p’tiot, p’tiote : petit.e gamin.e - (37) |
| p’tiot, p'tiote, adj. et s. petit en général. - (08) |
| p’tiot, s’tiot : petit, petite gamin / gamine - (37) |
| p’tit ailbert (l’) : livre de sorcellerie que le détenteur, s’il voulait obtenir un pouvoir maléfique, devait signer avec son sang (mais il ne pouvait parvenir à mourir alors qu’il était atteint d’indicibles souffrances, que lorsqu’un autre membre de sa famille avait accepté de le signer à son tour) - (37) |
| p’tou : putois - (35) |
| pa (féru), viande ou lard, surtout viande froide ou restant de lard. - (27) |
| pa (mon) : (mon) père - (37) |
| pâ (n.f.) : paix - (50) |
| pâ : Paix. « Fare la pâ » : faire la paix, se réconcilier. « Y est i vra que ta fane t'a foutu eune gif'lle a peu que te li a pas rendue ?- Qu'est-ce que te veux, i faut bin endeurer quéque chose pa avoir la pâ ! » : est-ce vrai que ta femme t'a gifflé et que tu ne lui a pas rendu ? - Qu'est-ce que tu veux il faut bien supporter quelque chose pour avoir la paix. - (19) |
| pâ : Part. « Chéquin sa pâ » : chacun sa part. « Eune pâ de beu » : un lot d'affouage. - (19) |
| pa : pois - (51) |
| pa : Pour. « Apporte dan du beu pa chauffer le fo » : apporte donc du bois pour chauffer le four. « Pa qua fare ? » : pour quoi faire ?. « Y est pa fare in pané ». S'emploie aussi pour « à » dans le sens de « à telle époque ». « J'érins vo voir pa la Saint-Georges » : nous irons vous voir à la Saint-Georges. On dit aussi par. Voir ce mot. - (19) |
| pâ moin, cependant. - (16) |
| pa : s. m. haricot. - (21) |
| pá, adv. nég., pas : « O n'é pá tant s'ment m'nu au d'vant d'son onque. » - (14) |
| pa, portion, nourriture. C'est une abréviation du mot latin pastus. On dit encore à Recey : Ampote brament de lai part aivô dou pain. « Ne manque pas d'emporter de la viande avec du pain. » - (02) |
| pâ, s. f. paix, calme, tranquillité : « beille moue lai pâ. - (08) |
| pà, s. f., paix, silence : « Voyons, galopin, fiche-me eùn p'chô la pà ! » - (14) |
| pa, s.f. paix. - (38) |
| pa. Pas, négative de passus… - (01) |
| pa'. prép. - Par. - (42) |
| pa. : Portion de nourriture. Apocope du mot latin pastus. Les villageois entendent par là un morceau de viande pour un repas. Ainsi ils inviteront quelqu'un ai prarre de lai pâ d'ai v ô ein morcéà de pain. - Se servir du mot part c'est faire un solécisme. - (06) |
| paborenkli : débraillé. (F. T IV) - S&L - (25) |
| pacan, homme grossier... - (02) |
| pacan, meurcelon : romanichel, vaurien - (36) |
| pacan. : Homme rustique (du latin paganus, païen, parce que le paganisme demeurait plus invétéré dans les campagnes que dans les villes). Le langage féodal avait encore des mots plus expressifs pour rendre les degrés de rusticité. Ainsi du mot latin petra, pierre, rocher, on appelait petra un paysan d'une intelligence dure, et, du mot latin plaustrum on appelait pleutre un charretier. - (06) |
| pacant : bohémien (voir meurselon). - (52) |
| pace que (loc.) : parce que - (50) |
| pachau, péchau n.m. Barreau d'échelle. Voir aussi bosson et beûdzon. - (63) |
| pache : s. m, et f., vx fr., pacte, contrat, traité. - (20) |
| pachiau : armatures situées au-dessous du panier - (43) |
| pachiau n.m. Armature de fond de panier. - (63) |
| pachio : échalas - (43) |
| pachiot : rame de petits pois ou de haricots - (43) |
| pachot : barreau (d'échelle) - (51) |
| pach'tau : (nm) barreau d’échelle - (35) |
| pàcot, s. m., boue, crotte ; au fig. embarras : « D'avou tous ses micmacs, ô s'ê métu dans l’pàcot jeùsque au cou. » - (14) |
| pâcotte - primevère jaune. - An faut raimassai de lai pàcotte ; ç'â bon pour des infusions. - Vois don les enfants quemant qu'à s'aibuyant ai sautai des paumes de pâcotte. - (18) |
| padan. Perdant. - (01) |
| padant : Pendant. « Premenins no dans le beu padant que le lout n'y est pas » : promenons nous dans le bois pendant que le loup n'y est pas. - (19) |
| padei. Par Dieu, jurement… - (01) |
| padériot (n. m.) : perdreau - (64) |
| padi. Perdis, perdit. - (01) |
| padon. Pardon, pardons ; c’est aussi le verbe perdons. - (01) |
| padonai. Pardonner, pardonné, pardonnez. - (01) |
| padouë, s. m., padou, ruban mi-fil et mi-soie : « La p'tiote a été m'qu'ri du padouë pou border ma mante. » - (14) |
| pâdre : perdre - (57) |
| padre : Perdre. « O n'a ren à padre » il n'a rien à perdre. « Travéilli à pain pardu » : cultiver un champ sans grand espoir de récolte. « Couchi à padre » : ne pas rentrer coucher. - (19) |
| pâdre, v. a. perdre. - (22) |
| padre, v. perdre. - (38) |
| pâdreau (n.m.) : perdreau - (50) |
| pâdreau, s. m. perdreau, jeune perdrix. - (08) |
| pàdreau, s. m., perdreau, jeune perdrix. - (14) |
| padri (n. f.) : perdrix - (64) |
| pâdri, s. f. perdrix. - (08) |
| pàdri, s. f., perdrix. - (14) |
| padri, s.f. perdrix. - (38) |
| pâdrix (n.f.) : perdrix - (50) |
| padrix : Perdrix. « Eune padrix roge » : une perdrix rouge. - (19) |
| padu. Perdu, perdus. - (01) |
| padze : poix. A - B - (41) |
| padze : page - (51) |
| padze : poix - (34) |
| pâdze n.f. Page. - (63) |
| paere, s.m. père. - (38) |
| pafe, adj., gris, ivre : « Vrâ, ôl on pren-t-i, d'ces gòtes é pi d'ces gôtes ! Aussi, drès l’matin, ôl é pafe. » - (14) |
| pafeugner. Flairer. Fig. Chercher. Même sens que « feugner ». - (49) |
| pafeugnon. Groin, museau. - (49) |
| paforne : sorte de gâteau cuit au four. (F. T IV) - Y - (25) |
| pafouiller, v. intr., bavarder, causer beaucoup, causer trop, sans rien dire de sérieux, et aussi s'exprimer d'une manière confuse. - (14) |
| pagane (en), loc., en pagale, pêle-mêle, terme de marine fluviale : « Toué, pò còrî, te laiss' tout ton cheû-vous en pagane. » J'ai aussi entendu prononcer : en pagaille. - (14) |
| pagane (nom masculin) : (En). en grand désordre. - (47) |
| pagane. Désordre : « laisser en pagane ». Fig. Désigne une personne sans ordre. - (49) |
| pagat. s. f. Jeune fille étourdie et qui n'a rien. (Annay-sur-Serein). - (10) |
| page : Nom féminin. Poix. « De la page de cordan-nier » : de la poix de cordonnier. « I a de la page su sa chaire », se dit de quelqu'un qui une fois assis, ne songe plus à s'en aller. - (19) |
| pagea : Gesse, espèce de vesse, mauvaise herbe qui croît dans les blés. - (19) |
| pageoux : Poisseux. « Les cordan-niers ant sovent les mains pageouses ». - (19) |
| pâgnâ : n. f. Personne peu intéressante. - (53) |
| pâgnadze n.m. (de l'anc. fr. pasnage, pâturage, venant du lat. pastionem). Pâturage. Mette les bétes en pâgnadze : les faire paître sur un pâturage dont on a seulement loué le droit de pâture. - (63) |
| pagne, s.m. pain (vieux) - (38) |
| pagnette. n. f. - Petit panier sans anse, sorte de corbeille. Déformation de «bannette», petite banne, panier d'osier. - (42) |
| pagnette. s. f. Petit panier sans anse, bannette, corbeille. (Lainsecq). - (10) |
| pagneux. Pieu, lit. - (49) |
| pagnié, s. m., panier. - (14) |
| pagnier. n. m. - Panier. - (42) |
| pagnière, s. f., corbeille en osier, plus grande et plus évasée que le pagnié, dont elle est devenue le féminin. C'est généralement dans la pagnière que les villageoises apportent leurs marchandises au marché. - (14) |
| pâgnin, pagnio - nonchalament, peu à peu, lentement. - Al ailaint pâgnin, pagnio, quemant s'â s'étaint premenai. - Ce n'â pâ lai in ovrei qui s'en vei pagnin-pagnio ai son chantei. - (18) |
| pagnoter (se). Se coucher. « Aller se pagnoter », « aller au pagneux ». (Argot moderne). - (49) |
| pagnotte. s. f. peureux, lâche dans le sens d'indolence, de mollesse. - (08) |
| pagueuille : (pakeuy' - subst. f. pl.) balayures, grosses poussières, menus débris. - (45) |
| paî : pis, mamelle. Et plus généralement le pis de la vache. « En 14, on mîgeo du paî d’vaiche » disait l’ancien poilu. - (62) |
| pai : n. m. Pain. - (53) |
| pai, part, portion. - (05) |
| paï, pa-yi, s.m. pays. - (38) |
| pai. Ne dites mot ; paix, du latin pax, adverbe comique employé pour ordonner à quelqu'un le silence, ou pour se l'imposer soi-même… - (01) |
| paï. Pays. - (01) |
| paican, s. m. vagabond, vaurien. - (08) |
| paice, plaice : n. f. Place. - (53) |
| paichâ, s. m. paisseau de vigne, échalas usé ou de rebut. - (08) |
| paichais - paisseau. - I cherche dans les faigots des petiotes brainches pou fâre des paichais de faiviôles. - Le Cadet Gossot é aivu l'idée de fâre des paichais pour vendre es vignerons, ma ci ne gâgne pâ aissez. - (18) |
| paichais, n. masc. ; échalas. - (07) |
| paichaler : Munir d'échalas, de paisseaux. « A la troisème feuille les vignes sant bien temps de paicheler » : dès la troisième année de la plantation il est temps de mettre des échalas dans les vignes. - (19) |
| paicheau (n.m.) : bâton de forme arrondie qui relie les deux montants d'une échelle, d'une chaise - (50) |
| paicheau : Paisseau, échalas. « Aigugi des paicheaux » : tailler en pointe les échalas. - (19) |
| paicheler. Garnir d'échalas, ramer les pois ; de paxillus, paisseau, qui est montagnard. La paicheleure est l'échalas lui-même. - (03) |
| paichon : barreau d'échelle, de barrière - (48) |
| paichon : barreau d'échelle ou barreaux servant à la fabrication des barrières de pré. Dans une échelle les paichons d'vont étes solides : dans une échelle les barreaux doivent être solides. - (33) |
| paichon, s. m. bâton de forme arrondie qui relie les deux montants d'une échelle ou d'un râtelier d'étable ; échelon. - (08) |
| paie : peau - (48) |
| paie, morceau do choix du porc. - (16) |
| paie, sf. omoplate de porc (terme de boucherie). - (17) |
| paige (n.f.) : page - (50) |
| paignôte. : Poltron, homme sans énergie. - (06) |
| paignotte et pagnotte, poltron, homme de peu de cœur... - (02) |
| paihan, ante, adj. parent. - (08) |
| pai'ille : paille - (48) |
| paile, paislerot - divers temps du verbe parler, où l'usage retranche l'r. - Le pôre père Maithelie â paile bein mau. - En feillot l'entendre quemant qu'a pairlot bein ; â fairo in bon avocat. - (18) |
| paîll’sson : récipient fait de paille serrée, tressée, employé notamment pour y mettre, enveloppée de linge blanc, la pâte à pain de ménage, préparée au levain, la veille de la cuisson, qui fermente - (37) |
| paillan : Soufflet, giffle. « La mère énervée d'entendre pialler son gosse : Veux-tu te cougi? (te taire) si je te fous in païllan te voiras bin ! ». - (19) |
| paillasse, n.f. panier à pâte. - (65) |
| paillasse, s. f. corbeille de boulangerie : une « paillassumée », une pleine paillasse. - (08) |
| paillasse. n. f. - Ventre. - (42) |
| paillasse. Paneton. Corbeille à pain, confectionnée autrefois avec de la paille (le paneton en osier a conservé ce nom) ; sommier (le sommier portait ce nom parce qu'il se composait d'un grand sac de toile rempli de paille). - (49) |
| paillasson. Petite corbeille à pain. - (49) |
| paîllé : meule de paille. - (62) |
| paillé : meule de paille. (BD. T III) - VdS - (25) |
| paille de maïs : s, f., enveloppe de l'épi du maïs. - (20) |
| pailleau, s. m., bois du chêne qui a été écorcé. - (11) |
| paillereai. s. m. paillasson, tapis ou coussin de paille. - (08) |
| pailleris. n. m. - Champ fauché en attente d'être labouré. - (42) |
| paillesse : corbeille à pain. A - B - (41) |
| paillesse : corbeille à pain - (34) |
| paillesse : paillasse - (43) |
| paillesse n.f. Paillasse remplaçant le matelas, remplie de feuilles de maïs et dotée de deux ouvertures latérales destinées à remuer le contenu de temps à autre. - (63) |
| pailli (on) : meule (de paille) - (57) |
| pailli : (nm) tas de paille - (35) |
| pailli : meule de paille entreposée après le battage - (51) |
| pailli : meule rectangulaire de paille battue - (43) |
| pailli n.m. Meule de paille, paillère. - (63) |
| pailli, n.m. meule de paille. - (65) |
| paillier : s. m., syn, de paillis - (20) |
| paillis : s. m., vx fr.. meule de paille. - (20) |
| paillon : s. m., palllot, paillasse de berceau. - (20) |
| paillon. n. m. - Paillasson : petit tapis de paille, de seigle ou de jonc, sur lequel on déposait les fromages à sécher. Le paillon était disposé sur une cherriée, plateau à fromages en bois, suspendu aux solives. - (42) |
| paillon: flocon de neige - (48) |
| paillot, s. m. balle ou capsule qui enveloppe grains. Le van sépare le blé de ses « paillots. » (voir : balot, bouffe.) - (08) |
| paillòt, s. m., balle, enveloppe des grains. - (14) |
| paillot. s. m. Couche de paille etendue pour servir de sous-trait. – Au plur., paillots s. m. et paillottes. s. f. Balles de blé ou d'avoine. (Pasilly, Lasson). - (10) |
| paillòte, s. f., paille des épis du maïs. Sert à remplir les paillasses, et quelquefois des matelas. (V. Panouille.) - (14) |
| paillotte. s. m. Fauvette. (Liehères). - (10) |
| paillri (n. m.) : éteule, chaume qui reste sur place après la moisson - (64) |
| pain : s. m. pain. - (21) |
| pain brio. Voyez Brio. - (01) |
| pain de Chatillon (Châtillon) : s. m., macaron au safran, originaire, dit-on, de Châtillon-les-Dombes. - (20) |
| pain de coucou (n.m.) : oxalide oseille - (50) |
| pain de coucou : plante oxalide, oseille. - (33) |
| pain de coucou, gomme de prunier. - (05) |
| pain de coucou. oxalide oseille. - (08) |
| pain d'ouyai (ouyau) (n.m.) : saxifrage des murailles - (50) |
| pain du lièvre. Morceau de pain que le vigneron, le cultivateur, le chasseur rapportent des champs et qui est de reste sur le repas qu'ils y ont pris ; on le donne aux petits enfants en leur disant que c'est le pain du lièvre ; en général ils le trouvent meilleur que l’autre ! - (12) |
| pain : s. m. Etre à son pain, vx fr.» être à son compte. Voir croûte. - (20) |
| painaice (n.m.) : panache - (50) |
| painé – panier. – Prend le petiot painé et pu pote le goûtai ai ton père. – Pour teni frais en te fauré mette le painé vé lai fontaingne, ai l'ombre ; vais mon enfan, et pu airainge bein cequi. - (18) |
| paine (nom masculin) : panier. - (47) |
| painé : panier - (48) |
| painé : n. m. Panier. - (53) |
| painé, panier - (36) |
| painer (n.m.) : panier (aussi painé) - (50) |
| painer d’oûsé : panier d’osier - (37) |
| painer : panier - (39) |
| paine-sauvée. : (Poena salva), travail rémunéré. (Franch. de Saulx, XIIIe siècle.) - (06) |
| paineti : s. m. petit coffre à pain, panetier. - (21) |
| paineu : s. m. maïs . - (21) |
| paing (n.m.) : pain - (50) |
| paing : pain - (39) |
| paingn', s. m. pain. - (08) |
| paingnée (nom féminin) : tourtière où l'on entreposait le pain. - (47) |
| paingnée, s. f. petite échelle placée horizontalement entre les poutres d'une maison et sur laquelle on dépose les pains de la fournée, c'està-dire la provision de deux à trois semaines. (voir : panne, pante.) - (08) |
| paini (on) : panier - (57) |
| painire (na) : panière - (57) |
| pain-marc. s. m. Tourteau de graines oléagineuses. (Saint-Florentin). - (10) |
| pain-maton. s. m. Synonyme de pain-marc. (Avallonnais). - (10) |
| painöt, sm. pan de chemise. - (17) |
| painteurer, v. a. peindre, mettre de la couleur. - (08) |
| painteurleurer (v.t.) : peindre grossièrement - (50) |
| painteurleurer, v. a. peindre un peu grossièrement. - (08) |
| paintreau : voir pressoir. - (20) |
| paipié, s. m., papier : « Le p'tiot, ô sait d'jà lire en paipié (lire l'écriture). » - (14) |
| paipier (n.m.) : papier - (50) |
| paipier, sm. papier. - (17) |
| paipillon, sm. papillon. Voir pampivö. - (17) |
| paipillotte : petit « tortillon » de papier pour se faire des « frisettes » - (37) |
| pair - lard, ou plutôt seulement la portion qu'on en mange. Pour toute autre viande, on dit généralement Fricot. - En faut bein de lai pair, ailé, pour quaitre homme. - Teins, Pierrot, mége ce bout de pair qui aivou ton pain. - Mon gairson, t'airé de lai pair aipré tai soupe. - (18) |
| pair : prép. Par. - (53) |
| pair, paire : s. m., vx fr. pair, paire, couple. Mes bottes sont tout usé s; je viens de m'en commander un paire de neufs. - (20) |
| pair. Lard ou viande cuite. Mai tante, beillez--moi don un petit bout de pair pour mainger d'évou mon pain. Origine inconnue. Notons que payrol signifie chaudière, en provençal. - (13) |
| pairaibole. Parabole… - (01) |
| Pairaidi. Paradis. Il y a dans le vignoble de Dijon un endroit nommé Paradis, qui produit de méchant vin, et un autre, nommé le Creux d'Enfer, qui en produit de fort bon, ce qui a donné lieu à ce quolibet des vignerons du pays : « que le çrô d’Anfar vau meù que le Pairaidi ». - (01) |
| pairaidis (n.m.) : paradis - (50) |
| pairaidis, s. m. paradis. - (08) |
| pairaidis, sm. paradis. - (17) |
| pairaissu (p.p.) p.p. du verbe paraître - (50) |
| pairaissu. part. pass. du verbe paraître. paru. - (08) |
| pairdi - espèce de juron, d'affirmation. Pardi. - I veux pairdi bein ; ci m'iré perfaitement. - Voué, voué ! ç'â pardi vrai. - (18) |
| pairdié : pardi, bien sûr - (48) |
| pairdié ! : pardi ! bien sûr ! - (37) |
| pairdon, s, m. pardon. - (08) |
| pairdonner : pardonner - (48) |
| pairdouner, v. a. pardonner. - (08) |
| paire, s. m., un paire : « J'm'é écheté un paire de bas, et un paire de saibots. » - (14) |
| paireau. adj. Pareil ; du latin par, paris (Domecy-sur-le-Vault). - (10) |
| pairei : pareil - (37) |
| paireil (adj.) : pareil — adj. fém., paireille = pareille - (50) |
| paireil, eille, adj. pareil, semblable, d'où le verbe « aipaireiller », rendre pareil. - (08) |
| pairent : parent - (48) |
| pairent : parent. Bonjou pairent : bonjour parent. - (33) |
| pairent : n. m. Parent. - (53) |
| pairent : parent - (39) |
| pairent, sm. parent. - (17) |
| pairentaige. s. m. parentage, famille : « al ô v'ni aivou tô son pairentaige », il est venu avec tous ses parents, toute sa famille. - (08) |
| pairents (n.m. et f.pl.) : parents - (50) |
| pairer, vt. parer, peler. - (17) |
| pairier : Parier. « Pairier à ju seur » : parier à coup sûr. - (19) |
| pairieure : Pari, gageure. « Ol a gagni sa pairieure » : il a gagné son pari. - (19) |
| pairijien : gamin de l’assistance publique de paris, confié et élevé dans une famille du morvan - (37) |
| pairijien grôs-bé : « vrai » parisien en vacances, un peu vantard - (37) |
| Pairis. Paris, la grand' ville. Les enfants trouvés sont souvent appelés petits Paris parce qu'ils nous viennent de la capitale. - (08) |
| pairisienne. Parisienne, enfant trouvé du sexe féminin, et par extension, toute fille venue de Paris et nourrie dans le pays. - (08) |
| pairlanter, v. a. parler français, parler avec affectation dans un autre langage que celui du pays. - (08) |
| pairlé, parler ; â ! n'm'an pairlë pâ, locution signifiant : inutile de me le dire ; je ne le sais que trop ! - (16) |
| pairlement, s. m. bavardage, parlage, manière de parler. On dit d'un bavard que c'est un « pairlement » sans vacances. - (08) |
| pairler (v.t.) : parler - (50) |
| pairler, v. n. parler : « pairlé-lu chu vô v'lé », parlez-lui si vous voulez. - (08) |
| pairlottes : conversations - (37) |
| pairoïl, oïlle, adj. pareil, le. - (17) |
| pairôlai et paroler. : (Pat. et dial.), parler. - (06) |
| pairole (n.f.) : parole - (50) |
| pairole. Parole. paroles. - (01) |
| pairôllai, parler, accumuler des paroles... - (02) |
| pairoû : paroir (outil de sabotier) - (48) |
| pairquet : bal champêtre - (37) |
| pairt, s. f. part, portion. La part est un gros morceau de lard qu'on sert après la soupe et que les convives se partagent entre eux. - (08) |
| pairtaigeou, ouse, adj. partageux, euse. - (08) |
| pairtaiger : partager - (48) |
| pairtaiger, v. a. partager, diviser en plusieurs parts. - (08) |
| pairticuhié, adj. particulier. - (08) |
| pairu (p.p.) : p.p. du verbe paraître - (50) |
| pais (adv.) : puis - (50) |
| pais (on) : pis - (57) |
| pais ou paie - peau. - I ai vendu ine paie de laipin cin sos ; tôjeur âtant. - Voiqui ine jolie paie de renair qui beillerons ai mossieu le curai. - Ceute jeune feille n'é pâ lai paie fine. - (18) |
| païs, sm, pays. - (17) |
| paisible : s. f., justice de paix. A rapprocher de corrigeante. - (20) |
| paislai, dépaislai – écorchai, peler. - Voyez Depaislai. - I l'ai trouvai, vos ne saivez pâ ai quoi ?... â paislo in chait pou le méger. - Al é dépaislai ine serpent ai pu al é mis lai paie âtor de son bâton. - (18) |
| paisque : parce que - (48) |
| paissaige (n.m.) : passage - (50) |
| paissaige : n. m. Passage. - (53) |
| paissaige, s. m. passage. - (08) |
| paissé : passé, déteint - (37) |
| paissè : v. i. Passer. - (53) |
| paissea. : Échalas pour la vigne. Du latin paxillus (Var. et Colum.). [Quich.] - (06) |
| paisseau (pé-çô) pessiau (Chal., Br.), paissia, pàchia (C.-d.), péchais (Y.). - Echalas pour la vigne ; du même mot paisseau usité en vieux français et venant de paxillus, pieu ; est employé ailleurs, mais ne se prononce qu'en Bourgogne correctement suivant sa forme ancienne. - (15) |
| paisseau : tuteur, échalas - (48) |
| paisseau et paissiâ. Support de la vigne, échalas. J’airons besoin de deux jaivelles de paissiâs pour fini not' ordon. Ce mot me parait venir de paxillus, petit pieu. On a dit anciennement palisseau. Le mot pal est resté dans le langage héraldique... - (13) |
| paisseau, n.m. échalas pour la vigne. - (65) |
| paisseau, pieu. - (04) |
| paisser (v.t.) : passer - (50) |
| paissiau : échalas, paisseau. Les tomates ont besoin d'un passiau : les tomates ont besoin d'un tuteur. - (33) |
| paissiau, paisseau. n. m. - Échalas. - (42) |
| paissieau : échalas. I, p. 19-1 - (23) |
| paissieu, adj. paresseux. - (08) |
| pait’lot : personne mal habillée - (37) |
| paitaîll’ries : ragots, bavardages colportés - (37) |
| paitaîlle, paitaiyou, paiteûille, paitoûillou : femme, homme bavards, qui colportent tous les ragots du village - (37) |
| paitaîller, paitoûiller : bavarder à outrance - (37) |
| paitairouf (en) : tout sens dessus dessous - (37) |
| paite, patte ; se dit familièrement pour la main et le pied ; le français a conservé cette signification dans ces mots : marcher à quatre pattes. - (16) |
| paite, sf. patte. - (17) |
| paite. Patte, pattes. Paite, de même qu'en français patte, se dit burlesquement pour la main. - (01) |
| paitelingué, vn. piétiner ; faire de petits pas. - (17) |
| paitenaille - panais, quelquefois légumes en général. - Chez nô i n'eumons pâ tré-bein les paitenailles. – Des paitenailles dans lai potée, ce n'â pas mauvais du tot, çi beille in gout qui pliai. - (18) |
| paitin, ,sm. patin. - (17) |
| paitogé, vn. patauger. - (17) |
| paitotes - pommes de terre. Pas bien usité. - Te sais ce que ç'â, des paitotes ? Ci ressemle pas mau és treuffes : ci se fait cueure lai moinme chose, ma c'â trop doucin, trop sucrai. En aipeule cequi en français, i croi, des patates. - (18) |
| paitouille, goûille : boue fluide - (37) |
| paitoûillou, goûilloux : boueux - (37) |
| paitraic’er : marcher à tort et à travers en causant des dégâts - (37) |
| paitraiç’ou : celui qui « paitraiç’e » partout, bon à rien - (37) |
| paitraique (âte) : (être) malade - (37) |
| paitrouillé, vn. patrouiller. - (17) |
| paitte (aine) : (un) torchon à vaisselle, une serpillère - (37) |
| paittier (l’) : (le) chiffonnier - (37) |
| paittou : se dit d’un animal qui a les pattes ou velues ou emplumées - (37) |
| paîtue. n. f. - Prairie, pâture. - (42) |
| paîtue. s. f. Pâture. - (10) |
| paîtuser. v. - Paître ; altération de pâturer. (Saint-Martin-sur-Ouanne, selon M. Jossier) - (42) |
| paîtuser. v. a. et n. Paître. (Saint-Martin-sur-Ouanne). - (10) |
| paivé (n.m.) : pavé - (50) |
| paivé, sm. pavé. - (17) |
| paix. La partie du porc qui se trouve près de l’épaule. C'est le paleron décrit dans les livres de cuisine. - (13) |
| paix-aixe. En paix et à l’aise. - (01) |
| paizaise. :-En paix et à l'aise. C'est une heureuse combinaison de mots pour exprimer deux idées qni s'associent si bien. En effet vivre paizaise c'est vivre dans le contentement de la paix. - (06) |
| paja : s. m. vesce sauvage qui pousse dans les blés. - (21) |
| pajau, espardjau n.m (du v.f. pasiau, pois). Vesce sauvage. Voir dzardeuillerie, brontsires. - (63) |
| pâké, pâquy, pasquier, pré où l'on mène paître le bétail. - (16) |
| palai, la première brève. Parler, parlé : Ai ne fai que palai, il ne fait que parler ; quand vos airé palai, quand vous aurez parlé ; tué bé palai, tu as bien parlé. Palai, la dernière longue est substantif, c'est palatium on palatum. - (01) |
| palalau, adj. grossier, lourd et sans éducation. - (22) |
| palan. Parlant. - (01) |
| palanche : s. f., pelle de terrassier. - (20) |
| palanche, perche, levier de bois. - (05) |
| palanche, s. f., perche, levier. - (14) |
| palatine. n. f. - Pélerine, manteau sans manches couvrant les épaules. - (42) |
| palatte : Battoir dont les laveuses se servent pour battre le linge. - Omoplate, épaule de porc. « La palatte fa in ban reuti » : l'épaule de porc fait un bon rôti. - (19) |
| palatter : Battre le linge à coup de palatte. « Alle a le bré entemi d'avoi palatté tote la jornée » : elle a le bras engourdi d'avoir battu le linge toute la journée. - (19) |
| palaud, lourd, gros, rustre. - (05) |
| pale : pelle à enfourner. IV, p. 29-h - (23) |
| pâlé, vn. parler. - (17) |
| pale. Parle, parles, parlent. - (01) |
| palé. Parlez. - (01) |
| palegaud : s. m. Lever le palegaud, tomber à la renverse. A rapprocher du surnom d'une Tournusienne en 1478 : La Paligaude (Archives dép. de la Côte-d'Or, B. 11592, f° 37). - (20) |
| pâler. v. a. parler. - (08) |
| palerée : pelletée. VI, p. 43 - (23) |
| paleron : montant supportant les ridelles (darêches*) d'un char. A - B - (41) |
| paleron : gros bâton pour les vaches - (43) |
| paleron : s. m., petit pal, pieu, spécialement le levier de bois à l'aide duquel on serre les cordes d'un char enroulées autour du treuil situé à l'arrière. - (20) |
| paleron, palgot : carcan placé autour du cou des chèvres pour les empêcher de passer à travers les haies - (43) |
| palesson, paleusson : barreau d'échelle - (43) |
| palesson, palisson. n. m.- Petite latte en bois, posée sur les solives pour en couvrir le vide, avant la pose d'un plancher en terre. - (42) |
| palesson. s. m. Chacun des petits fentons de bois posés en travers des solives d'un plancher pour en couvrir le vide, et sur lesquels on étend la terre destinée à former la première couche de l'aire où doit être assis le carrelage. On écrit aussi palson et palisson. - (10) |
| palessonner. v. - Poser les palessons. - (42) |
| palessonner. v. n. Poser les palessons d'un plancher. - (10) |
| palet, disque de pierre avec lequel jouent les enfants... - (02) |
| paléte, s. f., petite pelle, et battoir des laveuses, avec lequel elles battent le linge sur leur selle. - (14) |
| paleton : s. m., paleron, partie de l'épaule des animaux qui entoure l'omoplate. - (20) |
| paletot : veste - (44) |
| paletot sans manches : s. m., cercueil. Voir complet. - (20) |
| paletot : veste. Ex : "Boutonne ben ton paletot, n’y fait pas chaud !" - (58) |
| palette : omoplate. - (32) |
| palette : s, f., vx fr., battoir de laveuse. - (20) |
| palette, n.f. battoir pour le linge. - (65) |
| palette, s. f. on donne ce nom aux dents incisives parce qu'elles sont larges et en forme de petites pelles. - (08) |
| palette. n. f. - Visière de casquette. (Bléneau, selon M. Jossier) - (42) |
| palette. s. f. Visière de casquette. (Bléneau). - (10) |
| paleusson : tige de bois servant à actionner le tour de serrage des chars à foin - (51) |
| paleut : Palet, pierre plate qu'on lance vers une pierre plus grosse qui sert de but au jeu de palets. - (19) |
| paleute n.f. Battoir à lessive. - (63) |
| palfeùrmier, s. m., palefrenier. - (14) |
| palfeurnai : brosser, étriller, curer, rogner les pieds, soigner des animaux de trait. - (33) |
| palfeurnè : v. t. Soigner des animaux de trait. - (53) |
| palgau : (nm) triangle de bois pour empêcher les chèvres de traverser les haies - (35) |
| pâli : Pâlir. « La malèdie l'a fait pâli » : la maladie l'a fait pâlir. - (19) |
| Pali, Paliche. Synonyme patois de Pierre, Pierrette. - (13) |
| pâlichan : Pâlot. « Tan ptiet est dan bin pâlichan ? - Y est qu'ol a été malède » : ton enfant est bien pâlot ? - C'est qu'il a été malade. - (19) |
| paliche : Couche dure sous un objet : semelles, gâteaux, etc. ». Y a des paliches seu mes sulés (sous mes souliers) ». - (19) |
| palichon : pale - (44) |
| palière : s, f., vx fr, palier, pal, pieu. Pièce de bois qui sert à la manœuvre du pressoir. Voir pressoir à grand point et gosanche. - Pièce de bols qui entre dans la composition du char. Voir char. - Arrachoir pour ceps do vigne el autres arbustes. C'est un levier du second genre, dont une extrémité prend son point d'appui sur le sol, tandis que l’autre est soulevée par l'opérateur. Entre les deux extrémités, près du point d'appui, il y a une chaîne ou un crochet qui saisit le pied à arracher. Voir pèse. - (20) |
| palifre : graisse superflue - (48) |
| palifre. s. f. Gros morceau de pain. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| palire : montant qui supporte les daraises, les ridelles d'un char - (43) |
| palire : montant qui supporte les ridelles d'un char - (34) |
| pâlîre n.f. Pièce de bois ou de métal soutenant les darêches d'un char. Il y avait en général 4 pâlîres (aux quatre coins) et deux demi-pâlires (au milieu des côtés longs) sur un char. - (63) |
| palire, s. f. pièce de bois chargée de soutenir les ridelles d'un char. - (24) |
| palis. Pieu, lames de bois formant palissade. - (49) |
| palissadier : s, m., pieu de soutien entrant dans la construction d'une palissade. - (20) |
| palisse, s. f., haie, palissade vive. - (14) |
| palistre, jeu d'enfant. - (16) |
| palle : pelle - (51) |
| palle. s. f. pelle. - (08) |
| palle. s. f. Pelle. (Avallonnais). - (10) |
| paller, v. a. pelleter, travailler avec la pelle. - (08) |
| palliaire.s. f. Couverture de livre. S'entend surtout des enveloppes de papier, de parchemin ou d'étoffe, dont on recouvre la couverture d'un livre pour la garantir. (Plessis-Saint-Jean). – Du latin palliaria, palliarium, diminutif de pallium, manteau. - (10) |
| pallon, parpallon, sm. mauvais lit de paille. - (17) |
| palmenter (pairlenter) : parler français - (39) |
| palonné, s.m, , pièce de bois pour atteler les chevaux. - (40) |
| palotte : battoir de laveuse. (VSLD. T II) - S&L - (25) |
| palotte, s. f., battoir de la laveuse. - (40) |
| pâlou : Pâleur. « Alle est d'eune pâlou à fare peu (peur) ». - (19) |
| palpitoué. s. m. presbytère, maison du curé de la paroisse. - (08) |
| palpoïlli v. (vx.fr. palpoïer) v. Palper, peloter. On emploie surtout tartoïlli. - (63) |
| palpouille : s, f., palpation, pelotage. - (20) |
| palpouiller : v. a., vx fr. palpoier, fréq. de palper, peloter. - (20) |
| palron n.m. Levier de fer servant à manoeuvrer le tour ou le treuil du char. Il s'agit en fait de la tavelle alors que ce mot désigne à Sivignon un gros bâton et non le levier de tension. - (63) |
| paltoquai, paysan couvert d'une espèce de manteau de grosse laine appelé paltôk (racine, pallen, couverture , et toêk, laine, toison.) ... - (02) |
| paltoquai. Paysan, paysans ; palietoc est une casaque de paysan… - (01) |
| paltôquai. : Valet ainsi désigné du nom de sa tunique ou pourpoint, un paletoc. (Del.) - (06) |
| paltôt n.m. Veste. - (63) |
| pal'tôt : n. f. Veste. - (53) |
| pameroles : pièce d'un chariot - (39) |
| pamnâs (n.m.) : panais - (50) |
| pamne (n.f.) : épante ; échelle fixée entre deux poutres pour y placer le pain - (50) |
| pamner (v.t.) : balayer - (50) |
| pamniau, pangniâ (n.m.) : vieux morceau de tissu, vêtement démodé - (50) |
| pamô : beaucoup. (B. T IV) - S&L - (25) |
| pampille. s. f. Accroc. De pampe, fleuron. Par une sorte d'ironie, les pampilles, les accrocs, sont les fleurons, les bouffettes qui relèvent les vêtements du pauvre. (Percey). - (10) |
| pampillon : papillon. - (29) |
| pampillon, parpouillon (n.m.) : papillon - (50) |
| pampillon. Papillon. - (49) |
| pampiÿon, s. m., papillon. - (14) |
| pampoulette : voir barboulotte - (23) |
| pamprée (n.f.) : panais sauvage - (50) |
| pamprée (n.f.) : panais sauvage (de Chambure orthographie panprée) - (50) |
| pan (ai), adv. exprime le superlatif de la plénitude, de la régularité, de la continuité. Des blés ai pan, ène pleue ai pan, de beaux blés, une pluie abondante. - (17) |
| pan (charger au pan de la roue) : culbuter l'arrière du chariot qui tourne sur la logne pour engager une grosse pièce de bois et relever ensuite les roues. La pièce se trouve chargée. (VDS. T IV) - VdS - (25) |
| pan (en), loc. en chemise. Voir cu paniche. - (17) |
| panâ : Berle, heracleum spondillum, plante ombellifère qui croît dans les prés fertiles et peu humides. - (19) |
| panâ, s. m. panais sauvage ou petit panais. - (08) |
| panachére ou panechire : Paille de maïs. - Plante sauvage croissant dans les champs, dont la forme rappelle le millet (pané). - (19) |
| panaï, panaille, s.m. panier. - (38) |
| panaïl, s. m., panier. - (40) |
| panaille : épi de maïs. Ou panouille. Du latin : panacula. - (62) |
| panaille. Épi de maïs, panouille dans l'Autunois. - (49) |
| panaillon : rafle d’épi de maïs. C’est l’épi débarrassé de ses grains. (Combustible, rustique, recherché pour démarrer un feu). - (62) |
| panaillon, panouillon. Panouille petite, mal venue. Ce qui reste de la panouille une fois égrenée. - (49) |
| panais : s. m., millet (panicum italicum). - (20) |
| panaque ! interjection. Qui se pousse à la vue d'une chose dégoûtante, hideuse. (Sommecaise). - (10) |
| panaque : boiteux, difficulté à marcher. - (33) |
| panâs n.m. Panais. - (63) |
| panàs, et pànes, s, m., vieux linges, vieux vêtements, torchons, chiffons. - (14) |
| pancher : v. a., vx fr., épancher. Pancher de l'eau (pisser). - (20) |
| pancher, v. tr., épancher, répandre : « Ol a panché tout son siau par terre. » Se dit aussi pour : Satisfaire un petit besoin naturel. L'ivrogne sort du cabaret pour pancher de l'eau. - (14) |
| pançon : s. m. tonneau contenant 2 pièces de vin. - (21) |
| pandan. Pendant. - (01) |
| pandouiller : pendre - (44) |
| pandrouillè : pendre d'une manière disgracieuse - (46) |
| pané : Panier. « In pané de vendanges » : panier allongé et peu profond à une seule anse, dont se servent les vendangeurs. « In pané de marchi » : panier plus long et plus plat que le panier de vendanges et dans lequel les femmes de la campagne portent au marché le beurre, les œufs, le fromage. - (19) |
| pané : s. m. panier. - (21) |
| pané, v. a. essuyer. - (22) |
| pane. Panne. - (01) |
| paneau (na) - voûlée (na) : gifle - (57) |
| paneau : s. m., bas-lat. panellus, ancienne mesure de capacité pour les grains, en usage à Cluny. D'après un procès-verbal de 1568, le paneau contenait quatre quarterons, et le quarteron, appelé aussi boisseau, contenait trois coupes (Archives dép., II. 4, 3). - (20) |
| panée, s. f. gifle : gare à la panée ! - (24) |
| panée, s. f., panade, soupe qu'on prépare volontiers pour les enfants. - (14) |
| panée, sf. panais. - (17) |
| panées s. f. gifle. - (22) |
| panelle ! : exclamation un peu insultante - (39) |
| paner : balayer (surtout en pays Montcelien). A - B - (41) |
| paner : (prononcer : pan - ner). Tremper du pain dans la sauce, ou nettoyer à fond son assiette avec le pain. Ex : "T'as pas fini d'pan-ner ? Té vas ben user moun' assiette !" - (58) |
| panère : Grand panier, sorte de manne en osier, son contenu « Eune panère de linge ». - (19) |
| panére : grande corbeille à deux anses, en osier. - (62) |
| panerote : corbeille pour mettre le pain à lever - (48) |
| paneté : Panetier, celui qui distribue aux gens de la noce le pain et les gâteaux. - (19) |
| pane-ti : huche à pain - (43) |
| panetier : officier de la couronne qui avait autorité sur les boulangers de France. - (55) |
| panetier : s. m., huche à pain. - (20) |
| panetot : Paletot. « Le panetot à Mile » : le paletot d'Emile. - (19) |
| paneu : s. m. maïs. - (21) |
| paneuillan : Epi de maïs dépouillé de son enveloppe et de ses grains. « In chétiau de paneuillans » : construction que bâtissent les enfants en disposant les paneuillans comme on dispose les biscuits sur une jatte ou une assiette. - (19) |
| paneuille : Epi de maïs. « Eune paneuille de treuquis » : un épi de maïs. - (19) |
| pang’yons : (nmpl) appendices charnus des chèvres - (35) |
| pan-gna : paresseux. (LCSS. T IV) - S&L - (25) |
| pangnâ : un minus, un homme négligeable - (46) |
| pangnâ : n. m. Mal habillé. - (53) |
| pangnâ, homme mal mis qui passe son temps à flâner au lieu de travailler. - (27) |
| pangnau, subst. masculin : chiffon, harde. - (54) |
| pangnau. Femme malpropre, mal habillée, sans soin. - (49) |
| pangneau (nom masculin) : vêtement mal ajusté. - (47) |
| pangnia : bon à rien. - (66) |
| pangniâ, lambeaux de vêtement usé ; se dit aussi de ceux qui portent des vêtements déchirés. - (16) |
| pangnia. Fainéant, mal vêtu. I ne pouvons pas te garder chez neus. Quai qu’i ferins d'un grand pangniâ quemant toi. - (13) |
| pangniâ. Homme déguenillé, mal mis, dont les pans des vêtements sont en loques ; au figuré homme sans soins, paresseux. - (12) |
| pangniâs : mendiant, déguenillé. - (32) |
| pangniât : guenille, déguenillé (personne) - (48) |
| pangniât : un déguenillé, être vêtu comme un pangniât : mal habillé, attiffé, négligé. - (56) |
| pangnio : habit démodé - (44) |
| pangueuille : nippes - (43) |
| panguion, s. m. qui pend. Verbe pangyi. - (24) |
| panguœllion, s. m. qui pend. Verbe : panguœlli. - (22) |
| panhnio : personne mal habillée. A - B - (41) |
| panhnioder : amuser un bébé en le faisant sauter sur les genoux. A - B - (41) |
| pani : (nm) panier, muselière pour les veaux - (35) |
| pani : panier - (43) |
| pani : panier - (51) |
| panî n.m. Panier. - (63) |
| pani, musiau : muselière pour les veaux - (43) |
| paniauder, poniauder : amuser le bébé en le faisant sursauter - (43) |
| paniaux, et pan-nlâs, s. m., haillons, vieux vêtements : « Alle é braque, ma fi ! all'còrt les rues en paniaux. » - (14) |
| Panicher : nom de cheval. VI, p. 16 - (23) |
| panichet : s. m. le pied de maïs quand on a cueilli la panoille. - (21) |
| panichet. Feuille de maïs. On dit aussi pénichet, par corruption de panicule. - (03) |
| panichets, panissets, et panechats, s. m., feuilles qui forment l’enveloppe de la grappe de maïs, et qu'on enlève en échaillant. - (14) |
| panier d'mouches : ruche. IV, p. 25 - (23) |
| panière : s. f., vx fr., panier ou corbeille d'osier munie d'anses à ses deux extrémités ou même dépourvue d'anses. - (20) |
| panière, s. f. grand panier rond à deux poignées. - (22) |
| paniment, pendant. - (11) |
| panire : panière - (51) |
| panîre n.f. Panière. - (63) |
| panire, s. f. panier plat pour le marché. - (22) |
| panis. s. m. pl. Terme enfantin. Petits pieds, petons. (Lainsecq). - (10) |
| panishai (du) : paille de maïs. - (62) |
| panisset, paille de maïs, de panis. - (05) |
| panissets : pailles de maïs. (CH. T II) - S&L - (25) |
| panlires : (nfpl) chasse-mouches pour les vaches - (35) |
| panlires : rideaux pour chasser les mouches - (43) |
| pan'nâ : panais - (48) |
| pan-na : balayer. (S. T IV) - B - (25) |
| pannaige, s. m. pannage ; pâturage assuré à certains animaux, aux moutons principalement, pour un prix convenu. - (08) |
| pânnais - injure à un enfant qui est malpropre, mal tenu. - Ote tai don, pânnais que t'é ! - Chienne de pânnais, vais ! - Se dit aussi assez souvent pour panais. - I ons fait ine plianche de pânnais. - (18) |
| pannaure. s. f. balai. - (08) |
| panne (aivoère de lai) : avoir du ventre - (39) |
| panne blanche : poumon du porc - (39) |
| panne noère : foie du porc - (39) |
| pan-nè : v. t. Balayer. - (53) |
| panne, s. f. étoffe. au fig. avoir de la « panne », être gras, avoir des formes dodues. - (08) |
| panne, s. f. planche sur laquelle on dépose les pains. On prononce « pân-n'. » (voir : paingnée, pante.) - (08) |
| panne. Fanon de bœuf. - (49) |
| panneau (n.m.) : habit du dimanche - (50) |
| panneau, s. m. vêtement, habillement. Le « panneau » est l'habit des dimanches, des jours de fête : « a vé don s'mairié ojed'heu qu'al é mettu son panneau. » - (08) |
| panneau. Plumeau. II est vraisemblable que ce mot est resté tout droit de penna, dans le bourguignon. - (12) |
| pannée : plante : ombrelle, panais. Les lapins aimont les pannées : les lapins aiment les panais. - (33) |
| pân-née : n. f. Plante ombrelle-panais. - (53) |
| pan-née : panais sauvage - (39) |
| pânnées, s. f. pl., euphorbe sauvage. - (40) |
| pannemaim : s. m., vx fr. panemain, essuie-main. - (20) |
| panner (prononcez pan-ner). v. a. Essuyer, frotter. On panne les meubles avec un torchon. - (10) |
| panner (se), se torcher avec un linge. - (05) |
| panner (verbe) : balayer. - (47) |
| panner : balayer. (RDM. T II) - B - (25) |
| pan-ner : (pan-nè - v. trans.) balayer. I vâ: pan-nè lè mâ:yon:, "je vais balayer la maison (=la cuisine)". - (45) |
| pan-ner : balayer la maison - (39) |
| panner : v. a., vx fr. paner, torcher, essuyer avec un linge. - (20) |
| pan-ner, v. ; balayer. - (07) |
| panner, v. a. balayer, nettoyer : « sai mâion ô bin pan-née », sa maison est bien balayée. - (08) |
| panner, v. a. essuyer : panner la table (du vieux français panne, torchon). - (24) |
| panner. v. - Essuyer, frotter. Se prononce pan-ner. - (42) |
| pannevere, haillon de diverses couleurs (pannus varius), panouère, balai, haillon, tout objet propre à essuyer, à balayer. - (04) |
| pannèze, s. f. cloison en planches. - (08) |
| panniau, n.m. chiffon. - (65) |
| panniau. Haillon, du vieux mot peneaux. - (03) |
| pan-niaud : personne mal habillée - (34) |
| pañniaud n.m. Pan de chemise. - (63) |
| pan-niauder : amuser un bébé en le faisant sursauter - (34) |
| pañniauder v. Traîner en pans de chemise. - (63) |
| pannière : corbeille en osier ayant deux ouvertures pour y passer les mains. (TSO. T III) - D - (25) |
| pannion, s.m. mauvaise pièce d'étoffe qui pendloque. - (38) |
| pânno - pan de chemise. - Ainsi que dans le mot pânnais, prononcez la première syllabe pan et non pas panne. - Al éto devant son lei tot simplement en pânno. - Ma, mon enfant, en voit le pânno de tai chemie que passe pou darré. - (18) |
| pannô ( prononcez panneu ), être en pannô signifie être en chemise et tout à fait à son aise. Il vient du latin pannus, lambeau d'étoffe. - (02) |
| pannô. : (Être en), c'est-à-dire être en chemise. (Du latin pannus, lambeau d'étoffes.) - (06) |
| pannoche, s. f., serpillière ou chiffon pour nettoyer le sol. - (40) |
| pan-noére : (pan-nô:r - subst.f.) balai. - (45) |
| pan-noére : balais - (39) |
| pannosse, étoffe vaine, sans consistance. - (05) |
| pannouaire (nom masculin) : balai. - (47) |
| pannoué. n. m. -Torchon. Se prononce pan-noué. - (42) |
| pannouère (pan-nouère), s.f. morceau d'étoffe qui pend. - (38) |
| pannouére, s. f. balai. (voir : pannaure.) - (08) |
| pannourot (nom masculin) : petit balai. - (47) |
| pannourot, s. m. petit balai de cheminée. - (08) |
| panœ, s. m. maïs. - (22) |
| panoille : s. f. : épi de maïs. - (21) |
| panoïlle n.f. Epis de maïs avec l'enveloppe. - (63) |
| panoillon : s. m. ce qui reste de la panoille, quand on l'a égrenée. - (21) |
| panoïllon n.m. Goupillon constitué d'un manche à l'extrémité fendue en 4 avec des grandes feuilles de maïs insérées à angle droit dans ces fentes puis liées ensemble près du manche. Cet instrument était utilisé pour laver la vaisselle jusqu'à l'arrivée des brosses et des éponges. - (63) |
| panosse : balai à long manche servant à balayer les cendres du four à pain. A - B - (41) |
| panôsse (Chal.). - Haillon, vieux linge, chiffon ; se dit aussi d'une personne molle, efféminée, qui est comme une chiffe. Vient de panne, ancien mot signifiant vêtement, qui a formé pennon, et que l'on emploie encore en français pour désigner une étoffe imitant grossièrement le velours. - (15) |
| panosse (n.f.) : balai à long manche pour enlever les toiles d'araignées - (50) |
| panosse : (nf) fille molle, sans énergie - (35) |
| panosse : balai à long manche servant à nettoyer la cendre du four à pain - (34) |
| panosse : Paresseux, fainéant. « Remue te dan, grande panosse » : remue toi donc grand fainéant. - (19) |
| panosse n.f. 1. Torchon. 2. Individu mou et paresseux. 3. Péj. Fille qui a grandi trop vite. - (63) |
| panosse : s, f., vx f r., torchon ; au fig., individu mou et paresseux. - (20) |
| panosse, panosson. Sorte de balai, à très long manche, formé d'un paquet de vieux chiffons, employé pour balayer le four avant d'enfourner le pain. Fig. Femme de tenue négligée. - (49) |
| panosse, s. f., personne paresseuse, mollasse, sans caractère : « Que grande panosse ! a' n'fiche ran tout l’long du jor. » — « Jacot travaille, lu ; mâ, toaé, feignant, t'né qu'eùne vieille panasse. » C'est l'acception figurée du mot précédent. - (14) |
| panosse, s. f., vieux linge, mauvais chiffon, torchon. - (14) |
| panosser : v. a., torcher, essuyer avec une panosse. - (20) |
| panouche (nom féminin) : longue perche servant à nettoyer le four à pain avant d'enfourner. On dit aussi penouffe. - (47) |
| panouche : voir gaudre - (23) |
| panouille (Chal.), penouille (C.-d., Br.), penaille (Y.). - Epi de blé de Turquie (maïs), dans toute la Bourgogne, sauf dans l'Yonne où ce mot désigne l'épi de l'avoine. Vient par corruption de panicule, dont l'étymologie est le latin panicum ou panicula, fleurs en grappe. Littré cite ce mot avec le même sens comme faisant partie du patois autunois. Le verbe épanouiller exprime l'action de défaire les épis de maïs de leur enveloppe. - (15) |
| panouille : épis de maïs - (44) |
| panouille : mot féminin désignant un épi de maïs avec le grain. On dit aussi eune messe - (46) |
| panouille : n. m. Épi de maïs. - (53) |
| panouille : s. f., épi de maïs ; pied de maïs ; par analogie, grappe de raisin à grains très serrés. - (20) |
| panouille, n.f. épi de maïs. - (65) |
| panouille, penouille, et paneille, s. f., grappe de maïs mûre. Le paysan a parfois abondance de mots. - (14) |
| panouille, s. f. épi de maïs. Diminutif : panouillon. - (22) |
| panouille, s. f., maïs, (sur -pied). - (40) |
| panouille. Épi de mais dépouillé de ses grains et destiné à être brûlé. Au n'y ai ran de si commode que les panouilles pour aillemer son feu. A rapprocher de panache, etc. Du latin panicula. - (13) |
| panouillon : lavette - (35) |
| panouillon : s. m., syn. de touillon, bâton portant à son extrémité un chiffon de panosse ou des cordelettes de chanvre, et qui sert à laver la vaisselle ou autre chose. - (20) |
| panouillon, et penouillon, s. m., grappe de maïs qui n'a que quelques grains mal venus, ou qui n'a pu mûrir. Dimin. de Panouille. - (14) |
| panouillon, s. m., épi de maïs. - (40) |
| panoutes. s. m. pl. Pieds. Terme enfantin. (Saint- Valérien). Voyez panis. - (10) |
| panoye : épi de maïs. A - B - (41) |
| panoye : (nf) épi de maïs - (35) |
| panoye : épi de maïs - (34) |
| panoye : épis de maïs - (43) |
| panòye, f. épi de maïs. diminutif panòyon. - (24) |
| pano-ye, s.f. épi de maïs. - (38) |
| panoye, panoyon : épi de maïs égréné. (CH. T II) - S&L - (25) |
| panpillon, s. m. papillon. - (08) |
| panpivöt, sm. papillon. - (17) |
| panprée, s. f. panais sauvage qui abonde dans certains prés. En quelques lieux, la même plante est nommée « golle. » |
| pansadze : pansage (nourrir les bêtes) - (43) |
| pansâdze n.m. Pansage. - (63) |
| pansage (faire le), loc. s'occuper du repas du bétail. - (24) |
| pansage (nom masculin) : action de panser. - (47) |
| pansage : s. m. soins donnés aux bêtes quand elles reviennent des champs. - (21) |
| pansaige : n. f. Pansage. - (53) |
| pansan : Tonneau, fût. « J'ai ageté in pansan » : j'ai acheté un tonneau. - (19) |
| panse d'oueille (n.f.) : cornemuse - (50) |
| panse d'ouéille : cornemuse - (48) |
| panse, s. f. cornemuse, dite également « panse de beurbis », parce que l'instrument dont il s'agit est ordinairement fabriqué avec la peau du ventre d'un mouton. |
| pansé. Pensez. - (01) |
| pansement, s. m. pansage des animaux ; soins et nourriture donnés aux bêtes à cornes, aux chevaux, etc. - (08) |
| panser (verbe) : nourrir le bétail à l'étable. - (47) |
| panser : on dit panser pour le travail effectué matin et soir pour les animaux (nourrir, nettoyer le fumier, renouveler la litière, etc…). - (59) |
| panser lâs bêtes : leur donner leur nourriture quotidienne, le « pansage », leur « remplir la panse » - (37) |
| panser : v. faire le pansage . - (21) |
| panser, v. a. soigner, nourrir, régaler. - (08) |
| pansereau, gros ventre. - (05) |
| pansero. Gros ventre, diminutif de panse. - (03) |
| panseroo ou pansero. Penserais, penserait. - (01) |
| panseròt, s. m., abdomen saillant. Tout naturellement diminutif de panse. - (14) |
| pansi : donner à manger aux bêtes - (35) |
| pansi : jabot de volaille - (43) |
| pansi n.m. Jabot de la poule. - (63) |
| pansi v. Panser. - (63) |
| pansigot, s, m., estomac, panse. - (40) |
| pansire. Pensâmes, pensâtes, pensèrent. - (01) |
| pansou : pansu - (48) |
| pansou, s. m. panseur, celui qui panse, qui soigne, qui nourrit les animaux. Le féminin « pansouse » est peu usité. - (08) |
| pansou, s. m. pansu, individu à gros ventre, à grosse panse, gourmand, ivrogne. - (08) |
| pansoû, s. m., pansu, gourmand, biberon. - (14) |
| Pant es cabres : Nom propre, lieu-dit de Mancey. Actuellement c'est le « Col des Chèvres ». - (19) |
| pantalet. Sorte d'échasses. Nous disons aussi par corruption des ensaches. - (03) |
| Pantalon. Vénitiens, ainsi nommés à cause de saint Panlaléon leur ancien patron, d'où il est arrivé que les habits faits comme ceux que portent les Vénitiens s'appellent des pantalons. - (01) |
| pantarou : être en colère - (39) |
| pantarou. s. m. Personne en colère. (Tormancy). - (10) |
| pante, épante, s. f. appareil en forme d'échelle qui sert à porter les miches de pain provenant d'une fournée. Cet appareil est ordinairement posé sous les poutres au-dessus de la table à manger. - (08) |
| pantecôte. Pentecôte. - (01) |
| panténe, s. m. grand filet pour prendre les alouettes et autres oiseaux. - (08) |
| pantet : une chemise qui ne se boutonne pas jusqu'en bas - (46) |
| pantet : s, m., pan de chemise. - (20) |
| pantet, s. m., pan de chemise qui sort de la culotte, particulièrement de celle des enfants : « L'toqué ! ô n'sait pu c'qu'ô fait ; ô veint de s'preùm'ner tout en pantet ! » - (14) |
| pântet. Pan, petit pan, plus spécialement le pan de la chemise. - (12) |
| pantillon : (nm) pan de chemise - (35) |
| pantillon : pan de chemise - (43) |
| pantillon n.m. Chemise, pan de chemise. - (63) |
| pantilloñner v. Se déplacer dans la maison en chemise. - (63) |
| pantine, s. f. ancien bonnet de femme qui avait de grandes barbes pendantes. - (08) |
| pantion, s. m., chiffon, morceau de mauvaise étoffe : « Que qu't' veux que j'fasse de tous ces ch'tis pantions ? » (V. Panas, etc.) - (14) |
| pantion, s.m. synonyme de pannion. - (38) |
| pantiot. s. m., loque, mauvaise étoffe. - (40) |
| pantof'ille: Pantoufle. « Eune pare de pantofi'lle ». - (19) |
| pantomine : comédie - (44) |
| pantouillier, débauché, dévergondé. - (05) |
| panuguet, s. m. individu qui affecte le beau langage et qui a des prétentions de plus d'un genre. - (08) |
| panure n.f. Chapelure. - (63) |
| panure : s. f., chapelure. - (20) |
| pao, s.m. échalas. - (38) |
| paôh ! paôh ! : pan ! pan ! - (39) |
| paôrte,s.f. porte. - (38) |
| paour, s. m. lourdaud , pataud : un gros « paour. » - (08) |
| paour. s. m. Lourdaud. - (10) |
| papa, loc. le jeu du « papa » est connu en français sous le nom de marelle. Les joueurs poussent un palet de case en case, sautant sur un seul pied. - (08) |
| papa. Bouillie. - (01) |
| papan : Poupon, bébé. « Dado papan », voir dado. - (19) |
| papelard. s. m. Bavard, beau diseur, qui cherche à tromper avec ses paroles mielleuses. (Charentenaj). – Ce doit être un souvenir de nos guerres de religion. - (10) |
| papeluche. n. f. - Flocon de neige. (Villeneuve-les-Genêts, selon M. Jossier) - (42) |
| papeluche. s. f. Flocon. Des papeluches de neige. (Villeneuve-les-Genêts). - (10) |
| paperòter, v. a. manier malproprement. - (24) |
| paperouté, v. a. manier malproprement. - (22) |
| papéte, s. f., soupe pour les enfants, bouillie. - (14) |
| papeugner (verbe) : manger sans appétit. Faire la fine bouche. - (47) |
| papeugner : chipoter en mangeant - (60) |
| papi : papier - (43) |
| papi : papier - (51) |
| papî n.m. Papier. - (63) |
| papier a pochon : s. m., papier buvard. - (20) |
| papillonné, adj. tacheté de diverses couleurs comme certains papillons. - (08) |
| papinaude, parpinaude. n. f. - Soupe épaisse dans laquelle on ajoute de la farine et du pain. - (42) |
| papinaudée. n. f. - Confiture de prunes. (Saint-Aubin-Château-Neuf, selon M. Jossier) - (42) |
| papinaudée. s. f. Confiture de prunes. (Saint- Aubin-Châteauneuf). - (10) |
| papine. n. f. - Poupée. (Tannerre, selon M. Jossier) - (42) |
| papine. s. f. Poupée. – A Tannerre, se dit pour lapine. - (10) |
| papiôle : Flocon de neige. « I va nagi i commache déjà à cheu quèques papiôles » : il va neiger, quelques flocons commencent déjà à tomber. - (19) |
| papioule : petit insecte (essentiellement papillon de nuit) volant les soirs d'été. A - B - (41) |
| papioule : (nf) flocon de neige ; tâche de rousseur ; petit papillon de nuit - (35) |
| papioulé : (p.passé) moucheté, tacheté - (35) |
| papioulé : personne ayant des taches de rousseur sur le visage - (43) |
| papioule : petit insecte volant les soirs d'été - (34) |
| papioule : petit insecte volant les soirs d'été, tache de rousseur - (43) |
| papioûlé adj. Couvert de taches de rousseur, pioûlé. - (63) |
| papioûle n.f. Papillon, coccinelle, flocon de neige, tache de rousseur. Voir pioûlé. - (63) |
| papioule, papion : flocon de neige - (43) |
| papioule, s. f. flocon de neige. - (24) |
| papiouler : (vb) (humoristique) battre des paupières - (35) |
| papivole. n. f. - Coccinelle. - (42) |
| papivole. s. f. Coccinelle. (Villeneuve-les-Genèts). - (10) |
| papon : (papon - subst. m.) épouvantail. - (45) |
| Papon, nom d'homme. On donne ordinairement ce surnom de fantaisie au plus jeune fils de la famille, au dernier né. - (08) |
| papon, paponne : s. m. et f., nom qui s'applique aux statues de saints ou de saintes, grossières ou grotesques, vieilles ou détériorées, et qu'on appelle dans d'autres pays « babouins ». - (20) |
| papon, paponne, s. poupon, enfant joufflu : un gros « papon », une grosse « paponne. » - (08) |
| papon, s. m. pupille de l'œil : « l' papon dé-z-euillots » , la prunelle des yeux. - (08) |
| papon, s. m., poupon, expression enfantine. - (14) |
| papon. Poupon, terme enfantin. - (03) |
| papone : n. f. Fripouille gentille. - (53) |
| papòne, s. f., poupée. Considéré comme fém. de papon. - (14) |
| papòneau, et papouneau, s. m., personnage dessiné, gravé, émaillé, sculpté, ou découpé : « V'là d'jolis papòneaux dans c'cadre. » — « J'li ai baillé eùne vieille aissiéte où y avôt des papòneaux. » — « Vous savez ben, son ormoire avec des papòneaux taillés d'ssus. » Dimin. de papon. (V. Papounòt.) - (14) |
| paponne - poupée. - Teins, mon enfant, voiqui ine jolie paponne, que ç'â tai marraine qui te lai beille. - Haibille bein tai paponne, les petiotes feilles eumant bein cequi. - (18) |
| pâpote, pâpoute, bouillie que l'on donne aux petits enfants. - (16) |
| papôte. Potage d'enfant. C'est un terme enfantin comme papa. - (01) |
| papôte. : Bouillie pour un enfant. (Del.) - (06) |
| papotte, papoue, papoute. s. f. Soupe, bouillie, panade pour les petits enfants. - (10) |
| papoue, papotte. n. f. - Soupe (terme enfantin). - (42) |
| papoulette : voir barboulotte - (23) |
| papounôt, s. m., synon. de papòneau, mais pris dans un sens péjoratif. Statue grossière taillée au couteau, dessin informe : « C'marmot-là, à l'école, au lieur d'étudier, ô fait des papounòts su tous ses liv'es. » (V. Papòneau.) - (14) |
| papoute (ā), sf. soupe d'enfant. - (17) |
| papoute, autrement poupoute. - Voyez ce mot. - (18) |
| papoute, et poupoute, s. f., soupe d'enfants : « Allons, p'tiot, y é temps ; veins miger la papoute. » - (14) |
| papoute, s. f. soupe, terme mimologique dont on se sert en parlant aux bébés. en plusieurs lieux « popote. » - (08) |
| papoute. Panade ou bouillie pour les nourrissons. Onomatopée enfantine, comme baba, bobo, dada, maman, papa, pipi, etc. - (13) |
| papoute. Soupe, terme enfantin. - (03) |
| paquai. Paquet, paquets. - (01) |
| paquant(e) : romanichel - (39) |
| paqué, v. a. barrer le passage : paque-le ! - (22) |
| pâqueil : un pâquis, un pâturage, on dit également pâquiè - (46) |
| paqueilles. s. f. Racines de chanvre, résidus de chanvre et d'herbes sèches réunis en tas, auxquels on met le feu. (Elivey). - (10) |
| pâquer : (vb) retenir une bête, lui barrer la route - (35) |
| paquer : retenir les bêtes, leur barrer la route - (43) |
| paquer v. 1. Stopper, arrêter les bêtes. 2. Attraper au vol : y'est çhtu qu'vint d'paquer la paute. - (63) |
| paquer : v. a., attraper, « écoper ». Paques-y donc. C'est mol qui vas paquer pour toi. Voir rapaquer. - (20) |
| paquer, v. a. barrer le passage : paque-le ! - (24) |
| pâquerette : primevère. VI, p. 37-2 - (23) |
| Pâques (pâques) : s. f. pl. Faire ses Pâques, se dit du vin nouveau au premier soutirage, qui a lieu généralement après six mois, c'est-à-dire vers Pâques. On peut alors mieux juger de ses qualités et de ses défauts. - (20) |
| Pâques : Pâques. « Fare ses Pâques » communier. « Pâque flieurie » : le dimanche des Rameaux. « Pâque na » : le dimanche de la Passion. - (19) |
| paquet : vache avec son veau. - (59) |
| paquet, subst. masculin : ballot de linge à laver. - (54) |
| paquets : voir bagages. - (20) |
| paquette (n. f.) : touffe, bouquet - (64) |
| paquette, s. f. paquet, poignée : une « paquette » de grains, de noisettes, etc. - (08) |
| paqueuille (n.f.) : menu bois ; ce qui reste d'un arbre après avoir enlevé les grosses branches - (50) |
| paqueuille, s. f. menu bois, ce qui reste d'un arbre dont on a enlevé la tige et les grosses branches. - (08) |
| paqueuilles : déchets (végétaux) - (48) |
| pâqui : (nm) petit enclos près de la maison - (35) |
| paquiau. s. m. Tourteau, pain de noix, de chènevis, etc. (Turny). - (10) |
| pâquier : pâture communale. D’autres diront : pâqué ou pâquis, voire pâtis. Espace communal ou de vaine pâture. - (62) |
| pâquier, pât'cher : n. m. Pâquis (vieux français), pâturage. - (53) |
| pâquiers, et pâquers, s. m., pâquis, pâturages qui étaient autrefois des bois, et dont la qualité est médiocre. - (14) |
| pâquiette, pâtchette. n. f. - Pâquerette. - (42) |
| paquion. n. f. - Chipie. (Villeneuve-les-Genêts, selon M. Jossier) - (42) |
| paquion. s. f. Chipie, mijaurée. ( Ville–neuve-les-Genêts). - (10) |
| paquiôt : un paquet. - (56) |
| paquis : pâture, pré - (43) |
| pâquis, s. m. terrain vague où l'on mène paître les animaux : les « pâquis » communaux. - (08) |
| pâquotte (n.f.) : primevère mais aussi pâquerette - (50) |
| pâquotte, s. f. primevère officinale. - (08) |
| par : Pour. « Laiche dan breuler ce que ne c'eut pas par ta » : laisse donc brûler ce qui ne cuit pas pour toi, ne t'occupe pas de cela tu n'as aucun avantage à en retirer. « Par quafare que te n'y erais pas ? » : pourquoi n'y irais-tu pas. « Par qua fare » : pour quoi faire ? - (19) |
| par après, loc, adv., ensuite. - (14) |
| par là, locution adverbiale : probablement, à peu près, sans doute. - (54) |
| par' vent, s. m., paravent. - (14) |
| pàr, s. f., part, portion, morceau. - (14) |
| par. Part, parts : De tôte par, de toute part ou dé itôtes parts ; c’est aussi je perds, tu perds, il perd : Le tam se par, le temps se perd ; par, de plus, signifie pair, comme quand on dit « Pairi san par », Paris sans pair. - (01) |
| para : Pareil. « On érait loin en pa en trouer in para » : on irait loin pour en trouver un pareil. « Jamâ para ! », exclamation qui équivaut à a-t-on jamais vu chose pareille ! - (19) |
| para : s. m. poireau. - (21) |
| pâra ou paraille : Pareille. - (19) |
| parader, se pavaner. - (26) |
| paradi, reposoir du jeudi saint et de la Fête-Dieu. - (16) |
| paradis : Reposoir sur la place du village, pour la procession de la Fête-Dieu. - (19) |
| paradis n.m. Vin nouveau du Beaujolais. C'est l'équivalent du vin bourru, de la bernache de Touraine ou du neuer süsser d'Alsace. - (63) |
| paradis : s. m., petite quantité de vin de broute rouge qu'on met dans un seillet pour déguster. - (20) |
| paradis, s.m. bouteille d'eau-de-vie placée dans la chambre d'alambic, à la disposition des visiteurs ; il fallait qu'au temps de la distillation elle fût toujours pleine. - (38) |
| parai, s. f., cloison, muraille. Corruption de paroi. - (14) |
| paraie : s. f., aviron, épaillette. - (20) |
| parail, adj. pareil. - (38) |
| paraïl, adj., pareil, égal. - (40) |
| paraison : s, f., syn. de billet, chargeon. - (20) |
| paraissu, part. pass. du verbe paraître. paru : « ç'lai m'é paraissu mauvâ » , cela m'a paru mauvais. - (08) |
| paraissu, part., paru. - (14) |
| parapel, s. m., parapet. - (14) |
| parapiou : parapluie - (43) |
| parap'llu : Parapluie. « Le temps se charge te farais bien de prendre tan parap'llu ». - (19) |
| paraplu (on) : parapluie - (57) |
| parapyou n.m. Parapluie. - (63) |
| parasine, et parésine, s. f., poix-résine. Parasine n'empêche pas pouége. (V. ce dernier mot.) - (14) |
| parasol : s. m., se dit par synecdoche (la partie prise pour le tout) d'une voiture munie de tendue en forme de parasol. - (20) |
| parasolerie : s. f., industrie ou commerce du parasol. Enseigne d'un magasin : « Parasolerie Mâconnaise ». - (20) |
| parasse : Paresse. « Si o n'apprend ren à l'école y est pas de la bâtije y est de la parasse ». - (19) |
| parassoux : Paresseux. « Veux-tu des gaudes ? - Je veux bin. - Apporte tan écualle. - J'ai pas faim », dialogue exprimant le comble de la paresse. - (19) |
| parâtre, v. paraître. - (38) |
| paraule, s.f. parole. - (38) |
| paräyau : (nm) préau, petit pré - (35) |
| parc’e (aine) : (une) perche - (37) |
| parçalle (na) : parcelle - (57) |
| parce (n.f.) : perche - (50) |
| parce : perche. - (52) |
| parce, s. f. perche. - (08) |
| parcé. Percé, percez, percer. - (01) |
| parce-oraille : Forficule, perce-oreille, insecte qui ne justifie pas son nom car il est inoffensif - (19) |
| parcer (v.t.) : percer - (50) |
| parcer, v. tr., percer. - (14) |
| parcer. v. - Percer. - (42) |
| parceréte, et perceròte, s. f., vrille, foret. - (14) |
| parcerette : Percerette, vrille. « La parcerette sarve à fare des partus dans les pansans pa y mentre des quilles » : la percerette sert à faire des trous dans les fûts pour y mettre des faussets. - (19) |
| pârche (na) - parchet (on) : perche (poisson) - (57) |
| pârche (na) : gaule - (57) |
| parche : Perche, long brin de bois de 4 à 5 mètres. « Eune parche pa chaplier les calas » : une gaule pour abattre les noix. « Ol est assi haut qu'eune parche » : il est aussi haut qu'une perche, il est très grand. - (19) |
| parche : perche. On ébat les calats aiquant une parche : on abat les noix avec une perche. - (33) |
| parche : n. f. Perche. - (53) |
| parche : s. f. : perche. - (21) |
| parche, perche ; fâr lai parche, se trouver mal et tomber évanoui. - (16) |
| parche, s. f., perche, long brin de bois, soutien d'un jeune arbre, d'une plante. - (14) |
| parche, sf. perche. - (17) |
| parche. n. f. - Perche. - (42) |
| parche. Perche, perches, sorte de poisson. Parche a de plus toutes les autres significations du français perche, soit nom, soit verbe. - (01) |
| parchée, perchée, perchis. n. f. - Rangée, alignement de ceps de vigne: eune parchée d'bois tordu. - (42) |
| parcher. v. - Installer une parche par-dessus le chargement de foin d'une charrette. La perche fixée d'un côté dans la ridelle, était maintenue à l'autre bout par une corde, afin de serrer fermement l'ensemble. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| parchie, s. f., perchée, ce qui tient sur une perche. Perchée d'oiseaux, d'herbe, etc. - (14) |
| parci : Percer. « Parci in pansan de vin » : mettre une pièce de vin en perce. « In pané parci » : un panier percé, un prodigue. - (19) |
| parçu : part, pass., aperçu. « Sans qu'on s'en soit perçu. » (Lettre relative à l’Hôtel-Dieu de Mâcon, rapportée par le Nouvelliste, 4 juil. 1906). - (20) |
| pard' : v. t. Perdre. - (53) |
| pardâle : (nf) mille-pertuis rampant - (35) |
| parde (v.t.) : perdre - (50) |
| parde : perdre - (39) |
| parde, v. a. perdre. « i son pardus », nous sommes perdus. - (08) |
| parde, v. tr., perdre. - (14) |
| pardedans : s, m., vx fr., for intérieur. Je me demande, dans mon pardedans, s'i n' se fout pas d' moi. - (20) |
| pardessus : s, m., vx fr., objet donné ou travail exécuté par-dessus le marché. j'ai été son premier client; aussi j'ai toujours mon petit pardessus quand je me sers chez lui. - (20) |
| pardi, pardié, pardiène, sorte de juron, pour : par Dieu. - (16) |
| pardié - parguié : (prononcer paryé) Pardi ! Et alors ! Tiens donc ! Ex : "J'vas m'tée, paryé !" (Je vais me taire, tiens !) - (58) |
| pardié (interj.) : pardieu, pardi - (50) |
| pardiè : pardi ! pour sûr ! - (46) |
| pardié : Sorte de juron pour affirmer. « Pardié oué » : oui, mais oui ! - (19) |
| pardié : pardi, pardieu, pardienne ! - (39) |
| pardié! pardine! et pardiène ! excl., pardieu ! Juron affirmatif familier à toutes les classes. Ces trois formes s'emploient indistinctement. - (14) |
| pardienne, juron, pardi ! pardieu ! - (38) |
| pardonner : v. a., être content de quelqu'un, se contenter de quelque chose. « Dites-donc, le patron vous a donné au moins cent francs d'étrennes cette année ? — Ah ! S'i m'avait donné seulement ce qui s'en manque, j' le pardonnerais. » - (20) |
| pardouner : pardonner - (39) |
| pardouner, v. tr., pardonner. - (14) |
| pardre, parde. v. - Perdre. - (42) |
| pardu(e) : perdu(e) - (39) |
| paré (être bien), loc. être habillé richement. - (24) |
| paré : Nom commun masculin. Brisée, sentier, passage des gardes forestiers. Voir rian. - (19) |
| pâre : Paire, couple. « Eune pâre de sulés » : une paire de souliers. « Eune pâre de pigeans » : un couple de pigeons. En parlant de deux époux aussi peu estimables l'un que l'autre on dit : « y arait été demage d'en gâter deux pâres ». - (19) |
| pàre, pére, et peire, s. m., père. - (14) |
| pâre, s. m., père. - (40) |
| pare-feumire (on) : pare-fumée - (57) |
| pare-fu (on) : pare-feu - (57) |
| pàre-grand, s. m., grand-père. Inversion très familière chez nous. - (14) |
| parei, poirei : s. f., paroi ; ruelle du lit. D'un ménage qui commence à être en désaccord, on dit : Ça tourne du côté de la poirei. Voir L'Hôtel du Cul tourné. - (20) |
| pareillou : s. m. carrier. - (21) |
| pareire, carrière de pierre. En latin paries. - (02) |
| pareire. : Carrière, - en latin parietarius signifie maçon et paries muraille. - (06) |
| parement. Paroi d'une galerie de mine. Terme de mineurs. - (49) |
| parentaille. n. f. - Désigne l'ensemble de la famille proche. Au XVIIe siècle, on parlait de parentage ou de parentelle pour évoquer la parenté. Le dialecte poyaudin a conservé le mot français de la première moitié du XXe siècle, en lui ôtant son caractère péjoratif. - (42) |
| parepluie : s. m., parapluie. - (20) |
| parepuie*, s. m. parapluie. - (22) |
| parevent : s. m., paravent. - (20) |
| parfaire. : (Dial.), achever, perfectionner. - (06) |
| parfaite. Les parfaites, parmi les quiétistes, étaient ces sortes de dévotes qui, en vertu de la perfection où leurs directeurs leur disaient qu’elles étaient parvenues, croyaient pouvoir sans péché goûter avec eux des plaisirs sensuels. - (01) |
| parfin. Dernière fin : Ai lai patfin, à la parfin, c’est une vieille façon de parler qui a plus de force qu’enfin… - (01) |
| parfire. Porphyre, sorte de marbre d’un rouge pâle, marqueté de blanc. - (01) |
| parfoué. adv. - Parfois. - (42) |
| pargie et pergie. : Amendes de délits faits par les animaux (charte de 1229) et garantie donnée au seigneur par un colon (du latin parcere, épargner, conserver). [Franch. de Fontenay, 1272.] - (06) |
| pargjé, parié, pardié. interj. - Pardi : « Pardié oui, je m'en vais ! Et je ne vous regretterai guère, toutes ! » (Colette, Claudine à Paris, p.l79) - (42) |
| pârié, s. m. perrier, muraille pavée d'une chaussée d'étang. - (08) |
| pâriére, s. f. carrière de pierres, excavation profonde. - (08) |
| pariou : parieur - (43) |
| parisi*, s. m. congestion pulmonaire, mal de poitrine subit et grave. - (22) |
| pariûre, s. f., gageure, pari : « T’l’ain-mes tant que t'vas còri la vouér ; j't'en fais la pariùre. » - (14) |
| pariure, sf. pari. - (17) |
| parjon (m), case où on isole un animal. - (26) |
| parjon, sm. compartiment pour séparer les moutons. - (17) |
| parlant : part. prés. Rien parlant, d'un abord facile. C'est un homme bien parlant. - (20) |
| parlanter. v. n. Faire le beau parleur, quand on a le défaut contraire. (Etivey). - (10) |
| parlè : v. i. Parler. - (53) |
| parlement : s. m., parole, conversation, discours, J' vois ben q' vous avez un bon parlement. - (20) |
| parler (Faire) : loc, attribuer à quelqu'un des propos qu'il n'a pas tenus. - (20) |
| parler : Parler. A signaler les expressions suivantes : « Parler gras », grasseyer, « Parler le mossieu ou parler la dame », parler français ; « Parler de la main gauche » , parler une langue étrangère. - (19) |
| parler à, loc., d'un sens bien local, fréquenter, faire sa cour : « Toinot parle à la Jean-néte ; j'vouérons ben si ô la d'mande, à la fin des fins. » - (14) |
| parler que : Ioc, dire que. - (20) |
| parleûre, s. f., parlerie, parlage, babillage. - (14) |
| parlisse (que j'), parlît (qu'ô), subj., que je parlasse, qu'il parlât : « Y érôt donc folu que j’parlisse à c't houme ? J'éròs été ben empôchée. » - (14) |
| parmanoir. : (Dial.), persister. (Du latin permanere.) - (06) |
| parmaule : Penture d'une porte ou d'un volet. « La parmaule est reuillie (rouillée) ». - (19) |
| parme, s. f. penture de porte, de volet. - (24) |
| parme, s. f. penture. - (22) |
| parméte, v. tr., permettre. - (14) |
| parmetté. Permettez. - (01) |
| parmetu, part., de parméte, permis. - (14) |
| pârmis (y’ot) : (c’est) permis - (37) |
| parmis. part. pas. - Permis. - (42) |
| parmission (n.f.) : permission - (50) |
| paroche : s. m., vx fr., curé. - (20) |
| paroi, muraille. - (05) |
| paroille. Pareille. Pareille est le féminin de l’adjectif paroil, qui, bien que masculin et de deux syllabes, se prononce comme le féminin paroille, qui en a trois. - (01) |
| parou (couteau), espèce de plane. - (05) |
| parouaî (na) : paroi - (57) |
| parouesse, parouaiche (n.f.) : paroisse - (50) |
| parpadiö, sm. toqué, demi-fou. - (17) |
| parpaillon, (provençal), papillon, parpouillon. - (04) |
| parpaillon. n. m. - Personne incrédule, qui ne croit en rien (Sougères-en-Puisaye). Homme de rien, selon Jean Puissant. Dans divers dialectes, le mot désigne par injure le calviniste, c'est-à-dire l'incrédule. - (42) |
| parpille. n. f. - Tartine. - (42) |
| par'pleûe, s. m., parapluie. - (14) |
| parpointer. v. - Activer, accélérer un travail. (Villeneuve-les-Genêts, selon M. Jossier) - (42) |
| parpointer. v. a. Exciter au travail. J'ai beau le parpointer, il n'en va pas plus vite. (Villeneuve-les-Genèts). - (10) |
| parpouillon, papillon - (36) |
| parpouillon, s. m. papillon. - (08) |
| parqua : Pourquoi. « An ne sait pas parqua ni c'ment » : on ne sait pas pourquoi ni comment. - (19) |
| parquet : Bal forain qui vient s'installer les jours de fêtes. - (19) |
| parquet : bal-parquet populaire, forain. Salle de bal, toute en planches, démontable, sous chapiteau... ("Institution" traditionnelle accompagnant les Fêtes foraines, victime sans défense des salles polyvalentes ou des discothèques normalisées et réglementées...quoique moins dangereuse, cependant). - (58) |
| parquet : s. m., plancher volant pour les bals et, par extension, la salle de danse elle-même. Entrepreneur de parquet, individu qui va de commune en commune, les jours de fêle ou de foire, avec tout l'attirail nécessaire pour dresser une salle de bal. Voir baliste. - (20) |
| parraïllou : Ouvrier qui travaille à la carrière. - (19) |
| parrain fourou : parrain avare. (S. T III) - D - (25) |
| parrain : s. m., père (homme d'un certain âge). - (20) |
| parraire : Carrière. « La parraire de la Breuche » : la carrière de la Brosse. Nom de lieu, « Su les parraires ». - (19) |
| parre. Prendre ; on dit aussi prarre. - (01) |
| parrinage, s. m. parrain et marraine associés : cet enfant a de bons « parrinages » : j'ai vu passer les « parrinages. » - (08) |
| parse : perche, planche au plafond pour mettre le pain - (39) |
| parsè : v. t. et v. i. Percer. - (53) |
| parsi (n.m.) : persil - (50) |
| parsî, s. m., persil. - (14) |
| parsister : Persister. « Faut pas se décoraigi, faut parsister » : il ne faut pas se décourager, il faut persister. - (19) |
| par'sol, s. m., parasol. - (14) |
| parson : cage à poussins. (C. T III) - B - (25) |
| parson : n. m. Cage mobile où l'on met poules et poussins. - (53) |
| parsòne, et parsoune, s. f., personne. - (14) |
| parsonne : n. f. Personne. - (53) |
| parsonne, s. f. personne. - (08) |
| parsonne. Personne, personnes. - (01) |
| parsonnié, s. m. membre d'une association qui participe aux droits et aux charges de la communauté. - (08) |
| parsoune : personne - (39) |
| parsoune, personne. - (38) |
| parsounne, peursounne. n. f. - Personne. - (42) |
| part, sf. viande. Ce qui se mange avec du pain : fromage, etc. - (17) |
| partadze : partage - (51) |
| partadzi : partager - (51) |
| partage : Dicton : « Le partage à Saint-Liaude, tot d'in côté ren de l'autre ». - (19) |
| partagi : partager - (57) |
| partaigè : v. t. Partager. - (53) |
| partaigi : Partager. « Ol a partaigi » : il a partagé, sous entendu : son bien entre ses enfants. « Aller partaigi » : aller faire les lots d'affouage. - (19) |
| partaizer (v.t.) : partager - (50) |
| partaizer : partager - (39) |
| partaizou : partageur - (39) |
| partant : Pourtant. « I n'est partant pas de ma faute » : ce n'est pourtant pas de ma faute. - (19) |
| partaut (adv.) : partout - (50) |
| parterrer. v. a. Atterrer, renverser par terre. (Brienon). - (10) |
| parti : partir - (51) |
| parti : Partir. « I plio treu je pouyins pas parti tot de suite » : il pleut trop nous ne pouvons pas partir tout de suite. Partir sous les drapeaux. « San garçan est parti » : son fils est parti sous les drapeaux. - (19) |
| parti : v. i. Partir. - (53) |
| participer : v. n., accepter l'invitation de gens que l'on trouve sur le point ou en train de boire ou de manger. Voulez-vous participer ? - (20) |
| partie : s. f., faire sa partie, travailler de son métier. - (20) |
| partot : Partout. « Je l'ai charchi (cherché) partot ». « Demorer à deux lieues de partot » : habiter dans un pays perdu. - (19) |
| partsâ : (nm) faux plancher - (35) |
| partsâ n.m. Dans la grange, au-dessus du char, plancher amovible. - (63) |
| partu : Pertuis, trou. « Avoi le da dans le partu » : être dans une situation embarrassante, comme si on tenait le doigt au trou du tonneau après avoir perdu le fausset. « In partu de gauffre » : un trou de gaufre, un tout petit morceau. - (19) |
| partugi : Troué, percé, vermoulu. « Le meub'lle est bien partugi » : ce meuble est bien vermoulu. - (19) |
| partye et dévis. : (Divisus), état d'une personne habitant la maison d'un seigneur, mais cultivant d'autres terres que les siennes. (Franch. de Chanceaux, 1272.) - (06) |
| pas carré : s. m., ancienne mesure de surface en général valant, à Mâcon, 659 millièmes de mètre carré, et, à Dijon, 944 millièmes de mètre carré. - (20) |
| pâs d’ç’ine : en vitesse - (37) |
| pas d'âne : tussilage - (48) |
| pas d'âne : plante tussilage, borbotte. - (33) |
| pas de cib'lle : Stand. « In brave pas de cib'lle » : un endroit convenant bien pour établir un tir à la cible. - (19) |
| pas devant (prendre le), loc. partir en avant, à pas modérés, de manière à pouvoir être rejoint ensuite facilement : je prends le pas devant. - (24) |
| pas d'lai porte : seuil - (48) |
| pas golu : pois gourmand (pois-mangetout) - (51) |
| pâs golus n.m.pl. Variante de pois golus, pois mange-tout. - (63) |
| pas moins : (loc.) toutefois, cependant - (35) |
| pâs n.m. Pois. Dès que l'on précise qu'il s'agit de petits pois, il faut dire ptiets pois. - (63) |
| pâs : adv. Pas (ne pas). - (53) |
| pas : s. m., ancienne mesure de longueur pour les chemins. A Maçon, il valait comme l'aune, et comme la démarche, 2 pieds 1/2, soit 0 m. 812. A Dijon, il valait 3 pieds, soit 0 m. 972. Il y avait, en outre. un pas géométrique de 5 pieds, soit 1 m. 620. - (20) |
| pas, s. m., marche d'escalier. Le pas de la porte : « Peùrnez garde, la bonne mâre ; por entrer, y a eùn pas. » - (14) |
| paschit. adj. Mort, perdu. (Puysaie). - (10) |
| pascrit. adj. - Mort, perdu. Ce mot est directement issu de l'ancien français prescrit, du verbe prescrire, condamner. Le poyaudin a conservé la connotation juridique de l'origine latine du mot : praescribere, en latin, signifiait « écrire en tête, imposer, ordonner »... - (42) |
| pas-d'âne : n. m. Plante tulinage. - (53) |
| paser, v. peser. - (38) |
| pasilinol. : (Dial.) Dans le passage suivant de saint Bernard, ce mot a le sens de paralytique : « Nos gisiens en notre leit ainsi cum tuit pasilinols. » (Serm. de l'avent.) Jacentes paralytici, dit la version latine. - (06) |
| pas'ke, parce que. Un enfant à qui l'on demande le motif qui l'a poussé à telle action mauvaise et qui n'ose le faire connaître, se contente de répondre : pas'ke ! - (16) |
| pasque : (L's se prononce). Parce-que. « A cause dan que t'es pas veni ? - Pasque j'ai pas ésu le temps » : pourquoi donc n'es-tu pas venu ? - Parce-que je n'ai pas eu le temps. - (19) |
| pasque : loc. conj. Parce que. - (53) |
| pasque : parce que - (39) |
| pàsque, contraction de la loc. conjonct., parce que. - (14) |
| pasqué. conj.- Parce que. - (42) |
| passabje, adj. passable. - (17) |
| passab'lle : Passable. « La récolte est-i bonne ? - Oh alle est passab'lle ». - (19) |
| passab'llement : Passablement. S'emploie quelquefois pour beaucoup. « I fa passab'llement chaud » : il fait très chaud. - (19) |
| passager : s. m., sarcelle. - (20) |
| passai. Passé, passez, passer. - (01) |
| passaige (n.m.) : passage - (50) |
| passau, s. m., échalas. - (40) |
| pâsse (n. f.) : moineau (syn. pâstiot) - (64) |
| passe : moineau - (60) |
| passe : Passage, terme de chasse. « Aller à la passe à la bécasse ». - Bandeau de cheveux. « Fare sa passe » : faire sa passe, séparer ses cheveux sur le milieu de sa tête pour former deux bandeaux lisses séparés par une raie bien droite. - (19) |
| passe bochans : Roitelet. Voir à Roi patret. - (19) |
| passe partot : Passe-partout. « Les sabeutés (sabotiers) débitant leu noués (leurs noyers) au passe partot ». - (19) |
| passe preto : passe-partout - (43) |
| passe tous grains. Vin de qualité moyenne, au-dessus de l’ordinaire, mais inférieur aux grands crus. On le nomme ainsi parce qu'il est censé fait avec des raisins communs à gros grains et des raisins de qualité à grains fins. - (12) |
| passé : s. m., fromage passé. Voir fromage. - (20) |
| pâsse. n. f. - Moineau. Depuis le XIIe siècle, passe fut employé en ancien français pour signifier moineau (passer en latin) - (42) |
| passe-bois. Sorte de jeu, qu'on appelle à Chalon le Jean-rit. - (03) |
| passe-cul : s. m., cabriole. Rapprocher de bosse-cul et plat-cul. - (20) |
| passée : entrée d'un champ - (39) |
| passée : s, f., vx fr., passage, espace compris entre deux rangées de ceps ou d'arbustes. - (20) |
| passée, s. f. entrée, passage dans une haie, passage des oiseaux : la « passée » des bécasses. - (08) |
| passée, s. f., trou, passage pratiqué dans une haie: « T'voués la passée ; les p'tiots s'fouront par là por picorer. » - (14) |
| passeige. Passage, passages. - (01) |
| passelon. s. m. Echelon. (Roffey). - (10) |
| passe-peurtot : passe-partout - (51) |
| passe-peurtot n.m. Passe-partout (scie). - (63) |
| passeque, pa'ce que. Parce que. - (49) |
| passer, v. tr., achever, terminer : « J'poux ben còrî m'obuyer ein p'chò ; j'ai passé ma l'çon. » - (14) |
| passera, moineau. - (05) |
| passerà, s. m., passereau, moineau. - (14) |
| passera. Moineau. C'est le français passereau, du latin passer. - (03) |
| passerat : passereau - (61) |
| passerose. n. f. - Muguet. (Mézilles, selon H. Chéry) - (42) |
| passeròte, s. f., passoire. - (14) |
| pâssi v. Passer. - (63) |
| passiâ, échalas de vigne. - (27) |
| passier. s. m. Gerfaut, oiseau de proie. (Laduz). - (10) |
| passoir : s. m., vx fr., passage couvert entre la voie publique et la cour d'une habitation. - (20) |
| passon : cage mobile où l'on met poule et poussins. - (33) |
| passon, s. m., cage portative pour garder les poussins. - (40) |
| passou : Passage couvert. « O s'est mis à la coi (à l'abri) seu le passou ». - (19) |
| pâssou, passage sur un cours d'eau. - (16) |
| passouaire (n.f.) : passoire - (50) |
| passouaîre (na) : passoire - (57) |
| passouée. n. f. - Passoire. - (42) |
| passouère : passoire - (48) |
| passouére : passoire - (39) |
| passoure, sf. passoire. - (17) |
| pass'que : parce que - (57) |
| pâste : Peste. « An le fu c'ment la pâste » : on le fuit comme la peste. - (19) |
| pâstiot (n. m.) : moineau (syn. pâsse) - (64) |
| pastonade : carotte rouge ou fourragère. A - B - (41) |
| pastonade n.f. (lat. pastinacam). Carotte. - (63) |
| pastonade : s. f., pastenade. carotte (daucus carota). - (20) |
| pastonnade : (nf) carotte - (35) |
| pastonnade : carotte - (43) |
| pastonnade : carotte rouge ou fourragère - (34) |
| pastonnade : Carotte, daucus carota. « In ban morciau de bû d'ave des pastonnades au to cen fa eune bonne daube » : un bon morceau de bœuf avec des carottes autour cela fait une bonne daube. - (19) |
| pastonnade. Carotte. - (49) |
| pastounade*, s. f. carotte potagère. - (22) |
| pât (na) : part - (57) |
| patâ : Pétard fait d'un morceau de sureau dont on a enlevé la moelle. - (19) |
| patâche (patâchou(re)) : rôdeur de grands chemins - (39) |
| patàche, adj., fém. de patachou (au lieu de patachouse, peu usité), femme mal tenue, sans tournure, et parfois de mœurs équivoques : « Quand t'voux t'preùmener, n'vas donc pas d'avou c'te patàche. » - (14) |
| patache. s. f. Jeu d'enfant qui consiste à sauter sur le dos d'un camarade sans mettre les pieds sur une raie tracée exprès. (Soucy). - (10) |
| patacher (patracher) : traîner les pieds - (39) |
| patacher (verbe) : salir ou souiller un endroit propre ou entretenu. - (47) |
| patacher, patailler. Bavarder, faire des cancans. - (49) |
| patacher. Courir à droite et à gauche. An te faut marcher teut droit su lai route ; çai ne sert de ran de patacher quemant ce qui. Un patachon est un homme que l’on rencontre partout. Patache était le nom d'une voiture publique et d'une barque de cabotage. On a donné le nom de « patache » aux premières voitures à service régulier. Les Dijon nais prononcent patracher. - (13) |
| pataçhi, patraçhi v. Marcher en traînant les pieds. - (63) |
| patachon : vie marginale - (44) |
| patàchoû, adj. m. et parfois subst., homme sans beaucoup de conduite, qui boit trop fréquemment, et court la ville et les chemins : « Que v'tu! ô travaille deux jôrs par semain-ne, é peu, drès qu'ôl é pàyé, ô s'en va bouére ça qu'ôl a gangné;… n'y é ran qu'eùn patachoû. » - (14) |
| patachou, s. m. rôdeur de grands chemins. - (08) |
| patachoux, patailloux. Bavard. Ces mots s'appliquent surtout à celui qui parle à tort et à travers, en qui on ne peut pas avoir confiance. - (49) |
| patafia : chose éblouissante, grandiose - (60) |
| patafiau, patarin : hérétique. - (32) |
| patagauche. s. m. Maladroit. (Villiers-Bonneux). - (10) |
| pataï, s.m. chiffonnier. - (38) |
| pataille, adj., bavarde, cancanière : « Si vos v'lez l'acouter, all’vos en dira, là pataille ! - (14) |
| pataille, potache. Bavarde. - (49) |
| pataille, s. f., femme bavarde et médisante. - (40) |
| patâille, subst. féminin : bavarde, personne qui parle à tort et à travers. - (54) |
| patâiller, verbe intransitif : parler à tort et à travers. - (54) |
| patâilloux, adjectif qualificatif ou subst. masculin : bavard. - (54) |
| pataler : galoper. - (62) |
| pataler : v. n., vx fr. pesteler, aller et venir avec agitation. - (20) |
| pataler, v. intr., galoper. Se dit surtout d'un cheval qui va grand train. - (14) |
| pataler. Sauter en frappant des pieds. - (03) |
| patapatapan. Son du tambour français… - (01) |
| patapouf, adj., homme lourd, corpulent : « Ton lichoû d'vouésin, y et ein gros patapouf. » - (14) |
| pataquiou. s. m. Homme à l'extérieur négligé, malpropre, grossier dans ses manières, grossier dans son langage. (Savigny). - (10) |
| patâr, s. m., patard, monnaie ancienne valant environ cinq liards : «. D'ta pôche de la jòrnée, j'n'en baillerò pas tant s'ment ein patâr. » - (14) |
| patarâ : Nom commun, grande superficie de terrain. « I fiant tot in patarâ » : ils en exploitent grand. - (19) |
| patarà, s, m., vase ou pot, contenant une certaine quantité de liquide, et qu'à Santenay l’on remplit de l'eau laxative que les amateurs y vont boire. (V. Ouches.) - (14) |
| patara, s. m. grande étendue de terrain : un grand patara de vignes. - (24) |
| patara, s. m. grande étendue de terrain : un grand patara de vignes. - (22) |
| pataras. s. m. Toupie très-petite. - (10) |
| pataraud n.m. Vadrouille, pétard. La maijon est tote en pataraud. La maison est en désordre (du fait d'un trop plein d'activités). Ôl 't en pataraud ! Il est en vadrouille. - (63) |
| patard. s. m. Double sou. Se disait surtout des gros sous de l'ancienne monnaie. - (10) |
| pàtàrou (C.-d., Morv., Chal.), pantarou (Y.), (être en). - Etre hors de soi, agité, en colère ; employé probablement pour petarou, de pétard, dans le sens de faire du bruit. Est usité en argot… - (15) |
| patarou (en) (être), en préparatifs hâtifs, fiévreux. - (38) |
| patarou (en) : (être) dans tous ses états. (MM. T IV) - A - (25) |
| patarou (en), loc. être en « patarou », c'est être hors de soi-même, en effervescence, dans un état d'agitation physique ou morale. - (08) |
| patarou (être en) - être empressé, embarrassé, impatient pour faire quelque chose. - Ne vos mettez don pas en patarou quemant ce qui, ci n'aivance ai ran. - Oh, pou diére, ailé, â se met en patarou. - (18) |
| patarou (être en) (loc.) : être hors de soi-même, agité - (50) |
| patarou (être en) : être énervé, agité. (VDS. T IV) - VdS - (25) |
| patarou (être en), être ahuri, être en préparatifs pressés et interminables. Cette locution est fort usitée dans le Châtillonnais. - (02) |
| patarou (être en), être bouleversé, être dans tous ses états. S'emploie ironiquement en parlant d'une personne qui est affairée et en émoi pour recevoir convenablement un invité. - (27) |
| patarou : (être en patarou) être tout bouleversé - (46) |
| patarou : Branlebas de cuisine « Etre en patarou » : être très affairé en vue de recevoir des convives à sa table. - (19) |
| patarou : colère, fureur - (48) |
| patarou : foutre le bordel - (44) |
| patarou, s. m., embarras, préoccupation mouvementée. Être, se mettre en patarou, remuer, ranger, mettre en ordre chez soi pour les préparatifs d'une réception, etc. : « Y é donc ben grand'féte cheû l'gros, qu'ôl é dans tous ses patarous ? » - (14) |
| patarou, sm. remue-ménage. Gros souci ; effroi. Être en patarou. - (17) |
| patarou, tracas, préparatifs multipliés et faits à la hâte. - (16) |
| patarou. s. m. Personne en colère. (Guillon). – Voyez pantarou. - (10) |
| patarou. : Etre en patarou, c'est se donner du mouvement à tort et à travers, ne savoir où donner de la tête. Les mots latins per totum ruens semblent dépeindre une personne qui est saisie de ce vertige. - (06) |
| pataroux (être en). Etre en colère, dans tous ses états, être très ému. Etym. mot né d'une exclamation comme patapouf, patatras, patati, patata, etc. - (12) |
| pataroux (faire du). Faire des manières, des embarras ; avoir un train de vie au-dessus de ses moyens. - (49) |
| pataroux. Embarras, tourment, remue-ménage. An ne faut pas ailler voi lai Manette aujed'heu : el ast teute en pataroux ai cause de lai melaidie de son peîre. - (13) |
| patasse : s. f., personne peu active, molle; personne qui bavarde sans réflexion, patasse en paroles. - (20) |
| patasser : v. n., flâner, paresser ; parler à tort et à travers. - (20) |
| patasser, verbe intransitif : piétiner, marcher en laissant des traces de pas. - (54) |
| patassi, patrachi : piétiner, traîner les pieds en marchant - (43) |
| patata : personne ayant passé un pacte avec le diable et qui pouvait se transformer en loup. III, p. 18 - (23) |
| patata. n. m. - Personne désagréable, pas aimable, autoritaire (Arquian). Autre sens : sorte de loup-garou ; personnage légendaire, inquiétant, affublé d'une peau de loup, ou recouvert d'un drap blanc, il semait la terreur dans les campagnes. Synonyme de m'neux d'loups. (F.P. Chapat, p.150) - (42) |
| patatas. s. m. Variété de loup-garou. – Jeune homme évaporé, jeune fille dissipée. (Puysaie). - (10) |
| pataté, v. n. courir bruyamment de côté et d'autre. - (22) |
| patater, v. n. courir bruyamment de côté et d'autre. - (24) |
| patatrâ. Ce mot a droit de cité dans ce glossaire puisqu'il appartient au nivernais à un titre historique. le dict. de Trévoux raconte l'anecdote suivante : François de Gonzague, duc de Nevers, courant la poste de Paris à Nevers, son cheval s'abattit dans la ville de Pouilly, sur quoi une vieille femme lui cria : patatra, Monseigneur de Nevers! ce qui le mit tellement en colère, qu'il y envoya des soldats qui désolèrent toute la ville. - (08) |
| patatrac : Patatras. Exclamation lorsqu'on voit tomber quelqu'un. - (19) |
| patau, s. m. pataud, lourdaud : un gros « patau », homme trapu, mal bâti, sans esprit, sans tact au figuré. - (08) |
| pataud, gros, difforme. - (05) |
| pataûgi - gadroilli - patroilli : patauger - (57) |
| pataugi : Patauger. « Si la plio ne s'arrête pas je n'ins pas fini de pataugi » : si la pluie ne cesse pas nous n'avons pas fini de patauger. - (19) |
| patché : pâture (en B : patchi) A - (41) |
| pât'cher, pâquier : n. m. Pâquis (vieux français), pâturage. - (53) |
| patcher. Pattier. Chiffonnier. - (49) |
| patchère : pétrin, maie pouvant servir de table. A - B - (41) |
| pâtchère : pétrin (pâtière) - (51) |
| pâtchère : pétrin, mai, servant de table - (34) |
| pâtçhère n.f. Pétrin, maie. - (63) |
| patchère, patière. Pétrin, huche, maie. - (49) |
| patchet (on) : paquet - (57) |
| patchi : pâture - (34) |
| pâtçhi n.m. Pré proche de la maison. - (63) |
| patchié, s. m. coureur de grands chemins, individu de mauvaise mine et misérablement vêtu, diseur de bonne aventure. - (08) |
| pate : chiffon. A - B - (41) |
| pâté : chiffonnier. (S. T IV) - S&L - (25) |
| pate, s. f. linge usé, chiffon. Pati, chiffonnier des rues. - (22) |
| pate, s. f. linge usé, chiffon. Pati, chiffonnier des rues. - (24) |
| pàte, s. f., chiffon, morceau de linge, neuf ou vieux. - (14) |
| paté, s.m. mauvaise serpillère, chiffon. - (38) |
| pate. Chiffons. Nous disons aussi patin , et patier pour marchand de chiffons. - (03) |
| pâtée : nourriture pour les volailles - (48) |
| patelot. Nomade ; désigne, par comparaison, une personne sale, mal habillée. - (49) |
| pate-mouillée, s. f., personne, homme ou femme, sans énergie : « Ô sait pas se r'torner ; y ét eùne vrâ pàte-mouillée. » - (14) |
| pate-moyie, s. m. personne timide, hésitante, sans initiative. - (24) |
| patenaille, panais, légume ; en latin pastinaca. - (02) |
| patenaille, s. m. panais. - (08) |
| patenâye, panais, plante potagère. - (16) |
| patêne. s. f. Poignée par laquelle on prend un objet (Sampuits). - (10) |
| patenne. n. f. - Gros chiffon dont se servait la cuisinière pour se saisir des plats brûlants, ainsi que des fers à repasser. - (42) |
| patenolle, s. f. perle. - (08) |
| pâter : coller (terre sur les chaussures) - (48) |
| pater : coller, agripper - (51) |
| pater ou pati : Péter, éclater, claquer. « An va fare pater les bouètes la vaille de la fête » : on va faire des salves de boîtes la veille de la fête. « O se pliat à fare pati san fouat » : il se plait à faire claquer son fouet. - (19) |
| pâter : (pâ:tè - v. intr.) se dit des souliers, des sabots et aussi du soc de la charrue auxquels adhère la terre molle. - (45) |
| pâtés (crier les petits), loc. Se dit des cris que pousse une femme en mal d'enfant. Jadis, les marchands de petits pâtés les criaient très fort dans les rues. On voit l'analogie. - (14) |
| pates (des), des chiffons. - (38) |
| patet : Lange. « Qu'est ce que te fas itié (ici) à bavarder, vas dan puteu (plutôt) laver les patets à tes ptiets ». - (19) |
| patet, s. m. lange d'enfant (vieux français). - (24) |
| pâteure - (39) |
| pâteure (n.f.) : pâture - (50) |
| pâteure : pâture - (48) |
| pâteûre n.f. Pâture. - (63) |
| pateure, pateurâdze : pâturage - (43) |
| pateure, s. f. fourrage en général, dans le sens d'aliment, de pâture. - (24) |
| pâteure, s. f. pâture, pâturage, terre ordinairement close et engazonnée où les animaux paissent en liberté. - (08) |
| pâteureau, s. f. pâtureau, petit pâturage ordinairement à la portée des habitations. - (08) |
| pâteurer : paître - (48) |
| pâteurer : manger l'herbe - (39) |
| pâteurer, v. a. pâturer, manger l'herbe d'un pré ou d'une pâture. - (08) |
| patevôler : courir et tenter l’envol. Courir et simuler le vol, certains disent pativoler. Voler bas, pattes au sol, comme une poule. - (62) |
| patevôler, v. intr., aller de droite et de gauche, courir de tous côtés, être un peu partout : « D'avou vot' mau d'pied, vous d'vez gros vous enniûer ? — N'm'en parlez pas, moi qui ain-me tant patevôler... » - (14) |
| pati : chiffonnier, marchand de peaux de lapin, de ferrailles. A - B - (41) |
| pati. Pâtir, et dans cette signification, la première syllabe de pâti est longue ; mais quand elle est brève, alors pati signifie partir, ou c'est le substantif parti, ou quelque temps de la conjugaison du verbe partir. - (01) |
| patie. Partie, parties. - (01) |
| patier (ére) : genre de clochard - (39) |
| patier : chiffonnier, camp-volant, romanichel, personne mal vêtue - (48) |
| pâtier : Pâturage. « In ban pâtier » : un bon pâturage. Un vigneron dîne chez son patron, on l'a placé au bas-bout de la table où on ne lui passe que des restes. « Mange bien » lui dit son maître, « la table fait pâtier » - « Oué neut'mossieu, mâ l'harbe est bin pu drûge (bien plus drue) d'in bout que de l'autre ». - (19) |
| patier : un chiffonnier. - (56) |
| patier, marchand de chiffons. - (05) |
| patier, patcher, paquier. Pâturage. - (49) |
| patier, s. m., marchand de chiffons, qui achète et revend des pàtes. Jadis c'était le nom du marchand de chiffons à faire le papier. - (14) |
| patière (pâtière) : s, f., maie, pétrin. - (20) |
| pâtière, s. f., maie, coffre à boulanger la pâte. (V. Ballonge.) - (14) |
| patifles, s. f. pl., écorce de bois plané, servant d'allume-feu. - (40) |
| patifou. s. m. Niais, bouffon qui amuse les autres à ses dépens. (Percey). - (10) |
| patifouner (verbe) : tripoter, malaxer à outrance une pâte. - (47) |
| patin (un) : un chausson - (61) |
| patin : s. m., vx fr., demi-semelle doublant une semelle. - (20) |
| patin, s. m. pantoufle de lisière garnie d'une semelle. Lorsqu'il n'y a pas de semelle, le patin n'est qu'un chausson. - (08) |
| pàtin, s. m., diminut. de pâte. (V. ce mot.) - (14) |
| patin, subst. masculin : pantoufle légère, chausson. - (54) |
| patinée : danse - (39) |
| patiner, v. n. sautiller. Se dit d'un petit enfant qu'on fait danser en le soutenant et de tout ce qui saute avec légèreté. - (08) |
| patiner. Toucher avec la main. - (49) |
| patinouaîre (na) : patinoire - (57) |
| patira. n. m. - Souffre-douleur. - (42) |
| patirat. s. m. Souffre-douleur. – Se dit surtout d'un enfant chétif, qui manque des soins les plus nécessaires. - (10) |
| pâtire : (nf) pétrin - (35) |
| pâtire : pétrin, maie, servant de table - (43) |
| patire. Partimes, partites, partirent. - (01) |
| patis : pré. - (66) |
| patis : (le "a" est très accentué). Surface de terre peu fertile à vocation d'herbage. Ex : "Va don mett' les vaches dans l'pâtis." - (58) |
| pâtis, n. masc. ; pâturage, communal. - (07) |
| pativòler, v. intr., voler bas en s'aidant des pattes, comme les oiseaux de basse-cour. (V. Patevòler.) - (14) |
| pativoler. Voler· bas, et comme l'indique la composition du mot, en s'aidant autant des pattes que des ailes. - (03) |
| patlin : quartier - (44) |
| patô, quelqu'un qui est lourd et maladroit. - (16) |
| patò, s. m. lange d'enfant. - (22) |
| patoeille : boue - (39) |
| patoeiller : remuer dans la boue - (39) |
| patoi. Patois, langage d'un pays où l’on parle mal… - (01) |
| patoille : bavarde. (EDSEA. T II) - A - (25) |
| patöille : boue - (51) |
| patöilli : rendu boueux, patauger dans la boue - (51) |
| patoïlli v. Patauger. - (63) |
| patoillis, patouillis. s. m. Boue délayée, bourbier dans lequel on patouille, on met les pieds. (Plessis-Saint-Jean). - (10) |
| patoillon (patoïon) : s, m., flan. - (20) |
| patoïllon n. et adj. 1.Gâteau pas assez cuit, pâte mal levée ou mal cuite. 2. Chiffon sale et mouillé. - (63) |
| patöillou : boueux - (51) |
| patoïlloux adj. Boueux. - (63) |
| pâton : (pâ:ton: - subst. m.) petit tampon de terre, de boue séchée, que les chaussures sales laissent derrière elles. - (45) |
| paton : s. m., pied. Chauffe donc, tes patons. - (20) |
| pâton, s. m. petite masse détachée de la pâte dont on fait le pain. - (08) |
| pàton, s. m., petit bloc détaché de la masse de pâte. - (14) |
| pâtou (être) : aliment pâteux, collant à la bouche ou à la langue. - (56) |
| pâtou : pâteux, collant - (48) |
| pâtou – pâtre, berger en général celui qui mène les bêtes aux champs. - Vos é in petiot pâtou qu'à bein jeune. - Vote pâtou é laichai ailai ses berbis dans le prai et pu dans les treuffes que sont â long. - (18) |
| patou : n. et adj. Pataud. - (53) |
| pâtou, s. m. pâtre, berger, celui qui conduit aux champs et qui y surveille les animaux. - (08) |
| patouais (n.m.) : patois - (50) |
| patouaîs (on) : patois - (57) |
| patouè : le patois - è causîn patouè entre-leu, ils parlaient patois entre eux - (46) |
| patoué, s. m. patois, langage des campagnes par opposition avec le langage des villes. - (08) |
| patoué, s. m., patois, ce langage qu'on prétend corrompu, qu'on dédaignait jadis, et dans lequel on puise maintenant pour remonter aux étymologies, et connaître les usages, les coutumes, les traditions des localités. - (14) |
| patouéillat, s. m. creux rempli de boue, endroit fangeux, terre mouvante. « patouillat. » - (08) |
| patouéille : boue, gadoue - (48) |
| patouéille, patouéillou : bavarde, bavard - (48) |
| patouéille, s. f. boue, terre fangeuse ou mouvante. - (08) |
| patouéiller : tripotter dans l'eau, patauger, parler à tort et à travers - (48) |
| patouèiller : (patouèyé - v. intr.) bavarder, babiller. La gran:d' patouèy' "fichue bavarde" de A.Guillaume se rencontre encore très fréquemment dans la langue imagée. - (45) |
| patouéiller, v. a. tripoter quelque chose de sale, mi-liquide, mi-solide ; manier malproprement ou grossièrement. - (08) |
| patouéillot, patouille : boue, gadoue - (48) |
| patouéillou, ouse, adj. patouilleux, fangeux, vaseux, où le pied s'enfonce : un pré « patouéillou », une terre « patouéillouse. » - (08) |
| patouéillou, ouse, s. m. et f. bavard avec intempérance et déraison, celui ou celle qui patauge en parlant. - (08) |
| patouffier. n. m. - Lourdaud. (Villiers-Saint-Benoît, selon M. Jossier) - (42) |
| patouffier. s. m. Lourdaud. (Vilhers-Saint-Benoît). - (10) |
| patouillas, boue - (36) |
| patouillat (n. m.) : flaque d'eau - (64) |
| patouillat (n.m.) : creux rempli d'eau - (50) |
| patouillat (nom masculin) : endroit boueux. - (47) |
| patouillat. Flaque d'eau boueuse. - (49) |
| patouille (n.f.) : boue - (50) |
| patouille (nom féminin) : boue (voir gouille) - (47) |
| patouille : boue - (44) |
| patouille : boue - (60) |
| patouille : boue. - (09) |
| patouille : boue. D’où l’expression : se dépatouiller. - (62) |
| patouillè : v. t. Barboter dans l'eau. - (53) |
| patouille, n.f. boue. - (65) |
| patouille, subst. féminin : boue. - (54) |
| patouille. Boue, vase. D'où le verbe « empatouiller » : couvrir de boue, salir. - (49) |
| patouille. n. f. patouillat. n. m. - Flaque d'eau boueuse. Directement dérivé de l'ancien français patouiller (patauger), la patouille désignait à la Renaissance une boue liquide, une mare, et patouilleux signifiait boueux. - (42) |
| patouiller : s'amuser, pour les enfants, dans l'eau. - (66) |
| patouiller : v, n., vx fr, patoier, patauger. Ça patouille. - (20) |
| patouiller, patauger. - (04) |
| patouiller, v., tremper les mains dans l'eau et les taper. - (40) |
| patouiller, verbe intransitif : parler à tort et à travers. - (54) |
| patouiller. Patauger dans la boue ; remuer la boue. - (49) |
| patouiller. v. a. et n. Marcher dans la boue liquide, barboter. - (10) |
| patouillie : s. f., varicelle. - (20) |
| patouillon : s. m., mauvais mouchoir attaché d'habitude à la ceinture des enfants ; personne molle et bonasse. - (20) |
| patouillon(patoeillon) : personne sale - (39) |
| patouillon. n. m. - Lavette pour nettoyer la table. - (42) |
| patouillon. s. m. Sale. (Soucy). - (10) |
| patouillot (patoeillot) : endroit boueux - (39) |
| patouillou (-ouse) (n. et adj.m. et f.) : fangeux (-euse), où les pieds s'enfoncent - (50) |
| patouillou(patoeillou) : personne sale - (39) |
| patouilloux : boueux - (48) |
| patouilloux, adjectif qualificatif : boueux. - (54) |
| patouilloux. Couvert de boue, malpropre. - (49) |
| patous : velu - (57) |
| patouse : poule ayant des plumes sur les pattes - (48) |
| pâtoux : Pâteux. « Je cras bin que t'as fait la ribote, t'as la langue bien pâtouse ». - (19) |
| patouyi, v. n. piétiner dans la boue claire du dégel. - (22) |
| patòyi, v. n. piétiner dans la boue claire du dégel ou de la pluie. - (24) |
| patrachè : v. t. Traîner des pieds. - (53) |
| patrache, s. f., chaussure éculée. - (11) |
| patrache, s. f., femme qui court bavarder chez les voisins. - (40) |
| patrache, subst. féminin : pantoufle éculée, savate. - (54) |
| patrache. Savate en mauvais état ; par extension, vieilles chaussures éculées. - (49) |
| patracher : faire des marques de pas - (44) |
| patracher : marcher, piétiner - (48) |
| patracher : piétiner dans un endroit humide ou mouillé, plus ou moins sale, patauger. - (56) |
| patracher, v. a., marcher en traînant les pieds. - (11) |
| patracher, v. piétiner, marcher sans beaucoup avancer. - (65) |
| patracher, verbe intransitif : marcher en salissant, piétiner, faire les cent pas. - (54) |
| patracher. Fouler aux pieds, marcher en tout cassant dans une planche de légumes par exemple ; par extension, piétiner là où il ne faut pas, dans la boue, dans l'eau. - (12) |
| patraçhes n.f.pl. Vieilles chaussures. - (63) |
| patraçhi, pitraçhi v. Traîner des pieds. - (63) |
| patrachou : marcheur - (48) |
| patrachou : n. m. Qui traîne dans les rues sans but précis. - (53) |
| patrachou, s. m., terme de mépris, appliqué aux vagabonds, aux coureurs de grand chemin. - (11) |
| patrachou, subst. masculin : celui qui marche en traînant pieds, mais aussi celui qui fait du mauvais travail. - (54) |
| patrachoux, patachoux. Chaussé de vieilles chaussures éculées. On dit :« traîner la patache ». - (49) |
| patraque (n.f.) : pintade (du cri de ce volatile) - (50) |
| patraque (nom féminin) : pintade. Etre patraque être physiquement mal en point. - (47) |
| patraquer (verbe) : criailler en parlant de la pintade. - (47) |
| patrassi : (vb) taper des pieds - (35) |
| pâtri - expression à l'usage des enfants pour dire le signe de la Croix, à cause de In nomine Patris. - Mon enfant, vions voué, fais bein ton Pâtri. - En faut fâre son Pâtri devant que de méger. - (18) |
| patri : s. m. Dire son patri, dire le pater noster. Faire son patri, faire le signe de la croix (In nomine patris...). - (20) |
| patriache. Patriarche, patriarches. - (01) |
| patrichet, patriquet. n. m. - Plat à base de fromage blanc et de pommes de terre... - (42) |
| patrigner (v. tr.) : malaxer, triturer - (64) |
| patrigon : s. m., embarras, difficulté. Etre dans le patrigon, être dans le pétrin. - (20) |
| patrigone - la prune de Perdrigon. - Les patrigones sont des bein bonnes peurnes ; le Châtais nos en ai aichetai deux fouai. - (18) |
| patrigône, variété de prune appelée perdrigon. - (26) |
| patrigoner, v. a. manier longuement et avec maladresse : patrigoner du beurre. - (24) |
| patrigòt, s. m., patrouillis, patrouillage. Au fig., mauvaise affaire, embarras : « Y é pas por dire ; ma ô s'é métu là dans un fichu patrigòt. » - (14) |
| patrigoter : v, a., tripoter (au prop. et au fig.). - (20) |
| patrigòter, v, intr., patauger, barboter : « Diabe d'enfant ! V'tu ben n'pas tant patrigòter ! » — Au fig., mettre la main à des affaires peu claires. - (14) |
| patrimargotai, mettre, sans vue arrêtée, les mains à quelque ouvrage... - (02) |
| patrimargotai. : Manier et remanier une affaire, la fouiller et la refouiller, intriguer dans sa famille ou ailleurs. Les mots latins patri et matri argutare, redire et ressasser sans cesse à père et mère, n'auraient-ils point formé l'expression dont il s'agit? En Champagne patricotter signifie intriguer et patricotteux intrigant. (Grosl.) - (06) |
| patriquet. n. m. - Désordre : « La grand mée, alle a renversé l'siau dans la chambre, te parles d'un patriquet ! » ( Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| patriquet. s. m. Mélange de beurre et de fromage battus ensemble. (Puysaie). - (10) |
| patroïllan : Qui ne craint pas de patauger. Au figuré : qui a bon caractère. - (19) |
| patroïlle : Boue liquide. « Nos autres je sins habitués à la patroïlle » : nous autres nous sommes habitués à la boue. - (19) |
| patroille, boue liquide. - (05) |
| patroille, égouvillon de four. - (05) |
| patroille, s. f., patrouillage, eau sale, boue liquide. - (14) |
| patroille, s. f., sorte d'écouvillon, étoffe sale emmanchée au bout d'une perche, pour remuer et nettoyer le four. - (14) |
| patroiller, v. intr., patrouiller, patauger, marcher dans le patrouillis. Se prend aussi dans le sens impersonnel ; « Auj'deù i patroille (aujourd'hui il y a mauvais chemin). » - (14) |
| patroïlli : Patrouiller, marcher dans l'eau bourbeuse, travailler dans les terres détrempées par la pluie. - (19) |
| patroilloû, s. m., enfant qui s'amuse à remuer de l'eau sale. Pour tous les mots de cette famille, la prononciation d'une certaine contrée supprime volontiers le r (Patouille, Patouiller, Patouilloù). - (14) |
| patrouille. Morceau de sale étoffe emmanché pour remuer le four. Patrouillon (faire un). Se dit des enfants qui s'amusent salement avec de l'eau. Patrouiller se dit de la boue détrempée et liquide. - (03) |
| patrouille. s. f. Sorte d'écouvillon, de fourgon pour balayer le four. - (10) |
| patrouiller, v. patauger. - (38) |
| patrouner. v. n. Mal faire le pain. (Merry-la-Vallée). - (10) |
| patrouyon, enfant qui patrouille dans la boue. - (16) |
| pattassi : marcher, marcher sur place - (51) |
| patte (nom féminin) : chiffon dont on se servait (avant l'éponge) pour faire la vaisselle. - (47) |
| patte : (nf) chiffon - (35) |
| patté : avoir de la terre collée à la semelle de ses souliers - (61) |
| patte : chiffon - (34) |
| patte : chiffon - (44) |
| patte : chiffon - (51) |
| patte : Chiffon, loques. « S'te chemige est euse alle est bonne à mentre es pattes » : cette chemise est usée elle est bonne à mettre avec les chiffons. « Allons les enfants i est temps d'aller es pattes (d'aller au lit) ». - (19) |
| patte : chiffon. Le mot serait d’origine germanique. - (62) |
| patte de colloure : filtre en tissu utilisé pour coller le lait dans la colloure - (51) |
| patte d'euille : tussilage - (43) |
| patte d'ouaîe (na) : patte-d'oie - (57) |
| patte moïlle n.f. Chiffon humide utilisé pour repasser avec un fer. - (63) |
| patte n.f. 1.Serpillère. 2. Vieux vêtement, chiffon. - (63) |
| pàtte ou pate (C.-d., Morv., Chal., Br.). Pièce d'étoffe, chiffon ; le pattier est un chiffonnier. On appelle têtes de pattes, les femmes du peuple en bonnet de linge… D'autre part, les tailleurs appellent patte la petite bande d'étoffe attachée par un de ses bouts à une partie du vêtement et dont l'autre bout porte soit un bouton, soit une boutonnière ; c'est aussi une petite bande d'étoffe de couleur tranchante qui fait partie du parement d'un uniforme ou d'une livrée. - (15) |
| patté ou pattier : chiffonnier. Et aussi : marchand de peaux de lapins. - (62) |
| patte : s. f., chiffon.Patte mouillée, linge mouillé dont on menace de fouetter les enfants pour les corriger. Au fig., personne molle et sans énergie. - (20) |
| patte : s. f., empan. Voir arpan. - (20) |
| patte, n.f. chiffon. - (65) |
| patte, s. f. racine d'arbre plus ou moins ramifiée. L'arbre est abattu, il ne reste plus que la « patte. » - (08) |
| patté, s. m., acheteur ambulant de peaux de lapin, chiffons, ferraille, etc... - (40) |
| patte, subst. féminin : chiffon. - (54) |
| patte. Vieux chiffon. - (49) |
| patte-a-cul : s. m., qualificatif donné à celui dont le pan de chemise passe à travers son pantalon. - (20) |
| pattelôt n.m. Bohémien, marchand de vêtements au marché. Voir gueuriaud. - (63) |
| patter (Se). v. pron. Se salir de boue, se crotter. T'en as un' culotte pattée, mon pour' houme ! – Se dit, adjectivement, de tout ce qui est malpropre. Viens ici, moue patté (moure sale), que j' te débarbouille. (Villeneuve-les-Genêts). - (10) |
| patter (v. int.) : emporter de la terre à ses semelles, en marchant sur un sol boueux ou détrempé - (64) |
| patter : avoir les chaussures couvertes de houe. III, p. 32 - (23) |
| patter : s'engluer les sabots ou les chaussures de glaise ou de boue collante. Ex : "Après c'qu'a tombé d'yau, té vas patter dans l'garet !" - (58) |
| patter. v. - Avoir les chaussures crottées, collant au sol et gênant la marche: « Aveuc c'qué tombé ça va patter, mets don' tes bottes ! ... - (42) |
| patteraud, patteraude : s. m. et f., nomade. - (20) |
| pattes (ai quaite), loc. a quatre pattes, sur les pieds et sur les mains. - (08) |
| pattes : Pas d'âne, tussilage, tussilago farfara. « An fâ eune bonne infusion dave des flieus de pattes ». - (19) |
| pattet : s. m., vx fr. patet, drapeau, lange ; personne molle, sans énergie, peu débrouillarde. A Tournus, on dit un Saint-Pattet. - (20) |
| patti (on) : chiffonnier - (57) |
| patti : (nm) chiffonnier - (35) |
| patti : Chiffonnier, marchand de pattes. « Oh ! le patti ! » : cri du chiffonnier ambulant, ou encore : « Archeau pattes ! », marchand de pattes ! - (19) |
| patti : chiffonnier, marchand de peau, de lapin, de ferraille - (34) |
| patti : chiffonnier, marchand de peaux, de lapins, de ferraille - (43) |
| pattî n.m. Chiffonnier, marchand de peaux de lapin, de ferraille. - (63) |
| patti, pattire : s. m. et f., pattier, pattière (chiffonnier, chiffonnière). - (20) |
| pattiauder v. Peloter, palper, tripoter. - (63) |
| pattié, s. m. on donne ce nom au modeste industriel qui parcourt nos campagnes avec une voiture attelée d'un âne pour ramasser les chiffons et le vieux linge. Les « pattiers » de Château-Chinon avaient jadis une certaine notoriété dans le Morvan. - (08) |
| pattier : chiffonnier - (44) |
| pattier, n.m. chiffonnier, ferrailleur. - (65) |
| pattier, patché (n.m.) : chiffonnier, marchand ambulant qui récoltait la ferraille et les peaux de lapins - (50) |
| pattier, subst. masculin : marchand de pattes, ferrailleur. - (54) |
| pattiflée : s. f., gifle. - (20) |
| pattoire : adj., minutieux, tâtillon. - (20) |
| pattou, ouse, adj. pattu, celui qui a une grosse patte. Se dit surtout d'une racine d'arbre très ramifiée : « eun châgne pattou. » - (08) |
| pattoux : Pattu. « ln pigean pattoux ». - (19) |
| patural, paturail : s. m., vx fr. pasturel, pâtis. - (20) |
| pàturiau, s. m., petit pâturage. - (14) |
| patyire : patière. - (30) |
| pau - pieu. - En pliantant in pau ci souteinré lai bôcheure. - Aitaiche lai jement aipré le pau que voilai et pu te t'en iré. - (18) |
| pau (n.m.) : pieu (de l'a.fr. pal, du latin, pallus) - (50) |
| pau (pour pal). s. m. Piquet, écbalas, paisseaux. (Menades). - (10) |
| pau : Adverbe, peu. « In tant sait pau » : un tant soit peu. - (19) |
| pau : Pal, pieu. « In pau de banne ». « Le pau de banne » : est une forte pièce de bois à l'aide de laquelle deux hommes transportent une benne pleine de vendange, un râ. La benne est suspendue au pau par deux anneaux d'osier (cordots) engagés dans les cornes de la benne et chacun des porteurs place sur son épaule une des extrémités du pau. - Quand il pleut et qu'en même temps le soleil luit les gens disent, on ne sait trop pourquoi : « I pliô, i fa chaud, le diabe bat sa fane à grands cos de pau ». - (19) |
| pau : pieu - (60) |
| pau : pieu de clôture d'un champ (cf. le français pal). - (52) |
| pau : piquet de clôture - (34) |
| pau : s. m. instrument pour décharger les bennes. - (21) |
| pau n.m. (du lat. palum, le pieu) Pieu, gros piquet. - (63) |
| pau : (pô: - subst. m.) pieu, piquet, poteau. Pô: fêr = barre à mine. - (45) |
| pau*, s. m. piquet. - (22) |
| pau, n. masc. ; échalas, pieu. - (07) |
| pau, n.m. pieu. - (65) |
| pau, paul : s. m., vx fr. paul, pal, pieu. - (20) |
| pau, pieu. - (05) |
| pau, s. m. piquet (du latin palum). - (24) |
| pau, s. m. piquet, pieu dont on se sert pour renforcer les haies, surtout celles qui sont appelées sèches parce qu'elles sont faites de main d'homme avec des branchages coupés. On les nomme « tresses » dans une grande partie du Morvan. - (08) |
| pau, s. m., pal, pieu, poteau. - (14) |
| pau, s.m. pièce de bois passée dans les anneaux de la vis du pressoir, pour serrer. - (38) |
| pau. Pieu ; vieux mot qui vient de palus. - (03) |
| pau. Pieu. Pau en français ne se dit plus, pas même au pluriel… - (01) |
| pauche : Pêche. « Ol est allé à la pauche es escrevisses dans la Natouze ». - (19) |
| pauchi : Pêcher. « Ol est allé pauchi des goujans en Grijan ». - (19) |
| pauchoule, s. f. intestins d'un rat, d'un crapaud sur lesquels on a marché et qui se sont répandus ; méconium d'un oiseau. - (22) |
| pauchouse : Matelotte de poissons au vin blanc. La pauchouse est faite avec plusieurs espèces de poissons, c'est une spécialité chalonnaise, on emploie de préférence pour confectionner la pauchouse le petit vin blanc de Bragny. - (19) |
| pauchouse, s.m. mets bourguignon. - (38) |
| pauchoux : Pêcheur. « Dans des pays c'ment Mancy queva i a point de revire i peut guère y avoir de pauchoux » : dans des pays comme Mancey où il n'y a pas de rivière il ne peut guère y avoir de pêcheurs. - (19) |
| paud - pot : poteau (prononcer paaaud). Ex : "J'vas aller mett' ène chén' entermi les deux pauds!" (chéne = chaîne) Ex : "Eh ! Un paaaauud !" Il s'agit d'une menace, d'un désaccord, d'une colère et signifie : "Si je ne me retenais pas je lui (je te) donnerais un coup de gourdin !" Variantes : "Donnez-moi un gourdin !" "Si je prends un gourdin !" Ou bien : "Tu mérites vraiment une correction !" Ou bien encore, plus subtilement : "Arrête tes conneries !" - (58) |
| pauded’ieule, s. f. pirouette sur la tête (jeu d'enfants). - (22) |
| pauficher. Travailler maladroitement. Voiqui un auvraige qu’ast paufiché, les preux ne sont pas aissez profonds. On dit d'un homme qui veut aller trop vite qu'il travaille à paufiché, c'est-à-dire à pieu fiché, comme fait un planteur trop pressé... - (13) |
| paufichot (n.m.) : pieu, plantoir - (50) |
| paufichot. s. m. pieu, piquet, plantoir de jardinier. - (08) |
| paufile*, s. f. ruban par lequel la quenouille s'attache au côté gauche de la fileuse. - (22) |
| paufile, s. f. ruban par lequel la quenouille s'attachait au côté gauche de la fileuse. - (24) |
| pauforche, s. f., pieu terminé en fourche. Les chasseurs appellent pauforceau le piquet auquel ils attachent le filet pour pluviers. - (14) |
| paufouler (v.) : fouler, écraser avec le pied - (50) |
| pauge, s.m. pouce. - (38) |
| paugeoâ-yer, v, écraser avec le pouce. - (38) |
| paugeri, s.m. gant pour protéger une blessure au doigt. - (38) |
| paûgner, taûgner : hésiter - (37) |
| paûille : pou. - (31) |
| pauiller, prendre l'eau par les chaussures - (36) |
| pauilles et poyons. Poux. Ne vai pas vée lu, a te beillerai des pauilles ; al en ast cousu. - (13) |
| pauillot (n.m.) : pou - (50) |
| pauillu (-use) (n. et adj.m. et f.) : pouilleux, pouilleuse - (50) |
| paulai, nettoyer à la paule (pelle). Faire lai paulée signifie se régaler après le pressurage. - (02) |
| paûle (na) : pelle - (57) |
| paule : (nf) pelle - (35) |
| paule : pelle - (43) |
| paule : Pelle. « In mange de paule » : un manche de pelle. « La paule du fô » : large pelle de bois qui sert à enfourner le pain En parlant d'une mauvaise odeur: « An en ramasse pu ave le nez que dave eune paule ». « An li a foutu la paule au cu » : on l'a chassé honteusement. - Vanne. « I n'y a pas eune gotte d'iau dans le bé i a quéquin qu'a levé la paule » : il n'y a plus une goutte d'eau dans le lavoir, il y a quelqu'un qui a levé la vanne. - (19) |
| paule de faure : pelle à enfourner - (43) |
| paule de fô : (nf) pelle à enfourner - (35) |
| paule- maule. Pèle -mêle, de pelle et de mêler, comme quand on entasse diverses sortes de grains avec une pelle. - (01) |
| paule : s. f. pelle. - (21) |
| paule, paulie, s. f. vanne à retenir l'eau. - (22) |
| paule, pelle. - (05) |
| paule, s. f. pelle. Diminutif palœtte, pelle à feu. - (24) |
| paule, s. f., pelle, pour le feu, pour le four. - (14) |
| paule. : Pelle.- De ce substantif on a fait le verbe paulai (pêler, nettoyer avec la pelle). Paulai lé vaiche c'est extraire le fumier de l'étable des vaches. Paule-maule sont deux datifs qui signifient littéralement : Sers-toi de la pelle et rassemble en tas ; mais de la forme du datif ces expressions ontpassé à la forme adverbiale, paule-maule pour le patois, pêle-mêle pour le français. - (06) |
| paulée (n.f.) : repas qui marque la fin des moissons et des fenaisons - (50) |
| paulée (repas de la), souper qui se donne à la fin du battage, et ainsi nommé de la dernière pellée de blé que l'on de ramasser. (Voir Renard.) Également repas donné aux gens du pressoir après le pressurage qui termine les vendanges. - (14) |
| paûlée : fin d’une cueillette - (37) |
| paulée : fin d'un travail (fauchaison, moisson) - (48) |
| paulée : fin d'un travail. - (31) |
| paulée : Pelletée. « Eune paulée de tarre » : une pelletée de terre. - (19) |
| paulée : petit réjouissance (galettes, bonnes bouteilles, chansons…) entre gens qui ont fané ou moissonné ensemble pour marquer la fin des foins ou de la moisson (voir bouquet). - (33) |
| paulée des batteurs en grange. - (05) |
| paulée – repas, fête, quand on a fini la moisson, la vendange. – En fauré, note mâte, no fâre fâre ine bonne paulée. – A nos é dit que sai maillon finie i fairains lai paulée. - (18) |
| paulée : n. f. Réjouissance de fin de récolte. - (53) |
| paulée, et pâlee, s. f., pellée, pelletée, le contenu d'une pelle. - (14) |
| paulée, paula. Fête de la moisson, qui a lieu dans chaque ferme, la dernière gerbe engrangée. Elle consiste en un copieux et joyeux festin. - (49) |
| paulée, pauyée, sf. repas de moisson, tue-chien. Par ext., repas copieux, bombance. - (17) |
| paulée, pôlée (C.-d., Br., Morv., Chal.), paulâ (Char.). - Voici encore un mot destiné, comme plusieurs autres déjà cités, à exercer le talent et la patience des linguistes. La paulée est un repas qui se donne en Bourgogne à la fin d'un travail rustique, fauchaison, moisson et surtout après les vendanges, principal travail du pays. Plusieurs étymologies en ont été données, sans avoir paru complètement satisfaisantes… - (15) |
| paûlée, s, f., fête à la fin des moissons ou des vendanges. - (40) |
| paulée, s. f. repas, régal qui se donne dans nos campagnes à la suite de la fauchaison ou de la moisson. Lorsque les voituriers amènent le dernier chariot de foin ou les dernières gerbes, les ouvriers crient : paulée, paulée ! les voix traînant avec insistance sur la première syllabe. « pouâlée. » - (08) |
| paulée,s.f. fête qui suit la fin des vendanges. - (38) |
| paulée. Petit festin qui termine les longs ouvrages de la moisson, de la vendange, de la construction d'une maison. Aillons, mes enfants, dépouâcbons-neus de rentrer les jarbes devant lai pleue ; ai ce sair, (à ce soir) j’irons fare eune bonne paulée. Dans une famille nombreuse, lorsque la dernière fille se marie, les jeunes gens de la noce grimpent sur le toit et vont planter, en haut de la cheminée, un gros bouquet enrubanné. On fait des libations en arrosant ce bouquet avec des vins du crû et l’on chante à tue-tête : Sancte Paule, ora pro nobis... Une paulée est le contenu d'une poêle : on dit de même une chaudronnée, une casserolée, une potée. Or le grand régal des campagnards était un ragoût, une fricassée de volaille, de lapin ou d'autre viande, cuite rapidement dans la poêle. C'est bien le sens donné - (13) |
| paulée. : Régal. Lai paulée (du latin epulum), est le repas donné à ceux qui font le vin après que l'opération du pressurage est terminée. - (06) |
| paule-maule - mélange confus de différentes choses. - Que lote maillon â don mau tenue ! tot y â paule-maule, les haibits, les chéres, le pain ; en pourot dire les bêtes aitot. - (18) |
| paule-maule, entassement fait avec la pelle. Jargon de vendangeurs... - (02) |
| pauler, v. tr., remuer, nettoyer avec la pelle. - (14) |
| pauli, s. m. vanne à retenir l'eau. - (24) |
| paûlx : pieu en bois, piquet de haie - (37) |
| paumache, s.f. mâche. - (38) |
| paûme (na) : balle (petit ballon) - (57) |
| paume : balle de jeu. - (62) |
| paume, s. f. balle dont les enfants se servent dans leurs jeux. - (08) |
| paumée, paumai - gros, extraordinaire. A pou le co ! en voilai ine paumée… ine bétie ! ! - (18) |
| paumée, s. f. soufflet en pleine joue. - (08) |
| paumelette, s. f. paume à jouer. - (24) |
| paumer, v. a. frapper avec la main, battre, souffleter. - (08) |
| paumer. v. - Attraper : « Te vas voué quand j'l'aura paumé, i' va s'en rapp'ler ! » Ce mot est directement dérivé de l'ancien français palme, la main. Au XIIIe siècle, paumer signifiait : attraper, prendre sur le fait ; le dialecte poyaudin a conservé ce sens. - (42) |
| paumillon. s. m. Avant-train d'une charrette. (Gurgy, Sougères-sur-Sinotte). - (10) |
| paur, paure (adj. et n.m. et f.) : pauvre - (50) |
| paur, pauv'e. Pauvre. - (49) |
| paur, pauvre. Un homme ou une femme même octogénaires disaient, en parlant de leurs parents, mon paur-père, mai paur' mère ; une veuve, en parlant de son mari, mon paur' homme ; un veuf, en parlant de sa femme, mai paur' fanne. Paur' exprime ici une idée de regret, de piété filiale. - (27) |
| paure : mucus nasal, poireau - (43) |
| paure : Pauvre (adjectif). « An a bin des maux pa gâgni sa paure vie ». « Héla cen paure ! » : hélas le pauvre ! - (19) |
| paure : qui inspire de la pitié. Un paure gars : un pauvre gars. - (52) |
| paure : pauvre - (39) |
| paure, adj. pauvre. - (38) |
| paure, pauvre - (36) |
| paureille, s. f. pauvresse, terme d'amitié. - (08) |
| paurion. Pauvre ; en mauvaise part. - (03) |
| paurosse, s. f. pauvresse, une femme pauvre, une mendiante. - (08) |
| paurot (n.m.) : poireau - (50) |
| paurotte (n.f.) : poirée, ciboulette - (50) |
| paurou,ouse,adj. peureux, euse. Voir pörou. - (17) |
| paurquouai (adv.) : pourquoi - (50) |
| paurre, poûrre : pauvre - (37) |
| paurtant (conj.) : pourtant - (50) |
| paussou (ouse) : (pô:sou (ou:z') - adj.) peureux, poltron. Synonyme de crouin:dô:l'. - (45) |
| paussou, s. m. et f. peureux, poltron ; au féminin « paussouse » et quelquefois « paussoure. » - (08) |
| paut’lin : (nm) culbute - (35) |
| paûte (d'la) : pâtée (pour les animaux) - (57) |
| paute n.f. (or. inc.). Ballon en chiffons roulés en boule. - (63) |
| pauteler : dégringoler - (34) |
| pautenei. Pautonnier, vieux mot qui a eu diverses significations, mais toutes injurieuses… - (01) |
| pautenei. : (Pat.), paltonier, pautonier (dial.), gueux, coquin, vagabond, sans asile ; le mot paltonier, d'après M. Burguy, peut dériver du verbe latin palitari dont s'est servi Plaute dans le sens d'errer ça et là. - (06) |
| pautenet et pautenichon. Homme efféminé qui s'occupe du ménage et de la cuisine. - (13) |
| pauteure, s. f. fourrage en général, dans le sens d'aliment, de pâture. - (22) |
| pauthion : carcan placé dans le cou des chèvres pour les empêcher de traverser les haies - (34) |
| pautlin n.m. (de paute). Roulade, pirouette. - (63) |
| pautliner v. (de paute). Faire des pirouettes. - (63) |
| pautnaère, s.f. poche. - (38) |
| pautot,adj. massif ; le Pautot, surnom. - (38) |
| pautrai : piétiner partout (pautrer un jardin). - (33) |
| pautrailler, v., pelotter une fille et la tripotant et la pinçant. - (40) |
| pautrat : paysan mal dégrossi - (60) |
| pautrau, s. m., soupe très épaisse. - (40) |
| pautre. s. m. Lit. (Charentenay). - (10) |
| paûtrée : purée compacte - (37) |
| pautrée : soupe ou fricot très épais. So une boune pautrée. - (33) |
| pautremôle, s. m. désordre, confusion, désarroi : « ai lai pautremôle », à la débandade, sens dessus dessous. - (08) |
| pautremôler, v. a. mettre sens dessus dessous, en désarroi : « al é pautremôlé son butingn' », il a mis son avoir au pillage, il a embrouillé ses affaires. - (08) |
| pautrer (dans toute la Bourg.) - Fouler aux pieds, écraser, broyer. La pautrée est une purée de haricots ou de pommes de terre. La terre glaise, battue pour établir l'aire des granges, est de la terre pautrée. Vient du verbe pétrir qui se prononce ainsi en patois; de même pêcher se prononce paucber. - (15) |
| pautrer : fouler aux pieds. - (09) |
| pautrer : Patouiller, abîmer en marchant dedans. « Pautrer la millèche » : patauger dans la boue que l'on compare ainsi à de la bouillie de maïs (millèche). - (19) |
| pautrer : piétiner, tasser - (48) |
| paûtrer : piétiner. Écraser avec les pieds. Pour d’autres, tout simplement, pétrir. - (62) |
| pautrer : (pô:trè - v. trans.) piétiner, damer le sol avec les pieds, fouler. - (45) |
| pautrer, v. a. broyer, écraser, fouler. - (08) |
| pautrer, v. tr., marcher sur, piétiner, broyer, écraser : « Ô t'la vorteillé su l’sable, épeu ô t'I'a paulré c'ment ein tas d'pàtes. » - (14) |
| pautrer, v., aplatir, écraser le foin dans le fenil. - (40) |
| pautrer, verbe transitif : broyer, écraser au pilon. - (54) |
| pautrer. Faire de la pâte, plus spécialement faire du pain, par extension mêler avec les mains, broyer, éraser, mal faire une besogne. Etym. bouillie d'orge, qui a fait paste, pâte. - (12) |
| pautrer. Fouler aux pieds. - (03) |
| pautrer. v. n. Synonyme de patter. Se dit d'une terre argileuse et humide qui tient aux pieds. La terre pautre, on ne peut plus entrer dans les vignes, (Saint-Florentin). – Employé activement, signifie fouler la terre humide. - (10) |
| paûtrot : aliment trempé…. Comme la soupe trempée où le bouillon a été versé sur le pain. Un mélange alimentaire consistant ! - (62) |
| pautrou, ouse, adj. grossier, rustaud, quelquefois sale, malpropre. - (08) |
| pauv'e, s. et adj., pauvre, malheureux. - (14) |
| pauv'ment, adv., pauvrement. - (14) |
| pauvre : Mendiant (au féminin pauvrasse). « Ol est si bin intarassé qu'o donnerait pas in sou à in pauvre » : il est tellement avare qu'il donnerait pas un sou à un mendiant. - (19) |
| pauvre homme : Voir rikiki - (19) |
| pauvre : s. f., pauvresse. - (20) |
| pauvròsse, s. et adj., pauvresse, mendiante. En ce mot le r reparaît. - (14) |
| pauvrot. s. m. Mendiant. Fait, au féminin, pauvrosse. (Sénonais). - (10) |
| pauv'té, s. f., pauvreté, dénuement. - (14) |
| pauyot : poux - (34) |
| pavé : taché - (48) |
| pavé : s. m., route. A Mâcon, au XVIIIe siècle, on ne disait que le pavé de la Barre, pour la rue Bambuteau actuelle, et le pavé de Bourgneuf, pour la rue de Lyon actuelle. Ces deux rues sont des portions de roule nationale. - (20) |
| paver (se) : se tacher (surtout à table !). - (56) |
| pavot n.m. Coquelicot. - (63) |
| pavot, n.m. coquelicot. - (65) |
| pavot: (nm) coquelicot - (35) |
| pavotes. e. f. pl. Copeaux. (Soucy). - (10) |
| pavou : s. m. : coquelicot. - (21) |
| Payaude, Poyaude. n. f. - Puisaye. - (42) |
| Payaudin. n. m. - Poyaudin, habitant de la Puisaye. - (42) |
| payé : v. t. Payer. - (53) |
| päyer : (vb) payer - (35) |
| paÿèsse : panière en paille tressée (pour faire lever le pain) - (51) |
| pâyier chû lai bête (s’) : (se) rétribuer soi-même, « en nature » - (37) |
| paÿs(e) n.f. Ami(e), personne originaire du même village. - (63) |
| pays. Très usité pour village. - (12) |
| Pays-bas : région de plaine, par opposition au Morvan. VI, p. 2-3 ; VI, p. 6 - (23) |
| p'cha. Pissat, urine de bovin. - (49) |
| pché, vt. percer. Voir trèpché. - (17) |
| p'chée, p'chie. n.f. - Bécquée; synonyme de b'chée. - (42) |
| pçhi v. Pisser. - (63) |
| p'chi. Uriner, pisser. On dit couramment « aller p' chi ». - (49) |
| p'cho ; ein p'cho, un peu ; ein p'cho pu, un peu plus ; ein p'cho pu i tombô, un peu plus je tombais. - (16) |
| pcho ou pcheu. Peu, un peu. Ex. : « Donnez-moi un pcho de tabac pour bourrer ma pipe. » La vraie locution est même eum pcheu : « Donnez-moi eum pcheu de ceci ou de cela. » - (12) |
| p'chò, adv. de quantité, peu : « T'as ein fameux quignòt d'pain ; baille-moi-z-en donc eùn p'chò. » Un ramollissement de prononciation a fait que certains en sont venus jusqu'à dire : un m'chò. (V. ce mot.) - (14) |
| pchö, mchö, adv. peu. Tant si pchö que, si peu que. È mchö, un peu [vx f. un pochet]. - (17) |
| pchon (un) ptchon (un) : un petit peu - (51) |
| pchon : poisson - (51) |
| pçhon n.m. Poisson. - (63) |
| p'chon, b'chon, pochon, pouchon. n. m. - Petit morceau, petit bout, un peu. - (42) |
| p'chon, pochon, pouchon (du latinm paucum). s. m. Petit morceau, parcelle, un peu. - (10) |
| pchonni : poissonnier - (51) |
| p'chot (in p'chot), un peu. - (38) |
| p'chot : peu. Un p'chot : un peu. - (33) |
| p'chot : adv. Peu. - (53) |
| p'chot, adv. de quantité. peu, une petite quantité. - (08) |
| pchtio : petit - (44) |
| p'cin : poussin - (39) |
| p'cin, s. m. poussin, petit poulet nouvellement éclos. - (08) |
| p'çot (un), (un) peu - (36) |
| p'çot : peu. Un p'çot : un peu. Dounne m'en un pçot peu : donne-m’en un petit peu. Paulette dit : « un m'çot ». - (52) |
| pé (l'pé de vache), s.m, pis de la vache. - (38) |
| pe : fatigué - (44) |
| pe : laid - (57) |
| pé : père - (61) |
| pé : Pis, mamelle. « La vaiche nare a in ban pé » : la vache noire a un bon pis, un pis volumineux. - (19) |
| pe : pour - (43) |
| pe : puis - (46) |
| pé n.m. Pis de la vache. Voir posse. - (63) |
| pè : (pê: - subst. f.) peau. - (45) |
| pè, adv. pis. De pé qu'autan, de pis en pis. Voir pö. - (17) |
| pè, adv. puis. Et pé, et puis. [Dans la vallée de la seine, on dit peu.] - (17) |
| pé, et pî, s. m., pied. - (14) |
| pè, piau, sf. peau. - (17) |
| pé, pis ; tant pé, tant pis ; les jeunes disent : tan pire. - (16) |
| pé, s. m. pis : le « pé » d'une vache, le « pé » d'une brebis, d'une truie. Pé indique l'ensemble des trayons que nous appelons ici « totos. » - (08) |
| pé, s. m., pis de la vache. - (40) |
| pé. n. m. - Père. - (42) |
| pè. Pis, mamelle de ruminant. - (49) |
| pea. Peau, peaux. - (01) |
| peai, s. f. peau, enveloppe d'un corps : « lé sorciés s'haibillan daivou lai peai deu guiabe », les sorciers se cachent sous la peau du diable. - (08) |
| peau de diable : s. f., peau de taupe, nom d'une étoffe très résistante. - (20) |
| peau de poulet : s. m. Avoir la peau de poulet, avoir la chair do poule. - (20) |
| peau, n.f. cuir. - (65) |
| peau, peutte. Laid, méchant. Cet adjectif s'emploie dans le sens propre et dans le sens figuré. I ne veux pas me mairier d'évou lu, al ast trop peut - Te m’ai fait fâre eune peutte besogne... - (13) |
| peaufichot : n. f. Plante chou. - (53) |
| peautrer (se). Se rouler, s'enfoncer dans de l'eau sale, de la boue. - (49) |
| pecavi. Ce terme, à force d'être répété par le vulgaire, étant devenu comme français, n'est écrit par cette raison qu'avec un c. - (01) |
| peccata, s. m. ane, souffre-douleurs, plastron. - (08) |
| peceuner (v.) : toucher, tâter avec la main (le peuce = le pouce) - (50) |
| pechai : barreau d'échelle. (MM. T IV) - A - (25) |
| péchais : (péchê: - subst. m.) (terme de vannerie) côte de panier. Pour évaser le panier, on en augmente le nombre, quatre par quatre. - (45) |
| péchais. s. m. Paisseau. (Girolles). - (10) |
| péchau, pachau n.m. Barreau d'échelle. - (63) |
| pechau, s. m., paisseau. - (40) |
| pèchau. Échalas de vigne barreau de barrière ou d'échelle. - (49) |
| pechaÿ, s. m., pêcher - (40) |
| péche (na) : pêche - (57) |
| pêche : s, f., endroit d'une rivière bon pour la pêche naturellement ou par suite d'amorçage. - (20) |
| pécheau (n.m.) : barreau de chaise ou d’échelIe (aussi paicheau) - (50) |
| pécheler, v. tr., paisseler, garnir d'échalas. Se dit pour étayer la vigne, et ramer les pois. (V. Pessiau.) - (14) |
| pécheleùre, s. f., paissclure, petit lien de chanvre. Les vignerons s'en servent pour attacher, après la taille, la vigne aux paisseaux. (V. Pessiau.) - (14) |
| pecheniquo, tant soit peu de. Diminutif de pecho, paucum en latin. - (02) |
| pêcherie : mare, abreuvoir - (60) |
| pêcherie : mare. (SS. T IV) - N - (25) |
| péchi (on) : pêcher - (57) |
| péchi : pêcher (verbe) - (57) |
| pêchi : Pécher, persica vulgaris. « Ol a plianté des bans pêchis dans ses vignes ». « Des pêches de chin » de mauvaises pêches, amères. - (19) |
| péchiller, v. m., manger peu, et presque avec dégoût : « D'peù qu'ôl a été mau, l'opetit ne r'veint pas ; ô n'fait qu'péchiller. » - (14) |
| pecho et poucho. Peu. Le premier est un diminutif de peu, le second du vieux mot pou. - (03) |
| pecho, ou plutot par abréviation p'cho (in) - un peu. - In pecho de plieue fairo du bein. - Beillez-moi z-en in pecho. - I ons été in pecho mailaides. - (18) |
| pecho. Peu, et encore moins que peu ; c'est un diminutif de peu… - (01) |
| pechô. : Peu. Diminutif pechenicô, tant soit peu. Ces adverbes répondent aux adverbes latins pauxillum et pauxillulum. - (06) |
| péchon : barreau d'échelle ou de barrière. - (52) |
| péchon(s) : échelon(s) d'une échelle - (39) |
| péchot (un), expression, un peu. - (07) |
| pechot, peu. - (05) |
| péchou (on) : pécheur (poisson) - (57) |
| péchû (n.m.) : pêcheur - (50) |
| pécole : malade « honteuse » - (37) |
| pécolle (avoir la) : crève, maladie - (61) |
| pecquin, grossier paysan. - (05) |
| pecquoeu, s. m. queue d'un fruit. Pied d'un meuble. Verbe : empecoulé et dépecoulé. - (22) |
| pécuniaux, s. m., argent. Ne s'emploie qu'au pluriel : « C'téqui, ôl et à son afâre ; ôl a des pécuniaux. » - (14) |
| ped’yi, s. f. pitié. Adjectif : pen'yoeu, qui a de la pitié. - (22) |
| pedance (d'la) : pitance - (57) |
| pedance (faire de la), loc. se dit d'aliments qui, par leur saveur, permettent de manger beaucoup de pain avec. - (22) |
| pedance (faire de la), loc. se dit d'aliments qui, par leur saveur, permettent de manger beaucoup de pain avec. - (24) |
| pedju : perdu - (46) |
| pèdre, v. a. perdre. - (24) |
| pèdre, vt. perdre. . - (17) |
| pédri : perdrix - (48) |
| pèdri : (pèdri - subst. f.) perdrix. - (45) |
| pédri, perdrix. - (16) |
| pêdris, sf. perdrix. - (17) |
| pedrix (na) : perdrix - (57) |
| pédrix : perdrix - (39) |
| pédrix, padrix. n. f. - Perdrix. - (42) |
| ped'yi, f. pitié. Adjectif ped'you, qui a de la pitié. - (24) |
| pée : père. - (52) |
| pée, s. m. père. - (08) |
| péèche, s. f., pêche. - (40) |
| péétrâs : balourd, empoté, « emprunté » - (37) |
| pege : s. f, vx fr., poix, glu, et toute malière gluante. - (20) |
| péger : (péjé - v. trans.) piétiner, fouler aux pieds. - (45) |
| peger : v. n., poisser. Voir apeger. - (20) |
| pegeux, pegeoux : adj., poisseux. - (20) |
| pegneau, pagneau, panneau (du latin pannus). s. m. Treille de vigne plantée le long d'un champ pour en déterminer la limite. (Armeau, Courgis). - (10) |
| pegnitence. Pénitence… - (01) |
| pegnon, s. m. débris de fourrage après qu'on a « pegni » (peigné) un char de foin ; amas de mauvaises herbes enchevêtrées. - (22) |
| pegnou : homme qui peignait le chanvre - (43) |
| pegnoures, s. f. pl. débris de fourrage après qu'on a « pegni » (peigné) un char de foin ; amas de mauvaises herbes enchevêtrées. - (24) |
| pégosse. n. m. - Pou. - (42) |
| pégosse. s. m. Pou. (Puysaie). - (10) |
| pei. Pis, en latin pejus ; ou pis, mamelle de vache, de truie, de brebis, etc. ; mais en bourguignon, pei se dit du sein d'une nourrice en général : « Velai une norice qui é un bea pei », voilà une nourrice qui a un beau sein. Pei vient de pectus, et proprement signifie poitrine. - (01) |
| peiché. Péché, péchés. Il est verbe quand on dit j'on peiché, nous avons péché. Pu to meuri que peiché, plutôt mourir que pécher. - (01) |
| peignard : s. m., peigneur. Peignard à cane, peigneur de chanvre. (Archives mun., GG, 41, 16 oct. 1625). - (20) |
| peigne de chat. Cardère à foulon. - (49) |
| peigne-treue : chardon (litt. pei-truie). - (32) |
| peignon, pégnon (n.m.) : pignon d'une maison - (50) |
| peignon, s. m. pignon, partie de mur à pointe triangulaire qui unit entre eux les gouttereaux d'une maison. - (08) |
| peignon. Pignon. - (49) |
| peignon. s. m. Quantité de chanvre que le peigneur travaille à la fois, ou que le cordier s'enroule autour du corps pour filer. (Puysaie). - (10) |
| peignouaîr (on) : peignoir - (57) |
| pèil : pis. (LEP. T IV) - D - (25) |
| peillaisse, s. f. paillasse de lit. - (08) |
| peillasse : Paillasse. « Sa borse était caichie dans sa peillasse ». - (19) |
| peillasse : s. f. paillasse. - (21) |
| péillat, paillat (n.m.) : corbeille en paille ou en roseau tressée - (50) |
| péille (n.f.) : paille - (50) |
| peille (nom féminin) : chiffon sans valeur. - (47) |
| peille : le pis d'une vache - (46) |
| peille : Paille. « In fageut de peille » : un fagot de paille. « In cova de peille » : un toit de chaume. « Charchi des pos dans la peille » : chercher des poux dans la paille, chercher la petite bête. - (19) |
| peille : n. f. Paille. - (53) |
| peille : paille - (39) |
| peille : s. f. paille, tas de paille. - (21) |
| peille, paille. - (05) |
| peille, s. f. paille. - (08) |
| peilleraud, pilleraud. Chiffonnier. Fig. Chemineau, personne mal mise. - (49) |
| péillesson (n.m.) : paillasson - (50) |
| peilli : Meule de paille. « O s'était caichi daré le peilli » : il s'était caché derrière une meule de paille. - (19) |
| peillier, paillier, meule de paille. - (05) |
| peinde v. Peindre. - (63) |
| peindu - peint. On dit aussi Peinturé. - Les grands tableaux que sont dans l'Église c'â Mossieu Rocaut que les é peindus. - Madame Lejeune é peinturé le joli câdre qu'â dans lai chaipelle de S'-Mairtin. - (18) |
| peindu p.p. de peinde. Peint. - (63) |
| peindu : part, pass., peint. - (20) |
| peindu, part., peint : « Jarnidié ! ç’â biau cheù lu ; ses vôlots sont peindus en vâr. » - (14) |
| peindu, participe passé de peindre. - (02) |
| peine : s. f, prendre peine de quelqu'un ou de quelque chose, s'en préocuper, en avoir du souci, s'en inquiéter. - (20) |
| peine, pièce de bois de toit. - (05) |
| peiniller. v. n. Peiner, plier sous le fait. Quand un arbre est chargé de fruits, ses branches peinillent. (Etivey). - (10) |
| peinne : peine - (51) |
| peinteurer v. Peindre. - (63) |
| peinteûrleûrer : peindre - (37) |
| peinturlurer, v. tr., peinturer, peindre grossièrement, barbouiller. - (14) |
| peinturluroù, s. m., celui qui peinture ; barbouilleur d'enseignes. - (14) |
| peire. Gran-peire. Père, grand-père ; peire signifie aussi pire : Le remeide a peire que le mau, le remède est pire que le mal. Peire-gran est la même chose que gran-peire, grand-père ; No peire- gran, nos grands-pères, nos anciens pères. - (01) |
| peirefou. La coutume dont nous allons parler est spéciale à la ville de Nuits. Notre ami et collègue, M. Emile Bergèret, a bien voulu nous donner des détails précis sur cette fête populaire. Le jour des Saints-Innocents, on fouettait les petits enfants, ou du moins on en faisait le simulacre. C'était évidemment ta commémoration du massacre de tous les premiers nés d'Israël, ordonné par le roi Hérode. Cette petite fessée leur donnait droit au Peirefou de la fête des Rois. Qu'était-ce donc que le « Pérefou ». Une sorte de gâteau confectionné par les mères de famille.... Le souvenir biblique des rois Mages s’est mélangé avec les réjouissances mondaines du XVIe siècle. Beaune avait sa fête de l’âne, Dijon possédait la Mère-folle : Nuits voulut avoir son Père-fou. Le bonhomme de pâte était la représentation d'un personnage qui doit avoir figuré dans un cortège nuiton. - (13) |
| pejòter, v. n. s'agiter sur place, avec impatience, comme si on craignait d'avoir les pieds « pejis ». - (24) |
| pejouté, v. n. s'agiter sur place, avec impatience, comme si on craignait d'avoir les pieds « pejis ». - (22) |
| pêle : grosse marmite pour la cuisson des aliments du bétail. (BD. T III) - VdS - (25) |
| pelé, s. m. riz au lait. - (22) |
| pêlée (faire la) : régal à la fin d'une entreprise. - (09) |
| peler v. Piler. - (63) |
| pélering (n.m.) : pélerin - (50) |
| peleu, serpolet, pouillot. - (05) |
| peleuss-hes, prunelles. - (05) |
| pelisse, s. f., fragment de peau de mouton, que l'on met sur les sabots en en rentrant le bout en dedans, afin d'amortir la dureté du bois sur le cou-de-pied. - (14) |
| pelisse. Lanière de peau, garnie de sa fourrure, que l'on introduisait dans la partie supérieure des sabots, pour préserver le coude-pied ; l'extrémité de la pelisse s'étalait à l'extérieur. Au moyen-âge, les fabricants de fourrure étaient appelés pelissonniers. - (13) |
| pelle : s, f., vanne. - (20) |
| pellée, ce que contient une pelle. Une pellée de terre... - (02) |
| pellicon. : (Du latin pellicem), mante faite d'une toison. (Coutumes de Châtillon, 1371.) - (06) |
| peloce (p'losse) : s. f., vx fr. beloce, prunelle. Envoyer quelqu'un aux peloces, l'envoyer promener, l'envoyer au diable. - (20) |
| pelocier (p'lossier) : s, m., vx fr, beciocier, prunellier épineux (prunus spinosa). - (20) |
| pelon, s. m. gazon, motte. - (08) |
| pelosse : prunelle - (44) |
| pelosse, n.f. prunelle - (65) |
| pelosse, s. f. prunelle des haies. Polechi, prunellier (du vieux français béloce). - (24) |
| pelosse, s. f., prunelle, petite prune sauvage. - (14) |
| pelosses, prunelles. - (05) |
| pelossier : aubépine noire. - (30) |
| pèlou(se) : (pê:lou(ouz') - adj.) à peau dure et épaisse (en parlant de fromages qui ont vieilli en milieu sec). - (45) |
| pelouse, tapis de verdure. Dans l'idiome breton, plouz (Le Gon.) signifie paille... - (02) |
| penâ - punais. - I ons aichetai ine douzaine d'œufs ; quand en pense qu'en y en aivo deux penâ ! - Mossieu Lucotte é trouvai in œuf penâ, et c'â étai fini : a n'é pu velu ran aichetai chez no. - (18) |
| pènache (ā), sf. pou des animaux - (17) |
| penâge. s. f. Punaise. (Girolles). - (10) |
| pénaïa, punaillat. s. m. Bois punais, fusain. (Saint- Florentin, Saint-Maurice-aux-Riches-Ilomrr.es). - (10) |
| penaillan : guenille, vieux pan de chemise. - (30) |
| penaille (p'naille) : punaise - (39) |
| penaille, punaise - (36) |
| penaille. n. f. - Épi d'avoine. (Villiers-Saint-Benoît, selon M. Jossier) - (42) |
| penaille. s. f. Epi d'avoine ; du latin panicum ou panicula. (Vilhers-Saint-Benoit). - (10) |
| penailles - punaises. - I vein d'aichetai in lé, ma vos pensez bein qui vâ le passai â feu ; s'al aivo des penailles ? - (18) |
| penaillons : punaises. IV, p. 28 - (23) |
| penaillons, s. m., vieilles bardes, guenilles. - (14) |
| penais. Punais. - (49) |
| pénar. Penard. - (01) |
| penas, punais. - (05) |
| penau. Penaud, étonné, confus. Le mot penaud, qui n’est connu que depuis quelque soixante ans, a succédé à peneus, qu’on disait dans le même sens… - (01) |
| penchè : v. t. Pencher. - (53) |
| penchi : Pencher. « Vla eune meuraille que penche du côté qu'elle va cheu » : voilà un mur qui penche du côté qu'il va tomber, plaisanterie à la Palice pour dire : ce mur menace ruine. - (19) |
| pèn'cia (d'la) : paille (de maïs) - (57) |
| pencore - abréviation de pas encore. - A trouas heures ci ne seré pencore fini. - A n'éto pencore levai quand vos ête venu. - (18) |
| pendaine, n.f. terrain en pente. - (65) |
| pendaine, pendouille : s. f., pendant, s. m., vx fr, pendance, terrain en pente. Syn, de dépendaine. - (20) |
| pendaiñne : (nf) pente - (35) |
| pendain-ne : pente - (43) |
| pendain-ne : Talus, terrain en pente. « J'a bin trapi pa gravi ste pendain-ne » : j'ai eu de la peine à gravir ce talus. Lieu dit : « Ma tarre de la Pendain-ne ». - (19) |
| pendaiñne n.f. 1. Pente forte dans un terrain. Syn. beurdoûle et garaudaiñne. 2. Inclinaison forte de la vigne quand les grappes se font lourdes. La veugne fait pendaiñne. - (63) |
| pendant : coutre de charrue. - (31) |
| Pendant : Nom de lieu. « Les parraires du Pendant » : les carrières du Pendant, à Dulphey. - (19) |
| pende v. 1. Pendre. 2. Afficher sa publication de mariage à la porte de la mairie. Se pendre - (63) |
| pendeler. v. - Pendre. Au XIIIe siècle, on employait indifféremment pendre ou pendeler. Le poyaudin a conservé le second terme que le français a transformé en pendiller ou pendouiller. - (42) |
| pendenoillon, s. m. pendard, vaurien, homme on guenilles : un grand « pendenoillon » est à peu près ce qu'en français on appelle un grand pendard. - (08) |
| pendilouée, pendélouée. n. f. - Pendentif, bijou sans grande valeur. Mot employé dans un sens péjoratif. - (42) |
| pendiment : pendant - (48) |
| pendiment : pendant - (60) |
| pendiment : pendant. - (32) |
| pendiment : pendant. (MM. T IV) - A - (25) |
| pendiment : pendant. - (33) |
| pendiment que (loc.adv.) : pendant que - (50) |
| pendiment que, loc. pendant que, tandis que… on m'a volé « en ç'pendiment » que j'étais en voyage. - (08) |
| pendiôleries : (nfpl) nippes - (35) |
| pendler (v. tr.) : pendre (ant. dépendler) - (64) |
| pendouéiller, pendrouiller : pendre (lamentablement) - (48) |
| pendouéillon : chiffon, loque, oripeaux - (48) |
| pendoure : crémaillère. (MM. T IV) - A - (25) |
| pendrailler : (pen:drèyé - v. intr.) pendre comme un lambeau. Cf. fr. régional pendrouiller (avec l'influence des verbes en -ouiller). Composé de pendre et de drèy'. - (45) |
| pendre : (en parlant d’un terrain) être en pente - (35) |
| pendre : être en pente (terrain) - (43) |
| pendre : s. m., pendaison. - (20) |
| pendre : v. a. Pendre quelqu'un, afficher sa publication de mariage à la porte do la mairie. - (20) |
| pendreillons : oripeaux. Les clochards étint habillés aiquant des pendreillons : les clochards étaient habillés avec des oripeaux. - (33) |
| pendreûillou (âte) : (être) suspendu et balançant - (37) |
| pendriller (v.t.) : pendre comme une guenille - (50) |
| pendriller, v. a. pendre comme une guenille, comme une chose qui flotte. - (08) |
| pendriller, v. intr., pendiller, flotter: « Les penaillons, ô pendrilleint à la bise ; y étòt, ma fi, prou peùt ! » - (14) |
| pendrilli : Pendre. « Le corjan de man sulé pendrille » : le lacet de mon soulier pend. - (19) |
| pendrillon - chose déchirée, qui pend. - Ma ne vai pà sorti quemant cequi !... des pendrillons en bas de tai robe. - Que c'te fonne lai â don négligente ! aipré lé, aipré ses enfants, moinme aipré son homme, tojeur des pendrillons. - (18) |
| pendrillon (n.m.) : guenille, chiffon qui pend - (50) |
| pendrillon : n. m. Oripeau. - (53) |
| pendrillon, s. m. guenille, chiffon qui pend, qui traîne, qui flotte en l'air. - (08) |
| pendrillon, s. m., ce qui pend, cbiffon ; cordon qui pend derrière un vêtement mal ajusté : « Alle é, ma fi ! prou béle, avou tous ses pendrillons pou darrei sa rôbe ! » - (14) |
| pendrouiller : être suspendu et oscillant - (37) |
| pendu, -use p.p. de pende. Pendu,-ue. - (63) |
| penduse : part, pass, f., pendue. - (20) |
| pèné : panier. - (52) |
| péné : panier. - (59) |
| pené, pné adj. Puant, punais, pourri. - (63) |
| péne, s. f., panne, graisse garnissant la peau du porc. - (14) |
| péné, s. m. panier. - (08) |
| penège. Punaise. - (49) |
| penei ou p'né - panier. Voyez Painé. - (18) |
| penei, s. m., panier. - (14) |
| peneille, épis de maïs. - (28) |
| pèner. Balayer. - (49) |
| pénerée, s. f. un plein panier, le contenu d'un panier. - (08) |
| pénerée, s. f., le contenu d'un panier. - (14) |
| peneu (on prononce pneux), personne confuse... - (02) |
| peneú. adj., penaud, inquiet, mortifié, qui est en peine. - (14) |
| peneux - penaud - honteux, embarrassé. - Quand à nos é vu al â étai joliment peneû. - Al é don l'air peneû, ce gairson lai ! - C'à bein, ailé ; ile â peneuse aissez. - (18) |
| peneux et penâs. Synonyme beaunois de penaud. Honteux, déconcerté. Al ast peneux quemant un fondeux de clochees, on ajoutait mentalement : qu'ai manqué sai fonderie... On dit : les penâs de Corpiâ. Notre adjectif signifie punais aussi bien que peneux : le vilain sobriquet des gens de Corpeau pourrait même avoir le sens de pangnia, pannosus. (V. ce mot). - (13) |
| peneux, honteux. - (05) |
| peneux, penaud. - (04) |
| peneux. Penaud. Forme locale. - (12) |
| penibeye : pénible - (43) |
| pénibje, adj. pénible. - (17) |
| pénible : adj., désagréable, exigeant, capricieux. Oh ! quel enfant pénible ; il veut toujours se faire porter. - (20) |
| pénibye adj. Pénible. - (63) |
| penier, panier, pèné. - (04) |
| pènitiance, sf. pénitence. - (17) |
| penlîres n.f.pl. (de pendiller). Lanières, ficelles, semblables àdes franges, tombant devant les yeux des bœufs ou des chevaux pour les protéger des mouches. - (63) |
| penneauiller. v. n. Epousseter avec un panneau. (Percey). - (10) |
| penni, panis. - (05) |
| pennouille, épi de maïs, de panis. - (05) |
| penou : penaud - (57) |
| penou : s. m., vx fr. penne, plantoir. - (20) |
| penouille. Épi de blé de Turquie. - (03) |
| pènse, pincette de cheminée. - (16) |
| pense-bête : s. m., moyen vulgaire employé pour se rappeler quelque chose. - (20) |
| pensée : s. f. Menue pensée, pensée sauvage. En Maçonnais, elle passe pour un spécifique Infaillible contre le catarrhe. - (20) |
| penser (se) v. réfl. penser : « i m'pense, teu t'pense, a s'pence » pour je pense, tu penses, il pense. - (08) |
| penser (Se) : v. r., penser. Je m' suis pensé qu'i valait mieux que j'y alle. - (20) |
| penser (se), v. réfl., mais sens intr., penser : « I m’pense que t'pouròs ben m'rend' les quétes sous que j't'ai prôtés. » - (14) |
| penser de : voir de. - (20) |
| penser, v. intr., faillir, manquer, être sur le point de. « Ol a pensé cheûdre. » - (14) |
| pensi v. Penser. - (63) |
| pènsie, pincée de sel, de tabac, etc. - (16) |
| pension (se réduire a), loc. très usitée pour définir une situation générale dans le Morvan. Arrivés à un âge avancé, les parents remettent leur bien (leur butin) à leurs héritiers en échange d'une petite pension en argent ou en nature qui leur est toujours promise mais qui leur est rarement payée intégralement. - (08) |
| pensou (on) : penseur - (57) |
| pentecoûte (lai), la pentecôte. - (08) |
| pentsi : pencher - (43) |
| pentsi v. Pencher. - (63) |
| pentu (âte) : (être) en pente - (37) |
| peoei. Panier, paniers. - (01) |
| pêpê : mot masculin désignant une sauce très épaisse, la gadoue, la boue - (46) |
| pepée. Poupée. Terme plutôt enfantin. - (49) |
| pépère (l’) : (le) grand-père - (37) |
| pépère, subst. masculin : diminutif affectueux de grand-père, papy. - (54) |
| pépie : excroissance cornée sur la langue des poules, qui les empêche de manger et de boire. par extension, soif humaine permanente - (37) |
| pèpié : n. m. Papier. - (53) |
| pèpié, papier. - (26) |
| pepier, pépier. n. m. - Peuplier. - (42) |
| pépier, peupier, poupier. s. m. Peuplier. (Saint-Aubin-Châleauneuf, Villevallier, Laduz). - (10) |
| pépiniére (na) : pépinière - (57) |
| pépré : bête malade dépérissant, en général atteinte de tuberculose. A - B - (41) |
| pépré : bête malade qui dépérit, en général atteinte de la tuberculose - (34) |
| pépré adj. (d’un sens ancien de poivré, atteint d'une maladie vénérienne). Tuberculeux (pour du bétail). - (63) |
| pépré. Tuberculeux. Se dit du bétail : « in-ne vètse péprée ». - (49) |
| pèprèe (vache) : très maigre. - (30) |
| péprer v. Dépérir. - (63) |
| péquenot : paysan - (48) |
| péquenot : paysan - (39) |
| pér, père. - (26) |
| péràt, s. m., grosse pierre servant à amarrer un bateau. - (14) |
| perce-oreille : s. f. Une perceoreille. - (20) |
| percer, porcer : (pèrsé, porsé - v. trans.) percer, trouer. - (45) |
| percerette : s. f., vrille. - (20) |
| percerette, vrille. - (05) |
| percerette. Petite ville. - (49) |
| percevouair : percevoir - (57) |
| perchâ, s. m. perche, poisson. on prononce en plusieurs lieux « peurchâ. » - (08) |
| perche : ancienne mesure agraire variable selon les pays. - (55) |
| perche carrée : s. f., ancienne mesure de surface en général. La perche carrée de Paris valait 51 mètres carrés 065. La perche carrée de 19 pieds valait 38 mètres carrés 081. La perche carrée de Mâcon valait 5 mètres carrés 9355. La perche carrée de Dijon valait 9 mètres carrés 523. - (20) |
| perche : s. f., ancienne mesure de longueur pour les chemins. La perche de Paris, de 22 pieds, valait 7 m. 146. La perche de 19 pieds, en usage dans certaines régions, valait 6 m. 171. La perche de Mâcon, de 7 pieds 1/2,- comme la toise, valait 2 m. 436. La perche de Dijon, de 9 pieds 1/2, valait 3 m. 085. - (20) |
| perchée. s. f. Ligne, rangée de ceps dans une vigne. - (10) |
| perchie, s. f. perchée, tout ce qui peut se mettre sur une perche : « eune perchie d'râzins », une perchée de raisins. - (08) |
| perchòte, s. f., petite perche, perchette, soutien d'un jeune arbre. - (14) |
| perçon : (pêrson - subst. m.) sorte de cloche en grillage qui sert à isoler une volaille. Par métaphore, le mot a servi àdésigner péjorativement, lors de son apparition, le parc où l'on met les petits enfants qui ne savent pas encore marcher. - (45) |
| perdaule, pardaule, adj. chose qui peut se perdre aisément, sujette à se perdre. - (08) |
| pèrde, peurde v. Perdre. p.p. peurdu. - (63) |
| perdi ; autre orthographe de pairdi - sorte de jurement, d'assurance, d'affirmation. Cequi, ? oh ! i le fairai perdi bein âjedeu, vos pouvez y comptai. – Ma perdié voué ! le voiqui qu'a veint. - (18) |
| pére (on) : père - (57) |
| pére : père - (48) |
| pére : 1 n. m. Père. - 2 n. f. Paire. - (53) |
| pére, pé (n.m.) : père - (50) |
| père-grand, aïeul. V. grand. - (05) |
| perent, parent. - (04) |
| pérer, dépecer. - (26) |
| péresse, s. f. paresse. - (08) |
| peressou, ouse, adj. paresseux, euse. - (08) |
| perfeu, petits hommes de pâte qu'on faisait cuire au four, aux fêtes de l'Epiphanie et avec lesquels on rendait heureux les enfants. - (16) |
| pergnaux : yeux - (60) |
| pergniau, peurgneau. n. m. - Pruneau. - (42) |
| pérî (se), v. pron., se donner la mort : « Ol avòt eùn ben gros torment ; y é pou c'qui qu'ô s’é péri. » - (14) |
| péri : Périr, crever. « Sa vaiche a péri » : sa vache a crevé. « O s'en farait péri » : il s'en ferait mourir. - (19) |
| péri, part. pass. du verbe périr. nous disons il est péri pour il est mort - (08) |
| pérî, v. intr., mourir. Le part, est souvent employé substantivement pour mort : « Ol é pérî, » comme en Morvan. - (14) |
| péri, vn. périr. - (17) |
| péri. Péril. - (01) |
| périée. n. f. - Prière. - (42) |
| perier : gésier (y a-t-il ici un rapport avec la pierre, le gésier d'une volaille étant destiné à l'assimilation des matières les plus indigestes ?) Ex : "Il est ben grou ton jau routi. Prends donc ène cuisse et, à moué, té vas m'douner l'périer. J'aime ben !" - (58) |
| périer, subst. masculin : gésier. - (54) |
| périer. v. - Prier. - (42) |
| périr : v. a., abîmer, détruire. Au fig., vicier, corrompre. Sale gosse, va-t'en vers ceux qui t'ont péri. Etre péri, être mort ou en danger certain de mort. Se périr, périr par accident ou suicide. Il s'a péri en Saône. - (20) |
| périsi : Pleurésie. « Ol a étrapé in périsi » : il a une pleurésie. - (19) |
| péritre, v. n. périr, mourir, tomber en ruine. - (08) |
| perjon, s, m. cage à poulets, cage où l'on enferme une poule qui a des poussins. - (08) |
| perlécher (v. tr.) : pourlécher - (64) |
| perlicher. v. - Pourlécher. - (42) |
| perlicher. v. a. Lécher, pourlécher. (Rogny). - (10) |
| perlin. s. m. Nerprun, arbrisseau de la famille des rhamnées. – Perlin blanc, troène. (Perreuse). - (10) |
| pernaillé, ée. adj. Qui a de grosyeux, des yeux vifs, bien ouverts. (Vallée d'Ailtant). - (10) |
| pernaillier (n. m.) : prunelier - (64) |
| perne (n. f.) : prune - (64) |
| perne. Prune. - (49) |
| perneillé, ée. adj. Voir pernaillé. - (10) |
| pernelle (n. f.) : prunelle – oeil - (64) |
| pernelle (une) : une prunelle (fruit) - (61) |
| pernelle : œil, plus que prunelle de l'œil. Ex : "J'ouvère grand les pernelles, mais j'voué rin !" (on a aussi le choix avec l'usage du verbe s'areuiller). - (58) |
| pernelle. Prunelle. On dit aussi : « plosse ». - (49) |
| perneller. Prunelier. - (49) |
| perner. Prunier. - (49) |
| pernier (n. m.) : prunier - (64) |
| pernier : prunier, le fruit est la pern' - (58) |
| perniot (n. m.) : pruneau – oeil - (64) |
| péròle (la), s. f., marmite de l'équipage des mariniers. Cette appellation n'est pas la seule qui désigne cet ustensile. (V. Négresse.) - (14) |
| pérollier, péroullier : s. m., vx fr. peirolier, chaudronnier. - (20) |
| pèrou : (pèrou - subst. m.) outil de sabotier, sorte de plane qui sert à sculpter la forme extérieure du sabot - (45) |
| péroué : parou, outil de sabotier. - (33) |
| perouen : chaîne articulée réunissant les timons dans un attelage de deux bœufs. A - B - (41) |
| pérouen. Chaîne avec une boucle à chaque extrémité, pour atteler deux paires de bœufs à un char, une charrue. Les boucles s'accrochent au « t'chan » (timon). - (49) |
| péroux ou peuroux : Peureux. « Aujourd'heu les enfants ne sant pas si peuroux que dans le temps » : aujourd'hui les enfants ne sont pas aussi peureux qu'autrefois. - (19) |
| péro-ye, pareil. - (26) |
| perpignan, n.m. manche de fouet. - (65) |
| perpignan. n. m. - Long fouet, placé sur une lieuse pendant la moisson ; il est utilisé, de cette hauteur, pour cingler les chevaux en train de tirer la lieuse. (Sougères-en-Puisaye). Selon M. Lachiver : le perpignan est le nom donné au manche du fouet formé de baguettes flexibles réunies par un assemblage de corde. L'origine de ce nom est probablement à rechercher dans l'origine roussillonnaise du micocoulier utilisé pour la fabrication de ce manche ; il peut aussi être fabriqué en alisier. - (42) |
| perpoint : voir guîchard - (23) |
| perraillon : s. m., vx fr. perrayeur, carrier, tireur de grève. Le nom de famille Perrayon est bien connu. - (20) |
| perrier : (nm) gésier - (35) |
| pérrier : gésier - (37) |
| perrier, pierrier : s. m., vx fr. perrier, gésier. - (20) |
| perrier. Gésier. - (49) |
| perrière : s. f., vx fr., carrière de pierre. - (20) |
| perronelle. Air gai, chanson gaie… - (01) |
| perruche (prononcez pruche). s. f. Terrain pierreux. (Auxerre). - (10) |
| perruquî n.m. Coiffeur. - (63) |
| persat (n. m.) : plante dont les graines s'accrochent aux vêtements (syn. picsat) - (64) |
| persigneux. n. m. - Magnétiseur, guérisseur. - (42) |
| person (n.m.) : cage à poussins (aussi peurson) - (50) |
| person (nom masculin) : cage à poulets. - (47) |
| person : abri grillagé déplaçable pour petites volailles (mue) - (60) |
| person : cage à poulets. (SY. T II) ; poussinière. (RDM. T IV) - B - (25) |
| person : mue - (48) |
| person. Mue. Sorte de cage où l'on enferme la poule qui a des petits poussins. - (49) |
| personne (accompagne d'un verbe comme voir, rencontrer, trouver, etc.). Nous employons volontiers la tournure suivante : «Je croyais qu'on avait sonné, j'ai ouvert la porte et je n'ai personne vu. » - (12) |
| personnier, parsognier. n. m. - Associé, compagnon, complice. (Voir F.P. Chapat, p.l52) - (42) |
| personnier. s. m. Celui qui est associé avec un autre, soit pour un travail, soit pour une fête ou quelque partie de plaisir. – Personnière. s. f. Compagne de travail ou de plaisir. – À une noce, à une fête de village, un personnier a toujours sa personmère.(Villiers-Saint-Benoît). - (10) |
| persou : (pêrsou: - subst. f.) tarière. Cf. perchoir. - (45) |
| perte : s. f. Porter perte, porter préjudice, causer du dommage. - (20) |
| pertentaine (courir la). exp. - Se dit d'une personne qui n'est jamais chez elle. - (42) |
| pértenténe (courir la). Aller à la recherche de femmes légères ; les fréquenter. - (49) |
| perteus. s. m. Pertuis, trou, passage. – Perteus de l'heus (pertuis de l'huis), chatière, trou au bas d'une porte. (Avallonnais). - (10) |
| perthus, trou , peurtu. - (04) |
| pertintaille : objets sans valeur - (60) |
| pertout, pertot. Partout. - (49) |
| pertse : perche - (43) |
| pèrtsse : perche - (51) |
| pertuis, n.m. trou, gouffre, col (Donzy le trou - Donzy le pertuis - Donzy le Peurtu). - (65) |
| pertus (pr'tu) : s. m., pertuis, trou. - (20) |
| pertus. Pertuis. - (49) |
| pertuser (pr’tuser) : v. a., vx. fr. pertuisier, trouer. - (20) |
| perzeure. Présure. - (49) |
| pés (n.m.) : pis - (50) |
| pesc’iaûx : armatures en bois des paniers en osiers, échalas - (37) |
| peschaï, s.m. pêcher. (arbre) - (38) |
| pesche, s.f. pêche (fruit) ; anciennement paesche. - (38) |
| pèse : s. f., arrachoir pour ceps de vigne et arbustes. C'est une palière agissant comme levier du premier genre : une de ses extrémités est engagée sous le pied à arracher, ensuite de quoi l'opérateur « pèse » sur l'autre extrémité. - (20) |
| péser : peser - (43) |
| péshô : échalas, pieu. Altération du peu commun « paisseau ».On dit « rade cment un péshô » : raide comme un piquet. - (62) |
| pessaule. : (Dial.), passable, dans le sens de durée limitée. - (06) |
| pesseaux : échalas. - (32) |
| péssiae, paisseau. - (26) |
| pessiau, s. m., paisseau, échalas : « J'ons prou d'raïins autôr de nos pessiaux. » - (14) |
| pessie, et p'ssie, s. f., vessie. - (14) |
| pesson (n.m.) : pinson - (50) |
| pester, v. n. s'impatienter, maugréer. - (08) |
| pet, pis de vache. - (05) |
| pêt, s. m., pis, mamelle de la vache : « Dis donc, p'tiot, tes vaques sont ben crotoûses ; quand on lieù tire le lôt, i dèt pas été ben prôpe ? — Ah ! si ; on lieû-z-y lave le pèt. » - (14) |
| pet. Pis, mamelle de la vache ; du latin pectus. - (03) |
| pet’iai, adj. petit. - (22) |
| petâ (on) : pétard - (57) |
| pétailler. v. n. Faire claquer un fouet, faire péter des bombes, des capsules, pour le plaisir de faire du bruit. (Puysaie). - (10) |
| pétale : (nf!) pétale - (35) |
| pètard : n. m. Pétard. - (53) |
| pétard, n.m. nom donné aux plantes qui font du bruit quand on les fait claquer dans la main (silènes, digitale, sureau). - (65) |
| petas (p'tâ) : s. m., lat. pitlacium, lange, couche ; hardes, défroque ; pièce de raccommodage. - (20) |
| petas, s. m., chiffons, pièces pour rapetasser. - (14) |
| petasse (p'tasse) : s. f., guenille ; traînée, et, par extension, femme quelconque. - (20) |
| pétasse (une) : une groseille à maquereau - (61) |
| pétasse. n. f. - Grande peur : «J'a eu eune de ces pétasses, quand l'cauchon m'a foncé d'ssus. » Mot conservé en français argotique : avoir la pétasse, avoir la pétoche. - (42) |
| pétasse. n. f. pétard. n. m. - Plante herbacée, silène enflé. - (42) |
| pétasse. s. f. Grande peur, qui donne la foire. On dit d'un poltron, d'un homme qui a peur : Il a la pétasse. - (10) |
| petasser (p'tasser) : v. n., rapetasser. - (20) |
| petasser, v. tr., rapetasser, raccommoder de vieilles hardes. - (14) |
| pétasses : groseilles à maquereau. (P. T IV) - Y - (25) |
| petasson (p'tasson) : s. m., celui qui petasse. - (20) |
| petassoû, s. m., ravaudeur, fripier, celui qui commerce en vieux chiffons. - (14) |
| petassoux (p'tassou), petassouse : s. m. et f., rapetasseur, rapetasseuse. Voir rapetassoux. - (20) |
| petat : s. m., besoin de péter. Avoir le petat. - (20) |
| petaud, peutaud. s. m. Vilain, laid, mal plaisant. Ce mot, qui vient du latin pes, pedis, était le nom qui se donnait autrefois, par mépris, aux paysans, aux vilains (villani), qu'on enrégimentait dans les temps de guerre et qui marchaient toujours à pied. – Fait, au feminin, pétaude. (Avallon). – Se dit aussi, dans la Puysaie, pour camisole. - (10) |
| petauger, petouger (p'tauger, p'touger) : v. n., patauger. - (20) |
| petefeugnon : qui mange sans appétit — de petefouiner. - (30) |
| pételer : v. n., vx fr. pesteler, jouer des jambes, courir. - (20) |
| peter - veussi : péter - (57) |
| peter (p'ter) : v. n., péter. Se faire peler le bec de... : au prop., savourer quelque chose ; au flg., avoir « plein la bouche » de quelqu'un ou quelque chose. Voir peter te loup. Voir loup. - (20) |
| peter : péter - (51) |
| péterelle. Nom donné à une petite locomotive, au service de la mine sur les puits. - (49) |
| péterie. Pétarade. - (49) |
| pèterin. : (Dial.), infirme, méprisable, abject. - (06) |
| petétre. Peut-être. - (01) |
| peteu (p'teu) : s. m., roitelet, ou mieux troglodyte (troglodytes parvutus). - (20) |
| peteû, adj., honteux, timide, craintif : « Oh ! l'drôle de Jean-Jean ! Ol é là d'vant vous c'ment eùn peteù ! » - (14) |
| peteû, s. m., roitelet. - (14) |
| péteux, péteuse (p'teu) : adj., péteur, péeuse, qui fait du bruit, des embarras. - (20) |
| pétévielle. Éclaboussure de boue. S'emploie le plus souvent au pluriel. - (49) |
| pét'fainer, petfiner. Mal user d'une chose. - (49) |
| peti ! s. m., cri dont se servent les paysans pour appeler les poulets : « Peti ! peti ! » — Se dit concurremment avec petiòt. - (14) |
| Peti. Nom propre. Voyez Monsieu Peti. - (01) |
| peti. Petit, petits. - (01) |
| pétiau, s. m. paisseau, échalas. - (08) |
| petignö, öte, adj. tout petit. - (17) |
| petignô, tout petit, diminutif de petiô. - (02) |
| petignô. Les Bourguignons disent peti, petiô, petignô. - (01) |
| petignot - très peu, tout petit. – n'en veux diére ; ran qu'in to petigno ! - Oh le joli petiot chait qu'al â petigno !... - (18) |
| pétiller, p'tiller. Craqueler. Se servir d'une chose sans utilité. - (49) |
| pétilli : pétiller - (57) |
| petiô. : Petit. Diminutif, petignô. - (06) |
| petiot : petit - (48) |
| petiot : petit. - (32) |
| petiot : petit. - (66) |
| petiot, e, adj. petit. (voir : p'tiot.) - (08) |
| petiòt, et p'tiôt, s. et adj., petit. - (14) |
| petiot, petiote (adj. et n.m. et f.) : petit, petite - (50) |
| petiot, petit. - (05) |
| petiot, p'tiot par abrévation - petit, enfant (très souvent dans ce dernier sens). - Al â bein petiot vote jairdin. - Prôtez moi vote petiot coutais, al â pu quemode que le mainne. - Lote petiot â bein pu genti que lai p'tiote. - (18) |
| petiot. Petit, vieux mot. - (03) |
| petiôt-baisselon, s. m., houe de petite dimension, servant à sarcler le sarrasin. - (14) |
| petiòtement, adv., petitement. - (14) |
| petiouler (p'tiouler) : v. n., faire beaucoup de petits, avoir beaucoup d'enfants. - (20) |
| petit barreu, ou breute : carriole à deux roues et un timon - (43) |
| petit poulain (au), loc. porter un enfant au petit poulain, c'est le mettre à cheval sur ses épaules, une jambe par ci, une jambe par là, de chaque côté de la tête comme deux boucles d'oreilles. Le vrai patois dit : « au p'tiô poulain. » - (08) |
| petit, petit Cri pour appeler les volailles. - (63) |
| petiu. Trou. - (03) |
| pet'naille : herbe très appréciée par les lapins (panais sauvage) - (46) |
| peton (peiiôt ), s. m., petit pied. Quoique peton soit déjà un diminutif, nous disons très volonliers : « Tes petiòts petons. » - (14) |
| peton, s. m. pied. se dit seulement en parlant des enfants. - (08) |
| petonner. v. n. Gronder sans cesse. (Saint-Martin-sur-Ouanne, Villiers-Saint-Benoît). - (10) |
| petonnier, petonneux. s. m. Celui qui gronde toujours. (St-Martin-sur-Ouanne, Villiers-Saint- Benoît). - (10) |
| petou (on) : putois - (57) |
| petou (p'tou) : s. m., putois. - (20) |
| petou, p'tou : putois - (43) |
| petou, s. m. putois. Terme de mépris pour un vieil homme. - (22) |
| petou, s. m. putois. Terme de mépris pour un vieil homme. - (24) |
| pétouaîre (na) : pétoire - (57) |
| petouge (p'touge) : s. f., boue, bourbier (au prop. et au flg.). Oh ! là là ! Dans quelle p'touge que j'suis ! - (20) |
| petouger (p'touger) : v. n., patauger (au prop. et au fig.). Voir empetouger. - (20) |
| petougi, v. a. piétiner, tasser avec les pieds. - (24) |
| pétoûiller : pétarader - (37) |
| petouillon : travail fastidieux, qui n'avance pas - (60) |
| pétouillot : moteur pétaradant - (37) |
| petoux (p'tou), petouse : adj., péteux, honteux. - (20) |
| pétoux, péteux. Péteur. Fig. « Péteurs » s'emploie pour orgueilleux, vaniteux. - (49) |
| pétrâ - personne maladroite, lourde dans ses manières. – C’â in gros pétrâ que c't homme lai. - Quain pétrâ te me fâ don ! - (18) |
| pêtra : Lourdeau, individu grossier. « In greu pêtra » : un gros lourdeau. - (19) |
| pétrâ ou pétrâs, pétrât {dans toute la Bourg.). - Paysan, homme lourd, grossier et mal élevé. Ce mot n'est pas sans analogie avec pataud, dans le sens Je lourd, mais ce dernier vient de patte, qui a de gros pieds, et l'autre de pétra, mot grec désignant la pierre dont le vilIageois a fréquemment, au moins en apparence, la rigidité et l'insensibilité, comme les bornes… - (15) |
| pétra, paysan d'une grande rusticité... - (02) |
| pétrà, s m., empêtré, lourd comme une pierre, sot, grossier, niais : « Que gros pétrâ ! » - (14) |
| pétrâ, s. m. homme grossier et d'allure pesante. se dit surtout des paysans d'une extrême rusticité. - (08) |
| pétra. pétrelle. Paysan grossier. - (13) |
| pétra. Peu dégourdi, lourd. - (49) |
| pétras. adj. - Grossier, lourdaud, maladroit : «Le grand rosier cuisse de nymphe est déjà perdu de chenilles (c'est le valet du locataire qui m'écrit) et on s'amuse à les tuer toutes ; faut-il être pétras ! » (Colette, Claudine à Paris, p.259). L'histoire de ce mot remonte au latin petro, animal à la chair dure, employé par les Romains de manière métaphorique pour désigner un paysan lourdaud. Encore au début du XXe siècle, un pétras s'utilisait pour un personnage épais et sans intelligence, rustre. Dans plusieurs dialectes en France (Puisaye, Normandie, Poitou...), il s'emploie pour un homme lourd, grossier, mal élevé. - (42) |
| pétrat. s. m. Homme lourd, grossier dans son langage, dans ses manières. - (10) |
| pétrelle : s. f., paysanne. A rapprocher de « pétras ». - (20) |
| pètrigone, sf. perdrigon, sorte de prune. - (17) |
| pétrillan : Personne remuante, bavarde et prétentieuse. - (19) |
| pétrille, pétrillarde, pédrille, pédrillarde : s. f., personne, et surtout fillette, embarrassante, empêtrante, harcelante, tournant au point-de-côté. - (20) |
| pétriller. v. a. et n. Fouler aux pieds. (Cravant). - (10) |
| petrilli : Pétiller. « Le bouis bien so pétrille dans le fû » : le buis bien sec pétille dans le feu. - (19) |
| petrillon (mener son) : parler beaucoup en gesticulant. (S. T IV) - S&L - (25) |
| pétrissoire, s. f., pétrin. - (14) |
| petrœlliat, s. m. faiseur d'embarras. - (22) |
| petrœlliat, s. m. faiseur d'embarras. - (24) |
| petrœllions, s. m. pl. petits points rapprochés, taches fines comme projetées par une chose qui a pétillé. - (24) |
| petrœllions, s. m. pl. petits points rapprochés, taches fines comme projetées par une chose qui a pétillé. Verbe : petrœllyi, pétiller. - (22) |
| petrœyi, v. n. pétiller. - (24) |
| petrœyiôt, s. m. croupe, train de derrière (langage plaisant) : quel petrœyiôt elle a ! - (24) |
| petrogner : voir pitrogner. - (20) |
| pètrojaiquète (do), loc. dès le petit jour. - (17) |
| pétron : grosse ordure - (60) |
| pétronouiller : bricoler, tatillonner. (E. T IV) - VdS - (25) |
| pètrouillé, vt. pétrir qchose dans l'eau. Marcher dans la boue. - (17) |
| petrouiller (pour patrouiller). v. n. Marcher, s'agiter en regardant, en cherchant, en fouillant de l'œil partout, comme les hommes de police ou les soldats d'une patrouille. – S'emploie aussi activement. Patrouiller les rues. Patrouiller les boues. (Courgis). - (10) |
| pétroyer. v. n. Se dit d'un liquide gluant qui bouillonne. (Sainl-Mariin-duTertre). - (10) |
| pêtse n.f. Pêche. - (63) |
| pêtseux n.m. Pêcheur. - (63) |
| pétsi : pêcher - (43) |
| pêtsi v. Pêcher. - (63) |
| pètsse : pêche - (43) |
| pètue. s. f. Pâture. - (10) |
| pêtuer. v. a. et n. Pâturer, paitre. (Parly). - (10) |
| petun et betun. C'est ainsi que dans l'origine se nommait le tabac... - (02) |
| pétwayo : flaque de boue. (RDM. T III) - B - (25) |
| peu (ē), peute, adj. laid ; vilain, de mauvaise mine. - (17) |
| peu (faire) : avoir un peu honte, être vexé ; avoir la mine déconfite, faire mauvais. - (56) |
| peu : laid, vilain (peûte au féminin) - v'lai l'temps qui s’fait peû, y vai cheur eune rabasse, le temps se gâte, il va pleuvoir. - (46) |
| peu : Peur. « N'aie pas peu du chin (chien) o ne veut pas te meudre (mordre) ». « Se révailli en peu » : se réveiller en sursaut. - (19) |
| peu : Porc. « A la Saint Thomas (21 Décembre) tue tes peus, lave tes draps, dans trois jos noué sera (dans trois jours ce sera Noël) ». « Le creut es peus » : la mare aux sangliers, lieu dit du bois de Mancey. - (19) |
| peu : pour - (51) |
| peu : Puis. « A peû après ? » : et puis après ?. « A peû » signifie et « Ol a euvri la porte a peû o s'est en allé » : il a ouvert la porte et il s'est en allé. « Ol est veni dave sa fane a peu ses enfants » : il est venu avec sa femme et ses enfants. - On emploie aussi peu : « Deux peû deux fiant quatre ». - (19) |
| peu : vilain - (57) |
| peû : vilain. - (29) |
| peû bon ai z’ter â c’iens (âte) : avoir cessé de plaire, ne plus avoir aucune qualité aux yeux des gens qui auparavant vous en trouvaient des tas - (37) |
| peu : adv. Puis. - (53) |
| peu, à peu et puis. - (38) |
| peu, adj. vilain. - (38) |
| peu, adv. puis. (voir : ded' peu.) - (08) |
| peú, adv., puis, ensuite, d'ailleurs. - (14) |
| peu, laid. - (28) |
| peu, peur ; el é peu, il a peur ; peûrou, peureux. - (16) |
| peu, peur, p' prép. Pour. Voir peur. - (63) |
| peu, peur, p', pre : (prep.) pour « y est p'ta » : c'est pour toi - (35) |
| peû, peûte : mauvais, méchant. - (66) |
| peu, peute : (peu, peut' - adj.) laid, vilain, affreux. le Peu, "le Vilain", nom qu'on donne pudiquement au diable. - (45) |
| peu, peute, laid, laide. - (16) |
| peu, peutte : laid, laide. - (09) |
| peu, pou n.f. Peur. - (63) |
| peu, s. f. peur. c'est le français peur avec chute de l'r. (voir : poil.) - (08) |
| peu. Peus, peut. - (01) |
| peù. Puis. - (01) |
| peuble, peuple : s. m., vx fr. peuple, peuplier. - (20) |
| peûce : pouce - (48) |
| peuce : (peu:s' - subst. m.) pouce. - (45) |
| peuce, peûçot, ou pôce - pouce. - Aivou son mairtais â s'é beillé in co su le peuce. - C'â in fin matouais ; d'aivou lu en faut y mette les peuces. - Veins voué m'aidie, met ton pôce iqui su lai ficelle pendant qui vâ cliolai. - (18) |
| peûce, pouce. - (16) |
| peùce, s. f., puce. - (14) |
| peuce, s. m. pouce, le gros doigt de la main. - (08) |
| peùce, s. m., pouce. - (14) |
| peùce. Pouce, pouces. Les bonnes vieilles à Dijon content aux enfants la fable de Peùçô, ainsi nommé parce qu'il n'était pas plus grand que le peùce. - (01) |
| peucecul (peurcecul) : cynorhodon (fruit de l'églantier) - (51) |
| peûcèle, s. f., pucelle ; Il n'est pas de Noël où ce mot ne se trouve employé pour désigner la vierge Marie. - (14) |
| peucener, v. a. toucher, tâter avec la main. se dit principalement de l'action qui consiste à palper la chair des animaux pour s'assurer de leur état d'engraissement. - (08) |
| peùceron, s. m., puceron. - (14) |
| peuchan : Pochon, louche, grande cuillère avec laquelle on trempe la soupe. « Mens voir encore in ban peuchan de boïllan dans la soupière ». - Tache d'encre. « J'ai fait in peuchan su man cahier ». - Terme de tir, le peuchan est la baguette avec laquelle le marqueur montre sur la cible le point touché, si la cible n'a pas été touchée le marqueur agite son peuchan en l'air. - (19) |
| peuche : Poche. « O s'en va les deux mains dans ses peuches, tranquille c'ment Baptiste ». - Sorte de cuillère qui sert à prendre l'eau dans le seau. - (19) |
| peuçhe n.f. Pisse. - (63) |
| peuché, s. m. péché, manquement à la loi religieuse. « pécé. » - (08) |
| peucher, v. n. commettre un péché. « pécer. » - (08) |
| peuchie. s. f. Vessie. (Saint-Germain-des-Champs). - (10) |
| peuchné : un petit peu - (44) |
| peuchot ou p'chot (Un). Une petite quantité — Batisse, beille-moi don un bout de ton guétia ? Nain-ni ! i n’en ai déji gueîre. — Ran qu'un peuchot, pour goûter si al ast bon... - (13) |
| peuchtée : s. f. paille de haricot. - (21) |
| peuchton : piston - (51) |
| peuçot, adv. de quantité. peu, une petite quantité. - (08) |
| peuçot, s. m. petit sac en peau ou en étoffe dans lequel on enveloppe le pouce ou un doigt blessé. Chez nous un petit « peuçot » est un enfant de petite taille comme le petit-poucet. - (08) |
| peudja (na) : misère - (57) |
| peûdze : (nf) poix - (35) |
| peudze : poix - (43) |
| peudze n.f. Poix. - (63) |
| peudzi v. Coller. Y peudze és dagts : ça colle aux doigts. - (63) |
| peudzoux adj. Poisseux. - (63) |
| peue (et) : puis (et) - (48) |
| peue (et) : et puis - (39) |
| peue : peur - (39) |
| peûe. n. f. - Peur. - (42) |
| peue. s. m. Puits, source, fontaine.. (Avallonnais et Tonnerrois). Du latin puteus. - (10) |
| peufiou : qui cherche à faire des sottises. (RDM. T IV) - B - (25) |
| peufioue, peufiue : n. m. Petit vaurien. - (53) |
| peufourle. s. f. Espèce de galette, qui se fait cuire à l'entrée du four, avant d'enfourner le pain. – On dit aussi pifouine. (Montillol). - (10) |
| peuge, s. f. puce. - (22) |
| peugin, s. m. poussin. - (22) |
| peugnance. Personne difficile dans sa nourriture, qui lambine en mangeant. - (49) |
| peugne : (nm) peigne - (35) |
| peugne : peigne - (43) |
| peugne n.m. Peigne. - (63) |
| peugni : peigner - (43) |
| peugni : peigner - (51) |
| peugni v. Peigner. - (63) |
| peûgniôt : délicat, difficile à nourrir - (37) |
| peugnon : pignon - (51) |
| peugnou, adj., 2 genres, difficile sur le choix des mets. - (11) |
| peuher, v. a. peser, déterminer le poids de quelque chose. - (08) |
| peuhu, adj. peureux, craintif. - (08) |
| peuil : peur. (LEP. T IV) - D - (25) |
| peuille, s. m., peuplier. - (40) |
| peuille. s. f. Peuplier. (Fléys). - (10) |
| peu-je ? Puis-je ? - (01) |
| peule (na) : meule (de foin) - (57) |
| peûle : peuplier. D’où la peûlrie pour la peupleraie - (62) |
| peule, pelle ; peultë, ce que contient la peule. - (16) |
| peuleçon ou pelleçon. Long manteau dont se couvrent les femmes de la campagne. Etym. pellis, peau. - (12) |
| peuler, v. a. piler, écraser, fouler. - (08) |
| peulerin, s. m. pèlerin. - (08) |
| peulie : Poulie. « La peulie du pouits » : la poulie du puits. - (19) |
| peulin, n.m. nom de divers plantes comme le troène. - (65) |
| peulon, s. m. pilon, ce qui sert à écraser. — Piège dans lequel le rat prisonnier est assommé par la chute d'un poids. « peulon » et « meutré » sont synonymes. (voir : meutré.) - (08) |
| peulon. n. m. -Vigneron. (Leugny, selon F. Clas) - (42) |
| peulson, sm. guenille, torchon. Femme mal habillée. - (17) |
| peulsons (des) : des matelas grossiers ou plus péjoratifs des femmes grosses. - (66) |
| peultuquer : trépigner. (LS. T IV) - Y - (25) |
| peunâ : Punais. « Des ûs peunâs » : des œufs punais. Féminin « peunârde ». « Des liaches peunârdes, mauvases » plantes des champs, genre laiterons, vivace et à mauvaise odeur. (Lactuca scariola). - (19) |
| peunâ, adj. punais. au féminin « peunaille », comme « mauvâ », mauvais, au féminin « mauvaille.» - (08) |
| peunâille, s. f. punaise. on prononcé : « p'nâille » par syncope. « pn'âille, p'nâje ». - (08) |
| peûnais : (adj) (œuf) avarié - (35) |
| peunaise (na) : punaise - (57) |
| peûnaise : (nf) punaise - (35) |
| peunaise : punaise - (43) |
| peunaise n.f. Punaise. - (63) |
| peunalaï, s.m. prunelier. - (38) |
| peunâs : punais - (39) |
| peûnas, adj., punais, qui exhale une mauvaise odeur par le nez. - (14) |
| peûnâs, p’nâs : punais (se dit surtout d’un œuf couvé et avarié) - (37) |
| peûnâs, p’nâs : punais, se dit d’un œuf couvé et avarié - (37) |
| peúnâse, s. f., punaise, hôtesse acharnée et puante de certains lits. - (14) |
| peunat n. et adj. Pin chétif et en général, arbre chétif. - (63) |
| peunâye (n.f.) : punaise - (50) |
| peunaze : punaise. - (29) |
| peuné : œuf pourri - (43) |
| peune : Punaise. « Vain c'ment eune peune » : plat comme une punaise. - (19) |
| peuné : se dit des œufs qui ne sont plus bon - (44) |
| peunessie : mot féminin désignant le panic, sorte de millet (une mauvaise herbe) - (46) |
| peunetére – panetière ; planche sur laquelle on met les miches de pain, ordinairement suspendue au plancher. - I n'ons pâ mau de pain su note peunetére. - Vions-voué, aipote les miches qui les montâ su lai peunetére : là ! c'â le cas de dire, voiqui qui ons du pain su lai pliainche. - (18) |
| peuni : Puni. « Y est le Ban Dieu que l'a peuni » : c'est une punition divine. - (19) |
| peunibe, adj. pénible, qui cause de la peine, du chagrin. - (08) |
| peunitan, ante, adj. et s. pénitent, pénitente. - (08) |
| peûnitance, s. f., pénitence. - (14) |
| peunitence, s. f. pénitence. - (08) |
| peunitre, v. a. punir, châtier. - (08) |
| peup'ille (on) : peuplier - (57) |
| peupionotte, peuhaiminitouére. Exclamation pour maudire quelqu'un qui apporte de mauvaises nouvelles. Le sens est à peu près : oiseau de mauvais augure ! Cette locution est usitée surtout aux environ de Montsauche. - (08) |
| peupitre : Pupitre. « Chanter au peupitre » : chanter au lutrin. - (19) |
| peupje, sm. peuple. - (17) |
| peuplai. Peuplé, peuplez, peupler. - (01) |
| peuple ont en anatomie. - (12) |
| peuple s. f. Peuplier. Du latin populus. - (10) |
| peùple, et peûpier, s. m., peuplier. - (14) |
| peuple, peuplier. - (05) |
| peuple, s. m. peuplier. en plusieurs lieux : « pipinier, pipigner. » - (08) |
| peuple. Peuplier. Comme en latin populus signifie peuple et peuplier. - (03) |
| peupler (n.m.) : peuplier - (50) |
| peuplier : Peupler. « In pays bien peuplié » : un pays populeux. - Se multiplier. « Ses lapins ant bien peuplié » : ses lapins se sont multipliés en grand nombre. - (19) |
| peup'lle : Peuplier, populus alba. « Les jacquettes ant fait leu nid à la cuche du peup'lle » : les pies ont fait leur nid à la cime du peuplier. - (19) |
| peupllye, s. m. peuplier (du vieux français peuple. latin populus). - (24) |
| peupllye, s. m. peuplier. - (22) |
| peûpye : (nm) peuplier - (35) |
| peupye : peuplier - (43) |
| peupye : s. m. peuplier. - (21) |
| peupyî n.m. Peuplier. - (63) |
| peur (de) : loc. adv., presque. I gèle de peur, cela frise la gelée. - (20) |
| peur : Pur, non falsifié. « In ban fremage tot peur de cabre » : un fromage fait avec du lait pur de chèvre. « Du vin peur » : du vin non additionné d'eau. « Y est la peure vérité » : c'est la vérité pure. - (19) |
| peur, e, adj. pur, sans mélange. nous avons dans nos montagnes des eaux « peures », mais le vin « peur » y a encore la préférence. - (08) |
| peur, peu, p' prép. Pour. - (63) |
| peur, pr', p' prép. Par. Y'est pas peur hasard. Tot pr'un cop. Ô vint p'le tsmin. - (63) |
| peuraitre, v. a. pourrir. - (22) |
| peuraitre, v. a. pourrir. - (24) |
| peurant - bien mouillé. - Al an revenu, de lai tot peurants, queman si an les aivot jetai dans l'aie. - Té tot peurant de sueur ; en faut vitement te choinger. - (18) |
| peurcecul (peucecul) : cynorhodon (fruit de l'églantier) - (51) |
| peurcés (n.m.) : procès - (50) |
| peurchoux. s. m. Amorcoir. – A Vassy-sous-Pisy, ce mot se prononce en donnant un peu au p le son du b. - (10) |
| peur-chus (loc.adv.) : par-dessus. La partie la plus haute - (50) |
| peurci : (vb) percer, creuser - (35) |
| peurci : percer - (57) |
| peurde, pèrde v. Perdre. Ôl a coutsi à pèrde. Il a dormi loin d'ici, où il a pu. - (63) |
| peurdige, s. m. prodige. - (08) |
| peurdssus loc. adv. Par dessus. - (63) |
| peurdu : perdu - (57) |
| peurdu, -ue adj. Perdu. - (63) |
| peurdzi : purger - (43) |
| peurée : n. f. Bouillie épaisse. - (53) |
| peurée, s. f. purée, bouillie, matière à demi liquide. - (08) |
| peùrée, s. f., purée, bouillie. On fait chez nous d'excellentes « soupes à la purée » : de pois, de haricots, de pommes de terre. - (14) |
| peurgaler (v.) : malmener, chasser, mettre en fuite - (50) |
| peurgaler : poursuivre,rudoyer,maltraiter, pourchasser, bousculer, brutaliser - (48) |
| peurgaler : (pœrgalè - v. trans.) frapper, rudoyer, maltraiter. - (45) |
| peurgaler, v. a. malmener, chasser, mettre en fuite. - (08) |
| peurgaller : poursuivre - (39) |
| peurge : Purge. « Ol a pris eune peurge ». - (19) |
| peurge, s. f. purgation, remède purgatif. - (08) |
| peùrge, s. f., purge, médicament purgatif. - (14) |
| peurgi : Purger. « Le madecin li a dit qu'o farait bin de se peurgi ». « Le temps se peurge » : il pleut abondamment. - (19) |
| peurgnan : Lien de cuir qui attache le collier du cheval aux brancards de la voiture. - (19) |
| peurgneau. s. m. Pruneau. Au pluriel, se dit des yeux, des prunelles. Ail' en a des peurgnenux, cett'-là. - (10) |
| peurgnière : sieste - (60) |
| peuri : pourri - (43) |
| peûri : pourrir, pourri - (48) |
| peuri : (peu:ri - v. intr.) pourrir, se décomposer. - (45) |
| peuri : adj. Pourri. - (53) |
| peuri : pourir - (39) |
| peûri, peûrir : pourri, pourrir - (46) |
| peûri, pourrir et pourri ; un ciel longtemps pluvieux est un tan peûri. - (16) |
| peûrî, v. intr., pourrir. - (14) |
| peuri, v. n. pourrir, gâter, corrompre : « eune pon'm peurie. » (voir : pûri.) - (08) |
| peûri, vn. pourrir ; pp. peuri. - (17) |
| peuriai : prier. Les croyants peuriont souvent : les croyants prient souvent. - (33) |
| peûriau, s. m., purin, urine des bestiaux, recueillie dans des réservoirs, et qui sert à certains arrosages des terres. - (14) |
| peuriè : v. t. Prier. - (53) |
| peuriéle : prière - (39) |
| peuriéle, s. f. prière. (voir : peuriére.) - (08) |
| peurier : prier - (48) |
| peurier : prier. - (52) |
| peurier : prier - (39) |
| peurier, v. a. prier, faire une prière. - (08) |
| peùrier, v. m., prier, supplier. - (14) |
| peurière (n.f.) : prière - (50) |
| peuriére : prière - (48) |
| peurière : prière. - (32) |
| peuriére, s. f. prière. - (08) |
| peùriére, s. f., prière, supplication. - (14) |
| peurieu, euse, adj. celui ou celle qui prie avec piété, avec ferveur. - (08) |
| peurion : injure grave. (PSS. T II) - B - (25) |
| peûrion : mot masculin désignant une personne très sale, mal soignée - (46) |
| peurion, adj., poltron, paresseux. - (40) |
| peurion, sm. objet pourri. Personne malsaine ou couverte de plaies. - (17) |
| peuriou (-ouse) (n.m. ou f.) : celui ou celle qui prie - (50) |
| peurisse. Pourrisse, pourrissent. - (01) |
| peûriteure : pourriture - (48) |
| peuriteure, s. f. pourriture. - (08) |
| peûriteùre, s. f., pourriture. - (14) |
| peurjeu (Lé). s. f. La prière. (Montillot). - (10) |
| peurjuter (verbe) : couler, dégouliner. - (47) |
| peurla : environ, probablement - (51) |
| peurlan : nerprun. - (30) |
| peurlanlaire, s.f. peur. - (38) |
| peurlata (au), loc. adverb. a proportion; métathèse de prorata. - (08) |
| peurlére : Corde servant à attacher au timon d'un char le joug d'un attelage de renfort. « La peurlére train-ne » : l'attelage de renfort ne tire pas et au figuré se dit quand une jeune fille revient du bal sans être accompagnée d'un « ramenou ». - (19) |
| peurlére : s. f. grosse corde ou chaîne servant aux attelages. - (21) |
| peurlin (n.m.) : troëne à fruits noirs - (50) |
| peurlin, s. m. le « peurlin » est, je crois, le troëne à fruits noirs. - (08) |
| peurmé, adj. premier : il est entré « l' peurmé », elle est venue « lai peurmére. » - (08) |
| peurmé, adj. premier. - (38) |
| peurmer, peurmére (n. et adj.m. et f.) : premier, première - (50) |
| peurmette (v.t.) : promettre - (50) |
| peurmi : premier - (35) |
| peûrmis (y’ot) : (c’est) promis - (37) |
| peurnâ, peurnot, perneussaint - divers temps du verbe Prendre. - Teins, c'â juste quand te peurnâs lai piaiche pou t'en ailai qu'al ant passai. - Pour fâre in bon mairché en fauro qu'a peurneussaint tot le biblo. - Dis lli qu'â peurne in sai dans lai groinge. - Voyez Prenre. - (18) |
| peurnai : prendre. - (33) |
| peurnaï, s.m. prunier. - (38) |
| peurnaillier : prunellier. Le peurnaillier pico : le prunellier pique. - (33) |
| peurnais : œil - (48) |
| peurnais : pruneau - (48) |
| peurnais, s. m. prunelle, fruit du prunellier. Notre petite prune sauvage entre dans la fabrication du cidre ou « chitre » du pays. - (08) |
| peurnalay, s. m., prunellier sauvage. - (40) |
| peurnale : prunelle des yeux ou fruit du prunellier. - (33) |
| peurnale, prunelle ; peurnalé, prunellier. - (16) |
| peurnale, prunelle. - (27) |
| peurnale, s. f., prunelle. - (40) |
| peurnale, s.f. prunelle. - (38) |
| peurnâler (n.m.) : prunier épineux, prunellier - (50) |
| peurnalle : prunelle (fruit ou partie de l'œil) - (48) |
| peurnalle : prunelle(B. T IV) - D - (25) |
| peurnalle : prunelle. - (29) |
| peurnalle et peurnaler : prunelle et prunelier. Fruit du prunelier ou encore épeûne noire. Mêmes objet et définition que pouloshe (voir). - (62) |
| peûrnant bein gairde (en) : (en) faisant beaucoup attention - (37) |
| peùrnant, part, du v. prende, prenant. - (14) |
| peurnaudélle (n.f.) : prunelle - (50) |
| peurnaudelle, prunelle - (36) |
| peûrnaudelles : prunelles sauvages - (37) |
| peurnaule, adj. prenable, sujet à être pris, dérobé, volé. - (08) |
| peurnay, s. m., prunier. - (40) |
| peurne (n.f.) : prune - (50) |
| peurne (na) : prune - (57) |
| peûrne : prune - (37) |
| peurne : prune - (48) |
| peurne : prune. - (52) |
| peurné : prunier - (48) |
| peurné : prunier. - (29) |
| peurne : s. f. prune. - (21) |
| peurne et peurner : prune et prunier. - (62) |
| peurne n.f. Prune. - (63) |
| peurne : n. f. Prune. - (53) |
| peurne : prune - (39) |
| peurnè : v. t. Prendre. - (53) |
| peurne, parne. n. f. - Prune. - (42) |
| peurné, prunier - (36) |
| peurne, s. f. prune. - (08) |
| peurne, s. f. prune. Peurni, prunier. Peurgniau, pruneau. - (22) |
| peurne, s. f., prune. - (40) |
| peurné, s. m. prunier. on dit d'une personne qui regarde de travers, qui louche, qu'elle regarde le diable sur le « peurne. » - (08) |
| peurne, s.f. prune. - (38) |
| peurne, peurnalé. – En y é des peurnes, c't année, ci fait frémi. - Moi, c'â les peurnes Reine-Claude qui eume le pu. - I veins d'airoiché des peurnalés qu'embarraissaint lai meurée. - (18) |
| peùrne,et preùne. s. f., prune. - (14) |
| peùrnei, s. m., prunier. - (14) |
| peurnéle, s. f., prunelle : « J'ai évu ben des peùrnéles ; j'vons en faire de la boisson. » - (14) |
| peurnelé, s. m. prunellier, prunier épineux.Iil abonde dans nos haies vives. - (08) |
| peurnelle (nom féminin) : prunelle. - (47) |
| peurnelle : prunelle. - (52) |
| peurnelle : n. f. Prunelle, fruit du prunellier. - (53) |
| peurnelle : prunelle - (39) |
| peurnelle, pernelle. n. f. - Prunelle. Autre sens : prunelle. - (42) |
| peurnelle, s. f. prunelle, petite prune sauvage, fruit du prunier épineux très commun en Morvan. - (08) |
| peurnellier, pernailler. n. rn - Prunellier sauvage. - (42) |
| peurner : prunier. - (52) |
| peurner : n. m. Prunier. - (53) |
| peurner : prunier - (39) |
| peurnes : prunes - (43) |
| peurnes : prunes. - (33) |
| peurneuileu. s. m. Prunellier. (Montillot). - (10) |
| peùrnez, impérat. du v. prende, prenez. - (14) |
| peurni (on) : prunier - (57) |
| peurni : (nm) prunier - (35) |
| peurni : prunier - (43) |
| peurnî n.m. Prunier. - (63) |
| peurniau (n.m.) : pruneau - (50) |
| peurniau : pruneau - (43) |
| peurniau : pruneau. - (52) |
| peùrniau, s. m., pruneau. - (14) |
| peurniaux : pruneaux - (39) |
| peurnier, peurné (n.m.) : prunier - fruits = peurnes - (50) |
| peurnier. n. m. - Prunier. - (42) |
| peurnière (nom féminin) : sieste. Elle était surtout observée à la campagne pendant les travaux d'été, les foins ou la moisson. - (47) |
| peurnière : faire peurnière = faire la sieste. III, p. 32-v - (23) |
| peurnière, n. fém. ; tantôt, après-midi. - (07) |
| peurnière. s. f. Partie de la journée de 10 heures du matin à 2 heures. (GuilIon). – A Savigny-en-Terre-Plaine, on dit pergnère et pernière. Suivant l'instituteur de cette commune, le jour, dans les campagnes, est divise en trois parties du soleil levant à 9 heuies, matinée ; de 9 heures à 3 heures, pernère ; de 3 heures au coucher du soleil, soirée. Le bétail va aux champs la matinée et la soirée : il fait pernière entre les deux. - (10) |
| peurnire : pioche-hâche utilisée pour creuser les raies*. B - (41) |
| peurnire : (nf) houe - (35) |
| peurnire : pioche-hache - (34) |
| peurnire : pioche-hache - (43) |
| peurnîre n.f. Pioche montoise, pioche-hache. - (63) |
| peùrn'lei, s. m., prunellier. - (14) |
| peurnoncer (v.t.) : prononcer - (50) |
| peurnoncer, v. a. prononcer. - (08) |
| peurnotte, s. f. prenotte par métathèse : « être en peurnotte », être en délit, en danger d'être pris, puni. - (08) |
| peurnou : preneur - (39) |
| peùrnoû, adj., preneur. - (14) |
| peurnou, ouse, adj. preneur, preneuse; prenant, prenante : celui ou celle qui prend ou qui reçoit. - (08) |
| peurnouillats. n. f. pl. - Prunes sauvages. - (42) |
| peurnoulat. s. m. Prune sauvage. (Châtel-Censoir). - (10) |
| peurnoulats : prunes sauvages. - (09) |
| peùrnu, part, du v. prende, pris. - (14) |
| peurpe, adj. propre : « lie é vendu son peurpe bin », elle a vendu son propre bien. - (08) |
| peurpeulé adj. Secoué, traumatisé, choqué, inerte. - (63) |
| peurqua : (interr.) pourquoi - (35) |
| peurqua, peurque, peurçan, pçan, poçan adv. Pourquoî. - (63) |
| peurque non adv. Pourquoî pas. - (63) |
| peurri (-te) (adj.m. et f.) : pourri (-e) - (50) |
| peûrri : (p.passé) pourri - (35) |
| peûrri : pourrir - (37) |
| peûrri : pourrir - (57) |
| peûrri : Pourrir. « Eune pomme peûrrie ». « In hivé peûrri » : un hiver doux et pluvieux par opposition à un « hivé sain » (sec). « Du fremage peûrri » ; voir à fremage. - (19) |
| peûrri a dj. Pourri. - (63) |
| peûrri ! (y’en ot) : (il y en a) beaucoup ! - (37) |
| peurri, adj. pourri. - (38) |
| peurri, v., pourrir. - (40) |
| peurrit (adj) : pourri. - (62) |
| peûrriteure : Pourriture. « I a tot cheu en peûrriteure » : tout est tombé en pourriture. - (19) |
| peurseure : Présure. « Mentre le lait en peurseure ». - (19) |
| peursigre (v.t.) : poursuivre (p.p. peursigu = poursuivi) - (50) |
| peursigre, v. a. poursuivre, suivre avec rapidité. - (08) |
| peurson : poussinières, cage à poule (en B : piounire*). A - (41) |
| peurson : cage à poussins. (RDC. T III) - A - (25) |
| peûrson : pourriture - (48) |
| peurson : (peu:rson - subst. f.) pourriture, corps en décomposition ; au fig. chose répugnante. - (45) |
| peurson : 1 n. m. Enclos grillagé à volailles déplaçable. - 2 n. m. Personne qui ne vaut rien. - (53) |
| peursonne n. et adv. Personne. Voir ngun. - (63) |
| peursoué : pressoir. - (33) |
| peursoué, persoué. n. m. - Pressoir. - (42) |
| peursoué, s. m. pressoir. - (08) |
| peursson : cage en bois de forme trapézoïdale destiner à l'engraissement ou à l'isolement des volailles - (51) |
| peursson n.m. (du lat. pressare, serrer, enfermer). Cage à poussins. Voir pioñnîre. - (63) |
| peursuher, v. a. pressurer, mettre en presse ou sous un pressoir. - (08) |
| peursulé, part. pas. percé de petits trous, de petites piqures : du bois « peursulé », une feuille « peursulce » par les insectes. - (08) |
| peursure : présure, produit provenant de la caillette du veau, pour faire cailler le lait. Pou faire du froumège faut de la peursure : pour faire du fromage il faut de la présure. - (33) |
| peursureux. n. m. - Celui qui travaille au pressoir. - (42) |
| peûrtaintâ’ne : « jupons », « guilledou » - (37) |
| peurtant adv. Pourtant. - (63) |
| peurtantaigne - expression qui signifie l'idée de dissipation, de polissonnerie. - Ile â porlavant qu'ile corre sai peurtantaingne. - Ces gairsons lai, ce n'â pâ grand'chose ; ci corrre lai peurtantaingne. - (18) |
| peurtantaine (couri lai) : courir les chemin, aller à l'aventure, courir les filles - (48) |
| peurtantaine, loc. métathèse de prétentaine : « cori ou couhi lai peurtentaine », courir la prétentaine, aller çà et là, vagabonder. - (08) |
| peurtatout, peurtannout. s. m. Goûter du tantôt, de l'après-midi. (Giullon, Sacy). - (10) |
| peùrtauger, v. intr., patauger. Au figuré, faire mal les choses, mettre le désordre : « Ah ben, voui ! J'ai vu dans son ormoire. Pauv' linge ! y é prou peùrtaugé ! » - (14) |
| peurtauger. Même sens que pautrer, avec un alourdissement destiné à donner au mot un sens plus accentue. - (12) |
| peurte : porte - (43) |
| peûrte, et pôrte, s. f., porte. - (14) |
| peurteillé : gâteau-pain bien levé avec des trous - (39) |
| peurtèntène ; couri lai peurtèntène, se transporter en désoeuvré d'un lieu à un autre pour se livrer à des plaisirs plus ou moins illicites. - (16) |
| peùrter, et pôrter, v. Ir., porter. - (14) |
| peurter. v. - Prêter. - (42) |
| peurter. v. a. Prêter. - (10) |
| peurteu (n.m.) : trou, ouverture (de l’a. fr., pertuis =trou) - (50) |
| peurteu, s. m. pertuis, trou, ouverture. - (08) |
| peurteux. adj. et s. Prêteur. - (10) |
| peûrtillé : se dit d’un bois « piqué des vers » - (37) |
| peurtintaine (courir lai) : courir les chemins - (39) |
| peurtôt : (adv) partout - (35) |
| peurtot : partout - (51) |
| peurtot adv. Partout. - (63) |
| peurtse n.f. Perche, gaule. - (63) |
| peurtsi : percher - (51) |
| peurtsi v. Percher. - (63) |
| peurtu (on) - goulotte (na) : trou (petit) - (57) |
| peurtu : (nm) trou - (35) |
| peurtu : trou (pertuis) - (51) |
| peurtu, n.m. trou, gouffre, col (Donzy le trou - Donzy le pertuis - Donzy le Peurtu). - (65) |
| peurtuger (v.t.) : percer, faire un trou - (50) |
| peurtugi : trouer - (51) |
| peurtuïer, peurtujer. faire un trou, percer : « l' pain ô brâman peurtuié », le pain est bien percé, bien levé. - (08) |
| peurtûji adj. (de pertuis, petit trou). Vermoulu. - (63) |
| peurtûji v. Percer de petits trous, creuser comme le font les vers à bois. - (63) |
| peurtus n.m. Trou. Peurtus d'gaufre : aliment très peu nourrissant. Voir également garde-peurtus. - (63) |
| peurtusi : (p.passé) troué - (35) |
| peurzâ, s. m. rejeton parasite ; pousse gourmande que projette la racine d'un arbre fruitier. - (08) |
| peurzeure : présure - (39) |
| peus prép. Plus. Voir pyus, pyus', mé. - (63) |
| peusanteue, s. f. pesanteur. « peuhanteu, p'zanteue. » - (08) |
| peusée, s. f. se dit d'une romaine dont on se sert pour peser certaines marchandises et aussi de la quantité ainsi pesée. - (08) |
| peuser, v. a. peser : ce panier est plein ; comme il « peuse ! » « peuher, p'zer. » - (08) |
| peûsi : puiser - (57) |
| peûs'ner : faire le difficile à table, trier la nourriture - (48) |
| peus'ner : tâter, tripoter, palper - (48) |
| peusner : (peusnè - v. trans.) tripoter, peloter. S' lé: plin:ché , lé: gamin: peu:snan lé: gamin' ! "dans les fenils, les garçons pelotent les filles". - (45) |
| peuso : (peu:so - subst. m.) doigtier, poucier, sorte de capuchon dont on recouvre le pouce quand il est blessé. - (45) |
| peuson, s. m. poids : le « peuson » d'une horloge, d'une balance, d'un tournebroche, etc. - (08) |
| peûsou (on) : puisette - (57) |
| peusque : Puisque. « Peusque te froïlle je ne jû plieu » : puisque tu triches je ne joue plus. - (19) |
| peussé : petit à petit, plus tard - (51) |
| peusse. Puisses, puisse. - (01) |
| peussein. Puissions, puissiez, puissent. - (01) |
| peusser, v., pisser. - (40) |
| peûssiarou (ze) : (adj) poussiéreux (se) - (35) |
| peussin - poussin. Voyez l'abréviation P'sin. - (18) |
| peûssire : (nf) poussière - (35) |
| peut - laid, vilain, méchant. - C'â bein peut ce qu'à faisant lai. - Que ceute fonne lai â don peute ! – Oh le peut ! - (18) |
| peut (l'), le diable - (36) |
| Peut (le) : Diable (le) - (48) |
| peût (peutte) : méchant (e), diable. - (32) |
| peut : Laid. (au féminin : peute). « In peut dreule » : un vilain garçon. « Ol en a fait les centpeutes fins » : il a abusé d'une façon abominable. - (19) |
| peut : laid… et lié au diable. Le diable est le « peut ».On dit peutes façons : mauvaises manières, peutement : vilainement, et dans un dicton : « Peutes chattes : braves minons ». - (62) |
| peut : malgracieux - (48) |
| peut : Pot. « In peut de grès ». « In peut de chambre » : un vase de nuit. - (19) |
| peut : vilain - (60) |
| peut : laid (peute : laide). Ço peut de dire des menteries : c'est laid de dire des mensonges. O la peute, elle boude : ô la vilaine elle boude. - (33) |
| peut(e) : vilain(e), laid(e) - (48) |
| peut(e) : laid(e) - (39) |
| peùt, adj., laid, désagréable, sale, méchant : « Oh! l'peùt ! v'tu ben te t'cacher ! » — « Ol a peùt âr,. peùte façon. » - (14) |
| peût, adj., vilain, pas beau. - (40) |
| peut, adjectif qualificatif : laid, vilain. En Bourgogne, le Peut est le nom donné au Diable. Il se trouvait autrefois au Creusot, dans le quartier des Riaux, une Rue du Peut. - (54) |
| peut, et au féminin peute, laid, laide, difforme... Ce mot se prononce peuë, comme queue... - (02) |
| peut, laid - (36) |
| peut, peute (C.-d., Morv., Chal.), put, pute, putaud (Y.). - Laid, mauvais, méchant, désagréable ; du même mot vieux français, même sens, venant lui-même du latin putidus, puant. - (15) |
| peut, peute (n. et adj.m, et f.) : laid, mauvais, maudit ; le Peut : le Démon - (50) |
| peut, peute : laid, laide. Le peut Jean : surnom de mon oncle, par opposition à son père, le vieux Jean. - (52) |
| peût, peûte adj. 1.Vilain, vilaine. A peûte tsatte biaux minons. 2. Laid, laide, puant, puante. 3. Fatigué. - (63) |
| peut, peute : adj., vx fr. put, pute, laid, laide. A peute chatte beaux minons, à vilaine femme jolis enfants. - (20) |
| peut, peute, adj. laid, désagréable, mauvais, méchant, sale, infâme, maudit : le peut, le démon. - (08) |
| peut, peute, adj. qual. ; laid, laide. - (07) |
| peut, peute, laid, laide, puante. - (05) |
| peut, peute, laid, laide. - (27) |
| peut, peûte, peutte : vilain, vilaine. - (66) |
| peut, peute. adj. Laid, vilain. (Avallonnais, Haute-Yonne). – Ce doit être une abréviation de petaud, peutaud, Peutaud. - (10) |
| peût, peute. Laid, laide, au propre comme au figuré. Etym. probable putridus, puant, infect ; putida femme de mauvaise vie. - (12) |
| peut, peute. : Laid, laide, difforme. (Du latin putidus.) Ce mot se prononce peüe comme queüe (Del.). - Faire peute fin à quelqu'un, c'est mal mener une personne. (Del.) - (06) |
| peut, peutte : mauvais(e) ; une peutte mèrande. - (56) |
| peut. Laid, méchant. (Fém. Peute). - (49) |
| peut. Laid. Vient de putidus. - (03) |
| peutâbre, vilain personnage (peut-être corruption de peut' Arabe). - (27) |
| peutamés. s. f. Personne laide et mal gracieuse. (Etivey). - (10) |
| peutantaine (courir sa), avoir une conduite plus ou moins régulière. - (27) |
| peuta-vârne (na) : bourdaine - (57) |
| peutchiot (otte) : petit - (39) |
| peût-diaib’e ! (çai) : (cette) sale bête ! - (37) |
| peuté : Potier. « Alle a cassé eune trape tote neue seurtant de chez le peuté » : elle a cassé une terrine toute neuve sortant de chez le potier. - (19) |
| peute : vilaine - (57) |
| peute façon, vilaine manière. - (05) |
| peute fin, mauvais usage. - (05) |
| peute n.f. Pet sonore. - (63) |
| peute verne, bourdaine, verne puante. - (05) |
| peute, pute : s. f., peuts : s. m. pl., gaude ou toute autre bouillie (à cause des bruits produits par l'éclatement superficiel de petites masses gazeuses pendant l'ébullition). - (20) |
| peute. Laide. Peut, qui se prononce peuë, comme queuë, est le masculin de peute.. - (01) |
| peute’feûner : détériorer ; dépérir - (35) |
| peûtefanner, v., plier, plisser, froisser de l'étoffe. - (40) |
| peutefener (pet'fener) : v. a., faner, flétrir, friper. - (20) |
| peutefener : Gâcher, abîmer, faire mauvais usage de. « Ol a tot peutefené san butin » : il a abîmé ses vêtements. - (19) |
| peûtefeuner v. Périr, mourir, détériorer. Ce verbe signifie littéralement finir en puanteur. - (63) |
| peutefin - méchanceté, malice, insulte. - A ne se pliait qu'ai fâre des peutefins. - A m'é dit totes les peutefins qu'en peut imaginai. - (18) |
| peutefin, n. fém. ; sottise. - (07) |
| peutefin, s. f. mauvaise fin, faire une « peutefin », c'est se mal conduire, faire des sottises, commettre des fautes. - (08) |
| peùtefin, s. f., fin triste, déplorable, malheur, catastrophe : « O va mau, l'gas ; ô f’ra peùtefin. » - (14) |
| peutefiner : abimer, détruire. Donner une « peute » fin : un mauvais (et dernier) usage. - (62) |
| peutement - peutament : vilainement - (57) |
| peutement : adv., laidement, vilainement. - (20) |
| peutement : Laidement, vilainement. « Ol a fait peutement quand ol i a savu » : il a fait une vilaine grimace quand il l'a su. - (19) |
| peùtement, adv. , laidement, vilainement. - (14) |
| peutement, adv. vilainement, laidement, méchamment. - (08) |
| peuterie (na) : laideur - (57) |
| peûterie, s. f., mauvaise action. - (40) |
| peutes gens : les vilaines gens (vilains, pas beaux) - (46) |
| peuteuriauder : crépiter - (51) |
| peuteuriot : fessier - (51) |
| peutevarne (n.f.) : viorne (plante) - (50) |
| peutfane : plante fanée, dépérissant. A - B - (41) |
| peutfanne : plante qui dépérit, fanée - (34) |
| peutfené : plante qui dépérit - (43) |
| peutfiner (v.t.) : mettre à mal gaspiller - (50) |
| peutifame, loc. s'emploie comme une injure sans que la signification précise en soit connue. - (08) |
| peutin, pot. - (26) |
| peutoise. n. f. - Femme mariée : «En avant les danseux : allez tous les tertous, eni 'vez les catamoises, fait' claquer les peutoises, galoupez coumm' des fous, démantibulez-vous. » (Fernand Clas, p.122) - (42) |
| peutoise. s. f. Dans le langage des vignerons d'Auxerre, s'entend d'une femme mariée. - (10) |
| peutöt, sm. petit pot. - (17) |
| peutoué : putois. Ol étot peut coume un peutoué : il était laid comme un putois. - (33) |
| peutr, p'ter. v. - Péter. - (42) |
| peutrailli : éclabousser en petites gouttelettes - (51) |
| peutrelle n.f. 1. Mobylette. 2. Fille légère ou prétentieuse. - (63) |
| peutremôle (ai lai) (loc.) : en débandade - (50) |
| peûtreûyâ : (nm) prétentieux - (35) |
| peutreuyâ, peutreuyaud, peutreuyoux n.m. Prétentieux. - (63) |
| peûtreuye : (nf) petite machine qui pétarade (une mobylette, par exemple) - (35) |
| peûtreûyi : (vb) (en parlant du feu) pétiller, faire des étincelles ; (en parlant d’une personne) faire l’important - (35) |
| peutreuyi v. 1. Pétiller (feu). 2. Faire l'important. - (63) |
| peutre-yi : faire des étincelles, pétiller (peut être employé pour une personne) - (43) |
| peutrot (on) – épatou (n’) : épouvantail - (57) |
| peutrot (on) - rôda (on) : vagabond - (57) |
| peutte, laide. - (26) |
| peuve - temps du verbe Pouvoir. C'est une forme peu usitée. - I demande seulement qu peuve veni ine heure. - (18) |
| peuvé. Pouvez. - (01) |
| peuvein. Pouvions, pouviez, pouvaient. - (01) |
| peùvez, 2è pers. pl., ind. prés., pouvez. - (14) |
| peuvo, peuyo, vt. pouvoir. - (17) |
| peuvo. Pouvais, pouvait. - (01) |
| peuvon. Pouvons. - (01) |
| peux. n. rn pl. - Marécages. (Diges, selon M. Jossier) - (42) |
| peux. s. m. pl. Marécages ; terrains mouvants. (Diges, Seignelay). Voyez peue. - (10) |
| peuzias. s. m. Enfant naturel. (Domecy-sur-Cure). - (10) |
| pèvé, pavé. - (26) |
| pèye, paille ; pèyèsse, paillasse. - (16) |
| péyoux : Payeur. « Crédit est meû les mauvas payoux l'ant tué ». - (19) |
| pëzé, peser, appuyer fortement les mains sur un objet, pour le fixer. - (16) |
| pezkeu, paziau. s. m. Espèce de radis noir sucré, qu'on trouve dans les guérets. (Collan). - (10) |
| Phîlî (l’) : (le) Philippe - (37) |
| Philippot, prénom, Philippe. - (38) |
| Phlebâ : Philibert. Au féminin Phlibarte. - (19) |
| Phlippe : Philippe. - (19) |
| Phœbe domine. Cette invocation païenne s'est conservée jusqu'à nos jours. Avant de distribuer les parts du gâteau des Rois, le plus jeune enfant de la famille disait : Phœbe domine, voici pour le bon Dieu (c'était la part des pauvres) ; Phœbe domine, voici pour mon grand père ; Phœbe domine, voici pour ma tante et ainsi de suite... - (13) |
| phoebo. Jeu d'enfant, qui ressemblait à la cache-cache... - (13) |
| phormacie. Pharmacie. - (49) |
| phormacien. Pharmacien. - (49) |
| physique : Prestidigitation. « In to de physique ». - Sorcellerie. « I est de la physique » : c'est de la sorcellerie. - (19) |
| pi (adv.) : puis - (64) |
| pi (n’avò pas), loc. n'avoir pas confiance dans les affirmations de quelqu'un. - (22) |
| pi (n'avoué pas), loc. n'avoir pas confiance dans les affirmations de quelqu'un : il n'y a pas pi à ce qu'il raconte. - (24) |
| pi (on) - peule (na) - franc (on) : porte-greffe - (57) |
| pi (on) : pied - (57) |
| pî : Pis. Employé seulement dans la locution : « La vaiche a ban pî » : c'est une bonne vache à lait. « Va seurment (seulement) la vaiche a ban pî » : ne crains pas de te montrer exigeant on a de quoi payer. Dans les autres cas le pis se dit pé. - (19) |
| pî : pivert - (37) |
| pi d'sarpent (on) : salamandre - (57) |
| pi, s. m. pic, pioche à une ou deux pointes. - (08) |
| pî, s. m., petit morceau de bois, appointi des deux bouts, que les enfants font sauter à l'aide d'un bâtonnet. A chaque saut du bois pointu, les joueurs, sans s'inquiéter de comprendre, disent : « Pi ! mi ! trois-picotis ! » Qu'est-ce que cela signifie ? - (14) |
| pi, s. m., pic, instrument de fer, pointu des deux bouts. - (14) |
| pi, s.m. jeu d'enfant composé d'un morceau de bois court, aiguisé des deux bouts que l'on envoie au moyen d'un bâton long d'un mètre environ. - (38) |
| pi. C'est encore un jeu d'enfant. Le pi, diminutif de pieu, est un court morceau de bois aiguisé des deux bouts... - (13) |
| piâ : la peau - (46) |
| pia : plat - (44) |
| piâ : n. f. Peau. - (53) |
| piâ, s.f. peau. - (38) |
| pia, s.m. pied. - (38) |
| piâ, peau ; é n'é pâ peu d'sai piâ, il ne craint pas les durs travaux. - (16) |
| piâ. Peau. Prononciation locale. - (12) |
| piacard, sm. placard. - (17) |
| piacou : collant - (44) |
| piacou, collant. - (26) |
| piacou, gluant, collant. - (28) |
| piae, peau. - (26) |
| piafé, v. n. manger sans appétit. - (22) |
| piafer, v. n. manger malproprement. - (24) |
| piafou : mâcher la bouche ouverte - (44) |
| piagis. s. m. Plaisir. (Argenteuil). - (10) |
| piaï, plaisir - (36) |
| piaicar, s. m. placard, armoire pratiquée dans l'épaisseur d'un mur. - (08) |
| piaicard (n.m.) : placard - (50) |
| piaice (n.f.) : place - (50) |
| piaice (na) : place (publique) - (57) |
| piaice : place - (37) |
| piaicé : placé (« ain pairijien piaicé c’ez l’zean-mairie » « l’y ai l’ot piaicé coûmme doûmastque c’ez lâs miç’ot ») - (37) |
| piaice, s. f. place, lieu, condition : « aine boune piaice », une bonne place. - (08) |
| piaice, sf. place. - (17) |
| piaicement (on) : placement - (57) |
| piaicer, v. a. placer, mettre en place. - (08) |
| piaici : placer - (57) |
| piaiçou (on) : placeur - (57) |
| piaidé, vn. plaider. - (17) |
| piaidou, sm. plaideur. - (17) |
| piaie, s. f. plaie, blessure. - (08) |
| piaifond, sm. plafond. - (17) |
| piaignant (on) : plaignant - (57) |
| piaïlla : Braillard. - (19) |
| piaillai, parler haut en grondant et d'un air animé. Dans le roman français, piauler signifie pleurer, et piaulard est un criard qui se plaint sans cesse... - (02) |
| piaillai. : Crier plutôt que parler, fatiguer quelqu'un de ses plaintes. (Du latin pipilare, caqueter.) - Dans le vieux français, le mot piaulard signifie criard et pleureur. (Lac.) - (06) |
| piaillat, pialat. Pleurnicheur, criard. - (49) |
| piâilli : piailler - (57) |
| piaïlli : Piailler, brailler. « On les entend piaïlli d'eune lieue » : on les entend piailler de très loin. - (19) |
| piâillou (on) : piaillard - (57) |
| piâillou : pleurnichard - (37) |
| piain, pieue. - C'est une abréviation qui consiste à retrancher la lettre l, et qui est très fréquente. - Beillez-moi z-en piain lai traippe. - En m'en fauro to piain. - Lai lune à bein cernée, c'â de lai pieue pou demain. - (18) |
| piain, s. m. plain, la meilleure partie du chanvre, ce qu'on appelle « œuvre ». - (08) |
| piainche (n.f.) : planche - (50) |
| piaînche (na) : planche (passerelle) - (57) |
| piaînchi (on) - bauchi (on) : fenil - (57) |
| piaindre : plaindre - (57) |
| piaindre : Plaindre. « Se piaindre de graiche » : se plaindre sans motif, avoir trop et se plaindre. On dit également : pliaindre. « O s'est pliaingnu ». - Gémir. « Ol est malède, ol est dans san lit qu'o pliaint ». - (19) |
| piaindre, vt. Plaindre ; pp. piaindu, ue. - (17) |
| piaingnat : Qui se plaint. Dicton : « Grand piaingnat grand vivat » : celui qui se plaint continuellement vit longtemps, il n'est pas indispensable d'avoir une parfaite santé pour vivre longtemps. - (19) |
| piainne, sf. plaine. - (17) |
| piain-pi (on) : plain-pied - (57) |
| piainte (n.f.) : plainte - (50) |
| piaintse : planche - (43) |
| piaintsi : plancher - (43) |
| piai-piai : homme « simple » - (37) |
| piaire : plaire - (57) |
| piaire, vn. plaire. piait-i ? Plaît-il, comment ? - (17) |
| piaisant : plaisant - (57) |
| piaisanté, vt. plaisanter. - (17) |
| piaisi : plaisir - (43) |
| piaisi : plaisir - (57) |
| piait (ain) : (un) plat, (une) assiette - (37) |
| piait (n.m.) : plat - (50) |
| piait (y ot) : (c’est) plat - (37) |
| piaizi : plaisir - (51) |
| piàler, et piôler. v. intr., piauler, crier. Se dit du cri des enfants, des oiseaux, et des volailles. - (14) |
| pialer. Piailler. - (49) |
| pialou : pelé. - (32) |
| piâlou, s. m., peau de lait bouilli. - (40) |
| piàloù, s. m., qui piaule, qui crie. - (14) |
| pian : haie. - (59) |
| pian : une haie (désigne le cornouiller). - (56) |
| pian : haie (voir : savée). - (33) |
| pian, s. m. nom vulgaire du cornouiller des bois. « puan. » - (08) |
| pian, sm. plan. - (17) |
| piance, s. f planche avec les diverses significations du français plancher se dit « piancé. » - (08) |
| piancer (n.m.) : plancher - (50) |
| pianche : dalle sur un ruisseau. (RDM. T IV) - C - (25) |
| pianche. Planche. - (49) |
| pianchi : plancher du fenil. - (21) |
| piançon, homme fort et bien bâti. - (27) |
| piânè : v. t. Crier sur un ton aigu. - (53) |
| piane. s. f. Brebis ; par allusion sans doute a la lenteur. (Champignelles). - (10) |
| piâner : piailler - (48) |
| piâner : (pyâ:nè - v. intr.) parler de façon stridente. - (45) |
| piang (on) : poing - (57) |
| pianné, vn. piailler. Se dit du tui-tui des poussins. - (17) |
| pianner : pousser de petits cris. - (31) |
| pianœ, adj. lisse, aplani. - (24) |
| pianotte : 1 n. m. Klaxon. - 2 v. t. ind. Parler sur un ton aigu. - (53) |
| piansson, m. jeune plant de légumes, d'arbre (du vieux français planson). - (24) |
| piant (n.m.) : haie vive - (50) |
| piant : haie - (48) |
| piant : haie de courte hauteur - (37) |
| piant : plant - (51) |
| piantai : planter. - (33) |
| piantain (du) : plantain - (57) |
| piante (na) : plante - (57) |
| piante : plante - (51) |
| pianté chû sâs quîlles (ben) : de vigoureuse apparence - (37) |
| piantè : v. t. Planter. - (53) |
| piante, s.f. jeune vigne : une piante de 2 5 coupées (un hectare). - (24) |
| pianté, vt. planter. - (17) |
| pianter (v.t.) : planter - (50) |
| pianter : planter - (43) |
| pianter : planter - (51) |
| pianter : planter - (57) |
| pianter : planter. - (52) |
| pianter : repiquer - (43) |
| pianter, plianter, v. a. planter. - (08) |
| pianteux. Planteur. - (49) |
| piantin : plantain - (43) |
| piantou (on) : plantoir - (57) |
| piantou (oū), sm. plantoir. - (17) |
| piantou : plantoir, planteur - (43) |
| piapia : s. m., papotage. Faire des piapias. - (20) |
| piapia. Pic-vert. Ce nom rappelle le cri de l'oiseau. - (49) |
| piapot : s. m., renoncule rampante (ranuncutus rcpèns), « Les feuilles de la renoncule rampante sont connues des ménagères sous le nom de piport ou pied de poule ». (Cariot. Etude des fleurs, Botanique. t. III, 1865, p. 314). - (20) |
| piaque, s. f. plaque, « piaque de feu », plaque du foyer ; fonte qui protège la paroi du fond. (voir : taque.) - (08) |
| piaqué, vt. plaquer. - (17) |
| piaquer (v.t.) : pétiller en éclatant, mais aussi lancer dans le sens de plaquer (aussi pouaquer) - (50) |
| piaquer, v. n. pétiller en éclatant. la pierre à chaux « piaque » lorsqu'on la jette dans le feu. - (08) |
| piaquou : poisseux. Ces noms viennent de poix : la résine collante. - (62) |
| Piar : prénom Pierre. - (53) |
| piâre : pierre. - (66) |
| piâre, pierre et Pierre, nom de baptême que l'on prononce aussi : Piaro, Piéro. - (16) |
| piàre, s. f., pierre. - (14) |
| piare, sf. pierre. - (17) |
| piargi : piétiner - (57) |
| piari : gésier - (43) |
| Piariche, prénom, Pierre. - (38) |
| piarraille, s.f. pierraille. - (38) |
| Piarratte, prénom, Pierrette. - (38) |
| piârre (n.f.) : pierre - (50) |
| piârre (na) : pierre - (57) |
| piarre : (nf) pierre - (35) |
| Piarre : Piarrot ou Piarreut. Pierre ; au féminin : Piarrette ; Pierrette. - (19) |
| piarre : pierre - (43) |
| piarre : pierre - (51) |
| piarre : pierre - (48) |
| piarre : Pierre. « I est bin partot que les piarres sant deures » : partout les pierres sont dures, partout la vie est difficile. « Greux c 'ment eune piarre » : d'une grosseur indéterminée. « Piarre à fû » : silex. « Piarre fiche » : menhir. « Piarre régûjouse » : pierre à aiguiser. « Avoir eune mauvase piarre dans san fû » : avoir de gros embarras et principalement une maladie qui ne pardonne pas. - (19) |
| piarre : plaire - (43) |
| piârre à agûji n.f. Pierre à aiguiser, placée dans le godot, rempli d'eau, pour affûter le dâ. - (63) |
| piarre à caille : Nom féminin. Caillasse, pierraille. - (19) |
| piarre agueusoure : pierre à aiguiser - (43) |
| piârre agûjaude n.f. Autre nom, moins répandu de la pierre à aiguiser. - (63) |
| piarre ai raigûiller : pierre à aiguiser - (48) |
| piârre d’lai baissie : pierre assez grosse, entaillée, comportant une encoche pour l’écoulement des eaux domestiques usées - (37) |
| piarre d'aigujoure : s. f. pierre à aiguiser. - (21) |
| piarre d'aigüjourre : pierre à aiguiser - (51) |
| piarre d'aiguyouére : pierre à aiguiser - (39) |
| piârre de bassie n.f. Pierre d'évier. - (63) |
| piarre de lavou : s. f. pierre d'évier. - (21) |
| piârre de si (na) : évier (égouttoir) - (57) |
| piârre n.f. Pierre. - (63) |
| Piârre : n. f. Pierre. - (53) |
| piarre : pierre - (39) |
| Piarre, Piarrot : Pierre, diminutif de Pierre - (48) |
| piârre, s. f., pierre. - (40) |
| piârre, s.f. pierre. - (38) |
| Piarre. Pierre, nom propre, et pierre, lapis. Le menu peuple de Paris et les paysans des environs disent aussi Piarre… - (01) |
| piarre. Pierre. - (49) |
| piârres (lâs) : (les) « pierres », village de la commune de st léger-de-fougeret - (37) |
| piarres pourtu (être en) : se dit d'un endroit très caillouteux, avec des pierres partout. - (56) |
| piarreux. Pierreux. - (49) |
| piarri : pierrier - (43) |
| piârrî n.m. Gésier. - (63) |
| piarrire : (nf) carrière de pierre - (35) |
| Piarrou : n. Diminutif du prénom de Pierre. - (53) |
| piarsi (n.f.) : persil (aussi piarchi selon de Chambure) - (50) |
| piarsi : (nm) persil - (35) |
| piarsi : Persil, petroselinum sativum. « In boquet de piarsi » : un bouquet de persil. - (19) |
| piarsi : persil. - (62) |
| piarsi : persil. - (29) |
| piarsi n.m. Persil. - (63) |
| piarsi : n. m. Persil. - (53) |
| piarsi, s. m. persil. « piarchi. » - (08) |
| piârsi, s. m., persil commun. - (40) |
| piarsi, s.m. persil. - (38) |
| piasser, piouler, piauler. v. n. imiter la voix, les cris des petits oiseaux, des petits poulets qui appellent leur mère. Du latin pipilare. - (10) |
| piat (n.m.) : plat (aussi piait) - (50) |
| piat : plat - (51) |
| piat, s. m. plat, assiette : « liécer, lisser lé plats », lécher les plats. - (08) |
| pia-t-il, loc. plaît-il ? on prononce même quelquefois « aiti. » - (08) |
| piatre (ă), sm. plâtre. Emplâtre - (17) |
| piâtre (masc.), grande étendue (ex.: un piâtre de luzerne à faucher). - (27) |
| piatre, enpiatre (ā), sm. espace, superficie, étendue de terrain. È gros piatre d'bos, une grande surface de bois. - (17) |
| piàtre, m. espace découvert dans un lieu broussailleux ou dans un bois. - (24) |
| piatte (na) : billon - (57) |
| piaû (d'la) : pelure - (57) |
| piaû (na) : peau - (57) |
| piau : la peau (voir : treuffes en piau). - (56) |
| piau : peau - (37) |
| piau : peau - (43) |
| piau : Peau, cuir. « T'as dan bin peu de ta piau ? » : tu as donc bien peur pour ta peau ? « In devanté de piau » : un tablier en cuir. - (19) |
| piau : peau. - (33) |
| piau d’eûrchon : peau de hérisson. matière dans laquelle sont confectionnés la plupart des porte-monnaie des morvandiaux, disent les « mauvaises langues » - (37) |
| piau de bique : Manteau de fourrure d'homme. « Ol a véti sa piau de bique pa aller à la foire ». - (19) |
| piau n. f. Peau. - (63) |
| piau : peau - (39) |
| piau, et pia, s. f., peau, épidémie : « O n'vout pas aller s'bât' ; ôl a peur pour sa piau. » (Ne pas confondre avec le mot suivant.) - (14) |
| piau, paie : peau - (48) |
| piau, s. f. peau. - (08) |
| piau, s. m., poil, cheveu. Ne se prend pas volontiers en bonne part. On ne dit jamais piaux pour parler des beaux cheveux d'une femme. - (14) |
| piau. n. f. - Peau. Se dit également en parlant avec mépris d'une femme. Autrefois ce mot signifiait femme de mauvaise vie. (F.P. Chapat, p.153) - (42) |
| piau. Peau. - (49) |
| piaulai, piaunai - se plaindre souvent pour peu de chose, demander à chaque instant sans être dans le besoin. - Quoi qu'ile veint tôjeur piaunai quemant cequi ? - Voiqui ine heure que les poules piaulant, vai don lio beiller ai mégé. - C'est surtout pour les poules qu'on dit piauler. - (18) |
| piaulé (visage) : marqué de taches. - (31) |
| piaulé : taches de rousseur sur le visage - (34) |
| piaulé et pipolé. Marqué de taches. Ce mot s'applique aux hommes et aux animaux. I aivons un chet qu’ast piaulé quement un liopart. — Les blondes sont preique teutes piaulées. - (13) |
| piaule. n. f. - Petite fille. (Champignelle, selon M. Jossier) - (42) |
| piaule. s. f. Petite fille. (Champignelles). - (10) |
| piauler. v. - Gémir, pleurnicher, en parlant d'un animal ou d'un enfant. Autre sens : couler, en parlant d'un fromage, par analogie avec «pleurer». Piauler est un mot français (déformation par onomatopée du verbe piailler), très peu utilisé dans la langue courante. Le poyaudin, comme de nombreux autres dialectes, l'utilise abondamment pour les oiseaux et les petits poulets qui crient, ou bien pour les enfants qui pleurnichent. - (42) |
| piauler. v. n. Pleurnicher. – Se dit aussi d'un fromage passé, dont la pâte semble fondre et se détacher de la piau, de la croûte. - (10) |
| piauleux. adj Qui fait la peau, la piau. – Fromage piauleux, fromage dont la pâte semble fondre et se détacher de la croûte, qui n'est plus qu'une sorte de peau, de piau. - (10) |
| piaûlou : fromage « fort ». Mélange de restes de fromages, pétri et muri dans une jarre, sous la cendre, derrière le poêle… - (62) |
| piau-morte, s. f., durillon, aux pieds ou aux mains, cor, œil-de-perdrix. - (14) |
| piaûne : pivoine. - (62) |
| piaunè : réclamer, demander quelque chose - (46) |
| piauner : (pyô:nè - v. intr.) pousser des gémissements plainti fs et répétés. Ainsi, on dira d'un chien qui a faim ou froid qu' il pyô:n' pour attendrir ses maîtres. - (45) |
| piauner, v. intr., crier comme les oiseaux de basse-cour. - (14) |
| piauner, v. n. se dit en général du cri des oiseaux de basse-cour. - (08) |
| piauner. Piauler, pleurer; se dit surtout des enfants. Prononciation locale sans raison et sans étymologie spéciale ; piauner, de même que piauler, n’est pas autre chose qu'une forme de piailler. - (12) |
| piaûnou : quelqu'un qui réclame sans cesse (piaûnouse au féminin) - (46) |
| piaute, pioute, pioutre (pour peautre). s. f. Gouvernail. (Laroche, Auxerre). - (10) |
| piauteur : s. m., marchand de peaux (piaux) de lapin. - (20) |
| piaux de r’nard : vomissures. Peaux de renard, renard étant un vomi. « Les lendemains de fête les poules mangent les renards ». - (62) |
| piayant (adj.m.) : plaisant - (50) |
| piâyé, parler fort. - (16) |
| piâyi (n.m.) : plaisir - (50) |
| piâyiant : plaisant - (37) |
| piâzan, plaisant, agréable. - (16) |
| piâzi, plaisir. - (16) |
| pi-bot (on) : pied-bot - (57) |
| pica : ajonc - (43) |
| picadiö, sm. sarrasin, blé noir. - (17) |
| picaille. n. f. - Petite monnaie. Rappelle le mot picaillon, tiré du dialecte savoyard. Ces mots reprennent l'ancien français piquar (sonner, tinter), par allusion au bruit des petites pièces. - (42) |
| picaille. s. f. Argent, monnaie. (Armeau). - (10) |
| picaillons, s. m. monnaie, argent en général par extension : il a des « picaillons » tout plein son armoire. - (08) |
| picaissé : grêlé - (37) |
| picârd, s. m., frelon. - (40) |
| picasé (part.passé pris pour adj.) tacheté, et plus particulièrement, couvert d'éphélides. - (45) |
| picassé (adj.) : marqué de taches de rousseur (syn. piolé – picassé coumme enne oeu d'dinde) - (64) |
| picassé : (p.passé) piqueté (de taches) - (35) |
| picasse : épinoche. IV, p. 32 - (23) |
| picassé, adj. marqué de petites taches de différentes couleurs : une poule, une étoffe « picassée. » - (08) |
| picassé, adjectif qualificatif : parsemé de taches de rousseur. - (54) |
| picassé, piaulé, nantillé. Couvert de taches de rousseur. - (49) |
| picasse, subst. féminin : tache de rousseur. - (54) |
| picassé. adj. - Parsemé de taches de rousseur. - (42) |
| picasse. n. f. - Boisson faite avec des fruits macérés dans l'eau pendant une dizaine de jours. Autre sens : taches de rousseur. (Arquian) - (42) |
| picasse. s. f. Piquette, boisson faite de fruits macérés dans l'eau. (Villeneuve-les-Genêts). - (10) |
| picassi : rempli de tâche de rousseurs - (51) |
| picassou : rempli de tache de rousseur - (44) |
| picatouére, s. m. purgatoire, lieu de souffrance et d'expiation. - (08) |
| picaud, picaude : s. m. et f., personne grande et maigre, « grande perche ». - (20) |
| picbeû (on) - beucbeû (on) : pivert - (57) |
| pic-en-fort : mixture de fromages variés. - (30) |
| pichai : uriner. - (33) |
| pichai, pichot - pisser, urine. - I ne sai pas d'où voint qui ai besoin de pichai ai to manmant. - Depeu deux jors mon pichot à quemant rouge ; i irai voué le maidecin. - (18) |
| pichat (nom masculin) : flaque d'eau. - (47) |
| pichat, pichet. s. m. Sorte de cruche de terre ayant à peu près la forme d'un broc, et fort en usage dans les pays vignobles. - (10) |
| pichcoter (verbe) : eau qui s'écoule goutte à goutte. - (47) |
| piche : urine - (48) |
| piche : Urine. « In tepin de piche » : un pot de chambre. « De la piche de bourrique » : de la mauvaise bière. - (19) |
| piche de chien, s. f. mauvais champignon. - (08) |
| piche : urine - (39) |
| pichè : v. t. et v. i. Pisser. - (53) |
| piche, pite. Poulette. - (49) |
| pichenet, s. m. pot à boire. - (08) |
| picheneuter, manger sans appétit, en choisissant ce qui est à son goût. - (27) |
| picheneuter, manger sans grand appétit. - (28) |
| pichenlé : n. m. Pissenlit. - (53) |
| pichenli, s. m. pissenlit, œil de bœuf. environ de Château-Chinon, Fretoy, etc. ; « pichenleit » à Anost, où lit se prononce « leit. » cette plante est appelée pissenlit parce que son bouillon est un diurétique. - (08) |
| pichenlit (n.m.) : pissenlit - (50) |
| pichenlit : pissenlit - (48) |
| pichenlit : Pissenlit, voir crôpe. - (19) |
| pichenlit : pissenlit. Les saldes de pichenlit sont bounes : les salades de pissenlit sont bonnes. - (33) |
| pichenlit : pissenlit - (39) |
| pichenotai, manger sans appétit, chercher les morceaux sur son assiette et en prendre à peine... - (02) |
| pichenotai. : Manger du bout des dents, écarter les morceaux sur son assiette. - Quand les villageois mangent à la gamelle, ils s'invitent à y prendre, en se disant entr’eux : piqué don (piquez, prenez donc). - (06) |
| pichenote, petit coup donné avec le doigt. - (16) |
| pichenotter. Grignotter. On a dû dire piguenotter, et pichenotter n'est qu'une forme adoucie par l'usage. Etym. quenotte, petite dent, du vieux français quenne, ou même cane, dent. - (12) |
| picher : pisser. - (52) |
| picher : uriner - (48) |
| picher : uriner - (39) |
| picher, v. ; pisser. - (07) |
| picher, v. a. répandre, jeter, lancer de l'eau ou un liquide quelconque ; pisser, uriner. - (08) |
| picherais, s. m. oreiller que l'on met sous les petits enfants. - (08) |
| picheratte : Nom féminin. Jet fin de liquide, mince filet d'eau qui coule. - (19) |
| picheron. : Petite pièce d'une chose. (Cout. de Châtillon, 1371.) - (06) |
| picherotte (fontaine picherotte) : filet d'eau - (48) |
| picherotte (n.f.) : petite chute d'eau - (50) |
| picherotte : trou dans le cuvier, on mettait du glui pour faire couler l'eau, par extension tout jet d'eau peut être appelé « picherotte » - (39) |
| picherotte, n. fém. ; petite source qui pisse de l'eau. - (07) |
| picherotte. s. f. petit canal par où l'eau s'écoule; canule, gouttière, petite chute d'eau. - (08) |
| pichetrou, s. m. ouverture par où s'écoule un liquide quelconque. - (08) |
| pichi : Pisser, uriner. « Pichi su le jab'lie », voir jab'lle. - (19) |
| pichier. n. m. - Pichet. Le poyaudin a conservé le terme médiéval pichier (XIIe siècle) désignant un pot à vin, une cruche, par altération de bichier, d'origine gréco-latine. - (42) |
| pichneuté, vt. pluchotter, manger sans entrain. - (17) |
| pichot : purin - (39) |
| pichot, s. m. pissat, urine. - (08) |
| pichou - (39) |
| pichou : orifice urinaire du verrat (détourné quand on le tue et utilisé pour graisser les scies) - (48) |
| pichou : pisseux, décoloré - (48) |
| pichou, ouse, s. m. et f. pisseur, celui qui pisse. Se dit souvent des petits enfants comme terme amical : « eun p'tiô pichou. » - (08) |
| pichou, pichouse : enfant qui urine au lit - (48) |
| pichouse , s. f. pisseuse, carpe que l'on met dans un réservoir pour aleviner, c’est à dire pour produire de l'alevin. - (08) |
| pichouse : vache atteinte d'hématurie - (48) |
| pichoux (ain) : (un) lange de bébé jauni - (37) |
| pichoûx (dû) : (de) l’urine (surtout de porc) - (37) |
| pich'rotte : 1 n. f. Fuite d'un liquide très petite. - 2 n. m. Jet faible d'un liquide. - (53) |
| pich'rotte, petite fontaine - (36) |
| pico : (nm) queue d’un fruit - (35) |
| pico, épine. - (16) |
| Picoche. Nom de famille assez répandu dans le pays. - (08) |
| picocher. v. - Picorer, par analogie avec « pignocher », manger sans appétit ; dérivé de espinocher, manger du bout des dents, au XVIe siècle. - (42) |
| picocher. v. a. Picoter ; manger avec dédain, du bout des dents. (Puysaie). - (10) |
| picon n.m. 1. Assemblage en faisceau de javelles liées. 2. Plantoir. - (63) |
| picon, s. m., gouvernail de même genre que l'empeinte, mais plus court et placé à l'avant. Terme de marine fluviale. - (14) |
| picot (n.m.) : pointe, aiguillon - (50) |
| picot (on) : pédoncule - (57) |
| picot : épine - (48) |
| picot : mot masculin désignant la boule de la bardane munie de piquants et qui adhère facilement aux vêtements (jeu des enfants) - (46) |
| picot : piquet - (44) |
| picot : queue (d'un fruit) - (43) |
| picot d'salle (on) : pied de chaise - (57) |
| picot n.m. 1. Pédoncule piquant. 2. Queue de cerise et d'autres fruits. - (63) |
| picot : (pico - subst. m.) épine, piquant (d'un végétal : chardon, églantier, etc.) - (45) |
| picot : s. m., vx fr. pecot, pédicule (au prop. et au flg.). Des picots de cerises. Voir dépicoter et repicoter. - (20) |
| picot, n.m. queue de cerise. - (65) |
| picot, piquet. - (04) |
| picòt, s m., pointe, aiguillon, épine, écharde, tout ce qui pique : « Prends garde à tes dèts, p'tiote ; la branche a des picots. » - (14) |
| picot, s. m. pointe, aiguillon, épieu, piquet, piquant : les « picots » du houx, les « picots » de l'églantier, etc. On employait autrefois le terme picaude pour piqûre - (08) |
| picòt, s. m., produit du chardon pignòlot. (V. ce dernier mot.) Par leurs mille crochets, ces petites têtes s'attachent aux vêtements. Les gamins s'amusent à les lancer sur les passants, qui ont du mal à en débarrasser leurs habits. - (14) |
| picot, s.m. pieu court muni d'un clou qui sert aux enfants pour se faire glisser. - (38) |
| picot. n. m. - Épi. - (42) |
| picot. s. m. Pieu. – Perchot non ferré à l'usage des mariniers. (Argenteuil, Laroche, Auxerre). - (10) |
| picòté, adj., marqué do la petite vérole : « La pauv’fille ! aile é restée la figure toute picòtée. » - (14) |
| picòte, s. f., petite vérole. - (14) |
| picoter : faner (avec une machine) - (48) |
| picoter, v. parsemer de points, piquer de points. - (38) |
| picoter, v. picorer. - (38) |
| picoteuse : faneuse (à cheval) - (48) |
| picotin, s.m. avoine pour le cheval, l'âne. - (38) |
| picôtis, s. m. (V. Pi.) - (14) |
| picots : poils de barbe épais et durs, très courts - (37) |
| picots : restants de pennes de plumes sur le corps d’une volaille après son plumage - (37) |
| picou : n. m. Épinoche. - (53) |
| picou, s. m. queue d'un fruit. Pied d'un meuble. Verbes empicoler, munir de pieds, et dépicoler, enlever les queues des fruits (du vieux français pecol). - (24) |
| picouhée. s. f. Picorée, maraude. Eller à la picouhée, aller en maraude. (Lucy-sur-Cure). - (10) |
| picoulée. s. f. bouillie d'avoine ou de sarrasin. - (08) |
| picoussiau. n. m. - Pivert. - (42) |
| picoussiau. s. m. Pic-Vert. (Diges). - (10) |
| pic-pendre (dire — de quelqu'un) : c'est le charger d'une réputation déplorable fausse ou vraie. - (30) |
| pic-pouac. exp. - Grande quantité, à profusion : « J'ons ramassé les truffes, y'en avait ! Pic-pouac. » - (42) |
| picraie (n. f.) : nourriture, pitance - (64) |
| picsat (n. m.) : plante dont les graines s'accrochent aux vêtements (syn. persat) - (64) |
| pid : (nm) pied - (35) |
| pid : pied - (43) |
| pid : pied - (51) |
| pid : Pied. « Vins voir te chauffer les pids » : viens te chauffer les pieds. « Ol a les quat 'pids bliancs » : il a les quatre pieds blancs, il peut montrer patte blanche, il peut passer partout. - Tronc d'arbre. « In biau pid de noué » : un beau tronc de noyer. - (19) |
| pid de poule : Voir pipou. - (19) |
| pîd d'veugne n.m. Cep de vigne. - (63) |
| pîd n.m. 1. Pied. 2. Pas, allure. Martsi à so pîd. Marcher à son allure, à son pas. Martsi à pîds d'tsauchons. Marcher à pas feutrés. - (63) |
| pid. Pied. - (49) |
| pidance : massue. - (09) |
| pidance ou pidanse, repas, aliment ; bien, abondance... - (02) |
| pidance : s. f., pitance. Faire pidance, manger copieusement, manger un aliment en l'accompagnant de beaucoup de pain. Ce fromage est bon ; i fait faire pidance. - (20) |
| pidance, parfois pitanche, s. f., pitance. A aussi l'acception de bonne cuisine, gâteau, etc. - (14) |
| pidance, pitance : ce que l'on mange avec le pain. - (16) |
| pidance, s. f. masse ou maillet. - (08) |
| pidance. s. f. Viande, fruits, légumes, tout ce qui se mange avec le pain, tout ce qui sort à l'alimentation de l’homme en dehors du pain. Il diffère en cela de pitance, qui comprend le pain aussi bien que le reste, et qui offre l'idée restreinte et peu relevée d'une sorte de portion congrue attribuée soit à un homme, soit à un animal, pour son repos. Voyez épidancer. - (10) |
| pidancer, apidancer : v. a., faire manger abondamment, satisfaire largement l’appétit. Le trappisline n'apidance guère; autant manger du pain sec, ou encore de la pomme de terre. - (20) |
| pidanse ou pidance. : Repas, aliments, victuaille. - Mauvaise orthographe généralement usitée ; c'est pitance qui est le vrai mot. Il sembleraitêtre formé des mots latins piorum substantia, car il appartient particulièrement au vocabulaire monastique, où il signifie portion alimentaire donnée à un religieux. - (06) |
| pide du jour, pique du jour. Pointe du jour. - (49) |
| pidé, v. a. regarder avec attention. - (22) |
| pidence. s. f. Masse. - (10) |
| pider : regarder fixement, scruter. A - B - (41) |
| pider (C.-d., Chal.), pidrer (C.-d.), piger, pisé (Morv.). - Calculer, mesurer la distance en jouant aux palets ou aux billes, par exemple. Vient probablement de piéder, mesurer avec le pied, pas à pas. - (15) |
| pider : épier - (37) |
| pider : épier - (57) |
| pider : épier et mesurer/ pieds. Espionner. Mesurer par longueurs de pied, et compter pour tirer au sort dans les jeux d’enfants. - (62) |
| pider : Mesurer. « O m'y a bien pidé » : il m'a mesuré cela bien exactement. - Au jeu de bouchon : « Y est ma que tins - Pas vrâ, y est ma - Ah bin y faut pider ». - (19) |
| pider : regarder fixement - (34) |
| pider : regarder fixement - (43) |
| pider : regarder fixement - (44) |
| pider, peder : v. a. Lyonnais, bider. Mesurer (à l'aide du pied) une distance, spécialement au jeu de boules. Guetter. Je l'ai pidé venir. - (20) |
| pider, pidrer v. Regarder fixement, épier, guetter. Dz'l'ai pidé vni. J'ai guetté sa venue. - (63) |
| pider, v. a. regarder avec attention. - (24) |
| pider, v. épier, espionner. - (65) |
| pider, v. tr., mesurer, avec le pied ou une paille, la distance d'un palet à un autre. Expression dont se servent les enfants qui jouent au palet. - (14) |
| pider, v., regarder avec curiosité, espionner. - (40) |
| pider, verbe intransitif : tirer au sort avec une comptine ou un jeu. - (54) |
| pider, verbe transitif : guetter, épier. - (54) |
| pider. Tirer au sort pour choisir ses compagnons de jeu, par exemple à qui jouera le premier. Le tirage se fait d'une façon spéciale. Les deux chefs de bande placés à une certaine distance, marchent à la rencontre l'un de l'autre en plaçant leurs pieds talon contre bout. Celui qui arrive à poser le bout de son pied sur celui de l'autre a le droit de choisir. « Pider » vient donc de pied, « pid ». « Pider » s'emploie encore pour surveiller, guetter. - (49) |
| pi-de-troqui : clarinette (tr. lit. : pied de maïs). A - B - (41) |
| pidiance : Aliments, mets, ce que l'on mange avec le pain. « De la bonne pidiance ». - (19) |
| pidiance, pitiance, sf. pitance. - (17) |
| pidiaule, adj. celui ou celle qui est disposé à la pitié, qui est porté à avoir de la compassion pour autrui. - (08) |
| pidie : Pitié. « I vaut mieux fare envie que pidie ». - (19) |
| pidiè, pitié ; un Jésus à la colonne, à Nuits, s'appelle : l’bon Dieu d'pidié ; on y dit aussi : Notre Dame de Pidié, pour : Notre-Dame de la Compassion. É fé pidié, il excite la pitié. - (16) |
| pidié, pitié. - (05) |
| pidié, s. f. pitié, compassion, commisération. - (08) |
| pidié, s. f., pitié, compassion. - (14) |
| pidié, sf. pitié. Po pidié et po lö, par pitié et pour tout (au monde). - (17) |
| pidiou - piteux, digne de pitié, plein de compassion. - C'â ine brâve fonne que le cœur pidiou pou les malheureux. - Regaide donc qué air pidiou qu'al é ! - (18) |
| pidiou, adj., piteux, pitoyable, qui inspire la pitié. - (14) |
| pidiou, enclin à la pitié. - (05) |
| pidiou, ouse, adj. compatissant, miséricordieux, celui ou celle qui a pitié des autres : « ç'ô eune fon-n' bin pidiouse », c'est une femme bien compatissante. - (08) |
| pidiou, ouse, adj. triste, piteux. - (17) |
| pidiou. Digne de pitié, pitoyable. Nous disons pidie pour pitié. - (03) |
| pidioux : Sensible, qui s'émeut facilement. « O n'est pas pidioux » il n'est pas sensible, il a le coeur dur. - (19) |
| pidou : celui qui épie souvent - (37) |
| pidoux (au féminin pidouse), substantif et adjectif : celui qui épie. - (54) |
| pidrer : (vb) regarder avec insistance - (35) |
| pidrer, v. mesurer parcimonieusement. - (38) |
| pidrer. Se mettre au but, dans tous les jeux a projectiles. Ex. : « Avant de jouer, il faut d'abord pidrer. » Etym. pied. - (12) |
| pidri : chétif. Malingre. - (62) |
| pids d’ pots : renoncules (boutons d'or) - (51) |
| pidze : trace de pas - (51) |
| pidzeon : pigeon - (51) |
| pidzon : pigeon - (43) |
| pie : Pépie. « Totes ses pouleilles ant ésu la pie » : toutes ses poules ont eu la pépie. Au figuré, « prendre la pie » : avoir très soif. - (19) |
| pie : s .f., vx fr., espace de terre compris entre deux traversières et renfermant les portions de rases sectionnées par ces traversières ; portion de pré divisé pour la vente du foin sur pied. Voir rase. - (20) |
| pie, n.m. parcelle d'assolement, sole. - (65) |
| pie, pied. - (05) |
| pie. adj. - Pire : « C'est l'pie d'tout ! I' reuste pus eune grappe su' la treuille, les ravous il' ont tout mangé. » - (42) |
| pie. Pied. Nous appelons les ricochets « pieds de chat ». - (03) |
| pieau : la peau - (44) |
| pieau : peau. - (52) |
| piéc’e : pièce - (37) |
| piéce (aine) : (un) fût de 228 litres de contenance - (37) |
| piéce (na) : pièce - (57) |
| pièce : place - (43) |
| pièce : place - (51) |
| pièce ; une pièce de vin, de la contenance de deux cent vingt huit litres. Pièce se dit aussi pour : place : fé me d'lai pièce, fais moi de la place. - (16) |
| pièce : s. f., s'applique à toute espèce de somme d'argent, même ne correspondant pas à une pièce de monnaie proprement dite. Ça va chercher une pièce de sept à huit francs. - (20) |
| pièche : (pyèch' - subst. f.) pioche. - (45) |
| piècher : (pyèché - v. trans.) piocher. - (45) |
| piéchie (n.f.) : haie tressée - (50) |
| piéchie : haie (savée), on dit aussi : pléchie. - (33) |
| pièchot : (pyècho - subst. m.) serfouette, piochon. - (45) |
| piéci : buisson (qui sépare des pièces de propriétés) - (51) |
| piéci : placer - (43) |
| pied carré : s. m., ancienne mesure de surface en général, valant 10 décimètres carrés 552. - (20) |
| pied cube : s. m., ancienne mesure de volume en général, qui valait 0 mètre cube 034277, c'est-à-dire un peu plus de 34 décimètres cubes. - (20) |
| pied d’beu : champignon d’automne - (37) |
| pied d’couaiçot : mauvais tour, méchanceté - (37) |
| pied d’mairmitte : nez épaté - (37) |
| pied de boeuf (prononcé beu) : champignon rose (agaric) de très grande taille. - (59) |
| pied de jus : pieds trempé - (44) |
| pied d'pot : renoncules - bouton d'or - (39) |
| pied : s. m. A son pied, de son pied, loc. adv., sans se presser, sans se gêner. Marcher à son pied. - (20) |
| pied-de-beu : s. m., pied-de-bœuf, pied bot. - (20) |
| pié-de-môshe, loc. pied-de-mouche, avoine dégénérée que produit une culture sans engrais. - (08) |
| pied-jaune. s. m. Vigneron, ouvrier qui pioche la terre, qui a toujours les jambes et les pieds jaunis par la terre. - (10) |
| piedpou : plante : renoncule. - (33) |
| pied'pou : n. f. Renoncule. - (53) |
| pied-pou, n.m. renoncule des champs. - (65) |
| piége (on) : piège - (57) |
| piégeou (on) : piègeur - (57) |
| piégi : pièger - (57) |
| piêilli : plaisir - (48) |
| pièilli : plier - (57) |
| pièilli : ployer - (57) |
| pieillou : plieur - (43) |
| piein : plein - (57) |
| piein-nement : pleinement - (57) |
| piein-temps (à) : plein-temps - (57) |
| pieintse : planche - (51) |
| pieintsi : plancher - (51) |
| piein-vent (on) : plein-vent - (57) |
| piejer, v. a. plier, ployer. - (08) |
| piéjon, s. m. tige de bois pliée et couchée. (voir : pléchâ. pléïon.) - (08) |
| piémontouaise : piémontoise, pic des puisatiers italiens - (37) |
| piémontouaise, pieuche montouaise : pioche avec un pic - (48) |
| piémontouése, s. f. piémontaise, pioche à tranchant avec une pointe ou un pic à l'extrémité opposée. En français le piémontais est un instrument à l'usage des charpentiers propre à tailler les pièces de bois. - (08) |
| pien (-e) (adj.m. et f.) : plein, pleine - (50) |
| pien : complet - (57) |
| pien : plein - (43) |
| pien(ne) : plein(e) - (51) |
| pien, plein; là pien, tout plein. On dit encore en Bourgogne : J'en ai tout plein. - (02) |
| pienne : Sorte de frange formée de la rognure d'une pièce de toile à laquelle pendent les fils. - (19) |
| pienne-main (aine) : (une) brassée - (37) |
| pienner : le fait de former, par exemple un manche, avec une plane. - (33) |
| piennes, piounes, pionnes. n. f. pl. - Franges aux extrémités d'un tissu. - (42) |
| piennes, piounes, pionnes. s. f. pl. Fils non tissés formant franges à l'extrémité d'une pièce de toile ou d'étoffe quelconque. (Puysaie). - (10) |
| piépou (n.m.) : renoncule rampante - (50) |
| piépou : renoncule rampante - (48) |
| piépou : (pyé:pou - subst. m.) (botanique) bouton d'or. - (45) |
| piépou, renoncule vulgaire qui donne le bassèn d'or. - (16) |
| pié-pou. Renoncule rampante, ranunculus repens. - (08) |
| piérassi (du) - piér'ssi (du) : persil - (57) |
| piérassi, s. m. persil. - (22) |
| pie-ravâche. n. f. - Pie-grièche. - (42) |
| pie-ravâche. s. f. Pie-grièche. (Puysaie). - (10) |
| pierre-écrite, nom de loc. hameau de la commune d'Alligny-en-Morvan ainsi nommé à cause d'un monument assez curieux qui existe dans son enceinte. Ce monument était probablement une pierre tombale. - (08) |
| Pierrette, Pierrotte : s. f., nom que certaines paroissiennes de Saint-Vincent de Mâcon donnent aux paroissiennes de Saint-Pierre. Celles-ci ont la charité de ne pas traiter celles-là de « vieilles cathédrales », mais simplement de Vincentines. Voir Clémentine et Vincentine. - (20) |
| pierrier, s. m., gésier des volailles. - (40) |
| pierrot les petits. n. m. - Auriculaire. - (42) |
| Pierrot. ce dimin. de Pierre a pour diminutif Pierrichot, Piarrot. - (08) |
| piersi : le persil - (46) |
| pièrssi, s. m. persil. - (24) |
| piessi : haie. A - (41) |
| piessi : haie - (34) |
| piéton, s. m. facteur rural, celui qui porte les lettres dans nos campagnes. - (08) |
| piéton, s. m., facteur rural : « J'atendons l’piéton, raport aux nouveûles du p'iiot. Si ô veint vite, j’li baillerons à bouére eùn bon côp. » - (14) |
| piètre et pieitre, vil, mesquin, de peu de valeur... - (02) |
| piètre. : Vil, abject, de peu de valeur. Au XIIe siècle (1120) on appelait piètres de petites pièces de mince valeur. (Lac.) - (06) |
| pieû : pluie. - (21) |
| pieuç’e : pioche - (37) |
| pieuce : pioche. - (52) |
| pieuche (n.f.) : pioche - (50) |
| pieuche : pioche - (48) |
| pieûchè : piocher - (46) |
| pieûche : une pioche - (46) |
| pieuche : pioche. Dans les jardins on se sert de la pieuche : dans les jardins on se sert de la pioche. - (33) |
| pieuche : n. f. Pioche. - (53) |
| pieuchè : v. t. Piocher. - (53) |
| pieuche, piéche, s. f. pioche. « pieuce. » - (08) |
| pieuche, pleuche (une) : une pioche - (61) |
| pieuche, s. f. pioche. Verbe pieuchi. - (24) |
| pieûche. n. f. - Pioche. - (42) |
| pieûcher (v. tr.) : piocher, biner (pieûcher les blettes) - (64) |
| pieucher (verbe) : piocher. - (47) |
| pieucher : piocher - (48) |
| pieucher, v. a. piocher, se servir d'une pioche. « pieucer. » - (08) |
| pieuchon (n.m.) : petite pioche (a. fr. pieuchon) - (50) |
| pieûchon. n. m. - Petite pioche. - (42) |
| pieuchot : serfouette - (48) |
| pieuchot, s. m. petite pioche. « pieuçot. » - (08) |
| pieûchotte : une petite pioche - (46) |
| pieuçot : petite pioche, piochon. - (52) |
| pieue (n.f.) : pluie - (50) |
| pieue (nom féminin) : pluie. - (47) |
| pieue : pluie - (48) |
| pieue : pluie. - (52) |
| pieue : pluie. - (66) |
| pieue : pluie. - (32) |
| pieue, pleue : pluie. Les terrains sont noyés par le pieue : les terrains sont noyés par la pluie. - (33) |
| pieue, s. f. pluie. bourg. « pleuje, pleue. » - (08) |
| pieue, sf. pluie. - (17) |
| pieue. Pluie. - (49) |
| pieuee : n. f. Pluie. - (53) |
| pieuge : piège. - (29) |
| pieuher, v. a. pleurer, verser des larmes. - (08) |
| pieum' (nom féminin) : plume. - (47) |
| pieumâ : n. m. Plumeau. - (53) |
| pieumai : plumer. - (33) |
| pieumar, s. m. plumet. - (08) |
| pieumas (n.m.) : plumeau - (50) |
| pieumâs : plumeau - (48) |
| pieume (n.f.) : plume - (50) |
| pieume (na) : plume - (57) |
| pieume : plume - (43) |
| pieume : plume - (44) |
| pieume : plume - (48) |
| pieume : plume - (51) |
| pieume : plume. pieumer : plumer. - (52) |
| pieume : une plume. - (56) |
| pieume : plume. Les poules perdont leurs pieumes tous les ans : les poules perdent leurs plumes tous les ans. - (33) |
| pieume : n. f. Plume. - (53) |
| pieumè : v. t. Plumer. - (53) |
| pieumé, ée. adj. Chauve, plumé, déplumé. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| pieume, plume - (36) |
| pieume, s. f. plume. (voir : pleume.) - (08) |
| pieume, s.f. plume. Verbe pieumer, enlever la plume. - (24) |
| pieume. Plume. - (03) |
| pieume. Plume. - (49) |
| pieume. s. f. Plume. (Samt-Germain-des-Champs). - (10) |
| pieumeau (on) : plumeau - (57) |
| pieumeau, s. m. plumeau. (voir : râdouée.) - (08) |
| pieumer (v.t.) : plumer - (50) |
| pieumer : plumer - (43) |
| pieumer : plumer - (51) |
| pieumer : plumer - (57) |
| pieumer : plumer, peler, éplucher - (48) |
| pieûmer ain poulot : plumer un poulet - (37) |
| pieûmer dâs c’âtîgnes : éplucher des châtaignes - (37) |
| pieumer. Plumer. - (49) |
| pieumeue : épluchure de pommes de terre, pelure. - (52) |
| pieumeue : épluchure de pommes de terre, pelure. - (33) |
| pieumeue, s. f. épluchure, ce qui a été plumé, pelé, épluché. (voir : pleumer.) - (08) |
| pieumoure ou pioumoure, s. f. pelure, épluchure. Verbe pieumer, enlever la pelure, éplucher. - (24) |
| pieumu (-ouse) (adj.m. et f.) : plumeux,plumeuse - (50) |
| pieuque. s. f. Visière. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| pieûré ! (y n’ot pâs) : (ça n’est pas) mesuré chichement ! - (37) |
| pieuré, vn. pleurer. - (17) |
| pieurer (v.t.) : pleurer - (50) |
| pieurer : pleurer - (43) |
| pieurni, m. celui qui défriche des broussailles à la pioche. Verbe pieurner. - (24) |
| pieurnichi : pleurnicher - (57) |
| pieus : plus (négation) - (57) |
| pieusse : pioche - (39) |
| pieusse, pieuche (n.f.) : pioche - (50) |
| pieusser : piocher - (39) |
| pieusser, pieucher (v.t.) : piocher - (50) |
| pieussot : petite pioche - (39) |
| pieutche : pioche. (MLB. T II) - S&L - (25) |
| pieûte d’lâne (aine) : (une) pelote de laine - (37) |
| pieûte, (ain) plot (aine) : (un) billot pour fendre le bois - (37) |
| pieuton : billot. - (29) |
| pieuton, sm. petit cylindre de bois servant de siège aux enfants. - (17) |
| pieutoût : plutôt - (57) |
| pieutré, vt. faucher maladroitement. - (17) |
| pieutse : (nf) pioche - (35) |
| pieutse : pioche - (51) |
| pieûtse pyate : (nf) houe - (35) |
| pieûtsi : piocher - (35) |
| pieutsi : piocher - (51) |
| pieutsi, piotsi v. Piocher. - (63) |
| pieuvassai : bruiner, tomber une petite pluie, pleuvasser. - (33) |
| pieuvassè : v. impers. Bruiner. - (53) |
| pieuvasser : bruiner - (48) |
| pieuvo, pieuvre, vn. pleuvoir. - (17) |
| pieuvre : pleuvoir - (43) |
| pié-yer : plier - (43) |
| piffette. s. f. Petit verre de liqueur. (Guillon) - (10) |
| piff'reau (nom masculin) : petit métier qui consistait à collecter les peaux de lapins. - (47) |
| pifourne. s. f. Galette. (Vallée d'Aillant). - (10) |
| pifre, s. m., pif, nez gros et bourgeonné. Jadis on se faisait presque gloire de cette décoration du buveur. - (14) |
| pigè : v. t. Fouler pour tasser. - (53) |
| pigé, piétiner un terrain, imposer à quelqu'un des impôts onéreux. - (16) |
| pige, s. f. mesure, terme de comparaison pour une masse, une dimension, une étendue : prendre la « pige » de la taille, la « pige » des pas, la « pige » d'une enjambée, la « pige» d'un champ, etc. - (08) |
| pige, s. f., mesure, point de comparaison, et aussi attrape. - (14) |
| pige. s. f. Mesure de longueur. - (10) |
| pigeage : s. m., action de piger. - (20) |
| pigeai - piétiner, fouler. - Quand en pense que les petiots sont entrai dans le jairdin et l'en to pigeai. - I les ai trouvai qu'à pigeaint les rasins dans lai cuve. - (18) |
| pigean : Pigeon - (19) |
| pigeôle : n. f. Grippe toussante. - (53) |
| pigeonné : Pigeonnier. « Ol a fait bâti (construire) in pigeonné ». - (19) |
| pigeonner, pigeotter. v. n. Végéter, reverdir, bourgeonner, en parlant des végétaux. (Saint-Florentin, Villechetive). - (10) |
| pigeonni (on) : pigeonnier - (57) |
| pigeou, s. m., bâton pour fouler le raisin dans les cuves. - (40) |
| pigeou, s.m. merlin que l'on emploie pour écraser les raisins. - (38) |
| piger (dans toute la Bourg.). - Fouler, presser sous les pieds ; s'applique surtout, en Bourgogne, aux raisins qu'on écrase avec les pieds dans une cuve ou avec un pigeou, sorte de pilon à manche de bois ; du bas latin pigere, dans le sens de presser. C'est un peu le sens de pautrer. On pautre ou on pige la terre ; c'est de là qu'est venu pisé, terre rendue ainsi dure et compacte… Terminons en faisant observer qu'en argot, piger veut dire pincer, surprendre quelqu'un; c'est alors le sens du mot piège, venant du vieux français piéger, faire tomber dans un piège. - (15) |
| piger : piétiner pour tasser, fouler au pied - (48) |
| piger : prendre, voler - (60) |
| piger : v. a., piétiner, fouler aux pieds. - (20) |
| piger, broyer avec les pieds. - (28) |
| piger, fouler aux pieds. - (05) |
| piger, piétiner par des gens ou des bêtes, fouler le raisin dans la cuve. - (27) |
| piger, v. a. fouler, presser sous ses pieds. Le vigneron « pige » le raisin dans la cuve ; un jardinier « pige » la terre pour la rendre plus ferme. on « pige » une aire de grange pour battre l'argile. - (08) |
| piger, v. a. mesurer, prendre la mesure de... - (08) |
| piger, v. écraser ; piger la cuve : faire baisser sous le jus les raisins dans une cuve qui fermente, - (38) |
| piger, v. fouler aux pieds (piétiner le foin pour le tasser dans le fenil, fouler le raisin). - (65) |
| piger, v. tr., attrapper, tromper et dérouter quelqu'un qui médite un projet mauvais : « L'aut' voulòt l'mét' dedans ; mâ ô t’la brament pigé. » - (14) |
| piger, v. tr., écraser, fouler, aplatir avec les pieds. On pige le raisin dans la cuve ; on pige et avarie une récolte en marchant dessus ; on pige la terre pour la durcir, etc. - (14) |
| piger, v. tr., mesurer, particulièrement au jeu de bouchon, où l'on a à constater la distance des sous. - (14) |
| piger. Ecraser avec les pieds. Te vâs mettre tes saibots et monter su le pressoir pour piger les râsins. Ou dit aussi piger la terre, en plantant de jeunes arbres. On écrivait autrefois piéger : ce verbe, reste dans le langage des veneurs, a formé piège, instrument qui prend par les pieds les animaux malfaisants. - (13) |
| piger. Piétiner. Fig. « Se faire piger » c'est se faire prendre, se faire arrêter. - (49) |
| piger. v. a. Mesurer ; prendre en faute. - (10) |
| pigeuter : Piétiner sur place. - (19) |
| pigi : Fouler, broyer avec les pieds. « Pigi la cûe » : fouler le raisin dans la cuve. Le vigneron qui pige sa cuve ne se borne pas à fouler le raisin avec les pieds, il entre nu dans la cuve et broie les raisins en les écrasant contre sa poitrine avant de les mettre sous ses pieds. - (19) |
| pignai (se) : se peigner. - (33) |
| pignai, pignée – peigner, dispute avec coups. - Que le père Jean à don mau pigné tojeur. - Ah le Batisse é beillé ine bonne pignée â Daudi. - (18) |
| pignâloûs : fruit de la bardane, très adhésif, que l’on projette sur les cheveux, les habits, les chapeaux, où ils restent « collés » - (37) |
| pignanloup : petit fruit de la plante commune appelée bardane qui a pour caractéristique de s'accrocher solidement aux vêtements (propriété identique au Velcro). Ex : "Mais lavou don t'es allé trainer, t'as des pignaloup su' toutes tes affées ?" - (58) |
| pignar, s. m. celui qui peigne le chanvre pour fabriquer l'œuvre. - (08) |
| pignard, s. m., peigneur de chanvre. - (14) |
| pignârou (n.m.) : 1) peigneur de chanvre - 2) boule de bardane - (50) |
| pignârou, s. m. celui qui peigne et travaille le chanvre. (voir : barbanchon, serilleu.) - (08) |
| pignat (adjectif) : mal coiffé. - (47) |
| pigne (n.m.) : peigne - (50) |
| pigne (on) : peigne - (57) |
| pigne : peigne - (37) |
| pigne : peigne - (48) |
| pigne : peigne. - (52) |
| pigne : Peigne. « In pigne de bouis» : un peigne en buis. « Sale c'ment in pigne » : très sale. - Dents, mâchoire. « Alle m'a grinci cantre alle m'a fait voir san pigne » : elle m'a montré les dents. - « Pigne de bourrique » : plante sauvage, cardère. - (19) |
| pigne : un peigne - (46) |
| pigne : peigne. - (33) |
| pigne de chat, peigne de chat. Chardon à foulon, cardère. - (49) |
| pigne : n. m. Peigne. - (53) |
| pigne : peigne - (39) |
| pigne : s. m. peigne. - (21) |
| pignè : v. t. Peigner. - (53) |
| pigne, peigne - (36) |
| pigne, peigne ; s'pigné, se peigner ; pignë, voléé de coups. - (16) |
| pigne, peigne, pignard de chanvre. - (05) |
| pigne, peigne. - (04) |
| pigne, pingne, s. m. peigne. - (08) |
| pigne, rangée de dents. - (05) |
| pigne, s. m., peigne. - (14) |
| pigne, s.m, peigne ; pigner, v. peigner. - (38) |
| pigne. n. m. - Peigne. Au Moyen Âge, on employait pigne ou peigne, pigner ou peigner ; le poyaudin a conservé ces termes (issus du latin pectinem ). - (42) |
| pigne. Peigne. - (49) |
| pigne. Peigne. Pignier, peigner. Nous appelons pignards les peigneurs de chanvre. - (03) |
| pigneau, s. m. petit rameau à fruits de certains arbres ou arbustes, branches supérieures du sarrazin ou blé noir. On prononce en plusieurs lieux « pinau « et « pignas. » - (08) |
| pigne-cu, adj. m. et parfois subst., être sale, méprisable, homme de rien, servile, hypocrite. - (14) |
| pignée : raclée - (48) |
| pignée : raclée - (39) |
| pignée, bataille où les adversaires se prennent par les cheveux. - (27) |
| pignée, s. f. peignée, raclée, lutte où l'on se prend aux cheveux. De « pigne », peigne. - (08) |
| pignée, s. f., peignée, roulée : « Ah! j'te li ai fichu eùne pignée. . . ô s'en sôvenra. » — A de nombreux synonymes. - (14) |
| pigner (se) : se peigner. - (52) |
| pigner (v.t.) : peigner - (50) |
| pigner : peigner - (48) |
| pigner lai lâne : carder la laine - (37) |
| pigner : peigner - (39) |
| pigner, v. a. peigner au propre et au figuré. - (08) |
| pigner, v. tr., peigner, démêler. - (14) |
| pigner. Peigner. - (49) |
| pigneuchè : manger sans appétit, trier dans son assiette - (46) |
| pigneuchou : celui qui mange très peu - (46) |
| pigneuleu, variété de chardon (eryngium). - (27) |
| pigneulo, cône de chardon servant à peigner la laine. - (28) |
| pigneûlot : le fruit du chardon (eryngium) - (46) |
| pigneûse (lai) : (la) cardeuse de laine - (37) |
| pigni : peigné. - (62) |
| pigni : peigner - (57) |
| pigni : Peigner. « Alle est bien pignie » : elle est bien coiffée, ses cheveux sont bien arrangés. - (19) |
| pignier : s. m., vx fr., peigneur de chanvre. - (20) |
| pignier. v. -Peigner. - (42) |
| pignocher. v. n. Manger avec dégoût, sans appétit, du bout des dents. (Puysaie). - (10) |
| pignocheux. n. m. - Celui qui pignoche. - (42) |
| pignocheux. s. m. Qui mange avec dégoût, miette à miette, par petits brins. (Puysaie). - (10) |
| pignolô, s. m., bardane sauvage. - (40) |
| pignolo. Bardane. On dit aussi « lape » parce que ses fruits lapent aux habits. - (49) |
| pignolo. Fleur de la barbane {lappa major, arctium lappa, synanthérée). Etym. peigne qui dans le patois bourguignon se prononce pigne. - (12) |
| pignolot : « Chardan pignolot » : chardon à foulon, dipsacus fullonum. - (19) |
| pignolot : capitule de la bardane. - (62) |
| pignolot : fruit de la grande bardane - (48) |
| pignolôt : fruit d'une herbe haute ayant la « propriété » de s'accrocher aux vêtements. - (56) |
| pignolot : (pignolo - subst. m.) fruit de la bardane. C'est une farce des plus communes que d'en jeter à pleines poignées dans les cheveux des filles ... - (45) |
| pignolot : n. m. Fruit, graine de bardane. - (53) |
| pignolot, n.m. bardane, cardère. - (65) |
| pignolot, s. m., bardane. - (11) |
| pignòlot, s. m., chardon à foulon. - (14) |
| pignolot, s.m. bardane. - (38) |
| pignolot, subst. masculin : bardanne. - (54) |
| pignolot. Boutons et fleurs de la bardane, hérissés de piquants qui s’attachent aux vêtements, et surtout aux cheveux. Littéralement, un pignôlot est un petit peigne... - (13) |
| pignon. Pignons, amandes de la pomme de pin. - (01) |
| pignoner, v., attiser le feu dans l'âtre. - (40) |
| pignot : paquet de griottes ou de cerises - (48) |
| pignotsi v. (du moyen.fr. espinocher, s'occuper de bagatelles) Manger en triant les morceaux, du bout des dents. - (63) |
| pignotson n.m. Pinailleur, insatisfait. - (63) |
| pigon, pigonnier. Ringard servant à activer le feu. - (49) |
| pigoner (v.t.) : 1) attiser le feu en remuant les braises - 2) piquer par intermittence - (50) |
| pigoner : piquer, par exemple un aliment pour vérifier sa cuisson ou pour l'aider à cuire. - (56) |
| pigoner : (pigonè - v. trans.) fourgonner, remuer les braises dans le feu. - (45) |
| pigoner, v. n. fouiller, piquer par saccades avec un instrument pointu. - (08) |
| pigoner, verbe transitif : tisonner. Au sens figuré, il signifie taquiner. - (54) |
| pigoni v. 1.Remuer, gratter (le feu). Voir graboter. A noter qu'en Arcadie on dit pigouiller, ce qui est bien proche. 2. Fig. Asticoter, exciter, énerver, embêter quelqu'un. Voir dzver. - (63) |
| pigonnè : 1 v. t. Attiser en remuant. - 2 v. t. Faire des papouilles. - (53) |
| pigonner : chatouiller. (RDM. T IV) - B - (25) |
| pigonner : embêter - (44) |
| pigonner : remuer, attiser, exciter, « asticoter » - (37) |
| pigonner : tarabuster, tartouiller. - (32) |
| pigonner. Gratter le feu avec le ringard. Fig. Agacer, exciter quelqu'un, en le piquant avec le doigt ou un bâton. - (49) |
| pigot. Qyeue d'un fruit, pédoncule. - (49) |
| pigouner (verbe) : attiser le feu. - (47) |
| pigouner : embêter, asticoter - (61) |
| pigouner : se servir dans un plat avec les doigts avant le repas - (60) |
| pigrassis. s. m. Endroit humide ou l'on a piétiné. (Pasilly). - (10) |
| pigrat. s. m. Boue noire et fétide resultant du séjour des fumiers sur le sol. (Saint-Martin-du-Tertre). - (10) |
| pigron : femme acariâtre - (61) |
| pi'inche : planche - (48) |
| pi'incher : plancher - (48) |
| pi-indre. Plaindre. - (49) |
| pîîner : parler ou chanter sur un ton aigü (s’emploie surtout à la forme négative pour désigner quelqu'un qui ne peut plus parler : « ai peûvot p’ûs pîîner ») - (37) |
| pijer : piétiner. - (29) |
| pijoter, v., piétiner au même endroit. - (40) |
| piké quelqu'un, le blesser moralement ; el â piké, il est mécontent. - (16) |
| piké, tinter une cloche ; piké lai Pâssion, tinter pendant que le prêtre récite la Passion ; piké l'Dieu-l'vè, tinter pendant l'Elévation de l'Hostie. - (16) |
| pikeuta : picoter. - (29) |
| pil' tout - pil' fer : un pil’tout ou un pil’ fer - capable, ce dernier, de casser même du fer - sont des personnes qui abîment, qui cassent, non par maladresse, mais dans le besoin, ou le désir de casser. Ex : "Ton gamin, ma pour’ Lucie, c’est un vrai pil’fer." - (58) |
| pilarguier (nom masculin) : broc. - (47) |
| pilat. s. m. Roseau. (Bagneaux). Ce nom donné au roseau ne serait-il point une allusion à cette particularité touchante de la passion, dans laquelle les soldats de Pilate, après avoir posé sur la tête de Jésus une couronne d'épines, lui mirent dans la main un roseau en guise de sceptre ? - (10) |
| pile (ficher une) : donner des coups. - (09) |
| pile, donner une pile à quelqu'un, c'est le battre ou triompher de lui par la force du corps. Dans l'idiome breton, pila signifie terrasser, jeter par terre. (Le Gon.) ... - (02) |
| pilé, potage au millet, pilau. - (05) |
| pilé, s. m., millet cuit cl prêt à être mangé. Mets jadis assez répandu. - (14) |
| pile. Coups donnés ou reçus dans une lutte. Ne li réponds ran, a te flanquerot eune pile. Ce mot viendrait-il de la pila, sorte de grosse balle employée dans les jeux du cirque. - (13) |
| pilé. Millet cuit et apprêté. - (03) |
| pilée, du verbe ''piler" ; une "pilée fourchue" : quand la pilée est plus grande que de coutume ; d'la sao pilée : du sel pilé. - (38) |
| piler : abîmer - (61) |
| piler : abîmer, détruire. Ex : "Mon gamin ? Dame, y pile tout !" - (58) |
| piler, v. tr., piétiner, fouler aux pieds. - (14) |
| pilevinette - épinevinette, petit arbuste. – Mouai, i eume bein lai pilevinette ; c'â in pechot aigre. - An met de lai pilevinette dans lai piquette ; c'â bon. - (18) |
| pillaige (au), loc. a l'abandon, en désordre. Mettre tout « au pillaige », c'est bouleverser toutes choses dans le lieu où on se trouve. - (08) |
| pillaize - (39) |
| pillan : Petite écaille filiforme qui se forme dans la peau à l'extrémité des doigts, près des ongles. - (19) |
| pillandre, pillandroux : s. m., pillard, voleur. Oh ! sacré pillandre, Va ! - (20) |
| pillandrer : v. a., piller. - (20) |
| pille : s. f., pillon femelle. - (20) |
| pillé, vn. aboyer. Crier à tort et à travers. Qu’a ce que lu pilles ? - (17) |
| piller : v. a., éplucher, trier, choisir avec soin. - (20) |
| pillereau : être mal habillé - (44) |
| pilleû (du) : thym - (57) |
| pilleu. Plante aromatique dont on se sert en cuisine, et qu'on appelle à Chalon pillo. - (03) |
| pilleuchi : Pignocher, manger peu, sans appétit, faire le dégôuté. « I n'a point de pliaiji de fare à marande à des gens que ne fiant que de pilleuchi » : on n'a pas de plaisir à préparer un repas pour des gens qui mangent sans appétit. - (19) |
| pillier (on) : pilier - (57) |
| pillocher : v. a., syn. de piller ; pignocher, manger du bout des dents. - (20) |
| pillocher, v. manger sans appétit, comme font les poules qui picorent au travers des feuilles mortes. - (38) |
| pillocherie, s.f. action de manger sans appétit. - (38) |
| pillocheur, pillocheuse : s. m. et f., celui ou celle qui pilloche. - (20) |
| pillochou, s.m. qui mange sans appétit. - (38) |
| pillon (?), pion (?) : s. m. On dit qu'il y a du pillon dans un pré, surtout d'embouche, quand, à l'automne, l'état de - (20) |
| pillon (on) - peuillon (on) : écharde - (57) |
| pillon : barbe d’épi d’orge ou de blé. Viendrait du latin pilus : poil. - (62) |
| pillon : s. m., envie ; pellicule qui se détache de la peau autour des ongles. - (20) |
| pillon, pillot : s. m., poussin. - (20) |
| pillon. Petite escarre de peau qui se lève près des ongles. - (03) |
| pillote : petite poule - (43) |
| pillotte, pitse n.f. Poulette. - (63) |
| pilocher : manger sans appétit(B. T IV) - S&L - (25) |
| piloiché, manger très peu, comme quelqu'un qui n'a pas d'appètit et semble plutôt goûter les aliments que les manger. - (16) |
| piloicher. Manger peu et sans appétit. Léche, en vieux français ; signifie langue et loicher est le patois de lécher. Quand au préfixe pi on a le choix entre peu et poil ; les gens qui piloichent ont toujours l’air de chercher des cheveux dans le ragoût.. - (13) |
| pilon (ain), (aine) quîlle : (une) jambe de bois rustique - (37) |
| pilon : 1 stère de bois - (39) |
| pilon, s. m. cube de bois à feu que construisent nos bûcherons à l'époque du moulage. - (08) |
| pilon. s. m. Tas de cailloux le long des routes. (Mailly-la- Ville et un peu partout). - (10) |
| pilos, pilos, loc. petits, petits ! nos Morvandelles emploient ces deux mots avec une sorte de cri guttural pour appeler et rassembler les poussins au moment de leur jeter leur ration d'avoine ou de blé noir. - (08) |
| pilot : poussin - (48) |
| pilot : n. m. Petit poussin. - (53) |
| pilouaicher, manger sans grand appétit. - (28) |
| pilouècheu : manger sans appétit. - (29) |
| pilouté : faucher maladroitement. (B. T II) - B - (25) |
| pilure, pilule. - (04) |
| pilure, s. f., pilule. - (14) |
| pilvignète, sf. épine-vinette. - (17) |
| piman, thym et serpolet. - (16) |
| piment - thym des jardins. - Vos é du piment ; beillez moi z-en don voué in pecho pour mette dan ine daube. - I ons ine jolie roingée de piment to le long de l'ailée ! - (18) |
| pîmer. v. - Émettre un sifflement respiratoire dû à une infection pulmonaire. Se dit piler à Sougères-en-Puisaye. Ce mot pourrait être la déformation du verbe piper qui signifiant au XIIe siècle pousser un petit cri, siffler, jouer du pipeau. - (42) |
| pimontoise, pimontouèse. Pic de terrassier. Cet outil reçut probablement ce nom, lorsque les ouvriers piémontais l'apportèrent avec eux, pour travailler à la construction de la ligne de chemin de fer de Montchanin à Roanne (en l870). - (49) |
| pimontoise, s. f., pioche avec un pic. - (40) |
| pimontouaise (nom masculin) : sorte de pioche avec un pic et un tranchant (la piémontaise). - (47) |
| pimontouaise : pioche avec un pic - (39) |
| pimpeurnelle, s. f. pimprenelle, plante de la famille des rosacées. - (08) |
| pimpòner, v. tr., pomponner, parer. Ce verbe implique toujours l'idée de prétention : « Ah ! la p'tiote drôlesse ! I n'sais point trop c' qu'ail' deveinra ; ma all' se pimpòne gros. » - (14) |
| pimprenelle. Jeune fille, jeunes filles. Proprement, de jeune pimprenelle sont de jeunes éveillées, fringantes, évaporées… - (01) |
| pimprenelle. : (Dial et pat.). jeune fille éventée et fringante. - (06) |
| pinaguet. adj. m. Niais, sot, imbécile. – Signifie aussi engourdi. - (10) |
| pînai – rendre un léger bruit, un léger cri par la gorge. - I ne sai pâ ce qui ai dans le gousier ci pîne quand i soffle, … teins, écoute. - Nos p'sins pînant bein, est-ce qu'al airaint égairai lote mère ? - (18) |
| pinailler : être tâtillon - (48) |
| pinaîller : hésiter, faire « trainer », refuser à moitié - (37) |
| pinaîller : hésiter, ne pas parvenir à se décider - (37) |
| pinaillet : danse ancienne qui s'exécutait sur des pailles en croix - (60) |
| pinâilli : pinailler - (57) |
| pinaîllioux : hésitant - (37) |
| pinaillou : minutieux - (44) |
| pinaillou : quelqu'un qui pinaille (être exigeant au mauvais sens du terme) - (46) |
| pinajat. s. m. Patois. (Percey). - (10) |
| pînarde. s. f. Braillarde. - (10) |
| pincé, celui que la justice a saisi ; à s'â fè pincé, il s'est fait arrêter. - (16) |
| pince, s. f. barre de fer dont l'extrémité est taillée en biseau. elle sert à soulever et à diviser les quartiers de roche. La pince est aussi appelée « pau de fer. » - (08) |
| pince. n. f. - Grosse barre à mine ; synonyme de civiée. ( Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| pinces : Pincettes. « Tuje dan voir le fû dave les pinces » attise donc le feu avec les pincettes. - (19) |
| pinces, s. f. pincettes de cheminée. - (08) |
| pincette : Pinçon, action de pincer. « Fare mimi à la pincette » : embrasser quelqu'un en lui pinçant les deux joues. - (19) |
| pinchant (on) : penchant - (57) |
| pinchi : pencher - (57) |
| pinci : pincer - (43) |
| pinci v. Pincer. - (63) |
| pinciau. n. m. - Pinceau. - (42) |
| pinçot - pincée. - Mets du poivre dans le fricot ma, te sais ran qu'in pinçot. - (18) |
| pinçòt, s. m., pincée, minime quantité d'une chose. - (14) |
| pinçòte (à la), loc., à la pincette, exprimant une agacerie gentille. Les enfants se disent entre eux, et les mamans aux bébés : « Bise-me à la pinçòte », quand ils désirent que l'enfant les embrasse en leur prenant les joues ou le menton avec ses menottes. - (14) |
| pinçôte. Agaceries, pinceries. - (01) |
| pinçôte. : Boisai ai lai pincôte, c'est prendre quelqu'un par le menton pour l'embrasser. - (06) |
| pinçòtes, s. f. , pincettes, instrument du foyer. - (14) |
| pindu . : Pour peint, est un participe qui ne manque jamais d'être adopté au village. - (06) |
| pine : pénis. Cité dans le Roman de la Rose (Xlll ème siècle).Voir quine. Certains diront beurliche. - (62) |
| pine de pin, subst. féminin : pomme de pin. - (54) |
| pine, n.f. pomme de pin. - (65) |
| piner (dans toute la Bourg.). - Piailler, piauler, pépier, pousser des cris aigus comme les petits oiseaux, probablement par onomatopée… - (15) |
| pîner (ne pas), verbe intransitif : parler, émettre des sons. - (54) |
| pîner (v.t.) : pépier en parlant des poussins - (50) |
| pîner : piailler - (48) |
| pîner : Piauler, pousser de petits cris en parlant des oiseaux. « Je pairie (parie) qu'i a in nid dans le bochan (buisson) j'ai entendu pîner ». Au figuré, « Ne pas pîner » : garder le silence, se taire. « Mens te dans in carre a peu ne pîne pas » : mets toi dans un coin et tais toi. - (19) |
| pîner : respirer en sifflant - (39) |
| piner : v. a., piper. Il n'a pas piné mot. - (20) |
| pîner, crier - (36) |
| piner, v. intr., piauler. Se dit des poussins, et aussi des jeunes oiseaux, qui jettent de petits cris et commencent leurs chants. — Autre acception : quand l'enfant embrasse la mère, la mère dit à l'enfant : « Fais piner », c'est-à-dire fais chanter ton baiser. - (14) |
| pîner, v. n. pousser de petits cris aigus à la manière des oiseaux, surtout des plus jeunes. - (08) |
| piner. Pépier ; parler avec peine. « O peut pus piner » pour il ne peut plus parler. - (49) |
| piner. Piauler ; se dit des oiseaux. - (03) |
| pîner. v. n. Piailler, piauler. (Rugny). - (10) |
| pinerelle. s. f. Espèce de cigale. (Saint- Bris). - (10) |
| pinette : Sorte de sifflet fait d'un tube d'écorce de saule détaché au moment de la sève et dont on amincit l'une des extrémités, en soufflant dedans on en tire un son assez aigu. Au figuré : « Arroser la pinette » : donner à boire aux musiciens ou aux chanteurs. - (19) |
| pinette : s. f., petite trompette que les enfants font avec l'écorce du saule au moment de la montée de la sève. - (20) |
| ping (n.m.) : pin - (50) |
| pingalle. s. f. Sorte de pèle-mêle, de gâchis, de désordre. Mettre des choses en pingalle, les jeter au hasard, sans précaution, sans ordre, sur d'autres choses dissemblables, au risque des inconvénients, des accidents, des dommages qui peuvent en resulter. (Auxerre). - (10) |
| pingaule, s. f., perche pour tirer le seau du puits. - (40) |
| pingë, tige de vigne enracinée. - (16) |
| pingean : Pigeon. « Des pingeans pattoux » : des pigeons pattus. Cette forme a vieilli, on dit maintenant : pigean. - (19) |
| pingené, pingeon - pigeonnier, colombier, pigeon. - Note homme veut fâre in pingené, pais ce qui l'i ai dit qui eumâ les pingeons. - An n'â bon que les pingenés aint los ouvertures â levant. - (18) |
| pingeon : pigeon. - (29) |
| pingeon : s. m., pigeon. - (20) |
| pingeon, s. m. pigeon. - (22) |
| pingeon, s. m. pigeon. - (24) |
| pingôle, s. f., perche, gaule. Se dit principalement des perches ajustées au-dessus de certains puits pour tirer les seaux, le gros bout faisant bascule : « Va qu'rî le siau, écroche-le à la pingôle, et tire-nous de l'iau fràche. » - (14) |
| pinjon, s. m,, pigeon. - (14) |
| pin-na, poin-n a. Panais sauvage (Pastinaca sativa). - (49) |
| pin-nage. Habitude qui consiste à mettre du bétail en pâture, dans le pré du voisin, moyennant un prix convenu. - (49) |
| pinnate, s.f. flageolet, flûte champêtre. - (38) |
| pinner, v. jouer du flageolet. - (38) |
| pinoç’er : ne rien trouver à son goût - (37) |
| pinoç’ou, pinoç’e : tatillon, tatillonne - (37) |
| pinoche, pinochon, pinote, gnangnoche. Douillette, lambine, qui se plaint pour rien. - (49) |
| pinocher : trier - (44) |
| pinocher, gnangnocher. Se plaindre pour rien. Manger sans goût, en traînant, par petits morceaux. - (49) |
| pinocher, v. n., pépier. - (20) |
| pinochi, v. n. pousser des petits cris plaintifs à la manière du poussin. - (24) |
| pinon, m. bec fin d'un filtre à café ou autre ustensile. Petite trompe d'écorce ; diminutif pinette. - (24) |
| pinon, s. m. petite trompette d'écorce. Diminutif : pinette. - (22) |
| pînot : (pi:no - subst. m.) trochet de petits fruits à noyaux (cerises, prunes, etc.). - (45) |
| pînot : petite branche de griottes ou de cerises - (39) |
| pinouchi, v. n. pousser de petits cris plaintifs, à la manière du poussin. - (22) |
| pintale (na) : pintade - (57) |
| pintale, pintade. - (27) |
| pintale. Pintade. - (49) |
| pintalon (on) : pintade (mâle) - (57) |
| pintalon. Mâle de la pintade. - (49) |
| pînté (âte) : (être) ivre - (37) |
| pinte : s. f., ancienne mesure de capacité pour les liquides. Celle de Mâcon valait 1 litre 514 ; celle de Cbalon 1 litre 742 ; celle de Charolles 1 litre 198 ; celle de Tournus 0 litre 916 ; celle de Châteauneuf 1 litre 016 ; celle de Tramayes 1 litre 323 ; celle de Mont-Saint-Vincent 1 litre 520 ; celle de Romenay 1 litre 760. A la fin du XVIIe siècle, au grenier de Mâcon, elle servait aussi à mesurer le sel et avait la contenance de deux pots, soit 1 litre 750. Voir minot. - (20) |
| pînter (s’) : (s’) ennivrer - (37) |
| pînter lai reûç’e (s’) : (s’) ennivrer - (37) |
| piô : billot. A - B - (41) |
| piô : (nm) pieu - (35) |
| pio : plot, billot - (43) |
| piö, sm. cylindre [plot] ; tronc d'arbre propre à faire des charpentes ou à débiter en planches. - (17) |
| piô, vin... - (02) |
| piô. : Vin. - Les Grecs de Marseille ont dû nous transmettre leur verbe, boire, d'où vient notre mot pineau (raisin noir, fin). - (06) |
| piochaille : s. f., action de piocher ; temps du piochage. - (20) |
| piochaison : s. f., piochage. « Les piochaisons terminées, ils auront le temps nécessaire... » (Nouvelliste, 18 mars 1911). - (20) |
| piochat : s. m., pivert. - (20) |
| piochi : piocher - (57) |
| piochot : une petite pioche (voir : pieuchot). - (56) |
| piochou (on) : piocheur - (57) |
| piochoux, piochouse : s. m. et f., piocheur, piocheuse. - (20) |
| pioèche-môle, pêle-mêle, en désordre. - (27) |
| piola : petite pioche - (44) |
| piolai - tacheté, mais surtout des rousseurs à la figure et aux mains. - Ile l'a tote piolée, quemant si en l'i aivo jetai du son ai lai figure. - Sai vairôle à guérie, ma al à don piolai ! ci fait pô. - (18) |
| piôlé : tâches de rousseur. A - B - (41) |
| piolé (adj.) : dont le visage est couvert de taches de rousseur (syn. picassé) - (64) |
| piolé (-e) (adj‘m. et f.) : taché (-e), constellé (-e) de taches de rousseur - (50) |
| piole (n.f.) : tache de rousseur - (50) |
| piole (une) : un grain de beauté. - (56) |
| piolé : qui a des taches de rousseur - (37) |
| piole : tache de rousseur - (48) |
| piole : tache de son. VI, p. 43 - (23) |
| piole : n. f. Tache de rousseur sur le visage. - (53) |
| piôle : s. f., tache de rousseur. - (20) |
| piolé : taché de rousseur - (39) |
| piôlé, adj., qui a des lâches de rousseur: « Ah ! voui, je l'counais ; y é c'tu qu'é tout piôlé. » - (14) |
| piolé, adjectif qualificatif : parsemé de taches de rousseur. - (54) |
| piolé, de deux couleurs, marqué de rousseurs. - (04) |
| piolé, part, passé. marqué de taches de rousseur : un visage « piolé », cette femme est « piolée ». - (08) |
| piolé, pioulé. adj. Bigarré, moucheté, dont la peau est marquée de rousseurs. (Saint-Florentin). - (10) |
| piole, s. f. tache de rousseur, tache en général : cette fille serait plus jolie si elle n'avait pas tant de « pioles » à la figure. - (08) |
| piole, subst. féminin : tache de rousseur. - (54) |
| piôlé, se dit du petit cri des poussins et des petits oiseaux dans leur nid. - (16) |
| piolée. s. f. Quantité de vin absorbée par un ivrogne. En a-t-il une piolée ? De piot, vin. - (10) |
| piôler : v. n., vx fr., tacheter. Piôlé, tacheté de rousseur. - (20) |
| pioles (nom féminin) : taches de rousseur. - (47) |
| pioles : taches de rousseur (« ai l’ot tout piolé ! ») - (37) |
| pioles : taches de rousseur au visage. - (33) |
| piôles, piôlé, taches de rousseur, marqué de - (36) |
| piomb. s. m. plomb. - (08) |
| pion : poussin. B - (41) |
| pion : pied d'herbe, c'est le tapis végétal des prairies - (51) |
| pion : poussin - (34) |
| pion : poussin - (35) |
| pion : poussin - (43) |
| pion n.m. 1. Poussin. 2. Partie racinaire de l'herbe d'une prairie. Pour que l'herbe ne repousse pas il faut dépioñni, c'es-tà-dire l'arracher avec la motte de terre dans laquelle les racines sont emmêlées. 3. Tape, coup. - (63) |
| pion, s. m. chaumes du foin après la fenaison. - (24) |
| pion, s. m. pied, petit pied. on redouble quelquefois le mot dans le langage enfantin : chauffez les « pionpions » du marmot. - (08) |
| pionb, sm. plomb. - (17) |
| pionbé, vt. plomber. - (17) |
| pionci : pioncer - (57) |
| piondzi : (vb) se mouiller les pieds - (35) |
| piondzi : plonger - (43) |
| piondzi : se mouiller les pieds, prendre l'eau dans les sabots - (43) |
| piône, pivoine. - (16) |
| piône, s. f., pivoine. - (14) |
| pioné, s. m. pionnier, celui qui défriche. - (08) |
| piône, s.f. pivoine. - (38) |
| piôner : pépier, pleurnicher. Pour réclamer avec insistance : un poussin piône, une personne pleurniche, tous sont des piônou(s). - (62) |
| pioner : se plaindre (en parlant du cri des poussins). (S. T III) - D - (25) |
| piôner, v., geindre, se plaindre. - (40) |
| piôneries, s. f. pl., lamentations inutiles. - (40) |
| piongé, vt. plonger. - (17) |
| piongeon : plongeon - (57) |
| piongeou (on) : plongeur - (57) |
| piongeouaîr (on) : plongeoir - (57) |
| piongi : plonger - (57) |
| pionire : (nf) cage à poussins - (35) |
| pionire : cage à poussins - (43) |
| piônner : pleurnicher. (A. T II) - D - (25) |
| pion-ner : pleurnicher - (39) |
| pion'ner, pioûner : pleurer, pleurnicher, se plaindre - (48) |
| pionnére : « Plieuche pionnére » : grosse pioche dont on se sert pour défoncer un terrain en friche. - (19) |
| pionnière, piorniere : s. f., pioche à deux bouts, dont l'un a le tranchant perpendiculaire au manche, et l'autre parallèle ou encore pointu. - (20) |
| pioñnîre n.f. Cage à poussins. Voir peursson. - (63) |
| pionzon : importante construction de gerbes de paille, confectionnée le jour du battage avec les épis battus - (37) |
| piorner. v. n. Pleurnicher, pleurer (Tronchoy). - (10) |
| piot : piquet - (44) |
| piot : plot de bois où l'on découpe à la hache le petit bois des fagots - (51) |
| piot : s, m., vx fr., vin. - (20) |
| piot, s. m. billot (du vieux français plot). - (24) |
| piot, s. m. table de cuisine, bloc sur lequel on hache les viandes, les légumes. Piot est pour plot. (voir : plot. ploie.) - (08) |
| pioté, adj. peloté, roulé : cet enfant-là est « pioté gras », c'est-à-dire gras et rond comme une pelote. - (08) |
| piöte, sf. pelote. Pelote de bois servant à découper les viandes et à hacher les légumes. - (17) |
| piotège : partie d'un chariot qui s'articule sur le train avant. - (33) |
| pioter : v. a., vx fr., boire, « humer le piot ». - (20) |
| pioteur : s, m., amateur de piot. - (20) |
| pioton, s. m. bloc de bois, billot. - (08) |
| piotot (nom masculin) : plot monté sur trois pieds pour couper le petit bois. On dit aussi bique. - (47) |
| piôtre, n.m. clos, terrain, place publique. - (65) |
| piotreux. adj. Maladif. (Soucj). - (10) |
| piotse : pioche - (43) |
| piotse montoise n.f. Pioche-hache. Voir peurnîre. - (63) |
| piotse n.f. Pioche. - (63) |
| piotse piate : houe - (43) |
| piotsi : piocher - (43) |
| piotsi, pieutsi v. Piocher. - (63) |
| piôtson : (nm) serfouette - (35) |
| piotte. s. f. Pie. - (10) |
| piou (na) : pluie - (57) |
| piou (on) : pou - (57) |
| piou : (nm) pou - (35) |
| piou : pluie - (51) |
| piou : pluie, pou - (43) |
| piou d'bôs n.m. Tique. - (63) |
| piou n.m. Pou. - (63) |
| piou, s. f. pluie. - (24) |
| piou. s. m. Gros pic, grosse pioche. - (10) |
| piouche, s. f., pioche. - (14) |
| pioucher, v. tr., piocher. - (14) |
| piouj'ner - breûillassi - brouillassi : pleuvoir (légèrement) - (57) |
| pioulé : rempli de tâches - (51) |
| pioûlé, e adj. (de papioûle, papillon ou coccinelle). Couvert de taches de rousseur. - (63) |
| pioûler (v. int.) : piauler, piailler - (64) |
| piouler, piouter. v. - Gémir, pleurnicher ; synonyme de piauler. - (42) |
| pioùler, piouter. v. n. Piailler, piauler. (Serngny. Puysaie). - (10) |
| piouler. v. n. Piauler. Les petits poulets pioulenl. (Serrigny). - (10) |
| pioùlon. s. m. Enfant qui crie sans cesse : poussin qui piaille. (Puysaie). - (10) |
| pioulou. n. m. - Pleurnicheur, en parlant d'un enfant. - (42) |
| piouner : piauler chez le poussin. Pleurnicher, pleurer (en B : pionhner). A - (41) |
| piouner (verbe) : crier en parlant des animaux de basse-cour. - (47) |
| piouner : cri du poussin - (43) |
| pioûner : pépier - (57) |
| piouner : piailler ; pleurnicher - (35) |
| piouner : pleurer - (44) |
| pioûner : pleurer (quémander) - (57) |
| pioûner : pleurer en gémissant, se lamenter - (37) |
| piouner : pleurnicher - (51) |
| pioûner : quémander - (57) |
| piouner v. Pleurer. - (63) |
| piouner, piauner. Se dit de la plainte poussée par le chien qu'on corrige. Fig. Pleurer. - (49) |
| pioûnerie : pleurnicherie, lamentation, plainte - (48) |
| piounes. s. f. Fils non tissés à l'extrémité d'une pièce de toile. (Lainsecq). –Voyez piennes. - (10) |
| piounire : poussinière, cage à poule (en A : peurson*) B - (41) |
| piounire : poussinière, cage à poules - (34) |
| piounire : poussinière, cage à poules - (43) |
| piounoux, piouna. (Fém. Piounouse). Pleurnicheur. - (49) |
| pioûr : pleuvoir - (57) |
| pioure : pleuvoir - (51) |
| piournire : pioche pour faire les rigoles - (51) |
| pioutis : s. m., nid à poux. S'applique aux personnes et aux choses. - (20) |
| pipai - parler à peine, pas du tout. - Ile ne m'en é pas pipai. - Que te sas prudent ! te n'en piperé pas, t'entends. - (18) |
| pipe (n. f.) : narcisse - (64) |
| pipé : Taché en parlant des fruits dont la pulpe présente une quantité de petites taches. « Des pommes pipées ». - (19) |
| pipé ; n'pâ eûzé pipé, ne pas oser dire un mot. - (16) |
| pipé, part. pass. marqué de taches ou de points. un visage marqué de la petite vérole est « pipé » ou grêlé. - (08) |
| pipée, (étoffe) tachetée, détériorée. - (05) |
| pipée, s. f. pépie : nos poules ont « la pipée. » - (08) |
| pipelé, tacheté. - (26) |
| piper (Se) : v. r., se piquer, se détériorer par suite d'humidité ou dz quelque autre cause. Du papier pipé. Des gants pipés. Voir chanceler (Se) et pipoter. - (20) |
| piper mot (ne pas), loc., ne pas souffler mot, ne rien dire. - (14) |
| piper, synonyme de piner. - (03) |
| piper, v. n. aspirer, boire en humant comme dans un chalumeau, dans un tuyau quelconque ; fumer du tabac. - (08) |
| piper. Fumer la pipe. Par extension fumer. Fig. Dérober, escamoter. « Se faire piper », c'est se faire prendre, se faire arrêter. - (49) |
| piperette : s. f., vx fr. piperon, pointe, - (20) |
| pipette - plus rien, plus de traces. - Vos aivins piantai des chos et des carottes ; ailé voué, tenez, en n'en reste pas pipette. - I croyâs qu'à me beillero quéque sos de ce qu'à me doit,… oh ! pas pipette ! - (18) |
| pipeûlé : couvert de taches de rousseur - (46) |
| pipeulé, ie, adj. bigarré, ordinairement de noir et de blanc : vaiche pipeulie, poulöt pipeulé. - (17) |
| pipi (n.m.) : morceau de poterie brisé, fragment de vaisselle - (50) |
| pipi : Gland du bonnet de coton. Autrefois à la campagne les hommes portaient un bonnet de coton orné d'un gland ou pipi. - (19) |
| pipi, s. m. morceau brisé de poterie ou de cristal, fragment de vaisselle, etc., dont les petits enfants de nos campagnes se font des hochets à bon marché. - (08) |
| pipiau. n. m. - Pipette pour prélever un liquide. - (42) |
| pipie (n.f.) : pépie - (50) |
| pipie : (nf) pépie - (35) |
| pipie, s. f., pépie. Incommodité bien fréquemment ressentie, et qu'on augmente en cherchant à l'apaiser. - (14) |
| pipieulé, couvert de taches de rousseur sur la face. - (27) |
| pipionnète, sf. jeu dit de la boule entre garçons et filles. - (17) |
| pipiôté, tacheté surtout à la figure. - (16) |
| pipo : renoncule. A - B - (41) |
| pipo : renoncule - (34) |
| pipoeu; s. m. renoncule vivace et traçante. - (22) |
| pipolage : s. m., pipolure : s. f., moucheture. - (20) |
| pipolai - tacheté, moucheté de points ou de petits dessins. - Al é des haibits tot pipolai de gris et de vert. - Sai vaiche â pipolée de blian, que c'â vraiment joli. - (18) |
| pipôlé (C.-d., Br., Chal.), piôlé (C.-d., Y., Morv.). - Tacheté, marqueté, piqueté ; du même mot vieux français signifiant enjoliver, décorer, d'où nuancer et marquer de petits points, de petites taches. Dans la Côte-d'Or les taches de rousseur sont des piolles ; d'une personne qui a des taches, on dit qu'elle est piôlée. Dans le Charollais, les taches de rousseur sont des picasses ou des pioulles. Suivant du Cange, le mot pioler, venant du bas latin piola, signifiait autrefois parer de différentes couleurs. - (15) |
| pipolé (-e) (adj.m. ou f.) : tacheté (-e) - (50) |
| pipolé : moucheté - (57) |
| pipolé : Moucheté. « Les puges m’ant meurdu, j'en ai les brés tot pipolés » : les puces m'ont piqué, mes bras en sont tout mouchetés. - (19) |
| pipolé : tacheté. Décoré, enjolivé…Terre pipolée de fleurs (roman de la rose 1257). - (62) |
| pipolé : tacheté - (39) |
| pipòlé, adj. taché de points (vieux français). - (24) |
| pipolé, adj. tacheté, marqué de diverses couleurs. Ce mot s'emploie chez nous en parlant des choses, et « piolé » en parlant des personnes. - (08) |
| pipolé, adj., couvert de taches de rousseur. - (40) |
| pipolé, adj., qui a le visage plein de taches de rousseur. Étoffe, drap piqués : « All’ se creit gentite. Ah ben, vouiche ! alle é ben trop pipolée. » - (14) |
| pipolé. Marqueté. - (03) |
| pipolée (étoffe). v. pipée. - (05) |
| pipoler : v. a., vx fr., rnoucheter, tacheter. - (20) |
| pipoler, v. tr., marquer de taches, de points, pointiller. - (14) |
| piponpon. Sorte de jeu. - (03) |
| pipot point (ain’) : (il ne) protestait pas (de « piper » : réagir) - (37) |
| pipou : (Pid de poule). Renoncule des champs, bouton d'or, ranunculus arvensis. On l'appelle encore pied de poule, d'où sans doute le nom de pipou (pid de poule). « Eune tarre engringie de pipou » : une terre envahie par les renoncules. - (19) |
| pipou : bouton d'or. (CST. T II) ; renoncule des jardins. (CLF. T II) - D - (25) |
| pipou : le pourpier - (46) |
| pipou n.m. Renoncule ou pied de coq. - (63) |
| pipou, renoncule des champs. - (05) |
| pipou, s. f. renoncule vivace et traçante (du vieux français piépou, pied de poule). - (24) |
| pipou, s.m. renoncule sauvage. - (38) |
| pipou. Fumeur. - (49) |
| pipoux : s. m., fumeur de pipe. Nous n'oserions affirmer que la « pipouse » n'existe pas à Mâcon. - (20) |
| piqua, s.m. frelon. - (38) |
| piquage, piqure (piqûre) : s. m. et f., état du vin piqué. - (20) |
| piquai- outre tous les sens français, on l'emploie encore par exemple comme voici : - Al é piquai lai cliaiche nai co. - Hier, ce n'éto pas les petiots que piquaint lai passion. - Pique don des raimes es faiviôles. - (18) |
| piquant : terme du jeu de bouchon. Un sou piquant est une pièce de deux sous martelée sur le bord de sorte qu'en touchant le sol elle pique au lieu de glisser. - (19) |
| piquant : s. m., terme du jeu de bouchon, se dit du sou dont on a rendu les bords saillants sur chaque face en martelant le pourtour, pour en empêcher le glissement sur le sol. Voir galinant. - (20) |
| piquarome, piquérome. s. m. Sorte de jeu d'enfant, qui consiste à ficher droit en terre un bâton pointu. - (10) |
| pique (aine) : (une) allusion sournoise - (37) |
| pique (du jour), subst. féminin : aube, lever du jour. - (54) |
| pique (prendre la), loc., se piquer, devenir hostile, se brouiller, prendre la mouche. - (14) |
| piquè (s') : v. pr. Se piquer. - (53) |
| pique : (nf) « à la pique du dzo » : à l’aube - (35) |
| pique : à la pique du jour = à l'aube. III, p. 31 - (23) |
| pique : Pointe. « La pique du jo » : la pointe du jour, l'aurore. - (19) |
| piquè : vermoulu, aigre - (48) |
| pique du dzo n.f. Aube. - (63) |
| pique du jò, s. f. pointe du jour, à l'heure où celui-ci « pique »). - (24) |
| Pique du jour (à la), loc., à la pointe du jour : « Y ét ein rude piouchoû ; ô part à la pique du jòr » - (14) |
| pique du jour. loc. adv. - Aurore. - (42) |
| pique du jour. Locution fort usitée. La pointe du jour, l'aurore. - (10) |
| pique vou nôgue. : Jour ou nuit. Expressions importées par les troubadours. (Voir Rochegude.) - Pique du jour signifie, dans le Berri, la pointe du jour. (Gloss. du Berri.) - (06) |
| pique, n.f. aube (la pique du jour). - (65) |
| pique, pique aux fruits : s. f., maraude. Allons à la pique aux raisins. - (20) |
| pique, piquette : s. f, A la pique (ou à la piquette) du jour, à la pointe du jour. - (20) |
| pique, s. f. pointe au figuré : « lai pique deu jor. » - (08) |
| piquebost (n.m.) : pivert - (50) |
| piquebue. Oiseau. - (03) |
| pique-choux : s. m., jardinier maraîcher. - (20) |
| pique-cul, pique-a-cul, pique-fesse : s. m., objet pointu, ordinairement un bec de vieille plume, fixé dans plusieurs épaisseurs de papier, et qu'un écolier place à l'endroit où son camarade va s'asseoir. - (20) |
| piquée : s. f., plongée du flotteur d'une ligne à pécher. - (20) |
| pique-en tant, ou de péque-en tant - de plus en plus, de mal en pire. - En croyot que lai plieue ailot fini, et pu voiqui qu'en en choué de pique en tant. - Oh, ailé ! en n'â pâ à bout : c'â tojeur de péque en tant. - (18) |
| pique-feu : s. m., tisonnier. - (20) |
| pique-feù, s. m., tisonnier. Très efficace pour provoquer la mitraillante éruption des étincelles. - (14) |
| pique-lambin, s. m., petite bêche à grand manche pour couper les chardons dans les blés. - (40) |
| pique-nique. A la rigueur, sans exception, ric à ric ; quelques-uns écrivent pic-nic, et citent la loi de pic-nic, qui veut que chacun paye également sa part de l'écot. - (01) |
| piquenocher, piquenoter. v. n. Manger sans faim, avec dédain, comme par grâce, et du bout des dents. - (10) |
| piquenoteux. s. m. Qui mange avec dédain, en épluchant. - (10) |
| piquer : Tinter. « La masse pique » : la cloche tinte pour annoncer le commencement de la messe. Dans cette sonnerie le battant ne fait que piquer, toucher légèrement la cloche d'un seul côté au lieu de frapper en plein et des deux côtés comme dans la sonnerie à toute volée (à grand branle). - (19) |
| piquer â paûlx : s’endormir - (37) |
| piquer ain reûpillon : faire la sieste - (37) |
| piquer au byeû : (exp) (en parlant d'un fromage de chèvre) se couvrir de croûte bleue - (35) |
| piquer debout (se), locution verbale : se lever. - (54) |
| piquer : v. a., picoter. Piquer des fruits, marauder. - (20) |
| piquer : v. a., vx fr. piquier, tinter. Piquer les émeudes, tinter le glas. Voir émeudes. - (20) |
| piquer. Mettre debout : « piquer l'échelle contre le mur ». - (49) |
| piqueras (n.m.) : houx - (ouest-Morvan) Nous trouvons de plus ça et là : corsier, coursier à l'ouest ; houssot et aigru (haut-Morvan) - (50) |
| piqueras : houx - (60) |
| piquerie n.f. Réunion de femmes où l'on piquait les couvertures. On utilisait un métier apporté par la piqueuse en chef. - (63) |
| piquet (compter au), loc., se dit d'une chose importante : « Ol évôt pinté dépeû l'maitin ; quand ôl é rentré, sa fonne li a fichu eùne tripotée qui comptôt au piquet. » Vient évidemment du jeu de ce nom. - (14) |
| piquette (d’lai) : (du) vin « léger », acide - (37) |
| piquette : voir picasse - (23) |
| piqueûre : Piqûre. « Qu'est-ce que t'a dan fait enflier le dâ c'ment cen. -Y est eune piqueûre d'épeune ». - (19) |
| piqueut : Tige, pédoncule, queue de fruit. « In piqueut de cherige ». « Juer au piqueut » : à ce jeu deux personnes croisent deux queues de cerises, chacun en tenant une par les deux extrémités et tirant jusqu'à ce qu l'une des deux soit coupée par l'autre. Le joueur dont le piqueut de cerise reste entier gagne la partie. - (19) |
| piqueuter : Picoter, cribler de piqûres d'épingle. « In piqueute les preunes (prunes) pa les mentre (pour les mettre) tremper dans l'iau de vie ». - (19) |
| piqueutin : Picotin. Au figuré : « Prendre in piqueutin » se restaurer. « I pouyant bin s'en aller i venant de prendre in ban piqueutin » : ils peuvent bien s'en aller ils viennent de bien se restaurer. - (19) |
| Piqueux : Piqueur. Nom de lieu : «La grotte du Piqueux » : excavation peu profonde qui existe sous la Roche d'Aujou. - (19) |
| pique-vin : s, m., foret de marchand de vin ; coup-de-poîng (Nouveau Larousse ill., v°. coup). - (20) |
| piquieux, pitieux. adj. Qui a de la pitié, qui est compâtissant. Dans l'Auxerrois, dans la vallée d'Aillant, un homme dur, qui se laisse toucher difficilement, est un homme qui n'est gué piquieux. - (10) |
| piquon n.m. Tas de gerbes piquées dans un champ. - (63) |
| piquot : voir picasse - (23) |
| piquot : n. m. Échalas, faisceau, une chose qu'on enfonce, tuteur. - (53) |
| piquot. n. m. - Épine, chardon : « Fais don' attention où te mets ta main ! C'est plein d'piquots. » - (42) |
| piquoter, v. a. piquer à petits coups, frapper vivement avec un instrument pointu. - (08) |
| piquotte : se lever à la piquotte du jour. VI, p. 43 - (23) |
| piquotte, s. f. pointe, petite pioche à pointe. - (08) |
| piquou, s. m. piqueur, valet chargé de conduire une meute; agent employé à la surveillance des routes. - (08) |
| piranvôle (n.f.) : coccinelle - (50) |
| piranvôle : coccinelle. - (32) |
| piranvôle, s. f. coccinelle appelée vulgairement, suivant la contrée, bête à dieu, bête à la vierge, bête à martin. - (08) |
| piranvolle (n.f.) : coccinelle - (50) |
| pirate : s. m., braconnier. - (20) |
| pire : voir empi. - (20) |
| pire, s. m., empire. Rive gauche, en terme de notre ancienne marine fluviale : « Vira de pire ! » Tourne du côté d'empire ! c'est-à-dire du côté de la rive gauche. (V, Bronquer, Riaume.) - (14) |
| pirette*, s. f. petite carrière. - (22) |
| pirlouècher : manger peu. (G. T II) - D - (25) |
| pirminette : Epine-vinette, cerberis vulgaris. - (19) |
| piròle, et piraule, s. f., terme dont se servent les mariniers pour désigner le repas, les mets : « Préparer la piròle ; manger la piròle, de bonne piròle. » - (14) |
| pironelle, fiarde. Toupie. Fig. Jeune fille écervelée, peu sérieuse. - (49) |
| pironnelle : toupie, quolibet adressé à une gamine - (37) |
| pironnelle, s. f., toton lancé à la main. - (40) |
| pirouale : toupie - (48) |
| piroualle, s. f. grosse toupie, jouet d'enfant. - (08) |
| pirouelle. s. f. Sorte de jouel consistant en un moule de bouton ou en un petit morceau de bois rond, ordinairement plat ou convexe, traversé par un pivot sur lequel on le fait tourner, en lui imprimant avec l'index et le pouce un mouvement rotatoire. Synonyme de tonton. - (10) |
| pirouette : voir comblette - (23) |
| piroulé, adj. taché de points. [pipolé]. - (22) |
| pirvale (n.f.) : coccinelle - (50) |
| pirvale, s. f. coccinelle. Morvan bourguignon aux environ de Brazey, Liernais, etc. (voir : piranvole.) - (08) |
| pirvaler : (pirvalè - v. intr.) tournoyer. Fê:r' pirvalè, "faire des moulinets (avec qqch.)" - (45) |
| pirvalle, s. f., fille agressive et méchante. - (40) |
| pirvelle : (pirvèl' - subst. f.) 1- toupie, jouet d'enfant. 2- coccinelle. - (45) |
| pirveuler : voltiger, en parlant de la neige. (G. T II) - D - (25) |
| pirveuler, se dit de quelque chose de léger qui vole dans l'air. - (28) |
| pis adv. Puis, et puis. - (63) |
| pis que de plein. exp. - Plus que plein. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| pis qu'en tant, loc. mal en pis. une personne dont la maladie s'aggrave dit qu'elle va « de pis qu'en tant. » - (08) |
| pis, adj. triste, abattu, mécontent, déçu, déconfit. « i seu pis de ç'iai », je suis triste, confus de cela. - (08) |
| pis, pire. - (26) |
| pis. adv. - Puis : « Et pis combe in j'te doué pou' ton lapin ? » - (42) |
| pisaguer : poursuivre de près et avec un bâton. (VC. T II) - A - (25) |
| pisaguer : secouer, agiter, activer, asticoter, exciter - (48) |
| pisay, terre foulée aux pieds, pigée. - (05) |
| pischer, v, pisser. - (38) |
| piser, v. a. guetter. - (24) |
| pîsmes : brins de fil. - (09) |
| pisque conjonct. Puisque. - (63) |
| pisque, conj., puisque : « Pisque y é c'qui, va ben ! » - (14) |
| pisque. conj. - Puisque. - (42) |
| pisrale : rainette des champs. L’amphibien, voisin de la grenouille. - (62) |
| pissant mou. exp. - Trempé, mouillé jusqu'aux os. « La Laurence et le Roumain i' sont proumnés sous la pluie, i' sont ervenus pissant mou ! » - (42) |
| pisse (la) - peusse (la) : urine - (57) |
| pisse, s. f., pissat, urine: « Ma fi, voui, dans ton escayé y sent gros la pisse de chat. » - (14) |
| pisse-chien : s. m., ellébore fétide (helleborus fœtidus). - (20) |
| pissechien, grenouille terrestre. - (05) |
| pissechien. Grenouille rousse, Rana Temporaria. - (03) |
| pisser au pot : contrairement à ce qui viendrait à l'esprit : se dit d'une vache qui délivre bien son lait lors de la traite (car il arrive qu'elle se retienne). Ex : "La barrée, c'est ène boune ! Elle pisse au pot té peux m'crée. " (Tu peux me croire). - (58) |
| pisser : v. n. Pisser en vache. Voir mouler. - (20) |
| pisser. Couler. - (12) |
| pisserelle, n.f. grenouille. - (65) |
| pisserette, s. f. jet fin d'un liquide : boire à la pisserette de la fontaine. - (24) |
| pisserette, s. f. jet fin d'un liquide. - (22) |
| pisserette. Pissette. - (49) |
| pisserot : arrivée d'eau à un tuyau - (43) |
| pisserote ou picherotte, subst. féminin : petite source, filet d'eau. - (54) |
| pisseròte, s. f., pissote, canule, petit canal, gouttière. - (14) |
| pisseröte, sf. écoulement de l'eau par filet ou goutte à goutte. - (17) |
| pisserotte (une) : une fontaine - (61) |
| pisserotte, n.f. petit filet d'eau, petite source. - (65) |
| pisserotte, s. f., petit écoulement de liquide. - (40) |
| pisserotte. s. f. Petite poignée de brins de glui passee dans le trou d'un cuvier à lessive, pour régulariser l'écoulement du lessu. (Auxerrc). - (10) |
| pissette n.f. Sexe de petite fille. - (63) |
| pisseuse, s. f., femme (péjoratif). - (40) |
| pissevargö, sm. ginglet, petit vin acide. - (17) |
| pissi : pisser - (43) |
| pissi. Pissai, pissas, pissa. A Dijon, pisser dans ses chausses, c'est y lâcher tout… - (01) |
| pissöt, pisset, sm. pissat, urine. - (17) |
| pissotchére (na) : pissotière - (57) |
| pissotchére (na) : urinoir - (57) |
| pissotiau, s. m., récipient pour le soulagement des buveurs de cabaret ; parfois moitié de vieux tonneau. - (14) |
| pissou (n. m.) : pièce d'étoffe dont on garnit le berceau d'un enfant pour protéger la literie - (64) |
| pissou : celui qui a froid au derrière - (46) |
| pissou : graisse de cochon entourée de cuir et servant à graisser les outils de menuiserie (postérieur de l'animal) - (46) |
| pissou : matelas de berceau. IV, p. 58-a - (23) |
| pissou n.m. Lange. Voir drapiau. - (63) |
| pissoû, adj., pisseur, particulièrement le buveur. - (14) |
| pissou, sm. organe urinaire des animaux. - (17) |
| pissouaîr (on) : pissoir - (57) |
| pissous : terne - (57) |
| pissous, s.m. pl., linges servant de couches pour les jeunes enfants. - (40) |
| pissouse : fille. Il n’y aura pas d’équivalent pour le genre masculin (?) - (62) |
| pissouse. s. f., gamine. - (40) |
| pissoux, pissouse : adj., pisseux, pisseuse ; coulant, coulante. Des yeux pissoux, des yeux chassieux. - (20) |
| pissoux, pissouse : s. m. et f., pisseur, pisseuse. - (20) |
| pissrotin n.m. Faible écoulement de liquide. - (63) |
| pistole, s. f. on compte encore dans nos campagnes par louis d'or de vingt-quatre francs ou par pistoles de dix. - (08) |
| pistoler v. Fonctionner, rapporter de l'argent. Y pistole ! Ça rapporte ! - (63) |
| pistrouille : mauvais vin - (44) |
| pistrouille, bistrouille n.f. Piquette, mauvais vin. - (63) |
| pistrouille. Boisson de mauvaise qualité. On dit encore : « bistrouille ». Ce terme a été importé chez nous par les évacués du Nord en l9l4. - (49) |
| pistrouye, mauvais vin. - (16) |
| pitâ : n. m. Jeune poulet. - (53) |
| pitainche. Boisson, vin. Pitainche n’est pas un mot bourguignon c'est un terme de l'argot, que le poète a bourguignonisé. En jargon, pier et piarcher c'est boire, pianche c'est du vin ; de pianche on a fait pitanche, en bourguignon pitainche. - (01) |
| pitarnier. s. m. Bouteille de terre. (Migé). - (10) |
| pitâs : poulet chétif, enfant chétif - (39) |
| pitât : poussin - (48) |
| pitater : Galoper. « San chevau s'est mis à pitater, o nos a laichi daré » : son cheval s'est mis à galoper, il nous a laissés en arrière. - (19) |
| pitaudzi v. Patauger. - (63) |
| pitaudzon n.m. Celui ou celle qui patauge dans la boue ou dans l'eau, pataugeur. - (63) |
| pitche (na) : pique - (57) |
| pitche-fu (on) - freugon (on) - greppin d’pouêle (on) : pique-feu - (57) |
| pitcher : piquer - (57) |
| pitchet (on) : piquet - (57) |
| pitchette (d'la) : piquette - (57) |
| pitchoû (on) : piqueur - (57) |
| pitchout, pitiout. Contrit : « Ol est tot pitiout ». Malheureux, qui fait pitié. - (49) |
| pitchûre (na) : piqûre - (57) |
| pite (dans toute la Bourg) pitche (Char.). - Jeune poule. L'étymologie de ce mot serait intéressante à découvrir car celle qui a été proposée n'est pas entièrement satisfaisante… - (15) |
| pîte (n.f.) : jeune poule - (50) |
| pite (nom féminin) : jeune poule qui n'a pas encore pondu. - (47) |
| pite : jeune poule ayant à peine commencé à pondre - (37) |
| pîte : jeune poule. - (09) |
| pite : jeune poule. III, p. 60-i - (23) |
| pite : poulette, jeune poule - (48) |
| pite : Poulette, jeune poule. « Ces us sant bien ptiets, y est des us de pite » : ces œufs sont bien petits, ce sont des œufs de jeune poule. - (19) |
| pite : poulette. Jeune poule qui n’a pas encore pondu. Peut-être du bas latin pitta : jeune, ou la contraction de petite. - (62) |
| pite : (pit’ - subst. f.) jeune poule. - (45) |
| pite : jeune poule - (39) |
| pite : n. f. Jeune poule. - (53) |
| pite : s. f., poulette. - (20) |
| pite, jeune poule qui n'a pas encore pondu. - (16) |
| pite, jeune poulette. - (27) |
| pite, poulot, courosse : poule qui couve ou mère-poule. (CH. T II) - S&L - (25) |
| pite, poussine, poulette. - (05) |
| pite, s. f. jeune poule qui n'a pas encore pondu. - (08) |
| pite, s. f. poulette. - (22) |
| pite, s. f. poulette. - (24) |
| pite, s. f., jeune poule qui n'a pas encore pondu. - (40) |
| pite, s. f., poule toute jeune, qui n'a pas encore pondu. - (14) |
| pite, s. f., uniquement employé dans cette locution : « A la pite du jôr », pour : au point du jour, à la pointe du jour. - (14) |
| pite. Jeune poule. J croi ben que le pitou (putois) ai saigné eune de nos pites. C'est peut-être la contraction du mot petite. La pite était, au XVIe siècle, la plus petite des monnaies de cuivre. - (13) |
| pite. Poulette. - (49) |
| pite. s. f. Jeune poule. - (10) |
| piter (verbe) : piétiner. - (47) |
| piter : fouler - (60) |
| pîter : viser - (39) |
| pitét' : n. m. Jeu du pile ou face. - (53) |
| piteuil : putois. (LEP. T IV) - D - (25) |
| piteux : un putois - (46) |
| pîtiaû : celui qui cherche à apitoyer les gens - (37) |
| pitieu, putois. (Expression populaire il a la maladie du pitieu, pour exprimer qu'il mangerait bien du poulet). - (27) |
| pitiö, öte, sm. f. jeune poulet, poulette. S’emploie de préférence au féminin. - (17) |
| pitiö, putiö, sm. putois, fouine. - (17) |
| pito - putois. - Si vos saivains, Manettte ! le pito que nos é tuai deux poules lai neu !... Oh ! chien de pito !! - (18) |
| pitô, fouine. Dans certains pays on dit un pitois ou putois... - (02) |
| pitôdzi : aller et venir, ne pas tenir en place - (43) |
| pitodzi : patauger - (51) |
| pitoî, pitou ; sorte de belette avide de poisson, d'oeufs, de volailles. Le pitou s'appelle aussi : lai bëte, la bête ; lai bëte nôz é mèngé nô poule. Il est vraisemblable que ce mot bête soit la contraction du mot belette. - (16) |
| pitois, s. m. putois. - (08) |
| piton. s. m. Jeune poulet. (Courson). - (10) |
| pitoñner v. Palper en actionnant ses pattes avant (pour le chat) comme pour favoriser l'arrivée du lait à la tétine. - (63) |
| pitôs : même sens que le mot précédent - (39) |
| pitot : poussin. La poule promène ses pitots : la poule promène ses poussins. - (33) |
| pitou (n.m.) : putois - (50) |
| pîtoû : putois - (37) |
| pitou : putois. - (62) |
| pitou : 1 n. m. Furet. - 2 n.m. Putois. - (53) |
| pitou, pelou, putois. - (05) |
| pitou, piteu, putois. - (28) |
| pitou, p'teau. Putois. - (49) |
| pitou, s. m., putois. - (14) |
| pitou. s. m., putois. - (40) |
| pitoué : (pitoué: - subst. m.) putois. Proprement, "animal qui sent mauvais". - (45) |
| pitoué : putois - (39) |
| pitoue. s. f. Trempée au vin. (Bazarnes). – A Montillot, on dit pitot. - (10) |
| pitouée : putois - (48) |
| pitraçhi, patraçhi v. Traîner des pieds. - (63) |
| pitre n.f. Empreinte de grande taille (vache, sanglier). - (63) |
| pitre ou pitrée, s. f. trace de pas sur la terre ou la neige : on l'a suivi à sa pitrée. - (24) |
| pitre ou pitrée, s. f. trace de pas sur la terre ou la neige. - (22) |
| pitre, avare, non généreux. - (16) |
| pitré, piétiné. - (27) |
| pitrée : empreinte de gibier de sauvagine dans la neige - (43) |
| pitrées : (nfpl) traces dans la neige, la boue - (35) |
| pitrelle : empreinte de sauvagine dans la neige. A - B - (41) |
| pitrelle n.f. Petite empreinte, laissée par un animal de petite taille. - (63) |
| pitrer, pitter v. Laisser des traces de pattes (oiseaux), piétiner. - (63) |
| pitrer. v. - Piétiner, fouler, marcher sur : « Fais don' attention ! T'es en train d'pitrer ma robe !» - (42) |
| pîtrer. v. n. Marcher sur, fouler aux pieds. Tu pitres sur marohe. (Villeneuve-les-Genêts). - (10) |
| pitrogner : piétiner, ne pas avancer. (VSLD. T II) - S&L - (25) |
| pitrogner, petrogner, pitrougner, petrougner : v. a., syn. de bouliguer. « Vous me « pitrognez » trop fort. » (G. Gerin, Au Pays des Etangs). A rapprocher du vx fr. pestrer. - (20) |
| pitrogni v. Chercher, trier dans son assiette sans grand appetit ou un peu dégoûté. - (63) |
| pitroni v. Tripoter, peloter. - (63) |
| pitrougner, v., tergiverser, discuter sans fin. - (40) |
| pitrougnoux : ergoteur, lambin…. Qui pitrougne. - (62) |
| pitrouiller. v. - Aller et venir. (Merry-la-Vallée, selon M. Jossier) - (42) |
| pitrouiller. v.n. Aller et venir. (Mendia- Vallée). – Voyez Patrouiller. - (10) |
| pitsa : joint entre l'anse et l'armature du panier - (43) |
| pitse : (nf) jeune poule qui n’a pas encore pondu - (35) |
| pitse, pillotte n.f. Poulette. - (63) |
| pitsse : jeune poule qui n'a pas encore pondu - (43) |
| pitte - grand poussin, ou mieux petite poule. - Vos é lai des jolies pittes. - Mes petiotes pittes venant vraiment bein. - (18) |
| pitte : poule - (44) |
| pitte : s. f. jeune poule. - (21) |
| pitte, n.f. jeune poule. - (65) |
| pitte, poulette - (36) |
| pitter, pitrer v. Laisser des traces de pattes (oiseaux), piétiner. - (63) |
| pity-inte, petite. - (26) |
| pitz. : (Du latin pectus), poitrine. Le dialecte distinguait ce mot, par cette orthographe, de l'adverbe pis (pire) ; mais le patois avait, dans le mot pei, deux significations : c'est-à-dire, celle de l'adverbe de comparaison pis ou pire, et celle de pis ou mammelle. Ça tôjo pei qu'antan, c'est-à-dire c'est toujours de pis en pis. - (06) |
| piu : plus. - (33) |
| piu : adj. et n. Absence de. - (53) |
| pïu, pïu ! cri avec lequel les femmes appellent les oiseaux de basse-cour. (voir : piauner, pîner.) - (08) |
| piun, unne, adj. plein. — adv. Tö piun, tout plein, beaucoup. - (17) |
| piungeon : petit tas de foin - (48) |
| piunme, sf. plume. - (17) |
| piunmé, vt. plumer. - (17) |
| pivai, tourner avec rapidité, courir avec agilité. Le mot est particulier au Châtillonnais, et cette image a été sans doute suggérée comme une application de ce qui tourne avec rapidité sur un pivot. - (02) |
| pivai. : Tourner sur un pivot. Un enfant fait piver, une fiarde (toupie). En Champagne, pilvotter signifie sauter en tournant. - (06) |
| piver, v. intr., tourner sur un pivot, pivoter. Un enfant dit : « J'fais piver ma fiarde, » quand celle-ci tourne, pour ainsi dire, en dormant. - (14) |
| pivette : grosse pioche. A - B - (41) |
| pivette : grosse pioche - (34) |
| pivouaíne (n.f.) : pivoine - (50) |
| piye, pile ; eune piye de pessiâ, un amas de paisseaux. - (16) |
| piÿocher, v. tr., pignocher, manger malproprement : « Y ét eùn mauprôpe ; ô n'fait que piÿocher dans son eissiéte. » - (14) |
| piÿon, s. m., envie, petite languette de peau qui se soulève autour des ongles, et qu'on a tort d'arracher. - (14) |
| piÿòt, et piÿeû, s. m., thym, plante aromatique utilisée en cuisine. Il y a une sorte de piÿot sauvage, que les bonnes femmes vont « racoter » pour en préparer des infusions contre le rhume. - (14) |
| pïyotte : (nf) petite poule - (35) |
| pizagaige, s. m. action de « pizaguer », de fouiller dans un creux, dans un trou avec un instrument quelconque. - (08) |
| pizagè (v. trans.) 1 – aiguillonner. 2 - exciter, taquiner. - (45) |
| pizaguai: chercher noise, piquer au vif ou poursuivre. O me pizague : il me poursuit. Astiquoter, taquiner. - (33) |
| pizaguè : 1 n. f. Agressivité. - 2 v. t. Exciter. - 3 v. t. Remuer énergiquement. - (53) |
| pizaguée : n. f. Tournée. - (53) |
| pizaguer (v.t.) : piétiner - (50) |
| pizaguer, v. n. fouiller avec une pointe, une baguette, etc., en poussant, en agitant. - (08) |
| pizer (v.t.) : piétiner - (50) |
| pizon, s. m. pigeon. - (08) |
| pji, sm. pli. - (17) |
| pjinche, sf. planche. - (17) |
| pjoué, vt. plier, ployer. - (17) |
| plâ (n. m.) : tige de la luzerne quand elle a été battue - (64) |
| placâ : placard. - (62) |
| placiau, placier. n. m. - Petit espace, petit emplacement dégagé à la croisée des chemins. - (42) |
| placiau. s. m. Terrain vague, inculte. – Espace carré, planté d'arbres. - (10) |
| plâi, s. m. plaisir : « fié-moué l'plâi » faites-moi le plaisir. « piaihi. - (08) |
| plâï, s.m. plaisir. - (38) |
| plai. Plat, plats ; c’est aussi le singulier des trois personnes du verbe plaire, au présent de l'indicatif. - (01) |
| plâïan, ante: adj. plaisant, e, qui plait, agréable : une fille, une maison « bin plâhiante » : - (08) |
| plaice : place - (48) |
| plaice : n. f. Place. - (53) |
| plaice : place - (39) |
| plaicè : v. t. Placer. - (53) |
| plaice, s. f. place avec les diverses significations du français. « piaice. » - (08) |
| plaice, s. f., place publique. La nôtre a son côté ombreux, sous ses larges platanes plantés en 1811. - (14) |
| plaice. Aller, tô po lai plaice, c'est ne pas rester en repos... - (02) |
| plaice. Place, places, substantif ; c'est aussi le singulier des trois personnes du verbe placer au présent de l'indicatif, etc. Les Bourguignons prononcent plaice, glaice, comme s'il y avait pliaice, gliaice, mouillant toujours cette liquide entre une consonne et une voyelle. - (01) |
| plaid. Quelques campagnards se servent encore de ce vieux mot dans les villages arriérés de l'Auxois. Voici un joli proverbe, extrait des «Matinées Sénonaises » de l'abbé Tuest : - Deux femmes font un plaid, - Trois, un grand caquet, - Quatre, un plein marché. - (13) |
| plaider : v. n., discourir. Ah ! il a bien plaidé ! - (20) |
| plaidoû : plaideur - (48) |
| plaidou : plaideur - (39) |
| plaidou, ouse, s. plaideur, celui qui plaide. « piaidou. » - (08) |
| plaignard. Geignard. Jamais satisfait. - (49) |
| plaignou (re) : qui se plaint tout le temps - (39) |
| plaignoû : qui se plaint - (48) |
| plaignou : n. m. Personne qui se plaint souvent. - (53) |
| plaignoû, et plaignard, adj., qui se plaint, et souvent sans raison. - (14) |
| plaignu, participe de plainde, plaint. - (14) |
| plaihot, s. m. serpette pour couper le raisin à l'époque des vendanges. - (08) |
| plai'illon : perche de bois souple - (48) |
| plâillant : adj. Plaisant. - (53) |
| plâilli, ou plâyi - plaisir. - An é bein du plâilli aivou lo, i vos aissure. - En sortant de ce temps qui vos n'airas point de plâilli du tot. - (18) |
| plaimor de, loc. a cause de, en raison de, afin de… - (08) |
| plain : chanvre à filer. IV, p. 15-1 - (23) |
| plain : chanvre cardé. - (33) |
| plain, s. m. la meilleure partie du chanvre filé, œuvre. - (08) |
| plain. Plains, plaint. - (01) |
| plain. Plainte, vieux mot. - (03) |
| plainche, parche : n. f. Planche. - (53) |
| plainche, s. f. planche, passerelle ou pont sur un ruisseau ou une petite rivière. Diminutif de plainchotte. « piance. » - (08) |
| plainche, s. f., planche. Les scieurs de long en façonnent avec les longs sapins qui nous arrivent. - (14) |
| plainché, s. m. plancher, grenier, fenil. - (08) |
| plaincher, s. m., plancher, fenil, grenier, resserre au grain et au fourrage. - (14) |
| plainchi. s. m. Plancher. ( Domecy-sur-le-Vault). - (10) |
| plainde, v. pron., se plaindre : « On l'entend tôjor plainde ; mâ, vouah ! ô né pas si mau qu'ô veut ben dire. » - (14) |
| plaindé. Plaignez. - (01) |
| plainder, v. tr., plaindre. - (14) |
| plaindou, ouse, adj. et s. celui qui se plaint à tout propos et sans motif. Même sens à peu près que pleurnicheur. (voir : plaingnou.) - (08) |
| plaindu, part. pass. du verbe plaindre. Plaint. - (08) |
| plaindu, plaidue et plainduse : part, pass., plaint, plainte. - (20) |
| plaine : plane (outil de menuisier) - (48) |
| plaine : plane, outil de menuisier - (39) |
| plaine, s. f. plane, outil à l'usage des charpentiers et des charrons. On l'emploie avec les deux mains comme un rabot pour aplanir et polir le bois. - (08) |
| plaine, s. m. plane, nom vulgaire du faux platane qu'on appelle aussi érable sycomore. - (08) |
| plainer : planer (travailler avec une plane) - (48) |
| plainer, v. a. travailler avec la plane, aplanir, raboter. - (08) |
| plaingnou, ouse, s. m. ou f. celui qui se plaint outre mesure, qui est douillet. - (08) |
| plain-ne : adj. Pleine. - (53) |
| plain-ne, s. f., plaine. Nous en avons de vastes, couvertes de beaux champs de maïs. - (14) |
| plainotte, s. f. planète. - (08) |
| plaint : s. m., vx fr., plainte. Elle ne fait qu'un plaint toute la journée. - (20) |
| plaint, s. m. plainte, gémissement : « al ô bin mailaide, eun dé plains n'aitan pâ l'aute », il est bien malade, ses gémissements se succèdent sans interruption. - (08) |
| plaintin : Plantain, plantago media. « L'iau de pliantin est bonne pa les yeux » : une décoction de feuilles de plantin est un bon collyre. - (19) |
| plaire (v.t.) : plaire - (50) |
| plaisant. Gai ; par un idiotisme se dit plutôt d'un lieu que d'une personne. - (03) |
| plaisi (ä), sm. plaisir. - (17) |
| plaisir. : (Dial.), plaire. (Du latinplacere.) - (06) |
| plaisse : place - (48) |
| plaisser (verbe) : mettre en forme les haies en couchant les longues tiges pour les tresser entre les piquets. - (47) |
| plaisser : rabattre les haies - (60) |
| plaisu, part, du verbe plaire, plu. - (14) |
| plait-ai-Dieu. Plût à Dieu, utinam. - (01) |
| plâïu (-e) (p.p.) : participe passé du verbe plaire = plu (-e) - (50) |
| plâïu, part. pass. du verbe plaire. plu : « ç'ial m'é bin plâïu », cela m'a bien plu. (voir : plâï.) - (08) |
| plaiyé : plié - (37) |
| plaiyer : plier, empaqueter - (37) |
| plaiyon : morceau de bois qu’on jette sur un arbre pour en abattre les fruits - (37) |
| plaiyon : gros bâton - (39) |
| plaizi. Plaisir, plaisirs. - (01) |
| p'lan : Pilon « Dans le vieux temps an p'lait la sau dans in morté de piarre d'ave in p'lan de bouis » : autrefois on pilait le sel dans un mortier de pierre avec un pilon de buis. - (19) |
| planche : s. f. Panneau mobile qui, dans un char, ferme soit l'avant, soit l'arrière. - (20) |
| planche : s. f.. terme de tonnellerie, colombe, sorte de grande varlope renversée. Planche à bâtir, colombe légèrement concave dans le sens de la longueur, et sur laquelle on rabote les douelles. Planche à foncer, colombe légèrement convexe dans le même sens et sur laquelle on rabote les fonds. Aujourd'hui, les tonneliers préfèrent un type de planche unique et plane. - (20) |
| planche : voir pressoir. - (20) |
| planché, ée. adj. Couché, renversé par terre. – Blés planchés, blés couchés, renversés par le vent sur leur planche, sur les sillons. (Saint-Florentin). - (10) |
| plancher de lar : plancher en haut d'une grange. - (31) |
| plançon : s. m., plant de semis destiné à être repiqué. - (20) |
| plançon, plant de vigne. - (16) |
| plançon, s. m. personne d'encolure épaisse, homme trapu et de petite taille. - (08) |
| plançon, s. m. tige de saule, un peu grosse, destinée à être plantée en bouture. - (11) |
| plane. n. f. - Brebis. (Champignelles, selon M. Jossier) - (42) |
| planeau, plaineau : s. m., plateau, passerelle de bateau. - (20) |
| plan-plan : Lentement, sans se presser. « O s'en va tot plan-plan». - (19) |
| plan-plan : adv., doucement, lentement. Il va tout plan-plan. - (20) |
| planson : (plan:son: - subst. m.) personne courte et trapue. Synonyme de pô:tré (cf. ce mot) - (45) |
| plantai. Planté, plantez, planter. - (01) |
| plantai. : Planter. Véne qu'ai piante, vienne qui voudra. - (06) |
| plante : s. f., vx fr., plantation. Noms de lieuxdits : A la Plante, Ez Plantes, les Plantes Vieilles, etc. - (20) |
| plantée, n.f. jeune vigne. - (65) |
| planter. Planter. - (49) |
| planton, désignant la pomme de terre destinée à être plantée, et, par extension, un garçon gros et fort, sous cette forme « C'est un bon planton » - (11) |
| plaquasse : (placas' subst. f.) surface encombrée. - (45) |
| plaquer. Coller, être très adhèrent. - (12) |
| plaquiau. n. m. - Nénuphar. (Villeneuve-les-Genêts, selon M. Jossier) - (42) |
| plaquiau. s. m. Nénuphar. (Villeneuve-les-Genêts). - (10) |
| plaquier, platchier. v. - Plaquer, appliquer. - (42) |
| plare, v. plaire. - (38) |
| plâreau. s. m. Serpette de vendangeur. (Domecy-sur-le-Vault). - (10) |
| plat (Faire un) : loc, vanter. Il m'en a fait un plat. - (20) |
| plat de bande : s. m., plate-bande. - (20) |
| platane : s. f. « L'auto vint se jeter contre une platane bordant la route. » (Nouvelliste, 24 jUin 1913). - (20) |
| platcheaû(on) : plateau - (57) |
| plat-cul : s. m., chute qu'on fait sur le siège aux bains de rivière, et, par extension, le bain lui-même. Viens-tu faire un plat-cul en Saône ? Rapprocher de bosse-cul et passe-cul. - (20) |
| plate, s. f., bateau plat pour les laveuses. La plate est un lieu de prédilection pour les « jasons » et les cancans de la ville. — On donne aussi ce nom au grand bateau du bac, dans lequel on passe chevaux et voitures. - (14) |
| plate, s. f., grand plat en terre, pour aller au four. - (40) |
| plateau : voir pressoir. - (20) |
| plateau, platiau. – Voyez plaquiau. - (10) |
| plateau, s. m. bois de sciage d'une certaine épaisseur qui, entre autres usages, est employé pour fabriquer les mangeoires d'écurie. - (08) |
| platelée : s. f., vx fr., platée. - (20) |
| plati, v. a. aplatir, rendre plat, niveler. - (08) |
| platiau, s. m., plateau. - (14) |
| platiau. n. m. - Plateau. - (42) |
| platine : s. f., vx fr., taque de cheminée. - (20) |
| platine, s. f. langue. une bonne « platine », une bonne langue, un avocat de village, une commère. - (08) |
| platine, s. f., poitrine, dans le sens d'organe propre à parler fort et longtemps : « Ah voui ! c'té-là, all' vous en a eùne, de platine. N'y en a qu'por elle ! » — Encore alle et elle ensemble. - (14) |
| platine. Plaque d'une cheminée en fonte ou en pierre. Nos vieilles maisons rurales avaient au fond du foyer une platine en bouzard : c'est le nom d'une pierre provenant des carrières de Bouze et résistant au feu et à la gelée. On dit communément d'un bavard : al ai eune bonne platine. - (13) |
| platines. s. f. Langue de babillard. - (10) |
| platis : banc de sable plat, en eau peu profonde. - (62) |
| platô, planche épaisse, large et longue. - (16) |
| platon. s. m. Ecuelle de terre, petit plat. (Chigy). - (10) |
| platot : endroit plat et sec d'un pré - (39) |
| platre (plâtre) : s. m., emplacement. Noms de lieux : Le Plâtre (communes de Pierreclos et de Pruzilly). — J'ai là un petit plâtre de terre ; je sais pas ce que je veux y mettre. - (20) |
| plâtre, s. m. emplâtre. il a un « plâtre » sur la figure. - (08) |
| plâtre. Appareil en plâtre pour soigner un membre cassé : « aul ait la jambe dans le plâtre ». - (49) |
| plâtre. Emplâtre. Plâtre signifie aussi place à disposer du plâtre, de la chaux, des matériaux de maçonnerie à faire du mortier. On le trouve souvent avec ce sens dans les actes de vente. - (12) |
| plâtrée, s. f., platée, contenu d'un plat copieux. - (14) |
| platte : bateau-lavoir. (VSLD. T II) - S&L - (25) |
| platte : s. f., vx fr. plate, bateau lavoir. Platte chaude, platte froide, c'est-à-dire à eau chaude, sans eau chaude. Sardine de platte, ablette. - (20) |
| plattier, plattière : s. m. et f., propriétaire ou tenancier de platte. - (20) |
| plaud n.m. (du v. fr. plauder, raser les cheveux). Vagabond, mendiant, misérable. - (63) |
| plaud. Chauve. - (49) |
| plaud. s. m. et adj. Lourdaud. - (10) |
| plauder. Couper les cheveux. Fig. Se tirer les cheveux. Par extension, se battre. - (49) |
| plaut : vagabond - (43) |
| plàÿant, adj., plaisant. - (14) |
| plâ-yant, adj., plaisante. - (40) |
| plàÿi (au)! loc. elliptiq., au plaisir ! Jetée tout court de la sorte, elle veut parfaitement dire : « Au plaisir de vous revoir ! » - (14) |
| playi (n.m.) : plaisir - (50) |
| plâyi : plaisir - (48) |
| plaÿi : plaisir. On prononcerait le même mot pour le verbe « ployer », mais on préférerait plîÿi pour « plier ». - (62) |
| plâyi : plaisir - (39) |
| plàÿi, s. m., plaisir : « Si j'veins por iqui, y é pas tant por mon plàyi. » - (14) |
| playon : perche de bois souple - (48) |
| playon : perche de bois. - (33) |
| playon. s. m. Perche, morceau de bois souple employé pour serrer une chaîne ou une prolonge qui lie ou maintient des pièces de bois, des bourrées, un chargement quelconque sur une voiture. - (10) |
| plé (ai), loc. en abondance, à foison. son champ est bon, le blé y vient « ai plé. » - (08) |
| ple (pleu), plus : j'en vous pleu,je n'en veux plus. - (38) |
| plé : Bouillie de maïs, gaudes. - (19) |
| plé : s. m. farine de maïs, gâteau fait avec cette farine ou avec du riz. - (21) |
| pléant, e. adj. - Plaisant, plaisante : «La Janine, alle est ben pléante ded'pis qu'alle a trouvé eune houmme ! » - (42) |
| plèce : la place - (46) |
| pléchâ, s. m. tige ou branche d'arbre qui a été couchée vive pour la clôture d'un héritage. Nos « pléchies « se composent d'une série de « pléchas. » - (08) |
| plèchê : arbuste taillé pour faire une haie tressée - (48) |
| plécher - (39) |
| plècher : faire une haie couchée et tressée - (48) |
| plècher : (plèché - v. trans.) plesser, entrelacer les branches extérieures d'une haie vive. Pour soutenir l'entrelacs, on plante des poteaux (des pô:) à intervalles à peu près réguliers, ou on utilise des coneilles déjà existantes (v. ce mot). - (45) |
| plécher, v. n. plesser, coucher des tiges, des branches d'arbre au moyen de la serpe ou de la cognée pour former des clôtures. Toutes les haies vives du Morvan sont régulièrement « pléchées » ou « plessées » de manière à ce que les ouvertures se trouvent fermées au fur et à mesure que le temps détruit le bois mort. - (08) |
| plèchie : haie (taillée, couchée et tressée) - (48) |
| pléchie : (plèchi: - subst. f.) haie tressée, plessis. - (45) |
| pléchie : haie - (39) |
| pléchie, s. f. haie vive formée avec des tiges ou des brandies d'arbres entrelacées. - (08) |
| plée. v. - Plaire. - (42) |
| pléger, plesser. v. a. Ployer. Plesser une branche d'arbre. - (10) |
| pléier (v.t.) : plier (aussi pléyer) - (50) |
| pléïer, v. a. plier, ployer, fléchir, courber. - (08) |
| plèillè : plier - (46) |
| pleillé : v. i. ou v. t. ind. Plaire. - (53) |
| plein, œuvre. Filasse de chanvre peignée, prête à être filée. - (49) |
| plein-nòt, s. m., planche assez forte et large, posée de la terre au bateau, pour qu'on puisse y entrer ou en sortir. - (14) |
| pléïon,s. m. pleyon, petite perche en général flexible dont on se sert entre autres usages pour conduire le bétail aux champs. - (08) |
| pleisser, courber, abattre, pleissée, branches courbées. - (04) |
| plemâ, s. m. assemblage en bois qui réunit les deux roues d'une charrue. - (08) |
| plemeue, plemeure .s. f. Pelure de fruit. - (10) |
| pléne. Plaine, plaines. - (01) |
| plequiau : corbeille en bois. - (09) |
| p'ler : Piler. « De la sau p 'lée » : du sel pilé, du sel fin. - (19) |
| plesse : épluchure - (51) |
| plesser, v. a. courber, ployer les tiges d'arbres pour clore les héritages. - (08) |
| plessi : haie vive. (T. T IV) - S&L - (25) |
| plessis, plessis. Haie, bouchure. (Plessis est le mot en vieux français). - (49) |
| plessis, s. m., haie vive. (V. Bouchure, Palisse.) - (14) |
| plessis. Buisson. - (03) |
| pleû : pluie. - (29) |
| pleu, fouanèche. Pâturin des prés (Poa pratensis). - (49) |
| pleu, plui : part. pass. (de pleuvoir), plu. - (20) |
| pleu, s.f. pluie. - (38) |
| pleuche : outil pour piocher, à une seule lame rectangulaire assez large (largeur : 10 cm, environ). - (58) |
| pleucher : piocher, mais légèrement, voire délicatement, avec la pleuche. Ex : "J'monte pleucher la vigne !" - (58) |
| pleûdre : pleuvoir. D’où : « y pleut », « y pleuvot » : il pleuvait, « y pleudra » : il pleuvra, « y pleudrot » : il pleuvrait… - (62) |
| pleudre : pleuvoir. (A. T IV) - S&L - (25) |
| pleûdre, et plôdre, v. intr., pleuvoir. - (14) |
| pleudre, v. pleuvoir. - (38) |
| pleue (la) : pluie (la). - (62) |
| p'leue (pour pelure). s. f. Friche, terre inculte. (Plessis-du-Mee, Arcy-sur-Cure). - (10) |
| pleue : pluie - (48) |
| pleue : pluie - (39) |
| pleue, pieue. Pluie. - (49) |
| pleue, pleuve : a. f., pluie. - (20) |
| pleue, pluie ; pleuvre, pleuvoir ; on dit aussi : pieue et pieuvre; el é pleuvu lai neu, il a plu la nuit, - (16) |
| pleue, s. f. pluie. « pieue : a pieu », il pleut. - (08) |
| pleûë, s. f., pluie. - (14) |
| pleue, s. f., pluie. - (40) |
| pleue, subst. féminin : pluie en général. - (54) |
| pleûge : la pluie - lè pleûge é fè du bin au jaidien, la pluie a fait du bien au jardin. - (46) |
| pleuje, pluie. Du latin pluvia. - (02) |
| pleuje. : luie. (Dérivation du latin pluviam.) - (06) |
| pleumâ, pieumâ : plumeau - (48) |
| pleumâ, s. m. plumeau, balai de plumes. - (08) |
| pleùmàche, s. m., plumage, panache, ornement de coiffure : « Alle a éte d'la noce ; all' vous évòt ein pleùmàche su son chapiau ! . . . falot vouér. » - (14) |
| pleumaissier : écrivain - (48) |
| pleumâs : plumeau - (39) |
| pleûmasse, s. f., duvet. - (40) |
| pleume - (39) |
| pleume : plume - (48) |
| pleumé : plumier - (48) |
| pleume, pieume. n. f. - Plume. - (42) |
| pleume, piume ; pleumé ; on pleume un oiseau et même des légumes, des pommes de terre, des raves, etc. On dit aussi : pieume et pieumé. Pleumure, pieumure de légumes, la peau qu'on leur a enlevée. - (16) |
| pleume, s. f. plume à écrire ou autre. - (08) |
| pleùme, s. f., plume. - (14) |
| pleûme, s. f., plume. - (40) |
| pleume, s.f. plume. - (38) |
| pleume. Plume, plumes. - (01) |
| pleumeau. n. m. - Plumeau. - (42) |
| Pleumeire. Plombière, gros et beau village à une lieue de Dijon. - (01) |
| pleumer : plumer, peler, éplucher - (48) |
| pleumer : plumer - (39) |
| pleumer, v. a. plumer, peler, arracher le poil, éplucher. - (08) |
| pleùmer, v. tr., plumer, et aussi parfois peler. - (14) |
| pleumer, v. verbe plumer. - (38) |
| pleumeure, s. f. épluchure, pelure. - (08) |
| pleùmiau, et plumiau, s. m., plumeau, et aussi aile d'oie, dont les ménagères se servent pour épousseter, ramasser la cendre devant le feu, etc. - (14) |
| pleune, pleume. adj. -Pleine : « La feuillette, alle est pleune. » - (42) |
| pleure, pleuvoir. Pleuvoir. - (49) |
| pleure, v. n. pleuvoir : « a vé pleure », il va pleuvoir. « pluire, pleure. » - (08) |
| pleurer : v. n. Pleurer de courage, pleurer à chaudes larmes. Pleurer du ventre, avoir des gargouillements intestinaux. - (20) |
| pleûrer, v. tr. et intr., pleurer, et, dans un sens tout particulier, mesurer parcimonieusement : « Pleurer la nourriture à quelqu'un. » la lui reprocher. - (14) |
| pleurer. Pleurer. - (49) |
| pleûrou, pieûron, se dit d'une personne qui, sans pleurer, se plaint habituellement de son état de gène qu'elle exagère. - (16) |
| pleus. Voyez p’leue. - (10) |
| pleuseure : (pleu:zeur - subst. f.) présure. - (45) |
| pleuseure, s. f. présure, liqueur dont on se sert pour faire cailler le lait. - (08) |
| pleuter : pleuvoir - (44) |
| pleutre, rustre , charretier. Du latin plaustrum, charrette. - (02) |
| pleutre, s. m. grognon, maussade, d'humeur difficile. S'emploie surtout en parlant d'un enfant désagréable, qui se plaint à tort et à travers. - (08) |
| pleuvasser : bruiner - (48) |
| pleuvigné ; é pleuvigne, il tombe de la pluie fine. - (16) |
| pleuviner. Pleuvoir légèrement. Autrefois plouviner. - (03) |
| pleùvocher, v. intr., pleuviner, pleuvoir légèrement. - (14) |
| pleuvre : pleuvoir - (46) |
| pleuvre : pleuvoir. - (29) |
| pleuvre : v. n., pleuvoir. I va pieuvre. I faudrait bien qu'il plussisse... I faudrait trop qu'i pluvisse... - (20) |
| pleuvre. Pleuvoir. Vai-t-en ben vite raimasser les chemises qu'an ai mis choicher, an vai pleuvre. Nous avons le diminutif pleuviner que Brantôme écrit : pluviner. - (13) |
| pleuvroche, s.f. petite pluie. - (38) |
| pleuvrocher, v., pleuvoir doucement, bruiner. - (40) |
| pleùvu, 3ème pers. s. du parfait de pleùdre, plu : « Je v'leins còri ; y a pleùvu tòte la jornée. » - (14) |
| pleuvu, part. pass. du verbe pleuvoir. plu : « a n'é pâ pleuvu ojedeu », il n'a pas plu aujourd'hui. - (08) |
| pléyë, plier, par exemple, du linge. - (16) |
| plèyer : plier - (48) |
| pleyer : plier - (39) |
| pleyer. Plier ; ployer. - (49) |
| pleyer. v. - Plier. - (42) |
| pleyon : bâton souple - (39) |
| pléyuhe, playure. s. f. Lien de paille ou de chanvre pour accoler la vigne. (Saint-Florentin). - (10) |
| plia : Plier. « Plia du linge ». - (19) |
| pliacâ : Armoire creusée dans la muraille, placard. « As-tu bien fremé (fermé) le pliacâ ? ». - (19) |
| pliafand : Plafond. Au figuré : « Avoir eune euraignie dans le pliafand» : avoir une araignée au plafond, un grain de folie. - (19) |
| pliafonner : Plafonner. « Dans les veilles maijans les chambres n’étint pas pliafonnées ». - (19) |
| pliaice, ou, par abréviation piaice - place. - A juant és quilles su lai pliaice. - Lai piaice éto tote pliainne de mairchands. - (18) |
| pliaidi : Plaider, intercéder en faveur de quelqu'un. « J'ai pliaidi par ta » : j'ai intercédé pour toi. - (19) |
| pliaidoux: Plaideur, qui aime la chicane. « I est in pliaidoux enraigi ». - (19) |
| pliaijant : Plaisant, gai, agréable. « I est eun endra bien pliaijan » : c'est un lieu bien agréable, d'où l'on a une belle vue. - (19) |
| pliaiji : Plaisir. « Chéquin prend san pliaiji queva ol le troue » : chacun prend son plaisir où il le trouve. « I est bin pa vo fare pliaiji » : c'est bien pour vous être agréable. - (19) |
| pliain, ou par abréviation piain - plein. - N'en mets pas piain le soillot ; te ne pouras pas l'aiportai. - Tout plein veut dire beaucoup : Beillez-moi z'en to pliain. - (18) |
| pliainchi : Plancher. « Le pliainchi des vaiches » : le plancher des vaches - (19) |
| pliaindre : Plaindre. « O n'est pas bien à pliaindre ». On dit également piaindre. - (19) |
| pliain-ne : Plaine. « Les vins de la plain-ne ne valent pas les vins de la mantaigne » : les vins de la plaine ne valent pas les vins de coteau. - (19) |
| pliamb : Plomb. « Ol est vif c'ment in sa (sac) de pliamb ». « Tes ovrés te fondant du pliamb » : tes ouvriers perdent leur temps. - (19) |
| pliant : Plant. « Eune vigne de ban pliant » : une vigne de bonne espèce. - (19) |
| pliante : Jeune vigne. « Du vin de pliante » : du vin de jeune vigne. - (19) |
| plianter : Planter et plus particulièrement planter de la vigne. « Ol a fait plianter en Meurjuru » : il a fait planter en vigne la terre située en Meurjuru. - (19) |
| pliantoux : Planteur. « Eune brigade de pliantoux » : une équipe d'ouvriers occupés à planter de la vigne. - (19) |
| pliâre : Plaire « Alle fa tot ce qu'alle peut pa li pliâre » : elle fait tout ce qu'elle peut pour lui plaire. - (19) |
| pliat: Plat. « In pliat de faïence ». - Mets. « In ban pliat de favioles » : un bon plat de haricots. « An ne peut pas en fare in ban pliat » : on ne peut pas en dire du bien. - Uni. « In pays pliat » : une plaine. « Les cus pliats » : les habitants de la Chapelle de Bragny. « Du vin pliat» : du vin qui n'a guère d'alcool ni de bouquet. - (19) |
| pliati ? : Plait-il ? Formule polie pour faire répéter une phrase qu'on n'a pas entendue. Est moins familier que « Hein ? ». - (19) |
| pliatiau : Plateau, planche très épaisse. « In pliatiau de noué » : un plateau de noyer. - (19) |
| pliatine : Platine, tablette du poële sur laquelle on met les pieds pour se chauffer. « Mentre les pids su la pliatine ». Au figuré : «Avoir eune bonne pliatine » : avoir la langue bien pendue. - (19) |
| pliâtre : Plâtre. « In sa de pliâtre » : un sac de plâtre. « San père l'a battu c'ment pliâtre » : son père l'a sérieusement battu, corrigé. - Emplâtre. « Le Bliandieu li a mis in pliâtre » : le rebouteur lui a posé un emplâtre. - Carrefour. « Dan in temps les hommes s'arrâtint su le pliâtre en seurtant de la masse pa causer in moment » : autrefois les hommes s'arrêtaient au carrefour, en sortant de la messe, pour causer un moment. - (19) |
| pliches, s. f. pl., seins pendants et mous. - (40) |
| plié. Pliez, plier. - (01) |
| pliéche : Place. « Eune bonne pliéche » : une bonne place, une bonne situation. « La pliéche de grange » : l'aire. « Stu que va à la chaiche pé sa pliéche » : qui va à la chasse perd sa place. En parlant d'une fille à marier qui apportera à la communauté une jolie dot on dit : « I est eune bonne pliéche ». - (19) |
| pliein : Plein. « Pliein c'ment n'û » : plein comme un œuf. « Tot pliein » : beaucoup. « I avait tot pliein de mande à la foire ». - (19) |
| pliein, eine, adj. plein, pleine. - (08) |
| plieu : Plus, pas davantage. « Je n'en veux plieu » : je n'en veux plus. Plieu ne s'emploie qu'avec une négation, dans les autres cas on dit « pu ». « J'en veux pu » : j'en veux davantage. - (19) |
| plieuche : Pioche, houe. Il y a différentes sortes de pioches : « La plieuche à cornes » pioche à deux dents dont on se sert pour donner la première façon à la vigne (somarder) et la « Plieuche pliate » pour les autres façons. « La plieuche bâtarde » plus forte que la « Plieuche pliate » et la « plieuche pionnére » ou « Plieuche à pique » très lourde, dont on se sert pour défricher. - (19) |
| plieuchi : Piocher « Man homme est allé plieuchi es Leynes » : mon mari est aller piocher aux Leynes. - Cultiver la terre, exercer la profession de cultivateur. « Aujourd'heu neguin ne veut plieuchi tot le mande veut êt 'mossieu» : aujourd'hui personne ne veut cultiver la terre, tout le monde veut être monsieur. - (19) |
| plieuchoux : Piocheur. « Eune brigade de plieuchoux » : une équipe de piocheurs. - (19) |
| plieue - pluie. - En airo bein besoin de plieue. - C't'année qui quand les plieues s'y mettant ci n'en fini pas. - (18) |
| plieue ou pliô : Pluie. « I a cheu eune bonne plieue ». « Ptiéte plieue abat grand vent ». « Sauvins nos vlà la pliô ». « Après la pliô le biau temps ». - (19) |
| plieumage : Plumage « Le plieumage de la padrix roge est pu brave que stu de la padrix grige » : le plumage de la perdrix rouge est plus beau que celui de la perdrix grise. - (19) |
| plieumai - on emploie ce mot non seulement dans le sens ordinaire de plumer, mais encore pour peler. – Plieume ces poires qui, cair en les é rairnassées dans lai gôille. - En ne fau pas plieumai les pêches ; laie paie liô beille bein pu de gout. - (18) |
| plieume : Plume. « Les vieux écrivint ave des plieumes d'oie ». « La plieume répare l'ujau »: la plume fait la beauté de l'oiseau, la toilette embellit la personne qui la porte. « O m'avint mis des plieumes d'ujau su man chépiau » (vieille chanson). - (19) |
| plieumer : Plumer. « J'arai bin vite fait de plieumer in poulot ». - Eplucher. « Plieumer des tapines » éplucher des pommes de terre. - Peler. « Plieumer eune poire ». - « Se fare plieumer » : se faire gagner son argent. - (19) |
| plieumet : Plumet. « Dans n'in temps les canscrits mentint des plieumets su leu chépiau en allant à Sennecy, à présent quand i ant in plieumet y est en revenant ». - (19) |
| plieumeure : Epluchure. « Jete dan liau ces plieumeures ou bin ments les dans le boire es cochans » : jette ces épluchures ou mets les dans la pâtée des cochons. - (19) |
| plieurer : Pleurer. « Plieure pas y a point de mau » : ne pleure pas il n'y a pas de mal. En parlant d'un mort qui n'est regretté de personne : « O sera asseteu plieuré » : il sera vite pleuré. « Plieurer la milliéche » : être regardant en ce qui concerne la nourriture. On dit que « la vigne plieure » : quand la sève vient humecter la section du sarment fraîchement taillé. - (19) |
| plieurs, s. m. plur. pleurs, larmes, gémissements. - (08) |
| plieut : Billot, socle. « Chaplier des harbes su in plieut » : hâcher des herbes sur un billot. « Le plieut de la croix » : le socle de la croix. - Serpolet, thym, thymus serpillum. - (19) |
| plieutan : Peloton. « I me faut in ban plieutan de laine pa fini ma chausse » : il me faut un bon peloton de laine pour finir mon bas. - (19) |
| plieute : Pelote. « Eune plieute de fi » : une pelote de fil. Plieuttes : Plottes, commune du canton de Tournus. « Après Paris, Plieuttes », cet adage montre que les gens de Plottes (les plieutas) ont une très haute idée de leur pays. - (19) |
| plieute, s. f. billot sur lequel les sabotiers préparent le bois. - (08) |
| plieuvaichi : Pleuvoir peu abondamment mais longtemps et par intermittence. « I n'a fait que plieuvaichi tote la semain-ne ». - (19) |
| plieuve, ou pliôre - pleuvoir. - En vai plieuve lai neu, cair le temps â don si doux ! - En plieuvo fort sur les deux heures du maitin. - Ailons chercher note foin, demain en pliôré. - (18) |
| plinché : n. m. Plancher. - (53) |
| pliôre - pleuvoir. Voyez Plieuve. - (18) |
| pliot, pelot – billot, ou morceau de bois solide sur lequel on s'appuie pour frapper, couper. - Mettez vo don su le pliot pour copai lai viande. - Aiguyez vos paichais sur ce pied d'âbre qui, tenez ; ci vos serviro de pliot. - In pliot, c'â aissez commode dan in mannége. - (18) |
| plioute, plioutis, cri pour appeler les poules à manger. - (07) |
| plisses, s. f. petites semelles en paille que l'on met dans les sabots pour se préserver de l'humidité. - (08) |
| pliu : Pleuvoir. « Le temps se charge, i va pliu » : le temps se couvre il va pleuvoir. « I plio à la porte des feignants » : à la première goutte de pluie les paresseux s'abstiennent d'aller au travail crainte du mauvais temps. - (19) |
| pliungeon, n. masc. ; tas de foin ; les faneurs désandennent, at peus chauchent le foin, le mettent en pliungeons ; prononcez pliungeons. - (07) |
| pliyé, ployer sous un fardeau ; el â pliyé an deû se dit d'un homme très courbé. - (16) |
| pliyeu : s. m. instrument pour donner la forme creuse à la tuile. - (21) |
| plliaiç-he, place. - (05) |
| plliaine, plane, outil de charron. - (05) |
| plliaint, gémissement de douteur. - (05) |
| plliainte, plainte. - (05) |
| pllianœt’e*; adj. fraîche, pleine, boulotte. - (22) |
| plliansson, s. m. jeune plant. - (22) |
| plliante, s. f. jeune vigne. - (22) |
| plliâtre, emplâtre. - (05) |
| plliâtre, place, terrain vague. - (05) |
| plliâtre, s. m. espace découvert dans un lieu broussailleux ou dans un bois. - (22) |
| plliessis, haie vive plissée. - (05) |
| pllieu, s. f. pluie. Verbe : pllioure. - (22) |
| pllieume, plume. - (05) |
| pllieumoeure, s, f. pelure, épluchure. Verbe : pllieumé, enlever la plume ou la pelure. - (22) |
| plliòchi, v. n. arracher avec patience des mauvaises herbes. - (24) |
| pllioeuné*, v. a. défricher un bois à la pioche. Pllioeuni, celui qui défriche. - (22) |
| pllion, pilon d'étang. V. daigne. - (05) |
| pllionche, planche. - (05) |
| plliongi (se), loc. se mouiller les pieds par maladresse dans un ruisseau, un terrain inondé. Littéralement « se plonger ». - (24) |
| plliot, billot de bois. - (05) |
| plliou, s. m. billot. - (22) |
| pllioue, pllioure, pluie, pleuvoir. - (05) |
| plliourer, pleurer. - (05) |
| plloeuche, s. f. pioche. Verbe : pllioeuchi. - (22) |
| plô : (nm) vagabond - (35) |
| plo, billot de cuisine. - (16) |
| plo. Pluie. Piôre, pleuvoir. Pour une averse nous disons une beurée ou une batrasse. - (03) |
| ploçhe n.f. (de béloce, fruit du bélocier). Prunelle. - (63) |
| ploçhî n.m. Prunellier (on appelait autrefois bélocier le prunier sauvage). - (63) |
| plom. Plomb : Ai jeti son plom su lei, il jeta son plomb sur elle, en pilote expert, qui, ayant bonne opinion du terrain, y jette son plomb, c'est-à-dire y jette la sonde. - (01) |
| plom. : Plomb.- Jetai son plom, locution familière signifiant sonder une personne, une affaire. - (06) |
| plombure. s. f. Vernis à base de plomb qui recouvre la poterie de terre. (Puysaie). - (10) |
| plomner (v.) : écraser des légumes - (50) |
| plon (n.m.) : objet de bois pour écraser des légumes - (50) |
| plon : objet de bois pour écraser des légumes - (39) |
| plon. Bonde d'un étang. - (03) |
| plongeon (n. m.) : grosse meule de paille rectangulaire - (64) |
| plongeon (n.m.) : meule de paille ou de foin dans les champs ou dans les prés - (50) |
| plongeon (nom masculin) : meule de paille ou de foin. - (47) |
| plongeon : grande meule de bottes de paille ou de foin - (60) |
| plongeon : grosse meule de paille. Généralement érigée en une masse et d'une taille en forme de maison. Ex : "Les gamins...allez pas vous casser ène patte en jouant sul' plongeon !" - (58) |
| plongeon : n. m. Empilement de fagots de paille battue, construit comme un bâtiment afin qu'il soit étanche à la pluie et à la neige. - (53) |
| plongeon, n.m. tas de paille battue ou grand tas de foin. - (65) |
| plongeon, s. m. tas de foin qu'on forme le soir pour en favoriser la dessiccation. - (08) |
| plongeon. Meule de foin, de blé. - (49) |
| plongeon. n. m. - Grosse meule de paille ronde. - (42) |
| plongeon. s. m. Tas de foin composé de plusieurs viottes ou veuillotes réunies. (Chablis). - (10) |
| plonger, v. prendre de l'eau dans ses chaussures. - (65) |
| plonjon : tas de foin ou de paille. (SS. T IV) - N - (25) |
| plon-ner : écraser des légumes - (39) |
| ploplo, plèplet. Petit poulet. Cris poussés pour appeler les poussins « Plo ! Plo ! Plo ! ... ». - (49) |
| plôre, v., pleuvoir. - (40) |
| plorer. Pleurer. On disait autrefois plourer et plorer. - (03) |
| plosse : prunelle. A - B - (41) |
| plosse : prunelle - (51) |
| plosse, polache. Prunelle. - (49) |
| plosse. Prunelle. - (03) |
| plosser. Prunelier. - (49) |
| plôt (C.-d., Chal., Morv., Y.), plout (Y., Char.) piòt, piòton (Morv.).- Billot de bois, généralement soutenu par trois piéds, sur lequel les ménagères découpent la viande ou hachent les légumes. Ce mot était jadis usité, nous dit Littré, pour désigner le billot sur lequel le bourreau décapitait ; l'étymologie en serait inconnue… Dans l'incertitude, l'étymologie de bloc nous paraît la meilleure. Dans la Côte-d'Or on dit aussi ploton pour désigner le billot bas et sans pieds sur lequel on aiguise les paisseaux. Ajoutons qu'un enfant gros et lourd, un peu mastoc (massif) est, en Bourgogne, par analogie, appelé plot. - (15) |
| plot (on) : billot - (57) |
| plot : (plo - subst. m.) billot, sur lequel on fend le bois, coupe la viande, etc. - (45) |
| plot : plateau pour couper ou pour fendre - (48) |
| plot' : n. m. Plateau de bois servant à hacher. - (53) |
| plot : s. m., vx fr., billot de bois, borne de pierre. - (20) |
| plot, « L » billot , pièce de bois, ploda (bas latin). - (04) |
| plot, plot, piotte, plotte. Billot servant à couper du bois en petits morceaux. - (49) |
| plot, p'loton : plateau de bois servant de hachoir. - (33) |
| plot, s. m. bloc de bois détaché d'un arbre et qu'on emploie à divers usages, billot. - (08) |
| plòt, s. m., billot, escabeau, bloc de bois scié dans un gros tronc, et sur lequel la cuisinière hache sa viande, ses herbes, etc. On entend souvent dire de quelqu'un qui a le sommeil lourd : « O dort c'ment eùn plòt. » - (14) |
| plot, subst. masculin : billot pour couper le bois. Au figuré, c'est un terme péjoratif qualifiant une personne empâtée et lente, malhabile. - (54) |
| plot. Billot de bois. - (03) |
| plot. Gros billot en bois sur lequel on peut s'asseoir. Plote, bloc sur lequel les cuisinières hachent les viandes. On appelait plote, au moyen-âge, le tronc a offrandes placé dans une église. Dans le martyrologe de Notre-Dame de Beaune, ce mot est latinisé en plota. - (13) |
| plot. s. m. Palet. (Uugny). - (10) |
| plot. s. m. Piège à rats. (Guillon). - (10) |
| plot. s. m. Sellette faite d'un petit tronc de bois, d'un billot monté sur trois pieds. (Arcy-sur-Cure). – Voyez plout. - (10) |
| plot. s. m. Un peu ; du latin paululum. (Argenteuil, Etivey). - (10) |
| plot. s. m., pièce de bois pour fendre les bûches. - (40) |
| plote (n.f.) : bloc de bois dont on se sert pour fendre ou couper le bois - (50) |
| p'lote (na) : pelote - (57) |
| plote : pelote - (43) |
| plote : grosse bûche ronde pour fendre le bois - (39) |
| plote, s. f. bloc de bois, ordinairement de hêtre, dont on se sert dans les villes voisines pour hacher les herbes ou les viandes. - (08) |
| plote, s. f., pelote, tas, amas de diverses choses. N'est pas le féminin de plot. - (14) |
| plotège : partie du chariot sur l'essieu (train avant ou arrière) - (48) |
| plotège : (plotèj' - subst. f.) grosse traverse massive de bois, qui supporte le plateau du char et reçoit l'essieu. Il y a donc deux plotèj' : un à l’avant, et un à l'arrière. Le plotèj' est massif, ou composé de madriers solidement assemblés. - (45) |
| plotet : s. m., brique épaisse et étroite. - (20) |
| p'loton (on) : peloton - (57) |
| ploton : peloton - (43) |
| plotte : billot. Pour découper la viande. Voir : racleûres. - (62) |
| plotte : le plot à 3 pattes, le billot - (46) |
| plotte : table à trois pieds faite d'une souche d'arbre en général. - (31) |
| p'lotte d'aigu'illes : porte-aiguille - (57) |
| plotte, n.f. pièce de bois sur laquelle on débite les viandes. - (65) |
| plotte, s. f., pièce de bois pour débiter les viandes. - (40) |
| plou. n. m. - Billot en bois, à trois pieds. Ce mot, d'origine incertaine, est la déformation de plot, employé au XIVe siècle pour indiquer un billot en forme de tronc d'arbre. - (42) |
| plougnat. s. m. Grossier, lourdaud. - (10) |
| ploure : pelure - (43) |
| ploûsse (na) - plâtres (des) : prunelle (fruit du prunellier) - (57) |
| ploûssi (on) - épeune naire (n’) : prunellier - (57) |
| plout. (Fém. Ploute). Habitant de la campagne. Ce mot désigne plus particulièrement le cultivateur. Il a un sens plutôt péjoratif. - (49) |
| plout. s. m. Tronc de chêne ou d'orme monté sur trois pieds, qui sert pour hacher et couper la viande dans les cuisines. - (10) |
| ploute. s. f. Berge de lavoir, poutrelle. (Vallée d'Aillant). - (10) |
| pluce (nom masculin) : râteau à foin. - (47) |
| p'luche (na) : peluche - (57) |
| pluche, plusse(n.f.) râteau à foin - (50) |
| pluche. n. f. - Épluchure. - (42) |
| plucher : v. a., éplucher. - (20) |
| plucher, pleucher. v. - Éplucher : « Te vas m'plucher les truffes pou' c' soué ! T'iras jouer aprés. » Plucher est une altération de peluchier, signifiant d'une part éplucher, nettoyer, d'autre part lisser le poil, caresser... - (42) |
| plùcher, v. trans., éplucher. - (14) |
| plùchons, s. m., épluchures, rognures. - (14) |
| pluir, « L » pleuvoir, pluere. - (04) |
| plumard, plumet. Ces mots désignent à la fois un plumet et un plumeau. - (49) |
| plumard. Lit. (Populaire). - (49) |
| plumas, subst. masculin : aile d'oie ou d'autre volaille qui sert à dépoussiérer les meubles. Au sens figuré, ce mot peut aussi désigner les bras. - (54) |
| plume-pattes. Propre à rien, maladroit, imbécile. On dit aussi plume-treuffe dans le même sens. Voyez treuffe. - (12) |
| plumer, pieumer. Mots employés couramment non seulement pour plumer mais pour peler. - (49) |
| plumer, v. éplucher les pommes de terre. - (65) |
| plumer, verbe transitif : éplucher. - (54) |
| plungeon : petit tas de foin - (48) |
| plurer, v. tr., peler, ôter la pelure d'un fruit. - (14) |
| plus (Au) : loc. adv. Au plus on l'appelle, au plus il se sauve. Au plus on a, au moins on dépense. Voir moins. - (20) |
| plusiœurs : adj. et pron. indéf. pl. Plusieurs. - (53) |
| plusse (n. f.) : pellicule qui se forme à la surface du lait bouilli - (64) |
| pluviner : v. n., vx fr. ploviner, bruiner. - (20) |
| plyouton : s. m. plot de bois qui se mettait au bout de la table et sur lequel on mettait le pain. - (21) |
| p'nâ : pourri (punais en parlant d'un œuf) - (46) |
| p'nâ : se dit d'un œuf couvé non éclos, qui sent mauvais comme une punaise, œuf punais. - (52) |
| p'na : œuf couvé non éclos, qui sent mauvais comme une punaise, œuf punais. - (33) |
| p'nâ : n. m. Œuf couvé non éclos qui sent mauvais. - (53) |
| p'nâ, adj. punais. - (38) |
| pnâ, pnâze, punais, punaise. - (16) |
| pnaï, pnâ-ye, s.f. punaise. - (38) |
| p'naille : n. f. Punaise. - (53) |
| p'naille, punaise - (36) |
| pnas (adj.m.) : pourri en parlant d'un oeuf - (50) |
| p'nâs : punais - (48) |
| p'nê : panier. - (29) |
| pné, panier ; pné porteû, grand panier à vendange. - (16) |
| pné, pené adj. Puant, punais, pourri. - (63) |
| p'né. Punais. Fig. Vaniteux : « c h'tit p'né ». - (49) |
| p'nége. Punaise. - (49) |
| pnèle, sf. prunelle. - (17) |
| pnelö, sm. prunellier. - (17) |
| pneu, adj. penaud. - (38) |
| p'neu, euse, adj. penaud, qui a de la tristesse, de l'inquiétude, de la mortification. - (08) |
| pnin : panier. (PLS. T II) - D - (25) |
| p'nin, panier. - (26) |
| p'nné, penné, panné (du latin pannus, pan). s. m. Le pan de derrière d'une chemise. - (10) |
| pnö, sm. panier. - (17) |
| pnujeau : hotte pour remonter la terre dans les vignes, de pari-ujeau : panier-oiseau, parce que le dessus de la hotte est au-dessus de la tête ou parce que le porteur semble avoir des ailes. (C. T IV) - S&L - (25) |
| pô : piquet pour clôture en fil barbelé. A - B - (41) |
| pô - peur. - I ai grand pô qu'à ne réussisse pas. – C'â in gâ que n'é diére pô, ailé. - (18) |
| po - s'emploie en différentes formes, comme par exemple – Quand en vend en beille tôjeur quique chose po dessus. – Al ant passai po derré lai voiture. - (18) |
| pö (ō), sf. peur. - (17) |
| pô : (nm) piquet - (35) |
| po : Peu. « I s'en est po falu ». « Po d'aide fa grand bin ». - (19) |
| pô : peur. - (32) |
| pô : pieu, piquet - (43) |
| pô : pieu, piquet - (48) |
| pô : Pou. « St'enfant a des pôs ». Au figuré en parlant de quelqu'un qui fait plus d'embarras qu'il ne convient on dit : « O se drache c 'ment in pô su eune gâle » : il se carre comme un pou sur une gale. - (19) |
| pô : un pieu de clôture de champ. - (33) |
| po ou por - par, à travers. - Al ant passai po le bô, pour ailai ai Clombé. - I les ai laiché ailai to po les champs. – Vo les viez quemant qu'à corrant to par les rues. - On peut voir Por. - (18) |
| po : (pô - subst. f.) peur. Y é été œn' de sé: pô ! "j'ai eu une de ces frayeurs !". - (45) |
| pô : 1 n. m. Gros bâton. - 2 n. m. Pieu de clôture en bois. - 3 n. m. Peur. - (53) |
| pô : poteau, piquet - (39) |
| po(u) d'bô : tique - (48) |
| pö, adv. pis. Tant pö. De pö en pö. C’a bé pö. Qqf. : bé pu pire. Voir pè. - (17) |
| pô, peu : pour (aussi peur) - (50) |
| po, peur. - (05) |
| po, prép. par (dans les divers sens du français). - (17) |
| po, prép. pour. « Je pars po Montmoyen po Saint-Broing», pour Montmoyen par Saint-Broing. Po man que, pour lorsque. Voir man. - (17) |
| pô, prép., par, et aussi : pour. N'est pas exclusivement employé, Por intervient devant une voyelle. C'est affaire d'oreille. - (14) |
| po, sm. poil. - (17) |
| pö, sm. pot. - (17) |
| po. Peur. - (03) |
| po. Pieu. - (49) |
| po. Pour ; on dit aussi por, mais avec cette différence que po ne se met guère que devant les consonnes, et por que devant les voyelles : Ran que po vai, rien que pour voir ; ran que por an tâtai, rien que pour en tâter… - (01) |
| po. Quand ce mot signifie peur, on le prononce pôë, et ce mot monosyllabe est alors très long ; mais quand il signifie pot, il est très bref, et se prononce simplement pô sans trainer. - (01) |
| poçan adv. Pour ça, comme ça. - (63) |
| pôce - pouce. - Voyez Peuce, Peuçot. - (18) |
| poche (ō), sf. cuillère à soupe, louche. - (17) |
| pôche : la pêche - (46) |
| pôche : louche à potage. - (66) |
| pôche, n.f. louche à potage. - (65) |
| pôche, pêche de poisson. - (05) |
| poche, poce : s. f., mamelle. - (20) |
| pôche, pôchon : n. f. Louche. - (53) |
| pôche, s. f., pêche, action de pêcher, et poisson qu'on a pris : « Eh ben! mon gas, la pôche á-t-éle boune ? » - (14) |
| poche, s.f. louche ; marmite large plate à trois pieds sans couvercle pour faire cuire les gaudes. - (38) |
| pòche. Pêche, piscatio ; c'est aussi une cuiller à pot. - (01) |
| poche. Pêche. On a dit autrefois poische. Nous disons pôcher pour pêcher; pôchou pour pêcheur, et pôchouse pour matelote au vin blanc. - (03) |
| pôchée : n. f. Louchée. - (53) |
| pochener (verbe) : bouchonner un animal. - (47) |
| pôchener, v. a. bouchonner un animal avec un « pôchon » ou poignée de paille. le cavalier « pôchonne » son cheval ; le bouvier « pochonne » ses bœufs lorsqu'ils sont couverts de sueur. - (08) |
| pochenot, pouchenot. s. m. Un peu. (Saint- Brancher). - (10) |
| pocher, v. a. battre, frapper. - (08) |
| pocher, v. tr., pécher : « J'm'en vas au Doubs, pôcher la friteùre pou le dîner. » - (14) |
| pôcherôts, rats ; lo.c, rats pêcheurs ; rats d'eau, qui font concurrence à l'homme pour la chasse au poisson. (V. Pôchoù.) - (14) |
| pochetée. Pleine poche. Fig. « En avoir une pochetée » : c'est être simple d'esprit. (Argot). - (49) |
| pocheter : emporter un morceau de pain dans sa poche. VI, p. 68-26 - (23) |
| pôcheter, v. a. mettre en poche ou en sac. - (08) |
| pôcheton, s. m. petite poche, petit sac. - (08) |
| pocheton. n. m. - Petite poche sur une veste. - (42) |
| pocheton. s. m. Petite poche, gousset. - (10) |
| pôchî : pêcher. Dans le sens : tenter de prendre des poissons. - (62) |
| pòchi, v. a. se dit d'un contenu dont on laisse échapper une partie ; se dit aussi lorsqu'on laisse échapper les mailles d'un bas, d'un tricot. - (24) |
| pochon (ŏ), sm. poisson. - (17) |
| pochon : louche - (44) |
| pochon : louche (la). - (62) |
| pôchon : louche. - (29) |
| pôchon : mot masculin désignant la louche - (46) |
| pochon : s. f. louche. Dérivé de poche. - (21) |
| pochon(ö), sm. cuillère à soupe. - (17) |
| pôchon, s. m. poignée de paille ou de foin, d'étoupes, de chiffons, etc. Le « pochon » de paille sert à bouchonner, à étriller un cheval ou un bœuf. - (08) |
| pòchon, s. m., cuiller à pot, louche pour servir la soupe : « L'goinfe ! ô mainge ses gaudes à plein pòchon. » - (14) |
| pochon, s. m., instrument à long manche pour puiser l'eau dans un seau, bassin. - (40) |
| pòchon, s. m., tache, pâté d'encre : « Que p'tiot saligot ! Su toutes ses pages ô n'fait qu'des pòchons. » - (14) |
| pochon, s.m. grosse louche. - (38) |
| pochon. Grosse cuiller ronde pour servir la soupe. Dans le nord de la France on dit une « louche » . - (13) |
| pochonnier : s. m., individu qui tient le pochon, autrement dit qui se mêle de cuisine. - (20) |
| pochot : gros sac, fourre – tout. - (56) |
| pôchotte : une cuillère en bois, une petite louche - (46) |
| pôchou : pêcheur. Toujours dans le sens « halieutique » : la pêche c’est la pôche. - (62) |
| pôchou : un pêcheur - (46) |
| pôchou, pêcheur. - (05) |
| pôchoù, s. m., pêcheur. Aux bords de nos deux rivières, chacun l'est. = - (14) |
| pòchoule, s. f. ovaire d'une poule pondeuse sorti par accident. Par analogie intestins d'un rat, d'un crapaud écrasé. - (24) |
| pochouse Mets national, plat de poisson voisin de la meurette, mais qui est cependant autre chose. La terre classique de la pochouse est Saint-Jean-de-Losne. Etym. pocher dans le deuxième sens donne par Littré. - (12) |
| pôchouse, matelotte. - (05) |
| pôchouse, s. f., ce mot n'est pas le féminin de pôchoù. Il désigne une matelote particulière assaisonnée au vin blanc. Cette manière d'accommoder le poisson est spéciale aux bords de la Saône. Verdun est si renommé pour la confection de ce mets, — son mets national, — que des gourmets viennent de Beaune, par groupes, par bandes, pour s'en régaler. Le goût prononcé de nos voisins rend, par périodes, le poisson relativement cher dans le petit pays. - (14) |
| poch'tit, pouch'tit. Pauvre petit. Terme employé pour plaindre un enfant. - (49) |
| poçon : s. m., tetin. - (20) |
| pocone. adj. Sale. (Chigy). - (10) |
| po-devé. Par devers, vers, environ ; po devé le tam, vers, environ le temps. - (01) |
| podiö, sm. mendiant [pour Dieu]. Guenilleux. Vaurien. - (17) |
| pôdre, s. f., poudre, et tout ce qui est pulvérisé. - (14) |
| pôdre, v. pouvoir (vieux). - (38) |
| pod'zin : par-dessous. (PLS. T II) - D - (25) |
| pœ, adv. plus. - (22) |
| poè, poil, petite quantité (ex, je n'ai qu'un poè de beurre). - (27) |
| pœcque-du-jou, s. f. pointe du jour, moment où le jour «pique ». - (22) |
| pœje, s. f. poix. Verbe pœji, coller, poisser (vieux français). - (24) |
| pœje, s. f. poix. Verbe : pœji, coller, poisser. - (22) |
| pœjon, s. m. graine de bardane qui a la particularité de s'attacher facilement aux vêtements (synonyme de gretœyes) ; petite boulette de toute matière molle et collante. - (24) |
| pœjon, s. m. graine de bardane qui a la particularité de s'attacher facilement aux vêtements ; petite boulette de toute matière molle et collante. - (22) |
| poêle à quate trous n.m. Cuisinière à bois à quatre marmites. - (63) |
| poelée : poêlée : repas de fête, en particulier le matin suivant la nuit de Noces, servi aux jeunes mariés dans un pot de chambre (délicat ! tout ça…) et repas de fin de battage (qui est aussi une fête). Ex : "J’vons aller pourter la pouélée à ta Seûr d’boune heue a c’matin !" - (58) |
| poêlier (prononcez poêhier). s. m. Châssis auquel on suspend les poêles, la batterie de cuisine. - (10) |
| pœllion*, s. m. chaumes du foin après la fenaison. - (22) |
| pœlliouchi, v. a. arracher avec patience des mauvaises herbes très petites. On dit aussi pœllyi. - (22) |
| pœr ou pre, prép. pour. - (22) |
| pœrçi, v. a. percer. - (24) |
| poère : poire - (51) |
| poère à bon djeu (senale) : fruit de l'aubépine - (51) |
| poèri : poirier - (51) |
| poéron : petite poire - (44) |
| poèron : petite poire (en général à cuire, et non greffé) - (51) |
| pœrtu, s. m. trou. Verbe : pœrteusi, percer de trous. - (22) |
| pœssi, v. a. percer. - (22) |
| pœtfener, v. a. gâcher, abîmer ; pœtfener ses habits. - (24) |
| pœtrœ, s. m. croupe, train de derrière (langage plaisant) : quel pœtrœ ! - (22) |
| poeu, s. f. peur. - (22) |
| poeudre, s. f. poudre. Poeudron, poudre fine. Poeudrœlli, saupoudrer. - (22) |
| poeus, s. f. pl. bouillie de maïs ou de froment. Verbe : epoeuté, tourner en bouillie. - (22) |
| poeussàyoeu, adj. poussiéreux. - (22) |
| poeussire, s. f. poussière. - (22) |
| pôfai. Pôfai de rire, éclater de rire en faisant des efforts pour se contraindre... - (02) |
| pôfai. : Eclater de rire en faisant des efforts pour se contraindre. - (06) |
| pofe. Terme burlesque, dont on use dans le même sens que de pouë, de poupouê, de zest, de tarare, de tarare pon pon, etc., pour marquer qu'une chose n'a point eu ou n'aura point de succès. Pouf ou poufe exprime le bruit que fait l'amorce qui prendsans que l'arme tire, ou le bruit que ferait un sac de blé tombant d'en haut sur le pavé, ce qui se fait sans aucune lésion ni du pavé ni du sac. - (01) |
| pofer : (pôfè - v. intr.) haleter, être hors d'haleine, être complètement essoufflé. - (45) |
| pòfer, v. intr., pouffer, éclater de rire en s'efforçant de se contraindre : « Ol étot si drôle ; ô nous f’sòt pòfer. » - (14) |
| poffai - tousser, quelquefois étouffer. - I ai in rhume qui ne fâ que poffai ! – Pendant que le Louis chantot, tote les feilles poffaint de rire. - (18) |
| poffer : être essoufflé - (44) |
| pofouler (v.t.) : fouler, écraser avec les pieds - (50) |
| pôge : Pouce. « Ol y a pris ave les quat 'das peû le pôge » : il l'a accepté sans se faire prier. - (19) |
| poge. Pouce. - (03) |
| pôgeri : Poucier. « Qu'est dan que te t'es fait que t'as in pogeri ? » : qu'est-ce que tu t'es fait que tu portes un poucier ? - (19) |
| pognan : Petit pain que l'on fait avec le « raclian de la mâe », avec ce que l'on racle sur les parois de la maie après que l'on a fait les pains. « In pognan greus c 'ment le poing » : un « pognan » gros comme le poing. - (19) |
| pogne - peine, et main robuste qui sert fort. - En é de lai pogne, ailai, pour gâgnai sai pôre vie ! - A nos é fait bein de lai pogne ce malheureux enfant lai. - Al é ine pogne ai vos câssai les doigts ! - (18) |
| pogne : force du poignet, avoir de la pogne - (51) |
| pogne : main - (44) |
| pogne : main - (48) |
| pogne : poigne, poignet, force physique ou morale (« ai l’aivot d’lai pogne, aivaque sâs gaimins ! ») - (37) |
| pogné : poignée de chanvre - (43) |
| pogne n.f. Poigne. - (63) |
| pogne : s. f., pognon, pougnon : s. m., petit pain fait avec le reste et les raclures de la pâte d'une fournée. - (20) |
| pogne, poigne ; pognie, poignie, ce que la main peut tenir, en se fermant. - (16) |
| pognée : poignée - (51) |
| pognée : Poignée. « Eune pognée de mains ». - (19) |
| pognée. Poignée. - (49) |
| pognet : poignet - (51) |
| pognie (è nasal), sf. poignée. - (17) |
| pognie ou pognin – poignée. – Mets du son ine bonne pognie dans les treufes pour lai vache. - Le parrain a jeto des draigies ai lai grosse pognin to po les rues. - (18) |
| pognie, pougnie, pouégnie. n. f. - Poignée, de l'ancien français puignie, employé au XIIe siècle. - (42) |
| pognie. Poignée. Plusieurs prononcent encore empogner pour empoigner… - (01) |
| pognon : petit pain rond. A - B - (41) |
| pognon : petit pain rond - (34) |
| pognon : petit pain rond - (35) |
| pognon : petit pain rond fait avec le reste de la pâte à pain et réservé généralement aux enfants - (43) |
| pognon : petite boule de pain - (51) |
| pognon : s. m. petite brioche faite d'une poignée de pâte. - (21) |
| pògnon, s. m. petit pain, diminutif d'épogne. - (24) |
| pognon. Forte somme. On dit : « avoir du pognon » pour avoir de l'argent. - (49) |
| pohier, s. m. ce terme n'est usité que dans la locution : « enlever le pohier », laquelle répond à mettre la clef sous la porte, c’est à dire faire faillite ou banqueroute - (08) |
| poi - poil, petit morceau. - Vos chevaux al an le poi fin. - En ceute saison qui le poi des lapins ne teint pâ ; en vend les paies pou ran. - Al en ant tré bein, et à n'en beilleraint pâ in poi. - (18) |
| poi : poil. - (29) |
| poi : Poil. « In poi de barbe ». « Du poi folot » : du poil follet et du duvet en parlant des oiseaux. « In poi de treuquis » : un brin de maïs. « Du poi de treuquis» : des stigmates de maïs « Du poi de chin » : nom que l'on donne à une herbe courte et très fine difficile à faucher parce-qu'elle se couche sous la lame de la faux. (graminée). - (19) |
| poi de chien, s.m, chiendent. - (38) |
| poî folot n.m. Duvet, première barbe. - (63) |
| poi foulot : duvet première barbe - (44) |
| poi(l) poulot, subst. masculin : duvet juvénile, poil follet. - (54) |
| poi, poil ; on dit aussi : poi d'èrbe, poi d'serman, pour : brin d'herbe, sarment coupé et tiré lë poi, pour : tirer les cheveux. - (16) |
| poi, poil, brin d'herbe. - (05) |
| poi, s. m., pois, petits pois. D'un dormeur dont l'haleine bouillonne, on dit qu'il « sôfle les pois ». - (14) |
| poi, s.m. poil ; poi de paille : fétu de paille. - (38) |
| poi. Pais, pax. Nos anciens ont ainsi dit je fois pour je fais… - (01) |
| poi. Poil, brin d'herbe, chose de peu d'importance. - (03) |
| poi. s. m., poil, cheveu, brin d'herbe, menue chose : « O n'vout ran fâre du tout ; ôl a ein fameux poi dans la main. » - (14) |
| poi. : (Dial. ), peu. - Se déclinait comme le subst. latin pocus. « Alcune poie chose.» (Job.) On écrivait de même poi signitiant pesanteur, et poi signifiant légume. - Ça lai fieu dé poi répondait à : c'est la crême des hommes. - (06) |
| poiche (n.f.) : louche, grande cuiller - (50) |
| poiche, s. f. poche, grande cuiller de forme arrondie avec laquelle on verse le bouillon dans les écuelles. « poice. » - (08) |
| poichenot. s. m. Un peu. (Avallonnais). Voyez pochenot. - (10) |
| poicher : (pouâ:ché - v. trans.) pêcher. - (45) |
| poicre, adj. plein de, garni de. - (38) |
| poidri : perdrix. - (29) |
| poi-folo : (tr. lit. : poil fou) duvet , première barbe peu fournie d'adolescent. A - B - (41) |
| poi-foulòt, s. m., poil-follet, duvet. Se dit aussi bien de la jeune barbe qui pousse, que des plumes des jeunes oiseaux et de la première toison des moutons. - (14) |
| poige, poisse. Poix, substance résineuse. - (49) |
| poige, poix. - (05) |
| poigèn, celui dont les cheveux sont en désordre. - (16) |
| poigin - enfant à jolie chevelure, ou gentiment négligée. - Ces poigin lai ordinairement c'â malin. - C'â in joli petiot poigin. - (18) |
| poigneu : s. f. poignée. - (21) |
| poignie (ou pougnèe) : poignée. - (52) |
| poignie, pouégnèe : poignée. - (33) |
| poignoier. : (Du latin pugnare), usurper. (Cout. de Châtillon, 1371.) - (06) |
| poi-gollu : pois mange-tout - (43) |
| poi-golu : pois mangetout. A - B - (41) |
| poijau : (nm) vesces, mauvaises herbes - (35) |
| poil de bibi, exp. duvet des adolescents qui ne se rasent pas encore. - (65) |
| poil foulot, n.m.pl. duvet qui précède la barbe chez les adolescents. - (65) |
| poil, peu. - (04) |
| poileux, subst. masculin : garde de l'Usine. - (54) |
| poilière. s. f. Endroit du jardin ou sont semés, où poussent les petits pois. (Rogny). - (10) |
| pôille - pou, injures. - C't enfant lai â dévorai des pôilles. - I n'en reveins pâ ; â m'é chantai pôille ! - (18) |
| pôillon - poison. Chercher par Poyon. - (18) |
| poillotè : ramasser les petits oignons ou de l'herbe clairsemée - (46) |
| poiloù, adj., poilu, velu. Se dit de l'homme, de l'animal et de la plante. - (14) |
| poiloux, -ouse adj. Poilu, -ue. - (63) |
| poiloux, poilouse : adj., poileux, poileuse ; poilu, poiluse. - (20) |
| poiloux: Poilu. « Ol est poilou c'ment eun ours ». - (19) |
| poiluse adj. Poilue. - (63) |
| poiluse : adj. f., poilue. - (20) |
| poin. Point, particule négative ; c'est aussi ou point, punctum, ou poing, pugnus, ou point, pungit, etc. : Ai poin, bén ai poin, à point, à propos, bien à propos. - (01) |
| poinchon : un peu. - (09) |
| poinçon (dans toute la Bourg.). - Tonneau. Ce mot est français, d'après Littré ; il n'est cependant guère usité qu'en Bourgogne. L'étymologie en paraît inconnue à Littré ; elle serait due, suivant Bigarne, à l'obligation à laquelle étaient astreints autrefois les tonneliers de faire marquer ou poinçonner les fûts aux armes de la ville avant de les mettre en vente. - (15) |
| poinçon : (pouin:son - subst. m.) sorte de tonneau sur lequel on battait le seigle à la main, pour obtenir du glui. - (45) |
| poinçon : fût, futaille (sauf erreur : de 220 litres) Ex : "L'an-née a été boune, j'ons fait trois poinçons d'vin." - (58) |
| poinçon : voir tonneau. - (20) |
| poinçon. Tonneau à mettre le vin. C'était la mesure locale pour les liquides 228 litres. Avant de livrer ces fûts, les tonneliers devaient les faire poinçonner aux armes de la ville. (V. queue). - (13) |
| poine, peine. - (04) |
| poine, poingne. s. f. Peine, chagrin. (Cravant, Snvigny-en-Terre-Plaine). - (10) |
| poine, pouéne (n.f.) : peine - (50) |
| poine. Peine, vieux mot. - (03) |
| poiner, peiner - (36) |
| poing : s. m. Faire le poing dans sa poche, maîtriser sa colère parce qu'on y est forcé. - (20) |
| poingn', s. m. poing, la main fermée. - (08) |
| poingne, poine (n.f.) : peine, fatigue (aussi poène) - (50) |
| poingne, s. f. peine, fatigue, travail, effort, lutte. Quand le paysan vous dit tristement : « i n'é ran, ran, qu' mai poure poingn' », cela veut dire qu'il ne possède rien que ses deux bras pour travailler. - (08) |
| poingner, v. n. peiner, avoir de la peine, de la fatigue, travailler avec effort, souffrir : « i poingne tô mon sô en pourtan ç'lai », je fatigue tout mon soul en portant cela. - (08) |
| poingnie, s. f. poignée, ce qu'on peut tenir dans sa main. - (08) |
| poîn-ne (na) : peine - (57) |
| poin-ne : peine - (43) |
| poin-ne, peine. - (05) |
| poin-ne, s.f. peine. - (38) |
| poîn-ner : peiner - (57) |
| poinsériot (n. m.) : coquelicot - (64) |
| point (à), loc. à l'abri : il fait froid, il pleut, nous restons à point. - (24) |
| point : aucun - (57) |
| point carré : s. m., ancienne mesure de surface en général, valant 0 millimètre carré 0349, c'est-à-dire presque 3 centièmes 1/2 de millimètre carré. - (20) |
| point cube : s. m., ancienne mesure de volume en général qui, en réalité, n'existait pas. mais aurait valu 0 mètre cube 000000000006539, c'est-à-dire un peu plus de 6 millièmes 1/2 de millimètre cube. - (20) |
| point de temps. Très rapidement, sans délai, en un clin d'œil. - (12) |
| point de : loc, pas de, marque l'Indétermination soit dans l'espace, soit dans le temps.Où donc qu' te vas ? — Moi, à point d'endroit. - (20) |
| point d'endroit. Nulle part. - (12) |
| point : s. m., ancienne mesure de longueur en général, qui était le 1/1728 du pied, le 1/12 de la ligne, et valait 0 m. 000187. - (20) |
| point-de-côté : s. m., personne lancinante, tenace, dont on ne peut se débarrasser. - (20) |
| pointe (De) : loc adv., debout, sur son séant. Viens donc m'aîder à mett’ c't' échelle de pointe. J'ai été toute la nuit de pointe dans mon lit. - (20) |
| pointe (de), loc. debout. - (22) |
| pointe (éte en), loc. être debout : « chardez-vô, vô s'rez chi bin qu'en pointe », asseyez-vous, vous serez aussi bien que debout. - (08) |
| pointe n.f. Premier tissu, de forme triangulaire, directement en contact avec la peau du bébé, par dessus lequel on fixait le drapiau recouvert à son tour par le molleton. - (63) |
| pointe. s. f. Cierge. (Soucj). - (10) |
| pointer : v, n., poindre. J'ai vu pointer le jour. - (20) |
| pointer : v. a., au jeu de boules, tâcher d'arriver le plus près possible du cochonnet. - (20) |
| pointer, v. intr., poindre. Se dit du jour, soleil levant : « O s'leùve à bonne heure, pou vouér pointer l'jòr. » - (14) |
| pointreau, pointrail, paintreau : vx fr., poitrail. Voir pressoir. - (20) |
| pointuse : adj. f., pointue. - (20) |
| pointuse, adj. f., pointue. - (14) |
| pointye (de), loc. debout : ne rester pas ainsi de pointye, asseyez-vous. - (24) |
| poiquot : fleur de la digitale. - (33) |
| poirai, paroi, mur. - (05) |
| poiraï, s.m. poirier. - (38) |
| poiran : Petite poire aigrelette « Du boire de poirans » : boisson faite avec de petites poires sur lesquelles on passe de l'eau. - (19) |
| poiraÿ, s. m., poirier. - (40) |
| poiré : Poirier, pirus communis. « Manter su son poiré » : se mettre en colère. - (19) |
| poire à Bon Dieu : (nf) fruit de l'aubépine - (35) |
| poire à bon Dieu : cenelle. Fruit de « l’épeûne blanche » : l’aubépine. - (62) |
| poire à bon dieu, n.f. fruit de l'aubépine. - (65) |
| poire à bon dieu, s. f., cenelle. - (40) |
| poiré, n. masc ; poirier. - (07) |
| poiré, s. m. poirier. « poihé » - (08) |
| poiré, s. m., muraille. - (14) |
| poiré. Muraille ; de paries dont on a fait paroi. - (03) |
| poiré. Payeras, payera. - (01) |
| poire. Poirier. - (49) |
| poîre-à-bon-dieu n.f. Nom populaire des fruits de l'aubépine, les cenelles. - (63) |
| poire-a-bon-dieu, s. f., fruit de l'aubépine. - (11) |
| poirer pieûtot : poirier « plotot » (poires « dures ») - (37) |
| poirette (vx fr.), poirotte : s. f., petite poire. - (20) |
| poîrî n.m. Poirier. - (63) |
| poirillat. s. m. Petit poirier sauvage. (Etivey). - (10) |
| poiron : s. m., poire sauvage. - (20) |
| poîron, pouèron n.m. Poire sauvage. - (63) |
| poironé : Poirier sauvage donnant les poirans. - (19) |
| poironnier : s. m., poirier sauvage. Monter sur son poironnier, monter sur ses grands chevaux, s'emporter. - (20) |
| poirotcher. n. m. - Poirier sauvage. (Mézilles, selon H. Chéry) - (42) |
| poirotte. n. f. - Poire sauvage. - (42) |
| poiru, adj. peureux, poltron. - (08) |
| pois : haricot sec. Le mot « haricot » ne désigne que le haricot vert. - (52) |
| pois : haricots (ne pas confondre avec petits pois). III, p. 31-u - (23) |
| pois : haricot sec (seul le haricot vert se dit haricot). - (33) |
| pois de chien : gros champignon vénéneux - (60) |
| pois follot. Duvet, premiers poils. - (49) |
| pois gôlu : (nm) pois gourmand - (35) |
| pois golus n.m. Pois mange-tout. On dit aussi pâs golus. - (63) |
| pois : (prononcer : pouâ) haricot de toutes espèces : blanc ou flageolet. Ex : "Ène tranche de jambon du salouée avec des pois, n'a pas mieux !" - (58) |
| pois. Brin : « un pois d'herbe ». Fig. Un peu. - (49) |
| poisan : Poisson. Poisan est féminin : « De la poisan ». Au figuré : « Eune poisan » : une méchante femme. - (19) |
| pois-chevaux ou chevots, emmêlé : pour parler de l'herbe ; nom compris comme pois à chevaux. Cette herbe ost tot ai pois-chevaux. - (07) |
| poisé, peser. On disait en vieux français poïser au lieu de peser. (Lac.) En latin pondus, d'où le mot poids, qui a fait lui-même le verbe poiser. - (02) |
| poiser, peser, empoissé, oppressé. - (04) |
| poiser, pouéser, poiger. v. - S'enfoncer, s'embourber. Le verbe poiser serait l'origine du mot Puisaye. - (42) |
| poiser. v. n. Prendre l’eau dans ses chaussures en marchant. (Villiers-Saint-Benoît). - (10) |
| poison n.f. et adj. Poison, empoisonné, vénéneux, toxique. - (63) |
| poison : s. f. De la poison. Au fig., femme méchante. - (20) |
| poison, et pôïon, s. f., poison : « Qu'é-ce qu'y é que c'qui ? Jéte-s-y vite ; y é d’la poison. » - (14) |
| poison, et pouéson, adj., épithète injurieuse donnée à une méchante femme : « C'te mauvàs'-là, n'li parle point ; y ét eùne vrâ poison. » - (14) |
| poison, n.f. poison mais de genre féminin (l'arsenic est une poison dangereuse). - (65) |
| poison. Féminin, comme autrefois. - (03) |
| poison. s. f. Se dit d'une femme, d'une fille méchante, à langue venimeuse. - (10) |
| poisonner : v. a., empoisonner. - (20) |
| poisse, adj., poisseux, gluant : « Ol a tant patrouillé ses peùrnes, qu'ôl en a les mains toutes poisses. » - (14) |
| poissiau, s. m. echalas. Poisselé, planter des échalas. - (22) |
| poitre. Paître. - (01) |
| poitrinaire. Tuberculeux. - (49) |
| poitron, potron. n. m. - Grosse prune bleue. - (42) |
| poitron. s. m. Sorte de grosse prune. (Auxerre). - (10) |
| poitronnier, poitrounier, poitrougnier. n. m. – Prunier donnant des poitrons. - (42) |
| poitronnierl, poitrougnier. s. m. Sorte de prunier qui produit les poitrons. - (10) |
| poivre : Poivre. « I est feu c 'ment poivre». Cette locution n'a aucun rapport avec l'arôme du poivre, elle aurait pour origine les talents d'un clunysois nommé Poivre qui passait pour être très habile prestidigitateur. - « Chi du poivre » : distancer à la course, laisser en arrière. « Les gendarmes li ant coru (couru) après mâ ol les i a bin chi du poivre (ils n'ont pas pu l'atteindre) ». - (19) |
| poivrére : Poivrière. « Passe me dan la poivrère ». - (19) |
| poivrotte, s.f. poivrière. - (38) |
| poiyé, payer. - (16) |
| poiyeu : payer. - (29) |
| pojon, sm. poison. - (17) |
| pol : coq - (35) |
| pol, polot n.m. Coq, poulet. - (63) |
| pòlachi, v. n. desserrer, lâcher. - (24) |
| polachon : pantoufle - (44) |
| polacre : vigneron. (EDSEA. T II) - A - (25) |
| polai - pelé, dans le sens de chauve. - Vote chien al à to polai. - Le collier é to polai le chevau su le co. - (18) |
| polaille : volaille, poule. B - (41) |
| polaille : poule - (34) |
| polaille : poule - (35) |
| polaille : poule - (51) |
| polaille : volaille, poule - (43) |
| polaille n.f. Poule, volaille. - (63) |
| pòlaille, s. f. poule (du vieux français poulaille). Polailli, poulailler. - (24) |
| polaille. Poulaille. - (49) |
| polailli : poulailler - (35) |
| polailli : poulailler - (43) |
| polailli : poulailler - (51) |
| polailli n.m. Poulailler. - (63) |
| polain : poulain - (43) |
| polain : poulain - (51) |
| polais, s. m. arbre dont on a enlevé l'écorce, qui est pelé. - (08) |
| polât (faire son), être polâteux (se) : bouder, rester dans son coin. - (56) |
| polat : s. m. poulet. - (21) |
| polatte (n.f.) : petite pelle ; battoir des lavandières - (50) |
| polayer : pelleter - (43) |
| pôle (f), épi. - (26) |
| pôle : la pelle - (46) |
| polé : tondu à ras - (37) |
| pole n.f. Poule. - (63) |
| pole : (pôl’ - subst. f.) pelle - (45) |
| polé : (polè: - subst. m.) pelard, bois qu'on a dépouillé de son écorce pour faire du tan. - (45) |
| polè : 1 adj. et n. Chauve. - 2 v. t. Peler. - 3 v. t. Ruiner. - (53) |
| pôlé : dépoilé, déplumé - (39) |
| polé, adjectif qualificatif : tondu. - (54) |
| pôle, s. f. pelle. Diminutif : palœt’e, pelle â feu. - (22) |
| pôlée (la), repas copieux par lequel le cultivateur célèbre l'achèvement des oeuvres et auquel prennent part tous les ouvriers qui ont été associés à son labeur faire la pôlée, est la forme d'emploi de ce vocable. - (11) |
| pôlée on paulée. Fin de la récolte, de la moisson, de la vendange, fin d'un ouvrage. Mais paulée veut dire aussi le repas de réjouissance qu'on fait une fois la récolte terminée, et alors paulée est peut-être pour poêlée, contenu de la poêle, fricassée que l’on va manger, mets plus recherché que le menu quotidien. - (12) |
| pole-grasse n.f. Nom donné à la mâche que l'on appelle également dans la région, doucette, boursette, clairette, graissotte, levrette, pomâche, pommette. - (63) |
| poleilli : s. m. poulailler. - (21) |
| poler, époler, v. a. épiler, ôter le poil. Se dit principalement en parlant des animaux. un bœuf « polé », c’est à dire - (08) |
| poler, v. a. peler, enlever l'écorce d'un arbre. - (08) |
| pôler, v. tr., peler, arracher le poil : « Mon Diou ! à que c'qu'i r'sembe, d'avou son chapiau tout pôlé ! » - (14) |
| pôler, v., tondre à ras. - (40) |
| polet : petit poulet - (43) |
| polet : poulet - (51) |
| polle (aine) : (une) pelle - (37) |
| polle (n.f.) : pelle - (50) |
| polle : pelle (outil), vanne de retenue - (48) |
| pôlle : pelle et pôlleter pour pelleter… - (62) |
| polle : pelle. - (29) |
| polle : pelle. Pou remuer la terre la polle o utile : pour remuer la terre la pelle est utile. - (33) |
| polle : n. f. Pelle. - (53) |
| polle : pelle - (39) |
| polle, bonde : pelle, bonde, mécanisme à crémaillère que l’on lève afin de vidanger un étang artificiel pour « la » curer, pour « la » pêcher - (37) |
| polle, s. f. pelle. - (08) |
| poller, v. a. pelleter, se servir de la pelle. - (08) |
| polletée, s. f. pellée, pellerée, pelletée, le contenu d'une pelle. - (08) |
| polleter, v. a. pelleter. se dit de tous les travaux qui s'exécutent avec la pelle ; « polleter » l'argile, le sable, la terre, le grain, les pommes de terre, etc. - (08) |
| po'llot : Pou. Voir également à « pô ». - (19) |
| po'lloux : Pouilleux. « Des gueuriaux po 'lloux » : des mendiants pouilleux. - (19) |
| poloche (aine) : (une) dent d’adulte - (37) |
| polochon : s. m., traversin. - (20) |
| polote : (polot' - subst. f.) dent incisive. On les nomme "palettes", parce que ce sont les plus larges et les plus plates de toute la denture. A Magny-lès-Aubigny, on les nomme "pelles de four" (cf.Rouffiange, Le patois .. . de Magny-lès- Aubigny p. 422, § 1071 a). - (45) |
| polote, s.f. - palette pour battre le linge mouillé. - épaule de veau, de cochon. - (38) |
| polotte (aine) : (une) dent de lait - (37) |
| polotte : battoir à laver. (B. T IV) - S&L - (25) |
| polotte : incisive (litt. palette). - (32) |
| polotte : petite pelle - (48) |
| polotte, s. f. petite pelle. diminutif de polie = pelle. - (08) |
| polotte, s. f., épaule. - (40) |
| poltron, qui manque de bravoure et ne s'aventure pas... - (02) |
| polu, adj. poilu. Voir veulu. - (17) |
| pomache (d'la) - doucette (d'la) : mâche - (57) |
| pomâche (n.f.) : mâche, doucette - (50) |
| pomâche : mâche (la). Ou doucette. - (62) |
| pômache : Mâche, valerianella pubescens. Voir également « chauche boué ». - (19) |
| pomâche : valérianelle, potagère. - (21) |
| pomâche, mâche, valérianelle, bonne en salade. - (16) |
| pomache, n.f. mâche (salade). - (65) |
| pomâche, s. f. mâche, doucette, salade d'hiver. - (08) |
| pomâche, s. f., mâche, doucette, blanchette, « salade de chanoine ». - (14) |
| pôme, s. f., ballon pour jouer. - (40) |
| pome. Pomme. - (01) |
| pomeiller, v. tr., visiter des engins de pêche sans les enlever de l'eau... - (14) |
| pomin, pommier. - (26) |
| pommache : mâcher. - (31) |
| pommâche, mâche, doucette. - (05) |
| pommé : Pommier. « In pommé de rainettes ». - (19) |
| pomme de moisson. n. f. - Pomme précoce, bonne au moment la moisson vers la fin juillet. - (42) |
| pom-mé, poumé : n. m. Pommier. - (53) |
| pommé. Pommier. - (49) |
| pommer, pon'mer : pommier - (48) |
| pommi : pommier - (43) |
| pommi : pommier - (51) |
| pommî n.m. Pommier. - (63) |
| pommoté, s. m., pommier sauvage qui produit de petites pommes, connues sous le nom de pommottes. - (11) |
| pommotte, n.f. petite pomme sauvage. - (65) |
| pômon, s. m., poumon. - (14) |
| pomote : pomme sauvage. - (66) |
| pomper. Ce mot s'emploie avec le sens de faire une ponction. - (49) |
| pompiste : s. m., ouvrier en pompes. - (20) |
| ponais, s. m. linge usé, guenille, mauvais chiffon. - (08) |
| ponc, peine morale et physique. - (16) |
| ponce : appareil de ponte des volailles - (39) |
| poncelot. s. m. Petit pont consistant ordinairement en quelque madrier jeté sur un ruisseau. - (10) |
| poncenai : pousser en boxant, en bousculant. - (33) |
| ponç'ner, v, piquer, agacer avec un bâton. - (38) |
| ponçon : s. m., poinçon, tonneau. - (20) |
| ponçon, s.m. tonneau de 228 litres environ (poinçon). - (38) |
| pond’e ai parte (ailer) : (aller) pondre à perte : se dit des poules qui, délaissant le nid (pourtant garni du « gniau » incitateur préparé dedans), vont allègrement pondre à un endroit précis dans une haie. bien souvent, les œufs, s’ils ne sont pas découverts, sont perdus. toutefois, il est arrivé qu’un jour, la poule revienne un jour au poulailler suivie d’une dizaine de petits poulets tout « pioûnants ». - (37) |
| ponde : pondre - (48) |
| ponde : (pon:d' - v. trans.) pondre - (45) |
| pondre, v. n. abonder, foisonner. - (22) |
| pone : la peine - teum fè d'lè pone, tu me fais de la peine - ç'â pas lè pone, ce n'est pas la peine - (46) |
| pone. Peine, anciennement poine, comme roine pour reine, et poinard pour pénard… - (01) |
| poneau, s. m. sobriquet s'appliquant à un homme qui va lever les œufs dans une gelinière, qui s'occupe comme une femme des choses du ménage. - (08) |
| poner : v. a., poser. - (20) |
| poner, pouner, v. a. pondre. On prononce aussi « ponner » : nos poules viennent de « ponner. » au part, passé « ponu » ou « pounu. » une poule qui fait beaucoup d'œufs est une bonne « ponneuse » ou « pouneuse. » - (08) |
| pôner, v. tr., poser, mettre en place. - (14) |
| poneuse, pouneuse, s. f. pondeuse, femelle qui pond des oeufs. - (08) |
| ponfourche. n. f. - Fourche en bois, utilisée pour soutenir une branche. (F.P. Chapat, p.157) - (42) |
| ponger : v. a., éponger. - (20) |
| ponger, v. tr., éponger, enlever l'humidité avec une éponge. - (14) |
| pon'me : pomme - (48) |
| pon-me : pomme. - (52) |
| ponme : pomme. - (33) |
| pon-me : pomme - (39) |
| ponme, s. f. pomme. (voir : poume.) - (08) |
| ponmé, s. m. pommier. - (08) |
| ponmer (n.m.) : pommier - (50) |
| pon-mer : pommier - (39) |
| ponmotte (n.f.) : petite pomme sauvage - (50) |
| ponmotte, s. f. petite pomme sauvage. - (08) |
| ponne, sf. peine. - (17) |
| ponnu, pondu. - (04) |
| ponot. s. m. Homme qui s'occupe trop des détails du ménage, qui aime à faire de petits ouvrages de femme. C'est un synonyme de miton, de pondeux. - (10) |
| ponre, poner (v.t.) : pondre - (50) |
| ponse, ponte - (36) |
| ponse, s. f. ponte, action de pondre les œufs. - (08) |
| ponsson, s. f. tonneau (vieux français poinçon). - (24) |
| ponsson, s. m. tonneau. - (22) |
| pont (Mettre en) : loc, attacher deux à deux les sommets des ceps qui ont été préalablement accolés. - (20) |
| pont de l'Egalité : nom qu'on donne à Mâcon au pont de la rue Lacretelle, où les enterrements sont obligés de passer pour se rendre au cimetière. - (20) |
| pont, sm. point. - (17) |
| ponte. Oviducte. Organe par où s'évacue l'œuf qui se forme dans l'ovaire. - (49) |
| pontée, s.f. cruche à huile. - (38) |
| pontenier, s. m., pontonnier, passeur préposé au bac, celui qui, glissant les mains sur la corde, fait filer le grand ou le petit bateau d'un bord à l'autre de la rivière. - (14) |
| ponter : porter. - (32) |
| pontot, s.m. petite cruche. - (38) |
| ponu (p.p.) : p.p. du verbe pondre - (50) |
| ponu, part. pass. du verbe « poner ». pondu. - (08) |
| ponu. partic. prés. de poner, poudre. La poule a ponu. Des oeufs tout frais ponus. - (10) |
| pôoir, s. m. pouvoir, force, crédit. indicatif prés, i peu, teu peu, a peu ; i poùon, vô poùé, a poûan. - (08) |
| popa, subst. masculin : papa. - (54) |
| popée d'euve - petit paquet de filasse pour attacher à la quenouille. - Ile é deux popées d'euves ai felai ajedeu, et c'â du joli ! si vos viains ! – Lai Bôchotte é beillé deux popées d'euve su le Pain béni. - (18) |
| popeute : poupée - (43) |
| popier, sm. peuplier. - (17) |
| popin. s. m. Trou d'eau. (Armeau). - (10) |
| popitre, pupitre. - (16) |
| popitre, s.m. pupitre. - (38) |
| pople, s.m. peuple. - (38) |
| poplexie : s. f., apoplexie. - (20) |
| poplié : peuplier. - (29) |
| poplin. s. m. Jeune peuplier. (Lasson, Neuvy-Sautour). - (10) |
| pôpon. Poupon, poupons. - (01) |
| popouler, v. a. fouler, écraser avec le pied, marcher sur... en appuyant, en pesant. Le bétail « pofoule » l'herbe sur son passage ; le marais a été « pofoulé » par les sangliers. - (08) |
| poque n.f. Jeu de billes consistant à lancer une poignée de billes dans un trou (pot) pratiqué contre un mur ou contre un arbre. - (63) |
| poque : s. f., jeu qui consiste à lancer une poignée de billes dans un trou ou gueuleu pratiqué contre un mur ou un arbre. - (20) |
| poque, et pouche, s. f., poche. - (14) |
| poque. s. f. Sac, poche. – Par extension, petit trou fait au pied d'un mur ou sur une place, et dans lequel les enfants s'amusent à jeter des billes, des pièces de monnaie, des vieux clous ou autres objets de ce genre, de manière à n'y faire rentrer, sous peine d'avoir perdu, que le nombre déterminé par l'un des joueurs. La poque était encore, il y a quelques années, un jeu fort usité parmi les enfants d'Auxerre, qui, pour la plupart, prononçaient ploque. Du latin pocca. - (10) |
| poquelin, pouquelin : s. m., alouette lulu (alauda arborea). - (20) |
| poquelin, pouquelin : s. m., bouquet de fruits. - (20) |
| poquer : donner un coup de tête - (35) |
| poquer v. Choquer une bille contre une autre. - (63) |
| poquer : v. a., choquer une bille à l'aide d'une autre. - (20) |
| poquer, v, tr., atteindre. Verbe usité entre les enfants jouant aux billes. C'est toucher la gobille de son partenaire avec celle qu'on lance d'assez loin. — Pris quelquefois dans le sens de laisser : « Poque-me iqui c't imbécile. » - (14) |
| poquéte, et pouquéte, s. f., petite poche, pochette. - (14) |
| poqueux, euse. s. et adj. Difficile dans le manger. (Senonais). - (10) |
| poquo, poqué, conj. pourquoi. - (17) |
| por (prép.) : pour (aussi paur) - (50) |
| por : par. Por darré : par derrière. - (52) |
| por iqui, por ilai, loc, par-ci, par-là. - (14) |
| pôr lâvant - par là, là-bas. - Al â porlâvant, tenez aipelez-lu. - Vai don voué porlâvant, si pair hazaird t'en troûvas. - (18) |
| por qui, por lai - par ici, dans ces environs. - Al ant dû passai por qui. - C'â porqui ailentor qui ai perdu note clié. - Por qui, por lai, i ne sai pâ laivou. - (18) |
| pôr : 1 pré p. Par. - 2 pré p. Pour. - (53) |
| por : pour, par - (39) |
| por, prép. pour : « ç'nô pâ por-z-eules », ce n'est pas pour elles. - (08) |
| por, prép., pour, et par. Pô devant une consonne. - (14) |
| por, s. m. porc, cochon : un por, des pors. - (08) |
| por. Porc, cochon ; c'est aussi la préposition tantôt pour, tantôt par. Voyez po. - (01) |
| pôrau : poireau ; mucus nasal - (35) |
| porce. Pour ce : Et porquei diré tu ? porce… - (01) |
| porcer (v.t.) : percer - (50) |
| porcer : percer - (48) |
| porcer, v. a. percer, faire un trou avec un instrument, ouvrir un passage. - (08) |
| porchat. s. m. Passereau. (Avallonnais). - (10) |
| porche, jeune truie châtrée. - (05) |
| porche, passage couvert. Dans l'idiome breton, pors ou porz signifie grande porte cochère, porte de ville, de château. Dans le pays de Vannes, on dit porc'h. - (02) |
| porchenéche : Renouée des oiseaux (Polygonum aviculaire), mauvaise herbe des champs. - (19) |
| porcher, châtrer mâle ou femelle. - (05) |
| porcher. S'emploie pour hongrer, quand il s'agit d'un cochon. - (49) |
| porchi : Porcher, gardeur de porcs. Châtrer. - (19) |
| porcilière. s. f. Soue à cochons. – On dit aussi porcelière. (Chigy). - (10) |
| porçou, s. m. perçoir, instrument qui perce. - (08) |
| porc-sanglier : sanglier. II, p. 1-2 - (23) |
| pôr-dâré : loc. adv. et loc. prép. Par-derrière. - (53) |
| pordechu, adv. et subst. par-dessus. (voyez chu.) - (08) |
| pordilai, pourdilai, adv. de lieu. par-là, par là-bas. (voir : ilai.) - (08) |
| pordiné : grande gamelle en fer blanc servant à porter la nourriture aux champs. A - B - (41) |
| pordiner : grande gamelle en fer blanc pour porter la soupe aux champs - (34) |
| pordiner. Boîte à soupe, à fricot. Sert à l'ouvrier pour porter son dîner, d'où son nom. - (49) |
| pordinet n.m. Petite marmite pour porter la soupe aux champs. - (63) |
| pôr-d'su : loc. adv. et loc. prép. Par-dessus. - (53) |
| pôre : pauvre - (48) |
| pôre ti possible : exp. Pauvre type. - (53) |
| pôre : adj. et n. Pauvre. - (53) |
| poré : n. m. Estomac. - (53) |
| pore, (ö), sf. poire. - (17) |
| pôre, poire. - (26) |
| pòre, s. f. poire. Pòron, petite poire. Pòri, poirier. Pòròni, poirier sauvage. - (22) |
| poreau : poireau - (51) |
| pôreau n.m. 1. Poireau. 2. Morve, chandelle. - (63) |
| poreire et perrière. Carrière. Les chartes latines emploient le mot petraria. Le nom de La Perrière est commun à beaucoup de villages et de lieux-dits. Perrier, extracteur de pierres, est devenu un nom propre assez fréquent. (V. Poron.) - (13) |
| pòreu de loup, s. m. ail sauvage. Littéralement « poireau de loup ». - (24) |
| poreuse : (poreus' - subst. f.) bedaine, panse. - (45) |
| porfil, s. m., vx fr., pôfîle : s. f. (?), profil, bordure, ruban. « Le maçonnais appelle pofile l'attache qui soutient la quenouille sous le bras. » (F. Fertiault, Dictionnaire, p. 346). A rapprocher des vx fr, paufis et poufile. - (20) |
| porgalai - pourchasser, disperser plus ou moins de. - AI é porgalai quemant qu'en faut to ces galopins. - Aitends qui ailâ porgalai to cequi. - (18) |
| porgaler, se dit des bêtes échappées des prés qui errent dans les champs et y causent des dégâts. - (27) |
| porge : s. f., chute naturelle des fruits à chaille, et, par extension, leur ramassage. Aller à la porge des noix, des marrons, etc. - (20) |
| porger : v. a., vx fr. porgeter, projeter, jeter à terre, faire tomber, laisser tomber. - (20) |
| pòrgi, v. a. perdre, éparpiller : le sac desserré a porgi le blé (du vieux français porjeter). - (24) |
| porguèlé, vt. houspiller, malmener, secouer. - (17) |
| poriguer. Epargner, faire profiter certaines choses. J n'ons qu’enne live de lard pour dix personnes, porigne, mon aimi. - (13) |
| porin, poirier. - (26) |
| porio : gésier. (SY. T II) - B - (25) |
| poriô : gésier - (39) |
| porion. s. m. Le derrière. (Guillon). - (10) |
| poriot (n.m.) : gésier - (50) |
| poriot (nom masculin) : gésier. - (47) |
| poriot : gésier - (48) |
| poriot : (poryo - subst. m.) gésier. - (45) |
| poriot, pouriot : gésier. - (33) |
| poriot, s. m. gésier, jabot : « eun poriot d'oué. » - (08) |
| porlai, pourlai, adv. de lieu. par-là : « al ô porlai », il est par là, quelque part, aux environs. - (08) |
| porö, sm. poirier. - (17) |
| pòrœte, s. f. ciboulette (vieux français). - (24) |
| poron (n.m.) : grosse pierre ; roche de forme arrondie (étym. : de pierre) - (50) |
| poron : (subst. m.) gros bloc de pierre. Correspond au type fr. perron. - (45) |
| poron : gros caillou. - (09) |
| poron, s. m. grosse pierre, roche en général de forme arrondie ; ce champ est rempli de « porons. » - (08) |
| poron. s. m. Grosse pierre unie. (Guillon). – A Montillot, pierre ronde. – A Sermizelles, gros raillou rond de rivière. - (10) |
| porot : poireau - (48) |
| pörou, adj. peureux. - (17) |
| porpe : Pulpe. « Eune codre qu’a bin du porpe » : une courge dont la pulpe est épaisse. - (19) |
| porpe. Pourpre. - (01) |
| porqué, conj. et adv., pourquoi. - (14) |
| porquei. Pourquoi ; on dit aussi poquei. - (01) |
| porqui, paurqui (loc.adv.) : par ici - (50) |
| porqui, pourqui, adv. de lieu. par ici : « al ô porqui », il est par ici, ici près. - (08) |
| pôrre - pauvre. - A son bein porre ces gens lai. - Combein en y é don de porre métenant ! – C'â ine pôrre fonne, ailé, ne vos i fiez pâ. - (18) |
| porreau : Poireau, allium porrum. - (19) |
| porreau : poireau. - (52) |
| porrére - pierriére ou carrière. - Al â cherchai des pierres dan les porréres de Belle-Forêt. - En é euvri ine porrére dan le champ Lamblot. - Les porréres du Melin deveinrant importantes. - (18) |
| porretai - pauvreté. – Paurretai n'â pâ vice ! non, et portant ci dépend – En dit que Saint François s'é mairiai aivou lai porretai. - (18) |
| porron, n. masc. ; roche détachée en granit. - (07) |
| porron. Pierre, gros cailloux. Ce mot est resté dans la topographie locale : le Meix-Porron, à Gigny, est dans le voisinage de la voie romaine. Plusieurs monuments mégalithiques portent le nom de Porron de la fée. (V. Lousine), le Perronboil, à Sainte-Sabine, était peut-être consacré à Bélénus. - (13) |
| porron. Pourrons, pourront : Ne porron-je ? ne pourrons-nous ? - (01) |
| por-singlai. : (Pron. singliai), sanglier. - (06) |
| port (En bon) : loc. adv., à bon port. - (20) |
| port, s. m. on nomme port dans le pays un emplacement choisi à la proximité d'une rivière ou d'un ruisseau pour y déposer, y empiler et ensuite y mettre à l'eau le bois de moule que le flottage conduit à Paris. - (08) |
| portage. : Droit sur les charrois, aux portes des villes. (Cout. de Beaune, 1370.) - (06) |
| portaient au curé du village, pour qu'il les bénisse, des petites croix de bois confectionnées par leur père, ces croix étaient ensuite plantées dans les terres, dans l'espoir que les récoltes soient ainsi épargnées par les intempéries. - (63) |
| portail : s. m., vx fr. portal, porte cochère ou charretière. - (20) |
| portail, façade de la principale entrée d'une église, comme si l'on disait pors tal, porte-façade. (Voir Le Gon. à ces deux mots.) - (02) |
| portail, s. m., porte d'entrée, grille : « O s'ét érâté d'vant l’portail de là còr. » L'entrée la plus minime est portail. - (14) |
| portan, pourtant, cependant ; bèn portan, celui qui jouit d'une bonne santé. - (16) |
| portant : pourtant - (51) |
| portant, conj., pourtant. - (14) |
| portau (n.m.) : avancée du toit de la grange pour abriter les chariots - (50) |
| portau : portail - (34) |
| portau : portail - (35) |
| portau : portail - (43) |
| portau n.m. Portail. - (63) |
| portau, s. m. portail, saillie d'un toit en avant d'une grange pour abriter les chariots. - (08) |
| portcha (na) : portée (petits animaux) - (57) |
| portchére (na) : portière - (57) |
| porte feignant : Sorte de siège placé sur le char dont se servait le charretier pour le transport de diverses marchandises : blé, farine, etc - (19) |
| pôrte n.f. Porte. - (63) |
| pôrte : n. f. Porte. - (53) |
| porteau : portail - (51) |
| porteau : Portail. « In porteau de grange ». - (19) |
| pòrteau, s. m. portail de cour, de grange. - (24) |
| porteau. n. m. - Porte à deux battants superposés. - (42) |
| porte-bounheu (on) : porte-bonheur - (57) |
| porte-brancâs (on) : porte-brancards - (57) |
| porte-cutcheaû (on) : porte-couteau - (57) |
| portée : s. f., ancienne mesure de longueur pour les chemins valant le 1/50 de la lieue de Mâcon, 300 pieds, c'est-à-dire 97 m. 452. - (20) |
| portefeûiÿe, s. m., lit : « J'ai seûne ; i va m'fòrer dans l’portefeùiÿe. » Cette appellation originale est fort en usage, comme celle de « chapelle blanche », qui signifie la même chose. - (14) |
| porte-mâlheu (on) : porte-malheur - (57) |
| portemantcheaû (on) : portemanteau - (57) |
| portement : s. m., vx fr., santé. Depuis que j' vous ai vu, vous m'avez l'air d'avoir conservé un bon portement. - (20) |
| porte-paraplus (on) : porte-parapluies - (57) |
| porte-pot (A), porte-pôt : loc. Vin à porte-pot, vin à pot, dit aussi, suivant les régions, « vin à emporter », ou « vin au dehors ». Porte-pot : s. m., boutique où l'on vend du vin à porte-pot. « Il entra en relations avec un client qui tient un porte-pôt au voisinage de l'avenue de Saxe. » (Nouvelliste, 13 sept. 1911). Voir assiette. - (20) |
| porter : S'emploie pour « mettre » dans l'expression « Porter en joue ». - (19) |
| porter chu yien : porter à plusieurs, chacun son tour, sur le lien tenu à terre par le lieur, une brassée d’épis de façon à faire constituer une gerbe - (37) |
| porter en joue : loc, mettre en joue. - (20) |
| porter les dragées, locution verbale : faire le tour de ses connaissances, juste avant le mariage, en offrant des dragées pour présenter le ou la fiancé(e). - (54) |
| porte-sciés (on) : porte-clefs - (57) |
| porteû d’boffe : ramasseur avec la « rasse » de la « balle » à la batteuse - (37) |
| porte-vouaîx (on) : porte-voix - (57) |
| pôrtion (f), affouage. - (26) |
| portion, s. f., part d'affouage communal. - (40) |
| portion, s. f., potion, remède qui n'a pas toujours les sympathies du paysan. - (14) |
| portô : portail. A - B - (41) |
| portou (on) : porteur - (57) |
| portou (-ouse) (n.m.) : porteur (-euse) - (50) |
| portou : porteur - (43) |
| portou : porteur - (51) |
| portou d'hotte : porteur de hotte à la vendange. - (21) |
| portoû, s. m., porteur, commissionnaire. - (14) |
| portoux : Porteur. « In portoux d'heutte » : un porteur de hotte, celui qui porte la hotte dans laquelle les vendangeurs vident leurs paniers. « O s'est sauvé c 'ment in portoux de boudin » : il est parti, comme celui qui apporte du boudin en cadeau, sans attendre de remerciements. - (19) |
| portsâ n.m. Castreur, hongreur. - (63) |
| portu - trou. On n'emploie plus guère ce mot que pour badiner, par exemples dans ce cas. - Regaide don c'te feille lai qu'é in portu dan ses bas. - (18) |
| portu : s. m. trou. - (21) |
| portu, s. m., pertuis, trou, trouée. - (14) |
| portu, s. m., trou dans un récipient creux. - (40) |
| portuser, v. tr., creuser, trouer. - (14) |
| port'yon : petite porte, de la grange à l'écurie - (43) |
| poruilh. : (Dial.), même mot que poruec, poreuc, poroc et porhuec (en latinper illud), signifiant pour cela. - (06) |
| porvuque, loc. conj., pourvu que. - (14) |
| pôs : pas - (57) |
| pôs bon : mauvais - (57) |
| pôs groûs - p'tchot bout (on) : peu - (57) |
| pôsai. Posé, posez, poser. - (01) |
| poschené (pô:ch’nè) et parfois boschoné (bô;chonè) (forme francisée) : (v. tr.), étriller, bouchonner (un cheval). Au fig. rosser d'importance. - (45) |
| pôsè : v. t. Poser. - (53) |
| pose, posée : s. f., vx fr. pose, ancienne mesure agraire. - (20) |
| pôsée, s. f. moment du repos, de l'arrêt : la « posée » du soleil, du jour, le soir ; la « posée » de la nuit, le matin. - (08) |
| poser, v. a. déposer, mettre à bas : il a « posé » ses habits, ses sabots et s'est jeté à l'eau. - (08) |
| posette. s. f. Roseau en forme de poche. (Villiers-Saint-Benoît). - (10) |
| position : s. f. Fausse position, position anormale ou forcée ayant déterminé une sensation douloureuse, et, par extension, cette sensation elle-même. - (20) |
| pôsœur : n. m. Poseur. - (53) |
| posse (n.f.) : poche (aussi pot, vase) - (50) |
| posse : (nf) pis - (35) |
| posse : mamelle d’animal - (51) |
| posse : pis - (43) |
| posse n.f. Pis de la vache. Péj. Poitrine de femme. Voir pé. - (63) |
| pòsse, s. f. pis d'une vache, d'une chèvre. - (24) |
| posséir. : (Dial.), posséder. Dérivation du latin possidere, indic. présent., 3e pers possiet, dérivation du latin possidet. - (06) |
| posser : percer - (39) |
| possesse : s. f., vx fr., possession, patience. - (20) |
| possib' : adj. Possible. - (53) |
| possibe, adj., possible : « Y ét-y ben Dieu possibe ! » - (14) |
| pôssibe. Possible, peut-être. En français possible, pour peut-étre, a vieilli. - (01) |
| possibye n. et adj. Possible. - (63) |
| possou : pour percer, outil de sabotier - (39) |
| possuler, v. a. trouer, faire des trous. - (08) |
| post' : n. m. Poste, un poste de travail. - (53) |
| postailler, v. traîner par les rues, se poster à un coin de rue. - (38) |
| postaillou, s.m. garçon qui trame dans les rues. - (38) |
| poste (grand), subst. masculin : durée du travail équivalente à une journée. - (54) |
| poste. Durée du travail dans le puits, entre la descente et la montée de l'ouvrier. Terme minier. - (49) |
| postes (faire les), locution verbale : travailler en travail posté, faire les trois-huit. - (54) |
| postiche (à la), loc. à la hâte : coudre à la postiche. - (22) |
| postiche (à la), loc. à la hâte: coudre à la postiche. - (24) |
| postillon, s. m., languette de papier, ou carte percée, enfilée à la ficelle d'un cerf-volant, et qui rejoint celui-ci quand le vent souffle. Très employé jadis. - (14) |
| postillon. s. f. Paiticule de salive lancée en parlant. Les orateurs parlementaires, les avocats. les prédicateurs qui ont des brèches dans la mâchoire sont fort sujets à lancer des postillons. - (10) |
| postraille. s. f. Troupe d'enfants. (Armeau). - (10) |
| postume, pus. V. apostume. - (05) |
| pot (nom masculin) : pieu. - (47) |
| pot : pieu - (51) |
| pot : s. m. pot. - (21) |
| pot n.m. Trou creusé dans le sol pour le jeu de billes. - (63) |
| pot ou pau : échalas. - (09) |
| pot viro : pièce de bois fixée au bout des échelles tournant librement. - (33) |
| pot : s. m., ancienne mesure de capacité pour les liquides, contenant les 7/8 du litre ou 0 litre 875, et dont 8 font la quarte et 240 le tonneau à environ 1 litre près. A la fin du XVIIe siècle, au grenier de Mâcon, il servait aussi à mesurer le sel mais avait la contenance d'une demi-pinte. (Archives dép., C. 798, 2), c'est-à-dire la même contenance que la chopine, mesure de capacité pour les liquides, ou 0 litre 757. - (20) |
| pot : s. m., trou creusé en terre pour jouer aux billes. Syn. de gueuleu. - (20) |
| pot, pieu - (36) |
| pot, s. m. vase en général. - (08) |
| potabje, adj. potable. - (17) |
| potadzi : réchaud à charbon de bois. A - B - (41) |
| potadzi : potager (chauffe-plats alimenter avec des braises, placé en général sous une fenêtre - (51) |
| potadzi : réchaud à charbon de bois, construit en briques dans l'embrasure d'une fenêtre - (34) |
| potadzi : réchaud à charbon de bois, construit en briques, dans l'embrasure d'une fenêtre - (43) |
| potadzi n.m. Réchaud à charbon de bois, construit en brique, dans l'embrasure d'une fenêtre. - (63) |
| potagé*, s. m. sorte de réchaud établi autrefois dans l'entablement d'une fenêtre. - (22) |
| potager, s. m. sorte de réchaud fixe établi autrefois dans l'entablement d'une fenêtre. - (24) |
| potair : pétard - (48) |
| potan. Pourtant, néanmoins ; c'est aussi le participe actif de porter : L’un potan l’autre, l’un portant l'autre. - (01) |
| pôtance. Potence, gibet. - (01) |
| potanseigne, Porte-enseigne. - (01) |
| pôtar, s. m. sarbacane en bois de sureau dont la moelle est enlevée et au moyen de laquelle les enfants lancent de petites boules de chanvre. - (08) |
| potard : pétard. - (33) |
| potard : c 'qu'au fait, au fait, potard ! : ce qui est fait est fait ! - (56) |
| pôtard : pétard - (39) |
| potaÿllard, s. m., cytise. - (40) |
| potayon : pot en terre servant à mettre de l'huile. A - B - (41) |
| pôtch : la porte - freum bin lè pôtch ! Ferme bien la porte ! - (46) |
| potche : porte. (LCSS. T IV) - S&L - (25) |
| potchè : porter - quand'i éteû p'tiot, i potcheû des cuyottes cotches, quand j'étais petit, je portais des culottes courtes - (46) |
| potch'fon : l'armature sous le chariot - (46) |
| pôtchi (on) : pâquier - (57) |
| pôtchi (on) : pré (petit près de la maison) - (57) |
| pôtchon : entrave triangulaire placée au cou des chèvres pour les empêcher de traverser les haies. A - B - (41) |
| pôtchon n.m. (du lat. postem, le poteau). Entrave pour chèvre, en forme de triangle. - (63) |
| pot-de-chambre : s. m., qualificatif qu'on donne, dans certains jeux, à la personne à qui échoit un rôle plus ou moins ridicule. - (20) |
| pôté : jeune domestique (en B : pôti). A - (41) |
| poté : stockage de pommes de terre ou betteraves disposé en tas recouvert de terre. A - (41) |
| pote (aine) : (un) pet sonore - (37) |
| pote : (nm) silo creusé dans le sol - (35) |
| poté : couffin d'aiguisage - (51) |
| potè : péter - (46) |
| pote : petite carrière - (43) |
| pote : silo à légumes réalisé dans les champs avec de la terre et des pieds de maïs, topinambours de la paille et des fougères - (51) |
| pote : Terme de jeu de bille : petit trou creusé dans la terre. « Fare sa pote » : envoyer sa bille dans le trou. - (19) |
| pote d’laipin (aine) : quelque chose n’ayant aucune valeur - (37) |
| pote de treuffes : silo de pommes de terre - (43) |
| pote : s. m., serve ; s. f., creux, trou, silo à pommes de terre. Voir ravier. Il y a lieu de rapprocher pote de potière (voir ce mot). - (20) |
| potè : v. t. Péter. - (53) |
| pote, porte. - (27) |
| pôtë, repas donné après une moisson, une vendange. Ce mot semble dériver du grec apaulia, apaulies, voulant dire : présent, cadeau ; les Romains offraient des apaulies aux jeunes mariés. La pôtë est, en effet, un présent, puisqu'elle est un repas gratuit ; mais alors la pôtë devrait s'écrire l'apôtë. - (16) |
| poté. Coffin en bois pendu à la ceinture du faucheur pour placer sa pierre à aiguiser ; petit domestique engagé pour la garde des porcs. - (49) |
| pote. Porte, portes, substantif ; ce mot est aussi très souvent verbe, je pote fero, tu pote fers, ai pote fert, ou ferunt, - (01) |
| poteau, pièce des maisons en bois. V. coulmeau. - (05) |
| potée : s. f., jarre. Une potée dhuile. - (20) |
| potée : s. f., soupe au lard et aux choux à laquelle on peut ajouter d'autres légumes. - (20) |
| potee, s. f. ce qui est contenu dans un pot, un plein pot . - (08) |
| pòtée, s. f. pot à contenir l'huile. - (24) |
| potée, s. f., soupe épaisse et savoureuse, dans laquelle on a mis, avec la viande ou le lard, toutes sortes de légumes, choux, pommes de terre, haricots, carottes, etc. Grand régal des paysans. - (14) |
| potée. Plat national, composé de lard bouilli avec tous les légumes possibles, depuis les pommes de terre jusqu'aux choux, en passant par les carottes et les petits pois. La potée est la base de l’alimentation pour les paysans de la Côte-d’Or ; c'est notre couscoussou, notre pollenta. - (12) |
| potée. s. f. Tas, monceau de paille ou de fourrage. (Sormery). - (10) |
| pote-guignon. Porte-malheur. Qui dit guignon dit travers… - (01) |
| pôteillement, s. m. pétillement. - (08) |
| poteiller : pétiller - (39) |
| pôteiller, v. n. pétiller. - (08) |
| pôteillis, pôteillon, s. m. grand bruit, vacarme. (voir : pôtin) - (08) |
| potela : plancher à porcs. B - (41) |
| poteler : dégringoler. A - B - (41) |
| potelin : timbale à lait. A - B - (41) |
| potelin : petit pot à lait avec une anse - (34) |
| pôtené. Grossier, lourdaud, rustre, mal élevé. Etym. Pote qui n'est plus usité aujourd'hui qu'avec le substantif main, main pote, qui veut dire main lourde, maladroite ; pote a fait le diminutif potelé. - (12) |
| potenére - poche. - Teins, mon petiot, veins qui remplissà tai potenére de calots et de peurnes. - Comme le mot portu, il a disparu. - (18) |
| pôtenichon, fainéant qui, se tenant debout, regarde sottement ce que l'on fait. - (16) |
| poter : pêter avec bruit - (37) |
| poter : péter, exploser - (48) |
| poter lai sainté : être bien portant - (37) |
| poter : (potè - v. intr.) 1 -péter, lâcher un vent. 2 -exploser (cf. fr. pétard). - (45) |
| poter : pêter - (39) |
| poter, v. intr., péter. Une femme, qui ne voyait rien au-dessus des agréments (?) de son homme, lui disait : « Pote, pote, m'amie ; y é du bonbon. » C'était délicat. - (14) |
| poter, v. péter. - (38) |
| poter, v., péter. - (40) |
| poterai, pote - divers temps du verbe Porter. - Pote cequi ai ton onque, ç'â d'ailu. - Vos potera vote goûtai aivou vo. - (18) |
| poterais (n.m.) : gesse à grains ronds - (50) |
| pôterais, s. m. pl. gesse à graines sphériques qui croît dans les seigles. - (08) |
| poteralle, n. fém. ; jouet pour lancer des boulettes. - (07) |
| pôteralle, s. f. canonnière, jouet d'enfant avec lequel on lance des boules de chanvre. (voir : pôtar.) - (08) |
| poterein. Porterions, porteriez, porteraient. - (01) |
| poteron-mireille (Dé) - de très bonne heure, dès le matin. - I seu levai dé poteron-mireille. - Allons don ! des jeunes gens, ci se leuve dé poteron-mireille, bein devant les poules. - (18) |
| poteroo. Porterais, porterait. - (01) |
| potet, potaillon, potelion, potignon, potrillon : s. m., vx fr. potet et potetet, petit pot. - (20) |
| potet, s. m. encrier. diminutif de pot ; petit pot qui renferme de l'encre dans les campagnes. - (08) |
| potet, s. m., petit pot, encrier : « Je n'peux pas écrire; j'n'ai pus d'encre dans mon potet. » - (14) |
| pôteu. : Malotru. - (06) |
| poteumôle (n.m.) : emmêlement, désordre - (50) |
| pôteurmôle : mot utilisé dans l'expression « ai lai poteurmôle » qui signifie « pêle-mêle » - (39) |
| poteux, potou. s. m. Péteux. (Guillon). - (10) |
| pot-foèrou : pet chiasseux - (39) |
| poti. Portai, portas, porta. - (01) |
| potian : pourtant, on dit également potchan. - (46) |
| potiant, adj. bé potiant. Bien portant. - (17) |
| potiant, adv. pourtant. - (17) |
| potiau, s. m., poteau, pilier. - (14) |
| potier, poutier, v. ; porter. - (07) |
| potier, vt. porter. - (17) |
| potière, potire, poutire : s. f., pot. Par extension, cache, trou servant de cachette pour certain objets (argent, clef, etc.) ou de logis pour certains animaux (rat, grillon, etc.). - (20) |
| potiller : pétiller, crépiter - (48) |
| potiller : pétiller, éclater en brûlant (« y potillot d’c’eûs sâprés coups ! ») - (37) |
| potillerie, potin - (36) |
| potin : s. m., grains de fonte, et, par extension, grains de plomb pour la chasse. - (20) |
| pôtin, s. m. bruit, tapage. on a fait un « potin » du diable dans cette auberge. (voyez pôteillis.) - (08) |
| potiö, adv. partout. Tö potiö, tout partout. - (17) |
| pôtion : une soupe épaisse, avec beaucoup de pain - (46) |
| potire : (nf) faitout - (35) |
| potire. Portâmes, portâtes, portèrent. - (01) |
| potje, sf. porte. - (17) |
| potjie, sf. potée. - (17) |
| potjöte, sf. petite porte. - (17) |
| potô n.m. Silo de plein champ, semi-enterré et recouvert de paille de seigle et de terre, utilisé pour stocker les pommes de terre préalablement regroupées en taupires. Ce silo était également appelé un crô (voir ce mot). - (63) |
| poto, extrémités des doigts assemblées en faisceau ; pâ pu grô ke l’polo, tout petit. C'est avec le poto qu'on fait son mea culpa, en récitant le Confiteor. - (16) |
| poto. Silo. - (49) |
| potoère : pétoire - (39) |
| potoroder : pétarader - (39) |
| potou : celui qui pète fréquemment (on ajoute souvent : « l’y, yotain bon gârs… mais quant’aî pote, ai seint mauvâs ! ») - (37) |
| potou : haricot - (48) |
| potou : moto (péjoratif). - (52) |
| potou : qui pête - (39) |
| potouère : anus - (48) |
| potouère : vieux fusil, pétoire - (48) |
| potraie : grains de pois sauvage ou de nielle - (48) |
| potrale : pétrolette, motocyclette - (48) |
| potrale : pétoire, vieux fusil, ou moto ancienne . Les potrales ne roulint pas vite : les motos anciennes ne roulaient pas vite. - (33) |
| potrale : (potral' (pierre) - adj. f.) sorte de pierre calcaire très fine qui affleure dans le soldes forêts. Impropre à la construction (elle se clive en feuilles), elle éclate parfois assez bruyamment, lorsqu'on la jette au feu ; et c'était naturellement une plaisanterie ordinaire que d'en jeter une demi-douzaine dans le brasier, surtout le jour des Bordes (= feux de printemps). - (45) |
| potrale. Petite canonnière en sureau ; de poter, péter. - (03) |
| potraler : pétarader. - (62) |
| potré - (po:tré - subst. m.) : homme courtaud et trapu, mais sans force ni énergie ; gros homme lymphatique, souvent peu intelligent. - (45) |
| potré : (potrê - subst. m.) (terme de botanique) silène enflé, sorte de plante à fleurs cystoïdes dont les enfants détachent les vessies et les claquent violemment sur le dos de leur main pour les faire éclater. - (45) |
| pôtre-môle (à la), pêle-mêle. - (38) |
| pôtremôle : pêle-mêle, en vrac - (48) |
| potrer (se) : se coucher, dormir. (R. T IV) - Y - (25) |
| pôtrer : écraser avec les pieds - (39) |
| pôtrer, v. tasser la terre en la piétinant. - (38) |
| pôtri : piétiner. (RDB. T III) - S&L - (25) |
| pôtro : soupe ou ragoût trop épais. (CH. T III) - S&L - (25) |
| potron (n. m.) : groseille à maquereau - (64) |
| potron jacquet, potron minet : de bon matin, très tôt - (48) |
| potron, fruit rouge de l'églantier. - (16) |
| potronjacquet - (39) |
| potron-minette, loc. de grand matin. se lever à « potron-minette », c'est se lever à la pointe du jour. - (08) |
| potrou. s. m. Personne sale, vêtue de haillons. (Etivey). - (10) |
| pôtrouillé : v. t. Triturer, malaxer. - (53) |
| potse : louche (ustensile de cuisine). A - B - (41) |
| potse : louche - (34) |
| potse : poche, louche - (51) |
| potse, potson : (nf.nm) louche - (35) |
| potse, potson n.f. n.m. Louche. - (63) |
| potse. Poche. - (49) |
| potsoni : homme qui s’occupe à des tâches ménagères, en particulier de cuisine - (35) |
| potsoñnoux n.m. Homme qui s'occupe des tâches domestiques réservées aux femmes, ménage, cuisine, etc. A ne pas confondre avec le feunneret qui est efféminé et plus si affinités. - (63) |
| potsse : louche - (43) |
| potsson : louche pour faire le fromage - (43) |
| potssoni : homme qui s'occupe de faire la cuisine - (43) |
| pottai - petter. - A ne fait que pottai ; c'â bein désagréabe. - Dans sai mailaidie â potto très bein : ci le soulageot. - (18) |
| potte : silo à pommes de terre, à betteraves, recouvert de terre. Fourreau pour mettre la pierre à aiguiser la faux - (34) |
| potte, la porte. C'est souvent que les Bourguignons retranchent l'r par euphonie, ou plutôt changent l'r en t. - (02) |
| potte, porte. - (26) |
| pottée – mets composé de légumes, de choux et de pommes de terre principalement, cuits avec du lard. - Lai pottée n'â pâ tot ai fait aissez cueûte. - Mets in bon bout de laird dans lai potée. - (18) |
| potu, trou, caverne, ouverture. Du latin puteus, puits. - (02) |
| potu. : Creux.- Cette expression provient d'un jeu de billes, lesquelles il faut faire arriver dans des trous nommés pots. D'où le verbe potusai, creuser des trous. - (06) |
| Potugoi. Portugais… - (01) |
| potusai, faire des trous, pratiquer des ouvertures... - (02) |
| pòtyion, s. m. petit pot, son contenu : un pòtyion de crème. - (24) |
| pou (na) : peur - (57) |
| pou (re) : (adj) pauvre - (35) |
| pou : (nf) peur - (35) |
| pou : peur - (43) |
| pou : peur ; té mé fè pou ! : tu m'as fait peur ! - (56) |
| pou : peur - (48) |
| pou : pour - (48) |
| pou : pour - i seû pou..., je suis pour... - (46) |
| pou : pour, afin de... - (52) |
| pou : peur. I crais qu'ol è pou : je crois qu'il a peur. - (33) |
| pou : pour, afin de… - (33) |
| pou adv. Peu. A pou pré. A peu près. - (63) |
| pou n.f. Peur. - (63) |
| pou que : afin que - (57) |
| pou traipan : au travers. (S. T IV) - B - (25) |
| pou : pour - (39) |
| pou : s. f. peur. - (21) |
| pou, pour ; pouz eû, pour eux. - (16) |
| pou, préposition, par, pour ; pou cotain-ne, par côté. - (38) |
| pou, s. f. peur : la pou fait courir. - (24) |
| poû, s. f. peur, crainte, frayeur : « i é poû d' mûri », j'ai peur de mourir. « peu. » - (08) |
| pou, s. m. pot, marmite. - (08) |
| pou. Peu. On dit : « à pou près » pour à peu près. - (49) |
| pou. prép. - Pour : « T'en as eu pou' comben, c'té foué-ci ? Vieux chameau ! » - (42) |
| pou[y]er : enfoncer et se mouiller les pieds dans un terrain marécageux - (52) |
| pouâ - pois. - Mai chère Nannette, i aivâ ine pliainche de pouas, oh ! si vos saivains, bein airaingée, et pu les pingeons les ant tot mégés ! - (18) |
| pouâ (on) - caillon (on) - neûrrain (on) : porc - (57) |
| pouachai : pécher. Ol éto ai la pouache : il était à la pèche. - (33) |
| pouâche (n.f.) : pêche - (50) |
| pouâche : pêche (poisson) - (48) |
| pouâchè : n. m. Pêcher. - (53) |
| pouâche, pouâchai, pouâcherot – pêche et divers temps du verbe Pécher. – I sons ailai ai lai pouâche dan lai rivére vé le Melin ; i ons pris des… Vairons !! - Lai pouâche dans le Canal quemance demain. - Mossieu Francois pouâcho hier dans le Réservoir. - (18) |
| pouâche, s. f. pêche, action de pêcher. « pouéce. » - (08) |
| Pouâche-môl (du) : un mélange. (C. T IV) - A - (25) |
| pouâcher (v.t.) : pécher - (50) |
| pouâcher : pêcher - (48) |
| pouâcher, v. a. pêcher. « pouécer. » - (08) |
| pouâcherie (n.f.) : pêcherie ; petit étang ; réservoir où l’on met des truites - (50) |
| pouâcherie, s. f. pêcherie, petit étang, réservoir où l'on conserve ordinairement des truites. « pouécerie. » - (08) |
| pouâchon, s. m. poisson. « pouchon. - (08) |
| pouâchou (n.m.) : pécheur - (50) |
| pouâchoû : pêcheur - (48) |
| pouâchou, ouse, s. m. et f. pêcheur, celui qui pêche. « pouéçeu » ou « pouéçou. » - (08) |
| pouâchue : n. m. Pêcheur. - (53) |
| pouacre (C.-d., Chal., Br., Morv.).- Sale, vilain… Pouacre ou poacre est un mot du vieux français signifiant goutte ou gale ; cependant Littré prétend qu'il vient du genevois pouacre pris pour podagre, goutteux… - (15) |
| pouâffer : tousser - (39) |
| pouai (on) : poil - (57) |
| pouai : poil - (37) |
| pouai : n. m. Puits. - (53) |
| pouaiché : louche. Tu veux une pouaiché de soupe ? : tu veux une louche de soupe ? - (33) |
| pouaiche, grosse cuiller en bois. - (28) |
| pouaîds (on) : poids - (57) |
| pouaignée (na) : poignée (de porte) - (57) |
| pouaignet (on) : poignet - (57) |
| pouaile, garlot : n. f. Poële. - (53) |
| pouaillou : individu sale, supposé pouilleux. - (33) |
| pouailu – patoux : poilu - (57) |
| pouain’ne : peine. - (62) |
| pouainai : peiner. On pouaine pou marchai dans la neige : on peine pour marcher dans la neige. - (33) |
| pouain-ne ou poine : Peine. « I est pas la pouain-ne d'échâ » : ce n'est pas la peine d'essayer. - (19) |
| pouain-nè : v. t. Peiner. - (53) |
| pouaiquer : éclater - (37) |
| pouaîre (na) : poire - (57) |
| pouaire : poire - (39) |
| pouairer : poirier - (39) |
| pouaires d’ouîlleaux, pouaires ai bon dieu : en automne, fruit rouge de l’aubépine (pour la nourriture, l’hiver, des petits oiseaux) - (37) |
| pouaîri (on) : poirier - (57) |
| pouaîron (on) : poire (sauvage) - (57) |
| pouaîrouni (on) : poirier (sauvage) - (57) |
| pouairoux : peureux - (37) |
| pouais (on) : pois - (57) |
| pouais. n. m. - Haricot à écosser. - (42) |
| pouaison (on) : poison - (57) |
| pouaîsse : pêche - (39) |
| pouaisson (on) : poisson - (57) |
| pouaissonnerie (na) : poissonnerie - (57) |
| pouaissonnier (on) : poissonnier - (57) |
| pouaite. Poète… - (01) |
| pouaitrail (on) : poitrail - (57) |
| pouaitrine (na) : poitrine - (57) |
| pouaîvre (du) : poivre - (57) |
| pouaîvrer : poivrer - (57) |
| pouaîvrire (na) : poivrière - (57) |
| pouaîvron (on) : poivron - (57) |
| pouaîvrot (on) - soûlon (on) : poivrot - (57) |
| pouâix (dâs) : (des) poux - (37) |
| pouaix en lai paiye (çarc’er dâs) : (chercher) des « noises » - (37) |
| pouaiyoux : qui a des poux - (37) |
| pouane, s. m. punaise des champs. - (22) |
| pouâque, s. f. on dit des petits oiseaux lorsqu'ils sont nouvellement éclos qu'ils n'ont encore que la « pouâque. » cela signifie qu'ils n'ont encore ni plume ni duvet. - (08) |
| pouâquou, adj. petit oiseau qui n'a encore que la « pouàque. » - (08) |
| pouârte (na) : porte - (57) |
| pouas, s. m., pois. - (40) |
| pouce carré : s. m., ancienne mesure de surface en général valant 7 centimètres carrés 327. - (20) |
| pouce cube : s. m., ancienne mesure de volume en général, qui valait 0 mètre cube 000019814, c'est-à-dire près de 20 centimètres cubes. - (20) |
| pouce : s. m., ancienne mesure de longueur en général. Le pouce était le 1/12 du pied, comprenait 12 lignes et valait 0 m. 027. - (20) |
| pouce, s. m. pouce, le gros doigt de la main ; mettre au pouce signifie faire de main d'ouvrier : « ç'iai ô été mettu au pouce », cela a été fait avec soin. - (08) |
| pouche (n. f.) : sac à grain de cent kilos - (64) |
| pouche (nom féminin) : louche pour servir la soupe. - (47) |
| pouche. n. f. - Poche : louche, ustensile de cuisine. - (42) |
| pouchi, v. a. se dit d'un contenu dont on laisse échapper une partie. Se dit aussi lorsqu'on laisse échapper des mailles en tricotant. - (22) |
| pouchon (on) - pochon (on) : louche (ustensile) - (57) |
| pouchon : poisson. - (52) |
| pouchon, poisson - (36) |
| pouchon, poûyon (n.m.) : poisson - (50) |
| pouçot. n. m. - Pouce. Pouçot, léchepot, longis, malaquis et Pierrot-les-petits forment les cinq doigts d'une main, selon J. Puissant. - (42) |
| pouçou (-ouse) (n.m. ou f.) : peureux (-euse) - (50) |
| poudrer : v. a. Poudrer un contrat, se dit de la coutume propre à certaines communes, qui consiste, lorsqu'un contrat de mariage est signé, à le couvrir de pièces de monnaie au bénéfice des futurs époux. Le notaire donne l'exemple et les assistants le suivent. On dit aussi arroser le contrat. - (20) |
| poudri : poudrer - (57) |
| poudriller : éparpiller. (E. T IV) - VdS - (25) |
| poudriller. Semer, comme de la poudre qu'on jette. - (03) |
| poudrilli : Semer, éparpiller. « En deutant les cendres du poêle alle en a poudrilli partot » : en enlevant les cendres du poële elle en a semé partout. - (19) |
| poudrillir, poudrer. - (05) |
| poudriÿer, v. tr., éparpiller, semer autour de soi ; répandre de la poudre, poudrer. — Au fig., chercher à paraître : « Pou fâre ses embarras, ô n'é pas manchot ; o poudrille prou. » - (14) |
| poudron : s. m., poudre à sécher l'encre. - (20) |
| poudron, s. m - poudre fine. Verbe poudrœyi, saupoudrer. - (24) |
| poué (n.m.) : puits - (50) |
| poue : peur - (50) |
| poûe : peur, je zeu poûe : j’ai peur. - (66) |
| pouè : poil, cheveu - (48) |
| poué : poil. - (32) |
| pouè : poil. - (52) |
| pouê : puits. - (29) |
| pouè fleurtot : petit poil fin - (39) |
| pouè foulot : poils clairsemés, duvet de l'adolescent - (48) |
| poué – puits. - I vâ fâre creusai in poué dan note jairdin. - En veint de bôchai le grand-poué qu'éto su lai Pliaice. - (18) |
| pouè : (pouè - subst. m.) 1- poil. 2- cheveu. - (45) |
| poué : (poué: - subst. m.) puits. - (45) |
| pouè : poil - (39) |
| poué : puits - (39) |
| pouè : s. m. la plante qu'on laisse après qu'on a èch’arji. - (21) |
| pouè : s. m. poil. - (21) |
| poué : s. m. puits. - (21) |
| poué, adv. de quantité. peu, en petite quantité. accompagné de la négative, poué = poi, signifie point du tout comme dans cette phrase : tu n'en auras pas « eun poué. » - (08) |
| pouë, et poûr, s. f., peur : « Va donc ! a pas pouë ! » - (14) |
| poué, puits. - (16) |
| poué, s. f. poix, résine. - (08) |
| poué, s. m. poil, cheveu. - (08) |
| poué, s. m. puits : « l'eai deu poué ô crée », l'eau du puits est acre, mauvaise, désagréable au goût. - (08) |
| poué. s. m. Puits. - (10) |
| pouéc’e, poûc’e : louche pour la soupe, le lait, l’eau - (37) |
| pouéce (n.f.) : louche - (50) |
| pouèche : louche - (48) |
| pouèche : (pouèch' - subst. f.) louche. - (45) |
| pouèche, poiche. n. f. - La louche, l'ustensile de cuisine. Se dit poche, à Sougères-en-Puisaye. - (42) |
| pouèche, poiche. s. f. Poche, sorte de grande cuiller en forme de coupe pour servir le potage. Du latin poculum. - (10) |
| pouéchée, pouéchie : contenu d'une louche. - (33) |
| pouèchée, pouèchtée : louchée (contenu d'une louche) - (48) |
| pouéchenot (eun), s. m. un peu, une petite quantité. - (08) |
| pouèchie : (pouèchi: - subst. f.) contenu d ' une louche. - (45) |
| pouéch'no (un) : un peu. - (52) |
| pouéch'no : peu (un pouéch'no : un peu). - (33) |
| pouèchon : poisson - (48) |
| pouechon : poisson. - (33) |
| pouêchon : n. m. Poisson. - (53) |
| pouée (n.f.) : poire - (50) |
| pouée : puits - (48) |
| pouée : poire, fruit du pouérier. - (58) |
| pouée, pouère. n. f. - Poire. - (42) |
| pouée, s. f. poire, fruit du poirier : « aine pouée biosse », une poire blette. (voir : pouére.) - (08) |
| pouéer, poiger, poiser (pour puiser). v. n. S'enfoncer dans la boue, prendre l'eau dans ses chaussures (Diges, Puysaie). - (10) |
| pouéfou. n. m. - Poil dans le cou. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| pouéfoulot, s. m. poil follet, duvet. en plusieurs lieux « poifou, pouéfou » : le « pouéfou » d'un adolescent. - (08) |
| pouéfoulots : poils épars, clairs, légers sur la figure - (37) |
| pouègai : prendre de l'eau dans ses chaussures. Dans la boue on pouège : dans la boue on prend l'eau dans les chaussures. - (33) |
| pouége, s. f., poix. - (14) |
| pouége. Poix. - (03) |
| pouèger : enrager, rouspéter - (48) |
| pouègne : peine - (48) |
| pouègnée (pouègnie) : poignet - (39) |
| pouègner : peiner - (48) |
| pouègnet : poignet - (48) |
| pouègnie : poignée - (48) |
| poueiller : poirier. (SS. T IV) - N - (25) |
| pouein : n. m. et adv. (avec la négation ne) Point. - (53) |
| poueine : n. f. Peine. - (53) |
| poueine. s. f. Peine. (Montillot). - (10) |
| poueiñne n.f. Peine. - (63) |
| pouein-ne, s. f., peine : « Ah! voués-tu, d'avou tes bouderies, te m'fais prou d’la pouein-ne. » - (14) |
| pouèjer : (pouèjé - v. intr.) trépigner (de rage, de dépit, de jalousie ... ). - (45) |
| pouél : un poil - un poué bian étant le duvet d'un adolescent ou le mot désignant une personne aux cheveux blancs - un poué foullot sont les premiers poils de barbe qui poussent de manière irrégulière - (46) |
| pouél. n. m. - Poil. - (42) |
| pouélchi : s. m. prunellier. - (21) |
| pouêle (on) - garlot (on) : poêle (fourneau) - (57) |
| pouêle. n. f. - Poêle. - (42) |
| pouêlée (n. f.) : repas destiné à fêter la fin des travaux des champs, moisson ou vendanges - (64) |
| pouèlée : fête que l'on fait à la fin des récoltes - (39) |
| pouêlée, fin d'un mets plusieurs fois servi - (36) |
| pouêlée. n. f. - Repas de fête, lorsque la moisson est terminée et la dernière gerbe rentrée. Se dit pêlée à Sougères-en-Puisaye. - (42) |
| pouèleuche : s. f. prunelle. - (21) |
| pouéloter, v. n. se dit des herbes courtes et sèches qui se trouvent dans certains prés et qui se rebroussent sans être abattues par la faux. - (08) |
| pouèlou : poilu - (48) |
| pouélou : poilu, velu - (37) |
| pouélou : poilu - (39) |
| pouélou, ouse, adj. poilu, qui a beaucoup de poil. poileux et poilous ont été des termes de mépris. - (08) |
| pouêlounée. n. f. - Poêle bien remplie. - (42) |
| pouène - (39) |
| pouèner : peiner. - (52) |
| pouenne (ai) : (à) peine - (37) |
| pouenner : peiner - (37) |
| pouère : la poire (pouèrotte, une petite poire) - (46) |
| pouère : poire - (43) |
| pouère : poire - (48) |
| pouèré : poirier - (48) |
| pouère ai bon dieu : n. f. Baie de l'aubépine. - (53) |
| pouèré : n. m. Poirier. - (53) |
| pouéré, poirier - (36) |
| pouéré, poirier et piquette de poires ou d'autres fruits. - (16) |
| pouére, s. f poire. (voir : douneu.) - (08) |
| pouère, s. f. poire. Pouéri, poirier. Pouéron, petite poire. Pouéronni, poirier sauvage. - (24) |
| pouére, s. f., poire. - (14) |
| pouère, s. f., poire. - (40) |
| pouéré, s. m. poirier. - (08) |
| pouère. Poire. - (49) |
| pouérei, s. m., poirier. - (14) |
| pouèreil : un poirier - (46) |
| pouèrer : poirier. - (52) |
| pouér-i : poirier - (43) |
| pouériau, pouéreau, poiriau, poreau, pouriau. n. m. - Poireau. - (42) |
| pouérier. n. m. - Poirier. - (42) |
| pouéron : poire sauvage, non greffée. A - B - (41) |
| pouèron : (nm) poire sauvage - (35) |
| pouéron : petite poire ronde, poire sauvage - (43) |
| pouéron : poire non greffée - (34) |
| pouèron, poîron n.m. Poire sauvage. - (63) |
| pouèrond, poirond. Petite poire sauvage généralement ronde d'où son nom probablement. - (49) |
| pouèroni : poirier sauvage - (35) |
| pouèroni : poirier sauvage - (43) |
| pouèrot : poireau - (48) |
| pouèrotte : poire sauvage - (48) |
| pouèrotte : n. f. Poire sauvage de petite taille. - (53) |
| pouèrotté : n. m. Poirier sauvage. - (53) |
| pouérou, ouse, adj. peureux, craintif. - (08) |
| pouéru (-se) (adj.m. et f.) : peureux, peureuse - (50) |
| pouéson. n. m. - Poison. - (42) |
| pouesse : louche. Son contenu est une pouessée. - (52) |
| pouesse : louche - (39) |
| pouesse, louche - (36) |
| pouessée : louchée - (39) |
| pouéssiau, s. m. échalas (du latin paxillus). - (24) |
| pouèsson : poisson - (48) |
| pouésson, s. m., poisson, ressource de nos deux rivières. - (14) |
| pouésson. n. m. - Poisson. - (42) |
| pouet (n.m.) : poil - (50) |
| pouet : n. m. Poil. - (53) |
| pouêt, s. m., puits. - (40) |
| pouet, s.m. puits. - (38) |
| pouétrine, s. f., poitrine. - (14) |
| pouêts (on) : puits - (57) |
| pouets : poils. On breulo les pouets du couéchot : on brûle les poils du cochon, les soies… - (33) |
| pouève - (39) |
| pouève : poivre - (48) |
| pouéve. n. m. - Poivre. - (42) |
| pouèvrer : poivrer - (48) |
| pouèvrer : poivrer - (39) |
| pouffer (Se) : v. r., pouffer. « C'est à se pouffer de rire. » (Union Rép., 26 nov. 1902). Voir rigoler (Se). - (20) |
| pouffer : être essoufflé - (48) |
| pouffer : être essoufflé - (39) |
| pouffer, tousser. - (27) |
| pouffiace. Femme malpropre, sans vergogne, de mauvaise vie. (Argot). - (49) |
| pouffiasse. s. f. Fille de mauvaise vie. - (10) |
| pouffiner (verbe) : éternuer. - (47) |
| poufiasse : drôlesse - (60) |
| poûge (on) : pouce - (57) |
| pouge, m. pouce. Pougelin, doigtier pour un doigt blessé. - (24) |
| pouge, pouce. - (05) |
| pouge, s. m. pouce. - (22) |
| pougelin, s. m. doigtier protégeant un doigt blessé. - (22) |
| pougi : Puiser. « Pougi eune saille d'iau » : puiser un seau d'eau. « Pougi es bâtes » : puiser l'eau pour abreuver le bétail. - (19) |
| pougi : v. puiser. - (21) |
| pougnarder (se) : se quereller - (61) |
| pougne, s. f., poigne, poignet : « Ah! l'bigre, qué pougne qu'ô vous a ! » - (14) |
| pougnet, s. m. poignet. - (08) |
| pougnie : poignée. « Baÿe m’en un’ pougnie » : donne m’en une poignée. - (62) |
| pougnie : poignée. - (32) |
| pougnie, paugnie (n.f.) : poignée - (50) |
| pougnie, poignée. - (05) |
| pougnie, s. f. poignée : « aine pougnie d' cindre », une poignée de chanvre, ce que la main renferme pour l'opération du teillage. - (08) |
| pougnie, s. f., poignée, ce qu'on tient dans la main. - (14) |
| pougnie, s.f. poignée. - (38) |
| pougnie. Poignée. - (03) |
| pougnie. s. f. Poignée. (Avallonnais). Du latin pugnus. - (10) |
| pougnon, petit pain. - (05) |
| pougnon, s. m. petit pain. - (22) |
| pougnon, s. m., petite miche que les ménagères font pour les enfants avec le restant de la pâte ; gâteau fait d'une pougnie de farine. - (14) |
| pougnon. Gâteau ou petit pain, ainsi nommé parce qu'il est fait d'une pougnie de farine. Epoigne. - (03) |
| pougnoter v. Caresser, dorloter, cajoler. - (63) |
| poui ! interj., pouah ! fi ! Exprime le dégoût, la répulsion : « Poui donc ! poui caca ! » dit-on aux enfants pour les empêcher de toucher à quelque chose de malpropre. - (14) |
| poui ! fi – exclamation de dégoût. – Poui ! que ci sent mauvais ! – Poui ! vilain sâle que t'é ! veux-tu bein ailai te laivai. - (18) |
| poui ! fi ! poui don ! fi donc ! - (16) |
| poui, interjection pour marquer le dégoût... - (02) |
| poui, pouah ! - (27) |
| poui. Exclamation de dégoût. - (03) |
| pouïaige, s. m. action de puiser, d'amener à soi de l'eau. Le « pouiaige » d'un puits est plus ou moins pénible suivant qu'il est plus ou moins profond. - (08) |
| pouïer : (pô:yé - v.trans.) puiser (un seau). - (45) |
| pouïer, v. a. puiser, prendre de l'eau : « al ô été pouier d' l'eai é poué », il a été puiser de l'eau au puits. - (08) |
| pouih ! : Pouah ! - (19) |
| pouih ! Pouâh ! - (12) |
| pouih (ï), int. pouah ! - (17) |
| pouih. Exclamation de dégoût, très usitée à Beaune et dans les environs. Pouih ! Quelle horreur ! Mon petit frère a pris un crapaud avec ses doigts. Les Bas- Bretons ont l'adjectif ponc’h, sâle ; pougni veut dire, en wallon, sentir mauvais. - (13) |
| pouil, pou , pouillot. - (04) |
| pouillasser : v. a., pouiller. - (20) |
| pouillasserie. s. f. Habitation misérable, malpropre, sordide. – Se dit aussi, figurément, des personnes qui vivent dans la malpropreté et la misère. De pou. - (10) |
| poûillau : serpolet. - (52) |
| pouillau, pauillau (n.m.) coq (aussi jau, zau) - (50) |
| pouille : le petit oignon - plantè lè pouilles - (46) |
| pouille, et, pouillòt, s. m., pou. - (14) |
| pouille, sm ? pou. - (17) |
| pouille. Pou ; on écrivait autrefois poul, qu'on prononçait pouil, du latin pulex. Nous disons aussi pouillo ; pouillou est un terme injurieux. - (03) |
| pouille. Pou. On écrivait anciennement poul, qu'on prononçait et que depuis on écrivit pouil, en bourguignon pouille de là pouilleus, terme de mépris… - (01) |
| pouilleau (du) : (du) serpolet - (37) |
| pouilleau : coq - (37) |
| pouilleau : coq. On dit aussi. zau, cau ou jau. - (52) |
| pouiller (se) : gratter (se) - (48) |
| poûiller : rechercher avec minutie, avec insistance - (37) |
| pouiller, v. tr., chercher et ôter les poux, plutôt avec les doigts qu'avec le peigne. - (14) |
| pouiller. Chercher et prendre les poux dans la tête de quelqu'un. Dans un sens plus étendu, chercher. - (49) |
| pouille-revi. Pou mal écrasé, revenu, en quelque façon, de mort à vie, terme d’humiliation pour un pécheur qui veut s'anéantir devant Dieu ; quelquefois aussi terme injurieux, quand on s’en sert par mépris contre des gens à qui on reproche la bassesse de leur premier état. - (01) |
| pouilleröte, sf. piment sauvage, thym des prés. - (17) |
| poûilli (s') v. S'épouiller. - (63) |
| poûillon : mauvaise odeur, poison - (48) |
| pouillon : puceron - (43) |
| pouillon : n. m. Individu sale supposé pouilleux. - (53) |
| pouillon, pôyon (n.f.) : poison - (50) |
| pouillon, s. f. poison. S'emploie pour désigner tout breuvage mauvais au goût ou à la santé. - (08) |
| poûillot : pou - (48) |
| pouillot : n. m. Pou. - (53) |
| pouillot, guérdau. Pou. - (49) |
| pouillot, pou - (36) |
| pouillot, pou. - (05) |
| pouillot, s. m. pou, insecte parasite. - (08) |
| pouillot, subst. masculin : pou. - (54) |
| pouilloû, adj., pouilleux, misérable. S'emploie pour injurier : « Oh! l’pouilloû ! » dit-on à un traînard, fainéant, mal accoutré. - (14) |
| pouillou, misérable... - (02) |
| pouillou, ouse, adj. pouilleux. sm. Habitation malpropre ; maison misérable. - (17) |
| pouillou, ouse, pouilleux, euse, celui ou celle qui a des poux. - (08) |
| poûilloux(e) : pouilleux, pouilleuse - (48) |
| pouilloux, pauvre par inconduite. - (05) |
| pouilloux, pouillouse : adj., pouilleux, pouilleuse. - (20) |
| pouilloux. Par extension, malpropre. - (49) |
| pouiner, misérer : peiner - (43) |
| pouiñne : (nf) peine - (35) |
| pouin-ne, s. f. peine, physique ou morale. Pouin nàyé, qui est peiné physiquement. - (22) |
| pouin-ne, s. f. peine, physique ou morale. Pouin-nayé, qui est surmené, qui peine. - (24) |
| pouin-ne. Peine. « Avoir de la pouin-neé. - (49) |
| pouiñner : (vb) peiner - (35) |
| pouîot, s. m. thym commun que l'on cultive dans les jardins. - (08) |
| pouis, sm. puits. - (17) |
| pouiser, v. tr., puiser, de l'eau, etc. - (14) |
| pouit : Puits. « La barjale du pouit » : la margelle du puits. « Ol a laichi cheu la saille au pouit » : il a laissé tomber le seau dans le puits, c'est à dire il a manqué de prudence. - (19) |
| pouit, s. m., puits. - (14) |
| pouitrou-jacquai. : Barbarisme de langage, au lieu de patron-jacquai. Se lever dès patron-jacquai, ou comme patron-jacquai, c'est se lever dès le matin comme faisait saint Jacques, patron des voyageurs. - (06) |
| pouîts : puits. - (62) |
| pouits, puits. - (05) |
| pouizon, poison. - (16) |
| poujer, pouïer (v.t.) : puiser, prendre de l'eau - (50) |
| poujer, v. a. puiser, prendre de l'eau. « Poujer » est le même mot que « pouier « avec une signifie, plus restreinte. Nous ne l'employons guère qu'avec le sens de prendre de l'eau dans ses chaussures en traversant un lieu humide. - (08) |
| poujeure : crochet du puits. (MM. T IV) - A - (25) |
| pouji v. Poser. Te dvros l'pouji su l'fû. Tu devrais le poser sur le feu. - (63) |
| poul, s. m. bouillie de farine d'avoine, de sarrasin, etc. - (08) |
| poulache : Prunelle. « Du boire de poulaches » : de la boisson faite d'eau dans laquelle on a mis macérer des prunelles. - (19) |
| poulache : s. f., peloce, prunelle. - (20) |
| poulachi : Prunelier, prunus spinosa. « Eune boucheure de poulachis » : une haie de pruneliers. - (19) |
| poulachi, v. n. desserrer, lâcher. - (22) |
| Poulachon, surnom. - (38) |
| Poulacre. Polonais. Poulacre est corrompu de Polaque. L'Italien Polacco. - (01) |
| poulaille (na) : poule - (57) |
| poulaille : s. f., volaille ; os dépené. - (20) |
| poulaille, n.f. poule. - (65) |
| poulaille, s. f. poule. Poulàyi, poulailler. - (22) |
| poulaille, s. f., poule. - (40) |
| poulaille, s.f. poule. Terme de batteur ; disposition des gerbes sur l'aire. - (38) |
| poulaille, volaille, pouleille. - (04) |
| poulailli (on) : poulailler - (57) |
| poulaillon. n. m. - Jeune poulet. - (42) |
| poulain (pulvinus), chassis de bois pour descendre les tonneaux à la cave. - (04) |
| poulain : (poulin: - subst. m.) 1- poulain, petit de la jument. 2- mère de vinaigre (mycoderma aceti). - (45) |
| poulangis : étoffe. I, p. 26-1 ; V, p. 41 - (23) |
| poulangis. n. f. - Étoffe grossière. - (42) |
| poulangris, poulangis, s. f. étoffe grossière analogue à la serge ou à la tiretaine, avec laquelle les Morvandeaux se fabriquaient leurs vêtements - (08) |
| poulas. s. m. Coquelicot. (Bessy). - (10) |
| poulassi : prunellier. (BY. T IV) - S&L - (25) |
| poulât (pouyôt) : poulet - (39) |
| poulat, poulot : coq, poulet - (48) |
| poule de pin. Cône de pin, (Strobile). - (49) |
| poule d'eau. on donne ce nom aux ouvriers chargés de surveiller le flottage des bois. - (08) |
| poule que c’ante qu’ai faisu l’oeû ! (y ot lai) : c’est celui qui se défend un peu trop qui est certainement le coupable - (37) |
| poule. : Couri lai poule signifie musarder, rechercher les femmes. - (06) |
| poule-à-gâtron. s. m. Enfant sale, dégoûtant, que sa mère ne surveille pas et laisse vagabonder et trainer par les rues. (Elivey). – Voyez gâtron. - (10) |
| poule-grasse (n.f.) : lampsane commune - (50) |
| poule-grasse : Lampsane, lampsane communis. Plante sauvage qu'on rencontre dans les jardins et les champs. Comestible en salade avec d'autres plantes mélangées. - (19) |
| pouléille (n.f.) : volaille - (50) |
| pouleille : Poule. « I est la pouleille que chante qu’a fait l'û » : c'est la poule qui chante qui a pondu, et au figuré : c'est la personne qui se défend sans qu'on l'accuse, qui est coupable. - (19) |
| pouleille : n. f. Poule. - (53) |
| pouleille, polaille. Poulaille. - (49) |
| pouleille, s. f. volaille. - (08) |
| pouleilli : Poulailler. « Des ûs tot frais seurtant du pouleilli » : des œufs tout frais sortant du poulailler. - (19) |
| pouleriot, s. m., thym cultivé des jardins. - (40) |
| poulesses, prunelles. V. pelosses. - (05) |
| poulet sans os : s. m., pomme de terre. Pour mon déjeuner, j'ai mangé des poulets sans os. - (20) |
| poulet : s. m., coq. Voir chanter. - (20) |
| poulet, n.m. coq, coq des clochers. - (65) |
| pouleton : peloton. IV, p. 15-1 - (23) |
| poulette. n. f. - Ampoule, synonyme de bouflotte. - (42) |
| poulette. s. f. Abréviation d'ampoulette, petite ampoule. J'ai des poulettes plein les mains. (Arcy-sur-Cure et à peu près partout). - (10) |
| poulin : Nom masculin. Pièce de bois, ronde armée de fer à une extrémité, servant de plan incliné, pour charger les futs sur les véhicules de transport. - « Eune pâre de poulins » : une paire de poulins. - (19) |
| poulin, poulet. - (26) |
| pouline. Pouliche. - (49) |
| poulite, s. f. un des noms de la bouillie d'avoine, de sarrasin, de pommes de terre, qu'on appelle aussi « picoulée. » - (08) |
| poulo, poulet, coq. - (16) |
| poulô. Poulet, soit dans le propre pour le petit de la poule, dans le figuré pour un billet amoureux… - (01) |
| poulo. Poulet. - (03) |
| pouloshe : prunelle. Certains diront pelosse ou plosse, fruit du plossier ou pouloshier : le prunelier ou peurnaler ou encore épeûne noire. Mêmes objet et définition que peurnale (voir). - (62) |
| poulòsse, s, f. prunelle des haies. Poulòssi ou pouléssi, prunellier. - (22) |
| poulot (on) : poulet - (57) |
| poulot : le poulet ou le coq - (46) |
| poulot : poulet - (37) |
| poulot : poulet - (44) |
| poulot : Poulet, coq. « Eune plieume de poulot » : une plume de coq. « Le poulot du clieuchi » : le coq du clocher. « La chanson du poulot roge » : une chanson qui n'en finit pas, une scie. (Voir à roge) - (19) |
| poulot : n. m. Poulet. - (53) |
| poulòt, adj. employé dans les deux genres. Expression d'amitié, terme de caresse, qu'affectionnent surtout les enfants entre eux : « J’t’ain-me ben, mon poulot, ma poulòte. » — « Y et eun gentit poulòt. » - (14) |
| poulot, poulet. - (05) |
| poulot, s. m. poulet, volaille en général. se dit principalement du coq. Quand on parle du « cô », dans notre région, on entend le coq d'inde, le dindon. en plusieurs lieux, on prononce « pouillot. » - (08) |
| poulòt, s. m., jeune poulet. - (14) |
| poulot, s.m. poulet, coq. - (38) |
| poulöt, sm. poulet. - (17) |
| poulot, subst. masculin : poulet. - (54) |
| poulot. Poulet. - (49) |
| poulotte, jeune fille. - (05) |
| Poulouche, surnom. - (38) |
| pouls, « L » bouillie, puls, id. - (04) |
| poulthié, celui qui vend de la volaille en gros. - (16) |
| poulton (n. m.) : peloton, de laine, de ficelle, ... (ête au bout d'ses poultons (être au bout de son rouleau)) - (64) |
| poulton, s. m. peloton ; fil, laine, soie, ramassé en boule. diminutif de pelote. - (08) |
| poulton. s. m. Peloton. (Druyes). - (10) |
| poumâche. n. f. - Mâche. - (42) |
| poumâche. s. f. Sorte de salade, la même que la mâche ou doucette. - (10) |
| poume (une) : une pomme - (61) |
| poume : la pomme - lè poumes sont peûries, les pommes sont pourries - (46) |
| poume d'amour, s. f., baie du pommier d’amour (amome des jardiniers, oranger du savetier). - (14) |
| poume de tare, pomme de terre. - (14) |
| poume d'orange, s. f., orange. - (14) |
| poume : n. f. Pomme. - (53) |
| poumé, pom-mé : n. m. Pommier. - (53) |
| poume, s. f. pomme, fruit du pommier. - (08) |
| poume, s. f., pomme. - (14) |
| poume, s. f., pomme. - (40) |
| poumé, s. m. pommier. - (08) |
| poume, s.f. pouwe. - (38) |
| poumei, s. m., pommier. - (14) |
| poumeil : un pommier - (46) |
| poumetare : pomme de terre. - (21) |
| poumier : pommier, le fruit est la poum'. - (58) |
| poumlette, s. f. paume à jouer. - (22) |
| poummaÿ, s. m., pommier. - (40) |
| poumme (na) : pomme - (57) |
| poumme, poummé, pomme, pommier. - (05) |
| poumme, s. f. pomme. - (22) |
| poumme. n. f. - Pomme. - (42) |
| poummi (on) : pommier - (57) |
| poummier. n. m. - Pommier. - (42) |
| poumotte : la doucette, la mâche - (46) |
| pouner, poner, ponner. v. a. et n. Pondre. (Puysaie et un peu partout). - (10) |
| pouner, ponner. v. - Pondre. - (42) |
| poùner, v. tr., pondre. - (14) |
| poùneûse, s. f., pondeuse, poule qui pond. - (14) |
| pounot : homme tâtillon. (LS. T IV) - Y - (25) |
| pounot, ponot. n. m. - Homme qui exécute le travail habituellement réservé à la femme : « Soun houmme qu'était un pounot était aux p'tits soins pour elle, n’y laissait pus rienfai'e. » (Fernand Clas, p.286) - (42) |
| pounot. s. m. Pondeux, homme qui fait l'ouvrage d'une femme. (Etais). - (10) |
| pounou, ouse, s. et adj. peureux, poltron. se dit par allusion à la poule, prompte à s'effaroucher lorsqu'elle est dans le nid et pond ses oeufs. (voir : poner, poneau.) - (08) |
| pounouée. n. f. - Boule de graisse sous le ventre de l'oie. - (42) |
| pounouée. s. f. Pelote de graisse sous le ventre d'une oie. (Sommecaise). - (10) |
| poùnu, part, de pouner, pondu. - (14) |
| pouotte : porte. (B. T IV) - D - (25) |
| poupâ, s. m. se dit pour papa, père : « ain boun poupà. » - (08) |
| poupas. s. m. Nénuphar. (Annay-sur-Serein). - (10) |
| poupée : s. f., mâche. Voir levrette. - (20) |
| poupée, s. f. on appelle « poupée » ou « plain » le paquet de la meilleure filasse prête à être mise sur la quenouille. - (08) |
| poupéte : Poupée « Je te donnerai eune poupéte pa le jo de l'an ». - (19) |
| poupette (na) : huppe (oiseau) - (57) |
| poupette*, s. f. poupée. - (22) |
| poupette, s. f. poupée. - (24) |
| poupiat. s. m. Bardane. (Argenteuil). - (10) |
| poupine, s. f. petite poupée. diminutif de poupée. - (08) |
| poupiner (se), v. réfl. se faire « poupin » ou « poupine », porter une toilette à prétention, s'attifer. - (08) |
| poùponer (se), v. pron., se poupiner, se bichonner, se parer, se friser, comme on ferait d'un poupon. - (14) |
| poùpôte, s. f., huppe. - (14) |
| poupote. Huppe. - (03) |
| poupotte, huppe (oiseau). - (05) |
| poupoute - mot par lequel on désigne la soupe ou autre petite nourriture quand on parle aux petits enfants. - Teins, mon enfant, veins méger tai poupoute, le minou vouro l'aivoir. - Oh lai bonne poupoute, mon petiot chéri ! ci vai te fâre deveni grand. - (18) |
| poupoute : huppe. L’oiseau ! (Prédateur patenté de la courtilière : le coutrillot). - (62) |
| poupoute : s. f., popote, soupe, bouillie. - (20) |
| poupoute. Soupe. (Langage enfantin). - (49) |
| pouquai : pourquoi - (57) |
| pouquelin : voir poquelin. - (20) |
| pouquiotte. s. f. Pochette d'enfant. Du latin pocca, poccella. (Puysaie). - (10) |
| pour (en) (loc. adv. et prép.) : en échange de - (64) |
| pour (en) : en échange - (61) |
| pour (en), en échange (ex, Qu'est-ce que je te donnerai en pour ?). - (27) |
| pour (En). Locut. prépos. En échange. Donne-moi ça en pour. - (10) |
| pour (en). prép. - En échange : « Paul nous a appourté des girolles ! En pour va don ' i pourter un bout d' gâtiau. » Cette préposition est un vestige de l'ancien français empor ou empour, issus du latin pro (à la place de, en retour). - (42) |
| pour (En). Voir empour. - (20) |
| pour : pauvre - (60) |
| pour' : pauvre - (61) |
| poûr : pauvre, misérable. III, p. 63-o - (23) |
| pour amour que, pr’ amou’ que : vx fr. por amor que (v° Amor), loc, parce que. - (20) |
| pour ça. Locution adverb. Cependant, néanmoins, nonobstant. (Très-usité à Auxerre). - (10) |
| pour dedans, loc. dedans, à l'intérieur : pour le voir, il faut regarder « pour dedans. » - (08) |
| pour : pauvre. Ex : "Il t’ait ben acamandé, l’pour’houme !" - (58) |
| pour, poürus, peur, peureux, pou, poiru. - (04) |
| pour, poute. : Repousé, ée ; dérivation naturelle du latin pulsus, participe passé de pellere. - (06) |
| pourbouaîre (on) : pourboire - (57) |
| pour-chaplure : s. m., planche à hacher. A rapprocher du vx fr. pouer. v. a., couper. - (20) |
| pourchas s. m. Celui qui est habile à se tirer d'affaire, à qui tout est bon, tout profite. – Se dit aussi pour savoir-faire, adresse, habileté. Il est d'un bon pourchas. - (10) |
| pourchenèshe : mauvaise herbe vivace . Comme dans train’èshe on retrouve le suffixe péjoratif « èshe ».Le nom pourrait venir de pour les chenesses (noms donnés à de mauvais chiens, dans d’autres provinces françaises). (?) - (62) |
| pourciau, s. m., pourceau. - (14) |
| pourdâré, pordairé, perdairé, prép. de lieu. par derrière : mon jardin est « pourdaré » sa maison. - (08) |
| pour-de-loeu, s. m. ail sauvage. Littéralement : poireau de loup. - (22) |
| pourdiqui, adv. de lieu. - (08) |
| pourdiqui, pordiqui (adv.) : par ici - (50) |
| poûre (adj.) : pauvre - (64) |
| poure : pauvre - (43) |
| poure : pauvre, pas démuni mais qui inspire de la pitié. Un poure gars : un pauvre gars. - (33) |
| poûre adj. Pauvre. - (63) |
| poure rien : loc, pour rien. - (20) |
| poure, adj. et subst. pauvre, misérable, malheureux : - (08) |
| poûre, prép., pour : « Vous baulez tôjor poure rien. » La finale de ce mot est des plus accentuées, de sorte que « pour rien » se prononce : poureùrien (la seconde syllabe comme la première d'heureux). - (14) |
| poure. n. m. - Pauvre : «Mon poure p'tit ! T'as pus ren à t'mét' su' l'doûs. » Ce mot, directement issu de l'ancien français poure (du latin pauper : pauvre, faible, maigre) a peut-être subi l'influence de l'anglais poor, de prononciation et signification identiques. - (42) |
| poure. Pauvre, vieux mot. - (03) |
| poure. s. m. et f. Pauvre. Mon poure houme. Ma poure femme. Les poures de Guieu (les pauvres de Dieu). - (10) |
| poureau (un) : un poireau - (61) |
| poureau : (pouro - subst. m.) 1 – poireau. 2- envie, petit filet qui se détache de la peau autour des ongles (sans doute par comparaison avec les feuilles du poireau, qui se détachent de la tige de façon semblable). - (45) |
| poureau : poireau. Ex : "J’ons deux bounes rées d’poureaux dans l’jardin ! T'vas pouvouée’ fée d’la soupe, ma Grousse !" (Rée = raie - Grousse = grosse). - (58) |
| poureau : s. m., poireau. De la soupe aux poureaux. - (20) |
| poureau, s. m. narine, fosse nasale ou plutôt, hélas ! les mucosités qui en sortent. Environs de Lormes, une mère dit à son morveux d'enfant : « torce don té deu poureaux. » - (08) |
| poureau, s.m. poireau. - (38) |
| poureau. Poireau. - (49) |
| pourée : poireau. Les pourées ne gélont pas : les poireaux ne gèlent pas. - (33) |
| pourée, porée, s. f. poireau. « pohiau ». - (08) |
| pourée, pourrée. s. f. Poirotte, plant de poireaux. (Saint-Florentin). - (10) |
| pourerie, sf. débris répandus à terre. Quantité innombrable. - (17) |
| poureriez, 2ème pers. pl., cond. de pouvoî, pourriez. — Les 1res et 2èmes pers. pl. de ce temps des verbes en voir : savoir, revoir, etc., subissent presque toutes l'intercalation de la syllabe re (très fortement prononcée). - (14) |
| poureté, s. f. pauvreté, indigence. - (08) |
| pourette : s. f., vx fr. porette, ciboulette (allium schœnoprasum). - (20) |
| pourette. Ciboulette. - (49) |
| poureuté, gâteau que l'on fait avec de la purée de poireaux. - (27) |
| pourgalai : pourchasser. - (33) |
| pourgalanter, v., poursuivre de ses assiduités. - (40) |
| pourgaler. v. a. Poursuivre, pourchasser. (Coutarnoux, Etivey). - (10) |
| pourgaller on porgaller. Secouer, au figuré, gronder, blâmer. Etym. inconnue. - (12) |
| pourgi, v. a. perdre, éparpiller. - (22) |
| pouriat, s. m. bois pourri par l'usage ou l'humidité. - (08) |
| pourie, s. f., sorte de plante ligneuse, qu'on trouve volontiers dans les haies. Très recherchée des enfants pour sa saveur sucrée. - (14) |
| pourin : poireau. (PLS. T II) - D - (25) |
| pourin, poireau. - (26) |
| pouriot : gésier - (48) |
| pouriot, s. m., fruit de l'airelle ou myrtille. - (11) |
| pourlicher : lécher - (44) |
| pourlouaichè, beurlouaichè : v. pr. Se pourlécher. - (53) |
| pouro : un poireau - (46) |
| pouro, poireau ; on appelle aussi pouro l'ail sauvage à fleur bleue. - (16) |
| pourœte, s. f. ciboulette. - (22) |
| pourosse, s. f. pauvresse, mendiante. - (08) |
| pourot (on) : morve - (57) |
| pourot (on) : poireau - (57) |
| pourot : poireau. - (62) |
| pourot : n. m. Poireau. - (53) |
| pouròt, et pòròt, s. m., poireau. - (14) |
| pourot, pourottére - poireau, espèce de tarte faite avec des poireaux. - I ai pliantai ine pliainche de pourots ; ç'â bon cequi. - Note fonne, en chauffant le for é fait ine pourottére ; i n'eume diére cequi. - (18) |
| pourot, s. m., poireau. - (40) |
| pouröt, sm. poireau. - (17) |
| pourote, petite plante à feuilles en tube dont on assaisonne certains mets. - (16) |
| pouroté. Flan aux poireaux. J'irons dimoinche ai lai feite de Nautoux pour mainger du pouroté (V. flan). - (13) |
| pourotte (d'la) : poireau (à repiquer) - (57) |
| pourotte : le plant de poireau - (46) |
| pourou (ze) : (adj) peureux (se) - (35) |
| pourou : peureux - (43) |
| poûroù, adj., peureux, timide. - (14) |
| pourpoint (n. m.) : frelon - (64) |
| pourquii, pourtii, prép. autour de, environ, à peu près : pourtii scii, autour de six. - (38) |
| pourquoué. conj. - Pourquoi. - (42) |
| pourraï, s.m. pommier. - (38) |
| pourrait y avoir confusion avec guîgni (guigner, convoiter) mais l'image du mendiant qui remue sa sébile peut être à l'origine de l'expression. - (63) |
| pourre (on) : pauvre - (57) |
| pourre : pauvre - (51) |
| pourre : pauvre. - (09) |
| pourrée, paurrée (n.f.) : poirée, poireau - (50) |
| pourriat. n. m. - Bois pourri. - (42) |
| pourrie, s. f. morelle, solanum nigrum de Linné. - (11) |
| pourrieux. s. m. Gésier. (Etivey). - (10) |
| pourrisson. s. m. Lit, oreiller d'enfant remplie de menues pailles, de balles d'avoines ou de feuilles de hêtres. - (10) |
| pourson : n. m. Individu très sale, repoussant. - (53) |
| pourtau, s. m. portail. - (22) |
| pourté : v. t. Porter. - (53) |
| pourte. n. f. - Porte. - (42) |
| pourteau, port. - (05) |
| pourtée, s. f. portée. - (08) |
| pourtée, s. f., cruche. - (40) |
| pourtefon. s. m. liège flottant d'une ligne de pêcheur. - (08) |
| pourtement, s. m. comportement, manière dont on se comporte, état de la santé, situation physique ou morale. - (08) |
| pourter : porter - (48) |
| pourter, v. a. porter. on dit aussi « aipourter. » (voir : empourter.) - (08) |
| pourter, v. porter. - (38) |
| pourter. v. - Porter. - (42) |
| pourtera, s.m. portrait. - (38) |
| pourteû d’iau : porteur d’eau à la machine à battre - (37) |
| pourteux. n. m. - Porteur, celui qui porte la hotte. - (42) |
| pourtoû : porteur - (48) |
| pourtoué, s. m. matrice des femelles, des vaches, des brebis, etc. - (08) |
| pourtout (tout), adv. partout. - (38) |
| pourtu, pértu. Pertuis. - (49) |
| pourtu, s.m. pertuis, trou ; entrée dans une vigne, un mur. - (38) |
| pourtus, pourtusi, pertuis, trou, trouée. - (05) |
| pourvéance. : (Dérivation du régime latin providentiam), providence. La pourvéance de Dieu, c'est à-dire la providence divine. ( Franch. de Seurre, 1341.) - (06) |
| pous, s .f. pl. bouillie de maïs, de riz ou de froment. Verbe epouter, tourner en bouillie. - (24) |
| pouser : poser - (57) |
| pouser, v. a. poser, mettre à bas, se dépouiller de. (voir : poser.) - (08) |
| pousou (on) : poseur - (57) |
| pousrotte : la poussière - (46) |
| pous'rotte : poussière - (48) |
| poussaillou : poussiéreux - (57) |
| poussan : Pousse, bourgeon. « Les lilas ant déjà des grands poussans». - (19) |
| poussatoux : Poussièreux. « Mes habits sant tôtpoussatoux ». - (19) |
| pousse (n. f.) : poussière - (64) |
| pousse : poussière. Ex : "N'a trop ben d'pousse, j'vas balayer." - (58) |
| pousse, poussiée. n. f. - Poussière ; mot employé au XVIIe siècle, on disait aussi poussier. - (42) |
| pousse, s. f. pis d'une vache, d'une chèvre. - (22) |
| pousse, subst. féminin : dispute, vive réprimande, engueulade. - (54) |
| pousse. s. f. Poussière. (Sainpuits). - (10) |
| pousse-cul, presson. Gratte-cul, fruit de l'églantier. - (49) |
| pousségre, v. a. poursuivre, suivre avec vitesse, avec ardeur; au partie, passé « pousségu. » - (08) |
| pousségu, poussigué (p.p.) : participe passé d'un verbe peu usité que de Chambure signale : poussègre =poursuivre avec ardeur, suivre rapidement - (50) |
| pousseire. Poussière. - (01) |
| pousse-mou : s. m., syn. de cognedoux. - (20) |
| pousser (Se) : v. r., se reculer. Pouss’ te donc un peu. - (20) |
| pousser aine âcoûrue (y) : (le) poursuivre en le menaçant - (37) |
| pousser un bout loc. Donner à manger aux vaches à l'étable. - (63) |
| pousser, v. a. poursuivre, pousser, donner lâ chasse à quelqu'un ou à un animal. - (08) |
| poussëre, pousseûre, poussière. - (16) |
| pousserote : (pous'rot' - subst. f.) neige poudreuse que le vent chasse et accumule en congères. Synonyme de sourine. - (45) |
| pousserôte, s. f., poussière, celle de la paille brisée par le fléau, d'abord ; puis, par extension, toute autre poussière. - (14) |
| pousserotte (n.f.) : neige fine poussée par le vent - (50) |
| pousserotte, poussot : n. m. Flocon de neige, de foin ou de paille. - (53) |
| pousserotte, s. f. neige fine et congelée que le vent soulève comme de la poussière. - (08) |
| pousserotte, s.f. poussier. - (38) |
| pousse-treuffes, subst. masculin : sarbacane. - (54) |
| pousseu (être en). Etre irrité, en colère, en pataroux. - (12) |
| poussi (se) v. Se reculer, s'écarter du passage. - (63) |
| poussi. Poussif. - (01) |
| poussié, s. m. molécule de poussière. exprime l'unité dans le terme collectif poussière. On ramasse un « poussié » ; on ôte un « poussié » tombé dans du lait; un « poussié » vole dans l'air. - (08) |
| poussiér' : n. f. Poussière. - (53) |
| poussier, poussière. - (04) |
| poussire (d'la) - ch'ni (du) : poussière - (57) |
| poussire : poussière - (43) |
| poussire, .s. f. poussière. - (24) |
| poussirou : poussiéreux - (43) |
| poussnaère, s.f. poussière - (38) |
| pousso : mot masculin désignant la poussière - quand on éteû au battouère, on mingè plein d'pousso, quand on faisait le battage, on mangeait plein de poussière - (46) |
| pousso, poussière qui sort du crible ou du van. - (16) |
| poussö, sm. poussier, poussière. - (17) |
| pousson (n. m.) : germe de la pomme de terre - (64) |
| pousson : bouton de fleur - (35) |
| poussons de treuffes : yeux de pommes de terre - (43) |
| poussot - grain de poussière, fine poussière ; un petit peu. - Pou ce vent qui en é les uliots pliain de poussot. - Beillez moi z-en don, tenez, ran qu'in pousso, si vo velez. - On peut voir Cheni. - (18) |
| poussot (de nouèze) (loc.) : 1) poussière de neige - 2) petite épaisseur de neige - (50) |
| poussot (Être en). Précipiter le travail. Not' Claudine se mairie aiprés-demain : i seus teut en poussot. - (13) |
| poussot (n.m.) : balle de céréales (aussi boffe) - (50) |
| poussot : débris léger et flottant, flocon - (37) |
| poussot : flocon - (44) |
| poussot : enveloppe des graines qui tombent au battage - (39) |
| poussot, n.m. le petit flocon de neige qui annonce des chutes plus importantes. - (65) |
| poussot, pousserotte : n. m. Flocon de neige, de foin ou de paille. - (53) |
| poussòt, s. f., petite quantité, parcelles de poussière. - (14) |
| poussot, s. m. petit enfant, le dernier de la famille. - (08) |
| poussot, s. m. poussier, parcelle de poussière : « i é eun poussot dan l'euillot. - (08) |
| poussot, s. m., flocon de neige. - (40) |
| poussot, s.m. sciure très fine ; poussière de bois. - (38) |
| poussot, subst. masculin : flocon très léger. - (54) |
| poussot. Peu, quand il s'agit de poudre : « un poussot de farine ou de sel ». - (49) |
| poustager (v. tr.) : mettre en fuite - (64) |
| poustéger. v. - Malmener, bousculer : «J' s'mit à poustéger tout c'qu’y avait d'dans. » (Fernand Clas, p.276) - (42) |
| poustéger. v. a. Gronder, malmener, pousser quelqu'un par les épaules. - (10) |
| poustraillè : v. t. Poursuivre en harcelant. - (53) |
| pout*, s. m. pot. Poutllion, petit pot. - (22) |
| poute ladze : planches où se couchent les porcs - (43) |
| poute, s. m. trou dans le sol : trébucher sur un poute. - (24) |
| poute, s. m. trou dans le sol. - (22) |
| pouteau, poutiau. s. m. Pot à eau, petit pot en général. - (10) |
| poutée*, s. f. pot à contenir l'huile. - (22) |
| poutée, s. f., cruche en terre (pour le kroumir). - (40) |
| poutée, s.f. contenu d'une cruche d'huile. - (38) |
| poutée. s. f. Meule de foin. (Turny). Voyez potée. - (10) |
| pouter v. Embrasser, faire un bisou. - (63) |
| pouteure : engrais - (48) |
| pouteure : nourriture pour animaux (par ex: balle+betteraves) - (48) |
| pouteure : engrais - (39) |
| pouteure. s. f. pouture, fumier en général, engrais. - (08) |
| pouteurer : mettre de l'engrais - (48) |
| pouteurer : mettre de l'engrais - (39) |
| pouteurer, v. a. répandre le fumier, fumer. (voir : enfumaiger) - (08) |
| poutiou, s. m. petit chien. - (08) |
| poutire*, s. f. petite niche dans un mur, servant à déposer un « pout ». - (22) |
| poutire, s. f. petite niche dans un mur qui est censée servir de place pour le pot. - (24) |
| poutis, époutïs. Purée épaisse, pâtée. T'ai trop fait queûre (cuire) lai viande, Il ast teute en poutis. Les mots il, elle ou alle s'emploient au féminin, en variant presque dans chaque village. - (13) |
| poutot, s.m. cruche. - (38) |
| poutou n.m. Bisou. - (63) |
| poutre : s. m. Un poutre. - (20) |
| poutringue : s. f., femme vieille et laide ; poupée idem. - (20) |
| poutringue, potage mêlé. - (05) |
| poutringuer : v. a., abîmer, défoncer, enlaidir. Se poutringuer, se droguer, compromettre sa santé par l'abus des médicaments. - (20) |
| poutue, pouture. s. f. Pâtée composée de pommes de terre cuites, de son et d'eau grasse mélangés pour l'engraissement des pourceaux. - (10) |
| pouture (en). En marmelade. - (49) |
| pouture : aliment pour les cochons : mélange d'avoine, de son et autre aliment. - (66) |
| pouture, « L » engrain, putura (bas latin). - (04) |
| pouture, sf. mélange de betteraves et de menue paille, additionné de tourteaux à l'usage des bêtes à cornes et des moutons. Mouture de trémois pour les porcs. - (17) |
| pouvoi, peuvoi, pouvoir ; el é pouvu, il a pu. - (16) |
| pouvoî, v. tr., pouvoir. - (14) |
| pouvouaîr (on) : pochoir - (57) |
| pouvouaîr (on) : pouvoir - (57) |
| pouvouair : pouvoir - (57) |
| pouvouère. v. - Pouvoir. - (42) |
| pouvre, pauvre. - (05) |
| pouvu, parî. de pouvoî, pu : « Je v'leins tirer les Roués ; j'ons pas pouvu, faute à Colas, qu'étòt bé mau. » - (14) |
| pouvu, part, passé du verbe pouvoir. pu : « i n'é pâ pouvu l'fére », je n'ai pas pu le faire. - (08) |
| pouyâ : (vb) pouvoir, p.passé : pouyu - (35) |
| pouya : Participe passé, pouyu. Pouvoir. « I est pas tot de voula i faut pouya » : il ne suffit pas de vouloir, il faut pouvoir. Façon de parler : « Faudrait que vos pouyeusse en preufiter » : il faudrait que vous puissiez en profiter. - (19) |
| pouya, poÿa v. Pouvoir. - (63) |
| poûye, poux ; poûyou, très pauvre. - (16) |
| pou-yer, v., puiser de l'eau avec un pochon (cf. ce mot). - (40) |
| pouyô : poux A - B - (41) |
| pouyo : poux - (44) |
| pouyot, pauyot (n.m..) : thym sauvage (selon de Chambure, pouïot, aussi pouiot, a. fr., poliol) - (50) |
| pouyot, poulet - (36) |
| pouyu p.p. de pouvoir. Pu : dz'ai pas pouyu y faire ! - (63) |
| pouzon : s. f. un plein fuseau. - (21) |
| pôve, pôre : pauvre - (48) |
| pôvoi. Pouvoir. - (01) |
| pôvre. Pauvre, pauvres. - (01) |
| pôvretai. Pauvreté, pauvretés. Faire lai pôvretai, montrait sai pôvretai, se disent l'un et l’autre in obscenis, sur quoi l’on peut voir Balsac dans l’examen de ce vers du sonnet de Job ; vous verrez sa misère nue. - (01) |
| po-ya : pouvoir - (43) |
| poÿa : pouvoir - (51) |
| poyant. Payant. On a dit autrefois poyer pour payer… - (01) |
| Poyaudin. s. m. Habitant de la Puysaie. - (10) |
| pôyer : se mouiller les pieds dans un trou - Chercher les poux - (39) |
| pôyeûre : crochet du puits. (RDM. T III) - B - (25) |
| pôyon - poison (et, dans un autre sens, injure à l'adresse surtout des femmes). - Al é aichetai de lai pôyon chez l'aipoticaire ai Airnai. - En soupçonne que c'â lo qu'en mis de lai pôyon dan sai soupe. - Ne m'en paile pâ, tote ces feilles c'â des pôyons. - Ote tai don, petiote pôyon. - (18) |
| pô-yot, s. m., pou. - (40) |
| pô-yot, s.m. pou. - (38) |
| poyôts : poux - (39) |
| pôzas, s. m. plur. tiges sèches et dépouillées des pois. - (08) |
| pPoichon. s. m. Peu, petite quantité. - (10) |
| pra, s.m. pré. - (38) |
| pragnière, s. f. sieste : faire une bonne pragnière (du vieux français prangnière. Latin prandium). - (24) |
| pragnière, s. f. sieste. - (22) |
| prai - pré. – Lai soicheresse â étai bein grande ; i crains fort que les prai ne beillaint point de regain. - Note prai â en bon état. - (18) |
| praiji, v. a. prier, engager. Prêcher. - (22) |
| praiji, v. a. prier, engager. Prêcher. - (24) |
| praillon, petit pré. - (05) |
| prairie. Prairies. - (01) |
| praitique, s. f. pratique, manière de faire. avoir de « mauvailles praitiques », c'est s'y prendre mal au propre et au figuré. - (08) |
| pramou : parce que - (35) |
| pramou, pramou que adv. (de l'expr. pour l'amour de toi). Parce que, pour ça, pour cette raison. Alle est pas vnie pramou qu'alle est mlède. Elle n'est pas venue parce qu'elle est malade. - (63) |
| pran. Prends, prend. - (01) |
| prânière (fâre), rester au champ toute la journée et y « fâre médiot » après « marande » (cf, ces mots). - (40) |
| pranière : sieste - (43) |
| pranière, pranire : s. f., vx fr. prangière, sieste, méridienne. Faire pranire, vx fr. se pranger, faire la sieste. Voir dormle. - (20) |
| pranire : (nf) sieste - (35) |
| pranîre n.f. Sieste. Faire pranîre. Faire la sieste. - (63) |
| pranlire*, s. f. crochet de labourage en bois. - (22) |
| pranture. Peut-être. Pranture est une syncope de par avanture. - (01) |
| prarre. : Prendre. Ce mot est un des exemples assez fréquents dans le dialecte et le patois d'éliminer une consonne en redoublant celle qui la suit. - (06) |
| prau - prêt. - Vos pouvez veni quand vos vouras, to à prau. - Ces gens lai ne sont jaimâ prau ; c'â embêtant. - (18) |
| prau, prô : adj. Prêt. - (53) |
| prautai, prauto, prauteussain - divers temps du verbe Prêter. - I ai vu que mon père prauto bein des choses. - En fauro qu'à me prauteusse deux cents francs. - (18) |
| prâvarbe. Proverbe, proverbes. - (01) |
| prayer : prier - (43) |
| pràyioeu, s. m. carrier. Verbe : pràyé, extraire la pierre. - (22) |
| prè : pré - (48) |
| pré d'or n.m. Pâturage où les fleurs jaunes dominent, réputé donner un meilleur fourrage que celui où ce sont les fleurs blanches qui sont majoritaires (pré d'ardzent). - (63) |
| prè : n. m. Pré. - (53) |
| pre, adj. abréviatif, premier. Du langage des enfants, dans tous les jeux où ils ont à donner des numéros d'ordre : « Y é moué l’pre ; toué, l’se ; toué, l’der. n (La prononciation est tout simplement celle de la première syllabe de : premier, second, dernier.) - (14) |
| pre, prép. pour. - (24) |
| prè, sm. pré. - (17) |
| pré. s. m. Gésier. (Argenteuil). - (10) |
| précatoire. Purgatoire. - (01) |
| précepteur : Percepteur. « Le précepteur vindra dimanche à la mârerie (à la mairie) ». - (19) |
| précepteur : s. m., percepteur. - (20) |
| preception. Perception. - (49) |
| précessieu, s. m. prédécesseur, ancêtre, aïeul. - (08) |
| prechain, prochain, preuçain. - (04) |
| préche (on) : prêche - (57) |
| prèche : s. f., préchoir : s. m., chaire à prêcher. - (20) |
| prêcheil : un pêcher - (46) |
| préchi : prêcher - (57) |
| préchou (on) : prêcheur - (57) |
| preci : percer, creuser - (43) |
| précieusement, adv. s'emploie pour exprimer un accident, un coup imprévu, la survenance d'un incident grave : cet homme se portait bien lorsque la mort lui est venue « précieusement. » - (08) |
| prècipité, vt. précipiter. - (17) |
| preçou : vilebrequin - (43) |
| predant : perdant - (43) |
| pre-de-lai, loc. adv. par là-bas. - (24) |
| predix : perdrix - (43) |
| predu : perdu - (43) |
| prédzi : prêcher - (35) |
| prée - prairie ; pré d'une notable étendue. - AI en menai les vais dans lai prée. - Lai prée de Ch'taisneu à jolie ai voué en ce manmant qui. - (18) |
| Prée (La), nom de localité, commune d'Alligny et dans plusieurs parties du Morvan. - (08) |
| prée : près - (48) |
| prée : adv. Près. - (53) |
| préésse : n. f. Presse. - (53) |
| préfarance : Préférence. « I est stu qu’en donnera le pus qu’ara la préfarence » : c'est celui qui fera l'offre la plus élevée qui aura la préférence. - (19) |
| préhistouaîre (la) : préhistoire - (57) |
| prei. Pris, priœmium vel pretium, tant au pluriel qu'au singulier. - (01) |
| preiond : adj., profond. - (20) |
| prelai, loc. adv. par là-bas. - (22) |
| préler, v. a. engazonner, mettre à l'état de pré. L'eau et la chaleur ont bientôt « prélé » un terrain ensemencé de graine de foin. - (08) |
| preleure (na) - pronleure (na) : chaîne (grosse) - (57) |
| premé : premier - (48) |
| premé : premier. - (62) |
| premé : Premier. « Le premé co de la masse » : la première sonnerie annonçant la messe. « Pa fare des seutijes i est in premé » : pour faire des sottises il est premier, il est passé maître en polissonneries. - (19) |
| premé, premier ; l'enfant qui est le premier de sa classe dit qu'il est le preme (preme sans accent aigu sur le e final). - (16) |
| premé, preumé : adj. Premier. - (53) |
| premei, adj., premier. - (14) |
| premei. Premier, premiers. Le fin premei, le premier de tous… - (01) |
| premeire. Première, premières. - (01) |
| premener : promener - (43) |
| prementre : Promettre. « Je ne peux renprementre ». - (19) |
| premerie. Étoffe d'été, de la première saison, du temps prin, comme on le voit dans quelques trouvères. - (03) |
| premi (on) : premier - (57) |
| premi : premier - (43) |
| premi : premier - (57) |
| premî adj. et n. Premier, excellent, prééminent. - (63) |
| premî adv. Préalablement, auparavant. - (63) |
| premi, s. m. premier. - (22) |
| premi, s. m. premier. - (24) |
| premier : adj.. excellent, prééminent. C'est tout-à-fait un premier sur le piston. - (20) |
| premier : adv., vx fr. premiers, premièrement, auparavant. « ... Craignant décedder sans premier avoir testé... » (Extrait du testament de Philibert Berruyer, marchand, de Mâcon, du 28 Juil. 1602. Archives dép., B. 1627, f° 689). - (20) |
| première (En) : loc adv., hors ligne. Il te lui a foutu une tatouille, mais là, vous savez, en première. - (20) |
| première pointe de sa tige. Etym. transire, passer au travers (de la terre), par suite apparaitre. - (12) |
| premin, premier. - (26) |
| premi-né (on) : premier-né - (57) |
| premîre (en) loc. adv. Magistralement. - (63) |
| premîre (na) : première - (57) |
| premîre : première - (57) |
| premîr'ment : premièrement - (57) |
| premis : Promis « Je t'y ai premis » je te l'ai promis. « Dépeu premis jeusqu 'à teni… » : entre promettre et tenir… - Permis. « I est pas premis d'être si niin » : il n'est pas permis d'être si naïf, si bête. « Est-i bin premis ! » : est-ce possible ! - (19) |
| premissian : Permission. « Quû que t'as donné la premission de veni ? ». « Eune premissian de miné » : une permission de minuit, sous forme d'un bon gourdin. - Congé « Ol est veni en premissian ». - (19) |
| prenaule, adj. sujet à être pris, dérobé, volé. (voir : peurnaule.) - (08) |
| prènche, pêche (fruit) ; prènché, pêcher. - (16) |
| prend', peurné : v. t. Prendre. - (53) |
| prende v. Prendre. - (63) |
| prende, v. tr., prendre. - (14) |
| prendre (se). Se mesurer avec quelqu'un, lutter de force, d'adresse, ou de toute autre manière. Ex. : « Vous voulez vous prendre aux armes avec moi, vous êtes encore trop petit! » - (12) |
| prendre : Verbe prendre. « Se prendre de gueule » : se prendre de dispute, s'insulter. - (19) |
| prendre de chyiatte, loc. prendre par la douceur, la flatterie. - (24) |
| prendre de pique (se), loc. discuter avec quelqu'un en s'échauffant progressivement. - (24) |
| prene, prené, prune, prunier. - (05) |
| preniaû (on) - peurniaû (on) : pruneau - (57) |
| prenière : sieste (dans la région de gueugnon). A - B - (41) |
| prènière : après-midi, sieste, après le repas de midi et avant reprise du travail. (ALR. T II) - B - (25) |
| prenin, prunier. - (26) |
| prennuncé, prononcé. - (16) |
| prenoux : Preneur, acquéreur. « San butin est en vente mâ o ne troue pas prenoux » : son bien est à vendre mais il ne trouve pas d'acquéreur. - (19) |
| prenre (v.t.) : prendre - (50) |
| prenre : prendre - (48) |
| prenre lai mouche : se fâcher - (48) |
| prenre : (pren:r') 1- (v. tr.) prendre, dans tous les sens du français. 2- (v. intr.) partir de, avoir son commencement. - (45) |
| pren-re, prendre. - (26) |
| prenre, prenro, prenraint - divers temps du verbe Prendre ; et voyez d'ailleurs Peurnâ. - En fau prenre lai pogne pou réussi. - Sarre ce bout de laird, le chait le prenro. - Les enfants prenraint cequi, c'â sur. - (18) |
| prenre, v. a. prendre. au subj. « qui peurne, que teu peurne, qu'a peurne. » que le loup « m' peurne ! » est une des loc. habituelles du pays. elle équivaut au français que le diable m'emporte ! - (08) |
| prenre, vt. prendre, pp. prins. - (17) |
| préparè, aiprôté : v. t. Préparer. - (53) |
| prépari. Préparai, préparas, prépara. - (01) |
| prepe ai ran : bon à rien. - (66) |
| prepoin. Pourpoint. La mode des pourpoints cessa en 1675. - (01) |
| préqu' : adv. Presque. - (53) |
| prequa : pourquoi - (43) |
| prés - vés : près - (57) |
| prés adv. 1. Près. A pou prés. 2. Sur le point de. Alle est prés d'faire le viau. - (63) |
| presanti. Présentai, présentas, présenta. - (01) |
| présarver : Préserver. - (19) |
| prés-bâtards, s. m., prés situés au fond des vallons, ou au bas des pièces cultivées, dont ils reçoivent les eaux. Ont une grande ressemblance avec les prés-de-fauche. (V. ce mot.) - (14) |
| prés-de- fauche, s. m., prés arrosés, situés au bas des collines, sur le bord des rivières et des ruisseaux. — Dans le Charollais, on distingue trois classes de prés : les prés-de-fauche, les prés-d'embouche, et les pâquiers. (V. Prés-bâtards.) - (14) |
| prés-d'embouche, s. m., prés situés sur le versant des coteaux, et destinés à l'engrais, au vert, des bêtes à cornes. (V. les deux mots précédents.) - (14) |
| présent, viande de porc offerte aux parents et aux amis quand on tue le porc. - (27) |
| présentaule (adj.m. et f.) : présentable - (50) |
| présentaule, adj. présentable, digne d'être présenté, d'être offert en présent. - (08) |
| présents, n.m.pl. cadeaux de viande (lorsque l'on tue le cochon, il est d'usage de donner quelques présents aux voisins). - (65) |
| préseure : présure - (43) |
| preseure : Présure. « Mentre en preseure » : mettre de la présure dans le lait pour le faire cailler. - (19) |
| pressai. Pressé, pressés, presser. - (01) |
| pressan : Forte pince, levier en fer, diminutif de presse. - (19) |
| presse (avoir), loc., être pressé de..., avoir hâte de... : « J’ons presse de vouér not'gas r'veindu. » - (14) |
| pressé : Pressé. « Y en à que sant pas pressés ». - (19) |
| presse, presson. Levier de carrier. - (49) |
| presse, s. f. hâte. avoir « presse » de faire quelque chose = être pressé de… - (08) |
| presseurage : Vin qui coule du pressoir quand on pressure le marc après avoir tiré la cuve. « La tire a tojo pud de couleur que le presseurage » : le vin qui coule de la cuve est toujours plus fort en couleur que celui qu'on obtient en pressant le marc. - Action de pressurer. « J'ins fini neutés presseurages ». - (19) |
| presseurer : Pressurer, serrer à l'aide du pressoir le marc de raisin pour en faire sortir ce qu'il contient de vin. - (19) |
| pressi v. Presser. - (63) |
| préssœne, s. f. personne : les enfants et les grandes préssœnes. - (22) |
| pressoi : Pressoir. « In pressoi à grand point », un vieux pressoir d'un système dont il n'existe plus aujourd'hui que de rares échantillons. - (19) |
| presson : s. m., vx fr., levier de fer. - (20) |
| présson, s. m. levier de fer (vieux français). - (24) |
| présson, s. m. levier de fer. - (22) |
| pressone : personne - (43) |
| préssou : pressé (être) - (57) |
| préssoua : s. m. pressoir. - (21) |
| pressouaîr (on) : pressoir - (57) |
| pressouèr, s. m., pressoir, dont les approches ne sont pas sans danger quand il fait couler le vin doux. - (14) |
| pressurée : s. f., pressée, quantité de vendange pressurée. - (20) |
| prestachons n.f.pl. (prestations) Travail accompli par les habitants du village, jusqu'aux années soixante, en échange d'une dispense d'impôts communaux… - (63) |
| prétan. Prétends, prétend. - (01) |
| pretant : pourtant - (43) |
| pretauger, patauger, broyer la boue. - (05) |
| prête - prêtre, curé. - Vos connaissez le prête de Craincé ? En dit qu'al â don bon !! - Voiqui quaite mouas qui n'ons point de prête ; c'â bein long, ailé. - (18) |
| pretè : prêter - (46) |
| préte, s. m. prêtre : « a vé mûri, a fau qu'ri l’ prête », il va mourir, il faut appeler le prêtre. - (08) |
| prète, s. m., prêtre. - (14) |
| préte. Prêtre, prêtres. Les Italiens, à peu près comme les Bourguignons, disent : Prete et Preti. - (01) |
| pretentaîn-ne (core la) : prétantaine (courir la) - (57) |
| préter (se) v. S'étendre, se distendre en parlant des peaux, des étoffes. Quand une personne s'étire on dit : Les souyiers sant bon marsti, le cuir se préte. Les souliers sont bon marché, le - (63) |
| prêter (Se) : v. r., prêter, s'étendre, se distendre, en parlant des peaux, des étoffes, etc. Quand une personne s'étire, on dit : « Les souliers sont bon marché, le cuir se prête », par allusion aux « grosses bêtes » (vaches, veaux, etc.), dont les peaux s'emploient dans la cordonnerie. - (20) |
| préter : prêter - (57) |
| preti pour pétri. : Pétrir.- Exemple encore assez fréquent de la transposition de la consonne r. - On trouve un autre exemple de cette transposition dans le mot prôve pour pôvre. - (06) |
| preti. Pétri, participe passif. Preti est aussi le singulier des trois personnes du verbe à l'indicatif. Ce verbe fait encore preti à l'infinitif et à l'impératif. Enfin preti est aussi le singulier des trois personnes de prêter à l'aoriste de l'indicatif. - (01) |
| pretinguin : fruit d'un prunier d'une certaine espèce. - (30) |
| prétissoire, pétrin. - (27) |
| preto : partout - (43) |
| prètot. s. m. Petit prêtre, enfant de chœur. Se dit particulièrement de celui qui assiste l'officiant à l'autel, et qui porte une soutane noire au lieu d'une rouge. - (10) |
| prêtsi : prêcher - (43) |
| prêtsi, prêdzi v. Prêcher. - (63) |
| pretu : prou - (43) |
| pretu, s. m. trou, cavité. Verbe pretugi, percer des trous (du vieux français pertius. Latin pertusium). - (24) |
| pretusi : percé de petits trous - (43) |
| pretuzi : trouer - (43) |
| preû : pauvre. - (66) |
| preu : provin. (VDS. T IV) - VdS - (25) |
| preu ça : parce que - (43) |
| prêu, fosse pour recevoir des sarments de vigne destinés à la multiplication de cet arbuste ; preûzé, faire des preû. - (16) |
| preu, provin. - (28) |
| preû, s. m., provin. - (14) |
| preu, s. m., trou profond dans lequel on couche le sarment de vigne. - (40) |
| preu, s.m. provin. - (38) |
| preu. Faire un preu, c'est provigner : c'est coucher un cep de vigne pour le rajeunir et le multiplier. En vieux, français, preu et preufil ont le sens de gain. Le langage bourguignon emploie le verbe profiter dans le sens de croître, amender. - (13) |
| preubabje, adj. probable. - (17) |
| preuchain, adj. et s. prochain. « preuçain. » - (08) |
| preuche : Proche. « Y sant preuches parents ». - (19) |
| preud’su : pardessus - (43) |
| preufi, profit, gain ; preufité, profiter, saisir une bonne occasion, croître, grossir ; d'une personne, d'un animal, d'un arbre qui a bien grandi et grossi on dit : el é bèn preufité. - (16) |
| preufit : Profit « Ol en a fait san preufit ». « Ces bâtes mijant bien mâ y ne les y fâ point de preufit » : ces bêtes mangent bien mais elles n'engraissent pas. - (19) |
| preufit, adj. profitable. - (17) |
| preufit, sm. profit. - (17) |
| preufité, vn. profiter. - (17) |
| preufiter : Profiter. « J'ai preufité du ban marchi ». - Croître, engraisser. « Man cochan a bien preufité » - (19) |
| preumé : adj. num. premier. - (21) |
| preumenade (n.f.) : promenade - (50) |
| preumenade : Promenade. Lieu où l'on se promène, avenue plantée d'arbres. « Je l'ai rencontré à Torneu su la preumenade du Pas Fleury ». - (19) |
| preumener : Promener. « Des mossieurs sant veni se preumener su la Reuche » : des gens de la ville sont venus en promenade sur la Roche. - (19) |
| preûmener, v. tr., promener, conduire. - (14) |
| preûmer : premier (contraire : dârrer) - (37) |
| preumètre, promettre et certifier : i voz an preumè, je vous en assure. - (16) |
| preumi : premier - (51) |
| preumnu, preumnou (-ouse) (n.m. ou f.) : promeneur (-euse), touriste - (50) |
| preumö, adj. premier. - (17) |
| preumötre, vt. promettre. - (17) |
| preune : une prune - (46) |
| preune ou peurne : Prune. « Grôler des prennes » : secouer un prunier pour en faire tomber les prunes. « Si je m'en môle y ne sera pas pa des preunes » : si je m'en mêle ce ne sera pas pour rien, ce sera grave. - (19) |
| preuné ou peurné : Prunier, prunus domestica. « Inpreuné de reines claude ». - (19) |
| preune. Prune, prunes. Ce n'a pa po dé preune, façon de parler proverbiale, pour dire ce n'est pas pour rien… - (01) |
| preuniöre, sf. [prandi-aria]. sieste après le dîner. Après-midi. - (17) |
| preuntemps, s. m. printemps. - (08) |
| preupe : Propre. « Ol est preupe c'ment in sou ». « Y est cen qu'est du preupe! » en voilà du propre ! - (19) |
| preupement : Proprement. « Vlà de l'ovrage preupement faite » : voilà un travail fait proprement. - (19) |
| preupeté : Propreté. « Alle tint à la preupeté de sa maijan ». - (19) |
| preùpos, s. m., propos, causeries, potins. - (14) |
| preûposer, v. tr., proposer. - (14) |
| preuseur : présure - (48) |
| preuseure (d'la) : présure - (57) |
| preuti, pour pétrir. En latin, panem terere... - (02) |
| preuti, vt. pétrir. - (17) |
| preutissoure, sf. pétrissoire. Voir mai. - (17) |
| preuvat. s. m. Espèce de champignon des bois. (Etivey). - (10) |
| preuve ke, ai preuve ke, ce qui prouve que... - (16) |
| preuvèsseûre : vida dans une récolte. (RDM. T IV) - C - (25) |
| preuvet : champignon agaric. - (66) |
| preuvet, sm. prevet, sorte de champignon. - (17) |
| preuvisian : Provision. « Eune bonne preuvisian de beu pa l'hivé ». - (19) |
| preuvössöre, sf. vide, tache dans une récolte. - (17) |
| preûyire : (nf) prière - (35) |
| preûyond (e), preûyondou (ze) : profond (e) - (35) |
| prévenî, v. intr., provenir : « C'te montre que t'voués, alle se dérange jamâs. Alle me préveint d'mon grand. » - (14) |
| prév'ni : prévenir - (57) |
| prévouair : prévoir - (57) |
| prévoueillance : n. f. Prévoyance. - (53) |
| pre-yon : profond - (43) |
| priand : Profond. « In pouit bien priand » : un puits bien profond. - (19) |
| priandou : Profondeur. « Les raceunes des chardans vant à eune grande priandou ». - (19) |
| prichst, prouchst ! Oonomatopée dont on se sert pour exprimer la rapidité, l'instantanéité d'une action : c'est un garçon bien leste, il saute « prichst. » - (08) |
| prie, s. f. prise, moyen de prendre, de saisir un objet : je ne puis soulever cette roche, je n'ai pas de « prie » ou « prille ». - (08) |
| prié-dieu, prier-dieu : s. m., vx fr., prie-dieu. - (20) |
| prière : Paroles magiques auxquelles on attribue le pouvoir de guérir certaines maladies. « O sait fare la prière » : il sait les paroles magiques qui guérissent. - (19) |
| prière : s. f. Faire sa prière à Saint Nicolas, se dit dans le monde des mariniers pour « poser culotte [sauf respect] au bord de Saône ». - (20) |
| prijan : prison « Ol est gracieux c'ment eune pôrte de prijan » : il est aimable comme une porte de prison. - (19) |
| prije, s. f. prise. - (08) |
| prijon, s. f. prison, cachot. - (08) |
| prijon, s. f., prison. - (14) |
| prijongné, s. m. prisonnier, celui qui est en prison, qui ne peut sortir d'un lieu. - (08) |
| prijounier, s. m., prisonnier. - (14) |
| prillon : prison. - (62) |
| prin : temps clair, très dégagé. A - B - (41) |
| prin : temps clair, très dégagé - (34) |
| prin adv. (de printemps). Clair et dégagé (comme au printemps). L'temps est prin. - (63) |
| prin, adj. mince, fin : unjetprin ; de l'herbe prin (sic). - (24) |
| prin, adj. mince, fin. - (22) |
| prin. Pris, captus ou capti. C'est aussi le singulier des trois personnes de prendre à l’aoriste de l’indicatif. On dit en bourguignon indifféremment pri et prin. - (01) |
| prince (Le) : nom que prit en 1625 le chef de la Troupe joyeuse. Voir ce mot. - (20) |
| principau : adj., principal. - (20) |
| prindre : prendre - (43) |
| pringeotte : faire la pringeotte, c'est rallonger la soupe avec de l'eau - (46) |
| pringnère (de), de grand matin, à la première heure. Se disant autrefois des vaches que l'on menait de bon matin sur les friches de la montagne pour les faire pâturer et qu'on ramenait vers midi. - (27) |
| prinre : prendre. - (29) |
| prinre. Primes, prites, prirent. - (01) |
| prinse, sf. prise. - (17) |
| printam. Printemps. - (01) |
| printanier - printani : précoce (fiait) - (57) |
| printanier, printanière : adj., précoce. - (20) |
| printaniére - printanire : printanière - (57) |
| printanière, primevère, fleur. - (05) |
| printanîre adj. Précoce. Eun' hiver printanîre. - (63) |
| printi : pétrir - (39) |
| prinve, pauvre. - (26) |
| priò. Priais, priait. - (01) |
| prion. n. f. - Prison. - (42) |
| prire, s. f. carrière (du vieux français perrière). - (24) |
| prire, s. f. carrière. - (22) |
| prisi, s. m. congestion pulmonaire, maladie de poitrine subite et grave. - (24) |
| prisoû, adj., priseur de tabac. - (14) |
| prisou, ouse, adj. celui ou celle qui prise, prend du tabac. - (08) |
| prisoux : Priseur « In feu prisoux » : un fort priseur, qui prise beaucoup. - (19) |
| prisoux, prisouse : s. m. et f., priseur et priseuse de tabac. - (20) |
| prisu ! (y’ot ben) : (c’est) pluvieux dans tout l’horizon - (37) |
| prit’iait, loc. adv. environ, vers. Par ici. - (22) |
| pritcher : sauter - (39) |
| prit'iœ, loc. adv. environ, vers. Par ici. - (24) |
| privilégiére : adj. f.. privilégiée. Il a des appointements magnifiques... oh ! c'est une situation tout-à-fait privilégière. - (20) |
| priyon (n.f.) : prison - (50) |
| prô : prêt - y seu prô pou èllè è lè pôche, je suis prêt pour aller à la pêche - (46) |
| prô, adj., près, proche. - (14) |
| prô, ôtje, adj. prêt, te. - (17) |
| prô, près. - (38) |
| prô, prêt - (36) |
| pro, proef, près, pros. - (04) |
| prô, prôte : prêt, prête - (48) |
| prô, prote : (prô:, prô:t' - adj.) prêt, prête. - (45) |
| prô, prôte, prêt, prête. - (16) |
| prò. Prêt. - (01) |
| problâme : Problème. « A l'écôle an li fa fare des problâmes ». - (19) |
| proça : Procès. « In mauvâs arrangement vaut mieux qu'in ban proça ». - Procès verbal. « Le gârde li a fait in proça » : le garde champêtre lui a dressé procès verbal. - (19) |
| pròçai. Procès. - (01) |
| procédé : s. m., craie avec laquelle on frotte les procédés de queues de billard. - (20) |
| prôché, proîché, prêcher, donner des conseils. - (16) |
| prôche, sm. prêche. - (17) |
| prôche, vt. prêcher. - (17) |
| proché. Prêcher. - (01) |
| prôcher, et prâcher, v. tr., prêcher. - (14) |
| prôches : prêches - (37) |
| prôchou, sm. prêcheur. - (17) |
| procureux : s. m., procureur. (Arch. mun.. GG. 3S, 17 mai 1643). - (20) |
| prôdige. Prodiges. - (01) |
| produ, produit ; produre, produire. - (16) |
| produre : Produire. « O sait bin fare rendre à ses tarres tot ce qu'y pouyant produre ». - (19) |
| prœne, s. f. prune. Preni, prunier. Pregniau, pruneau. - (24) |
| profès : qui a fait des vœux par lesquels on s'engage dans un ordre religieux, après le noviciat. - (55) |
| profi (on) : profil - (57) |
| profitaule (adj.m. et f.) : profitable - (50) |
| profiter : grossir - (51) |
| profiter : on dit d’un animal qu’il a bien profité s’il s’est bien développé, a bien grossi et grandi. - (59) |
| prôfiton. Profitons. - (01) |
| profonder, v. a. approfondir, rendre plus profond en creusant. - (08) |
| prôji : Prêcher. « Le curé a bien prôji». « Est tot prôji qu'a envie de bin fare » : il n'est pas besoin de prêcher aux gens de bien. - (19) |
| prôjoux : Prédicateur. « In ban prôjoux » : un bon prédicateur. - (19) |
| prolangi : Prolonger. « Le madecin dit qu 'o ne peut pas le guéri, tot ce qu 'o peut fare y est de le prolangi ». - (19) |
| prolongi : prolonger - (57) |
| prôme (ein) : petite barrière placée devant une porte pour empêcher les poules d'entrer. (RDT. T III) - B - (25) |
| prôme : petit portillon en bois ou fer, ouvragé, fermé en principe lorsque la porte d’entrée de la maison, devant laquelle il est fixé, est ouverte, ce qui permet à la lumière du jour d’éclairer la pièce tout en empêchant les enfants de s’échapper - (37) |
| prome : (prom' - subst. m.) petit portillon placé devant la porte extérieure, qui permet, les jours de beau temps de la laisser ouverte, tout en interdisant l'accès de la maison aux animaux domestiques. - (45) |
| prôme, prompt, pronde, prône : portillon devant la porte - (48) |
| prôme, s. m. petite porte ou barrière placée devant la porte d'entrée des maisons pour écarter les animaux sans ôter l'air et la lumière. - (08) |
| promesse : bague de fiançailles. - (33) |
| Promeune. Promènes, promène, promènent. - (01) |
| promie, promise : fiancée - (48) |
| promis(e), n.m.(f.) fiancé(e). - (65) |
| promner : promener - (51) |
| promonique : adj., pulmonique. - (20) |
| promontouaîre (on) : promontoire - (57) |
| promouégner, v. a. promener, conduire à la promenade, porter çà et là. - (08) |
| prompt, adj. emporté, irascible : « ç'ô eun boun' honm', mâ al ô prompt », c'est un bon homme, mais il s'emporte facilement. - (08) |
| pron, Prompte. - (01) |
| prond - avau : profond - (57) |
| prond ou priond, adj. profond. Féminin pronte. - (24) |
| prond, adj. profond. - (22) |
| pronde : petite barrière devant la porte - (39) |
| prône (n.m.) : portillon placé à l'entrée de l'habitation pour empêcher les volailles d'entrer (aussi pronme) - (50) |
| prone. Prônes. - (01) |
| prône: petite barrière qui interdisait l'accès de la maison aux poules quand on laissait la porte ouverte. Chambure, qui signale prône en Champagne, dit « prome » en patois et prononce pron-me. Paulette dit pronle. - (52) |
| prôner. v. - Quémander : «Alle est encor' v'nue prôner du pain pou' son gamin ! » Probablement du latin pronare : incliner en avant, qui n'a pas donné de dérivé en français. Attesté dans le bas latin du vocabulaire d'Église au Ve siècle. - (42) |
| prôneux. n. m. - Quémandeur. - (42) |
| pronle, n. masc. ; porte à claire-voie. - (07) |
| pronne : portillon devant la porte principale de la maison pour empêcher les jeunes enfants de sortir ou les volailles d'entrer dans la maison. Le pronne airéto les poules de rentrer : le portillon empêchait les poules de rentrer. - (33) |
| prônonçai. Prononcé, prononcés, prononcer. - (01) |
| prononci : prononcer - (57) |
| prop' : adj. Propre. - (53) |
| propagi : propager - (57) |
| prope : propre - (48) |
| prope adj. Propre. Y'est du prope ! C'est immoral, ce n'est pas convenable ! - (63) |
| prope adj. Véritable. - (63) |
| prope ai ran : bon à rien, incapable - (48) |
| prope ai ran : propre à rien - (39) |
| prope, adj. propre. - (08) |
| pröpe, adj. propre. - (17) |
| pròpe, adj., propre, qui appartient à, convenable, net : « Vouah ! y ét ein pròpe à ran. » - (14) |
| prope, propre ; propté, propreté. - (16) |
| prôpe. Propre. On dit aussi prôpre, mauprôpre. - (01) |
| prôpeté, s. f., propreté. - (14) |
| prôphécie. Prophéties. - (01) |
| Prôphéte. Prophète. - (01) |
| prophétise : Prophétie. « As-tu vu la prophétise qu'y a su l'armona (l'almanach) ». - (19) |
| propô. Propos. Ai prôpô, à propos. - (01) |
| prôpôse. Propose, proposes, proposent. - (01) |
| propre : adj., véritable. C'est de la prop’ salelé. - (20) |
| prop'té, s. f. propreté. dans nos montagnes, « la prop'té » n'est pas encore à l'ordre du jour. - (08) |
| pros (ō), prép. près. - (17) |
| proserpine. s. f. Fille coureuse et de conduite légère. (Soucy). - (10) |
| prôt (âte) : (être) prêt - (37) |
| prôt (-e) (edj.m. et f.) : prêt, prête - (50) |
| prot (Fém. prôte). Prêt. - (49) |
| prôt (te) : prêt(e) - (39) |
| prôt : Prêt. « La marande est prôte » : le repas est prêt. « Y est pas prôt que j'y alle » : je n'irai pas de sitôt. - (19) |
| prôt ai pourter : prêt à porter - (48) |
| prôt, adj., prêt, préparé à. - (14) |
| prôt, ôte, adj. prêt, préparé : « i seu prô : lai sôpe ô prôte. » - (08) |
| prôt, prôt' : adj. Prêt, prête. - (53) |
| prôté, prêter. - (16) |
| prote. Prête. Prò est le masculin, prote le féminin. Le boudin a prô, l’andouille a prote, le boudin est prêt, l’andouille esl prête. - (01) |
| protégi : protéger - (57) |
| prôter (v.t.) : prêter - (50) |
| prôter : prêter - (37) |
| prôter : prêter - (48) |
| prôter : Prêter. « Prôte me dan tan cutiau ». - (19) |
| prôter, et preûter, v. tr., prêter. - (14) |
| prôter, v. a. prêter : « prôte-moué tai pieuche », prête-moi ta pioche. - (08) |
| prôter, v. prêter. - (38) |
| protonotaire : officier de la Cour pontificale qui était chargé de l'expédition des actes. - (55) |
| Prôtoû, adj., prêteur. - (14) |
| prôtou, ouse, s. prêteur, euse. on dit aussi : « emprétou, emprôtou » pour emprunteur. - (08) |
| protsain : prochain - (51) |
| prottes (â) : (les) « communs » du château de clinzeaux - (37) |
| prou - assez. Ce mot veut dire également beaucoup ; mais chez nous il signifie uniquement assez. - I en ai prou. - Peurnez-en, ailé en y en airé encore prou pour no. - I ons prou de plieue ; métenant en nos fauro du chaud. - Ile en é prou, ailé ; ile ne veut pâ reveni. - (18) |
| prou (adv.) : assez, suffisamment - (50) |
| prou (C.-d., Chal., Morv.), prau, preu (Br.). - Assez, suffisamment, beaucoup ; est encore un mot du vieux français fort usité en Bourgogne. - (15) |
| proû (d’) : (de) trop - (37) |
| prou : (adv) assez, suffisamment - (35) |
| prou : assez - (57) |
| prou : assez (français) - (51) |
| prou : assez - (48) |
| prou : assez, suffisamment - (43) |
| prou : Assez. « Léve te t'as prou dremi » : lève toi tu as assez dormi. - (19) |
| prou : suffisamment. Alors que littéralement, dans l’expression : peu ou prou : prou indique beaucoup, ici c’est assez ! Pourrait venir du latin pro ut : assez. - (62) |
| prou adv. Assez, suffisamment. - (63) |
| prou saoû ! (âte) : (avoir) très bien mangé - (37) |
| prou, adv. assez. - (24) |
| prou, adv., assez, suffisamment : « Vous m'baillez tout c'qui ? marci ! J'en ai prou. » - (14) |
| prou, adv., assez. - (40) |
| prou, adverbe. assez, suffisamment : « i en é prou », j'en ai assez ; « ai prou poigne », à peine, à grand’peine. - (08) |
| prou, assez - (36) |
| prou, assez (i ot prou, c'est assez). - (38) |
| prou, assez ; i an é prou, j'en ai suffisamment. - (16) |
| prou, assez. - (04) |
| prou, assez. - (05) |
| prou. adv. Assez, beaucoup. On dit d'une chose dont on ne veut pas, qu'on n'en veut ni peu ni prou. – Prou ben. Locut. adverb.. Assez bien, parfaitement, très-bien. (Avallonnais). - (10) |
| prou. Assez. - (49) |
| prou. Suffisamment. Ne me varsez pu ai boire, i seus ben qu'i en ai prou. Dans le vieux langage français, prou signifiait beaucoup... - (13) |
| prouaîe (na) : proie - (57) |
| prouan n.m. Maillon de fer servant à relier la charrue à l'avant-train. - (63) |
| proué : (nm) lanière fixée à une chaîne pour maintenir ensemble l’âge de la charrue et le timon - (35) |
| proué, s. m. petit timon mobile, timonnot, employé pour atteler les bœufs qui marchent devant la paire attachée au timon fixe. - (08) |
| prouet : chaîne reliant le timon des bœufs à la charrue - (43) |
| proufi, pourfi, s. m. profit, gain, bénéfice. - (08) |
| proufit, s. m., profit, gain, bénéfice. - (14) |
| proufitaule, adj. profitable, qui donne du profit, avantageux. - (08) |
| proufiter, v. intr., profiter. - (14) |
| proufiter, v. n. profiter comme en français mais le mot s'emploie encore en parlant des personnes et des choses dans une acception particulière. on dit d'un enfant qu'il a bien « profité » lorsqu'il a beaucoup grandi, d'un bœuf lorsqu'il s'est engraissé dans un herbage, d'un arbre lorsqu'il s'est développé rapidement. - (08) |
| prougner. v. a. et n. Provigner. (Vincelottes). - (10) |
| prouin. n. m.- Marcotte de vigne. (Leugny, selon F. Clas) - (42) |
| proulouée (pour prolouère). s. f. Grosse chaîne servant à l'attelage des bœufs. (Avallonnais). - (10) |
| proulouère : pièce d'attelage spéciale. - (33) |
| proumàte, v. tr., promettre. - (14) |
| proumàtu, part, de proumàte, promis. - (14) |
| proumesse. n. f. - Promesse. - (42) |
| proumettu, part, passé du verbe promettre. Promis : « a m'é proumettu ç'lai », il m'a promis cela. - (08) |
| proumouner : promener. Comme mouner pour mener et émouner pour amener (voir). - (62) |
| proune. subs. f. Porte à claire-voie. (Fresne). - (10) |
| prousse (être en), loc., être animé, excité, colère: « Ol é gros en prousse après son p'tiot. » - (14) |
| proutt tié ! int. cri du berger appelant ses moutons. - (17) |
| prouvâble, adj. qui peut être prouve. S'emploie pour dire qu'une chose est assurée, authentique, notoire. - (08) |
| provàrbe, s. m., proverbe. - (14) |
| pröve, adj. pauvre. - (17) |
| prôve, pour pauvre, métathèse habituelle aux Bourguignons. - (02) |
| prôve. Pauvre, pauvres. On dit plus régulièrement pôvre, d'où, par transposition de lettres, prôve a été formé. - (01) |
| prôvi. Prouva. - (01) |
| provinage : s. m., provignage. - (20) |
| provisouaîre : provisoire - (57) |
| provisouaîr'ment : provisoirement - (57) |
| prov'ni : provenir - (57) |
| prövté, sf. pauvreté. - (17) |
| prtoeuji, v. a. piétiner, tasser avec les pieds. - (22) |
| prudent, prudente : adj., personne bien élevée. - (20) |
| prue : s. f., vx fr. pue, dent (de peigne, de râteau, etc.), pointe, proue. - (20) |
| prue, pruse. s. f. Présure. - (10) |
| prue. n. f. - Présure. (Mézilles, selon H. Chéry) - (42) |
| prunter : v. a., prêter. - (20) |
| pruntier, vt. prêter. Emprunter. - (17) |
| prùye, s. f. dent de fourche, de râteau, de pioche (du vieux français pue, dent). - (24) |
| prùye, s. f. dent de fourche, de râteau. Diminutif : prùyon. - (22) |
| p'sachin (on) : grenouille grise - (57) |
| psée, p'sin : n. m. Poussin. - (53) |
| pseuillon : sans appétit. A - B - (41) |
| pseuillon : sans appétit - (34) |
| pseuyon : qui mange en rechignant - (51) |
| p'si : pisser - (57) |
| p'si : uriner - (57) |
| psilles. s. f. pl. Vêlements. (Poilly-sur-Serein). - (10) |
| p'sin : poussin - (48) |
| p'sin ou pussin : Poussin. « Va pas vés la cluche padant qu'alle est dave ses p 'sins alle te sauterait dessus ». « Miji c 'ment in psiti » : manger comme un oiseau. - (19) |
| psin : (psin: - subst. m.) poussin - (45) |
| p'sin ; abréviation de pussin - poussin. - (18) |
| p'sin, psée : n. m. Poussin. - (53) |
| p'sin. Petit poulet. - (49) |
| p'so (un), un peu - (36) |
| p'son, s. m. peu, petite quantité, miette : « eun p'son » de sucre, de farine, de beurre, etc. (voir : p'chot.) - (08) |
| psonne (n.m. et pron.ind.) : personne - (50) |
| psot (adv.) : peu - un psot = un peu - (50) |
| psou, sâquiot : n. m. Sarcloir. - (53) |
| p'ssin, s.m. poussin. - (38) |
| pt’fené, v. a. gâcher, abîmer. On dit aussi pœt’fené. - (22) |
| ptâ : fleur de digitale. Jouet pouvant faire une petite détonation. A - B - (41) |
| pta : digitale (botanique) - (51) |
| pta : digitale, jouet servant à faire une détonation quelconque - (34) |
| pta : jouet servant à faire une détonation quelconque - (43) |
| ptâ n.m. 1. Pétard. 2. Corolle de digitale : les enfants les faisaient éclater sur le dos de leur main. 3. Besoin de péter. - (63) |
| p'ta. Digitale. Les enfants s'amusent à faire éclater, péter la corolle en tube, en pinçant l'ouverture et la heurtant sur le front. Pétard, sorte de pistolet fait avec une branche de sureau vidée de sa moelle et un piston avec lequel on lance des balles d'étoupes ; jouet enfantin. - (49) |
| ptau : taupe - (44) |
| p'tau. Putois. - (49) |
| ptché tarin : terre sableuse, légère, sur soubassement granitique. A - B - (41) |
| p'tche, p'tchot.Petit enfant : « c'te fen-ne a beaucoup de p'tchot ». - (49) |
| ptchet (chtit) : petit - (51) |
| p'tchiot, niafron : n. m. Enfant. - (53) |
| ptchon : un ptchon = un peu. A - B - (41) |
| ptchon (un) pchon (un) : un petit peu - (51) |
| p'tchot (on) - ch'tit (on) : petit - (57) |
| p'tchot mau (on) : bobo - (57) |
| p'tchot pouais (on) : petit pois - (57) |
| p'tchot-beûrre (on) : petit-beurre - (57) |
| p'tchot-boûs (du) : petit-bois - (57) |
| p'tchote fille (na) : petite-fille - (57) |
| p'tchotement : petitement - (57) |
| p'tchot-garçon (on) : petit-fils - (57) |
| p'tchot-gris (on) : petit-gris - (57) |
| p'tchot-lait (du) : petit-lait - (57) |
| p'tchot-nègre (on) : petit-nègre - (57) |
| p'tchot-n'vou (on) : petit-neveu - (57) |
| p'tchots-enfants (des) : petits-enfants - (57) |
| pter v. Péter. Voir veuchi. - (63) |
| p'tét : adv. Peut-être. - (53) |
| p'téte : peut-être - (48) |
| p'tête : Peut-être. « Va t'y fare chaud demain ? p'tête bin qu'oué, si y pliôt pas ». - (19) |
| pt'éte-bin adv. Peut-être. - (63) |
| p't-étre : peut-être - (57) |
| pthio, pthiote, petit, petite (adjectif) ; substantivement : ein pthio, un petit garçon ; eune pthiote, une petite fille. - (16) |
| p'tiet : Petit. « Jean est pu p 'tiet que san frère ». « Donnes m'en in p'tiet » : donne m'en un peu. - Petit enfant, bébé. « Alle donne à téter à san p 'tiet » : elle allaite son enfant. - « Fare le p 'tiet » : accoucher. - Jeune animal. « Ol a detrut tote eune famille de renas : le père, la mère a peu les p 'tiets ». - (19) |
| p'tiet leit : (nm) petit lait - (35) |
| p'tiet mi : (nm) résidu de rinçage d'une ruche - (35) |
| ptiet, ptiot n. et adj. Petit. - (63) |
| ptiet-à-ptiet loc. Petit à petit. Voir atsopchon. - (63) |
| p'tignin, petit garçon. - (26) |
| ptingonî n.m. Prunellier sauvage. - (63) |
| p'tingonnier. Prunier non greffé. - (49) |
| ptinguin : grosse plosse*. A - (41) |
| ptinguin : petite prune - (44) |
| ptinguin n.m. (du lat. putidum, amer). Petite prunelle sauvage ou fruit déformé ou taché par le mildiou. - (63) |
| p'tinguin. Petite prune rapportée par un prunier non greffé. - (49) |
| pt'iœ, adj. petit. - (24) |
| pt'ion (un), loc. un peu : en demander un pt’ion. - (24) |
| p'tion, onte, adj. petit, petite : « ol é ain p'tion ; ç'ô sai p'tionte », il a un petit, un petiot ; c'est sa petite, sa petiote. env. de Château-Chinon. (voir : p'tiot.) - (08) |
| p'tiot : le petit - y guèdjeû l'petiot, je gardais le petit (au jeu de tarot m'né le p'tiot au bout) - (46) |
| p'tiot : petit - (48) |
| ptiot : petit. Lè treue fait ses p'tiots : la truie fait ses petits. - (52) |
| p'tiot : un petit enfant - le p'tiot é chu dans les otchies, èl été plein d'cambeûles, é è s'é mis è breuillè, le petit est tombé dans les orties, il était plein de boursouflures et il s'est mis à pleurer - (46) |
| p'tiot : petit. La treue fait ses p'tiots : la truie fait ses petits. - (33) |
| p'tiot ai p'tiot : peu à peu - (48) |
| p'tiot, p'tiote : n. Petit, petite. - (53) |
| p'tiot, subst. masculin ou adjectif qualificatif : petit. - (54) |
| ptit terrain, tarrain : terre très légère granitique - (43) |
| p'tite rave. n. f. - Radis. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| p'tô : Putois. « Le p'tô a saigni mes pouleilles ». - Nom de lieu. « La râ du P 'tô », souce intermittente qui ne coule qu'après des pluies abondantes, elle paraît moins active qu'il y a cinquante ans. « I a bin bravementpliu, la râ du P'tô coule ». - (19) |
| pto, ptou n.m. Putois. - (63) |
| ptou : putois - (51) |
| ptou : s. m. putois. - (21) |
| ptu, sm. pertuis, creux ; puits. - (17) |
| p'tuns (des) : des ordures. - (66) |
| ptuns, sm., pi. [vx f. Bétuns. cf. béton, bitume]. décombres, démolitions. Voir gazins. - (17) |
| ptusé, ie, adj. percé, ée. - (17) |
| ptusöt, sm. objet troué. - (17) |
| pu : dent d'outil de ferme (fourche, râteau...). A - B - (41) |
| pu - plus. - I n'en veux pu, i en ai bein aissez. - Vos ne nos en envieras pâ pu que cequi. - Le Dominique â pu grand et pu fort que lu. - (18) |
| pu (adv.) : plus - (50) |
| pu : (nf) dent de la fourche - (35) |
| pu : dent de fourche, de râteau - (43) |
| pu : plus (+) ou ne …plus - (48) |
| pu : Plus. « Ni pu ni moins ». « Pu j'te vois pus j't'âme ». Voir aussi plieu. - Nom donné au myosotis. - (19) |
| pu : plus. I n'en ai pu : je n'en ai plus. - (52) |
| pu d'hêche n.m. Dent de herse. - (63) |
| pu n.m. (du lat. pungere, piquer). Dent d'outil (râteau, pioche). - (63) |
| pu teut : Plus tôt. « Va devant t'arriveras pu teut ». - (19) |
| pu : prép. Plus. - (53) |
| pu, adv. plus : « i n'env' pu », je n'en veux plus ; « aie pu béte qu'eun âne », etc. - (08) |
| pu, adv. plus. - (17) |
| pu, adv., plus. - (40) |
| pu, plus ; i n'an peu pu, je suis à la fin de mes forces ; i n'an veu pu, je n'en veux pas davantage. Pu se dit aussi pour : une humeur sortante. - (16) |
| pu. Plus. Pu bea, plus beaux. Quelquefois c’est le singulier des trois personnes de pouvoir à l’aoriste de l’indicatif, ou des trois personnes du verbe puer au présent du même mode. - (01) |
| puan, insupportable, à raison de sa mauvaise conduite, de ses manières ridicules. Puantize, mauvaise odeur. - (16) |
| puanté, s. m. puant, terme de mépris pour désigner un mauvais drôle. - (08) |
| puantise, s. f. puanteur. - (08) |
| pub'iller : publier - (57) |
| publier (pub'llé) : Publier. - (19) |
| puçaude, s. f. fricot, régal. - (08) |
| puce maligne. Pour pustule maligne. - (12) |
| puceune (na) : poulette - (57) |
| puchan, ante, adj. puissant, qui a du pouvoir, fort. - (08) |
| puchance, s. f. puissance. - (08) |
| pucheque (conj.) : puisque - (50) |
| pucheuna : jeune poule. - (21) |
| pue : Dent de fourche ou de fourchette. « An secoue la peille dave eune forche à trois pues ». - (19) |
| pue. Pointe, branche d'une fourche ou de tout outil pointu. - (49) |
| puer (v. tr.) : essorer (syn. puonner) - (64) |
| puge : Puce. « Y a eune puge que m'a meurdu » : une puce m'a piqué. « O n'est pas pu feû qu’eune puge » : il n'est pas plus fort qu'une puce. - (19) |
| puge, puce. - (05) |
| puge, s. f. puce. - (24) |
| pûge, s.f. puce. - (38) |
| pugeât : cosse de haricot, de fève ou de pois - (60) |
| pugeote (être en). .Etre nus bras. - (03) |
| pugeotte (en), être nu en chemise. - (05) |
| pugin, s. rn. poussin. - (24) |
| pugna (na) : poignée (mesure) - (57) |
| pugnat (na) - pouaignée (na) : poignée (de main) - (57) |
| pugni. Puni, punis, punir. - (01) |
| puie. n. f. - Pluie - (42) |
| puits : s. m., ustensile de ménage indéterminé. - (20) |
| pûje (na) : puce - (57) |
| pûji v. Puiser. - (63) |
| pulain. s. m. Troène. (Puysaie). - (10) |
| pulin, perlin. n. m. - Troène. Cornouiller sauvage, selon F.P. Chapat. - (42) |
| pulmonique : s. f., maladie des poumons. - (20) |
| punaseau. s. m. Troène. (Argenteuil). - (10) |
| puni : punir - (57) |
| puonner (v. tr.) : essorer (syn. puer) - (64) |
| pupue. s. f. Huppe, oiseau. - (10) |
| puque loc. adv. Plus que. - (63) |
| pûr : Puer. « Qu'est dan qu'i a que pue c 'ment cen ? ». En parlant d'une chose malodorante et, au figuré, d'affaires véreuses, on dit : « Pu an y rebeuille pu y pue » : plus on remue plus çà sent mauvais. - (19) |
| pur : adj. Vin pur. Voir milan. - (20) |
| puran, purante se dit des vêtements pleins d'eau ou de sueur. - (16) |
| purcatoire : Purgatoire. « O peut bin entrer au paradis tot drat, ol a bin fait sari purcatoire en ce mande ». - (19) |
| purè : dégouliner, en parlant de l'eau - (46) |
| pure, v. n. puer. - (22) |
| pure, v. n. puer. - (24) |
| purée, s. f. bouillie. (voir : peurée.) - (08) |
| purer v. a. Presser des fruits, des légumes, pour en exprimer la pulpe, de l'oseille ou des épinards cuits, pour en exprimer l'eau. - (10) |
| purer, v. tr. et intr., égoutter, couler. - (14) |
| purési, pleurésie. - (05) |
| purgatouaíre (n.m.) : purgatoire - (50) |
| purger, presser un fruit avec ses doigts pour s'assurer de sa maturité. - (27) |
| pûri s. m. lieu où se trouvent les prisonniers du jeu de barres. - (08) |
| pûri : pourrir - (39) |
| pûri, v. n. pourrir. - (08) |
| pûrîsi, s. m., pleurésie. - (14) |
| purisie (purisi) : s. m., pleurésie. - (20) |
| purisie, sf. pleurésie. - (17) |
| purisy. Pleurésie, vieux mot. - (03) |
| pûriteure, s. f. pourriture. - (08) |
| purote : en bras de chemise (être en purote) - (46) |
| pûrri (p.p.) : p.p. du verbe pourrir - (50) |
| purriére. : (Dial. ), poussière. - Du latin pulverem, cas oblique de pulvis. - (06) |
| pus (adv.) : plus (j'en veux pus (je n'en veux plus)) - (64) |
| pus : plus - (51) |
| pus : plus - (39) |
| pus, et pu, adv. de comparaison, plus : « Quand t'vas la vouér, te prends l’pus còr. » - (14) |
| pus, peu conj. négative. Plus (plus du tout). - (63) |
| pus. adv. - Plus : « Faudra en mét' un peu pus qu'la derniée foué ! » - (42) |
| pus. Puis ; plus. « Et pus o vint » (et puis il vint) ; « o n'en peut pus » (il n'en peut plus). - (49) |
| puse : puce - (43) |
| puser, vt. puiser. - (17) |
| pûser. v. - Essorer, tordre : « Veins don' m'ainder, on va pûser les draps. »(Arquian) - (42) |
| pusin n.m. Poussin. Voir pion. - (63) |
| pus'ke, puisque. - (16) |
| pusot. Puceron. - (49) |
| pusque : puisque - (39) |
| pussance. Puissance, puissances. - (01) |
| pussenére : La pussenére ou la pussinère est la constellation des Pleïades. - (19) |
| pussenöre, sf. poussinière. - (17) |
| pusshir , pisser. - (05) |
| pussin - poussin. - I ons douze pussins. - Que vos p'sins venant don bein ! - I ai vu vote pussin lâvan, vé lai rivére. - On emploie l'abréviation au moins aussi souvent que le mot entier, selon la commodité de la prononciation. Au féminin ont dit pussine dans le sens de pitte. - (18) |
| pussin (on) : poussin - (57) |
| pussin : s. m. poussin. - (21) |
| pussin : s. m., poussin. - (20) |
| pussin, et p'ssin, s. m., poussin : « Alle ét empêtrée c'ment eùne poule qui n'a qu'eùn p'ssin » - (14) |
| pussin, poussin mâle. - (26) |
| pussin, poussin. - (27) |
| pussin, pussine : poussin, une jeune poule - (46) |
| pussin, pussine, poussin, poussine. - (16) |
| pussin, sm. poussin. - (17) |
| pussin. Pour poussin. - (12) |
| pussine, poussin femelle. - (26) |
| put ! interj. de dédain : « Eh ben ! quoi ? put !... éprâs tout, j'm'en moque. » - (14) |
| put, pute. adj. Laid, malséant. (Irancy). Du latin putidus. - (10) |
| put, vil, bas, pute, terme injurieux dont le synonyme actuel est bien connu ; on disait autrefois deputaire par opposition à debonnaire, peut, peute, laid. - (04) |
| putain. Se dit d'un homme. - (03) |
| putassier n. et adj. Vil, individu prêt à toutes les bassesses pour arriver à ses fins. - (63) |
| putassier. n. m. - Coureur de filles, de putains (Sainte-Colombe-sur-Loing). Ce terme est toujours utilisé dans la langue française populaire. - (42) |
| putaud (du latin putidus) s. m. Homme laid ou de mauvais renom. – Au féminin, putaude. (Courgis). - (10) |
| puteut : Adverbe. « Vins dan puteut te preumener que de demorer sité au carre du fû » : viens donc te promener plutôt que de rester assis au coin du feu. - (19) |
| putô, plus tôt et plutôt ; putô, de meilleure heure. - (16) |
| putôt - plus tôt ; et plutôt. - Pou ne pâ éte en retaird venez in pecho putôt. - Faisez putôt queman cequi, ci vauré mieux. - (18) |
| putôt, adv., plus tôt, et plutôt. - (14) |
| putöt, putiöt, adv. plutôt. - (17) |
| putôt, pyutôt adv. Plutôt. - (63) |
| putouée : putois - (48) |
| putoût. adv. - Plutôt ou plus tôt : «Et s'couchinrent ben vite pou êtr 'putoût au lendemain. » (Fernand Clas, p. 222) - (42) |
| putrat, putrin. s. m. Jus de fumier, purin ; boue fétide qui en résulte. (Vertilly). - (10) |
| putt ! - exclamation, expression du peu de cas que l'on fait de quelque chose. - A n'en pâ velu m'en beiller davantage… putt !... – Et pu çâ' lai to ce qu'al ant !... putt. - (18) |
| Puy. nom de localité qu'on rencontre dans quelques parties du Morvan et qui désigne une montagne, une colline ou au moins une éminence de terrain. le hameau dénommé le puits est au pied du beuvray. - (08) |
| puyant, adj. qui sent mauvais. Gommeux, faiseur de manières. - (24) |
| pùyant, s. m. gommeux, faiseur de manières. - (22) |
| pu-ye, s.m. peuplier. - (38) |
| puze : (nf) puce - (35) |
| pûze n.f. Puce. - (63) |
| pyacâ n.m. Placard. - (63) |
| pyafond n.m. Plafond. - (63) |
| pyainde v. Plaindre. - (63) |
| pyaindre (se) : plaindre (se) - (43) |
| pyaindre : plaindre, p.passé : pyégnu - (35) |
| pyaindu p.p. de pyainde. Plaint. - (63) |
| pyainte n.f. Plainte. - (63) |
| pyaisant adj. Plaisant. - (63) |
| pyaisantin n.m. Plaisantin. - (63) |
| pyaisantrie n.f. Plaisanterie. Voir beurdinerie. - (63) |
| pyaisi n.m. Plaisir. - (63) |
| pyai-ti ? loc. (litt. Plaît-il ?) Comment ? - (63) |
| pyan-pyan adv. Doucement. - (63) |
| pyanquer v. Planquer. - (63) |
| pyant n.m. Plant. - (63) |
| pyante n.f. Plante. - (63) |
| pyanté n.m. Plantain. - (63) |
| pyanter v. Planter. Arrive que pyante. Advienne que pourra. Peu importe ce qui en résultera. - (63) |
| pyanter : v. planter. - (21) |
| pyantoî n.m. Plantoir. - (63) |
| pyaque n.f. Plaque. - (63) |
| pyaquer v. Plaquer. - (63) |
| pyare v. Plaire. - (63) |
| pyare, pierre. - (26) |
| pyat : (adj) plat ; fém. pyiète - (35) |
| pyat : s. m. plat. - (21) |
| pyat n.m. Plat. I'aurint mandzi l'pyat. Ils auraient mangé le plat (tellement ils avaient faim). - (63) |
| pyat, pyate adj. Plat, plate. - (63) |
| pyatâne n.m. Platane. - (63) |
| pyateau n.m. Plateau. - (63) |
| pyatine : s. f. plaque métallique des vieilles cheminées et partie plate à l'intérieur du four. - (21) |
| pyâtre n.m. Plâtre. - (63) |
| pyäyi, piéyi : plier - (35) |
| pyèce : (nf) place - (35) |
| pyéce n.f. Place. - (63) |
| pyèche : s. f. place. - (21) |
| pyéci v. Placer. A onze ans dz'étos pyécie vés des bourdzeois. - (63) |
| pyein, pyeiñne adj. et n. Plein, pleine. - (63) |
| pyeiñne main n.f. Poignée pleine. - (63) |
| pyencer : économiser. (S. T III) - D - (25) |
| pyenne main: (nf) poignée, contenue d'une main - (35) |
| pyersil s. f. persil. - (21) |
| pyessis n.m. 1. Haie vive tressée entre les pieds d'arbustes étêtés. 2. Enclos entouré de haies vives. - (63) |
| pyeu : s. f. pluie. - (21) |
| pyeue, pluie. - (26) |
| pyeume : s. f. plume. - (21) |
| pyeume n.f. Plume, épluchure. - (63) |
| pyeumer : (vb) plumer, éplucher - (35) |
| pyeumer v. Plumer, éplucher. - (63) |
| pyeûmet : (nm) coussinet sur la tête de la vache attelée - (35) |
| pyeumet n.m. Coussinet bourré de paille de maïs isolant le joug de la tête des bœufs. - (63) |
| pyeumme, plume. - (26) |
| pyeurer v. Pleurer. - (63) |
| pyeurésie n.f. Pleurésie. - (63) |
| pyeûri : (vb) pleurer - (35) |
| pyeurs n.f.pl. Pleurs. - (63) |
| pyeutse : (nf) épluchure - (35) |
| pyeuviner v. Bruiner. - (63) |
| pyèzi, plaisir. - (26) |
| pyi n.m. Pli. - (63) |
| pyier v. Plier. - (63) |
| pyin, pyenne : (adj) plein (e) - (35) |
| pyinche : planche. (PLS. T II) - D - (25) |
| py-inche, planche. - (26) |
| pyinthe n.f. Plinthe. - (63) |
| pyintse : (nf) planche ; carré de jardin - (35) |
| pyintse n.f. Planche. - (63) |
| pyintsi de cotson : plancher à porcs A - B - (41) |
| pyintsi n.m. 1. Plancher. 2. Caillebottis. - (63) |
| pyomb n.m. Plomb. - (63) |
| pyondzi v. Plonger. - (63) |
| pyot n.m. (du bas lat. ploda, pièce de bois, de l'anc.fr. plot, billot) Billot, souche à fendre. - (63) |
| pyot ! (qué gros) : (quel gros) lourdaud ! (à marche pesante) - (37) |
| pyou : (nf) pluie - (35) |
| pyou n.f. Pluie. - (63) |
| pyour, pyeuvre : pleuvoir - (35) |
| pyoûre v. Pleuvoir. - (63) |
| pyoure : v. pleuvoir. - (21) |
| pyouyer, plier. - (26) |
| pyun, plein. - (26) |
| pyus , pyus' adv. Plus, davantage, en outre. Trois touries pyus' eune tseuvre. Voir maîs. - (63) |
| pyutôt, putôt adv. Plutôt. - (63) |
| pzé, bzé, vt. peser. - (17) |
| pzè, peser une marchandise ; on dit aussi : pëzè ; é pëze bin, il donne le bon poids, en parlant d'un marchand. - (16) |
| q 'ri : chercher (du vieux français : quérir ? ) ; va q'ri un siau d' iau : va chercher un seau d'eau. - (56) |
| q... - (bien des mots à voir par C.) - (18) |
| qeugner (pour cogner). v. a. Bossuer. C'est l'effet pour la cause : un objet est bossué, parce qu'il a été queugné. (Perreuse). - (10) |
| q'nout. n. m. - Cerisier sauvage. (Leugny, selon F. Clas) - (42) |
| qoi s'ke, qu'est-ce que ? quoi s'k'an di ? que dit-on ? qoi s'k'an fé ? que fait-on ? Qoi s'k'an fé chë veu ? comment se porte-t-on, chez vous ? - (16) |
| qoua va-t-il ? où va-t- il ? - (05) |
| qri v. Chercher, quérir. Va qri les vatses ! - (63) |
| qu' : 1 pron. relat., pron. inter. et conj. Que. - 2 pron. relat. Qui. - (53) |
| qu’ai. Qu'il, qu'ils. Ou'ai est également pluriel et singulier. Qu’ai veigne, signifie qiril vienne, et qu'ils viennent. - (01) |
| qu’eûtre, v. a. connaître, reconnaitre. - (08) |
| qu’ion : petit bout de bois conique mis dans la bonde d'un tonneau pour faire appel d'air, ou placé en dessous de la crémière en terre - (43) |
| qu’ri : (vb) chercher - (35) |
| qu’ri : chercher (aller) - (43) |
| qu’ri : (cri - v. trans.) aller chercher. - (45) |
| qu’yiquet : cliquet - (37) |
| quâ ! : Exclamation pour faire ouvrir le bec à un oiseau en lui donnant la becquée. « Quâ ! jacquot ». - (19) |
| qua : Prononcer ka. Quoi. « Pa qua fare ? » : pour quoi faire ?. « Marci y a pa de qua » : merci il n'y a pas de quoi. - (19) |
| qua : quoi - (43) |
| qu'a dit, loc. qu'il dit, forme locale de que il dit. - (08) |
| quà ? et qu'à-ce ? pr. rel. et interj., quoi ? et qu'est-ce ? Figure dans le plus grand nombre des phrases interrogatives : « Ma, qua c'a-t-i qu'alle a qu'à crie? — Alle a qu'alle a chu. » - (14) |
| qua. Prononcez quoi, où ; quà va dis, se traduit par quâ vas-tu? C'est le même mot. - (03) |
| quacou (nom féminin) : voir caquou. - (47) |
| quadrette : s. f., groupe de quatre joueurs associés. Voir doublette. - (20) |
| quadria (pwèr) : poire assez grosse et de couleur grise, peut-être la passe-crassane. (RDM. T IV) - B - (25) |
| quadrin : boîte à goûter. III, p. 31 - (23) |
| quahimoudou, quasimodo, le dimanche qui suit Pâques. - (08) |
| quai : quoi - (57) |
| quai. Estomac de chevreau préparé pour faire de la présure. - (49) |
| quaibeugné : cabossé. (S. T III) - D - (25) |
| quaihiment (adv.) : quasiment, presque - (50) |
| quaihiment, adv. quasiment, comme. - (08) |
| quailaizes dâs reûes : calages des roues - (37) |
| quailiteu, euse, adj. qui a de la qualité, qui est de bon aloi : ce blé est « quailiteu », c'est une terre « quailiteuse. » - (08) |
| quaillè : caillé - (48) |
| quaillé : caillé, caillot - (39) |
| quaillot : caillot - (39) |
| quâiment : presque - (37) |
| quaïment. adv. - Quasiment. - (42) |
| quain, quainne - quelle, quelle ; celui ou celle que. - En voiqui deux ; vos choisiras le quain que vos vouras. - I sons aissez embarraissé ; i ne saivons pas du tot lai quainne qu' bonne. - Quainne heure quen â ? - (18) |
| quaingnô, s. m., était jadis le nom du présent que les parrains faisaient à leurs filleuls le premier jour de l'an après leur baptême. (V. Quignòt, Quin-nòt.) - (14) |
| quair : quart - (48) |
| quair : stalle - (48) |
| quairante : adj. num. Quarante. - (53) |
| quairnais, nale, adj. de travers, de côté. - (08) |
| quairnal : (kêrnâ:, -al: - adj.) qui penche dangereusement, bien près de « verser ». - (45) |
| quaírné (loc.adv.) : de quart, de travers - (50) |
| quairne, adj. ce qui est de quart, de travers, de côté ; ce qui est penché, incliné ; ce qui a perdu son aplomb. - (08) |
| quairner : (kêrnè - v. intr.) pencher dangereusement. - (45) |
| quairner, v. a. mettre de quart, de côté, de travers, obliquement, pencher. - (08) |
| quairniau, s. m. lucarne, ouverture, fente pour donner du jour. - (08) |
| quâirriaux : carreaux - (37) |
| quairtaut : quartaut (en morvan 57 litres) - (37) |
| quairteille, s. f. petit quartier, portion, morceau : « eune quairteille » de pain. - (08) |
| quairteiller : (kêrtèyé - v. trans.) déplacer un objet lourd par quarts de rotation. En français régional, on dit : « faire marcher ». - (45) |
| quairteillier, v. a. mettre de quart, dresser, diriger de côté, incliner, pencher une pierre, un bloc, ou tout objet qui a plusieurs faces. - (08) |
| quairtié, s. m. quartier, morceau : « eun quairtié » de pain, de lard, de roche, de bois, etc. - (08) |
| quairtô : tonneau de 57 l (1/4 de pièce) - (48) |
| quaisse, poêle à friture. - (27) |
| quait fârs en l’âr (lâs) : étendu sur le dos - (37) |
| quaite (adj.num.) : quatre - (50) |
| quaite : quatre - (48) |
| quaite, adj. num. quatre. - (08) |
| quaite, ou quaitre - quatre. On met quelquefois quaitre devant une voyelle. - I en aitendâs deux, â sont venus quaite. - En y aivo quaite chevaux su lai fouaire. - Le petiot du Châtain, ci é déji quaitre ans. - (18) |
| quaiteron, quarteron - quart ; surtout le quart de cent, c'est-à-dire vingt-cinq. - Vais voué m'aichetai in quaiteron d'épingues. - I ai mégé pour mai pairt in quaiteron de châtaignes. - (18) |
| quaitore (adj.num.) : quatorze - (50) |
| quaitore, nom de nombre. Quatorze. - (08) |
| quaitton (en), en grumeaux. - (28) |
| qualiteux (se) : se d'une bête en bonne viande - (39) |
| quan. Quand… - (01) |
| quance (faire) : faire semblant. (A. T II) - D - (25) |
| quance (Faire) : semblant. - (66) |
| quance (faire), faire semblant. - (27) |
| quance (faire), faire semblant. - (28) |
| quance (faire). Faire semblant. Ex. : « Quand je lui ai demandé de l'argent, il a fait quance de ne pas me comprendre. » Etym. inconnue. - (12) |
| quance, comme si. Faire quance de (en latin, agere quasi), agir de manière à faire croire qu'on fait une chose, mais ne la point faire. On la trouve aussi çà et là dans les auteurs aller de quance, pour aller de côté... - (02) |
| quance, eance (C.-d.) (faire).- Faire semblant… - (15) |
| quance, sf. fare lai quance de, faire semblant de. Po quance, pour rire. - (17) |
| quance. Semblant, mine. Faire quance, c'est faire mine, faire semblant. On dit d'un homme qui sait bien dissimuler, qu'ai fai bé lé quance… - (01) |
| quance. : Semblant de. Faire quance (latin quasi ou quantumcumque), c'est agir comme si l'on faisait une chose qu'on ne fait point. On dit encore dans le langage familier c'est quasi cela, quasiment cela. - (06) |
| quand : (conj) en même temps que « ol é v’ni quand ma » - (35) |
| quand : avec (« y y vai quand touai ! ») - (37) |
| quand : avec - (48) |
| quand : en même temps (« s’couc’er quand lâs poules ») - (37) |
| quand : en même temps que - (43) |
| Quand le vin ne coule plus que lentement du robinet, parce que le niveau a beaucoup baissé dans la pièce, on dit que ça moule ou encore que ça pisse en vache. - (20) |
| quand que, loc., lorsque : « J'prendrons noute grande panière quand que j 'irons au marché. » - (14) |
| quand : conj., vx fr. quant, avec, en même temps que. J'irai quand toi. Viens-tu quand moi ? Sa femme est brouillée quand lui. - (20) |
| quand, adv., avec, en même temps que : « J'irai là-bas quand vous. » - (14) |
| quand, adv., en même temps que. Ex. : j'arriverai quand vous, pour en même temps que vous. - (11) |
| quand, pré. en même temps que (j'y vais quand toi - j'y vais avec toi). - (65) |
| quand, prèp. s'emploie pour « avec », dans le sens d'accompagner : je vais quand toi, nous irons au marché quand lui. - (24) |
| quand. En même temps que. Ex. : « Montez en voiture, je vais prendre la traverse, et j'arriverai quand vous. » - (12) |
| quandqu' : quand - (48) |
| quanque, loc. adv. autant que, autant de fois que, tout ce que : « teu s'ré le mâtre quanque teu l’ vouré », tu seras le maître lorsque tu le voudras. - (08) |
| quanque. conj. - Lorsque, quand. - (42) |
| quant conjonct. En même temps que. Ôl est vni quant ma. - (63) |
| quant et vous, avec vous. - (04) |
| quant' : adv. interr. Quand, uniquement quand la liaison orale ce fait avec une voyelle. - (53) |
| quant’, quant’y : quand - (37) |
| quanté (a) : à côté - ou en même temps. Ex : "il est ben arrivé au bourg à quanté moué !" - (58) |
| quante, adv., quand. Nous avons vu « quand », mais qui a une autre acception : « Quante la p'tiote veinra, j'li baillerai eùne flameùsse. » - (14) |
| quante, quanter, entaille de marque ou d'ouche. - (05) |
| quante. On appelle ainsi les entailles faites dans l'ouche, ou de semblables ;du latin quantus, qui marque la quantité. - (03) |
| quantes fois que, loc. autant de fois que, aussi souvent que : « i vinré quantes fois qu'teu vouré », je viendrai aussi souvent que tu voudras. - (08) |
| quantitié, sf. quantité. - (17) |
| quar. Quart, quarts. - (01) |
| quaraller : Quereller. « Ces deux animaux sant toje après à se quaraller » : ces deux imbéciles sont toujours en train de se quereller. - (19) |
| quarantaîn-ne (na) : quarantaine - (57) |
| quarantaiñne n.f. Quarantaine. - (63) |
| quarbillo : tonnelet. (C. T III) - B - (25) |
| quàréle, s. f., querelle, dispute. - (14) |
| quarelle, diminutif de quarre, un petit coin, un de quelque chose. - (02) |
| quarelle. : (Dial.), diminutif de quarre. – Un petit coin, un fragment d'une chose. - Dans le patois, quarelle est aussi le même mot que le français querelle. C'est dans ce sens que les expressions pairôle de quarre signifient parole de travers. - (06) |
| quârillot (l’) : friche de genêts près du « village de l’homme » - (37) |
| quarquelin, échaudé, pièce de pâtisserie légère. - (02) |
| quarre : coin, compartiment, angle, côté d'un carré selon Chambure, qui devrait donc écrire Car (d'où Carat, Carate ?). - (52) |
| quarre : guérir (ne s'emploie qu'à l'infinitif). - (30) |
| quarre du feu : (au) coin du feu. IV, p. 59-h - (23) |
| quarre en coin (de), loc. d'angle en angle. - (08) |
| quarré : s. m., pal ou pieu transversal servant à fermer une bouchure. - (20) |
| quarré, angle droit. - (05) |
| quarré, carex, herbe marécageuse. - (05) |
| quarre, coin, partie anguleuse d'un lacet... - (02) |
| quarre, quaire, s. m. coin, compartiment, case, place, angle, côté d'un carré, quelquefois le carré même : « ç'ô eun endreumi, a n' quitte pâ l’ quarre de son feu. » - (08) |
| quarre, se mettre dans son quatre, se dit des nouveaux mariés qui quittent le logis paternel pour former un établissement particulier. - (11) |
| quarre, v. a. chercher, quérir. - (08) |
| quarre. Coin, angle, parce que tout carré ayant quatre angles ou coins, chacun de ces coins ou angles est, en bourguignon, appelé quarre… - (01) |
| quarrée, dans le sens de chambre : la brave quarrée, pour la belle chambre. - (11) |
| quarrie, s. f. coin, angle : « quarrie d' l'éheille », coin de l'oreille. - (08) |
| quarroy, carrefour, quarrie, Quarre-rouge, nom de lieu. - (04) |
| quart (aller de). exp. - Aller de travers. - (42) |
| quart (de) : de côté. - (09) |
| quart (n.m.) : coin - le quart du fu le coin de l'âtre - (50) |
| quart : (nm) coin (quart du fu : coin du feu) - (35) |
| quart : s. m., quartier, résidence. De nombreux lieux habités, dans notre département, sont dits le Quart, les Quarts, ou sont formés du mot Quart suivi d'un nom patronymique, comme Le Quart Barrot, Le Quart Belin, Le Quart Bernard, etc. - (20) |
| quart : voir carre. - (20) |
| quart. Coin. « Regarder d'un quart d'œil ». - (49) |
| quartaud : fût, contenance : un quart de feuillette. - (32) |
| quartault, demi-feuillette ou quart de tonneau. - (05) |
| quartault, mesure de grains. - (05) |
| quartaut : Quart d'une pièce de vin, 54 litres. « In quartaut de vin ». - (19) |
| quartaut : tonneau. En principe : ½ de feuillette (114 L) ou ¼ de fut (228 L). - (62) |
| quartaut n.m. Tonneau d'une contenance de 57 litres. La feuillette a une capacité du double, 114 litres et la pièce (barrique) de 228 litres. - (63) |
| quartaut, quarteau : s. m., quart de tonneau, ancienne mesure de capacité pour les liquides, valant 52 litres 2915 et contenant actuellement, en Mâconnais, environ 54 litres. - (20) |
| quartcher (on) : quartier (morceau) - (57) |
| quarté : Quartier. « I demorant dans le mouême quarté ». Ce qui reste d'un pain entamé. Terme dont se servent les afouagistes pour désigner la portion de la coupe de l'année qui doit être partagée entre dix ayants droit. « Tiri les quartés » : tirer au sort pour l'attribution des quartiers. - Phases de la lune : « Le premé, le darré quarté ». - (19) |
| quarte : s. f., ancienne mesure de capacité pour les liquides, contenant 8 pots, c'est-à-dire 7 litres ; seau tronconique en bois, de la contenance de la quarte, servant exclusivement à mesurer le vin. - (20) |
| quarté, s.m. quartier : in quarté d'paingne, le quart d'un pain. - (38) |
| quartei, s. m., quartier, morceau, portion. - (14) |
| quartelle. s. f. Morceau d'un quartier. Une quartelle de pomme. Le quart est plus gros que la quartelle. – On dit aussi quartelot dans le même sens. - (10) |
| quartelot. n. m. Quartelle. n. f. - Quartier « un quartelot d'poumme. » - (42) |
| quarteranche : s. f., mesure de capacité pour les grains, valant 14 litres 314. Voir coupe. - (20) |
| quarteranchée : s. f., ancienne mesure de surface pour les terres, correspondant à ce qu'on peut ensemencer avec une quarteranche de grain, et valant 4 ares 346. - (20) |
| quarteron : s. m., ancienne mesure de capacité pour les grains, correspondant étymologiquement au « quart » d'une mesure telle que le setter ou le poinçon, et contenant probablement quatre coupes (si l'on s'en rapporte du moins au texte suivant), ce qui la ferait l'équivalent du minot, soit 52 litres 132. Voir coupe. - (20) |
| quarteronnée : s. f., ancienne mesure de surface pour les terres correspondant à ce que l'on peut ensemencer avec le quart du bichet ou quarteron. Si le quarteron valait quatre coupes, la quarteronnée correspondait à quatre coupées, c'est-à-dire à environ 15 ares 828. - (20) |
| quarti (on) : quartier (viande) - (57) |
| quarti : quartier - (43) |
| quartier, n.m. hameau. - (65) |
| quartille : quartier, morceau. III, p. 61-1 - (23) |
| quasi, et quasiment, adv., presque. Entre dans une locution assez piquante : « Y a du quasi, » comme qui dirait : Il y a du presque, c'est presque cela : « O va d'avou elle ; alle l’ainme quasiment . » Remarquez elle et all’ employés concurremment. - (14) |
| quasi, quasiment adv. Presque, à peu près. - (63) |
| quasi, s. m., ceinture osseuse du bassin. - (40) |
| quasi. En quelque sorte... - (13) |
| quasiman, à peu près, presque de la même manière. - (02) |
| quasiment : à peu près. - (09) |
| quat' : Quatre. « Jy sint allés quat' ou cin » : nous y sommes allés quatre ou cinq. « Du vinâgre des quat voleux » : du vinaigre extrêmement fort. - (19) |
| quat'. adj. num. - Quatre. - (42) |
| quat'chiffre : Quatre de chiffre. Piège formé d'une lourde planche supportée par trois réglettes disposées en forme de 4 et dont la moindre secousse rompt l'équilibre. « Tendre in quat'chiffre ». - (19) |
| quate : quatre - (48) |
| quate : quatre - (39) |
| quàte, adj., numérique, quatre : « Quàte sous. » - (14) |
| quate, quatre ; quate sous. - (16) |
| quate, quatre adj. num. Quatre. On utilise presque toujours quate sauf dans de rares expressions telles que "faire quatre heures". - (63) |
| quate. Quatre. Lé quate quarre, les quatre coins… - (01) |
| quatei - quartier, le voisinage, mot bourguignon cité dans l'Introduction. - Depeu qu'ai sont venu s'éborger dans le quatei. - (18) |
| quatei. Quartier, quartiers. - (01) |
| quat'en-chiffe, s, m., quatre-de-chiffre, piège pour prendre les rats, les oiseaux, et composé de trois petits bâtons à peu près disposés en forme de 4. - (14) |
| quate-z-yeux loc. Attende à quate-z-yeux : attendre en embuscade. - (63) |
| quat'fers d'un chien (ne vaut pas les), loc., imagée et expressive pour dire : Ne vaut rien. (V. Quat’vingt dix neuf coups.) - (14) |
| quat'heûres, s. m., goûter, léger repas que l'on fait vers les quatre heures. La mère, panier au bras, rentrant de courses, demande à son p'tiot : « As-tu fait quat’heures ? » - (14) |
| quatiö, sm. quartier. - (17) |
| quatorz : adj. num. Quatorze. - (53) |
| quatôrze adj.num.card. Quatorze. - (63) |
| quatoze. Quatorze. - (01) |
| quatranchife : n. f. Construction hétéroclite. - (53) |
| quatre en chiffre, s. m. piège à rats. - (08) |
| quatre heures (faire les). Faire un gouter à quatre heures de l’après-midi. - (12) |
| quatre heures : gouter - (44) |
| quatre heures : loc Faire quatre heures, faire le goûter de quatre heures. - (20) |
| quatre-chiffre : espèce de trappe sur un léger appui, pour prendre les rats - (60) |
| quatre-z-yeux (A) : loc, entre quatre yeux. Attendre quelqu'un à quatre-zyeux, l'attendre en embuscade. - (20) |
| quatr'heurer : Goûter à quatre heures. « N'y via temps de quatr'heurer». - (19) |
| quatr'heures : goûter - (48) |
| quatr'heures : Léger repas entre la « marande » et le souper. « Marander de quatr'heures » : goûter à quatre heures. - (19) |
| quat'vingt dix neuf coups (avoir fait les), loc., dont on se sert pour dire de quelqu'un qu'il a mené une vie joyeuse, dissipée, aventureuse, et qu'il ne vaut pas cher. (V. Quat-fers d'un chien.) - (14) |
| quaude (n.m.) : qui a la queue coupée - (50) |
| quausu : Quasi, presque, voir causu. - (19) |
| quavie : pourquoi ? - (09) |
| qu'avie, quévie. conj. - Pourquoi : « Qu'avie don' ? Qui s'récrions tous deusses. Eh ben que r'prend l' monsieur, c'est moué qu'est Deibler. » (Fernand Clas, P.353) - (42) |
| qu'avis, qu'avis donc ? Locut. interrog. Pourquoi, pourquoi donc ? Pourquoi ça ? De quel avis ? (Puysaie.). - (10) |
| quchotè : remplir à ras bord - (46) |
| qué (ë), pr. et adj. des deux genres. Quel. Grand, excellent au superlatif : È que digner, un fameux dîner. È que toupet, un fier toupet. - (17) |
| que (m) : grange à gerbes située à côté de faire de la grange. (CST. T II) - D - (25) |
| qué : Quel. « Que malheu ! » quel malheur ! « O ne sait plieu à qué saint se vouer ». - (19) |
| que : qui - çâ l’eil que vin, c'est elle qui vient - Çà leilles que v'non, ce sont elles qui viennent - (46) |
| que pron. rel. conj. et adv. dont, avec quoi. - (63) |
| que st'i aut ? que st i aut ? qu'est-ce que c'est ?. - (38) |
| que va ?, interrog. où ? - (24) |
| que vint : Qui vient, prochain. « Dimanche que vint ». - (19) |
| que vint, loc. prochain. L’an-née que vint, la semaine que vint, mardi que vint. - (22) |
| que vint, loc. prochain. L'an-née que vint, la semaine que vint, mardi que vint. - (24) |
| que : pron. rel., conj. et adv., dont ; avec quoi ; où. - (20) |
| que, et qui. - Ces deux pronoms sont quelquefois employés l'un pour l'autre. Mais on peut dire : 1° qu'à la première personne, si, Qui paraît mis pour Que ce n'est que par le simple effet de l'élision. - Les fruts qui eume bein. - Les champs qui aiaichetai. - 2° qu'à toutes les autres personnes c'est, en réalité, toujours Que qui est mis à la place de Qui. - C'â vo que vos fairâ cequi… C'â lu que veinré… C'â ces temps de plieue que rendant mailaide. - (18) |
| qué, ké, très gros ; à la vue, par exemple, d'un gros porc, d'un gros poisson, on dit : el â qué. - (16) |
| qué, pr. relat., quoi : « Qué qu't'as ? Qué qu'te voux ? » - (14) |
| qué, qeulle : (adj.) quel, quelle - (35) |
| qué, qué don pron. et adj. interr. Quel, quelle. Qué don noviaux te m'portes ? Quelles nouvelles m'apportes-tu ? - (63) |
| qué, quée, adj. quel, quelle. Se prononce au pluriel comme au singulier : « que chemin, que mensonges. - (08) |
| quecas, noix, calas. - (04) |
| quecé, adj. se dit quand on a tout perdu au jeu : je suis quecé. - (38) |
| quèche : poêle à frire. A - B - (41) |
| quéchion n.f. Question. Dans l'feuron du diabye, nos voyot l'Juyien Leperse, y'étot Quéchion p'un tsampion. - (63) |
| quéchioñnaire n.m. Questionnaire. - (63) |
| quéchioñner v. Questionner. - (63) |
| quéc-tsouze : quelque chose - (43) |
| quécun, pour quelqu'un. - (02) |
| quée - pour quain et quainne. Voyez cet article. - Quée champ i laiborerons demain ? - Le quée de nos deux t'eume le pu ? – Lai quée de ces feilles lai te préférerâs ? - (18) |
| quée (adj.int. et excl.m.s.) : quelle - (50) |
| quée (le) : lequel - (39) |
| quéequ' : adj. indéf. et adv. Quelque. - (53) |
| quéequ'côs : adv. Quelquefois. - (53) |
| quéeze : adj. num. Quinze. - (53) |
| quegnon, s. m. quignon. - (24) |
| quéhi, v. a. quérir, chercher, prendre. (voir : querre.) - (08) |
| quei. Quel, quels, quelle, quelles et quoi. - (01) |
| queicun. Quelqu'un. - (01) |
| quéille (n.f.) : caille - (50) |
| quèille : quelle - en quèille ânnée qu't'eû né ? en quelle année es-tu né ? - (46) |
| queille, s. f. la partie caillée du lait avec laquelle on fait des fromages. - (08) |
| queille, s. m. caille, oiseau de passage. - (08) |
| queiller, v. a. cailler, faire prendre en grumeaux, en caillots. - (08) |
| queillerotte, s. f. têtard de grenouille ou de crapaud. - (08) |
| queinchi, v. n. manifester de l'impatience en poussant des cris aigres et désagréables. - (22) |
| queinchi, v. n. manifester de l'impatience en poussant des cris aigres et désagréables. - (24) |
| queique. Quelque, quelques. On prononce quéque, et quéqu’un à Paris… - (01) |
| queiudre : coudrier, noisettier. - (32) |
| quel : s. m., personnage d'importance. C'est un quel, c'est quelqu'un. - (20) |
| quela : dernier né (d'une couvée). (T. T IV) - S&L - (25) |
| quela : noix. (RDC. T III) - A - (25) |
| quelache, cravate tout ordinaire. - (28) |
| quelair : feu follet. (RDM. T III) - B - (25) |
| quelar pour clar. : Feu follet, une chose qui claire. (Voir au mot clairai.) - (06) |
| quelar. Ardent, météore enflammé, feu sautelant qui parait de nuit autour des marais… - (01) |
| quéle (lai) : laquelle - (39) |
| queleire. : Pour exprimer colère, est du patois moderne. Ère (du latin ira) est le vrai mot. El at ère, c'est-à-dire il est fâché, il est en colère, est du franc patois. - (06) |
| quéler, v. a. réprimander, faire des reproches à quelqu'un. - (08) |
| quelère, colère. - (02) |
| quélette (n. f.) : récipient collectif dans lequel tous les convives buvaient à tour de rôle – récipient servant à quêter à l'église - (64) |
| quéllyi*, s. m. lait caillé. - (22) |
| quelogne, sf. quenouille. - (17) |
| quelogne. Quenouille… - (01) |
| quelognée. : Filasse garnissant une quelogne ou quenouille. - (06) |
| quelon, dernier-né. - (28) |
| Quelon. Jaquette, Jaqueline, Jaquelon. C'est de ce dernier que s'est formé Quelon. - (01) |
| quelongnée, quenouillée, filasse garnissant une quenouille. (Voir au mot felongne.) - (02) |
| quelot (nom masculin) : le plus petit des oiseaux d'une couvée. - (47) |
| quelot, culot. Le plus petit animal d'une nichée ; le plus jeune enfant d'une famille. - (49) |
| quelot, quelotte. Le dernier né d'une portée ou d'une couvée, le cadet des enfants, le plus petit, le plus faible. - (12) |
| quelot, s. m., dernier-né d' une famille. - (40) |
| quemâchlle*, s. m. crémaillère. - (22) |
| quemáchye, s. m. crémaillère. - (24) |
| queman. Comment…. - (01) |
| quemance. Commence, commencent. - (01) |
| quemancé. Commencé, commencez, commencer. - (01) |
| quemanci. Commençai, commenças, commença. - (01) |
| quemancire. Commençâmes, commençâtes, commencèrent. - (01) |
| quémander, mendier. C'est presque la traduction littérale du latin qui mendicat. - (02) |
| quemandouse - personne qui demande sans cesse, qui ennuie par ses sollicitations comme une Braimouse (voir ce mot). On dit aussi Quemandou et Braimou. - (18) |
| quemant – comment, comme, lorsque. - Quemant fau-ti qui faisâ ? - A n'é qu'ai bein traiveillé quemant vo, et à réussiré. - (18) |
| quemau, s. m. moyette de sarrazin. - (22) |
| qu'eme, pour que même. - (02) |
| qu'éme. : Apocope pour que même. - (06) |
| quemein faut (être), loc. être aimable et serviable : ces gens sont bien quemein faut (littéralement : comme il faut). - (24) |
| quement, conj., comment. Nous mettons ce mot à cette lettre parce qu'on ne manquera pas de l'y chercher. Mais, pour son orthographe plus logique, nous renvoyons à C’ment. - (14) |
| quemiau, s. m. moyette de sarrasin, fèves ou colza (du latin cumulus). - (24) |
| quemin, s. m., chemin, route à suivre. - (14) |
| quenard, trompeur. - (02) |
| quence - semblant. - Al é fait quence, voilai tot. - Le pu souvent ces gens lai faisant seulemant quence ci ne côte ran… - (18) |
| queneille. n. f. - Quenouille. - (42) |
| quenessu : reconnu. - (66) |
| queneton. : Duvet de cane. - (06) |
| quenette, quenotte. Dent d'un petit enfant ; se dit aussi pour désigner les dents de l'adulte. - (49) |
| queneussu, connu... - (02) |
| quenoille : quenouille - (43) |
| quenoïlle n.f. Quenouille. - (63) |
| quênôt : un canard. - (56) |
| quenotte : dent (enfant) - (48) |
| quenotte : dent. - (66) |
| quenouille : voir pressoir. - (20) |
| quenoux. s. m. Sauvageon sur lequel on ente les cerisiers. Dans les usages du Tonnerrois, le quenoux n'est pas con- sideré comme arbre à haute tige. - (10) |
| quenu. : D'où le patois a fait queneussu. (Franch. de Salmaise, 1265.) - (06) |
| queper : cracher. - (52) |
| quéq', quioque. adj. - Quelque. - (42) |
| quéq'choûe, quioq'choûe. pron indéf. - Quelque chose. - (42) |
| quéq'foué. adv. - Quelquefois. - (42) |
| quéq'onque. adj. - Quelconque. - (42) |
| quêqu : quelque - (51) |
| quéqu'chouse, et quét'chouse, loc., quelque chose. - (14) |
| quêque (adj.ind., adv.) : quelque - (50) |
| quêque (s) un (s) (ène (s)) : quelque (s) un (s) (une (s)) - (51) |
| quéque : quelque - (48) |
| quéque : Quelque. « O fa ce qu'o peut pa gagni quéques sous » : il fait ce qu'il peut pour gagner quelques sous. « Donne li tot de mouême quéque chose » : donne lui tout de même quelque chose. - (19) |
| quéque chouse (pron.ind.m.) : quelque chose - (50) |
| quéque co : quelquefois - (43) |
| quêque t’veux qu’y y fiaîsse ! : je n’y peux rien ! - (37) |
| quêque tsouze : quelque chose - (51) |
| quéque, et quéte, adj. indéf., quelque. - (14) |
| quèque, pron. quelque. - (17) |
| quèquè. Bêta, simple d'esprit, imbécile. - (12) |
| quèque. Quelque. - (49) |
| quéquefois : Quelquefois. « J'érins bin vos voir quéquefois ». - (19) |
| quéquendrœ (à), loc. quelque part, à quelque endroit. - (24) |
| quêques : quelques - (37) |
| quéques : quelques - (44) |
| quéques adv. Quelques. - (63) |
| quéques cops loc. adv. Quelquefois. Alle est vni m'adzuer quéques cops. - (63) |
| quequette. n. f. - Poule naine. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| quéqu'eunes adv. Quelques unes. - (63) |
| quéqu'fois, et quet'fois, adv., quelquefois. - (14) |
| quéquin : quelqu'un - yè quéquin ? van, yè vin... il y a quelqu'un ? non, il n'y a personne - (46) |
| quéquin : Quelqu'un. « J'attends quéquin ». - (19) |
| quêqun : quelqu'un - (51) |
| quéqun, quéquaine - quelqu'un quelqu'une. - En y aivot quéqun chez le Mâlaird quand i ai étai. - I venons de cueillai nos poumes ; peurnez en quéquaines pou vos petiots. - (18) |
| quéqun, s. et pron. indéf. quelqu'un ; au féminin " quéqueune. » - (08) |
| quéqu'un : (pron.) quelqu'un - (35) |
| quéqu'un adv. Quelqu'un. - (63) |
| quéqu'un, pr. indéf., quelqu'un. - (14) |
| quéqu'un, quéqu'une, quioqu'un, quioqu'une. pron. indéf. - Quelqu'un, quelqu'une. - (42) |
| quéqu'ung (pron.ind.) : quelqu'un - (50) |
| quéqu'uns, quéques uns adv. Quelques uns. - (63) |
| queratte, s. f., outil en fer pour nettoyer les socs de charrue ou les bêches. - (40) |
| querciller. Grésiller ; produire un petit bruit sec. - (49) |
| quercis, crécis. n. m. - Scorie du minerai de fer que l'on trouve dans toute la Puisaye, témoin d'une activité métallurgique importante de l'Antiquité à la fin du Moyen Âge. - (42) |
| quercoualle. s. f. Hanneton. - (10) |
| querelleux adj. Querelleur. - (63) |
| quereute : petit outil pour curer les sabots, les pioches - (43) |
| quergeot (n. m.) : terre rouge pleine de petits cailloux - (64) |
| querger : crier. - (09) |
| querger. v. n. Crier. (Châtel-Censoir). - (10) |
| queri - aller chercher. V. Cri. - (18) |
| quéri (les paysans prononcent cri), chercher. C'est le passif du latin quœrere. - (02) |
| quéri : Quérir, chercher. « Ol est allé quéri in fagueut ». - (19) |
| querî, et q'rî, v. tr., quérir, chercher : « Attends ! attends ! si tu n'veins pas, j'm'en vas aller t’q’rî. » — « J'peux pas ouvrî l'tirouér ; va m'qu’ri la clé. » - (14) |
| queri, v. a. aller chercher, quérir. - (22) |
| queri, v. a. aller chercher, quérir. - (24) |
| queri. Chercher ; du latin quoerere. - (03) |
| queri. Quérir. - (01) |
| quérier (v. int.) : crier, pleurer - (64) |
| querier : crier - (39) |
| querier, v. ; crier. - (07) |
| querieu (se) : curieux (se) - (39) |
| queriot (pour criot). subs. m. Terre crayeuse. - (10) |
| queriot, criot. n. m. - Terrain sec et pierreux favorable à la vigne, situé à flanc de coteau. - (42) |
| quérir, chercher. - (04) |
| querir. Chercher, demander : l’r ne se prononce pas. Au moyen-âge les vagabonds étaient appelés painquérants. - (13) |
| querlame. Ce mot pittoresque n'est plus guère usité, si ce n'est dans quelques villages de l'arrière-côte ; il signifie crémaillère. Il est écrit cromascle dans le protocole d'un notaire du XVe siècle. Les Morvandeaux disent quierâme et les Flamands coularme. - (13) |
| quermaillère. Crémaillère. - (49) |
| quernaille. Corneille. - (49) |
| quernet. adj. Qui incline la tête à droite ou à gauche. (Guillon). - (10) |
| querniâ : adj. Et n. m. Tordu. - (53) |
| querotte : raclette, surtout pour nettoyer la terre après la charrue - (39) |
| querre, v. a. quérir, chercher. - (08) |
| querre. : (Dial.), quéri (pat.), chercher (du latin quoerere), faisait je quis au parfait, dans le dialecte. - Le patois dit quéri et prononce cri. - (06) |
| querrée, carcasse (sottise grossière) - (36) |
| querrier : crier - (61) |
| quersî (v. int.) : déteindre, ternir - (64) |
| quersiller (pour cressiller). v. n. Frissonner, ressentir par tout le corps un certain frémissement, un malaise subit et désagréable sous l'impression d'un mouvement de crainte ou de terreur, ou bien au grincement de deux corps qui crissent en se frottant. - (10) |
| quersiller : trembler. (MM. T IV) - A - (25) |
| quersiller : grésiller (dans la poêle, principalement). Ex : "T'entends-t-y qu'ça quersille ? mets-don nout' mourciau d'beu à cuie !" (Beu : pour beuf). - (58) |
| quersiller. v.- Frémir, trembler. Se dit également pour grésiller. - (42) |
| querson. Cresson ; cartilage. - (49) |
| quertous. Fém. Quertouse. Crasseux, malpropre. - (49) |
| ques-qu'un, pronom, quelqu'un. - (38) |
| quesse - poêle, ustensile de cuisine. V. Caisse. - (18) |
| quesse (n.f.) : poêlon - (50) |
| quesse : poêle (casserole). - (29) |
| quesse : une poêle à frire - (46) |
| quesse : (kès' - subst. f.) poêle (subst. f.) - (45) |
| quesse, s. f. poêle, lèchefrite. - (08) |
| quessée : une poêle bien remplie - (46) |
| quesson : matière agglomérée - (48) |
| quét' : adj. num. Quatre. - (53) |
| quéte (na) - tchiéte (na) : quête - (57) |
| quéte n.f. Quête. - (63) |
| quêter, v. a. chercher, se mettre à la recherche pour trouver quelqu'un ou quelque chose, mendier : quêter son pain, demander l'aumône. - (08) |
| quêteux n.m. Quêteur. - (63) |
| quetialles, n. fém. plur. ; jambes. - (07) |
| quéton : agneau. (F. T IV) - Y - (25) |
| quetoufle (nom féminin) : poche d'eau consécutive une piqûre ou une brûlure. - (47) |
| quétoux : Quêteur. « As- tu donné quéque chose au quétoux ? ». Autrefois le curé et le maître d'école avaient chacun leur « quétoux » qui passait dans les pressoirs au moment de la récolte et dans les années d'abondance on remplissait volontiers leur arrosoir. Cette coutume a disparu, les bonnes habitudes se perdent ! - (19) |
| queu : Coq, voir c'eu. - (19) |
| queu : cuit (queute au féminin) - (46) |
| queu : cuit - (48) |
| queû, et qué, adj., quel. - (14) |
| queu, quieu, adj. quel : « queu hom', queu malheur. » - (08) |
| queube : souche. Peut-être du celte « keun » de même sens. - (62) |
| queuch' : n. f. Cuisse. - (53) |
| queuche (n.f.) : cuisse - (50) |
| queûche : cuisse - (37) |
| queuche : cuisse - (44) |
| queûche : cuisse, jambe - (48) |
| queuche : cuisse. - (52) |
| queuche : cuisse. - (59) |
| queuche : sommet - (44) |
| queuche : une cuisse. - (56) |
| queuche : cuisse. Une queuche de poulat : une cuisse de poulet. - (33) |
| queûche et queûchotte - cherchez par Cueuche. - (18) |
| queuche : (keu:ch' - subst. f.) cuisse ; par extension, la jambe tout entière. - (45) |
| queuche : cuisse - (39) |
| queuche : jambe, cuisse. - (32) |
| queuche, s. f. jambe : « i m' seu fé mau es queuches », je me suis fait mal aux jambes. - (08) |
| queuche, s. f., sommet de l'arbre. - (40) |
| queuche, subst. féminin : cime de l'arbre. - (54) |
| queûche, subst. féminin : jambe, cuisse. - (54) |
| queuchener, v. a. écussonner, greffer en écusson. - (08) |
| queucher. v. a. Casser. Queucher des noix. (Soucy). - (10) |
| queûchére, ou cueûssére - jambe de bas, sans le pied. Nos ancêtres, nos grand'mères surtout, mettaient leur petit trésor dans une queuchére. - Voiqui deux queuchéres qui renterai et ci me fairé ine jolie paire de bas. - Ine cueussére, ci se caiche dans lai peillaisse. - (18) |
| queuches, s. f., pl. cuisses . - (40) |
| queuches. Cuisses, jambes. I seus lâsse d'aivoïr été ai Echevarne ( Echevronne) les queuches me fiant mau. (V. Cagnards et êqueu). - (13) |
| queuchin (n.m.) : coussin, oreiller - (50) |
| queûchot : haut d’une côte, d’une colline, d’un arbre - (37) |
| queûchot : jambe de pantalon - (48) |
| queuchot : jambe de pantalon - (39) |
| queuchot, s. m. jambe, la partie du pantalon dans laquelle on met la jambe. « queussot. » - (08) |
| queuchot, s. m., tète en général. - (40) |
| queuchot. Cime. - (49) |
| queuchou : tête - (44) |
| queucle. V. cueucle. - (05) |
| queude (n.m.) : noisetier, coudrier (du lat. corylus, qui a donné couldre en a. fr.) (aussi queudre, coudre, coutre) - (50) |
| queude. Coude. - (49) |
| queuder (se). S'accouder. - (49) |
| queuder. v. n. Terme de vendange. Remplir des queues, des fûts, en plus grand nombre qu'on avait calculé ; en d'autres termes, récolter au-delà de ses espérances. - (10) |
| queûdes : tiges de noisetiers - (37) |
| queudre : coudrier, noisetier - (60) |
| quêudre : cueillir. - (62) |
| queudre, noisetier, coudre... - (02) |
| queudre, quieudre, s. f. coudrier, noisetier. - (08) |
| queudre. Cueillir. - (03) |
| queudre. V. cueudre. - (05) |
| queudron, arrête-bœuf, plante. - (05) |
| queûe d’poéle : têtard - (37) |
| queue de casse : têtard - (44) |
| queue de casse : têtard. La casse étant la poêle à frire. - (62) |
| queue de casse, subst. féminin : têtard. - (54) |
| queue de casse, têtard de grenouille. - (40) |
| queue de casse. Têtard. - (49) |
| queue de casse. V. casse. - (05) |
| queue de quèche : têtard (tr. lit. : queue de poêle). A - B - (41) |
| queue de rat : prêle. Plante des lieux humides aux multiples noms : queue de renard… herbe à récurer… - (62) |
| queue de renard, n.f. prêle. - (65) |
| queue de renard, s. f., prêle des prés. - (40) |
| queue de vatse : cirrus, nuage de beau temps. A - B - (41) |
| queue de vatse : cirrus, nuage de beau temps ayant la forme d'une queue de vache - (34) |
| queue d'ernard - (39) |
| queue d'etang : s. f., pilet (anas acula). - (20) |
| queue d'quesse : le têtard de grenouille - (46) |
| queue nouée (n. f.) : plante herbacée commune dans les prés - (64) |
| queue : s. f., sarment qu'on recourbe après la taille et dont on lie l'extrémité au cep ou à la branche mère. - (20) |
| queue, quoue, deux pièces de vin, contenant ensemble quatre cent cinquante-six litres. - (16) |
| queue, s. f. tonneau dont la capacité varie suivant les lieux. - (08) |
| queue. La plus grande des anciennes mesures pour les liquides, en particulier pour le vin. I me raippeulle que les bons vins de Seivigney ne vaillint que cinq cents francs lai quoue. On a fait venir ce mot du latin cupa, coupe. J'aimerais mieux culeus, qui désignait une mesure contenant vingt amphores, ou quarante urnes. Cela équivaut, d'après Danet, à 480 pintes. Cette contenance se rapprocherait de notre queue qui renferme 456 litres... - (13) |
| queue-de-casse, cul-de-casse : s. f. et s. m., têtard de la grenouille (à cause de sa forme qui rappelle celle d'une casse). - (20) |
| queue-de-vache : s. f., cirrus, nuage en traînée filamenteuse. - (20) |
| queues de cane : voir queues de pouééle - (23) |
| queues de pouééle : têtards. IV, p. 32 - (23) |
| queugnat (un) : un fruit atrophié - (61) |
| queugne, s. f. coup, meurtrissure causée par un choc. - (08) |
| queugne, s. f. racine d'arbre ou d'arbuste, chicot, ce qui parait hors de terre d'une tige coupée. (voir : queugnon.) ; - (08) |
| queugner, v. a. cogner, frapper sur quelque chose. - (08) |
| queugner. v. - Cogner. - (42) |
| queugnon (n.m.) : souche, trognon, croûton - (50) |
| queugnon : gros morceau de pain. - (31) |
| queugnon, s. m. trognon, débris, morceau : un " queugnon » de chou, de pomme, de salade. - (08) |
| queuhieu, euse, adj. curieux, celui ou celle qui a de la curiosité. (voir : queuriou.) - (08) |
| queuka : poulet. (N. T IV) - C - (25) |
| queul (adj.) : quel - (64) |
| queula. Feu follet. Ce mot vient de clarus, claresco ; le queula est aussi le plus petit oiseau d'une couvée, le culot. - (03) |
| queula. V. cueula. - (05) |
| queular, s. m. feu follet qui danse sur la surface des marécages ou le long des rivières et qui finit par s'y plonger en poussant des éclats de rire. On donne aussi ce nom aux enfants morts sans baptême. - (08) |
| queulard, s. m., jeu de billes. - (40) |
| queulât : être rouge comme un queulât : très rouge (au visage) (signification inconnue) (voir : queular ?). - (56) |
| queûlat : petit dernier d'une nichée - (43) |
| queûle (aine) : (une) souche avec racines d’un arbre arraché ou abattu - (37) |
| queûle (mai), (mon) queûlot : (mon) « petit dernier » - (37) |
| queule : racine d'arbre - (44) |
| queule : souche, morceau de bois informe - (48) |
| queule : 1 n. f. Cuite sévère. - 2 n. f. Queue. - 3 n. f. Souche d'un arbre. - (53) |
| queule : bûche. - (32) |
| queule, gros morceau de bois noueux difficile à fendre. - (28) |
| queule, n.f. souche, bûche. - (65) |
| queule, s. f. le collet d'où partent les racines d'un arbre et qui reste en terre lorsque le tronc est abattu. Ex. : une queule de bois. - (11) |
| queule, sf. pied de fort taillis que les bûcherons détournent pour s'en faire du bois de chauffage. Excroissance graisseuse qui vient au derrière des vieilles poules. - (17) |
| queule, souche d'arbre. - (27) |
| queule, subst. féminin : souche d'arbres. Au sens figuré, ramasser une bonne queule, c'est prendre une bonne cuite, s'enivrer. - (54) |
| queule. Souche d'un arbre. Fig. Niais, peu dégourdi. - (49) |
| queule. Souche. On dit une queule de chêne, une queule de saule, la queule de Noël. Etym queue, le bout, L’extrémité inferieure de l'arbre. - (12) |
| queulepote (à la), locut. adv., position des enfants qui glissent sur la glace, d'abord debout pour prendre leur élan, puis ensuite à la queulepote, c'est-à-dire accroupis. - (11) |
| queuler : cueillir. Ex. : "J'on passé nout' journée à queuler nos c'ries." (Cerises). - (58) |
| queules : sabots de bois. - (32) |
| queulin, s. m. brin plus court et plus menu qui se détache et tombe lorsqu'on secoue une poignée de paille pour faire le glui. - (08) |
| queulle : grosse branche. - (30) |
| Queulmets (Les), nom de localité dans la commune d'Alligny-en-Morvan. le lieu est situé sur le sommet d'un plateau. - (08) |
| queulo : dernier né d'une famille. - (30) |
| queulot : dernier né d'une famille. Animal le plus petit d'une nichée. A - B - (41) |
| queulot - le dernier ; le dernier fait, surtout en parlant des oiseaux. - Note petiot, al é trouvai un nid, et pu à n'y é léché que le queulot. - I veins de trouvai un de nos p'sins qu'à mort, ma c'éto le queulot. – C't'enfant qui ne veint pâ bein… pôre petiot queulot ! - (18) |
| queulot (n.m.) : 1) dernier né - 2) le plus jeune poussin d'une couvée - (50) |
| queulot : dernier né, le plus petit - (48) |
| queulot : dernier né. - (62) |
| queulot : le dernier né. - (66) |
| queulot : le plus jeune - (44) |
| queûlot : le dernier, la queue, le benjamin. - (32) |
| queùlòt, s m., culot, dernier né d'une famille, d'une couvée. Le fumeur appelle aussi queùlot ce qui reste au fond de sa pipe. (Culot, de là culoter.) - (14) |
| queulot, s. m. celui qui est le dernier d'une famille ou qui est en arrière des autres, le plus jeune enfant, le plus petit oiseau d'une couvée. - (08) |
| queulot, s.m, dernier-né. - (38) |
| queulot, subst. masculin : le dernier-né, le plus petit. - (54) |
| queulté, adj. fatigué, éreinté. - (38) |
| queulte, s. m. culte, culte religieux, cérémonies de l'église. - (08) |
| queulter : peiner - (48) |
| queume, s. f. écume. - (08) |
| queune : boulet de jeu de billes. Voir : biscayen. - (62) |
| queûpai : cracher. - (33) |
| queupâs : crachat - (48) |
| queupâs : crachat - (39) |
| queuper (v.t.) : cracher (du lat., escupire = cracher) - (50) |
| queuper : cracher - (48) |
| queuper : cracher - (39) |
| queuper, cracher - (36) |
| queuper, v. a. cracher, saliver. - (08) |
| queupot. s. m. crachat. « queupat. » - (08) |
| queuque (adjectif) : quelque. - (47) |
| queuquiot (n. m.) : individu stupide - (64) |
| queurai : curer, nettoyer, enlever le fumier. O fayot queurai les vèches : il fallait curer les vaches. - (33) |
| queuraille, s.f. cœur d'un fruit qui a été mangéil ne reste plus que la "queuraille". - (38) |
| queuraillon : reste de la pomme de terre lorsque l'on a gardé les parties germées, trognon de pomme - (43) |
| queuratte (n.f.) : curette de charrue - (50) |
| queûrc’ie : résidu de cuisson collé au fond de la coquelle - (37) |
| queurchon : cresson - (48) |
| queurchon : cresson - (39) |
| queurchot, aiccroc : n. m. Crochet. - (53) |
| queurcifi, s. m. crucifix, figure du sauveur. - (08) |
| queurcifix (n.m.) : crucifix - (50) |
| queûrcille : menu morceau - (37) |
| queurde : courge, potiron. A - B - (41) |
| queurde : citrouille, potiron. - (30) |
| queurde : courge - (44) |
| queurde : courge, potiron - (34) |
| queurde : courge, potiron - (43) |
| queurde. Courge. Fig. Imbécile. - (49) |
| queure : cuiller. - (66) |
| queûré (âte) : ne plus rien posséder - (37) |
| queûré (not’ mon chieu l’) : monsieur le curé - (37) |
| queure (un) : une cerise - (61) |
| queure (v.t.) : cuire - (50) |
| queure : cuire - (48) |
| queûre : cuire. « Ô migerin mes deux sabots si j’y eux fio queûre » se lamentait la mère d’une famille d’affamés. - (62) |
| queuré : curé, prêtre - (43) |
| queuré : se dit d'une salade dont le cœur est bien formé, qui a bien poussé - (46) |
| queûré : vidé - (37) |
| queure : cuire. On f'to queure la soupe : on faisait cuire la soupe. - (33) |
| queure bouet, s.m. houx. - (38) |
| queure : cuire - (39) |
| queure : v. t. Cuire. - (53) |
| queurè : v. t. Curer, nettoyer. - (53) |
| queure, s. f. coudrier, noisetier. - (08) |
| queure, v. a. cuire. - (08) |
| queure, v. cuire. - (38) |
| queûre, v., faire cuire. - (40) |
| queure. Cuire ; de coquere, d'où l'on a fait en vieux français queux ; queuqueute, bouillie des enfants. - (03) |
| queure. v. a. et n. Cuire. (Arcy-sur-Cure, Andryes). Du latin coquere. - (10) |
| queure. V. cueure. - (05) |
| queurée, s. f. curée, fosse d'assainissement autour des habitations. - (08) |
| queureille, s. f. coquille d'oeuf, de noix, de noisette, épluchure en général. - (08) |
| queurer (verbe) : nettoyer les étables ou les écuries. - (47) |
| queurer : curer - (43) |
| queurer : curer, nettoyer, enlever le fumier. - (52) |
| queûrer : curer, nettoyer. « Va queûrer l’écurie ». - (62) |
| queûrer : curer, vider - (37) |
| queurer : curer, vider - (48) |
| queurer : faire perdre - (44) |
| queûrer lâs vaic’es : nettoyer l’étable - (37) |
| queurer : curer - (39) |
| queurer, dépouiller, nettoyer. - (05) |
| queurer, v. a. curer, nettoyer, vider. « queuher. » - (08) |
| queurer. Curer, nettoyer. Fig. Gagner au jeu tout ce que possède son partenaire. - (49) |
| queurer. Dépouiller quelqu'un de tout ce qu'il a ; terme de jeux, peut-être du latin quoerere, ou du français curer, nettoyer. A Chalon on dit queusser. - (03) |
| queurére : coudrier. - (29) |
| queurette : petit ustensile servant à nettoyer les sabots, les pioches... A - B - (41) |
| queurette : petit ustensile pour nettoyer les sabots, les pioches - (34) |
| queurette, s. f. curette, espèce de couteau en bois qui sert à nettoyer le soc de la charrue lorsque la terre s'y attache. - (08) |
| queureure, s. f. curure, ce que produit le nettoyage d'un fossé, d'une rigole, la terre, le gazon, la boue, qui sortent d'un trou, les ordures d'une cave balayée, etc. - (08) |
| queureures : saletés, raclures - (48) |
| queureures : saletés. Surtout les saletés qu'une vache fait quand elle a fait veau - (39) |
| queurî : quérir, aller chercher. Certains disent : « qu’rî ». - (62) |
| queuriai : crier. Ol o sourd pou queuriai tant fort : il est sourd pour crier aussi fort. - (33) |
| queuriateur, s. m. créateur. Dieu est notre « queuriateur. » - (08) |
| queuriateure, s. f. créature : « c'te poure queuriateure ; ç'ô cune mauvaille queuriateure. » - (08) |
| queuriau, s. m. terre où il y a beaucoup de pierres, en général de bonne qualité. - (08) |
| queuriè, couâillè : v. i. Crier. - (53) |
| queurie, s. f., croûte de lait du nouveau-né. - (40) |
| queurie, s. f., souche restée dans le sol, après abattage. - (40) |
| queurier (un) : un cerisier - (61) |
| queurier (v.t.) : crier - (50) |
| queurier : crier - (48) |
| queurier : crier. - (52) |
| queurier : crier. (MM. T IV) - A - (25) |
| queurier, v. a. crier, appeler quelqu'un à haute voix : « queurié-lu », appelez-le. - (08) |
| queurieux (adj.m.) : curieux - (50) |
| queurieux : curieux - (48) |
| queuriou, ouse. curieux. s'emploie dans un autre sens que celui de la curiosité pour exprimer l'idée d'un désir, d'un souci : aimez-vous les cerises ? je n'en suis pas curieux. « cuhieu » - (08) |
| queurlame, crémaillère. - (27) |
| queurle : souche d'arbre. (BD. T III) - VdS - (25) |
| queurle : souche d'arbre. (RDM. T II) - B - (25) |
| queùrle, s. f., grosse souche, racine d'arbre. - (14) |
| queurle, s.f. souche de bois. - (38) |
| queurle. Souche racineuse du chêne ou de tout autre bois. Les queurles fiant un bon feu, mas an faut se beiller ben de lui pone pour les arraicher et pour les fendre,. - (13) |
| queurlée (une) : une bonne cuite. (P. T III) - B - (25) |
| queurlot de genète (eun) : une souche de genêt. (RDM. T II) - B - (25) |
| queurmaillére (n.f.) : crémaillère - (50) |
| queurnailler : regarder sournoisement - (43) |
| queurnéille (n.f.) : corneille - (50) |
| queurnéille : corneille - (48) |
| queurneille : (kœrnèy' - subst. f.) corbeau et non corneille. Même sens que crâ:. - (45) |
| queurneille, s. f. corneille, corbeau. - (08) |
| queurneuil : corbeau - (43) |
| queurni, le, adj. terne, d'un blanc sale, grisâtre par usure. Se dit surtout d'un linge qui est mal lavé. - (08) |
| queurni, v. n. racornir, rendre dur comme la corne, rendre coriace. - (08) |
| queûrnîlles : corneilles - (37) |
| queurniot : averse - (60) |
| queurnot (nom féminin) : joue, écurie de porcs. - (47) |
| queurot, s. m. tablier de peau de mouton principalement à l'usage des ouvriers qui vannent dans la grange. - (08) |
| queurote. Mauvais chien, du vieux mot queurre, chien qui ne fait que courir. - (03) |
| queurotte (en aivouair plein les queurottes) : jambe (en avoir plein les jambes) - (48) |
| queurotte : cuillère de sabotier - (48) |
| queurotte : outil pour nettoyer le soc de la charrue - (48) |
| queurou, ouse, s. celui qui cure , qui nettoie, qui vide : « eun queurou d' biés, un queurou d' poués », un cureur de biez, de puits. (voir : queurer.) - (08) |
| queurpe (n.m.) : appentis sommairement construit - (50) |
| queurpe (nom féminin) : remise ou hangar. - (47) |
| queurpe, s. f. remise, hangar, loge adossée à une construction. On bâtit ordinairement une « queurpe » avec des bois de peu de valeur et des genêts ou des roseaux. « Queurpe » = croupe, pan de mur. - (08) |
| queûrpiât, seûrpiât : homme de peu de valeur, pas sérieux - (37) |
| queûrpion : croupion de volatile, arrière-train humain - (37) |
| queurpoton (en), loc. a croupeton. Se dit de celui qui se courbe jusqu'à terre, qui arrondit son corps en se baissant, qui se ramasse sur lui-même, qui s'accroupit. - (08) |
| queurre : cuire. - (29) |
| queursille : n. f. Vandoise. - (53) |
| queursilles : petits poissons - (44) |
| queurson (n.m.) : cresson - (50) |
| queurson, s. m. cresson. - (08) |
| queurte (na) - créte (na) : crête - (57) |
| queurte. Crasse. - (49) |
| queurtelle : crotte (de lapin, chèvre...). A - B - (41) |
| queurtelle : crotte de lapin etc... - (44) |
| queurtelle : crotte de lapin, de chèvre - (34) |
| queurtelle, quértelle. Crotte ; excrément de certains animaux comme la chèvre, le lapin. Fig. Tout petit morceau. - (49) |
| queurtien, s. m. chrétien. - (08) |
| queuruel, ele, adj. cruel, cruelle. - (08) |
| queurvaisse, s. ï. crevasse, fente. - (08) |
| queurvas (n.m.) : creuvasses aux mains - (50) |
| queurver (v.t.) : crever, mourir - (50) |
| queusan. Souci, soin. - (03) |
| queusan. V. cueusan. - (05) |
| queusance, s. f. connaissance, information, avis. - (08) |
| queûshne : cuisse. (Toujours siffler le sh). - (62) |
| queusonner : tousser (voir : teusser, teuchener). - (56) |
| queusse (eune) : une brebis. (MM. T IV) - A - (25) |
| queusse : brebis - (48) |
| queûsse : cuisse, écorce - (43) |
| queusse : cuisse. - (29) |
| queusse : partie gagnée au jeu. Perdre : « ramasser » une queusse, se faire queusser. Pour certains : une pierre à aiguiser, plus rarement une cuisse (voir queûshne). - (62) |
| queusse : une cuisse - (46) |
| queusse et queuche. Cuisse. - (03) |
| queusse : (keus' - subst. f.) brebis (à ne pas confondre avec bêrbi, qui s'applique au genre ovin sans distinction de sexe). - (45) |
| queussé : exp. Avoir tout perdu au jeu. - (53) |
| queussé, adj., sans argent, faucher. - (40) |
| queusse, cuisse, jambe. - (27) |
| queusse. Cuisse, jambe. Mot emprunté au patois, qui a queusse où queuche dans le même sens. Etym. le bas latin cossa ou cossia, cuisse. - (12) |
| queussé. Ruine, mais avec un sens moins grave, moins absolu, moins definitif ; queussé veut dire surtout qu'on n'a plus d'argent pour le moment, ou sur soi. Etym. queue, être queussé veut dire être a la queue de ses ressources, au bout de son argent. - (12) |
| queussené (se), vr. se décomposer, être mangé aux vers. - (17) |
| queussenotte (sauter à la), à cloche-pied. - (28) |
| queusser : perdre aux billes. (S. T III) - D - (25) |
| queusser : (keusè - v.trans.) peiner, fournir de grands efforts. - (45) |
| queûsserotte : cloche-pied - sautè è lè queûsserotte, sauter à cloche-pied - (46) |
| queuss-hes. V. cueuss-hes. - (05) |
| queuss'nè : v. i. Toussoter. - (53) |
| queûssou : écorçoir - (43) |
| queût : cuit, prêt, malin - (43) |
| queut : cuit. Une viande pas queute : une viande pas cuite. - (33) |
| queut : v. t. Griller. - (53) |
| queut, adj., cuit. - (40) |
| queut, eute. participe passé du verbe queure. Cuit, cuite. (Arcy-sur-Cure). - (10) |
| queut, queute. Cuit, cuite. - (49) |
| queute (p.p.f.) : p.p.f. du verbe cuire - (50) |
| queutè : n. m. Faire l'amour. - (53) |
| queute, s. f. cuite, le pain cuit dans une seule fournée : « eune bonne queute », une bonne fournée. - (08) |
| queute. V. cueute. - (05) |
| queûtée (aine) : (une) bonne longueur - (37) |
| queuter : louper, manquer - (46) |
| queuter : manquer, rater - (48) |
| queuter : rater - (44) |
| queuter v. (terme argotique) Rater. - (63) |
| queuter, v. curer. - (38) |
| queuter, v., choir, tomber. - (40) |
| queutillon, jupon. - (27) |
| queutin. s. m. Agneau. Voir queuton. (Forêt d'Othe). - (10) |
| queutine. s. f. Agnelle, jeune brebis qui n'a pas encore porté. (Perrigny-les-Auxerre). – Voir queuton et queutin. - (10) |
| queutiot : rustaud - (60) |
| queûton : petite queue. - (33) |
| queûton : n. m. Petite queue. - (53) |
| queuton, queutonne. s. m. et f. Appellations sarcastiques données au mouton et à la brebis a cause de leur courte queue. (Armeau). - (10) |
| queûtou : un chaud lapin - (46) |
| queuveu, s. m., cheveu. - (14) |
| queûvri (l’) : (le) couvert (de la maison) - (37) |
| queuÿer, s. m., cuiller en bois ou en métal. - (40) |
| quevà : (k'va) Où. « Quevà dan qu'o demore ? » : où habite-t-il ? « O demore au diabe j'sais pas quevà » : il habite très loin, je ne sais où. - Nota : plus recemment on prononce de préférence qouâ. - (19) |
| queva ?, interrog. où ? - (22) |
| quevea, cave, caveau où se place le bon vin. - (02) |
| quevea. : Cuve.- Le diminutif est quevelô, petite cuve.- On appelait égoton de queveà un vin de rebut. - (06) |
| quevelô, petite cuve, diminutif de quevéa, cuve. - (02) |
| quévie - quavie : pourquoi. - (58) |
| quévie-don : variante du précédent. Ex. : "Quévie-don qu'javons tant d'malhuheux ?" - (58) |
| quezan. Soin, inquiétude, souci… - (01) |
| quezan. : ÇDial. et pat.), souci, inquiétude. On dit un chagrin cuisant, un remords cuisant, comme si ces passions brûlaient l'âme de celui qui les ressent. Ce mot quezan pourrait donc bien venir du rég. latin coquitationern. (Voir au mot cusencenaule.) - (06) |
| qui - abréviation d'iqui ; ici, celui-ci, abréviation très employée. - Venez voué, qui, tenez, qui causains in pecbo. - C'â qui que logeant les carriers de lai Seigne. - Quand vos veinrâs vos mettrâ vos aifâres tot bonnement qui. - (18) |
| qui : (pr interr) quoi, que « qui qu’y est qu’çan ? » - (35) |
| qui : quoi, que - (43) |
| qui a perdu son poil. - (08) |
| qui c'qui ? et qui é c'qui ? contract. de Qui est-ce qui ? « Qui c'qui veint por iqui nos déranger ? » - (14) |
| qui loc. interrogative Qu'est-ce. Qui qu'ô m'vout ? Qu'est-ce qu'il me veut? Qui qu'y est ? Qu'est-ce que c'est ? mais également, qui est-ce ? - (63) |
| qui qu’yé ? : qu’est-ce que c’est ? - (43) |
| qui veint, formule adjective pour dire : prochain, prochaine : « L'an qui veint, la semaine qui veint. » - (14) |
| quia (le) : portillon. (E. T IV) - S&L - (25) |
| quiack bitou : un fromage blanc - (46) |
| quiacotte : femme très bavarde. (RDM. T II) - B - (25) |
| quiacottè : v. i. Bavarder. - (53) |
| quiai, s. m. claie, petite porte basse qui protège l'entrée des maisons contre l'invasion des volailles ou autres animaux, barrière en général. « quiau. » - (08) |
| quiair : clair - (48) |
| quiair : clair. - (32) |
| quiairdi, v. n. éclairer, donner de la lumière, jeter de la flamme. - (08) |
| quiaîsse (lai) : (la) classe, (l’) école - (37) |
| quiaisson, s m. grumeau. Se dit de certaines substances lorsqu'elles se coagulent. - (08) |
| quiaivollée : n. f. Grippe intestinale. - (53) |
| quiampoing : pincée, poignée - (39) |
| quianpoing, s. m. poignée, ce qui peut tenir dans la main : un « quianpoin » d'herbe, de grain, etc. - (08) |
| quianponner, v. a. saisir à pleins bras et en quelque sorte avec les poings, à bras le corps. - (08) |
| quiaper, v. n. clapper. se dit principalement du bruit que font certaines personnes en mangeant. - (08) |
| quiaq, quiaquè : une claque, claquer - (46) |
| quiaque : claque - (48) |
| quiaque : (kyak' - adj. inv.) neuf, flambant neuf. (subst. f.) signifie claque, gifle, comme en français. - (45) |
| quiaque, quiaque-bitou : fromage, fromage blanc - (48) |
| quiaque-bitou, fromage blanc très maigre. - (40) |
| quiaque-bitou, s. m. fromage maigre et mou tel qu'il sort de la faisselle. On le nomme ainsi parce qu'on l'emploie quelquefois comme remède curatif de certaines maladies des yeux et notamment de la « bite. » (voir : bitou, quiaquer.] - (08) |
| quiaquer : claquer - (48) |
| quiaquer, v. a. claquer, appliquer, lancer quelque chose avec force. - (08) |
| quiaquia, s. m. espèce de litorne, grive. - (08) |
| quiâ-quiâ, tchiâ-tchiâ, tiâ-tiâ. n. m. - Sansonnet, étourneau. - (42) |
| quia-quia. s. m. Litorne, oiseau du genre des grives, ainsi appelé par onomatopée. (Puysaie). - (10) |
| quia-quia. : (Qu'on prononce tia-tia,) grive de la grosse espèce.- Onomatopée imitant le ramage de cet oiseau. - (06) |
| quiar : clair - (39) |
| quiar, e, adj. clair : « aileume lai chandeille po fére quiar. » - (08) |
| quiar, s. m. clerc de notaire. - (08) |
| quiâr’ment : clairement - (37) |
| quiârè : (éclairé), être allumé - (46) |
| quiâre, s. f., clé de porte. - (40) |
| quiaroure : la lampe - (46) |
| quiarser (v. tr.) : croiser, alterner - (64) |
| quiarté, s. f. clarté, lumière. (voir : cliarté.) - (08) |
| quiasse (n.f.) : classe - (50) |
| quiasseux (pour classeux). s. m. Ecolier, celui qui va en classe. (Monades). - (10) |
| quiau (n.m.) : portail, petite barrière - (50) |
| quiau, fléau - (36) |
| quiau, s. f. claie, petite barrière : « fromé lai quiau », fermez la barrière. (voir : clô, quiai.) - (08) |
| quiau. s. m. Tuyau. Se dit aussi de, la tige creuse du blé, des pommes de terre et en géneral de toutes celles des plantes similaires. – A Auxerre, les pècheurs appellent quiau, le tuyau de plume, garni ou non d'un bouchon, qui sert à maintenir sur l'eau la partie de la ligne qu'on laisse flotter, et qui, quand il oscille et s'enfonce, indique qu'un poisson mord ou se trouve pris à l'hameçon. – Quiau quiot, s'emploie aussi adjectivement, à Auxerre, pour, sot, niais, imbécile, sans doute par allusion à l'idiotisme du quiau de la ligne, qui, insconscient et inerte, tantôt semble dormir là ou l'eau sommeille, et tantôt se meut stupide sous l'impulsion du courant ou des tiraillements d'un poisson. - (10) |
| quiausser (se) : s'étrangler en mangeant ou en buvant. (G. T II) - D - (25) |
| quiavolée, s. f., clavelée des poules. - (40) |
| quibier, v. a. cribler. - (24) |
| quib'lle : Crible. Voir c'iblle. - (19) |
| quié (lai) : (la) clé - (37) |
| quié (n.f.) : clef - (50) |
| quié : clé - (48) |
| quié : une clé - (46) |
| quiê : (kyê: - subst. m.) portillon ; parextension, porte en général. - (45) |
| quié : clé - (39) |
| quié, s. f. clef. (voir : soquié.) - (08) |
| quié. Clef. - (49) |
| quièche : (kyèch' - subst. f.) cloche . La kèch', de quelque taille qu'elle soit, est en bronze et ne se confond absolument pas avec campeun', qui est en tôle. On dit aussi kyoch'. - (45) |
| quiécle, s. m. couvercle. - (08) |
| quiécot. n. m. - Haut du crâne : « l'mit l'chapiau à haute forme qui y t'nait su' l'quiécot d'sa tête coume un bouessiau su' une chitrouille. » (Fernand Clas, p.343) - (42) |
| quiédot, otte, adj. tiède, qui n'est ni chaud, ni froid : « eune sôpe quiédotte. » une soupe froide est une soupe « morte » aux env. de Corbigny. - (08) |
| quieitiste. Quiétistes…. - (01) |
| quieler. v. - Parler très lentement. (Mézilles, selon H. Chéry) - (42) |
| Quiément (l’) : (le) Clément - (37) |
| quien, s. m., chien. Sert souvent d'injures. - (14) |
| quienchi, qui-inchi. Flétri, ridé. « Un freut quienchi ». Le synonyme est « routi ». - (49) |
| quiêque (n.m.) : couvercle - (50) |
| quiéque : (kyé:k' - subst. m.) couvercle (d'une marmite, d'un saloir...). - (45) |
| quiéque, quiécot et clèque. Couvercle... - (13) |
| quiéqueu, couvercle. (Proverbe : Pas de petit poteu (pot) qui n'eue son quiéqueu). - (27) |
| quiéquo : couvercle. (RDM. T IV) - B - (25) |
| quiéquo : (kyé:ko - subst. m.) petit couvercle. - (45) |
| quiêr (e) : (kyêr / kyè:ré adj.) 1 - clair (couleur). 2 -dilué (la couleur claire suggère une faible densité, de même que le mot clairsemé). - (45) |
| quiérâme, s. f. Carême : « lai quiérâme », le Carême. - (08) |
| quierâme, s. m. crémaillère. « Cremaille » ou « cremillé» . - (08) |
| quiérer : clairer (feu) - (48) |
| quiérer : clairer - (39) |
| quiérer : (kyè:ré - v. intr.) chauffer, tirer (en parlant d'un poêle). - (45) |
| quiérer, v. n. clairer, briller, donner de la lumière, s'enflammer. On fait « quiérer » le feu en soufllant. (voir : clairer.) - (08) |
| quieuce (n.f.) : cloche - (50) |
| quieucer (v.t.) clocher - (50) |
| quieûche : une cloche - lè quieûches sonnin..., les cloches sonnaient... - (46) |
| quieûcheil : le clocher - (46) |
| quieul. adj. interrog. - Quel, quelle. - (42) |
| quieulè : v. t. Clouer. - (53) |
| quieupart (adv.) : sans doute, probablement - (64) |
| quieuque (adj. indéf.) : quelque (syn. quioque) - (64) |
| quieuton. n. m. - Petite queue. - (42) |
| quiévî (adv.) : pourquoi (quiévî don) - (64) |
| quigni : (vb) geindre - (35) |
| quigni : cri du cochon - (43) |
| quignô, présent du parrain à son filleul le premier jour de l'an après le baptême... On dit aussi quaingnô, d'où est venue l'expression faire la quaigne, c.-à-d. célébrer par un festin la naissance d'un enfant. - (02) |
| quignô. : Présent du parrain à son filleul le premier jour de l'an après le baptême. - Dans le dialecte, quignon signifie un lopin de pain ou de gâteau pour le morceau d'honneur, le chantiau. Les Picards disent le quignot. (Corb.) Je trouve au glossaire de la Franche-Comté (Dart) que ce mot vient du latin cuneus et signifie un morceau de pain en forme de coin. - (06) |
| quignon n.m. (v.fr. quignon, coin) Premier morceau, arrondi, coupé à l'extrémité d'un pain long. On dit aussi trognon. - (63) |
| quignon, quillon. Gros morceau : « un quignon de pain ». - (49) |
| quignon, s.m. morceau de pain. - (38) |
| quignòt, s. m., quignon de pain, de gâteau : « Y étôt la fête ; le drôle a v'nu; j'li ons baillé un quignòt de flan. » - (14) |
| quignot. s. m. Gosier. (La Celle-Saint-Cyr). - (10) |
| quignou (ze) : (adj) (enfant) grognon, qui pleurniche - (35) |
| quillade et quillasse. s. f. Glissoire. Voyez quiller. - (10) |
| quillaud (adj.) : liquide - (64) |
| quillaud, aude. adj. - Glissant, poli, luisant. (Perreuse, selon M. Jossier). Autre sens : fringant, bien dans sa peau, se redressant. (F.P. Chapat, p.163) - (42) |
| quillaud, aude. adj. Glissant, poli, luisant, (Perreuse). - (10) |
| quillé : Celui qui renvoie la boule au jeu de quilles. - (19) |
| quillé : cuiller. - (52) |
| quille : Fausset. « Fa attention de bien chauchi la quille » : aie soin de bien enfoncer le fausset. « Jû de quilles » : jeu de quilles, très en vogue à la campagne. - (19) |
| quîlle : jambe de bois rustique (pilon) - (37) |
| quille de pauvre : s. f., petite saucisse. - (20) |
| quillé : cuillère, outil pour faire les sabots - (39) |
| quillé, cuiller - (36) |
| quillée (nom féminin) : cuillère. - (47) |
| quiller (aine) : (une) cuillère - (37) |
| quîller : ramasser les quilles au jeu - (37) |
| quiller : v. n., glisser. - (20) |
| quiller. v. n. Glisser. - (10) |
| quîlles : jambes humaines - (37) |
| quillet : s. m., esquille osseuse. - (20) |
| quillette. s. f. Petit poulain, sorte d'échelle massive, en usage sur les ports pour le chargement et le déchargement des fûts de petite dimension. De quiller, glisser. (Auxerre). - (10) |
| quilli : (vb) glisser - (35) |
| quilli v. Glisser. - (63) |
| quillon : petit bout de bois conique mis dans la bonde d'un tonneau pour faire appel d'air. A - B - (41) |
| quillon : (nm) bonde - (35) |
| quillon : petit bout de bois conique mis dans la bonde d'un tonneau pour faire un appel d'air - (34) |
| quillon de pain : croûton. - (30) |
| quillon n.m. Fausset du tonneau, petite cheville de bois. On appelait également quillon la demi-bouteille de vin servie au bistrot et d'une contenance de 23 cl. La bouteille, elle, avait une capacité de 46 cl ; on l'appelait communément le pot. - (63) |
| quillon n.m. Glaçon qui pend du toit. - (63) |
| quillon : s. m., fausset. Avoir toujours un quillon pour boucher un trou, avoir la répartie prompte. - (20) |
| quillon. Fosset d'un tonneau. - (49) |
| quillot : le dernier-né des enfants d'une famille - (46) |
| quinaud, aude adj. Honteux, confus. - (63) |
| quincairner : tousser sans arrêt - (37) |
| quincârne, s. f. trompe ; corne de marchand ambulant. Verbe quincarner. - (24) |
| quincârne, s. f. trompe ; corne de marchand ambulant. Verbe : quincârné. - (22) |
| quincarner, v. braire. - (38) |
| quinchan : Pinson. « In nis de quinchans ». - (19) |
| quinchard, quincharde : adj., qui quinche. Une voix quincharde - (20) |
| quincher : v. n., émettre un son aigu et criard. - (20) |
| quinchi : pourri - (44) |
| quincou. n. m. - Mauvais vin, dont on ne boit qu'une seule fois. - (42) |
| quine ! exclamation, au jeu de loto. - (40) |
| quine : pénis. Chant des vendanges de Des Périers : « En sa tine-Propre et digne -S’égaye l’enfant divin-De sa quine-Tant bénigne-Y ayde à pisser le vin »… Voir « pine ». - (62) |
| quine n.f. Pénis, pine. - (63) |
| quiner v. Forniquer. - (63) |
| quinet : s. m., jeu du guillet, de la guiche, ou mieux du bâtonnet. - (20) |
| quinion. Gros morceau de pain, taillé en forme de coin. Au dirot qu'al ai la var solitaire. Voiqui qu’al ai dévoré trois quignons de pain et pus al en demande encore... - (13) |
| quinitte. s. f. Lit. (Soucy). - (10) |
| quin-nòt, quin-note, s. aux allures d'adj. : « Mon quin-nòt, ma quin-note, » connue qui dirait : « Mon canard, ma canette. » Terme d'amitié qu'échangent entre eux les enfants. Pour l'œil, aussi bien que pour l'oreille, il faudrait presque écrire quainnot. - (14) |
| quinque. Nom patois de la cigale. C’ast pas facile de prendre les quinques, al ont des bons uillots ; an faut eite aidroit pour les aipprucber... - (13) |
| quinquenaird, jingouâ : n. m. De travers. - (53) |
| quinquenelle. Répit de cinq ans. Faire quinquenelle, au propre, c'est obtenir des lettres de répit pour cinq ans. Au figuré, c'est s'affaiblir, baisser, mollir, tomber en décadence. A Dijon, les enfants qui se divertissent à jouer au volant disent qu'il fait la quinquenelle quand il a quelque plume rompue, qu'il tourne ou pirouette mal, car c'est de pirouetter que vient le bourguignon pirôtea, volant. On dit aussi en Bourgogne qu'un chapeau dont l'un des bords baisse, fait la quinquenelle. Ce mot vient de quinquennalis, qui suppose dilatio. - (01) |
| quinquenelle. : Délai de cinq années. On l'accordait à un mauvais débiteur. Faire la quinquenelle c'était donc être mal dans ses affaires, selon le patois bourguignon du temps de Lamonnoye. - (06) |
| quinquerniau. s. m. cousin, insecte dont la piqûre et le bourdonnement sont importuns. « quinquarniot » - (08) |
| quinquet, s. m., petite lanterne. - (40) |
| quinqueurniau (n.m.) : moustique, cousin - (50) |
| quinqu'gneau : moustique. IV, p. 27 - (23) |
| quinquin : L'auriculaire, le petit doigt. « Le ptiet quinquin n'en a pas tâté » : le petit doigt n'a rien eu. Citation tirée d'une formulette qu'on récite aux enfants en leur prenant l'un après l'autre les doigts de la main. « La poule a fait l'û, sti là l'a mis au fû, sti là l'a tiri, sti là l'a miji, le ptiet quinquin n'en a pas tâté ! ». - (19) |
| quinquin, et quinque, s. m., le cinquième des doigts de la main, le petit doigt : « T'n'as pas été sage ; mon quinquin m'y a dit. » - (14) |
| quinquin, petit doigt. - (05) |
| quinquin, s. m. l'annulaire, le cinquième doigt (du latin quintus, le cinquième). - (24) |
| quinquin, s. m. l'annulaire, le cinquième doigt. - (22) |
| quinquin. Auriculaire. - (49) |
| quinquin. Petit doigt, du latin quintus, comme Charles-Quint. - (03) |
| quinquoux. s. m. Boudeur. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| quinson (n.m.) : pinson - (50) |
| quinson : s. m., vx fr., pinson. Quinson de mer, pie-grièche. - (20) |
| quinson, n.m. pinson. - (65) |
| quinson, pinson. - (27) |
| quinson, pour pinson, oiseau. - (02) |
| quinson, s. m. pinson, oiseau de l’ordre des passereaux. - (08) |
| quinson, s. m., pinson. - (14) |
| quinson, s. m., pinson. - (40) |
| quinson, s.m. pinson. - (38) |
| quinson, tjinson, sm. pinson. - (17) |
| quinson. Pinson. (Vieux français). - (49) |
| quinson. Pinson. D'autres provinces disent aussi quinson pour pinson. Je n'ai pas trouvé la cause de cette altération. - (12) |
| quinson. : Pinçon. Même dénomination en Champagne. (Grosl.) - (06) |
| quintal : s. m., ancienne mesure de poids, comprenant 100 livres et valant 48 kilos 951. Depuis l'adoption du système métrique, le quintal métrique vaut 100 kilos, et l’ancien quintal (non métrique), encore en usage dans les campagnes, a passé de 48 kilos 951 à 50 kilos. - (20) |
| quintau (on) : quintal - (57) |
| quintau : Demi-quintal. « In quintau de foin » 50 kilog. de foin. - (19) |
| quintau n.m. Quintal, soit cent livres (le quintal valant 100 kilos n'a pas réussi à s'imposer vraiment). - (63) |
| quintau : s. m., quintal. - (20) |
| quintau, s.m., quintal : « J'li ai vendu eùn quintau d’farine. » - (14) |
| quintault, quintal de 100 livres. - (05) |
| quinto : quintal - (43) |
| quint-quint n.m. Petit doigt de la main ou du pied. - (63) |
| quint-quint : s. m., petit doigt de la main et du pied. - (20) |
| quinzaiñne n.f. Quinzaine. - (63) |
| quinze-onces. s. f. Dénomination ironique donnée aux personnes jeunes, légères et de petite taille. (Vassy-sous-Pisy). – On dit au reste, à peu près partout d'une personne vive et preste en ses mouvements, qu'elle ne pèse pas quinze onces. - (10) |
| quio : (kyô - subst. m.) 1 - clou. 2 - rhume, coryza assez sérieux qui s'accompagne d'expectorations fréquentes. - (45) |
| quioché, s. m. clocher. « clieucé. » - (08) |
| quioler : (kyôlè - v. trans.) clouer. - (45) |
| quion : quoi, pourquoi. Ex. : "C'est pour quion fée, j'verrons ben..." - (58) |
| quion, s. m. fausset de futaille. - (24) |
| quiôpe : (kyôp' - subst. f.) mauvais chien, inutile et plus ou moins malodorant. - (45) |
| quioque (adj. indéf.) : quelque (syn. quieuque) - (64) |
| quioque : cloque - (48) |
| quioquè : faire le bruit d'une poule qui couve - (46) |
| quioque : une cloque - (46) |
| quioque sé, loc. qui sait ? c'est à peu près. - (08) |
| quioquer (v.t.) : glousser, pour les poules qui demandent à couver - (50) |
| quioquer (verbe) : glousser. - (47) |
| quioquer : glousser, appeler ses poussins - (48) |
| quioquer, v. n. glouser, closser. Se dit des poules qui demandent à couver. - (08) |
| quioquerie, s. f. glousserie, gloussement de la poule qui demande à couver. - (08) |
| quiorde (n.f.) : corde - (50) |
| quiorde, v. a. tordre. - (08) |
| quiosè : le bruit fait quand on s'étouffe - (46) |
| quiossai : appeler ses poussins. La couotte quiosse ses pitots : la poule couveuse appelle ses poussins. - (33) |
| quiôssè : passer de vie à trépas - (46) |
| quiosser : (kyossè - v.intr.) tousser très fort. - (45) |
| quiot (n. m.) : fosse aménagée sous un pressoir pour recueillir le jus de raisin - (64) |
| quiot, tiau, tchiau. n. m. - Tige, fane d'un légume : un quiot d'truffes. - (42) |
| quiou (n.m.) : clou - (50) |
| quiou : un clou - (46) |
| quiou : clou - (39) |
| quiou, s. m. clou et furoncle. - (08) |
| quioûlè : clouer - (46) |
| quiouler (v.t.) : clouer - (50) |
| quiouler, v. a. clouer, attacher avec un clou, fermer. - (08) |
| quiouller : clouer - (39) |
| quiousser. v. n. Pour criousser, crier souvent, pleurnicher. (Courgis). - (10) |
| quioutè : clouter - (46) |
| quiq'chouze : quelque chose - (46) |
| quiqelicoû ! : Le chant du coq. Le coq lui-même : « In biau quiquelicoû ». - (19) |
| quique chose (du) - ce qu'on donne, après le repas en plus, ou avec du pain entre les repas. - Main mère, beillez-moi don du quique-chose. - Mége tai soupe et t'airé du quique-chose aipré. - (18) |
| quique, s. f. chignon défait et pendant : elle perd sa quique. - (24) |
| quique, s. f. chignon défait et pendant. - (22) |
| quiquette n.f. Quéquette. Voir beurlette. - (63) |
| quiquiche, subst. féminin : capuche, bonnet avec un pompon. - (54) |
| quiquitte : n. f. Petite poule. - (53) |
| quiter, v. intr., cesser, interrompre : « Qu'ôl ét en-niuant ! ô n'quite pas de tracasser. » - (14) |
| quiter, v. tr., laisser, lâcher, diminuer de prix : « Ol a quité son d'ventai. » — « J'ai quité mon coutiau su l'plot. » — « O m'a quité trois francs su ma note. » - (14) |
| quitiance, sf. quittance. - (17) |
| quitier, vt. quitter. - (17) |
| quitje, adj. quitte. - (17) |
| qui-tsouse, quiqu'tsouse : ((loc. indéf.) quelque chose - (35) |
| quitsouze loc. adv. Quelque chose. - (63) |
| quitte (éte) loc. Etre disponible. - (63) |
| quitte : adj. abs., libre de travail ou d'occupation. - (20) |
| quitter v. Oter un vêtement. - (63) |
| quitter : v. a., enlever à quelqu'un, lui ôier ; rabattre (en matière de paiement). - (20) |
| quitter, v. a. lâcher, renoncer à, tenir quitte de : « quittez-moi » une pistole et nous serons d'accord ; il m'a « quitté » deux louis sur le prix de ses boeufs. - (08) |
| quiue, s. f. cuve, grand vaisseau de bois dont on se sert pour la lessive et autres usages. En quelques lieux «quioue. « (voir : coue.) - (08) |
| quiüpée : n. f. Toux grasse. - (53) |
| quiüperie : n. f. Être atteint de toux grasse. - (53) |
| quive : (kiv' - subst. m.) tamis (à grains ou à sable). - (45) |
| qui-yi : glisser - (43) |
| qu'men ? : comment ? - (46) |
| qu'men çè ? : comme cela ? - (46) |
| qu'men c'qui : comme ceci - (46) |
| qu'mensè : commencer - (46) |
| qu'ment, comment, comme. - (38) |
| qu'mîn fô : comme il faut - (46) |
| qu'neille : quenouille. - (33) |
| qu'nillot : quelqu'un qui hésite, qui touche à tout et ne fait rien (on dit aussi qu'nillotou) - (46) |
| qu'nillotè : lambiner, ne pas avancer dans son travail - (46) |
| qu'ô : pron. relat. Qui. - (53) |
| quo, pron. quoi. - (17) |
| quœllyon, s. m. fausset. - (22) |
| quœrt’e, s. f. crasse. Quœrtoeu, crasseux. - (22) |
| quoeumé, v. n. attendre longuement, perdre son temps. - (22) |
| quœye-de-pouvre, s. f. petite saucisse. Littéralement « verge de pauvre ». - (24) |
| quœye-de-pouvre, s. f. petite saucisse. Littéralement «verge de pauvre ». - (22) |
| quoi (quietus), tranquille, se tenir quoi, être à la quoi, être à l'abri , ou mieux être là quoi. - (04) |
| quoi : (adv. interr.) où - (35) |
| quoi : où - (43) |
| quoi ? (tout court), interrogation adressée à une personne qui vous appelle ; elle est pour : que me veux-tu ? Quoi, à la fin d'une foule de phrases, a le sens de : que direz-vous ! souvent il n'est qu'un remplissage sans signification, qu'un abus de parole ; telle personne ne vous dira pas trois mots sans y ajouter : quoi ? - (16) |
| quoî pron. ou adv. Où : Quoî qu'ôl est ? Où est-il ? - (63) |
| quoi qu’te vas ? : où vas-tu ? - (43) |
| quoi : adv., où, en quel lieu. A rapprocher du vx fr. quoi (En). - (20) |
| quoie (A la) : voir cote (a la). - (20) |
| quoieteit. : (Dial.), tanquillité. Dérivation du régime latin quietatem. « La quoieteit de patiance. » (Job.) - (06) |
| quoingir (se). V. coinger, coughir. - (05) |
| quoiqu aul est ? : où est-il ? - (51) |
| quoique : où ? - (51) |
| quoique au reste : où habite-t-il ? - (51) |
| quoirie. Rassemblement de personnes qui marchent les unes derrière les autres. Deux étymologies sont soutenables : la première celle de kyrielle, facétieusement dérivée d’un chant religieux qui se répète longuement ; la seconde, celle de queue, en patois quoue, bien caractérisée par la locution faire queue à la porte d'un spectacle. Il est à remarquer que le patois de Beaune a trois mots qui expriment la même idée : quoirie, ribanbelle, et girlicouée. - (13) |
| quonaille : Quenouille, voir à conaille. - (19) |
| quonéille (n.f.) : queunouille - (50) |
| quoneuille : (nf) tendon du cou - (35) |
| quoque (ŏ), conj. quoique. - (17) |
| quouai (pr.inter., pr.relat.) : quoi - (50) |
| quouai : adv. exclam. Quoi. - (53) |
| quouaique (conj.) : quoique - (50) |
| quouaique : quoique - (57) |
| quouaude : (couô:d' - adj.inv.) à qui on a coupé la queue. - (45) |
| quoue - queue. V. Couau. - I n'eume pâ in chien qu'en li é copai lai quoue. - Son petiot Francisse, al â tojeur ai lai quoue de sai cliaisse. - (18) |
| quoue (n.f.) : queue - (50) |
| quoue : queue - (51) |
| quoûe : queue - (48) |
| quoue : queue. - (29) |
| quouè : quoi - (48) |
| quouè ? : quoi ? - quouè qu'çâ qu'cè ? qu'est-ce que c'est ? - quouè què niè ? qu'est-ce qu'il a ? - (46) |
| quoue d cuesse : têtard - (51) |
| quoue d'cache n.f. Têtard. (litt. queue de poêle). - (63) |
| quoue de rnâ n.f. Queue de renard, prêle. - (63) |
| quoue de r'nair : prêle (queue de renard) - (48) |
| quoue d'l'étang n.f. Arrivée de l'eau dans l'étang. - (63) |
| quoue d'vatse n.f. Cirrus ou cheveux d'ange. Traînée nuageuse constituée de critaux de glace, réputée être annonciatrice de pluie. - (63) |
| quoue n.f. 1. Queue. 2. Mancheron de la charrue. - (63) |
| quouè qu'côt : qu'est ce que c'est ? , qu'est-ce ? - (48) |
| quouè que ç'ot : qu'est que c'est - (39) |
| quoué qui gnia. exp. - Qu'est-ce qu'il y a ? « Mais derriée tous ces cartounnages, derriée ces masques, quoué don qui gnia ? » (Fernand Clas, p.l72) - (42) |
| quoue : (cou: - subst. f.) queue d'un animal. - (45) |
| quoue : queue - (39) |
| quoue, n. fém. ; queue. - (07) |
| quoue, s. f. queue. (voir : coite.) - (08) |
| quouë, s. f., queue. Nous disons, comme partout : « N'y é ran d'si deùr à éracher qu'la quouë. » - (14) |
| quoué. pron rel. - Quoi. - (42) |
| quouée, n. fém. ; queue de l'étang. - (07) |
| quouère : lanière de cuir passant derrière la queue du cheval (croupière) - (46) |
| quoûgner : couper la queue - (37) |
| quoûill’tai don’ ! : tais-toi donc ! - (37) |
| quoûlou : mot masculin désignant une queue de renard ou prêle - (46) |
| quoumeau : tarte aux œufs et à la crème - (46) |
| quouneille, quenouille. - (05) |
| quoùneille, s. f., bâton auquel tient le chanvre à filer. Au figuré on dit : « Ol a de l'œuvre à la quoùneille. » - (14) |
| quoùneille, s. f., quenouille, colonne de bois placée à chaque coin du lit pour en soutenir le ciel, et autour de laquelle on enroule par moments les rideaux. - (14) |
| quoùneillée, s. f., provision de filasse qui garnit la quenouille. - (14) |
| quouquaisse (C.-d., Y.), queue de casse (Chal.). - Sobriquet des tétards de grenouilles qui n'ont qu'un gros corps tout rond et une queue aplatie comme celle d'une poêle, appelée casse en patois bourguignon… - (15) |
| quou-quaisse, têtard de grenouille. - (27) |
| quôzi : (adv) presque - (35) |
| quri (aller quri) : quérir, chercher - (51) |
| quri (aller) (v.t.) : aller chercher, apporter - (50) |
| qu'ri (verbe) : quérir. Ne s'emploie qu'à l'infinitif et après les verbes aller, venir, faire, envoyer. (Va don qu'ri un siau d’eau). - (47) |
| qu'ri : chercher - vai qu'ri..., va chercher... - (46) |
| qu'ri : quérir, aller chercher - vai qu'ri !, va chercher ! - (46) |
| qu'ri : quérir, aller chercher - (48) |
| qu'ri : v. t. Quérir. - (53) |
| qu'ri, chercher. - (27) |
| qu'ri, v. a. quérir, chercher : « al ô été qu'ri d' l'eai dan l' poué », il a été chercher de l'eau dans le puits. - (08) |
| qu'ri, v., quérir, aller chercher. - (40) |
| qu'ri'. v.- Chercher, quérir : « Au lieu dfai'e l'âne, vas don' m'qu'ri' des c'ries pou' c'souèr ! » - (42) |
| qu'ril : chercher. IV, p. 57-2 - (23) |
| qu'rir : quérir, aller chercher. On vai qu'rir ce qu'on ai besoin : on va chercher ce dont on a besoin. - (33) |
| quû : (kû). Qui. « Je sais pas quû ce qui est que me choupe » : je ne sais pas qui c'est qui m'appelle. - (19) |
| qu'vint. Prochain, prochaine : « la semain-ne qu'vint », pour la semaine prochaine. « Qu'vint » est probablement l'abréviation de qui vient - (49) |
| quyiainquant : verroteries, « tape-à-l’œil » - (37) |
| quÿilli : glisser - (51) |
| r. : Afin de donner plus de sonorité à quelques mots, les Bourguignons ajoutaient cette consonner à certaines voyelles finales, ou la substituaient à d'autres consonnes plus molles : ainsi, au lieu de ciel, miel, clef où clé, avocat, opéra, ils disaient cier, mier, clar, aivocar, operar. - (06) |
| r’a. Redevient, ou s’il est permis de parler ainsi, r’est, comme si du verbe être, on pouvait former le composé r'être. On dit en français trop est trop, mais le bourguignon trô r’a trô est une élégance inimitable pour faire sentir que l’excès est au plus haut point. - (01) |
| r’belé, blé, se faire be-lé : douleur due à la vibration d'un manche d'outil mal tenu. Par extension, décharge électrique sur un doigt ou sur un membre - (43) |
| r’beuille-merde (nom masculin) : personne qui fouille partout pour satisfaire sa curiosité. - (47) |
| r’beuiller (en) : avoir de la peine physiquement à faire son travail - (37) |
| r’beuiller : (pour un humain) chercher fébrilement dans n’importe quoi, en mettant tout sens dessus dessous - (37) |
| r’beuiller : se dit du porc ou du sanglier qui remue la terre avec son groin - (37) |
| r’beuiller, regarder fixement, avec obstination, d'un air naïf et bête. - (27) |
| r’beuillî : remuer, retourner. On pourrait aussi écrire « r’beuÿî ». - (62) |
| r’bouler : écarquiller les yeux. « Ô r’boule des callots » - (62) |
| r’bouler dâs cailots : écarquiller les yeux - (37) |
| r’bouré quelqu'un : lui faire des reproches. - (16) |
| r’boûteux : rebouteur, guérisseur - (37) |
| r’buter : (vb) reculer devant une tâche - (35) |
| r’calè quelqu'un : lui répondre de manière qu'il ne sache plus que dire. - (16) |
| r’canner : (vb) hennir - (35) |
| r’ceper : tailler la base d'un tronc pour faire venir des rejets - (43) |
| r’ceuper : (vb) tailler la base d’un tronc pour faire venir des rejets - (35) |
| r’chigné, ne plus vouloir continuer un travail commencé ; se dit aussi pour : chercher à imiter les manières de quelqu'un ; dans ce dernier sens, on dit encore : r'gëgné. - (16) |
| r’chimbyi : (vb) ressembler « o r’chimbye son père » - (35) |
| r’chimbyi : ressembler - (43) |
| r’chôssé, couvrir le pied d'une plante d'un amas de terre ; on r'chôsse la vigne, les pommes de terre, le maïs, etc. - (16) |
| r’ciper : couper ras. Vient probablement de « receper » : couper ras du sol un arbuste pour produire des rejets (en taillis). - (62) |
| r’ciper, couper franc la base d'un arbre abattu, enlever l'entaille. - (27) |
| r’cmoshî : recommencer. - (62) |
| r’consôler, v. a. consoler, donner des consolations. (voir : eurconsôler.) - (08) |
| r’cope : son (céréale) moulu très fin - (43) |
| r’couvri : recouvrir - (43) |
| r’dzet : (nm) allant, énergie - (35) |
| r’dzeute, r’tolon : rejet - (43) |
| r’dziper : se détendre comme un ressort - (43) |
| r’dziper, r’dzoper : (vb) se détendre comme un ressort, se dérober - (35) |
| r’fend : refend - (57) |
| r’fonte : refonte - (57) |
| r’fuge (on) : refuge - (57) |
| r’fus (on) : refus - (57) |
| r’gardé, avec une négation : é n'nô r'garde pâ, il ne fait point de cas de nous : se dit surtout entre parents désunis. - (16) |
| r’gaûgneux, r’haibilleux : remetteur en place de membres déplacés - (37) |
| r’gigner, hennir. - (27) |
| r’gimber : réagir alors qu’on est au plus bas. - (62) |
| r’gingot : retour de fête par un repas 8 jours après. - (62) |
| r’gipè, se r’gipé, regimber. - (16) |
| r’giper, se guérir, triompher d'un mal. (Ex., le malade a r’gipé). - (27) |
| r’gipper : réagir vivement. Se débattre, ruer. - (62) |
| r’gogni : (vb) remettre un membre - (35) |
| r’gognou : (nm) rebouteux (ostéopathe de l’ancien temps) - (35) |
| r’gognou, r’guegnou : rebouteux - (43) |
| r’goule : (nf) rigole, ruisseau - (35) |
| r’goule : petit ravin creusé par l'érosion après l'orage - (43) |
| r’groupement (on) : regroupement - (57) |
| r’guegni, r’gogni : rebouter - (43) |
| r’gueurni : (p.passé) (fruit) ratatiné - (35) |
| r’jailliss'ment (on) : rejaillissement - (57) |
| r’jan-ner, imiter. - (26) |
| r’jet (on) : rejet - (57) |
| r’jeter - rej'ter : rejeter - (57) |
| r’jiper : sursauter - (57) |
| r’jui – rejui : rejouer - (57) |
| r’kènké ; se r'kènké, s'ajuster, se bien parer. - (16) |
| r’keulé, reculer ; marcher à r'kulon, marcher en reculant ; mettre un vêtement à r'kulon est le mettre à l'envers. - (16) |
| r’kiyé quelqu'un est rabattre son arrogance par des paroles qui l'humilient justement. - (16) |
| r’lan, mauvaise odeur d'une chose trop longtemps fermée. - (16) |
| r’leutsi : (se) régaler ; lécher - (35) |
| r’liché, lécher longuement ; on r'liche une liqueur, par exemple, quand on la boit lentement, avec sensualité. - (16) |
| r’ligionnaire, celui qui suit bien sa religion. - (16) |
| r’lodze : (nm !) horloge - (35) |
| r’lodze : horloge - (43) |
| r’loichî : relècher - pourlècher. Pronominal ou transitif. On a dit « lochî » pour lécher, là on appuie sur l’effet babines et gourmandise. - (62) |
| r’lûre, reluire ; on dit vulgairement d'une chose que l'on désire vivement avoir ou manger qu'elle r'lu o vantre. - (16) |
| r’maishî : balayer. Malgré le sens de ramasser, viendrait d’un patois raim (brindille), de balai, du latin ramus (rameau) (?) - (62) |
| r’màyé, remailler, refaire les mailles brisées d'un tissu. - (16) |
| r’mené, ramener et faire des reproches à quelqu'tm, lui répondre de manière qu'il ne sache plus que dire. - (16) |
| r’mercié, remercier ; si l'on accuse une personne d'un acte mauvais qu'elle n'a pas commis, elle répond ironiquement : i vô r'mercie bèn ! Lorsqu'on rend une chose empruntée, l'on dit : an vô r'mercian ! an vô bèn r'mercian ! - (16) |
| r’mésse, balai fait, jadis, de brindilles de bois ; r'messé, balayer. - (16) |
| r’messi : (vb) balayer ; récolter, glaner - (35) |
| r’nâ : (nm) renard ; raie de labour qui n’est pas droite - (35) |
| r’na : raie de labour mal faite - (43) |
| r’nâ, renard, ce que vomit un homme ivre. - (16) |
| r’nâkyé, r'nâklé, ne plus vouloir continuer un travail qu'on trouve au-dessus de ses forces. - (16) |
| r’nauder : (vb) se faire prier - (35) |
| r’neuvyâ, le renouveau. On donne généralement ce nom au printemps, époque où la nature semble se renouveler ; mais comme l'année commençait, jadis, en mars, il est très probable que le mot r'neuvyâ s'employait alors pour désigner le renouvellement de l'année. - (16) |
| r’noçon : (nm) retour de fête - (35) |
| r’noçon : retour de fête - (43) |
| r’nuncé, renoncer. Une mère, mécontente de son enfant, va jusqu'à lui dire : j'te r’nunce ! je te renonce ! - (16) |
| r’paire (on) : repaire - (57) |
| r’pas (on) : repas (grande occasion) - (57) |
| r’passoûse (na) : repasseuse - (57) |
| r’péchage (on) : repêchage - (57) |
| r’pécher: donner à manger à un cheval en cours de route quand le trajet est trop long. - (27) |
| r’pentance (na) : repentance - (57) |
| r’penti : repentir - (57) |
| r’pérable : repérable - (57) |
| r’pérage (on) : repérage - (57) |
| r’père (on) : repère - (57) |
| r’pèrer : recreuser (une mare ou un puits) - (57) |
| r’peuler : donner une vibration à la suite d’un choc (synonyme de « peurpeuler) - (35) |
| r’piaicement (on) : replacement - (57) |
| r’pièillable : repliable - (57) |
| r’piquage (on) : repiquage - (57) |
| r’plat (on) : replat - (57) |
| r’plâtrage (on) : replâtrage - (57) |
| r’pli (on) : repli - (57) |
| r’polissage (on) : repolissage - (57) |
| r’portage (on) : reportage - (57) |
| r’portaîre (on) : reporter - (57) |
| r’pos (on) – r’pous (du) : repos - (57) |
| r’pousant : reposant - (57) |
| r’pouser : reposer - (57) |
| r’pousouaîr (on) : reposoir - (57) |
| r’poussant : repoussant - (57) |
| r’pouzi (se) : (vb) se reposer - (35) |
| r’présailles (des) : représailles - (57) |
| r’présentant (on) : représentant - (57) |
| r’présentation (na) : représentation - (57) |
| r’preuché, reprocher; r'preuche, reproche. En parlant d'un aliment qui digère mal et tend à remonter a la bouche, on dit : s'ki me r'preuche. - (16) |
| r’prin : (nm) mélange de son et de farine, recoupe - (35) |
| r’prise (na) : reprise - (57) |
| r’prisi : repriser - (57) |
| r’prochable : reprochable - (57) |
| r’proche (on) : reproche - (57) |
| r’prochi : reprocher - (57) |
| r’producteur (on) : reproducteur - (57) |
| r’production (na) : reproduction - (57) |
| r’produire : reproduire - (57) |
| r’quiyer (se) : se faire beau - (35) |
| r’sangé, se r'sangé, changer de vêtements, par exemple, quand on est mouillé de sueur ou par la pluie. - (16) |
| r’si : (vb) pétrir - (35) |
| r’sôté; tressaillir ; un bruit inattendu fait r’sôté. - (16) |
| r’suvre, recevoir ; el é r'seuvu, il a reçu. - (16) |
| r’târé, amasser de la terre autour d'un pied de vigne, de pomme de terre. - (16) |
| r’teni, retenir ; réparer un objet, un tonneau, un vêtement, etc. - (16) |
| r’tiré su.. , ressembler à... ; un enfant r'tire su son përe, quand il a quelque chose de ses traits, de ses manières. - (16) |
| r’tire, endroit pour les débarras. - (16) |
| r’tîreûte (ai lai) : moyen primitif de contraception, consistant en un mouvement physique du partenaire masculin exécuté promptement, au moment opportun - (37) |
| r’toler : rejeter (faire un rejeton) - (43) |
| r’torné, retourné une chose ; retourner en un lieu ; s'en r'torné, revenir chez soi, après une journée de travail, après un voyage. - (16) |
| r’troussé un vêtement, en le relevant; on r'trousse aussi quelqu'un, quand on répond à ses insolences par des paroles qui l'obligent à se taire. - (16) |
| r’tsaude : (nf) « se coutsi à la r’tsaude » : se coucher dans un lit non fait - (35) |
| r’tségna, r’tseûgnon : (nm) resucée (de café) - (35) |
| r’tseûgni : (vb) imiter, singer - (35) |
| r’tseûlon, r’tsolon : (nm) rejet - (35) |
| r’vâmer, donner de nouvelles pousses. - (27) |
| r’vâmeù, raisin qui mûrit après vendange. - (16) |
| r’vanje, revanche ; se r'vanjé, prendre sa revanche. - (16) |
| r’varpé, se r'varpé, regimber dans une rébellion. - (16) |
| r’varper (se) : (vb) se rebiffer - (35) |
| r’varper (se) : se ressaisir. - (62) |
| r’varper : réagir, se rebeller, se rebiffer. - (62) |
| r’vaux : retours vifs et brefs d’air, de fumée, de flamme dont l’effet, fréquemment, « en série » justifie le pluriel. - (62) |
| r’venan, personne dont l'imagination voit la ressemblance et que l'on croit sortie de sa tombe. - (16) |
| r’veûillè : fouiller en mettant du désordre - (46) |
| r’veuillon : celui qui fouille en mettant du désordre - (46) |
| r’veutsi : remuer en cherchant - (43) |
| r’veûyâ : (nm) champ mal labouré - (35) |
| r’veûyat : champ mal labouré - (43) |
| r’veuyé, fouiller des objets en les mettant en désordre. - (16) |
| r’veû-yi : (vb) retourner (en cherchant quelque chose) - (35) |
| r’veû-yon : (nm) ménage - (35) |
| r’vin-z'-i voi, reviens-y voir ! expression de défi ; se dit à un enfant que l'on chasse d'un endroit où on l'a surpris à mal faire, à marauder, par exemple. - (16) |
| r’vire : (nf) rivière - (35) |
| r’vire : rivière - (43) |
| r’viré un objet, le retourner en sens inverse ; r'viré sai veste, changer d'opinion ; r'viré quelqu'un : lui répondre de manière à le faire changer d'avis ; se r'viré, se retourner pour revenir sur ses pas. - (16) |
| r’viri : (vb) retourner - (35) |
| r’viri, r’veri (se) : retourner - (43) |
| r’vni : revenir - (43) |
| r’voi, revoi r; ai vô r'voi, se disent deux personnes parentes ou amies, en se quittant ; aujourd'hui l'on se dit ar'voir ! qui ne vaut pas ai vô r'voi ! - (16) |
| r’vole : (nf) fête (à la fin des moissons) - (35) |
| r’vômi, vomir. - (16) |
| r’vorché, fouiller des objets en les mettant sens dessus dessous. On r'vorche aussi une vigne, un champ, quand on les cultive mal. - (16) |
| r’vorcher, bouleverser en s'agitant ; se retourner dans son lit. On dit aussi, les sangliers r'vorchent les champs. - (27) |
| r’vouâguer, v. a. vomir, éprouver des vomissements successifs. - (08) |
| r’vouiller, fouiller, comme les sangliers dans les terres. - (27) |
| r’vûe, nouvelle rencontre à venir; i san de r'vue se dit pour ; nous nous reverrons, pour terminer tel marché, par exemple. - (16) |
| ra : Le contenu d'une benne de vendange. « In biau ra fa la fillette » : un bon ra donne une feuillette de vin. - (19) |
| ra : raie - (51) |
| râ : Raie « Fare sa râ » : se peigner de façon que les cheveux soient séparés par une raie. - Sillon. « Eune râ de charrue ». - Petit cours d'eau : « La râ du P'tô ». - (19) |
| râ, et râë, s. f., ligne, raie, ruisselet. — La prononciation, ouverte et longue, se rapproche plus du second des deux mots. (V. Roie.) - (14) |
| ra, raie : rigole, sillon de labour, petit fossé. A - B - (41) |
| rà, s. m., mot dont se sert le paysan pour appeler les cochons : « Rà ! rà ! vein iqui ! » - (14) |
| rà, syncope et synonyme de Arrà. (V. ce dernier mot.) - (14) |
| ra’yin : raisin. - (62) |
| rababouinè, rabâcher, répéter souvent une même chose. - (16) |
| rabachai, répéter souvent la même chose. Dans l'idiome breton, rabadiez signifie fadaise, niaiserie, puérilité. (Le Gon.) - (02) |
| rabâchi - bassiner : rabâcher - (57) |
| rabachoux. Rabâcheur. - (49) |
| rabaclou : colporteur ou démarcheur débitant son boniment. A - B - (41) |
| rabaclou : colporteur, démarcheur, qui débite son boniment - (34) |
| rabasse : une pluie importante (forte averse qui ne dure pas), on dit également rèbesse - (46) |
| rabasse, forte averse qui survient inopinément mais ne dure pas. - (27) |
| rabasse, n.f. averse violente et brève. - (65) |
| rabasse, pluie battante, de courte durée. - (16) |
| rabasse. Averse soudaine, coup de pluie bruyant. Etym. dans certaines provinces comme dans le Berry et dans le Forez, on dit rabâter pour faire du bruit, notamment pour les accidents atmosphériques, ainsi : « le tonnerre rabâte, la pluie rabâte ; » il est évident que rabasse est un mot voisin de ceux-ci, et qui a, comme eux, pour origine le latin rabere, être furieux, faire rage. - (12) |
| rabastineries : choses usées, traîneries dans les greniers. (CH. T III) - S&L - (25) |
| rabat, sm. grabat. El su l’rabat, être malade. - (17) |
| rabatchau. n. m. - Personne qui prétend savoir tout faire, travaille sans suite, ne fait jamais rien de bien ; synonyme d 'arcandier. - (42) |
| ràbâtée, rabâtelée (Y.), rabeutelée (Char.). - Foule, grande quantité. Prendre une rabâtée de poissons, avoir une râbatée d'enfants. Vient du vieux français, dans lequel rabaster signifie (aire du bruit, du tapage, signification que ce verbe conserve enrore dans le Berry… Dans le patois de l'Auxois et du Morvan, rabeuteler a pris, par extension le sens de délirer, d'extravaguer. Une rabeutelée étant une quantité énorme, extravagante, il est facile de faire un rapprochement entre ces deux expressions. - (15) |
| rabàtée, rabàtelée s. f. Foule, grande quantité. - (10) |
| rabâtement. n m. - Bruyante dispute, remue-ménage, grand bruit : « On entend, il me semble, un grand rabâtement dans la chambre en face de la nôtre. » (Colette, Claudine à l'école, p.lll) - (42) |
| rabâter : Faire du bruit en furetant à tort et à travers. « Que diabe est-ce que te rabâtes ! ». - (19) |
| rabâter, faire du bruit, ravâter, employé dans un sens mystérieux. - (04) |
| rabâter, rabeuter. v. n. Faire du bruit en remuant, en agitant, en fouillant. - (10) |
| rabâter. v. - Faire du bruit, au sens propre et au sens figuré : « Et je songe que le mari de Rézi pourrait rabâter dur, le jour où des potins effleuraient son oreille trop cuite. » (Colette, Claudine en ménage, p.353). Rabaster, ou rabacher, mots d'origine obscure, signifiaient en ancien français du XIIe siècle faire du tapage. Au XVIe, le rabat désigne le tumulte ou le lutin, l'esprit follet. Le poyaudin (ainsi que l'ancien provençal) a conservé rabâter, alors que le français a préféré rabâcher. Le mot rabat-joie (celui qui trouble la joie) est un vestige de cet emploi médiéval. - (42) |
| rabâteux. n. m. - Celui qui fait beaucoup de bruit, de remue-ménage. - (42) |
| rabat-jouaîe (on) : rabat-joie - (57) |
| rabâtlée, rabeutlée. n. f. - Un grand nombre, une grande quantité, de personnes ou d'objets : « Tas-ti vu c'te rabeutlée, marche ! l' vont tous à la cave ! » - (42) |
| rabâtler (v. int.) : produire un bruit désagréable, discordant - (64) |
| rabâtsi v. Rabâcher. - (63) |
| rabatte : s. m. sorte de moulin pour écraser les fibres de chanvre. - (21) |
| rabattu : part, pass., rebattu. - (20) |
| rabattue n.f. 1. Tour de fauchage à contresens au pourtour du pré. 2. En couture, rabat, ourlet. - (63) |
| rabaude, s. f. pelle de bois à pousser le blé, la poussière. Verbe rabauder, pousser en râclant (du vieux français raballe). - (24) |
| rabaude, s. f. pelle de bois à pousser le blé, la poussière. Verbe : rabaudé, pousser en râclant. - (22) |
| rabauder : v. a., ramasser, mettre en tas. - (20) |
| râber : Rêver. Le mot a vieilli on dit aujourd'hui râver. - (19) |
| rabêtir. v. - Rabaisser une personne (Mézilles, selon H Chéry). Autre sens : exténuer, épuiser, physiquement ou moralement. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| rabeuclée. Raclée ; frottée ; volée de coups. - (49) |
| rabeuiller, r'beuiller, rebeuiller. v. a. et n. Remuer, chercher, fureter, farfouiller, bouleverser ; figurément, s'occuper à des riens. (Courgis, etc.). - (10) |
| rabeut : Rabot. « In rabeut de menûsier ». - (19) |
| rabeutelée, grand nombre. - (27) |
| rabeutelée, s.f. grande quantité. - (38) |
| rabeutelée. Un grand nombre de quelque chose. Etym. il y a dans le patois du Morvan et dans celui de l'Auxois le mot rabeuteler, qui signifie extravaguer, delirer, or une rabeutelée signinant une quantité inusitée, hors de la règle, une quantité extravagante, il est probable qu'il sort de ce verbe, avec une légère extension du sens primitif. - (12) |
| rabeûteler (v.t.) : 1) bêler - 2) tenir des propos hors de sens, incohérents - (50) |
| rabeuteler : (prononcer : rabeut' ler). Faire, fabriquer. Ex : "Quion qu'té rabeutelle ?" Ce n'est pas un compliment, en général et pour le moins dubitatif sur l'utilité de l'acte. - (58) |
| rabeuteler, v. n. délirer, extra vaguer, tenir des propos incohérents ou hors de sens. - (08) |
| rabeuteleu, euse, adj. extravagant, celui ou celle qui divague, qui tient des propos déraisonnables. - (08) |
| rabeûtelou (n.m.) : celui qui rabeûtèle - (50) |
| rabeuter : Raboter. « Rabeuter eune planche ». Au figuré « O s'est fait rabeuter ses quat'sous », il a perdu au jeu le peu qu'il possédait. - (19) |
| rabeuter. v. a. et v. n. Rabâcher. (Sermizelles). - (10) |
| rabeûtler. v. - Se faire réprimander (F.P. Chapat, p.l65). Autre sens : farfouiller. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| rabeutoux : Raboteux, mal uni. « In chemin rabeutoux ». - (19) |
| râbi. Ratatine, racorni par la cuisson. Etym. inconnue. - (12) |
| rabiau (au), loc., en diminuant. Lorsqu'on joue, aller au rabiau, c'est perdre des points. Dans un marché, avoir du rabiau, c'est obtenir une diminution de prix. - (14) |
| rabiaû (du) - rêste (on) : reste - (57) |
| rabiauder : (se) rhabiller - (35) |
| rabiauder : recoudre - (44) |
| rabiauder, rapatauder. Rapiécer, rapetasser ; raccommoder grossièrement. - (49) |
| rabibocher : réconcilier - (44) |
| rabibocher, v., se mettre d'accord après une dispute, avec ou sans intermittence. - (40) |
| rabichauder : (vb) rafistoler - (35) |
| rabichioder : réparer grossièrement - (43) |
| rabicoin (n. m.) : encoignure - (64) |
| rabicoin (un) : un coin inaccessible - (61) |
| rabicoin : petit coin difficile d’accès. Ex : "Anvec toun’ euti, oublies pas les rabicoins !" - (58) |
| rabicoin. n. m. - Cagibi : « A qui la faute ? Si vous m 'aviez écoutée, je serais votre maîtresse, mussée bien tranquille dans un petit rabicoin. .. » (Colette, Claudine en ménage, p.338) - (42) |
| rabicoin. s. m. Petit coin. (Saint-Sauveur, Tonnerre). - (10) |
| rabidole. s. f. Rave ronde, navet du Limousin. Diminutif de rabe, rabi, rabiau ; en français, rabiole. (Etais). - (10) |
| rabidoler. v. a. Abattre avec une gaule. Rabidoler des noix. (Bligny-en-Othe). - (10) |
| rabigueutter : ranimer. - (66) |
| rabillauder (v. tr.) : ravauder, raccommoder - (64) |
| rabillons. s. m. pl. Morceaux de menu bois. (Armeau). - (10) |
| rabine, s. f. galette sèche liée avec des écumes de beurre ou de la graisse de porc. (voir : radiche.) - (08) |
| rabiot : supplément. - (66) |
| rabioter v. Voler, chaparder. - (63) |
| rabioter. Voler adroitement. Bénéficier d'un supplément de part, honnêtement ou non. (Argot). - (49) |
| rabistoquer, v. tr., rapiécer, raccommoder, mais sans donner bien bel air à l'objet avarié. - (14) |
| rabje (ā), sm. râble. - (17) |
| râblé, adj. qui a du râble, qui a les reins forts. se dit d'une personne courte et trapue. - (08) |
| râblé, gras et fort ; se dit de l'homme et de l'animal. - (16) |
| râble, s. m., grand racloir en fer pour tirer les braises du four à pain. - (40) |
| rable. V. boulot. - (05) |
| rabobéchi (se) v. Se réconcilier, se rabibocher. Voir se rapapilloti. - (63) |
| rabobeliner : rapetasser - (60) |
| rabobiller, réparer tant bien que mal. - (27) |
| rabobiner, et rabobicher, v. tr., rajuster, remettre en état, réconcilier : « Alle é si jentite, qu'all’les a rabobinés ensembe. » - (14) |
| rabobiner. v. a. Rapetasser. (Villiers-Bonneux). - (10) |
| rabobiyé, réparer vivement un objet. - (16) |
| rabonder (se), se rabonnir, s’améliorer, diminuer de prix. - (05) |
| rabônir, v. tr., rabonnir, rendre meilleur, bonifier : « Après c'qu'ôl a fait, l'vauran, y é pas lu qu'on veut rabônir. » - (14) |
| raboquin. Festin. Nous disons aboquer, pour donner à manger aux oiseaux. - (03) |
| rabora : labourer. - (29) |
| rabostillon one, adj., personne de taille courte et contrefaite. - (11) |
| rabot, s. m., petit soulèvement, inégalité de pavé, de terre sur les routes : « J'seû été au mitan d'la levée ; y avòt ben des rabots. » - (14) |
| rabot. n. rn. - Pilon pour battre le beurre. (Villiers-Saint-Benoît, selon M. Jossier) - (42) |
| rabot. s. m. Pilon pour battre le beurre. (Villiers-Saint-Benoît). - (10) |
| raboton, rugueux ; un chemin raboton, un chemin mal uni, pierreux. - (16) |
| rabotoû, adj., raboteux, inégal. Plancher, chemin rabotoû. - (14) |
| rabougri : vieux ridé - (44) |
| rabouin, n.m. râleur. - (65) |
| rabouin, s. m., personnage râleur, peu sympathique. - (40) |
| raboulâtrer. v. - Raccommoder grossièrement, synonyme de rechâtrer. - (42) |
| raboulâtrer. v. adj. Raccommoder. (Grandchamp). - (10) |
| raboulatris. n. m. - Raccommodage grossier. (Mézilles, selon H. Chéry) - (42) |
| raboulir, v., niveler la terre sur un cercueil ou une plantation. - (40) |
| raboulot : gros et court. - (31) |
| raboulot, boulot. Gros mais pas grand. - (49) |
| raboulot, subst. masculin ou adjectif qualificatif : boulot, râblé, trapu. - (54) |
| rabouni (r) (v. ou p.p.) : 1) rendre meilleur - 2) rendu (-e) meilleur - (50) |
| rabouni, raibouni, v. a. rendre meilleur : mon terrain était mauvais, le fumier l'a « rabouni. » - (08) |
| rabouré, vt. labourer. - (17) |
| rabourer, v. a. labourer. - (08) |
| rabouter, v. tr., raboutir, coudre bout à bout : « L'pauvre houme ! ôl a l'air minâbe. Sa fonne devròt ben li rabouter ses nipes. » - (14) |
| raboutoner, et rabout'ner, v. tr., boutonner de nouveau : « Vouéyons, chin d'sâlòt, raboutone donc ta cueûlote. » - (14) |
| raboyée. s. f. Nichée de petits oiseaux. (Mâlay-le-Vicomte). – Ce mot doit être une altération de rabouillère, terrier de lapins, nid où la lapine fait ses petits. - (10) |
| raboyère (pour rabouillère). s. f. Terrier, creux, trou, cavité. (Villiers-Bonneux). – Voyez raboyée. - (10) |
| racafouer. v. - Humilier. Ce mot remonte au bas-latin ecclésiastique raca (pauvre individu), lui-même influencé par l'araméen raqâ (sot, méprisable), et par l'hébreu roq (crachat). On trouve au XIXe siècle un emploi littéraire dans l'expression« crier raca sur quelqu'un», au sens de «mépriser». Racafouer, uniquement employé en usage dialectal aujourd'hui, signifie humilier. - (42) |
| racafouer. v. a. Humilier. (Perreuse). - (10) |
| racagnardi : souffrant, qui n'a pas la forme - (46) |
| racaille, troupe d'enfants bruyants. Dans l'idiome breton, raca ou graka signifie faire un bruit désagréable, et, au figuré, caqueter, babiller. (Voir Le Gon., au mot graka.) - (02) |
| racalot : fauvette des roseaux. (PSS. T II) - B - (25) |
| racanette : petite canne sauvage. - (09) |
| racanette : s. f., sarcelle. - (20) |
| racanette. s. f. Roseau dont les paniaules servent à faire des balais. (Saint-Florentin). - (10) |
| racantatian : Récit, racontar. « I n'y a pas à se fier à ses racantatians » : il n'y a pas lieu d'ajouter foi à ce qu'il raconte. - (19) |
| racanter : Raconter. « Qu'est-ce que te racantes de neu ? ». - (19) |
| racapin : Grippe-sous, usurier. « Y est in fameux racapin ». - (19) |
| racapin, adj. avare, accapareur. - (22) |
| racapin, adj. avare, accapareur. - (24) |
| racater (se), v. pr., se retirer, s'abriter : « Eh! boune vouésine, que d'venez-vous donc ? On n'vous vouét pus. — Que v'lez-vous, vouésin ! par ce grô-t-hivâr, i m^racate au counòt d' mon feù. » - (14) |
| racàter, et raquàter, v. tr., ramasser : « Eh! vieux ! que qu'te fais ? Racàte donc ton bounòt. » - (14) |
| raçauffer (v.t.) : réchauffer - (50) |
| rac'chevené : Ramoneur. « Macheuré c'ment in rac'chevené » : barbouillé de noir comme un ramoneur. - (19) |
| raccorci : raccourcir - (57) |
| raccorder (se) v. Se réconcilier. Voir rabobéchi, rapapilloti, rapatrier. - (63) |
| raccouer v. Rattacher, raccorder, réconcilier. - (63) |
| raccoutrer v. (du v.fr. racosturer, recoudre) Recoudre grossièrement. - (63) |
| raccroc n.m. Hasard. Ôl l'a su p'raccroc. - (63) |
| raccrochi : raccorcher - (57) |
| raccruchi : Raccrocher. Au figuré trouver par hasard, par raccroc. « Quevà dan que t'as raccruchi ce vieux fauteuil ? ». - (19) |
| raceune : Racine. « Eune raceune de noué » : une racine de noyer. « Prendre raceune » : tarder à s'en aller. - (19) |
| raceune : s. f. racine. - (21) |
| rachais, polisson, gamin. En breton , râch signifie teigne, maladie de la peau qui affecte particulièrement les enfants mal tenus. - (02) |
| râche – espèce de galle à la tête ; et d'autre part nom de la cuscute, plante qui rampe et étouffe tout autour d'elle. - Çi teint quemant râche ; i n'ai jaimâ pu veni ai bout de l'enlevai. - On peut voir Riache, pour lequel on le met quelquefois. - (18) |
| râche (ai) (loc.) : dru, dense, épais - (50) |
| râche (ai), loc. dru, épais, uniformément dense : mon blé pousse « ai râche. » (voir : rase.) - (08) |
| râche : coquelicot. - (29) |
| rache : coquelicot. (E. T II) - B - (25) |
| râche : (râ:ch - 'subst. f.) cuscute, sorte de plante parasite de la luzerne. - (45) |
| rache : s. f., vx fr., teigne, croûte de lait. - (20) |
| râche, rachet, teigne, teigneux, mot injurieux. - (05) |
| râche, s. f. teigne, inflammation du cuir chevelu. (voir : râchou.) - (08) |
| râche, s. f., teigne, gale. On entend souvent dire : Ça teint bon, ça teint coume râche. » - (14) |
| râche. s. f. Teigne, maladie de peau qui s'attaque à la tête. - (10) |
| rache. Teigne. Rachet, qui a la râche, terme injurieux. - (03) |
| râchée (n.f.) : 1) touffe d'arbustes rabougris - 2) buisson où se trouve des souches - (50) |
| râchée, s. f. touffe d'arbres rabougris, buisson où se trouvent des souches, de vieux troncs d'arbres. - (08) |
| râchée. s. f. Touffe de bois. (Soucy). - (10) |
| rachelotage. s. m. Rattachage des faïences cassées au moyen de fil de fer ; en général, toute réparation minime ou grossière. - (10) |
| racheloteux. s. m. Celui qui rattache, qui raccommode les faïences cassées. - (10) |
| râcher : (râ:ché - subst. m.) épervier, et oiseau de proie en général. - (45) |
| râchet : Enfant malingre et chétif. « In cheti râchet » : un petit malingre. - (19) |
| rachet, adj. chétif, rachitique ; s'emploie particulièrement comme injure (du vieux français racheux, teigneux). - (24) |
| râchet, adj., mot qui, d'abord synonyme de Râchoù, a ensuite son acception figurée, qui le fait l'équivalent de « gamin » : « Allons, dit une femme à un drôle qui l'ennuie, va-t'en donc, ch'ti râchet. » - (14) |
| râchet. Rachitique, malingre. Etym. rache, teigne, du bas latin raticare, gratter, venu lui-même de radere. - (12) |
| racheux, rachoux, rachais, rachet : s. m., vx fr. racheus, teigneux (au prop, et surtout au flg.). - (20) |
| râcheux. adj. Qui a la râche, la teigne, une maladie de peau quelconque à la tête. - (10) |
| râchi (les beuchons) v. Tailler. - (63) |
| râchi : racler - (43) |
| râchie : (râ:chi: - subst. f.) rachée, souche de bois coupée qui donne des rejets. Le terme râ:chi: est péjoratif, et ne s'emploie qu'à propos de végétaux nuisibles tels que ronces, épines noires, noisetiers etc. Lorsqu' il s'agit au contraire de rejets d'arbres, on parle de sôpé. - (45) |
| rachœ, adj. chétif, rachitique. - (22) |
| râchon (n.m.) : arbre rabougri - (50) |
| râchon : touffe, bouquet hirsute. - (32) |
| râchon – buisson épineux, mal fait. - C'â in vrai ràchon d'épeune que ce caractére lai. - Ce n'â pas in boquet qu'â m'ant beillé c'â in râchon. - Que te te pigne don mau ! c'â in vrai râchon que tai tête. - (18) |
| râchon, s. m. arbre ou arbuste rabougri, rachitique, découronné. (voir : ragot, rangot.) - (08) |
| rachot, subst. masculin et adjectif qualificatif : chétif, malingre. - (54) |
| rachot. s. f. Pissenlit. (Rugny). - (10) |
| rachou : terme affectueux s'adressant à un enfant. - (56) |
| râchoû, adj., rude, rugueux, qui a la teigne. - (14) |
| râchou, atteint d'une maladie du cuir chevelu, sorte de teigne. - (27) |
| râchou, ouse, adj. teigneux, celui ou celle qui a la teigne. (voir : râche.) - (08) |
| rachou, ouse, adj. teigneux, poilu et sale. - (17) |
| râch'yer : v. enlever les mauvaises herbes. - (21) |
| racine jaune : s. f., carotte (daucus carola). - (20) |
| raclai. Racler. - (01) |
| râcle. Toute espèce de racloir. - (12) |
| racleûres : restes, raclures alimentaires. « En étre à migî des racleûres de plotte » : réduit à manger les raclures de billot. - (62) |
| racliai - outre le sens français de râcler ; détruit, disparu complètement. - L'oraige é fait gros de mau tot à racliai. A n'i é pu un poi d'herbe. - A peu près le même sens que râsai. - (18) |
| racliat : Nettoiement. « Fare le racliat » : est une opération qui consiste à enlever d'une coupe à exploiter prochainement tout le mauvais bois, les épines, les buis, les ronces, etc et à ne laisser que le bon bois, chêne, hêtre, bouleau, charmille, érable, etc. Le bois qui provient de cette opération : « In fagueut de racliat ». - (19) |
| racliée : Raclée, correction manuelle, volée de coups. - (19) |
| raclier : Racler. « Raclier des tonneaux », détacher les cristaux de tartre (on dit aussi décrayer) qui se sont fixés à l'intérieur du tonneau. - Terme de culture, raclier ou raper c'est racler le terrain avec la pioche pour couper l'herbe, opération qui remplace, quand la terre est trop durcie par la sécheresse, une des façons à donner aux vignes. - (19) |
| râcliner (v. tr.) : frotter bruyamment en raclant - (64) |
| racliot - raclure. - Peurnez nos gaudes su vos aissiettes ; moi i mégerai dans lai chaudeire pour aivoir le râcliot. - (18) |
| râclot, s. m. gratin, ce qu'on racle au fond d'une casserolle ou d'une marmite : le « râclot » est le régal des enfants. - (08) |
| râclòt, s. m., raclure, croûte ordinairement d'un beau brun doré, qui reste au fond de la marmite où l'on a fait cuire les gaudes, et que la cuillère enlève par rubans. Très recherché de certains. Les mères abandonnent volontiers ce régal aux enfants. - (14) |
| raclot, s. m., tout ce qui adhère dans la casse - poêle à frire. - (40) |
| râclot. Raclure, ce qui reste au fond du pot, du plat ; les parties que la cuisson y a fait adhérer au figuré le reste, la fin d'une chose. - (12) |
| raclotte : gaude brûlée au fond de la marmite. - (31) |
| râclotte : raclette - (39) |
| raclotte, couche de gaules restant au fond de la casserole. - (28) |
| raclotte, raillotte. Rainette ; crécelle. - (49) |
| raclotte. n. f. - Raclette. - (42) |
| râcloû de boyaux, loc., crin-crin, mauvais joueur de violon, — qu'on est encore bien heureux de trouver et de jucher sur ses tonneaux pour les noces, les foires et tous les bals de fêtes. - (14) |
| raclouner. v. - Racler proprement un plat, une casserole. - (42) |
| raclues. n. f.pl. - Restes, déformation de « raclures ». - (42) |
| racmailler, rencmailler (sans doute pour remmailler). v. n. Raccommoder, repriser sans cesse les mêmes mailles. – Au figuré, répéter à chaque instant la même chose. (Mâlay-le-Vicomte, Plessis-Saint-Jean). - (10) |
| racmeuder : Raccommoder. « Racmeuder des chausses » : raccommoder des bas. - (19) |
| rac'moder : raccommoder - (61) |
| racmoder : raccommoder des vêtements, des chaussons - (43) |
| rac'moder, v. tr., raccommoder. - (14) |
| racmoder. Raccommoder. - (49) |
| racoin (n.m.) : coin, angle, endroit obscur - (50) |
| racoin : fossé. (SB. T IV) - C - (25) |
| racoin : recoin - (48) |
| racoin : un recoin. - (56) |
| racoin, ragoin : s. m., vx fr. racoi, recoin ; odeur composite sui generis impossible à analyser, mais dans laquelle y a du renfermé, de la saleté, du rat crevé, de la mauvaise cuisine, de la fumée, etc. - (20) |
| racoin, s. m. coin, angle, endroit obscur ou secret. - (08) |
| racoin, s. m., coin d'une pièce, d'une maison. - (40) |
| racoin, s. m., recoin, coin sombre, angle retiré : « J'ons sarché dans tous les racoins, et j'ons pas pu y treùver. » - (14) |
| racointer (v. int.) : rouspéter (syn. digoter) - (64) |
| racointer : grogner, récriminer - (60) |
| racointer, racouéter. v. - Raconter, répéter. Employé généralement dans un sens péjoratif.: « Guade don' la mée Tinatte ! Quoiqu'elle est en train d'racointer ? Marche, enco' des counneries ! » - (42) |
| racontance : s. f., vx fr., racontage, récit. - (20) |
| racoquiller (se). Se raccommoder après une brouille. (S'emploie aussi à la voix active). - (49) |
| racoquilli (s') v. Se refaire une santé, se requinquer. - (63) |
| racorgnat, s. m., coin d'une pièce d'eau ou d'un champ. - (40) |
| racornir : devenir dur, par dessiccation ou excès de cuisson. - (56) |
| racorti : Raccourcir. « Les jos sant déjà bien racortis ». - (19) |
| racot. s. m. Plant de vigne sans racines. (Nailly, Veron). – Sarment, à Soucy. - (10) |
| racoter, se dit des industriels ruraux qui parcourent les fermes pour acheter les œufs, la volaille, le gibier et les revendre au marché de la ville voisine. - (11) |
| racôti, adj., raccourci, de petite taille; et aussi : desséché, retiré, racorni par le feu. - (14) |
| racotier (n.m.) : marchand ambulant d'oeufs, de volailles ... - (50) |
| racotier, n.m. personne qui passe dans les fermes pour acheter les œufs et les divers produits à revendre : le coquetier. - (65) |
| racotier, qui se livre à ce commerce. - (11) |
| racotier, racotcher. Coquetier. - (49) |
| racotier, ragotier, ragotière : s. m. et f., coquetier, coquetière. - (20) |
| racotier, subst. masculin : coquetier, marchand d'œufs et de volailles provenant des élevages de la région. - (54) |
| racotier. Coquetier, celui qui apporte de la campagne à la ville les œufs, le beurre, la volaille, etc. Etym. inconnue. - (12) |
| racouailler. v. - Parler bruyamment, sans raison sérieuse. - (42) |
| racouéter, racointer. v. a. Chercher des retours. (Mézilles). – Répéter souvent la même chose en grommelant. - (10) |
| racoussaud n.m. Personne petite. - (63) |
| racoutrer. Raccommoder les vieux habits. I vâs tâcher de racoutrer tai culotte. C'est une altération de recoudre. - (13) |
| racueillon : enfant maigre, chétif (voir : raqueillon). - (56) |
| rade : Plein jusqu'au bord. « In grand varre de vin tot rade » : un grand verre de vin plein à ras bord. - Sorte de règle que l'on passe sur l'orifice d'une mesure de capacité pour les grains, pour enlever le trop plein. - (19) |
| râde qu’balle (p’us) : en vitesse - (37) |
| radeche : s. f., gâteau de farine de maïs. - (20) |
| radée : (nf) averse - (35) |
| radée : averse - (51) |
| radée n.f. (vx.fr. radir, pleuvoir à verse) Averse de pluie abondante et de courte durée. - (63) |
| radée : s. f., vx fr. radei, rador, averse. Il en est tombé une, de radée ! Voir brevée et brusée. - (20) |
| radelier, s. m., celui qui confectionne les radeaux. La prononciation élide le premier e autant que possible, et finit par donner rad’lier, et chez certains même rad'ier. - (14) |
| rader : Passer la rade pour enlever le trop plein. - (19) |
| rader, râcler, raser la mesure. - (05) |
| radeure : Croûte qui se forme au fond d'une marmite où cuisent des gaudes et qu'on détache en raclant. - (19) |
| radeuter : Radoter « An venant vieux an se ment à radeuter ». - (19) |
| radfi, adfi : (vb) retrouver (quelque chose qu’on a perdu) - (35) |
| rad'iau, s. m. tas très allongé de branchages ou de terre travaillée. - (24) |
| radiau, s. m., radeau. - (14) |
| radiche, s. f. galette dont la surface est frottée de beurre et sur laquelle on trace des raies. La « radiche » est encore appelée « rabine, rabigou », dans certaines localités. (voir : rabine.) - (08) |
| radichon, s. m. petite galette sèche ou croquante. - (08) |
| radie : molle (comme une pomme que l'on a conservée trop longtemps) - (61) |
| radin : fricot attaché au fond des écuelles. (P. T IV) - Y - (25) |
| radin. n. m. - Ce qui reste attaché au fond d'une poêle après cuisson d'un aliment. L'histoire de ce mot remonte au verbe rater, utilisé au XIVe siècle et d'origine obscure, dans le sens de «racler». Le radin fut donc celui qui rate, celui qui racle les rognures pour ne rien laisser perdre ; d'où le sens figuré d'« avare », encore employé aujourd'hui. Puis au XIXe siècle, le radin signifia : ce qui est raclé, par glissement du sens actif.au sens passif - (42) |
| radiner : v. n., vx fr. radir (v. a.), pleuvoir à verse. - (20) |
| radiner. v. - Enlever, racler le radin. - (42) |
| radiner. v. a. Enlever le grattin, le râclon d'un poêlon, d'une tourtière, en grattant. – Par extension, frotter l'un sur l'autre deux corps durs pour en obtenir un grincement désagréable. (Chastenay). - (10) |
| radis, rasis. s. m. Etoffe rayée. De radier, rayer. (Bléneau). - (10) |
| radjigner. v. - Ronger, en parlant d'un animal. (Mézilles, selon H. Chéry) - (42) |
| radoire. s. f. Instrument en usage dans les halles et marchés pour niveler le blé dans la mesure. (Joigny). - (10) |
| radotou, radoteur. - (16) |
| radouci (se) : Radoucir, calmer. « Le temps se radoucit », la température devient plus douce. « O s'est radouci » : il s'est calmé. - (19) |
| radouée (n.f.) : palette pour racler la pâte au fond de la maie - (50) |
| radouée (nom féminin) : raclette pour enlever la pâte qui reste au fond de la maie (pétrin). - (47) |
| râdouée, s. f. instrument dont on se sert pour racler la pâte dans la huche ou mait. - (08) |
| radoux, s. m., redoux, réchauffement de l'air, après une période de froid. - (40) |
| radzeuni : rajeunir - (43) |
| rafale : Dont l'aspect dénote la ruine, la misère. « Ol est bin rafalé » : il a bien l'air d'être dans la misère. - (19) |
| rafalé, adj. râpé, misérable. - (38) |
| rafau, s. m. vieil arbre rabougri, de mauvaise venue, qui n'a pas de tête ; arbre couronné. - (08) |
| ràfe, adj., rugueux, rude au toucher, au fig. revêche : « T'as les mains ben ràfes : on diròt la langue d'ein chat. » — « Qu'ôl é don ràfe en vous parlant! » - (14) |
| rafe, rafle, adj. franc, cassant, qui n'est pas flexible. certains bois sont « rafes », et se brisent lorsque l'on essaie de les faire ployer : une noix « rafe » est une noix où l'écorce est engagée dans l'amende et qui ne se peut manger. - (08) |
| râfe, rude au toucher. - (05) |
| rafe. Rude au toucher. La langue du chat est rafe. - (03) |
| raferdir : refroidir. Ex : "Vins goûter, ça va raferdie !" - (58) |
| rafeurdir (verbe) : refroidir. - (47) |
| raffe : amer, âpre, âcre. - (33) |
| rafferdi. adj. - Refroidi : « Michel ! Couve-toué don', t'es en nage ! Te vas attraper un chaud-rafferdi ! Ah ces gamins !!! » - (42) |
| rafferdir. v. - Refroidir. - (42) |
| rafficher (se). v. - Se moquer, se ficher. - (42) |
| rafficher (Se). v. pronom. Se moquer, prendre plaisir à dire, ou à faire des choses désobligeantes pour autrui. (Villiers-Saint-Benoît, Villeneuve-les-Genêts). - (10) |
| raffignat (nom masculin) : mauvaise odeur. - (47) |
| raffrilloter. Avoir froid. - (12) |
| raffut, raiffut, s. m. bruit, tapage, vacarme : faire « raffut », faire tapage. - (08) |
| raffut, s. m. Grand bruit, tapage. - (10) |
| raffut. Bruit, vacarme, tapage. Etym. inconnue. - (12) |
| raffut. Grand bruit. - (49) |
| raffuter : Affuter. « Ma sârpe a bien faute de raffuter » : ma serpette a bien besoin d'être affûtée. - (19) |
| raffuter. v. a. Raccommoder. – Battre, gronder, tarabuster. - (10) |
| rafisteulé, réparer un peu un objet en mauvais état. - (16) |
| rafistoler a presque le même sens que racoutrer, mais il est plus étendu et s'applique à toute espèce d'objets. An faut rafistoler note taule qu’ast cassée. — Dis ai lai meire qu'elle rafistole le restant du vià. Les habitants de l'Yonne disent « afistouler. » - (13) |
| rafistoler, rétablir la toilette dérangée. - (05) |
| rafistoler, v. ; refaire, arranger. - (07) |
| rafistoler. Rétablir quelque chose de dérangé, composé de affistolé. - (03) |
| rafje (ā), sf. râfle, le plus haut numéro du tirage au sort. - (17) |
| raflai. : (Pron. rafliai), emporter tout ce qu'on trouve. (Du latin rapere.) Les Picards disent une raflée comme on dit ailleurs une tapée d'enfants par exemple, pour exprimer une agglomération de marmaille quelque part. Ce dernier mot vient de top qui, en néerlandais (Burg.), signifie touffe de cheveux. Les Bourguignons, comme cela leur arrive souvent, ont changé l'o en a. - (06) |
| rafle (adj.) : cassant, qui n'est pas flexible - (50) |
| râfler : enlever sur une surface. - (09) |
| ràfler, v. tr., effleurer : « Ol avòt bu ein coup d'trop ; ô ràflòt les murs en rentrant. » - (14) |
| rafliai, emporter tout ce qu'on trouve à sa portée. En latin rapere. - (02) |
| rafougnon (en). En désordre. Etym. inconnue. - (12) |
| rafouillon, s. m., chose de rebut, mauvais reste de viande : « Que c'qu'ié que ces rafouillons qu'te m'bailles à mainger ? Notre chin n'en vouròt point. » - (14) |
| rafquéter, v. a. ravoir, racheter, reprendre par acquêt ou autrement, rentrer en possession, rattraper ou plutôt attraper une chose jetée, égarée. on « raiquéte » du bien par l'économie. - (08) |
| rafraîchi : rafraîchir - (57) |
| rafraîchi : Rafraichir. « Le temps se rafraichit ». « T'as bien fait de ma rafraichi la mémoire ». Terme de brandevinier mettre de l'eau froide dans la hotte de l'alambic. - (19) |
| rafreudi : refroidir - (51) |
| rafriquer (se), se réjouir d'avance. - (05) |
| rafriquer (se). Se réjouir, peut être du vieux mot frisque, gai, joyeux ; bas latin, friscus. - (03) |
| rafu, grand bruit, vacarme. - (16) |
| râfu, s. m., bruit, tapage : « Que râfu qu'te nous fais ! V'tu ben t'taiser ! » — « La neût j'ons entendu ein râfu du diâbe. » - (14) |
| rafut: bruit - (48) |
| ragâcher, v. tr. et intr., rabâcher, gronder, taquiner, parler sans cesse, sans raison, et surtout d'une manière ennuyeuse. - (14) |
| ragâcher, v. tr., gagner aux billes, en faisant rouler doucement la sienne. Terme de jeu enfantin. - (14) |
| ragacheries, menues choses mobilières... - (02) |
| ragacheries. : Menues choses mobilières. A Genève on nomme ragâche un petit marchand regrattier. (Glos. gen.) - (06) |
| ragâchoù, s. et adj., rabâcheur : « Ol é enniuant, c'vieux ragâchoù ; à rec'mence tôjor la main-me chouse. » (V. Ragjognon.) - (14) |
| ragadonner. v. - Rapiécer. (Villiers-Saint-Benoît, selon M. Jossier) - (42) |
| ragadonner. v. a. Rapiécer. (Villiers-Saint-Benoît). - (10) |
| ragasse (n. f.) : forte averse (syn. rouassée) - (64) |
| ragasse (nom féminin) : averse de courte durée. - (47) |
| ragasse : (nf) averse - (35) |
| ragasse : averse - (44) |
| ragasse : averse forte et brève. (Voir gareau). - (62) |
| ragasse : averse violente. - (66) |
| ragasse : averse, giboulée. (R. T IV) - Y - (25) |
| ragasse : Averse, pluie battante. « Je nos sins troués dans la ragasse » : nous nous sommes trouvés dehors pendant l'averse. - (19) |
| ragasse : grosse giboulée de pluie (ne concerne ni la neige, ni la grêle). - (33) |
| ragasse n.f. (construit sur aigue avec un r initial de renforcement et le suffixe asse, péjoratif). Averse abondante, violente et de courte durée, plus forte qu'une beurée. - (63) |
| ragasse : n. f. Grosse giboulée de pluie. - (53) |
| ragasse : s. f., averse. A rapprocher de ravace. - (20) |
| ragasse, forte averse inopinée. - (27) |
| ragasse, raigasse : grosse giboulée, grosse averse - (48) |
| ragasse, s. f. averse. Verbe ragasser. - (24) |
| ragasse, s. f. averse. Verbe : ragassé. - (22) |
| ragasse, s. f., pluie forte et brève. - (40) |
| ragasse, subst. féminin : averse forte et abondante. - (54) |
| ragasse. Averse. Pluie subite, abondante, généralement de peu de durée. - (49) |
| ragasse. n. f. - Giboulée, averse. - (42) |
| ragasse. s. f. Pluie soudaine, qui tombe fort et qui passe vite. - (10) |
| ragasser : Pleuvoir à verse. « I ragasse bin bravement ! ». - (19) |
| ragasser : v, n., pleuvoir à ragasse. - (20) |
| ragassi v. Pleuvoir fort. - (63) |
| ragâtouner (v. int.) : radoter (quand on est vieux, on ragâtoune) - (64) |
| ragaucher (se) : se rattraper. - (66) |
| ragaucher. Attraper au vol un objet qu'on vous jette. Voyez raquetter, dont ragaucher me parait être une forme alourdie. - (12) |
| ragaume (nom masculin) : plat généralement confectionné avec des restes. - (47) |
| râger : remuer, bouger. (F. T IV) - Y - (25) |
| rageuver, v., aiguiser. - (40) |
| ragne (bon) : verbe haut. (RDM. T IV) - B - (25) |
| ragô : (nm) chicot - (35) |
| ragognai - murmurer, gronder. - Al â tojeur ai ragonai. - Al é don ragonai, ragoniai !!... que c'en éto béte. - Al â quemant cequi, que velez-vo ! c'â in vrai ragogniou. - (18) |
| ragogner (C. -d., Chal.), raigoigner, ragosser (Morv.), ragonner (Y., C.-d.).- Gronder, grogner, grommeler. Vient probablement de ragot, lequel a formé le verbe ragoter, aujourd'hui hors d'usage, et cité par Littré, qui n'en donne pas l'étymologie. Selon nous, cette étymologie serait la même que celle de ergoter (discuter), c'est-à-dire le latin argutare. Ragoter et ergoter n'ont pas grande différence entre eux, comme sens et comme construction. - (15) |
| ragogner : ronchonner, gronder. (A. T IV) - S&L - (25) |
| ragogner : v. n., grogner, gronder. - (20) |
| ragogner, ragueugner. Marmotter, grogner. - (49) |
| ragogner, v. tr., gronder à tout propos, murmurer, bougonner, maugréer : « Que c'que t'nous ragognes donc là, toué. » - (14) |
| ragogner, v., maugréer, rouspéter. - (40) |
| ragogner, verbe intransitif : rouspéter, maugréer. - (54) |
| ragogni v. (de agonir précédé d'un r de renforcement). Rouspéter. - (63) |
| ragognon : très grognon - (44) |
| ragognon n. et adj. Grincheux, grognon. - (63) |
| ragognon, ragueugnon. Marmotteur. Se dit d'une personne de mauvaise humeur, jamais satisfaite ; grognon. - (49) |
| ragògnon, s. et adj., grognon, mécontent, grondeur, qui trouve à redire à tout. - (14) |
| ragoi : rassasié. (S. T IV) - B - (25) |
| ragoincher. v. - Rabâcher. - (42) |
| ragome, ragueuillon. Aliment mal préparé, peu appétissant. - (49) |
| ragoné, exprimer longuement son mécontentement. - (16) |
| ragônè, ragônée : rouspéter, une engueulade - (46) |
| ragoner : grommeler, ronchonner. - (29) |
| ragoni. : Ce mot répond à l'expression anglaise rag, qui signifie chiffon, et dont nos ancêtres du XVe siècle ont façonné une sorte de diminutif. - (06) |
| ragonné, vn. gronder, morigéner ; grogner. - (17) |
| ragônner : (se) rhabiller - (35) |
| ragonner : Gronder, réprimander. « O n'est pas d'arrate de ragonner » : il ne cesse de faire des réprimandes. - (19) |
| ragonner : marronner. (E. T IV) - C - (25) |
| ragonner et ragotter. Gronder fréquemment. An ne peut ran fâre ai son idée, a ragonne du maitin â seir... - (13) |
| ragonner on ragogner. Grander quelqu'un, ou grogner contre quelque chose, trouver mal ce qu'on fait. Ex.: « Jamais content, il ragonne sans cesse contre tout et ne trouve rien de bien. » Etym. ragot. - (12) |
| ragonner, manifester une mauvaise humeur en marmottant. - (27) |
| ragonner. v. a. et n. Gronder, parler en grognant, en faisant des reproches, en maugréant. – Répéter à chaque instant la même chose. - (10) |
| ragosse, s. f. gronderie, réprimande. - (08) |
| ragosser, gronder - (36) |
| ragosser, v. a. gronder quelqu'un. il y a des gens qui « ragossent » toujours leur entourage. - (08) |
| ragossou, ouse, s. et adj. grognon, grondeur. - (08) |
| ragot : chicot - (43) |
| ragot : râblé - (48) |
| ragot : taureau. (MM. T IV) - A - (25) |
| ragot de bois : morceau de branche ou arbuste cassé fiché dans le sol et qui peut être blessant. - (59) |
| ragot n.m. (d'une racine rag- désignant ce qui est petit, trapu, gros). Chicot. - (63) |
| ragot : s, m., grognon. - (20) |
| ragot, s. m. histoire qu'on raconte à satiété, rabâcherie. (voir : rangot.) - (08) |
| ragot, subst. masculin et adjectif qualificatif : petit mais vif, vigoureux. - (54) |
| ragot. s. m. Plant de vigne d'un an. (Armeau). – Au pl., redite d'observations, de gronderies déraisonnables, ennuyeuses. Il est insupportable avec tous ses ragots. - (10) |
| ragot. s. m. Taureau. (Domecy-sur-Cure). - (10) |
| ragot. Tige de plante s'élevant au-dessus du sol après la récolte. - (49) |
| ragotat, ragoton,ragougnat, rogaton n.m. (du fr. ragoton, rogaton) Fond de casserole, râclure de marmite, débris. - (63) |
| ragoter : v. n., grogner, grognonner. - (20) |
| ragoter, gronder, murmurer, ragogner. - (04) |
| ragoter, v. n. rabâcher, redire sans cesse les mêmes choses - (08) |
| ragoter. v. n. Radoter, gronder, faire des bavardages, des cancans, des ragots. (Civry, Sainpuits, Soucy). - (10) |
| ragoton (nom masculin) : petits morceaux de nourriture. - (47) |
| ragotou, ouse, s. celui qui grogne ou rabâche sans fin : un vieux « ragotou », une vieille « ragotouse. » - (08) |
| ragotoû, s. et adj., bavard, cancanier, diseur de menteries, faiseur de ragots : « C'tô-là, all'vous en débile ! ma y ét eùne ragotouse. » - (14) |
| ragotte : ruelle (du lit) - (48) |
| ragou. Ragoût, ragoûts… - (01) |
| ragoué – ragouilli : rassasié - (57) |
| ragoué - ragouilli : repu - (57) |
| ragoué (-e) (adj.m. et f.) : rassasié (-e) - (50) |
| ragoué : repus - (44) |
| ragoué de qqch. (être) : être saturé, en avoir plus qu'assez. - (56) |
| ragoué, adj., repu (après un repas). - (40) |
| ragoué, adjectif qualificatif : repu, ou même écœuré par trop de nourriture. - (54) |
| ragoué, être dégouté d'une chose à force d'en être saturé : j'en suis ragoué. - (11) |
| ragoué. Dégoûté. Ne nous fait point de soupe au lard, nous en sommes ragoués. C'est le contraire d’engoué. - (13) |
| ragoué. Rassasié. - (49) |
| ragouer : rassasier. Satisfaire. « Ô n’en vou pu, ô l’o ragoué » : il n’en veut plus, il est repu. - (62) |
| ragouer, v. tr., rassasier, dégoûter : « J'n'en voux pu, d'ton fricot ; j'en seû ragoué. » - (14) |
| ragougnasse : mauvaise cuisine - (48) |
| ragougnasse : mauvaise pitance - (60) |
| ragougnasse : mets médiocre fait de peu… et parfois d’un peu de tout. C’est ragout + le suffixe péjoratif asse ou ragougnârde. - (62) |
| ragougnasse : mauvaise cuisine. - (33) |
| ragougnasse : n. f. Cuisine très mauvaise. - (53) |
| ragougnasse, s. f., plat peu appétissant. - (40) |
| ragougnî : ronchonner. Un ronchon est un « ragougnou ». - (62) |
| ragouillage, s. m., mauvaise ratatouille, cuisine d'auberge, mets à sauce trop longue et fade. - (14) |
| ragouilli : dégoûter - (57) |
| ragouin : Odeur de ce qui est ragouiné. « La sope sint le ragouin ». - (19) |
| ragouiner : Cuire trop longtemps et sans aucun soin. « Fa attention de ne pas laichi ragouiner la marande ». On dit aussi gouiner. - (19) |
| ragouiner : faire cuire longtemps et doucement - (51) |
| ragouiner, raguiner. v. - Plusieurs usages : 1. Ronger, grignoter (Saint-Martin-sur-Ouanne, selon M. Jossier). 2. Ranimer, attiser (Sougères-en-Puisaye). 3. Racler, gratter : « Bon Gieu ! J'sais pas c'qui m'a passé dans l' gargari ! Ca a raguiné, c'est quasiment coumme des pépins. » (Fernand Clas, p.330) - (42) |
| ragoux, ragouse : adj., qui vomit. - (20) |
| ragriffer. v. - Rattraper, récupérer ce que l'on avait laissé échapper. (Saint-Martin-sur-Ouanne, selon M. Jossier). Mot dérivé de « griffe ». - (42) |
| ragriffer. v. a. Rattraper, reprendre ce qu'on avait laissé échapper. (Saint-Martin-sur-Ouanne). - (10) |
| ragromer (se) v. Se recroqueviller. Syn. d'agrômer. - (63) |
| ragueusi, frileux, engourdi, qui se tient au coin du feu. - (27) |
| ragueut : Gros brin de bois pas très long. « In ragueut de châgne ». - (19) |
| ragueuter : Battre, rouer de coups. « Si te ne demores pas tranquille te vas te fare ragueuter ». - (19) |
| ragueu-you, s. m., aiguiseur de ciseaux et de couteaux. - (40) |
| raguiner. v n. Ronger, faire du bruit à la manière des rongeurs. (Saint-Martin-sur-Ouanne). - (10) |
| raguouè : repu - (46) |
| raguzeu : aiguiser. - (29) |
| rai : (nm) rayon d'une roue (de char) - (35) |
| rai : rigole, sillon, petit fossé - (34) |
| rai : s. m. rayon de voiture. - (21) |
| rai, s. m. rayon d'une roue : il manque un « rai », les « rais » sont usés. - (08) |
| rai'aifét'la nouruture : pâté liquide pour les cochons. - (33) |
| raibâcher, v. a. râbacher. (voir : ravacher.) - (08) |
| raibaîç’er : répéter à satiété - (37) |
| raibaicher, v. a. rabaisser, diminuer, déprécier. (voir : baicher.) - (08) |
| raibait ! (y) : le vent ramène la fumée de notre côté - (37) |
| raibat, s. m. rabais, diminution de prix : tout est cher, mais il y aura du « raibat. » - (08) |
| raibaurer (v.t.) : labourer - (50) |
| raibeubingné, vt. rabobiner. - (17) |
| raibeûclée, raibeût’lée : grosse averse - (37) |
| raibeuqué, raibuqué, vt. aboutir, réussir, atteindre un but : Bé raibuqué ! - (17) |
| raibeutlée : grand rassemblement de personnes. - (33) |
| raibeût'lée, raibeut'née : grand nombre, grande quantité - (48) |
| raibeut'née : grosse quantité. (S. T III) - D - (25) |
| raibeutnée : n. f. Grand rassemblement de personnes. - (53) |
| raibiau (au), loc. en diminuant, avec diminution. un joueur qui perd des points va « au raibiau. » - (08) |
| raibiaudaige, s. m. rabillaudage, rhabillage, raccommodage un peu grossier. - (08) |
| raibiauder (v.t.) : rhabiller grossièrement, réparer un objet en mauvais état - (50) |
| raibiaûder : recoudre, réparer un vêtement - (48) |
| raibiaûder, raip’taisser : réparer des vêtements - (37) |
| raibiauder, v. a. rhabiller grossièrement, raccommoder, réparer un objet en mauvais état, mettre des pièces à un vêtement ou à un meuble, restaurer à la hâte. - (08) |
| raibiboc’er (s’), (s’) aircaûser : être à nouveau en accord après avoir été « brouillés » - (37) |
| raibibocher : réconcilier - (48) |
| raibléger, v. n. être chargé, accablé de. On dit d'un arbre : il a tant de fruits qu'il en « raiblége. » (voir : bléger, aibléger.) - (08) |
| raibô. Inégalité de pavé, endroit raboteux dans le chemin. - (01) |
| raibolé : continuer de pleurnicher. (CT. T II) - S&L - (25) |
| raibôler (v.t.) : pleurnicher bruyamment - (50) |
| raiborû (n.m.) : laboureur - (50) |
| raibot (n.m.) : rabot - (50) |
| raiböté, raibeuté, vt. raboter. - (17) |
| raibotou, ouse, adj. raboteux, ce qui est noueux, inégal. - (08) |
| raibougri : chétif, petit - (48) |
| raibouin : romanichel - (37) |
| raibouli : niveler, combler - (48) |
| raibouli : reboucher un trou - (39) |
| raibouli, v. a. remplir un trou, un creux en nivelant. (voir : aibouli.) - (08) |
| raibourer (verbe) : labourer. - (47) |
| raibroquer, hoqueter - (36) |
| raiccomodû (n.m.) : raccomodeur - (50) |
| raice, sf. race. - (17) |
| raiceune (n.f.) : racine - (50) |
| raiceune (na) : racine - (57) |
| raiceune, s. f. racine : « eune raichine d'âbre. » - (08) |
| raiche : dure, raide - (39) |
| raiche, s. f. race : « eune mauvaille raiche », une mauvaise engeance. - (08) |
| raichine, s. f. racine : « eune raichine d'âbre. » - (08) |
| raicingne, sf. racine. - (17) |
| raicmödé, raicmeudé, vt. raccomoder. - (17) |
| raic'môder : raccommoder - (48) |
| raic'moder : raccommoder - (39) |
| raic'moder, v. a. raccommoder. « rac'moder. » - (08) |
| raicoaillé (se), vr. se récrier, pousser des plaintes aiguës. - (17) |
| raicoin, sm. racoin, coin. - (17) |
| raicointaige (n.m.) : rabâchage, bavardage ennuyeux - (50) |
| raicointaige, s. m. radotage, rabâchage, bavardage ennuyeux ou fatigant. - (08) |
| raicointer (v.) : rabâcher, répéter la même chose - (50) |
| raicointer, v. a. redire avec insistance, rabâcher, répéter toujours une même chose. - (08) |
| raiconter (v.t.) : raconter - (50) |
| raiconter : raconter - (48) |
| raiconter : raconter - (39) |
| raicontou (-ouse) (n.m. ou f.) : conteur (-euse), racanteur (-euse) - (50) |
| raicontû (n.m.) : raconteur - (50) |
| raicôti ou récôti, de petite taille, comme l'on dirait raccourci par l'action du feu ; recoctum en latin. (Voir le mot ratri.) ... - (02) |
| raicôti ou récôti. : De petite taille, comme on dirait d'un objet raccourci par l'action du feu. (Du latin recoctum.) - (06) |
| raicotji, vt. raccourcir. - (17) |
| raicottier, coquâtier : ramasseur dans les fermes des œufs et volailles (coquetier) - (37) |
| raicouand : repas de baptême. - (32) |
| raicouaud (n.m.) : repas de baptême (haut-Morvan) - (50) |
| raide : Fort, en parlant d'une liqueur. « Veux-tu du doux ? - Nan j'ain-me mieux le raide ». « Se teni raide » : résister, ne pas se laisser entortiller. « Se teni raide c'ment un marchand de poulots ». - (19) |
| raide, adj. rapide, qui a un mouvement précipité. on dit d'un ruisseau à forte pente que son eau est « raide. » - (08) |
| raidée. n. f. - Rayon : eune raidée de soulet, un rayon de soleil. - (42) |
| raidée. s. f. Radiée (Radius), pour rayon. – Raidée de soulet, échappée de soleil à travers un nuage. (Puysaie). – A Auxerre, on dit une râlée de soleil, râlée sans doute pour raidée. - (10) |
| raideuté, vn. radoter. - (17) |
| raidio (n.f.) : radio - (50) |
| raidons (des) : courbatures - (57) |
| raidou : Raideur. « Sa chambe est bin guérie mâ y a toje enco in ptiet bout de raidou » : sa jambe est bien guérie mais il y a encore un peu de raideur. - Vitesse. « J'ai bin vu passer la renâ mâ j'ai pas pouyu le tiri, ol allait d'eune raidou ! ». - (19) |
| raidouci (v.t.) : radoucir - (50) |
| raidouci : réchauffer - (39) |
| raidouci, v. a. chauffer, échauffer, réchauffer : « fié raidouci l'eai », faites tiédir l'eau ; la pluie a « raidouci » l'air. (voir : douci.) - (08) |
| raidoucir : réchauffer (un plat) - (48) |
| raidôzer, v. a. apaiser, calmer une personne qui s'effarouche ou s'emporte, apprivoiser. Se dit surtout en parlant des jeunes animaux. On « raidôze » un chien, un oiseau sauvages. - (08) |
| raie (ai lai), loc. a la « raie » de la nuit, signifie à la brune, à l'entrée de la nuit. - (08) |
| raie (an). L'un dans l’autre, ensemble, l’un parmi l’autre. Etym. raie dans le sens de sillon, d'espace cultivé. - (12) |
| raie (en) : tout droit. - (09) |
| raie (En). locut. adv. L'un portant l'autre, en moyenne. (Soucy). - (10) |
| raie : barre de chocolat - (44) |
| raie : rayon d'une roue - (43) |
| raie : sillon. III, p. 31 - (23) |
| raie de la neut : commencement de la nuit. - (09) |
| raie de rcope n.f. Rigole d'écoulement des eaux de ruissellement coupant un chemin de terre en diagonale et se prolongeant par une saignie, c'est-à-dire une saignée parallèle au chemin. - (63) |
| raie n.f. 1. Rigole d'écoulement des eaux. 2. Sillon de labour. - (63) |
| raie : s. f., vx fr., sillon longitudinal d'une terre séparant les rases les unes des autres. Voir rase. - (20) |
| raie. Race. « Raice de vipeire », race de vipères, mauvais enfants de mauvais pères… - (01) |
| raifarmi (v.t.) : raffermir - (50) |
| raifarmi : raffermir - (39) |
| raifârmi, v. a. raffermir, durcir. le soleil « raifârmit » la terre. (voir : aifârmi.) - (08) |
| raifaud, rafaud, sm. avorton, être chétif et mal venu. - (17) |
| raiffeût : bruit - (37) |
| raifiner, v. a. rendre plus fin, plus pointu un objet quelconque. (voir : aifuter.) - (08) |
| raifistoler, v. a. raccommoder, réparer, restaurer quelque chose en mauvais état. On « raifistole » un harnais brisé, un filet dont les mailles sont rompues, un habit déchiré. - (08) |
| raifistoller : rattacher comme s’il s’agissait de branches (« tolles ») cassées - (37) |
| raifouillon, reste de viande. En Normandie, raffreux signifie chose de rebut. (Pluquet.) - (02) |
| raifouillon. : Restes de viandes. - On dit en Normandie raffieu, pour exprimer des choses de rebut. Le complément latin repulsionem, rejet, a sans doute formé ce mot. - (06) |
| raifouingné, vn. fureter. Qqf. grogner. - (17) |
| raifousseulerie, sf. renchérissement sur rafaud, avec intention méprisante. - (17) |
| raifraichi, vt. rafraîchir. - (17) |
| raifreumer, v. a. affermer de nouveau : on « raifreume » un domaine comme une servante. - (08) |
| raifuter, v. a. aiguiser, rendre pointu. (voir : aifuter.) - (08) |
| raigaisse : pluie violente, inopinée, avec du vent - (37) |
| raigaisse, ragasse, sf. averse soudaine et violente. - (17) |
| raigasse : giboulées - (39) |
| raigauché, vt. attraper au vol (avec la main gauche). - (17) |
| raige (n.m.) : rage - (50) |
| raige : rage - (48) |
| raige, s. f. rage : « al ô en raige », il est en fureur. - (08) |
| raige, sf. rage. - (17) |
| raigement, adv. avec rage, violemment, furieusement : avoir « rangement » mal aux dents ; il est tombé « raigement » de la grêle ; vous êtes « raigement » en colère. - (08) |
| raigne, n. fém. ; gravier ou sable de roche. - (07) |
| raigni : fripé, ratatiné - (39) |
| raigogner, gronder, murmurer - (36) |
| raigognier : rouspéter pour peu de chose - (37) |
| raigogueillade, s. f. régal en général. Se dit d'un bon repas qui restaure, comme d'un bon feu qui réchauffe, etc. - (08) |
| raigogueiller, v. a. ranimer, ragaillardir, remettre en vigueur. (voir : goguenette, goguenoter.) - (08) |
| raigoguiller: ragaillardir - (48) |
| raigoigner (v.t.) : grogner sans cesse - (50) |
| raigoigner. v. a. grogner sans cesse, gronder à tout propos. - (08) |
| raigoignon, s. m. celui qui grogne sans cesse. - (08) |
| raigoignou (-ouse) (n.m. ou f.) : celui, celle qui grogne sans cesse - (50) |
| raigoignou, adj. celui qui va toujours grommelant, grondant : « eun raigoignou ; eune raigoignouse. » - (08) |
| raigonné, ragonné, vn. grogner, gronder. - (17) |
| raigot (n.m.) : branche taillée au ras du sol. - (50) |
| raigot : dru, dégourdi - (37) |
| raigote : expr. Personne alerte et courageuse. - (53) |
| raigots : cancans colportés - (37) |
| raigou : n. m. Ragoût. - (53) |
| raigoué : repu d’avoir trop mangé - (37) |
| raigoué : repu. (LF. T IV) - A - (25) |
| raigoué : adj. Repu. - (53) |
| raigranti, vt. agrandir. - (17) |
| raigueuguigné, ramassé sur soi-même. - (28) |
| raiguïer, v. a. aiguiser, rendre aigu, tranchant : « i vé raiguïer mon couteai. » - (08) |
| raigû-iller : aiguiser - (48) |
| raigûillier : aiguiser à nouveau - (37) |
| raigûilloû : rémouleur - (48) |
| raiguïou, s. m. aiguisoir, tout engin dont on se sert pour aiguiser. - (08) |
| raiguiser, v. aiguiser. - (65) |
| raiguiseur, raiguisoux, raiguijoux, bégigi. Rémouleur ambulant. - (49) |
| raiguîzou : rémouleur, affûteur (on dit aussi « bijiji », bien moins employé) - (37) |
| raiguji : Aiguiser. « Aide me dan à raiguji man cutiau ». - (19) |
| raigujoux : Qui aiguise. « Eune piarre raigujouse » : une pierre à aiguiser. - (19) |
| raigusè : aiguiser - (46) |
| raigusé, vt. aiguiser. - (17) |
| raiguser (C.-d., Chal.). - Repasser (les couteaux), pour aiguiser, mais raiguser signifie plutôt rendre tranchant et le mot aiguser est pris dans son vrai sens d'apointer, rendre aigu. - (15) |
| raigusou : un rémouleur - (46) |
| raiguÿî : affuter, aiguiser. Voir aiguÿî. - (62) |
| raihnable. : (Dial.), et raignauble. (Job.) Dérivation du régime latin rationabilem, raisonnable. - (06) |
| raïin, s. m., raisin : « L'raïin é meùr ; j'allons v'nanger. » - (14) |
| raïinet, s. m., raisiné, cette confiture locale, faite de fruits cuits dans le vin doux, excellente comme on la façonne chez nous et dans le Midi. On en connaît le nom à Paris, mais on n'y connaît guère la chose. - (14) |
| raijan : Raison. « T'as raijan ». Argument : « Tot cen n'est pas des raijans ». - (19) |
| raijenée : Raisiné, confiture de raisins. - (19) |
| raijeunni, vt. rajeunir. - (17) |
| raijin : Raisin. « Eune greume de raijin » : un grain de raisin. - (19) |
| raijin : s. m. raisin. - (21) |
| raijonner : Raisonner, sermonner. « J'ai biau ésu le raijonner, y est c'ment si j'avais chanté ». - (19) |
| raijotè : v. t. Rajouter. - (53) |
| raijouter (v.t.) : rajouter - (50) |
| rail (masc), voix (ex.: ce malade a encore bon rail ; ce qui est un indice de guérison). - (27) |
| râil, s. m., organe, voix, parole : « J'te réponds qu'on l'entend, c'tu-là ; ôl a eùn fameux râil. » - (14) |
| railemer : rallumer - (39) |
| railemer, v. a. rallumer, allumer de nouveau : « i vé rail'mer le feu. » (voir : ailemer.) - (08) |
| railentir (v.t.) : ralentir - (50) |
| raillâ, s.m. gros bâton. - (38) |
| raille (m), voix perçante. - (26) |
| râillè : crier très fort - (46) |
| raille, s. m. râle de genêt, autrefois assez commun dans le pays, plus rare aujourd'hui. - (08) |
| raille, s. m. voix, parole : il a un bon « raille », une forte voix. - (08) |
| râille. Autre nom de la rainette. Un vieux proverbe dit : « quand les râilles chantent avant Pâques, il fera froid quarante jours après ». - (49) |
| raille. Voix suraiguë des enfants qui crient, des commères qui se disputent. Etym. introuvable. - (12) |
| railler : faire des rigoles - (43) |
| railleu : s. m. charrue à deux ailes. - (21) |
| raïlli v. Caqueter. - (63) |
| railli. Raillai, raillas, railla. Raille, comme qui dirait rialler. - (01) |
| râillon : raison - (48) |
| raîllotte : courtillière - (37) |
| râillotte, subst. féminin : crécelle. - (54) |
| raim, branche (D'où araimer, aramer, le soleil s'arame, se cache dans les branches ; au soulot raimant, au soleil couchant. Ce mot est de même provenance que cimer, remuer, s'agiter : ne cime pas ! ne fais pas un mouvement !). - (04) |
| raim, et rain, s. m., ramée, ramille, branchette. On dit un rain de balai, de fagot. - (14) |
| raim, n. masc. ; balai. - (07) |
| raim, rain (du latin ramus). s. m. Branche d'arbre, brin de fagot, houssine. Un rain de bois ou, simplement, un rain. - (10) |
| raim, s. m., morceau d'un fagot de charbonnette. - (40) |
| raim. Brin, morceau de bois ; le mot est peu usité seul, on dit un raim de fagot, un raim de balai. Etym. rameau, ramée. - (12) |
| raim. : (Dial.), rain (pat.). Du rég.latin ramum, rameau, fragment de branchage. Le mot raimaisse, petites branches, en est le diminutif. - Au figuré, raimaisse signifie aussi réprimande ; mais au propre, donné lai raimaisse, veut dire donner le fouet comme cela se pratiquait dans les écoles d'autrefois.- D'autre part, faire la ramasse ou rôtir le balai, c'était pratiquer un sabbat clandestin dans les bois pendant la nuit. - On appelait chevaliers de ramons, ramassiers et hérites (du latin hoereticus), ceux qui pratiquaient ce sabat. - (06) |
| raim’ner : redonner très bonne apparence, nettoyer minutieusement - (37) |
| raim’ner lai quyâsse, renyier lai qu’yâsse : vomir - (37) |
| raimaigé, remaij'né, vn. Attirer chez soi, amadouer (en mauvaise part). - (17) |
| raimaige, sm. ramage. - (17) |
| raimaiger, raimeuler : rassembler - (48) |
| raimairâs (n.m.) : ramassis d’objets sans valeur - (50) |
| raimaisins, sm. extrémités des branchages de tailles. Fagots légers. - (17) |
| raimaissè : v. t. Ramasser. - (53) |
| raimaisser (v.t.) : ramasser - (50) |
| raimaisser, v. a. ramasser. - (08) |
| raimânaizer : réemménager - (37) |
| raimasse, correction, réprimande... Un balai se disait remaice (du latin ramus) en Bourgogne, et les balayures s'appelaient dé remaissure. - (02) |
| raimassé, vt. ramasser. - (17) |
| raimasser : ramasser - (39) |
| raimasseuse, s. f. on donne encore quelquefois ce nom à la femme, sage ou non, qui préside officiellement ou officieusement à un accouchement, qui ramasse l'enfant au moment où il fait son entrée plus ou moins précipitée dans le monde. - (08) |
| raime (aine) : (une) perche à haricots, à petits pois - (37) |
| raimé (âte) : (être) fatigué - (37) |
| raimé (âte) : (se faire) disputer fortement - (37) |
| raime (d’lai) : (du) bois moyen coupé - (37) |
| raime (n.f.) : rame - (50) |
| raime : dispute reçue, remontrance - (37) |
| raime : fatigue - (37) |
| raime : rame - (48) |
| raime : rame, petite branche - (39) |
| raime, s. f. rame, ramée, branchage des arbres. dans le langage des bûcherons, la rame est tout ce qui reste de menu bois lorsque le moule est façonné. (voir : moule.) - (08) |
| raime. Rame. - (49) |
| raimender : grossir à nouveau - (48) |
| raimender : grossir à nouveau - (39) |
| raimender, v. a. rendre à quelqu'un la force, l'embonpoint, la santé. une mère « raimende » son enfant en le nourrissant bien. (voir : aimender, remender.) - (08) |
| raimerâ, s. m. goût ou odeur de sauvagine. se dit principalement de la chair des animaux qui habitent les bois. Le sanglier sent fortement le « raimerâ ». - (08) |
| raimeûler (v.t.) : rassembler - se raimeûler (v.pr.) : se rassembler - (50) |
| raimeûler : rassembler - (37) |
| raimeûlerie (n.f.) : assemblage, rassemblement - (50) |
| raimiau (n.m.) : rameau - (50) |
| raimiau, s. m. rameau, branche d'arbre. - (08) |
| raimiauler, v. a. réconcilier, rendre ami : les doux cousins étaient brouillés, mais on les a « raimiaulés. » (voir : aimiquiaule.) - (08) |
| raimielle (n.f.) : ravenelle des champs (aussi ramielle, ravoneau) - (50) |
| raimieûner, raipioûner : toussailler, être enroué - (37) |
| raimillon, s. m. petit rameau, menue branche. - (08) |
| raimogno : adj. De peu de valeur. - (53) |
| raimoignâ, raimougnâ, ramonâ, s. m. le ramoneur de cheminées est celui qui emploie le ramon ou balai fait de ramilles. (voir : raime.) - (08) |
| raimoingeou, s. m. celui qui remmanche les outils. On dit aussi « aimoingeou ». (voir : moinge.) - (08) |
| raimona, raimonou, sm. ramoneur. - (17) |
| raimoner : ramoner - (48) |
| raimouègner : ramener - (48) |
| raimouégnier : ramener - (39) |
| raimougnâ (n.m.) : ramoneur (aussi selon de Chambure : raimoignâ) - (50) |
| raimougner, raimouner, v. a. ramener : le troupeau est sorti, « raimougne-lu. » (voir : aimougner, mougner.) - (08) |
| raimouner, v. a. ramoner, nettoyer une cheminée avec le balai, avec un fagot, etc. (voir : raime.) - (08) |
| rain (n.m.) : baguette, tige - (50) |
| rain : Brin de bois d'une certaine grosseur. - (19) |
| rain : perche, tige bonne à faire un bâton. - (32) |
| rain, branchage, rameau... - (02) |
| rain, grosse branche de fagot. - (05) |
| rain, s. m. baguette, brin, rameau, verge, balai. (voir : roucher, tire.) - (08) |
| rain, sm. bâton, branche solide. Aitens, aitens ! que j'preune è rain po te gatouillé les épaules ! - (17) |
| rain. Branche d'arbre coupée. Vos devrins garder, pour chauffer le for les fagots lai qu'an y ai les pus gros rains. On devrait écrire raim : le radical latin est ramus.... - (13) |
| rain. Morceau de bois. Vieux mot. - (03) |
| raindzi : ranger, ruminer - (43) |
| raine : sorte de pierre friable, argileuse, que l’on extrait et que l’on épand de temps à autre dans les cours de fermes pour égaliser le terrain - (37) |
| rainette, n.f. crécelle. - (65) |
| rainette. Petite grenouille verte, rana rubeta. Nous appelons aussi rainette la crécelle, à cause de son bruit aigre et semblable au coassement de la grenouille. - (03) |
| raînettte, renotte. s. f. Petit lezard. (Béru, Annay-sur-Serein). - (10) |
| raing (qu'on prononce rain). s. m. Rang, rangée suite de bateaux attachés à la queue l'un de l'autre et marchant sous la direction d'un bateau maire (major). (Canal de Bourgogne, Laroche, Auxerre). - (10) |
| raingement (du) : rangement - (57) |
| raingi : ranger - (57) |
| rainmé, vt. ramer. - (17) |
| rainmeau, sm. rameau (du dimanche des rameaux). - (17) |
| rainmoné, vt. ramoner. - (17) |
| rain-néte, s. f., crécelle. Même source que rânote, le bruit de la crécelle imitant volontiers le coassement de la grenouille. — Les trois derniers jours de la semaine sainte, cet instrument peu harmonieux remplace les cloches « parties à Rome », et dans les mains des enfants sert à appeler les fidèles aux offices et principalement aux Ténèbres. — Dans la Franche-Comté, certains villages dénomment la rainette : cri-cri, ou bruyant. (V. Tartevéle.) - (14) |
| rain-nette (na) : rainette - (57) |
| rain-non, s. m., murmure, bruit confus de paroles. Quand le chat ronronne, il fait son rain-non. - (14) |
| rainon (n.m.) : bruit continu et exaspérant - (50) |
| rainon, s. f. bruit de paroles, colloque bruyant, bavardage à haute voix. - (08) |
| rainotte. n. f. - Rainette. - (42) |
| rainsin : s. m., raisin. - (20) |
| raintse, eurne : rangée - (43) |
| râïon, s. f. raison, motif, preuve, etc. « vos é râion », vous avez raison. « râjon. » - (08) |
| raïon, s. f., raison : « É-t-i godiche, c'tu-là ! ô n'a pas d'raïon de s'ensauver c'ment c'qui. » - (14) |
| raion. n. f. - Raison. - (42) |
| raïons (avoir des), loc., être en querelle, en dispute, en altercation : « N'li dis donc ran ; ôl a tôjor des raïons d'avou tout l’monde. » - (14) |
| raïouner, v. intr., raisonner, discuter. - (14) |
| raip’taic’er : réparer - (37) |
| raipatacher : raccommoder (des personnes) - (48) |
| raipatacher : raccomoder - (39) |
| raipatacher, v. a. rapetasser, raccommoder, surtout les bas que nous appelons « chausses. » - (08) |
| raipautot (n.m.) : roitelet (aussi rapoutot, rapétret) - (50) |
| raîpé : tondu à ras - (37) |
| raipéa, rappel, réclame. Dans le Châtillonnais, le rapeau c'est lorsque, entre deux joueurs, le jeu recommence parce qu'il y a eu un nombre égal de quilles abattues et qu'on renouvelle l'enjeu. On renvie au jeu, disent les paysans, c.-à-d. on y rappelle de nouveau deux joueurs dont les chances ont été égales... - (02) |
| raipea. : Réappel des joueurs quand il y a eu un nombre égal de quilles abattues. (Du latin reappellatio.) - Raipea se dit aussi de l'horloge qui répète les heures. - (06) |
| raipeire. Rapière, vieille épée. - (01) |
| raipetioti, v. a. rendre plus petit, diminuer. - (08) |
| raipeuce, s. f. raiponce, plante de la famille des campanulées, salade. - (08) |
| raipeulè, raip'lè : v. t. Rappeler. - (53) |
| raipeûrc’er, raic’mmoder : allonger, raccommoder - (37) |
| raipeûrtroç’ir : raccourcir - (37) |
| raipeutchiotti : rapetisser - (39) |
| raipiâ : adj. et n. Avare. - (53) |
| raipionner (v.t.) : se racler la gorge en toussant - (50) |
| raiponde : relier, réunir, abouter - (48) |
| raipondre : (rèpon:d' - v.tr.) rabouter, faire se rejoindre deux bords ou deux extrémités : par ex. joindre les deux bouts d' un lien, refermer une plaie ou une déchirure, d'où le sens de "raccommoder à la hâte ". - (45) |
| raipondre : v. t. Réunir. - (53) |
| raipondre, mettre bout à bout. - (28) |
| raipondre, v. ; rallonger une corde. - (07) |
| raipondre, v. a. rejoindre, joindre ensemble, mettre bout à bout, côte à côte, deux objets pour les réunir. - (08) |
| raiponeiller : raccomoder des guenilles - (39) |
| raiponse : (rèpon:s' subst. f.) ravaudage grossier. - (45) |
| raiponse : n. f. Réponse - (53) |
| raipoto : 1 n. m. Petit oiseau. - 2 adj. Se dit de quelqu'un de petit. - (53) |
| raipoto, homme de petite taille - (36) |
| raipôtot : petit bonhomme, petit oiseau, roitelet - (39) |
| raipotot, rapotot : petit enfant - (48) |
| raipoûniau : remontrance sévère - (37) |
| raipoupiner, v. a. nettoyer, parer, orner. - (08) |
| raipourtaule, adj. qui est d'un bon rapport, productif. Un champ, un pré, est bien « raipourtaule » lorsqu'il donne de fortes récoltes. - (08) |
| raipourter : rapporter - (48) |
| raipourter, v. a. rapporter, apporter de nouveau ou à nouveau. - (08) |
| raipoutot : roitelet (petit oiseau). (et aussi) le plus petit de la famille - (37) |
| raippel (n.m.) : rappel - (50) |
| raipporter : rapporter - (39) |
| raipreûprî (s’) : (se) rendre propre à nouveau, (se) laver, (se) « changer » - (37) |
| raipreûpri : remettre propre - (37) |
| raipropi : nettoyer - (48) |
| raip'tioti : rapetisser, diminuer - (48) |
| raiqueillon, s. m. avorton, enfant chétif ou mal conformé. - (08) |
| raiquéter (v.t.) : racheter, reprendre, rentrer en possession - (50) |
| raiquêter : récupérer - (48) |
| raiqueûillon : « reste » de nourriture médiocre - (37) |
| raiqueûlot : petit, malingre - (37) |
| raiqueuquingné, vt. acoquiner. - (17) |
| raiqu'modè : v. t. Raccommoder. - (53) |
| raishe : bande de terre. - (62) |
| raisin, n.m. grappe de raisin. - (65) |
| raisonabje, adj. raisonnable. - (17) |
| raisonnable : adj., de taille, de grosseur, de valeur raisonnable. Un cochon raisonnable. - (20) |
| raisonnabye (adj.m. et f.) : raisonnable - (50) |
| raisse : panier ovale. (E. T IV) - S&L - (25) |
| raisse, s. f., sillon double, tracé au moyen de six raies, pour l'ensemencement du maïs et des pommes de terre. - (14) |
| raisseurer (v.t.) : rassurer - (50) |
| raissi : adj. Rassis. - (53) |
| rait (on) : rat - (57) |
| rait, raite (n.m. et f.) : rat, rate (souris) - (50) |
| rait, raite : rat, souris, rate - (48) |
| rait, te, sm., f. rat, rate ; souris. - (17) |
| raitaujon, s. m. raton. - (08) |
| rait-bardot (on) : lérot - (57) |
| rait-bardot (on) : loir - (57) |
| raîtcheau (on) : râteau - (57) |
| raite (n.m. ou f.) : rat, rate - (50) |
| raite : souris (surtout des champs) - (37) |
| raite : souris ; voir rate. IV, p. 21-3 - (23) |
| raite : terme affectueux pour une enfant (« al’ y’ot mai s’tiote raite ! ») - (37) |
| raite : une souris - (46) |
| raîte : souris - (39) |
| raité, part. passé. mordu, rongé par les souris ; qui a le goût, l'odeur de rat, de souris. - (08) |
| raite, s. f. souris. Dans nos campagnes toute souris est une « raite », qu'elle soit ou ne soit pas la femelle du rat. - (08) |
| raité, vt. rater. - (17) |
| raitelée, discours... - (02) |
| raitelée. : Tout ce qu'on peut proférer de paroles quand on est animé. - Raitou, raitouse sont des expressions familières pour qualifier un jeune garçon et une jeune fille qui se recherchent. - (06) |
| raiter : chasser les souris (pour un chat) - (48) |
| raiter : rater, manquer - (48) |
| raiter : rater, prendre, pourchasser les souris - (39) |
| raiter, v. n. rater; prendre, pourchasser, détruire les souris : « i é eune bonne chaite, a raite bin », j'ai une bonne chatte, elle prend bien les souris. - (08) |
| raitiau : rateau - (37) |
| raitoler, v. a. atteler de nouveau : « a fau raitoler lé vaiches », nous allons « raitoler » nos bœufs. s'emploie au figuré pour relouer, reprendre du service. un domestique « se raitole » à son maître par suite d'une nouvelle convention. (voir : aitoler.) - (08) |
| raitore. Rature. - (01) |
| raitore. Souricière, ratière… - (01) |
| raitouére, s. f. ratière, piège à rats, souricière. - (08) |
| raitounée, sf. tournée de coups de bâton. - (17) |
| raitôyer, v. n. prendre les rats, les souris. Il faut un chat et des souricières pour « raitôyer » dans les maisons. (voir : raiter.) - (08) |
| raitôyon : petite souris - (39) |
| raivâge, s. m. ravage, désordre, bouleversement, confusion : « fére l' raivage », mettre tout sens dessus dessous. - (08) |
| raivâger, v. n. faire beaucoup de bruit, de brouhaha. - (08) |
| raivaine, sf. [ravine]. Pluie d'orage, averse isolée. - (17) |
| raivant : pente - (39) |
| raivât’lée : déclivité rapide dans un talus - (37) |
| raivaté : v. pr. Se répéter. - (53) |
| raivâter (v.t.) : gronder, faire du bruit - (50) |
| râivâter : disputer (en certains lieux : harceler) - (37) |
| raivâter, v. a. gronder avec bruit, malmener rudement, maltraiter. - (08) |
| raivauder (v.t.) : rabâcher, dire des choses inutiles - (50) |
| raivaûder : recoudre - (48) |
| raivauder, v. n. ravauder, dire des riens, des choses inutiles, des niaiseries, quelquefois rabâcher. - (08) |
| raivaudou, ouse, adj. et s. rabâcheur, celui qui parle à tort et à travers, sans suite, qui vagabonde dans son langage. - (08) |
| raivauler, v. a. ravaler, rabaisser, déprécier, villipender. - (08) |
| raive : rave - (51) |
| raive : Rave, raphanus sativus. « An sone les raives asseteut après machan » : on sème les raves aussitôt après la moisson. - (19) |
| raive, s. f. rave. notre région donne le nom de «chou-raive » au rutabaga. - (08) |
| raive, sf. rave. - (17) |
| raiveneai, s. m. radis ravenelle (raphanus raphanistrum). - (08) |
| raivi (on) : silo (à betteraves ou pommes de terre) - (57) |
| raivingné, vt. raviner. - (17) |
| raiviot : n. m. Pic de mineur à un seul côté. - (53) |
| raivivé, vt. raviver. Recoudre, repriser, réparer. - (17) |
| raiv'nais : ravenelle - (48) |
| raiv'née : n. f. Ravenelle. - (53) |
| raivnée, sf. petite averse. - (17) |
| raivoler (v.) : rabattre, courber (étym. : provient de ravaler) - (50) |
| raivoler, v. a. ravaler, rabattre, courber, incliner. (voir : aivoler, deroler.) - (08) |
| raivou (n.m.) : lérot, loir - (50) |
| raivou, raibaîrdot, raibaîrdâs : loir, lérot - (37) |
| raivouâ, v. a. ravoir, avoir une fois de plus. - (08) |
| raivouillote : n. f. Mauvaise herbe. - (53) |
| raivouseu, loir, rat qui mange les fruits. - (27) |
| raivout, ravou : n. m. Loir. - (53) |
| raiz’ter (y) : (y) racheter une seconde fois - (37) |
| raize : rage - (39) |
| raizeûster : rajuster - (37) |
| raizeûtants d’goûter (dâs) : (des) reliquats du repas de midi - (37) |
| raizeûter (y) : (y) demeurer, n’en pas bouger - (37) |
| raizeûteûre (aine) : (un) morceau d’étoffe cousu pour allonger - (37) |
| raizoûter (en) : (en) ajouter - (37) |
| rajaquer, v., récupérer au vol ; se rajaquer, prévenir une chute. - (40) |
| rajeûni : rajeunir - (57) |
| rajeuni : Rajeunir. « T'as fait coper ta barbe y t'a rajeuni de dix ans ». - (19) |
| rajeuster : Rajuster. « Y a été bien rajeusté ». - (19) |
| râjignée, s. f. treille de vigne. - (08) |
| ràjin, s. f. raisin. - (08) |
| rajon, rason, sf. raison. - (17) |
| râjon, s. f. raison. (voir : râïon.) - (08) |
| râjouner, v. a. raisonner. - (08) |
| râjouneu, euse, adj. raisonneur, euse, celui ou celle qui raisonne, qui use de raisonnement. - (08) |
| rakeulot : n. m. Petit - (53) |
| rakeurveuilli v. Ratatiner. - (63) |
| râkié, racler ; râkyure, ce qu'on ôte en râclant. - (16) |
| râkyë, volée de coups. - (16) |
| râle, ée (pour raîle, de raie). partic. p. et adj. Rayé. – On dit substantivement, à Auxerre, une râlée de soleil. Voyez raidée. - (10) |
| râle. n. f. - Rafle : ce qui reste d'une grappe de raisin, une fois les grains enlevés. - (42) |
| râle. n. m. - Rainette. (Saint-Sauveur, selon M. Jossier) - (42) |
| rale. s. f. Râfle, grappe de raisin dont les grains ont été détachés. - (10) |
| râle. s. m. Rainette, sorte de petite grenouille. (Saint-Sauveur). - (10) |
| r'aler, v. intr., aller de nouveau : « J'avions à r'vouér la p'tiote cheû sa grand' ; j'y sons r'alés. » — « J'n'ai pu mau au genò ; je r’vas à l'écòle. » - (14) |
| raleumer : rallumer - (43) |
| rallondzi : rallonger - (43) |
| rallondzi v. Rallonger. - (63) |
| rallonger : reculer l'arrière-train - (46) |
| ralon. n. m. - Petit morceau de branche, mal élagué, dépassant du tronc. (Villiers-Saint-Benoît, selon M. Jossier) - (42) |
| ralon. s. m. Chicot sur la tige d'un arbre mal élagué. (Villiers-Saint-Benoît). - (10) |
| ralouer, v. a. louer, amodier de nouveau. On « raloue » un champ, un pré, une ferme, un domestique. - (08) |
| ralu (adj.) : rugueux - (64) |
| ralu : non lisse, rèche. (P. T IV) - Y - (25) |
| ralu, ue. adj. - Plusieurs usages : 1. Rêche, rugueux, desséché : des mains ralues. 2. Bourru, brutal. 3. Personne mal vêtue, au physique ingrat, n'inspirant pas confiance.( M. Jossier, p.l07) - (42) |
| ralu, ue. adj. Se dit d'un arbre noueux, dont les branches contournées manquent de symétrie. – Se dit aussi de tout individu aux habits râpés, au visage fruste, disgracieux, mal venu. – On l'emploie quelquefois substantivement. C'est un ralu. - (10) |
| raluchon. s. m. Enfant chétif et malingre. Diminutif de ralu. - (10) |
| Ramagé : nom de bœuf. III, .p. 29-o - (23) |
| ramai : (nm) balais d’écurie - (35) |
| ramai : balai - (43) |
| ramai : Balai. « In ramai de bouis » : un balai de buis. - (19) |
| ramai, s. m. balai. Verbe ramaichi (du vieux français ramas). - (24) |
| ramaichi : v. balayer. - (21) |
| ramaiser. v. - Calmer, détendre. Se ramaiser, se calmer. - (42) |
| ramaiser. v. a. Calmer, apaiser, réconcilier. (Grandchamp, Rogny). – Se ramaiser. v. pron. Cesser de crier, de pleurer, en parlant d'un enfant. (Villiers-Saint-Benoît). - (10) |
| ramaisseuse : sage-femme. - (32) |
| ramas, ramais : s. m., vx fr. ramasse, balai. - (20) |
| ramasser : v. a., amasser, récolter. - (20) |
| ramasser : v. a., vx fr. ramassier, balayer. V'Ià que l’ blé est temps d' battre ; i faut ramasser le seuil. - (20) |
| ramasser, v. cueillir, glaner. - (65) |
| ramasser, v., nettoyer (un plat, par exemple). - (40) |
| ramassi : balayer - (57) |
| ramassi : ramasser - (51) |
| ramâssi : ramasser - (57) |
| ramassi les épis expr. Glaner. Voir yienner. - (63) |
| ramassi v. Ramasser, cueillir. - (63) |
| ramati : ramollir - (51) |
| ramâti, adj., imprégné de brume, le matin. - (40) |
| rambarrai, faire des reproches à quelqu'un sur sa conduite ou sur ses discours... - (02) |
| rambarré. : Faire des remontrances à quelqu'un, comme un juge à un justiciable à la barre. Le même mot s'emploie en Picardie. - (06) |
| rambeuillot (n.m.) : cordon ombilical; (de chambure note lambeillot) - (50) |
| rambeuillot. Nombril. - (49) |
| rambille (la), rambillot (le) : le nombril. - (56) |
| rambillonner, v. a. se dit d'une chose qui rentre dans le corps dont elle fait partie. - (08) |
| rambillot, n.m. nombril. - (65) |
| rambillot, s. m. nombril. (voir : lambeillot, nombeillot.) - (08) |
| rambillot, subst. masculin : nombril. - (54) |
| rambillot. s. m. Nombril. (Monades). - (10) |
| rambôr, s. f., rambour, sorte de pomme originaire de Rambures, territoire d'Amiens. (V. le Glossaire des Noëls Bourguignons.) - (14) |
| rambor. Rambour, sorte de pomme ainsi nommée de Rambures, dans le territoire d'Amiens, où ces pommes ont commencé à être connues… - (01) |
| rambrunchai. : Qui a un mécontentement intérieur, qui fait la moue. - Du latin bronchus, expression avec laquelle Plaute qualifie un personnage dont la bouche fait saillie. (Quich.) - (06) |
| rambruncher. Faire des reproches, corriger. Te veux li jeter des piârres ? Aittends, aittends ! I vas le rembruncher. C'est le synonyme de révâter. (V. ce mot). On prétend que c'est un terme de drapier : « rubrocher, apprêter la pièce de drap avec des broches ou baguettes de fer. » - (13) |
| rame de fond : s. f., longue rame terminée par un double crochet de fer. - Voir épaillette. - (20) |
| ramé n.m. Balai de cour fait de rameaux. - (63) |
| rame : long morceau de bois assez fin, plutôt flexible. Ex : "Les vaches du pée Julette atint dans mon pré ! Mon gamin les a fait sorti avec ène rame. Al' dalaient ben !" - (58) |
| Ramé, nom de bœuf. - (08) |
| rameau : buis. En raison de l’utilisation de branches de buis dans la cérémonie religieuse des Rameaux. - (62) |
| ramée : Une certaine largeur de terrain, planche. « J'ai sonné (semé) eune ramée d'ôrge dans ma tarre » - (19) |
| ramée. n. f. - Abri rudimentaire, constitué de branches. Ce mot utilisé en France jusqu'au XIXe siècle, est issu de «rame», branche d'arbre. On le retrouve aujourd'hui dans les expressions « rames de haricots », et « ne pas en fiche une ramée ». - (42) |
| ramée. s. f. Espèce de tente formée de perches et de branches d'arbres garnies de leur feuillage vert, qui, dans les assemblées champêtres et les foires, sert à abriter les buvettes et les restaurants rustiques. (Sommecaise). - (10) |
| ramendever (se), v. pr., se rappeler, se remémorer. - (14) |
| ramenoux : On appelle ainsi le garçon qui après avoir dansé au bal public accompagne sa danseuse et la ramène chez elle. « La Marie n'avait point de ramenoux dimanche ». N'avoir pas de « ramenoux » est presque un affront, car « c'est le triste lot des filles dédaignées, de revenir du bal sans être accompagnées ». (Poésie de Buchot). - (19) |
| râmer (se) v. Se garnir de nuages. Le cié s'râme. - (63) |
| râmer : ramer - (57) |
| ramer les poissons, locution verbale : pêcher à la ligne. - (54) |
| ramer, verbe transitif : gronder, engueuler. - (54) |
| ramessi, r'messi : balayer - (43) |
| ramette : s. f., rainette verte (hyla viridis). - (20) |
| rameûre (na) : rame - ramure (tuteur) - (57) |
| rameure : Rame, petite branche qui sert de soutien à certaines plantes grimpantes telles que pois, haricots. « J'ai été au beu charchi in fagueut de rameures ». - (19) |
| ramiâ, s.m. rameau. - (38) |
| ramiaû (on) : buis - (57) |
| ramiau : Rameau de buis bénit à la messe du dimanche des Rameaux. Naguère on allait en procession le jour des Rameaux, chaque fidèle tenant à la main sa petite branche de buis et aux enfants on donnait un rameau agrémenté d'une belle pomme à travers laquelle il semblait avoir poussé. - (19) |
| ramiau, s. m., rameau, petite branche feuillue. - (14) |
| ramiauler, v. tr., rendre amis, réconcilier : « J'les ons invités, é pi j'Ies ons ramiaulés. » Dans la première moitié du mot on trouve un réduplicatif d'ami (r'ami). - (14) |
| Ramiaux (les) Les Rameaux. Alle a fété Pâques dvant les Ramiaux ! Elle n'a pas attendu le mariage pour le consommer. - (63) |
| ramieau (on) : rameau - (57) |
| ramièle : ravenelle, sanve. A - B - (41) |
| ramielle : (nf) ravenelle, « herbe à lapin » - (35) |
| ramielle : (nf) sanves - (35) |
| ramielle n.f. Moutarde sauvage, ravenelle. - (63) |
| ramien : romanichel - (61) |
| ramier. n. m. - Emplacement à l'intérieur de la maison où l'on entrepose le bois de chauffage. Même origine que ramée : la rame était une branche en ancien français. - (42) |
| ramier. s. m. Dans la Puysaie, endroit de l'habitation ou le paysan amoncelle les branchages qui doivent servir à son chauffage journalier. - (10) |
| ramillot : Même sens que rameau dont ce mot est un diminutif ramochi : Murmurer de mécontentement. - (19) |
| ramimioner, v., faire des minauderies. - (40) |
| ramioder : réconcilier - (51) |
| ramioller : rassembler. (BY. T IV) - S&L - (25) |
| ramioner (v. int.) : se racler la gorge – grommeler, ronchonner - (64) |
| ramiôner, v., rouspéter sans motif. - (40) |
| ramiouler (pour remiauler). verbe n. Aboyer. (Sainpuits). - (10) |
| ramiouler v. Geindre perpétuellement. - (63) |
| ramiouler. v. - Aboyer. (Sainpuits, selon M. Jossier) - (42) |
| ramiouner : rabâcher - (44) |
| ramiouner. Miauler. Fig. Se plaindre en marmottant pour exprimer son mécontentement. - (49) |
| ramlœ (les), s. m. pl. les Rameaux. - (22) |
| ram'ner : ramener - (57) |
| ramnuseret : musaraigne. A - B - (41) |
| ramò, s. m. balai. - (22) |
| ramocher : v. n., ronchonner. - (20) |
| ramœt’e, s. f. crécelle. - (22) |
| ramœt'e, s. f. crécelle. Bavardage. - (24) |
| ramolli : ramollir - (57) |
| ramon. Ancien nom du balai, d'où ramoner. On dît aussi remesse et ermesse. Voici un curieux proverbe, rapporté par G. Meurier : Du neuf ramon - La femme nettoie sa maison - Et du vieil, bat son baron. A Valenciennes, le gui est appelé ramon de sorcière. - (13) |
| ramonances, sf. fatras, haillons, débris inutilisables. - (17) |
| ramoner : rabâcher. - (66) |
| ramoniquin. s. m. Rémouleur. (Armeau). - (10) |
| ramou : (arbre) branchu - (35) |
| ramou : branchu (arbre) - (43) |
| ramouai (on) : balai - (57) |
| ramouègnâs : longue branche touffue dont l'extrémité est parfois garnie de houx et servant à ramoner les cheminées - (48) |
| ramouègnâs : ramoneur - (48) |
| ramouèner : v. ramener. - (21) |
| ramougnat : ramoneur. - (32) |
| ramougniât : ramoneur. - (62) |
| ramoulé, repasser sur la meule pour aiguiser. - (16) |
| ramouna : ramoneur - (39) |
| ramounà, et romonâ, s. m., ramoneur : « On entend l’ramound chanter. Gare ! y é l'hérondale d'hivar. » - (14) |
| ramouna, ramona. Petit ramoneur. - (49) |
| ramouner, et r'mouner, v. tr., ramener : « Veins, veins, p'tiot drôle, j'vas tramouner cheû vous. » - (14) |
| ramouner, v. tr., ramoner : « Pour pas mett' le feù à ta ch'vinée, faut la fâre ben ramouner. » - (14) |
| ramouner. Ramoner. - (49) |
| ramouner. v. - Ramoner. - (42) |
| ramouneux. n. m. - Ramoneur. - (42) |
| ramouniâ, s.m. ramoneur. - (38) |
| ramoure : s. f. rame (pour haricots). - (21) |
| rampau (être) : être à égalité après un jeu donc en rappel. - (62) |
| rampau n.m. Egalité aux dés, aux cartes ou aux billes. - (63) |
| rampeaux : ex -aequo. - (66) |
| rampener : soufrer bruyamment, difficilement - (43) |
| rampignolle, s. f. bordure de mortier le long des toitures. - (08) |
| rampignolles : parties du haut d'un pignon - (39) |
| rampiner : v. n., syn. de rancaisser. - (20) |
| rampiner, v., respirer avec peine, avec des bruits importants et de l'encombrement. - (40) |
| rampion, rancot, ranchon, rouillasse, royesse ,royasse, reutse n. f. (du v. fr. resque, rêche). Enrouement, râle. - (63) |
| rampli. Rempli, remplis, remplir. - (01) |
| rampnée : souffle fort. Personne essoufflée. A - B - (41) |
| rampner v. (dérivé du francique hrampon, grimper avec des griffes). Tousser d'une toux grasse, respirer bruyamment. - (63) |
| rampô (être), être à égalité dans un jeu. - (40) |
| rampô, adj. égal, dans la même situation ; à Buxy : rapô. - (38) |
| rampone. : (Dial. et pat.), reproche, raillerie. - (06) |
| ramuseret : musaraigne - (43) |
| ran : rien - (43) |
| ran : rien - (44) |
| ran : rien - è mé ran beillè, il ne m'a rien donné - (46) |
| ran : rien - (48) |
| ran que, loc., rien que : « Ô n'm'a beillé ran que c'qui. » - (14) |
| ran : pron. indéf. Rien. - (53) |
| ran : rien - (39) |
| ran, adv. rien. - (17) |
| ran, ind., rien. - (40) |
| ran, rien. - (05) |
| ran, rien. - (26) |
| ran, rien. Si l'on veut payer à un homme charitable un service qu'il a rendu : s'n'â ran, ce n'est rien, dit-il, pour témoigner le plaisir qu'il éprouve d'avoir rendu ce service. Pour qualifier un vaurien, l'on dit que s'â ein ran ki vèye, un rien qui vaille ; ran ke s'ki, seulement cela ; ran k’an le r’gairdan, i li fé peu, seulement en le regardant, je lui fais peur ; s'â ein ran du teu, c'est un rien du tout. Rien que, rien qu'en, non français, se disent même par ceux qui d'ordinaire parlent français. - (16) |
| ran, s. m. rien, nulle chose : « i n'é pu ran », je n'ai plus rien. « rin. » - (08) |
| ran, s. m., rien : « Te n’vaux ran ! » — « Je n'te dois ran ! » - (14) |
| ran. Rien. C'est aussi l'impératif de rendre, et le singulier des trois personnes du même verbe au présent de l'indicatif. Il signifie encore rang, ordre, etc. « Chécun en son ran », chacun en son rang. - (01) |
| ran. Rien.. - (13) |
| ranbârë, ranbouré quelqu'un : le reprendre avec des paroles dures d'un mal qu'il a fait ou voudrait faire. - (16) |
| ranbarré, v. a. contredire sèchement et méchamment. - (22) |
| ranbrassé, embrasser, baiser. - (16) |
| ranbrunchay, qui a un air mécontent. Dans l'idiome breton, rambréez signifie rêveur. (Le Gon.) ... - (02) |
| rancagi : Râler. « An l'entendait rancagi ». - (19) |
| rancailler, v. respirer difficilement avec une gêne accrue. - (65) |
| rancaîller, v., respirer avec une gêne accrue. - (40) |
| rancaisser : n, v. n., bas-lat. rancare, faire entendre un bruit de rancot. - (20) |
| rancart (au) : plus bon à rien - (37) |
| rancart. s. m. Sorte de râtelier fixé le long d'un mur et dans lequel sont plantées des chevilles auxquelles on suspend les objets inutiles ou qui ne servent plus. Mettre au rancart, c'est donc mettre au rebut ; se dit au propre et au figuré. (Un peu partout). - (10) |
| rancasè : respirer difficilement et bruyamment, on utilise aussi les mots recâsè et rencâillè - (46) |
| rancaser, agoniser avec sterteur. - (05) |
| rancâser, et rancasser, v. intr., jeter les derniers souffles, râler. Se dit de l'agonisant qui respire avec peine et suffoque : « Ol é ben prô d'pâsser ; ô rancâse. » - (14) |
| rancâsser, rancàsser (Chal.), rancôsser (C.-d.), ranquener {Morv.). – Râler ; a la même origine que rancòt. - (15) |
| ranche : la pièce en bois qui sert à tenir les planches d'un chariot - (46) |
| ranche : ligne de travail aux champs, laissée par le piocheur, planteur, cueilleur, coupeur… - (62) |
| ranche : Ligne, rangée. « Eune ranche de gaumais » : un rang de ceps de Gamay. - (19) |
| ranche : ridelle. - (09) |
| ranche : s .f. rangée de ceps. - (21) |
| ranche, ranchée, range : s. f., rangée. Une ranche de peupliers. De ranche, Ioc., d'affilée, de suite. - (20) |
| ranche, s. f. un des petits poteaux mobiles qui retiennent les ridelles d'un chariot. (voir : aifroinche.) - (08) |
| ranche. n.f. - Rangée: une ranche de blette. - (42) |
| ranche. s. f. Rangée. (Saint-Martin-sur-Ouanne). - (10) |
| ranchée, et rangie, s. f., rangée : « Eùne ranchée d'âbres, eùne rangie d'mâïons. » - (14) |
| ranches (n.f.pl.) : petits poteaux mobiles qui retiennent les ridelles d'un char - (50) |
| ranchie, s. f. rangée, succession de choses mises en rang : une « ranchie » de gerbes, une « ranchie » d'arbres, etc. en quelques lieux « rancie : « aine bielle rancie d' çâgnes », une belle rangée de chênes. - (08) |
| ranchner v. Tousser. Voir rembeuter, teurèler, teuraler, rampner. - (63) |
| ranchon (n.m.) : enrouement (aussi rinchon) - (50) |
| ranchon Voir rampion. - (63) |
| ranchot, rangée, casier. - (05) |
| ranchou n.m. Renfermé (odeur), rance. Y chint l'ranchou. - (63) |
| rancné, vn. racler du nez et de la gorge. Ronfler. Se dit aussi des hoquets des agonisants. - (17) |
| ranco, râle des mourants. - (16) |
| ranco, s.m. enrouement. - (38) |
| ranco. Enrouement. - (03) |
| rancœur, dégout. - (04) |
| rancôrsî, v. tr., raccourcir. - (14) |
| rancôssai, avoir le râle, étouffer, respirer avec bruit. Dans l'idiome breton, ronkella signifie râler... - (02) |
| rancôssai. : A voir le râle, étouffer. Du latin rancare, qui s'applique au mugissement sourd du tigre. (Quich.) - Être au ranco, signifie, à Genève, être à l'agonie. (Gloss. gen.) - (06) |
| rancot (avoir le), avoir une gêne respiratoire terminale. - (40) |
| rancot (avoir le), n.m. respirer avec une gêne terminale, râler en parlant d'un mourant. - (65) |
| rancòt (C.-d., Br., Chal., Char.), rangòt (Morv.). - Enrouement, râle. Guillemin donne de ce mot curieux plusieurs étymologies latines : runculare ronfler ; raucus rauque, d'où voix rauque ; raucire et raucari enrouer. Chambure et Cunisset-Carnot préfèrent le vieux français rancor, rancoeur, et Delmasse revient à raucare, dans le sens de râler, qui a fait le mot rauque et le verbe rauquer, lequel se trouve dans Littré, mais non dans le dictionnaire de l'Académie. Cette dernière explication nous paraît la bonne. - (15) |
| rancot : enrouement. Avoir le rancot : avoir du mal à respirer et à parler. - (62) |
| rancot n.m. (du lat. raucus, être enroué, v.fr. rauquer, être enroué). Voir rampion. - (63) |
| rancot : s. m., râle, enrouement. S'emploie aussi adjectivement. J’ suis rancot, veut dire : Je suis enroué. - (20) |
| rancot, enrouemcnt, respiration d'agonie. - (05) |
| rancot, rinchon. Rhume, toux avec enrouement de la voix. - (49) |
| rancòt, s. m., enrouement, respiration de moribond : « J'ai évu frèd, à c'maitin, é pi v'là qu'j'ai l’rancòt ! » - (14) |
| rancot. Ce mot me paraît être une onomatopée : - (13) |
| rancot. Hoquet, râle, tout bruit de la gorge. Etym. le vieux français rancor (avec apocope de l’r), rancœur, dégout, soulèvement du cœur, breton ronkell ; mot voisin ronchonner. - (12) |
| rancoter, v., respirer, râler (en parlant du mourant). - (40) |
| rancoû, adj., qui a le rancòt, enroué dangereusement. - (14) |
| rancou, enroué. - (05) |
| rancoux, rancouse : adj., qui rancaisse. - (20) |
| rancueûne, s. f., rancune, animosité. - (14) |
| rancueûnoû, adj., rancunier. - (14) |
| rancuneux. Rancunier. - (49) |
| randalle : Rondelle. « Eune randale de seucissan ». - (19) |
| randar : n. m. Passe-partout - (53) |
| rande, s. f. baguette, bâton servant de mesure : une rande à planter de la vigne. - (24) |
| rande, s. f. baguette, bâton servant de mesure. - (22) |
| randelatte : Lierre terrestre, glechoma hederacea. « Eune infusian de randelatte », employée pour les rhumes et les affections de la poitrine. - (19) |
| randiau : Rond, halo. « La lune a in biau randiau, je sins bin seurs d'avoi de la pliô ». - (19) |
| randiau, s. m. halo autour du soleil ou de la lune. - (22) |
| randin : Objet de forme cylindrique. « In randin de châgne ». Ronde que les enfants accompagnent de la formule : « Randin picotin, la Marie a fait san pain, pas pu greux que san levain, pî ! », sur cette dernière syllabe point d'orgue et les enfants s'accroupissent. - (19) |
| randoner, v. intr., gronder, être de mauvaise humeur : « L'pauv'vieux, ô n'é pas émusant ; y é si sôvent qu'ô randone. » - (14) |
| randzi : ranger - (51) |
| ranfermi, raffermir ; une chair malade qui se guérit se ranfermi. - (16) |
| ranflier : Ronfler. « Pas pus teut qu’ol a la tête su le c'euchin o se ment à ranflier ». - (19) |
| ranfraichi. Rafraichi, rafraichis, rafraichir… - (01) |
| ranfrôchî, v. tr., rafraîchir : « Alle obliòt de m'rende mes sous ; j't'li ai ranfròchi la mémouére. » - (14) |
| ranfrôchissement, s. m., rafraîchissement, refroidissement. - (14) |
| range : Nom féminin, ronce. « In bochan de ranges » : un roncier, voir anan. - (19) |
| ranger, v. ruminer. - (65) |
| ranger, v., remuer, secouer. - (40) |
| ranger. Se dit pour ruminer ; mâcher une seconde fois. - (49) |
| rangi : Ranger. « Ses affâres sant tojo bien rangies ». Mettre de côté. « Ol a fini pa rangi eune grosse borse ». - (19) |
| rangi, v. a. 1. réparer, raccommoder faire rangi une montre. – 2. Ranger. — 3. Garer. - (24) |
| rangot, s. m. racine qui sort de terre, racine des genêts ou autres arbustes coupés dans les pâturages mis en culture : un champ plein de « rangots. » les « rangots » empêchent de faucher les blés parce qu'ils font obstacle à la faux. - (08) |
| rangot, s. m. râlement, râle : les « rangés » d'un mourant, d'un homme à l'agonie. - (08) |
| rangot: (ran:go - subst. m.) moignon de petite branche, sur une bûche ou tout morceau de bois coupé, en quoi il faut le distinguer de tan:co (voir ce mot). - (45) |
| rangoyi : essouffler, rendre son dernier soupir. A - B - (41) |
| rangoyi, rampné : essoufflé, soupirs - (43) |
| ranguëné ; ranguëné së compliman ; ne pas laisser dire à quelqu'un quelque compliment sot, inutile, est lui faire ranguëné së compliman. - (16) |
| ranguëné, redite ennuyeuse pour ceux qui l'entendent : s'â teûjo lai mènme ranguëne. - (16) |
| ranguener : (rank'nè - v. neutre) se râcler la gorge. - (45) |
| rangueûgner, v. intr., être colère, mais en dedans ; garder les vilains mots qu'on voudrait dire aux autres, mais qu'on ne dit qu'à soi tout seul : « Je n'sais pas c'qu'ôl a ; ma ô rangueùgne tô l'temps. » - (14) |
| rangueûgnoû. adj., qui gronde intérieurement. - (14) |
| ranlargî,v. tr., rélargir : « Not'fonne m'a ranlargi mes jambes de cueùlòte. » - (14) |
| ranmanché, mettre un nouveau manche à un outil. - (16) |
| ranmené, ramener; i l’ranmeune, je le ramène. - (16) |
| rannées, s. f. années. On prononce ran-née comme an-née. (voir : renfans, reux, rieux.) - (08) |
| rànôte, s. f., rainette, petite grenouille verte. - (14) |
| rânotte : têtard (voir queue de pouééle). VI, p. 9 - (23) |
| ranpiné, v. n. faire entendre un sifflement faible, aigu et rythmé au cours de la respiration. - (22) |
| ranpiner, v. n. faire entendre un sifflement faible, aigu et rythmé au cours de la respiration. - (24) |
| ranpli, remplir ; é fô l'ranpli, il faut le remplir, en parlant, par exemple, d'un fût de vin en vidange ; ranplissure, ce qui sert à remplir. - (16) |
| ranquaiser, v. n. respirer avec un bruit de borborygmes (du bas-latin rancare). - (24) |
| ranque : seulement, rien que … - (48) |
| ranque : seulement, uniquement. I veux ranque la paix : je ne veux que la paix. - (33) |
| ranque : adv. Rien que, seulement, uniquement. - (53) |
| ranquednou, ouse, adj. rancuneux, qui a de la rancune, du ressentiment. - (08) |
| ranquener, râler, bruit que fait une personne très malade en respirant fort et difficilement comme dans l'agonie. - (27) |
| ranquener, v. ; faire entendre le râle de la mort. - (07) |
| ranqueune, s. f. rancune, ressentiment, animosité. - (08) |
| ranqueuner, parler de la gorge. - (28) |
| ranqueuner, v. n. râler. Se dit d'une personne à l'agonie. (voir : enrauguer.) - (08) |
| ranqueusai, accuser, dévoiler quelque chose ; en latin rem accusare... - (02) |
| ranqueut : Enroué, enrouement. « Y a langtemps qu'ol a le ranqueut » : il y a longtemps qu'il est enroué. - (19) |
| rantanteu (sans doute pour retenteu). s. m. Flûte d'écorce de noisetier. (Festigny. – Rantantou, à Domecy-sur-Cure). - (10) |
| rantre : Rompre. « San sabeut est rantu ». - (19) |
| ranverdi, reverdir ; un champ desséché ranverdi après la pluie. - (16) |
| ranvers, versant escarpé d'une montagne, généralement à l'exposition du nord et peu propice à la culture. - (11) |
| rapa : râpé. (S. T IV) - B - (25) |
| rapâïer, v. a. apaiser, calmer et quelquefois reconcilier. (voir : apâïer.) - (08) |
| rapan : Partie qui adhère au fond d'un récipient quand la cuisson a été trop forte. Lorque les fruits qu'on distille prennent au fond de l'alambic et brûlent ils forment un « rapan » qui donne un mauvais goût au produit de la distillation, on dit alors que l'eau de vie a un goût de « rapan ». - (19) |
| rapance : Ce qui sert à rallonger. « An va y mentre eune rapance ». - (19) |
| rapandre : Rallonger. « La corde du pouits est treu corte y faudra la rapandre ». - (19) |
| rapapilloter (se), v. réfl., se remettre en meilleur état. Peut se prendre au physique et au moral. - (14) |
| rapapilloti (se) v. Se réconcilier. Voir rabobéchi, raccorder, rapatrier. - (63) |
| rapaqué, v. a. rattraper en l'air adroitement : attention, rapaque ! - (22) |
| rapaquer v. Rattraper au vol. Voir paquer. - (63) |
| rapaquer : v. a., attraper au vol. Voir paquer. - (20) |
| rapaquer, v. a. rattraper en l'air adroitement : attention, rapaque la pomme ! - (24) |
| raparmer (v.t.) : épargner, économiser - (50) |
| rapatafiole (te), t'emporte (le diable) - (36) |
| rapatafioler, v. tr. N'est à peu près uniquement employé que dans cette locution : « L'bon Diou t’ratafiole ! » c'est-à-dire te bénisse ! Se dit ironiquement à quelqu'un qui vous ennuie. - (14) |
| rapatassé : Rapetassé, rapiécé. « Ses habits sant tot rapatassés ». - (19) |
| rapatassi, rapatassonner : (vb) rapiécer - (35) |
| rapatauder. Raccommoder grossièrement. - (49) |
| rapatéchi v. Rapetasser. - (63) |
| rapatéchi, v. a. raccommoder pièces sur pièces, avec des « pates ». - (24) |
| rapatéssi, v. a. raccommoder pièces sur pièces, avec des « pates ». - (22) |
| rapatrier (se) v. Se réconcilier. Voir rapapilloti, rabobéchi, raccorder. - (63) |
| rapatter (se). v. - Se démener. (Mézilles, selon H. Chéry). Savoir se servir de ses jambes, de ses pattes. (Perreuse, selon M. Jossier) - (42) |
| rapatter (Se). v. pron. Savoir se servir de ses pattes, se rattraper aux branches. (Perreuse). – Se dit au propre et au figuré. - (10) |
| rapautau : roitelet. Terme de mépris pour un homme de piètre apparence. - (52) |
| râpe (aine) : (un) bavard, (un) raseur - (37) |
| râpé : volé - (37) |
| rapé ! (y’ot) : (c’est) terminé ! (c’est) fichu ! - (37) |
| râpe, râquiotte : racloir - (48) |
| râpe, s. f. rafle : faire « râpe », rafler, prendre tout, ne rien laisser : cet homme-là a une bonne « râpe », c’est à dire prend tout ce qu'il peut prendre. - (08) |
| râpe, s. f. vieux hêtre couronné, grosse souche d'arbre en général. dans quelques localités du une « râpe » est un baliveau de réserve et toujours un hêtre. Le chêne de même âge ne porte pas ce nom. - (08) |
| râpe, s. f., crochet au long manche pour tirer la braise du four. - (14) |
| râpé, s. f., piquette faite avec du raisin, sur lequel on verse de l'eau. Du tonneau on tire jusqu'à épuisement. Alors, sur le même raisin on reverse des seaux d'eau, et l'on obtient un faible diminutif de la première piquette. - (14) |
| râpe, s. m. crochet de fer qui a un long manche et dont on se sert pour retirer la braise du four : « peurné l’ râpe, l' pain ô keu », prenez le râpe, le pain est cuit. (voir : agraper, grapiner, râper.) - (08) |
| rape. adj. - Plein, à ras bord, en parlant d'un récipient. (Mézilles, selon H. Chéry) - (42) |
| rapeau (C.-d., Chal., Morv.), raipiâ (C.-d.). - Egalité au jeu, pour rampeau, qui, suivant Littré, s'applique à une partie de quilles, se jouant d'un seul coup, et désigne également le second coup d'une partie se jouant en deux coups. Dans le langage des joueurs de quilles, faire rapeau ou rampeau signifie abattre le même nombre de pièces, c'est-à-dire être égal à son adversaire. L'étymologie se trouve probablement dans le réappel auquel cette égalité donne lieu. Se dit aussi d'une horloge qui répète les heures. - (15) |
| rapeau, 2e coup d'une partie de quilles. - (04) |
| rapeau, s. m. dans le langage des joueurs de quilles, faire rapeau signifie que le joueur a abattu le même nombre de pièces que son adversaire. - (08) |
| ràpeau, s. m., appeau. Jeune oiseau dont on se sert pour attirer les autres. Petit instrument qu'on met dans sa bouche (à soi, bien entendu), et à l'aide duquel on imite le chant des oiseaux. - (14) |
| râpée (n.f.) : crêpe aux pommes de terre râpées - (50) |
| râpée : crêpe à base de pommes de terre râpées et de lait caillé. - (52) |
| raper : élaguer une haie, sarcler la mauvaise herbe. A - B - (41) |
| râper : nettoyer - (61) |
| râper : tailler le côté des buissons - (51) |
| râper : voler, dérober - (37) |
| râper aine traisse : élaguer une haie - (37) |
| râper lai traisse : élaguer la haie - (37) |
| râper v. 1. Tailler, couper les bouchures. 2. Enlever les moisissures d'un fromage. - (63) |
| râper : nettoyer les haies - (39) |
| raper : v. a., vx fr., enlever. Râper un fromage, en ôter le dessus. - (20) |
| râper, v. a. emporter tout, ne rien laisser. - (08) |
| raper. v. a. Attraper, prendre, saisir vivement. Du latin rapere. (Armeau). - (10) |
| rapetasser, v., recoudre grossièrement un sac. - (40) |
| rapetassoux (rap'tassou), rapetassouse : s. m, et f., rapetasseur, papetasseuse. Voir petassoux. - (20) |
| rapetauder (verbe) : en couture, réparer sommairement. - (47) |
| rapetrê : roitelet. (C. T IV) - S&L - (25) |
| rapetret : roitelet - (51) |
| rapetret n.m. Personne de petite taille. Roitelet. - (63) |
| rapeue, s. f. râpure, rognure. - (08) |
| rapeure : résidu de branchage après élagage. A - B - (41) |
| rapeûre : Râpure. « De la rapeûre de tapines » : des pommes de terre râpées. - (19) |
| rapeûtret : (nm) roitelet - (35) |
| rapeutret : roitelet - (43) |
| rapi : Vin fait avec du raisin qu'on cueille avant l'époque de la vendange pour avoir plus tôt du vin nouveau. « Je n'ai plieu de vin dans ma cave, je va fare in rapi ». - (19) |
| rapi, s. m. boisson âpre faite de fruits macérés dans l'eau (du vieux français rapé). - (24) |
| rapia : avare - (51) |
| rapiâ, adj., avare, radin. - (40) |
| rapia, rapiate : avare. Certains étin rapia : certains étaient avares. - (33) |
| rapia, s. m., avare, grippe-sou. - (11) |
| rapiaîn-ner : caresser - (57) |
| rapiamus (faire), loc., chiper, soustraire un objet. - (14) |
| rapiamus n.m.pl. Gérémiades, plaintes. - (63) |
| rapiat (nom masculin) : avare, radin, proche de ses sous. - (47) |
| rapiât (on) : avare - (57) |
| rapiat n.m. Avare. - (63) |
| râpiât, c’ien : avare - (37) |
| rapiat. D'une avarice sordide. Ce mot est employé comme nom et comme adjectif. (Français familier). - (49) |
| rapiat. s. m. Qui est avare, qui gratte, qui rapine. Voyez raper. - (10) |
| rapiau : Egalité au jeu. « J'ai fait cin points cen nos fâ rapiau » : j'ai fait cinq points cela nous met à égalité. « Rapiau de c'euchin » : baillement. - (19) |
| rapiaud (éte) loc. Etre à égalité de points (aux quilles). - (63) |
| rapiauder v. Chercher à compléter. - (63) |
| rapiauter, v. réparer (un habit). - (38) |
| rapicoler : voir repicoler. - (20) |
| rapide n. Personne très portée sur le sexe. - (63) |
| rapide, adj. hardi, énergique, résolu, celui ou celle qui va vite, qui va droit au but. - (08) |
| rapie : genre de crêpe. - (30) |
| rapiéchi, rapiéci v. Rapiécer. - (63) |
| rapiéci, rapatessi : rapiécer - (43) |
| rapiéc'ter, v. tr., rapiécer : « La couraude ! all'ne treùve jamâ l'temps d’rapiéc'ter son houme ; ô va tout dég'nillé. » - (14) |
| rapiester. v. - Rapiécer. - (42) |
| rapille : Lutte entre gamins qui se disputent les dragées qu'on leur jette à l'occasion d'un baptême ou d'un mariage. Au figuré. « I est à la rapille » : c'est à qui pourra s'en emparer. - (19) |
| rapion, rapon. Aliment formant une croûte adhérente au fond d'une casserole, par suite d’un feu trop violent. - (49) |
| rapionner, rinchonner. Faire entendre, en respirant, des sifflements, des ronronnements produits par des mucosités accumulées dans les bronches ; toussoter. - (49) |
| râpionner, verbe intransitif : se râcler la gorge ou toussoter pour enlever des mucosités. - (54) |
| raplaplat : s. m., aplati, déprimé, ramolli. - (20) |
| raplien-ner , rapliennoux : Masser, il y avait autrefois des « raplieinnoux » qui soignaient en les massant les gens qui s'étaient « étendus » ou qui avaient « l'estomac décroché ». Le raplein-gnoux était le « kiné » de jadis ! - (19) |
| rapné : spatule servant à racler la pâte dans le fond du pétrin (ou patchère*). A - B - (41) |
| rapné : spatule pour racler la patte dans le fond de la patchère - (34) |
| rapnée : spatule pour racler la pâte dans le fond du pétrin - (43) |
| rapo, rapiâ, égalité de points aux jeux de quilles, de billard ; en Gascogne, fâr rampeou est : faire concurrence ; on Franche-Comté, l'on dit aussi ranpô. - (16) |
| rapœtrœ, s. m. roitelet. - (22) |
| rapœtrœ, s. m. roitelet. - (24) |
| rapœye, s. f. broussaille sur une pente raide et rocailleuse. - (24) |
| râpogniû (ai yaivot) : (il lui avait) répondu - (37) |
| rapoir, râpe. - (16) |
| rapoire (râpoire) : s, f., râpe de cuisine. - (20) |
| rapon : résidu solide dans le fond d'une casserole. Nuage noir à l'horizon. A - B - (41) |
| râpon : (nm) raclure ; nuage au soleil couchant - (35) |
| rapon : gratin, dépôt. - (30) |
| râpon : partie collante au fond de la coquelle - (37) |
| rapon : résidu fond de casserole - (44) |
| râpon n.m. Rhume. On dit aussi rinchon. - (63) |
| râpon ou râzon : raclure ou nuage au soleil couchant - (43) |
| râpon, subst. masculin :ce qui attache au fond du plat ou de la cocotte. - (54) |
| raponde (v.t.) : répondre - (50) |
| raponde v. Rattacher deux éléments (pièces de tissus, fil). - (63) |
| rapondre : nouer 2 morceaux de fil ou de ficelle, le résultat est une raponse - (46) |
| ràpondre, apondre, àponser (Chal.), apondre (Char.), raipondre, aipondre (Morv.). Allonger une étoffe à l'aide d'un morceau, joindre deux pièces d’étoffe ensemble ; du même mot, vieux français, apondre, rapondre qui signifiait réunir. Une aponse ou raponse désigne la pièce servant à rallonger l'étoffe. Dans le Charollais apondre quelqu'un signiie le rejoindre. - (15) |
| rapondre, réunir par un noeud les deux extrémités d'un fil brisé. - (16) |
| rapondre, v. tr., rallonger, ajouter, rejoindre deux morceaux : « T'crès donc que j'sons bitous ? On y vouét prou qu'y é rapondu. » - (14) |
| rapondu : allongé. (S. T III) - D - (25) |
| raponner. Ramasser, nettoyer « la râpon ». - (49) |
| raponse (n.f.) : réponse - (50) |
| raponse : résultat obtenu en effectuant l'action de rapondre - (46) |
| raponse n.f. Rallonge, ajout. Mette eune raponse (à un vêtement). Mot de la famille d'aponcheûre (bourbonnais). - (63) |
| raponse, raccord (terme de couture). - (27) |
| raponse, s. f., pièce d'étoffe, de linge, ajoutée sans soins minutieux à une autre pièce. - (14) |
| raponsi v. Réparer en rattachant deux éléments, agrandir, rallonger. Ce verbe est à rapprocher du verbe bourbonnais aponcher. - (63) |
| rapor ; ai rapor, ai répor de lu, en sa considération ; ai rapor ke, parce que... - (16) |
| raport à, loc., à cause de : « L'mariage a manqué rapport à lu, qui v'lòt pu gros d'écus et pu long d'târe. » - (14) |
| rapôrter, et rapourter, v. tr., rapporter, faire des rapports en sournois. - (14) |
| râpote : espèce de petite binette en fer pour râcler la male - (39) |
| rapôto : oiseau : roitelet. Ol étotpas piu grous qu'un rapôto : il n'était pas plus gros qu'un roitelet. - (33) |
| rapôtot : n. m. Roitelet. - (53) |
| rapotot, n.m. roitelet. - (65) |
| rapotot, roitelet - (36) |
| rapotot, s. m., roitelet. - (11) |
| rapouillou : celui qui parle à tort et à travers. - (33) |
| rapoustin (n. m.) : remontrance, réprimande - (64) |
| rapoustin, (ston) : réprimande - (60) |
| rapoutâ (n.m.) : roitelet (Morvan-est) - (50) |
| rapoutâ : autre nom du roitelet (voir loibri). II, p. 28-1 - (23) |
| rapoutâ, s. m. roitelet, petit oiseau à bec fin. se dit par extension d'un homme ou d'un enfant chétif, de forme grêle. en plusieurs lieux, « raipotot. » - (08) |
| rapouto, subst. masculin : roitelet ou troglodyte. - (54) |
| rappaler (se) - souv'gni (se) : souvenir (se) - (57) |
| rappaler : rappeler - (57) |
| rappaler : Rappeler, se souvenir. « Rappale te bin ce que je te dis ». Au jeu, faire un coup qui met les joueurs à égalité. Se dit du chant de la perdrix, « Les padrix rappalent ». - (19) |
| rappé : élaguer une haie, sarcler la mauvaise herbe - (34) |
| rappeau : s. m., vx fr. rapeau, rappel. - (20) |
| rappeau. Pour rampeau ; égalité au jeu. - (12) |
| rappeler : v. a., appeler. Rappeler d'un procès. - (20) |
| rappelonner, rappelouner. v. - Réparer, remettre en état. Se dit également pour une personne qui sort de maladie : « T'as vu la Germaine, alle est ben rappelounée ! » - (42) |
| rappeur : résidu de branchage après élagage - (34) |
| rappliquer. Arriver à l'improviste et en grand nombre. - (49) |
| rappon : fond de casserole, nuage noir à l'horizon - (34) |
| rappondre, rapondre : v. a., vx fr. rapondre, ajouter, allonger. Voir appondre et dépondre. - (20) |
| rappondre. Allonger un objet trop court en y fixant un autre objet. Ex. : « J'ai rappondu ma corde avec un morceau de fil de fer. » Etym. le latin apponere avec un r augmentatif. - (12) |
| rappondre. Faire une ropponse. Terme de couturière. C'est allonger un morceau d'étoffe en y cousant une pièce. - (13) |
| rapponse, raponse : s. f., ajoutage, allonge. Mettre une raponse à un vêtement, à un meuble. Voir apponse. - (20) |
| rapport à loc. Compte tenu de. - (63) |
| rapportoux : Dénonciateur, terme d'écolier. « An n'âme quère les rapportoux ». - (19) |
| rappot. Ex-aequo. - (49) |
| rappreuchi : Terme de chasse, se dit des chiens qui suivent de près le gibier. « Les chins rappreuchant » - (19) |
| rapproche : Aboiement des chiens qui sont près d'atteindre le gibier. « Les chins donnant du rapproche ». - (19) |
| rapprochi : rapprocher - (57) |
| rapproprir. v. - Rendre plus propre. « Il les bouchonna un p'tit brin pou' les rappropri ', les ettela à la charrette et partit. » (Fernand Clas, p.223) - (42) |
| rappyiquer v. Rappliquer. - (63) |
| rapreutsi : rapprocher - (43) |
| rapsaudè : raccommoder grossièrement, faire une reprise à un vêtement - (46) |
| rapsauder : refaire médiocrement. - (66) |
| rapsauder, raccommoder grossièrement. - (27) |
| rapsauder, raptsauder v. Raccomoder. - (63) |
| rapsauder, v. tr., raccommoder, mais imparfaitement : « La pauv'fille ! alle a ben l’intention de r'tenî son linge ; mâ all’ le rapsaude. » - (14) |
| rapsôdé, raccommoder un linge en mauvais état ; réparer un objet détérioré. - (16) |
| rapsôder : Raccommoder grossièrement. « Ses habits sant tot rapsôdés ». - (19) |
| rapsoder et rapetasser sont deux expressions familières admises par quelques lexicographes. Ils signifient « raccommoder grossièrement. » Mon haibit-veste ai déji été rapsôdé, mas portant an faut tâcher de le rapetasser encore eune fois. - (13) |
| rapsôder, v. a. raccommoder grossièrement : « rapsôder » des bas, un pantalon, une robe, etc. - (08) |
| rap'souder - r'groler : réparer (sommairement) - (57) |
| rapsouder : rafistoler - (57) |
| raptassi v. Rapetasser, réparer grossièrement. - (63) |
| raptassoux, -ouse n. Personne qui répare grossièrement. - (63) |
| rap'tioti : rapetisser - (57) |
| râqhier, v. a. racler, ratisser, gratter. - (08) |
| râqhiot, s. m. raclure. ne s'emploie que pour designer le gratin d'une bouillie, ce qui reste au fond de la marmite et ce que l'on enlève en raclant avec la cuillère. (voir : râclot.) - (08) |
| raqhiotte, s. f. fauvette. (voir : ratelâ, rapoutâ.) - (08) |
| raqué, v. n. déborder malproprement. - (22) |
| raquenaille. n. f. - Marmaille. (Villeneuve-les-Genêts, selon M. Jossier) - (42) |
| raquenaille. s. f. Marmaille. ( Villeneuve-les-Genêts). - (10) |
| raquenoux, adj., acide (en parlant d'un fruit vert). - (40) |
| raquer : Rater. « San feusi a raqué ». - (19) |
| raquer : v. n., bas-Iat. rascare, vomir. - (20) |
| raquer, v. n. déborder malproprement (du vieux français racher, cracher. Latin rascare, vomir). - (24) |
| raquer. v. n. Manquer, échouer.(Soucy). - (10) |
| raquetter. Recevoir dans la main un objet lancé, rattraper quelque chose qui tombe. Etym. rachete, rasquete, en vieux français voulaient dire la paume de la main, du bas latin racha, le carpe ; de là on a tiré raquette par analogie d'usage entre cet instrument et la main ; nous avons fait de raquette, le verbe très commode et très clair raquetter. - (12) |
| raquetter. Saisir un objet lancé. I vas te jeter ton chaipiâ, raiqueutte'lu. Ce mot est emprunté à l'ancien jeu de paume et à celui du volant, dans lesquels on se sert d'une raquette. - (13) |
| raquettes : s. f. pl., castagnettes enfantines faites de deux planchettes qu'on tient entre les doigts pour en jouer. - (20) |
| raqueulot, adjectif qualificatif : petit, chétif. - (54) |
| raqueut : Recors « I est veni eun hussier d'ave deux raqueuts » : il est venu un huissier avec deux recors. - (19) |
| râquiè : racler - (46) |
| râquier (v.t.) : racler, s’éclaircir la voix, se racler la gorge - (50) |
| raquignon, raquignonne : adj., grincheux, grincheuse. - (20) |
| raquiner. v. a. Produire un bruit léger, sec et continu. (Villiers-Saint-Benoît). - (10) |
| râquiot : nourriture raclée au fond de la cocotte ou d'un plat - (48) |
| râquiot : nourriture qui a grillé dans le fond d'une cocotte - (39) |
| raquiot. Grenouille grise vivant sur la terre dans les prés humides. - (49) |
| raquioté : qui a cuit trop longtemps, racorni (de raqhiot : râclure, fond de marmite). - (56) |
| raquiote : n. f. Raclette. - (53) |
| râquiotte (n.f.) : fauvette - (50) |
| râquiotte : mot féminin désignant le fait de racler - (46) |
| râquiotte : raclette, racloir avec un manche pour racler, ramasser la boue. - (33) |
| râquiou : un racloir - (46) |
| râquioux. s. m. Boueur, celui qui racle, qui enlève les boues. - (10) |
| rarangi : Verbe, réparer, remettre en place. « Le madecin li a rarangi san bré ». - (19) |
| raratte, s.f., dent de lait. - (40) |
| rarattes : s. f. pl., vieilleries, choses mises au rebut. Syn. d'arrigailles. Voir ravaderie. - (20) |
| rarbi, vt. mettre au vert, à l'herbe les animaux nourris au sec depuis longtemps. - (17) |
| rare adj. Douteux, étonnant. Y srot bin rare qu'ô veunne ! - (63) |
| rariver, v, raccommoder, ressemeler (à Buxy). - (38) |
| ras : le rayon du chariot - (46) |
| ras : s. m., vx fr., mesure rase, et, dans une partie du vignoble, benne contenant la quantité de vendange nécessaire pour faire une feuillette de vin. - (20) |
| rasche, teigne. - (04) |
| rase (ai), loc. adv. comble jusqu'au bord, au niveau de… - (08) |
| ràse (au), loc., au ras, jusqu'au bord, comble. - (14) |
| rasê : raisin. (B. T IV) - D - (25) |
| rase : s. f., vx fr., bande de terre comprise entre deux raies longitudinales et allant généralement d'un bout, à l'autre d'un champ. On dit les rases de première pie, de deuxième pie, etc., pour les portions de rases comprises dans la première pie, la deuxième pie, etc. - (20) |
| rase, s. f. espace de vigne délimité par deux allées (vieux français). - (24) |
| rasée, s.f. rayon : rasée de sulot, rayon de soleil ; on dit aussi "rasée de vin". - (38) |
| rasement n.m. Espace entre la sablière et le toit. - (63) |
| rasement. Haut du mur d'un bâtiment sur lequel repose la sablière. - (49) |
| rasin : n. m. Raisin. - (53) |
| râsin, s. m. raisin. « râjin. » - (08) |
| rasin, sm. raisin. - (17) |
| râsing (n.m.) : raisin - (50) |
| rasoi : Rasoir. « San cutiau cope c 'ment in rasoi » - (19) |
| rasoî n.m. Rasoir. - (63) |
| rason, s. m. couche mi- brûlée de bouillie attachée au fond de la marmite. - (24) |
| rasouaîr (on) : rasoir - (57) |
| rasouair : n. m. Rasoir. - (53) |
| rasoué : rasoir. - (33) |
| rasouère : rasoir, râclette - (48) |
| rasoux : Barbier, celui qui rase. - (19) |
| rasoux, rasouse : adj., raseur, raseuse. - (20) |
| rassaré : regrouper - (34) |
| rassarer : entasser le foin en andé* (= andain) ou en mio* (= tas) avant transport. A - B - (41) |
| rassarer : (vb) amasser le foin - (35) |
| rassarer : grouper le foin en rouleaux, en gros andains pour le charger - (43) |
| rassarer les dzerbes : rentrer les javelles - (43) |
| rassarrée n.f. Congère de neige, réunion de personnes, d'objets. - (63) |
| rassarrer : resserrer, rassembler - (51) |
| rassarrer v. Ranger, mettre à l'abri. - (63) |
| rassasié, vt. rassasier. - (17) |
| rasse (nom masculin) : grande panière ovale. On dit aussi resse. (Il a été bercé dans une resse : se dit d’un bossu). - (47) |
| rasse : (nf) grand panier à deux anses - (35) |
| rasse : grand panier - (44) |
| rasse : grand panier à deux anses qui servait à transporter les lapins - (43) |
| rasse : grand panier ovale sans anse à deux poignées pour transporter les récoltes (ex pommes de terre, betteraves etc…). - (59) |
| rasse : grande panière tressée d'osier de forme oblongue avec des poignées à chaque extrémité - (51) |
| rasse : sorte de corbeille. - (30) |
| rasse n.f. (du lat. riscum, coffre d'osier). Grande corbeille grillagée ou en osier servant au sèchage et au transport de plantes. - (63) |
| rasse : n. f. Grande corbeille ovale en osier. - (53) |
| rasse, n.f. corbeille allongée avec deux poignées, souvent destinée au linge. - (65) |
| rasse, raisse : grand panier à oreilles en osier allongé, pour ramasser les légumes, la « balle », les fruits cueillis en nombre etc... (dans certains lieux on dénomme aussi « rasse » le panier individuel en osier à couvercle se fermant à anses entrecroisées de couleur noire, servant en autres utilisations à transporter un lapin mâle ou femelle vivant, dans un but de « croisement ») - (37) |
| rasse, s. f., grande corbeille à linge, en osier écorcé et à grandes poignées. - (40) |
| rassembier, v. a. rassembler. - (24) |
| rassemb'illement (on) : rassemblement - (57) |
| rassemb'iller : rassembler - (57) |
| rassembliement : Rassemblement. - (19) |
| rassemblier : Rassembler. « Je nos sins rassembliés à l'aubarge » - (19) |
| rassette. s. f. Grande corbeille. (Etivey). - (10) |
| rassie : adj. f., rassise. Mie (de pain) rassise. - (20) |
| Rassigneau : nom de bœuf. III, p. 29-o ; VI, p. 7 - (23) |
| rassir, v. a. tonifier, particulièrement l'estomac ; se dit surtout lorsqu'à du bétail au vert on donne un peu de fourrage sec. - (24) |
| rassorti : Réassortir. « Ol a vendu in de ses bûs mâ o va aller à la foire pa se rassorti ». - (19) |
| rassôtte : grande corbeille d'osier ou d'écorce de noisetier (cf. rasse : panier servant à mesurer le charbon dans les forges). (R. T IV) - Y - (25) |
| râste : Reste. « Quand ses héritiers ant ésu payé partot i n'ant pas ésu grand chose de râste ». - (19) |
| râster : Rester, demeurer. « Quévà dan qu 'o râste ? » : où habite-t-il ? - (19) |
| raster. v. - Rester. - (42) |
| rasti : grillé. (SY. T II) - B - (25) |
| râsure : dépôt de ce qui a cuit en mitonnant, comme les gaudes - (46) |
| rasure, croûte de bouillie adhérente au fond de la marmite. - (05) |
| ràsure, s. f., synonyme de raclot. (V. ce dernier mot.) - (14) |
| rasure. Résidu de bouillie qui s'attache aux parois de la marmite ; probablement parce qu'il faut racler ces parois pour l'avoir ; radere, rasum. - (03) |
| rat barda : loir - (44) |
| rat bardat. Loir, lérot. - (49) |
| rat bardot : lérot. Voir : bardot. - (62) |
| rat bardot, subst. masculin : lérot. - (54) |
| rat, rate, s. m. et f., terme d'amitié donné aux petits garçons et aux petites filles : « Veins, mon p'tiot rat ! Bise-me, ma p'tiote rate ! » Ces mots caressants naissent spontanément de la bonne humeur du pays. - (14) |
| rat. Mot qui sert à appeler les cochons. - (03) |
| râtaie : râteau - (48) |
| rataille. n. f. - Désigne l'ensemble des rongeurs. - (42) |
| ratale, s. f. désignation vague d'un organe indéterminé de l'abdomen : n’avoir pas la ratale attaquée, être bien portant (du vieux français ratelle.) - (24) |
| ratale, s. f. désignation vague d'un organe indéterminé de l'abdomen : n'avoir pas la ratale attaquée, être bien, portant. - (22) |
| ratales, n. fém. plur. ; talons ; jeter un bâton és ratales. - (07) |
| ratapacher, v. tr., rapetasser, raccommoder imparfaitement, sans soin et sans goût. - (14) |
| ratapasser : raccommoder à la hâte. (S. T III) - D - (25) |
| ratapeusner : (ratapœsnè - v. trans.) ravauder, rapiécer. - (45) |
| rataponer, et ratiponer, v. tr., retaper et rapiécer. - (14) |
| rataponner. Taponner, mettre en tapon, avec l'augmentatif local ra. - (12) |
| ratatignë ; une viande trop cuite, trop desséchée est dite : ratatignë. - (16) |
| ratatouye, mets mal préparé, rebutant. - (16) |
| râtcheau : râteau - (51) |
| râtcheau : râteau - (39) |
| ratcheau. Râteau. - (49) |
| râtcheauder : râteler - (51) |
| rat-de-cave : s. m., cloporte des murs ou des caves (oniscus murarius). - (20) |
| rate (avoir la). Sentir au flanc gauche une douleur assez aiguë qui se produit à la suite d'un exercice violent. Etym. il est probable que le mot dilatée ou gonflée, s'expliquant a la rate, est sous-entendu dans notre expression. - (12) |
| rate (faire la), loc., faire sautiller, courir de tous côtés, mais surtout faire arriver brusquement devant les yeux de quelqu'un, un rayon de soleil réfléchi par un petit miroir qu'on manœuvre. Amusement déplaisant des gamins. - (14) |
| rate (na) : souris - (57) |
| rate : Femelle du rat. Dent dans le langage enfantin. « Fa voir tes ptiètes rates ». « Rate voleréche » chauve-souris. - (19) |
| rate : souris. Comme si c’était la femelle du rat ( ?) - (62) |
| rate : souris. IV, p. 33 - (23) |
| rate n.f. Dent de lait. - (63) |
| rate volerate, rate voleuse : s. f., vx fr. ratte volage, chauve-souris. - (20) |
| rate vouluce, chauve-souris. - (05) |
| rate : s. f. (terme enfantin), dent, spécialement dent de lait. - (20) |
| rate, s. f., souris. - (14) |
| rate, s.f. rat ; rate vôlante : chauve-souris. - (38) |
| rate. n. f. - Souris. - (42) |
| rate. Tous les mustelins au-dessous de la taille du rat ordinaire, souris, mulots, musaraigne, etc., sont des rates chez nous. - (12) |
| râteai, s. m. râteau de jardin ou râteau qui sert à ramasser le foin. - (08) |
| ratelâ (n.f.) : fauvette - (50) |
| ratelâ : voir rapoutâ - (23) |
| ratelâ, s. m. roitelet. - (08) |
| ratelai : herser. On ratelo les semences : on hersait les semences. On vai ratelai aveuc une rateule : on va herser avec une herse. - (33) |
| ratelè : v. t. Herser. - (53) |
| rateler : herser. - (52) |
| râteler, v. a. râteler, herser, se servir de la râtelle ou herse et non pas du râteau. - (08) |
| râteleure, s. f. râtelure, ce qu'on ramasse avec le râteau, paille, foin, débris de toute sorte. - (08) |
| ratelle n.f. Rate (viscère). - (63) |
| ratelle : s. f., vx f r. (Littré), rate {viscère). - (20) |
| ratelle, s. f., rate. - (40) |
| ratelot (nom masculin) : faux combiné avec une sorte de râteau pour couper les céréales. - (47) |
| râtelou (-ouse) : râteleur - (50) |
| râtelou, odse, s. m. et f. râteleur, râteleuse, celui ou celle qui ramasse le foin des prés. - (08) |
| ratepenade. : Ornement de femme aux XVIe siècle, et dout il est question cians des statuts somptuaires de 1580. Ce mot répond à chauve-souris ou rate ailée (pennata) et signifiait, sans doute, un objet de toilette en forme d'ailes de chauve-souris. - (06) |
| rater : ne pas réussir. - (09) |
| rater, v, tr., chasser le rat, la souris. Se dit du chat. - (14) |
| ratère : Ratière. - (19) |
| rates, s. f., dents d'un petit enfant. Mamans et nourrices emploient ce mot d'une façon toute gentille : « M'amie, montre-me tes p'tiotes rates. » Dans plusieurs provinces les dents de lait portent ce nom. - (14) |
| rateuiller. n. m. - Râtelier. - (42) |
| rateule (n.f.) : herse garnie de dents de bois - (50) |
| rateule (nom féminin) : herse. - (47) |
| râteule : herse - (48) |
| rateule : herse. - (52) |
| rateule : herse, horche. - (33) |
| râteule : herse - (39) |
| rateule : n. f. Herse. - (53) |
| râteule, s. f. herse, instrument de culture garni de dents de fer ou de bois. - (08) |
| râteuler : herser - (39) |
| rateure, ratière, souricière. - (05) |
| ratevaler : v. n., syn. de tracter et de grollasser, marcher en traînant les pieds. - (20) |
| rate-volage. n. f. - Chauve-souris. « Au-dessus de ma tête zigzague le vol noir et muet d'une petite rate volage ... » (Colette, Claudine en ménage, p.424) - (42) |
| rate-volerate, et rate-voluche. s. f., chauve-souris. Les paysans, ignorant qu'ils ont affaire à un destructeur d'insectes nuisibles, clouent encore impitoyablement la chauve-souris aux portes de leurs granges. - (14) |
| rate-volerette. Chauve-souris. - (49) |
| rate-voûlerette n.f. Chauve-souris. - (63) |
| rati, adj., infesté de rats. - (40) |
| râtiau (n.m.) : râteau - (50) |
| ratiau (un) : un râteau - (61) |
| râtiau : (nm)râteau ; râtelier - (35) |
| râtiau : râteau, râtelier - (43) |
| ratiau : râteau. - (52) |
| râtiau : un râteau. - (56) |
| ratiau : râteau. - (33) |
| râtiau n.m. 1. Râteau. 2. Râtelier placé au dessus de la crèche dans l'écurie. - (63) |
| râtiau, s. m., râteau, et râtelier pour le foin et la paille. - (14) |
| râtiau. n. m. - Râteau. - (42) |
| râtiauder v. Aplanir, râtisser. Voir beurlouter. - (63) |
| ratiboiser. Enlever, voler par ruse. Mot employé dans l'expression : « se faire ratiboiser ». - (49) |
| ratichan : Sévère réprimande. « Ol est bin seur d'avoi in ban ratichan ». - (19) |
| ratichon, s. m., réprimande, reproche : « En rentrant d'I'écòle, ôl a r'cevu du pére ein ratichon soigné. » - (14) |
| ratichon. s. m. Balai usé. (Armeau). - (10) |
| ratieau, ratelier. - (05) |
| ràtier (ā), vt. racler. - (17) |
| ratiöte (ā), sf. raclette. - (17) |
| ratire (na) : souricière - (57) |
| ratitsonner : (vb) enguirlander - (35) |
| ratitsonner v. Donner une râclée. - (63) |
| ratje (ā), sf. racle. - (17) |
| rât'lé : râtelier - (48) |
| rât'ler : herser, râtisser - (48) |
| rât'leu. n. f. - Râteleuse. - (42) |
| rât'leuse : râteau mécanique à cheval pour le foin - (48) |
| ratlin, râteau en bois. - (26) |
| ratlö, sm. râtelier. - (17) |
| rât'lot : faux à céréales munie d'une sorte de rateau vertical - (48) |
| ratö, raté, sm. râteau. - (17) |
| ratoire, s. f., ratière, souricière. - (14) |
| ratolerœtte, s. m. chauve-souris. - (24) |
| ratoudròsse, s. m. chauve-souris. - (22) |
| ratouée. n. f. - Piège à rate, à souris. - (42) |
| ratouère. Ratière. - (49) |
| ratour, s. m., retour, détour, chemin qui force le marcheur à se retourner. - (14) |
| ratourner, v. intr., retourner, détourner. - (14) |
| râtraichi : rétréci - (37) |
| ratrapé a plusieur significations ; un enfant en ratrape un autre quand il arrive à la même taille que lui ; un élève en ratrape un autre en arrivant, dans ses études, au même point que lui ; on ratrape quelqu'un sur le chemin, en marchant plus vite que lui. - (16) |
| ratri : desséché au four. (SY. T II) - B - (25) |
| râtri : trop cuit, trop réduit par la cuisson. - (32) |
| ràtri, adj., flétri, desséché au four : « Eh ! dites donc, la mére ? C'te miche é ben ràtrie. » - (14) |
| ratri, contracté, retiré, comme quelque chose de des séché ou de trop cuit... - (02) |
| ratri, desséché, paraît être la synthèse de rétréci. - (13) |
| ratri, mets desséché par la chaleur. - (28) |
| ratrouper : rassembler. - (66) |
| ratsaper : (vb) attraper - (35) |
| rattaichi : Rattacher. « La vaiche s'est détaichi va la rattaichi ». - (19) |
| ratte : (nf) souris ; dent de lait - (35) |
| ratte : dent de lait d'un enfant. - (30) |
| ratte : souris, dent de lait, pomme de terre, quenelle - (43) |
| ratte, n. fém. souris ; terme d'affection, de cajolerie : viens, mai ratte. - (07) |
| ratte, souris. - (28) |
| ratte-oul’rette : (nf) chauve-souris - (35) |
| rattire : (nf) piège à rat - (35) |
| ratt'ler : ratelier des vaches, ou on met leur foin - (39) |
| ratt'lot : râteau placé sur la faux utilisé pour couper les céréales - (39) |
| rattoire, piège à souris. - (28) |
| rattoul’rette : chauve-souris, rat volant - (43) |
| ratuchon : s. m. euphorbe. - (21) |
| rat-voujeux, rat-voiseux : loir, lérot, voiseux : de voix sonore. - (32) |
| raû (l’) : (la) buse mâle - (37) |
| rau (n. f.) : sillon, raie laissée par la charrue au cours du labour (rau perrée (empierrement, procédé de draînage consistant à disposer des pierres au fond d'un fossé, puis à les recouvrir de fascines et à remplir la tranchée de terre)) - (64) |
| raû (n.m.) : buse, rapace - (50) |
| rau : épervier, buse - (34) |
| rau : petit rapace, buse ou épervier. À rapprocher du vieux français roër, tournoyer ? - (52) |
| rau n.m. (du lat. rasculare, râcler) Busard, épervier, dont le cri évoque un raclement. Voir bourre. - (63) |
| rau, raus ou rauche. : (Dial. et pat.), enroué (du latin raucus). On dit aussi dans nos campagnes rhômelou. - Voici l'origine du dicton être enrhumé comme un loup. Les villageois assurent que si le loup surprend le berger, celui-ci devient rauche au point de ne pouvoir articuler le moindre cri ; que si, au contraire, le berger voit le loup le premier, l'animal perd la voix. Cette croyance remonte loin et appartient au paganisme : car Virgile, dans ses Bucoliques (ecl. X), fait dire au pâtre Moeris qui se plaint d'avoir perdu la mémoire des vers, et jusqu'à la voix pour les chanter - (06) |
| rau, s. m. oiseau de proie appelé « rouaule ». - (08) |
| raub'ille (on) : racloir (à braises) - (57) |
| rauble, rouable. s. m. Instrument de bois ou de fer, pour retirer la braise du four. - (10) |
| raublée, s. f. raclée, volée de coup de poing. - (08) |
| raubler, v. a. battre vigoureusement, donner une raclée à quelqu'un. - (08) |
| raubllye, s. f. râble, ou râcloir à manche pour la braise, le blé, la poussière. - (24) |
| raubye : (nm) tire-braises - (35) |
| raub-ye : tire-braise - (43) |
| raubye n.m. Tire-braise, râclette de bois à long manche pour ramasser le blé sur l'aire ou pour déblayer la neige. - (63) |
| raubyi v. (du lat. rutabulum, pelle à feu). Râcler, ramasser, mettre en tas. - (63) |
| rauche (n. f.) : espèce de roseau - (64) |
| rauche (n.f.) : jonc, roseau - aussi reuche - (50) |
| rauche : herbe de mauvais pré. - (09) |
| rauche : plante des terrains humides - (60) |
| rauche : jonc, ou herbes de prairies humides. Ex : "T'as vu ton pré ? C'est que d'la rauche !" - (58) |
| rauche : roseau, croup, enrouement. - (32) |
| rauché, adj., enroué. - (40) |
| raûche, s. f., teigne des cheveux. - (40) |
| rauche. n. f. - Carex, roseau utilisé pour le rempaillage des chaises. - (42) |
| rauche. s. f. Iris des prés. (Villiers-Saint-Benoît). - (10) |
| rauches : laiches (carex). Ill, p. 43 - (23) |
| rauchi (se) (p.ê. de roûchie). Se voûter. - (63) |
| raud : nom collectif pour divers oiseaux de proie dont la buse. Ill, p. 49-6 ; IV, p. 20-1 - (23) |
| raud, subst. masculin : buse, tiercelet. - (54) |
| raudeure, s. f. couche brûlée de bouillie attachée au fond de la marmite. - (22) |
| raue, s. f raie, sillon : la « raue » d'un champ. - (08) |
| raue. n. f. - Raie, sillon de labour. Mettre en raue signifie commencer le premier sillon. Raue désigne aussi, par comparaison, l'ornière faite par des roues de charrette. - (42) |
| raue. s. f. Raie, rigole dans un champ. Une raue couverte. - (10) |
| rauger (se) : Se tourner, se mouvoir. Ex : "J'ai mal dans les oues, j'peux pu m'rauger..." - (58) |
| rauger (v. tr.) : remuer, mélanger (syn. boulayer) - (64) |
| rauger : brasser (la salade) - (61) |
| rauger : remuer un liquide en tournant. - (09) |
| rauger : remuer, emmailloter. IV, p. 59-c - (23) |
| raüger, v. tourner en rond ; on "raüge" une tasse de café avec la cuiller pour faire fondre le sucre. - (38) |
| rauger, v. tr., mouvoir, agiter, remuer : « Allons ! v'tu te t'nî ; t’rauges tôjor. » — « J'vas qu'rî du lait ; rauge les gaudes. » (V. Roger.) - (14) |
| rauger. v. - Remuer en tournant : en battant des œufs ou en tournant le bouton de porte. « Et quand j'entends rauger la porte, j'croué toujou' qu' c'est lui qu'va rentrer. » (Fernand Clas, p.188) - (42) |
| raugmente, s. f. augmentation de prix, de valeur : il y a de la « raugmente » dans le prix des blés. - (08) |
| raug'mente, s. f., augmentation de prix, renchérissement : « Ben marci ! sur les troquets y a gros d'la raug'mente ! » - (14) |
| raugmenter : augmenter (« lâs zours ont brâment raûgmenté ! ») - (37) |
| raugmenter : Augmenter. « Les impôts ant enco raugmenté s 't'an-née». - Renchérir « Tot raugmente ». - (19) |
| raugmenter : v. a, et n., augmenter. - (20) |
| raug'menter, v. intr., renchérir : « V'là l'pain qui raug'mente ; faudra s'sârer la sous-ventrière. » - (14) |
| raugmenter, v. n. augmenter de prix, de valeur. - (08) |
| raugue, s. f. enrouement, état du larynx où la voix est rauque. (voir : enrauguer.) - (08) |
| raujer : remuer en tournant - (60) |
| raul, s. m., buse. - (40) |
| raule. Instrument en fer, à long manche, destiné à retirer la braise du four. Rauler, ramasser les charbons. An faut ben rauler lai breise devant que d'enforner. Après avoir raulé, on nettoie avec l'écueillon. Les Auxonnais disent un rauble. (V. Ecueillon). - (13) |
| raupié : fauché (ruiné) - (57) |
| rauquenailler. v. n. Répéter toujours la même chose. (Sens). Voir racmailler. - (10) |
| rauquenailleux. adj. et s. Qui se répète sans cesse. (Sens). - (10) |
| rausc'iller : râcler - (57) |
| rausc'illou (on) - rausc'ille (on) : racloir - (57) |
| rause, s. f. allée de vigne. - (22) |
| raute : petite branche torsadée et bouclée pour ficeler les fagots de bois, de paille - (34) |
| raût'ler : râteler - (57) |
| raût'li (on) : ratelier - (57) |
| ravace, ravate : s. f., vx fr. rave, débordement, inondation. A rapprocher de ragasse. - (20) |
| ravàchelins, s. m., débris de toutes sortes, entraînés d'abord, puis laissés par les courants d'une inondation (branchages, fragments de bois, de joncs, de roseaux, outils, fragments de meubles, de vaisselle, etc.). : « Grand Dieu ! Y a-t-i été tèribe ! Y avòt haut c'ment c'qui d'ravàchelins sur les bords ! » - (14) |
| ravacher, v. n. délirer, extravaguer. Se dit des malades lorsqu'ils ont la fièvre et parlent d'une manière incohérente. - (08) |
| ravaderie : s. f., ravauderie, débris, détritus. Voir rabattes. - (20) |
| ravageou, s. m., déserteur, pillard, insoumis. - (40) |
| ravagi : ravager - (57) |
| ravaillou, s. m., petite oseille sauvage. - (40) |
| ravalé, v. n. rouler en bas. - (22) |
| ravassé, rêvasser. - (16) |
| ravasse. Feuilles de raves qu'on donne au bétail. - (03) |
| ravasser, avoir des rêves pénibles, indices d'une mauvaise digestion ou d'une santé précaire. - (27) |
| ravasser, délirer, ravâcher. - (04) |
| ravasses, feuilles de raves. - (05) |
| ravasses, s. f., feuilles de raves, ramassées pour le bétail. On appelle les Bressans « migeous de raives », et les Savoyards « croque-raves ». - (14) |
| ravasson (n.m.) : radis, ravenelle - (50) |
| ravasson, s. m. radis ravenelle. - (08) |
| ravatai, gronder, tourmenter quelqu'un de reproches. - (02) |
| ravate (ă-ā), vt. secouer, recevoir en malmenant, faire des reproches. - (17) |
| râvâtè : remuer les pieds sous la table - (46) |
| ravaté, v. n. se dit, en versant un liquide, lorsque celui-ci coule à terre en suivant la paroi extérieure du vase : attention, ça ravate. - (22) |
| ravaté. : Lutiner quelqu'un de reproches bruyants. En Champagne on dit ravâcher, et en Franche-Comté rabater, faire petite rage contre quelqu'un. (De la basse latinité rabesrere, car le latin pur est rabire ; quid rabis? (Plaute), qu'est-ce qui provoque ta fureur ?) - (06) |
| ravâtelée (n.f.) : rabâcherie, répétition de propos insignifiants - (50) |
| ravatelée, s. f rabâcherie, répétition de propos insignifiants. (voir : raivâter.) - (08) |
| ravatelées. s. f. pl. Paroles dépourvues de sens, niaiseries, insanités. - (10) |
| ravâter (pour rabâter). v. n. Remuer vivement. (Argentenay). - (10) |
| ravater : chercher partout. (G. T II) - D - (25) |
| ravâter : disputer, faire des remontrances - (37) |
| ravater ou raveuter : Se dit du liquide contenu dans un fût lorsque, faute de pression, il coule faiblement au lieu de jaillir. « I a causu plieu ren dans ma fillette, alle ravate ». Se dit aussi du liquide qui coule le long d'un récipient en versant : « Fa attention t'y fa ravater tot le lang ». - (19) |
| ravâter, faire du bruit, pris dans un sens mystérieux - (36) |
| ravater, v. ; gronder. - (07) |
| ravater. Ravauder, au propre et au figuré. - (12) |
| ravateries (des) : des choses de faible valeur. - (66) |
| ravatlé : se répéter. - (33) |
| ravauder. v. - Traîner, se promener sans but précis. - (42) |
| ravauderie n.f. Vieillerie, objet, ouvrage maintes fois rafistolé. - (63) |
| ravauderie, s. f. débris de peu de valeur. - (22) |
| ravauderie, s. f. débris de peu de valeur. - (24) |
| ravaut (au), loc., au rabais. Presque synonyme de rabiau. - (14) |
| ravayer : v. n., ramasser les raves. - (20) |
| râve : Rêve. « San râve est de se mairier d'ave un mossieu ». - (19) |
| rave : s. f. Petite rave, radis rouge (raphanus sativus). - (20) |
| rave, raive : navet - (43) |
| ravèche, s. f. partie feuillue des raves, betteraves. - (24) |
| ravégi : Ravager. « La grale a ravégi les vignes ». - (19) |
| Raveillé : nom de Bœuf. III, p. 30-o - (23) |
| ravel (En) : Ioc, vx fr. revel (s. m.), en gaieté, en joie, en fête. - (20) |
| ravenale : ravenelle, sanve - (43) |
| ravenale : Ravenelle, sisymbrium vimineus - (19) |
| ravene : rejet. (F. T IV) - Y - (25) |
| ravenelle, n.f. moutarde sauvage. - (65) |
| râver : Rêver. - (19) |
| ravére : silo à betteraves. - (62) |
| ravet (n. m.) : loir - (64) |
| ravet : voir ravou - (23) |
| raveter : v. n., se dit d'un liquide qui sort en bavant du vase qui le contient ou qui tombe à côté de celui où on le verse. Y a pus guère de vin dans c'te pièce ; ça commence à raveter. - (20) |
| raveter, v. n. se dit, en versant un liquide, lorsque celui-ci coule à terre en suivant la paroi extérieure du vase : attention ça ravœte ! - (24) |
| raveuiller : gratter (en parlant d'un animal) - (61) |
| raveune : (nf) « mettre en raveune » : énerver, exciter - (35) |
| raveune n.f. (du vx.fr. revel) 1. Rage. 2. En chaleur, en chasse. - (63) |
| raveux. s. m. Loir, Lérot, ainsi appelé sans doute, parce qu'il mange les raves dans les champs. - (10) |
| ravi, 1. s. m. silo de raves, de betteraves. — 2. v. a. grimper une pente, la gravir. - (22) |
| ravi, s. m. silo de raves, de betteraves. - (24) |
| raviaule, s. f., mets dans lequel on a mis force raves. - (14) |
| ravier, monceau de raves et autres racines, couvert de terre. - (05) |
| ravier, ravière : s. m. et f., silo à raves, betteraves, etc. Voir pote. - (20) |
| ràvier, s. m., tas conique de raves, de pommes de terre, disposé dans les champs ou dans les cours. - (14) |
| ravigueté, raviver ; un bon feu raviguete ; un mets assaisonné raviguete. - (16) |
| ravigueuter : Ravigoter. « Bois voir in ban cô pa te ravigueuter ». - (19) |
| raviner. Pleuvoir avec force, de façon à ce que l'eau puisse creuser des ravines. - (12) |
| raviner. v. n. Se dit, figurement, d'un individu qui, ayant toujours faim et ne pouvant se rassasier, mange sans cesse et avidement. (Saint-Florentin). - (10) |
| raviot : plante : ravenelle. Le raviot pousso dans les terres pauvres : la ravenelle poussait dans les terres pauvres. - (33) |
| ravitailli : ravitailler - (57) |
| ravoder : chercher en fouinant - (51) |
| ravôdeuse, celle qui, par état, raccommode le linge. - (16) |
| ravodrie : vieillerie - (51) |
| ravodze : rugueux - (51) |
| ravonë, raves sauvages. - (16) |
| ravoneau (n.m.) : ravenelle des champs (aussi raimielle) - (50) |
| ràvonée, s. f., sorte d'herbe, ayant de la ressemblance avec le chiendent, mais qui n'est d'aucun usage, et qu'on brûle par tas dans les champs pour la transformer en engrais. - (14) |
| ravòsse, s. f. partie feuillue des raves, des betteraves. - (22) |
| ravou : loir. IV, p. 33 - (23) |
| ravou : rat, loir. - (52) |
| ravou : loir - (39) |
| ravou, raivou : n. m. Loir. - (53) |
| ravou, raveu. n. m. - Lérot ou loir. - (42) |
| ravou, ravu, raveneau, raveniau, raveniou : s. m., raviole, raveniale : s. f., ravenelle, nom qui s'applique à la fois au radis sauvage (raphanus raphanistrum) et à la moutarde des champs (sinapis arvensls). Mes raves ont tourné en raveniaux (c'est-à-dire n'ont pas grossi). - (20) |
| ravou, s. m. rat, le fléau des greniers rustiques - (08) |
| ravou, s. m., rat en général. - (40) |
| ravou, s.m. gros rat. - (38) |
| ravouair : ravoir - (57) |
| ravougeau, ravougeot, ravouseau. s. m. Rat des champs, loir, lérot. (Guillon, Argenteuil, Argentenay). – Voyez raveux. - (10) |
| ravougeot, ravou : lérot - (48) |
| ravougiot : loir. (MM. T IV) - A - (25) |
| ravouiller. v. - Réveiller : « L'Martial i' m'a fait goûter sa goutte, a ravouillerait un mort ! » - (42) |
| ravouillou, s. m. petit rat. désigne en général un animal de petite espèce, une bestiole. - (08) |
| ravoujot (n.m.) : Ioir, lérot (aussi ravouyot) - (50) |
| ravoujot, s. m. rat. - (08) |
| ravourgis. s. m. Chauve-souris. (Serrigny). - (10) |
| ravousot, loir. - (28) |
| ravout : loir, ou rat dormant. - (33) |
| ravoux et ravoiseux. C'est le nom bourguignon du loir. - (13) |
| ravouzeu : un loir - (46) |
| ravouzeû, espèce de gros rats. - (16) |
| ravu : part, pass, du v. ravoir. - (20) |
| rawoi v. Ravoir, récupérer. - (63) |
| rawu p.p. de rawoi Dz'ai eu biau frotter, dz'l'ai pas rawu, la tatse est pas partie. On dit aussi, dz'l'ai pas ramnée ou rue ou ré-ue ou encore ré-aijue. - (63) |
| rayan : Rayon. « L'assiètte est su la rayan du vasselier ». - (19) |
| rayâtin, raipoustin : remontrances, disputes reçues - (37) |
| rayé (rèïé), vn. se faner aux rayons du soleil (en parlant du foin récemment coupé). - (17) |
| râye, voix forte ; el é ein bon raye, il a la voix forte ; rayé, crier fortement. - (16) |
| rayeur, sf. reflets, lueurs lointaines d'incendie. Rougeur dans le ciel. - (17) |
| râ-yin, s. m., raisin. - (40) |
| râ-yin, s.m. raisin. - (38) |
| râyins : raisins - (37) |
| râyon (n.f.) : raison - (50) |
| râyon : raison - (39) |
| râyon : raison. - (32) |
| râ-yon, s. m., bâton pour lisser les draps du lit. - (40) |
| râ-yon, s.f. raison. - (38) |
| ra-yot, s.m. gros bâton. - (38) |
| râ-yure, s. f., rayure. - (40) |
| râzigno, petite plante grasse, à fleurs jaunes ou blanches, qui croit dans des terrains secs et sur les murailles. - (16) |
| razin : raisin. - (29) |
| râzin, raisin : du latin racemus dont il n conservé la lettre a. - (16) |
| râzin, raisin. - (26) |
| râzon : fond de casserole, nuage noir à l'horizon - (43) |
| râzon, raison ; évoi râzon, avoir le bon droit pour soi ; se dit aussi dans le sens de : querelles, d'altercations ; évoi dë râzon avou kékun, avoir des altercations avec quelqu'un. - (16) |
| râzonè, s'excuser par de vains motifs de ne pas faire une chose commandée ; é n'fô pâ tan râzoné. - (16) |
| r'bailler (se), v. réfl. se révolter, résister avec force - (08) |
| r'baillon, s. f rébellion, résistance à la loi. - (08) |
| r'beau : un crapaud - (46) |
| r'becter (se). v. - Se remettre, se rétablir. - (42) |
| rbedoïllé, vt. repriser, recoudre, réparer (un vêtement). - (17) |
| r'beiller : redonner - (48) |
| r'beiller, v. a. redonner, donner une fois de plus, rendre, restituer. (voir : beiller.) - (08) |
| r'beuillai : retourner le sol comme le porc avec son groin, remuer des papiers. - (33) |
| r'beuillè : regarder longuement, avec insistance, curiosité et envie - (46) |
| r'beuillé : v. t. Remuer, fouiller. - (53) |
| r'beuille, s. m. second labour donné à une terre en sombre ou jachère. - (08) |
| r'beuille-merde (n.m.) : bousier - (50) |
| rbeûiller (v. int.) : rester dans l'inaction, rêvasser (syn. reûiller) - (64) |
| r'beuiller (verbe) : fouiller la terre à la manière d'un sanglier Plus généralement fouiller à la recherche de quelque chose. - (47) |
| r'beuiller : fouiller, remuer - (48) |
| r'beuiller, erbeuiller. Remuer la terre avec le groin (se dit du porc). Fig. Mal labourer et par extension, mal faire son travail. Mettre tout, sens dessus dessous. - (49) |
| r'beuiller, rabeuiller. v. - Farfouiller, bouleverser, remuer. - (42) |
| r'beuiller, v. a. bouleverser le sol en fouillant. S'emploie principalement en parlant des porcs qui renversent la terre avec leur groin. - (08) |
| r'beuiller, verbe transitif : remuer, mettre sens dessus dessous. On l'emploie aussi au sens figuré pour dire peiner ou remuer. - (54) |
| r'beuillon, rebuillon. Remue-ménage pour nettoyer. On dit : « faire le r'beuillon ». - (49) |
| r'beurer : recoudre, réparer un vêtement - (48) |
| rbeuyé (ē), vt. regarder bêtement, fixement ou avec insistance. - (17) |
| r'beûyè, regarder longuement et niaisement une personne ou une chose : ké k'tu r'beûye don, r'beûyou ? - (16) |
| rbicler (v. tr.) : redonner des forces, revigorer (syn. rdûler) - (64) |
| r'bilè : v. t. Écarquiller les yeux. - (53) |
| r'biquè, r'drossé : v. pr. Se redresser. - (53) |
| r'biquer : redresser (se) - (48) |
| r'blanchir (se). v. - Se changer en mettant des vêtements propres. - (42) |
| r'blanchir (Se). v. pron. Mettre du linge blanc, des vêtements plus propres que ceux que l'on porte d'habitude. Se dit fréquemment dans la classe ouvrière. - (10) |
| rboché, vt. rembarrer. Voir rebâré. - (17) |
| rbolé, rboulé adj. De mauvaise humeur, grognon, écoeuré, rassasié. - (63) |
| rboler (se) v. 1. Geindre. 2. Se mettre en boule pour se protéger du froid. 3. Se mettre en colère. 4. Faire la grimace. - (63) |
| r'boler, erboler, rebouler (se, s'). Se renfrogner, contracter ses traits pour exprimer son mécontentement, sa mauvaise humeur. « N'te r'bole don pé tant les uillots » (yeux). - (49) |
| r'boller, pleurer - (36) |
| r'boquè : avoir mauvaise haleine - (46) |
| r'botnè : v. t. Reboutonner. - (53) |
| r'boulè : v. t. Rembarrer, renvoyer, rejeter vivement. - (53) |
| r'bouler : ouvrir tout grand (les yeux), écarquiller - (48) |
| r'bouler, verbe transitif : ouvrir les yeux tout grands, faire de gros yeux. - (54) |
| r'bouler. v. - Écarquiller les yeux : « Reuillant eune baraque de bobêches qui r'boulaint en rigant des dents. » (G. Chaînet, En chicotant mes braîsons, p.33) - (42) |
| r'boullai : rembarrer, renvoyer, rejeter vivement. I v'lo rentrai, i meus fait d'le r'boulai : il voulait rentrer, il eut mieux fait de le renvoyer. - (33) |
| r'bouteux (on) : rebouteux - (57) |
| rboûtsi v. Reboucher. - (63) |
| r'brâtè : exp. Faire demi-tour. - (53) |
| rbrâter v. (du lat. pop. brachitare, tourner) 1. Retourner. 2. Rebuter. - (63) |
| rbrotsi v. Semer (une céréale) deux années de suite au même endroit. - (63) |
| r'brousse-pouè : rebrousse-poil - (48) |
| r'campanser : Compenser rebeurer : Rapiècer. « Rebeurer eune veille chemije ». Peu usité. - (19) |
| r'campense : Récompense, terme usité en matière d'affouage quand un lot paraît valoir moins que les autres on y ajoute un lot supplémentaire qu'on appelle « r'campense ». - (19) |
| rcaquilli v. Rejeter un aliment en crachouillant. - (63) |
| r'cas, recas. s. m. Nom sous lequel on désigne, à Coulours, l'huile de seconde pression. Quand on a pressé une première fois, on casse les tourteaux, on les fait chauffer, et puis on les remet sous la presse. - (10) |
| r'casse, r'passe. n. f. - Huile de deuxième pression, synonyme de recassis. - (42) |
| rcatoïllé, vn. faire le goûter de quatre heures. - (17) |
| r'cevouair : recevoir - (57) |
| rchan-ner (v. int.) : hennir, en parlant du cheval - (64) |
| r'chatrai : réparer grossièrement une déchirure. - (33) |
| r'châtrer : recoudre grossièrement, raccommoder - (48) |
| r'chignai ses dents : se moquer, rire de… - (33) |
| r'chigni : rechigner - (57) |
| rchimbi : ressembler - (51) |
| rchimbyi v. Ressembler. - (63) |
| r'chingi : rechanger (bien habillé) - (57) |
| r'chôde; coucher à la r'chôde est coucher dans un lit non refait. - (16) |
| r'chouaingè (se) : v. t. Se rechanger. - (53) |
| r'chouaingeai (se) : se changer de vêtements (voir chouaingeai). - (33) |
| r'chouinge : rechange - (48) |
| r'cipè : v. t. Recouper, retailler. - (53) |
| r'cipe. Rognure (terme minier) ; petit rondin obtenu en rognant une traverse ou un étai trop long. - (49) |
| r'ciper, erciper. Rogner, raccourcir. - (49) |
| r'ciper, verbe transitif : couper, tailler. - (54) |
| rcmenchi v. Recommencer. - (63) |
| rcognaîte v. 1. Reconnaître. 2. Vérifier l'appoint d'un paiement. - (63) |
| r'coin (on) : recoin - (57) |
| r'compenser, v. a. récompenser. - (08) |
| rçon, eurçon, sm. hérisson. - (17) |
| r'conâssan, reconnaissant, celui qui se souvient d'un bienfait. On donne particulièrement le nom de r’conâssance à un don offert pour un service rendu. - (16) |
| r'connaissab' : adj. Reconnaissable. - (53) |
| r'constitution (na) : reconstitution - (57) |
| r'construction (na) : reconstruction - (57) |
| r'copè : v. pr. Se contredire. - (53) |
| rcoper v. Recouper. - (63) |
| r'cori d'deux, cf. ordir. - (38) |
| r'counnaîte. v. - Reconnaître. - (42) |
| r'counniaichance (na) : reconnaissance - (57) |
| r'counniaissant : reconnaissant - (57) |
| r'cours (on) : recours - (57) |
| rcoutsi v. Recoucher. - (63) |
| rcouvri v. Recouvrir. - (63) |
| r'covri, v. a. recouvrer, prendre, saisir, attraper quelque chose qui flotte, qui s'échappe. - (08) |
| rcratsi v. Recracher. - (63) |
| r'creusi - r'creuilli : recreuser - (57) |
| r'croqu'villi (se) - rengreum'saler (se) : recroqueviller (se) - (57) |
| r'croqu'villi : recroquevillé - (57) |
| r'çu (on) : reçu - (57) |
| r'cueilli : recueillir - (57) |
| r'dalle (na) : ridelle - (57) |
| rdère v. Redire. Y'a ren à rdère. - (63) |
| rdeursi : redresser - (51) |
| r'distribution (na) : redistribution - (57) |
| rdô : rebut de bois après sciage. A - B - (41) |
| rdon : gaillet gratteron (ou lape*). A - B - (41) |
| rdôs n.m. Planche portant encore un peu d'écorce, chute de sciage. - (63) |
| r'dosse : dosse, crôute de bois - (48) |
| r'doub'illement (on) : redoublement - (57) |
| r'douillè : rabrouer - (46) |
| r'douiller, verbe transitif : gronder, réprimander. - (54) |
| r'douiller. v. - Houspiller, se débarrasser de quelqu'un sans ménagement : «J'te la r'douill'rais ben leu' médecine, avec ieu drogue et ieux saletés. » (Fernand Clas, p.64) - (42) |
| rdoux n.m. Redoux. - (63) |
| r'draer, v. redresser. - (38) |
| r'dressement (on) : redressement - (57) |
| rdressi v. Redresser. - (63) |
| r'driler : redresser - (60) |
| r'drossé, r'biquè : v. t. Redresser. - (53) |
| r'drosser : redresser - (48) |
| rdrûler (v. tr.) : revigorer (syn. rbîcler) - (64) |
| r'druler, r'drussir. v. - Retrouver des forces, redevenir dru. - (42) |
| rdyen : s. m. regain. - (21) |
| rdzaïlli v. Repousser dru. - (63) |
| rdzaïllon n.m. Voir dzaïllon. - (63) |
| rdzaïlloñni v. Voir rdzaïlli et dzaïlloñni. - (63) |
| rdzepé : qui fait ricochet - (43) |
| rdzeter v. Rejeter. - (63) |
| rdzimber : se rebeller, se défendre après une réprimande (forme déformée de regimber). A - B - (41) |
| rdzimber : se défendre après une réprimande - (43) |
| rdzimbeux, rdzimbeuse adj. Récalcitrant. - (63) |
| rdzimbi v. Regimber. - (63) |
| rdziper : faire ricochet, gicler, éclabousser (syn. dziper*). A - B - (41) |
| rdziper v. (du v.fr. giber, agiter les membres, sursauter) Bondir, sauter (en parlant d'un objet). - (63) |
| rdzipper : qui fait ricochet - (34) |
| rdzôlé : synonyme du précédent. A - B - (41) |
| rdzôper v. (variante de rdziper) Rebondir. - (63) |
| rdzuer v. Rejouer. - (63) |
| rê : demi-litre en fer blanc. (CST. T II) - D - (25) |
| ré, n.m. mesure de la crème. - (65) |
| rë, petit vase pour mesurer le lait, la crème, les graines. Remplir rë une mesure est la remplir jusqu'à son sommet. - (16) |
| ré. Mesure de lait à Dijon et aux environs; elle-vaut un demi-litre ; ré désigne aussi l'instrument en fer blanc, à queue perpendiculaire qui contient cette quantité de lait et avec lequel on le mesure. - (12) |
| re. : Ce réduplicatif est très fréquemment employé dans le patois bourguignon, pour ajouter du nerf à l'expression. - Re s'ajoute même au verbe être comme réduplicatif dans le dialecte comme dans le patois. « Alcune fois en sunt plus fer (firmi) cant il resont déhurteit (pressés, renversés). » (S. B.) - (06) |
| réaiju p.p. du v. rawoi. Voir ru. - (63) |
| réambre ou rambre. : (Remunerare), indemniser d'un dommage. · (Charte de 1229.) Rambre était aussi reproduire un acte, en faire la grosse (Roq.), comme si l'on donnait le reminiscere, le souviens-toi de la minute de l'acte. - (06) |
| rebaiquai (se). : Se révolter contre des remontrances. Ce mot se compose du réduplicatif re et du mot bai (bec). On donne l'épithète de rebecca à une jeune fille qui réplique au lieu d'écouter de bons avis. - (06) |
| rebalter. v. a. Couper le haut des talles de la vigne, lorsqu'elles depassent les paisseaux. (Perrigny-lès-Auxerre). - (10) |
| rébarbaratif, adj., rébarbatif. - (14) |
| rebarbé (se), vr. se révolter. Voir revarpé. - (17) |
| rebâré, vt. mettre à la porte avec des reproches. - (17) |
| rebàte, s. f., meule verticale des moulins, servant à gruer l'orge. - (14) |
| rèbaubi (ō), vt. embellir, rajeunir, remettre à neuf. - (17) |
| rebauche (à), en abondance, à foison. - (40) |
| rebauler, et rebôler. v. intr., pleurer, gémir, crier très fort, pleurer en criant. S'emploie comme bauler, dont il est cependant le réduplicatif : « D'abord que j'le quitte, ce p'iiot, ô s'met à r'bauler. » - (14) |
| rebecquai, se révolter contre l'autorité... On dit, en Bourgogne, rébecca pour qualifier un enfant insoumis... - (02) |
| rebéquer (se), v. pr., se rebifïer, se révolter. En Bourgogne, ou appelle rebecca un enfant insoumis. - (14) |
| reberdauler, v. tr., refaire mal quelque chose : « Ce diâbe d'carloû, ô m'a drôlement r'berdaulé mes souleis ! » (V. Rabistoquer.) - (14) |
| rèbesse : pluie importante, on dit également rabasse - (46) |
| rébëti, abêtir ; é n'vo fô pâ l’rébëti, se dit à un homme, en lui parlant de son enfant auquel il inflige de trop fréquentes corrections. - (16) |
| rebeuillé, regarder de nouveau. C'est un réduplicatif de beuillé. (Voir ce mot.) - (02) |
| rebeuiller (v.t.) : retourner la terre dans tous les sens - (50) |
| rebeuiller : fouiller. - (09) |
| rebeuiller : redonner (voir : r'beiller). - (56) |
| rebeuiller : regarder en dessous. - (66) |
| rebeuiller : remuer tout pour chercher quelque chose. (B. T IV) - S&L - (25) |
| rebeuiller : remuer, mettre du désordre. (RDM. T II) - B - (25) |
| rebeuiller : retourner la terre - (44) |
| rebeuiller, qu'il ne faut pas confondre avec rebuyer, c'est regarder fixement quelqu'un, ouvrir de grands yeux, comme font les bœufs. Qu'ai-que t'ai don ai me rebeuiller quemant un ébécile ? Le dictionnaire de Roehefort dit beuiller : dans quelques villages on dit rebôler (ne pas confondre avec réboler)... - (13) |
| rebeûiller, rebuyer, et reveûiller, v. intr., chercher en remuant avec désordre, mettre sens dessus dessous, fureter, bouleverser : « As-tu fini de r’beùiller dans mes afâres ? » - (14) |
| rebeuiller, regarder avec curiosité. - (28) |
| rebeuiller, v. ; labourer la terre pour la deuxième fois. - (07) |
| rebeuiller. v. - Chercher, remuer, farfouiller. - (42) |
| rebeuiller. v. a. Donner à la vigne une deuxième façon. (Guillon). - (10) |
| rebeuiller. v. n. et v. a. Fureter, chercher, fouiller mettre de menus objets en désordre. (Prégilbert). - (10) |
| rebeuilleux : ventre (celt. beuil : ventre). - (32) |
| rebeûillon, s. m., bulles d'air, bouillonnement que le poisson fait monter à fleur d'eau. - (14) |
| rebeurer, v. a. remettre en partie à neuf, réparer un objet brisé ou use : on « r'beure » un panier en le raccommodant par endroits ; on « r'beure » des bas, une robe en y mettant des pièces. - (08) |
| rebeurot, s. m. la partie d'un bas qui est en mauvais état et qu'il s'agit de réparer, de refaire, surtout de rempiéter. - (08) |
| rebeuroter, v. a. refaire un bas, le rempiéter. (voir : rebeurer.) - (08) |
| rebicher (se) : se décoller. (S. T III) - D - (25) |
| réblorger. Déborder ; du latin vergere, répandre, verser. - (03) |
| rebôche (à), en masse, beaucoup. - (38) |
| rebœquelli, v. n. redresser avec exagération jusqu'à pencher en arrière. - (22) |
| rebœquœllyi, v. n. redresser avec exagération jusqu'à pencher en arrière : il est fier, il en rebœqtuœllye ! - (24) |
| rebôguyer : (r'bôkyè - v. tr.) : rabattre au marteau une pointe de clou qui dépasse. - (45) |
| réboissi. Rabassai, rabaissas, rabaissa. - (01) |
| rebolé : de mauvaise humeur (tr. lit. : en boule). A - B - (41) |
| rebolè : v. t. Rabâcher. - (53) |
| rébolement, s. m. pleurs, cris, lamentations : des « rébolements » sans fin. - (08) |
| réboler (Chal., Br., Mbrv.). – Crier ; se lamenter ; vient peut-être de l'augmenatatif ré et balare, bêler? Il existait en vieux français un verbe reboler signifiant frapper à nouveau, comme fait la boule au jeu de quilles, et par suite, repousser. Dans ce dernier sens, le verbe rebillier était plus fréquemment employé. - (15) |
| réboler (v.t.) : pleurer en gémissant. - (50) |
| reboler : Faire mauvais accueil, rabrouer. « Je veux pas y r 'torner o m'a bin treu rebolé ». - (19) |
| réboler : pleurer avec bruit. VI, p. 4-10 - (23) |
| réboler : pleurer fort et longtemps, comme un veau qui appelle sa mère en bolant et en rébolant. - (62) |
| rebôler das euillos : (r'bôlè dé:z œyo - v. intr.), rouler les yeux, les écarquiller. - (45) |
| réboler : (rébolè - v.intr.) pleurer à chaudes larmes, sangloter. - (45) |
| reboler : v. n., vx fr., geindre. - (20) |
| reboler, gémir, pleurer, réboler. - (04) |
| réboler, pleurer en criant, est l'augmentatif de boler ; (V. ce mot). Al ast teut ébeité d'aivoir pardu sai fiJle : an l'entend réboler tant que lai neut dure. Ces deux verbes sont une forme de bêler. - (13) |
| réboler, v, se lamenter, crier beaucoup. - (38) |
| rebòler, v. a. repousser méchamment, renvoyer avec aigreur (vieux français). - (24) |
| réboler, v. n. pleurer avec bruit, répandre des larmes en se lamentant, en gémissant. on dit d'une personne qui pleure sans cesse qu'elle ne « dérébole » pas. (voir : boler.) - (08) |
| reboler, v., regarder en l'air en riant. - (40) |
| réboler. Pleurer. Etym. balare, bêler, se plaindre en répétant ses cris, et l‘augmentatif ré. - (12) |
| rebolisé, réprimander sèchement ; en latin repulsare... - (02) |
| rebollai : sangloter. - (33) |
| rebollé : de mauvaise humeur - (34) |
| réboller : pleurer, sangloter - (48) |
| réboller : pleurer - (39) |
| rebor (à), loc., à rebours. - (14) |
| rebor. Rebours. Ai rebor, à rebours. Rebor adjectif, rebours, signifie revêche… - (01) |
| réborger, v. intr., déborder, passer par-dessus les bords ; « O prend tant de sôpe, que son assiéte en réborge. » - (14) |
| reboter, v. n. regarder en dessous. - (24) |
| rebôtre. Remettre. - (01) |
| rebouerger : rallier. (MM. T IV) - A - (25) |
| reboufer, v. intr., saillir, ressortir avec gonflement, bouffer : « Sapeùrju ! la bàll' robe qu'alle avòt ! pou darrei, y r'boufòt c'ment eùne marmite. » - (14) |
| rebouisai. : Repousser quelqu'un, l'accueillir par des gourmades. (Du latin repulsare.) Les Picards disent rebésir. - (06) |
| reboulé : de mauvaise humeur - (44) |
| reboulé ée, adj., rechigné, revêche. - (11) |
| reboulé, v. a. repousser méchamment, renvoyer avec aigreur. - (22) |
| reboule-euillots, s. m. celui qui ouvre de grands yeux par surprise ou frayeur. On prononce généralement « r'bôle-euillots. » - (08) |
| rebouler (Chal., Br., Morv.), erbouler (Morv.), ribouler, riboler (C.-d.). -Ce verbe qui ressemble beaucoup par la forme à réboler, en diffère complètement par le sens. Il signifie remuer, rouler en tous sens, principalement en parlant des yeux. Du vieux français reboule ou riboule ; bâton servant à remuer la braise. Suivant Durandeau, rebouler signifiait plutôt faire de gros yeux comme çeux des boeufs. Cette opinion est conformé à celle de La Monnoye… - (15) |
| rebouler (revolvere) les yeux, les tourner d'un air hagard, menaçant. - (04) |
| rebouler : rouler. - (09) |
| rebouler des yeux. Rouler les yeux. - (03) |
| rebouler des zieù, loc., rouler des yeux, faire les gros yeux : « L'peut drôle ! tout l'temps ô me r’boule des zieù,.. On diròt qu'ô va m'miger. » - (14) |
| rébouler : reboucher, niveler un trou - (39) |
| rebouler, erbouler (v.) : "rebouler las oeuillots" = rouler les yeux en tous sens - ne pas confondre avec réboler = crier en gémissant - (50) |
| rebouler, erbouler, v. n. rebouler les yeux, les rouler en tous sens en regardant autour de soi. « erbouler : al erboule las jous (yeux) coume ain chat qu'a lé pattes dan lai braige », il roule les yeux comme un chat qui a les pattes dans la braise. - (08) |
| rebouler, v. faire les gros yeux. - (38) |
| rèbouli : (rèbouli - v. trans.) combler (un trou). niveler (un terrain accidenté). - (45) |
| rebouller : rouler les yeux en tous sens. - (52) |
| reboulu : part, pass., vx fr. rebolé, rassasié, dégoûté. Etre reboulu de nourriture, de misère, d'une personne, etc. Voir regoulé. - (20) |
| reboulu, adj. rassasié, dégoûté, rebuté. - (22) |
| reboulu, adj. rassasié, dégoûté, rebuté. - (24) |
| rebourgeonner. v. n. Raconter les choses comme elles sont. (Percey). - (10) |
| rebouté, e, part. passé. remis en santé, rétabli : « i seu été mailaide, ma i seu bin r'bouté », j'ai été malade, mais je sais bien rétabli. - (08) |
| rebouté, v. n. regarder en dessous. - (22) |
| rebouter, repousser. - (04) |
| rebouter, v. a. remettre en place, raccommoder un membre disloqué. Rebouter signifie littéralement remettre. - (08) |
| rebouter. v. - Tordre le bout d'un clou, d'un fil de fer, etc. ( Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| rebouteu, s. m. le « rebouteux » de nos campagnes est celui qui raccommode plus ou moins mal les membres des animaux et quelquefois même ceux du pauvre monde. - (08) |
| rebouteux (n.m.) : celui qui répare et remet les membres en place - (50) |
| reboutie, rboutié, vt. rebouter. - (17) |
| reboutiou, rboutiou, sm. rebouteur. - (17) |
| rébraillai, crier fort haut et de rechef ; c'est un composé de la préposition réduplicative et du mot braillai. (Voir ce dernier mot.) - (02) |
| rebramer. v. a. et n. Récrier. Le cerf brame et rebrame. – On dit aussi, figurement, d'un homme qui se plaint vivement d'avoir faim et soif, qu'il rebrame la faim et la soif. - (10) |
| rébrandinè (se) : se balancer. (RDT. T III) - B - (25) |
| rebras : Tournant. « O n'a pas bin pris le rebras » : il n'a pas bien pris le tournant. - (19) |
| rebrasser. v. a. Accoler les jeunes sarments. (Serrignj). - (10) |
| rebratai, retourner sur ses pas, relever un vêtement. Dans la langue d'Oïl, rebras signifie replis d'une robe, et rebrasser c'est relever, replier. - (02) |
| rebratai. : Remanier une chose, comme si l'on disait employer de nouveau ses bras. Il ne faut pas confondre avec rebrasser, parce que rebras signifiant dans le dialecte les replis d'un vêtement, rebrasser c'est relever, replier ou retrousser ce vêtement. - (06) |
| rebrâtè : v. pr. Se retourner. - (53) |
| rebrater : retourner en sens inverse. (RDM. T IV) - B - (25) |
| rebrâter : Retourner. « Je nos étains trampés de chemin i a fallu rebrâter ». - (19) |
| rebrater : v. a. et n.. retourner ; au flg. : rebuter, repousser. Voir brater. - (20) |
| rebrater, v. n. rebrousser chemin, « brater » deux fois. - (24) |
| rebrater, v. retourner une voiture attelée pour la ramener dans la direction opposée. - (38) |
| rebrâter, v., retourner une voiture, pour revenir. - (40) |
| rebrauté, v. n. rebrousser chemin, « brauter » deux fois. - (22) |
| rebreûches : Restes que le bétail laisse dans la mangeoire ou le ratelier. - (19) |
| rebreuchi : Labourer peu profondément une terre qui vient d'être moissonnée. - (19) |
| rébreuiller, crier pour se plaindre. - (10) |
| rebreuiller, v. ; crier ; tai maigeon breûle, les petiots sont dedans qu'al en rébreuillent. - (07) |
| rebreyer. v. n. Ruminer. (Percey). - (10) |
| rebricher, passer à rebrousse-poil. - (28) |
| rebricher. Retrousser, et aussi rebrousser chemin. Etym. bas latin rebursus, rebours, contre-poil, contre-chemin. - (12) |
| rebro, r'bro, s.m. reste. - (38) |
| rebrocher : v. n., vx fr. rebrochier, semer du blé ou une autre céréale deux années de suite dans la même terre. - (20) |
| rebrousse-pouai (à) : rebrousse-poil - (57) |
| rebruller ; labourer pour la première fois un terrain qui s'est reposé. (S. T III) - D - (25) |
| rebufade. Rebuffade. - (01) |
| rebuillement : Remue-ménage, bouleversement. « S't'affâre a fait bien du rebuillement ». - (19) |
| rebuillon (r'buyon), rebuillonnage : s. m., ménage. Faire son rebuillon. Etre en rebuillonnage. - (20) |
| rebuillon, s. m., dérangement, bouleversement. Faire le rebuillon, mettre tout sens dessus dessous, mais pour nettoyer et remettre en place ensuite. La bonne ménagère fait souvent le rebuillon. - (14) |
| rebu'llan : Action de faire le ménage à fond en déplaçant et replaçant tous les objets pour les nettoyer « Fare le rebu'llan ». - (19) |
| rebullet (C.-d.), rebuyer ou rebùller (Br., Chal.), rebeuyer (Char.), rebeuiller (Y.), reveuiller (Br., Y:). - A le même sens que lrebouler et probablement la même origine, mais s'applique de préférence aux objets. C'est remuer, fureter, chercher avec le sens de bouleverser, mettre sens dessus dessous. Le rebuyon ou rebeuillon signifie dérangement, bouleversement, remue-ménage ; le grand rebuyon est un nettoyage exceptionnel qui nécessite un dérangement total avant la remise en place des objets dans une maison… - (15) |
| rebu'lli : Remuer, mettre en désordre, faire le rebu'llan. « T'as pas fini de rebu 'lli ? ». - (19) |
| rébuter Tirer au but pour savoir qui sera le premier. - (12) |
| rebuyer : mettre en désordre. - (31) |
| rebû-yer, v. secouer, faire le ménage, remuer avec violence. - (38) |
| rebû-yer, v., nettoyer en secouant. - (40) |
| rebuyer. Fouiller dans les rebuts, se dit des animaux et des personnes. Les couchons se plaisant ai rebuyer teute lai jornée. — Mâs qu'èque te pense don de rebuyer dans leus les coins de lai mâson... - (13) |
| rebû-yon, s. m., nettoyage de printemps. - (40) |
| rebû-yon, s.m. ménage. - (38) |
| rec’moder : raccomoder. - (62) |
| recacoiller. v. n. Se dit des noix qui perdent leur coque verte avant leur maturité. (Mâlay-le-Vicointe). - (10) |
| récafaudis : éclats de voix. (F. T IV) - Y - (25) |
| recalai, répliquer vertement à quelqu'un... - (02) |
| recalai. : Répliquer vivement (du latin recalere, s'échauffer de nouveau). - (06) |
| recander, v. a. fatiguer à l'excès, éreinter. (voir : arcandié.) - (08) |
| récanement, hennissement de satisfaction. - (05) |
| recansoler : Consoler. « Ses héritiers ant bien été asseteu recansolés ». - (19) |
| récaper, réchaquer ou répaquer : Rattraper au vol une chose qu'on jette. « San chin récape bien ». - (19) |
| recaquiller : v. a., rejeter un aliment en crachouillant. L'enfant qui mange sa bouillie en recaquille toujours un peu de chaque cuillerée. - (20) |
| recaquœlli, v. a. recracher des aliments à moitié mâchés. - (22) |
| recaquœlli, v. a. recracher des aliments à moitié mâchés. - (24) |
| reçarcer (v.t.) : rechercher - (50) |
| recarrelaige, s. m. pavage en carreaux ou en dalles, pavage en général. - (08) |
| recarreler, v. a. paver avec des pierres, des dalles, des carreaux, etc. - (08) |
| recarreloux : s, m., carreleur de souliers. - (20) |
| recasse. s. f. Voyez r'cas. Huile de recasse. (Villiers-Saint- Benoît). - (10) |
| recasser : modifier l'assolement par la succession de 2 céréales (seigle après blé) - (43) |
| recasser. v a. Semer une seconde fois du blé dans un champ qui vient d'en donner. (Perrigny). – Labourer en travers des sillons. (Tonnerre). - (10) |
| recassis. n. m. - Plusieurs usages : 1. Goûter, quatre heure. 2. Deuxième ensemencement d'un champ dans la même année. 3. Labour exécuté perpendiculairement aux premiers sillons. (Tannerre, selon M. Jossier). 4. Second passage au pressoir pour la noix et le colza. - (42) |
| recassis. s. m. Labour fait en travers des sillons. (Tannerre). - (10) |
| recassis. s. m. Sorte de goûter, de petite collation faite entre deux repas. (Auxerre). - (10) |
| récationai, régaler... - (02) |
| recercer, v. a. rechercher, poursuivre. on prononce « r'cercé. » - (08) |
| recès. s. m. Partie d'une rivière, en dehors du chenal navigable, où les mariniers garent et mettent leurs bateaux à l'abri. – Les pêcheurs donnent aussi le nom de recès aux excavations plus ou moins profondes dans lesquelles se cache, se retire quelquefois le poisson. Du latin recessus. - (10) |
| rec'eulans (à) : En reculant. - (19) |
| rec'euler : Reculer. « Rec 'euler pa mieux sauter ». - (19) |
| reçeupé, recoupé, vt. récéper, couper par le pied un gros branchage, un baliveau. - (17) |
| réceure - (39) |
| réc'eurer : Récurer. « Réc 'eurer les casseroles ». « Réc 'eurer san chaudron » : aller à confesse. - (19) |
| rec'eute : Etat d'un lit qui n'a pas été fait. « Couchi à la rec 'eute », on dit aussi à la réchaude. - (19) |
| receveur : s. m., ouvrier qui, à l'atelier, reçoit dans ses mains les pièces façonnées sortant des machines. - (20) |
| recevoi : recevoir - (43) |
| recevoi : Recevoir. « Alle reçoit bien san mande ». - (19) |
| recevon. Recevons. - (01) |
| recevou : s. m., vx fr. receveor, réservoir. Voir baignoire. - (20) |
| rechagner : v. a., vx fr. rehaner, singer quelqu'un en sa présence, par moquerie ou impatience ; lui faire des reproches. Voir rechigner. - (20) |
| rechainge. Rechange, rechanges, rechangent. Dans la langue des nourrices de Dijon, rechanger un enfant, c'est lorsqu'il a gâté son linge, lui en donner de blanc. - (01) |
| rèchaipe, sf. action d'échapper. Être de rechaipe, être en fuite, hors de danger. - (17) |
| rechairgner, v. a. rechigner, imiter les gestes ou le langage de quelqu'un, contrefaire, singer autrui. dans quelques parties du « reçaigner » ; ailleurs « écharnir. » - (08) |
| réchaké, recevoir dans les mains un objet qu'on vous lance ou qui tombe de haut. - (16) |
| réchandî, v. tr., réchauffer : « Fais eùne flambée ; j'voudrôs ben m’réchandi l'bout des dèts. » - (14) |
| réchandir. Réchauffer. - (03) |
| réchandre : Réchauffer. « J'ai coru pa me réchandre ». - (19) |
| réchandre : réchauffer. « Y réchant » : çà donne chaud. - (62) |
| réchandre, réchaindre, réchaindrer : v. a., échauder, réchauffer. Voir échandir. - (20) |
| rechandre, réchauffer. - (05) |
| réchandues : Bouffées de chaleur. « Je ne sais pas ce que j'ai i me prend des réchandues à tot moment » - (19) |
| rechaner, rechagner. v. n. Braire, hennir. - (10) |
| rechaner, rechanner. v. - Braire. - (42) |
| rechàner, v. intr., hennir. - (14) |
| rechantrer, v. a. mettre une jante à une roue, réparer le cercle en bois de la roue. (voir : chantre.) - (08) |
| réchappe (de), loc. sain et sauf, ce qui a échappé à un danger : ils ont tous péri, il n'y en a qu'un de « réchappe. » - (08) |
| réchappe : part, pass., réchappé. Il a été bien fatigué, mais le v'là réchappe. - (20) |
| réchaquè : attraper, rattraper - i â réchaquè lè bâle et peu i â renviè, j'ai rattrapé la balle et je lui ai renvoyée - (46) |
| rechaquer : rattraper. (E. T IV) - VdS - (25) |
| rechaquer, recevoir ce qu'on jette. - (05) |
| réchaquer, v. rattraper. - (38) |
| réchaquer, v. tr., recueillir, rattraper, recevoir, saisir au vol quelque objet qu'on vous jette : « Réchaque donc l'iau dans ton bassin. » — « Hé ! jéte-me des cerises ; j'vas les réchaquer. » — « Coume te réchaques ben l’volant ! ô n'tôche tant s'ment pas la raquéte. » - (14) |
| recharche : Nom féminin, quête en nature des conscrits. « Les conscrits fiant la recharche aujourd 'heu ». - (19) |
| recharchi : Rechercher. « Y est eune affare régliée i n'y a plieu ren à recharchi » - (19) |
| réchargnier : se moquer de qqn. (voir : rechairgner, écharni). - (56) |
| récharner : Tourner les gens en dérision en imitant ou en contrefaisant leur langage ou leurs tics. « Ol a la vilain-ne habitude de récharner le mande». - (19) |
| rechâtrè : recercler une roue - (46) |
| rechâtrer : recoudre grossièrement, raccommoder - (48) |
| rechâtrer, v. a. raccourcir le cercle d'une roue pour le rajuster lorsqu'il est disloqué. (voir : chântre.) - (08) |
| rechâtrer. v. - Raccommoder à la va-vite, synonyme de raboulâtrer - (42) |
| rechâtrue, rechâtrure, erchâtrue. n. f. – Raccommodage grossier, vite fait. - (42) |
| rechâtrure, erchâtrure. s. f. Réparation maladroite d'une déchirure. (Gisy-les-Nobles). - (10) |
| rechaud (au), loc. : « S'coucher au r’chaud » c'est se coucher sans faire son lit entièrement. On appelle encore cela retaper son lit. Mauvaise coutume de quelques ménagères qui craignent leurs peines. - (14) |
| rèchaud, sm. réchaud. - (17) |
| rechaude (A la) : loc, dans un lit non fait. Coucher à la rechaude. - (20) |
| rechaude (coucher à la), loc. coucher une deuxième fois dans un lit non refait. - (22) |
| rechaude (cuchi à la), loc. coucher une deuxième fois dans un lit non refait (du préfixe re et de chaud). - (24) |
| réchaude (se). Se réchauffer. - (49) |
| réchaude : Voir rec'eute. - (19) |
| réchaufai. Réchauffé, réchauffez, réchauffer. - (01) |
| réchauferdi. s. m. Chaud et froid causant une maladie. Il a pris un réchauferdi. (Saint-Martin-sur-Ouanne). - (10) |
| réchauferdir (Se). v. pronom. Avoir chaud et froid. (Ibid.). - (10) |
| réchaufferdi. n. m. - Chaud et froid : « Il est ben malade, il a attrapé un réchaufferdi en rentrant l'houais. » Synonyme de chaud-rafferdi. - (42) |
| rechausser, v. a. rechausser une roue c'est mettre à neuf les jantes, les garnir d'un nouvel embattage de fer ou de bois. - (08) |
| rechausser, v., verser une nouvelle rasade. - (40) |
| rechaussi : Rechausser, réparer un outil usé, le reforger en remplaçant le métal que l'usure a fait disparaître. - (19) |
| rêche, adj. difficile de caractère, ombrageux, susceptible. - (11) |
| rèche, s. f., teigne de la barbe. - (40) |
| rèche. Rude. - (49) |
| réchèdre, v. a. réchauffer. - (24) |
| rechée : Sieste. « Fare rechée » : faire la sieste. - Dicton : « Quand la feuille bouche l'yeu an peut fare rechée », quand la feuille de vigne est assez grande pour couvrir l'œil les jours sont assez longs pour qu'on puisse faire la sieste. - (19) |
| récheindre, v. a. réchauffer. - (22) |
| rechéler : v. n., vx fr. chacler, touffer, repousser plus touffu. - (20) |
| réchetai. Racheté, rachetez, racheter. - (01) |
| récheter, v. tr., racheter. - (14) |
| récheti. Rachetai, rachetas, racheta. - (01) |
| recheurter, v. a. rasseoir, asseoir une fois de plus. (voir : cheurter.) - (08) |
| réchie : voir arsie - (23) |
| réchignè : v. t. Imiter. - (53) |
| rechigner : imiter, faire comme, répéter - (48) |
| rechigner : refuser avec mauvaise humeur. - (09) |
| rechigner et récheigner. Se moquer, imiter la voix, la démarche et les gestes de quelqu'un. I dirai ai mossieu le mâte que te ne fais van que me rechigner... - (13) |
| réchigner ou rechigner. Contrefaire quelqu'un avec moquerie ; c'est un sens nouveau que nous donnons au mot rechigner. - (12) |
| rechigner : v, a., vx fr. reschignier, singer (voir rechagner), repousser. I m'a r'chigné du coude. - (20) |
| rechigner, erchigner. Faire la grimace à quelqu’un, en le contrefaisant pour le tourner en ridicule, l'insulter. - (49) |
| rechigner, mal accueillir. - (05) |
| rechigner, repousser un mets. - (28) |
| rechigner, v. tr., singer, contrefaire, imiter en raillant, mal accueillir : « Poui ! c'musiau d'singe-là, ô r'chigne tout l'monde. » - (14) |
| rechigner. Contrefaire quelqu'un. - (03) |
| rechignou, adj. moqueur. - (38) |
| réchiquer : rattraper - (57) |
| rechlliou (odeur de), loc. odeur d'humidité, de renfermé. - (22) |
| réchodre : Relever, employé dans cette expression. « Le temps se réchot » : les nuages s'élèvent, le ciel s'éclaircit. - (19) |
| rechoinger, v. a. changer, échanger de nouveau : « i é r'choingé d' chemie », j'ai changé de chemise. - (08) |
| réchoquer. Rattraper quelque chose qu'on vous jette. A Chalon, on dit réciiaquer. - (03) |
| rechoupe, s. f. éclat détaché d'une souche d'arbre. (voir : erchoupe, reussope.) - (08) |
| réchuer (v.t.) : ressuer - (50) |
| rechûte, bâtiment en appentis. - (05) |
| rechyiou (odeur de), loc. odeur d'humidité, de renfermé (du vieux français reclos). - (24) |
| rëci, éloge ; faire un gran rëci de quelqu'un est faire un grand éloge de lui. - (16) |
| récie : voir archie - (23) |
| recie et son diminutif rechinoy signifient repas, collation, comme dans la langue romane d'Oïl... - (02) |
| récie : sieste. - (32) |
| récie, s. f., goûter, ou petite collation après le repas du soir. Répétition du souper. - (14) |
| récie. : A deux diminutifs pour exprimer deux phases différentes de l'appétit : ce sont les mots rechinoi et rôssignon ; ce dernier se traduit par régalade. - (06) |
| récimorau : Nom que donnaient les écoliers de mon temps (1850) à un livre de lecture intitulé : Récits moraux et instructifs. « Je sais pas ce que j'ai fait de man récimorau ». - (19) |
| réciner, v. tr., faire la récie. - (14) |
| reciner. Goûter. « Fàre lai recie basse », c'est goûter dans la vigne. Peut-être du latin recenare. - (13) |
| recipe : petit copeau provenant de l'abattage des arbres. (BD. T III) - VdS - (25) |
| reciper : fignoler une souche. - (31) |
| reciper : Recéper, couper proprement au ras du sol la souche d'un arbre abattu. - (19) |
| rècitier, vt. réciter. - (17) |
| récliamer : Réclamer. « Ol a tojo quéque chose à récliamer ». - (19) |
| reclous : s. m., vx fr., reclus, renfermé. Ça sent le reclous ici. - (20) |
| recmander : recommander - (43) |
| rec'mencé : v. t. Recommencer. - (53) |
| rec'mencer, v. tr., recommencer. - (14) |
| recmenci : recommencer - (43) |
| rëcô ! est le plus dur des noms qu'un père, irrité contre son enfant, puisse lui donner ; c'est sans doute un parallèle de notre mot racaille. - (16) |
| recodai, se souvenir de. I me recode de celai. « Je me souviens de cela ; » c'est le même sens que le mot latin recordari. Par extension, nos villageois disent du maître d'école : Ça lu que recode not gaçon. « C'est lui qui enseigne la lecture ou l'écriture à notre garçon. » ... - (02) |
| recodai. : Se souvenir. I me recode de celai, je me souviens de cela. (Du latin recordari.) Par extension, on a donné à ce mot le sens d'apprendre aux autres ce qu'on sait, ce dont on se souvient. C'est la transformation d'un verbe réfléchi en un verbe actif. - (06) |
| récodan. Se récodant, se souvenant. On dit bien recorder sa leçon, quand on la répète afin de s'en souvenir ; mais on ne dit plus en français se récorder d'une chose pour dire s’en souvenir. - (01) |
| récode. Souviens, souvient, souviennent. « Quant i me récode », quand je me souviens. - (01) |
| recodier, vt. recorder, rappeler au souvenir. - (17) |
| récoeudre* (se), v. r. se garer. - (22) |
| recognaître : reconnaître - (43) |
| recogné. Recogner, recognez. - (01) |
| recogner (Se), r'cogner (Se). v. pron. Se remettre en état, se guérir, se rétablir. (Sainpuits). - (10) |
| recogner (se). v. - Se rétablir, « se retaper ». - (42) |
| recommachi : Recommencer. « Y est c 'ment la chansan du poulot roge qu 'a quatre vint dix neu couplets a peu quand y est fini an recommache ». - (19) |
| récompenser : payer autrement qu’avec de l’argent un travail fait - (37) |
| recondre : v. a., vx fr, rescondre, cacher. Soleil recondant, soleil couchant. Soleit recondu, soleil couché. - (20) |
| récondre, v. n. se coucher, en parlant du soleil (du vieux français rescondre (coucher). Latin recondere). - (24) |
| récondre, v. n. se coucher, en parlant du soleil. - (22) |
| recondure, v. a. reconduire, accompagner. Au participe passé « recondu : i l'é r'condu cheu lu », je l'ai reconduit chez lui. - (08) |
| reconfotai. Réconforter. Reconfort pour consolation, conforter et réconforter, pour consoler, se trouvent dans le nouveau dictionnaire de l'Académie, comme des mots d'usage. - (01) |
| reconnaissabye (adj.m, et f.) : reconnaissable - (50) |
| reconnaitre (reconnaître) (Se) : v. r., s'acquitter d'une dette de reconnaissance. - (20) |
| reconnaitre (reconnaître) : v, n., vérifier l'appoint d'un paiement. Voulez-vous reconnaître ? - (20) |
| reconsoler : consoler - (44) |
| reconsoler : v. a., consoler. Y a pas quinze jours qu'elle a perdu son homme ; elle est d'jà toute r’consolée. - (20) |
| reconsoler, v. consoler. - (65) |
| réconté, raconter : koi k'te nô réconte ! dit-on à quelqu'un à la parole de qui l'on ne croit pas. - (16) |
| reconvreuti : reconvertir - (43) |
| recopage : Coupage, mélange de vins de différentes qualités. « Les marchands fiant des recopages de neutés vins d'ave les vins du midi » - (19) |
| recope : Recoupe, farine tirée du son remoulu. - (19) |
| recoper : Faire des coupages. Au pressoir recoper signifie couper de nouveau une partie du bloc de marc pour le presser une seconde fois. - (19) |
| recoper : recouper - (43) |
| recôqueriller, v. tr., recroqueviller, racornir par le feu : « L'pauv'petiot ! l’feù a pris ché eusses ; on n'a pas pouvu l'sauver. Quand on l'a r'treùvé dans les c'nises, ôl étôt tout recòquerillé. » - (14) |
| recôquillai, racorni ; en latin recoctum, parce que c'est l'effet du feu de racornir les objets, recoquere en latin. - (02) |
| recoquillé. : Racorni par le feu. (Du latin recoctum.) Recocrillé, qu'on emploie plus généralement, est un barbarisme. - (06) |
| recoquiller (Se) : v. r., se rengorger, se redresser d'un air vaniteux. - (20) |
| recòquœyi (se), v. r. dépérir, se recroqueviller. - (24) |
| recorder (se), v. pr., se ressouvenir. - (14) |
| recorder. v. a. Faire lire. (Rogny). – Faire apprendre une leçon par cœur. (Etivey). - (10) |
| recordon. s. m. Fruit avorté. (Etivey). - (10) |
| recore, sauver, secourir; au participe passé recous, sauvé ; en latin recuperatus. On dit, en vieux français, aller à la recousse, c.-à-d. aller au secours de quelqu'un, lui prêter assistance. - (02) |
| récore. Sauver, recourre, dans le sens qu'on dit recourre un prisonnier, avec cette différence entre le français recourre, et le bourguignon récore, que l’e de la première syllabe de recourre est féminin, et que celui de récore est masculin… - (01) |
| rècotchir : raccourcir - (46) |
| récoti, raccourcir. - (26) |
| récou. Recous… - (01) |
| rècouailler : récrier. (SB. T IV) - C - (25) |
| recouaner. Braire. On lit, dans un bestiaire du XIIe siècle : « come l'asne sauvage qui plus est afami plus s'efforce de braire et de récaner. » Récaner, d'où nous avons fait ricaner, c'est rire sans bruit, en montrant les dents. Le langage enfantin a conservé le mot de canottes et quenottes, dents. - (13) |
| recouchée : s. f., marcotte. - (20) |
| recoucher : v. a., coucher. - (20) |
| recoucher, v. marcotter la vigne. - (65) |
| recougnaichance : Reconnaissance. - (19) |
| recougnaitre : Reconnaître. « Je l'ai pas recougnu ». Terme de chasse éventer la piste du gibier. « Y a in lièvre man chin recougnait ». - (19) |
| récouinai, désirer ardemment une chose. El en récouine, c.-à-d. il n'y tient pas. Dans l'idiome breton, rec'huz signifie inquiet, et rec'hi s'inquiéter. (Le Gon.) Notre mot français rechigné signifie avoir un air contracté par le déplaisir ou par la mauvaise humeur. - (02) |
| récouinai. : Avoir grande envie d'une chose. (Voir au mot chouinai dont il paraît être un réduplicatif.) - (06) |
| récouiner ou récouigner. Pleurer. Voyez couiner. - (12) |
| recouiner. Crier·. On dit aussi recainer. - (03) |
| récoulter. v. - Récolter. - (42) |
| recounaissu, part. de recounâtre, reconnu. - (14) |
| recounâtre, v. tr., reconnaître, observer, découvrir. - (14) |
| recoupette, n.f. son très fin. - (65) |
| recouquelli (se), v. r. dépérir, se recroqueviller. - (22) |
| recouquiller. v. - Recroqueviller, rentrer dans sa coquille : « Alle prit ben vite ça au sérieux, a s'récouquilla coumme eune couisse qui couve son premier oeu. » (Fernand Clas, p.286) - (42) |
| récourci, raccourcir, par exemple, une branche d'arbre, en la taillant. Ce mot s'emploie aussi, comme substantif, dans le langage des couturières : fâr ein récourci. - (16) |
| récousse ; v'ni ai lai récousse de kékun, venir au secours de quelqu'un qui se trouve dans un grand danger. - (16) |
| récousse. Aide, secours. - (01) |
| recoutrer, raccoutrer. v. a. Raccommoder, (Montillot). - (10) |
| recouvri : part, pass., recouvert. Voir couvri. - (20) |
| recouvri, v. a. recouvrer. (voir : r'covri.) - (08) |
| recoy. : (En latin receptum), cachette. (Franch. de Seurre, 1278.) - (06) |
| récoy-in, abri. - (26) |
| recracher aux mains (Se) : loc, se raccommoder (au flg.). - (20) |
| recrèche : s. f., débris de fourrage ou d'aliments laissés dans la crèche par le bétail. - (20) |
| récrépissi. C'est l'aoriste bourguignon de raccroupir, qui exprime parfaitement la manière dont Elisée se raccourcit pour ajuster autant qu'il pouvait sa taille à celle de l'enfant… - (01) |
| recreuchis. s. m. Mauvaise huile. (Pasilly). - (10) |
| récrié, crier fortement ; s'récrié, se plaindre hautement d'une chose. Une personne est récrië, quand de mauvais bruits circulent contre elle ; dans ce sens, récrié est le parallèle du mot français décrier. - (16) |
| recrinssi, v. a. recroqueviller, resserrer. - (24) |
| recroire. : (Du latin re-crescere), augmenter le prix d'une chose. (Franch. de Seurre, 1278.) - (06) |
| recrue. s. f. Petit bois qui longe une pièce de terre. (Chevillon). - (10) |
| recrure. Reculer, être poltron ; vieux mot. - (03) |
| récuerlai : pleurer. O récuerlot : il pleurait. - (33) |
| recueulons (ai lai), loc. adv. à reculons. - (17) |
| reculoir, s. m., avaloire (pièce de harnais, pour faire reculer la voiture). - (40) |
| reculoir. Culière. - (49) |
| récupairè : v. t. Récupérer. - (53) |
| rècuré, vt. écurer. - (17) |
| récure. Écure, écures, écurent. - (01) |
| récuré. Écurer, écurez. Ceux qui font rarement leur dévotions disent, allant à confesse, qu'ils vont écurer leur chaudron. - (01) |
| récurer, écurer. - (05) |
| récurer, et récueùrer, v. tr., écurer, nettoyer : « Putôt que d'tailler des bavétes, va donc récueùrer tes chaudrons. » - (14) |
| récurer. Écurer. - (49) |
| récuron, s. m., lavette, mauvais linge à écurer. - (14) |
| récuron, torchon de paille ou de chiffon pour le nettoyage des marmites. - (16) |
| récuron. Torchon à écurer, lavette. - (01) |
| reçvô, vt. recevoir. - (17) |
| redaire : redire - (43) |
| redan : (redan - subst. f.) redan, épaulement, renfoncement, butée, glissière. Par exemple, on appellera redan les ressauts d'un mur bâti sur un terrain en pente pour conserver le niveau. - (45) |
| redarguer. : (Re- arguere), répliquer. (Franch. de Couchey, 1386.) - (06) |
| redébôguyer : (r'débôkyè - v. tr.), redresser, pour le chasser, la pointe d'un clou qu'on avait rabattue. - (45) |
| redeû : Planche plane d'un côté, convexe ou irrégulière de l'autre. Dans un lot provenant du sciage d'un tronc d'arbre il y a toujours deux « redeus », ce sont les deux planches qui sont à l'extérieur du bloc. - (19) |
| redevaler, redescendre, redevoler. - (04) |
| redevance (A la). locut. adv. Au-devant. – Aller à la redevance de quelqu'un, aller au-devant de lui. - (10) |
| redevance : s. f., vx fr. devancie. Couper la redevance à quelqu'un, passer transversalement devant quelqu'un de manière à le retarder ou à l'arrêter, - (20) |
| redevoler, v. a. redescendre, descendre une autre fois. (voir : devoler, raivoler.) - (08) |
| rédicule, adj., ridicule, et aussi petit sac que les dames portaient jadis au bras et qu'elles reprennent maintenant. - (14) |
| rédié*, v. a. raccommoder le linge, ravauder. - (22) |
| rédier, v. a. raccommoder le linge, ravauder. - (24) |
| redisoo ou redizò. Redisait, redisais. - (01) |
| redôble. Redoubles, redouble, redoublent. - (01) |
| redonder v. n. Sauter, rebondir. (Soucy). - (10) |
| redos : s. m., plateau extrême d'un tronc d'arbre débité en longueur, par conséquent brut d'un côtë et plan de l'autre. - (20) |
| redoublier : Redoubler. « La pliôt redoub'lle ». Terme de chasse, tirer un second coup de fusil sur le même objectif. « J'ai manqué man lièvre au premé cô mâje l'ai redoub 'llié ». - (19) |
| redouiller, v., refuser à un examen. - (40) |
| redouiller. v. a. Houspiller. - (10) |
| redoux : Température plus douce. « Après in greux hivé an est bien âge de voir veni le redoux ». - (19) |
| redoux : s. m., dégel, retour du temps doux après le froid. - (20) |
| redrachi : Redresser. « Se redrachi » : se tenir droit, marcher fièrement. - (19) |
| redressi : redresser - (43) |
| redreussi. Rudressa, fit marcher droit. - (01) |
| rëdure, réduire ; i* seû rëdu, dit-on quand on est fatigué au point de ne pouvoir plus continuer un travail on quand ce travail est achevé. On dit aussi : rëdùre lai meûre, pour : dessécher la saumure et en retirer le sel qu'elle contient. - (16) |
| rèdure, vt. réduire. - (17) |
| redzeuiller : rejouer - (43) |
| redziper : ricocher - (43) |
| rée (masc.) : mesure à lait. (REP T IV) - D - (25) |
| rée. : (En latin reus). C'était le défendeur dans un procès, le demandeur se nommait acteur (du latin actor), c'est-à-dire agissant. - (06) |
| réenter : v. a., renier, rempléter. - (20) |
| réenture : s. f., action de réenter. Voir rentage. - (20) |
| réesté : v. i. Rester. - (53) |
| réétios : n. f. Faux équipée d'un râteau en bois qui recueille les tiges à mesure qu'elles tombent et les empêchent de se mêler. Râteau à 3 doigts pour l'orge, 4 doigts pour le blé, 5 doigts pour l'avoine, beaucoup plus rare celui à 2 doigts pour l'herbe. Appelé également « javelier » par nos amis canadiens et « rastell » dans le midi de la France. - (53) |
| refaire : v. n., répéter, prendre une nouvelle consommation. - (20) |
| réfectouaire : n. m. Réfectoire. - (53) |
| refére (se), v. réfl. changer en s'améliorant, prendre de la vigueur, de l'embonpoint, s'embellir. - (08) |
| rèffauder (se) : se brûler superficiellement. (EDSEA. T II) - A - (25) |
| reficher (Se). v. pron. Reprendre son aplomb, se replanter sur ses pieds, se rattraper après avoir perdu l'équilibre. (Percey). - (10) |
| reficher, refechier : v. a., vx fr. refichier, raffermir, redresser. - (20) |
| rèfièchi, vt. réfléchir. - (17) |
| refier (Se) : v. r., vx fr., se lier. - (20) |
| réflétci : réfléchir - (51) |
| réflexian: Satiété. « Faut pas êt' crainti, faut miji à ta réflexian ». - (19) |
| réflexion : s. f., réfection. Manger, boire à sa réflexion. - (20) |
| refœchi (se), v. r. se redresser avec fierté, se tenir « fœche ». - (22) |
| refœchi, v. a. redresser en enfonçant davantage v. r. se redresser avec fierté, se tenir « fœche ». - (24) |
| refougné, adj. qui est enfoncé dans ses habits. - (38) |
| refouiller. Se dit de quelque chose qu'on a mangé et qui vous fait mal au cœur ; même origine que farfouiller. - (03) |
| refourrée. s. f. Ration de fourrage pour les bestiaux. (Villiers-Bonneux). - (10) |
| refourrer. v. a. Donner aux animaux domestiques leur ration de fourrage. (Ibid). - (10) |
| refoux : hirsute. - (32) |
| refradi : Refroidir. « Le temps s'est bien refradi ». - (19) |
| réfraidi : refroidir - (57) |
| réfraidiss'ment (on) : refroidissement - (57) |
| refredi : refroidir - (43) |
| refredi, v. a. refroidir. - (24) |
| refregni : renfrogner (se) - (43) |
| réfrié, v. a. refroidir. - (22) |
| réfrignòlé, adj., frileux, refroidi : « J'ai fait, à c'maitin, eùn tôr su la levée ; mâ i f'sòt eùne bise du diâbe. . . j'seû tout réfrignòlé. » - (14) |
| refrillé, ée. adj. Qui a froid, qui grelotte. (Annay-sur-Serein). - (10) |
| refrillé, refroidi. - (28) |
| réfriller, v. a. refroidir. ne s'emploie guère qu'au participe passé. être « refrillé », avoir froid ou plutôt être refroidi. (voir : friller.) - (08) |
| réfriôdi, celui qui a peine à se réchauffer. - (16) |
| réfriquer (se), v. pr., se réjouir d'avance : « Les griôtes seront bentôt meùrtes ; i m’réfrique d'en miger. » — « J'vons-t-i nous obuyer à c'te fête ! Je m’réfrique d'y ginguer. » - (14) |
| refrôdji, vt. refroidir. - (17) |
| refromer, v. a. refermer, fermer de nouveau. (voir : fromer, enfromer.) - (08) |
| regâ : Regard. « Ol est c 'ment le rend o n'a que le regâ », allusion à la fable de La Fontaine, « Le renard et les raisins ». - (19) |
| regadò. Regardais, regardait. - (01) |
| regadon. Regardons. - (01) |
| regadure, visage , regard ; de l'italien riguardo. - (02) |
| regagni : regagner - (43) |
| regain (subst. m.) première repousse de l' herbe après la fauchaison. - (45) |
| regairdan, ante, part. présent de regairder. regardant, économe jusqu'à l'avarice, celui qui n'a pas bon cœur. Au féminin « regairdante. » - (08) |
| regairder, v. a. regarder, faire attention à... prendre soin de... on dit d'un fils dénaturé qu'il ne « regarde » pas son père. - (08) |
| régalade, plaisir que procure un lion feu, quand on revient froid du travail. - (16) |
| régalai, dans le sens de répartir, distribuer également, vient de rega, travailler légèrement la terre avec la charrue. (Le Gon.) Dans le même idiome breton, régez (Le Gon.) signifie braise. De là vient cette expression très commune dans nos campagnes : régaler le feu, c.-à-d. ajouter au foyer de nouveaux aliments. - (02) |
| régalant (pas), répugnant. - (27) |
| régaler. : (Dial. et pat.), répartir également la terre en la cultivant. (Du latin oequare, aplanir, accompagné du réduplicatif, comme dans une infinité de mots.) - (06) |
| regamer : repousser. - (56) |
| regâmer : (r'gâ:mè - v. neutre) repousser, donner des rejets, en parlant des tubercules et de toutes les plantes en général excepté les céréales (voir r'trouèché). - (45) |
| regâmer, v. n. repousser, pousser de nouveau : les seigles sont gelés, mais ils vont « regâmer. » - (08) |
| régaudi, se réjouir ; d'où régaudon, et non pas rigaudon. On doit dire danser un régaudon (en latin, re gaudere.) ... - (02) |
| régaudi. Réjouir. - (01) |
| régaudi. : Se réjouir (du latin gaudere, avec le réduplicatif), d'où l'on devait dire danser un régaudon et non pas un rigaudon. - (06) |
| régaudir (se), v. pr., se réjouir, se divertir, s'ébattre : « Dà ! hier, à l'aport, j'ons fricoté, j'ons bu, j'ons dansé ; j'nous sons prou régaudis ! » - (14) |
| regaugner, v., remettre un nerf. - (40) |
| régaume (n. m.) : mixture, préparation culinaire d'aspect répugnant (syn. barbaude) - (64) |
| régaume. n. m. - Plat douteux, pas appétissant. - (42) |
| rège, s, f., sillon, raie qui sert de sentier dans les terres. - (14) |
| rège. Sillon. - (03) |
| régeignai, regignai, requignai, et, selon La Monnoye, rejannai, contrefaire quelqu'un ; en bas latin, gannare, se moquer. Les Picards disent rejongler. Dans le Châtillonnais, on dit rejauner ; mais c'est un barbarisme de mots. - (02) |
| regen-nai : hennir ou rire en se moquant. Tu peux toujours regen-nai mais ço pas drole pour mouai : tu peux toujours rire mais ce n’est pas drôle pour moi. - (33) |
| régen'ner : braire, hennir, rire en se moquant - (48) |
| reget, regipeau, regipiau, regipiace : s. m., vx fr, regipaux, reget et regetoere, raquette, piège à prendre les petits oiseaux. - (20) |
| regiber, remuer, reziper. - (04) |
| regigner (v.) : faire la grimace en montrant les dents - (50) |
| regigner : montrer les dents - (48) |
| regigner, v. n. faire une grimace en montrant les dents. - (08) |
| regingaut : s. m., vx fr. rejault, retour de fête, répétition de fête. - (20) |
| regingner, imiter les paroles ou les actes de quelqu'un pour s'en moquer, singer. - (27) |
| regingo : dimanche qui suit celui- de la fête patronale. (CH. T III) - S&L - (25) |
| regingo : Seconde fête qui se fait une semaine après la première. « Si te veux pas veni à la fête vins au regingo ». - (19) |
| regingo : se dit d'une perche pliée qui, une fois libérée, se redresse brutalement. - (33) |
| regingot, n.m. grand repas, bon repas. - (65) |
| regingot, s. m. repas de famille qui se donne à l'occasion du baptême d'un nouveau-né. - (08) |
| regingou, s. m., lendemain de fête. - (40) |
| reginguer, v. intr., regimber, se rebiffer. N'est pas le réduplicatif de ginguer : « Ô n'é pas ben c'mode ; drès qu'on li fait eùne reprémande, ô r'gingue. » - (14) |
| reginguer. v. - Regimber, ruer. - (42) |
| reginguer. v. n. Regimber, sauter, ruer, cabrioler. (Annay-sur-Serein). - (10) |
| reginguet : s. m., vx fr, ginguet, vin de petite qualité, vert, aigrelet. - (20) |
| regipais, n. masc. ; piège qui se redresse. - (07) |
| regipement, s. m. action de regimber, de se débattre, de remuer les bras et les jambes, de s'agiter violemment. - (08) |
| regiper (Chal.), C.-d., Br.), regiber (Morv.). - Se débattre, lancer des coups de pieds, regimber, résister ; du même mot vieux français. A beaucoup d'analogie comme sens avec le mot dinguer (Voir plus haut). - (15) |
| regiper (se) : rebiffer (se), remuer (se) - (48) |
| regiper (se) : se détendre. - (32) |
| régiper (se) ou s'argiper : se rétablir, se démener - (61) |
| regiper (se) : (se r' jipè - v. pron.) se rebiffer violemment (cf. se r'vêrpè) - (45) |
| regiper (se), v. se rebiffer, se dit d'un enfant qui donne de coup de pieds. - (65) |
| regiper (v.t.) : débattre - se regiper (v.pr.) : s'agiter - (50) |
| regiper : Rebondir, soubresauter. « En copant du beu je m'en sus fait regiper in bout pa le nez ». - (19) |
| regiper : v. n., regimber, ruer, se débattre. - (20) |
| regiper, ergiper. v. n. Sauter, sautiller, regimber, tressaillir. (Vassy-sous-Pisy). – Se regiper. v. pron. Prendre sa revanche, se rebiffer. (Champinelles). - (10) |
| regiper, v. intr., gigoter, tressaillir, lancer des coups de pieds, se débattre avec des soubresauts : « Quand j'vons li bailler l'titi, à ce p'tiot, ô r'gipe tô c'ment eùne sarpent. » — « L'pauvre houme ! ôl é bé mau ! ô n'peut pu r'giper. » — Quand il est hors de l'iau, le poisson regipe. — La forme pronominale de ce verbe (se regiper) n'en change presque pas l'acception. Ainsi, dans les exemples cités, on pourrait aussi bien dire : « Se regipe. » - (14) |
| regiper, v. n. se démener, se débattre des pieds principalement. « erziper. » - (08) |
| regiper, v. se redresser ; si t'y écrases lai téte ai une sarpent, sai quoue se regipe. - (07) |
| regiper, v., se débattre, se défendre. - (40) |
| regiper. Remuer, donner du pied ; vieux mot. - (03) |
| regiper. Se débattre, agiter les membres dans tous les sens. Etym. forme locale de regimber, qu'en vieux français on trouve souvent sous la forme regiber et même giber. - (12) |
| régiper. Sursauter. On prononce souvent : « ergiper ». - (49) |
| regipiâs : piège à détente (ressort ou arbre bandé). - (32) |
| regipiau : collet à chevreuil. - (66) |
| regipiau. s. m. Petit tronc d'arbre, rejet, nouvelle pousse. (Bligny-en-Othe). – Ressort, réaction, rebondissement. (Rogny). - (10) |
| regippai, rejaillir, regimber. - (02) |
| regipper, sauter, sursauter. - (05) |
| réglier : Régler, solder « Y en a que sant pas pressis de réglier ». - (19) |
| réglisse en bois : s. m., bois de réglisse. - (20) |
| rég'lle : Régle. « C'en est de rég'lle » : c'est l'usage. - (19) |
| règné*, v. n. suinter, couler légèrement ; se dit pour la futaille seulement. - (22) |
| régne, s. m. régime, état de choses : le « régne » du chaud, du froid, le « régne » de la cherté, du bon marché. un mauvais « régne » est en somme une mauvaise situation. - (08) |
| régner, v. n. suinter, couler légèrement ; se dit pour la futaille seulement. - (24) |
| régner, v. n. vivre, exister, être. On dit d'un homme qui meurt dans sa jeunesse : « a n'é pâ régné longtemps. » - (08) |
| regobeiller, se dit des porcs et des chiens qui reviennent aux matières vomies. - (08) |
| régochir, rattraper. - (26) |
| regoeugnoeu, s, m. rebouteur. Verbe : regoeugni. - (22) |
| regôgner : v. a., rhabiller, rebouter. Voir argôgner. - (20) |
| regogner, restaurer fractures et luxations. - (05) |
| regôgner, v. a. remettre un membre brisé, disloqué. - (08) |
| regogner. v. a. Arrêter. (Quincerot). - (10) |
| regôgneur, regôgneux, regôgneuse, s. m. et f., rhabilleur, rebouteux, rebouteuse. Voir argôgnier. - (20) |
| regôgnou, n.m. rebouteux. - (65) |
| regôgnou, s. m. praticien de campagne qui est à la fois médecin, vétérinaire et sorcier. (voir : gôner, gougneur.) - (08) |
| regognou, s. m. rebouteur. Verbe regogni. - (24) |
| regôgnoux : rebouteux, regôgner : remettre en place. - (32) |
| regoguiller : redonner de la force. (EDSEA. T II) - A - (25) |
| régoguiller. Rendre gai. Lai petite goutte que te m’ai beillée m'ai regoguillé. A rapprocher de gai, gogue, etc L'argot parisien et ses imitateurs provinciaux disent rigoler. - (13) |
| régoillardi, se ragaillardir, s'animer, s'embellir... - (02) |
| régoillardi. : (Dial. et pat.), animé, embelli. - (06) |
| regon, s. m., graisse de porc, épiploon. - (40) |
| regonchyi : regonfler - (43) |
| regondale, n. fém. ; grosse étoupe. - (07) |
| regondée : trop-plein qui remonte - (60) |
| regoner (se) : rhabiller (se) - (43) |
| regonfler : v. n., refluer. - (20) |
| regonnes, s. f. déchet, rebut de la filasse, du chanvre. N'est usité qu'au pluriel : les « regonnes » du chanvre. (voir : plain.) - (08) |
| regordzi : regorger - (43) |
| regôrge (avò à), loc. avoir à profusion, regorger. - (22) |
| regòrge (avoué à), loc. avoir à profusion, regorger. - (24) |
| regougneux : rebouteux. - (30) |
| regoulé (r'goûlé) : adj., rassasié, dégoûté. J'en suis toute regoulée, soûle comme du pain moisi ! Voir reboulu. - (20) |
| regoule, s. f. rigole. - (22) |
| regoule, s. f. rigole. - (24) |
| regounalé, v. a. réparer sommairement et â peu de frais. - (22) |
| regraipi, rattraper, ressaisir de nouveau. (Voir au mot gripai.) Dans le Châtillonnais, on dit encore d'un joueur qui avait perdu et qui gagne : Il se ragripe... - (02) |
| regraipi. : Rattraper, regagner. - (Du latin re-arripere, ressaisir.) - On dit encore d'un joueur qui perdait, il se ragrippe. - (06) |
| regraitou, adj. sujet aux nausées, qui éprouve du dégoût pour certains aliments. - (24) |
| regreffer, v. a. raccommoder, mettre en réparation : on « regreffe », ses bas, ses habits, ses chaussures. Cela signifie qu'on y met des pièces, qu'on les remet à neuf. - (08) |
| regregni : ratatiné (fruit) - (43) |
| regreni, v. a. rider, ratatiner (du vieux français regrigner). - (24) |
| regrepoter : agripper. (B. T IV) - Y - (25) |
| regresse, s. f. rebut de filasse. (voir : regonnes.) - (08) |
| regret (fare), loc. dégoûter, écœurer. - (22) |
| regret : Confusion, honte. « Y fa regret de voir des choses parailles » : on a honte de voir des choses semblables. - (19) |
| regret : s. m. Faire regret, exciter le déplaisir, la répugnance, la pitié. Ah! que t'es sale; ça fait regret. - (20) |
| regret, s. m., déplaisir, contrariété, peine, chagrin : « I m'fait regret d'vouér ces pauv'gens si maupourtants. » - (14) |
| regrétoeu, adj. sujet aux nausées, qui éprouve du dégoût pour certains aliments. - (22) |
| regretter (Se) : v. r., regretter d'être dans une situation déterminée. Il se regrette à la campagne. - (20) |
| regricher (se). v. - Se rebiffer, tenir tête. - (42) |
| regricher (Se). v. pron. Se redresser, se rebiffer, tenir tête, se révolter. – S'emploie aussi neutralement. Ses cheveux regrichent tellement, qu'on croirait toujours qu'il est mal peigné. - (10) |
| regrignè : faire des plis (correspond au français grigner) - (46) |
| regrigné : grincheux - (44) |
| regrigne : adj. Flétri, froissé, ratatiné. - (53) |
| regrigné : ratatiné, ridé. - (32) |
| regrigné, regreni : part, pass., vx fr. se ragrigner, ridé, ratatiné, recroquevillé ; grincheux, maussade. - (20) |
| regrigné. Ratatiné, ridé, réduit. - (12) |
| regrigner (C. -d., Chal.), ragraigner (C.-d.), rengrigner (Y.). - Se rider, en parlant d'un fruit qui sèche, une pomme ou un raisin de préférence. Du même verbe vieux français (voir ci-dessus grigner), qui a plutôt le sens de grincer. Dans la Côte, se ragraigner veut dire aussi s'attrister, s'assombrir, et dans l'Yonne se rengrigner signifie empirer. - (15) |
| regrigner (se), se dessécher, en parlant d'un fruit. - (40) |
| regrigner (se), v. pr., se rider au moral, s'assombrir : « Pasqu'ô va su l'âge, le père Chose se r'grigne de pu en pu. O craint la môr. » - (14) |
| regrigner (se). Se rider, se ratatiner, se réduire par la dessiccation. - (12) |
| regrigner : froisser. - (29) |
| regrigner, v. se ratatiner en parlant d'un fruit. - (65) |
| regrigner, v. tr., froncer, rider : « L'vieux, ôl a la mine prou peùte ; ô n'fait qu'la r’grigner. » On dit : « Eùne poume regrignée. » - (14) |
| regrigner. An n 'ai pas de fiance ès chiens quiregrignant les dents. Même famille de mots que grincer, grignoter, grigon. Le participe, regrigné, s'applique à un fruit trop vert et chargé de rides. - (13) |
| regroller : v. a., réparer des grolles. - (20) |
| regrolleur : s. m., savetier. Voir grolleur. - (20) |
| regroulé, ée. adj. Qui a froid. – Etre regroulé, avoir froid. (Soucy). - (10) |
| reguegnouler, v. a. réparer sommairement et à peu de frais : reguemoule vite cette brouette. - (24) |
| regueni, e, adj. ridé, qui a des rides, des plis, des crevasses. on prononce « reg'ni. » - (08) |
| réguer : v. n., vx fr., bégayer. J'ai un cousin qui bègue en parlant ; eh ben, vous n'y croiriez pas, i chante aussi bien qu' vous et moi. - (20) |
| regu-er, ergu-er. Labourer en ados, en « regueux ». - (49) |
| reguerner (pour regrener). v. a. Ramasser sur une assiette, sur un plat, les menus restes, les bribes qu'on y a laissés. (Gisy-les-Nobles). - (10) |
| regueurqui : grognon. A - B - (41) |
| regueurqui : grognon - (34) |
| regueux. Ados formé par deux bandes de terre, versées l'une contre l'autre. - (49) |
| reguigné : rétréci, froissé. - (30) |
| reguinfer. v. a. Redresser. (Argentenay). - (10) |
| réguiser. Aiguiser; au figure réguiser a un tout autre sens, il veut dire perdre, détruire. Ex. : « Avec la fluxion de poitrine qu'il a, il est réguisé ! » Etym. aiguiser et l'augmentatif ré. - (12) |
| réguisoux, réguiseur. Aiguiseur, rémouleur. - (49) |
| reguœrni, v. n. rider, ratatiner. - (22) |
| réguser : aiguiser. - (66) |
| réguyou : oiseau dont le cri de crécelle annonce la pluie (aiguiseur). (B. T II) - B - (25) |
| réguzai, aiguiser. Ai réguze son côperô. « Il aiguise ou repasse son couperet » (large couteau de cuisine). En latin, acuere, re acuere, aiguiser... - (02) |
| réguzé, aiguiser ; réguzon, celui qui repasse sur la meule les couteaux, les ciseaux. - (16) |
| réguzer, aiguiser. - (26) |
| régûzer, v. tr., aiguiser, appointir. - (14) |
| régûzoû, s. m., aiguiseur, rémouleur. - (14) |
| reige. Rage. - (01) |
| reigni : Régner, exister. « L 'ac'eu n'a pas reigni langtemps dans leu ménage » : l'accord n'a pas régné longtemps dans leur ménage. - (19) |
| reiguignotter : grignoter, égroter. - (32) |
| rein, ren. Pron. indéf. - Rien. - (42) |
| rei-ne : n. f. Reine. - (53) |
| reiner, v. a. couvrir avec le gros sable appelé areine (voir : areiner.) - (08) |
| Reinette, nom propre, diminutif de Reine. - (08) |
| reingée. n. f. - Colonne vertébrale ou épine dorsale pour les poissons. - (42) |
| reingi, v. a. réparer, raccommoder. - (22) |
| reingi, v. n. ruminer, pour un animal. - (24) |
| reingnée (n. f.) : échine d'une personne ou d'un animal - (64) |
| reingnée. s. f. Colonne vertébrale. (Saint-Martin-sur-Ouanne). - (10) |
| rein-ne (na) : reine - (57) |
| reiñne n.f. Reine. - (63) |
| rein-ne, s. f., reine : « La mignonne Magrite étòt la rein-ne de la fête ; tô l’temps alle a dansé. » - (14) |
| rein-ne. Reine (prononcer « rin-ne »). - (49) |
| rein-nette : n. f. Reinette. - (53) |
| reinte (na) - chaîn-ne du doûs (na) : échine - (57) |
| reitre. Cavalier allemand, de l'allemand reiter, qu'on prononce reitre. - (01) |
| rejaguer. v. n. Ressauter, rebondir. (Bussy-en-Othe). - (10) |
| rejâmner (v.t.) : braire, crier- en parlant des animaux, hennir - (50) |
| réjâner, v., braire (âne). - (40) |
| rejannai, contrefaire quelqu'un. (Voir le mot regeignai.) - (02) |
| rejannai. Contrefaire, par manière d'insulte, le ton et la voix de quelqu'un… - (01) |
| rejannai. : (Pat.), rejanner (dial.), imiter le ton, les manières, ou les ridicules de quelqu'un. (Du bas latin gannare, se moquer). - Ceux qui disent rejauner font un barbarisme. En bon latin, le réduplicatif re et l'infinitif gannire exprimeraient que l'on gronde et que l'on se fâche de nouveau contre quelqu'un. - (06) |
| rejanné : braire. (SY. T II) - B - (25) |
| réjanner : (réjan:nè - v. neutre) hennir. - (45) |
| rejanner, rejaugner, rejogner (pour rechaner). v. a. Echarnir, singer, contrefaire le langage, les gestes de quelqu'un. (Collan, Etivey, Fleys). - (10) |
| réjanner, v. n. se dit du cri des chevaux, des ânes et de quelques autres quadrupèdes. on prononce « ré-jan-né. » - (08) |
| rejanner, v.; hennir (cri du cheval). - (07) |
| réjaquer : saisir au vol. Attraper adroitement un objet lancé. - (62) |
| réjaquer. Même sens que ragaucher, dont il parait au reste n'être qu'une autre forme. - (12) |
| rejauber. v. n. Ricocher, ressauter, rebondir. (Percey). - (10) |
| rejaud. s.m. Ressaut, rebondissement, ressort. – Rejaud de la terre, humidité qui ressort de la terre, qui, l'hiver, se congèle à sa surface et qui, en cet état, se combinant avec la première pluie d'un dégel, forme ce qu'on appelle le verglas. (Saint-Florentin, Puysaie). - (10) |
| rejauler : v. n., syn. de rechéler. - (20) |
| rejauner (verbe) : crier en parlant des chevaux et des ânes. - (47) |
| rejauper, v. intr., rebondir : « Ma balle ? Gageons que j'la fais rjauper pu haut qu'toi. » Se dit aussi d'une personne qui saute lestement : « Le bigre ! ô n'é pas gambi ; ô r'jaupe tô c'nient eùne bique. » - (14) |
| réjé, rager, se dit de celui qui manifeste, avec colère, son mécontentement de ne pouvoir faire ou avoir ce qu'il veut. - (16) |
| rejeuillan : Rejeton produit par les racines. - (19) |
| rejeuilli : Produire des rejetons. « L’agacia est in beu que rejeuille ». Se dit aussi de certaines affections de la peau. « San fareng'lle a rejeuilli ». - (19) |
| rejicler, v. intr., rejaillir. - (14) |
| rejighier, v. n. rejaillir, éclabousser en jaillissant avec force. (voir : jighier.) - (08) |
| réjiner, v. n. même signification que « réjanner.» - (08) |
| rejingau (n.m.) : bon repas ; retour d'une fête (de Chambure note rejingot) - (50) |
| rejingot : bon repas, banquet plantureux. - (32) |
| rejiper (se) : se remuer rapidement. (RDM. T IV) - B - (25) |
| rejœpé, v. a. relever vivement le talon en marchant. Action pour un objet quelconque de se détendre brusquement. - (22) |
| rejœper, v. a. relever vivement le talon en marchant. Action pour un objet quelconque de se détendre brusquement. - (24) |
| rejœpiau, s. m. piège à petits oiseaux, fait d'une baguette qui « rejœpe ». - (22) |
| rejœpiau, s. m. piège à petits oiseaux, fait d'une baguette qui « rejœpe ». - (24) |
| rejoinre, v. a. rejoindre, réunir. on prononce « r'joinr'. » au part, passé, rejoindu. - (08) |
| rejonflai et regonfai, être surabondant. (Voir, pour l'étymologie, au mot goinfre.) ... - (02) |
| rejonflai. : Surabonder, regorger de. - (06) |
| rejonfler. v. n. Sourdre, jaillir. (Soucy). - (10) |
| réjoüi. Réjouir. - (01) |
| rejuissance, s. f. réjouissance. (voir : juissance.) - (08) |
| rékité ; s'rékitè, s'acquitter d'une dette. - (16) |
| relâ : Relier, en parlant des fûts cercler. « In pansan bien relâ ». - (19) |
| relaboré : prairie remise en culture - (43) |
| relâchi : Lâcher à nouveau. « La pliô est arrâte, je vas relâchi les vaiches ». - (19) |
| relachi : Lécher, nettoyer avec la langue. « Se relachi de quéque chose » : la trouver bonne, s'en lécher les doigts. - (19) |
| relâchi : Relâcher. « Ol était bien assidu à l'ovrage mâ vlà quéque temps qu 'o s'est bien relâchi ». - (19) |
| relaper, v. n. se reprendre à quelque chose, recommencer un travail, renouveler un effort. (voir : laper, loper.) - (08) |
| relavan : Lavette, chiffon pour frotter la vaisselle qu'on lave. - (19) |
| relaver : Laver la vaisselle. « Les jos de grande fête an prend eune fane esprès pas relaver ». « Relaver san butin » : se ruiner. - (19) |
| relaver : v. a., laver ; délaver. On dit de quelque chose de délavé ; « Y est r'lavé – r’laveras-tu. » - (20) |
| relaver, v. faire la vaisselle. - (65) |
| relaver, v. tr., laver, mais seulement pour la vaisselle : « V'tu ben aller r'laver tes assiettes; » autrement, pour le linge, par exemple, on dit : laver. - (14) |
| relave-titi, s. m., soutien-gorge. - (40) |
| relaveures : Eau dans laquelle on a lavé la vaisselle. - (19) |
| relaveuse, s. f., laveuse de vaisselle, qu'on prend souvent en aide dans les grandes occasions. - (14) |
| relavouse : Laveuse de vaisselle. - (19) |
| relavure, et relaveùre, s. f., eau sale provenant du lavage de la vaisselle. - (14) |
| rêle. s. f. Crécelle. (Soucy). - (10) |
| rélemai. Rallumer, rallumé, rallumez. - (01) |
| relent, relenteur, mauvaise odeur. - (04) |
| relent. Mauvaise odeur. Tai chambre vai senti le relent si te n’euveure pas les feneites... - (13) |
| releuge : Horloge. « Eune heure de releuge » : une bonne heure ; une heure qui parait longue. « Ol est itié à vos causer des heures de releuge ». Releuge est du masculin, « in releuge ». - (19) |
| réleùmer, v. tr., rallumer : « J'ai étindu la lampe ; faut-i que j'ia réleùme ? » - (14) |
| releuve selle. (V. Selle). - (13) |
| relevai. Relever, relevé, relevez. - (01) |
| relevée, s. f., temps de la journée, à partir de midi. - (40) |
| relève-titi, n.m. soutien-gorge. - (65) |
| relicher, r'licher (se). Se régaler, se délecter. (Barbarisme populaire). - (49) |
| relicher, v. tr,, lécher : » Qu'ô bouéve, qu'ô mainge, le fichu gormand, ô se r'liche tô l'temps la babouine. » - (14) |
| relicher, v., sucer. - (40) |
| relier : v. a., lier. Relier des sarments, un fagot, etc. - (20) |
| religionnou, ouse, adj. religieux, euse. (voir : eurligiou.) - (08) |
| relingé, vêtu de neuf. - (26) |
| relinquer (relinquere), abandonner, laisser, délinquer. - (04) |
| reloge , horloge. - (05) |
| reloge : horloge. - (32) |
| reloge : s. m., horloge. - (20) |
| reloge, horloge. - (02) |
| reloge, s. m. horloge : un vieux reloge. - (24) |
| reloize, horloge - (36) |
| relouaichè : embrasser, lécher - (46) |
| relouge, s. m. horloge : un vieux relouge. - (22) |
| relucher, v. tr., reluquer, lorgner du coin de l'œil. - (14) |
| reluqué (être), trompé dans ses prévisions. - (05) |
| relûre, v. intr., reluire, briller. - (14) |
| relusòt, s. m., étincelle, tison, reste de feu : « O v'lèt s'chaufer les dèts, mâ n'y évòt pu qu'ein r'lusòt dans la chvinée. » (V. Lusòt.) - (14) |
| reluzi. Reluisis, reluisit. - (01) |
| remàgaon, remànon (ChaL), remànence (Y.). - Reste, chose abandonnée, crouton de pain, par exemple ; du latin remanere, rester. Le vieux français a dans le même sens le mot remanet. - (15) |
| remâgnier, v. a. manier une seconde fois, reprendre, retoucher. - (08) |
| remai, balai. - (05) |
| remaice, réprimande. (Voir au mot raimasse.) - (02) |
| remaicheûres : Balayures. - (19) |
| remaichi : Balayer. « La maijan est tojo bien remaichie ». - (19) |
| remâiller : (r'mâ:yé - v. trans.) réparer, rafistoler. - (45) |
| remaisse, sf. [ramasse]. balai. - (17) |
| remaissé, vt. balayer. - (17) |
| remanceu, s. m. rebouteur ; celui qui remet les membres démis ou brisés. (voir : regôgnou, raimoingeou.) - (08) |
| remander : Rapiécer des vêtements. « Ol a n 'neguin pa le remander ». - (19) |
| remander, v, tr., repriser, raccommoder des vêtements, du linge, etc. « Drôl' d'emplâtre ! a’n’sait pas tant s'ment r'mander ses bas ! » - (14) |
| remander, v. a. raccommoder, mettre en réparation des habits ou autres objets déchirés ou gâtés. « ermander. » (voir : aimender, raimender.) - (08) |
| remandrœyi, v. a. raccommoder. - (24) |
| rémanence. s. f. Chose de peu de valeur, abandonnée, delaissée. (Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes). Du latin remanere. – Au plur., rémanences (remanentia), restes d'un repas (Etivey). - (10) |
| remarcie, s. f. remerciement. Une personne à qui l'on a rendu quelque service s'acquitte en vous disant : « ai vot' bonne r'marcie », c’est à dire à votre bon remerciement. - (08) |
| remarcier, v. tr., remercier, rendre grâces. - (14) |
| rémargôtore. Vif, frais, vert, gaillard, enjoué. Cet adjectif est nasculin et féminin. Homme rémargôtore, homme gai, éveillé, fanne rémargôtore, femme gaie, enjouée… - (01) |
| remarquai. Remarqué, remarquez, remarquer. - (01) |
| remasance. : (Quod remanet), le surplus d'une chose. (Cout. de Châtillon, 1371.) - (06) |
| rémâssé, ramasser, par exemple, une chose qui est sur terre; rémâssé du mal, attraper du mal ; rémâssé du foin, des gerbes, les enlever du pré, du champ ; é s'ë fé rémâssé, se dit de quelqu'un qu'on a frappé rudement dans une lutte ou que la justice a saisi. S'rémâssé, se relever d'une chute. - (16) |
| rémasser, v. tr., ramasser, prendre, relever. - (14) |
| rèmati : (rèmati - v. trans. et neutre) (se) ramollir en (s') humectant. Se dit principalement du foin fauché qui a reçu la rosée. - (45) |
| remaugeoù, et remaugeù, s. m., rebouteur, celui qui remet les fractures, les foulures. Ces sortes de raccommodeurs, qui parfois réussissent, sont très courus dans les villages, et la ville n'est pas sans y avoir encore un brin de confiance. Se croire guéri est donc quelque chose? - (14) |
| remauger, restaurer les fractures. - (05) |
| remauger, v. tr., remettre les foulures, les fractures. Quand le rebouteur cherche à remettre en place un membre cassé, un muscle déplacé, il remauge. - (14) |
| remauger. Raccommoder, surtout dans le sens médical ; le docteur remauge les doigts, les jambes, etc. Etym. inconnue. - (12) |
| remauger. Remettre les fractures, ce qu'on appelle ailleurs rebouter. Nous nommons remaugeurs les empiriques qui se mêlent de ces pratiques ainsi que de sortilèges thérapeutiques. - (03) |
| rembalè : v. t. Remballer. - (53) |
| remballer, v. a. rembarrer. - (24) |
| rembârrer : ne pas être d’avoir, « envoyer promener » - (37) |
| rembeillot : nombril. Les groûs ont un bon rembeillot : les gros ont un bon nombril. - (33) |
| rembeurtaller v. Remettre une bretelle de sabot. - (63) |
| rembeuter : (vb) sonner creux, faire de l’écho - (35) |
| rembeuter : sonner creux, faire de l'écho - (43) |
| rembeûter v. Tousser d'une toux caverneuse. - (63) |
| rembillot : n. m. Lombric. - (53) |
| rembonnir, rembounir. v. - Bonifier, rendre meilleur : « Nout vin i' rembonnit ben mieux en bouteille. » De rabonnir, mot français déjà employé au XIIIe siècle. - (42) |
| rembôrrer : Rembourrer. - (19) |
| remborser : Rembourser. « Je li ai prôté quéques sous, je ne sais pas quand o pourra me les remborser, j'ai bien peu qui sait pa la semain-ne des quat jeudis ». - (19) |
| rembotner v. Reboutonner. - (63) |
| remboué'illot : repli - (48) |
| rembounir, rembonnir (pour rabonnir). v a. Ameliorer, redonner, ajouter de la qualité. (Montillot). - (10) |
| remboussiller, v. a. bosseler, causer une enflure, une proéminence. Se dit encore dans le sens d'augmenter le volume d'une chose susceptible de dilatation. - (08) |
| remboussiller. v. a. Recourber, river un clou en le courbant. (Etivey). - (10) |
| remboutonner : v. a., reboutonner. Se remboutonner, reboutonner sa culotte. - (20) |
| rembraichi : Embrasser. « Y est la meude que le Mâre rembraiche l'épôsée ». - (19) |
| rembrincher. v. a. Recourber, river, émousser la pointe d'un clou, d'une aiguille, etc. (Percey). - (10) |
| rembroicher, v. a. rabattre, river une pointe, un crochet, tout objet plus ou moins pointu à l'extrémité. Au fond le sens est repiquer, piquer une fois de plus. (voir : broicher.) - (08) |
| rembruchè : v. t. Remettre en place une chose, un objet sorti de sa place. - (53) |
| rembrucher (se), se cacher dans les épines et les broussailles (sanglier). - (40) |
| rembrucher (se), v. se cacher. - (65) |
| rembruée : Elan. « Prendre sa rembruée » : prendre son élan. - (19) |
| rembrun. s. m. Air sombre, triste ou mécontent que laisse voir une personne sur sa figure. (Etivey). – De rembrunir. - (10) |
| rembruncher. Rembrunir, au propre et au figuré. Ex. : «Le temps se rembrunche, bien sûr il va tonner. » « Pourquoi prenez-vous cet air rembrunche ? » Etym. forme locale de rembrunir. - (12) |
| remburè : remplir, remettre à niveau - (46) |
| remeide. Remède, remèdes. - (01) |
| remeimbrance, s. f., mémoire, souvenir : « J'I'ai voyue quête part ; j'en ai ben eùne idée de r’meimbrance . » - (14) |
| remeimbrer (se), v. pr., se rappeler, se remémorer. - (14) |
| remembrance, apparence sans réalité. - (05) |
| remender : v. a., bas-lat, remendare, raccommoder. - (20) |
| remender, raccommoder les vêtements. - (05) |
| rémené. Ramenez. - (01) |
| remener, v. a. en parlant d'un levain, action de le délayer et de le pétrir avec un peu de farine pour exciter sa fermentation. - (24) |
| rémener, v. ramener. - (38) |
| rementre : Remettre. « Se rementre » guérir. « Ol a été bien malède mâ o commache à se rementre » - (19) |
| remer. : (Dial.), rester (du latin remanere). On trouve aussi dans le dialecte remaigner. - Dans le même dialecte, remesses signifie choses abandonnées et de peu de valeu r; ce mot répond à celui de remaisses du patois. (Voir ce mot.) - (06) |
| remerque, s, f. marque, signe. S'emploie au propre et au figuré. Un chasseur fait des « remorques » dans un bois pour retrouver son chemin en cassant des branches d'arbres, en écorçant quelques tiges sur son passage, en jetant de la mousse sur sa trace, etc… (voir : merque.) - (08) |
| remesse, balai. - (28) |
| remesse, n.f. balai. - (65) |
| remesse, s. m., balai. Les sorcières allaient au sabat à cheval sur des manches à balais ; on les appelait ramassières. - (14) |
| remesse. Balai. On appelait ramassières les sorcières qui s'imaginaient aller au sabbat sur des balais. - (03) |
| remesser, v. tr., balayer. - (14) |
| remessure, s. f., ramassis, balayure. - (14) |
| remette (v.t.) : remettre - (50) |
| remettu, part, passé du verbe remettre. Remis s'emploie avec la même signifie, qu'en français mais aussi avec le sens de céder, abandonner, livrer : il m'a « remettu » son pré, je lui en ai « remettu » la récolte. - (08) |
| remétu, part., remis. - (14) |
| remeuiller : remuer - (43) |
| remiage, remuage : s. m., vx fr. romirage, voyage a Rome, pèlerinage. - (20) |
| rèmielle. Giroflée ravenelle, plante de la famille des Crucifères. - (49) |
| remiender. Raccommoder. - (03) |
| remiller, crier de douleur. - (05) |
| rem'illi - r'me'illi - r'nuer - freuguener : remuer - (57) |
| reminieuler : réconcilier. (E. T III) - VdS - (25) |
| remirou : s. m. miroir. - (21) |
| remirou, s. m. miroir. - (24) |
| remmancher. v. - Réparer, soigner un membre cassé. Ce mot est directement issu de l'ancien français manche, signifiant : estropié, infirme de la main ; manche est dérivé du latin mancus : manchot, mutilé. - (42) |
| remmancheux (n. m.) : rebouteux - (64) |
| remmancheux. n. m. - Rebouteux. - (42) |
| remmancheux. s. m. Rebouteux, celui qui fait métier de réduire les luxations et les fractures. (Puysaie). - (10) |
| remmoinzer : remmancher - (39) |
| remœroeu*, s. m. miroir. - (22) |
| remoincher, v. a. remmancher, remettre un manche. « r'moinger, r'moinzer. » (voir : raimoingeou.) - (08) |
| remoinger. Remettre un moinge, c'est-à-dire un manche à un outil. Par extension, rajuster un membre démis, d'où remoingeoux, synonyme de rebouteux... - (13) |
| remoinger. v.a. Remmancher.(Vassy). - (10) |
| rémolandier : Rémouleur. - (19) |
| remôler, v. tr., aiguiser couteaux et ciseaux sur une meule. - (14) |
| remôloû, et r’mouleû, s. m., rémouleur. - (14) |
| remondoure, s. f. cicatrice. - (24) |
| remonte : s. f., montée d'une voie de communication quelconque, par analogie avec la remonte d'un cours d'eau. Le bateau de remonte. Le train de remonte. Voir descise. - (20) |
| remontée (ai lai), loc. au dessus, en amont, mais aussi à l'envers, à rebours, de bas en haut. - (08) |
| remontée de sang : s. f., congestion à la tête. - (20) |
| remonter : v. n., monter. - (20) |
| remontoir : s. m., cavalier de la remonte. - (20) |
| remontrer, v. a. enseigner, apprendre quelque chose à quelqu'un. - (08) |
| remontrer, v. tr., montrer, apprendre, enseigner : « Le mâtre li r'montre l'écriture. » - (14) |
| remordre (Se). v. pron. Avoir des remords, se repentir. (Mézilles). - (10) |
| remoti, remontie : part, pass., vx fr. remous, écarté, caché. - (20) |
| remotis. : Mot emprunté directement au latin, Laissai é remotis c'est laisser un objet parmi les choses mises de côté, en un mot c'est mettre au rebut. - (06) |
| remoucher (r'moucher) : v. a., reluquer. Remouche-le donc ! - (20) |
| remouchi : Rembarrer, remettre à sa place. « O s'est bienfait remouchi ». - (19) |
| rèmouègnâs : (rèmouènyâ: - subst. m.) longue branche de charme souple et touffue à son extrémité, dont on se sert pour ramoner les cheminées. - (45) |
| remouiller : v. a., mouiller. - (20) |
| rémoulandi, s. m. rémouleur. - (22) |
| rémoulandi, s. m. rémouleur. - (24) |
| rémoulou (on) - ramoulou (on) : rémouleur - (57) |
| remoune*, s. f. aumône. - (22) |
| remoune, s .f. aumône. - (24) |
| rempailli : rempailler - (57) |
| rempaillou (on) : rempailleur - (57) |
| rempaler, v. remettre des échalas dans une vigne. - (38) |
| rempaler, v., mettre en place les paisseaux. - (40) |
| rempapilloti (se) v. Se requinquer. - (63) |
| remparer. v. - S'emparer, attraper, prendre : « Eh mon gars ! Rempare la gearbe. » - (42) |
| remparer. v. a. et n. Recueillir, attraper, se saisir. C'est une des formes populaires du verbe s'emparer. Les enfants, dans leurs jeux, les ouvriers, dans leurs travaux, se disent souvent entre eux : Rempare ! pour saisis-toi, empare-toi de ce que je vais te lancer. (Auxerre). – A Saligny, on dit réparer. - (10) |
| rempatter, v. a. rechausser, recouvrir les racines d'une plante, d'un arbre, etc. (voir : patte.) - (08) |
| rempcher : renverser. - (66) |
| rempeilli : Rempailler. « Vla eune chaire qu 'a faute de rempeilli ». - (19) |
| rempeilloux : Rempailleur. « Eune rempeillouse de chaire (chaise) ». - (19) |
| rempiaiçant (on) : remplaçant - (57) |
| rempiaici : remplacer - (57) |
| rempiaiç'ment (on) : remplacement - (57) |
| rempiassai : remplacer. Ce qu'on ai cassé o faut le rempiassai : ce que l'on a cassé il faut le remplacer. - (33) |
| rempiassè, remplaicè : v. t. Remplacer. - (53) |
| rempiéci : remplacer - (43) |
| rempiéci : remplacer - (51) |
| rempièsser : remplacer. - (52) |
| rempieumer : remplumer - (51) |
| rempieumer : remplumer - (57) |
| remp'illi – rempi : rempli - (57) |
| rempiner : râler tel un bronchiteux. Faire des bruits de poitrine en respirant avec gêne. - (62) |
| rempirer, v. intr., aller plus mal : « L’méd'cin é ben v'nu ; n'empôche que l'pauv'diâbe rempire. » - (14) |
| remplaisser : remplacer - (48) |
| remplancher. v. - Effectuer le troisième et dernier labour. - (42) |
| rempleinsir, v. tr., remplir : « Alle évòt trop rempleinsi sa marmite ; la sôpe a reborgé. » - (14) |
| rempleûmer (se), v. pr., se remettre dans ses affaires. - (14) |
| rempliaichi : Remplacer. « Dan in temps les sordats fiaint sat ans mâ les riches pouyaient se fare rempliaichi ». - (19) |
| remplieumer : Remplumer, reprendre de l'embonpoint. « Alle était fine magre mâ aile s'est bin remplieumée ». - (19) |
| remp'lli : Participe passé, remp'ille. Remplir, ouiller. « Si an n'a pas soin de remp 'lli quand i faut le vin prend in gout d'évent ». - Etre fécondé. « Ma vaiche ne veut pas remp 'lli i faudra que je la meune encore in cô es bûs » - (19) |
| rempresser, v. a. remettre en forme, rendre à un objet sa forme première lorsqu'il a été déprimé. (voir : empresser.) - (08) |
| rempyéci : (vb) remplacer - (35) |
| rempyéci v. Remplacer. - (63) |
| rempyi v. Remplir. - (63) |
| rên (prononcer rin), branche d'arbre, de fagot. - (16) |
| ren : (pronom indéfini) rien - (35) |
| ren : rien - (51) |
| ren : rien - (57) |
| ren : rien, seulement, uniquement. Cè n'y fait ren : ça ne fait rien. - (52) |
| ren : Rien. « O n'est ban à ren ». « Veni à ren » dépérir. « Y est ren que prend pas grand chose » ou « Y est ren que prend ren », se dit d'un homme de rien (mauvaise conduite) qui prend une femme qui ne vaut pas mieux. - (19) |
| ren pron. indéf. Rien. Ô l'a aijue p'ren. Il l'a eue pour rien. - (63) |
| ren, ran (pr.ind.) : rien - (50) |
| ren, rien. - (38) |
| ren. Rien. - (49) |
| ren. Rien. Du latin rem, accusatif de res, chose ; non habeo rem, je n'ai rien ; non agit rem, il ne fait rien. Nos anciens auteurs disaient rien pour chose. - (03) |
| ren’ : rien. - (62) |
| rén’ne (prononcer rin-ne), la reine et Reine, nom de baptême. Sente Rênne, vierge martyre. - (16) |
| rena : renard - (43) |
| rena : Renard « Eune beurne de rena » : un terrier de renard. « Prendre le rena » : achever certains travaux, couper la dernière javelle du champ que l'on est en train de moissonner. « Fare les renas » : vomir en parlant d'un ivrogne. - (19) |
| rena, r'na. Renard. - (49) |
| renacler : faire les derniers efforts. - (09) |
| renacler. Renifler. - (03) |
| renadier, vn. « renarder », vomir. - (17) |
| renair, s. m. renard. dans l'usage on prononce « r'nair. » « ernar. » - (08) |
| renalaille, arenalaille : s. f., vx fr. renaissaille, grenouille. - (20) |
| renan : Nom masculin, irrégularité dans un labour. - (19) |
| renanci : Verbe, renoncer. « J'y ai renanci ». - (19) |
| renaquai, cracher. - (02) |
| renâquer, v. intr., cracher de gros crachats tirés du nez. - (14) |
| renâquiè : renâcler - (46) |
| renâquier : renâcler. - (66) |
| renaquier : renifler. - (66) |
| renard (prendre le), finir la moisson. - (05) |
| renard (prendre le), loc. C'est se livrer aux réjouissances qui, tous les ans, terminent la grande opération de la moisson. Le soir du dernier jour, pour la rentrée à la ferme, on enjolive la voiture finale, que les plus ingambes surmontent d'une croix confectionnée avec des épis, et ornée de fleurs et de rubans entremêlés. Toute la bande des gars et des fillettes, que précèdent les vieux, suit le char en chantant et surtout en huchant, c'est-à-dire en jetant à tout propos et hors propos leur cri favori de : You cou cou ! — Mais « le Renard ? » On ne le voit guère apparaître dans tout cela, — C'est vrai. La coutume a survécu à son étiquette. On ne retrouve pas le pourquoi de cette dénomination. - (14) |
| renard (Prendre le). On appelle ainsi les réjouissances qui suivent la fin de la moisson. La dernière voiture de blé est surmontée d'une croix formée d'épis mêlés de fleurs et de rubans. Les filles et les garçons la suivent en chantant et en huchant. Le soir il y a galas et danses. Dans la Côte Chalonnaise, on appelle paulée, la fête qui couronne les vendanges et ce mot vient de nos plaines. Dans divers lieux , quand la fin du battage est arrivée, elle donne lieu à certaines réjouissances qu'on nomme fête de la pellée ou paulée ; nous disons paule pour pelle. - (03) |
| renard. Vomissement d'un ivrogne, d'où renarder... - (13) |
| renarder : v. n., se dit du vin lorsqu'il commence à perdre de son bouquet. - (20) |
| renarder, v., vomir le long du chemin. - (40) |
| renarder. v. - Traîner, s'attarder. - (42) |
| renarder. v. n. Lanterner, muser, s'attarder. (Perreuse). - (10) |
| renâré, adj., défiant, fin, rusé comme un renard. - (14) |
| renârer, v. intr., rusailler, user de finesses comme le renard. - (14) |
| renas, s. m. pl. traces de vomissements d'ivrogne. - (22) |
| renas, s. m. pl. traces de vomissements d'ivrogne. - (24) |
| renaud : s. m., renard. II y a quelques années, celui qui avait pris un renaud, allait quêter chez les propriétaires des basses-cours, et il en recevait une volalle ou des œufs. - (20) |
| renauder (r'nauder) : v. n., être mécontent, grogner. - (20) |
| renâ-yon, s. m., cervicalgie, douleur du cou. - (40) |
| renbiais, sm. remblais. - (17) |
| renbraissé, vt. embrasser. - (17) |
| renbrinché (se), vr. se heurter, s'empêtrer dans qque obstacle. Dous votiures qui se renbrinchent. - (17) |
| rencamaradé, vt. réconcilier. - (17) |
| renchairger, v. a. charger quelqu'un d'une commission, donner charge de : « i seu renchairgé de ç'lai », je suis chargé de cela. (voir : enchairger.) - (08) |
| renchaler. v. a. et n. Rattraper, saisir. (Auxerre). - (10) |
| renchardir. v. - Renchérir. (Sommecaise, selon M. Jossier) - (42) |
| renchardir. v. n. Renchérir, augmenter de prix. (Sommecaise). - (10) |
| renchaussement, s. m. la partie d'une muraille de maison qui se trouve entre le plancher et l'extrémité inférieure du toit. - (08) |
| renchausser, v. a. rehausser une muraille. - (08) |
| renchou : (nm) odeur de renfermé - (35) |
| renchou : odeur de renfermé - (43) |
| rencontrer v. Choisir un compagnon, une compagne. - (63) |
| rencôté : v. i. Tousser comme pour vomir. - (53) |
| rencougni : rencogner - (57) |
| rencoulu, ue. adj. - Se dit d'une personne ayant un petit cou, la tête dans les épaules. (Mézilles, selon H. Chéry) - (42) |
| rencoulu, ue. adj. Qui a le cou très court et enfonce dans les épaules. (Mézilles). - (10) |
| rencranner, v. a. renfermer dans un coin, dans un cran. les vaches sont « rencrannées » dans le bois, c’est à dire dans un coin de bois. - (08) |
| rencreussè : préparer un champ - (46) |
| rencreutè : enterrer de nouveau - (46) |
| renculotter (Se) : v. r., se reculotter. - (20) |
| rende : rendre - (48) |
| rendement : s. m. Rendement de noces, retour de noces. - (20) |
| rend'man, ce que rapporte une propriété en terres, en vignes. - (16) |
| rendoublée (de), loc. adv., à nouveau : « Quand ôl a évu bisé la p'tiote, ô l'a cor bise de rendoublée. » - (14) |
| rendoublée, redoublement d'injures. - (05) |
| rendoublée, s. f., redoublement, souvent d'injures. Ne s'emploierait pas pour la répétition d'une chose agréable. - (14) |
| rendoubler, v. a. mettre en double, doubler. - (08) |
| rendoubler. Jurer. On dit aussi de quelqu'un qui est courbé, qu'il marche tout rendoublé. - (03) |
| rendouiller : (randouyé - v. trans.) retrousser (une manche de vêtement) par en dessous, image empruntée à la fabrication de l’andouille dont c'est la technique. - (45) |
| rendre - dégueuler - dégobiller : vomir - (57) |
| rendremi (se) : Rendormir (se). « J'ai pas pouyu me rendremi ». - (19) |
| rendremi : rendormir - (43) |
| rendreuiller, v. a. ranimer, rendre vif, dispos, dru. (voir : dreuiller, dreuler, dru.) - (08) |
| rendrûler (v.t.) : revigorer ; rendre "dru" - (50) |
| rendrûyer : ragaillardir - (48) |
| rendu adj. Arrivé. - (63) |
| rène : arène (matériau de décomposition du granit) - (48) |
| renerers (à), à la renverse. - (05) |
| réneux. adj. - Léger, en parlant d'une terre rappelant la terre d'arène. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| renevei, usurier qui renouvelle les échéances de ses débiteurs. En latin, renovare... - (02) |
| renevei. Usuriers. Quoique le peuple, à Dijon, appelle en général tous les usuriers renevei, je trouve néanmoins que ces renevei pratiquaient une usure d’une espèce particulière, en ce que, moyennant une certaine somme, ils prêtaient un bœuf à un laboureur, qui se chargeait de leur en rendre un de même âge dans le terme convenu. Comme par ee traité ils renouvelaient la dette, on les appelait de là reneuviers… - (01) |
| renevei. : Prêteur qui renouvelle à un taux usuraire les échéances de ses débiteurs en retard. (Du latin renovare.) Les poètes bourguignons s'épuisent en malédictions contre cette race d'écorcheurs des pauvres gens. - (06) |
| renfans, s. m. plur. enfants. (voir : reux, rieux.) - (08) |
| renfermi, renfromi, renfroumi. n. m. - Champ clos par des haies, et par extension, tout champ cloturé. - (42) |
| renfeurmè, renfromè : v. t. Renfermer. - (53) |
| renfié, vt. renfler. - (17) |
| renforci : renforcer - (51) |
| renforci : renforcer - (57) |
| renfort : s. m. Renfort de fête, prolongation de fête. - (20) |
| renfort : s. m., partie saillante du talon de l’ouche : « L’ouche se compose de deux morceaux : l'un portant le renfort, et que pour cette raison on appelle le talon... » (Nizier du Puitspelu, Veilleries Djonnaises, l’Ouche, le verbe Oucher, dans Nouvelles littéraires de Lyon, 4 mars 1906). - (20) |
| renfraîchi, v. a. rafraîchir : la pluie a « renfraîchi » les prairies. - (08) |
| renfraîchissement, s. m. refroidissement : « al o mailaide d'eun renfraichissement. » (voir : fraîcheur.) - (08) |
| renfrauchir : rafraîchir. - (32) |
| renfremé : Renfermé, discret « Ol est bien renfremé y a pas moyen de ren savoi de liune ». « Goût de renfremé » odeur de moisi qui se dégage d'un local longtemps inhabité. Cloturé en parlant d'un champ. - (19) |
| renfromai : renfermer. Dans les grumes o y'ai des nous renfromés : dans les grumes il y a des nœuds renfermés. - (33) |
| renfromer : renfermer - (48) |
| renfromer : renfermer. - (52) |
| renfrongnou, adj. grognard. - (17) |
| renfrougné, adj., refrogné, mécontent. - (14) |
| renfroumer. v. - Renfermer. - (42) |
| renfroumis. s. m. Enclos. (Sainpuits). - (10) |
| rengaigi : Reprendre du service. - (19) |
| rengain-ne (na) : rengaine - (57) |
| rengaiñne n.f. Rengaine. - (63) |
| rengordzi (s') v. Se rengorger. - (63) |
| rengorgi (se) : rengorger (se) - (57) |
| rengougnou : rebouteux. - (62) |
| rengourgé, vt. rengorger. - (17) |
| rengoyi v. Expirer. - (63) |
| rengraigner, v. n. augmenter, croître, grandir dans le mal, empirer. on dit aussi « engraigner » : le mal « s'engraigne. » - (08) |
| rengrêcher, v. a. rehausser, élever par étages successifs : « rengrécher » un mur, une maison, une pile de bois, une meule de foin. (voir : renchausser.) - (08) |
| rengrignai (se). : Se réassombrir.- Dans le dialecte on disait l'engrégement d'un mal. Le poète Marot se plaint d'un mal qui chaque jour engrège ses longs ennuis. On trouve dans le dictionnaire de Nicot le mot rengréger traduit par le latin redulcerare, ulcérer de nouveau. (Voir au mot gr aigne.) - (06) |
| rengrignai, aggraver une chose fâcheuse. Rendre plus greigne, plus triste. (Voir au mot graigne.) ... - (02) |
| rengrigner (se). v. - S'aggraver, empirer. Mot du XIIe siècle issu du latin gravis, lourd. Agregier ou agrever signifiaient rendre plus pesant, accabler, opprimer. Ragregier (avec le préfixe répétitif.re-) avait le sens de aggraver de nouveau. A la Renaissance, on dit rengréger, terme retenu par le poyaudin. Le français n'a conservé que le mot grever. - (42) |
| rengrigner. v. n. et se rengrigner. v. pron. Devenir plus grave, empirer. Du vieux mot greigneur, qui se disait autrefois pour plus grand. (Puysaie). - (10) |
| rengueugner (Chal., Br.), regôgner (Morv.). - Remettre un membre, rebouter ; vient de rengainer pris dans le sens de remboîter. Le rebouteur est un rengueugneur ou rengueugnou. On dit aussi dans le même sens remauger, remaugeau. - (15) |
| rengueùgner, v. tr., rebouter. Ne pas confondre avec rangueùgner. (V. ce dernier mot.) - (14) |
| rengueugni : Rebouter, réduire les fractures. « Ol est allé se fare rengueugni ». - (19) |
| rengueugnier, v. remettre en place un membre démis. - (38) |
| rengueugnou : rebouteur. (VSLD. T II) - S&L - (25) |
| rengueugnou, s. m., rebouteux. - (40) |
| rengueugnoux : Rebouteur, empirique qui se mêle de réduire les fractures, les luxations et les entorses. Le mot ne se prend pas en bonne part, on n'a pas dans le « rengueugnoux » la même confaince que dans le « blandiau ». - (19) |
| rengueurni v. Réamorcer. - (63) |
| renicler, v. intr., renâcler ; au figuré, hésiter, reculer : « Qu'é c'qu'y ét-i qu'ôl a dans l'nazô, qu'ô r'nicle tôjor ? » — « On disôt qu'ô li flanquerôt eùne trempe ; mâ ôl a reniclé. » - (14) |
| reniquer, v. tr., renier, refuser la chose promise. - (14) |
| renmouceler, v. tr., amonceler, ramasser en tas : « Attends vouér, que j’renmoucéle mes calas dans mon d'vantei. » - (14) |
| renmouéler (se), v. réfl. s'engraisser, prendre de la graisse, de l'embonpoint. - (08) |
| renne : terre rouge - (39) |
| rén-néte (prononcer rin-nête), pomme reinette. - (16) |
| ren-nhausser, v. tr., rehausser, mettre plus haut (prononcez ran . . .) - (14) |
| renoçon : s. m., retour de fête, répétition de fête. - (20) |
| renoçons, s. m. pl. lendemain d'une fête ou son retour le dimanche suivant. - (24) |
| renoille, s. f., grenouille. - (14) |
| renoille. Grenouille. - (03) |
| renoille. : Grenouille (du latin ranicula). La dérivation est ici plus naturelle que dans le français. - (06) |
| rënon, ronron du chat. - (16) |
| renon, s. m. irrégularité de labourage. - (24) |
| renoncer : v. n., renacler, refuser par satiété. II renonce sur la pitance. - (20) |
| renori, vt. renoircir. - (17) |
| renouçons, s. m. pl. lendemain d'une fête ou son retour le dimanche suivant. - (22) |
| renoueille, s. f. grenouille. On prononce souvent par métathèse « eurnoille, eurnoueille. » - (08) |
| renouelle (n.f.) : grenouille - aussi arnoueille - (50) |
| renouille, grenouille. - (05) |
| renovaler : Renouveler. - (19) |
| renoviau : Renouveau, première phase de la lune. « Le temps se braille y est le renoviau de la lune que fa cen ». - (19) |
| renoyer : s. m., tilleul sauvage (tilla partifolia). - (20) |
| renpeuti, vt. enlaidir. - (17) |
| renpiaicant, sm. remplaçant. - (17) |
| renpiaicé, vt. remplacer. - (17) |
| renquiller : réemmancher, remettre en place - (37) |
| rênsë, averse de pluie reçue ; une volée de coups est aussi une rênsë. - (16) |
| renseigna - rens'gni : renseigner - (57) |
| renserrer (v. tr.) : amasser, entasser - (64) |
| renserrer, rasserrer. v. - Réunir, regrouper (de la paille, des fruits, les bêtes, etc.) L'idée de rapprocher / réunir est issue du croisement de sens entre deux emplois de serrer en ancien français ; l'un signifiait fermer, dérivé direct du bas latin serrare ; l'autre, en usage à partir du XIIIe siècle, signifiait ranger. Il reste, en français moderne, les mots « serrure» et «resserre», créés à partir de ces deux premiers sens. Le poyaudin en a tiré le sens de rapprocher / réunir, alors que la langue française évolua peu à peu vers le sens de « presser ». - (42) |
| rentage : s. m., action de renter. Voir réenter. - (20) |
| rentaire. Redevance, rente, fermage. - (12) |
| rentarrer : v. accumuler de la terre autour du pied de pomme de terre. - (21) |
| rentauger. v. - Rentrer les plumes dans un oreiller ou un édredon. - (42) |
| rente, Ferme ou métairie éloignée d'un centre d'habitation. - (13) |
| renté, vt. retricoter le haut d'un bas ou d'une chaussette. - (17) |
| rente. Ferme isolée. - (12) |
| renter, v. a. raccommoder, refaire, repriser. - (08) |
| renter, v. tr., repriser, remonter, rempiéter : « Alle tricote bé ben ; alle m'a renté eùn paire de bas. » C'est tricoter des pieds à de vieux bas dont on a conservé les jambes. - (14) |
| rentiau. s. m. Petit rentier n'ayant que des ressources à peine saffisantes pour le faire vivre. (Saint-Florentin). - (10) |
| rentòrner (se), v. pr., s'en retourner : « Piarot é v'nu. Ô vlòt m'dire qu'ô vouròt ben... ma, l'béta, ô s'é rentorné sans oser. » - (14) |
| rentorteuilli v. Entortiller de nouveau. - (63) |
| rentouaîlage (on) : rentoilage - (57) |
| rentourner (se) v. S'en retourner. - (63) |
| rentourner (Se) : v, r., s'en retourner. - (20) |
| rentourner (se). S'en retourner. - (49) |
| rentrè : v. i. Rentrer. - (53) |
| rentrée : s. f., entrée. - (20) |
| rentrer : entrer - (48) |
| rentrer à bonne heure : rentrer de bonne heure - (51) |
| rentrer d’pied, rentrer d’son pied : revenir chez soi à pied - (37) |
| rentrer n.f. Entrer. - (63) |
| rentrer : v. a., rentraire. Rentrer une couture. - (20) |
| rentrer : v. n., entrer. - (20) |
| rentrer, verbe intransitif : entrer. - (54) |
| renvâler, v. a. rallumer. (voir : envâler.) - (08) |
| renvârse (na) : renverse - (57) |
| renvarse. n. f. - Renverse. - (42) |
| renvarser : Renverser. - (19) |
| renvarser, v. tr., renverser, détruire, faire tomber. - (14) |
| renvché, vt. renverser. - (17) |
| renversé (Vendre du vin au pot). Les particuliers avaient le droit de vendre leur récolte au détail, mais on ne devait pas boire dans leur cave. L’acheteur apportait son broc ou sa bouteille, et le vendeur, mesurant à la pinte, renverrait son pot dans le vase qu'on lui présentait. Un petit drapeau, blanc ou rouge, suivant la couleur du vin, servait d'enseigne extérieure. Encore un usage qui disparaît ! Il n'y a plus à Beaune que deux ou trois caves ou flotte le petit drapeau. - (13) |
| renveurdi, v. a. redevenir vert, reverdir. - (08) |
| renveursant : renversant - (57) |
| renveurser - déveurser : renverser - (57) |
| renviè : renvoyer - (46) |
| renvié, vt. renvoyer. - (17) |
| renvier : renvoyer. - (29) |
| renvier, v. a. renvoyer : « al é renvié son vâlot », il a renvoyé son domestique ; « renvie-io cheu lu », renvoie-le chez lui. (voir : envier.) - (08) |
| renvïer, v. tr., renvoyer, rendre, restituer. - (14) |
| renv'iller : renvoyer - (57) |
| renvni v. Revenir. - (63) |
| renvoler (Se) : v. r., s'en revoler. - (20) |
| renvorser, v. a. renverser, faire tomber quelqu'un ou quelque chose. (voir : verser.) - (08) |
| renvressi : renverser - (43) |
| renvyé, renvoyer ; quand on est lassé d'un mauvais serviteur, on le renvîe. - (16) |
| renvyi v. Renvoyer. - (63) |
| réou. adj. - Réjoui, heureux. - (42) |
| repaicher, v. a. restaurer, rafraîchir, nourrir. Se dit quelquefois des personnes mais plus particulièrement des chevaux et des bœufs. On « repaiche » son cheval à l'auberge en lui donnant de l'avoine. - (08) |
| repaicher. S'arrêter dans une auberge avec son attelage et y faire reposer bêtes et gens en mangeant quelque chose. Etym. forme altérée de repaitre ; de pascere, postum. - (12) |
| repailler, v. tr., rempailler : « La Giraude a passé ; j'li ai baillé mes cheires à r’pailler. » - (14) |
| repailloû, s. m., rempailleur de chaises. - (14) |
| répainché. : Répandre un liquide (en latin pandere, avec le réduplicatif re). - (06) |
| répairme : (répêrm' - subst. f.) économie. - (45) |
| répairmer : économiser - (48) |
| répairmer : épargner - (37) |
| répairmer : (répê:rmè - v. trans.) économiser, épargner. - (45) |
| répancher, v. tr., épancher, répandre. - (14) |
| repanpille (y an) : il y en a des tas. (RDM. T IV) - B - (25) |
| repareiller : v. a., vx fr., réparer, remettre a neuf. - (20) |
| reparer : Embellir. « La plieume répare l'ujau » : la plume embellit l'oiseau, se dit d'une femme laide qui porte une toilette élégante. - (19) |
| répargne : s. f., épargne. La caisse de répargne. - (20) |
| réparmai : épargner. Ol é ben réparmai toute sa vie : il a bien économisé toute sa vie. - (33) |
| réparmai, épargner... - (02) |
| réparmai. : Epargner. (De l'italien resparmiare.) - (06) |
| réparme (n.f.) : épargne - (50) |
| réparme : Epargne, économie. « An a vu réparme aller charchi du pain chez galboudre » : on a vu l'avare aller demander secours au prodigue. - (19) |
| réparmè : v. t. Économiser. - (53) |
| réparmé, faire des économies, laisser une part d'un mets pour un second repas. - (16) |
| réparme, s. f. épargne, économie. - (08) |
| réparme, s. f., épargne, économie. - (14) |
| rèparmé, vt. épargner, ménager. - (17) |
| réparme. Epargnes, épargne, épargnent. Le mot bourguignon réparme est quelquefois substantif, comme le vieux français répargne. - (01) |
| réparmer (v.t.) : épargner - (50) |
| réparmer : économiser - (57) |
| réparmer : économiser. - (29) |
| réparmer : économiser. épargner. - (62) |
| réparmer : épargner - (57) |
| réparmer : Epargner, économiser. En plaisantant on dit « i faut fare des greusses sopes pa réparmer le pain ». - (19) |
| réparmer, épargner ; réparme, épargne. - (05) |
| réparmer, v. a. epargner, agir avec parcimonie. - (08) |
| réparmer, v. tr., épargner, mettre de côté : « Si ô n'dépense ran, y é pas faute d'avouér ; ô réparme prou. » - (14) |
| réparmer. Épargner. - (03) |
| repasse : Terme de brandevinier, rectification, seconde distillation. « Fare la repasse » : distiller une seconde fois - (19) |
| repassou : repasseur - (43) |
| repatrier : v. a., vx fr., rapatrier, réconcilier. - (20) |
| repècher : (r'pèché - v. trans.) nourrir un cheval sans le dételer. Au figuré : se r'pèché "se restaurer". - (45) |
| repelé, adj. courbaturé (du vieux français repeller). - (24) |
| repelé, adj. courbaturé. - (22) |
| repellé, repellée : part, pass., vx fr. repeller (verbe), courbaturé, fatigué, déprimé. - (20) |
| repenè. Raclette de boulanger. - (49) |
| repentance (n.f.) : repentir - (50) |
| repentance, s. f. repentir. - (08) |
| repenti (se) : Repentir (se). « O pourrait bin s'en repenti ». - (19) |
| repenti (se), enrepenti, vr. Se repentir ; pp. repentu, enrepentu. - (17) |
| repentu : part pass., repenti. - (20) |
| repentu, part. pass. du verbe repentir. Repenti. - (08) |
| repentu, part., repenti. - (14) |
| repère. : Retour .- Dans une charte de 1215 repère de l'ost signifie retour des vassaux qui guerroyaient pour leur seigneur. - (06) |
| répermer : économiser. (A. T II) - D - (25) |
| répermer : économiser. (VC. T II) - A - (25) |
| répertouaîre (on) : répertoire - (57) |
| répéti. Répétai, répétas, répéta. - (01) |
| répétiotir (L’r final ne se prononce pas). v. a. Rapetisser. - (10) |
| rèpétret. Roitelet. - (49) |
| répeubyique n.f. République. - (63) |
| répeuce, s. f. réponse. Usité dans quelques parties de la région, à Montigny-sur-Canne notamment. - (08) |
| répeucener, v. n. faire des reproches, adresser une réprimande, malmener. (voir : peucener.) - (08) |
| répeùler (se), v. pr., se rappeler, se souvenir : « Voui, voui, l'malhureux, ô s’répeùle prou d' l'avouer argardée ! » - (14) |
| répeusses : petits salsifis sauvages - (39) |
| repicoler, rapicoler : v. a., consolider un fruit sur son pédoncule. Voir dépicoter et picot. - (20) |
| répié. Fourré buissonneux. Les vipères s'y cachent. Fig. Lieu dangereux. Repaire où l'on risque de se faire dévaliser. - (49) |
| rêpier n.m. (du germanique hrispa, broussaille). Roncier. - (63) |
| repiouné, v. n. agiter les jambes d'un mouvement de va-et-vient, comme on fait dans l'insomnie. - (22) |
| repiquer, v. intr., augmenter de prix, reprendre de la valeur : « Au marché, i n'se vendòt pas gros d'aibord ; mâ, par après, la vendue a r’piqué. » - (14) |
| repiquer, v. n. reprendre de la valeur par une hausse de prix : le bétail ne se vendait pas, mais cela a un peu « repiqué. » - (08) |
| repiquer. Mettre de nouveau au jeu, recommencer la partie sur un nouvel enjeu ; par extension recommencer. - (12) |
| réplaigni (prononcez répliaigni), aplanir. - (02) |
| replaigni. : (Pron. repliaigni), aplanir. - (06) |
| replat : s. m., vx fr.. lieu plat, plateau. Cinq ou six hameaux ou écarts du département de Saône-et-LoIre s'appellent Les Replats. - (20) |
| repliat : Nom masculin, palier, replat. - (19) |
| rèplué, vn. étinceler, briller par éclats intermittents. - (17) |
| repô. Repos. - (01) |
| repon, s. m. décombres. Verbe reponer, extraire des décombres (du vieux français repous). - (24) |
| repon, s. m. décombres. Verbe : repouné, extraire des décombres. - (22) |
| rèponde v. Garantir, assurer. - (63) |
| répondi. Répondis, répondit. - (01) |
| répondou (n.m.) : répondeur téléphonique - (50) |
| répondrò. Répondrais, répondrait. - (01) |
| reporcher. Raccommoder grossièrement, provisoirement. - (49) |
| repös, sm. repos. Ête de repös, reposer, faire la sieste. Ête d'è bon repös, se dit d'un animal qui se couche tranquillement après avoir mangé. - (17) |
| repostaille. : Retraite, cachette. C'est une des expressions de saint Bernard. « Li repostaille del cuer, » les retraites du coeur. (En latin repositoria.) - (06) |
| répouner, répondre - (36) |
| repouner, v. a. répondre, faire une réponse. (voir : poner.) - (08) |
| répouner, v. tr. et intr., répondre, raisonner : « A tô c'qu'on li a dit, ôl a tôjor répounu. » - (14) |
| rèpouré, vt. épandre (du foin, du fumier). - (17) |
| repous : s. m., vx fr., plâtras et débris de matériaux incombustibles, qu'on utilise généralement pour combler les vides compris entre plafonds et planchers. - (20) |
| repouser : reposer - (43) |
| repouser, v. a. reposer, poser une seconde fois, prendre du repos. - (08) |
| repousser : v, a., reculer, ajourner, renvoyer, retarder. Il m'a promis des étrennes, mais il y repousse toujours. - (20) |
| repoux : Platras. « Quand an fa réparer eune maijan an ne sait pas ce qu'an veutfare du repoux ». - (19) |
| repôze. Reposes, repose, reposent. - (01) |
| reppe : forêt de buissons principalement. Vient peut-être du germanique hrispa. - (62) |
| reppe. Petit bois. - (03) |
| rèpp'lè : rappeler - (46) |
| reprémande, s. f., réprimande. - (14) |
| reprendre : v. a., prendre. « Ils ont voulu reprendre leur revanche. » - (20) |
| repreuche : Reproche, réprimande. « Néguin n'âme les repreuches ». - (19) |
| repreuche, s. m. reproche. - (08) |
| repreucher, v. a. reprocher, faire un reproche. (voir : eurproucher.) - (08) |
| repreuchi : Reprocher. « Je n'ai ren à me repreuchi ». Donner des renvois. « Le boudin me repreuche ». - (19) |
| reprin, s. m. son très fin, « prin ». - (22) |
| reprin, s. m. son très fin, très « prin ». - (24) |
| reprin. Repris. - (01) |
| reprocher : v, a. Se dit d'un repas ou d'un mets que l'on digère mal. - (20) |
| reprocher, v. intr., revenir, en fait de digestion, donner des rapports : « Je nmainge pu d'boudin toute la jornée ô me r’proche. » - (14) |
| reprocher. Se dit d'un aliment qu'on digère mal et donne des nausées. Expression locale : « les harengs que j'ai m'gis à midi m'ont reproché tot le soir ». - (49) |
| répteret, reptereu, repteu : s. m., roitelet. Voir peteu. - (20) |
| république (n. f.) : instrument manuel servant à butter la vigne - (64) |
| répugner, v. tr., regarder avec répugnance : »C'te Toinéte, alle é si mauprope, que j’répugne c'qu'all' nous fricòte. » - (14) |
| répugni : Répugner. « Je n’y répugne pas » : cela ne me déplaît pas. - (19) |
| repunailh. : (Dial.), malédiction, séquestration (du latin repugnatio). - (06) |
| repuse adj. Repue. - (63) |
| repuse : part pass. f., repue. - (20) |
| requaillassé, adj., en bonne voie de convalescence. - (40) |
| requemançon. Recommençons. - (01) |
| réquénier : imiter en singeant - (39) |
| requenuë. Reconnue. - (01) |
| réquerer : récurer - (39) |
| requéri : part pass., requis, réquisitionné. - (20) |
| requeri. Requérir. - (01) |
| requerier, v. ; crier, pleurer. - (07) |
| requerò. Requérais, requérait. - (01) |
| réquetter, verbe transitif : attraper au vol, rattraper. Au sens figuré, se dit pour récupérer une personne. - (54) |
| requeuler : reculer - (43) |
| requeuler, v., reculer ; à la requeuline, se dit d'un endroit désert et écarté. - (40) |
| requeunoitre. Reconnaitre. - (01) |
| requeunoître. : Reconnaître. C'est bien la dérivation du verbe latin recognoscere. - (06) |
| requeuper, v. a. recracher, rejeter ce que l'on a dans la bouche. (voir : queuper.) - (08) |
| réqueurai : récurer. O faut requeurai les outils qu'on se sert : il faut nettoyer les outils dont on se sert. - (33) |
| réqueurcher, v. raccrocher. - (38) |
| réqueurè : v. t. Récurer. - (53) |
| requeurer : récurer - (43) |
| réqueurer : récurer - (48) |
| réqueurer : récurer. - (52) |
| réqueurer : se racler la gorge - (43) |
| rèqueurer. Récurer, nettoyer. - (49) |
| réqueuriai : pleurer. La tristesse fait réqueuriai : la tristesse fait pleurer. - (33) |
| réqueurier (se) : récrier (se) - (48) |
| réqueurier : pleurer. - (52) |
| réqueurier, v. a. appeler, demander en pleurant, en se lamentant. S'emploie activement : « l’ p'tiô réqueriô sai mère », l'enfant demandait sa mère en criant ; « a réqueuriô lai faim », il criait la faim. (voir : queurier.) - (08) |
| requeuron, s. m. bouchon de paille dont on se sert pour écurer la vaisselle de cuisine. - (08) |
| réquiâmè : réclamer - (46) |
| réquiâmier, v. a. réclamer, faire une réclamation : « quioqu' teu réquiâme », que réclames-tu ? que demandes-tu ? - (08) |
| requignoler, raquignoler : v. a., rafistoler. Voir déquignoler. - (20) |
| requillè : à la pêche, sortir un poisson de l'eau avec une épuisette appelée requillou - (46) |
| requillè : au jeu de quilles, relever les quilles et renvoyer les boules - (46) |
| réquillou : épuisette. (A. T II) - D - (25) |
| requinqué (se), se parer, s'ajuster, s'orner. Dans l'idiome breton, kinkla signifie orner, embellir, ajuster. (Le Gon.) Les mots quincaillier, qu'on écrivait d'abord clincailler, et clincant ont la même origine. - (02) |
| réquinqué (se). : Se parer de toutes sortes d'ajustements. Le mot quincaillerie a sans doute amené cette expression ; ce qui le ferait croire c'est celle de se requinquiller usitée dans le pays de Vaud. (Glos. gen.) - (06) |
| requinquelliouné, v. n. plisser, resserrer, chagriner. - (22) |
| requinquer (se) : s'habiller avec luxe. - (09) |
| requinquer. v. a. Faire une demi-toilette, donner un certain air, un certain agencement à sa toilette ou à celle d'une autre personne. Requinquer ses filles. – Se requinquer. v. pron. S'approprier, se donner un certain petit air. (Auxerre). - (10) |
| requinqueyioner, v. n. plisser, resserrer, chagriner. - (24) |
| requinquiller : v. a., requinquer. - (20) |
| requinquilli (se) : Se requinquer, se parer plus qu'il ne convient, se dit surtout en parlant des vieilles personnes. - (19) |
| rèqu'meûdè : raccommoder - (46) |
| requoué, s. m. abri, lieu de retraite : « ai requoué », à l'abri, à couvert. (voir : aicouau, coi, côyer.) - (08) |
| rere ou raire. : (Dial.), ôter, retrancher. (Du latin radere.) - (06) |
| rérebeu : Arrête-bœuf, bugrane, ononis arvensis. La racine du rérebeu est très résistante mais cependant pas au point d'arrêter les bœufs comme le laisse entendre le nom de cette plante, aussi bien en français qu'en patois. - (19) |
| rerentrer, verbe intransitif : rentrer. - (54) |
| rerrasson. n. m. - Petite terrasse . - (42) |
| rertous, teurtous. adj. indéf. - Tous : « La priée qui savons par cœur est repri' par tertous en chœur. » (Fernand Clas, p.162) - (42) |
| résarve : Coupe faisant partie du quart en réserve de la forêt communale. « La résarve de Montat ». Part que se réserve un père de famille dans la propriété qu'il partage entre ses enfants. - (19) |
| rèsarvé, ie, adj. réservé, ée. - (17) |
| rèsarve, sf. réserve. - (17) |
| résarvoi : Réservoir, pièce d'eau à côté d'une habitation. - (19) |
| réschu, réschue (le son sch est étranger au français), adj. sec. verbe : après une pluie, i réschu. - (38) |
| réschure, s.f. le fait de sécher. - (38) |
| rescier : v. a., scier. - (20) |
| reséance. : (Du latin re-sedere), droit de domicile d'un seigneur. (Cout. de Châtillon, 1371.) - (06) |
| resegrizai (se), se désassombrir, se débarrasser du gris, dont la teinte attriste l'âme. - (02) |
| resegrizé (se). : Se débarrasser du gris dont la teinte assombrit l'âme.- Il y a une pièce de vers en patois bourguignon (1660), laquelle a pour titre lai Bregogne resegrizée, c'est-à-dire la Bourgogne désassombrie. - (06) |
| reséper, « L » tailler, retrancher en coupant, resecare. - (04) |
| réservouaîr (on) : réservoir - (57) |
| réservouair : n. m. Réservoir. - (53) |
| réseuter (v.) : rester (non attesté chez de Chambure) - (50) |
| résibeu : Tout contre. « O s'est fait coper les cheveux résibeu la piau » : il s'est fait couper les cheveux ras. - (19) |
| résidu, subst. masculin : boue combustible faite à partir de la poussière de charbon. - (54) |
| résipèle, s. m., érésipèle, ou mieux érysipèle. - (14) |
| résipère, pour érysipèle. - (11) |
| résipères : érésypèles. IV, p. 32 - (23) |
| resnaule. : (Dial. et pat.), raisonnable, en latin rationabilis. - (06) |
| résodre : Résoudre. Se consoler. « I faut bin se résodre ». - (19) |
| resœgnoulon, s. m. goûter après la veillée. Verbe : resœgnoulé. - (22) |
| resolte : s. f., vx fr. résout (m.), résolution, achèvement. - (20) |
| Résolu : nom de bœuf. III, p. 30-o - (23) |
| rèsonné, vn. sonner. Faire du bruit. - (17) |
| résou, adj. résolu. - (17) |
| résous, résolu. - (04) |
| resous, résoudre (pour résolu, ue). partic. p. du verbe Résoudre. Déterminé, hardi. Un garçon résous. Oh moi, monsieur, je n'suis gué résoude. - (10) |
| respai. Respect, respects. - (01) |
| respect (sauf vot'), loc. Cette formule de politesse assaisonne tous les discours du Morvandeau poli qui se pique de savoir vivre. c'est le j'ai l'honneur de... à l'usage de nos campagnes. - (08) |
| respectai. Respectez, respecté, respecter. - (01) |
| respirè : v. i. Respirer. - (53) |
| respoun, réponse, répouner, répondre. - (04) |
| resquilleux n.m. Ramasseur de quilles. - (63) |
| resquilli v. Ramasser les quilles. - (63) |
| resquousse. : (Latin recuperationem), reprise par violence d'un gage déjà saisi. (Franch. de Molesme, 1260.) - (06) |
| ressailli : ressayer - (57) |
| ressanne. Ressemble, ressembles, ressemblent. - (01) |
| ressâre (n.f.) : remise, endroit où l'on emmagasine - (50) |
| ressârer (v.t.) : rassembler, renfermer de nouveau, réunir dans un lieu - (50) |
| ressârer, v. a. rassembler, rapprocher, réunir en un lieu, renfermer de nouveau, retirer. (voir : sârer.) - (08) |
| ressarvi : Resservir. « Quand an ment du vin en botaille i ne faut pas fare ressarvi les vieux bouchans ». - (19) |
| ressasier : Rassasier, manger à sa faim. « Es-tu bien ressasié ? ». - (19) |
| ressauter : v. n., tressauter. - (20) |
| resse (n. f.) : large corbeille en osier, de forme allongée - (64) |
| resse : panier allongé - (61) |
| resse : grand et large panier plat en vannerie. Ex : "Dame ! J'ons ben ène grande pleine resse de pern'" (cet exemple confirme bien le " ras-le-bord " satisfaisant). - (58) |
| resse : intervalle situé entre les parties plus élevées dans le labourage en sillons. (CH. T II) - S&L - (25) |
| ressée (n. f.) : contenu d'une resse - (64) |
| ressemaler : Ressemeler. - (19) |
| ressembiant (adj.m.) : ressemblant - (50) |
| ressembier, v. a. ressembler. - (24) |
| ressemblein. Ressemblions, ressembliez, ressemblaient. - (01) |
| ressembler : v. a. Je vais voir c’ que ça ressemble. — Ah ! qu'i ressemb' son père ! Le v'là tantôt aussi grand qu’ lui ! - (20) |
| ressembler, v. intr., ressembler à : « L’genti p'tiot ! ressembe son peire ; y é lu tout naqué. » — On dit bien : ressembler, ressembleint ; mais, devant l’e muet, le l tombe : ressembe. - (14) |
| resseu (-te) (adj. ou p.p. m. ou f.) : sec, sèche, séchée - (50) |
| resseu, eute, partie, passé du verbe resseure. Sec, séché : ce linge est « resseu », la toile est « resseute. » - (08) |
| resseur : r (éseur' - v. trans.) sécher, voire dessécher. - (45) |
| resseure (v.) : sécher, rendre sec - (50) |
| résseûre : ressuyer, sécher - (48) |
| resseure, v. a. sécher, rendre sec. - (08) |
| ressie : repas de quatre heures. (C. T III) (RDM. T III) - B - (25) |
| ressigné, vn. faire le réveillon. - (17) |
| ressigneux : Rossignol. « O chante c'ment in ressigneux ». - (19) |
| ressignolet. Rossignol - (49) |
| ressignon, sm. réveillon, repas tardif. - (17) |
| ressi-in-mé, v. a. ressembler. - (22) |
| ressimbliance : Ressemblance. « Je l'ai recougnu à la ressimbliance de san père ». - (19) |
| ressimblier : Ressembler. « Qui se resimb'lie s'asimb'lle ». - (19) |
| ressinger, recommencer. - (26) |
| ressiter. v. a. Rasseoir. – Se ressiter. v. pron. Se rasseoir. Voyons ! vous vous ressiterez ben un peu. - (10) |
| ressoper : retailler - (48) |
| ressouder. v. n. Ajouter un sou à d'autres sous, une quantité de monnaie déterminée à une autre donnée déjà, parce qu'on l'exige de vous. Ce que tu me donnes là ne fait pas tout-à-fait mon compte, il faut que tu ressoudes. (Auxerrois). - (10) |
| ressoupé : retaillé à ras de terre un arbre coupé trop haut. - (33) |
| ressoupe. n. f. - Pied d'un arbre arraché, souche. (Merry-la-Vallée, selon M. Jossier) - (42) |
| ressoupe. s. f. Bas du pied d'un arbre arraché. (Merry-la-Vallée). - (10) |
| ressource, s. f. source, fontaine. - (08) |
| réssu, part., ressué. Se dit de certains corps qui rendent de l’humidité intérieure. Chez nous, réssu constate que ce rendement est terminé. Une chose réssue est une chose qui a été mouillée et qui cesse de l'être, ressuyée. - (14) |
| rëssu, rëssûé, asséché, assécher ; fâv réssure, faire sécher. - (16) |
| ressuer : Se dit du foin qui paraît sec et qui redevient humide en fermentant. - (19) |
| ressui : séché. - (66) |
| ressui, qui a perdu son humidité. - (02) |
| ressui. : Qui a perdu son humidité. (En latin re-siccatus.) - (06) |
| ressuire - rossailli – ressuilli - rassain-ni : ressuyé (terrain plus sec) - (57) |
| ressuyer : sécher après la pluie. - (66) |
| ressuyer, v., s'égoutter, sécher. - (40) |
| restant (n.m.) : reste - (50) |
| restant. Reste : « au donne le restant au chat ». - (49) |
| réste n.m. Reste. Y'en a bin d'réste ! Il en reste encore. - (63) |
| réste. Reste. La première syllabe de reste se prononce en bourguignon comme la première syllabe de respect. - (01) |
| rester (où habites-tu ? où qu’te restes ?) : habiter - (43) |
| rester (verbe) : habiter (la voit don qu'vous restez au village ?). - (47) |
| rester : demeurer - (44) |
| rester : habiter - (51) |
| réster v. Habiter. Quoî don qu'ô réste achtheûre ? Syn. tsomer, dmorer. - (63) |
| rester, v. habiter. - (65) |
| rester, v. n. demeurer, habiter, résider, loger. - (08) |
| rester, v., habiter. - (40) |
| rester, verbe intransitif : habiter. - (54) |
| resucée, s. f., nouvelle ration (de goutte). - (40) |
| retâ : Retard. « Pa fare des seutijes o n'est pas en retâ ». - (19) |
| rètabji, vt. rétablir. - (17) |
| retable : ornement d'architecture avec un décor peint ou sculpté, contre lequel est appuyé l'autel dans une église. - (55) |
| retade. Retardes, retarde, retardent. - (01) |
| retaille. Retaille, morceau. - (01) |
| retailles, s. f. pl. débris d'étoffes conservés pour des raccommodages (vieux français). - (24) |
| retairdif, ife, adj. tardif, qui est en retard, qui mûrit ou se développe plus tard. - (08) |
| retais. adj. Celui dont le caractère est sombre, mélancolique. (Savigny). - (10) |
| rétalat : Brins de foin qui restent sur le sol et qu'on reprend au râteau. - (19) |
| rétalé : Ratelier. « J'ai garni le rétalé » : j'ai mis du foin dans le ratelier. - (19) |
| rétaler : Râteler, ramasser avec le rateau. - (19) |
| rétaloux : Celui qui ramasse le foin avec un râteau. Au féminin rétalouse. - (19) |
| rétâmer : étamer - (57) |
| rétâmou (on) : étameur - (57) |
| rétâmou (on) : rétameur - (57) |
| retamou, s. m., ouvrier rétameur ambulant. - (40) |
| rétamoue, rétameur. - (26) |
| retandi. Retendis, retendit. - (01) |
| rètanmé, vt. étamer. - (17) |
| rétaquer, v. intr., bruire avec éclat. Ce verbe, sans équivalent, ne s'applique guère qu'au bruit du tonnerre. Le paysan dit : « Le tounare rétaque. » Le réduplicatif indique l'intention d'exprimer des coups qui se succèdent. - (14) |
| rétcheurer : nettoyer - (57) |
| rétcheurer : récurer - nettoyer - (57) |
| rét'chiâ : n. m. Râteau. - (53) |
| réte : Poignée de filasse de chanvre. « Eune réte d'ôvre » : est la quantité de filasse nécessaire pour garnir une quenouille. - (19) |
| rète : voir rate - (23) |
| rétè : rateau. (LCSS. T IV) - S&L - (25) |
| reteilles, s. f. pl. débris d'étoffes conservés pour des raccommodages. - (22) |
| rètelle. Rate. On dit encore : « ratelle ». - (49) |
| reteni : Retenir. Terme de couvreur : « Reteni in cova à tranche ouvart » : réparer une toiture à fond en « retenant » toutes les tuiles les unes après les autres. - (19) |
| reteudre : Retordre. « Donner du fi à reteudre ». - (19) |
| reteurdu : Retordu, retors. « Y est in reteurdi » : c'est un malin. - (19) |
| réti, routi. Flétri, ridé : « c'tes pouères sont totes réties ». - (49) |
| rétiâ, res-tiâ, s.m. râteau. - (38) |
| rétiâ, s. m., râteau de jardin. - (40) |
| rètianmé, vt. réclamer. - (17) |
| rétiau : Râteau. « In rétiau de jardin » : un râteau pour le jardin. Le Rétiau, la constellation d'Orion ou plutôt les trois rois et le baudrier d'Orion, étoiles dont la disposition rappelle la forme du râteau dont se servent les faneurs. Le Rétiau, le Chariot et la Pussenère (Les Pléaides) sont à peu près les seules constellations qui ont un nom dans le patois. - (19) |
| retinton (d'une noce) : ce qu'on appelle retour dans certaines régions. - (30) |
| retinton : s. m., répétition, retour, revenez-y. - (20) |
| retinton, s. m. petit retour de fête de peu d'importance. - (24) |
| retinton, s. m. petit retour de fête. - (22) |
| retinton, s. m., écho, reflet, léger souvenir d'une personne ou d'une chose : « I m'répeùle eùn brin la p'tiote ; j'en ai c'ment eùn r'tinton. » - (14) |
| retinton. s. m. Petite noce. (Pasilly). - (10) |
| retintouin, s. m., arrière-goût, reste, retour : « Quand j'ai migé du fromage, j'en ai tôjor eùn r’tintouin dans l'garguillòt. » — « Ol a évu eùn r'tintouin d'colique. » - (14) |
| retiraison : s. f., action de retirer, retrait de marchandises. - (20) |
| retirance. s. f. Demeure, refuge, domicile. - (10) |
| retire, s. m. refuge, asile, le lieu où l'on se retire : ce pauvre homme n'a pas de « retire. » - (08) |
| retirer à quelqu'un, lui ressembler. - (03) |
| retirer de ... ressembler à ... - (05) |
| retiri : Retirer. - (19) |
| rét'lè : v. t. Râteler. - (53) |
| retolon : petits rejets - (43) |
| retonée ou retonnée. : Répartie, riposte. Le mot italien ritornata a été traduit en français par ritournelle pour exprimer la répétition au refrain de partie d'un couplet. - (06) |
| retonée. Repartie prompte et imprévue, dicton, quolibet… On appelle ainsi ritournelles, ces chansons dont les premiers vers se repètent à la fin des couplets… - (01) |
| retoner : revenir sur ses pas. - (66) |
| rétonnée, repartie, riposte. - (02) |
| reton-ner, v. n. produire un écho. - (24) |
| retor, s. m., retour, action de revenir d'un endroit. - (14) |
| retor. Retour. Mais fi retor, c’est du fil retors. - (01) |
| retordu, retorduse : part, pass., retors, retorse. - (20) |
| retorne, s. f. retour, soulte d'échange : « i t' beille mai vaiche, ma i veu d' lai retorne. » - (08) |
| retòrne. s. m., retour, remise sur un marché, échange : « O vlòôt m'bailler son pré cont' le mien ; mâ ô d'mandòt eùne trop grosse retòrne. » - (14) |
| retorner : retourner - (48) |
| retorner : Retourner. « Ol est grandement leugi, ol a de qua se retorner ». - (19) |
| retorner, v. intr., retourner, revenir. - (14) |
| retorner, v. n. retourner. - (08) |
| rétorniâ : étourneau. - (31) |
| rétoulâ, s. m. terrain qui a été ensemencé sur éteules, c’est à dire qui porte une fois de plus une récolte de céréales. - (08) |
| rétoulé, subst. partie. terrain cultivé une seconde fois, une année de plus. le seigle réussit souvent sur les « rétoulés. » - (08) |
| rétouler, v. a. emblaver une fois de plus le même terrain. - (08) |
| rétouné, v. n. produire un écho. - (22) |
| rètoure, ratière. - (26) |
| retournate. s. f. Clayon de fromage. (Coulours). - (10) |
| retourneau : s. m., étourneau. - (20) |
| retournette. s. f. Tresse de paille circulaire pour dresser les fromages. (Plessis-Saint-Jean). - (10) |
| retra(o)yant : personne qui exerce un retrait. - (55) |
| rétrachi : Rétrécir. En parlant d'un ouvrage de tricot, faire une ou plusieurs mailles en moins. - (19) |
| retrait, s. m., lieu où l'on se retire, latrines. Nos grands-pères n'avaient d'abord que les champs et les prés, où chacun allait « voile au vent » Puis ils établirent ce réduit intime, mais le plus loin qu'ils purent de l'appartement : au fond d'une cour, au bout d'un jardin. Au point de vue de l'odorat, c'était bien ; mais ayez donc la colique la nuit, et par la pluie ou la neige !... - (14) |
| retranchi : Retrancher. « Se retranchi » : se priver. « L’an-née est mauvâse, i va bin falla se retranchi ». - (19) |
| rétraubyi v. (du lat. stabulum avec un re de renforcement). Mettre les vaches à l'étable avant l'hiver. - (63) |
| rétrecissi C'est l'aoriste bourguignon de rétrécir… - (01) |
| retreinssi, v. a. recroqueviller, resserrer. - (22) |
| retrillonné : rétréci. - (66) |
| rétrillonner. v. n. Rogner sur tout, lésiner, agir en avare. - (10) |
| retrocher, v., repousser en touffe sur une queule. - (40) |
| rétroici, v. a. rétrécir, rendre plus étroit. - (08) |
| retrosser : Retrousser. « Y a de la borbe, retrosse ta culotte ». - (19) |
| retrosser, ertrosser. Trousser, retrousser. - (49) |
| retrossi son d'vanti : relever son tablier (en signe de politesse) - (43) |
| retrouècher : (r'trouèché - v. intr.) taller, produire des rejets, en parlant des céréales. Pour les autres végétaux à rhizômes, on dira r'gâ: mè. - (45) |
| retrouer : Retrouver. « Y fiait bin si na que je ne pouyais jama retrouer man chemin ». - (19) |
| retrouer, v. a. retrouver. (voir : trouer.) - (08) |
| rétrouèssi : rétrécir - (48) |
| retrouincher : (r'trouin:ché - v. intr.) labourer la terre en juin ou juillet de l'année qui suit celle de la jachère, le "sombre". - (45) |
| retsairtsi : rechercher - (43) |
| rétsaper : réchapper - (43) |
| rétsapper v. Sorti d'un danger. - (63) |
| rétsau : réchaud - (43) |
| rétsaud n.m. Réchaud. - (63) |
| rètse : (adj.f) (pente) raide, escarpée - (35) |
| rétsergni : imiter les grimaces de quelqu'un, singer - (43) |
| retsergnou : imitateur - (43) |
| retsinde : réchauffer - (51) |
| rétsindre : réchauffer. A - B - (41) |
| rétsindre (se) : (se) réchauffer ; p. passé : rétsindu - (35) |
| rétsindre (se) : se réchauffer - (43) |
| rétsindre : réchauffé - (34) |
| rétsindre v. (du lat. excandere, chauffer à blanc, vx.fr. eschandir, se chauffer). Réchauffer. - (63) |
| rétsindu adj. Réchauffé. Dz'su pas bié rétsindu. - (63) |
| rettaichi : rattacher - (57) |
| rette : souris - (52) |
| rette volerette : chauve-souris (tr. lit. : rat volant). A - B - (41) |
| rette volerette : chauve-souris - (34) |
| rette : s. f., vx fr. ruette, ruelie. - (20) |
| rètte, souris. - (26) |
| retumbe. Retombe. La seconde syllabe de retumbe se prononce comme la première d'humble. - (01) |
| rétyau : s. m. râteau. - (21) |
| reu : Usité seulement dans ces locutions : « Au reu du chaud, au reu du sola » en pleine chaleur, en plein soleil. - (19) |
| reu n.m. (du lat. rivus, ruisseau, petit cours d'eau) Ruisseau. Voir riot. - (63) |
| reu, s. m. pluie torrentielle. Ne s'emploie guère qu'au pluriel dans la locution « les reus d' mai », c’est à dire les grandes averses ou ondées du printemps qui parfois endommagent gravement les chenevières. - (08) |
| reu. Petit ruisseau ; lavoir. - (49) |
| reube : Robe. « Eune reube d'indienne ». « Le reube de beu » ou la « reube de brot », jadis les jeunes gens et principalement les bergers se donnaient rendezvous dans la montagne le premier dimanche de Mai pour fabriquer avec les nouvelles frondaisons une sorte de cloche, une robe de bois dans laquelle l'un d'eux s'introduisait ; ils descendaient ensuite une bande au village, escortant celui qui portait la « reube de beu » et ils faisaient une quête dont le produit leur permettait de célébrer par un festin rustique le retour du printemps qui venait de descendre de la forêt avec eux. Cette poétique coutume a disparu depuis plus d'un demi-siècle. - (19) |
| reûbe, et rôbe, s. f., robe. - (14) |
| reubignet, sm. robinet. - (17) |
| reubin, sm. bélier. - (17) |
| reubinet : Robinet. - (19) |
| reubinet, sm. martinet (fouet). - (17) |
| reubye : s. m. râble. - (21) |
| reûc’e (ainez), reûc’ou, mouelle : humeur coulant des narines - (37) |
| reûç’oux (âte) : (être) morveux - (37) |
| reuce (n.f.) : roche - (50) |
| reuchan : Rocher. « La seurce de la Doue so d'in greux reuchan ». - (19) |
| reuchat : roitelet. - (09) |
| reuchat. s. m. Roitelet. (Andryes, Châtel-Censoir). - (10) |
| reûche (n. f.) : goutte au nez (avouèr la reûche au nez) - (64) |
| reuche (n.m.) : 1) rouge-gorge - 2) morve - (50) |
| reuche (une) : goutte au nez, morve - (61) |
| reuche : morve, rouge-gorge - (60) |
| reuche : Roche. « I sant allés se preumener su la Reuche » : ils sont allés se promener sur la Roche d'Aujou… - (19) |
| reuche : rouge-gorge. II, p. 31 - (23) |
| reuche : rûche - (48) |
| reuche : ruche. - (29) |
| reuche : saleté dans le nez - (44) |
| reuche : morve. - (52) |
| reuche : petit oiseau (vocable plus rare que Ouéyau). Ce mot est utilisé par Pierre Chambon dans une de ses poésies patoisantes. - (58) |
| reuche : s. f. tas de foin disposé en raies allongées. - (21) |
| reuché : v. i. Eternuer. - (53) |
| reuche, adj. rugueux. - (38) |
| reûche, niche ; reuché, rucher. - (16) |
| reuche, s. f. oiseau de l'ordre des passereaux, rouge-gorge. - (08) |
| reuche, s. f. roupie au nez. - (08) |
| reûche, s. f., corbeille en osier, d'une forme spéciale, pour mettre la pâte à porter au four. - (14) |
| reuche, s.f. ruche. - (38) |
| reuche, subst. féminin : morve. - (54) |
| reuche. Laîche ou carex : herbe dure poussant dans les prés marécageux ; sert à faire la litière. - (49) |
| reuche. n. f. - Goutte au nez. Autre sens : roitelet, à Sougères-en-Puisaye, et dans le sud de l'Yonne. Rouge-gorge, selon M. Jossier, et F.P. Chapat. - (42) |
| reuche. s. f. Rouge-gorge. (Diges). - (10) |
| reuche. s. f. Roupie au bout du nez. - (10) |
| reuchener, v. n. raccommoder grossièrement, sans goût, sans propreté. (voir : châtrer.) - (08) |
| reucheron : partie supérieure de la ruche en paille. - (33) |
| reucheux. adj. - Se dit d'une personne qui a toujours la goutte au nez. - (42) |
| reucheux. adj. Qui a toujours la roupie, la goutte au nez. - (10) |
| reuchis. n. m. - Désigne le restant, le fond, la fin : le reuchis d'une noce. Autre sens : un peu. - (42) |
| reuchis. s. m. Un peu. (Saint-Sauveur). - (10) |
| reuch'né : v. i. Ronchonner. - (53) |
| reuchner : laisser brûler un met sur le feu. A - B - (41) |
| reuchô, toile grossière dont se servent les vignerons... - (02) |
| reûchon (n.m.) : morveux (aussi reûchou) - (50) |
| reuchon : partie supérieure de la rûche - (48) |
| reuchon : restant (de soupe, par exemple). - (52) |
| reuchon, qui offre un visage renfrogné ; on emploie aussi ce mot en parlant du taureau en colère. - (27) |
| reuchon, s. m. raccommodage, rapiécetage mal fait : faire des « reuchons = reuchener. » (voir : châtreure.) - (08) |
| reuchon, s. m. ruche, panier en forme de cloche à l'usage des abeilles - (08) |
| reuchon. s. m. Dette d'auberge. (Bessy). - (10) |
| reuchöt, sm. rochet. - (17) |
| reûchou (ze) : (adj) mal lavé (e), morveux (se) - (35) |
| reuchou, mouchoir - (36) |
| reuchou, ouse, adj. roupieux, celui qui est sujet à avoir la roupie au nez. (voir : reuche.) - (08) |
| reuchouner (verbe) : ronchonner, rouspéter. - (47) |
| reuchoux, adjectif qualificatif : morveux, malpropre. - (54) |
| reude, adj. rude, fort, énergique. - (08) |
| reudeur, s. f. rudesse, dureté, sévérité. - (08) |
| reudéyer,v. a. rudoyer, malmener, maltraiter. (voir : rudôger.) - (08) |
| reue (faire la) : bouder. - (29) |
| reue (fém.), foin ramassé en bandes avant de le mettre en tas. - (27) |
| reue (laire lai), montrer un visage renfrogné, signe de mécontentement. - (27) |
| reue (n.f.) : roue - (50) |
| reue : grimace, moue, bouderie - (48) |
| reûe : la moue, on dit également boque - fère lè reûe, fère lè boque, faire la moue - (46) |
| reûe : mot féminin désignant une rangée de légumes dans un champ - (46) |
| reue : rang de foin relevé au râteau - (48) |
| reue : roue - (48) |
| reue : roue. - (52) |
| reue : tas (de foin). (RDM. T IV) - B - (25) |
| reue : Tas de branches récemment abattues dans la forêt, tas de foin de forme allongée qui sera transformé en « cuchot » avant d'être mis sur le char. « Eune bonne reue de lagnes » : un bon tas de perches. « Mentre en reue » : réunir le foin en « reue » avant de la mettre en « cuchot ». - (19) |
| reue : moue. Le mal grécieux fait la reue : le mal gracieux fait la moue. Faire la reue : bouder. - (33) |
| reue : roue. Les reues tournont : les roues tournent. - (33) |
| reue de nwêge : congère. (RDM. T III) - B - (25) |
| reue : (reu: - subst. f.) 1- roue. 2- gros andain de foin fait à la râteleuse. - (45) |
| reue : 1 n. f. Andain, rangée de foin ou de céréales fauchés. - 2 exp. Faire la mauvaise tête. - (53) |
| reue : roue - (39) |
| reûe, moue ; fâr lai reûe, faire la moue, en signe de mécontentement. - (16) |
| reue, roue - (36) |
| reue, s. f. roue de voiture. - (08) |
| reue, s. f., andain de grande taille, avant les cacherons,(cf. ce mot). - (40) |
| reue, sf. mauvaise mine. Toné lai reue, faire la gueule, regarder d'un air furieux. - (17) |
| reuë. Roue, et tout au contraire pour queue, on dit en bourguignon quouë. - (01) |
| reufé : v. t. Ruminer. - (53) |
| reufe, crasse, saleté, surtout sur la tête des enfants malpropres. - (27) |
| reuffle, crasse de la tête chez les enfants. - (02) |
| reufien. Rufien… - (01) |
| reufou : malpropre, hirsute, sale - (48) |
| reufou(ouse) : (reufou(ouz') - adj.) 1- hirsute (se dit spécialement d' un chien tout crotté). 2- rugueux, mal poli (en parlant du bois). - (45) |
| reuge, adj. rouge ; reugeoiller, rougir. - (38) |
| reugner. Attendre. On dit couramment « faire reugner » pour faire attendre. Se dit aussi pour grogner en parlant du porc. - (49) |
| reugnon. Groin de porc. - (49) |
| reuilla : Enroué, catarrheux. « In vieux reuilla ». - (19) |
| reuillas, reuillasson : s. m., lambin. - (20) |
| reuillasser, reuiller : v. n., vx fr, roeillier, lambiner. - (20) |
| reûille (d'la) : rouille - (57) |
| reûille (n. f.) : silo de betteraves ou andain de foin (enne reûille de blettes) - (64) |
| reûille (n.f.) : rouille - (50) |
| reuille : rouille - (51) |
| reuille : rouille - (48) |
| reuille : Rouille. « Les eutis que sarvant tos les jos ne craignant pas la reuille ». - Maladie des blés due à des champignons microscopiques dont l'humidité favorise le développement. - (19) |
| reuillè : rouiller, oxyder - (46) |
| reuillè : 1 v. t. Rouiller. - 2 v. pr. Se râcler la gorge. - (53) |
| reuille, s. f. rouille. - (08) |
| reuille, s.f. rouille. - (38) |
| reuille, subst. féminin : chapardage, vol. - (54) |
| reuille. Rouille. - (49) |
| reuille-mardes (dâs) : (un) homme « fouineur » - (37) |
| reûille-mardes : coléoptère noir et lent, vivant dans les bouses de vaches - (37) |
| reûiller (v. int.) : rester dans l'inaction, rêvasser (syn. rbeûiller) - (64) |
| reuiller : rouiller - (48) |
| reuiller : voir reuillon - (23) |
| reuîller, raiveûller : rechercher dans les détritus pour récupérer - (37) |
| reuiller, v. rouiller. - (38) |
| reuiller, verbe transitif : récupérer ou dérober. - (54) |
| reuiller. Rouiller. - (49) |
| reuiller. v. - Regarder, en ouvrant de grands yeux : « Y s'plantait là d'vant ceux ch'vaux d'bouais, reuillant partout, mains dans les poches. » (G. Chaînet, En chicotant mes braisons, p.24). Autre sens : ruminer, en parlant d'un animal. (F.P. Chapat, p.171) - (42) |
| reuiller. v. n. Chercher, demander : se dit surtout des enfants qui vont demander des restes d'un repas de noce. (Sainpuits). – S'entend, à Bléneau, d'une vache qui ne mange pas. Elle reuille. - (10) |
| reûilli (v.t.) : rouiller - (50) |
| reuilli : rouiller - (51) |
| reûilli : rouiller - (57) |
| reuilli v. Rouiller. - (63) |
| reuilli, v. a. rouiller, couvrir de taches rougeâtres comme la rouille. - (08) |
| reuillis. n. m. pl. - Restes d'une noce ; synonyme de reuchis. (Sainpuits, selon M. Jossier) - (42) |
| reuillis. s. m. pl. Restes d'une noce. (Sainpuits). - (10) |
| reuillo : enrouement. (CH. T III) - S&L - (25) |
| reuillon : chercher le reuillon = solliciter les restes du repas de noces. IV, p. 23-7 - (23) |
| reuillon : n. m. Crachat. - (53) |
| reuillons : résidus - (37) |
| reûillot (n. m.) : restes d'un repas de noces, que les enfants du voisinage venaient réclamer (chorcher l'reûillot (se dit de quelqu'un qui profite des occasions pour se faire offrir à boire ou se faire nourrir gratuitement)) - (64) |
| reuillot, instrument en bois, en forme de petite pelle, que les laveuses de lessive emploient pour battre le linge. - (11) |
| reuillot, rouillot. n. m. - Battoir en bois des lavandières. - (42) |
| reuillot, s.m. enrouement. - (38) |
| reuïllot. Tapette en bois dont les femmes se servent pour battre le linge. Les laveuses fiant autant de bruit dévou leus langues que d’aivou los reuillots. Le français battoir ne précise pas, comme notre mot reuillet, l'action de « retourner en volant : revolo. » Les Morvandiaux disent un tacot. - (13) |
| reuillou (-ouse) : (adj .m. ou f.) : rouillé (-e) - (50) |
| reûillou : rouillé - (57) |
| reuillou(se) : rouillé(e) - (51) |
| reuillou, ouse, adj. rouillé, qui a la couleur de la rouille : un pré « reuillou », une eau « reuillouse. » - (08) |
| reuilloux, subst. masculin ou adjectif qualificatif : personne qui reuille, chapardeur, voleur. - (54) |
| reuilloux. Rouilleux. - (49) |
| reûillure (d'la) : rouillure - (57) |
| reûlée : mot féminin désignant le cadeau donné par la marraine à l'occasion des fêtes de Pâques (lè reûlée d'Pâques) - (46) |
| reûlette : roulette - (37) |
| reûlot : cylindre à vapeur sur les routes - (37) |
| reûlotte : roulotte (de bohémiens) - (37) |
| reume, rhume. - (04) |
| reume, s. m. rhume. - (08) |
| reûme, s. m., rhume. - (14) |
| reûmoû, adj., enrhumé, qui tousse habituellement. - (14) |
| reune : (rœn - subst. f.) sable grossier produit par la décomposition du granit. - (45) |
| reune, reuné, ruine, ruiné. - (05) |
| reunouse : (reunou:z' : adj. f.) qui comporte beaucoup de roen' (en parlant d'une terre pauvre). - (45) |
| reuper : (reupè - v. neutre) émettre un rot sourd et profond. Pour dire "éructer bruyamment", on emploie le verbe fr. rotè - (45) |
| reuquer : Roter. - (19) |
| reuquille : Petit flacon. « Eune reuquille de goutte ». - (19) |
| reûqu'ner : tousser, se gratter la gorge, avoir une respiration bruyante - (48) |
| reusaice, sf. rosace. - (17) |
| reusaulou : coquelicot. (BEP. T II) - D - (25) |
| reuse, s. f. ruse, détour, stratagème : avoir des « reuses », user de finesse pour arriver à son but. (voir : reuser.) - (08) |
| reûsement : heureusement - (57) |
| reuser, v. a. ruser, avoir des ruses, des finesses, des subterfuges. - (08) |
| reussé, vn. voir sombré. - (17) |
| reusser : tousser - (48) |
| reusser : (reusé - v. neutre) tousser faiblement, toussoter. - (45) |
| réussi : Réussir. « Ses affares n'ant pas réussi ». Ironiquement « Ol est réussi », il est tout à fait ridicule, grotesque. - (19) |
| reusson : (reuson: - subst. m.) rièble, autrement dit gaillet grateron ou gaillet accrochant. - (45) |
| reussope, s. f. fragment, débris, éclat détaché de la souche d'un arbre, déchet d'une bûche façonnée en moule. (voir : erchoupe, rechoupe, sopée.) - (08) |
| reussoper, v. a. couper avec la cognée ce qui reste à la souche d'un arbre abattu. (voir : erchouper.) - (08) |
| reustique, adj. rustique, fort, solide, de bonne qualité : une étoffe rustique, c'est-à-dire qui résiste, qui dure longtemps. - (08) |
| reût’né (mets) : (mets) archi-réchauffé, jusqu’à prendre mauvais goût - (37) |
| reuta'lli : Fustiger, battre à coups de verges. « O s'est fait reuta 'lli c'ment i faut ». - (19) |
| reûtè : enlever, on dit aussi eûtè - (46) |
| reute : s. f. attache de fagot. - (21) |
| reuté, vn. roter. - (17) |
| reuteler : travailler en lambinant - (60) |
| reutenaler, v., coller au fond de la gamelle, en parlant de la soupe. - (40) |
| reutenées, s. f .pl., odeur des herbes qui pourrissent dans les fossés. - (40) |
| reûtener : Cuire trop longtemps. « Du fricot reûtené » : de la viande qui est restée trop longtemps au feu. - (19) |
| reutener, v. cuire trop longtemps. - (65) |
| reuter (verbe) : gratter le sol de sa patte en parlant d'un taureau qu'il vaut mieux éviter. - (47) |
| reuter, v. a. se dit des bêtes à cornes et principalement des taureaux qui fouillent la terre avec leurs pieds en la rejetant derrière eux. - (08) |
| reuter. v. a. et n. Encorner, donner des coups de cornes, en parlant d'un bœuf. (Domecy-sur-Cure). - (10) |
| reuti : Rôtir. « Fare reuti in poulot ». - Viande rôtie. « In reuti de viau ». - Tartine. « Eune reutie de fremage blianc ». - (19) |
| reûti : v. t. Rôtir. - (53) |
| reutïe, s.f. rôtie, tartine. - (38) |
| reutîlle, s. f. tartine, rôtie. - (22) |
| reutîlle, s. f. tartine, rôtie. - (24) |
| reutissoure, sf. rôtissoire. - (17) |
| reutji, vt. rôtir. - (17) |
| reutnaler : cuire trop longtemps. - (62) |
| reutné : odeur de brulé - (44) |
| reût'nè : 1 n. m. Plat cuisiné trop longtemps sur le feu, brûlé. - 2 n. f. Pommes de terre trop cuites. - (53) |
| reutné. Réchauffé. Se dit en parlant d'aliments préparés à l'avance. « Vos êtes jamais prêts, le déjeuner vais être tot reutné ». - (49) |
| reutner : rouspéter. A - B - (41) |
| reûtner : aller vite, se dépêcher - (43) |
| reutner : rouspéter - (34) |
| reutner v. 1. (du lat. ructare, roter). Rouspéter, ronchonner. 2. Se dessécher sur le fourneau. - (63) |
| reutner, v. rôtir. - (38) |
| reut'ner, verbe intransitif: cuire trop longtemps en prenant un mauvais goût. - (54) |
| reutö, sm. bourbier, ornière profonde, fondrière. - (17) |
| reûton : (nm) sentier escarpé - (35) |
| reûton : sentier escarpé - (43) |
| reuton, s. m. sentier étroit. - (22) |
| reuton, s. m. sentier étroit. - (24) |
| reuton. Indécis, traînard. - (49) |
| reûtoner, v. intr., trop tromper. Se dit de la soupe dans laquelle on a coupé le pain trop longtemps d'avance, et de sauces, de mets qui cuisent et recuisent indéfiniment : « Ta fricassée n'a pas bon goût ; t'las laissé reûtoner. » (V. Beùrtaler.) - (14) |
| reutse : herbe de marécage, iris d'eau. Voix rauque, enrouée. A - B - (41) |
| reutse : avoir la reutse : être enroué - (34) |
| reutse n.f. (du v. fr. resque, rêche). Grand roseau, laîche, iris des marais, massette, quenouille, carex. - (63) |
| reutse n.f. Enrouement. - (63) |
| reutses : jonc des marais - (43) |
| reûtson : (nm) enrouement - (35) |
| reûtsonner : (vb) se racler la gorge - (35) |
| reutyeu : s. f. tartine. - (21) |
| reûv’yi : (vb) réveiller - (35) |
| reuve. n. f. - Rave, navet. - (42) |
| reuvôdre, remettre du fil en peloton ; d'où revogeuse, ou ravôdeuse, pour qualifier l'ouvrière qui fait des raccommodages. - (02) |
| reux, s. m. plur. œufs : elle a vendu ses « reux » au marché, elle a donné ses « reux » à ses « renfans. » (voir : renfans, rieux.) - (08) |
| reûye, rouille ; reûyé, rouillé. - (16) |
| reuyer : rouiller - (39) |
| reûyou : rouillé - (43) |
| reûyou(ze) : (p.passé) rouillé(e) - (35) |
| revage : Rivage, endroit qu'on fréquente. « I n'est pas su neute revage » : ce n'est pas dans nos parages, ce n'est pas un pays que nous fréquentons. - (19) |
| révaillé. Réveillé, éveillé, vif, gai. - (01) |
| révaille. Réveilles, réveille, réveillent. - (01) |
| révailli : Réveiller « Padant les ovrages i faut se révailli de ban métin ». - (19) |
| revainchai (se), prendre sa revanche, se venger de. - (02) |
| revainchai (se). : Prendre sa revanche. - (06) |
| revainche. Revanche. An revainche, en récompense. - (01) |
| revainché. Revencher. - (01) |
| revâmè : pousser une seconde fois (en parlant des pommes de terre) - (46) |
| revâmer, s. m., pousses des pommes de terre dans la cave. - (40) |
| revamon. Revenez-y. Vote flan âst excellent, en voudrâs un petiot revâmon. Ce mot est usité à Meursault. Un revamon est un bourgeon adventice qui se développe sur le collet ou sur la racine des arbres fruitiers. - (13) |
| revange : Revanche. Terme de jeu, « donner la revange », offrir au joueur qui a perdu de jouer une nouvelle partie. - (19) |
| revanger (se), v. se venger. - (38) |
| revangi : Prendre une revanche. « Se revangi » : se défendre. En parlant des récoltes, abonder. « Y a-t-i bien ésu du blié dans sa tarre ? O s'est enco pas mau revangi ». - (19) |
| revangi : v. donner un bon rapport (se dit de la terre). - (21) |
| revangi, 1, v. a. défendre : n'aie pas peur, je te revange. — 2. v. n. abonder : cette récolte revange. - (22) |
| revanne, s. f. criblure, ce qui reste après l'opération du vannage. On prononce « re-van-n'. » - (08) |
| revannerie, s. f. criblure. - (08) |
| révarbère. Réverbère. - (49) |
| revardi : Reverdir. « S'te ptiète pliô a bien fait revardi les près ». - (19) |
| revari, ce qu'on peut appréhender d'une chose. En latin, reveri, appréhender ; revereor, j'appréhende... - (02) |
| revari. : Ce qu'on peut appréhender d'une chose. (En latin vereri signifie craindre.) - (06) |
| revarper (se) : Se rebiffer, se retourner crânement contre un agresseur. « Quand an foule su la coue d'in vé o se revarpe » : quand on marche sur l'extrémité d'un ver il se « revarpe ». - (19) |
| revarper (se) : se rebiffer. - (56) |
| revarper (se) : se reculer brutalement. - (66) |
| revarper (se) : se redresser, se défendre. (A. T II) - D - (25) |
| revarper (se), et reverper (se), v. pr., se redresser, se raidir contre quelqu'un, lui tenir tête, se rebiffer : « Le diâbe ! drès que j'voux l'envier à l'écôle, ô se r’varpe coume ein chat en coulâre. » - (14) |
| revarper (Se), reverper (Se) : v. r., se rebiffer. - (20) |
| revarper (se), s'opposer, se défendre. - (05) |
| revarper (se), v. pr., se révolter, se rebiffer contre une admonestation ou une correction. - (11) |
| revarper (se), v. se rebeller. - (65) |
| revarper (se), v. se révolter. - (38) |
| revarper (se), v., se défendre pour guérir. - (40) |
| revarper (se). Se retourner contre quelqu'un, faire face à un danger, protester énergiquement. Etym. inconnue. - (12) |
| revarper. Se cabrer, se défendre. - (03) |
| revarpi (se), se rebiffer, faire comme un ver ou un reptile dont les tronçons s'agitent. Revarpai signifie aussi, dans certains lieux, résister. - (02) |
| revarpi ou revarpai. : Se rebiffer, faire comme un ver ou un reptile dont les tronçons s'agitent. - (06) |
| revarrein. Reviendrions, reviendriez, reviendraient. - (01) |
| rèvâter : (révâ:tè - v. trans.) battre comme plâtre, rouer de coups. - (45) |
| révater. Gronder, punir un enfant. Ce verbe est très employé dans l’Auxois. Gaigeons voi qu’i m'en vâs te révâter, tins. Gaigcons-y voi !.. - (13) |
| rèvatler : rêver en parlant. - (52) |
| revaucer, revaucher : v, a., mettre en revauge. - (20) |
| revauge, revauche : s. f., jauge. Mettre des rosiers en revauge. - (20) |
| rèvauluch'na : gamin polisson. (VSLD. T II) - S&L - (25) |
| rève : (nf) rave - (35) |
| rève : rave - (43) |
| réve, rave. - (16) |
| rève, rave. - (26) |
| rëve, rêve ; à quelqu'un qui raconte une chose fausse on dit : te l'ë rëvé ! - (16) |
| revecher (Se) : v. r., vx fr. revecher, se rebiffer. - (20) |
| reveigne. Revienne, reviennent. - (01) |
| revelà ou rev'là : Locution adverbiale. Revoilà. « Te rev'là ! ». - (19) |
| revendoux : Féminin : revendouse. Revendeur, coquetier. - (19) |
| revenge, s. f., revanche, coup rendu pour un coup reçu. - (14) |
| revenger (se), se battre de nouveau. - (05) |
| revenger : v. a., revancher ; prendre la défense de ; rapporter, produire. - (20) |
| revenger, v. tr., venger, revancher, défendre quelqu'un : « On li f'sòt du mot, à c'petiot ; je l'ai revengé. » - (14) |
| revenger. Se défendre, vieux mot. - (03) |
| revengi, 1. v. a. défendre : n'aie pas peur, je te revenge (du latin vindicare et du préfixe re). — 2. v. n. abonder : cette récolte revenge. - (24) |
| reveni : Verbe revenir « T'es dan reveni ». - (19) |
| revenî, v. tr., ranimer, redonner de la vigueur : « Ol étòt bé mau ; mâ j'li ai beillé eùne gôte pou li r’veni l'cœûr. » - (14) |
| revenir (Se) : v. r., se réduire, se rétracter. Se dit des aliments solides. - (20) |
| revenir (se). Augmenter de volume sous l'effet de l'eau, de la cuisson. - (49) |
| réventer : refroidir ou aérer - (48) |
| réventer : (révan:tè - v. trans.) 1- au propre : refroidir. Ainsi en parlant du temps : Sè s' révan:t', "le temps se rafraîchit". 2- au figuré : refroidir l'ardeur, c-à-d dégoûter. - (45) |
| réventer, v. a. refroidir, rendre froid : le lait est trop chaud « réventez-le » ou faites-le « réventer. » - (08) |
| revenu, similaire. (Ex.: c'est le revenu d'un tel, pour dire qu'il a agi comte ce dernier). - (27) |
| reverdière, s. f., verdier, oiseau. - (14) |
| revère, rivière. - (05) |
| reverpai (se) : se mettre sur la défensive. (C. T IV) - A - (25) |
| reverper (C.-d.), revarper (Chal., Br.). S'emploie comme neutre ou passif et signifie résister, se défendre, se rebiffer… Dans l'Yonne, on dit, pour exprimer le même fait, se regricher qui se rapproche plus de se rebiffer. La véritable origine nous paraît plutôt se trouver dans le vieux français reverbèrer qui, actif, signifiait : répéter, et neutre ; regimber. - (15) |
| reverper (se) : rebeller (se) - (48) |
| reverper (se) : se cabrer. - (32) |
| reverper (se) : (se r'vêrpè - v. pron.) se récrier, réagir de façon brusque, protester énergiquement. L'idée de protestation contenue dans ce mot est plutôt verbale, contrairement à se r'jipè où l'on songe davantage à une rébellion physique. - (45) |
| reverper (Se). Résister en se défendant, au propre et au figuré. Un serpent, sur la queue duquel on foule, se reverpe. Les enfants désobéissants ont l'habitude de se reverper. - (13) |
| reveuiller : bouleverser. (T. T IV) - S&L - (25) |
| reveuiller : remuer, bouleverser, molester. - (32) |
| reveuiller : retourner des affaires, ou la terre. - (66) |
| reveuiller, bouleverser, renverser. - (05) |
| reveuiller, revorcher, feneuiller : chercher (le second avec l'idée : en laissant du désordre). (G. T II) - D - (25) |
| reveuiller, v. retourner la terre. - (65) |
| reveuiller, variante de rebeuiller. v. n. Fouiller. (Pasilly). - (10) |
| reveuiller. Bouleverser pour chercher, ou ranger ensuite quelque chose ; c'est ce qu'on appelle à Chalon faire le rebuillon. - (03) |
| reveuillis. s. m. Terrain fouillé. (Pasilly). - (10) |
| reveurder, v., reverdir. - (40) |
| réveuster. v. a. Faire des reproches, gronder. (Etivey). - (10) |
| reviauler (verbe) : aboyer en laissant paraître la douleur. - (47) |
| reviauler, v. a. hurler ou aboyer avec douleur. Se dit principalement des chiens : « acoute c'man ton chien r'viaule. » - (08) |
| reviauler, v. intr., aboyer en gémissant : « Tôte lai neùt j'entends pô lai rues des chins qui r’viaulont. » - (14) |
| revicoulé, v. n. ragaillardir : ce bon vin m'a revicoulé. - (22) |
| révigner. v. a. Aveindre. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| revigorai, revivre, se ranimer... - (02) |
| révigorai. : Revivre, se ranimer. (Rac. lat. vigor.) - Rabigoté est un barbarisme qui était usité dans le Châtillonnais. - (06) |
| révigôtai. Ravigoter, ravigotez, ravigoté. - (01) |
| révïlli v. Réveiller. - (63) |
| révillo : enrouement. (S. T IV) - B - (25) |
| revion, s. m. détour, sinuosité : une rivière qui serpente dans un pays montagneux fait de nombreux « rêvions. » - (08) |
| reviouser, v. n. revivre, repousser, donner un regain : les prés secs ne tardent pas à « reviouser » après une forte pluie. - (08) |
| revire : la rivière. - (56) |
| revire : rivière - (34) |
| revire : Rivière, ruisseau « La revire des M'lin Meutin ». - (19) |
| revire, s. f. rivière. - (22) |
| revire, s. f. rivière. - (24) |
| revire, s. f. rivière. cette forme a vieilli et n'est plus guère usitée. (voir : riviée.) - (08) |
| revire-coups (à), loc. à coups redoublés. - (24) |
| revire-Marion : s. m., vs fr., tournemaln, revers de main, soufflet. - (20) |
| revirer(se) : se retourner, se recourber - (60) |
| revirer, retourner. - (05) |
| revirer, v. a. retourner, tourner dans un autre sens. (voir : devirandouére, virer.) - (08) |
| revirer. Faire des rondes et des farandoles... - (13) |
| revirer. Retourner, vieux mot. - (03) |
| reviri : Retourner. « O s'est reviri tot d'in co ». - (19) |
| reviri. Virer, c'est tourner. Revirer quelque chose, c'est la retourner d'un sens à un autre… - (01) |
| reviver, v. n. revivre, repousser, donner un regain. (voir : reviouser.) - (08) |
| revivre, r'vive. n. m. - Regain, herbe qui repousse après la première coupe. - (42) |
| revivre, s. m. regain, herbe qui pousse après une première récolte. - (08) |
| revivre. s. m. Regain, herbe qui repousse après la première coupe. (Lamsecq). - (10) |
| rev'ni : v. i. Revenir. - (53) |
| revni, revenir. Outre son sens naturel ce mot en a d'autres ; ainsi l'on dit : s’ki n'me revin pâ, pour : je ne m'en souviens pas. On dit encore : s't'enme ki n'me revin pà, pour : cet homme ne me plaît pas ; je ne lui donnerais pas ma confiance. La ménagère fait revni un mets en le faisant réchauffer. - (16) |
| rev'ni, r'veni : revenir - (48) |
| revôdre. : Mettre du fil en peloton (du latin revolvere) ; d'où revodeuse et non ravodeuse pour qualifier l'ouvrière qui fait l'emploi du fil. - (06) |
| révoé, possêder une chose à nouveau ; s'rivoé, se ravoir, sortir d'un mauvais pas où la vie était en danger, de l'eau, par exemple, où l'on était accidentellement tombé : é s'â révu ! De quelqu'un qui est en danger de mort on dit aussi : el éré bèn dë mô d'se révoé, il aura bien de la peine de s'en tirer. - (16) |
| revœiller. v. n. Regarder niaisement, d'un œil rêveur, d'un œil endormi. (Pasilly). - (10) |
| revœri, v. a. retrousser : reveri ses manches. - (24) |
| revoeugi, v. n. se remuer en tous sens, au lit spécialement. - (22) |
| révoéyé, réveiller ; el â bèn révoéyé ! se dit d'un enfant gai, qui a bonne mine. - (16) |
| revogner : vomir. (RDM. T IV) - B - (25) |
| revogué, demâmé : v. t. Vomir. - (53) |
| revoguer : vomir. (RDM. T II) - B - (25) |
| revogueur : n. m. Qui a été vomi. - (53) |
| révoillé, part. pass. réveille, dégourdi, gai, alerte. (voir : evoiller, voilier.) - (08) |
| revoiller, et ravoiller, v. tr., réveiller : « O dremôt su l'ôvraige ; j'te l'ai brâment révoillé. » - (14) |
| révoiller, v. réveiller. - (38) |
| revoin, regain, seconde récolte en fourrage. - (16) |
| revoinge (n.f.) : revanche - (50) |
| revoinge, s. f. revanche. - (08) |
| revoinger (se), v. réfl. se venger, tirer vengeance : « i m' r'voingerai d' lu », je me vengerai de lui. - (08) |
| revoiron. Reverrons, reverront. - (01) |
| revoisire (A la). locut. adv. Au revoir. (Lainsecq). - (10) |
| revoiyure, sf. revoir dans : ai lai revoiyure. - (17) |
| revole : fête de la fin des foins, des moissons - (43) |
| revole : Réjouissance à l'occasion d'un travail important. « J'ins fait la revole des machans ». - (19) |
| revole : s. f., révolution ; achèvement d'un cycle ; terminaison d'un travail, périodique (moisson, vendanges, etc.) ou non, et fête (repas, bal, etc.) donnée à.cette occasion. - (20) |
| revole, n.f. fête et repas de fin de vendanges. - (65) |
| revole, s. f. fin d'un travail accompagnée parfois d'une réjouissance : la revole des moissons. - (24) |
| revoler : Faire la revole. - (19) |
| révoluchené, - (05) |
| révoluchné. Se dit d'une tête hérissée, corruption de révolutionné. - (03) |
| revonge : (r'vonj' - subst. f.) congère, amas de neige poussée par Je vent. - (45) |
| revorchai, retourner, mettre quelqu'un à la raison, le faire changer de note... - (02) |
| revorchai. : Reprendre vertement quelqu'un. (Du latin revortere, ou revertere.) - (06) |
| revorché : retourné, bouleversé. - (32) |
| revorché : retourné. - (66) |
| revôrché : v. t. Retomber plusieurs fois, retourner sens dessus-dessous. - (53) |
| revorcher : ce que font les sangliers dans les champs, des dégâts ! - (66) |
| revorcher, remuer, se démener. - (28) |
| revorcher, v., retourner à la bêche une terre ou un jardin ; réprimander vertement. - (40) |
| revorcher. Retourner un objet sans dessus dessous, revorcher la terre pour labourer ; bouleverser. Etym. le patois orche, herse, orcher, herser. - (12) |
| revôrchon, qui met en désordre. - (26) |
| rêvou (on) : rêveur - (57) |
| revouaguer, vomir - (36) |
| révouaillè, révoueillè : 1 adj. Très éveillé. - 2 v. t. Réveiller. - (53) |
| révouéiller (v.t.) : réveiller - (50) |
| révouèiller : réveiller - (48) |
| révoueiller : réveiller - (39) |
| révoueillon (n.m.) : réveillon - (50) |
| revouérons, fut. de revouér, reverrons : « Bonsouér ! J'm'en vas ; mâ j'nous r'vouérons. » - (14) |
| revouger, revouiller : v. a., vx fr. revoler et reverchier, mettre en désordre. Qui est-ce qui a revouillé mon tiroir ? - (20) |
| revougi, v. n. se remuer en tous sens, au lit spécialement. - (24) |
| révouilli : éveillé - (57) |
| révouilli : réveiller - (57) |
| révouiner : murmurer. - (56) |
| révouiner : imiter le cri du cheval - (39) |
| revouinger (se) : (se r'vouin:jé - v. pronom.) sc venger, se revancher. - (45) |
| revoulai, troubler, agiter, renverser... - (02) |
| revoulai. : Troubler, agiter, remuer. – Dans le dialecte français revoulun signifie tourbillon de vent. (Lac.) Ces mots viennent du latin revolutum, de revolvere, ainsi que cette autre expression ribouler les yeux. - (06) |
| revoule, s. f. fin d'un travail : la revoule des vendanges. - (22) |
| revouse (n.f.) : amas de neige produit par le vent ; congère - (50) |
| revouse, s. f. amas de neige produit par le vent lorsqu'il souffle avec violence. « ravousse, ravoûse, reviouse. » - (08) |
| rèvouzeu, petit rongeur. - (26) |
| revoyue. (A la). locut. adv. Au revoir. (Grandchamp). - (10) |
| revoyure (à la). Au revoir. « À revoir » se dit également très souvent. - (49) |
| revrechi, v. a. rebrousser. - (24) |
| revredi : reverdir - (43) |
| revresser : reverser - (43) |
| revu, part. pass. de ravouér : « J'évò guâri mon reùme, é pi j'en ai révu eùn aute. » Eu (évu) avec réduplicatif. - (14) |
| revuiller, chercher en déplaçant des objets sans précaution. - (28) |
| revuyé (ū), vt. retourner sens dessus dessous. Voir rvoché. - (17) |
| révyi : réveiller - (43) |
| révÿi : réveiller - (51) |
| réye (m) : raifort. (CST. T II) - D - (25) |
| rfaire v. Refaire. - (63) |
| rfende v. Refendre. - (63) |
| rferdî (v. int.) : refroidir - (64) |
| rfeurdi v. Refroidir. - (63) |
| rfeurmer v. Refermer. - (63) |
| rfonci : refaire le fond - (51) |
| rfonci : refaire un fond (de panier) - (51) |
| r'frain (on) : refrain - (57) |
| rgadié (ă), vt. regarder. A Beneuvre : regâtié. - (17) |
| rgâgni v. Regagner. - (63) |
| rgain n.m. Regain. - (63) |
| r'gairder : regarder - (48) |
| r'gâmer : faire de nouveaux tubercules (pomme de terre) - (48) |
| r'gâmer : repousser (plante) - (48) |
| r'gâmer : repousser, faire de nouvelles tiges - (48) |
| r'gard (on) : regard - (57) |
| r'gardan, presque avare ; qui a peur de donner. - (16) |
| r'gardant : regardant - (57) |
| rgaugneu : rebouteur - (34) |
| rgaugni : action de remettre, replacer une articulation - (34) |
| r'geaud (avoir du). expr. - Avoir la forme, être actif.(Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| rgedaud : mendiant. - (30) |
| r'gègner : (r'jègné - v. neutre) seulement usité dans la locution r'jègné lé: dan, "montrer les dents de mécontentement, être furieux". - (45) |
| r'gennè : v. i. Hennir, rire en se moquant. - (53) |
| r'gigner (des dents) : rire en montrant les dents, avoir un rire idiot - (48) |
| r'gingo : repas léger, collation. - (33) |
| r'gingo. Retour de fête. - (49) |
| r'gingot : banquet - (48) |
| r'giper (se), verbe pronominal : se redresser brusquement, sursauter. - (54) |
| r'gippai (se) : réagir avec force, se regimber, protester, ruer. La contradiction fait se r'gippai : la contradiction fait se regimber. - (33) |
| r'gippè (s') : 1 v. pr. Se démener. - 2 v. pr. Réagir avec force. - 3 v. pr. Se regimber. - (53) |
| rgippé, vn. réchapper. S’emploie avec en : en réchapper (d'une maladie, d'un péril). - (17) |
| r'gipper (se) : réagir, regimber (se), remuer, se rebiffer, se démener - (48) |
| r'gipper. v. - Sursauter, tressaillir : «Le jus de groseille verte qui fait regipper ... » (Colette, Claudine à l'école, p.135). Se dit également pour rebiffer. - (42) |
| r'glisse : Réglisse. « R'glisse de beu » : bois de réglisse, glycyrrhiza glabra. - (19) |
| rgogneu : rebouteur. A - B - (41) |
| rgogni : remettre en place une articulation. A - B - (41) |
| rgôgni v. Replacer une articulation. - (63) |
| rgôgnioux, rgôgnieux n.m. Rebouteux. Voir gôgni. - (63) |
| rgonchi v. Regonfler. - (63) |
| rgôni v. Remettre en place ses vêtements, rhabiller. - (63) |
| rgordzi v. Regorger. - (63) |
| rgougni : rebouter - (51) |
| rgougnou : rebouter - (51) |
| r'gougnou ou gougnou, subst. masculin : rebouteux. - (54) |
| rgoule : rigole, petit ravin creusé par l'érosion. A - B - (41) |
| r'goûle (na) - raie (na) : rigole - (57) |
| rgoule : petit ravin creusé par l'érosion - (34) |
| r'grainci - rengreum'salé : rabougri - (57) |
| r'gret (on) : regret - (57) |
| rgret n.m. Regret. Y m'fait rgret. ça me dégoûte, ça me fait pitié. - (63) |
| r'grettable : regrettable - (57) |
| rgretteux adj. Délicat, facilement dégoûté. - (63) |
| r'gricher (se). v. - Se rebiffer, se redresser. - (42) |
| r'grigné, adj. ridé, rétréci. - (38) |
| r'grignè, rider, en parlant d’un bon feu, d'un fruit. Ce mot s'emploie aussi pour : grigné, grigné lë dan. - (16) |
| rgringné, regrigné, ie, adj. recroquevillé, ée. Ratatiné, ée. - (17) |
| r'groler : restaurer (réparer) - (57) |
| r'guèdiè : regarder - quouè qu'tu r'guèdj ? qu'est-ce que tu regardes ? - (46) |
| rgüer : labourer en faisant des rgueux*. A - B - (41) |
| rgüer, labori à rgueux v. Labourer en faisant des sillons adossés, en opposition. - (63) |
| rguèri, vt. guérir. - (17) |
| rgueu : sillons adossés (tracés en opposition). A - B - (41) |
| rgueu n.m. (du lat. regulam, la règle puis ensuite le fossé) Sillon adossé ou alterné. - (63) |
| r'gueugniou, s.m. rebouteux. - (38) |
| r'gueùlisse, s. m., réglisse : « J'teùsse ; j'vas m'écheter du r’gueulisse. » - (14) |
| r'gueuriot : gruau, farine grossière, et même mêlée de son pendant l'occupation, pour empêcher la pâte du pain de coller au cabas. - (33) |
| rgueurni (se) v. Montrer son mécontentement par une grimace. - (63) |
| rgueurni v. (du v. fr. guigner). Dessécher, ratatiner, rider. - (63) |
| rguingné, vt. regringné les dents, relever les lèvres en montrant sa denture en signe de menace, ou de moquerie. - (17) |
| rhabillauder. v. - Rapiécer. - (42) |
| rhabillauder. v. a. Rapiécer, rapetasser. Rhabillauder un bateau, un vêtement, y faire à la hâte de menues réparations. - (10) |
| rhabilli : rhabiller - (57) |
| rheumelou, tousseur, asthmatique , du mot rhume. C'est un barbarisme de dire gremeiou, comme on le fait dans quelques endroits de la Bourgogne. - (02) |
| rhime : Rhume. « J'ai éttrapé in ban rhime ». - (19) |
| rhubârbe (d'la) : rhubarbe - (57) |
| rhumatiste (on) : rhumatisme - (57) |
| rhume : s. m., douleur rhumatismale occasionnée par le froid. Rhume de jambe. Bhume de bras. Avoir un rhume dans le dos. - (20) |
| ri. Ris. - (01) |
| ri’viére dâs dizans (lai) : (le) « garat », rivière coulant à quelque distance de st léger-de-fougeret - (37) |
| riâ : (nm) ruisseau - (35) |
| riàche, adj., rèche, âpre au goût, au toucher. — S'applique au figuré pour un caractère difficile. - (14) |
| riache, dur, coriace, et, au moral, difficile à vivre. En latin, reardere signifierait s'enflammer de nouveau... - (02) |
| riache. Dur, coriace… - (01) |
| riache. : Dur, coriace, et, au figuré, difficile à vivre. (Du latin re accensum, qui s'échauffe, qui s'enflamme de nouveau). - (06) |
| riage, rayage. n. m. - Sillon. (Villiers-Saint-Benoît, selon M. Jossier) - (42) |
| riage, rayage. s. m. Ensemble des raies d'uu champ. (Villiers-Saint-Benoît). - (10) |
| riâle : grand racloir en bois servant à rassembler la cendre dans le four à pain. A - B - (41) |
| riale. Racloir formé d'une petite planchette trapézoïdale allongée, et d'un long manche ; sert à racler, à ranger le blé sur le grenier. - (49) |
| rialle, ruelle. - (27) |
| rian : Nom masculin, sorte de sentier, passage que les gardes forestiers font dans les coupes d'affouage, pour marteler les baliveaux. - (19) |
| riand : Rond. « Fare in riand » : tracer une circonférence. - (19) |
| riande : riante (plante) - (48) |
| rianner. v. n. Braire, hennir. (Courson). - (10) |
| riante, s. f. patience crépue (rumex crispus) connue sous les noms vulgaires de parelle, rointe, etc., etc. - (08) |
| riate : Ruelle de lit. « Couchi à la riate » : coucher du côté de la ruelle. - (19) |
| riau, rio. n. m. - Petit cours d'eau, ruisseau. Ce mot s'employait en ancien français du XIIe siècle sous les formes rui, ruiot ou riot. Un petit ruisseau était un ruisel (d'où dérive l'actuel mot « ruisseau » ). - (42) |
| riau, s. m., œuf que les villageoises laissent en réserve pour indiquer aux poules l'endroit où elles doivent pondre. - (14) |
| riau. s. m. Ravin, lit de torrent, ruisseau. (Plessis-Saint-Jean). C'est le riou du Valais, des Cevennes et des Pyrénées. - (10) |
| riaude : tige de bois très flexible - (37) |
| riaule (nom féminin) : raclette pour écarter les cendres du four à pain. - (47) |
| riaule : racloir à long manche. Précisément le « cure-étable », permet de ramasser : les cendres, la boue… - (62) |
| riauler, rioler. v. n. Se dit de l'eau des ruisseaux qui coule sur des cailloux en bruissant, en cascadant. – Veut dire aussi ricaner. (Villeneuve-les-Genêts). - (10) |
| riauler. v. - Ricaner. (Villeneuve-les-Genêts, selon M. Jossier) - (42) |
| Riaume : s. m., terre de Royaume, rive droite de la Saône. Termes de batellerie ; aller de Riaume, virer de Riaume, etc. Voir Empi. - (20) |
| riaume, s. m., royaume. En terme de notre ancienne marine fluviale, rive droite : « Vira de riaume ! » Tourne du côté de royaume ! c'est-à-dire du côté de la rive droite. - (14) |
| riautes : n. f. Liens divers, faits avec des rejets d'arbres filandreux. - (53) |
| riaÿ, s. m., cerisier. - (40) |
| ribaa. Ribaud, ribauds. Ribaud signifie proprement paillard, et en général un méchant homme. - (01) |
| riban : Ruban. « In nout de riban » : un nœud de ruban. Jadis, le jour du tirage au sort, les conscrits se paraient d'une profusion de rubans, celui qui avait tiré un bon numéro choisissait des rubans blancs. Pour les mauvais numéros il prenait des rubans rouges et pour un numéro douteux des rubans bleus ou multicolores. Les plus galants faisaient cadeau de leurs rubans à leur bonne amie. - (19) |
| riban, s. m. ruban. - (08) |
| riban. Ruban, vieux mot. - (03) |
| riban. Ruban. - (49) |
| ribasse (fâre), prendre le casse-croûte du matin. - (40) |
| ribaud, personne de mœurs licencieuses. Dans l'idiome breton, ribôdérez signifie concubinage... - (02) |
| ribaude : (nf) vache stérile - (35) |
| ribaude n. et adj. Stérile. - (63) |
| ribaude, teuriaude : vache stérile - (43) |
| ribeulé, vn. [rebouler, ribouler]. rouler (les yeux). - (17) |
| ribeulon, sm. protubérance formée par quelques objets saillants, enfermés dans un sac. - (17) |
| riblette : petit morceau d'aliment - (51) |
| riblon : s. m., débris de métal, grains de plomb pour la chasse. Au riblon, au rebut. - (20) |
| riblonner, verbe transitif : réformer, mettre à la casse. - (54) |
| riblons, s. m. pl., tas de ferrailles pour le « patté » (cf. ce mot). - (40) |
| ribolé, crier, pleurer fort. - (16) |
| riboler, v.; faire les gros yeux ; qués oeillots qu'me ribolot !!! - (07) |
| ribollé : v. i. Sangloter. - (53) |
| ribon ribène. Ce terme n’est pas plus propre aux Bourguignons qu'aux autres peuples de la France… - (01) |
| ribon-ribaine, loc., bon gré malgré. Aujourd'hui peu employée chez nous, et répandue plus loin que la Bourgogne. - (14) |
| ribote : fête de la fin des foins ou des moissons. A - B - (41) |
| ribote (faire). n. f. - Action de faire la noce, la fête, de mener joyeuse vie : « V'avez qu'à ouvri vaut 'jornal, vous voyez qu'ça : qué des ribottes. » (G. Chaînet, En chicotant mes braisons, p.49). Mot probablement dérivé de ribauder, avoir une vie de débauche, employé au XIIIe siècle. - (42) |
| ribote, ivresse légère ; el â an ribote, il est quelque peu ivre. - (16) |
| ribotte : faire la fête - (43) |
| ribotte : fête de la fin des foins, des moissons - (34) |
| riboulé signifie ouvrir de grands yeux, les dilater en tous sens : ce mot vient du latin revolvere, rouler. - (02) |
| ribouler (des yeux) : les tourner dans tous les sens. - (66) |
| ribouler (les œilles). Ecarquiller les yeux, les rouler sous le coup de la colère, ou de I’ émotion. Etym. le vieux français reboule, riboule, bâton, perche qui servait a ribouler le feu, la braise, le feu du four, c'est-à-dire a l’agiter pour le faire briller ou prendre. - (12) |
| ribouler : ouvrir tout grand (les yeux), écarquiller - (48) |
| ribouler : v, a., vx fr, reboler, rouler. I riboulait des yeux, qu'on aurait dit qu’i z'allaient sortir de sa tête ! - (20) |
| ribouler. v. - Rouler de gros yeux : « Ils le r'gardinrent tertous en riboulant les pernelles. » (Fernand Clas, p.307) - (42) |
| ribouller : rouler ses yeux ; ribouller ses callots (voir : rebouler). - (56) |
| ricabb. s. m. Geai. (Puysaie). - (10) |
| ricacher : sourire - (44) |
| ricader, v. frapper le "pi" (cf. ce mot) avec le bâton alors qu'il est en l'air (jeu d'enfants). - (38) |
| ricainer (v.t.) : ricaner (aussi ricaisser) - (50) |
| ricaisser (v.) : rire fort en se moquant - (50) |
| ricaisser : ricaner - (48) |
| ricaisserie (n.f.) : éclat de rire fort et moqueur - (50) |
| ricané, rire d'une manière narquoise. Dans l'idiome breton, richana signifie caqueter, comme les poules lors qu'elles veulent pondre. (Voir ce mot dans le Voc. bret. de Le Gon.) - (02) |
| ricaner : hennir - (43) |
| ricaner, rincaner v. Hennir. - (63) |
| ricassai : rire en se moquant, ricaner. - (33) |
| ricasse ou ricache, subst. féminin : personne qui ricane sans motif, qui rit bêtement. - (54) |
| ricasse, s. f. femme qui rit à tout propos et qui se moque d'autrui. (voir : richeu.) - (08) |
| ricasser ou ricacher, verbe intransitif : rire sottement, ricaner. - (54) |
| ricasser, v. n. rire avec moquerie, ricaner avec chuchotements. - (08) |
| ricasser. Rire niaisement ou méchamment. - (49) |
| riche-poulot. Ç'ast lai chanson du riche-poulot : an n'en trouve pas lai finition. Cette chanson supposée est ce qu'on appellerait maintenant une scie d’atelier... - (13) |
| rîcher (v.t.) : ruminer en parlant des bovins (aussi ringer) - (50) |
| richeu, euse, adj. celui ou celle qui aime à rire, à plaisanter, à se moquer, à railler. - (08) |
| ricochi : ricocher - (57) |
| ricouaissot (n.m.) : chanson qui n'en finit pas (de Chambure note ricouasson) - (50) |
| ricouchon, ricouasson, loc. chanter « en ricouchon » ou en « ricouasson », c'est chanter une chanson qui ne finit pas, reprenant toujours ses refrains avec le même air et les mêmes paroles. - (08) |
| ridal : s. f. ridelles, pièces qu'on ajoute à la voiture pour la monter en chê. - (21) |
| ridale : ridelle - (48) |
| ridale : Ridelle, accessoire d'un char, en forme d'échelle ou de ratelier , les ridelles servent à élargir la base du char pour faciliter le chargement du foin ou des gerbes. - (19) |
| ridalle, s. f. ridelle, claie en forme d'échelle que l'on pose sur les chariots pour retenir le foin, la paille, etc. en quelques lieux « éridelle. » - (08) |
| ridaller, v. a. poser les ridelles d'un chariot : un char « ridallé », un char garni de ridelles. - (08) |
| ridelle : montants de bois en forme d'échelle sur le côté d'un chariot formant le contenant. Construction similaire pour un véhicule utilitaire hippomobile plus petit. Ex : "Tins bon la ridelle, j'vons fée trotter nout' ane !" - (58) |
| ridelles - (39) |
| ridi : ridé - (57) |
| ridiau : rideau - (43) |
| ridiau : Rideau. « Tiri le ridiau ». - (19) |
| ridiau, s. m., rideau, toile tendue pour cacher. - (14) |
| ridieau. n. m. - Rideau. - (42) |
| ridier, vn. rider. - (17) |
| ridje, sf. ride. - (17) |
| ridjeau (on) : rideau - (57) |
| ridjeaux (des) : voilage - (57) |
| ridjèle, sf. ridelle. - (17) |
| rie, s.f. cerise. - (38) |
| rie. v. - Rire : « On va ben rie dimanche, c'est la fête a Chaumine ! » - (42) |
| riélement, adv. réellement, en réalité. - (08) |
| rienque, adv., seulement. - (40) |
| rière, s. f., cerise. - (40) |
| riéte (ē), sf. fascicule de chanvre tillé. - (17) |
| rieute : brin d'osier. (S. T IV) - S&L - (25) |
| rieute : Hart. Dans le langage forestier, lien fait d'une petite branche d'osier ou de tout autre bois suffisamment flexible. « An lâ les fagueuts d'ave des rieutes » : on lie les fagots avec des « rieutes ». - (19) |
| rieux, s. m. yeux, organes de la vue. - (08) |
| rifler, égratigner, écorcher. - (04) |
| rifler, v. tr., effleurer, raser, frôler : « Crapau ! ton caillou m'a riflé l'orille. » - (14) |
| rifler. v. a. Erafler. Rifler la bonde d'un tonneau. Les tonneliers et commissionnaires en vins ont perdu l'habitude de rifler les bondes, sans doute parce que cette précaution ne parait en rien de ce qu'on voulait éviter. - (10) |
| rifoler, v. n. rire étourdiment et bruyamment. - (24) |
| rigandène : personnage imaginaire destiné à faire peur aux enfants - si te r'guèdje au fond du poui, le rigandaine te f 'ré cheur dedans... - (46) |
| rigaudi, rigôti. s. m. Pruneau, prune cuite. (Soucy). – Se dit, en général, de toute chose, de tout fruit rissolé, ridé, racorni par la vétusté, le soleil ou la cuisson. Des prunes rigôties. Une poire, une pomme rigaudie. - (10) |
| rigaudon. s. m. Petil régal de bouillie aux œufs ; régal, en général. - (10) |
| rigeot. n. f. - Femme rousse. (Perreuse, selon M. Jossier) - (42) |
| rigeot. s. f. Femme rousse. (Perreuse). - (10) |
| riglée. s. f. Ruilée, bordure de ciment, de platre ou de mortier, que les couvreurs appliquent sur un tranchis, sur une rangee de tuiles ou d'ardoises, pour les lier avec un mur ou avec les jouées d'une lucarne. Du latin regula. - (10) |
| rignaud. n. m. - Mauvais caractère, déplaisant, grincheux ; dérivé de rigner, montrer les dents. (Perreuse, selon M. Jossier) - (42) |
| rignaud. s. m. Caractère difficile, grognon, déplaisant. (Perreuse). - (10) |
| rigne-galette. n. m. - Niais, ou qui ricane niaisement. (Perreuse, selon M. Jossier) - (42) |
| rigne-galette. s. m. Niais ou qui ricane niaisement. (Perreuse). - (10) |
| rigner (pour grigner). v. n. Grincer des dents. (Saint-Florentin). - (10) |
| rigner. v. - Montrer ou grincer des dents : «Attention ! T'approuche pas, l'chien i' rigne des dents ! » - (42) |
| rigolade (boire è lè), pour boire de cette façon, le buveur mettait son pouce à l'entrée du goulot de la bouteille ou de la cruche pour ne laisser sortir qu'un petit filet d'eau ou de vin qui tombait de haut dans la bouche. Il parait que cette façon de boire désaltérait mieux. Certains disaient, boire è lé régalade. - (27) |
| rigolade, s. f. réjouissance, divertissement, débauche. - (08) |
| rigolai se dit en parlant de l'eau qui s'écoule d'un plan supérieur. Dans l'idiome breton, rigol, au pluriel rigolou, signifie sillon. (Davies.) ... - (02) |
| rigôlai. Couler, ruisseler, de rigole, canal creusé pour faire couler l'eau… - (01) |
| rigôlai. : Se dit de l'eau qui s'épand sur un terrain en déclive. (Du verbe latin rivare ou plutôt de son diminutif rivulare.) - (06) |
| rigolat. s. m. Petit ruisseau. (Chigy). - (10) |
| rigoler (Se) : v, r., rigoler. Voir pouffer (Se). - (20) |
| rigoler : v. n., pleurer (en parlant de la vigne). - (20) |
| rigoler, rigouler. Couler rapidement. Rouler sur une surface en pente. « Se faire rigouler sur le talus ». - (49) |
| rigoler, v. n. jouer, plaisanter, blaguer, faire une débauche. - (08) |
| rigoler. v. a. Ouvrir, pratiquer des rigoles. – Rigoler une vigne, relever les terres de chaque côté des perchées pour butter les ceps à l'hiver. (Environs de St-Florentin). – A Perrigny-lès-Auxerre, on dit rauler. - (10) |
| rigolette, s. f. mince filet de liquide coulant comme une petite rigole. - (24) |
| rigoleuse : matériel agricole servant à faire des rigoles pour l’écoulement de l’eau de pluie. - (59) |
| rigoule, s. f., rigole, petit fossé, tranchée pour planter. - (14) |
| rigoule. n. f. - Rigole. - (42) |
| rigouler, v. a. rigoler, couler, s'écouler, découler. - (08) |
| rigouler, v. intr., couler dans une rigole. - (14) |
| rigouler. Synonyme beaunois du vieux verbe dégouliner ; tomber goutte à goutte. I me seus crû pardu quan i ai vu mon sang rigouler le traivars de mes chausses, A rapprocher de rigole. - (13) |
| rigoulette, s. f. mince filet de liquide coulant comme une petite rigole. - (22) |
| rigouliner : rouler doucement, glisser lentement - (37) |
| rigouliner ou degouliner. Couler, s’écouler, en parlant d'un liquide ; descendre rapidement. Etym. rigole. - (12) |
| rigoulotte : petite rigole. - (09) |
| rigoulotte, s. f., même sens que pisserotte, cf. ce mot. - (40) |
| rigoulotte. n. f. - Petite rigole. (Arquian) - (42) |
| rigoureux : adj., vigoureux. Un arbre rigoureux, Voir vigoureux. - (20) |
| rigpiau : braconnage. - (33) |
| rigue : s. f., bande joyeuse. - (20) |
| rigue, s. f., réunion d'individus qui font un travail en commun : « La rigue des crocheteurs. » Par extension, bande, société : Une joyeuse rigue ; faire partie d'une rigue. (V. Ròde.) - (14) |
| rik : étroit. (RDB. T III) - S&L - (25) |
| rikiki : Personnage principal d'un théâtre de marionnettes qui parcourait les campagnes de chez nous vers le milieu du XIXe siècle et jusqu'à 1940. Rikiki personnifiait le petit soldat français qui ne connaît pas d'obstacles, il avait toujours le rôle le plus important aussi bien dans le mystère de la Passion que dans Barbe-Bleue ou Geneviève de Brabant et dénouait toutes les situations en traversant la scène au cri de « Sauve, gare que je passe ». - Vin blanc doux pris sous le pressoir et auquel on ajoute un verre d'eau de vie de marc par litre, après quelques jours ce mélange se boit comme liqueur. On l'appelle aussi pauvre homme. - (19) |
| rilleau, ridiau. n. m. - Rideau. - (42) |
| rîlli : rayer - (57) |
| rils. s. m. pl. Mets composé d'un poumon et d'un foie de porc hachés ensemble. (Environs de Joiguy). – Dans la Touraine et le Bloisis, on a les rillons et les rillettes. - (10) |
| rimai. Rimé, rimez, rimer. - (01) |
| rimargotore et remargotore. : Vif, enjoué. - (06) |
| rimargotore, vif, frais, gaillard, enjoué. - (02) |
| rimé, adj., odeur et goût désagréables, contractés par les aliments trop cuits qui se sont attachés au fond du vase sur le feu : « Ah! Jean-néte, tes gaudes sentent l’rimé! » - (14) |
| rimon : bande de terre - (60) |
| rimons : blé fait avec une charrue à 2 versoirs - (60) |
| rimouée (n. f.) : rime - (64) |
| rimouner, v. a. ce terme s'emploie à Montigny-En-Morvan et ailleurs pour définir le travail de la charrue qui butte les pommes de terre. (voir : richeu, riser, risotte.) - (08) |
| rin (m), rame de fagot. - (26) |
| rin : rien - (61) |
| rin : un fagot - (46) |
| rincané, v. n. hennir. - (22) |
| rincaner : Braire. « La bourrique a rincané ». - (19) |
| rincaner, v. n. hennir. - (24) |
| rincazé, v. n. respirer avec un bruit de sifflement. - (22) |
| rincé, nettoyer les verres. Les Bretons disent rinsa. (Voir au mot Rincer dans le Dict. franç.-bret. de Le Gon.) - (02) |
| rinceau, rinciau : s. m., rinçure ; vinasse présentée comme cru authentique, par conséquent bien dlfférente du « rancio ». - (20) |
| rince-bouteille : s. m., capitule de la cardère sauvage (dipsacus silvestris). - (20) |
| rince-daigts (on) : rince-doigts - (57) |
| rincée, pluie forte et passagère. - (05) |
| rincée, s. f., averse, réprimande, volée de coups. (V. une quantité de synonymes de cette dernière acception : Daubée, Dégelée, Pignée, Pile, Raclée, Roulée, Volée, etc. ) - (14) |
| rincer, v. a. laver. rincer du linge, c'est le laver avec un savonnage, sans recourir à une lessive. - (08) |
| rinceure : Rinçure. L'eau dont on s'est servi pour rincer une futaille. - (19) |
| rinche (na) : rangée - (57) |
| rinche, s.f. rang (de vigne, par exemple). - (38) |
| rincher, v. n. ruminer. se dit des bêtes à cornes et par extension de quelques autres animaux. (voir : ringer.) - (08) |
| rinchon (avoir le), locution verbale : être enroué, avec la voix cassée. - (54) |
| rinchon (n.m.) : enrouement - (50) |
| rinchon : rhume - (44) |
| rinchon n.m. Rhume. On dit aussi râpon. - (63) |
| rinchon, s. m. embarras de la gorge, râlement. - (08) |
| rinchonner (v.t.) : être enroué - (50) |
| rinchonner, v. n. avoir un embarras de gorge, râler. - (08) |
| rinci : rincer - (43) |
| rinci : rincer - (51) |
| rinci : rincer - (57) |
| rinci : Rincer. « Rinci in tonneau ». Au figuré, battre, corriger. « O va se fare rinci » : il va se faire corriger. - (19) |
| rinci v. Rincer. - (63) |
| rindzi : (vb) ruminer - (35) |
| rindzi v. Ranger. - (63) |
| ringâ, s.m. ringard de foyer. - (38) |
| ringâ, s.m. ringard de poêle. - (38) |
| ringârd : long tisonnier en fer utilisé par le mécanicien de la locomobile - (37) |
| ringard, s. m., pique-feu pour l'âtre. - (40) |
| ringarder, v., attiser le feu. - (40) |
| ringarder. Activer le feu avec un ringard. - (49) |
| ringasse : giboulée. Il est tombé une boune ringasse : il est tombé une bonne giboulée. - (33) |
| ringasse : n. f. Giboulée. - (53) |
| ringè : v. t. Ranger. - (53) |
| ringeai : ruminer (bétail). Les vèches ringeont calmement : les vaches ruminent calmement. - (33) |
| ringeon, s. m. débris, déchet, ce qui reste d'une chose rongée : un « ringeon » de pain, de viande, etc. - (08) |
| ringer (verbe) : ruminer. - (47) |
| ringer, v. a. ronger, manger peu à peu, ruminer. (voir : roinger.) - (08) |
| ringi : Ruminer. « Les vaiches sant après à ringi » : les vaches sont en train de ruminer. - (19) |
| ringi : v. ruminer. - (21) |
| ringlier. v. n. Respirer avec bruit, péniblement. (Etivey). - (10) |
| ringningnin, s. m. musique monotone. - (24) |
| ringningnin,; s. m. musique monotone. - (22) |
| ringuêr' : tisonnier. (RDM. T IV) - B - (25) |
| ringuer, v. tr. et intr., regretter, être privé d'une chose, se passer avec tristesse de. . . : « Ah! voui, ma pauv'petiote, quand t'vas éte partie, j'vas joliment t'ringuer ! » - (14) |
| rinjon : trognon, déchet. (F. T IV) - Y - (25) |
| rin-neure, s.f. rainure. - (38) |
| rin-non : ensemble de répétitions faites avec insistance. (RDM. T IV) - B - (25) |
| rin-non. Chant monotone à bouche fermée. On dit : « mener un rin-non ». Ronron ; sorte de bruit continu. - (49) |
| rinschi, ? moisi. - (38) |
| rinsou : s. m. sorte de poinçon employé pour égrener les panoy. - (21) |
| rintse : rangée. A - B - (41) |
| rintse : rangée - (34) |
| rinzemoute, s. f. raisin sauvage. - (22) |
| rinzenée, s. f. raisiné. Compote de fruits. - (22) |
| rinzenée, s. f. raisiné. Compote de fruits. - (24) |
| rinzer : ruminer, en parlant du bétail. - (52) |
| rinzer : ronger - (39) |
| rinzer, v. a. ranger, mettre en ordre. - (08) |
| riô : marécage, mouille (région de Mornay - Saint Bonnet de Joux). A - (41) |
| rio - riot : ruisseau. Ex : "Mets-don la chopine dans lé rio pour pas qu'alle ait chaud !" - (58) |
| rio (n. m.) : ruisseau - (64) |
| riô, riau, s.m. ruisseau. - (38) |
| riole (être en). Faire la débauche. Rioliche veut dire dans notre patois femelle en chaleur. - (03) |
| riole (ō), sm. crochet aplati qu'on emploie sur champ pour retirer les, braises du four. - (17) |
| riôlè : faire la fête - fère lè riole - (46) |
| riôle, s. f., gaieté. « Être en riòle, » c'est être en joie, presque faire la débauche. Se prend en bonne et en mauvaise part. - (14) |
| riolé, tacheté , rayé. - (05) |
| riolé. Tacheté, vieux mot. - (03) |
| riôler (C.-d., Chal., Morv.), riòlet (Br.). - Se réjouir, être gai. La locution être en riole, signifie faire la fête. C'est encore une expression du moyen âge. - (15) |
| riôler (v.t.) : être en bombance - (50) |
| riôler, v. intr., fêter, se réjouir, se livrer au plaisir. - (14) |
| riôler, v. n. être en gaîté, en joie, en bombance. (voir : rigouler.) - (08) |
| rioler, v. rire à moitié, sourire. - (38) |
| riolle (en) : (exp) en désordre, en vrac - (35) |
| riôlou : celui qui fait la fête, un noceur - (46) |
| rion, s. m., rayon, sillon. « Semer les rions, » c'est semer quelques grains le long de la raie mitoyenne des sillons. (Ce mot n'est qu'une contraction de rayon, comme riaume, de royaume.) - (14) |
| riond (on) : rond - (57) |
| riorte (Chal., Br.), érouette (C.-d.), rouète, rouote (Morv.). - Lien fait d'une branche flexible ou d'un brin d'osier tordu ; l'étymologie est le latin retorta, même sens. Le vieux français avait réorte également dans le même sens, et le verbe actif réorter pour lier, garrotter. - (15) |
| riorte, rorte, lien en bois tordu. - (05) |
| riorte, s. f., brin d'osier tordu et servant de lien, lien fait d'une branchette d'arbre. - (14) |
| riorte. Brin ou lien d'osier, du latin retorta. - (03) |
| riote : chemin de terre étroit. - (31) |
| riote, rioute, riaude : s. f., vx fr. reorte, lien formé d'une branche d'osier ou de bois vert. - (20) |
| riôte, rote. Branche flexible qui sert de lien, de verge. Rouette. - (49) |
| riote, ruelle, passage étroit allongé. - (16) |
| riôte, s. f., perche de chêne tordue, servant à la confection des radeaux. (V. Riorte, Ròte.) - (14) |
| riôter. Corriger avec une verge, une « riôte » : « si te continues, te vais te faire riôter ». - (49) |
| riotte : (ruelle) mot féminin désignant le passage entre le lit et le mur ou entre 2 maisons - (46) |
| riotte : petit chemin étroit. (BD. T III) - VdS - (25) |
| riotte : ruelle encaissée entre deux haies. (et aussi) petit chemin bien frayé permettant un passage de communication légal ou toléré - (37) |
| riotte : ruelle entre le lit et le mur. « Ô l’a chezu dans la riotte » : il est tombé du lit…coté mur. - (62) |
| riotte : ruisseau - (48) |
| riotte : ruisseau, ruelle d'un lit. Féminin de rio : ruisseau (accent tonique sur o). - (32) |
| riotte : ruisseau. (B. T IV) - S&L - (25) |
| riotte : n. f. Ruelle. - (53) |
| riotte : voir synonyme ruelle. - (58) |
| riotte, s. f., lien de jeune bois pour attacher les gerbes. - (11) |
| riotte, s. f., ruelle entre le lit et le mur d'alcôve. - (40) |
| riotte, s.f. ruelle. - (38) |
| riotte. n. f. - Espace entre le lit et l'armoire. (Arquian) - (42) |
| riou, ouse, s. rieur, rieuse. on dit aussi : « risou, risouse. » (voir : riser, richeu.) - (08) |
| rioute ou rouate, s. f. lien à fagot en osier ou en autre bois tordu (du vieux français réorte. Latin retorta). - (24) |
| ripaitons : pieds - (37) |
| ripater : danser. (CH. T II) - S&L - (25) |
| ripaton : petit peton d’enfant. - (62) |
| riper : glisser, ne pas prendre prise - (37) |
| riper, v. intr., glisser, s'échapper : « Oh! c'gueùrdin d'pouésson, ô m'a ripé entre les dèts. » - (14) |
| riper, v. n. glisser, couler. se dit d'un objet qui s'échappe de la main. - (08) |
| riper, zouer rip’ : prendre la fuite - (37) |
| ripiau, s. m., homme de mauvaise vie, a le même sens que ribaut. - (11) |
| ripon, rason, roson : s. m., vx fr. rasure, raclure ; partie d'un mets qui a adhéré à la casserole dans laquelle il a cuit. - (20) |
| ripons de chien, loc. excroissances charnues en forme de boules qui sont adhérentes au vagin des vaches ou attachées à l'arrière-faix. - (08) |
| ripopai, mauvais vin. On dit aussi ripopée et ripopette dans plusieurs localités de la Bourgogne. - (02) |
| ripopée, ritoupée. s. f. Fille perdue ; canaille, en général. - (10) |
| ripopée. : Salmigondis. - (06) |
| ripopète, objet de mauvaise qualité, mauvais vin. - (16) |
| ripopette. Pour ripopée. - (12) |
| rippe (na) : bois (petit) - (57) |
| rippe : s. f., vx fr. riepe, taillis. Une dizaine de hameaux et écarts du département de Saône-et-Lolre, tous d’ailleurs sur la rive gauche de la Saône, portent le nom de La Rippe ou Les Rippes. - (20) |
| ripper : sauter, glisser, partir - (34) |
| riquet : tout petit, court - (37) |
| riquet ou riquiqui, adjectif qualificatif : étroit, étriqué. - (54) |
| riquetter. v. a. Attraper de la main ce qu'on vous jette. (Etivey). - (10) |
| riquiotè : chercher la petite bête - (46) |
| riquiotou : celui qui cherche la petite bête - (46) |
| riquiqui (n. m.) : le plus petit des doigts, dans le langage enfantin - (64) |
| riquiqui : le plus petit des doigts et des orteils - (60) |
| riquiqui : s. m., liqueur faite de vin blanc doux additionné d'eau-de-vie. - (20) |
| riquiqui, liqueur de ménage. - (02) |
| riquiqui, s. m. vin blanc maintenu doux par l'adjonction d'un peu d'eau-de-vie de marc. - (22) |
| riquiqui, s. m., ratafia (boisson). - (40) |
| riquiqui, s. m., toute liqueur de dessert quelconque, eau-de-vie, rhum, genièvre, etc. : « Hardi ! mon vieux ! eùne gòte de riquiqui pou fâre descende le dîner. » - (14) |
| riquiqui, s. rn. vin blanc maintenu doux par l'adjonction d'un peu d'eau-de-vie de marc. - (24) |
| riquiqui. Vin blanc mélangé de marc. Plutôt employé dans le pays vignoble. - (49) |
| rire : Expression : « Pa de rire », pour rire, en plaisantant. - (19) |
| rire : adj., douteux, invraisemblable. - (20) |
| risan. Riant. - (01) |
| risant, part, prés., riant, caressant. - (14) |
| riser, v. n. rire légèrement. - (08) |
| riseulé, vn. sourire. - (17) |
| riseuler, rire en se moquant. - (27) |
| risibje, adj. risible. - (17) |
| risoler : rissoler - (43) |
| risòte, s. f., risette, entre le rire et le sourire, surtout bon rire enfantin : « Allons, p'tiot, fais risòte à man-man. » - (14) |
| risotte, s. f. risette, rire léger, sourire. - (08) |
| risoù, s. m., rieur, moqueur : « C'drôle! y ét ein ch'ti risoù ; ô r'chigne tous ceûsses qui passont. » - (14) |
| riston : fût de 210 à 220 litres. (F. T IV) - Y - (25) |
| riston. s. m. Fût mesurant 200 titres. (Saint-Florentin). - (10) |
| risu, pass. du verbe rire : « All' li a disu quét'chouse à l'orille, é peu ôl a risu, ôl a risu !! . . . » - (14) |
| rit : s. f. paquet d'œuvre prête à être filée. - (21) |
| ritaurnélle (n.f.) : ritournelle - (50) |
| rite, s. f. petit paquet de chanvre teillé. - (22) |
| rite, s. f. petit paquet de chanvre teillé. - (24) |
| ritse : riche - (43) |
| ritse n. et adj. Riche. - (63) |
| ritsesse : richesse - (43) |
| ritte, poupée d'œuvre ou filasse. - (05) |
| rivage, rivaige, s. m. rive, bord, extrémité : le « rivage » d'un toit, d'un mur. - (08) |
| rive : s. f., douelle mobile et courte, que, en faisant la lessive, on place entre le linge et la paroi du cuvler, quand le contenu de ce dernier menace d'en dépasser le bord ; hausse. - (20) |
| rive, s. f. bord, extrémité, lisière : la « rive » d'un bois, d'un champ, d'un lit ; suivez la « rive » du pré et vous trouverez la route. (voir : sourivée.) - (08) |
| Riveau, nom de localité près d'Autun. - (08) |
| rivéére : n. f. Rivière. - (53) |
| riveire, s. f., rivière. Nous sommes fiers des deux nôtres. - (14) |
| riveire. Rivière, rivières. - (01) |
| river (v. tr.) : border un lit - (64) |
| riverdure : s. f., petite flambée. - (20) |
| rivëre, rivière. - (16) |
| riviâre, s. f., rivière. - (40) |
| riviée : rivière. Ex : "Mènes don les vaches jusqu'à la riviée !" (Sous-entendu : à l'abreuvoir, au baignouée). - (58) |
| riviée. s. f. rivière, ruisseau. - (08) |
| rivinre, rivière. - (26) |
| rivöre, sf. rivière. - (17) |
| rivoter, v. n. couler lentement, goutte à goutte, suppurer. (voir : riper.) - (08) |
| rivoter. Couler doucement. Se dit d'un liquide qui s'échappe par une fissure. Not’ poinçon ai rivoté, j’ons pardu dix pintes de vin. - (13) |
| riyaille, s.m. cerisier. - (38) |
| Rizo : nom de bœuf. III, p. 30-o - (23) |
| rizu (-e) (p.p.) : participe passé du verbe rire - (50) |
| rizu, part. pass. du verbe rire. ri. indic. prés. " i ri, teu ri, a ri ; i rizon, vô rizé, a rizan ; — impér. rizon, rizé, qu'a rizan. » (voir : richeu, riser, riou.) - (08) |
| r'jâdi, v. a. reconstruire, refaire à nouveau. Dans notre patois et dans plusieurs autres, le simple « jâdir » ou « jardir » se dit de l'accouplement du jars et de sa femelle. (voir : jâdi.) - (08) |
| r'janer : (prononcer arjean-ner). Hennissement répété particulier du cheval. A rapprocher chez l’homme d’un raclement de gorge, ce n’est donc pas un vrai hennissement, mais une expression particulière à l’animal. Un signe assez discret que l’on peut considérer comme une impatience ou une inquiétude, surtout s’il est répété. Ex : "Va don vouée dans l’écurie c’que c’te j’ment a à r’jean-ner." - (58) |
| r'janer, r'jeanner. v. - Hennir. Au figuré : rire comme un cheval ou comme un âne. Mot d'origine francique directement issu de l'ancien français du XIe siècle : rechaner signifiait braire comme un âne, un rechan était un braiment. Le poyaudin a conservé ce mot, disparu en français, en l'utilisant de manière imagée pour l'homme. - (42) |
| rjau (n. m.) : élan, sursaut d'énergie (donner du rjau) - (64) |
| rjauder (v. int.) : rejaillir, gicler, en parlant d'un liquide - (64) |
| r'jauder, rejauder. s. m. Ricocher, ressauter, rebondir. (Puysaie). - (10) |
| r'jauder, r'jauber. v. - Ricocher, rebondir. - (42) |
| r'jaut. n. m. - Force, ressort, forme : avoir dur r’jaut, avoir de la force, du répondant. Se dit également pour un ricochet, un rebond. - (42) |
| r'jaut. s. m. Choc, ricochet, rejet, ressauter, rebondir. (Puysaie). – Voyez rejaud. - (10) |
| rjiper (v. int.) : sursauter - (64) |
| r'jipiot : sorte de piège. (B. T IV) - Y - (25) |
| r'jompir, rebondir. - (26) |
| rjouandre : v. rassembler. - (21) |
| rjoupi, vn. rebondir (en parlant d'une balle ou de tout autre objet élastique). - (17) |
| r'jpiae (m), piège. - (26) |
| r'keuler : reculer - (48) |
| rkeuler v. Reculer. - (63) |
| rkeulment n.m. Nom des courroies utilisés pour faire reculer le cheval. - (63) |
| rkeure v. Recuire. - (63) |
| r'lâche (na) : relâche - (57) |
| r'lais (on) : relais - (57) |
| r'laivou : le chiffon à vaisselle - (46) |
| r'lance (na) : relance - (57) |
| r'lâtion (na) : relation - (57) |
| rlâtsi : relâcher - (51) |
| rlâtsi v . Relâcher, lâcher. - (63) |
| rlbon ribaine. : Bon gré malgré. - (06) |
| r'lecheux d'canons. n. m. - Personne portée sur la boisson, buvant à droite et à gauche en toute occasion. (Sainpuits) - (42) |
| r'lent (on) : relent - (57) |
| r'leûcher. v. n. Reluire (Saint-Florentin). - (10) |
| rleuge : s. m. horloge. - (21) |
| r'leuiot, s. m., enrouement, laryngite. - (40) |
| r'leutsi : régaler (se), lécher (se) - (43) |
| rleutsi, rlatsi v. Lécher, pourlécher, embrasser. - (63) |
| r'levage (on) : relevage - (57) |
| r'levailles (des) : relevailles - (57) |
| r'lève (na) : relève - (57) |
| r'lève : n. f. Relève. - (53) |
| r'lev'ment (on) : relèvement - (57) |
| r'licher (se), verbe pronominal : se lécher, se régaler. - (54) |
| r'licher, r'loicher, v. lécher ; glisser de nouveau. - (38) |
| r'lichta (na) : glissade - (57) |
| rlidzieuse n.f. et adj. Religieuse. - (63) |
| r'ligieuse (na) - sϞr (na) : religieuse - (57) |
| r'ligion (na) : religion - (57) |
| rlindzi (se) v. Acheter de nouveaux vêtements. - (63) |
| rlindzi v. Habiller, vêtir. Ôl 'tot rlindzi d'nû. Il était habillé de neuf. - (63) |
| r'lingeai (se) : mettre des vêtements propres. - (33) |
| rlinger (se) (v. pr.) : s'endimancher - (64) |
| r'linger (se) : mettre des vêtements propres - (48) |
| r'linger (se). v. - Se changer, mettre du beau linge. « D'nout' temps, quand nous femmes se r'lingint, les jours de fête et les dimanches ... » (Fernand Clas, p.l80) - (42) |
| r'liquat (on) : reliquat - (57) |
| r'lique (na) : relique - (57) |
| rlodze : horloge - (51) |
| rlodze n.m. Horloge. - (63) |
| r'loge (on) : horloge - (57) |
| r'loge (un). Horloge - (49) |
| r'loge, s. m., horloge. Encore un genre changé : « J'ons un bon r’loge cheû nous. J'veins d'le r'monte r; ô marche quasiment tout l'moués. » - (14) |
| r'loge, s.m. horloge. - (38) |
| r'loge. s. m. Horloge. Un bon r'loge. Un petit r'loge. Un r'loge de Comté. - (10) |
| r'loichou, -ouse, adj. lécheur, lécheuse. - (38) |
| rloje, horloge. - (16) |
| r'louâgé : v. t. Touiller. - (53) |
| r'louaiché : v. t. Relécher. - (53) |
| r'luer, v. reluire, briller. - (38) |
| rluquer v. (fr. pop. reluquer) Regarder avec curiosité ou attention ou convoitise. - (63) |
| rlure, vn. reluire. - (17) |
| rlusant, sm. ver luisant. - (17) |
| r'ma, s.f. balai. - (38) |
| r'maer, v. balayer. - (38) |
| r'maillage (on) : remaillage - (57) |
| r'mairiage (on) : remariage - (57) |
| r'm'aisse, balai. - (27) |
| rmander : raccommoder. A - B - (41) |
| r'mander : raccommoder - (57) |
| rmander : raccommoder des vêtements, des chaussons - (34) |
| r'maniement (on) : remaniement - (57) |
| r'marque (na) : remarque - (57) |
| r'masticage (on) : remasticage - (57) |
| rméchi v. Balayer, nettoyer avec le ramé. - (63) |
| r'mède (on) : remède - (57) |
| r'mée : mot féminin désignant un grillage servant à protéger les poussins - (46) |
| r'membrement (on) : remembrement - (57) |
| r'merciement (on) : remerciement - (57) |
| r'messe (f), balai. - (26) |
| r'messe : balai. - (29) |
| r'messè : balayer, aussi récurer - (46) |
| r'mèsse : mot féminin désignant un balai - (46) |
| r'messure, balayure. - (26) |
| r'mett' : v. t. Remettre. - (53) |
| rmette v. Remettre. - (63) |
| r'meuiller : s’agiter - (43) |
| r'minji - ranminji : remmancher - (57) |
| r'mise (na) - vouillaû (on) : remise - (57) |
| rmise n.f. Remise, local de rangement du matériel. - (63) |
| r'misé. adj. - Rangé jusqu'à la saison prochaine, en parlant d'un outil, rangé dans la remise. - (42) |
| rmiser v. Ranger (du matériel). - (63) |
| r'montage (on) : remontage - (57) |
| r'monte (na) : remonte - (57) |
| r'montée (na) : remontée - (57) |
| r'monte-pente (on) : remonte-pente - (57) |
| rmonter l'bonnet : monter la tête à quelqu'un - (51) |
| r'montouaîr (on) : remontoir - (57) |
| r'montrance (na) : remontrance - (57) |
| rmontrer v. Instruire, apprendre. - (63) |
| r'mords (on) : remords - (57) |
| r'morquage (on) : remorquage - (57) |
| r'morque (na) : remorque - (57) |
| r'morqueur (on) : remorqueur - (57) |
| r'moulage (on) : remoulage - (57) |
| r'mous (on) : remous - (57) |
| rna (n.m.) : renard - (50) |
| r'nâ : un renard - (46) |
| rnâ n.m. 1. Renard. Voir goupil'. 2. Zone mal labourée. 3. Vomissure. - (63) |
| rna : s. m . renard. - (21) |
| r'na, renard. - (26) |
| r'nâ, s.m. renard. - (38) |
| r'nâd (on) : renard - (57) |
| rnad : renard - (51) |
| r'nâilli : renâcler - (57) |
| r'naird(e) : renard(e) - (48) |
| r'napée. n. f. - Petite quantité. - (42) |
| r'napie. n. f. - Giboulée. - (42) |
| r'nârd : n. m. Renard. - (53) |
| r'nardeau (on) : renardeau - (57) |
| r'naré. adj. - Malin, rusé comme un renard. - (42) |
| rnauder v. 1. Etre mécontent, renacler, grogner. 2. Avoir des renvois, vomir. - (63) |
| Rné, Rnée n. René, Renée. - (63) |
| r'ner, v. mûrir en parlant du bois de la vigne ; c'est lorsque le pampre devient brun et ligneux ; synonyme de "aoûter". - (38) |
| rnifier, vn. renifler. - (17) |
| r'niflard (on) : reniflard - (57) |
| r'nifler - r'nisc'iller : renifler - (57) |
| r'nifler : renifler - (48) |
| rnoçon n.m. Rebond de la fête. Voir rtinton. - (63) |
| r'noiger, r'nouéger, v. a. reneiger, neiger encore une fois : le vent du nord souffle toujours, « a vé r'noiger. » - (08) |
| r'noille (na) : grenouille - (57) |
| r'nommée (na) : renommée - (57) |
| r'nonce (na) : renonce - (57) |
| r'nonci : renoncer - (57) |
| rnonci v. Renoncer, refuser. La vatse a rnonci son viau. La vache a refusé son veau. - (63) |
| r'nonciation (na) : renonciation - (57) |
| r'nouéille : grenouille - (48) |
| rnouille, sf. grenouille. - (17) |
| rnouïllis, sm., pl. œufs de grenouille. - (17) |
| r'nouvaler : proroger - (57) |
| r'nouvaler : renouveler - (57) |
| r'nouveau (on) : renouveau - (57) |
| rô : épervier, buse (ou autres rapaces). A - B - (41) |
| ro : buse - (60) |
| rô : sillon tracé par le soc de la charrue - (46) |
| rô, épis de maïs encore en lait. - (16) |
| rô, rocher. - (02) |
| ro, sm. roi. - (17) |
| ro. Épi de maïs vert qu'un fait griller sur les charbons, parce qu'il est pour ainsi dire rôti. - (03) |
| rôbe. Robe, robes. - (01) |
| Rôbeigne. Robine, nom de bergère. - (01) |
| Robelot. nom de bœuf. (voir : Châtillon.) - (08) |
| röbes, sf., pl. vêtements en général, d'homme ou de femme. - (17) |
| robière : s. f., personne qui, dans une communauté, est chargée de l'entretien des robes. - (20) |
| robillot : n. m. Nombril. - (53) |
| robin : taureau. (F. T IV) - Y - (25) |
| robin : s. m., vx fr., robinet. - (20) |
| Robin. nom de bœuf. - (08) |
| Rôbin. Nom propre… - (01) |
| robin. s. m. Taureau. (Cudot, Couleurs). – Robin, robine, lapin, lapine. (Armeau). - (10) |
| Robine : nom de mule. VI, p. 16 - (23) |
| robinet n.m. Sexe de petit garçon. - (63) |
| robinet. Petit fouet à lanières de cuir qui servait à battre les habits et à corriger les enfants. On l'appelle aussi martinet. - (13) |
| robiniot (n. m.) : sorte de beignet - (64) |
| rôble : crochet pour le four. - (09) |
| rôble : râclette ; outil pour remuer le blé. IV, p. 29-h ; IV, p. 59-c - (23) |
| roble : raclette de four - (60) |
| robler. v. a. Battre. (Serrigny). - (10) |
| roblier : Tirer avec le râteau. - (19) |
| rob'lle : Râteau de bois avec lequel on ratisse le blé et les autres grains dont l'aire est couverte après le battage. - (19) |
| rocaille. n. f. - Restes d'un repas. (M. Jossier, p.lll) - (42) |
| rocaille. s. f. Restes d'un repas. (Puysaie). - (10) |
| rôché, vt. ronger. Voir rungé. - (17) |
| rochet, s. m. blouse très courte que l'on porte dans quelques parties du nivernais sur la frontière morvandelle. - (08) |
| rochet, s. m., louchet, hoyau à lame tranchante, dont le manche est terminé par une poignée transversale ou manette, sorte de bêche. - (14) |
| rochi, s. m. pelle droite, louchet. - (24) |
| rôchillon, sm. morceau portant la trace des dents. Petit fruit mal venu. - (17) |
| rochon : s. m. pierre qu'on exploite dans une carrière. - (21) |
| rochon : s. m., roche, rocher. - (20) |
| rochot (on) : louchet - (57) |
| rock (prononcez Rô). Oiseau de proie. – Rock pleumé, vampire sous forme de chauve-souris monstrueuse ; au figuré, méchant homme, usurier, qui s'enrichit illicitement, qui s'engraisse aux dépens de ses victimes. (Puysaie). - (10) |
| rocot : bout tendre de l'os - (39) |
| rocton. s. m. Bâton non ferré dont se servent les mariniers des canaux pour bouter dans les biefs, le long des perrés ou des herges maçonnées de pierres sèches. (Navigat. de l'Yonne et des canaux affluents). - (10) |
| roculon : dernier né dans un nid. - (09) |
| roculon, rouculon. n. m. - Plus petit, dernier né, avorton. « Sa femme alle était pas pu haute que deux liards de beurre, c'était eune petite roculoune ... » (Fernand Clas, p.220) - (42) |
| roculon. s. m. Dernier né d'une famille, d'une couvée. - (10) |
| rod. Buse. - (49) |
| rôdâ (on) : rôdeur - (57) |
| rôde (C.-d., Chal.). - Bâton. Rudis en latin a le même sens, ainsi que rod en anglais. Le vieux français employait le mot rodereau pour désigner un bâton ou une arme quelconque. - (15) |
| rôde, s. f., bande, troupe. A presque le même sens que Rigue, et pourrait passer pour son synonyme. - (14) |
| Rôdômon. Rodoment. Nom propre… - (01) |
| rôdou, ouse, adj. et s. rôdeur, vagabond. - (08) |
| rodza : rougir - (51) |
| rodze : (adj) rouge - (35) |
| rodze : rouge - (43) |
| rodze : rouge - (51) |
| rodze adj. Rouge. - (63) |
| roe : Roue. « Eune roe de m'lin » : une roue de moulin. « Pousser à la roe » : aider. « La roe de Saint-Barnâ » : l'arc en ciel. - (19) |
| roe, raie (o long). - (26) |
| rôë, s. f., roue de véhicules, de moulins, etc. - (14) |
| rôe, sf. raie. - (17) |
| rœiller. v. n. Ouvrir de grands yeux ; regarder méchamment, d'un œil d'envie, de convoitise. (St-Maurice-aux-Riches-Hommes). - (10) |
| rôeré. Rouleras, roulera. - (01) |
| rœssi, v. a. tonifier, particulièrement l'estomac. - (22) |
| Rogachons (les) n. Les jours des Rogations sont les 3 jours précédant la fête de l'Ascension durant lesquels le curé prenait la tête d'une procession qui sillonnait la commune ; les enfants - (63) |
| rogane, s. f. organe, voix, son de voix. - (08) |
| roganiste : s. m., savetier. - (20) |
| rogaton : s. m., vieux garçon laissé pour compte. - (20) |
| rogâtonner, rogâtouner. v. n. Chercher à tâtons. (Montillot). – Rabâcher, grommeler. - (10) |
| rogatons : restes de viande. (S. T III) - D - (25) |
| rogaume, s. m., mixture culinaire entre la soupe et le ragoût. - (40) |
| rogé (ō) (se), vr. se remuer, bouger. S’emploie aussi au sens actif. - (17) |
| rôgè : (urger) faire vite - fou qui m'rôge paceque y'â du monde è dignè, faut que je fasse vite car j'ai du monde à dîner - (46) |
| rôgè : remuer - rôge bin lè sauce, remue bien la sauce - (46) |
| roge : rouge - (57) |
| roge : Rouge. « Eune padrix roge » : une perdrix rouge. « Vivent les roges, à bas les bliancs » : refrain révolutionnaire du temps de la révolution de 1848 ; « les roges », les républicains, « les bliancs », les royalistes. - (19) |
| rogé, remuer par excès... - (02) |
| rogé. Remués, remué, remuer. Se rogé, se remuer. Ne vo rogé pa, ne vous remuez pas… - (01) |
| rogé. : Remuer jusqu'à se rendre incommode. – Rageur pour rogeur, se dit d'un enfant turbulent. (Voir au mot mauroge.) - (06) |
| rogeailli : rougir - (57) |
| rôgean : Objet qui a été rongé. « Pose dan ce rôgean, je vas te donner eune autre pomme ». - (19) |
| ròge-bosse, s. m. rouge-gorge. - (24) |
| rogeo. Remuais, remuait. - (01) |
| rôgeoâ-yer, v. rougir. - (38) |
| rogeôle : Rougeole. « San ptiet a ésula rogeôle ». - Mauvaise herbe qui croît dans les blés (mélampyre ou melampyrum arvense). La rougeole est ainsi nommée non à cause de sa couleur mais parce-que sa graine mêlée au blé donne une farine de mauvaise qualité et du pain de couleur rougeâtre. (Voir aussi canvartille). - (19) |
| rôgeons : aliments entamés. Des restes, des reliefs de repas : ce qui a été rongé. - (62) |
| rogeou : Rougeur. Dicton : « Rogeou du métin fa torner le m'lin » : rougeur du matin (signe de pluie) fait tourner la roue du moulin. - (19) |
| roger : remuer. - (29) |
| roger, remuer (o long). - (26) |
| roger, ronger ; rogeon, débris rongé. - (05) |
| rôger, v. remuer (cf. raüger). - (38) |
| rôger, v. tr., syn. de rauger, bouger, remuer : « Ol é cousu de douleurs ; ô n'peut pu s'rôger. » - (14) |
| roger. Remuer. - (03) |
| rôgi : Ronger. Au figuré, « Donner des eus à rôgi », donner des os à ronger c'est faire en présence de quelqu'un des réflexions sous le couvert desquelles il est facile de deviner un blâme à l'adresse de quelqu'un. « Je ne li ai point dit de seuttijes mâ je li ai donné des eus à rôgi ». - (19) |
| rogi : Rougir. « Alle rogit c'ment in cu fouatté ». - (19) |
| rogmanté, augmenter ; quand le prix d'une chose s'est élevé, on dit qu'il est rogmanté ; une rivière qui croît rogmante. - (16) |
| rognâ : Croûte laiteuse, impétigo, maladie des tout jeunes enfants. - (19) |
| rognan : Rognon. « In rognan de viau » : un morceau de veau coupé avec le rognon. - (19) |
| rogne (âte en) : (être) en état de colère difficilement contenue - (37) |
| rogne (en), de mauvaise humeur, grincheux. - (27) |
| rogne : Chicane. « Charchi rogne » : chercher chicane. - (19) |
| rogne, s. f., talure, meurtrissure, écorchure d'un certain endroit chez un apprenti cavalier : « Ol a éte à ch'vau à c'maitin, é pi ôl a étrapé la rogne. » - (14) |
| rogne. Meurtrissure qu'éprouvent les cavaliers qui débutent. - (03) |
| rogner chû tout : économiser à outrance - (37) |
| rognes (chercher des), chercher des motifs de discussions, de querelles. - (27) |
| rognes (chercher des). Chercher noise. - (49) |
| rognes (s’arc’er dâs) : faire des reproches sournois, provoquer - (37) |
| rognes n.m.pl. Querelle. - (63) |
| rogneûre (aine) : (un) tout petit morceau - (37) |
| rogneure : Rognure. Ironiquement « Rogneure de cantique », refrain obscène. - (19) |
| rogni : rogner - (57) |
| rogni : Rogner. Au figuré, « Rogni les ang'lles », rogner les ongles, mettre hors d'état de nuire. - (19) |
| rogni, rseper : rogner - (43) |
| rognons bardots (avoir les) : avoir envie de rire. (CH. T II) - S&L - (25) |
| rognou (on) : rogneur - (57) |
| rogôme (un) : une préparation culinaire pas terrible ! - (61) |
| rogôme : des restes de repas (un mélange) - (46) |
| rogôme : n. m. Mélange un peu bizarre. - (53) |
| rogome. Aliment mal préparé. - (49) |
| roi patret : Roitelet, très petit oiseau connu aussi sous le nom de troglodyte. - (19) |
| roi, raide, étendu, fatigué. - (05) |
| roi. Raide, vieux mot. - (03) |
| roi. Rois. - (01) |
| roïal, adj. royal. - (17) |
| roïas : adj. m. et f., enroué. - (20) |
| roïasse, rouïasse : s. f., enrouement. Avoir la roïasse. A rapprocher du vx fr, enroïr, enrouer. - (20) |
| roibi, roibbi. s. m. Roilelet. - (10) |
| roibri : roitelet(F. T IV) - Y - (25) |
| roibri : voir loibri - (23) |
| roiche (n.f.) : roche (aussi reuce) - (50) |
| roiche, s. f. roche, rocher. Prononcer « roice, raice. » aux environs d'Avallon « reuce. » - (08) |
| roide. adj. - Raide. Le poyaudin a conservé la prononciation usitée en ancien français du XIIIe siècle. - (42) |
| roidelo. Roitelet. - (03) |
| roid'lé, roid'lo, roitelet, petit oiseau. - (16) |
| roidot, s.m. roitelet. - (38) |
| roie ; un fosse creuse par un cours d'eau, une raie qui partage une terre en deux champs sont des roie. - (16) |
| roie ou raie (C.-d., Morv., Chal., Br.). – Sillon de terre, d'où, par analogie, ruisseau, petit cours d'eau. Dans cette dernière acception, l'étymologie est plutôt rû, lequel est usité en français avec le même sens que raie, et qui a formé ruisseau. Cependant Littré, qui reconnaît ce mot comme étant usité en Basse-Bourgogne pour désigner un ruisseau venant de source, donne comme étymologie le latin rivus, pour srivus, radical sanscrit sru, couler. Pourquoi pas le verbe grec …, couler ? - (15) |
| roie : (rouâ: - subst. f.) sillon. - (45) |
| roie, raie - (36) |
| roie, raie entre sillons, bief. - (05) |
| roie, raie. - (04) |
| roie, rouée. Raie. - (49) |
| roie, s. f. raie, sillon dans une terre labourée, mesure vague de superficie. - (08) |
| roie, s. f., ru, petit cours d'eau, raie entre sillons. - (14) |
| roie. Raie, petit cours d'eau, vieux mot. - (03) |
| roiger, v. ; remuer. - (07) |
| roigner (v.t.) : rogner - (50) |
| roignon, s. m. rognon, le rein des animaux. - (08) |
| roin (n. m.) : ornière - (64) |
| roin (n.m.) : rein - (50) |
| roin : ornière - (60) |
| roin : rien. - (29) |
| roin, s. m. rein : «. i é mau es reins », j'ai mal aux reins. - (08) |
| Roin. Rivière de Savigny, qui prend sa source au-delà de Bouilland, à la Grande Dore... - (13) |
| roincener, v. a. labourer sans goût, sans soin, grossièrement, c'est-à-dire en laissant des « roins » ou petites éminences sur le sol, par défaut de bonne culture. (voir : roinchoner.) - (08) |
| roincher. v. n. Ruminer, en parlant des animaux. (Rogny). - (10) |
| roinchon, s. m. bande de terre, de gazon négligée par la charrue dans un labourage incomplet. Diminutif de « roin. » (voir : royou.) - (08) |
| roinchoner, v. n. labourer grossièrement, irrégulièrement, en laissant des lacunes dans le labourage, et par extension labourer mal. (voyez roincener.) - (08) |
| roinci, v. n. respirer avec difficulté, comme une personne qui a du rhume ou de l'asthme. - (08) |
| roinçons : dos d'âne dans le labour - (39) |
| roindze : (nm) sorte d’oseille - (35) |
| roinge (du lâ roinge), adj. rance. - (38) |
| roinger (v. int.) : ruminer - (64) |
| roinger (v.t.) : ronger - (50) |
| roinger, v. a. ronger. « roinzer. » (voir : ringer.) - (08) |
| roingner, v. a. rogner - (08) |
| roingneure, s. f. rognure, ce qui a été rogné. - (08) |
| roinjeu : ranger. - (29) |
| roins, reins. - (27) |
| rointe : Plante qui croît dans les prés, rumex triplex, appelé aussi chô-gras. - (19) |
| roiròte, et rouaròte, s. f . , petite serpette pour couper le raisin. Le vigneron a un assez riche vocabulaire. (V. Sarpe, Sarpéte, Goui, Gouisòt.) - (14) |
| roise, rouaise. s. f. Routoir, endroit ou l'on rouit le chanvre. (Soucy, Saligny). - (10) |
| roiser. v. a. Rouir. Roiser du chanvre. (Maligny). - (10) |
| roitelòt, s. m., roitelet. - (14) |
| roiyè : ronger, être roiyé : être dévoré (par les moustiques par ex.) - (46) |
| roj : adj. rouge . - (21) |
| ròjàyer, v. n. rougir d'émotion; avoir des couleurs naturellement. Adj. ròjayat, qui a de fortes couleurs. - (24) |
| rôjé, remuer, agiter ; s'rôjé, se remuer pour changer de place ou de position. - (16) |
| rojon. Débris de pomme ou de poire mangée, du verbe ronger. - (03) |
| rokè, roter ; se dit aussi pour : hoquet ; el é l'roké, il a le hoquet. - (16) |
| rolate : Roulette, petit outil dont les ménagères se servent pour couper la pâte qui sert à faire les « bigneuts ». - (19) |
| rôlè : v. t. Rouler. - (53) |
| rôle, râteau en fer pour remuer la braise et la sortir du four. - (16) |
| rôle, s.m. racloir en bois pour rassembler les cendres dans un four à pain ; peut être en fer pour les braises ; râble. - (38) |
| rôle. Roule, roules, roulent. C'est aussi role et roles, substantif singulier ou pluriel. - (01) |
| roler : (vb) rouler - (35) |
| roler : Rouler. Au figuré, dégringoler. « Ol a rolé les égrés » : il a dégringolé les escaliers. « Juer à role pansan » : s'amuser à descendre une pente en roulant sur soi-même comme un fût. - (19) |
| rôler, v. rouler. - (38) |
| rôler, v. tr. et intr., rouler, faire tourner, aller en tournant. - (14) |
| rolin, rolot, adj. pas solide. - (38) |
| rolle (n.f.) : petite flûte fabriquée lorsque le bois "sève" - (50) |
| rolle, s. f. petite flûte que les enfants de nos campagnes se fabriquent au temps de la sève avec l'écorce du sureau, du noisetier et autres arbustes. - (08) |
| rollet (n.m.) : rainette, petite grenouille - (50) |
| rollet, s. m. petite grenouille verte. - (08) |
| rolot : Rouleau. « In rolot de papier ». « In rolot de nage » : grosse boule de neige que les enfants s'amusent à rouler sur la neige récemment tombée et qui augmente de volume à chaque tour, comme l'avalanche qui n'est en somme qu'un énorme « rolot de nage ». - (19) |
| rôlotte, s.f. roulotte. - (38) |
| rom. Romps, rompt. - (01) |
| romaiñne n.f. Grande balance romaine. - (63) |
| romeler, roumeler. v. - Respirer bruyamment, en émettant un sifflement ; synonyme de pimer. (Sommecaise, selon M. Jossier) - (42) |
| romeler, roumeler. v. n. Pîmer, respirer avec bruit. (Sommecaise). - (10) |
| rommaler : maugréer. (MM. T IV) - A - (25) |
| rompée : prairie remise en culture. A - (41) |
| rompis n.m. (de rompre) Défriche. - (63) |
| rompis : s. m., vx fr, rompeïs, défriche. Il y a en Saône-et-Loire de nombreux hameaux ou écarts dénommés ; le Rompay, Le Rompey, Le Romoais, Le Roupoix. - (20) |
| rompu : s. m., rompue : s. f., fraction d'unité de mesure. - (20) |
| rompue : pâturage labouré - (48) |
| ronchon (n.m.) : grognon, mal luné - (50) |
| ronchon (nom masculin) : grognon. - (47) |
| ronchoner, v. intr., grogner : « Qu'é ce qu'ôl a donc, c'diâbe, qu' tô l'jor ô ronchone ? » - (14) |
| rond : adj. Avaler tout rond, avaler sans mâcher. - (20) |
| rondale (na) : hirondelle - (57) |
| rondalle (na) : rondelle - (57) |
| ronde : local à l'air libre où sont nourris les cochons (en A : trion). B - (41) |
| ronde : local à l'air libre où sont nourris les cochons - (34) |
| ronde n.f. Enclos des porcs communiquant avec leur écurie, couvert ou non, précédant le sainier. - (63) |
| ronde, petit cuvier pour recevoir les eaux de la lessive, etc. Le rondan est plus grand que la ronde et sert à la fabrication du vin. - (16) |
| ronde, s. f. baquet, petit cuvier. La ménagère place ordinairement une « ronde » sous la rigole du grand cuvier de lessive pour recevoir le « luchu. » - (08) |
| ronde, sf. cuve. - (17) |
| Rondeau : nom de bœuf. 111, p. 2.9-o - (23) |
| rondelette, s. f. lierre terrestre (plante à tisane). - (24) |
| rondelotte, s. f., lierre terrestre. - (40) |
| rondenées, borborygmes. - (05) |
| rondiau, s. m. halo autour du soleil ou de la lune. - (24) |
| rondonner : v. n., grogner, ronchonner. - (20) |
| Rondot : nom de bœuf. Sous le joug souvent associé à Marin. (Voir Marin). - (62) |
| rondöte, sf. petite cuve. - (17) |
| rondotte, n.f. lierre terrestre. - (65) |
| rondya : petit baquet. Rond en bois sur lequel on hache la viande ou les légumes. (V. T IV) - A - (25) |
| rondzi, roudzi : ronger, grignoter - (43) |
| rondzi, roudzi v. Ronger. - (63) |
| rôné : ravenelle. Entre dans le panier d’herbe pour les lapins (avec d’autres, pas plus nobles : yâche, séneçon…) - (62) |
| rônée, s.f. légumineuse nuisible à fleurs jaunes. - (38) |
| rôner : se dit des roulements sourds d'un orage au loin. (G. T II) - D - (25) |
| ronfe, et ronfle, s. f., sommeil d'ennui : « O nous en dégoise trop, c'bestiâ-là. . . J'en ai la ronfe. » - (14) |
| ronfiant, adj. ronflant. - (17) |
| ronfié, vn. ronfler. - (17) |
| ronfier : ronfler - (48) |
| ronfier, v. n. ronfler. se dit lorsqu'on fait un ouvrage pénible, avec grand effort : j'ai fini, mais je n'en puis plus, j'en « ronfle. » - (08) |
| ronfiou, sm. ronfleur. - (17) |
| ronflai. : (Pron. ronfliai), ronfler. J'en ai lai ronfle (pron. ronfieu), c'est-à-dire je dors d'ennui de ce quej'entends. - (06) |
| ronfle : s. f., toupie ronflante. - (20) |
| ronflée (à la) (loc. adv.) : a la volée (envouéyer quique choue à la ronflée) - (64) |
| ronflée, correction - (36) |
| ronflée. n. f. - Punition corporelle : « Continue mon chameau ! Et te vas vouère la ronflée qu'te vas t'prende ! » - (42) |
| ronflon : s. m., somme. J’ai fait un bon ronflon. - (20) |
| ronflon, ronflonne : adj., dormeur, dormeuse. Ch’tit ronflon. - (20) |
| ronge, s.f. ronce. - (38) |
| rongeon : s. m., débris de pain ou de fruits qu'on a rongés. Veux-tu bien finir tes rongeons ! Voir curon. - (20) |
| rongeon, et rôgeon, s. m., cœur qui reste d'un fruit rongé ; rongeon de pomme, de poire, dans lesquels on a mordu : « O n'é pas chiche, lu ; ô vous beilleròt ben voulentier ses rongeons. » - (14) |
| rongeon, rougeon. n. m. – Trognon : un rongeon d'poumme. - (42) |
| rongeon, s. m. ce qui reste d'une chose qui a été rongée, d'un os, d'un fruit entamé, d'un légume, etc. - (08) |
| rongeon. s. m. Trognon de fruit. Un rongeon de pomme. - (10) |
| rongeon. Trognon, fruit dont on a rongé la partie comestible, ce qui reste d'un fruit entame, d'un morceau de pain, d'un membre de volaille dont on a mangé presque toute, la chair. - (12) |
| ronger (verbe) : touiller son café. - (47) |
| ronger : v. a. et n., vx fr. ronfler, ruminer, au prop. et au fig. - (20) |
| ronger. v. - Rogner : « Florine, t'approuche pas du chien, i' rouge eune ous ! » - (42) |
| rongeure (ronjure). s. f. Marque des dents sur un fruit a moitié rongé. - (10) |
| ronghiot, s. m. rond, cercle. - (08) |
| rongi : ronger - (57) |
| rongne, sf. dispute, querelle. Charché rongne, chercher querelle. - (17) |
| ronjeon, rongeon (Chal., Morv., Y.), rôjon (Br.), ringeon (Morv.). - Reste, trognon de pain ; du verbe ronger. Ronget a le même sens en vieux français. - (15) |
| ronjon, ce qui reste d'un morceau de pain, d'un fruit presque entièrement mangé. - (16) |
| ronlai. Ronfler. - (01) |
| ronté : s. m., vx fr. routeis et ronteis, friche. Il y a à Fuissé un écart dénommé Les Rontets. Voir déronté. - (20) |
| rontontue : trompe en écorce. - (09) |
| rontontue. s. f. Trompe d'écorce. (Chàtel-Censoir, Trucy). – Voyez rantanteu. - (10) |
| rontre — écanailli (maïs) : déchaumer - (57) |
| ronze : (nf) ronce - (35) |
| ronze : ronce - (43) |
| ronze : ronce - (51) |
| ronze n.f. Ronce. - (63) |
| ronzi : roncier - (43) |
| ronzî n.m. Roncier. Voir rêpier. - (63) |
| rôo ou rò. Rôt, rôti. - (01) |
| ropaire. s. m. Bélier, (Domecy-sur-le-Vault). - (10) |
| rôpi, s. m. piquette, souvent à goût âpre, qui « rôpe » (râpe). - (22) |
| rôpié – rousti : dépouillé (au jeu) - (57) |
| rôpœull’e, s, f. broussaille sur une pente raide et rocailleuse. - (22) |
| roqualot. Petit homme, roquet, chose rabougrie , mal venue. Etym. diminutif de roquet. - (12) |
| rôquè : roter - (46) |
| roquelaude : blouse longue et blanche. - (09) |
| roquelaude. s. f. Longue blouse, vêtement long, en géneral. - (10) |
| roquer : roter. - (62) |
| roquer, roter. - (05) |
| roquer, rouquer. v. - Cogner, choquer : « Guade don' c'qu' te fais, t'as encor' roquer les verres ! » - (42) |
| roquer, v. intr., roter : « En mingeant, ô n'fait que roquer ; y et ein vrâ goret. » - (14) |
| roquer. Roter. - (03) |
| roquerai, s. m., rot, explosion incivile. - (14) |
| roquèt : hoquet - (37) |
| roquille : s. f., topette graduée pour eau-de-vie. - (20) |
| roquîye, s. f. petite fiole à eau-de-vie. - (24) |
| rôquœll’e, s, f. petite fiole à eau-de-vie. - (22) |
| rorer : v. a., vx fr., dérober. - (20) |
| rôsé : Rosier. « Rôsé sauvage » églantier. « Rôsé de tos mois » rosier remontant. - (19) |
| rose au loup, n.f. coquelicot. - (65) |
| röse, sf. rose. - (17) |
| rôseai, s. m. roseau. « rosiau, rousiau. » (voir : rousiau, roucher, verne.) - (08) |
| rosée : champignon de pré. Ex : "N'a fait trop sec a c'tan-née, j'aurons pas d'rosées !" - (58) |
| rôsée : n. f. Rosée. - (53) |
| rosette : s. f., gros intestin (chez les animaux). - (20) |
| rosia (na) : rosée - (57) |
| rosiau (n.m.) : roseau - (50) |
| rosiau (on) : roseau - (57) |
| rôsiau : Roseau, laiches et autres plantes aquatiques qui croîssent dans les prés humides. « Y a du rôsiau dans man pré ». Tige du blé. « Ce blié a in ban rôsiau ». - (19) |
| rosse : rousse - (35) |
| rosse : rousse - (43) |
| rosse, cheval usé. Dans l'idiome breton, roncé, au pluriel ronceed, signifie cheval, dans quelques parties du Finistère. (Voir au Dict. français-celtique du P. de Rostrenen, au mot Cheval) ... - (02) |
| rossée, s. f., bonne raclée, roulée. Ce mot, dans ce glossaire, a plus d'une demi-douzaine de synonymes. - (14) |
| rossiaud : Roux, blond ardent. « Ol a les cheveux roussiauds ». Qui a les cheveux roux : « Y est in ptiet roussiaud ». - (19) |
| Rossignau. nom de bœuf. (voir : Rôsseau, Rôssot.) - (08) |
| Rossigneau : nom de bœuf. III, p. 29-o - (23) |
| rossignô : n. m. Rossignol. - (53) |
| rossignò, s. m., rossignol : « L'av'vous entendue, la preùmenouse ? All' chantôt tout c'ment l’rossignò. » - (14) |
| Rossignol : nom de mulet. VI, p. 16 - (23) |
| rôssignôle. Chante, chantes, chantent mélodieusement. - (01) |
| rossignon : réveillon aux marrons et au vin blanc. (AS. T II) - S&L - (25) |
| rossignon, petit repas de gens et bêtes, entre le souper et le coucher. - (05) |
| rôssignon, régalade. (Voir au mot recie, dont rôssignon et rechinoy semblent être les diminutifs.) ... - (02) |
| rossignon, s. m., repas que l'on fait le soir, après la veillée. - (14) |
| rossignon, s. m., souper nocturne en mai. - (40) |
| rossignon. Réveillon. - (03) |
| rossignot, s. m. rossignol. - (08) |
| rosso (ein) : nèfle. (RDT. T III) - B - (25) |
| rosso : petite poire d'un rouge brun à chair très ferme. (RDM. T III) - B - (25) |
| rosso : n. f. Poire naine que l'on sèche et cuire dans du vin rouge. - (53) |
| ròssœ, adj. jaune. Verbe ròssàyer, jaunir. - (24) |
| rossot : Roux, nom de bœuf, féminin : « rossate », nom de vache. - (19) |
| rôssot, e, adj. rousseau, de couleur rousse ou fauve : le garçon est «rôssot» et la fille «rôssote.» - (08) |
| rôt (Chal., Br.). - Epi frais de maïs, grillé sur le feu ou devant un feu clair, d'où il suit qu'un épi bon à être grillé (c'est-à-dire vert) est appellé un rôt. Vient de rôtir. - (15) |
| rôt de maïs, épi rôti, grillé. - (05) |
| rôt : panoille rôtie. - (21) |
| rôt, reut (reût) : s. m., épi de mais (panouille) grillé. - (20) |
| rôt, s. m., grappe de maïs, encore laiteuse et rôtie devant le feu. Les grains se durcissent, se dorent, et éclatent. Régal des gamins, qui, trop souvent, font de cette gourmandise la cause d'une picorée en règle. - (14) |
| rôtaï, rôtaille, s. m. clématite. - (38) |
| rôtch : mot féminin désignant un lien fait avec l'écorce du saule ou de la paille de seigle - (46) |
| rôtchon : un paquet de cheveux emmêlés, un sac de nœuds - (46) |
| rôte : tresse munie d'une boucle faite avec une branche souple pour servir de lien à un fagot ou une gerbe. A - B - (41) |
| rôte (ou rouate) : (nf) lien de fagot ou de gerbe - (35) |
| rôte : lien végétal vrillé sur lui-même pour permettre son accrochage - (51) |
| rôte n.f. (du lat. retortam, tordu, retourné). Lien de fagot constitué d'une longue tige fraîche de châtaignier ou de chêne que l'on tendait avec de la paille de seigle à l'aide d'un bâton (le beuil). - (63) |
| rôte, brioche en couronne et tige d'osier servant à attacher des paquets de choses diverses. Dans le second sens : « si j'pran eune rôte ! dit un père à son enfant indocile, en le menaçant d'une correction. - (16) |
| rote, grand nombre, troupe. - (05) |
| rote, lien de bois flexible ou mansenne (en liant, on tourne le lien dont on disloque les fibres pour qu'il ne se casse pas). - (27) |
| rote, n.f. lien de fagot. - (65) |
| rôte, s. f., baguette flexible : « O m'a baillé su l'dos des bons côps d'rôte. J'en ai core mau. » (V. Riòte, Riorte.) - (14) |
| rôte, s. f., lien en coudrier ou en osier. - (40) |
| rôte, s. f., route, et chemin qu'on a à faire dessus. - (14) |
| rote. Troupe. - (03) |
| rote. : Lien pour gerbes ou fagots. Dans le dialecte on dit roorte, en Franche-Comté riorta, à Genève rioute(Gloss. gen.). Du latin retortum, supin du verbe retorquere, parce que l'on tord ces liens en les employant. - (06) |
| rôteillè : remuer dans tous les sens en position couchée - (46) |
| rôteillon : un tas d'objets emmêlés - (46) |
| rotelö, sm. roitelet. - (17) |
| rôter, v. a. reprendre, retirer une chose prêtée ou donnée. (voir : doter.) - (08) |
| rôteurer : mâturer - (51) |
| ròti, et routî, v. a., rôtir, griller : « O n'fait qu'la montrer au feù pou fâre routï sa viande » - (14) |
| rotie (ŏ), sf. tartine (de beurre, de confiture). - (17) |
| rotie : une tartine, on dit aussi routie - (46) |
| rôtie : vin chaud - pain grillé. III, p. 16-2 ; V, p. 48 - (23) |
| rôtie, roûtie : n. f. Tartine. - (53) |
| ròtie, s. f., tartine de pain, souvent de la longueur de la miche, et sur laquelle on étend beurre, confitures, etc., etc. Une des plus préconisées est celle du fromage blanc frais, que l'on couvre de rondelles de radis, de ciboule ou d'ail. - (14) |
| rôtie, s. f., tartine de, pain (grillée ou non). - (40) |
| rotie, tartine de beurre, de crème, de fromage, de miel, de confitures dont on régale les enfants. - (16) |
| rotje (ō), sf. [rorte]. lien de bois flexible, généralement de mancienne destinée aux fagots. Lien de gerbe. - (17) |
| rôtjelé, vt. tortiller. Abîmer ? - (17) |
| rotse : roche - (43) |
| rotse n.f. Roche, rocher. - (63) |
| rotsi : (nm) rocher - (35) |
| rotsi : rocher - (43) |
| rotsi n.m. Rocher. - (63) |
| rotsi, nenvier : jeter (un caillou) - (43) |
| rotté : v. i. En baver. - (53) |
| rou : s. m. synonyme de reuche. - (21) |
| rou, rouet à filer qu'en certains pays on appelle filète. - (16) |
| rouâ : sillon. - (62) |
| rouâ, rô : raie - (48) |
| rouâ, s.f. raie, fossé ; la rouâ d'Crissey, le ruisseau de Crissey. - (38) |
| rouâcher, v. intr., mâchonner comme les animaux qui ruminent, tourner et retourner quelque chose dans sa bouche sans l'avaler. - (14) |
| rouae : raie, sillon - (37) |
| rouâe : n.m. Sillon. - (53) |
| rouâgai : remuer quelque chose avec un objet dans un récipient, remuer la soupe. - (33) |
| rouâgè : v. t. Remuer quelque chose avec un objet dans un récipient. - (53) |
| rouâgeou, rouaizou (n.m.) : palette à manche pour remuer une bouillie, etc… - (50) |
| rouâgeou, s. m. palette à manche dont on se sert pour remuer une bouillie, une pâtée, et principalement les pommes de terre cuites. On écrase les tubercules avec « l'écrâzou », on les remue avec le « rouâgeou. » - (08) |
| rouâger (se) : secouer (se), agiter (s'), activer (s'), remuer (se) - (48) |
| rouager : mélanger en retournant avec un instrument (louche, cuillère, etc...). - (56) |
| rouâger : remuer en tournant - (48) |
| rouager : remuer. (RDM. T II) - B - (25) |
| rouager : remuer. (S. T III) - D - (25) |
| rouâger, rouaizer (v.t.) remuer (pour de Chambure rouâger) - (50) |
| rouâger, v. a. remuer, agiter en tournant. « rouaizer. » (voir : rebouler.) - (08) |
| rouager. A Dijon : rôger. S'agiter en faisant du bruit. Un lapin s'ast fôré sous note pile de sarments ; an l’entend rouâger, i aillons tâcher de le prenre. Les étymologies ne manqueront pas aux chercheurs : rage et rager ; rouage, impôt que les voituriers payaient sur certaines routes ; ravager. Le substantif rouâgie, d'ailleurs peu usité, a un sens très différent ; il signifie repos, interruption de travail : i vas fâre eune petiote rouagie. - (13) |
| rouai (on) : roi - (57) |
| rouailler : fouetter - (60) |
| rouaill'not : v. i. Crier comme. - (53) |
| rouain (du) : regain - (57) |
| rouain : s. m., regain, seconde pousse des prés. - (20) |
| rouain, regain. - (05) |
| rouaines : mauvaise herbes envahissantes perennes. Vrai nom: rumex. - (59) |
| rouainte : s. f., patience à feuille crépue (rumex crispus), et par assimilaion toute autre plante résistant comme elle à la faux. - (20) |
| rouaiquer : hoqueter - (37) |
| rouais : raie - (39) |
| rouaiter, peiner, fouetter - (36) |
| rouaizer : tourner, remuer une sauce - (39) |
| rouaizer, remuer - (36) |
| rouaizer, ronger - (36) |
| rouaizou : cuillère de bois - (39) |
| rouaizou, cuiller de bois - (36) |
| rouâjoû : instrument pour remuer, cuiller de bois - (48) |
| rouale : petite roue - (48) |
| roualer : (roualè - v. intr.) miauler. Il s'agit du miaulement plaintif du chat qui a faim. - (45) |
| rouales : avant-train de charrue - (48) |
| roualle : Rouelle. « Eune roualle de viau ». - (19) |
| roualle du genou : rotule. - (33) |
| roualles : avant train de charrue. Les roualles faitint partie de la charrue. - (33) |
| rouande, n.f. rumex. - (65) |
| rouânè : v. i. Cri du chat en rut. - (53) |
| rouâner : miauler (de faim ou en période de rut) - (48) |
| rouâner, v. n. se dit du hennissement d'une jument en chaleur. - (08) |
| rouanner (rouan-ner). v. n. Miauler. (Chastenay). - (10) |
| rouânner, rouiner. v. - Miauler, avec ce miaulement particulier des chats qui se battent. Au figuré : pleurnicher, geindre. - (42) |
| rouannis. n. m. - Miaulement. - (42) |
| rouante : plante : grande oseille, grande patience, de son vrai nom la Rumex. - (33) |
| rouante. n. f. - Chénopode blanc, épinard sauvage. (Mézilles, selon H. Chéry) - (42) |
| rouarte : lien en bois - (43) |
| rouarté, v. a. cingler avec un bâton flexible comme on ferait avec une « rouarte ». - (22) |
| rouarte; s. f. lien à fagot en osier ou en bais tordu. - (22) |
| roûas : raie de labour. Une rouas de charrue : la dernière raie laissée par la charrue dans un champ labouré. Signifie aussi une rigole pour drainer, assainir un champ. - (33) |
| rouasse (à) (loc. adv.) : à vers (i pleut à rouasse) - (64) |
| rouasse (à). loc. adv. - On dit pleuvoir à rouasse, pour une forte pluie incessante, que la terre ne peut plus absorber. - (42) |
| rouassée (n. f.) : forte averse (syn. ragasse) - (64) |
| rouasser : folâtrer, traîner. (F. T IV) - Y - (25) |
| rouat : Rouet. « Foler au rouat » : filer au rouet. « Rouat de m'lin » : roue dentée, sorte de pignon qui fait partie du mécanisme d'un moulin. - (19) |
| rouater, v. a. cingler les jambes avec un bâton flexible comme on le ferait avec une « rouate ». - (24) |
| rouâter, v. a. frapper avec une verge, avec une houssine, avec des brins de bois, des « rouettes. » (voir : rouéler.) - (08) |
| rouâteule, s. f. lien qui sert d'attache aux gerbes pendant la moisson. - (08) |
| rouatin : pain humide - (60) |
| rouâtte : verge pour corrections corporelles - (37) |
| rouâtte, rouette (n.f.) : brin flexible d'osier,de noisetier servant à lier (du lat., retorta, p.p. de retorquere = retordre, a. fr., reorte, riote, lien d'osier ou de coudrier) - (50) |
| rouâtter (v.t.) frapper avec une verge, une "rouâtte" - (50) |
| rouâtter : corriger, cingler avec une verge - (37) |
| rouaûle (n.m.) : morceau de bois emmanché pour tirer les braises du feu - (50) |
| rouaule : voir raud - (23) |
| rouaule : oiseau de proie : buse, épervier. - (33) |
| rouaule : sorte de raclette pour retirer la braise du four à pain. - (33) |
| rouaule : (rouô:l' - subst. m.) râble, fourgon, outil à tirer les braises du four à pain et à tirer les céréales pour les étendre sur le grenier, les faire sécher, les empêcher de moisir. - (45) |
| rouaule : grosse buse ; morceau de planche, emmanchée pour tirer les braises du four - (39) |
| rouaule, s. m. oiseau de proie. (voir : rau.) - (08) |
| rouaule, s. m. rable, pelle en bois munie d'un grand manche avec laquelle on remue les grains et qui sert à divers autres usages. (voir : raubler.) - (08) |
| rouâyer : frapper avec une branche flexible - (39) |
| rouban, et riban, s. m., ruban : « Alle étòt bé brave ; all' s'é métu des roubans partout. » - (14) |
| rouban, s. m. ruban. (voir : riban.) - (08) |
| roubigneau, robigneau. n. m. - Grosse crêpe salée. - (42) |
| roubigneau. s. m. Sorte de beignet, consistant en farine délayée dans du lait et frite dans la poêle, à l'huile ou au beurre. Dans la Puysaie, la fête de la Vierge de février, la Chandeleure, est appelee la Boune-Dame-des-Roubigneaux. Ce jour-là, les voyaux (les oiseaux) se mariont, et le soir, dans la voillie (à la « soirée), on fait des Roubigneaux, des crêpes. (Mezilles, Lainsecq, etc.). – II est à remarquer que, dans la Puysaie et dans plusieurs des communes riveraines de la Haute-Yonne, il existe quantité de familles du nom de Robineau, et que, partout, ce nom est transformé par la prononciation vulgaire en celui rle Roubigneau. - (10) |
| roubri, roibri. s. m. Roitelet. - (10) |
| rouç’er en lai fouanaic’e (lai) : (la) coucher dans l’herbe (avec intention) - (37) |
| rouchâ : n.m. Ru. - (53) |
| rouchâ, rouchaie : ruisseau - (48) |
| rouchai : couler abondamment. - (33) |
| rouchat, s. m. pelle droite, louchet. - (22) |
| rouchau (n.m.) : ruisseau - (50) |
| rouche (A) : loc, à verse, à torrents. Il pleut a rouche. - (20) |
| roûche : averse. (E. T IV) - S&L - (25) |
| rouchè : (rouchê: - subst. m.) ruisseau. - (45) |
| rouché : v. impers. Pleuvoir beaucoup. - (53) |
| rouchè : v. t. Taper vivement. - (53) |
| roûche, roûchie n.f. (du lat. rustum, branche, bâton). Forte averse. Râclée (correction). - (63) |
| roucheai, s. m. ruisseau, cours d'eau, écoulement d'un liquide. « Roucheau » et en quelques lieux « russeau. » - (08) |
| roucheau : ruisseau - (37) |
| roucheau : ruisseau. - (52) |
| rouchée : averse. (F. T IV) - Y - (25) |
| rouchée : grosse averse. - (33) |
| rouchée, gaireau : n. f. Grosse averse. - (53) |
| rouchée, subst. féminin : averse abondante. - (54) |
| rouchée. s. f. Violente averse. (Villiers-Bonneux). Du verbe roucher, lancer. - (10) |
| rouchelée : grosse averse - (39) |
| roûcher (v.t.) : 1) donner une volée de coups - 2) tomber de la pluie à verse - (50) |
| roucher (verbe) : lancer avec force. - (47) |
| roucher : pleuvoir - (44) |
| roucher : pleuvoir violemment - (48) |
| roucher : tomber. “Y’en rouche”, il pleut à seaux. - (59) |
| roucher : v. a. et n., pleuvoir à rouche ; rouer de coups. - (20) |
| roucher, rosser - (36) |
| roucher, se dit de la pluie qui tombe à flots, qui ruisselle. - (11) |
| roucher, v. n. battre, donner une volée de coups. - (08) |
| roucher, v., pleuvoir en abondance. - (40) |
| roucher, verbe impersonnel : pleuvoir beaucoup. Au sens figuré, roucher quelqu'un, c'est le renverser. - (54) |
| roucher. Jeter, se débarrasser ; pleuvoir à verse. On dit : « y en rouche ». - (49) |
| rouchi : Pleuvoir à verse, se dit surtout d'une pluie battante poussée par un grand vent. - (19) |
| roûchi Voir roûtsi. - (63) |
| rouchler : ruisseler. - (52) |
| rouchler : pleuvoir fort et longtemps - (39) |
| rouchot : un ruisseau, d'où l'expression : il en rouche : il pleut très fort (comme un ruisseau qui coule). - (56) |
| rouchot : bêche d'une forme spéciale pour curer les fosses. (CH. T II) - S&L - (25) |
| rouchot, louchet, pelle. - (05) |
| rouchottes : de teinte rouge (se dit surtout des noisettes mûres) - (37) |
| rouctouner. v. - Ronchonner ; synonyme de bougounner. (Mézilles, selon H. Chéry) - (42) |
| rouctouneux. n. m. - Celui qui rouctoune . - (42) |
| roudoudou : s. m. Gros roudoudou, gros bonnet, « grosse légume ». - (20) |
| roudzi : ronger. A - B - (41) |
| roudzi : ronger - (34) |
| roudzi, rondzi v. Ronger. - (63) |
| roudzon : trognon. Fragment de pomme de terre après avoir prélevé quelques taillons*. Coupe de foin effectuée après refus du bétail. A - B - (41) |
| roudzon : (nm) trognon de pomme - (35) |
| roudzon : reste de pomme de terre, de pain ou d'aliment quelconque - (43) |
| roudzon : reste de ta pomme de terre, lorsque l'on a prélevé les taillons - (34) |
| roudzon de pain : petit morceau de pain - (43) |
| roûdzon n.m. (de roudzi). Refus (herbe refusée), trognon, croûton. - (63) |
| roue (faire la), être fâché, ainsi qu'un paon qui fait la roue. - (38) |
| roue : (nf) rouleau de foin que l’on fait avant de charger - (35) |
| rouè : le roi - (46) |
| rouè : roi - (48) |
| roué : s. f. roue. - (21) |
| rouè : roi - (39) |
| roue, andain. Long rouleau de foin sec, amassé par le faneur avec son râteau. Ce travail se fait avant la mise en petite moyette « miau », pour être chargé plus aisément. - (49) |
| roué, roé (n.m.) : roi - (50) |
| roue, roûle n.f. Rouleau de foin fait au râteau, andain. - (63) |
| roue, s. f. roue, rouet. - (38) |
| roué, s.m. roi (vieux). - (38) |
| roué. n. m. - Roi. - (42) |
| rouèble, rouable, rouèbe. n. f. - Râteau en fer, utilisé dans les fours à pain pour rapprocher les braises et les retirer. - (42) |
| rouèche : roche - (48) |
| rouèche : roche. - (29) |
| rouèche : roche. (B. T IV) - D - (25) |
| rouèchi, v. n. pleuvoir à verse. - (24) |
| rouèchillè : manger directement sur l'os - (46) |
| rouègner : rogner - (48) |
| roueille, s. f. trace, sillon sur la peau d'un homme, mais plus souvent sur le cuir d'un animal à la suite d'un coup de fouet, d'un coup de pointe quelconque. L'aiguillon fait souvent des « roueilles » sur le corps des bœufs de travail. - (08) |
| roueiller, v. a. maculer, rayer le corps en frappant, en cinglant avec une baguette flexible ou avec une pointe. - (08) |
| rouèillon : (rouèyon: - subst. m.) bande de terre qu'on laisse inculte pour marquer la limite de deux champs. - (45) |
| rouèillon : bande de friche entre 2 champs (où en général sont déposées les pierres retirées des champs) - (48) |
| roueillou, ouse, adj. et s. celui ou celle qui expectore des humeurs épaisses comme dans la pituite. - (08) |
| rouèle, sf. [rouelle]. petite roue. - (17) |
| rouelle de viâ, s.f. rouelle de veau. - (38) |
| rouelle : petite roue de charrue - (39) |
| rouelle, n.f. roue de charrue. - (65) |
| rouelle, ruelle. n. f. - Roue en fer d'une charrue. - (42) |
| rouelle, s. f. petite roue : les « rouelles », roues de charrue. S'emploie pour désigner tout l'avant-train. on prononce « roualle » dans une partie du Morvan. - (08) |
| rouelle, s. f., avant-train de la charrue ; rôti de veau avec le rognon. - (40) |
| rouellon. n. m. - Chapeau à large bord. - (42) |
| rouellon. s. m. Chapeau a larges bords qui, relevés forment des espèces de ruelles. (Puysaie). – On dit aussi rouelle, dans le même sens. - (10) |
| rouenne (n.f.) : grosse oseille sauvage des champs, rumex (aussi rouanne) - (50) |
| rouéte, rouote, s. f. brin flexible de saule, d'osier, de noisetier, de bouleau et d'autres bois encore, avec lequel on fait les liens pour les toitures en chaume et pour différents usages. - (08) |
| rouéter, v. a. battre avec une baguette, une verge, fustiger. (voir : rouâter, roucher.) - (08) |
| rouéter. v. - Fatiguer, épuiser. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| rouette - (39) |
| rouette (nom féminin) : tige végétale flexible (généralement du roseau) utilisée en guise de corde. - (47) |
| rouette : bagaguette. (LS. T IV) - Y - (25) |
| rouette : lien de bois. - (09) |
| rouette : lien fait de jeunes pousses d'arbres tortillées pour les assouplir. Baguette souple. - (52) |
| rouette : tige de bois vert flexible que l’on coupe sur place pour suppléer aux liens de paille de seigle lorsqu’on n’en a pas suffisamment prévu. - (37) |
| rouette : lien fait de jeunes pousses d'arbres tortillées pour les assouplir. - (33) |
| rouette :lien fait d'une jeune tige de noisetier tortillée et utilisée pour lier les fagots - (48) |
| rouette, branche flexible. - (04) |
| rouette. n. f. - Branche flexible, badine. - (42) |
| rouetter (rouotter) : frapper avec une branche flexible - (39) |
| rouetter (v. tr.) : garnir de fascines une tranchée, un puits - (64) |
| rouetter (verbe) : utiliser des rouettes. Frapper avec une rouette en guise de fouet ou de martinet. - (47) |
| rouetter : frapper avec une baguette, battre - (48) |
| rouettis. s. m. Perches entrelacées entre des piquets et formant barrage dans un ru. – Fascinage pour empêcher la chute des terres. (Sommecaise). - (10) |
| rouéze (adj.m. et f.) : rouge - (50) |
| rouèze : rouge - (39) |
| rouéze, rouize, adj. rouge. - (08) |
| rouèzer : remuer (la soupe). - (52) |
| rouézi (p.p.) : p.p. du verbe rougir - (50) |
| roufle, rôfle, s. m. écaille farineuse, excoriation de la peau. se dit par extension de la crasse qui se forme par plaque sur le visage à la suite d'une malpropreté prolongée. - (08) |
| rouflou, rôflou, ouse, adj. se dit des écailles farineuses que laissent certaines éruptions cutanées. - (08) |
| roûge (on en). exp. - On peine, on prend un coup de chaud, on devient rouge : « On en roûge avec le bouais, y'a trente stères à empiler ! » (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| rougeon : s. m., touffe d'herbe qui, dans un pâturage, est dédaignée par le bétail. - (20) |
| rougeon. Touffe d'herbe délaissée dans une prairie par les animaux. Morceau de betterave ou de tubercule rongé à demi. - (49) |
| rougeot, s. m. cuscute commune. - (08) |
| rougeot, s. m. mildiou de la vigne. - (40) |
| rouger (v. tr.) : mâchonner, sucer en triturant dans la bouche - (64) |
| rouger. Ronger : « rouger ses ongues ». - (49) |
| rougeurs (les), s. f., rougeolle : « La fiÿòte a les rougeurs ; pauv' chàte ! faut brament la soigner. » - (14) |
| rougi. Rougis, rougit, rougir. - (01) |
| rougie (n.f.) ; rougeoiment de l'horizon au soleil levant ou couchant - (50) |
| rougie : rougeole. - (33) |
| rougie : rougeur du soleil au couchant - (39) |
| rougie, n.f. rougeur du ciel. - (65) |
| rougner, v. rogner. - (38) |
| roui se dit du chanvre. Faire roui (rouir) le chanvre, c'est en mettre les tiges dans l'eau afin que, les filaments étant nettoyés, les substances molles et visqueuses se séparent facilement. Dans l'idiome breton, rouez (Le Gon.) signifie clair, transparent. - (02) |
| rouil : s. m., vx fr., rouille. Du rouil. - (20) |
| rouillasse Voir rampion. - (63) |
| rouillè : frapper ou pleuvoir fort - (46) |
| rouilleau. Battoir à battre le linge quand on le lave. Même étymologie que rouir, ruisseau ; la racine de tous ces mots qui ont trait à l'eau est ru, l'eau qui coule; Sanscrit sru, rouler. - (12) |
| rouilleau. n. m. - Rouleau. - (42) |
| rouillée : une volée - (46) |
| rouiller : frapper le linge avec un battoir, le rouilleu. (G. T II) - D - (25) |
| rouillère (n.f.) : blouse - (50) |
| roûillére : blouse de maquignon (noire) - (48) |
| rouillo, battoir de la laveuse. - (28) |
| rouïllö, s/77. battoir de laveuse. - (17) |
| rouillot : battoir de laveuse. - (09) |
| rouillot : le battoir avec lequel la lavandière battait le linge à laver sur sa planche, on dit également battouère - (46) |
| rouilpot. s. m. Synonyme dc battoir. Instrument à l'usage des blanchisseuses et des laveuses de lessive. (Auxerre). - (10) |
| rouin : ornière dans un chemin. (ALR. T II) - B - (25) |
| rouin : rein - (48) |
| rouin, s. m. regain. - (22) |
| rouin, s. m. regain. - (24) |
| rouin, s. m., regain. - (14) |
| rouin. Regain. - (03) |
| rouinchir : avoir les poumons encombrés, embarrassés, une respiration sifflante. - (33) |
| rouindze : oseille sauvage (rumex acetosa) (botanique) - (51) |
| rouindzi : ruminer - (51) |
| rouinger, roincher, ranger. v. - Mâcher, ruminer (au sens propre et au sens figuré) : « Entér’ temps, quand qu'son vente i' braîlle, l'rouinge un vieux bout d'pain trâlé. » (Jacques Martel, Ene rude attelée, p. 7) - (42) |
| rouinhne : rumex, grande oseille. A - B - (41) |
| rouin-ne. Patience ; plante poussant dans les prés et le long des rues. - (49) |
| rouins : ornières. (SS. T IV) - N - (25) |
| rouinte : rumex, grande oseille - (43) |
| rouinte n.f. Patience à feuilles crépues (rumex crispus), qui résiste à la faux. - (63) |
| rouinte, s .f. patience à haute tige qui pousse dans le foin. - (24) |
| rouinte, s. f. patience à haute tige qui pousse dans le foin. - (22) |
| rouir. : (Dial et pat.), placer du chanvre dans l'eau, pour faciliter la décortication des filaments. Il en résulte une décomposition qui rend l'eau toute rouge, ce qui a fait emprunter au latin le verbe rubescere dont le mot rouir est la dérivation naturelle. On lit roure dans une charte des franchises de Tart de1275. - (06) |
| rouïre : rouleau de foin avant chargement - (43) |
| rouissi, v, n. pleuvoir à verse. - (22) |
| rouizir, rougir - (36) |
| roujàyé, v. n. rougir d'émotion ; avoir des couleurs naturellement. - (22) |
| roùji, v. a. ronger. - (22) |
| roùji, v. a. ronger. - (24) |
| roûjie, sf. rougeole. Voir roujöle. - (17) |
| roujöle, sf. rougeole. - (17) |
| roûjon, s. m. ce qui reste d'un fruit, d'une tranche de pain mangés à moitié. - (22) |
| roùjon, s. m. ce qui reste d'un fruit, d'une tranche de pain mangés à moitié. - (24) |
| roulché, ée. adj. Imbibé d'eau. (Soucy). - (10) |
| roûle : rouleau pour passer sur les céréales - (39) |
| roule : s. m., gros andain de foin que l'on forme à l'aide des râteaux au moment de charger le char. On chargé en roule quand on est pressé ; autrement on charge en cuchon. Voir andain et cuchon. - (20) |
| roùlë, coups reçus et oeufs teints que l'on donne aux enfants, aux fêtes de Pâques, pour jouer a la roulë. Dans ce jeu, l'oeuf touché par un autre oeuf appartient au possesseur de l'oeuf qui l'a touché. - (16) |
| roûle, roue n.f. Rouleau de foin fait au râteau, andain. - (63) |
| roule. s. m. Partie sur laquelle un objet cylindrique est placé ou doit être placé pour rouler. Mettre des tonneaux de roule. - (10) |
| Rouleau. nom de bœuf et d'homme dans la contrée. - (08) |
| roulée (de Pâques). Œufs de Pâques, cadeaux qu'on se fait à l’époque de cette fête. Etym. L'origine de ce mot est probablement l’usage ou l’on est encore dans nos campagnes de jouer les œufs durs et teints qu'on se donne a Pâques, en les faisant rouler sur un plan incliné. - (12) |
| roulée : œufs recueillis en courant carnaval - (48) |
| roulée, rout'lée. n. f. - Tradition de Pâques : les œufs frais étaient quêtés par les enfants de chœur ainsi que le facteur, le jeudi saint. - (42) |
| roulée, s. f. œufs cuits au dur que l'on donne aux enfants dans la semaine de pâques et qu'ils s'amusent à faire rouler en aval le long d'une planche inclinée. - (08) |
| roulée. Provision d'œufs de Pâques. Mai marreune, i vins queri mai roulée. Ces œufs, donnés en cadeau aux enfants, étaient teints de diverses couleurs et cuits au dur. Ils servaient au jeu de la roulée qui se pratiquait le lundi de Pâques, sur la montagne de Beaune. Quand les œufs bardots étaient brisés à force de heurts et de roulades, on en faisait une salade fortement épicée, que l’on mangeait sur les tables de pierre, à côté de la magnifique source de l'Aigue. - (13) |
| roulées : œufs donnés en cadeau au moment de Pâques, ou aux rogations aux enfants de chœur ou au facteur. - (33) |
| rouler Carnaval : action des enfants qui se promènent pour chercher des œufs et de l'argent le jour du mardi-gras - (39) |
| roulette : s. f., ruban métrique enroulé dans un étui. - (20) |
| rouleûtte : petite largeur de pré entre une prairie importante et le côteau. (RDM. T IV) - C - (25) |
| roulie, sf. roulée, cadeau de Pâques d'un parrain ou d'une marraine, se composant d'œufs teints [à la pelure d'oignon ou à l'anémone pulsatille]. Le cadeau de pâques est qqf. désigné par cogneu (voir ce mot). Primitivement gâteau de noël, puis présent fait aux filleuls le jour de l'an, le cogneu désigne aujourd'hui un objet flatteur quelconque. - (17) |
| roulière : s. f., blouse non seulement du roulier mais encore du paysan. - (20) |
| rouliére, s. f. blouse des campagnards qu'on appelle aussi « blaude » ou « biaude. » (voir : blaude.) - (08) |
| roullière*, s. f. blouse. - (22) |
| roullière, s. f. blouse (du français « roulier », porteur de blouse). - (24) |
| roulon : barreau d'échelle, ou de chaise. Ex "Aga toun' échelle, n'y manque un roulon ! Té vas tomber." - (58) |
| roulon. n. m. - Barreau d'une échelle, d'une chaise. - (42) |
| roulon. s. m. Barreau d'une échelle, d'un tabouret, d'une chaise. (Puysaie). - (10) |
| roulôte, comme si l'on disait à présent ruellotte, petite rue. - (02) |
| roulôte. Nom d'une rue de Dijon qui n'est presque habitée que par de pauvres vignerons et autres gens de la lie du peuple. De ruelle, diminutif de rue, est venu le second diminutif ruellette, ou, selon la terminaison familière aux Dijonnais, ruellote, qu’ils ont prononcé ruellôte, et par corruption roulôte. - (01) |
| roulotte, petite rue. Dans l'idiome breton, ru, au pluriel ruiou, signifie chemin. (Voir Lep. et Le Gon. ).. - (02) |
| roumâne (lai) : (la) balance romaine - (37) |
| roume, roumigie. n. f. - Terre marécageuse. - (42) |
| roume, roumigie. s. f. Terrain mouvant, marécageux, d'où l’eau suinte sans cesse. (Grandchamp, Sommecaise). - (10) |
| roumer, roumiller. v. n. Ronfler en dormant. (Pasilly). - (10) |
| Roumié. nom de famille assez répandu dans le pays. - (08) |
| roumiller (verbe) : émettre des bruits de poitrine bronchiteuse. - (47) |
| rouôle : buse - (48) |
| rouôle : instrument pour retirer les braises du four - (48) |
| rouôle, n. masc. ; oiseau de proie qui plane en l'air. - (07) |
| rouôle, n. masc. ; râble (fer recourbé pour tirer la braise du four). - (07) |
| rouôler, v. ; tirer quelque chose avec le râble. - (07) |
| rouöt, sm. rouet. - (17) |
| rouotte : (rouot' - subst. f.) verge souple (en coudrier, en églantier ... ) dont on se sert pour lier un fagot. - (45) |
| roupane : n. f. Robe longue. - (53) |
| roupètes. s. f.pl. Ce qu'on appelle vulgairement les haricots du pape. (Sainte-Magnance). - (10) |
| roupille, s. f., roupie, goutte qui tombe du nez. - (14) |
| roupilloû, s. m., roupilleux, qui a la roupie au nez. Un bébé avait une telle aversion de son grand-père, un peu trop souvent roupilleux, qu'il se relirait avec effroi toutes les fois que celui-ci voulait l'embrasser. Pour ne pas se priver des caresses du p'tiot, le pauvre vieux cessa de priser. - (14) |
| rouploute, sf. petite blouse courte de taille. - (17) |
| rouquer. v. a. Coudoyer, heurter plus ou moins violemment. Il m'a rouqué en passant. (Perrigny-lès-Auxerre). - (10) |
| rouquille. n. f. - Petite quantité, petite goutte, une rincette : «Là d'sus on but l'café, pis un aut' arrosé d'marc, eune p'tite rouquille dans l'fond d'la tasse.» (Fernand Clas, p. 325) - (42) |
| rouscaîller : rouspéter - (48) |
| roûse (na) : rose - (57) |
| rousé : rosé - (51) |
| roùse, s. f. , rose : « T'é béll' coume eùn' roùse. » — Une large feuille de rose, disposée ad hoc, et qu'on a bien gonflée en soufflant dedans, produit la même explosion que la groseille à taperiau. - (14) |
| rousée (n.f.) : rosée - (50) |
| rousée : rosée - (43) |
| rousée : rosée - (51) |
| roûsée n.f. Rosée. - (63) |
| rousée, rosée. - (04) |
| rousée, s. f. rosée. « rouhée » - (08) |
| rousée, s. f., rosée : « Tendre coume rousée. » - (14) |
| rouseiller, v, intr., tomber sous forme de rosée : « A c'maitin, l’temps s'é couvri ; é peu v'là qu'i rouseille. » - (14) |
| rouseiller, v. n. se former en gouttes comme la rosée. S'emploie surtout pour désigner la sueur qui perle sur le visage. - (08) |
| roûsi (on) : rosier - (57) |
| roûsi : rosir - (57) |
| rousiau, s. m. roseau, jonc. - (08) |
| rousiau, s. m., roseau. - (14) |
| rousier, s. m., rosier. - (14) |
| rousière, s. f., roseraie, endroit planté de roseaux. - (14) |
| rouspétè : v. i. Rouspéter. - (53) |
| rousse (à — les chiens), se dit d'une pluie qui tombe en abondance au point de mouiller les chiens qui d'ordinaire ne la craignent pas. - (27) |
| rousse (na) : gardon - (57) |
| rousse : gardon rouge aux nageoires. - (62) |
| rousse : une bonne averse - (46) |
| rousse, averse. - (26) |
| rousse, petite pluie après laquelle le ciel s'éclaircit. En breton, roues ou rouez signifie clair, transparent ; et rouescat, s'éclaircir. - (02) |
| rousse, sf. forte averse. Voir raigaisse. - (17) |
| roussi, roussir ; santi l’roussi, sentir le roussi, c'est-à-dire l'odeur désagréable d'un vêtement légèrement atteint par le feu. - (16) |
| roussiâ : ruisseau. - (29) |
| rousso : l'abri de la pluie - è pleu, y vè m'mettre è lè rousso, il pleut, je vais me mettre à l'abri - (46) |
| rousso : quelque chose qui a commencé à brûler - (46) |
| rousso : un rouquin - (46) |
| rousso, roussotte, celui, celle qui a le teint roux, les cheveux roux et tout ce qui tire sur le roux. - (16) |
| rousso. Un peu roux. - (03) |
| roussœ, adj. jaune. Verbe : roussàyé, jaunir. - (22) |
| roussòt, adj., roux. Les paysans emploient fréquemment ce mot ; c'est un nom donné à leurs bœufs. Adressé à une personne, se prend en mauvaise part. - (14) |
| roussot, un peu roux. - (05) |
| roustaillée : n. f. Correction. - (53) |
| roustailler, v. a. frapper avec un fouet, une houssine, une cravache, etc… - (08) |
| rousti : adj. Raté. - (53) |
| rousti, adj., accablé, ruiné, fichu, mort : « O m'a gagné toutes mes gobilles ; j'seù rousti. » — « O rancâse, le pauv' ! ôl é rousti. » - (14) |
| rousti. Perdu, volé, attrapé. (Argot). - (49) |
| rout' : n. f. Route. - (53) |
| route, s. f. raie qui divise les cheveux de femme au milieu de la tête. - (08) |
| routée. s. f. Rangée. - (10) |
| routelotte, s. f. petite branche de bois tordue pour faire un lien servant à la couverture en chaume. Tout couvreur en paille doit être muni de « rouettes » ou « routelottes » et de perches. (voir : rouéte.) - (08) |
| roûti : rôti - (51) |
| roûti : rôti - (48) |
| routi : tartine - (34) |
| roûti : rôti - (39) |
| routi, rôti. - (04) |
| roûti, v. a. rôtir, griller, mettre sur le gril. - (08) |
| routi. Flétri, flasque, vidé. On dit aussi« quienchi ». - (49) |
| roûti. n. m.- Rôti. - (42) |
| routie : tartine. A - B - (41) |
| roûtie (n. f.) : mixture que l'on sert aux nouveau mariés le matin de la nuit de noces - (64) |
| roûtie (n.f.) : rôtie ; tartine de pain recouverte de beurre, de confiture... - (50) |
| routie : (nf) tartine - (35) |
| routie : tartine - (43) |
| roûtie : tartine - (51) |
| roûtie : tartine grillée avec beurre, saindoux, fromage (le piaulou, par exemple)… - (62) |
| roûtie : tartine, tranche de pain - (48) |
| routie : tartine. - (52) |
| routie : tartine. - (33) |
| roûtie n.f. Tranche de pain, tartine. - (63) |
| routie : petit repas servi dans un pot de chambre (appelé aussi : vase de nuit...selon le milieu !) que l'on apporte aux jeunes mariés le matin de la Nuit de Noce, alors qu'ils sont encore couchés. - (58) |
| roûtie, rôtie : n. f. Tartine. - (53) |
| routie, rotie. - (05) |
| routie, rotie. Tartine de beurre, de fromage, de confiture, etc. - (49) |
| roûtie, s. f. rôtie, tartine de pain sur laquelle on met ordinairement quelque friandise, beurre, crème, fromage ou confiture. - (08) |
| routie, tartine. - (28) |
| roûtie. n. f. - Vase de nuit rempli de vin blanc et de chocolat que l'on apportait aux jeunes mariés le matin de la nuit de noces. - (42) |
| routiers, s. m. on désigne sous ce nom les hommes employés aux travaux des chemins. (voir : route.) - (08) |
| roûtlée (n. f.) : quête faite par les enfants de chœur pendant la semaine sainte (ordinairement des oeufs) - (64) |
| routoir. s. m. Aigeoir. - (10) |
| roûtsi, roûchi v.1. Pleuvoir très fort. I roûtse. 2. Lancer en éparpillant. Roûtsi l'foin ou le fmî. 3. Rosser, rouer de coups. - (63) |
| rouvri : rouvrir - (57) |
| rouyaux, oiseaux - (36) |
| rouyer, s. m., roulier. Jadis, ce terme désignait spécialement les conducteurs de voitures de roulage. - (14) |
| roùyëre, blouse. - (16) |
| rouÿère, s. f., blouse solide, portée jadis par les rouliers. - (14) |
| rouyeu : battoir à linge. (REP T IV) - D - (25) |
| rouyon : n. m. Mauvaise rayure. - (53) |
| rouze (lai) : (la) rousse, (la) rouquine. appellation donnée à une femme (non péjoratif) à cheveux roux - (37) |
| rouze : (nf) rose - (35) |
| rouzée : (nf) rosée - (35) |
| röyasse, röyesse : enrouement - (35) |
| royasse, royesse, rouillasse Voir rampion. - (63) |
| royaume : plat mal cuisiné - (60) |
| royaumer. v. n. Parcourir les Etats, son royaume, chercher de l'ouvrage qu'on ne trouve pas, mendier de village en village, de porte en porte. - (10) |
| röyère : (nf) blouse de paysan - (35) |
| ro-yère : blouse de paysan - (43) |
| ro-yesse : enrouement - (43) |
| royon, s. m. bande de terre non labourée, lacune dans un labourage. (voyez roie, roinchon.) - (08) |
| rparti v. Repartir. - (63) |
| r'parti : v. i. Repartir. - (53) |
| r'passage (on) : repassage - (57) |
| rpassi v. Repasser. - (63) |
| rpaulî (v. int.) : rebondir - (64) |
| r'péchi : repêcher - (57) |
| rpennter (se) (v. pr.) : s'améliorer, en parlant d'un aliment - (64) |
| r'pentant (on) : repentant - (57) |
| r'pèrer : curer (une mare) - (57) |
| r'peurnè : v. t. Reprendre. - (53) |
| rpeutassé, vt. réparer, raccommoder. - (17) |
| r'plaicé : v. t. Replacer. - (53) |
| r'pôher, v. a. reposer, poser une fois de plus. - (08) |
| r'pôser : reposer - (48) |
| rpouser v. Reposer. - (63) |
| rpran : s. m. farine mêlée de son. - (21) |
| rprendre : reprendre - (51) |
| rprin n.m. (du lat. primum, premier). Farine bise obtenue au 1er blutage. - (63) |
| rprinse, sf. reprise. - (17) |
| rprotse n.m. Reproche. - (63) |
| rprotsi v. Reprocher. - (63) |
| rpruche, sm. reproche. - (17) |
| rpruché, vt. reprocher. - (17) |
| rpyanter v. Replanter. - (63) |
| rpyat n.m. Replat, lieu plat, plateau. - (63) |
| rpyier v. Replier. - (63) |
| r'quemencer, v. recommencer. - (38) |
| r'quête (na) - r'quéte : requête - (57) |
| r'queuler : reculer - (48) |
| rquilli (se) v. Se requinquer, se faire beau. - (63) |
| r'quillou : mot masculin désignant une épuisette - (46) |
| r'quillou : un ramasseur de quilles - (46) |
| r'quin (on) : requin - (57) |
| r'quinquè : v. t. Requinquer. - (53) |
| rrr onom. En arrière ! (ordre donné au cheval). - (63) |
| rrrrr (roulé) : interjection pour commander le recul du cheval. On dit aussi Rrrrrié... et aussi, pour hâter le mouvement de la bête : Rrrrrié-don ! - (58) |
| rsâré, vt. resserrer. - (17) |
| r'sarrement (on) : resserrement - (57) |
| r'semaler : ressemeler - (57) |
| rsembier, rsanné, vt. ressembler. - (17) |
| r'semb'illance (na) : ressemblance - (57) |
| r'semb'iller : ressembler - (57) |
| r'sentre : ressentir - (57) |
| r'seter : rasseoir - (57) |
| r'sicler, r'siquer. v. - Remplacer, remettre une essique, éclisse de bois utilisée pour la fabrication des paniers d'osier. - (42) |
| rsiper : rogner. A - B - (41) |
| rsiper : couper - (44) |
| rsiper : rogner - (34) |
| r'son, hérisson. - (26) |
| r'sopè : couper les herbes ou les restes de souches - (46) |
| r'soper : retailler - (48) |
| rsopper (v. tr.) : attraper au vol - (64) |
| r'sopper, r'souper. v. - Recéper, couper un arbre au ras du sol. Autre sens : châtier, corriger, remettre dans le droit chemin : « Espèce de grande armelle ! T'aurais pu aussi bien bréger ma robe ! Reviens m'inviter, je te resouperai. » (Colette, Claudine à l'école, p.l68). Souper remonte au verbe choper ou saper, dont l'origine est incertaine et le sens probablement onomatopéique sous l' influence de « choquer ». On trouve choper au XIIe siècle, dans le sens de heurter, buter, trébucher. (Il reste aujourd'hui l'expression« pierre d'achoppement», issue de cette signification)... - (42) |
| r'sôrt (on) : ressort - (57) |
| r'sortissant (on) : ressortissant - (57) |
| r'source (na) : ressource - (57) |
| rsson, sm. [hérisson]. graines rondes armées d'aspérités piquantes, fournies par le nettoyage des céréales. Voir eurson. - (17) |
| r'tâd (on) : retard - (57) |
| rtadié, vn. retarder. - (17) |
| r'tardataire (on) : retardataire - (57) |
| rtarder : retarder - (51) |
| r'tarrer - rentarrer : butter (la terre) - (57) |
| rtaulon : repousse sur une souche fraîchement coupée - (34) |
| r'tcheu : recuit - (57) |
| r'tcheuler : reculer - (57) |
| r'tcheulons (à) : reculons (à) - (57) |
| r'tendre : se faire avoir - tu t'é fait r'tendre, tu t'es fait avoir - (46) |
| r'teni, v. a. retenir, tenir une seconde fois pour raccommoder, pour améliorer, pour embellir. - (08) |
| rtenin, vt. retenir. - (17) |
| r'tenti : retentir - (57) |
| r'tenue (na) : retenue - (57) |
| r'tiemper. v. - Se changer, s'habiller correctement. (Sougères-En-Puisaye) - (42) |
| r'timpis (nom masculin) : soutien-gorge. - (47) |
| rtinton n.m. Repas huit jours après une fête ou une noce. Voir rnoçon. - (63) |
| r'tinton, r'gingot. Retour de noces. Festin donné le dimanche qui suit la noce, aux proches parents qui n'ont pas pu assister au mariage. - (49) |
| r'tinton: (nm) retour de fête (8 jours plus tard) - (35) |
| r'tires (les) : litière sale (des vaches) - (57) |
| rtni v. Retenir. - (63) |
| r't'ni. v. - Retenir. - (42) |
| r'to (on) : retour - (57) |
| rtôler v. Repousser plus dru, plus touffu. - (63) |
| rtôlon : repousse sur une souche fraîchement coupée. A - B - (41) |
| r'tombée (na) : retombée - (57) |
| r'torne : raie courte pour terminer le labour dans un champ en pointe - (48) |
| r'torné : v. t. Retourner. - (53) |
| r'torner - r'veûilli : retourner (mettre en désordre) - (57) |
| r'torner : retourner - (48) |
| rtotsi v. Retoucher. - (63) |
| r'touche (na) : retouche - (57) |
| r'touchi : retoucher - (57) |
| r'trait (on) : retrait - (57) |
| r'traite (na) : retraite - (57) |
| r'traité (on) : retraité - (57) |
| r'traite : n. m. Retraite. - (53) |
| r'traitè : n. m. Retraité. - (53) |
| r'transmission (na) : retransmission - (57) |
| rtreupi v. Repousser en partant du pied pour un végétal ; on dit aussi treupi. - (63) |
| rtrossi v. Retrousser. - (63) |
| r'trouè : v. t. Retrouver. - (53) |
| rtrouver : retrouver - (51) |
| rtsâgni adj. Grincheux, de mauvaise humeur. - (63) |
| rtsâgni v. 1. Maugréer 2. Imiter en exagérant. - (63) |
| rtsardzi v. Recharger. - (63) |
| rtségni : de mauvaise humeur (rechigner). Se moquer d'une personne en imitant ses grimaces. A - B - (41) |
| rtsègni : de mauvaise humeur - (34) |
| rtseugne-tsat : petite peau au coin de l'ongle qui devient douloureuse si on l'accroche - (51) |
| rtseugni v. Imiter en exagérant. - (63) |
| rû : petit ruisseau - (37) |
| rû : ruisseau. - (09) |
| ru p.p. du verbe rawoi. On disait aussi réaiju. - (63) |
| ru, s. m. ruisseau, et par extension tout lieu où on peut laver le linge. (voir : reu.) - (08) |
| rû, s. m., ruisseau. - (40) |
| ru, sm. ruisseau. - (17) |
| rualle deû lit : petit espace entre le « lit de coin » et le mur, où l’on se glisse après avoir un peu tiré le lit pour le refaire - (37) |
| ruante : plante sauvage qui pousse au printemps (feuilles très larges, avec tiges hautes et dures quand elles montent en graines) - (39) |
| ruârte (na) : lien en bois tendre - (57) |
| rûche, petit panier dans lequel on fait lever le pain (ne pas confondre la rûche avec la reûche à abeilles) ; la rûche est un parallèle de bruchon. - (16) |
| ruchô. Roquet de vigneron, espèce de juste-au-corps de grosse toile, étroit et serré d'une ceinture sur les reins. - (01) |
| ruchô. : Sorte de blouse courte, en grosse toile, dont s'affublaient les vignerons. Elle était tellement d'uniforme qu'on appelait ruchô un vigneron. - (06) |
| rude, grand, important ; ein rude sarvice, un grand service rendu. - (16) |
| rudéÿer, v. tr., rudoyer : « All' ne pourra pas rester d'avou lu ; ô n'fait que d'la rudéÿer. » - (14) |
| rudje, adj. rude. - (17) |
| rud'man, très, beaucoup ; s'â rud'man bon, c'est très bon. Parfois rud'inan est remplacé par rude, comme dans ces mots : trévoéyé rude, travailler rude, pour rudement. - (16) |
| rudôger, v. a. rudoyer, malmener, maltraiter. (voir : reudéyer.) - (08) |
| rue : chemin. Chemin d'exploitation. Ex : "J'passons toujours par la rue Creue pour monter su' Chamery." La rue Creuse, ainsi dénommée à cause de sa pente raidissime sur la fin (ou le début, c'est selon) de son parcours. En descente, sa pente peut être assimilée à un creux de terrain important. On prononce : creueeee. - (58) |
| rue, ruhé. adj. Rusé. J'seus pas si rüé que z'eux. (Tronohoy). - (10) |
| rue, s. f. chemin en général, les alentours d'une habitation, cour de maison. - (08) |
| ruée (n.f.) : chemin bardé de haies - (50) |
| ruée : chemin creux - (48) |
| ruée : petit chemin creux entre deux haies vives - (37) |
| ruées d’lai ville (en lâs) : (dans les) rues de château-chinon - (37) |
| rueilla : battoir à laver. (F. T IV) - Y - (25) |
| ruelle (n. f.) : roue de charrue - (64) |
| ruelle : espace compris entre lit et mur. Le lit était souvent ouvragé d'un côté et sommaire sans fioriture de l'autre. De façon moderne, on parlerait de lit de coin, par opposition à un lit de milieu, esthétique des deux côtés. Ex : "J'vons changer le lit, té vas m'ainder, passe don dans la ruelle." - (58) |
| ruelle, s. f. chemin étroit bordé de haies vives et en conséquence très ombragé. - (08) |
| ruette (n. f.) : ruelle du lit - (64) |
| ruette (n.f.) : espace entre le lit et le mur - (50) |
| ruette : (nf) ruelle du lit - (35) |
| ruette : s. f., vx fr., ruelle. - (20) |
| ruever. : (Dial.) Ce mot, qui est l'analogue de rouver a pour racine le verbe latin rogare et signifie demander avec prière. (S. B.) - (06) |
| ruf. adj. - Rude, dur, pas commode (Mézilles, selon H. Chéry). Autre sens: vif, agile. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| ruge-boge. Rouge-gorge. - (03) |
| rugeotter, v. rosir, rougeoyer. - (38) |
| rugné : très fatigué. (M. T III) - D - (25) |
| ruis. : (Du latin rus), impôt sur les vassaux des campagnes, en diverses occurrences. - (06) |
| ruje, rouge ; ruji, rougir ; é ruji, il a honte. - (16) |
| rûlle (na) : lange - (57) |
| rullô, en Champagne rouillot, battoir de lessive. A Châtillon on dit un tapoir... - (02) |
| rullô. Battoir de lavandière… - (01) |
| rûncher : éructer sourdement - (37) |
| rûnchon, rancot : rhume, enrouement - (37) |
| runchöt, ronchet, sm. barre verticale soutenant les ridelles d'une charrette à moisson. - (17) |
| rundzi v. (du lat. rumigare, ruminer) Ruminer, mâcher. - (63) |
| rûne : Ruine. « Sa maijan est en rûnes ». « In butin en runes » : une propriété inculte. - (19) |
| runement. : (Dial.), murmure. M. Burguy cite comme étymologie le mot rûnen de l'ancien haut allemand et ayant le sens du latin susurrare. - (06) |
| rûner : Ruiner. « Ces gens sant rûnés ». « In c'eu rûné » : un corps ruiné, épuisé par excès de travail ou de privations. - (19) |
| rungé, vn, [vx t. ronger]. ruminer (se dit des bêtes à cornes). - (17) |
| rungé, vt. ronger. Voir rôché. - (17) |
| rungne (ün), sf. ruine. - (17) |
| rungné, vt. ruiner. - (17) |
| runme, sm. rhume. - (17) |
| ruôte, s. f., ruelle, petite rue, sentier entre murs ou haies. Également la ruelle du lit. - (14) |
| russhaler, pisser. - (05) |
| russiau, s. m., ruisseau, petit cours d'eau. - (14) |
| russiau. n. m. - Ruisseau. - (42) |
| russiau. Ruisseau. - (49) |
| rutchia (na) : tartine - (57) |
| rvain, sm. regain de prairie naturelle. Deuxième coupe. - (17) |
| r'vaînche (na) : revanche - (57) |
| r'valle (m) : racloir avec lequel on enlevait les braises de la sole du four avant d'enfourner le pain. (CST. T II) - D - (25) |
| r'valorisation (na) : revalorisation - (57) |
| r'vamer, repousser. - (26) |
| r'vanchâd (on) : revanchard - (57) |
| r'vari. Charivari. - (49) |
| r'varpai (se) : se reprendre, se ressaisir. Ol s'o r'varpai : il s'est défendu. Se retourner contre, réagir. On se r'varpot quand on est contredit : on réagit quand on est contredit. - (33) |
| r'varpè (s') : 1 v. pr. Se rebeller. - 2 v. pr. Se reprendre. - (53) |
| rvarpé (se), vr. se retourner pour prendre l'offensive ; se redresser pour attaquer. Se révolter - (17) |
| rvarper (se) v. (de veurpi, vipère). Se révolter, se rebiffer. - (63) |
| r'varper (se), verbe pronominal : se redresser brusquement. - (54) |
| r'varper, ervarper (se). Se rebiffer ; résister avec arrogance ; se défendre. - (49) |
| r'varper, regimber. - (26) |
| r'venance, s. f. foisonnement. la chaux maigre n'a pas de « r'venance ». - (08) |
| r'vendicâtion (na) : revendication - (57) |
| r'vendou (on) : revendeur - (57) |
| r'venger (se). Se venger ; se défendre. - (49) |
| r'veni - r'vegni - renv'ni - s'en r'torner : revenir - (57) |
| rveni : revenir - (51) |
| r'veni : revenir - (48) |
| r'veniant (on) : revenant - (57) |
| rvenin, vn. revenir, pp. rvenun. - (17) |
| r'vente (na) : revente - (57) |
| r'venu (on) : revenu - (57) |
| r'verper (se) : ressaisir (se), se retourner contre quelqu'un, se défendre - (48) |
| r'vêtement (on) : revêtement - (57) |
| r'veuiller : remuer la terre sans méthode. (RDV. T III) - A - (25) |
| r'veuiller : chercher en remuant. (A. T II) - D - (25) |
| rveuilli : remuer la terre avec le groin, en parlant du porc ou du sanglier. A - B - (41) |
| rveuilli : remuer la terre avec le groin - (43) |
| rveuilli : remuer la terre avec le groin, en parlant du porc ou du sanglier - (34) |
| rveuilli v. (du lat. pop. revolvicare, retourner). Remuer, retourner. - (63) |
| rveuillon n.m. Désordre, grand ménage. - (63) |
| r'veun : n. m. Retour. - (53) |
| r'veuniotte : mot féminin désignant un rétro fait par une bille - (46) |
| r'veurdi - r'veurdailli : reverdir - (57) |
| r'veurper (se) : défendre (se) - (57) |
| rveurper (se) : rebiffer (se) - (51) |
| r'veurper (se) : rebiffer (se) - (57) |
| r'veurper (se) : révolter (se) - (57) |
| r'veursement (on) : reversement - (57) |
| rvinmi (ïn), vn. repousser après la première végétation, et avant la coupe. (Se dit des avoines desséchées par la chaleur et que les pluies font repousser du pied.) - (17) |
| r'vire (na) : rivière - (57) |
| rvîre n.f. Rivière. Ô trouerot point d'iau dans la rvire. - (63) |
| r'viri (se) : retourner (se) - (57) |
| rviri (se) v. Répliquer vertement, se retourner, se rebiffer. - (63) |
| r'vir'ment (on) : revirement - (57) |
| rvive (n. m.) : regain (faucher du rvive) - (64) |
| rvoché (adj.) : dont la pointe est tordue, en parlant d'une aiguille par exemple - (64) |
| rvoché, vt. [revercher]. Retourner en tous sens, fouiller. Mettre en désordre. - (17) |
| r'voillotte : mot féminin signifiant au revoir, à bientôt aussi - ai lè r'voillure - (46) |
| rvôle, rvoûle n.f. (du lat. revolvere, retourner en arrière). Fête de fin de moissons, de fin de travaux en général. - (63) |
| rvolles : s. f. pl. fêtes après les gros travaux. - (21) |
| r'vorchè : culbuter, retourner salement la terre ou autre chose comme une voiture, une personne - èl é teut r'vorchè dans lè tirouê, il a laissé le tiroir en désordre - (46) |
| r'vorcher : fouiller la terre en profondeur, de place en place, comme le font les sangliers. (RDV. T III) - A - (25) |
| r'vosson (ai lai). a rebours. - (08) |
| r'vouair : v. t. Revoir. - (53) |
| r'vouèilleure (ai lai) : revoir (à se), au revoir - (48) |
| r'vouère. v. - Revoir. - (42) |
| r'vouse : congère - (48) |
| r'vouses, amoncellements de neige - (36) |
| r'voyue, r'voyure, r'voisire (à la). exp. - Au revoir, à bientôt. - (42) |
| r'vue (na) : revue - (57) |
| rwoî (à) loc. Au revoir. - (63) |
| rwoî v. Revoir. - (63) |
| rwoyeûre n.f. Revoyure. - (63) |
| ryiens : regains. Deuxième récolte du foin en fin de saison estivale. Ex : "Lundi, j'coumence mes ryiens." - (58) |
| ryon : s. m. petit chemin dans les bois. - (21) |
| ryote. : (Du latin ruere), querelle. Escheur ryote signifie éviter une querelle. (Priviléges de Rouvres, 1357.) - (06) |
| r'zau, s. m. ressaut, secousse, cahot. - (08) |
| r'zillé : être mal coiffé, avoir les cheveux emmêlés - (46) |
| r'zillè : feuille séchée à moitié et frisée sur les bords - (46) |
| s (faire des) loc., tituber, aller de droite et de gauche par suite de trop copieuses libations. Encore une locution assez répandue, et que nous conservons néanmoins comme bien nôtre. - (14) |
| s' : pron. pers. Se. - (53) |
| s’acouater, à la coi, à coi : se mettre à l'abri de la pluie - (43) |
| s’au. Locution. C'est. S’au li, c'est lui. S’au cè, c'est ça. (Etivey). - (10) |
| s’cheurter, s’chiter : s’assoir. - (59) |
| s’coûre, secouer. - (16) |
| s’coutsi à la r'tsaude : se coucher dans un lit non fait - (43) |
| s’cöyou : (nm) panier à salade - (35) |
| s’en d’vant d’ri : sens devant derrière - (43) |
| s’main-ne, s. f., semaine. - (14) |
| s’male, semelle. - (16) |
| s’mantire : (nm) cimetière - (35) |
| s’mâye, temps de semer. - (16) |
| s’mènne (prononcer : s’min-ne), semaine. - (16) |
| s’métire, s’mentire : cimetière - (43) |
| s’mouille (d’lai) : (de la) semoule - (37) |
| s’rési, s’risi : cerisier - (43) |
| s’t’hon’ré-lâs-bains : saint honoré-les-bains - (37) |
| s’ter : (vb) (en parlant des abeilles) essaimer - (35) |
| s’tu, s’teulle : celui-là, celle-là - (43) |
| s’vëre, civière. - (16) |
| s’vire : (nf) brouette - (35) |
| sa : (nf) soif - (35) |
| sâ : (nm) soir - (35) |
| sâ : Faucher. « I faut sâ à la rosée » : il faut faucher pendant qu'il y a de la rosée. - (19) |
| sa : Sac. « In sa de tapines » : un sac de pommes de terre. « In sa de lunet », voir ce mot. - (19) |
| sa : soi - (51) |
| sa : Soi. « Chéquin pa sa » : chacun pour soi. « In ptiet chez sa vaut mieu qu’in grand chez les autres ». - (19) |
| sa : Soif « Bois in co, t'as sa » : bois un coup, tu as soif. - (19) |
| sa : soif, soir, sac - (43) |
| sa : Soir. « O traveille du métin au sa » : il travaille du matin au soir. - Ouest. « Le poulot regarde en sa » : le coq du clocher regarde l'Ouest. - (19) |
| sâ n.f. Soif. - (63) |
| sa n.m. Soir. Ch'tu sa, Nina ! - (63) |
| sa : sac - (39) |
| sa(r)clot, subst. masculin : sarcloir. - (54) |
| sâ, s. m. tamis de crin ou de soie dans lequel on passe la farine et autres matières pulvérulentes. - (08) |
| sâ, s. m., sac, au propre et au figuré : « J'li ai baillé ein sâ d'poumes de tare. » — « T'as métu moun afâre dans l’sâ. » N'empêche pas sac. - (14) |
| sà, s. m., sas, tamis de crin : « Por fâre ses corniotes, alle a passé sa fleur au sà. » - (14) |
| sa, s.m. la genne contenue dans le pressoir ; un sa de genne ; couper les oreilles du lapin : couper le "sa" avec la doloire. - (38) |
| sa, s.m. sac. - (38) |
| sa, sac. - (05) |
| sa, sept. - (38) |
| sa, seuche : adj. sec, sèche. - (21) |
| sâ, tamis. - (16) |
| saba, grand bruit, vacarme ; s'â ein saba d'anfer ! - (16) |
| sabat, adj., qualification donnée à un enfant turbulent et dont le bruit fatigue : « V'là eùne heûre que t'tapages autor de moué ; taise-te donc, sabat ! » - (14) |
| sabat, s. m., bruit, tapage : « V'tu ben n'pas faire tant d’sabat, ch'ti p'tiot ; t'm'essourdilles les orilles. » - (14) |
| sabater : Secouer. « Na sabate dan pas tant ce pané te vas casser ce qui a dedans ». - (19) |
| sabattage. n. m. - Cerclage métallique d'une ancienne roue de tombereau, utilisé dans les champs pour niveler les taupinières ; le sabattage, posé à plat, était tiré par un cheval. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| sabernot (pour sabrenaud). s. m. Ouvrier maladroit, qui travaille malproprement, grossièrement, comme à coups de sabre. (Laduz). - (10) |
| sabeu : sabot. - (29) |
| sabeut : Sabot. « Quand l'ovrage presse i ne faut pas mentre les deux pids dans le mouême sabeut » : quand le travail presse il ne faut pas mettre les deux pieds dans le même sabot, il ne faut pas être entravé. « Alle dit qu'alle a envie d'entrer au couvent. - Oué ! au couvent de Saint-Denis, quat'sabeuts seu le lit! ». - (19) |
| sabeuté : Sabotier. « La boutique du sabeuté ». - (19) |
| sabeuter : Faire du bruit en marchant avec des sabots. - (19) |
| sabin. Sciure de bois. - (03) |
| sabiöre, sf. sablière. - (17) |
| sabiot (nom masculin) : sabot. On dit aussi saibot ou saibiot. - (47) |
| sabiot. n. m. - Sabot. - (42) |
| sabje, sm. sable. - (17) |
| sablioniére : Carrière de sable. « La sablionnére de Drefy » : carrière de sable rouge située dans le bois de Montmacon. - (19) |
| sablioux : Sableux. « In tarrain sablioux ». - (19) |
| sab'lle : Sable. « In tamb 'riau de sab'lle ». « Avoi du sab'lle dans les yeux » : avoir sommeil, quand il est l'heure d'aller au lit on dit aux enfants : « Allez vos couchi le ptiet homme a passé o vos a jeté du sab'lie dans les yeux ». Cette légende de l'homme au sable est répandue un peu partout. - (19) |
| sabot godot : (nm) sabot tout en bois et sans bride - (35) |
| sabot godot : sabot entièrement en bois - (43) |
| sabot-dzaune n.m. Sabot du dimanche. - (63) |
| sabotée : distance parcourue rapidement, généralement peu longue. Voir : coup d'galop. Ex : "J'y vas, d'ène sabotée paryé !" - (58) |
| saboteil : un sabotier - (46) |
| sabot-godot n.m. Sabot simple, tout en bois. - (63) |
| saboti (on) : sabotier - (57) |
| saboti : sabotier - (51) |
| sabotî n.m. Sabotier. - (63) |
| sabots motos : des sabots tout en bois, sans brides. - (33) |
| saboulé, secouer, malmener. - (16) |
| sabouler - (Voir plus loin tabouler). - (15) |
| sabouler : abîmer, piétiner, mettre sens dessus-dessous. Ex : "Té vas pas v'ni sabouler nout' ouvrage, d'abôrd !" - (58) |
| sabouler, et sabouter, v. tr., mal faire sa besogne : « Ah ! y ét eùne pauv' coudeuse ; all' vous saboule toute son ôvrage. » - (14) |
| sabouler, secouer, frapper. - (05) |
| sabouler, v. tr., gronder, secouer, troubler, réprimander vertement, rosser : « T'as pas été à l'écôle aujord'heù ; gare! ta mère va t’sabouler. » - (14) |
| sabouler. Secouer, vieux mot. - (03) |
| sabouler. v. - Malmener, rudoyer. Le dialecte poyaudin a conservé ce mot en voie d'extinction dans le français du XXe siècle. Terme d'origine complexe (croisement probable entre saboter, secouer et bouler), sabouler est un verbe récent (XVIe siècle) signifiant malmener, houspiller, voire se bagarrer. - (42) |
| sâbre, s. m. sable, arène. - (08) |
| sabye : sable. (B. T IV) - D - (25) |
| sâbye n.m. Sable. - (63) |
| sabye, sable. - (26) |
| sac de fornée n.m. Sac étroit et allongé, à mailles finescontenant la farine ou le blé (capacité 70 à 80 kg). - (63) |
| sac de vin, ce qu'un pressoir peut contenir de raisins. - (16) |
| saca : (nm) petite quantité - (35) |
| saca : petite quantité - (43) |
| sac-à-diâbe, loc., injurieuse, sac-à-diable, vaurien, étourdi, qui brave et saccage tout. - (14) |
| sacaige, s. m. masse, quantité. - (08) |
| sacar. On appelle à Dijon sacards ces gens qui, en temps de peste, enterrent les corps des pestiférés, et qui, dans cette occasion, volent tout ce qu'ils trouvent sous leur main dans les maisons des malades. On entend par ce mot tous coquins, pendards, gens de néant et, comme on dit, de sac et de corde… - (01) |
| saccaigi : Saccager. « La grale a saccaigi neutés vignes ». - (19) |
| saccouter, saccoter. v. a. Secouer par petites saccades. (Perrigny-lès-Auxerre). - (10) |
| sacener, v. a. indique une démonstration de doute ou de dédain. On dit surtout « sacener » les épaules, c’est-a-dire les soulever par saccade en signe de désapprobation méprisante. (voir : sacquer.) - (08) |
| sache (na) : sac (pour le grain) - (57) |
| sache : Sèche. Féminin de so. « Des cherijes saches ». - (19) |
| sache : s, f., sac en toile de moindre contenance que le grand sac de cent kilos. Une sache de farine. - (20) |
| sach'e : s. m. cercle. - (21) |
| sache, s. f. sac à grains. Verbe ensachi, mettre en sacs ; tasser comme dans un sac. - (24) |
| sache, s. f., grand sac : « J'li porte eùne sache de joulis calas. All' s'ra contente. » - (14) |
| sachée : s, f., contenance d'une sache. Une sachée de noix. - (20) |
| sachée, s. f., contenu d'un sac. - (14) |
| sachi : Sécher. « Mentre sachi du linge ». - (19) |
| sachi v. Sarcler. - (63) |
| sachlle, s. m. cercle de fût. - (22) |
| sachlle, s. m. cercle de fût. - (24) |
| sachot, et séchot, s. m., sachet, petit sac. - (14) |
| sachot. Petit sac - (49) |
| sach'yé : v. sarcler. - (21) |
| saçhyi : (vb) sarcler - (35) |
| saciau, sarciau. s. m. Petite serpe. Du latin ascia. - (10) |
| sacier, s. m. un gros « sacier » est un individu qui a de l'embonpoint et dont le corps à force d'être gros a la forme d'un sac. sacouter, saicouter, v. n. parler bas, chuchotter : « quioque teu saicoute don ilai », qu'est-ce que tu chuchottes donc là ? (voir : acouter, oscouer, sombrer.) - (08) |
| saciot. n. m. - Petite serpette dont se servaient les vendangeurs. - (42) |
| sâcler, v. a., sarcler : « Ol ét hébile à sâlcler son champ. » - (14) |
| saclerot: binette. - (31) |
| saclier : Cercler. « Eune tonne sacliée en fé » : une tonne cerclée de fer. - (19) |
| sac'lle : Cercle. « In sac'lle de tonneau ». Devinette : « Qu'est-ce que lâ mieux in tonneau qu'in saclle ? ». Réponse : « Deux sac'lles ». - (19) |
| saclo. Sarcloir, du vieux mot sacleau. - (03) |
| sâclon (n. m.) : sarcloir - (64) |
| saclot : sarcloir. (CH. T II) - S&L - (25) |
| sâclot, s. m., sarcloir. A un jardinier qu'on trouvait au cabaret un camarade disait : « Eh ben! y et iqui qu'te serches ton sâclot ? » — On entend parfois : sâclote. - (14) |
| saclot, sarcloir, fessou. V. baisselon. - (05) |
| sàcloû, s. m., sarcleur. - (14) |
| sacœ, s. f. chose : une brave sacœ (par dérision). Quantité : donnez-m'en une pet’iète (petite) sacò. - (22) |
| saconnette (vieille) ! : injure échangée entre femmes en colère. (MLB. T III) - S&L - (25) |
| sacouterie, saicouterie, s. f. conversation à voix basse, propos murmurés à l'oreille, chuchottement. - (08) |
| sacoutou, ouse, adj. celui qui parle bas, qui chuchotte. par extension, « sacoutouse » se dit d'une commère qui bavarde discrètement et prudemment en médisant de son prochain. - (08) |
| sacquée. s. f. Sachée, la contenance d'un sac. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| sacquer : v. a., vx fr. sachier, jeter, secouer, maltraiter. - (20) |
| sacquer, saiquer, v. a. mettre avec force, jeter, pousser sur, enfermer : « sacquer » du foin dans un fenil, « sacquer » des pommes de terre dans un « crô », « sacquer » un homme en prison, etc. - (08) |
| sacquer. v. a. Secouer violemment. - (10) |
| sacquet. s. m. Saccade, heurt, cahot subit. (Soucy). - (10) |
| sacripiant n.m. (du fr. sacripant). Vaurien. Sade adj. Savoureux, doux. Très souvent employé dans le sens contraire : sans goût, fade. Voir assadi. - (63) |
| sacristaine : s. f., sacristine. - (20) |
| sacristain-ne : Sacristine - (19) |
| sade : Savoureux, agréable au goût, sucré. « Les raijins sant bien sades, le vin sera ban ». - (19) |
| sade : adj., vx fr., savoureux, doux, agréable au goût. - (20) |
| sade*, adj. sucré. - (22) |
| safre. adj. - Plusieurs usages : 1. Glouton, gourmand. 2. Fade, sans saveur, en parlant d'un plat. 3. Sec. 4. Qui s'effrite, qui ne se tient pas, en parlant de la terre (Sougères-en-Puisaye). Le premier sens de cet adjectif.est directement hérité de l'ancien français du XIIIe siècle : safre, mot d'origine obscure, signifiait alors glouton ou adonné au plaisir, voluptueux. Les autres sens contenus dans le mot poyaudin, à connotation plus négative, pourraient être un affaiblissement progressif.de la signification première. - (42) |
| safre. adj. Goulu, glouton, gourmand. Chien safre. Enfant safre. – Se dit aussi des farineux, et généralement de toute chose qui absorbe beaucoup d'eau en cuisant. La pomme de terre est safre. – A Villeneuve-les-Genêts, s'entend d'un mets desséché pour être resté trop longtemps sur le feu, et qui, par suite, n'a plus ni suc ni saveur. – A Mige, signifie sec. - (10) |
| sâga, s. f. femme sans ordre, sans économie, sans esprit de conduite : « çô eune saga, tô trâne dan sai maion. » - (08) |
| sagaïe, sacaïe : s. f., bas-lat, saga, historiette, babiole, brimborion. - (20) |
| sagané : serré, comprimé (dans une voiture par ex.) - (61) |
| sage : Pieux, dévot. « Y est du mande sage, i vant bien à la masse » : ce sont des gens dévots, des pratiquants. En parlant des enfants, obéissant, tranquille : « Ol est sage c'ment eune image ». - (19) |
| sageon. s. f. Saison (Domecy-sur-le-Vault). - (10) |
| sagnat, sagnet : s. m, vx fr. sagne, verger, marais. - (20) |
| sâgne : chêne. - (52) |
| sagné : enclos à porcs - (43) |
| sagné : petit enclos à côté des bâtiments d'exploitations où l'on met les cochons en champs - (51) |
| sâgne : chêne - (39) |
| sagne, n.f. petit terrain, enclos proche de la maison où l'on enferme les poules. - (65) |
| sagne, sagné : (nf.nm) enclos à porcs - (35) |
| sagnette (na) : gerçure (petite) - (57) |
| sagneute : achillée millefeuille (espèce médicinale servant à la confection de remèdes) - (43) |
| sagni : (vb) saigner - (35) |
| sagni : saigner - (43) |
| sagni : saigner - (51) |
| sagni : saigner - (57) |
| sagn'ment (on) : saignement - (57) |
| sagnou (on) : saigneur - (57) |
| sagoin : travailler salement - (44) |
| sagouillè : salir - (46) |
| sagouiller, et sagoiller, v. tr., secouer, remuer, barboter dans l'eau sale, mal laver le linge. Par extension s'applique parfois à d'autres besognes mal faites : « All' sagoille joliment sa lissive ! » - (14) |
| sagouillon : sale - (44) |
| sagouillon, et sagoillon, adj., souillon, personne malpropre, qui fait du pauvre ouvrage. - (14) |
| sagouillou : un sagouin, une personne sale, qui salit, qui travaille salement - (46) |
| sagouin : Ouvrier qui gâche la besogne, qui travaille malproprement. - (19) |
| sagouin n.m. Mauvais ouvrier. - (63) |
| sagouiné adj. Mal fait. - (63) |
| sagouiner : bâcler un travail - (48) |
| sagouiner : Travailler malproprement, sans goût. - (19) |
| sagouiner, v., bacler un travail. - (40) |
| sagoût : Mot usité seulement dans la locution : « Y n'a ni goût ni sagoût », cela est insipide, n'a aucun goût, ni bon ni mauvais. - (19) |
| sagrot, sangrot, sanglot : s. m., secousse, cahot. Les sanglots d'une voiture. - (20) |
| sagroter, sagrouter, sangroter, sangrouter : v. a., secouer. Voir greuter. - (20) |
| sai (adj.pos.f.) : sa. - (50) |
| sai (na) : soif - (57) |
| sai (on) : soir - (57) |
| sai : sac - (37) |
| sai : soi - (57) |
| sai : adj. poss. f. Sa - (53) |
| sai, adj. poss. féminin de la 3e personne. Sa : « sai mére, sai feille, sai fon-n' », sa mère, sa fille, sa femme. - (08) |
| sai, s. m. sac en général. « sa. » - (08) |
| sai, s. m. sel. - (08) |
| sai. Sa, pronom personnel féminin devant une consonne. Sai fanne, sa femme. C'est aussi le singulier des trois personnes de savoir au présent de l'indicatif. C'est, en troisième lieu, le singulier et le pluriel du substantif sac. Enfin c'est le nom du patriarche Seth, troisième fils d'Adam. - (01) |
| s'ai. S'il. S'ai vo plai, s'il vous plait. - (01) |
| saibai. Le jour du sabbat des Juifs, le septième jour de la semaine, appelé parmi nous samedi. C'est aussi le sabbat des sorciers. - (01) |
| saibbait : tarare à manivelle manuelle - (37) |
| saibbat : sabbat, grand bruit - (48) |
| saibé, s. m. sabbat, assemblée de sorciers qui se réunissent sous la présidence de satan. - (08) |
| saibeutö, sm. sabotier. - (17) |
| saibo, saibeu, sabot. Ce nom dérive, dit-on, de Sabaudia, nom latin de la Savoie où l'on suppose que les sabots furent inventés. - (16) |
| saibot : n. m. Sabot. - (53) |
| saibot, s. m. sabot. Nous disons d'un sabot cassé qu'il a fait veau. (voir : veai.) - (08) |
| saibòt, s. m., sabot. On dit d'une fille enceinte qu'elle a « cassé son saibot ». Variante de la « Cruche cassée ». - (14) |
| saibot, sm. sabot. - (17) |
| saiboté : n. m. Sabotier. - (53) |
| saiboter (n.m.) : sabotier - (50) |
| saiboter (v.) : faire du bruit en marchant avec des sabots - (50) |
| saiboter, v. intr., saboter, marcher bruyamment, donner des coups de pied avec ses sabots. S'emploie aussi pour dire qu'on a mall travaillé : « Oh ! l’feignan, ô saibote tout c'qu'ô fait. » - (14) |
| saiboter, v. n. faire du bruit en marchant avec des sabots, marcher lourdement. — Saiboter, v. a. maltraiter, donner des coups de pied à quelqu'un, malmener à la pointe du sabot. - (08) |
| saibots godots : sabots entièrement taillés en plein bois (sans « coussin » : « chans brécole ») - (37) |
| saibouler, v. a. mener rudement, maltraiter. (voir : abouler, bouléyer.) - (08) |
| saiboutou, ouse, adj. et s. celui qui sabote, qui fait du bruit en marchant lourdement. - (08) |
| saic (n.m.) : sac - (50) |
| saic : n. m. Sac. - (53) |
| saiche : Grand sac. « Eune saiche de bran » : un grand sac de son. - (19) |
| saiche, s. f. sac à grains. Verbe : ensaichi, mettre en sacs ; tasser comme dans un sac. - (22) |
| s'aichiter, s'asseoir - (36) |
| saichot : Sac, petit sac. « Les vaichis portant leu marande dans in saichot », ce saichot est un sac de toile qui se porte en bandoulière, derrière le dos. - Besace de mendiant. « O ne li a pas cassé la corde se san saichot ! » : l'aumône qu'il lui a donnée n'est pas lourde. - (19) |
| saichot, petit sac, besace. - (05) |
| saichöt, sm. sachet. - (17) |
| saiclier : Sarcler. « Saiclier des tapines à moitié » : sarcler des pommes de terre dont on aura la moitié du produit pour prix de son travail. - (19) |
| saiclieut : Sarcloir, petite pioche dont on se sert pour sarcler. - (19) |
| saiço, petit sac - (36) |
| saiçot (n.m.) : petit sac - (50) |
| saide, adj. [sade]. qui a de la saveur. - (17) |
| saide, adj. Se dit de ce qui est naturellement un peu sec, de ce qui se détache aisément par grumeaux. Le pain de seigle est réputé « saide » lorsqu'il est cuit à point, lorsque la pâte résiste au lieu de s'amollir sous le doigt. - (08) |
| saide, doux, agréable... - (02) |
| saide, sade, suave, agréable à manger. - (05) |
| saide. Tendre, doux, agréable à manger. Dépeu qu'ions choingé de mûnier, le pain qu’i maingeons ast saide... Peut-être du latin sapidus. - (13) |
| saige : sage - (48) |
| saige, adj. sage, tranquille, docile, pieux. « saize. » - (08) |
| saige, adj. sage. - (17) |
| saige. Sage, sages. - (01) |
| saigesse, s. f. sagesse, bonne conduite. « saizesse. » - (08) |
| saigesse, sf. sagesse. - (17) |
| saigesse. Sagesse. - (01) |
| saignate: Gerçure aux mains. « La bije fa veni des saignates » : le vent du Nord provoque les gerçures des mains. - (19) |
| saigne n.f. (du gaul. sania, terrain marécageux) Bonne prairie humide. - (63) |
| saigne, seigne : s. f., vx fr. sagne, creux, ravin. - (20) |
| saigne-langue : Achillée millefeuille ou Gaillet grateron (plantes) - (voir envorne). III, p. 43-1 - (23) |
| saigne-langue : plante : gaillet, ou grateron. Dans les savées on cherchot du saigne-langue : dans les haies on cherchait du gaillet. - (33) |
| saigne-nez : voir saigne-langue - (23) |
| saignerette n.f. Plante herbacée qui aurait des vertus hémostatiques. - (63) |
| saigneròte, s. f., plante (l'achillée millefeuilles) que les enfants s'amusent à s'introduire dans le nez pour le faire saigner. - (14) |
| saignéte, s. f., gerçure, fente, crevasse que le froid produit sur les mains, et qui saigne. - (14) |
| saignette : s. f., crevasse, gerçure. - (20) |
| saignette. Gerçure aux mains occasionnée par le froid. Saignerote, Achillée mille feuilles, parce que cette plante introduite dans le nez le fait saigner. - (03) |
| saignettes, gerçures de froid aux mains. - (05) |
| saigneux d'cotson n.m. Tueur de porcs à domicile. Voir tueux. - (63) |
| saigni : parc à porcs. A - B - (41) |
| saigni : Saigner. « Saigni du nez ». « Saigni in cochon » tuer un porc. - (19) |
| saignie (herbe de la). Saigne-nez, (Achillée millefeuille). - (49) |
| saignie n.f. Saignée. - (63) |
| saignotte (n.f.) : achillée mille-feuilles - (50) |
| saignotte : gerçure. - (31) |
| saignotte : voir saigne-langue - (23) |
| saignotte : plante achillée : mille feuilles. - (33) |
| saignousi : Ensanglanter. « Ol a tot saignousi san mouchou depeuche ». - (19) |
| saignoux : Taché de sang. « Les bouchis ant sovent leu devanté saignoux ». - (19) |
| sai'illére : salière - (48) |
| saijan : Saison. « La bonne saijan » : l'été. « La mauvâse saijan » : l'hiver. - (19) |
| saiji : Saisir. Au figuré, comprendre. « As-tu saiji ce que je t'ai dit ? ». - (19) |
| saijonner : Verbe, se dit d'un arbre ne donnant des fruits que tous les deux ans. - (19) |
| sailaide aû lard, sailaide â graittons : salade à feuilles craquantes, « frisée », pour laquelle le lard émincé grésillant dans la poêle est versé directement sur les feuilles dans le saladier - (37) |
| sailaide, s f. salade. - (08) |
| saile (adj.m. et f.) : sale - (50) |
| sailé (du), (du) côtis : (des) côtes de porc conservées dans le saloir - (37) |
| saile : sale - (37) |
| saile coûmme aine heûppe (âte) : (être) très sale, malpropre (la huppe est un oiseau qui construit son nid dans ses excréments) - (37) |
| sailè : adj. et n. m. Salé. - (53) |
| sailer : saler - (48) |
| sailinon (n.m.) : petit coffre pour le sel - (50) |
| sailinon, s. m. petit coffre en bois muni d'un couvercle où l'on conserve la provision de sel pour la cuisine. - (08) |
| saillâ : femme sale sur elle et dans son ménage - (60) |
| sâillâ : personne malpropre ou travaillant de manière très négligée. - (62) |
| saillâ, s. f., femme malpropre, souillon, qui met en désordre et salit tout autour d'elle : « Que saillâ ! quand all'fait son - (14) |
| saillât, adj., malpropre, taché. - (40) |
| saillau : petit portail latéral, portillon à l'entrée de la ferme - (34) |
| saillaux : petit portail latéral, portillon à l'entrée de la ferme ou du jardin - (43) |
| saille : s. f. seigle. - (21) |
| Sâillé : n. propre. Saisy, petit village de Saône-et-Loire, près d'Epinac. - (53) |
| saille, piaintse de grandze : grande planche devant le seuil de la grange - (43) |
| saillée. n. f. - Salière. - (42) |
| sailleût ben ! : bonjour - (37) |
| sailli : faucher (couper de l'herbe) - (57) |
| saillia. Synonyme patois de souillon : c’te p’tiote Nannette, ç'àst un vrai saillia. - (13) |
| saillô, seau pour puiser l'eau. Les paysans ne manquent jamais de dire un sciau, comme dans le patois picard et lorrain... - (02) |
| saillô. : Seau pour puiser de l'eau. On lit ces mots dans une charte de 1535 citée par le Glossaire genevois : « Le droit de bourgeoisie se payait quatre écus d'or et, de plus, unum seillotum correi bolocti (un seau de cuir bouilli, à l'usage des incendies). » Dans le dialecte on dit seille. Les villageois ne manquent jamais de dire un sciau. - (06) |
| saîllon (en) : en tenue négligée. (B. T IV) - D - (25) |
| saillonner (v. tr.) : fouetter - (64) |
| saillot : petite barrière qui ferme le sagné - (51) |
| saillot, seillot n.m. (du lat. cilia, paupière, puis bord). Portillon fermant l'accès piéton de la cour. - (63) |
| saillou (on) : faucheur - (57) |
| sailon : saloir. VI, p. 4-9 - (23) |
| sailon, s. m. saloir, vaisseau en bois, petite tonne dont on se sert pour saler les porcs et conserver le salé dans la saumure. - (08) |
| sailoper (y) : mal travailler - (37) |
| sailotte, salle : siège à 1 ou 3 pieds pour la traite - (48) |
| sailou (n.m.) : saloir - (50) |
| sailoû (saloû) : saloir - (39) |
| sailoû : culotte de femme - (48) |
| sailoû : saloir - (48) |
| sailou : voir sailon - (23) |
| sailoup’rie (d’lai) : tout ce qui est inutilisable - (37) |
| sailouprie, s. f. saloperie. N'implique pas toujours la malpropreté. C'est une épithète souvent très amicale donnée par la maîtresse de maison à ses volailles ou autres petites bêtes qu'elle nourrit. - (08) |
| sailu (nom masculin) : saloir. - (47) |
| saim'di : samedi - (48) |
| saimedi, s. m. samedi, le septième jour de la semaine. - (08) |
| sain : Sec, non exposé à l'humidité. « In leugement sain ». « Les prés sains donnant du maillo foin que les prés mollins ». - (19) |
| sain, saindoux (ain long). - (26) |
| sain. Saint, saints. - (01) |
| saîné : n. m. Bruit de la combustion du bois. - (53) |
| sainer. : (Dial.), guérir. (Du latin sanare.) - (06) |
| sainfoin : trèfle violet (en B : triolet*). A - (41) |
| sainfoin : trèfle - (44) |
| sainfoin. Nom donné par erreur au trèfle, le sainfoin étant appelé « espercette ». - (49) |
| saingn', adj. et subst. saint : « ain saingn' », l'esprit « saingn'. » au féminin sainte et au pluriel saints ou saintes. - (08) |
| saingner, v. a. saigner, tirer du sang. Nous disons « saingner » pour tuer un porc. - (08) |
| saingneu : saigner. - (29) |
| saingnie, s. f. saignée, action de tirer du sang. - (08) |
| sainier, sanier n.m. (du gaul. sania, terrain marécageux). Petit terrain attenant aux bâtiments réservés aux cochons. - (63) |
| sain-ne : sien - sienne - (57) |
| saint : Saint, statue de Saint. « In Saint de beu » une statue de Saint en bois. - « Saint Frisquin » Saint-Frusquin, « Ol a miji tot san Saint Frisquin » il a mangé tout ce qu'il avait. - Note, voir Saint-Bonnot, Saint-Guerin. - (19) |
| Saint Beurson : Saint Brisson - (48) |
| Saint boudin, Saint couèchon : Fête quand on tue le cochon - (48) |
| saint diab' (à la saint diab') : exp. Très tôt le matin, expression pour dire un lever très matinal, souvent avant le lever du soleil. - (53) |
| Saint-Amour ! excl. des vieillards du commencement du siècle : « Quand il boit mon bon vin, et surtout la bonne denrée : Saint-Amour ! s'écrie t-il, que ça ne dure-t-i encore vingt-cinq ans ! » (Correspondance de 18 17.) - (14) |
| Saint-Brice : s. m., nom du cimetière de Mâcon, qui était d'ailleurs la désignation ancienne du quartier (aujourd'hui de la gare), provenant elle-même d'une chapelle dédiée à saint Brice et disparue depuis longtemps. - (20) |
| Saint-Clair, Sainte-Claire, herbe de Saint-clair ou de Sainte-Claire, clair, claire : s. m. et f., belladone (atropa belladona), plante à laquelle on attribuait la vertu de guérir les maux d'yeux. - (20) |
| Saint-Claude : s. f. Partager à la Saint-Claude, garder tout pour soi. Syn. de partager à bon belin (voir belin). - (20) |
| Saint-Coessot : fête qui a lieu quand on tue le cochon - (39) |
| Saint-Espri. Saint-Esprit. L'orthographe bourguignonne supprimant toutes les lettres qui ne se prononcent point, retranche de Saint-Esprit, par cette raison, le dernier t final, même devant une voyelle, et écrit toujours Saint-Espri, Ce mot ne signifie pas seulement la troisième personne de la Trinité, mais aussi cette croix en broderie d'argenl,que les chevaliers de l'Ordre du Saint-Esprit portent sur leur juste-au-corps et sur leur manteau… - (01) |
| Saint-Filerie, Saint-Fellerie : s, f., fête collective au cours de laquelle, après la Saint-Vincent, on mange entre voisins et amis, la cagnotte faite pendant les veillées (flleries) d'hiver. - (20) |
| saint-frusquin n.m. 1. Effets personnels. 2. Dans une énumération on trouve à la place de etc... - (63) |
| Saint-Laurent, subst. féminin : fête patronale du Creusot. - (54) |
| Saint-Longin, loc., jeu de mots, sobriquet donné au garçon qui va, vient, et travaille avec lenteur, qui est long. - (14) |
| Saint-Michel n.m. Coulemelle. - (63) |
| saintorée, centaurée. - (26) |
| Saint-Patet : voir patet. - (20) |
| saint'reine. Boîte de colporteur. Autrefois les colporteurs portaient avec leurs marchandises, une sainte Reine en plâtre, fermée à clef dans un compartiment séparé. Pour la modique somme d'un sou, il ouvrait la boîte et montrait la sainte. Quelle joie pour les enfants ! De là l'expression « saint'reine » pour désigner la boîte du colporteur et, par extension, le placard, l'armoire. - (49) |
| Saint-Sauvette : s. f., Saint-Sylvestre. Courir la sant-sauvette, demander la sant-sauvette, coutume des villages du Maçonnais, presque entièrement disparue aujourd'hui, qui consistait à aller quêter des étrennes en nature de porte en porte, le 31 décembre. - (20) |
| Saint-Tourmentin : s. m., personne désagréable, qui vous tourmente. La Sainf-Tourmentin, syn. de la Saint-Martin, époque désagréable à cause du terme. - (20) |
| sain-yi, san-yi : sanglier - (43) |
| sâïon, s. f. la « sâîon » est la belle saison, la saison des travaux agricoles les plus importants, l'espace de temps qui s'écoule entre pâques et la toussaint. - (08) |
| sàïon, s. f., saison. Analogie avec màïon, râïn, etc. - (14) |
| saïouer. v. a. Saluer. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| saipeigne, sapine. Mot particulier à Dijon pour exprimer une jatte faite en bois de sapin... - (02) |
| saipeigne. : Sapine, jalle en bois de sapin. Elle repanche ène saipeigne. (Virg. vir., ch. Iv.) - (06) |
| saipiau - (39) |
| saipiau, chapeau - (36) |
| saipin (on) : sapin - (57) |
| saipin, sm. sapin. - (17) |
| saipine : cuveau en bois de sapin placé sous le moulin à dents, pour y recevoir, après moulinage, la nourriture des porcs - (37) |
| saipine : seau à lait - (48) |
| saipine : 1 n. f. Seau en bois ou en fer blanc. – 2 n. f. Demi fût de bois utilisé comme baquet par les mineurs pour se laver (les douches n'existaient pas sur les puits), servait aussi à laver le linge. - (53) |
| saipingne, sf. sapine. - (17) |
| sairaisin, s. m. sarrasin ou blé noir. - (08) |
| sairgottè, sigolè : v. t. Secouer. - (53) |
| sairraisin (n.m.) : sarrasin ou blé noir - (50) |
| saisonner, v. n. se dit, en parlant d'un arbre, lorsque celui-ci ne donne des fruits qu'un an sur deux. - (24) |
| saissot : petit sac - (37) |
| saissot : sac, petit sac - (39) |
| saissot, sac - (36) |
| saites, 2me pers. du prés. de l'indicatif du verbe sacouèr : « J'vous ain-me gros, saites-vous bé ?. . . » - (14) |
| saitron, s. m. grabat, mauvais lit à l'usage des plus pauvres gens. - (08) |
| saivaiment, adv. savamment, de science certaine, en connaissance de cause, sciemment. - (08) |
| saivaite, sf. savate. - (17) |
| saivan, adj. et s. savant, celui qui sait, qui connaît quelque chose, et non pas celui qui a de la science comme on l'entend en français. - (08) |
| saivant (n. et adj.m. et f.) : savant (-e) - (50) |
| saive, s. f., sève, liquide nutritif des végétaux, force du vin, vigueur de l'homme. - (14) |
| saivé. Savez. Vo le saivé, vous le savez… - (01) |
| saivein. Savions, saviez, savaient. - (01) |
| saiver (v.t.) : écorcer un arbre au moment de la sève - (50) |
| saiver, v. a. écorcer un arbre au moment de la sève, enlever la peau, écorcher. - (08) |
| saiver, v. intr., faire sortir la sève de la branche de saule, de noisetier, de merisier, que les enfants frappent du manche de leur couteau pour fabriquer des sifflets. - (14) |
| Saivigni. Savigni vers Beaune, belle terre féconde en bon vin. - (01) |
| saivo (ê), vt. savoir. Au conditionnel, s'emploie au lieu du verbe pouvoir : je ne sevos, je ne pourrais. - (17) |
| saivò. Saurait. - (01) |
| saivoi. Savoir. - (01) |
| saivon (n.m.) : savon - (50) |
| saivon. Savons. - (01) |
| saivoo ou saivò. Savais, savait. - (01) |
| saivouâ (v.t.) : savoir - (50) |
| saivouâ, saivar (v.) : savoir - (50) |
| saivouâ, v. a. savoir. Au part. pass. saivu : « i n'é pâ pouvu l' saivouâ », je n'ai pas pu le savoir. - (08) |
| saivouère : savoir - (48) |
| saivouner, v. a. savonner, laver avec du savon, faire un savonnage. - (08) |
| saivu (p.p.) : p.p. du verbe savoir - (50) |
| saivu, part, passé du verbe savoir : « se i eusse saivu », si j'avais su, propos de jeunesse! « se i eusse pouvu », si j'avais pu, propos de vieillesse ! - (08) |
| saize (n. et adj.m. et f.) : sage - (50) |
| saizon. Saisons. - (01) |
| sâkiè : sarcler (enlever les mauvaises herbes avec un outil) - (46) |
| sâkyé, sarcler. - (16) |
| sakyou : sarcloir. (B. T IV) - D - (25) |
| sal : s. f. selle, petit tabouret à trois pieds, où l’on s’assied pour traire les vaches. - (21) |
| salade (aller à la), chercher la mâche et les pissenlits au printemps. - (40) |
| salade, n.f. pissenlit. - (65) |
| saladi : saladier - (43) |
| saladi : saladier - (57) |
| saladou (être), aimer la salade - (36) |
| salai. Salé, salés. Borguignon salai, bourguignon salé. On ne s'accorde pas touchant l'origine de ce proverbe… - (01) |
| salambier : ouvrier maladroit. (F. T IV) - Y - (25) |
| salambier. s. m. Sale, malpropre, malhonnète, ce qu'on appelle partout un salopier. (Plessis-Saint-Jean). - (10) |
| salan : Petit banc. « Ments dan in salan seu tes pids ». - (19) |
| sale : Terme de jeu d'enfants, celui qui prononce ce mot se met par là même en dehors de toute attaque. - (19) |
| sale, s. f. siège en bois à trois pieds [selle]. Diminutif : salon, petit banc pour les pieds. - (22) |
| salére : Salière. « Varser la salére porte malheu ». - (19) |
| saleupe : Salope, personne sale. - (19) |
| saleuper : Faire salement sa besogne. « De l'ovrage saleupée ». - (19) |
| saleuperie : Saloperie, saleté, chose de rebut. « As-tu ageté quéque chose à la vente ? - Ma fa nan, an n'a ren que vendu des saleuperies ». - (19) |
| saleupiau : Salaud, masculin de saleupe. - (19) |
| saleure : Lard salé depuis peu, petit salé. - (19) |
| sâli : salir - (57) |
| salie : Provin obtenu en enterrant complétement un cep dont on a étalé plusieurs rameaux, chacun des ceux-ci donnera un provin qui remplacera les ceps manquants. - (19) |
| salignon (nom masculin) : boîte à sel. - (47) |
| salignon : vase ou l'on écrase le sel. (MLV. T III) - A - (25) |
| saligòt, adj., saligaud : «Y ét eùn' petiote saligòte ; alle a tôjor la frimousse crassouse. » - (14) |
| saligòter, v. tr. , salir : « Ma, voué donc coume t'as saligoté ta jupe ; te n'pourâs pu aller à la fête. » - (14) |
| salingnot. s. m. Coffre à sel. (Etivey). - (10) |
| salipiau, adj., sale, mal vêtu, mal appris. - (14) |
| salîre (na) : salière - (57) |
| salîre, s. f., salière. - (14) |
| sa'llan : Sillon. « Labourer à sa'llans relevés » : c'est faire quelques raies relevées les unes contre les autres pour permettre l'écoulement des eaux. - « Vendre in sa'llen » : vendre une parcelle de terre. - (19) |
| salle (na) : chaise - (57) |
| sa'lle : Seau. « Pougi eune sa'lle d'iau » : puiser un seau d'eau. « Boire à la sa'lle » : boire de l'eau. - (19) |
| sa'lle : Seigle. « In glieu de sa'lle » : un petit fagot de paille de seigle. - (19) |
| salle : Selle, petit siège de bois sans dossier. « Salle d'écurie », petit siège à trois pieds sur lequel on s'assied pour traire les vaches. « Salle de boiri » : support en bois, en forme de V porté sur trois pieds et sur lequel on place le cuvier (boiri). - (19) |
| salle : siège à trois pieds pour traire les vaches. Pou tirer les vèches on peurno la salle : pour traire les vaches on prenait le siège à trois pieds. - (33) |
| salle de bue, banc de lessive. - (05) |
| salle d'ombrage : s. f., salle de verdure, lieu planté d'arbres formant couvert. - (20) |
| salle, chaise. - (05) |
| salle, sallerotte, s.f. trépied sur lequel on met le burot. - (38) |
| salle, subst. féminin : salle à manger. - (54) |
| salle. Chaise, vieux mot. Nous appelons « salle de bue », un banc de lessive. - (03) |
| saller : Seller « Saller in chevau ». Vieille chanson : « Le chevau est à la porte tot sallé, tot bridé, la belle pour vous emmener ». Les jeunes gens allaient chanter cette chanson à la porte de la fiancée la veille de la noce. - (19) |
| salmeure, s. f. saumure. - (22) |
| salmire : s, f., saumure. - (20) |
| salomon, s. m. sceau de salomon, muguet multiflore très commun dans nos campagnes. - (08) |
| salopé ma robe !... » - (14) |
| saloper, v. tr., faire maladroitement quelque chose : « Ah ! c'te Marion ! Je n'li baillerai pu ran à faire ; all' m'a si ben - (14) |
| salopette. s. f. Sorte d'embrouille-malin, de pantalon de dessus en toile à l'usage des ouvriers. (Bléneau). - (10) |
| salopiaud n.m. Sale. - (63) |
| salopier, n. masc. ; débauché. - (07) |
| salopiod, salopiode. Malpropre (au physique comme au moral). Mot commun à plusieurs patois. - (49) |
| saloprie, chose malpropre ; on donne vulgairement les noms de saloprie et de salopyâ à des personnes qui déplaisent. - (16) |
| salou (on) - salouaîr (on) : saloir - (57) |
| salou : (nm) saloir - (35) |
| salou : Saloir. « Y a du là dans le salou ». Autrefois les saloux étaient tous en bois maintenant beaucoup sont en grès. - (19) |
| salou : voir sailon - (23) |
| salou : s. m. saloir. - (21) |
| salou, s.m. saloir. - (38) |
| salouair : n. m. Saloir. - (53) |
| saloué. n. m. - Saloir. - (42) |
| saloue. s. m. Saloir. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| salouée : saloir. Gros pot de grès ventru pour y conserver la viande du porc abattu, puis salé. Ex : "J'ons mis l'couchon dans l'salouée". - (58) |
| salpêtre (Faire) : loc., verglacer - (20) |
| saluire. Saluâmes, saluâtes, saluèrent. - (01) |
| salure : s. f., salaison, viande salée. - (20) |
| salut ! bonjour ! - (38) |
| salutare : Salutaire. - (19) |
| samadi, sañmadi : (nm) samedi - (35) |
| sambadi : s. m. samedi. - (21) |
| sambadi, samedi. - (05) |
| sambadi. Samedi, vieux mot. - (03) |
| samban (nom masculin) : sorte de fauteuil en bois formant un coffre et qui se trouvait placé près de la cheminée. - (47) |
| sambèdi (on) : samedi - (57) |
| sambiau, chambiau, châbiau (pour châbleau). s. m. Petit câble. – En navigation, corde fixée par un bout à l'avant d'un bateau et qui, terminée à l'autre extremité par une boule doublée de fer, passée dans la cincenelle ou corde de tirage, sert, suivant le cas, à raccourcir ou à rallonger celle-ci, de manière à ce que le bateau soit maintenu constamment dans la direction du chenal. (Navigation de l'Yonne). - (10) |
| sambiére : servante - (39) |
| sambre : Adjectif « Labourer sambre » : labourer peu profondément comme par exemple pour déchaumer. - (19) |
| samedi (Mettre du) : loc., travailler rapidement et, par conséquent, sans soin, comme on ferait le samedi d'une besogne qu'on voudrait à toute force terminer avec la semaine. « Ma robe est toute bougrassée ; on voit ben que la couturière y a mis du samedi. » - (20) |
| samedi : s. m,. jour du marché de Mâcon, et, par extension, ce marché lui-même. - (20) |
| samp : champ - (39) |
| sampille : s. f., guenille, — Adj. pris substantivement, arsouille, Individu en guenilles. Oh ! grand sampille que t'es ! Regarde-moi donc c'te grande sampille ! Voir dessampiller. - (20) |
| sampillerie : s. f., collectivité de sampilles ou arsouilIes. - (20) |
| sampilli v. Travailler sans soin. - (63) |
| san : sommeil (surtout utilisé dans l'expression avoir san). A - B - (41) |
| San Bone : (NL) Saint Bonnet des Bruyères (mais Saint Bonnet = Saint Bonnet de Joux) - (35) |
| San Creûtoul : (NL) Saint-Christophe - (35) |
| San L’dzi: (NL) Saint Léger - (35) |
| San Piarre : (NL) Saint Pierre le Vieux - (35) |
| San Piarri (re) : habitant (e) de Saint Pierre le Vieux - (35) |
| San S’frin : (NL) Saint Symphorien - (35) |
| san yer : sanglier - (44) |
| san, s. m., sang : « A quand j'ons vu c'qui, ça nous a torné l’san. » - (14) |
| san, tsan, s. m. champ. - (08) |
| san. Sans, préposition. San lu je n’airein ran fai, sans lui nous n’aurions rien fait. Je san, tu san, ai san, je sens, tu sens, il sent. C’est aussi l’impératif du même verbe, san cé gan, ai sante bon, sens ces gants, ils sentent bon. C'est de plus le subslantif sens : Tête veùde de san, tête vide de sens. S'an avec une apostrophe : Ai s’an at éporsu, il s’en est aperçu. - (01) |
| san-[y]er : sanglier. - (52) |
| san’ne (évoir) : sommeil (avoir). - (62) |
| san’ne : sommeil. « Évoir san’ne » : avoir sommeil. - (62) |
| san-brenaba ou san-brenabè, s. f. arc-en-ciel, littéralement Saint-Barnabé. - (24) |
| san-brenabau*, s. f. arc-en-ciel, littéralement Saint-Barnabé. - (22) |
| sanciau (nom masculin) : sorte de beignet, nature ou aux pommes. - (47) |
| sandalou : personne qui met des sandales - (44) |
| sandrine (lai) : (l’) alexandrine - (37) |
| sang : s. m. Il est si tellement gros... On voit bien que tout son sang se tourne en graisse. Et pis y est pas de la graisse de bon aloi... - (20) |
| sanger : changer. Ex : "Y sange pas, l’pour berlot ! Toujours à lucher !" - (58) |
| sanger, v. tr. et intr., changer une chose, et varier de figure, d'embonpoint, aussi bien que d'habitudes. - (14) |
| sanger. Changer. - (49) |
| sanger. v. - Changer. - (42) |
| sang-fraid (on) : sang-froid - (57) |
| sanghié, s. m. sanglier. « sanlé. » - (08) |
| sangi : Songer, penser. « Te m'y fara sangi » : tu m'y feras penser. - (19) |
| sanglé, sanglier, sanlé. - (04) |
| sangle. : (Du complém.latin singularem), se dit d'un objet seul. - (06) |
| sangler : v. a., cingler. - (20) |
| sang-meurti : Meurtrissure. « Pa miji le sang meurti y e ren de si ban qu'in empliâtre de pain mâchi » : pour guérir les meurtrissures rien ne vaut un emplâtre de pain mâché. - (19) |
| sangoiller. Remuer violemment. - (03) |
| sangonée, s. f., sanie, sang corrompu, humeur. Ex. : cracher la sangonée. - (11) |
| sangonnée. Sang impur, généralement mélangé de pus, qui coule d'une plaie. - (49) |
| sangouégner : remuer en tous sens - (48) |
| sangouner, v. tr., secouer violemment, sans précaution : « On a, c'te neût, sangouné la porte ; j'savions pas c'qu'iétôt. » - (14) |
| sangrot, s. m. cahot. Verbe sangroter. - (24) |
| sangrou, s. m. cahot. Verbe : sangrouté. - (22) |
| sangsurer. v. - Sucer le sang. Se sangsurer : se ruiner, se saigner, faire le maximum pour quelqu'un. - (42) |
| sangsurer. v. a. Sucer le sang, épuiser jusqu'au sang. – Se dit, figurément, pour épuiser, dissiper le bien de ses maitres ou de ses parents. – Se sangsurer. v. pron. Au figuré, se mettre dans la gêne, s'épuiser, se ruiner pour ses enfants. - (10) |
| sangsusier. n. m. - Celui qui ramasse les sangsues. (Voir F.P. Chapat, 179) - (42) |
| sanguegnon, s. m. sureau yèble, dont les baies écrasées sont couleur de sang. - (22) |
| sanguegnon, s. m. sureau yèble, dont les baies écrasées sont couleur de sang. - (24) |
| san'gueir, san'ier : n. m. Sanglier. - (53) |
| sanguellier : sanglier. Ex : "Pendant la guerre, j'allint dans les vignes la nuit pour chasser les sanguelliers qui pillint tout" (prononcer pi-lin). Cela s'est effectivement pratiqué avant vendanges, puisque les fusils étaient réquisitionnés et qu'ils devaient être remplacés, faute de mieux, par des casseroles que l'on frappait pour faire du bruit et éloigner les hardes. - (58) |
| sanguette, s. f., sang de volaille (que l'on a recueilli). - (40) |
| sanguié, san'yé : sanglier - (48) |
| sanguier (n.m.) : sanglier (aussi sanler) - (50) |
| sanguignan ou singuignan : Sanguignon, cornouiller sanguin, cornus sanguineum ; l'écorce est rougeâtre et les baies donnent un jus rouge sang. Les bergers s'imaginaient naguère que s'ils frappaient une de leurs bêtes avec un bâton de sanguignon, celui-ci lui ferait uriner du sang. - (19) |
| sanguignon, n.m. cornouiller sanguin. - (65) |
| sanguignon, troëne, fresillon. - (05) |
| sanguillon, s.m. cornouiller sanguin. - (38) |
| sanguin : arbrisseau rouge. - (09) |
| sanguinion. Arbuste dont les baies noires sont couleur de sang, quand on les écrase. - (03) |
| sanhier. n. m. - Sanglier. - (42) |
| San-ier : sanglier. - (33) |
| sanier, sainier n.m. Petit terrain attenant à l'écurie pour le cochon. - (63) |
| sanjé, changer ; sanj’man, changement. - (16) |
| sanle. s. m. Senevé. (Saint-Florentin, Vincelotte). - (10) |
| sanler : sanglier - (37) |
| san'llié : Sanglier. « Les san'lliés ant ravaigi les treuquis ». - (19) |
| sanllyi*, s. m. sanglier. - (22) |
| san-madi : samedi - (43) |
| sanm'di, samedi. - (16) |
| san-médi : Samedi. « Le marchi de Tôrneu se tint le san-médi ». - (19) |
| san-min-ne, loc. ce qui est à moi. San-neutre, ce qui est nous. San-tin-ne, ce qui est à toi. San voûtre, ce qui est à vous. San-yiôs, ce qui est à eux. - (24) |
| san-min-ne, loc. ce qui est à moi. San-tin-ne, ce qui est à toi. Sein-voûtre, ce qui est à vous. Sein-lliou, ce qui est à eux. - (22) |
| sanmu. : J'seù sanmu, c'est-à-dire je suis ému, j'ai le sang agité. - (06) |
| sannan (fare) : faire semblant. - (29) |
| san-né, v. a. semer. - (22) |
| sanne. Semble. Ce me sanne, ce me semble. - (01) |
| san-ner, sembler. - (26) |
| sanpœllerie, s. f. gaspillage, éparpillement. - (22) |
| sanpœyerie, s. f. gaspillage, éparpillement : quelle sanpœyerie ! - (24) |
| sans cimer : sans rien dire - (48) |
| sans-gin-ne (on) : sans-gêne - (57) |
| sansiau : sorte de crêpe ou beignet (grapiau) - (60) |
| sansiau. n. m. - Grosse crêpe, sorte de roubigneau. (Arquian) - (42) |
| sansillan : Petit gland charnu pendant sous le cou de certaines chèvres. - (19) |
| sansillon : morceau de chair rouge qui pend sous le bec des coqs. - (21) |
| sansiot (n. m.) : sorte de galette épaisse et salée, de consistance pâteuse, cuite à la poêle (syn. crépiot) - (64) |
| sansiot : synonyme de grapiau. Grosse crêpe épaisse contenant des restes de repas. Ex : "Après ton grapiau, j’vas ben bouée un siau yau !" - (58) |
| sans-née : plante parasite des céréales - (39) |
| sanso'lle : Souillon, femme qui fait les gros ouvrages de la cuisine. - (19) |
| sanson, s. f. chanson. - (08) |
| sansouille : s. f., sansouillon : s. m,, souillon. - (20) |
| sansouille, s. f. femme sans ordre, sans propreté. On dit aussi sandrouille ; sansouillon et sandrouillon. - (22) |
| sansouille, s. f., petite écope, avec laquelle on vide l'eau de la santeine d'un petit bateau. (V. Santeine.) - (14) |
| sansouiller, v. tr., gargouiller, barboter, secouer un linge dans l'eau. S'emploie au figuré : « Attends, ch'ti vauran ! j'm'en vas t’sansouiller ! » - (14) |
| sansouiller. Laver dans l'eau malpropre ; barbotter. - (49) |
| sansouillon. Personne malpropre. - (49) |
| sansôvé, fuir au plus vite. - (16) |
| sansòye, s .f. femme sans ordre, sans propreté. On dit aussi san-dròye, sansòyon et sandròyon. - (24) |
| sans-pli, surnom donné plaisamment à un suisse de l'église, lequel, dans l'exercice de ses fonctions, se tenait raide comme sa hallebarde, ses vêtements ne faisant pas un pli. (V. les Sonnets Verdunois.) - (14) |
| sans-tchulotte (on) : sans-culotte - (57) |
| santauron (mener le) : bougonner sans arrêt. (RDM. T IV) - B - (25) |
| santé, sentier. - (16) |
| santei. Sentier, sentiers. - (01) |
| santeine, s. f., sentine, l'endroit le plus bas d'un bateau, où l'eau se rassemble en raison de la pente, et d'où on la rejette à la rivière à l'aide de la sansouille. La santeine, — en petit la sentine d'un navire, — se trouve entre deux traverses. (V. Sansouille.) - (14) |
| santerie, s. f. sauteuse, danse improvisée et sans façon. - (08) |
| santeux : adj., qui a une bonne santé, qui est sain. - (20) |
| santi, sentir ; santiman, odorat. - (16) |
| santi. Sentis, sentit, sentir. - (01) |
| santibon : du parfum - (46) |
| santif : n. f. Santé (bonne ou mauvaise). - (53) |
| santurieu, euse, adj. celui qui a de la santé, de la force, une constitution vigoureuse, de belles couleurs au visage. - (08) |
| santurieux, euse. adj. Qui est plein de santé. - (10) |
| san-yâ (on) : sanglier - (57) |
| sanye : (nf) sangle - (35) |
| san-yer (n. m.) : sanglier - (64) |
| sanÿer : sanglier - (51) |
| san-yer : sanglier - (39) |
| sanyi : (nm) sanglier - (35) |
| sañyî n.m. Sanglier ; on dit aussi sañyer. - (63) |
| sanyié, s. m. sanglier. - (24) |
| sanzer : changer. - (52) |
| sao, s.f. sel : d la sao p'lée : du sel pilé (fin). - (38) |
| Saône (falre une, ou faire sa) Se dit des petits enfants qui obéissent aux nécessité aqueuses de la nature. - (12) |
| Saône : s. f., cours d'eau quelconque ; rigole artificielle. On voit facilement des enfants faire une Saône au milieu de la rue. - (20) |
| saoûl : Saoûl, ivre. « An voit bin quand eun homme est saoûl mâ an ne voit pas quand ol a sa». « Miji san saoûl » : manger à sa faim. - (19) |
| saoûlan : Ivrogne. « San homme est in saoûlan ». - (19) |
| saoûler : Enivrer. « O s'est aré saoûlé hiya » : il s'est encore enivré hier. - Rassasier, repaître. « T'es in ban bouéran, t'as bien fait saoûler tes bâtes ». - (19) |
| saoulon. Ivrogne au sens péjoratif. (Mot aussi employé dans les régions voisines). - (49) |
| sapée n.f. Forte pluie battante qui tasse le sol. - (63) |
| sapigne, et sapeigne, s. f., jale, ou cuve, vaisseau en planches de sapin, servant pour la lessive, les provisions de lait, et autres besoins du ménage. - (14) |
| sapine (n.f.) : cuve de bois - (50) |
| sapine (nom féminin) : cuve en bois à divers usages. - (47) |
| sapine : Petit baquet de bois dont on se sert pour transvaser le vin. La sapine est le plus souvent en sapin, d'où son nom. - (19) |
| sapine : s. f. petit baquet. - (21) |
| sapine : s. f., chaland non ponté. - (20) |
| sapine, n.m. seau, cuvier en bois. - (65) |
| sapine, s. f. vaisseau en bois blanc, en sapin ordinairement, où l'on dépose du lait ou autre liquide. - (08) |
| sapine, s. f., seau en bois pour la cave. - (40) |
| sapine, s.f. récipient en bois pour mettre le vin, d'une contenance d'environ 25 litres. - (38) |
| sapine. Petit baquet cylindrique en bois ; jarle. (Mot employé en Bourgogne). « Sapine » figure sur le Larousse. - (49) |
| saping (n.m.) : sapin - (50) |
| sapiniére (na) : sapinière - (57) |
| sapouter : couper du bois à la hache. - (52) |
| sapoûter : coupailler avec une serpe - (39) |
| sapouter, tailler en morceaux - (36) |
| sapré : sacré. Atténuation de sacré dans un juron, mais aussi renforcement d’un mot : un’ ne saprée histoire. - (62) |
| sapré, adjectif qualificatif : sacré. - (54) |
| sâpré, -e adj. Sacré, e. - (63) |
| sâpré, sâcré : important (« y âtot ain sâpré mairiaize ! ») - (37) |
| sâqhi’, s. f. sarclage : « lai sâqhi' dé treuffes », le sarclage des pommes de terre. - (08) |
| sâqhiot, s. m. petite pioche dont on se sert pour sarcler dans les jardins ou dans les champs. - (08) |
| sàqhiou, ouse, s. m. sarcleur, celui qui sarcle : « lé sâqhious d' treuffes », les sarcleurs de pommes de terre ; « c'te fonne-laite ô eune bône sâqhiouse. » Généralement « sâqhioure » au féminin. - (08) |
| saquaie, s. f. chose : une brave saquaie (par dérision). Quantité : donnez-m'en une petite saquaie. - (24) |
| saquè : prendre toutes les billes de son adversaire - (46) |
| saquer, serrer en morvandeau, littéralement, mettre en sac, dans sa poche. - (04) |
| saquer, v. tr., jeter, pousser, enfoncer, blottir du foin, des pommes de terre et autres denrées dans des coins. - (14) |
| saqueùrdiéne ! juron honnête des bons vieux d'autrefois. - (14) |
| saquiai : sarcler. O saquio : il sarclait. - (33) |
| sâquiè : v. t. Sarcler. - (53) |
| saquier (v.t.) : travailler et nettoyer la terre avec la pioche (de Chambure note sâqhier) - (50) |
| sâquier : sarcler - (48) |
| sâquier : sarcler - (39) |
| sâquier, v. a. sarcler, travailler la terre et la nettoyer avec la pioche et non avec le sarcloir. - (08) |
| sâquieuse : une sarcleuse - (46) |
| sâquiot : (sâ:kyo - subst. m.) sorte de serfouette qui servait à couper les chardons, les pissenlits et autres mauvaises herbes dans les champs et les jardins. - (45) |
| saquiot : sarcloir. - (33) |
| sâquiot, psou : n. m. Sarcloir. - (53) |
| sâquiot, sâquioû : sarcloir - (48) |
| sâquioure : outil pour sarcler - (39) |
| sar : chariot - (39) |
| sâr : n. m. Soir. - (53) |
| sâr, s. m. soir : « al ô sâr, al ô bin sâr », il est tard, il est bien tard. - (08) |
| sâr, s. m., soir. - (40) |
| sar, s.f. soif. - (38) |
| sar, s.m. soir. - (38) |
| sar. Sers, sert. - (01) |
| sarabande : comédie - (44) |
| sarabande. s. f. Dévergondée, fille ou femme désordonnée. (Etivey). - (10) |
| sarazenère, champ planté de sarrasin. - (14) |
| sarazin, s. m., nom d'une ancienne tribu, éteinte aujourd'hui, mais dont le souvenir persiste. - (14) |
| Sarbone. Sorbonne. Personne n’ignore que la célèbre maison de Sorbonne a été ainsi nommée de son fondateur Robert, appelé Robert de Sorbonne, à cause du village do ce nom où II était né au diocèse de Reims… - (01) |
| sarce : douve pour retenir les cendres sur le charrier (?) - (60) |
| sarcher, et sercher, v. tr., chercher. - (14) |
| sarcher, sercher. Chercher. - (49) |
| sarcheu : chercher. - (29) |
| sarciller, sarcillonner. v. a. Couper, tailler malproprement, soit par maladresse, soit parce qu'on le fait avec un mauvais instrument. - (10) |
| sarcillotter. v. a. Soupasser. (Sommecaise). - (10) |
| sarclot, s. m., petite pioche à deux pans. - (40) |
| sarclot. Sarcloir. - (49) |
| sarcöil, sm. cercueil. - (17) |
| sarcueil, cercueil. - (04) |
| sardine de platte : s. f.. ablette. Voir platte. - (20) |
| sâre (ai), loc. mettre « ai sàre », mettre à l'étroit, à la gêne, mettre en presse, contraindre. - (08) |
| sâre, s. f. coin de bois qui s'adapte sous le joug des bœufs ou quelquefois sous « l'amblâ » pour assurer la direction du timon. - (08) |
| sâré, serrer. - (16) |
| sâré, vt. serrer. - (17) |
| sarée : grande pièce de toile faite avec du fil de chanvre plus grossier que pour les draps - (39) |
| sârer, v. a. serrer, fermer, enfermer, presser, conserver, garder, mettre sous clef. - (08) |
| sàrer, v. tr. , serrer, enfermer, presser. - (14) |
| sareté, v. a. couper avec peine, comme on fait avec une très mauvaise scie. - (22) |
| sâreure, s. f. serrure. - (08) |
| sarfeu : cerfeuil. - (29) |
| sarfin : cerfeuil. (PLS. T II) - D - (25) |
| sarfin, cerfeuil. - (26) |
| sarfu, s. m. cerfeuil. - (22) |
| sarge, serge. - (04) |
| sarge. Charge. - (49) |
| sargement. Chargement. - (49) |
| sargent : Sergent. « Le sargent des pampiers ». - (19) |
| sargent. n. m. - Sergent. - (42) |
| sarger. Charger. - (49) |
| sargo, secousse; saugoté, celui qui est secoué, par exemple, sur une voiture. - (16) |
| sargö, sm. secousse violente, choc, cahot. - (17) |
| sargô. Cahot. Proprement, sargô est une de ces secousses qu'on souffre dans un coche ou autre voiture, par un chemin haut et bas… - (01) |
| sargot, n.m. cahot. - (65) |
| sargot, s. m. secousse, choc, cahot. - (08) |
| sargot, s. m., cahotement, choc, secousse, occasionné aux voitures primitives du pays, par les ornières de dimension de certains petits chemins. . . où il y a aussi des pierres : « Les sargots de la vouéture ont démantibulé mon r'loge. » Au figuré, peut signifier malheur ou contretemps. - (14) |
| sargot. Cahot. - (03) |
| sargot. Cahot. - (49) |
| sargot. Secousse produite par un choc : an y ai êvu un gros sargot et lai voiture ai varsé. - (13) |
| sargoter, v. a. ébranler, secouer, cahoter. - (08) |
| sargoter, v. tr. et intr., cahoter, secouer : « C'te vouéture n'a point d'bonté por nous ; all' nous a jouliment sargotés ! » —« Hiâr, vous éteins parti ; on a sargoté vote pôrte. » - (14) |
| sargoter, v., secouer fortement pour chasser l'eau. - (40) |
| sargoter. Cahoter. - (49) |
| sargotter. Secouer, se dit surtout de l’action de secouer la fermeture d'une porte pour l'ouvrir; sargot, secousse, choc, cahot en vient. Etym. inconnue. - (12) |
| sârin (C.-d., Chal.).- Sciure de bois ; le mot sciure vient de secare, couper. - (15) |
| sarin : Sciure de bois. - (19) |
| sarin : sciure. Connu mais non utilisé chez nous, ce mot viendrait du latin serrae : sciage. - (62) |
| sârin, s. m., sciure de bois : « Ma page d'écriture ne veut pas chesser ; j'y vas métro du sàrin. » - (14) |
| sârin, sciure. - (38) |
| sarjé, charger ; sarjeman, chargement. - (16) |
| sarma : sarment - (21) |
| sarmaizes : sermages (village entre château-chinon et moulins-engilbert) - (37) |
| sarmanter : v. ôter de la vigne les sarments coupés. - (21) |
| sarment : s. m., serment - (20) |
| sarment, s. m. serment. - (08) |
| sarment, s. m., serment : « Seûtes çartain ; j'vos en fais l’sarmcnt. » - (14) |
| sarmenté : v. t. Sarmenter. - (53) |
| sarmenter : Ramasser et mettre en petits fagots (jevales) les brins de sarment d'une vigne qui vient d'être taillée. - (19) |
| sarmenter, v., faire des fagots de sarments. - (40) |
| sarmentouse : Ouvrière qui sarmente ; ce travail étant presque toujours fait par des femmes, le masculin sarmentoux est peu usité. - (19) |
| sarmon, s. m. sermon, réprimande. - (08) |
| sarmon, s. m., sermon : « Noute cueùré, quand ô prôche, ô nous débite tôjor le mein-me sarmon. » - (14) |
| sarmon. Sermon, sermons. - (01) |
| sarmoner, sarmouner, v. a. sermonner, réprimander, gronder. - (08) |
| sarmoner, v. tr., sermonner, faire de la morale. - (14) |
| sarmounner (v.t.) : sermonner - (50) |
| sâro, vêtement de petit enfant. - (16) |
| saroir : scie battante - (43) |
| saron : sciure de bois - (43) |
| saron, s. m. sciure de bois (du vieux français serre, scie). - (24) |
| saron, s. m. sciure de bois. - (22) |
| saroter : scier doucement - (43) |
| saroti : scieur - (43) |
| sarotte : petite voiture à vaches - (39) |
| sarouler. v. - Malmener; ne s'emploie que pour les personnes. (Mézilles, selon H. Chéry) - (42) |
| sarp : s. f. serpe. - (21) |
| sarpan, serpent (se dit au féminin). - (16) |
| sarpan. Serpent, serpents. - (01) |
| sarpatte. n. f. - Serpette. - (42) |
| sarpatte. s. f. Serpette. (Courgenay). - (10) |
| sarpe (n.f.) : serpe - (50) |
| sârpe (na) : serpe - (57) |
| sarpe (nom féminin) : serpe. - (47) |
| sarpe : (nf) serpe - (35) |
| sarpe : serpe - (37) |
| sarpe : serpe - (43) |
| sarpe : serpe. - (52) |
| sarpe : Serpent, couleuvre. « Y est pas eune sarpe y est in vipère ». - « Viôlette à la sarpe » : pervenche (vinca minor). - (19) |
| sârpe : Serpette, outil dont se servaient les vignerons pour tailler la vigne, aujourd'hui la « sârpe » est remplacée par le sécateur et n'est plus guère employée. - (19) |
| sarpe : serpe. - (33) |
| sârpe n.f. Serpe. - (63) |
| sarpe : n. f. Serpe. - (53) |
| sarpe : serpes - (39) |
| sarpè : v. t. Couper avec une serpe. - (53) |
| sarpé : v. tailler la vigne. - (21) |
| sârpe, s. f. serpe courte et légère, servant autrefois à tailler la vigne (v. fig. à goyœte). Verbe sârper. Sârpaille, taille de la vigne. - (24) |
| sarpe, s. f. serpe, instrument de forme courbe qui sert à couper, à tailler le bois - (08) |
| sârpe, s. f., grande serpe à ébrancher. - (40) |
| sàrpe, s. f., serpe, serpette. - (14) |
| sârpe, s.f. serpe. - (38) |
| sarpe, serpe. - (04) |
| sarpe, serpe. - (16) |
| sarpe, serpe. - (26) |
| sarpe. n. f. - Serpe. - (42) |
| sarpe. Serpe. - (49) |
| sârpe; s. f. serpe courte et légère, servant autrefois à tailler la vigne. Verbe : sârpé. Sarpeille, taille de la vigne. - (22) |
| sarpent (n.m.) : serpent - (50) |
| sarpent (na) : couleuvre - (57) |
| sarpent (na) : serpent - (57) |
| sarpent (un’ne) : serpent (un). L’inversion des genres est à remarquer. La sarpent pourrait être plus précisément la couleuvre. - (62) |
| sarpent : couleuvre. IV, p. 32 - (23) |
| sarpent : serpent - (48) |
| sarpent : n. m. Serpent. - (53) |
| sarpent : serpent - (39) |
| sarpent, n. fém. (!) ; serpent. - (07) |
| sarpent, s. f. serpent : « ailé viâ, a i é eune sarpan dan l' chemi », allez vite, il y a un serpent dans le chemin. - (08) |
| sârpent, s. f., serpent, couleuvre. - (40) |
| sarpent, s. f., serpent. On dit « eùne sarpent ». - (14) |
| sarpent, s.f. serpent. - (38) |
| sarpent, sf. serpent. - (17) |
| sarpent. n. f. - Serpent. - (42) |
| sarpent. Serpent. - (49) |
| sarpentin : Serpentin, tuyau de l'alambic où se condense le produit de la distillation. - (19) |
| sarper : (vb) tailler à la serpe - (35) |
| sarper : élaguer une haie - (43) |
| sarper : Tailler la vigne. « La vigne commache à bougi y est temps d'avoi fini de sarper ». - (19) |
| sârper v. Tailler au croissant le flanc des haies. - (63) |
| sarper : tailler. - (21) |
| sarpette : n. f. Serpette. - (53) |
| sarpiyère, s. f., serpillière, toile grossière et claire pour emballages. - (14) |
| sarpolet : serpolet - (48) |
| sarpolet : serpolet - (39) |
| sarpoulè, serpoulè. Serpolet. - (49) |
| sarpoures : (nfpl) broussailles obtenues en « sarpant » - (35) |
| sarpoures, breussions : broussailles obtenues en serpant - (43) |
| sarpoux : Ouvrier qui taille la vigne. - (19) |
| sarquè : donner un coup sec pour débloquer - (46) |
| sarquer : secouer brusquement. (G. T II) - D - (25) |
| sarqueu, s. m. cercueil, bière, tombeau. - (08) |
| sarqueû, s. m., cercueil. - (14) |
| sarrai : serrer, fermer, rentrer au poulailler, à l'étable (aussi : mettre en place, ranger). T'es sarrai les vaiches ? as-tu fermé les poules ? - (33) |
| sarraigin, sarrasin. - (05) |
| sârrè : serrer - y vè tsârrè lè gargouille, je vais te serrer le cou - (46) |
| sarrè : 1 v. t. Mettre à l'abri. - 2 v. t. Serrer. - (53) |
| sarre. Serre, ongle d'oiseau de proie, C'est aussi je serre, tu serres, il serre, et ils serrent, etc. - (01) |
| sarre-eu : frileux. - (29) |
| sarrer – sarter : scier - (57) |
| sarrer (v.t.) : fermer ; mettre une barre pour fermer une porte - rentrer les animaux en vue de l'hiver - (50) |
| sarrer : (vb) serrer ; rassembler les bêtes - (35) |
| sarrer : 1.serrer ; 2. enfermer, rentrer au poulailler, à l'étable ; 3. mettre en place, ranger. - (52) |
| sârrer : ranger soigneusement (dans un tiroir, un placard) - (37) |
| sarrer : rassembler les bêtes afin de les rentrer le soir venu - (43) |
| sarrer : serrer - (43) |
| sârrer : serrer - (57) |
| sârrer : serrer, ranger, placer, mettre à l'abri - (48) |
| sarrer : Serrer. « Sarrer la mécanique » serrer le frein. - Ranger, rentrer. « Sarrer du foin » : rentrer du foin. - (19) |
| sarrer la mécanique loc. Serrer les freins d'un char. - (63) |
| sarrer v. Ranger un vêtement, rentrer les bêtes le soir. - (63) |
| sarrer : ranger quelque chose - serrer quelque chose avec les poings - (39) |
| sarrer, v. ; ranger. - (07) |
| sârrer, v. serrer. - (38) |
| sârre-téte (on) : serre-tête - (57) |
| sarretier : charretier - (39) |
| sarrette n.f. Bonnet du costume charolais, doté d'un ruban de serrage que l'on nouait sous le menton. - (63) |
| sarreure (n.f.) : serrure - (50) |
| sârreûre : serrure - (37) |
| sarreure : Serrure. « La clié est après la sarreure » : la clef est dans la serrure. - (19) |
| sarreure : serrure - (39) |
| sârreure, s. f., serrure. - (40) |
| sarreure, s.f. serrure. - (38) |
| sarreûre, sarrure : serrure - (48) |
| sarriau : Cordon pour serrer. « La borse du juriau n’a pas faute de sarriau » : la bourse du joueur n'a pas besoin de cordon pour la serrer (elle est souvent vide). - (19) |
| sarrin, sciure du bois. - (05) |
| sarrin. Sciure de bois. Etym. secare, couper ; on a dû dire d'abord scarrin ou sciarrin. - (12) |
| sârr'ment : serrement - (57) |
| sarron : (nm) sciure de bois - (35) |
| sarron n.m. (du lat. serram, la scie). Sciure de bois. - (63) |
| sarron : s. m., vx fr. serrure, sciure de bois. - (20) |
| sârrotte : charrette. - (52) |
| sarrurier : Serrurier. « Ol est en apprentissage chez in sarrurier ». - (19) |
| sarsser : chercher - (39) |
| sart, s. m. défrichement, lieu inculte. - (08) |
| sarti : châssis d'un chariot - (39) |
| sarur : s. f. serrure. - (21) |
| sârure, s. f., serrure. Ignorée encore de plusieurs de nos paysans, qui n'ont que le simple loquet pour fermeture. - (14) |
| sarvaize (n.m.) : servage - (50) |
| sarvale : Cervelle. « Tête sans sarvale » : tête sans cervelle, étourdi. - (19) |
| sarvale, cervelle ; sarvô, cerveau, d'où vient ésarvelé, étourdi qui ne réfléchit pas. - (16) |
| sarvante : Servante. « Alle est sarvante chez des mossieux ». - (19) |
| sarvante, s. f., servante, support, ustensile de cuisine servant à soutenir sur le feu marmite et poêlon. - (14) |
| sarvante. n. f. - Servante. - (42) |
| sarvants : On désigne sous ce nom tout le personnel qui est de service à une noce : « cuisenière, botailli, paneté et jusqu'aux lavouses ». - (19) |
| sârve, s. f., pièce d'eau, mare. - (40) |
| sârve, s.f. étang. - (38) |
| sarve. Serve, servent. - (01) |
| sarvelle. n. f. - Cervelle. - (42) |
| sarvi : Servir. « I ne sarve à ren de se fare du mauvâ sang ». En parlant d'un mauvais domestique : « Ol est à maître chez Mau-sarvi ». - Faire son service militaire : « Ol a sarvi dans les dragans ». - Saillir. « Ma vaiche a été sarvie pa in ban teuriau ». - (19) |
| sarvi : servir - (39) |
| sarvi : v. t. Servir. - (53) |
| sarvi, v. a. servir, être au service de quelqu'un, se rendre utile. - (08) |
| sarvî, v. tr., servir, obliger. - (14) |
| sarvi. Servis, servit, servir. - (01) |
| sarvi'. v. - Servir. - (42) |
| sârviâte, s. f., blouse pour traire les vaches. - (40) |
| sarvice (n.m.) : service - (50) |
| sarvice : Service. « Ol est de ban sarvice quand an n'a faute de ren ». - Expression « rentrer du sarvice » : rentrer dans ses foyers, après le service militaire. - (19) |
| sarvice : n. m. Service. - (53) |
| sarvice : service - (39) |
| sarvice, s. m. état de domesticité, de dépendance volontaire ou non : être au « sarvice » ; se mettre en « sarvice. » - (08) |
| sarvice, s. m., service, ouvrage à faire, bon office à rendre. - (14) |
| sarvice, sm. service. - (17) |
| sarvice. Service, services. - (01) |
| sarviéte, s. f., serviette. « C'qui? ces paipiès ?. . . Y é bon à faire des sarviétes sans orlôts. » Chacun sait à quoi s'en tenir sur la nature de ces serviettes. - (14) |
| sarviette : Serviette « Eune dozain-ne de sarviettes ». « Sarviette d'enfant » : tablier à bavoir qu'on met aux enfants quand ils sont à table. - (19) |
| sarviette. n. f. - Serviette. - (42) |
| sarvisant, adj. serviable. - (17) |
| sârvissant (ai l’ot ben) : (il est toujours) prêt à rendre service - (37) |
| sarviteur, et sarviteû, s. m., serviteur. - (14) |
| sarviteur. Serviteur, serviteurs. - (01) |
| sarzer : charger - (39) |
| sas (adj.pos.pl.) : ses - (50) |
| sas, plur. de l'adj. poss. ses. - (08) |
| sasciage (on) : sarclage - (57) |
| sascier : biner - (57) |
| sascier : sarcler - (57) |
| sasc'ille (on) : cercle - (57) |
| sasière : claie de bois suspendue, pour sécher les fromages - (60) |
| s'asper - s'esper - s'empigi : trébucher - (57) |
| sasse (n.f.) : espèce de tamis où l'on étale les fromages pour les faire égoutter - (50) |
| sasse (nom masculin) : tamis. Généralement en bois sur lequel on place les fromages pour les faire égoutter. - (47) |
| sasse, s. f. espèce de tamis dont on se sert pour faire égoutter les fromages frais. Dans les villes voisines le mot équivalent est « serce. » - (08) |
| sasseau : tamis - (60) |
| sasseau : tamis. Ill, p. 49-3 - (23) |
| sasseau. s. m. Tamis, petit sas. - (10) |
| sassener (pour sasser, sassonner). v. n. Remuer les épaules. (Vassy-sous-Pisy). – Voyez sasser. - (10) |
| sâsser (se). v. - Gigoter, remuer sans arrêt, ne pas tenir en place ; probablement dérivé de « secouer avec un sas ». - (42) |
| sasser : tamiser, cribler. Il, p. 11-11 - (23) |
| sasser, tamiser. - (05) |
| sasser. v. n. Se remuer en faisant des mouvements de hanches et d'épaules, à droite, à gauche, parce qu'on éprouve une démangeaison dans le dos. (Auxerre, Saint-Martin-sur-Ouanne). - (10) |
| sassier. n. m. - Fabricant ou marchand de « sas », de tamis. (M. Jossier, p.l12) - (42) |
| sassier. s. m. Fabricant ou marchand de sas, de tamis, de cribles et autres produits de l'industrie du Jura. (Puysaie). - (10) |
| sâssis : seuil - (39) |
| sat : Sept. « Ol a ésu sat enfants ». (La liaison se fait devant une voyelle). - (19) |
| sate : petite branche flexible servant de fouet. A - B - (41) |
| sate (fouaille): fine baguette de bois souple qui servait d'instruments de correction - (51) |
| sate : (nf) badine, baguette - (35) |
| sate n.f. Baguette, badine. - (63) |
| satée : forte pluie battante. Correction infligée à un enfant. A - B - (41) |
| sater : (vb) fouetter avec une « sate » - (35) |
| sater : taper avec une fouaille (fine baguette de bois souple) - (51) |
| sater : tasser - (60) |
| sater v. Cingler avec une sate. - (63) |
| sater : tasser. Ex : "Si tu veux tout mett' va falloué sater !" - (58) |
| sater. Ensacher ; entasser ; presser. - (49) |
| saterion : bruit - (60) |
| sati, v, a. serrer, tasser longuement. - (22) |
| sati, v. a. serrer, tasser longuement. - (24) |
| satie, s. f., grand seau en bois pour la lessive. - (40) |
| satié, s.f. pitié. - (38) |
| sâtié, vt. sarcler, pp. sâtié, satjiè. - (17) |
| satième : Septième. - (19) |
| sâtiou, sm. sarcleur. - (17) |
| satisfare : Satisfaire. « An ne peut pas satifare totes ses fantaijies ». - (19) |
| sâtron : bœuf châtré - (39) |
| satrouiller : laver quelque chose très mal. (CH. T II) - S&L - (25) |
| satsi, seutsi , stsi v. Sécher. - (63) |
| satso (beurli): petit sac - (51) |
| satso : sachet - (43) |
| satsot n.m. Sachet, petit sac. - (63) |
| satte : petite branche flexible servant de fouet - (34) |
| satte, vredze : petite branche flexible servant de fouet - (43) |
| sattée : forte pluie fouettante - (34) |
| sattée : forte pluie fouettante - (43) |
| satter : fouetter avec une petite branche - (43) |
| satter : tasser - (61) |
| satye, cercle. - (26) |
| satyer, sarcler. - (26) |
| saty-in, sarclette. - (26) |
| sau (d'la) : sel - (57) |
| sau (la) : sel - (43) |
| sau : (genre hésitant) sel - (35) |
| saû : chaud. - (52) |
| sau : Sel. « De la sau plée » : du sel pilé, du sel fin. - (19) |
| sau adj. Sec. Au féminin, seutse. - (63) |
| sau n.m. Sel. (Ce mot a tendance à se perdre comme d'autres se terminant en "el" tels que gel, dégel (dzau, dédzau). - (63) |
| sau plé, sau fine : sel fin - (43) |
| sau, s. f. sel. Sau pelée, sel fin, autrefois pilé au mortier. - (22) |
| sau, s. f. sel. sau pelée, sel fin, autrefois pilé au mortier. - (24) |
| sau, s. f., sel : « Ton bouillon é fadasse ; mets-y donc eùne bonne pincée d’sau. » - (14) |
| sau, sel. - (05) |
| sau, sel. - (16) |
| sau, soiche. adj. Sec, sèche. (Etivey). - (10) |
| sau. Sel. Ce mot est féminin. Il a formé autrefois saunier, saumure, saupiquet, etc. - (03) |
| saûb'illage (on) : sablage - (57) |
| saûb'ille (du) : sable - (57) |
| saûb'iller : sabler - (57) |
| saûb'illeux : sableux - (57) |
| saub'illire (na) : carrière de sable - (57) |
| saûb'illire (na) : sablière - (57) |
| sauce - saule. - Le Pierrot é tondu ses sauces hier. - I ai envie de pliantai des sauces le long de lai rivére. - (18) |
| sauce : saule - (48) |
| sauce : s. m., saule, Plusieurs hameaux ou écarts du département sont ainsi dénommés. - (20) |
| saucé : s. m., trempette. - (20) |
| sauce, sauche, sauge, s. m. saule en Morvan et en Bourgogne. Dans l'Yonne les oseraies sont des « saucies. » - (08) |
| saucée, s. f., averse, pluie vigoureuse qui met les gens à une jolie sauce. (V. Trempée, Rincée, etc.) - (14) |
| sauceron : n. m. Champignon. - (53) |
| sauceron, champignon. - (05) |
| sauceron, n.m. champignon. - (65) |
| sauceron, s. m., champignon. - (14) |
| sauceron, s. m., saucière, vase de terre à mettre la sauce. - (14) |
| sauceron. Champignon, probablement parce qu'on le met dans les sauces. - (03) |
| saucerons : champignons. (RDF. T III) - A - (25) |
| sauces, bas - (36) |
| saucette, s. L, mouillette trempée dans la sauce. - (14) |
| sauciére (na) : saucière - (57) |
| saûcler : sarcler. pour désherber. - (62) |
| saûclot : sarcloir. Équivalent de la houe. - (62) |
| saude : saule. - (30) |
| saudze : (nm) saule - (35) |
| saudze : sauge - (51) |
| saudze : saule - (43) |
| saudze n.m. Saule. - (63) |
| sauellier, sarcler. - (05) |
| saufre que, soffre que, loc. sauf que, avec réserve que : j'irai te voir, « saufre que » j'en sois empêché. - (08) |
| saufre, et sauv', prép., sauf, excepté : (« J'veinrai vous vouér, saufre l'hivâr. » — « Lu ? Y ét ein goret, sauv'vote respèt. » - (14) |
| saugale. s. f. Cigale. – Voyez binaile. (Joigny). - (10) |
| saûge (on) : saule - (57) |
| sauge : Sauge des prés, salvia pratensis. Il existait autrefois une coutume qui consistait à donner un bouquet de sauge à un prétendu évincé, le jour du mariage de son rival et une vieille chanson disait : « Faites moi z 'un bouquet. Un beau bouquet de sauge. J'ai fait l'amour pour d'autres. D'autres le feront pour moi. Adieu ! belle, je m'en va ». - (19) |
| sauge : Saule, salix alba. « In sauge bernoux » : un saule creux. « Eune tête de sauge » : un saule exploité en têtard. - (19) |
| sauge, n.m. saule. - (65) |
| sauge, s.m. saule. - (38) |
| sauge, saule. - (05) |
| sauge, sause, et saus, s. m., saule. — Lorsqu'une jeune fille a été délaissée par son amoureux et qu'il en épouse une autre, les jeunes gens du pays vont couper des branches de saule et les plantent devant la porte de l'abandonnée. - (14) |
| sauge. Saule. - (49) |
| sauge. Saule. En latin, salignus, saligneus, de saule. - (03) |
| sauge. : (Dial. et pat.) Du rég. latin salicem. Saule. (Charte desfranch. d'ls-sur-Tille, 1369.) D'où sauciz et saussoie, qu'on lit dans les chartes pour un lieu planté de saules. - (06) |
| saugeret : s. m., moineau friquet (passer montanus). - (20) |
| Sauieu : Saulieu - (48) |
| saulaizer (v.t.) : soulager - (50) |
| saulcière (prononcez saucière). s. f. A Joigny, petite levée qui se fait au bas d'une vigne à pente rapide, transversalement aux perchées, pour arrêter les terres, et qui est ainsi appelée, parce que, généralement, elle est plantée d'osiers ou de petits saules. Voyez saulcis. - (10) |
| saulcis. s. m. Plantations d'osiers. - (10) |
| sauler (n.m.) : fenil sur le plancher d'une grange (aussi solier) - (50) |
| Sauleu pour Saulieu, ville frontière du Morvan bourguignon. - (08) |
| saulx. Substantif féminin, synonyme de sel. An faut mette ben de lai saulx su lai viande pour lai consarver pendant les cainicules. Un usage bizarre et quelque peu superstitieux est encore pratiqué dans les villages du Beaunois : lorsqu'un petit enfant vient pour la première fois dans une maison, on lui offre, en bon présage, un œu et de lai saulx. - (13) |
| saumas. s. m. Lieu humide dans les prés. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| saumeure : (nf) saumure - (35) |
| saumeûre n.f. Saumure. - (63) |
| saumeùre, s, f., saumure. - (14) |
| saumeure, s. f. saumure, eau saturée de sel. - (08) |
| sauné : Petit garçon turbulent n'ayant aucun soin de la propreté de ses vêtements. - (19) |
| saupiat : Mal appris, goujat. - (19) |
| saupiat : personne malpropre, négligée. (VSLD. T II) - S&L - (25) |
| saupiât, s. m., travailleur peu soigneux. - (40) |
| saurnouais (-e) (adj. et n.m. et f.) : sournois, sournoise - (50) |
| saus (prép.) : sous - (50) |
| sauseri, s. m., espèce de moineau, qui niche principalement dans les saules. Vient naturellement de notre mot sauge. (V. Passerâ, et Tiri.) - (14) |
| saussaie : une plantation de saules - (46) |
| sausse : un jeune saule qui donne de l'osier - (46) |
| sausse : chaussette - (39) |
| sausson : chausson - (39) |
| saut, s. m. chute, cascade : le Saut-de-Gouloux, le Saut-du-Loup, petites cascades près de Montsauche et de Moulins-Engilbert : le Saut-de-Villemouson près de Saint-Père. - (08) |
| saute (à la), à l'abri de la pluie. - (27) |
| sautè è lè queûsserotte : sauter à cloche-pied - (46) |
| saute- en-barque, s. f., redingote courte, à l'instar des vestons de pêcheurs, commode pour sauter en bateau, et que portaient les jeunes gens à l'entour de 1830. - (14) |
| saute goyat : accompagnateur du prétendant de la jeune fille à marier - (43) |
| saute-couillat : s. m., saute-ruisseau. Voir gouillat. - (20) |
| saute-goïllat n.m. Chaperon, entremetteur. - (63) |
| saute-gouillò, s. m. saute-ruisseau. Celui qui accompagne un prétendant dans ses démarches. - (22) |
| saute-göya : (nm) « saute-ruisseau » ; accompagnateur du prétendant d’une fille à marier - (35) |
| saute-goyat, s. m. saute-ruisseau. Celui qui accompagne un prétendant dans ses démarches. - (24) |
| saute-loga : frivole. - (29) |
| saute-mottes. s. m. Bergeronnette. (Armeau). - (10) |
| saûter d’chus l’pouai : « sauter sur le poil », disputer - (37) |
| sauter : posséder sexuellement. D'usage essentiellement masculin et ne nécessitant ni consentement ni partage. Le vocabulaire urbain (contemporain du mot patoisant ? ou postérieur ?) le nuancerait d'une signification moins brutale, quoique d'une vulgarité très similaire. Ex : "Il a pas été long à la sauter, la fumelle !" - (58) |
| Sautereau. Nom de famille fort répandu dans le pays. - (08) |
| sauterelle : s. f., puce. - (20) |
| sauteriau : Marcotte, provin. « Fare des sauteriaux» : provigner. - (19) |
| sauteriau : sauterelle. IV, p. 28 - (23) |
| sauteriau : petit asticot souvent dans le fromage ou le jambon. - (33) |
| sauteriau s. m., sauterelle. - (14) |
| sauteriau, sauteriot. s. m. Sauterelle. (Chigy). - (10) |
| sauteriaud adj. Turbulent, agité (pour un enfant). - (63) |
| sauterie, s. f., sauteuse, danse rapide et mouvementée, qui s'exécute presque toujours au son enfiévrant du tambour, et qui termine nos farandoles. - (14) |
| sauterilli : Sautiller, gambader. « O n'est pas d'arrate de sauterilli » : il ne cesse pas de gambader. - (19) |
| sauterio (riot ou riau) : sauterelle. - (58) |
| saute-sâssis : se dit de quelqu'un qui va toujours chez les autres - (39) |
| sauteuse, s. f. danse du pays analogue aux bourrées de l'auvergne et du bourbonnais. - (08) |
| sauteux n.m. Barre de bois fixée contre des barbelés pour faciliter leur franchissement. Lorsque c'est une haie qu'il faut franchir, on utilise un étséli. - (63) |
| sauteziau. s. m. Ver de fromage. (Percey). - (10) |
| sautot (n.m.) : passage d'une haie par deux échelles adossées - (50) |
| sautot : (sô:to - subst. m.) petite palissade qu 'on ménageait dans une haie pour en permettre le franchissement, à l' usage des chasseurs. - (45) |
| sautot : passage aménagé pour franchir une haie - (48) |
| sautou (on) - sautralou (on) : sauteur - (57) |
| sautraler : sauter (sur place) - (57) |
| sautralle (n.f.) : sauterelle - (50) |
| sautralle (na) - boutchine (na) : sauterelle - (57) |
| sautralle : sauterelle - (48) |
| sautralle : sauterelle. L'été les champs étint pleins de sautralles : l'été les champs étaient pleins de sauterelles. - (33) |
| sautralle, s. f. sauterelle. - (08) |
| sautralle, sautrau : n. f. Sauterelle. - (53) |
| sautreiller, v. n. danser en sautant, danser lourdement, avec gaucherie. - (08) |
| sautreuyi : (vb) sautiller - (35) |
| sautreyi : sautiller - (43) |
| sautu (nom masculin) : sorte d'échelle double pour franchir les clôtures (voir échailler). - (47) |
| sauvadze : sauvage - (51) |
| sauvadzin n.m. Sauvageon, rejet sauvage d'arbre greffé. - (63) |
| sauvadzon : (nm) pommier sauvage ; rejet d’arbre - (35) |
| sauvadzon : pommier sauvage - (43) |
| sauvadzon : sauvageon (porte greffe sauvage) - (51) |
| sauvage : Adjectif, se dit du temps, lorsque le vent souffle en bourasques. - (19) |
| sauvage, adj. se dit du temps, lorsque le vent souffle par bourrasques : c'est sauvage, ce matin. - (24) |
| sauvageot. Sauvageon, jeune arbre à greffer. - (49) |
| sauvagin : Sauvageon. « Enter in sauvagin » greffer sur un sauvageon. - (19) |
| sauvai. Sauvé, sauvés, sauver. - (01) |
| sauvaige, adj. sauvage. - (08) |
| sauvaize (n. et adj.m. et f.) : sauvage - (50) |
| sauve - sauvé ; hors de danger. - Al â étai bein mailaide ; ma métenant al â de sauve. - Voiqui l'hyver passai, i sons de sauve. - (18) |
| sauve : Sève. « i faut se dépôchi d'écôrcer le beu padant qu'ol est en sauve ». - (19) |
| sauve : adj., sauvé. - (20) |
| sauve, adj. des deux genres, sauvé, vée : « Ol a été ben mau ; ma ô va mieù. . . le v'là sauve. » — « Y é c'ment la vaque à Nicot. Alle étòt bourenfe ; alle é sauve itou. » - (14) |
| sauvé. Sauvez, à l’impératif. - (01) |
| sauvellöt, sauvillöt,sm. troène. - (17) |
| sauveu. Sauveur. - (01) |
| sauvillain : troène. (CLF. T II) - D - (25) |
| sauvillô, troëne, arbuste. - (02) |
| sauvillô. : Troëne, arbuste. - (06) |
| sauvò. Sauvais, sauvait. - (01) |
| sauvon, et savon, s. m., savon. - (14) |
| sauvon, s.m. savon. - (38) |
| sauvon, savon. - (05) |
| sauvou , creux d'eau où on lave. - (05) |
| sauvou. Petit réservoir d'eau de source. - (03) |
| sauvouchi (n.f.) : chauve-souris - (50) |
| savai : enlever l'écorce ou l'épiderme, écorcher. Je me suis savé : je me suis écorché. - (33) |
| savar, v.savoir. - (38) |
| savater : Saveter, gâter la besogne. « Y est de l'ovrage savatée ». - (19) |
| save. n. f. - Sève. - (42) |
| savée : haie. - (33) |
| savée. s. f. Haie vive. (Bessy). - (10) |
| saver : érafler, enlever l'écorce, écorcher - (48) |
| saver : faire sortir la sève. - (09) |
| saver : séparer l'écorce du bois. Voir flûteau. V, p. 25 - (23) |
| saver, frapper l'écorce de saule. - (05) |
| saver. Expression dont se servent les enfants, et qui signifie faire sortir la sève du saule, en le frappant avec un manche de couteau pour en fabriquer des sifflets. Ils accompagnent cet exercice d'une sorte de mélopée. - (03) |
| saverot : mélange de vin et de bouillon. - (30) |
| savoi : Savoir. « Est-ce qu'an peut savoi ? » : peut-on savoir ? Au participe passé fait savu : « Te n'as pas savu t'y prendre ». - (19) |
| savoi, saoi : savoir - (43) |
| savoïa : Savoyard, ramoneur. - (19) |
| sàvonade, s. f., savonnage : « J'évò bé du linge sale. J'lai métu à tremper, é pi c'tantôt j'ai fait ma sâvonade. » - (14) |
| savonnade. Savonnette. On désigne la saponaire sous le nom « d'herbe de la savonnade ». - (49) |
| savouai : n. et v. t. Savoir. - (53) |
| savouair : savoir - (57) |
| savouair-fére (on) : savoir-faire - (57) |
| savouair-vivre (on) : savoir-vivre - (57) |
| savouér mau, loc, savoir mauvais gré, être fâché, prendre en mauvaise part : « O m'a savu mau d'li avouér dit ça. » - (14) |
| savouér,v. tr., savoir, connaître. - (14) |
| savouère, saouère. v. - Savoir. - (42) |
| savu, part, de savouér, su : « Drè qu'ôl a savu c'qui, ôl a còri li pourter quéte chouse. » - (14) |
| sav'vous ? loc. contractive, savez-vous ? - (14) |
| sawoî v. Savoir. - (63) |
| säyau : (nm) portillon - (35) |
| sàyé, v. a. faucher. - (22) |
| sayer, seyer : v. a., lat. secare, faucher. - (20) |
| sàyer, v. a. faucher (du latin secare). - (24) |
| säyi : (vb) (surtout à Matour) faucher - (35) |
| sayo : petit portail latéral. Portillon à l'entrée de la ferme. A - B - (41) |
| sâyon (n.f.) : saison, été - (50) |
| sâyon (n.f.) : saison ; été - (50) |
| sâyon : saison - (39) |
| sayoux : Faucheur. « Saint-Liaude était in fameux sayoux ». - (19) |
| sâze : Seize. « San garçan a déjà sâze ans ». - (19) |
| saziée : panier pour sécher les fromages - (61) |
| sazière (nom féminin) : panier plat à claire-voie dans lequel on fait sécher les fromages. - (47) |
| s'bâssè : se baisser - (46) |
| s'bêler, v. réfl. s'appeler, se rechercher, se désirer l'un l'autre. S'emploie surtout au figuré. On dit, par exemple, que les épis « s'bèlan » dans un champ où ils sont rares et distants les uns des autres. - (08) |
| s'bouliguè : se dépêcher - (46) |
| scabillard, arde. adj. Vif, mutin, dissipé. (Villeneuve-sur-Yonne). Du latin scaber. - (10) |
| scéléreu, euse, adj. méchant, mauvais, dangereux. Ne s'emploie guère que dans une locution du Morvan nivernais où l'on dit : le temps est « scéléreu » lorsque le ciel est couvert de grosses nuées d'orage. - (08) |
| scerein. Saurions, sauriez, sauraient. Je ne scerein chantai, nous ne saurions, nous ne pouvons chanter… - (01) |
| scerò. Saurais, saurait. On ne scerò li palai, on ne saurait, on ne peut lui parler. La raison qui a oblige d’écrire scerò pour serò est la même aue celle qui a fait écrire scerein pour serein. - (01) |
| s'cher. v. - Sécher. - (42) |
| schie (aine) : (une) scie - (37) |
| schie (n.f.) : scie - (50) |
| schii, six. - (38) |
| schîler : scier - (37) |
| schiler, v. n. siffler à la manière des serpents. L'oie « schile » pour défendre ses petits. - (08) |
| schlam, chlam : n. m. Boue résultat du lavage du charbon. - (53) |
| schloff (aller à). Aller au lit. (Ce mot n'est pas particulier à Montceau). - (49) |
| sciâ : clair - (57) |
| sciâ, s.m. bouchon de tonneau, bonde. - (38) |
| scia. Scialer. Prononciation patoise des mots sceau et sceller. Le sciâ est une petite bonde qui ferme le haut d'une futaille. - (13) |
| scialè : 1 v. t. Ceinturer. - 2 v. t. Cercler. - 3 v. t. Sceller. - (53) |
| sciâler, et siàler, v. tr., fermer hermétiquement, cacher, bondonner une futaille : « L'pâre Tournas a fini de sciâler son tonneau. » — « L'argent é sciàlé dans l'ormoire. » - (14) |
| sciâler, v. sceller, boucher un tonneau avec un "sciâ" entouré d'une patte (chiffon). - (38) |
| scian (on) : côté - (57) |
| scian (on) : flanc - (57) |
| sciape (na) : main (grosse) - (57) |
| sciatte (na) : nuque - (57) |
| sciau, s.m. outil de tonnellerie pour "sciâler". - (38) |
| sciavaû (on) : hameçon - (57) |
| scié (na) : clé - (57) |
| scie, chie : scie - (48) |
| scienssou, instruit. - (26) |
| scière (na) : clairière - (57) |
| scieupeter - cligni - scieuper - scieumeuter : cligner (rapidement) - (57) |
| scieupeuter - scieumeuter : ciller - (57) |
| scieux d'long. n. m. - Scieur de long. Autre sens : petits moucherons se déplaçant en bandes verticales, et dont le mouvement rappelle le geste du scieur de long. (Sougères-En-Puisaye) - (42) |
| sciller. v. - Enlever les feuilles d'une petite branche ou d'une plante en faisant glisser la tige dans la main ; synonyme de assiller. - (42) |
| sciô (on) : barrière (petite) - (57) |
| sciô (on) : portillon - (57) |
| scioche (na) : cloche - (57) |
| sciochi (on) : clocher - (57) |
| sciϞre : n. f. Sciure. - (53) |
| scion (on) - têtre (na) : tarte - (57) |
| scion d'bô : le scieur de bois - (46) |
| scion. n. m. - Crasse du cochon. (Mézilles, selon H. Chéry) - (42) |
| sciotte. s. f. Scion, baguette, rejeton, jeune branche destinée à être greflée. - (10) |
| sciou (on) : clou - (57) |
| scioûler : clouer - (57) |
| scirotter, scier avec mauvaise scie. - (05) |
| sciuet (on) : fouet - (57) |
| sciuetter : fouetter - (57) |
| sclate. : (Dial.), tribu. La sclate Levi (Rois). Du latin scala. - (06) |
| scoffion. : Ornement de luxe, sorte de franges ou brindilles d'or ou d'argent, qui se portait au XVIe siècle. (Du latin scopius.) - (06) |
| scorbut, s. m. scorbut, maladie de la bouche. Nos paysans se servent souvent du pluriel : il a les « escorbus. » nous disons escorbut, escorpion, escandale, esquelette, estatue, etc… - (08) |
| scorre : v. secouer. - (21) |
| scouillou n.m. Panier à salade. - (63) |
| s'couisè : se taire - s'couisè-vo don ! taisez-vous donc - (46) |
| scouœur : n. m. Secoueur. - (53) |
| s'coûr : secouer - (57) |
| s'cours-gens. (Voyez escourgens). - (10) |
| scoussé, vt. secouer ; pp. secoussu. - (17) |
| sco-you : panier à salade - (43) |
| scrafe. : Nageoire. (Du haut allemand moyen schrafen, selon M. Burguy.). - (06) |
| s'crampir : se mettre au travail - (46) |
| screu : soleil. - (66) |
| scrupule : s. m., ancienne mesure de poids, correspondant au 1/3 du gros, comme le denier, et valant 1 gramme 274. - (20) |
| scupir, cracher, keuper. - (04) |
| scyer. v. a. Secouer, cahoter. (Saint-Florentin). - (10) |
| s'décanillè : se lever tôt - (46) |
| s'décharbouillè : se débarbouiller - (46) |
| s'déforé : v. pr. S'emballer. - (53) |
| s'déshèbillè : se déshabiller - (46) |
| sé (n.m.) : sel - (50) |
| sè : pronom pers. lui, elle. - (21) |
| se : sec - (43) |
| se cô'iller : se taire - (48) |
| se dabiller : se déshabiller - (61) |
| sé de neurin : une tête de cheptel - (39) |
| se dépatouiller : se débrouiller - (44) |
| se dit : s'faire stsi (satsi :sécher). - (63) |
| se fa*, loc. oui, cela est. Son opposé est ne fa, non, cela n'est pas. - (22) |
| se gaunier : s'habiller - (44) |
| se goler : se gratter - (48) |
| se grouiller : se dépêcher - (44) |
| se lapper : se mettre au travail, se prendre (dispute ou bagarre) avec quelqu'un - (48) |
| se mettre à l'essotte (esseute) : abriter (s) - (57) |
| se piéci, parti en maître : se louer comme servante - (43) |
| se pouiller : se gratter - (44) |
| se pron. Remplace le second nous ou vous dans la conjugaison des verbes réfléchis. Nos s'envindrans renque aprés la messe. Vous s'promnez, vos ez bin raison. - (63) |
| se rabyi : se rhabiller - (43) |
| se retaper : prendre des forces - (44) |
| se revarper : se défendre - (44) |
| se revorcher : se retourner - (44) |
| se r'giper : réagir, se remuer - (48) |
| se r'peûsè : se reposer - (46) |
| se r'quinquè : reprendre des forces - (46) |
| se r'varpè : se rebiffer, se retourner brusquement pour répondre, rétorquer, réagir, faire face - (46) |
| se r'verper : se rebiffer, se rebeller - (48) |
| se sitter : s'asseoir - (44) |
| se s'ter : s'asseoir - (57) |
| se vaner : se vautrer dans la poussière (pour les poules) - (43) |
| se vautrer : mal se tenir - (44) |
| se : pron., remplace incorrectement le second nous ou vous dans la conjugaison des verbes réfléchis. Nous se marierons la semaine prochaine. Où donc que vous avez été se promener ? - (20) |
| sè : s. m. soif. - (21) |
| sè : s. m. soir. - (21) |
| sé : sel - (39) |
| se, adj., second. Est l'abréviation de ce mot. Employé par les enfants dans leurs jeux pour se compter. - (14) |
| se, pron. pers., employé pour : nous, vous : « Vous s'portez ben ? » — « Aujòrdeu dimanche, nous s'preùm'nons su la levée. » - (14) |
| se, pronom de la 3e pers. S'emploie pour nous et vous avec un verbe pronominal : nous « s' porton bin », nous « s' parlon » tous deux etc… - (08) |
| sé. adj. posses. fém. Sa. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| se. Ses, pluriel de son et de sa. On écrit se devant une consonne, ses devant une voyelle, sé pairan, sés enfan, ses parents, ses enfants. - (01) |
| sébin : sabot. (PLS. T II) - D - (25) |
| sèbin, sabot. - (26) |
| sec (ai), loc. adv. se dit d'un mur construit à pierres sèches, c’est à dire sans mortier : ce champ est clos de murs à sec. - (08) |
| sec : s. m. Gout de sec. Se dit du tonneau qui n'a pas été soigné après dépotage et qui, sans être moisi, n'a pas bon goût et ne prend pas la mèche. - (20) |
| séca ou secca : Terme vague qui désigne une chose quelconque, comme les mots : chose, machin, affaire « Qu'est-ce qu y est dan que s'te séca ? ». - Une quantité indéterminée. « Ments voir eune séca de poivre dans la sope » : mets du poivre dans la soupe. - (19) |
| sèche : sac de toile de jute, généralement grand. Nom féminin. - (62) |
| sécher : v. a. Se faire sécher, se pendre. - (20) |
| secheron, s. m. petit furoncle. - (24) |
| sécheron. s. m. Paisseau de rebut. (Annay-sur-Serein). - (10) |
| s'èchetè : s'asseoir - (46) |
| sécho. Sac, petit sac. - (03) |
| sèchot (on) : sac (en papier) - (57) |
| séchot (pour sachot). s. m. Petit sac. (Avallonnais, Auxerrois). - (10) |
| séchouaîr (on) : séchoir - (57) |
| seclet (en). loc. adv. - À l'abri, à couvert ; synonyme de écoué. Déformation de l'expression « en secret ». (Saint-Privé, selon M. Jossier) - (42) |
| seclet (En). Locut. adv. A l'abri, à couvert. Se dit sans doute pour en secret, par conversion de l’r en l. V'nez vous mettre en seclet. (Saint- Privé). - (10) |
| secòr, et s'cor, s. m., secours. - (14) |
| secor, s. m. secours, assistance. Le mot se contracte le plus souvent en s'cor. - (08) |
| secòrî, et s'còrî, v. tr., secourir. - (14) |
| secorre, s'cori, v. a. secourir, porter secours, donner de l'appui, faire l'aumône. - (08) |
| sécot : fluet, homme grand et maigre - (37) |
| sécòt, adj,, sec ; au figuré, égoïste : « Lu ? ô n'doune jamâ ran ; y et ein sécòt. » - (14) |
| sécot. Nom sous lequel on désigne un individu maigre, décharné. - (49) |
| secouade, s. f. secousse, assaut : une « secouade » de grêle, de pluie. - (08) |
| secouer : vider en secouant - (48) |
| secourre : secouer. - (29) |
| secretâre : Secrétaire, secrétaire de mairie. « J'ai pas troué le mâre mâ j'ai vu le secretâre ». - (19) |
| sectembe, s. m. septembre : j'irai vous voir en « sectembe. » - (08) |
| secuyer. v. a. Secouer. (Bligny-en-Othe). - (10) |
| sède, adj. sucré, sapide (du latin sapidus). - (24) |
| séde, savoureux, en parlant du pain, d'un fruit, etc. - (16) |
| sède. Intraduisible. On dit du pain ou du fromage, quand ils ont bon gout, un gout appétissant et sûr de fraicheur ou de bonne qualité, qu'ils sont sèdes. Origine inconnue. - (12) |
| sêdli : s. m. chandelier. - (21) |
| sêdole : s. f. bougie. - (21) |
| sée : 1 n. m. Saint. - 2 adj. poss. Ses. - (53) |
| sëgnie, sèngnie, saignée ; sëguiè, sènguié, saigner ; te m'sèngnie, dit une personne à une autre qui l'importune et la fatigue. - (16) |
| segnoule, s. f. manivelle. Verbe segnouler (langage plaisant) (du vieux français soignoile. Latin ciconiola). - (24) |
| segnoule, s. f. manivelle. Verbe : segnoulé (langage plaisant). - (22) |
| segoiller, secouer, remuer. - (05) |
| segolè : se frotter contre les murs, un pieu, pour se gratter (en parlant des animaux). (RDT. T III) - B - (25) |
| segoulli, v. a. secouer longuement. - (22) |
| segouyi, v. a. secouer longuement. - (24) |
| ségre, v. a. suivre, venir à la suite, poursuivre. - (08) |
| segret : Secret, recette merveilleuse. « O cougnait in segret pa guéri les breuleures, o sait la prière ». Voir prière. - (19) |
| segreute : batteuse manuelle (machine bruyante) - (43) |
| segrot, segroter, cahot, cahoter. - (05) |
| ségu, part, passé du verbe « ségre » = suivre. Suivi, poursuivi. Nous disons plus souvent « suivu. » - (08) |
| ségue (v.t.) : suivre - (50) |
| seguer : v. a., suivre ; tirer au jeu pour savoir qui fera telle ou telle chose. - (20) |
| segueyi, grouler : secouer - (43) |
| seguez ( provençal et latin, sequor), suivez ; seguez lai sente, suivez le sentier. - (04) |
| seguiée (n.f.) : sécheresse - (50) |
| seguiée, sécheresse - (36) |
| sei. Sel. Grain de sei, figurément c’est le baptême, à cause du grain de sel bénit que le prêtre met dans la bouche de l’enfant qu’il baptise… - (01) |
| seiché. Sachez. On a écrit seiché plutôt que saiché, pour mieux marquer la prononciation. - (01) |
| seichez, imp. de savouér, sachez : « Seichez ben, vieux malin, qu'vous n'valez ran du tout. » - (14) |
| séier, se rapproche beaucoup plus de sedere que le français s'asseoir. Marci ben : i seus trop preissé pour me séier... - (13) |
| seigle, sorte de blé, en latin secale. (Pline. ) - (02) |
| seigne n.f. Ravin, creux, crevasse. - (63) |
| seigne : voir saigne. - (20) |
| seigneurie : droit, puissance, autorité d’un seigneur. Territoire sur lesquels s’étendait cette autorité. - (55) |
| seigni : parc à porcs - (34) |
| seiguie. s. m. Seigle. (Vassy-sous-Pisy). Nous supposons que l'instituteur qui nous donne ce mot a voulu, en l'écrivant ainsi, indiquer qu'il se prononce en mouillant le gl de seigle. (Seille). - (10) |
| seilée, galette à l'huile et au sel. On dit salée dans le Châtillonnais. C'était l'usage, dans les familles, de collationner avec ce simple mets, le jour du Vendredi saint. En latin, sal et sale, sel. - (02) |
| seilée. : Galette à l'huile et au sel. - C'était l'usage dans les familles de collationner avec ce simple mets pendant les jours d'abstinence. - (06) |
| seillâ : paille de sarrazin, personne malingre - (39) |
| seillaud : portail - (44) |
| seille : seigle. - (52) |
| seille : seigle. - (33) |
| seille : s. f. seau dans lequel on trait les vaches. - (21) |
| seille : s. f., seau. - (20) |
| seille, s. f., seau, baquet, vase de bois qui sert dans le ménage et aux vendanges. Petit seau pour traire les vaches. - (14) |
| seille, s. m. seigle. - (08) |
| seille, seigle - (36) |
| seille, seigle. - (04) |
| seille. n. m. - Seigle. - (42) |
| seiller. s. m. Evier ; sans doute parce les seaux, les seilles se mettent habituellement sous la pierre d'évier. (Lindry). - (10) |
| seillet : s. m., seillette : s. f., vx fr., seau ; petit baquet de bols, dont deux douves opposées sont plus longues que !es autres et percées d'un trou pour permettre le port de l'ustensile. Sert à la vendange, au lavage, etc. - (20) |
| seilleton : s. m. même sens que seille , dont il est le diminutif. - (21) |
| seilleton, seillaton : s. m., petit seillet n'ayant qu'une douve plus longue et percée d'un trou. Sert à traire les vaches. - (20) |
| seilli, v. a. sortir ; ôter (du vieux français saillir). - (24) |
| seilli, v. a. sortir ; ôter. - (22) |
| seilli, v. a. sortir. indic. présent : i seille, teu seille, a seille, i seillon, vo seille, a seillan : sors d'ici, « seille d'iqui »; « al ô seilli», il est sorti. - (08) |
| seillie (ai lai), loc. a la sortie au sortir de : « lai seillie » d'un bois, d'un champ, etc. - (08) |
| seillie, s. f. charge d'eau : une pleine « seillie. » - (08) |
| seillieu : portillon. (S. T IV) - S&L - (25) |
| seillon. Sillon. - (49) |
| seillot : un seau - è pleut ô seillot (en fou ô seillot) il pleut à seau - (46) |
| seillot, saillot n.m. Portillon. - (63) |
| sein. Soyons, soyez, soient. Il faut trainer la prononciation de ce subjonctif sein. - (01) |
| seinère : s. f., bavette de tablier. - (20) |
| seins - autre orthographe de sains, et encore quelques exemples. - Si saivâ qu'à seint chez lo tantôt, i iras les voué. - Qu'à seint tojeur gentis. - Que vos seins bein tranquilles, en n'y é point de danger. - (18) |
| seins, impér. et subj. d'être, soyez, soyons : « Y a pas d'danger que j’seins si bêtes ; je l'counassons. » - (14) |
| seinti v’nî (ai yaivot) : (il y avait) prévu d’arriver - (37) |
| seinties (dâs) : (des) senteurs - (37) |
| seiterie : anémie - (39) |
| seiye (n.m.) : seigle - (50) |
| seiye n.m. Seigle. - (63) |
| séjòr, s. m., séjour, résidence. - (14) |
| séjor. Séjour. - (01) |
| sékié, longue sécheresse. - (16) |
| s'elarder : tomber à plat - (44) |
| sélébral, cérébral ; la fièvre sélébrale. - (16) |
| sélède. Salade. - (49) |
| sélinot, s. m., boîte pour mettre le sel. - (11) |
| selle : (nf) tabouret - (35) |
| selle : chaise. - (52) |
| selle du bon Dieu (A la) : loe., sur quatre mains entrecroisées. Porter un enfant à la selle du bon Dieu. - (20) |
| selle : s. f., vx fr., petit banc de bois. - (20) |
| selle, « L » chaise, sella. - (04) |
| selle, chaise - (36) |
| selle, n.f. tabouret à trois pieds pour la traite des vaches. - (65) |
| selle, s. f. selle, escabeau, siège bas à l'usage des enfants. Dans quelques localités « salle. » - (08) |
| selle, sellon : tabouret à traire à trois pieds - (43) |
| selle. n. f. - Tabouret à trois pieds, utilisé pour la traite des vaches. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| selle. Siège de bois. La selle à traire est un petit escabeau grossier. Une selle de bue est le tréteau à trois pieds qui supporte le cuvier à lessive. Porter à la sellette est un jeu d'enfant. Deux personnes se prennent fortement, l’une la main droite, l'autre la main gauche, et asseoient l'enfant sur cette chaise vivante, en le soutenant avec les deux mains libres. Relève-selle. Festin d'adieu que l'on donne le lendemain ou quelques jours après une fête... - (13) |
| sellette : s, f., trépied en bois sur lequel on pose le ras avant de le placer sur la charte. - (20) |
| sellon : petit banc pour poser les pieds - (43) |
| sellon : repose-pieds - (35) |
| sellon : s. m., petite selle basse. - (20) |
| sellote, s. f. sellette, escabeau. en plusieurs lieux de la région « sallote. » - (08) |
| sèlope. Salope. - (49) |
| sèloperie. Saloperie. - (49) |
| selotte (nom féminin) : petit siège d'enfant. - (47) |
| sèlou : un saloir - (46) |
| semain', s mein-ne : n. f. Semaine. - (53) |
| semaine (Sur) : loc., en semaine. J'irai un jour sur semaine. - (20) |
| semaingne : semaine. - (29) |
| semain-ne : Semaine. «La semain-ne que vint » : la semaine prochaine. « En semain-ne » : un jour autre que le dimanche. - (19) |
| semain-ne. Semaine. - (49) |
| semale : Semelle. « Eune semale de sulé » : une semelle de soulier. - « Train-ner la semale » : marcher lentement en traînant les pieds, manquer d'activité. « In train-ne semale » : un désoeuvré. - (19) |
| semant, somant. Semence. - (49) |
| semard (s'mar) : s. m., vx fr. somart, vigne ou champ qui en est à la première façon. - (20) |
| semardé, v, a. piocher la vigne pour la première fois au printemps. - (22) |
| semarder (s'marder) : v. n., vx fr. somarer, donner la première façon à un champ ou à une vigne. Voir biner et tiercer. - (20) |
| semarder, v. a. piocher la vigne pour la première fois au printemps. - (24) |
| sembiére (n.f.) : servante (chambleire pour de Chambure) - (50) |
| semb'iller : sembler - (57) |
| semblant, s. m. air, apparence, mine : il fait « l’ semblan » d'être content. - (08) |
| sembler : v. a., vx fr., ressembler à. Il semble son père. - (20) |
| sembler, v. intr., ressembler à : « Colas sembe jouliment sa mére. » - (14) |
| sembliant : Semblant, feinte. « Y est pas qu'ol est cantant mâ o fa sembliant ». - (19) |
| séme, s. f. jambe. Ce mot qui est complètement inusité ailleurs, s'emploie aux environ de Château-Chinon. - (08) |
| semeillu, objet proposé à acheter. - (05) |
| semelle : s. f., se dit, au jeu de saute-mouton, de l'espace mesuré par la largeur d'une semelle de soulier. - (20) |
| semelle : s. f., syn. de barque. - (20) |
| semelle : voir pressoir. - (20) |
| semen : Semence. « Mes semens de fèves ne valant ren ». - (19) |
| semence, époque de la semaille. - (05) |
| semens, s. m. semences. S'emploie quelquefois pour désigner les graines de céréales, mais toujours au pluriel, « les s'mens. » - (08) |
| sement : s. m., semence. Voir essement. - (20) |
| seminâre : Séminaire. - (19) |
| semognoux : Celui qui fait une demande ou une offre pour le compte d'un autre et en particulier celui qui plaide la cause d'un amoureux auprès de sa belle. - « Des fois qu'alle amerait mieux le semognoux que le galant ». - (19) |
| semon : Offrir. « O m'a semon ses tarres à traveilli » : il m'a offert de travailler ses terres. - (19) |
| semonder : v. a., vx fr, semoner, semondre. - (20) |
| semondre : inviter. III, p. 16-2 - (23) |
| semondre, smondre, vt. offrir (une denrée, une marchandise). Au fig., vr, se soumettre, s'humilier. - (17) |
| semondre. v. a. Offrir pour un prix de. J'y ai semondu mon blé trop bon marché ; i m'a pris au mot. - (10) |
| semonre (Morv.), semondre (Chal., Y.). - Appeler, proposer, offrir ; du vieux français semoner, venant de sub monere, qui a formé en outre le substantif semonce (avertissement mêlé de reproches), seul usité maintenant en français. - (15) |
| semonre, v. a. semondre, appeler, convoquer, offrir, proposer. On « semon » ses amis pour avoir leur secours ; on « semon » son bien pour le vendre. Participe passé, « semondu. » - (08) |
| semonssai, inviter, solliciter à ... - (02) |
| semonssai. : Inviter. Le dialecte disait semondre. (Du latin summonere.) - (06) |
| semouaîr (on) : semoir - (57) |
| semoudre, proposer à acheter. - (05) |
| semouille. Semoule. - (49) |
| semouner : voir semondre - (23) |
| semouner, s'mouner (v.) : inviter quelqu'un aux noces - (50) |
| s'emperchè : se prendre les pieds dans un obstacle, on utilise également les mots s'empaturè et s'empigè. - (46) |
| sempéser (v. tr.) : soupeser - (64) |
| s'empifrer : manger à toute vitesse - (44) |
| s'empigeai : s'empêtrer. Ramasses tes étroperies, tu vas t'empégeai : ramasses tes tailles de haie, tu vas t'empêtrer. - (33) |
| s'empiger : s'attraper les pieds - (44) |
| sen cu d' sô, loc. sens dessus dessous. - (08) |
| sen d’vant-d’ri : (loc) sens devant-derrière, en désordre - (35) |
| sen devant dimèche, loc. sens devant derrière : il a mis son tablier sen devant dimèche. - (24) |
| sen d'van dimoinge, loc. sens devant dimanche pour sens dessus dessous. S'emploie avec le verbe faire ou mettre, pour exprimer qu'on met une chose à l'envers, à l'opposé de ce qui doit être fait ou mis. - (08) |
| sen d'vant dimanche, loc., sens dessus dessous. - (14) |
| sèn lonjin, traînard, celui qui est long au travail. - (16) |
| senai, senerâs, seune - divers temps du verbe sonner. - En entend d'iqui senai les cliaiches. - Voilai les Vêpes que senant, dépouâchons-no. - Ces aissiettes qui sont de bonne faïence ; â senant bein. - (18) |
| senai. Sonné, sonner. - (01) |
| senaille, semaille. - (05) |
| senale (poère à bon djeu) : fruit de l'aubépine - (51) |
| senales ou senelles - fruits de l'aubépine. - Ne mége don pâ des senelles quemant cequi, mon enfant ce n'â pà bon. - Les senelles, c'â quemant bein des choses c'â aissez joli, et c'â to. - (18) |
| senau. Coup de poing si rude qu’on en peut entendre le son, et de là senau, parce qu’en bourguignon, pour dire sonner on dit senai. On pourrait aussi le dériver d’assener. - (01) |
| senbe - même sens, presque même mot que senle. - (18) |
| senbier, y. imp. sembler. Voir sonner. - (17) |
| s'endurer : s'ennuyer - (44) |
| sene : s. m., somme, sommeil. - (20) |
| senée, s. f., partie de la poitrine découverte par le corsage, entre les seins. - (40) |
| senelle : baie de l'aubépine - (60) |
| senelle : se dit de quelqu'un de maladif ou de quelque chose de fripé ou de ratatiné - (39) |
| senelle. Fruit de l'aubépine que les enfants de Beaune appellent « pomme du bon Dieu »... - (13) |
| sener - s'ner : semer. Ex : "Si d’main n’a pas d’yau, j’irons s’ner nout’ avouène !" - (58) |
| sener, châtrer un porc, une truie. - (04) |
| sener, semer. - (05) |
| sener, v. a. châtrer les animaux. « ch'ner, c'ner. » - (08) |
| sener, v. a. semer. - (24) |
| s'enheurser : s'énerver - (48) |
| senicle, serin, oiseau... - (02) |
| senicle. : (Dial. et pat.), serin, oiseau. - (06) |
| senifier, v. a. signifier, déclarer, notifier, annoncer. - (08) |
| seniquier. Cligner de l'œil avec malice. Faire un signe d'intelligence. Ce mot est employé dans le pays- bas. - (13) |
| senle, senlot, senleraint - divers temps du verbe sembler. - En me senlot bein, aito. - Ile le veut, cair en l'i senle qu'ile réussiré. - S'â ne faisaint pâ quemant cequi c'â qu'à ne ressenleraint diére ai lote père… - Ali fait senlant. - (18) |
| senne (l’) : (le) sien - (37) |
| senne (lai) (pr.pos.f.sing.) : la sienne - (50) |
| senne (lai) (pron.pos.) : la sienne - (50) |
| senne (lai) : sienne (la) - (39) |
| senne (le, lai), sennes (lâ, les) : sien (le), sienne (la), siens (les), siennes (les) - (48) |
| senongé , présager, annoncer, pronostiquer... - (02) |
| senongé. Annoncez, annoncer. Vo me senongé, vous m’annoncez ; senongé vient de subnunciare. On chantait à Dijon, dans le temps de la comète de 1665 : Voyan lai queu' de lai cômaite, Qui no senonge tan de mau. - (01) |
| senongé. : Annoncer. (Du latin subnuntiare) - (06) |
| senôure : s. f. sac du semeur pour les semences. - (21) |
| s'en'oûsser : s'étouffer (en mangeant) - (48) |
| s'enreuillè : se casser la voix (par maladie) - (46) |
| sens devant dimanche : loc., sens devant derrière. - (20) |
| sens dvant derri loc. Sens dessus dessous. - (63) |
| sensibje, adj. sensible. - (17) |
| sensoilli : tremper dans l'eau, dans la boue - (43) |
| sent bon : parfum - (44) |
| sentaigne, s. f. centaine, attache, lien qui retient un écheveau de fil ou de laine et qui en ferme l'extrémité. - (08) |
| sentaÿ, s. m., sentier. - (40) |
| sent-bon : s. m., parfum, eau de toilette. - (20) |
| sentcher : sentier - (51) |
| senté : n. m. Sentier. - (53) |
| senté : s. m. sentier. - (21) |
| sente : sentier. Essentiellement pour piétons. Plus large, le sentier devient rue. Ex : "Te verras ben la sente qui monte, après la maison du maréchal..." - (58) |
| sente, senté, s. m. sentier, petit chemin. - (08) |
| sente, sentier. - (04) |
| senti : (nm) sentier - (35) |
| senti : sentier - (43) |
| senti, vt. sentir, pp. sentu. - (17) |
| sentibon : eau de cologne. - (66) |
| sentibon : parfum - (48) |
| sentibon : n. m. Parfum. - (53) |
| sentibon : parfum - (39) |
| sentibon, sm. parfum, eau de toilette. - (17) |
| sentibon. Parfum. - (49) |
| sentie ou satie : Longue sécheresse. « Je tenins eune sentie » : nous sommes dans une période de sécheresse qui paraît devoir se prolonger. - (19) |
| sentier : s. m. Sentier commun. Voir chemin. - (20) |
| sentier. Chantier. - (49) |
| sentiment n.m. Senteur, parfum. - (63) |
| sentiment : s. m., senteur, parfum. Ces fleurs sont pas bien jolies, mais elles ont beaucoup de sentiment. - (20) |
| sentir : v. a. Ce terme, qui ne s'applique couramment qu'aux perceptions du toucher, de l'odorat et du goût, s'emploie aussi à Mâcon pour l’ouïe et peut-être pour la vue, ce qui est d'une correction involontaire mais absolue, puisque sentir signifie, dans son acception philosophique, « percevoir par un sens quelconque ». La petite dort ; on la sent pas. Tiens, te vlà! J’ t’al pas sentu venir. - (20) |
| sentre : sentir - (57) |
| sentu : part pass., senti. - (20) |
| sentu, part., senti. - (14) |
| sentu, partic, passé du verbe sentir. - (08) |
| seoir (Se) : v. r., s'asseoir. On ne craint pas de dire siétez-vous pour seyez-vous, c'est-à-dire asseyez-vous. - (20) |
| sépairer (v.t.) : séparer - (50) |
| s'épanter : appréhender - (57) |
| sépartie. s. f. Séparative, limite commune à deux propriétés. (Saint-Martin-sur-Ouanne). - (10) |
| sepécial, sepécialement : adj. et adv., spécial, spécialement. - (20) |
| s'épentè : v. pr. Se faire du souci, du mauvais sang. - (53) |
| sèpiau : chapeau. - (52) |
| sèpin, sapin. - (26) |
| sèpine : (sèpin' - subst. f.) seau en bois blanc pour traire les vaches, à l'origine en bois de sapin qui lui a donné son nom. Depuis, le métal galvanisé, le fer blanc, l'aluminium ont remplacé le bois et le seau s'est agrémenté d' un bec verseur. - (45) |
| sept' adj. num. Sept. - (63) |
| sept en gueule : Petite poire si petite qu'on peut en mettre sept à la fois dans la bouche. - (19) |
| septante, soixante-dix. - (16) |
| septemb' : n.m. Septembre. - (53) |
| septembe (n.m.) : septembre - (50) |
| septembrier : s. m., vigneron (qui fait sa récolte en septembre) ; vendangeur à la journée, et, par extension, ouvrier médiocre. - (20) |
| septembrier. s. m. Tonnelier qui, au mois de septembre, va de pays en pays pour réparer les fûts à vendange. (Perrigny-lès-Auxerre). - (10) |
| sept-en-gueule : s. f., poire de petit muscat (pirus fructu minimo). On l'appelle aussi trente-en-gueule et poire à la livre. - (20) |
| sept-en-gueule. n. f. - Petites poires sauvages qui se mangeaient blettes, si petites qu'on pouvait en mettre sept en bouche à la fois. (Saints, selon G. Pimoulle) - (42) |
| s'equarquiller : ouvrir grand les yeux - (44) |
| sequelle. Séquelle, suite attirail. - (01) |
| s'equeuler : tomber par terre - (44) |
| séquiée, séguiée, s. f. sécheresse. - (08) |
| s'équiercir : s'éclaircir - (46) |
| serancer. v. a. Peigner le chanvre avec un seran. (Puysaie). - (10) |
| serande, s. f. andouille. - (08) |
| serau : s, m., vx fr., angélus du soir. Voir matene. - (20) |
| seraus (Je). conditionn. prés. du verbe Être, pour je serais. (Tonnerrois). - (10) |
| sercher, v. a. chercher, rechercher : « quioque teu serches ? » qu'est-ce que tu cherches ? - (08) |
| serciller, v. tr., écouter. - (14) |
| sercizan, serviable. - (16) |
| sercler : v. a. et n., sarcler. - (20) |
| seré. Seras, sera, serez. - (01) |
| sereille, s. f. séran, grand peigne dont se servent les ouvriers qui travaillent le chanvre et, en plusieurs contrées, le lin. - (08) |
| serein. Serions, seriez, seraient. - (01) |
| seréjeux. s. m. Filassier. (Saint-Germain- des-Champs). - (10) |
| serène (pour sirène). s. f. Appellation ironique donnée par les habitants de Lainsecq a la cigale, sans doute parce son chant est loin de charmer et de séduire. - (10) |
| séreugne : charogne, mauvaise bête - (39) |
| sergent : s. m., poisson blanc qui tient de l'ablette et du chevaine. - (20) |
| sergent. Huissier. On dit communément de quelqu'un qui marche très vite : a cort comme un sargent. Le nom vulgaire de sergent est donné aux beaux scarabées bronzés Je nos jardins, à cause de la rapidité et des détours de leur marche. - (13) |
| sergenter : action de poursuivre par le moyen de sergents, officier de justice chargés de signifier les exploits, les assignations, de faire les saisies, d’arrêter ceux contre lesquels il y avait une prise de corps. - (55) |
| sergot, sergotai - cahot, cahoter, remuer. - Oh ! les mauvais chemins ! en â sergotai de to côtai. - Les sergots me faisant du mau, ai moi ; â me câssant l'estomâ. - Ne sairgote don pâ lai tâbe quemant cequi. - (18) |
| sergoter : (sêrgotè - v. intr.) agiter, secouer, ébranler, mais aussi cahoter. - (45) |
| sergueu, forte secousse, cahot d'une voiture. Au sens figuré, maladie grave, épreuve pénible. - (27) |
| seri, s. m. chauve-souris. - (08) |
| seri, s. m. séran ou sérançoir, peigne à dents d'acier dont on se sert pour séparer la filasse du chanvre. On dit « seriger » pour employer le « seri », peigner le chanvre. (voir : sereille.) - (08) |
| seri, seran. s. m. Peigne de fer à longues dents pour peigner le chanvre.(Puysaie). - (10) |
| seriger, v. a. peigner le chanvre. - (08) |
| serillou, s. m. ouvrier qui peigne le chanvre. - (08) |
| serin, soleil. - (26) |
| serin. L'air du soir vers le coucher du soleil… - (01) |
| seris, musaraigne. - (05) |
| seris, sris, sf. petite souris des champs. - (17) |
| serjant. : (Dial.), serviteu r; du latin serviens. (S. B.) - (06) |
| serment : s. m., sarment. - (20) |
| serment, s. m., sarment, bois de la vigne. - (14) |
| séro-senant. Lorsque sonne l'angélus du soir. I seus rentré des vignes séro-senanl. Soir se prononce seir. - (13) |
| serpe, sarpe, s. f. serpent. n'est plus usité dans le langage mais subsiste dans les noms de lieu : le bois, le champ, le pré de la serpe ou de la sarpe à la chaux, commune d'Alligny-en-Morvan. - (08) |
| serpent (ène) : couleuvre - (51) |
| serpent (fém.), serpent. - (27) |
| serpent (une) : couleuvre - (43) |
| serpent (une) : une couleuvre - (61) |
| serpent : (nf !) couleuvre - (35) |
| serpent n.f. Serpent, orvet, employé au féminin. - (63) |
| serpent : s. f. Une serpent. C'est pas une serpent, c'est un vipère. - (20) |
| serpent. Nous le mettons au féminin. Ex. : « Allons-nous promener au Mont-Afrique, nous passerons par la Combe à la Serpent. » - (12) |
| serpiller : frétiller. (P. T IV) - Y - (25) |
| serpillére (na) : serpillière - (57) |
| serpillère : petite besace. - (09) |
| serre. s. f. Contusion, ecchymose résultant d'une forte pression, d'un serrement exercé sur un membre ou sur quelque partie du corps. (Merry-la-Va!lée). - (10) |
| serre-bande : s. m., perche fixée transversalement à une entrée de bouchure pour en barrer l'accès. - (20) |
| serrée : s. f., serre, action de presser la vendange. - (20) |
| serrer : mettre en place. - (09) |
| serrer, sarrer, verbe transitif : mettre à l'abri, en lieu sûr, ranger. - (54) |
| serrer. v. - Amasser, économiser, rassembler la paille, les pommes, etc. Voir renserrer. - (42) |
| serrette : s. f., serre-tête. - (20) |
| sersifi, s. m., salsifis. - (14) |
| sersifis : s. m., salsifis. Voir Nouv. Larousse illustré, v° cercifis. - (20) |
| sertifis : un salsifis - (46) |
| seruziau. s. m. Sureau. (Soucy). - (10) |
| servanta : s. f. poignée à crochet pour prendre l'anse de la marmite. - (21) |
| servante : s. f., syn. de donzelle. - (20) |
| serve (ou serbe) : (nf) mare - (35) |
| serve : creux muré, en eau - (43) |
| serve : mare. (BD. T III) - VdS - (25) |
| serve : s. f., réservoir, creux d'eau. - (20) |
| serve, petit étang, petite mare. - (28) |
| sèrve, s. f. petite mare à bords verticaux. - (22) |
| sèrve, s. f. petite mare à bords verticaux. - (24) |
| serve. Réservoir à conserver le poisson ; du latin servare. - (03) |
| serviçant adj. Serviable. - (63) |
| serviçant, servisant : adj., vx fr. servlçable et servisant, serviable. - (20) |
| service : s. m. Etre d'un bon service, être bien serviable. - (20) |
| serviette, n.f. vêtement protecteur pour la traite des vaches. - (65) |
| servillan, ante, adj. serviable, qui aime à rendre service. - (08) |
| servir : v. n. Seri se dit serve. A quoi qu’ ça serve ? - (20) |
| servisant : serviable - (46) |
| servisant, adj. serviable. - (65) |
| servisante : serviable - (51) |
| serviseux : serviable. - (66) |
| servissant, adj. verbal, disposé à rendre service, obligeant. - (11) |
| servissant, adjectif qualificatif : serviable, qui aime rendre service. - (54) |
| s'étarni : étaler (s') - (57) |
| seté, v. a. asseoir : entrez et setez-vous. De seton, dans la position assise. - (22) |
| seter (se), et s'ter (se), v. réfl., s'asseoir. Abrév. de asseter. - (14) |
| sétie, et sòtie, s. f., sécheresse du gosier, grand'soif. Indisposition bien entretenue dans la localité. — Plus près du latin que notre mot français. - (14) |
| setie. Sécheresse, du latin sitis, parce que la terre a soif. Nous disons aussi sotie. - (03) |
| sétier et séquier. Sécheresse, grands vents qui dessèchent la terre. Aipreis ce sétier-qui, an faurot eune grande pleue. - (13) |
| setier : s. m., ancienne mesure de capacité pour le sel, faisant le 1/12 du muid et comprenant 4 mlnots. Sa contenance était de 203 litres 528. - (20) |
| seton (s’ton) : s. m. Etre de seton, se mettre de seton, être assis, s'asseoir. - (20) |
| s'étrillè : se grater - pou s'étrillé, lai ânes se roulon su lai chaidions, pour se gratter, les ânes se roulaient sur les chardons - (46) |
| setsi : sécher - (43) |
| sette - sept devant une voyelle : sai devant une consonne. - Al étaint sette enfants dans lote famille.- En i é sette ans de cequi. - (18) |
| Settons (les). Le vaste réservoir du haut Morvan appelé avec un peu d'emphase le lac des Settons. - (08) |
| seu (i), première pers. sing. du prés, de l'indic. je suis. - (08) |
| seu (n.m.) : 1) seuil d'une porte (aussi cheu) - 2) sureau (arbuste) - (50) |
| seu (on) : seuil - (57) |
| seû : seuil. - (29) |
| seû : Sous. « Le chai est seû l'hangar ». « Mentre la clié seû la chatère » : déménager à la cloche de bois. - (19) |
| seu : sureau - (48) |
| seu : sureau - (60) |
| seu : sureau. On fait des pétards aiquand du seu : on fait des pétards avec du sureau. - (33) |
| seu ou chut, aire à battre en plein air. - (05) |
| seu ou sou. : Tect à porc. (Du latin suem, rég. de sus). Le mot souillon qui signifie sale, malpropre, se réclame de la même souche ; cependant on dit aussi touillon et touillé de boe. (Souillé de boue.) - (06) |
| seû : s. f. sœur. - (21) |
| seu : sureau - (39) |
| seú, 1re pers. du v. être : « I seú bé seùr qu'alle ét iqui. » - (14) |
| seû, et seûrò, s. m., sureau. Sert à la confection de plusieurs petits ustensiles d'enfants : taperiau, jiclerôte, etc. (V. ces mots.) - (14) |
| seu, étable à porcs - (28) |
| seû, repus. «Les écrevisses, çai de lai viande ai gens seûs » (pour des gens qui n'ont plus faim). - (27) |
| seu, s. m. seuil d'une porte. On dit aussi le « pas d' lai porte. » - (08) |
| seu, s. m. sureau commun, très abondant dans notre région. On y trouve souvent le sureau à grappes rouges. « cheu. » - (08) |
| seü, s. m., seuil : « L'vieux reste iqui su l’seü, qu'ô s'chauffe tout bêlement les genò au soulò. » - (14) |
| seû, seutse : (adj) sec, sèche - (35) |
| seu, seutse adj. Sec, sèche. - (63) |
| seu, sou, étable à porcs. De même en langue romane d'Oïl ; du latin sus. - (02) |
| seu, teet à porc. - (16) |
| seù. s. m. Sureau. (Domecy-sur-le-Vault). - (10) |
| seù. Suis. I seù, ou je seù, je suis ; l’accent grave mis à seù donne à entendre que la prononciation de cet eu est particulière… - (01) |
| seu’ : seuil. C’est une apocope de seuil. « Seut’te su’l seu’ » : assieds toi sur le seuil. - (62) |
| seubllieu ou seublly’e, s. m. sifflet. Verbe : seub’llié. - (22) |
| seubriqueut : Sobriquet. « An l'appalait Grenadier mâ y était pas san nam y était in seubriqueut ». - (19) |
| seuçai. Sucé, sucez, sucer. - (01) |
| seucare : Morceau d'étoffe placé en dessous et à l'emmanchure d'une manche de chemise pour lui donner de l'aisance. - (19) |
| seucé (ē), vt. sucer. - (17) |
| seucer, v. a. sucer. - (08) |
| seûcer, v. tr., sucer : « Le p'tiot seûce tôjor ses dèts. » - (14) |
| seûche (d'la) : suie - (57) |
| seuche : sèche (fém. de sec) - (57) |
| seuche : souche - (48) |
| seûche, s. f., souche, tronche, grosse bûche. - (14) |
| seuchi : sécher - (57) |
| seuchi : v. sécher. - (21) |
| seuci : Souci, plante, calendula arvensis. « Ol est jaune c'ment in seuci ». - Souci, inquiétude. « I ne sarve de ren de se fare du seuci » - (19) |
| seucissan : Saucisson. « Eune rolate de seucissan » : un rond de saucisson. - (19) |
| seucisse : Saucisse. « In pliat de seucisses ». - (19) |
| seuçot : (seuso - subst. m.) bourrache, plante à fleurs bleues qui pousse au printemps sur le bord des routes et des chemins, en même temps que le coucou ; les écoliers arrachaient la fleur sucrée pour la sucer. - (45) |
| seuçot, s. m. chose que l'on suce. Un sucre d'orge est le « seuçot » par excellence. - (08) |
| seûçòt, s. m., objet que l'on suce, réglisse, sucre d'orge, etc. - (14) |
| seuçoter, v. a. suçoter, sucer longtemps et lentement. - (08) |
| seûçoter, v. tr., suçoter, faire fonctionner le seuçòt. - (14) |
| seûçoû, s. m., suceur : « Pou i! quand ô vous bise, ce gros mastoc, y ét ein vrâ seùçoû ! . . . » - (14) |
| seucre : Sucre. « In pain de seucre ». « Quand alle dit du mau du mande alle cra qu'alle mije du seucre ». Le mot seucre a vieilli, on dit maintenant sucre. - (19) |
| seûcre, et seûque, s. m., sucre. Au figuré, chose très bonne. - (14) |
| seucre, seuque, s. m. sucre. - (08) |
| seucrer : Sucrer. « In varre de vin seucré ». - (19) |
| seucrin. Sucrin, sucrins. Melons sucrins, qui ont un goût de sucre, surtout lorsque, comme dit Charles Etienne, on les arrose d'eau sucrée, pour les rendre plus sucrins… - (01) |
| seue (n.f.) : suie - (50) |
| seue : suie - (48) |
| seûe : suie. - (29) |
| seûe : Suie. « Y est na c'ment de la seûe » : c'est noir comme de la suie. - (19) |
| seue : suie. La seue d'la chem'née : la suie de la cheminée. - (33) |
| seue, s. f. suie de cheminée. - (08) |
| seûë, s. f., suie : « Ol é blanc coume la seùë. » - (14) |
| seue, sueue : n. f. Suie de cheminée. - (53) |
| seûe, suie. - (16) |
| seue. n. f. - Suie. (Diges, selon M. Jossier) - (42) |
| seue. Soue à cochons. (Gizy-les-Nobles). - (10) |
| seue. Suie. (Diges). - (10) |
| Seùédoi. Suédois. - (01) |
| seùer, v. intr., suer, transpirer. - (14) |
| seûf : soif. - (66) |
| seuffri : souffrir - (43) |
| seuffri v. 1. Souffrir. Ôl a seuffri l'martyre. 2. Supporter. Dz'poux pas la seuffri chti-là ! Je ne peux pas la supporter celle-là ! - (63) |
| seuffy-in, soufflet. - (26) |
| seufio, soufflet pour exciter le feu. - (16) |
| seufre, soufre ; seufri, soufrer ; les jeunes gens disent : du sulfre. - (16) |
| seufri, vt. souffrir. - (17) |
| seufri, souffrir, enduré ; te seufre s'ki, tu permets cela. - (16) |
| seug’nioule : (nf) manivelle du puits - (35) |
| seûgé : v. t. ind. Songer. - (53) |
| seugnenioule n.f. (onom.). Manivelle du puits. - (63) |
| seûgni : (vb) soigner - (35) |
| seugni, v. i. 1. soigner. — 2. Guetter : seugni le lait sur le feu ; seugni le facteur. - (24) |
| seùgre. Suivre. - (01) |
| seugre. v. a. Suivre. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| seugu, ue. partic. prés. de seugre. Suivi, ie. Je l'ai seugu. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| seùgu. Suivi. On dit aussi suvi, que l'on trouvera plus bas. J'ai ouï dire à l'infinitif suvre, seùvre et seùgre. C'est dans ce dernier qu'a été formé seùgu. - (01) |
| seugueuilli v. Secouer. - (63) |
| seugueurte : (nf) petite machine quelconque qui a des ratées, ne fonctionne pas bien - (35) |
| seugueûyi : (vb) secouer - (35) |
| seuil de grange, n.m. aire. - (65) |
| seuil : s. m., aire à battre le blé. - (20) |
| seuille : seau en bois, seille (en A : siô). B - (41) |
| seûillé - sureau. - Cueillez de lai flieur de seuillé ; c'â bon pour des remèdes. – Les petiots ant aibimai note seuillé en en copant des brianches pour fâre des taprelles et pu des gigliôres. - (18) |
| seuille (na) : seau - (57) |
| seuille (na) : seille - (57) |
| seuille : (nf) seau à traire - (35) |
| seûille : pègre. - (52) |
| seuille : personne ou chose méprisable - (60) |
| seuille : seau à traire - (43) |
| seuille : seau en bois - (34) |
| seuille n.f. Seau (à traire les vaches). Alle prend bachin p'seuille. Elle fait tout à l'envers. - (63) |
| seuille. Seuil, le pas de la porte… - (01) |
| seuiller : sureau. - (32) |
| seûiller, v. intr., siffler, de la bouche, ou avec un sifflet. - (14) |
| seûillère : l'articulation entre le chariot et le limon - (46) |
| seuillet, sureau. - (28) |
| seuilli : v. faucher. - (21) |
| seuillier, sureau. - (05) |
| seuillon (on) : seillon - (57) |
| seûillôt, et suillôt, s. m., sifflet, surtout celui que les enfants taillent dans des branchettes de saule. - (14) |
| seùjai. Sujet, sujets. - (01) |
| seule (lai) : le sol d'un pré - (39) |
| seùle : poutre de chêne couchée sur les fondations et sur laquelle repose le cadre de poutres qui ferme le châssis des anciennes maisons de paysans construites en pisé nom local: torchis ou feusse. (CST. T II) - D - (25) |
| seûlé : sureau. L’arbre, du latin sambucus. - (62) |
| seule, grosse pièce des maisons de bois, posée sur le sol. - (05) |
| seûle, s. f. pièce de bois qui sert de bordure à la a tisse » ou meule de gerbes. - (08) |
| seulé, s. m. soulier. - (22) |
| seule. Grosse solive, du vieux mot sole. - (03) |
| seule. : (Dial.), siècle. C'est la vraie dérivation du latin seculum. - (06) |
| seulée, seurée : n. f. Haie en pente. - (53) |
| seûlet ou seûlot, subst. masculin : sureau. - (54) |
| seuleu, soleil. - (27) |
| seulitâre : Solitaire. - (19) |
| seûllon : émêché. - (29) |
| seûlo : soleil. - (29) |
| seulöre, soulaire, sm. solaire, vent du sud. - (17) |
| seulot, s. m., soleil (le matin). - (40) |
| seulvé, vt. soulever. - (17) |
| seume, söme, sm. sommeil. - (17) |
| seume, somme d'argent et court sommeil. - (16) |
| seument (adv.) : seulement - (64) |
| seumiolles : plante parasite des céréales - (39) |
| seum-not : sentier - (39) |
| seum-notte : morceau de tige de chanvre pour allumer le feu - (39) |
| seum'tëre, cimetière. - (16) |
| seumtet, sm. lourdaud. - (17) |
| seune (la) : sommeil - (57) |
| Seûne : la Saône - (46) |
| seune, s. m. sommeil. - (24) |
| seûne, seûme, et seûnon, s. m., somme, sommeil. - (14) |
| seune. Sommeil, ainsi que son diminutif seunon. - (03) |
| seune. Sonne, sonnes, sonnent. - (01) |
| seunge, s. m. singe. - (08) |
| seungerie, s. f. singerie, grimace. - (08) |
| seunne, sommeil. - (05) |
| seûpe (lai) : (la) soupe (dans le sens : le repas du soir) - (37) |
| seupe, soupe ; seupé, repas du soir. - (16) |
| seupiesse, sf. souplesse. - (17) |
| seûr : sœur. Terme affectueux : c'est ainsi que j'interpellais Ernestine. - (52) |
| seur : Sûr. « Y est pas si seur que si était vrâ » : ce n'est pas si sûr que si c'était vrai, j'en doute. - (19) |
| seùr, adj. et adv., sûr, certain. - (14) |
| seur, e, adj. sur, certain. - (08) |
| seur. Sûr, sûrs. Ceux qui, comme les Bourguignons, prononcent seur dans la signification du latin securus, font fort bien d'écrire seur ; mais ceux qui, dans cette même signification, prononcent sur, comme le prononcent tous ceux qui parlent bien, ont grand tort d'écrire seur. - (01) |
| seurbande, s. f. jeune tige flexible des arbres forestiers. Se dit par extension des branchages, de la rame. - (08) |
| seurbander, v. a. coucher les rameaux qui forment les haies sèches, les mettre horizontalement les uns sur les autres, quelquefois en les entrelaçant. - (08) |
| seurbe n.f. Sorbe. Les seurbes, y'est dzaffe, y fait les grandes dents ! Les sorbes, c'est âpre, on dirait que ça allonge les dents. - (63) |
| seurbî n.m. Sorbier. - (63) |
| seurbou, s, m. nœud de corde à l'aide duquel on serre les narines d'un animal afin de le maîtriser. - (22) |
| seurçallerie : Sorcellerie. « I n'y a pas langtemps qu'an ne cra plieu à la seurçallerie ». - (19) |
| seurce : Source. « La seurce de la Doue est dans in brave endra ». - (19) |
| seurcier : Sorcier. « Dans le temps an avait peu des seurciers. Aujourd'heu an n y cra plieu ». « Y est pas bien seurcier » : ce n'est pas bien difficile. - (19) |
| seurdent, s. m. nous appelons improprement surdent un certain agacement des dents produit par un fruit acide. - (08) |
| seuré : Sureau, sambucus nigra. « De la miône de seuré » de la moëlle de sureau. - (19) |
| seure et enseure. : (Dial. )« Je te seurai tot celle part où t'iras.» (S. B., 1er sermon du carême.) – Le patois dit seùgre et enseùgre, et, au participe, seùgu (secutus). La dérivation du latin sequi et insequi est plus naturelle dans le patois et a dû précéder celle du dialecte.- Ensirvence (dial.), exprime l'action de suivre avec insistance, c'est-à-dire de poursuivre : L'ensirvence del deable, (Job.) - (06) |
| seûré : n.m. Sûreau. - (53) |
| seûre, s. f., sœur. - (14) |
| seurée : haie. (RDT. T III) - B - (25) |
| seurée : portion de terrain séparant deux propriétés de niveaux différents et qui appartient en général au terrain le plus élevé. (RDM. T IV) - B - (25) |
| seurement : Seulement. « Y a ren dans les vignes je sais pas seurement si an fara la boite » : il n'y a rien dans les vignes, je ne sais pas si on fera de quoi boire pour soi. - (19) |
| seurement, adj. assurément, avec certitude, en sûreté, avec sécurité. - (08) |
| seûrement, adv., sûrement. - (14) |
| seurès. s. m. Sureau. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| seureté : Sûreté. - (19) |
| seureté, s. f. sûreté, assurance, sécurité - (08) |
| seûreté, s. f., sûreté, assurance. - (14) |
| seurfare : Surfaire. « I faut marchander, les marchands ant l'habitude de seurfare ». - (19) |
| seurge, s. f. suie. - (22) |
| seurlée : espace laissé entre deux sillons pour éviter un enrochement ou une dénivellation. - (32) |
| seurlée : (sœrlé: - subst. m.) talus de terre qui limitait ordinairement les pièces labourées appartenant à des propriétaires différents. Quand il se faisait un regroupement de ces parcelles, on aplanissait la seurlée ou, plus fréquemment, s'il y avait une dénivellation, on la plantait d'arbres fruitiers car les racines y trouvaient plus de terre. - (45) |
| seurlée, s. f. petit talus de terre, ados dans un champ. On abat les « seurlées » pour niveler parfaitement un terrain. - (08) |
| seurmot : premier vin que l'on tire de la cave, le meilleur. (M. T III) - B - (25) |
| seuroi, s. m. butte de terre ordinairement formée par la charrue sur la limite d'une pièce labourée. - (08) |
| seûròte, s. f., petite sœur. Diminutif. - (14) |
| seurpaisser, v. a. surpasser, comme en français, et dépasser. - (08) |
| seurplus, s. m. ce qui reste, ce qu'il y a de plus. - (08) |
| seurpourter, v. a. supporter, endurer. « cheurpourter. » - (08) |
| seurprendre : Surprendre. « Cen ne me seurprend pas » : cela ne me surprend pas. - (19) |
| seurprenre, v. a. surprendre, prendre à l'improviste, prendre par ruse ou par fraude. - (08) |
| seurprise, s. f. surprise. « cheurprie ». - (08) |
| seurtai. Sûreté, sûretés. - (01) |
| seurti : Sortir. « La faim fa seurti le loup du beu ». - (19) |
| seurtie : Sortie. « An y a fait publier à la seurtie de la masse », autrefois toutes les publications se faisaient à l'issue de la grand'messe du dimanche. - (19) |
| seurtot : Surtout. « Y est in pliaiji de se preumener dans neutés beus seurtot l'été ». - (19) |
| seûrtout, adv., surtout, principalement. - (14) |
| seurvante (na) - seurvouse (na) : servante - (57) |
| seurvi : servir - (57) |
| seurvisant : serviable - (57) |
| seurvou (on) : serveur - (57) |
| seurvouéiller (v.t.) : surveiller - (50) |
| seusseing : Acte sous seing privé « Le marchi est fait, i ant passé des seusseings ». - (19) |
| seussi, v. a. sucer. - (22) |
| seussi, v. a. sucer. - (24) |
| seussot d'bique : chèvrefeuille - (48) |
| seustance. Substance. - (01) |
| seut : Polisson, turbulent. « Man Dieu ! que ce dreule est seut » : Dieu que ce garçon est polisson. « Ol est seut c'ment in pané sans anse » : il est désagréable comme un panier sans anse, ce qui serait un ustensile bien incommode. Féminin : seute. - (19) |
| seutainne, sf. trace ; marche. Disposition d'une chose ; moyen pratique de s'en tirer. - (17) |
| seutarrain : Souterrain. « A présent pa travarser les gares an vos fa passer dans des seutarrains ». - (19) |
| seûté : v. i. Suinter. - (53) |
| seûte, s. f., suite, conséquence, ordre. - (14) |
| seuté, vn. émettre des hoquets, après une crise de pleurs (se dit des enfants). - (17) |
| seùte. Suite, suites. - (01) |
| seuteni : Soutenir. « An dit qu'in varre de vin seutint eun homme, ma j'en ai bu eune dozain-ne a peu je peux pas me teni ». - « Natian françase, seutenins nos tos Le clergé, la nobliasse. Y sant tos cantre nos ». (Vieux refrain révolutionaire). - (19) |
| seûter : Sangloter. « I fa de la pouène de l'entendre seûter ». - (19) |
| seuter : prêter (un cheval…). (LS. T IV) - Y - (25) |
| seuter. v. n. Se prêter mutuellement les animaux de labour, s'associer, s'entr'aider pour les travaux des champs. (Pays riverains de la Haute-Yonne). – A Gy-l'Evèque, on dit suiter ; à Auxerre, soueter : le véritable mot est soister (sociare). – Il existe, à Auxerre, beaucoup de personnes qui donnent à seuter, par ironie, le sens de lotir. Il est ben seuté, c'est-à-dire il est bien mal loti, mal partagé, et, dans le sens propre, il est bien mal associé. - (10) |
| seûtes, impérat. et 2me pers. plur. du subj. prés, du verbe être, soyez, et soyiez : « Allons, les p'tiots, seùtes bé sages. » — « Dépôchez-vous ; faut qu'vous seùtes là-bas d'main. » - (14) |
| seuteux. s. m. Celui qui est associé avec un autre pour labourer, pour faire certains travaux agricoles : « Aide-moi, je t'aiderai ! » (Mailly la-Ville). - (10) |
| seutin : Soutien. « Ol a in bau seutin ». - (19) |
| seutlé, v. a. retrancher les racines du collet d'une jeune vigne. - (22) |
| seutnin, vt. soutenir ; pp. seutnun. - (17) |
| seutot. adv. Surtout. - (10) |
| seutre, v. a. travailler et surtout labourer par association. Ce verbe se rattache à une coutume assez répandue dans le pays. Deux individus qui n'ont qu'une vache se concertent pour composer un attelage de charrue en s'entr'aidant réciproquement. Quelques localités ont la forme « cheuter. » - (08) |
| seutse, seu adj. Sèche, sec. - (63) |
| seutsi (stsi) : sécher - (51) |
| seûtsi : (vb) sécher - (35) |
| seutsi, satsi, stsi Voir satsi. - (63) |
| seûtsresse : (nf) sécheresse - (35) |
| seutsretse n.f. Sécheresse. - (63) |
| seuttije : Sottise, action sotte « St'enfant ne fa ren que des seuttijes ». - Injures, mauvaises raisons. « Ol l'a agoni de seuttijes ». - (19) |
| Seuv’gnon : (NL) Sivignon - (35) |
| Seuv’gnoni (re) : habitan t(e) de Sivignon - (35) |
| seûve (l’) : (le) suivre (« ai lâs ai seûvis ! » : il les a suivis !) - (37) |
| seuveni : Souvenir. « Y est tot ce que je peux fare de m'en seuveni » : c'est tout juste si je m'en souviens. - (19) |
| seuvnin (se), vr. se souvenir ; pp. seuvnun. - (17) |
| seùvre, et seuv', v. tr., suivre. - (14) |
| seûvu, part., de seùvre, suivi. - (14) |
| seux, ou seû - divers temps du verbe Etre. - Voiqui pré de huit jors qui seux traignant. - I vourâ bein que te seû pu grand. - (18) |
| seûyé, sureau. - (16) |
| seûyer, s. m., sureau. - (14) |
| seuyer. Sureau. - (03) |
| seuzé : sureau. (C. T III) - B - (25) |
| sève : nom du local où est enfermé le cochon. (CST. T II) - D - (25) |
| sevée. s. f. Haie vive. (Avallonnais). – A Massangy, on dit s'fée, s'vée ; à Domecy-sur-Cure, savée. - (10) |
| sever : voir sayer. - (20) |
| severonde, chanlatte, et, en langue romane d'Oïl, subgronde. C'est aussi un vieux mot français, que Nicot faisait dériver du latin suggrunda (Vitruve), avant-toit, entablement. - (02) |
| sévéronde. : (Dial. ), chanlatte. En dialecte subgronde, que Nicot fait dériver de suggrundia (Vitruve), avant-toit, entablement. - (06) |
| sevillot, s. m. troëne, arbuste. - (11) |
| sévoé, savoir ; s'â s'ki n'sé pâ, se dit pour : j'ignore cela, je ne puis vous renseignier sur ce que vous me demandez. - (16) |
| séyau : (nm) seau - (35) |
| sèye : (nm) seigle - (35) |
| seyé : sureau. (B. T IV) - D - (25) |
| sèyère, salière. - (16) |
| séyon, et, soillon, s. m., sillon. - (14) |
| s'frognè : se frotter - (46) |
| sgo (à) : par à coups - (51) |
| sgond adj. num. Second. - (63) |
| s'gônè : déchirer ses vêtements, aussi se salir - (46) |
| si - six. Abrégé de chi ou chisse. - Moi, i ai comptai si vaiches aivou lô vais. - En i aivoi ai co sur â moins si voitures de pierres. - (18) |
| si fait - réponse affirmative. - Te né don pâ fait ce qui t'aivâ dit ?... Si fait note mâte. - A n'en encore ran aiportai ?... Si fait. - (18) |
| si fait, loc. adv., mais si, si bien. Affirmation très accentuée : « Je n'ia créyòs pas gentite ? — Oh! si fait! » - (14) |
| si fait, si. - (38) |
| si moin, presque rien. - (16) |
| si vîn, six vingts, six fois vingt, cent vingt. - (16) |
| si, pour : oui ; si fé, oui, certainement. - (16) |
| si. Six, sex, Si, en bourguignon, devant une consonne, siz devant une voyelle, si pistôle, six pistoles, siz écu, six écus. - (01) |
| siâ - si. - Oh siâ, i vô l'aissure. - Ma siâ, c'â quemant cequi. - Presque plus usité. Voyez Aissiâ. - Dans un autre sens voyez Ciâ. - (18) |
| sia (ï-ā), adv. [sic est]. si. Oui. [Paraît s'employer indifféremment en réponse à une interrogation affirmative ou négative.] - (17) |
| sia, essia. Adverbe d'affirmation qui dérive directement du latin etiam. - (13) |
| siâ, s. m. bondon de futaille. On prononce « sa » dans une partie de la région. - (08) |
| sia, si et oui. On parle encore ainsi, dans beaucoup de pays de forêts et de montagnes, pour affirmer. - (02) |
| siâ, si. - (27) |
| sia. : Si et oui. - (06) |
| sialè : v. t. Scier. - (53) |
| sialer : fermer un fût avec une bonde. (RDM. T IV) - B - (25) |
| siâler, v. a. mettre un bondon à une futaille. En quelques lieux, « sâler. » - (08) |
| siâler, v., bonder un fût avec un « siâlou ». - (40) |
| siâlou, s. m., marteau de cave. - (40) |
| sials : porcs - (61) |
| siam (n. m.) : porc - (64) |
| siam : porc - (48) |
| siame, s. m. porc (langage plaisant). - (22) |
| siame, s. m. porc (langage plaisant). - (24) |
| siamme : autre nom du cochon - (60) |
| siamouaîs (on) : siamois - (57) |
| siau (n.m.) : seau - (50) |
| siau (n.m.) : seau - (50) |
| siau (nom masculin) : seau. - (47) |
| siau : seau - (44) |
| siau : seau - (60) |
| siau : seau à eau - (43) |
| siau : seau - (48) |
| siau : seau, verre à boire de grande contenance - (37) |
| siau : seau. - (59) |
| siau : seau. - (66) |
| siau : seau. « Sarieu’ c’ment un âne qui boit dans un siau » : pour une personne affectant un air important. - (62) |
| siau : Seau. « Son affare est dans le siau ». Siau est peu usité, on dit plutôt « sa'lle ». - (19) |
| siau : seau. On pourtot l'ieau aiquand un siau : on porte l'eau avec un seau. - (33) |
| siau n.m. Seau. - (63) |
| siau, s. m., seau. Pour indiquer une bonne averse, nous disons : « I pleut à siaux. - (14) |
| siaü, s. m., seigle. (V. Soille.) - (14) |
| siau, sm. seau. Voir soiö. - (17) |
| siau, souaillot : n. m. Seau. - (53) |
| siau. n. m. - Seau. Autre sens : seuil de porte. « Le pée Biquet l'attendait su' l'siau d'sa porte. » (Fernand Clas, p.216) - (42) |
| siau. s. m. Seuil de la porte. (Trucy). - (10) |
| sibot (n.m.) : crapaud - (50) |
| sibot, s. m. crapaud. - (08) |
| siche, adj., chiche, avare, parcimonieux. - (14) |
| sieau : seau. - (52) |
| siègi : sièger - (57) |
| siégi : Siéger. « Ol a été du jury ma o n'a pas siégi sovant ». - (19) |
| siéque (n.m.) : siècle - (50) |
| sier. Sied. « Celai vo sier bé », cela vous sied bien. - (01) |
| sierrer (Se). v. pron. S’asseoir. (Bussy-en-Othe). - (10) |
| siéteau (n. m.) : tabouret pour traire les vaches - (64) |
| siéter (s') (v. pr.) : s'asseoir - (64) |
| sieter (se) : s'asseoir. Ex : "Prends ène chée, et siète-toué-là !" - (58) |
| siéter (v. tr.) : asseoir - (64) |
| siéter, siter (se). v. - S'asseoir : « Siette-toué don' eune mineute, t'as ben l'temps ! » - (42) |
| siéter, v. asseoir, consolider, fixer. — siéter (se), v. réfl. s'asseoir. - (08) |
| siéter. v. a. Asseoir. - (10) |
| siétez-vous don' marchez don'. exp. - Asseyez-vous, ne restez pas debout, vous avez bien le temps. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| siétez-vous : voir seoir (Se). - (20) |
| siéton, siétot. n. m. - Siège : tabouret, pierre ou tout ce qui peut être utilisé pour s'asseoir. - (42) |
| sietot : tabouret. Généralement d'écurie. Pour s'asseoir et traire les vaches, par exemple. Ex : "Diab où j'ai ben mis mon siétot !" - (58) |
| siétot, siéton. s. f. Petit siège. (Etais, Champignelles). - (10) |
| sietter : s'asseoir. - (09) |
| sietton (un) : un siège - (61) |
| sieue : agacée (dent) après avoir mangé des fruits verts. (S. T IV) - S&L - (25) |
| sieues, adj. ; pour qualifier les dents aigries. - (07) |
| sieurge, s. f. suie. - (24) |
| sifloû, s. m., siffleur, qui siffle constamment, homme ou oiseau. - (14) |
| signaude, s. f. étincelle qui sort des cheminées et s'élève dans l'air. - (08) |
| signé ; s'signè, faire sur soi le signe de la crois, son pâtri, son nom du Përe. - (16) |
| signe, s. m. bruit entendu mystérieusement la nuit ou qu'on attribuait autrefois aux revenants. - (24) |
| signeûle : manivelle. - (29) |
| signeûle : mot féminin désignant un bruit agaçant de sirène - (46) |
| signeûle : une manivelle - (46) |
| signeule ou signole. Manivelle de quelque sorte qu'elle soit. Le mot signole désigne, d'après Littré, un dévidoir construit sur l'axe d'un treuil. - (12) |
| signeûle, manivelle à tourner pour mouvoir une machine. - (16) |
| signeule, manivelle. - (28) |
| signôle - manivelle à tourner, par exemple, une roue, une meule par extension un instrument de musique mécanique. - I vâ ailai aiguyai note serpe, veins voué tornai lai signôle. - Torne don lai signôle mieux que cequi san lai sergotai. - Al é aiportai ine signôle ai musique ; c'â joli, vais. - (18) |
| signôle (C.·d., Chal.), gignoule (Char.), sigôle (Morv.). - Manivelle et, par extension, l'instrument de musique appelé vielle, dont on joue à l'aide d'une manivelle. La vielle est l'instrument favori du Charollais, où se danse une bourrée analogue à celle de l'Auvergne. Cet ancien et curieux instrument a été récemment remis en honneur dans les concerts parisiens par l'éminent artiste bourguignon Laurent Grillet. Le mot signôle a produit le verbe signôler ou sigôler, qui a le sens de secouer (Morv.)… - (15) |
| signole, n. fém. ; manivelle. - (07) |
| signôle, s. f. vielle, instrument de musique. Ce nom paraît emprunté à la manivelle et s'est étendu à l'instrument tout entier. - (11) |
| signôle, s. f., instrument bruyant et désagréable. - (40) |
| signôle, s. f., vielle, instrument de ressource pour les bals. - (14) |
| signole. Manivelle, vielle. - (03) |
| signoûle (na) : manivelle - (57) |
| signoule : s. f., vx fr. soignolle, manivelle; instrument de musique à manivelle, comme la vielle, l’orgue de Barbarie, etc. ; par assimilation, tout objet agaçant comme ces Instruments. - (20) |
| signouler : v. a., ennuyer quelqu'un par des radotages, le fatiguer. Tu me signoules la tête. Bon Dieu, qu’ t'es signoulant ! - (20) |
| sigogner : voir cigogner. - (20) |
| sigogni : (vb) triturer - (35) |
| sigolè : secouer. (RDT. T III) - B - (25) |
| sigolè, sairgotè : v. t. Secouer. - (53) |
| sigoler (v.) : agir par saccade, secouer - (50) |
| sigôler, v. a. agiter par saccade, secouer. - (08) |
| sigon, demi-poupée d'œuvre. - (05) |
| sigougner : secouer, remuer, « branler dans le manche » - (37) |
| sigovi : un peu maladroit. (RDM. T IV) - B - (25) |
| sigovi. Grand bonnet de laine que les vignerons de la côte portaient en hiver. Les laines de Ségovie étaient fort estimées en Bourgogne à cause de leur longue durée et de leur imperméabilité. I vâs mette aujed’heu mon sigovi : lai bise ast froide... - (13) |
| sigre (v.t.) : suivre (p.p., sigu) - (50) |
| sigre : (vb) suivre - (35) |
| sigre : suivre - (43) |
| sigre, sigue, v. a. suivre, être à la suite. Au participe passé « sigu. » - (08) |
| siguer, v. a. suivre. Aux environ de Montsauche. - (08) |
| sigueréne, s. t. rampe ou guide-mains d'escalier, garde-fou de passerelle. - (08) |
| silée : petite raie. - (09) |
| silée, sillée. s. f. Raie, rayure. - (10) |
| siller. s. m. Pierre d'évier. (Environs de Saint-Florentin). – On dit aussi sillère, au féminin. – Voyez seiller. - (10) |
| siller. v. a. Rayer, sillonner légèrement. Voyez ciller. - (10) |
| simagrée, s.f. (l'auteur ne signale pas de sens local). - (38) |
| simaigrées : simagrées, gestes habituels - (37) |
| simblier : Sembler, ressembler. « O simb 'lle bien san père. -Y est bin ce qu'i me simb'lle ». - (19) |
| sime : baguette. (RDM. T II) - B - (25) |
| simer : (sî:mè - v. intr.) chauvir, en parlant des chevaux. Rekeul' tè, lè Sultan' vin d'sî:mè dé:z èrèy' ! "recule-toi, la Sultane (la jument) vient de chauvir" (= tu risques .un coup de sabot) - (45) |
| simer, cimer : bouger, chauvir (dresser les oreilles) - (48) |
| simer, v. a. remuer les paupières ou les sourcils : « simer des yeux. » - (08) |
| simer, vn. suinter : se dit d'une source ou d'une plaie. - (17) |
| simie. s. f. Endroit où il suinte de l'eau, ou l'eau sime de terre. (Sommecaise). - (10) |
| simo, lisière du drap. - (16) |
| Simon et Luca peuvent avoir été des noms de bergers de Judée ; en quoi l'auteur marque un peu plus de jugement que certains rimailleurs, qui, dans leurs Noêls, introduisent des bergers nommés Georget, Thibaud, Fiacre, Huguet, Colas, etc., ce qui n'est pas moins ridicule que s’ils donnaient à un berger français le nom d'Amos, ou de Nabal… - (01) |
| simotter, v. a. mouvoir les paupières, les lever et les abaisser tour à tour. - (08) |
| simp'ille : simple - (57) |
| simp'illement : simplement - (57) |
| simplement : Simplement. « J'y renance simp 'llement ». - (19) |
| simp'lle : Simple, facile. « Y est simp'lle c'ment banjo » : c'est simple comme bonjour, cela ne présente pas de difficulté. - (19) |
| sin (le) (pr.pos.m.sing.) : le sien - (50) |
| sin, senne, adj. poss. sien sienne. En quelques lieux le féminin est « seune » : « ç' nô pâ lai seune », ce n'est pas la sienne. - (08) |
| sinaut. s. m. Echafaud. (Soucy). - (10) |
| sindié ou singuié : sanglier. - (29) |
| sindiö, sm. [singularem]. sanglier. - (17) |
| sindiö, sm. [singultumj. sanglot. Hoquet de l'agonie, dernier soupir. - (17) |
| sindyé, sanglier. - (26) |
| sinécure n.f. Corvée. (Emploi à contre-sens). - (63) |
| sinécure : s. f., corvée, travail pénible, obligation fastidieuse. - (20) |
| sinel : Terme de jeux de billes : quand la bille qu'il a lancée rencontre un obstacle qui la gêne, le joueur n'a qu'à crier : « sinel » et cela lui donne le droit de placer sa bille à l'endroit où l'on suppose qu'elle devait aller. « Sinel au but », donne droit de se placer au but. - (19) |
| singeons : bouture. - (29) |
| singi - dejin-ner : singer - (57) |
| singi : Singer, imiter. - (19) |
| singuié : sanglier. - (66) |
| singuiè : un sanglier - (46) |
| singuié, sanglier. - (27) |
| sinifiance, s. f., signification. - (14) |
| sinifier : Signifier. « Qu'est-ce que cen sinifie ? ». - (19) |
| sinifier, v. tr., signifier, déclarer. - (14) |
| sin-ne : Sien, sienne. « Je ne donnerais pas la min-ne en po la sin-ne » : je ne changerais pas la mienne pour la sienne. « Chéquin cen sin-ne » : chacun le sien, chacun son bien. - (19) |
| sinon ke, selon que ; sinon s'k'é m'diré, selon ce qu'il me dira. Demande-t-on à une personne si, par exemple, elle fera telle chose, elle répond en hésitant : s'é sinon ! c'est selon ! sans rien dire de plus. - (16) |
| sinpje, adj. simple. - (17) |
| sinté : Sentier. « Le sinté à Laurent », chemin non carrossable qui va de Mancey à Veneuse-Etrigny en traversant la montagne. - (19) |
| sinté à Talan : Voir à talan. - (19) |
| sintir (v.t.) : sentir - (50) |
| sintre : Sentir. « Y as-tu sintu ? » : l'as tu senti ? « Alle ne peut pas le sintre » : elle ne peut pas le sentir. - (19) |
| sintue : Odeur. « Miji san pain à la sintue » : se repaître de l'odeur d'un festin auquel on n'est pas invité. - (19) |
| sin-yer : frapper avec une trique - (39) |
| sinze : singe - (39) |
| sio (on) : seau (pour traire les vaches) - (57) |
| sio : cep. (S. T IV) - B - (25) |
| siô, partic. d'affirm. oui. moins usité que « chô » et « aissiô. » - (08) |
| siô. conjonction. Si. Ma siô, mais si. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| sion (on) : planche (espace semé de légumes) - (57) |
| sion : (nm) sillon - (35) |
| sion : largeur utilisée par le semeur (soit entre 12 à 14 raies de labours) - (43) |
| siot - du verbe se soucier. - Voilai quemant c'éto és autes fouai ; ma en s'en siot bein ! - An ne l'eûmot pas du tot ; ma a ne s'en siot dière, vais. - (18) |
| siot, s. m., cep de vigne. - (40) |
| siou (d'la) : sureau - (57) |
| sioue : soue, tect, étable à cochons. - (62) |
| sioue, s. f., soue à porcs. - (40) |
| sioue, s.f. tec à porcs. - (38) |
| Siphorien, prénom, Symphorien. - (38) |
| sirain-ne (na) : sirène - (57) |
| siréje, cirage. - (16) |
| sireu : Sirop. - (19) |
| siringue, s. f. seringue. - (08) |
| siriñne n.f. Sirène. - (63) |
| sirô vignôlai. : Sirop de vignes, vin doux. Expression dont se sert Aimé Piron. - (06) |
| sirugien : Chirurgien. - (19) |
| sirugien, s. m., chirurgien. - (14) |
| sirujien, chirurgien. - (16) |
| sisite (fâre), loc., s'asseoir : « Veins, p'tiot, veins fâre sisite au counòt du feù. » - (14) |
| sis-sis. Faire sis-sis, s'asseoir. Tiens, m'ami, fais ton sis-sis. - (20) |
| sit nomen. Argent monnayé. I vouras ben me mâirier d'évou lai Fanchette : an li beille un bon troussel, et pu son peîre ai des sit nomen plein sai peillesse. On sait que les pièces d'argent portaient la légende « sit nomen domini benedictum ».L'usage de cette locution a cessé depuis une quarantaine d'années. - (13) |
| si'talman, si tellement, locution dont le premier terme donne de la force au second. - (16) |
| sitance, sossitance : (sitans', sositan:s') rien. Ce mot est à rapprocher de frimance (voir ce mot). Al an tô méjé lè galèt' ; al an nô: réstè sositan:s' "ils ont mangé toute la tarte, il n'en est rien resté". - (45) |
| sité : assis - (43) |
| sité : assis. (B. T IV) - S&L - (25) |
| sitelle : (nf) petit tabouret à traire - (35) |
| siter (se) : (vb) s’asseoir - (35) |
| siter (se) à cul pyat : (exp) s'asseoir par terre - (35) |
| siter (se) : v. s'asseoir. - (21) |
| siter (se), verbe pronominal : s'asseoir. - (54) |
| siter (Se). v. pron. S'asseoir. - (10) |
| siter : Asseoir. « Site te dan in moment » : assieds toi un moment. - (19) |
| siterelle des dames, subst. féminin : jeu de la chaise. C'est un jeu qui consiste à se faire porter par deux camarades, en étant assis sur leurs bras croisés. Aujourd'hui, on dit faire la chaise. - (54) |
| sitie (sicie) : s, f., soif, sécheresse. - (20) |
| sitoût - d'astoût : aussitôt - (57) |
| sitout. adv. - Sitôt - (42) |
| sitrelle (aine) : (un) petit siège, (un) petit banc - (37) |
| six-quat’deux (à la), loc. se dit d'un travail fait hâtivement, sans soin. - (22) |
| six-quat'-deux (à la) : Locution. Se dit d'un travail fait hâtivement et sans soins « Fare à la six-quat'-deux ». - (19) |
| six-quat'deux (a la), loc. se dit d'un travail fait hâtivement, sans soin. - (24) |
| sizià, ciseau. - (16) |
| s'ke, pour : est-ce que ? s'ke te veu fini ? veux-tu cesser ? dit-on à un enfant turbulent, tapageur. - (16) |
| slé (en) (loc. adv.) : en réserve (mette quioque choue en slé) - (64) |
| sllon n.m. Sillon. - (63) |
| sloeu, s. m. soleil. - (22) |
| slou, s. m. soleil. - (24) |
| slyé : petit baquet pour les raisins à la vendange. - (21) |
| s'ma (du) : jachère - (57) |
| s'machurè : se salir le visage - (46) |
| s'main-ne (na) : semaine - (57) |
| smain-ne : (nf) semaine - (35) |
| smaiñne n.f. Semaine. - (63) |
| s'male, semelle ; r'semalé, mettre à des souliers de nouvelles semelles et donner une bonne leçon à qui la mérite. - (16) |
| s'malle (na) : semelle - (57) |
| s'maller l'bordon : donner un coup de pied aux fesses - (48) |
| s'man, graines pour semences. - (16) |
| smardé : v. faire le premier piochage de la vigne. - (21) |
| smarder : labour de fin d'année - (43) |
| smarder v. Donner la premiere façon à un champ, à une vigne. Piocher en surface. - (63) |
| s'maulle : semoule. Une galette à la s'mouille : une tarte à la semoule. - (33) |
| s'mè : semer - (46) |
| s'meine : n. f. Semaine. - (53) |
| smence n.f. Semence. - (63) |
| s'mences (les), s. f., époque des semailles : « Y é bentôt les s’mences. » - (14) |
| s'ments, s. m., ensemencements fournis par le locataire d'un terrain, que le bailleur est chargé de labourer. - (14) |
| s'mer les épousés, loc, jeter sur le couple, à son retour de l'église, différentes sortes de graines : blé, avoine, fèves, etc. - (14) |
| smer v. Semer. - (63) |
| s'mer, v. tr., semer. - (14) |
| s'mettre è cavale : se mettre à cheval sur... - (46) |
| s'meûssè : se faire tout petit pour ne pas être vu - (46) |
| smin-ne : s. f. semaine. - (21) |
| s'mis (on) : semis - (57) |
| s'monder : offrir quelque chose pour le faire acheter - (39) |
| s'mondre, v. tr., offrir, proposer une affaire, une emplette : « J'li ai s'mondu mon blé. » Se dit généralement des domestiques : « Alle é venue se s'mondre. » - (14) |
| s'monter l'bobèchon, s'monter l'bonnèchon : se monter la tête - (48) |
| s'monter le bobéchon : se monter la tête - (39) |
| s'moû, s. m., semeur. - (14) |
| s'moué. n. m. - Semoir. - (42) |
| s'mouillon (on) : sieste - (57) |
| s'moule : n. f. Semoule. - (53) |
| smouner : voir semondre - (23) |
| s'mouÿe, et s'mòÿe, s. f., semoule. - (14) |
| snaille, sf. sonnaille, petite clochette. Voir aichaule. - (17) |
| snailli : disséminer, disperser - (51) |
| s'nale, ç'nale : cenelle (baie de l'aubépine) - (48) |
| sné : v. semer. - (21) |
| snèe (la) : poitrine. (E. T IV) - S&L - (25) |
| s'née : n. f. Espace entre un vêtement et la poitrine. - (53) |
| snée : n. f. Poitrine féminine. - (53) |
| snée, s.f. espace compris entre le cou et le creux de l'estomac ; ine snée d 'calas : ce que peut contenir en noix l'espace compris entre la chemise et la peau dans la "snée" (dérivé de "sein"). - (38) |
| sner (v. tr.) : semer - (64) |
| s'ner : semer - (57) |
| s'neyè : se noyer - (46) |
| s'nia (la) : semailles - (57) |
| snicle (un) : chénopode blanc. des cultures et décombres ; tiendrait davantage son appellation de « senousse » (autre nom du chénopode) que de sa quasi-homonymie avec la « sanicle d’Europe » (ombellifère des sous-bois) (?). - (62) |
| snitiot : herbe très forte montant jusqu'à 1 m 50 avec plusieurs rameaux. (E. T II) - B - (25) |
| s'nou (on) : semeur - (57) |
| snuschion, s.m. seneçon. - (38) |
| so - seu : sec - (57) |
| so - sou. - Prôtez-moi don voué quinze so. - Es aute fouai, es pôres c'éto des liairds ; ma ai c't'heure â velant des so. - (18) |
| sô - soul. - Al â tojeur sô, ce pôre homme lai c'â bein malheureux. - I ne veux pu ran, i seux prou sô ; c'â cequi s'aipeule bein repaiché. - Raimeune les bœufs, vais ; à son prou sô métenant. - (18) |
| so – toit à porcs. - Vai don notie lai so de note couchon ; ci sent gros mauvais ! - Est-ce que t'é bein fermai lai so ? - (18) |
| so (na) : soue - (57) |
| sô : (adj.) sourd - (35) |
| so : (prep) sous - (35) |
| so : haie. (CST. T II) - D - (25) |
| so : s. f. sel. - (21) |
| so : sec - (37) |
| so : sec - (46) |
| so : sec - (48) |
| sô : sec, c'est sô son saoûl ! - (56) |
| so : Sec. « Ce foin est prou so, mentins le en cuchots » : ce foin est assez sec, mettons le en tas. Féminin : sache. Au figuré : « So c 'ment in co de trique » - (19) |
| sô : soir. (CST. T II) - D - (25) |
| so au féminin soiche - sec et sèche. - Note foin â aissez so ; en fau ailai le queri. - Que ce temps qui â don so ! en fauro in pecho de plieue. - Lai terre â bein soiche, ran ne peut bein veni. - On dit aussi Choiche. - (18) |
| sò ou soo. Sois, soit. Que je sò, que tu sò, qu'ai sò, que je sois, que tu sois, qu'il soit ; sò saige, sois sage. On met sò devant une consonne, sòt devant une voyelle, sò di san vanitai, soit dit sans vanité ; san vanitai sò-t-i di, sans vanité soit-il dit. De plus sò, et plus communément soo, est le substantif soie. - (01) |
| so : adj. Sec. - (53) |
| sô : prép. Sous (dessous). - (53) |
| so : sec - (39) |
| so, adj. sec. - (38) |
| so, cep de vigne ; ceux qui croient bien parler disent : un cèpte. - (16) |
| so, chouèche : sec, sèche. - (29) |
| s'ô, et s'ou, contract. de Si vous : « Eun p'tit sou, s'ô plait (ou s'ou plait). » — Aux visiteurs qui vont au Mont-Saint-Michel les gamins demandent : « Sou, s'plait, » pour : Un sou, s'il vous plaît. C'est laconique. - (14) |
| sô, et sou, prép., sous. - (14) |
| so, s.f. sel (cf. sau). - (38) |
| so, sec ; soèche au féminin ; du pin so, du pain sec. - (16) |
| sô, sec. - (02) |
| sö, sf. soif. - (17) |
| sö, sf. tect à porcs. Soue, mare à sangliers. - (17) |
| sö, sm. saoul. Voir sou. - (17) |
| so, sm. soir. Ai ç'sô, ce soir. Mardi ai ç'sö, mardi soir. - (17) |
| sô, soche, adj. sec, sèche. - (17) |
| sô, sòche, adj., sec, sèche. - (14) |
| so, soche, sec, sèche. - (05) |
| so, soif. - (26) |
| so, sön adj. Poss. Son. - (63) |
| so, sou : sou (monnaie) - (48) |
| sô, souéche ou chouéche au féminin, adj. sec : ce linge est « sô » : cette terre est « souéche » ou « chouéche. » - (08) |
| sô, sous ; d'sô, dessous. - (38) |
| so. Sec, fait au féminin soche. - (03) |
| sô. Sou, qu'on écrivait autrefois saoul, en latin satur…. - (01) |
| so’, souache, souachî : sec, sèche, sécher. - (62) |
| soâye, seigle. - (16) |
| sobrandier. Se dit de l'individu qui est de la suite d'un autre, de sa clientèle dans le sens antique du mot, qui a avec lui une communauté de vues ou d'intérêts, qui le soutient au besoin. Ex. : « II a fait obtenir une bonne place à X, ce n'est pas étonnant, c'était un de ses sobrandiers. » - (12) |
| sobye, sabye : sable - (43) |
| soc, souèce (adj.m. et f.) : sec, séche - (50) |
| sôce, saule. - (16) |
| soche, souche de bois. - (05) |
| soché, vt. sécher. - (17) |
| socheron, sm. champ stérile. Personne maigre. - (17) |
| soch'ou : s. m. soufflet. - (21) |
| sochresse, sf. sécheresse. - (17) |
| sôci. Souci, soucis. - (01) |
| sociau : adj. m., social ; s. et adj. m., socialiste. - (20) |
| sôco, saussaie, lieu planté de saules. - (02) |
| sôco. : Lieu planté de saules. - (06) |
| sodiâ, sourd. - (27) |
| södiant, adj. suivant. - (17) |
| sodiöt, öte, adj. sourd. Voir sor. - (17) |
| sodje : sourd - èl â sodje q'ment un pot ! il est sourd comme un pot ! - (46) |
| södjre, vt. [mouillure entre d et r, comme pour modjre et todjre]. suivre ; pp. sodiu. - (17) |
| sôdre : Sortir. « An ne peut pas fare sôdre du sang d'eune piarre » : on ne peut pas tirer de sang d'une pierre ni de l'argent de quelqu'un qui n'en a pas. « Va dan tiri à boire - J'en d'so » : va donc tirer à boire - J'en sors, j'en viens. - (19) |
| so-dzendre : (nm) prétendant d’une fille à marier (humoristique = sous-gendre) - (35) |
| soé, soif. - (16) |
| soèchons, échalas inutilisables parce que pourris ou vétustes. - (27) |
| soediais, adj. ; sourd. - (07) |
| soéf, souéf, soué. n. f. - Soif.: « Te doués avouèr soué, veins don' bouère un canon. » - (42) |
| sœllye, s. f. seau. Diminutif siaton. - (24) |
| sœllye, s. f. seau. Diminutif : selliaton. - (22) |
| sœû (na) : sœur - (57) |
| sœul, sœule : adj. Seul, seule. - (53) |
| soeur : (nf) religieuse - (35) |
| sœurée. s. f. Sociéte. (Lucy-sur-Cure). – Doit s'entendre probablement de quelque réunion de jeunes filles amies, s'aimant comme des sœurs. - (10) |
| soèye, soueille (n.m.) : seigle (de Chambure écrit soueille) - (50) |
| sofaîte n.m. Espace de stockage du fourrage sous le faîte du toit. - (63) |
| sôfar. Souffert, soufferts. - (01) |
| sofflai, soffle (ll bien mouillées) - souffler, souffle. - Le vent sofflio fort lâvan en chaume. - Te soffle dan tes doigts, en fait don bein froid ? - Te sofflieuré lai lampe sitôt qu'en fairé jor,.. t’entens ! - (18) |
| soffri, v. a. souffrir, endurer. au partic. passé « soffri » : « al é prou soffri po mûri », il a assez souffert pour mourir. - (08) |
| sôflai. Soufflet, soufflets. C'est aussi l'infinitif du verbe souffler… - (01) |
| sôfle. Souffle, nom ou verbe. - (01) |
| sôflein. Soufflions, souffliez, soufflaient. - (01) |
| sòfler les pois, loc., ronfler en faisant sortir de sa bouche un souffle qui ressemble à une ébullition. - (14) |
| sòfler, v. tr., souffler, respirer. - (14) |
| sofliot : Soufflet, gifle. « Ol a reçu in ban sofliot ». - (19) |
| sof'lle Souffle. « Y m'a copé le sof'lle ». « O n'a plieu que le sof'lle ». - (19) |
| sofller ou soflier : Souffler. « Soflians voir in moment » : soufflons un peu. - Attiser. « Soflier le fû ». - Eteindre. « Soflier la lampe ». - (19) |
| sòfrance, s. f., souffrance. - (14) |
| sofrance, sofreté, souffreté. n. f. - Souffrance. Sofrance a été employé dès le XIIe siècle en ancien français, le poyaudin l'a conservé intact. - (42) |
| sôfré. Souffrez. - (01) |
| sòfrî, part, du verbe précédent, souffert : « Ah ! qué gros maux sòfri par ce chin d'temps ! » - (14) |
| sòfrî, v. intr., souffrir, endurer. - (14) |
| sôfri. Souffris, souffrit, souffrir. - (01) |
| sofri'. v. - Souffrir. Le poyaudin emploie le terme ancien français usité depuis le XIe siècle : sofrir, dérivé du bas latin sufferire. - (42) |
| sôhaiter (v.) : souhaiter - (50) |
| soi (Sur) : loc. Etre sur sol, être propriétaire de son habitation. Travailler sur sol, cultiver ses propres terres. - (20) |
| soi ou soé. Haie. A s’ast caiché darré lai soi. Ce mot vient-il du Hainaut où il a le même sens, ou bien les Hennuyers l'ont-ils emprunté au bourguignon : nescio ? - (13) |
| soi ou soip. : (Dial. et pat.) Ce mot a deux significations : venant du latin soepes, il signifie haie ; venant du latin sitis, il veut dire soif. Glaucé de soi, glousser de soif (expression de Lamonnoye) ou récrier la soif comme on dit au village, est une expression fournie par le latin glocire ou glocitare, glousser comme la poule qui réclame sa pitance de la ménagère. - (06) |
| soi, et mieux soip, haie ; du latin sœpes. - (02) |
| soi, et soie, s. f., haie sèche. - (14) |
| soi, lui : i ôt à soi , c'est à lui. - (38) |
| soi, s. f., soif : « Ol a tant buvoché, c' lichoù, qu'ô n' fait qu'crier la soi. » - (14) |
| soi. Haie sèche ; latin, soepes ; bas latin, sotum. - (03) |
| soi. Soif. - (01) |
| soi’ : soif. « J’avo soi’ ! » : j’avais soif ! - (62) |
| soichai - sécher. Pour choichai voyez ce mot. - (18) |
| soiche, adj. sèche. - (38) |
| soicher , v. tr., sécher, dessécher : « Ton vin blanc, l'gueùrdin, ô m' soiche la garguillòte. » - (14) |
| soicher, sécher. - (05) |
| soicher, souécher, v. a. sécher, dessécher. La terre « soiche » vite dans l'été. On dit de l'ivrogne qu'il « soiche » sur pied. - (08) |
| soicher, v. ; peser sur ; soiche cette herbe-là. - (07) |
| soicher, v. ; sécher. - (07) |
| soicheresse, souécheresse, s. f. sécheresse, état de ce qui est desséché. - (08) |
| soicherin, n. masc. ; lieu sec où l'herbe pousse mal. - (07) |
| soicherin, souécherin, s. m. sécheron, partie sèche d'un pré, endroit qui n'est pas irrigué. - (08) |
| soicherosse, s. f., sécheresse. - (14) |
| soicherotte, souécherotte, s. f. sécheresse. - (08) |
| soichot, n. masc ; cauchemar. - (07) |
| soichou, sodéchou, s. m. sécheur, appareil quelconque servant à sécher le linge. - (08) |
| soide, adj. sur, trop fait. - (38) |
| soie : s. f. grosse corde qu'on passe sur le char de foin ou de blé pour maintenir la charge. - (21) |
| soie, haie sèche. - (05) |
| soie, s. f. duvet, poil du corps humain : il y a trois mois qu'il est couché sur la « soie » de son dos est une locution donnant à entendre qu'un homme est alité depuis longtemps : - (08) |
| soifer, v. intr., apaiser sa soif, boire, et parfois beaucoup. - (14) |
| soifou : ivrogne, un boit-sans-soif. - (62) |
| soifoû, s. m., soiffeur, ivrogne : « Vrâ ! que soifoû qu'ça fait qu'ton houme ! » - (14) |
| soignat. s. m. Personne incapable, qui n'est bonne à rien. (Courgis). - (10) |
| soigné pour signé. : Soigné de son soignot, c'est-à-dire signer de son seing. (Franch. de Seurre, 1341.) - (06) |
| soigner : v. a., vx fr. soignier, surveiller, guetter. J’ vas l’ soigner venir. - (20) |
| soigni : soigner - (43) |
| soileau (nom masculin) : seau généralement entreposé dans la bassie et qui contenait l'eau de source destinée à la consommation. - (47) |
| soille - seigle. - C't'année les soilles sont joliment grands ; en pourré fâre des liens, pair exemple. - Les .soilles sont pu geurnai que les bliets. - (18) |
| soille, s. f., seigle. - (14) |
| soille, s.f, ancien récipient employé jusqu'au XIXe siècle, pour la mesure des grains ; égandiller la soille : contrôler sa capacité. Dérivé : soillon. - (38) |
| soille, seigle. - (05) |
| soille, seille de puits. - (05) |
| soille, soueille, s. m. seigle. Dans le pays seigle et blé sont synonymes. Le froment y est d'importation récente. - (08) |
| soille. Seigle. - (03) |
| soilleau (n.m.) : seau où l'on puise l'eau du puits dans la "bassie" (de Chambure note soillot) - (50) |
| soillée, s.f. contenu d'un seau. - (38) |
| soiller : voir soueiller - (23) |
| soilleu, seau. - (27) |
| soillié (nom féminin) : petite pièce attenante à la cuisine. - (47) |
| soillié, s. m. cellier, petite pièce annexe de la principale ou généralement de l'unique chambre et dans laquelle on place les ustensiles de ménage. - (08) |
| soillo : seau. - (29) |
| soillon - sillon, petite pièce de terre. - A creuse peutéte bein in pecho trop ses soillons. - Vos me fairains in grand plâys, père Daird, si vos velains me vende vote soillon des rues de Cuchey. - (18) |
| soillon de terre, sillon. - (05) |
| soillon, n. masc. ; seau. - (07) |
| sô-ïllon, s.m. sillon. - (38) |
| soillon, sillon tracé par la charrue. - (27) |
| soillot (i) - seau. - Vai voué cherché in soillot d'aie pour laivai les treuffes. - Lai jement é bu préque deux soillots d'aie ; ci ne vaut ran de les laicher aivoir soi quemant cequi. – Pends tôjeur le baissin aipré le soillot ; c'â sai pliaice. - (i) Mot parfaitement français au xvc siècle. P. L. - (18) |
| soillot : voir soueillot - (23) |
| soillot, s. m. seau. dans toute maison morvandelle il y a le « soillot » qui renferme l'eau du puits ou de la source voisine, et le brillant bassin de cuivre dans lequel on la boit à pleines lèvres. - (08) |
| soillot, s. m., seau d' écurie. - (40) |
| soillot, s.m. seau, - (38) |
| soillot. Seau à mettre du liquide. Prends don not’ soiIlot pour ailler quéri de l’ia. ... Nos campagnards donnent le nom de seille au vase de sapin qui sert à traire les vaches. - (13) |
| soin : sein. - (29) |
| soin, s. m. sein, la partie du corps où sont les mamelles, la mamelle elle-même. Une mère donne le « soin » à son enfant. - (08) |
| soin, sein. - (16) |
| soinge, soingeai - divers temps du verbe changer. - Ne soinge don pâ quemant cequi les choses de pliaice. – Ces gens lai, â soingeant d'idées pu souvent que de chemies. - Le temps vai soingeai. - (18) |
| soingner (se) v. réfl. se signer, faire le signe de la croix. - (08) |
| soingner (se). v. - Se signer. - (42) |
| soingner (Se). v. pron. Se signer, faire le signe de la croix. Soingne-te, moun enfant. - (10) |
| soingnou, ouse, adj. soigneux, celui qui a du soin, qui soigne avec zèle, avec intelligence, qui a cure , souci de bien faire. - (08) |
| soins, seins. - (27) |
| soinzer (v.) : changer - (50) |
| soinzer : changer - (39) |
| soïö, sm. a Échalot : soïeu. - (17) |
| soiré : sureau (en B : souéri). A - (41) |
| soiretée. s. f. Soirée. (Villiers Bonneux). - (10) |
| soiron, serment, promesse solennelle... - (02) |
| soiron. : (Dial. et pat.) On dit aussi soirment, ce qui est une même dérivation du latin sacramentum. (Voir aux dernières lignes du mot gaufretié.) - (06) |
| soir'tée. n. f. - Soirée. - (42) |
| soirton. n. m. - Goûter, quatre heures pour les enfants. (Perreuse, selon M. Jossier) - (42) |
| soirton. s. m. Goûter, petit repas qui se fait à 4 heures du soir. (Perreuse). - (10) |
| soirtonner. v. - Faire quatre heures. (Perreuse, selon M. Jossier) - (42) |
| soirtonner. v. n. Faire le soirton. (Perreuse). - (10) |
| soiteure (n.f.) : mesure égale au journal pour les terres labourables = 23 a. 85 ca. - (50) |
| soiteure, s. f. soiture, mesure de superficie qui contient ici comme le journal 22 a. 85 c. Le terme journal s'applique aux terres labourables, tandis que soiture se dit exclusivement des prairies ou pâturages. - (08) |
| soiture : mesure agraire pour les prés : ce qu’un homme pouvait faucher en une journée ~ 1/3 ha. (Voir souâ) - (62) |
| soiture : Mesure de surface employée pour les prés : 34 ares 26. - (19) |
| soiture : s. f., ancienne mesure de surface pour les terres (prés) ; correspondant à ce qu'un homme peut faucher (sayer) en un jour, et de même contenance que le journal, c'est-à-dire valant 31 ares 284. - (20) |
| soiture, s. f., étendue de pré qu'un homme peut faucher (soüer) en un jour. - (14) |
| soiture, s. f., mesure de pré (= un journal). - (40) |
| soiture. Mesure bourguignonne qui s'applique aux prairies : elle a la même contenance que le journal de labour, c'est-à-dire : trente-quatre ares vingt-huit centiares. Les chartes du Moyen-âge traduisent ce mot par secatura : c'est ce qu'un homme peut faucher en un jour. - (13) |
| soiture. Mesure d'étendue pour les prés, bas latin soitura ; ce qu'un homme dans un jour peut faucher ou souer. - (03) |
| soiturei, s. f., faucheur, celui qui soüe. - (14) |
| soiturier, faucheur. - (05) |
| soixantaiñne n.f. Soixantaine. - (63) |
| soiya, seau pour puiser l'eau et la conserver pour l'usage. - (16) |
| soiyeuil : seau. (LEP. T IV) - D - (25) |
| soj : s. f. sauge ; saule. - (21) |
| solâ : le soleil (voir : soulai, soulau). - (56) |
| sola : s. m. soleil. - (21) |
| sola : Soleil. « Le sola lut pa tot le mande ». « Ol a du butin au sola » : il a du bien au soleil. « Euser le sola » : flaner, tuer le temps. - (19) |
| soladzi : soulager - (43) |
| sôlai - soûler, rassasier. - Songez don ! lai Pierrette que se sôle ! Oh ! c'â éffrayant !... - Que c'â don peut, ces ivrognes que se sôlant ! - En y aivo in bon diniai ; i me seux sôlai. - (18) |
| solaire - le vent du midi. - C'â le solaire que beille, to vai soicher. - C'â le solaire que breûle les denrées. - (18) |
| solaire : vent du sud. III, p. 24-d - (23) |
| solaire, n. masc. ; vent du sud. - (07) |
| solaus, soleil soulot. - (04) |
| soldas, s. m. plur. étincelles qui s'échappent en gerbes du foyer et font irruption dans la chambre. - (08) |
| soldâs, s. m., étincelles qui s'échappent en feu d'artifice d'une bûche lorsqu'on tisonne activement. - (14) |
| solé : fenil au dessus de la grange (en B : soli). A - (41) |
| solé (n.m.) : grenier à foin (a. fr., solier = grenier) - (50) |
| solé (nom masculin) : grenier à foin. - (47) |
| solé : (nm) soleil - (35) |
| solé : soleil - (43) |
| solé : soleil - (51) |
| solé : où on engrange le foin - (39) |
| sole, s. f. sole, terrain en général. - (08) |
| solé. s. m. fenil, grenier à foin, plancher supérieur. - (08) |
| solégi : Verbe soulager. « Y m'a solégi » : cela m'a soulagé. - (19) |
| solei (on) : soleil - (57) |
| solei n.m. 1. Soleil. 2. Tournesol. - (63) |
| soler, souler : v. n., avoir coutume. - (20) |
| soler. Grenier à foin ; on a dit autrefois solier. - (03) |
| soleure : plancher du solé* ou son premier rang de foin ou de paille. A - B - (41) |
| soleure : plancher du fenil ou premier rang de foin, de paille sur celui-ci - (34) |
| solever : soulever - (43) |
| soli : (nm) partie supérieure de la grange - (35) |
| soli : fenil au-dessus de la grange - (34) |
| soli n.m. (du lat. solum, le sol) Fenil au-dessus de l'étable, constitué d'un plancher posé sur des solives recouvert d'une couche d'argile (le tarra) ; on dit aussi fnau. - (63) |
| sôli. Soulai, ou rassasiai, soûlas, soula. - (01) |
| solin (n.m.) : partie élevée d'un pré sec par nature - (50) |
| solin : (nm) friche - (35) |
| solin : partie sèche d'un pré - (48) |
| solin n.m. 1. Friche. 2. Partie la plus sèche d'un pré. - (63) |
| solin : (solin: - subst. m.) 1- partie élevée et sèche d'un pré par rapport à la partie basse beaucoup plus humide. 2- le solin est aussi le chaufau d'lè grouin:j', là où l'on empilait les gerbes qui devaient attendre le "battoir". - (45) |
| solin, s. m. partie élevée d'un pré généralement humide, endroit sec par nature. ce pré est mauvais, mais il a quelques bons « solins. » On appelait autrefois solin ou sollin l'étage inférieur d'une maison, le rez-de-chaussée. - (08) |
| solin, vacible, audzère : friche - (43) |
| soling : partie sèche du sol d'un pré, partie un peu en pente - (39) |
| solive : s. f., ancienne mesure de volume pour le bols de charpente. Elle avait 6 pieds de longueur, 1 pied de largeur et 6 pouces d'épaisseur, soit 3 pieds cubes, et valait 0 mètre cube 102827 centimètres cubes. - (20) |
| soliveau : s, m. baliveau. - (20) |
| solleit. : (Dial.), soulé (pat.), rassasié de. - (06) |
| sôllhon, ll mouillées, s. f. souillon, femme ou fille malpropre. - (08) |
| solo : (vb. n’existant qu’au passé, exprime l’aspect révolu) « y solo être eune tarre » : autrefois, c’était un champ - (35) |
| sôlô. Soleil. - (01) |
| sôlo. : (Dial. et pat.), soleil. « Li soloz de justice. » (S. B., 1er sermon de l'avent.) - (06) |
| soloir v. (lat. solere, avoir coutume de). Avoir l'habitude. - (63) |
| sôlon - homme qui s'enivre souvent. - En ne dairo pâ aivoir de pitié pou les sôlons. - In sôlon, quée pliaie aibominabe dans ine famille, et quée sâle exemple dan les rues !... c'â bein pire qu'in annimau. - (18) |
| soltain. : (Dial.), solitaire. Vraie dércyation du reg. latin solitarium. - (06) |
| solû (n.m.) : saloir - (50) |
| solver v. Soulever. - (63) |
| som : dormir un som = faire la sieste. III, o. 32-v - (23) |
| som n.m. Sommeil. - (63) |
| som, son : s. m., vx fr., sommeil. - (20) |
| somâ : Jachère. « Eune tarre en somâ » : un terrain en jachère. - (19) |
| soma'lli : Sommeiller. « Va dan te couchi puteut que de soma'lli su ta chaire ». - (19) |
| somances : semailles - (43) |
| somarder : Donner la première façon à la vigne. « In ban vigneran a tojo fini de somarder pa la Saint-Geôrges ». - (19) |
| sombre : labour léger après moisson (pour attendre), jachère - (48) |
| sombre : terrain que l'on sombre. Voir sombrer - (23) |
| sombre : premier labour superficiel, après moisson pour faire germer les mauvaises herbes. - (33) |
| sombre : s, m., vx fr., terre qui n'a reçu que le premier labour. Planter sombre, planter peu profondément. Etre sombre, être planté peu profondément. - (20) |
| sombre, jachère. - (26) |
| sombre, jachère. - (27) |
| sombre, s. m. terre qui a reçu un labour : terre en « sombre. » Le mot est plus usité dans le nivernais et en bourgogne que dans le Morvan proprement dit. - (08) |
| sombrer (v.t.) : faire un labour préparatoire - (50) |
| sombrer : donner un labour superficiel. III, p. 28-n - (23) |
| sombrer : en morvan, labourer au printemps - (37) |
| sombrer : labourer pour laisser en jachère - (48) |
| sombrer : (son:brè - v. intr.) labourer un champ et éventuellement le herser pour le laisser reposer un an sans l'ensemencer. On dit alors que la terre est en sombre. - (45) |
| sombrer : labour peu profond pour préparer la terre pour le printemps suivant - (39) |
| sombrer. v. a. labourer un terrain, donner un labour préparatoire. - (08) |
| sombres, sombes. n. m. pl. - Premiers labours : « On va bentôut fai'e les sombres, si l'temps change pas ! » Ce mot est utilisé en ancien français depuis le XIIIe siècle ; un sombre (de l'allemand Sommer, belle saison) était la saison du premier labour, ou le premier labour lui-même. - (42) |
| sombres. s. m. pl. Premier labour, premières façons données aux terres et aux vignes. - (10) |
| sombreté, somberté. n. f. - Obscurité. - (42) |
| sombreté, somberté. s. f. Obscurité état de ce qui est sombre. (Puysaie). - (10) |
| somence, s. f. semence, le grain que l'on sème. (voir : semens.) - (08) |
| somence, soumence : semence - (48) |
| somer : semer - (43) |
| somer : semer - (51) |
| somer, soumer : semer - (48) |
| somer, v. a. semer, répandre les grains de semence. « soumer. » - (08) |
| som-mè : v. t. Semer. - (53) |
| somme, charge d'un âne, d'un cheval. - (04) |
| somme, n.m. sommeil, uniquement dans l'expression « j'ai somme - j'ai sommeil ». - (65) |
| somment. adv. - Seulement. - (42) |
| somoir : semoir - (51) |
| somoû : semeur - (48) |
| somoû : semoir de toile (voir flairé) - (48) |
| somou : (sômou - subst. m.) il ne s'agit pas des semoirs modernes que traîne un tracteur. C'était un tablier de forte toile, à bretelle unique qui passait sur l'épaule gauche. Le semeur réunissait les deux coins du bas et, ces coins relevés, il pouvait transporter 10 à 15 kilos de blé qu'a sômo è lè vô:lé: (qu'il semait à la volée). - (45) |
| somou, s. m. semeur, tablier dans lequel le laboureur met le grain qu'il sème. - (08) |
| son (la) : sommeil - (43) |
| son (n. m.) : somme (fée un son) - (64) |
| son : (nm) sommeil : « dz’ai son » - (35) |
| son meine : ce qui m'appartient - (51) |
| son seine : ce qui lui appartient - (51) |
| son', so adj. poss. Son. Voir so. - (63) |
| son. Sommes, sont. Je son contan, nous sommes contents, ai son contan, ils sont contents. - (01) |
| sonbre, sm. saison de la jachère dans l'assolement triennal. - (17) |
| sonbré, vl. donner le premier coup de charrue ; le deuxième se dit reussé, le troisième semé. - (17) |
| sondzi (r) : (vb) songer, penser à faire qqch. - (35) |
| sondzi : songer - (43) |
| sondzi v. Songer, réfléchir, penser, envisager. Très utilisé à la place de penser et réfléchir. - (63) |
| sône, s. f., la Saône, dans laquelle le Doubs se jette à Verdun. Le confluent a lieu à la pointe de l'Ile. - (14) |
| soner : Semer. « A la Saint-Geôrges sone ton ôrge, à la Saint-Mâ y est treu tâ » : à la Saint-Georges sème ton orge, à la Saint-Marc il est trop tard. - (19) |
| songer, penser. - (26) |
| songer, v. rêver la nuit (cette nuit, j'ai beaucoup songé). - (65) |
| songi : rêver (penser) - (57) |
| songi : songer - (57) |
| songné, vt. [signer]. jeter de l'eau bénite sur un mourant en tenant le cierge de famille. - (17) |
| sonjou, rêveur. - (16) |
| sonne : Sommeil. « Va te couchi, t'as sonne ». - (19) |
| sonne : s. m. sommeil. - (21) |
| son-ne, s. m. sommeil. - (22) |
| sonné, y. imp. sembler. È m'sonne, è m'sonno, il me semble, il me semblait. - (17) |
| sonneille, s. f. sonnaille, clochette qu'on attache au cou des animaux qui vont aux pâturages. - (08) |
| son-ner : sonner - (57) |
| sonner, v. a. sonner. on entend « son-ner » les cloches. — « sonner les moches », appeler l'essaim d'une ruche en frappant sur des ustensiles métalliques. - (08) |
| son-nette : sonnette - (57) |
| son-nou (on) : sonneur - (57) |
| sonoure : Sorte de tablier en forme de sac dans lequel le semeur porte devant lui le grain qu'il veut semer. - (19) |
| sonoux : Semeur, peu usité. - (19) |
| sons (nous), nous sommes. - (04) |
| sonzer (v.t.) : songer - (50) |
| sop' : n. f. Soupe. - (53) |
| sop : s. f. soupe . - (21) |
| sôpailler, v. a. secouer, agiter en tout sens. - (08) |
| sope (n.f.) : soupe - (50) |
| sope : (nf) soupe; souper - (35) |
| sope : soupe - (51) |
| sope : soupe ; repas du soir - (43) |
| sopé : v. dîner du soir. - (21) |
| sope n.f. Soupe, repas du soir. - (63) |
| sôpe, s. f. soupe. - (08) |
| sòpe, s. f., soupe. C'est l'aliment de prédilection pour le soir ; aussi dit-on sòper. Plusieurs s'en contentent pour leur dernier repas. - (14) |
| sôpe. : Soupe, potage. On dit : dressai lai sôpe, c'est-à-dire servir le potage. - (06) |
| sopée : cépée - (48) |
| sopée, s. f. cépée, touffe de jeunes arbres sortis de la même souche. - (08) |
| soper v. Souper, prendre le repas du soir. - (63) |
| soper, v. n. souper. S'emploie comme déjeuner et diner avec la forme passive : « i seu sôpé », je suis soupé = j'ai soupé. - (08) |
| sòper, v. tr., souper, manger la soupe. - (14) |
| sopès. s. m. Cep. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| sopiére, s. f. cepée, touffe d'arbres ou d'arbustes sortant de la môme souche. (voir : sopée.) - (08) |
| sòpir, s. m., soupir. - (14) |
| sòpirer, v. intr., soupirer, désirer. - (14) |
| soque (n.m.) : socle - (50) |
| sôquié, loc. sous clef, dans une cachette : « al é mcttii son airgen sôquié », il a caché son argent. - (08) |
| sôr, s. m., sort, difficulté, empêchement. Dans bien des phrases s'emploie d'une façon particulière : « Oh ! gueùrdin d’sôr ! j'ai-t-i du mau !» — « On a jeté eun sôr su ma vaque. » — « Eh ben ! la p'tiote ne peut pas v'nî ? Y é donc eun sôr ! » - (14) |
| sor, sodje, adj. sourd, sourde. - (17) |
| sor, sorde, adj. sourd, sourde. - (08) |
| sor. Sourd, sourds. Ce peut aussi être le verbe je sor, ai sor, je sors, il sort, et le substantif sort. - (01) |
| sorcelage : sorcellerie. VI, p. 43 - (23) |
| sorcer. v. a. Guetter, chasser. Le chat sorge. (Grandchamp, Laduz). - (10) |
| sorci : sorcier - (43) |
| sorcière, n.f. araignée faucheux. - (65) |
| sorciére, s. f. araignée. - (08) |
| sorcillaige, s. m. sortilège, maléfice de sorcier. - (08) |
| sorciller. v. - Sourciller. Le poyaudin conserve l'idée contenue dans l'ancien français sorcillier, usité depuis le XIIIe siècle, à partir du mot sorcille, sourcil. - (42) |
| sord (e) : sourd - (48) |
| sòrd, adj., sourd: « Ol é sòrd c'ment eun pot. » - (14) |
| sordais - sourd. - Al â sordais quemant ine piaiche. - C'â embêtant les sordais, en faut criai que to le monde entend. - Préche les sordais et boi de l'aie. - (18) |
| sordat : s, m., soldat. - (20) |
| sordat, s. m. soldat. - (24) |
| sorde : sourd - (57) |
| sordeai, s. m. sourdaud, celui qui a l'oreille dure. - (08) |
| sordeilhe. : (Dial.). impureté. (Du latin sordicula.) - (06) |
| sordia : sourd. - (29) |
| sordiâ, sourd. - (16) |
| sordiau, s. m. sourdaud. - (08) |
| sordiaud, sordiaude adj. Sourd, sourde. Les Bressans disposent du verbe essordialer, rendre sourd. - (63) |
| sordité (na) : surdité - (57) |
| sordzeure : morceau de bois torsadé servant à relier les cordés* au joug. A - B - (41) |
| sordzeure : morceau de bois torsadé pour relier les cordets au joug - (34) |
| sorée, sf. soirée. - (17) |
| soret (n.m.) : haricot qui n'a qu'un cotylédon - (50) |
| sorge. n. f. - Bonne terre, propre, bien préparée. (Bléneau, selon M. Jossier) - (42) |
| sorge. s. f. Terre en bon état, bien ameublées. (Bléneau). - (10) |
| sorgeon. s. m. Poignée de chanvre. (Etais, Festigny). - (10) |
| sorgette. s. f. Piège à souris. (Laduz). - (10) |
| sorgin : rats ou souris. (DC. T IV) - Y - (25) |
| sorgin. s. m. Rataille. (Laduz). - (10) |
| sörie, sf. portée nombreuse. Grande quantité. - (17) |
| sòris, s. f., souris. - (14) |
| sormonter. v. - Surmonter. Usage directement emprunté à l'ancien français sormonter, employé au XIIe siècle. - (42) |
| sornette. n. f. - Surnom, sobriquet. - (42) |
| sornette. Sobriquet. (Bléneau). - (10) |
| sornois, oise, adj. sournois, qui n'est pas franc. - (08) |
| sorquetot (adv.) : surtout, par-dessus tout - (50) |
| sorquetot, adv. surtout, principalement, par dessus tout. peu usité et seulement dans le nivernais. - (08) |
| sorquetout, surtout. - (04) |
| sorquetout. : (Super quoe tota), en outre. (Franch. de Salmaise, 1265.) - (06) |
| sorsaillir. : (Du latin super salire, sauter pardessus), contrevenir à une convention. (Franch. de Seurre, 1278.) - (06) |
| sort (n. m.) : cep de vigne - (64) |
| sôrte, s. f., sorte : « Ol é métu d'dans d'eùne bàle sôrte ! » - (14) |
| sorti : sortir - (57) |
| sòrtî, v. intr., sortir, partir, — et, acception particulière, venir de. Ainsi : « Ô sòrt de pôcher, ô sòrt de miger. » - (14) |
| sortir : v, a., enlever, rabattre (en matière de paiement). - (20) |
| sòrtu, part, de sòrtî, sorti, parti. - (14) |
| sortu, part. pass. du verbe sortir. sorti : « al é sortu », il est sorti. - (08) |
| sorussanz. : (Dial.), surabondant. (Rac. rom. issir ; rac. lat. super exiens (exire), dépassant les bords). - (06) |
| sorvaillance. n. f. - Surveillance. - (42) |
| sos - en d'sos - d'sos : dessous - (57) |
| sôs (prép.) : sous - (50) |
| sos : sous - (51) |
| sos : sous - (57) |
| sos prép. Sous. - (63) |
| sos, prép. sous : « al ô choué sô lu », il est tombé sous lui. - (08) |
| sôt, adj. insupportable. Féminin sotte. - (24) |
| sot, sotte : adj., désagréable, ridicule, en parlant das personnes. - (20) |
| sotan. Sortant. - (01) |
| sôtane. Soutane. - (01) |
| sotche : la sorte - (46) |
| sotchir : sortir - (46) |
| söte, sf. suite. Tö de söte. Voir maitenant, cesse. - (17) |
| sote. Sorte, sortes, substantif féminin. Tôte sote, toute sorte, toutes sortes ; c'est aussi le subjonctif du verbe soti, sortir. Velé vo que je soie, voulez-vous que je sorte ; je veu que tu sote, je veux que tu sortes ; je velon qu’ai sote, nous voulons qu'il sorte, ou qu'ils sortent. - (01) |
| sôte-bousson, saute-buisson, sorte de fauvette. - (16) |
| sôteni. Soutins, soutint, soutenir. - (01) |
| soti. Sorti, sortis, sortit, sortir. - (01) |
| sotie. n. f. - Sottise. Mot apparu au XIIe siècle, dérivé de sot, et d'origine incertaine. Le dialecte poyaudin l'a conservé intact. Le français n'a gardé que le sens dramatique : une sotie, dans l'histoire du théâtre, est le nom donné à une farce satirique mettant en scène des personnages bouffons lors de représentations populaires, du XIVe au XVIe siècle. - (42) |
| sotie. Sortie, sorties ; sotie, est aussi un vieux mot français, synonyme de sottise, et de plus, une sorte de poème dramatique ancien, mêlé de moralités et plaisanteries ; c’est ce qu’on appelait autrement farce. - (01) |
| sotisieu, s. m. celui qui injurie les autres, qui a de gros mots dans la bouche, grossier. - (08) |
| sotji, vn. sortir. - (17) |
| sôtrale, sauterelle. - (16) |
| sôtré : fond d'un tas de foin - (39) |
| sotterie, s. f. sottise, bêtise, niaiserie, plaisanterie. - (08) |
| sottie, s. f. sottise, niaiserie, propos léger. - (08) |
| sottise n.f. 1. Bêtise d'enfant. 2. Injure. Ôl l'a agoni d'sottises. - (63) |
| sottise, 1. s. f. dépradation : ce garnement vient de faire des sottises. — 2. s. f. pl. remontrances sévères, insultes : il mérite qu'on lui dise des sottises. - (24) |
| sottisoux n.m. Celui qui dit ou fait des sottises (sens 1.) - (63) |
| sottisoux : s. m., sottisier, celui qui dit ou fait des sottises. - (20) |
| sou (tout) : seul (tout) - (48) |
| sou (un) de deux sous. Une pièce de dix centimes. - (12) |
| sou : (adj) rassasié - (35) |
| sou : porcherie. - (29) |
| sou : seul (tot sou : tout seul) - (51) |
| sou : seul. Ol aito tout sou : il était tout seul. - (33) |
| sou, cinq centimes ; un sou d'deû sou ; un grô sou, dix centimes. - (16) |
| soû, et sô, s. f., souë, étable à pourceaux. - (14) |
| sou, étable à porcs. - (28) |
| sou, s. f. logement du porc. - (22) |
| soû, s. m. ce qu'il faut, ce qui est nécessaire, au propre et au figuré, pour causer la satiété, la lassitude, le dégoût même : manger et boire « son soû », travailler, « poigner tout son soù. » - (08) |
| sou, s. m. soc de charrue. - (08) |
| sou, seùle, seul, seule ; teû sou, tout seul ; teute seùle, toute seule. - (16) |
| sou, siou (Chal.), soue (Morv., Y.), sô, sou, seu (C.-d.). - Endroit où l'on enferme les porcs, tect à porcs ; c'est encore une expression du vieux français remarquable par sa tournure directement latine, sou venant de sus, porc. - (15) |
| soû, sö, adj. saoul. On dit : El a soû, il est saoul, et : j'en ai mon sö, j'en ai mon saoul. - (17) |
| sou, soule - seul, seule. - I les aitandains to, et pu lai Jeannette à brament venue tote soule. - Al êto to sou ai piaicher dan son champ de treuffes. - Ces mots ne vont jamais seuls ; on voit qu'ils sont toujours accompagnés de to ou de lote. Si on veut exprimer l'idée de un seulement, on emploie ce mot, mais avec un auxiliaire, ainsi : an no daivo envie troua motons, an nos en é envie ran qu'un. - (18) |
| sou, soule (adj.m. et f.) : seul, seule - tot sou = tout seul - (50) |
| sou, soule : (adj) seul (e) (var. su) - (35) |
| sou, soûle : adj. seul, seule. - S'emploie presque toujours avec tout ; toute. - (21) |
| soû, soûle, adj. saoul, rassasié de nourriture en général ou d'un aliment quelconque en particulier. L'homme qui a bien diné sans avoir bu avec excès dit : « i seu bin sou. » Une femme dit « i seu soûle », en pareille circonstance. - (08) |
| sou, soule, adj. seul : « i seu sou », je suis seul ; « ile ô tote soûle », elle est toute seule. - (08) |
| sou, soûle, adj. seul suivi de tout. Teu sou, teute soule. Seul abs., se dit seul. - (17) |
| sou. Étable à pourceaux. Nous disons aussi so et cho. - (03) |
| sou. Toit à porcs. Ce mot est plus concis et plus grammatical que le français : c'est le latin sus que les Romains prononçaient sous. Hi ! hi ! hi ! le Daudi m'aivot enfremée dans lai sou. C'est de là que vient l'adjectif souillon. Le paysan bourguignon appelle son cochon « note haibillé de soie ». J'ai cru longtemps à une plaisante antinomie, le poil du porc étant tout le contraire d'un fil de soie. Un peu de réflexion m'a fait voir que la soie du cochon vient aussi de sus. Les riverains Belges de la Meuse disent : de la suie de porc. - (13) |
| sou[y]er : soulier - (52) |
| souâ : faucher à la faux. Comme soiture : du bas-latin : secatura, et du latin secare. - (62) |
| souâcer, v. a. presser fortement, appuyer sur... - (08) |
| souâcerot, s. m. cauchemar, sensation morbide d'un poids qui gêne et pèse sur la poitrine pendant le sommeil. - (08) |
| souachè : v. t. Serrer, presser fortement. - (53) |
| souacher, souâcer (v.) : presser fortement, appuyer sur quelque chose - aussi chouâcher (de Chambure écrit : souâcher) souécheresse, souécherotte (n.f.) : sécheresse - (50) |
| souaffâ (on) : soiffard - (57) |
| souâge, chouâche : n. m. Saule. - (53) |
| souai - clôture de champ, de pré, faite ordinairement de bois. - Les vaiches ant aibimai lai souai. - Les galopins ant brisai lai souai pour fâre du feu… Cré nom ! si les tenas ! - (18) |
| souai (lai) : (la) soif - (37) |
| souaî (na) : corde (grosse et longue) - (57) |
| souai (pr.pers. 3 elle pers,compl.) : soi, lui - (50) |
| souai : le soir - (46) |
| souai : n. f. Soif. - (53) |
| souaiche : adj. Sèche. - (53) |
| souaiché, chouaiché : v. t. Sécher. - (53) |
| souaicheresse : n. f. Sécheresse. - (53) |
| souai-disant : soi-disant - (57) |
| souaif (n.f.) : soif (le f final ne se prononce pas) - (50) |
| souaîgner (v.t.) : soigner - (50) |
| souaigneus'ment : soigneusement - (57) |
| souaigneux : soigneux - (57) |
| souaigni : soigner - (57) |
| souaignou (on) : soigneur - (57) |
| souaille. Seigle. On disait autrefois soille... - (13) |
| souaillot, siau : n. m. Seau. - (53) |
| souair, sar (n.m.) : soir (aussi souer) - (50) |
| souairée : n. f. Soirée. - (53) |
| souaisson (on) : soisson - (57) |
| souaixantain-ne (na) : soixantaine - (57) |
| souaixantchème : soixantième - (57) |
| souaixante (adj.num.) : soixante - (50) |
| souaixante : soixante - (57) |
| souârî n.m. Sureau. A Beaubery on dit un souer. - (63) |
| souateure : division du pré. - (21) |
| souaye : seigle. - (29) |
| souâyon : largeur de coupe partielle, pour terminer une raie disons d’une demi-raie. - (62) |
| soubâ, s. m. secousse, cahot d'une voiture. - (08) |
| soubrer (verbe) : labourer profondément. - (47) |
| soubriniller : secouer rudement - (60) |
| soûche : s. f. chenêt. - (21) |
| souçhi : souffler - (35) |
| souchlle, s. m. souffle. Souchllié, souffler. - (22) |
| souchlle, s. m. souffle. Souchllier, souffler. — Souchlliou, soumet. Souchllier les pous, loc. faire avec la bouche, en dormant, un bruit rappelant celui produit par l'ébullition lente des « pous » (bouillie). - (24) |
| souchllœ, s. m. soufflet. - (22) |
| souchon. n. m. - Personne peu bavarde, qui ne bouge pas, telle une souche. - (42) |
| souchon. s. m. Homme taciturne, qui ne parle et ne bouge pas plus qu'une souche. (Sommecaise). - (10) |
| souci, s. m., sourcil. - (14) |
| soucil (souci) : s. m., sourcil. - (20) |
| soudar. Soldat. Soudart est l'ancien mot français… - (01) |
| soudè : v. t. Souder. - (53) |
| soudre*, v. a. soulever. - (22) |
| soué (n. f.) : soif - (64) |
| soue : cabane à cochon. - (09) |
| soué : haie. - (31) |
| souè : la soif - on voué quand i â bu mais on n'voué pas quand i â souè, on voit quand j'ai bu mais on ne voit pas quand j'ai soif - (46) |
| soue : logis du cochon. - (66) |
| soue : porcherie - (48) |
| souè : soi - (48) |
| soué : soif - (61) |
| souè : soif - (48) |
| souë à cochons, souille. - (05) |
| souè, haie. - (16) |
| soue, s. f. case, loge où l'on enferme les porcs : une « soue » à cochons. - (08) |
| soué, s. f. soif, besoin de boire : « i é soué », j'ai soif. - (08) |
| soué, souéfer : soif, avoir soif. - (56) |
| soue. s. f. Trou, fossette pour le jeu de bille. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| souécer (v.t.) : sécher - p.p. souécé = séché - (50) |
| souèche : sèche - (48) |
| souècher : sécher - (48) |
| souécherin, sécheron (n.m.) : partie sèche d'un pré en général sur une butte - (50) |
| souécherotte. s. f. Sécheresse. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| souée. n. f. - Soie. - (42) |
| souéfer, v. n. avoir soif, terme plus particulièrement à l'usage des ivrognes. (voir : désouéfer, soué.) - (08) |
| souégner. v. - Soigner. - (42) |
| soueil : le seigle - (46) |
| souè'illé : cellier - (48) |
| souèille : seigle - (48) |
| soueille : n. m. Seigle. - (53) |
| soueille : seigle - (39) |
| soueille, selle. n. f. - Seille : seau large et bas utilisé pour la traite des vaches, synonyme de tiotte, tirette, tirouée. - (42) |
| soueiller : pièce où l'on fait la vaisselle. V, p. 41-5 - (23) |
| soueillie : pierre encastrée dans le mur derrière la porte où on mettait les seaux d'eau - (39) |
| soüen, adv. de temps. souvent : « i vé soüen dan ç'te mâïon-laite », je vais souvent dans cette maison-là. - (08) |
| souèr : soir - (48) |
| souër, faucher. - (05) |
| souér, s. m., soir : « Bonjor, vouésin ! A c’souér ! » - (14) |
| souèr, soué. n. m. - Soir. - (42) |
| soüer, v. tr., faucher. - (14) |
| souer. Fauchet. - (03) |
| souère : soir - (39) |
| souèrée. n. f. - Soirée. - (42) |
| souesser : tasser. - (52) |
| souêsser : appuyer - (39) |
| souèsser : sécher - (39) |
| souèteure : mesure agraire pour les prés (environ 22 ares 85) - (48) |
| souèteure : (souèteur' - subst. f.) mesure de surface qui, à Liernais équivaut à 22 ares 85 centiares ; à noter qu'autrefois on ne parlait de soiture que pour la surface d'un pré, le terme de journal étant réservé aux champs. - (45) |
| soufeurneaux, soufferneaux. s. m. pl. Bas de la toiture à l'intérieur d'un grenier. (Mailly-la-Ville). - (10) |
| souffert : part, pass. pris pour infinitif, souffrir. J'ai souffri tout ce qu'on peut souffert. - (20) |
| souffieu : soufflet. - (66) |
| souffioû, souffloû : soufflet - (48) |
| souffiû : n. m. Souffleur, ventilateur. - (53) |
| souffle-en-cul : s. m., qui est prétentieux, puant, et gonflé de son importance. « Ce grand souffle-en-cul, il a toujours l'air de croire qu'i faut s’ mett' deux pour lui dire m...! » - (20) |
| soufflot : le chou de Bruxelles qui n'est pas serré - (46) |
| soufflot, s. m. soufflet de feu. - (08) |
| souffloû : anus - (48) |
| soufflou, s. m., soufflet de foyer. - (40) |
| soufflou, s.m. soufflet ; celui qui souffle. - (38) |
| souffreté. s. f. Souffrance. (Puysaie). - (10) |
| souffri : souffrir - (57) |
| souffri : part, pass., souffert. Voir ouvri. - (20) |
| souffri : v. t. Souffrir. - (53) |
| soufiet, s. m. soufflet de cheminée et soufflet sur la joue. - (08) |
| souflòt, s. m., soufflet de feu. - (14) |
| soufrer : brûler une mèche de soufre à l'intérieur d' un fut. La mèche est très peu épaisse, mais assez large et longue. On l'accroche à la bonde qu'on plaçait pour fermer le fut, après l'avoir allumée. - (58) |
| sougaler. v. a. Gronder, réprimander quelqu'un, lui infliger une correction. (Courgis). - (10) |
| sougner, v. suivre. - (38) |
| sougni, v. a. guetter : le chat sougne le rat. - (22) |
| soûgnon : grosse maille de chaîne reliant la charrue à la roualle. - (33) |
| sougrenette (pour saugrenette). s. f. Sobriquet, nom saugrenu. (Villiers-Saint-Benoît). - (10) |
| sougueniller, v. a. secouer, agiter par secousse. - (08) |
| souhé, s. m. souhait. - (08) |
| souhet, haie. - (28) |
| sou'ier. n. m. - Soulier. - (42) |
| sou-iers : souliers - (43) |
| souillarde : (nf) coin du « forni » où on prépare la pâtée des poules et des cochons - (35) |
| souillarde : s. f., réduit où se trouve l'évier. - (20) |
| souillarde, n.f. évier ; petite pièce, isolée de la cuisine, où se trouve l'évier. - (65) |
| souillarde, s. f., évier isolé dans la cuisine. - (40) |
| souillat. s. m. Flaque d'eau bourbeuse. (Environs de Pontigny). - (10) |
| souille. s. f. Mare dans les bois. (Armeau). - (10) |
| sou'illée : soulier - (48) |
| souïller : soulier. - (33) |
| souiller, soulé : n. m. Soulier, chaussure. - (53) |
| souillis. n. m. - Fouillis. (Saint-Martin-sur-Ouanne, selon M. Jossier) - (42) |
| souillis. s. m. Amas de choses inutiles jetées pêle-mêle. (Saint-Martin-sur-Onanne). - (10) |
| souillon, on dit aussi touillon, sale, fangeux... - (02) |
| souillot : seau. V, p. 41-5 - (23) |
| soûl, -le adj. Saoûl. Soûl d'tsoux, soûl d'brou ! Qu'importe la qualité, du moment qu'il y a la quantité. - (63) |
| soul, soule. adj. Seul, seule. (Vassy-sous-Pisy). Du latin solus. - (10) |
| soul. adj. - Seul. - (42) |
| soula : soleil. - (62) |
| soula, soulè, soulo : soleil - (48) |
| soulagi : soulager - (57) |
| soulai : soleil. Ço ben agréable le soulai : c'est bien agréable le soleil. - (33) |
| soulai, s. m. soleil. nous avons les deux formes « soûlai » et « soulau » ; toutes deux sont anciennes. - (08) |
| soulai, soulagement, consolation. - (05) |
| soulai, soulaire. s. m. Vent du sud. - (10) |
| soulai, soulei (n.m.) : soleil (aussi soulé) - (50) |
| soulai. : (Dial. et pat.), soulier. (Du latin solea, sandale.) - (06) |
| soulai-raimant (n.m.) : soleil couchant - (50) |
| soulaire (n.m.) : vent du sud ou sud-est - (50) |
| soulaire : voir solaire - (23) |
| soulaire, s. m. vent du midi ou sud-est. « soulare. » - (08) |
| soulaire, soulai, solaire, ensoulaire. n. m. - Vent du sud ou du sud-est. - (42) |
| soulare : voir solaire - (23) |
| soulare, vent du sud - (36) |
| soulasson. n. m. - Soûlaud, ivrogne : « L'Émile, ça dev'nu un vrai soulasson, ded 'pis qu'l'Andrée alle est partie ! » - (42) |
| soulau, s. m. soleil. « quand oll' ervené ai lé, l' soûlot étot couicé », quand elle revint à elle le soleil était couché. - (08) |
| soulay, soulier. En latin solea, sandale. - (02) |
| soule (toute) : seule (toute) - (48) |
| soulé : partie haute de la grange où on range le foin. - (52) |
| soulè : soleil. - (52) |
| soulé, soleil - (36) |
| soulé, v. n. avoir coutume. Ne s'emploie qu'au passé : je soulais y aller. - (22) |
| soulei (l’) : (le) soleil - (37) |
| soulei : soleil - (39) |
| soulei, et sùlei, s. m., soulier. Chaussure à laquelle les sabots font une forte concurrence. - (14) |
| souléjé, soulager ; s'souléjé en prenant un aide, un remède, une bonne nourriture, etc. - (16) |
| soûler, v. a. rassasier, satisfaire la faim ou la soif jusqu'à la satiété. - (08) |
| souler, v. r. avoir coutume. Ne s'emploie qu'au passé : je soulais y aller chaque année. - (24) |
| soules. Souliers. C'est presque le français du XVe siècle. On écrivait alors soulers et solers... Ce mot vient directement du latin solea, sandale. - (13) |
| soulet, souleil. n. m. - Soleil. - (42) |
| souleuvé : v. t. Soulever. - (53) |
| souley, fenil inférieur. - (05) |
| soulo : le soleil - (46) |
| soulò, s. m., soleil : « Si ô s'couche d'avou l’soulò, ô s'leùve itou d'avou lu ; ôl é du maitin. » - (14) |
| soulo, seûlo, soleil. - (16) |
| souloir, avoir coutume, (solere). - (04) |
| souloir, soulouer (v.) : avoir coutume de... (ex. : coutume ô soulot éte). A l'imparfait seulement - (50) |
| soûlon (on) : ivrogne - (57) |
| soûlon, celui qui s'enivre fréquemment. - (16) |
| soûlot : n. m. Ivrogne. - (53) |
| soûlòt, s. et adj., soulard, ivrogne : « O n'démâre pas du cabaret ; y et eun vrâ soùlòt. » - (14) |
| soûlot, soûlotte n. Soûlon. - (63) |
| soum : le sommeil, un somme - (46) |
| soumarder, v., entretenir en jachères. - (40) |
| soumare : terre en jachère. - (31) |
| soume, s. m., somme, sommeil : « Ol é prou feignan ; ô n'a jamâ fini son soume. » - (14) |
| soumence (n.f.) : semence - (50) |
| soumer - (39) |
| soumer (v.t.) : semer - (50) |
| soumer : semer, perdre quelque chose en cours de route - (37) |
| soumer : semer. On vé élai soumer : on va aller semer. - (33) |
| soumettu, sômettu, part, passé du verbe soumettre. soumis. - (08) |
| soumétu, part., soumis : « J'étôs l'pus fôr ; ô s'é soumétu. » - (14) |
| soumme (n.f.) : somme (soumme, n.m. pour somme = sommeil) - (50) |
| soumme, s.m. somme. - (38) |
| soumme. n. f. - Somme, addition. Autre sens : sommeil. «J'vas fai' un soumme. » - (42) |
| soummeil. n. m. - Sommeil. - (42) |
| soummier. n. m. - Sommier. - (42) |
| soumou : semoir - (39) |
| soumû, soumoû (n.m.) : semoir - (50) |
| soun (adj.pos.m.s.) : son (rare) - (50) |
| soun, adj. possessif ; "son" devant une voyelle : soun houme, soun orle : son homme, son aile. - (38) |
| soun. adj. poss. - Son : «A pourte soun habit tout neu' pou' la messe ! » - (42) |
| soûner v. Sonner. Y soûne la mô ! Les cloches annoncent un décès. - (63) |
| soùner, et sener, v. tr., sonner. - (14) |
| souner, v. a. sonner, agiter une cloche, donner un son en général. - (08) |
| soûnette n.f. Sonnette. - (63) |
| sounner (v.t.) : sonner - (50) |
| sounner : (vb) sonner - (35) |
| sounner : sonner - (43) |
| sounner, v. sonner. - (38) |
| sounner. v. - Sonner. - (42) |
| sounnerie : sonnerie - (43) |
| sounou, s. m. sonneur, celui qui sonne : « ain sounou » de cloches. - (08) |
| soûnoû, s. m., sonneur, qui sonne les cloches. - (14) |
| soupa : soupé. (S. T IV) - B - (25) |
| soupailler : remuer, retourner, faire sortir du lit - (60) |
| soupè : dîner - (48) |
| soupe grillalée : soupe aux choux où le lard est remplacé par quelques lardons grillés, jetés brûlants dans le bouillon. (CH. T II) - S&L - (25) |
| soupe : s. f. Aller aux soupes, se rendre à un repas de noces. Voir veille. - (20) |
| soupe, n.f. peut désigner tous les repas. - (65) |
| souper : dîner - (57) |
| soupiau : cep, partie de la charrue en dessous du fer. Le soupiau usé la charrue versot : le cep usé la charrue versait. - (33) |
| soupie : s. f., vx fr. soupule, petit plancher mobile qui se place à l'extrémité de certaines barques. - (20) |
| soupiée (soupièrée) : - (39) |
| soupière : souche. - (33) |
| soup'ille : souple - (57) |
| soup'illesse (na) : souplesse - (57) |
| soupiot. n. m. - Soc de charrue. (M. Jossier, p.ll4) - (42) |
| soupiot. s. m. Soc de charrue. (Puysaie). - (10) |
| soupirau n.m. Soupirail. - (63) |
| soupirau : s. m., soupirail. - (20) |
| soupirau, s. m., soupirail : « L'bétâ ! ôl a fremé l’soupirau d'sa cave. Ô n'y vouét pu ran. » - (14) |
| soupirô, soupirail. - (16) |
| souqueniller. v. n. Fureter partout, même en dérangeant, en secouant les habits, les souquenilles. (Courgis). – Activement et figurément, veut dire secouer quelqu'un, le houspiller, le réprimander vivement. (Mailly-la-Ville, Mouffy). - (10) |
| sourcer, v. n. sourdre, jaillir du sol, couler à fleur de terre. - (08) |
| sourcer. v. n. Sourdre. (Saligny). - (10) |
| sourci (on) : sourcil - (57) |
| sourci n.m. Sourcil. - (63) |
| sourdat, s. m. soldat. - (22) |
| sourdiâ : n. m. et adj. Sourd, malentendant. - (53) |
| sourdiau, et, plus patois, seudiai. Sourd. - (03) |
| sourdiau, s. et adj., sourd, inattentif. - (14) |
| sourdiau, s. m. sourd. - (22) |
| sourdiau, s. m., sourd. - (40) |
| sourdiaud, sourdiaude : s. m. et f., sourdaud, sourdaude. - (20) |
| sourdille. s. f. Petite source. (Percey). - (10) |
| sourdis. s. m., sourdie.s. f. Endroit ou l'eau sourd. (Laduz). - (10) |
| sourdre. v. a. Soulever quelque chose de lourd. C'est si lourd, que je n'ai pas pu le sourdre.(Courgis). - (10) |
| sourie. v. - Sourire. - (42) |
| sourine (n.f.) : neige très fine et sèche qui est chassée par le vent du nord - (50) |
| sourine (nom féminin) : neige poussée par le vent qui peut se former en congère. - (47) |
| sourine, s. f. neige très fine et sèche qui est chassée par le vent du nord. - (08) |
| sourivée, s. f. terre située sous le bord inférieur d'un talus, d'une éminence : la « sourivée » d'un champ, d'un sillon. - (08) |
| sousc'ille (on) : souffle - (57) |
| sousc'iller : souffler - (57) |
| sousc'illerie (na) : soufflerie - (57) |
| sousc'illou (on) : soufflet - (57) |
| sousc'illou (on) : souffleur - (57) |
| sousciou (on) : ventilateur (soufflet) - (57) |
| sous-conscrit : s. m., conscrit de la classe suivant immédiatement celle qui vient d'être appelée. Dans le Chalonnais on dit « pousse-conscrit ». - (20) |
| sous-tasse : s. f., soucoupe. - (20) |
| souster : v. a., terme de Jeu de cartes, être appuyé, soutenu. J'ai le roi sousté à trèfle. Voir dessouster. - (20) |
| souster. Soutenir en général, mais surtout au jeu. Souste, soutenu. - (12) |
| souster. Soutenir, se dit surtout au jeu, d'une carte accompagnée d'une autre de même couleur ; du latin sustentare. - (03) |
| sous-venteryee : sous-ventrière. Partie du harnais de travail du cheval passant sous son ventre. Le harnais est en cuir épais, cousu, très robuste. C’est l’œuvre du bourrelier. L’expression peut être détournée dans un sens humoristique et malicieux. Ex : "Le Pintra, avec sa panse…sa ceinture al’ lui sért de sous-venteryée". - (58) |
| sous-ventriée. n. f. - Ceinture, sous-ventrière. Toujours utilisé dans ce sens, dans le langage populaire. Ce mot du XIVe siècle, désigna en premier lieu, la sangle passant sous le ventre d'un cheval ; l'emploi imagé du mot a donné le sens de ceinture pour l'homme. - (42) |
| sous-ventriére (na) : sous-ventrière - (57) |
| sout, adj. insupportable. - (22) |
| soûte (à la) : s. f. à l'abri. - (21) |
| soûte (à la). V. assote. - (05) |
| soute (Ai lai) : à labri de la pluie. (CLF. T II) - D - (25) |
| soute (oū) (ai lai), loc. a l'abri de la pluie.! Voir acoïô. - (17) |
| soute, abri. (Voir au mot acoyô.) - (02) |
| soutèn, soutien. - (16) |
| soûtin : soutien - (48) |
| soutîn : soutien - (39) |
| soutin, s. m. soutien, appui, protecteur. - (08) |
| sout'ni : soutenir - (57) |
| soût'ni : soutenir - (48) |
| soutrai, sôtrai, s. m. paille ou foin de rebut et quelquefois fagots, branchages qu'on étend dans la grange où l'on dépose les récoltes de l'année. Le « soutr'ai » est à proprement parler la couche sur laquelle on construit la meule ou « teiche » de gerbes. On se défend ainsi de l'humidité qui pourrait endommager le gerbier. - (08) |
| souttise, 1. s. f. déprédation : ce garnement vient de faire une souttise. — 2. s. f. pl. remontrances sévères, insultes : il m'a dit des souttises. - (22) |
| souveni ; s'souvni, se souvenir de quelqu'un, d'un événement, d'un bienfait reçu, etc. On dit aussi s'seuvni. - (16) |
| souyai, s. m. sureau. - (22) |
| souyasserie : buanderie, état de l'ivrogne qui cuve son vin. - (30) |
| souyé : (nm) soulier - (35) |
| soûyér : soulier - (39) |
| souyi, v. a. crotter, souiller : ce mauvais chemin m'a souyi. - (22) |
| souyier n.m. Soulier. - (63) |
| sôvan. Souvent. - (01) |
| sôve, sauvé ; el â sôve, il est sauvé, il est guéri. - (16) |
| sôvéje, sauvage, celui qui maltraite sa femme, ses enfants et n'est pas sociable ; se dit aussi des arbres, des plantes à l'état de nature. - (16) |
| sôvenance (n.f.) : souvenir - (50) |
| sôvenance, et sôvenî, s. f., souvenir. - (14) |
| sôvenance, s. f. souvenir : « i n'en é poin d' sov'nance », je ne m'en souviens pas. - (08) |
| sôvené. Souvenez. - (01) |
| sôveni. Souvins, souvint, souvenir. - (01) |
| sovenir, soveni'. v. - Souvenir : « l' va ben s'en soveni' ! » Souvenance et sovenir étaient employés au XIIe siècle ; « souvenir » apparut à la Renaissance ; le dialecte poyaudin a conservé sovenir, dérivé direct du verbe latin subvenire. - (42) |
| sovent : (adv) souvent - (35) |
| sovent adv. Souvent. - (63) |
| sôvent, adv., souvent : « Qu'j'irons ? Pu sôvent ! » - (14) |
| sòverain. Souverain, souverains. - (01) |
| sovni (se) : (se) souvenir - (35) |
| sovni (se) : (vb) se souvenir - (35) |
| soy : s. m. sable. - (21) |
| sòyai, m. sureau. - (24) |
| soyau : seau. - (32) |
| so-yé : (nm) sureau - (35) |
| soye : seigle. Rabelais disait « seille ». - (62) |
| so-yé : sureau - (43) |
| soyé et soïé. : Faucher. Soir, fauchaison, et soieur, faucheur. Du latin secare, couper les seigles. (Franch. de Labergement, 1285.) - (06) |
| so-ye, seigle. - (26) |
| soyer : s. m., vx fr. seu, sureau noir (sambucus nigra). - (20) |
| söyi : (p.passé) sale, souillé - (35) |
| so-yi : sale - (43) |
| so-yi : souiller - (43) |
| sòyi, v. a. crotter, souiller : ce mauvais chemin m'a sòyi. - (24) |
| soyin : seau. (PLS. T II) - D - (25) |
| soy-in, seau. - (26) |
| s'pas : adv. N'est-ce pas. - (53) |
| spectac' : n. m. Spectacle. - (53) |
| spéctâkye, spectacle ; béyé ein biâ spéctâkye, donner un beau spectacle se dit ironiquement pour : donner un mauvais exemple par un acte blâmable. - (16) |
| s'pignè : se peigner - (46) |
| spou : n. f. Binette. - (53) |
| s'pouillè : se rouler dans la poussière, en parlant des poules - (46) |
| sran, sri. n. m. - Sorte de peigne en fer à longues dents, utilisé pour peigner le chanvre. - (42) |
| srande : andouille - (39) |
| srée : bout de fer pour peigner le chanvre - (39) |
| sreillou : qui peigne le chanvre - (39) |
| s'rempitallè : se renflouer (aux billes) - (46) |
| s'rempuchotè : se renflouer, on dit également se rempichotè, en jouant au "pot" - le p'tiot Jeannot é perdu bin des billes ; è vè essayé de s'rempichotè, en jouant au "pot" (jeu de billes), le petit Jeannot a perdu beaucoup de billes ; il va essayer de se renflouer - (46) |
| s'reument, adv. seulement. - (08) |
| s'ri : petite souris (musaraigne) - (48) |
| s'ri : musaraigne. - (33) |
| s'ri : n. f. Musaraigne. - (53) |
| s'ri, musareigne. - (26) |
| srî'illé : cerisier - (48) |
| sriner : seriner - (51) |
| srizi : (nm) cerisier - (35) |
| srizin : cerisier. (PLS. T II) - D - (25) |
| s'rizin, cerisier. - (26) |
| stalle : chacun des sièges de bois disposés dans le chœur d'une église. - (55) |
| s'tantô : cet après-midi - (46) |
| s'taugnè se batter - è s'bètin, è s'taugnin, è s'tirvouignin, combin qu'è zètin ? ran qu'un, ils se battaient, ils se tiraillaient, combien étaient-ils ? rien qu'un - (46) |
| sté : vannage rudimentaire consistant à jeter les céréales de la porte de la grange, la balle tombant en premier et le grain allant au fond. A - B - (41) |
| s'té : assis - (57) |
| sté : méthode de triage des céréales, consistant à les jeter au fond de la grange - (34) |
| ste, démonstratif, cette. - (38) |
| s'téequît' : ceux-ci, celles-ci - (48) |
| stè'lè, stèqui : celle-là, celle-ci - (46) |
| s'tèquît' : celle-ci - (48) |
| ster (se), esster (s'), v. s'asseoir. - (38) |
| s'ter : asseoir - (57) |
| steune, démonstratif, celle. - (38) |
| stignè : se gratter fortement - (46) |
| sti-i-ye*, s. f. grande sécheresse. - (22) |
| stit(e) : mauvais(e), méchant(e) - (39) |
| s'tôt, adv., sitôt, aussitôt. - (14) |
| s'toût - ass'toût – deustoût : sitôt - (57) |
| stroublot. n. m. -Tourbillon. (Saint-Aubin-Château-Neuf, selon M. Jossier) - (42) |
| stroublot. s. m. Tourbillon de vent. (Saint-Aubin-Chateau-Neuf). - (10) |
| struble. s. m. Champ moissonné. - (10) |
| stsi (se mette) v. Se pendre. - (63) |
| stsi (seutsi) : sécher - (51) |
| stsi Voir satsi. - (63) |
| s'tu ki, celui-ci ; s'të ki, celle-ci. - (16) |
| stu là : Celui-là. - (19) |
| stu, démonstratif, celui. - (38) |
| stu. Celui, ou, comme le disait encore Balsac, cetui. On dit en français dans le discours familier, st homme, ste femme… - (01) |
| stulè, stuqui : celui-là, celui-ci - (46) |
| stune : Celui-ci. - (19) |
| stune, démonstratif, celui. - (38) |
| s'tuquît : celui-ci - (48) |
| sû ! interj., sus ! debout ! allons ! « Allons, sû ! » - (14) |
| su (le) : Aire au dehors de la grange sur laquelle on battait le blé. - (19) |
| su (prép.) : sur - (64) |
| su : (adj) seul - (35) |
| su : (nf) sœur biologique (par opposition à la religieuse) - (35) |
| su : (prep) sur - (35) |
| su : sur - (51) |
| su : sur (préposition) - (57) |
| su : sur - (48) |
| su : Sur. « Y a bien des calas su le noué ». - (19) |
| su : sur. Mets la bouteille su la table : Mets la bouteille sur la table. - (33) |
| su de grandze, tsu de grandze : aire de la grange quand on utilisait le fléau - (43) |
| su mon meinne : sur mes propriétés - (51) |
| sû n.f. Soeur. - (63) |
| su ou sus. En latin superstemus, allons donc, marchons donc, ou plutôt sursum, dont le mot su est une abréviation. - (02) |
| su prép. 1. Sur. 2. Dans la, de la : un dzo su smaiñne. - (63) |
| su son seinne : sur ses propriétés - (51) |
| su : prép. Sur. - (53) |
| su, int. sus, debout ; levons-nous, sortons de table. - (17) |
| sû, interjection. sus, debout. - (08) |
| su, prép. sur. on prononce « su » ou « chu », suivant les lieux. - (08) |
| sù, prép., sur. Cette prononciation contractive n'empêche pas le r dans certains mots : surlouer, etc - (14) |
| su, préposition, sur. - (38) |
| su, sue adj. et n. Seul, seule. T'étos-ti tot su ? - (63) |
| su, sur et vers ; su pié, sur pied ; su lë mëneu, vers minuit. - (16) |
| su. prép. - Sur : « A soun âge ! Il est encore grimpé su ' l' grous c'risier ! » - (42) |
| su. Sur, préposition, ou sus, particule propre à exciter. - (01) |
| su. : Apocope de sursum, debout. - (06) |
| su’yé, siffler ; su'yo, sifflet. - (16) |
| su’yot : sifflet. - (62) |
| sua (na) : suée - (57) |
| suatisme. : (Dial.), douceur. (Du reg. latin suavitudinem). - (06) |
| subi : subir - (57) |
| subiat : s. m.: sifflet. - (21) |
| subier : siffler - (57) |
| subier, suier (v.) : siffler (de Chambure écrit suïer) - (50) |
| subieu, s. m. sifflet. Verbe subier. - (24) |
| subiô : sifflet. A - B - (41) |
| subiö, suyö (ū), sm. sifflet. - (17) |
| subiot (on) : sifflet - (57) |
| subiot, suïot (n.m.) : sifflet - (50) |
| subioter : siffloter - (57) |
| subiou (on) : siffleur - (57) |
| subjime, adj. sublime. - (17) |
| sublai. : (Pron. subliai), siffler. (Du latin sibilare.) Dans le Jura on dit subier, et, dans le Châtillonnais, süiller, et süilleau, un sifflet. - On qualifiait le flageolet de sublô de chauderonei. - (06) |
| sublat, sublet, sublot. s. m. Sifflet. - (10) |
| sublè : siffler - (46) |
| suble. Siffles, siffle, sifflent. Sublai en bourguignon, c’est siffler… - (01) |
| subler : v. n., siffler. - (20) |
| subler, et sibler, v. intr., siffler. - (14) |
| subler. Siffler, prononcez subier ; vieux mot. - (03) |
| subler. v. a. et n. Siffler. Du latin sibilare. – Il y avait, dans le temps, à Joigny, un fossoyeur qui sublait les malades en danger de mort, pour les attirer plus vite au cimetière. - (10) |
| sublet, sublot : s. m., sifflet. - (20) |
| sublette (nom féminin) : (Tomber en). être victime d'une grande fatigue. - (47) |
| subliai, siffler. On dit, dans le Châtillonnais, suiller et suillô, pour sifflet... - (02) |
| sublier : Siffler. « O sub'lle c'ment in miarle ». Latin sibelare. Vieux dicton : « A Charcub 'ille le loup sub 'ille », Charcuble, hameau de Bissy la Mâconnaise, près du Mont-Saint-Romain. (Pays sauvage autrefois). - (19) |
| subliot : Sifflet. « Le chaichou choupe san chin dave in subliot » : le chasseur appelle son chien avec un sifflet. « Cen li a copé le subliot » : çà lui a coupé le sifflet. - (19) |
| subllier, sublliot, siffler, sifflet. - (05) |
| sublo : un sifflet - (46) |
| sublô. Sifflet, petite flûte d’enfant… - (01) |
| sublòt, et siblet, s. m., sifflet. - (14) |
| sublôt, subilet (C.-d., Chal.), chulot (Char.), suyôt (Y.), seuillòt (C.-d., Chal.), suillet (Morv.), suillot, sulòt (Chal.), sullio ou sublò (C.-d., Br.). - Sifflet, généralement fait avec une branche de saule, sur laquelle les enfants tapent pour détacher l'écorce ; par extension gorge, gosier. Le verbe subler, suyer, ou suiller existe également. Du même verbe vieux français subler, dérivé du bas latin siblare, par abréviation de sibilare (siffler), qui conserve la forme latine mieux que ne l'a fait le mot français siffler. - (15) |
| subloû, s. m., siffleur. - (14) |
| subou, s. m., vin fait avec les premiers raisins et du sucre, pour attendre la vendange. - (40) |
| subye : (nm) sifflet - (35) |
| subyé : v. siffler. - (21) |
| subyer, siffler. - (26) |
| subyi : siffler ; souffler (vent) - (35) |
| subyi v. Siffler. - (63) |
| subyot n.m. Sifflet. A noter l'expression : Dz'sus pas du bôs qu'nos fait les subyots. Je ne suis pas spécialement arrangeant. - (63) |
| suçard : s. m., suceur, soiffard. - (20) |
| suche, souche ; lai suche de Noué (prononcer Nouë en une seule syllabe), la suche de Noël si aimée des enfants. - (16) |
| suche, souche. C'était une grosse bûche ou fonds de feu qu'on plaçait au foyer la veille de Noël... - (02) |
| suche. Souche. C'est une très grosse bûche qu’on met au feu la veille de Noël, et qu'on appelle en Bourgogne, par cette raison, lai suche de Noei… - (01) |
| suchenôtai, on dit mieux chuchenôtai, parler bas, chuchoter... - (02) |
| suchenòter, v. intr., chuchoter : « Que c'quô s'disont ? sont tôjor à suchenòter entre eûsses. » - (14) |
| suçon : s. m., surjet grossier. - (20) |
| suçonner : v. n., faire un suçon. - (20) |
| sue : sœur - (43) |
| sûe : Sœur. « I sant trois frères qu'ant chéquin eune sûe » : ils sont trois frères qui ont chacun une sœur, autrement dit ils sont quatre enfants, trois garçons et une fille. - (19) |
| sué. Suer. - (01) |
| sueue, seue : n. f. Suie de cheminée. - (53) |
| sueys. : (Dial.),.doux (du latin suavis). - (06) |
| sufloké, suffoquer, presque étouffer, ne pouvoir parler, parce qu'on est sous une vive impression. - (16) |
| suge, suie. - (05) |
| sugéssions, s. f. pl. risques : que de sugéssions avant les vendanges ! - (24) |
| sugéssions, s. f. pl. risques : que de sugéssions avant les vendanges ! - (22) |
| sugner, v., peiner, ne pas suivre à la marche. - (40) |
| sûgnier, v. tr., fournir de, subvenir, alimenter : « Crais-tu que j'porai l’sûgnier d'saibòts, si t'les casses coume ça ? » — « Voui dà ! faudròt còre que j'te sûgne de toubac ! » - (14) |
| sui (n.m.) : suif (le f final ne se prononce pas) - (50) |
| sui : s. m. seuil, dans l'expression : au seuil de la grange. - (21) |
| sui, s. m. suif. environs de Château-Chinon : « chi. » - (08) |
| suî, s. m., suif : « L'malin ! ô f'ròt des chandéles sans suî. » - (14) |
| suïer, v. a. siffler. - (08) |
| sû'iller : siffler - (48) |
| suiller. Siffler. Autrefois sublier, du latin sibilare. Ce verbe a formé le mot suillot qui signifie le canal de la respiration chez l'homme et chez les animaux. Mai sœur ai fait choicher le suillot d'eune dinde pour fâre un peloton ai envuder du fil. On appelle aussi suillot une sorte de hautbois ou flageolet. - (13) |
| sû'illot : sifflet - (48) |
| sûillot – sifflet. - Soffle don dan ton sûillo. - Beille moi voué ceute grosse peille qui te faisâ in joli petiot suillot. - Al â jaune quemant in suillo. - (18) |
| suiner. v. n. Suinter. (Percey). - (10) |
| Suisse : s. f., Suissesse. - (20) |
| suite (A la) : loc., presque, à peu près. Voir après et côté (A). - (20) |
| suite ou suitre - suivre, suffire à, fournir. - Ah ma ! c'â qui ne sai pâ si pourrai liô suite, â train qu'a y ailant. - Lote gairson dan les écoles lô côte bein ; to le monde é pô qu'à ne pouvaint suitre. - Ne mairche don pâ si vite, te voi bein que c't'enfant ne peut pâ te suite. - (18) |
| suiton. s. m. Celui qui accouple son cheval avec le cheval d'un autre, pour labourer. (Saint-Martin-sur-Ouanne). – Voyez seuteux et seuter. - (10) |
| suître, v. a. suivre. une partie de la région prononce « chuitre. » - (08) |
| suive v. Suivre. - (63) |
| suivu p.p. de suive. Suivi. - (63) |
| suivu : part, pass., suivi. - (20) |
| suivu, partie, passé du verbe suivre. suivi. - (08) |
| sujé ; bon sujé, homme bon ; mavâ sujé, homme mauvais ; ëte sujé ai sai gueule (familier), être porté à boire, à manger au delà du nécessaire. Sujé se dit aussi pour : porte-greffe. - (16) |
| sûl, et seû, adj., seul : « L'pauv'vieux ! ôl é tôjor tout seû ! » - (14) |
| su-l'champ - (voir maintenant) : sur-le-champ (tout de suite) - (57) |
| sulé : soulier. (MLB. T II) - S&L - (25) |
| sulé : Soulier. « Eune pare de sulés ». Recommandation plaisante au cordonnier « Fâ me eune bonne pare de sulés que ne prenint pas l'iau et que portint bien le vin ». - (19) |
| sulé s. m. soulier. - (21) |
| sulé, s. m. soulier. - (24) |
| suler (on) : soulier - (57) |
| sûler, v. a. boire en aspirant, humer. « chûler. » - (08) |
| sulés, souliers. - (05) |
| sûlier, v. ; siffler. - (07) |
| sûlliai - siffler. - A sûille to le long du chemin en menant ses bêtes es champs. - A suillo pou se teni compaignie. - Quemant qu'a sûille, c'â préque de lai musique. - (18) |
| sulo - soleil. - Le sulo â don breûlant ajedeu, que to cueut. - Le sulo ne se montre que pair manmant ; c'â in temps agréabe. - (18) |
| sulo : soleil. - (32) |
| sùlon, et s'lon, prép., selon, suivant : « Si j'irai ? Y é s’lon. » - (14) |
| sûlot : (sû:lo - subst. m.) sifflet ; le sûlo était facile à fabriquer : il fallait un bon couteau et une branche de frêne bien droite de 15 cm. de long et de 15 à 18 mm. de diamètre. Si on fait cette opération au printemps, à la montée de la sève, on a toutes les chances de réussir. - (45) |
| sûlot : 1 n. m. Sifflet. - 2 n. m. Soleil. - (53) |
| sûlot, s. m. gorge, gosier, canal de la respiration. Couper « l’ sûlô » = couper le sifflet en français ou couper la gorge. - (08) |
| sulot, s.m. soleil. - (38) |
| sûlot. s. m., soleil très chaud. - (40) |
| sulot. Soleil. An ne faut j aimas se découvri lai teîte au grand sulot. Les Bretons disent sul et les méridionaux souleu. - (13) |
| suloté : exposé au soleil. - (32) |
| sûmerger, v. tr., submerger, couvrir d'eau. - (14) |
| sunge, s. m. songe, rêve : « i é fé eun béai sunge », j'ai fait un beau rêve. - (08) |
| sunger : songer, penser - (48) |
| sunger, v. a. songer, penser : « i sunge ç'lai », je pense cela. - (08) |
| sunjé, songer ; ai koi k'te sunje don ? se dit à quelqu'un que l'on veut détourner d'une action mauvaise. - (16) |
| suparbe (adj.m. et-f.) : superbe - (50) |
| suparbe, adj. superbe. - (38) |
| suparbe. Superbe, adjectif et substantif. - (01) |
| suparstition. n. f. - Superstition. - (42) |
| suposition (eùne), loc. complétive, supposé que : « Vous v'nez, eùne suposition, eh ben! drès qu'vous êtes là, j'vous raconte l'afâre. » Parfois même, quand la phrase est rapide, on dit simplement : « suposition. » - (14) |
| suppourter. v. - Supporter. - (42) |
| suprènme, suprême ; Ëte suprènme, Dieu ; un vigneron dit plutôt l’ëte suprènme que Dieu. - (16) |
| supter. v. a. Supporter. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| suque (n.m.) : sucre (de Chambure écrit : seucre, seuque) - (50) |
| suque : sucre - (48) |
| suque : sucre - (39) |
| sur son trente-six (être), loc. avoir ses plus beaux habits. - (24) |
| sûr, adj. acide, aigre au palais. - (17) |
| sûr, sûrement ; pou sûr, bèn sur ; bèn sur ke voui, bèn sûr ke si. - (16) |
| surâ, suraint - divers temps du verbe savoir, dans le sens de pouvoir. - Te ne surâ pâ menai les chevaux, mon enfant, reste iqui. - Est-ce que vos ne surains me dire si al ant passai por qui vé les naive heures ? - Voyez Sairâ. - (18) |
| surbòchlle, s. m. nœud de corde à l'aide duquel on serre les narines d'un animal pour le maîtriser. - (24) |
| surchargi : surcharger - (57) |
| surfloquer : Suffoquer, rendre muet de surprise. « Y m'a si bin surfloqué que je n'ai pas savu qu'en dire ». - (19) |
| surflouqué*, v. a. suffoquer. - (22) |
| surfoquer, v. a. suffoquer. - (24) |
| suri (v.t.) : aigrir, devenir aigre - (50) |
| sûri : de goût désagréable, aigrelet (comme la sueur) - (37) |
| sûrî, v. intr., surir, devenir aigre. - (14) |
| suri, v. n. aigrir, tourner à l'aigre, devenir acide, sur. - (08) |
| surlée (la), désigne la levée de terre sur laquelle une haie a été plantée et qui produit une sorte de petit escarpement. - (11) |
| surlouer, v. tr., sous-louer : « O surloue eùne de ses deux chambres ; ôl a prou d'la grande. » - (14) |
| surmarcher (Se) : v. r., se commande : (en parlant des pièces d'un appartement). - (20) |
| surnagi : surnager - (57) |
| surplis : vêtement de toile fine que le prêtre porte par-dessus la soutane. - (55) |
| surporter : v. a., supporter. - (20) |
| surprinse, sf. surprise. - (17) |
| survoûler : survoler - (57) |
| sus, et sis, 1re pers. prés, indic. du verbe être : « Je sus, je sis. » - (14) |
| suscomber, v. n. succomber. - (08) |
| suspensoire : s. f., suspension (portelampe). - (20) |
| suspente, s. f., soupente : « All' couche pas loin d'eûsses, dans le counòt d'la suspente. » - (14) |
| susso, petite fleur, de la famille des labiées, dont les enfants se plaisent à sucer le miel. - (16) |
| sustance, s. f. substance, ce qui subsiste, ce qui reste : il a tout mangé, il n'en reste pas « sustance », il n'en reste aucune trace, aucun débris. - (08) |
| sustance, s. f., substance. - (14) |
| sûtai, suti - rusé, adroit. - A n'â diére sutai, le pôre gairson in pecho quemant son père. - C'â in suti c'tu lâvan, vais. - (18) |
| sute : Suite. « La pliu trois jos de sute ». «J'y va tot de sute » - (19) |
| sùti, adj., subtil, fin, rusé. - (14) |
| suti, fin d'esprit, subtil, se dit surtout ironiquement. - (16) |
| sutie. Subtile, féminin de l’adjectif masculin suti, subtil. - (01) |
| sutöt, adv. surtout. - (17) |
| suvan lu, suivant lui, selon lui, d'après lui. - (16) |
| suvant : Parasite, pique assiette. « Y est in suvant » : il suit les gens pour vivre à leurs dépens. - (19) |
| suve, suvot, suvaint - divers temps du verbe suivre. - En faut que te suve les bêtes jeusque dan le prai. - En faut qui saivâ ! i le suvrai le jor et lai neu ! – Lai petiote Rénette suvot sai mère en bolant. - (18) |
| suvre : suivre. - (29) |
| suvre : Suivre. « Tâche de suvre tan chemin drat » : tâche de suivre le droit chemin, de bien te conduire. « Je li ai donné la marche à suvre mâ ol l'a pas suvue ». - (19) |
| suvre, suivre ; su me, suis-moi : seuvu, suivi - (16) |
| suyé (ū), vn. siffler. - (17) |
| sùye, 1. s. f. sœur. — 2. s. m. aire à battre le blé. - (22) |
| suyer, sureau, suy. - (04) |
| sù-yer, v. siffler ; on dit aussi sûler. - (38) |
| sû-yer, v., siffler. - (40) |
| suyer. v. a. et n. Siffler. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| suy-in, sifflet. - (26) |
| suy-in, sureau. - (26) |
| suyo : sifflet. - (29) |
| suyot : sifflet. - (66) |
| sûyot : sifflet. - (32) |
| sû-yot, s. m., sifflet. - (40) |
| suyot. s. m. Sifflet. - (10) |
| suziau. n. m. - Sureau. - (42) |
| Suzon. C'est le nom d'un ruisseau qui prend sa source à une quinzaine de kilomètres de Dijon, dans la vallée nommée Val-de-Suzon. - (12) |
| svanailli : v. arracher le chanvre. - (21) |
| s'vire : brouette - (43) |
| syénite : sorte de roche granitique, ainsi dite de Syène, en Égypte. - (55) |
| symétries. n. f. pl. - Simagrées : « Il ne faut pas tant de symétries : tu prends une chenille dans ta main, tu vas la porter ... » (Colette, Claudine à Paris, p.259) - (42) |
| symoise, rasade, lampée, verre de vin... - (02) |
| symoise. : Rasade, lampée, verre de vin. – En Champagne, simer signifie suinter (Grosl.) ; dans le Berri, l'eau sime signifie l'eau s'infiltre (voc. du Berri), de sorte que prendre une symoise de vin c'est s'infiltrer un verre de vin dans l'estomac. - (06) |
| syon : s. m. sillon. - (21) |
| t - est employé souvent par euphonie. - (18) |
| t' - te : tu - (57) |
| t’ : pron. pers. Tu « T’ » est utilisé pour faire la jonction avec une voyelle. - (53) |
| t’chiaffè, tiaffè : v. t. Manger en faisant du bruit. - (53) |
| t’enne (l’) : (le) tien - (37) |
| t’iat’ia, s. m. porc (langage plaisant). - (22) |
| t’iau, s. m. tige de pomme-de-terre. - (22) |
| t’iaulée, s. f. grosse troupe : une t’iaulée de poussins. - (22) |
| t’ièchi, v. a. cacher. - (22) |
| t’ieinteure, s. f. teinture ; peinture. Verbe : t’ieindre. - (22) |
| t’iéquandrœ (à), loc. quelque part, à quelque endroit. - (22) |
| t’ieubllié, v. a. cribler. - (22) |
| t’ieuchi, v. a. coucher. - (22) |
| t’ieuchon, s. m. tas de fourrage, tas d'objets. Verbe : at’ieuchouné, mettre à tas. - (22) |
| t’ieudre, s. f. courge. T’ieudri, pied de courge. - (22) |
| t’ieugni, v. a. cogner, tasser. - (22) |
| t’ieula, s. m. poussin le plus malingre de la couvée. Dernier-né en général : le t’ieula de la famille. - (22) |
| t’ieur, adj. court. Féminin : t’ieurte. - (22) |
| t’ieure, s. f. 1. Curette. — 2. Presbytère, cure. - (22) |
| t’ieurneille, s, f. corbeau, corneille. - (22) |
| t’ieutre, s. f. matelas de plumes. Diminutifs : t’ieutrœt’e et t’ieutrœton. - (22) |
| t’iut’iau, s. m. couteau. - (22) |
| t’iùye, s. m. queue. - (22) |
| t’ni : (vb) avoir, posséder « o tint des vatses » - (35) |
| t’ni : avoir, posséder - (43) |
| t’ni sai lanyue : ne pas divulguer un secret - (37) |
| t’ni, tenir; t’ni co, tenir coup, ne pas abandonner un travail avant qu'il ne soit achevé. - (16) |
| t’ni. v. - Tenir. - (42) |
| ta - tan : taon. Nombreux à tourmenter chevaux et bétail. - (58) |
| tâ : (adv.) tard - (35) |
| ta : (pr. pers.) toi - (35) |
| ta : ta d'eau = triton ; ta de terre = salamandre. IV, p. 32 - (23) |
| tâ : Tard. « Te farais mieux de ne pas te couchi si tâ a peu de te lever pus métin ». En parlant d'un enfant venu au monde bien après ses aînés : « Y est in qu’est veni su le tâ ». - (19) |
| ta : toi - (43) |
| ta : toi - (51) |
| ta : Toi. « Y est ta qu’as gagni » : c'est toi qui a gagné. - (19) |
| tâ : une salamandre - (46) |
| ta : salamandre terrestre, se trouve aussi dans les fontaines. - (33) |
| ta bardot, s. m., salamandre de fontaine. - (40) |
| ta : s. m. toit. - (21) |
| ta : taon - (39) |
| ta, n.m. salamandre, triton. - (65) |
| ta, pronom personnel ; dote-ta, leve-ta, sete-ta : ôte-toi, lève-toi, assieds-toi ! (employé uniquement avec l'impératif). - (38) |
| tâ, s. m., triton de fontaine. - (40) |
| ta, s.m. salamandre ; ta bardot : salamandre bariolée. - (38) |
| tâ, ta, ta ! - exclamation d'indifférence, de dédain. - Et pu a vouraint qui liô-z-aicorde cequi ?... Tâ, ta, ta !! Al aitendrant longtemps. - A demande, en parait, qui lli augmente ses gaiges !... Tâ, ta, ta !! - (18) |
| tâ, târd adv. Tard. - (63) |
| ta, tat (pour tac, qui se prononce ta). s. m. Sorte de Lézard, salamandre terrestre.(Coulours). - (10) |
| ta. n. m. - Salamandre. - (42) |
| ta. Salamandre tenestre. - (03) |
| tab' : n. f. Table. - (53) |
| tab'. n. f. -Table. - (42) |
| taba, poudre noire du blé charbonné. - (16) |
| tabac d’ St Jean : armoise. Que certains anciens ont fumé du temps des restrictions de tabac. - (62) |
| tabac saint-jean, n.m. armoise. - (65) |
| tabac saint-jean, subst. masculin : feuilles d'armoise séchées. - (54) |
| tabagnô, réduit obscur qui sert de débarras. - (27) |
| tabagnon : s. m., cabanon, réduit, cabinet de débarras et, par assimilation, maison mal tenue ; bannelon (bachut) ; plancher installé à l'arrière d'un bateau de joute pour porter le jouteur. - (20) |
| tabaillâ : bavard. A - B - (41) |
| tabailla : bavard - (34) |
| tabaille. Bavarde. - (49) |
| tabailler. Bavarder. - (49) |
| tabailli : bavardage. A - B - (41) |
| tabailli : bavardage - (34) |
| tabannion : réduit, très petit appartement - (43) |
| tabari, s. m. bruit, vacarme. - (08) |
| tabari, tapage. - (04) |
| tabasin, adj., fou, cinglé. - (40) |
| tabassi - tôner : tabasser - (57) |
| tabateux, tabateuse : s. m. et f., personne qui use et surtout abuse du tabac. - (20) |
| tabatiëre, grain de blé charbonné. - (16) |
| tabatout. On appelle ainsi celui qui prise. - (49) |
| tabayat : femme souillon et brouillonne, gamin remuant - (60) |
| tabäyi : (vb) bavarder, jacasser - (35) |
| tabazin : (adj) abasourdi - (35) |
| tabazin : abasourdi - (43) |
| tabe - table. - Mets ce bruchon su lai tabe ; c'â des pouâs ai égueurnai. - Torche don in pecho lai tâbe ; c'â ce qu'en fauro fâre aipré chèque repas. - (18) |
| tâbe : table - (48) |
| tabe : table - (39) |
| tàbe, s. f., table. Se dit aujourd'hui plus volontiers que taule, néanmoins maintenu. (V. Taule, où sont réunis les congénères des deux mots.) - (14) |
| tabier : tablier - (51) |
| tâbier : tablier - (48) |
| tâbier, s. m., tablier. - (14) |
| tab'ille : Table. Voir trob'ille. - (19) |
| tabillon, s. m. gros morceau détaché de quelque chose : un « tabillon » de pain, de fromage etc… - (08) |
| tabje, sf. table. - (17) |
| table : s. f. Faire une table, ancienne coutume des villages du Maçonnais. - (20) |
| tabler. Tablier. On dit encore « in devanter » ou « in-ne devantère ». - (49) |
| tablette. s. f. Alphabet (Germigny). – On dit aussi tabiette. - (10) |
| tabolée, taboulée. Grand nombre. « Avoir in-ne tabolée de p'tiots ». - (49) |
| taboler : souffrir, tarauder - (51) |
| taboler v. (de tabor, tambour, vacarme au XIè s.). Taper, frapper sur quelque chose en faisant du bruit, tambouriner. - (63) |
| taboler : (tabôlè - v. intr.) au sens propre, selon Chambure, faire du bruit en frappant, battre le tambour, comme le garde-champêtre autrefois ; à Liernais, on ne connaît que le sens figuré qui évoque une douleur lancinante : coup de marteau sur les doigts, rage de dents etc. - (45) |
| taboler, tabouler (v.) : frapper avec force - faire du bruit en frappant - (50) |
| taboler,tabouler, sabouler. Frapper, taper à grand coups. Battre le linge qu'on lave avec un battoir. Fig. Douleur vive par secousses. « Mon boron me tabole » pour mon furoncle me fait mal. - (49) |
| taboniau. Objet de peu de valeur, inutile et encombrant. Fig. Pièce remplie de « tabionaux » ; par extension, pièce en désordre. - (49) |
| taboniô : petit local, réduit, très petit appartement. A - B - (41) |
| taboniot : une personne laide - (44) |
| taborniau : bicoque mal tenue et mal éclairée. - (62) |
| tabot : gros et court en parlant d'une personne. A - B - (41) |
| tabot : gros et court - (34) |
| tabot : usée, émoussée pour une pioche - (43) |
| tabougnon (mettre en) : mal ranger quelque chose. (VSLD. T II) - S&L - (25) |
| tabouiller. : (Dial.), taboulé (pat.), faire du bruit sur quelque objet sonore, comme sur un tambour. Ce dernier mot vient de l'arabe tabur ou tambur, qui est la vraie racine des mots précédents. Au figuré, on taboule un fait, une anecdote, un propos. - (06) |
| taboulé, breudouler : grondement de l'orage - (43) |
| taboulé, frapper sur un tambour. Dans l'idiome breton, tabut signifie bruit. En Champagne, tabouler veut dire frapper à coups redoublés. - (02) |
| taboulé, v. a. frapper avec bruit sourd : il a taboulé à la porte. - (22) |
| tabouleau, s. m. nom que les enfants donnent au bruit particulier qu'à défaut du son des cloches on fait entendre dans les églises le jeudi , le vendredi et le samedi de la semaine sainte. — petit marteau à tête de bois. — un poussah, homme trapu et gros, enfant très gras par allusion à des ventres arrondis comme des tambours. (voir : tabouler.) - (08) |
| taboulée, s.m. se dit d'un grand nombre de personnes réunies autour d'une table. - (38) |
| tâbouler (C.-d., Chal., Br., Morv.).- Battre, frapper, faire du bruit. - Vient de tabourer, même sens, signifiant jouer du labour, ancienne forme du mot tambour (à Reims existe encore la rue du Tabour). A Uchon (Saône-et-Loire) on dit taboutai, mot qui se rapproche encore plus de tabut, bruit et tabuster, faire du bruit, lesquels sont l'origine de tabour… - (15) |
| tabouler (verbe) : taper, faire grand bruit. - (47) |
| tabouler : (vb) cogner, frapper - (35) |
| tabouler : cogner, frapper, faire du bruit - (43) |
| tabouler : cogner, taper, battre bruyamment (cœur), élancer (douleur) - (48) |
| tabouler : élancer (douleur). (CH. T III) - S&L - (25) |
| tabouler : frapper - (44) |
| tabouler : frapper (à une porte), faire du bruit - (60) |
| tabouler : Frapper, faire du bruit en frappant. « Queu-ce que taboule enco à la pôrte a stés heures ? », qu'est-ce qui frappe encore à la porte à pareille heure ? Produire un élancement douloureux. « Je me sus piqué le da hiya, y me taboule bin bravement aujourd'heu ». - Tabouler se dit encore du bruit qu'on croyait entendre dans une maison hantée « Il y a longtemps qu'on n'entend plus tabouler ». - (19) |
| tabouler : remuer rudement. (RDR. T III) - A - (25) |
| tabouler : taper. Et aussi par pulsations douloureuses sur une blessure corporelle. Du bas latin taballare. - (62) |
| tabouler : v. a., frapper bruyamment, faire du bruit. - (20) |
| tabouler : verbe utilisé pour parler d'une douleur qui élance - (39) |
| tabouler, tambouriner, frapper. - (05) |
| tabouler, v. a. faire du bruit en frappant, battre le tambour. On « taboule » un arrêté du maire, une représentation théâtrale, un déballage de marchandises. - (08) |
| tabouler, v. a. frapper avec bruit sourd : il a taboulé à la porte. - (24) |
| tabouler, v. pour parler d'une douleur (ma dent me taboule). - (65) |
| tabouler, v. secouer, frapper (on a taboulé à la porte). - (65) |
| tabouler, v. tonner au loin. - (65) |
| tabouler, v. tr., frapper, du pied, de la main, d'un bâton, surtout sur un corps sonore, faire grand bruit, battre du tambour : « J'iai prou taboulé ; mâ ô n'm'a ran acouté. » - (14) |
| tabouler, verbe transitif : frapper, cogner. Au sens figuré, il signifie élancer, subir une douleur lancinante, comme des coups répétés. - (54) |
| tabouler. Faire du bruit en tapant sur quelque chose. Etym. tambour, jadis tabour ; bas latin tabollare. - (12) |
| tabouler. Frapper. - (03) |
| taboulòt, s. m., bruit retentissant, surtout celui du tonnerre : « Ça s'mitoune là-haut ; va y avouér du taboulòt. » - (14) |
| taboulot. Tonnerre. Le creux de Chagny ast ben noir, i airons du taboulot. Les orages qui viennent fondre sur notre côte se forment presque toujours dans « le creux de Chagny », entre cette ville et la montagne de Corchanut. - (13) |
| taboulou, subst. masculin : bagarreur, qui cogne facilement. - (54) |
| tabouniau, s. m., récipient en planches, boîte grossière, percée de trous nombreux, destinée à tenir le poisson en eau vive, et qu'on met à flotter à côté du bateau. — Se dit aussi, par une analogie assez claire, d'une masure, d'une bicoque, d'une pauvre maison , délabrée et à jours : « Mon Dieu ! qu'é c'qui é que son cheû lu ? Ein ch'ti tabouniau. » Par dérision, une maison où l'on ne se plaît pas : « O peut ben m'étende (m'attendre) ; j'n'y r’veinrai fichtre pas, dans son tabouniau. » - (14) |
| tabouré, vn. tambouriner. - (17) |
| tabouret : s. m., petite fosse pratiquée à l'entrée d'un canal souterrain, où viennent s'accumuler les matières solides amenées par les eaux. - (20) |
| tabus. s. m. Tourment, inquiétude ; querelle, débat, procès. (Merry-la-Vallée). - (10) |
| tabye (traubye) : table - (51) |
| tabye : table. (B. T IV) - D - (25) |
| tabye n.f. Table. - (63) |
| tabye, tôle, table. - (16) |
| tabyi v. Tabler, prévoir, pronostiquer. - (63) |
| tâcer (v.t.) : tâcher - (50) |
| tâche voé d'fâre s'ki ! locution de défi pour empêcher une mauvaise action. - (16) |
| taché, tacreux : s. m., salamandre. - (20) |
| tachenöre (ā), sf. taissonnière, terrier de blaireau. - (17) |
| tâcher moyen, loc., trouver moyen : « Oh! la boune petiote, allé é prou c'mode à ainmer ; j’tâcherai moyen d'aller la vouér. » - (14) |
| tacheu, s .f. salamandre, à peau tachetée. - (24) |
| tâchi : Tâcher, avoir soin, s'efforcer. « Tâche de bien te comporter ! ». - Faire exprès. « C'ment que t'as bin pouyu fare pa casser ste vitre ? - Oh je n'y ai pas tâchi ». - (19) |
| tachi, v. a. tacher. - (24) |
| tâchi, v. a. tâcher. - (24) |
| tachole : s. f., tassée, bolée. - (20) |
| tachon : blaireau A - B - (41) |
| tachon : blaireau - (34) |
| tachon, s. m., blaireau. - (40) |
| tâchon, tasson, taison, taisson. s. m. Blaireau. (Rugny, Festigny). - (10) |
| tacnailler : produire un «tac-tac». « pris d’froid : ô tacnaillot des dents ». - (62) |
| tacneillat : Personne qui discute beaucoup. « Y a pas moyen de s'entendre dave liune ol est si bin tacneillat ! ». - (19) |
| tacneilli : Discuter longuement et âprement les conditions d'un marché. - (19) |
| tacnessi : chercher noise. (BY. T IV) - S&L - (25) |
| taco : pièce de bois suspendue au cou des vaches. (T. TIV) - Y - (25) |
| tacocher : v. a., tapoter. - (20) |
| tacon : s. m., vx fr., pièce de raccommodage. - (20) |
| taconner : v. n., vx fr., rapiécer ; bricoler ; tâtonner. - (20) |
| taconner, tacoter. v. Travailler sans suite à toutes sortes d'ouvrages, selon le caprice du moment, souvent sans résultat utile. Au XIIe siècle, un tacon est une pièce appliquée sur un vêtement ou une chaussure, taconer signifie raccommoder, et le taconier est un rapiéceur, un savetier. Le dialecte poyaudin utilise un emploi imagé de ce mot, comparant les activités du travailleur aux pièces d'un même tissu. Le français contemporain a abandonné ce terme, sauf.dans le vocabulaire technique de la typographie artisanale (taconner, c'est arranger les caractères d'imprimerie dans la forme). - (42) |
| taconner. v. n. Arcander, bacuter, travailler sans suite, sous l'inspiration du caprice, tantôt à un ouvrage, tantôt à un autre. - (10) |
| taconnier : s. n., vx fr., rapiéceur ; savetier. - (20) |
| tacot : digitale - (48) |
| tacot : petit train à voie étroite - (48) |
| tacot : digitale - (39) |
| tacòt, s. m., morceau de bois, souche de petit arbre taillé, battoir de laveuse. - (14) |
| tacot, tagot, s. m. celui qui frappe, qui cogne à petits coups. - (08) |
| tacot. adj. - Mou, lambin, hésitant, qui fait tout en tâtonnant. - (42) |
| tacot. s. m. Lambin, qui fait tout en tâtonnant, en hésitant. - (10) |
| tacot: train à voie métrique qui passait devant la ferme supprimé en 1952. - (59) |
| tacote. Battoir de laveuse. (Argentenay). - (10) |
| tacoter : lambiner. (F. T IV) - Y - (25) |
| tacoter : perdre son temps. (B. T IV) - Y - (25) |
| tacoter, v. n. frapper à petits coups et fréquemment. Se dit d'un homme qui travaille avec mollesse et sans faire beaucoup d'ouvrage. - (08) |
| tacòter, v. tr., frapper à petits coups. - (14) |
| tâd : tard - (57) |
| tadier (ă), vn. tarder. - (17) |
| tadjevèle, sf. femme originale, toquée. - (17) |
| taffoureutte : moustique. (M. H. LE GRAND à Noiron-sousGevrey. Le taffoureute ne serait pas le moustique mais un petit insecte piqueur qui constituait jadis une plaie pour les chevaux car ils se nichaient dans leurs oreilles). (REP T IV) - D - (25) |
| taffourottes : moustiques. (A. T II) - D - (25) |
| tafian : mauvais. (SB. T IV) - C - (25) |
| tafion : pâtisserie compacte. (EDSEA. T II) - A - (25) |
| tafioner : tripoter. - (66) |
| tafiote (Je) : je tripote ou je bidouille. - (66) |
| tafourotte : mot féminin désignant un moustique - (46) |
| tâgeai (se) : se taire. Dis ien, tàge touai : ne dis rien, tais toi. - (33) |
| tagné, tagni, tagnie : part pass., tanné, flétri, fatigué, flapi. - (20) |
| tâgner : gémir sous l’effort ou la douleur, geindre en besognant. - (62) |
| tagner, plaindre, gémir. - (05) |
| tâgner, v. intr., geindre, se plaindre en travaillant, comme le mitron qui pétrit. A une autre acception plus... intime : faire les efforts d'un constipé. - (14) |
| tagner. Je suppose que ce mot, qui signifie se plaindre, est une corruption de ahanner: ahan. - (03) |
| tagni : Respirer péniblement et bruyamment par suite de la fatigue. « Y m'a fait tagni de manter le sinté à Laurent ». - (19) |
| tagni, v. n. tousser avec peine, faiblement. - (22) |
| tagni, v. n. tousser avec peine, faiblement. - (24) |
| tâgnoter : faire le difficile à table (voir : tangnau : lambin, musard). - (56) |
| tagot. Synonyme de ragot. - (49) |
| tai : grosse salamandre noire à rayures jaunes vivant en terre fraîche. A - B - (41) |
| tai - salamandre, espèce de petit lézard, lent, qui aime les endroits frais, ombreux ; aussi inoffensif qu'il a été réputé dangereux. - Al â méchant quemant in tai. - (18) |
| tai (adj.pos. f.s.) : ta - (50) |
| tai : toi - (57) |
| tai, salamandre. - (05) |
| tai, ta, tainne - tien, tienne. - Lai Glaudine t'envie tai bliaude-ronde qu'ile é raiquemaudée. - Voiqui in bonnot que n'â pas d'ai moi ; est-ce que c’â le tainne ? - I ne peux pâ restai dan ceute pliaice qui, i seu échenai vraiment ; beille-moi don lai tainne, ci me choingeré. - (18) |
| tai, tac, charbon blanc de bestiaux. - (05) |
| tai, touai : pron. pers. Toi. - (53) |
| tai. Ta, comme mai ma, sai sa, pronoms féminin adjectifs possessifs. - (01) |
| taibac (n.m.) : tabac (comme en français le c ne se prononce pas) - (50) |
| taibaic d’ç’ine : cigarette ou tabac pris dans le paquet d’un ami (de « ç’iner » : chiner, prendre) - (37) |
| taibaitou : mouchoir de priseur - (37) |
| taibeler. v. a. Tacher. (Ménades). - (10) |
| taibeulé, pizaguè : v. t. Remuer énergiquement. - (53) |
| taibiau, sm. tableau. - (17) |
| taibiète, sf. tablette. - (17) |
| taible (nom féminin) : table. - (47) |
| taibôlè, tarbeuillé : 1 n. m. Élancement douloureux. - 2 n. m. Tonnerre (lors d'un orage). - (53) |
| taibôlée : n. f. Grande quantité. - (53) |
| taiboule ! (y’mù) : (ça) m’élance ! (ça) me fait mal ! - (37) |
| taiboulée (aine) : (un) grand nombre, beaucoup - (37) |
| taibouler : (en certains lieux) mentir énormément - (37) |
| taibouler : taper, frapper à coups redoublés sur du métal, de la pierre, du bois - (37) |
| taiboulou : (en certains lieux) menteur éhonté - (37) |
| taiboulou : celui qui tape ainsi - (37) |
| taibye (n.f.) : table - (50) |
| taiche : Tache. « Eune taiche de cambou ». - Tas. « I va pliu i faut mentre les gearbes en taiches ». - (19) |
| taiche : n. f. Tache. - (53) |
| taiche, s. f. tache. « taice. » - (08) |
| taicher, v. a. tacher, salir. « taicer, taiher. » - (08) |
| taichi : Tacher. « Prends garde de taichi la nappe ». - (19) |
| taichon (n.m.) : blaireau (a.fr., taisson) - (50) |
| taichon : n. m. Blaireau. - (53) |
| taichon, s. m. blaireau, taisson. - (08) |
| taici, interj. dont on se sert pour contenir un chien prêt à s'élancer. - (08) |
| taicot : chemin de fer, d’intérêt local, à voie étroite (écartement des rails : 1 mètre au lieu de 1m44) - (37) |
| taigne. Le présent du subjonctif de tenir, fait, à la troisième personne du singulier et du pluriel, en bourguignon taigne, en français tienne et tiennent. Le pluriel bourguignon de la troisième personne de l’indicatif du présent fait aussi taigne. - (01) |
| taihi, v. a. tarir, dessécher. - (08) |
| taille n.f. Corsage. La boulandzire étot ren rétsindue, alle étot en taille. Ici ren (rien) s'emploie dans un sens inverse de sa signification normale. La boulangère était toute réchauffée, elle était en corsage. - (63) |
| taille : s. f., corsage. J'ai rencontré Mme X... ; elle était rien réchauffée, elle était en taille. - (20) |
| taille, n.f. corsage. - (65) |
| taillepré : pioche pour les rigoles - (43) |
| taille-pré n.m. Pioche à deux fers dont un en forme de couperet recourbé. - (63) |
| tailler eùne bavéte, locution pittoresque, employée pour dire babiller longuement : « Tout coup qu'all' sort por aller qu'rî quête chouse, all' s'érâte pou tailler eùne bavéte. » - (14) |
| tailleûse (na) : couturière - (57) |
| tailleuse : couturière - (43) |
| tailleuse : Couturière. (Voir coudrère). - (19) |
| tailleuse : s. f., cétoine dorée (celonia aurala), coJéoptêre vivant sur les roses. Voir émeraude. - (20) |
| tailleuse, s. f. couturière. - (22) |
| tailleuse, s. f. couturière. - (24) |
| tailli : tailler - (43) |
| tailli : tailler - (57) |
| taillion : morceau de pomme de terre avec un germe destiné à être planté - (34) |
| taillon : fragment de pomme de terre portant un germe et destiné à être planté. A - B - (41) |
| taillon : (nm) morceau de pomme de terre coupé, destiné à être planté - (35) |
| taillon : germe de pomme de terre, avec une partie de la chair, destiné à être planté - (43) |
| taillon n.m. Morceau taillé : pain, fromage, pomme de terre avec son germe. - (63) |
| taillon : s. m., vx fr., morceau. Un talllon de pain, de pomme, de viande, etc. Du taillon, de la « chapote » (voir ce mot) de viande. - (20) |
| tàillon, s. m. tranche de viande, spécialement de lard (vieux français). - (24) |
| taillon, teillon. Morceau. Se dit surtout d'un morceau de poire ou de pomme. - (49) |
| tailon, sm. talon. - (17) |
| taimi. Tamis, crible, sas. Tonai le taimi, divination par le moyen d'un tamis ou sas que font tourner les bonnes gens pour retrouver les choses perdues… - (01) |
| tainer : peiner en gémissant. - (56) |
| tainer, tamner (v.) : être essoufflé - (50) |
| tainer, v. n. être essoufflé, oppressé par excès de fatigue ou par une marche rapide : « i taine, te taines, a taine. » ce travail est pénible, il me fait « tainer. » - (08) |
| taingni : geindre - (57) |
| taîn-ne : tien - tienne - (57) |
| tain-tai-ben, s. m., rampe d'escalier, garde-fou. Ex. : te pranrai le tain-tai-ben, et peu te montrai. - (11) |
| taintouin : souci - (37) |
| taipant : adj. Tapant. - (53) |
| taipe (aine boûnne) : (une importante) diminution constatée à un mets, ou à une boisson servis - (37) |
| taipe (aine) : (une) gifle - (37) |
| taipé : bien caché, blotti - (37) |
| taipé : éclaté (en parlant d’un fruit) - (37) |
| taipe, sf. tape. - (17) |
| taipe-culs (ain) : route toute déformée, à bosses, à nids-de-poules - (37) |
| taipée (aine) : beaucoup - (37) |
| taiper en l’lit’e : faire baisser de façon appréciable le niveau du litre - (37) |
| taiper en lai beûtte : travailler avec ardeur - (37) |
| taipette (aine) : (un) piège à souris - (37) |
| taipette, zaippe : langue « bien pendue » - (37) |
| taipi. Tapis. - (01) |
| taipon : agglomération de matières qui obstruent - (37) |
| taipou : pelle en bois pour battre le linge au lavoir - (37) |
| taiqué : se dit d’un gâteau non « levé » à la cuisson - (37) |
| tairaisse : récipient en terre cuite pour le lait - (37) |
| tairbolai - agiter, secouer des objets. - Il â venue dan lai maitenée tairbolai note porte. - Vos ne pouvez don ran prenre san que vos tairbolain to ! – Ne tairbolle don pâ quemant cequi ceute enfant. - (18) |
| tairbutai - déranger, inquiéter quelqu'un. - Que vô me terbutez don ! – A son venus me terbutai dan mon ôvraige. - (18) |
| taire (Se) : v. r. Taisez-vous !, se dit à l'annonce d'une nouvelle ébouriffante et est immédiatement suivi d'un second impératif de sens contraire : Racontez-moi ça ! - (20) |
| tairi : tarir - (48) |
| tairi : tarir - (51) |
| tairi, vt. tarir. - (17) |
| tairjöte, sf. targette. - (17) |
| tairte â gueûrlons, tairte ai lai fouainaic’e : mets imaginaires, plaisanterie « servie » aux « parisiens gros becs » qui connaissent tout - (37) |
| tairteûill’ries : attouchements prolongés, « pelotage » - (37) |
| tairteûill’ries : éclaboussements - (37) |
| tairteûiller : tripoter avec les doigts, triturer, comme de la pâte à tarte, « peloter » - (37) |
| tairteûiller d’yiau : remuer de l’eau avec les mains - (37) |
| tairteûillot : petite tarte aux fruits mélangés à la pâte - (37) |
| tairtevelai, faire du bruit avec une crécelle en bois qu'on nommait tartevelle ou tartavelle. C'était l'instrument qu'on mettait à la disposition des lépreux, afin que, lorsqu'ils sortaient, ils prévinssent les passants de s'éloigner d'eux... - (02) |
| tairtevelai. : Faire du bruit, et, au propre, agiter une tartevelle. C'était une sorte de crécelle en bois dont se servaient les lépreux pour prévenir les passants de s'éloigner d'eux. - Dans quelques provinces, on a employé les tartevelles pour annoncer les offices pendant les trois derniers jours de la semaine sainte, afin de suppléer les cloches qui restent alors muettes en signe de deuil. - (06) |
| tairtolliai - aimer à remuer l'eau, à laver sans cesse, à manipuler sâlement une chose. - Quoi que te tairtoille don tôjeur quemant cequi ? Ile l'a tôjeur ai tairtoillai dan l'aie… ine mannie, quoi ! - Ote-tai don, teins ; t'é ine petiote tairtoillon, que te te sâlis tote !... - (18) |
| tairtoué'iller : remuer dans l'eau - (48) |
| tairtoufe - pomme de terre. - Se dit rarement aujourd'hui. - (18) |
| taise. Thèse. Taise, quand on dit je taise, est un verbe qui signifie, je vise… - (01) |
| taiser (se ), se taire, se taïer. - (04) |
| taiser (se) (v.pr.) : se taire - (50) |
| taiser (se), v. pr., se taire : « Te couines trop fort, p'tiot drôle ; v'tu ben t'taiser ! » - (14) |
| taiser, v. a. taire, garder le silence. Peu usité. on n'emploie plus guère que l'impératif : « taise-toué », tais-toi. - (08) |
| taiser. Se taire. - (03) |
| taisrailot ou tarâlot - espèce de charpeigne, de corbeille plate, pour la terre, les choses grossières. - Emporte aivou toi le taisrailot pou raimassai des pierres. - A m'é beillé des carottes pliain le tarâlot. - (18) |
| taisse : s. m., vx fr., taisson, blaireau. - (20) |
| taisse-toué : tais-toi. Expression qui indique la surprise : "c'est pas possible !" Ex : "L'pée Gaston il est môrt ? Oh ben taisse-toué!" - (58) |
| taiss-hon, taisson, blaireau. - (05) |
| taisson, blaireau, taichon. - (04) |
| taisson, n.m. blaireau. - (65) |
| taisson, s. m. blaireau (vieux français). - (24) |
| taisson, s. m. blaireau. - (22) |
| taitan millienne (mai) : (ma) tante emilienne - (37) |
| taitounou, ouse, adj. tâtonneur, celui qui tâtonne, qui hésite beaucoup avant de prendre une détermination. - (08) |
| taitpraisser : remplir des imprimés, des papiers - (37) |
| taivaissée : forte correction - (37) |
| taivaisser : battre, « corriger » - (37) |
| taivan-nè : 1 v .t. Embêter. - 2 v. t. Insister. - (53) |
| taivin (n.m.) : taon - (50) |
| taivin : taon - (48) |
| taivin : taon, grosse mouche à bœufs - (37) |
| taivin, s. m. taon, grosse mouche qui s'attache particulièrement aux bœufs, aux chevaux. Plusieurs prononcent « ataivin. » en quelques lieux « taibin. - (08) |
| taivin, sm. taon. - (17) |
| taivin, tavin : n.m. Taon. - (53) |
| taivin'né, pizaguè : 1 v. t. Aiguillonner. - 2 v. t. Exciter. - (53) |
| taivoue, excavation sur le bord d'une rivière. - (28) |
| taiye (lai), c’ez l’boulanzer : c’était deux petites planchettes en bois identiques (une pour le client, une restant chez le boulanger), que le boulanger plaçait l’une contre l’autre, bien ajustées, lors de chaque achat de pain. avec une lime, il faisait une entaille commune aux deux planchettes en même temps. a la fin du mois, le client payait le total. un coup de rabot commun effaçait tout et l’on recommençait. - (37) |
| taizé (se), vr. taire. Taiz' tö, tais-toi. - (17) |
| tajer (se), v. réfl. se taire, garder le silence. - (08) |
| taka : s. m. heurtoir . - (21) |
| take, battoir de laveuse ; takète, cliquette. - (16) |
| taki adj. (du vx. fr. tacon, morceau de pâte servant de levain). 1. Mal levé, mal cuit (pour le pain, un gâteau). 2. Fig. Pas dégourdi, simplet. - (63) |
| takote, silène des champs. - (16) |
| tal, pronom, tel. - (38) |
| talan : Talon. « Ol a mis des clios seu les talans de ses sabeuts ». « Train-ne talans » : celui qui lambine en marchant, qui reste en arrière. « Sinté à talan » : passage n'ayant pas plus d'un mètre de large. - (19) |
| talander. v. n. Demander plusieurs fois la même chose. (Soucy). - (10) |
| talandyé, taillandier. - (16) |
| Talant (qui voit Talant n'est pas dedans) Dicton emprunte à la topographie locale. Talant est bâti sur une colline circulaire qui domine la plaine ou s'étend Dijon, et que l’on aperçoit a de très grandes distances ; les pentes de cette colline sont fort raides et rendent son ascension difficile. Au propre, le dicton s'explique tout seul, et serait d'une grande naïveté aussi ne remploie-t-on qu'au figuré, pour dire qu'il y a une grande distance entre la coupe et les lèvres. - (12) |
| talardé (adj.) : fou (t'es complètement talardé) - (64) |
| talarder (v. tr.) : secouer vigoureusement, comme dans un tarare – bâcler en parlant d'un travail - (64) |
| talbo. Se dit d'un enfant gros et court. - (03) |
| Talbor. Thabor, montagne où se fit le miracle da la transfiguration. Au lieu de Thabor on a dit Talbor, par une ignorance affectée en la personne du vigneron Barôzai, qu'on feint être l’auteur de ces Noëls. - (01) |
| talé : abimé - (44) |
| talé : se dit d'un fruit portant des marques de chocs sur sa surface et, de ce fait, ne pouvant être conservé durablement. - (56) |
| tale : branche d’arbre (une branche conséquente). Ex : "T’as ène tale à ton poumier qu’a va casser sous les poumes." - (58) |
| tale, « L » branche , talea. - (04) |
| talé, meurtrir, meurtri ; talûre, meurtrissure. - (16) |
| talé, v, a. presser brutalement, contusionner. - (22) |
| tale-bois. s. m. Pie, oiseau. (Perrigny-lès-Auxerre). - (10) |
| talechi, v. a. frapper à coups répétés au cours d'un travail fastidieux : il a talechi tout un jour. - (24) |
| talepon, s. m. grosse bûche de bois noueux. - (22) |
| tàler (C.-d., Chal., Br.), tôler (Morv.). – Meurtrir ; talure, meurtrissure… C'est une vieille expression du moyen âge, conservée exclusivement en Bourgogne, qui signifiait broyer et dont un dérivé, taloche, est seul encore usité en français…. En Morvan le mot tole s'emploie encore pour dire branche (chose qu'on coupe ?). - (15) |
| taler (se). v. - Se meurtrir : « J'm's'eus talé l'grous artau avec mes nouviaux sabiots. » Le poyaudin utilise à la forme pronominale le verbe français taler, employé essentiellement en parlant des fruits. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| taler : meurtri - (43) |
| taler : Meurtrir, froisser, blesser. « Faudra mener farrer tes bus i ant les pids talés ». « Des pommes talées » : des pommes qui se sont endommagées en tombant de l'arbre. - Battre. « I se sant talés à cos de poingt ». - (19) |
| tâler : meurtrir. - (66) |
| taler v. Meurtrir, taper. Dz'vas t'taler l'cul, chtit gredin ! - (63) |
| taler, « L » meurtrir, talare (bas latin), piller, ravager, détruire; ce mot est évidemment de même formation que le mot condômer, frapper, blesser, venant de condomines, ancien nom des corvées. - (04) |
| taler, talure, meurtrir, meurtrissure. - (05) |
| taler, v. a. presser brutalement, contusionner. - (24) |
| taler. Meurtrir. Etym. inconnue. - (12) |
| taler. Meurtrir·; talure, meurtrissure. - (03) |
| taler. : Meurtrir. M. l'abbé Dartois dit que ce mot vient du gaulois taol (Leg.), coup. D'où le mot taloche. - (06) |
| taleu : syn. de potchon* dans la région de Génelard. B - (41) |
| taleu (n.m.) : entrave que l'on met au cou des chèvres ou des oies - (50) |
| taleu : entrave de bois pendue au cou des vaches pour les empêcher de sortir - (48) |
| taleu : triangle de bois que l'on met au coup d'une chèvre pour qu'elle ne passe pas à travers les buissons - (51) |
| taleu : bout de bois pendu au cou des vaches pour les empêcher de sortir, aussi au cou des oies en forme de râteau - (39) |
| taleu, .s. m. morceau de bois qu'on attache au cou des oies pour les entraver et les empêcher ainsi de pénétrer dans les terres ensemencées. - (08) |
| taleu, s. m. tronçon de bois suspendu au cou du bétail pour l'empêcher de courir ; palonnier de charrue. - (22) |
| taleuche : Claque, calotte, giffle. - (19) |
| taleuchi : Donner plusieurs « taleuches » de suite et rapidement « Ol l'a taleuchi de la garde » : il l'a calotté d'importance. - (19) |
| taleuchi, v. a. frapper à coups redoublés. - (22) |
| taleûre : Callosité, gonflement des chairs ou même abcès provenant de la compression par la chaussure ou le manche d'un outil. - (19) |
| taleûre n.f. Talure, meurtrissure sur un fruit, cal. - (63) |
| taleut : Gros morceau de bois qu'on suspend par une corde au cou d'une bête pour l'entraver. - (19) |
| taleutsi : taper dessus - (43) |
| taleux n.m. Entrave de bois fixée au cou des chèvres. On dit surtout pôtchon lorsqu'elle prend la forme d'un triangle. - (63) |
| talgau : (nm) partie d’une tige coupée qui dépasse du sol - (35) |
| talgô : petite souche de bois mort. A - B - (41) |
| talgot : petite souche de bois mort - (34) |
| talgot : souche ou petit bout de tronc d’un petit végétal - (51) |
| tal'got : tige coupée au ras du sol, souche - (43) |
| talgot n.m. Trognon. - (63) |
| talibo : salsifis sauvage. (S. T III) - D - (25) |
| talibô, herbe des prés dont le nom vulgaire est barbe de bouc. A Châtillon, les enfants disent balibo, ce qui est un barbarisme dans l'idiome. - (02) |
| talibo, scorsonère, salsifis des prés. - (16) |
| talibô. : Barbe de bouc, herbe des prés. (Del.) - (06) |
| talibot. Plante comestible qui pousse dans les prés : c'est une espèce de salsifis dont la tige est sucrée. - (13) |
| talifon - (39) |
| talimouriot (faire le) : faire la culbute complète. (R. T IV) - Y - (25) |
| talipon, s. m. tapon, tas, amas de choses en désordre. Un drap qu'on ramasse sans le plier est « en talipon » comme le linge sale qu'on donne aux blanchisseuses - (08) |
| tali-tala, comme ci , comme ça - (36) |
| talitala, loc. comme ci, comme çà : aimezvous le tabac ? « talitala, talilala ! » - (08) |
| talle : branche d'arbre verte. - (09) |
| talle n.f. (de tailler). Morceau, quantité. Ôl en a mandzi eune bonne talle. Il en a mangé un gros morceau. - (63) |
| talle, n.f. tige de vigne. - (65) |
| talmouse, s.f. sorte de gâteau. - (38) |
| talmouse. Sorte de gâteau au fromage. Le mot et la chose disparaissent ; la génération qui nous suit ne connaîtra plus ces pâtisseries savoureuses et non sucrées de nos ancêtres : flamusses, talmouzes, chaussons et corniottes... - (13) |
| talo. Extrémité du jarret : « un talo de jambon ». - (49) |
| taloche, coup de la main ouverte ou fermée... - (02) |
| taloche. Coup. - (49) |
| talocher. Battre, corriger. - (49) |
| talochi : talocher - (57) |
| talon : partie de la faux se fixant sur le manche - (48) |
| talon : s. m. Chemin à talon, sentier à talon, chemin ou sentier ou l'on ne passe qu'à pied. - (20) |
| talonnou (talonniére) : outil utilisé pour creuser les sabots - (39) |
| talôpe, taloupe, s. f. balle dont les enfants se servent dans leurs jeux : une belle « talôpe » ; jouer à la « talôpe. » - (08) |
| talot : extrémité du jambon - (44) |
| talot n.m. Talon, extrémité, base, entâme. - (63) |
| talot, subst. masculin : talon du jambon. - (54) |
| talotse n.f. Taloche, gifle. - (63) |
| talotsi v. Talocher, gifler. - (63) |
| taloupe : petite balle, balle - (48) |
| taloupe : petite balle - (39) |
| taloûr : tout à l'heure - (57) |
| talpon, s. m. tapon, tas, amas, paquet, masse confuse : jeter ses vêtements « en talpon. » - (08) |
| talpon, tapon : paquet de différentes matières (foin aggloméré, etc…) - (48) |
| talucher, v., enfoncer des piquets à la masse. - (40) |
| taluchon. s. m. Gros morceau de pain. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| talure. Contusion occasionnée par le maniement d'un outil ou par le frottement d'une mauvaise chaussure. A s'ast fait eune talure qui s'ast tornée en panaris. C'est le substantif du verbe taler, qui figure dans quelques dictionnaires. - (13) |
| talure. Meurtrissure. Substantif venu de taler. - (12) |
| tam. Temps. - (01) |
| tamberiaû (on) : tombereau - (57) |
| tambeuriau, s. m. tombereau. - (22) |
| tambola (na) : tombola - (57) |
| tambor. Tambour, tambours. - (01) |
| tamborin. Tambourin, tabourin, petit tambour. - (01) |
| tambour : s. m., fût de 300 a 400 litres, moins allongé que les fûts ordinaires, et dont la forme, par conséquent, rappelle celle du tambour. - (20) |
| tambourner : Battre du tambour, publier à son de tambour. « As-tu entendu ce qu'an a tambourné ? ». - (19) |
| tambourner, v. n. battre du tambour. - (24) |
| tambournier : Celui qui bat du tambour. - (19) |
| tambournier, s. m., tambour de ville, celui qui va à tous les coins de rues « faire assavoir » au son du tambour. - (14) |
| tamb'riau : Tombereau, et son contenu. « In tamb'riau de femé ». - (19) |
| tamiji : Tamiser. « De la fareune tamijie bien fin ». - (19) |
| tamoyen, tanmoyen, interj. qui exprime la surprise, le doute : vraiment ? est-ce possible ? - (08) |
| tampeune : vieille vache en mauvais état - (48) |
| tampeune :cloche à vache - (48) |
| tampignon : gros morceau de pain - (60) |
| tampôner, v. intr., s'amuser, tuer le temps en plaisir, mener la vie de garçon : « Nous autres fous, nous tampônons toujours. . . continuellement à l'hôtel, au café. . . » (Correspondance chalonnaise de 1838.) - (14) |
| tamponne : Ribote « Fare la tamponne » : riboter - (19) |
| tamponne, tampougne : s. f., cuite (au sens argotique). Avoir une tamponne. Se flanquer une tampougne. - (20) |
| tamuzeau : travailleur lent. - (66) |
| tan ! interj. qui a un sens négatif et qui équivaut à peu près au français bah! : « tan, que v'lé-vô qui v'zen diâ ! » bah ! que voulez-vous que je vous en dise. - (08) |
| tan ke, jeusk'ai tan ke, jusqu'à ce que. - (16) |
| tan née, ronf’iée : correction sévère - (37) |
| tan ner : donner une forte correction corporelle - (37) |
| tan, s. f. fois. usité dans plusieurs locutions : « ai tan » = à cette fois. - (08) |
| tan. Tant. - (01) |
| tan; l’tan, le ciel atmosphérique ; grô tan, ciel orageux. - (16) |
| tancheuleman (adv.) : seulement, pas davantage (aussi tanchuman) - (50) |
| tanchote, s.f. chanteflûte. - (38) |
| tanchotée, s.f. contenu d'une chanteflûte. - (38) |
| tancot - grosse cheville de bois, dans un mur ou dans la terre, à laquelle on attache le bétail. - En â temps d'aitacher le vais ; mets in tanco dan le mur. - Dan le prai te plianteré in tancot pour lai vaiche, aivou ine corde in pecho longue. - (18) |
| tancot : (tan:co - subst. m.) reste de branche ou de racine qui reste après défrichage, dépassant du sol au point de faire trébucher; concerne aussi les branchettes d'une bûche mal élaguée ; par extension, le mot désigne enfin une plume naissante qui reste fixée dans la peau d'une volaille après qu'on l'a plumée. - (45) |
| tancot : morceau de racine ou de tige sortant de terre - (48) |
| tancot : parcelle d'aliment résistant à la mastication (saucisson sec, par ex.), signification exacte : racine sortant de terre. - (56) |
| tancot : 1 n. m. Chicot. - 2 n. f. Plume naissante. - 3 n. m. Reste saillant. - (53) |
| tancot : longue tige. - (21) |
| tancot : s. m., chicot (d'une plante, d'une feuille, d'un fruit, d'une plume de volatile, etc.) Voir tebeut. - (20) |
| tancot, s. m. parties dures d'une plante ; la tige même de cette plante : il ne reste plus que le tancot. - (24) |
| tancot, s. m. racine de genêt ou autre arbuste qui sort de terre, ce qui reste en saillie sur le sol d'un végétal coupé. - (08) |
| tancot, s. m., tronc mal coupé. - (40) |
| tancot, s.m. chicot, tronc, branche cassée. - (38) |
| tancot, subst. masculin : tuyau qui reste sur la peau des volailles qui sont plumées. - (54) |
| tancou, s. m. parties dures d'une plante ; la tige même de cette plante : il ne reste plus que le tancou. - (22) |
| tandûe, cloison de briques. - (16) |
| tanée : fessée - (44) |
| tânée : une rossée - (46) |
| taneire. Tanière, tanières… - (01) |
| taner, v. a. tracasser, tourmenter, fatiguer par des importunités. - (08) |
| taneuser (prononcez tan-neuser). v. n. Prendre son temps, l'employer a des riens. Par corruption de tempuser, tempore uti, tempore abuti. (Etivey). - (10) |
| taneusot (tan-nousot). s. m. Qui taneuse, qui perd son temps. (Etivey). – Voyez taneuser. - (10) |
| tanfouner (verbe) : battre. - (47) |
| tangnau, aude, adj. lambin, musard. Se dit d'un individu qui s'attarde par esprit de minutie. - (08) |
| tangnére, s. f. tanière, retraite, refuge pour les hommes ou les animaux, lieu où l'on se cache, où l'on s'abrite. - (08) |
| tânier, v., respirer avec bruit et tirage. - (40) |
| tanir, v. a. flétrir : l'herbe est tanie par le soleil. - (24) |
| tanir, v. a. flétrir : l'herbe est tanie par le soleil. - (22) |
| tân-nè : v. t. Tanner. - (53) |
| tan-né, frapper rudement une personne, un animal. - (16) |
| tan-née - (39) |
| tan'née : correction - (48) |
| tan-ner (se faire). Se faire battre. - (49) |
| tanner (v. int.) : haleter - (64) |
| tan'ner : battre, tabasser - (48) |
| tân-ner : battre, tanner. - (52) |
| tan-ner : donner une forte correction. Taper violemment une personne un animal - (51) |
| tânner : battre. O fayo tânner les peaux : il fallait battre les peaux. - (33) |
| tañner v. Rosser, harceler, souffler (essouflement). - (63) |
| tan-ner : corriger - (39) |
| tan-ner, v. battre. - (38) |
| tanner. v. - Plusieurs usages : 1. Geindre, se plaindre sans arrêt. 2. Haleter, être essoufflé (Saint-Martin-sur-Ouanne, selon M. Jossier). 3. Donner une raclée, une correction : « Si j'peux l'tau-per, i' va s' prende eune de ceu tânnée ! » Mot employé en français familier avec l'image de tanner le cuir ou la peau. - (42) |
| tanner. v. n. Hateter, geindre, souffler fort en travaillant. (Saint-Martin-sur-Ouanne). – A Auxerre, v. a. Battre, frapper plus ou moins violemment. On prononce tan-ner. - (10) |
| tanpon : 1 n. m. Bouillie collée au fond d'une casserole. - 2 adj. Tas de vêtements. - (53) |
| tanprèle, sf. taperelle, sarbacane faite d'une tige de sureau vidée de sa moelle et munie d'un piston. - (17) |
| tanprelou (oū), sm. sureau. - (17) |
| tanque à tanque loc. adv. Tant et plus. - (63) |
| tanque et tanque, loc. beaucoup et longuement : rire tanque et tanque. - (24) |
| tanque loc. adv. Tant que, jusqu'à. - (63) |
| tanque, tanque, loc. beaucoup et longuement : s'amuser et rire tangue, tangue. - (22) |
| tanqueut : Trognon « In tanqueut de chou ». « In tanqueut de paneuille » : le gros pédoncule de l'épi de maïs. - Moignon. « Ol a copé la coue de san chin o ne li a ren que laichi le tanqueut ». - (19) |
| tanquot : reste de branche brisée sec, dur, resté lié au tronc. En provençal pieds tanqués (restés au sol), a donné « pétanque ». - (62) |
| tanseipsô, loc. tant soit peu. s'emploie substantiv. : « ain tanseipsô », un tant soit peu. - (08) |
| tanseulement, adv. seulement, pas davantage. « tancheulement. » - (08) |
| tanseure : Tonsure. Au figuré : commencement de calvitie. - (19) |
| tansipeu. adv. - Tant soit peu. - (42) |
| tant adv. 1. Tellement. 2. Autant. - (63) |
| tant moyen : explétif. (MM. T IV) - A - (25) |
| tant moyen voua... : je me demande... (MM. T IV) - A - (25) |
| tant peune plus ; tant pene ol s'défoussalot à lu pàrler, tant peune ol n'répondot ren, plus il s’évertuait à lui parler, plus il se taisait. - (38) |
| tant qu’à : (prép) jusqu’à (lieu) - (35) |
| tant qu’à : jusqu’à - (43) |
| tant qu'à (dzusque) : jusque - (51) |
| tant qu'à, loc, quant à, jusqu'à : « Tant qu'à la Nan-néte, i n'en faut pus parler ; n'y é pus ran qu'eùne couraude. » - (14) |
| tant que dure dure : loc, adv., autant que possible, jusqu'à extinction, Le Glaudius a monté un broc de seize litres, et pis à nous deux on a bu tant que dure dure. - (20) |
| tant que tant que (tant qu’ tant qu’) : loc., syn, de tant que dure dure. il lut a foutu des coups tant que tant que. - (20) |
| tant seulement, seulement. - (04) |
| tant s'ment, adv., seulement : « Alle é joulite, sa coumédie ! on n'y vouét tant s'ment ran du tout. » - (14) |
| tant, tante, adj. tant, autant, en aussi grande quantité : « i f'ré ç'lai tantes foués qu'vô vourâ », je ferai cela autant de fois que vous voudrez. - (08) |
| tantai (de tantum), un peu. - (02) |
| tante : Dame dans le langage enfantin, appellation indépendante de toute idée de parenté. « Dis marci à ste tante » : dis merci à cette dame. - (19) |
| tanteu : Après-midi. « Neutés mande vant veni tanteu » : nos parents vont venir cet après-midi. – Tantôt. « Tanteu itié, tanteut liavent » : tantôt ici, tantôt là. - (19) |
| tantinet, diminutif tantai. - (02) |
| tantinot (n.m.) : chicot qui demeure au tronc d'un arbre après l’élagage des branches - (50) |
| tantinot, s. m. chicot qui demeure au tronc d'un arbre après l'élagage des branches. - (08) |
| tantir’lire : caractère de vieille personne - (37) |
| tantô : n. m. Tantôt. - (53) |
| tantô, l'après-midi ; su l'tantô, sur l'après-midi. Ce mot semble composé de temps et de haut, parce que, à midi, le soleil a atteint sa plus haute élévation. - (16) |
| tantò. Tantôt. - (01) |
| tantôt (dans toute la Bourg.). - Aprèsmidi. Adverbe pris substantivement. Dans le patois bourguignon, on dit : ce tantôt, le tantôt, pour dire cet après-midi. C'est encore par suite de la conservation d'un usage ancien, tantôt étant autrefois usité dans le sens d'après·midi. - (15) |
| tantôt (l’) : (l’) après-midi - (37) |
| tantôt n.m. Après-midi. - (63) |
| tantôt ! (ai) : (à) plus tard ! - (37) |
| tantôt, s. m., après-midi : « Veinrez-vous c'tantôt ? » Ce mot implique toujours un délai. Au contraire, dans certaines localités, tantôt veut presque dire : à l'instant. - (14) |
| tantôt, sm. après-midi. - (17) |
| tantouiller (se). Se baigner, se rouler dans la vase. Se dit surtout du porc. - (49) |
| tantouiller : mélanger - (44) |
| tantoût (on) : tantôt - (57) |
| tantout. adv. - Tantôt. - (42) |
| tantse n.f. Tanche. - (63) |
| tant-se-po : Locution, tant soit peu. Voir pau. - (19) |
| tant-sé-pou, loc. tant soit peu. - (22) |
| tant-sé-pou, loc. tant soit peu. - (24) |
| tanusé, tainusé, vn. s'occuper à des riens. - (17) |
| tanuser, tortiller avec ses doigts (se dit d'un enfant qui touche son nez, une plaie, une croûte). - (27) |
| tanuseu : propre à rien. - (66) |
| tanuzer, bricoler. - (26) |
| tapairt (n.m.) : digitale (aussi taperiau) - (50) |
| tapan : Grosse cheville servant à boucher le trou pratiqué dans une futaille, une cuve, un cuvier. « I ne faut pas êt' gauche pas mentre la fantaine à la plièche du tapan de la cue sans fare jiclier eune gotte de vin ». - (19) |
| tapante, s. f. pomme de terre qui tape ou crève en cuisant, c’est à dire qui se fend sous l'action du feu. - (08) |
| tapé (e): (p.passé) fruit (pomme ou poire) coupé en tranches et séché au soleil - (35) |
| tapé (être). Être simple, peu malin. - (49) |
| tape coulou, s.m. celui qui rôde autour des fourneaux, à l'affût d'un bon morceau. - (38) |
| tape : s. f., battoir de laveuse. - (20) |
| tapè : v. t. Taper. - (53) |
| tapé, frapper et crever ; une pomme de terre dont lta peau s'est fendillée au feu est dite tapë. - (16) |
| tape, soufflet reçu. - (16) |
| tape-à-l’eu (on) : tape-à-l’œil - (57) |
| tape-çarre. Coup mortel. Baillé le tape-çarre, c’est porter un coup mortel, donner le coup de la mort, de tape qui signifie coup, et de çarre, c’est-à-dire cendre, mot qui donne une idée de mort… - (01) |
| tape-cul : voiture à 2 roues. Hippomobile. - (62) |
| tapée - un tas, beaucoup. - En y en aivo ine tapée. - Ile emporto dan son devanté ine tapée de poires. - (18) |
| tapée (eune) : beaucoup, tas (un), quantité (une) - (48) |
| tapée (tournée) : un grand nombre - (51) |
| tapée : tas. Une tapée de monde : beaucoup de monde. - (52) |
| tapée : une quantité - (44) |
| tapée : tas. Une tapée de monde: beaucoup de monde. - (33) |
| tapée : n. f. Beaucoup de chose, d'objet ou de monde. - (53) |
| tapée, s. f. groupe nombreux : une tapée d'enfants. - (22) |
| tapée, s. f., grande quantité : « Eùne tapée d'monde ; eùne tapée d'poumes ; eùne tapée de livres. » - (14) |
| taper (se) (v.pr.) : se blottir, p.p. tapé (-e) = blotti (-e) - (50) |
| taper (se) : (vb) (en parlant d’un lièvre) gîter - (35) |
| taper (se) : gîter (lièvre) - (43) |
| taper (se). Se tapir. - (49) |
| taper v. Eclater, se fendre. - (63) |
| taper : v. n., éclater, se fendre. Ce verre de lampe a tapé. - (20) |
| taper, v. frapper. - (65) |
| taper, v. intr., faire du bruit, éclater. Ne pas confondre avec l'acception transitive du même verbe, et qui signifie donner des tapes : « L'as-tu entendu ? mon canon veint d'taper. » — « Còvre ben la càsse ; les dragées vont taper. » - (14) |
| taper. Nous donnons à ce verbe le sens de fendre, d'éclater. Les bonnes pommes de terre tapant quand an les fait queure ai l'étouffée. — Lai marmite ai tapé. - (13) |
| taper. v. n. Crever, en parlant d'une bête météorisée. (Etivey). - (10) |
| taperaie : silène (plante) - (48) |
| taperè : (tap'rê: - subst. m.) silène enflé; voir potè, potrê : Les enfants cueillent les fleurs en forme de petite bourse et tout en maintenant fermée l'extrémité de la corolle, ils font exploser le ventre de la fleur en la tapant contre l'autre main. - (45) |
| tapereai, s. m. digitale pourprée (digitalis purpurea) extrêmement commune dans le pays. - (08) |
| tapereau, taperiau (tap'riau) : s. m., vx f r. taperet, fessier. - (20) |
| taperéle, s. f., diminutif de taperiau, taperiau en petit. Le tube est formé d'une plume d'oie, ouverte aux deux bouts, et qui découpe ses tampons en se piquant dans une écorce de courge, une rondelle de rave ou de pommes de terre ; les coups partent de même. (V. Taperiau.) - (14) |
| taperiau (n.m.) : digitale (elle éclate "tape" lorsque l’on souffle dedans (aussi tapairt) - (50) |
| taperiau, et taprïau, s. m., instrument en bois de sureau, qui, pour sa confection, a de l'analogie avec la Jicleròte. Seulement, au lieu de servir à chasser de l'eau, il chasse avec explosion les tampons de filasse humide qu'on fixe à ses deux extrémités. Vient de taper (faire du bruit.) - (14) |
| taperiau, gâteau - (36) |
| taperiau, s. m. traquet, oiseau du genre des becfigues qui fait un bruit semblable à un tapement en agitant sa queue et ses ailes. - (08) |
| tapériau. s. m. Cheville. (Plessis-Saint-Jean). - (10) |
| tape-talon (A) : !oc., en frappant du talon. Se dit notamment au jeu de glissade. - (20) |
| tapète (familier), langue ; el é eune bonne tapète, il a une bonne langue qui lape bien, sans discrétion, sur qui que ce soit. - (16) |
| tapéte, s. f., petite tape. - (14) |
| tapette, s. f. langue babillarde. il y a un peu partout de ces « tapettes » là. - (08) |
| tapette. Babillard, bavard. Etym. analogie entre les mouvements de la langue du bavard, et ceux que produisent des coups tapes avec vitesse. - (12) |
| tapigner (v. tr.) : piétiner, fouler aux pieds - (64) |
| tapignon (n. m.) : se dit d'une pâtisserie de consistance épaisse et lourde à digérer - (64) |
| tapignons. n. m. pl. - Vieux chaussons. (Saint-Privé, selon M. Jossier) - (42) |
| tapignons. s. m. pl. Vieux chaussons. (Saint-Privé). - (10) |
| tapin. s. m. Soufflet, tape. (Armeau). Du latin alapa. - (10) |
| tapinaud : Gros, lourdaud, mangeur de pommes de terre. - (19) |
| tapinaude, s. f. grosse galette sur laquelle on met une couche de pommes de terre, d'épinards ou autres légumes du même genre. - (08) |
| tapine : (nf) topinambour - (35) |
| tapiné : Pied ou fanes de pomme de terre. « Breuler les tapinés » : brûler les fanes. - (19) |
| tapine : Pomme de terre. « Saclier des tapines » : sarcler des pommes de terre. - (19) |
| tapine n.f. Topinambour. - (63) |
| tapine : s. f. pomme de terre. - (21) |
| tapine : s. f., pomme de terre. Voir toplne. - (20) |
| tapine, s. f. galette commune fabriquée avec un mélange de farine et de pommes de terre. - (08) |
| tapine, s. f., pomme de terre : « O n'é pas déficile ; pou son diner ô n'mainge que des tapines. » - (14) |
| tapine, s.f. pomme de terre. - (38) |
| tapine, topine. Topinambour. - (49) |
| tapine, treuffe : pomme de terre. - (62) |
| tapiner : piétiner. - (52) |
| tapiner : taper à petits coups. (EDSEA. T II) - A - (25) |
| tapiner : piétiner sur place. Quand on o impatienté on tapine : quand on est impatient on piétine sur place. - (33) |
| tâpiner : piétiner - (39) |
| tapiner, piétiner - (36) |
| tapiner, tapigner. v. - Tourner un objet dans tous les sens. (Mézilles, selon H. Chéry). Autre sens : trépigner. (F.P. Chapat, p.186) - (42) |
| tapiner, v. a. toucher en pressant, tripoter, tenir dans ses mains avec vivacité et continuité. Ce terme signifie quelquefois trépigner en nivernais. - (08) |
| tapinte, souricière. - (26) |
| tapis (Les) : s. m., fabrique de sparterie bien connue à Mâcon. - (20) |
| tapoillai : glisser. So tapoillo la vou so trop mouillé : ça glisse là où c'est trop mouillé. - (33) |
| tapoir : batte à linge. - (66) |
| tapon (mettre en un). n. m. - Mettre en boule, en bouchon. - (42) |
| tapon (n.m.) : amas emmêlé, chiffonné - (50) |
| tapon : un tampon - (44) |
| tapon n.m. (du francique tappo, cheville). Trou de tonneau, bouchon de tonneau. En tapon : en bouchon. - (63) |
| tapon s. m. Mauvais gâteau fait d'une tapée de pâtée. (Argentenay). - (10) |
| tapon – un tas, comme tapée ; mais avec une nuance ; un tas mal fait de petites choses ; une poignée. - Ile n'a dière soigneuse ; dans les tiroirs de son airmoire en y é des tapons de fi, des tapons de piéces. - Ile se coiffe bein mau derré sai tête, ç'â in tapon de cheveux,… que ci fait rire. - (18) |
| tapon : 1 n. m. Agglomérat. - 2 n. m. Grumeau. - (53) |
| tapon : petit tas. Nuance : un peu tassé. Ex : "Aga ton gamin. Il a boun' idée à fée son tapon". - (58) |
| tapon : s. m., syn. de broche ; par extension, le trou de cannette, et même celui du c... - (20) |
| tapon, s. m. bonde longue. Verbe : tapouné et détapouné. - (22) |
| tapon, s. m. bonde longue. Verbes taponer et détaponer. - (24) |
| tapon, s. m., tas de terre ou de neige sous le sabot. - (40) |
| tapon, s. m., tas, tampon, poignée, bouchon : « Eùn tapon de fi ; eùn tapon d'cheveux ; eùn tapon d'étoupes. » Ce mot emporte toujours l'idée d'emmêlement. - (14) |
| tapon, s.m. motte de terre. - (38) |
| tapon, s: m., se dit de toute matière malléable réduite en boule. Ex. : un tapon de neige. - (11) |
| tapon, subst. masculin : amas de cheveux, de poils collés ou de résidus feutrés. - (54) |
| tapon, tas de linge ou d'objets mal en ordre... - (02) |
| taponner (v. int.) : barboter dans l'eau - (64) |
| taponnier, tapounier. s. m. Celui qui passe son temps à faire des taponnages, des ouvrages de peu d'importance. Mailly-la-Ville. – A Auxerre, on dit tapouniot. - (10) |
| taponnis, tapounis. s. m. Réunion d'objets de peu de valeur. – A Auxerre, petite galette faite à la hâte. Un tapounis de pâte. - (10) |
| taporniote : n. f. Mite. - (53) |
| tapoû - morceau de bois de forme plate dont les femmes se servent pour battre le linge en le lavant. – Vote tapoû â gros azille ; prôtez-moi le don. - Teins ! voiqui mon tapoû que s'en vai su l'aie ; aitraipe lu vite. – Les fonnes tapant de lai langue pu encore que de lô tapoû. - (18) |
| tapou (oū), .sm. battoir de laveuse. Voir rouillö. - (17) |
| tapoû : battoir de lavandière - (48) |
| tapou : battoir des laveuses. (S. T III) - D - (25) |
| tapou : battoir, palette de bois munie d'une poignée pour taper (essorer) le linge sur la pierre au lavoir. - (52) |
| tapou : (tapou - subst. m.) battoir, petite palette de bois en forme de pelle à four dont se servaient les laveuses pour extraire l'eau de leur linge, alors qu'elles étaient agenouillées dans la caisse à laver garnie de paille, au bord d' une mare, ou dans un bateau-lavoir aménagé. - (45) |
| tapoû : battoir à linge - (39) |
| tapou, s. m. palette de bois à manche avec lequel on bat le linge, battoir. En quelques lieux « tapois. » - (08) |
| tapoué : palette de bois avec une poignée pour taper (essorer) le linge sur la pierre au lavoir. - (33) |
| tapouéiller : tripotter dans l'eau - (48) |
| tapouillâ : méli-mélo - (39) |
| tapouilla, méli-mélo - (36) |
| tapouillâ, s. m. se dit d'une souillure, d'une grosse tache sur la table, sur une nappe, tache de sauce, d'huile, etc., répandues par maladresse. - (08) |
| tapouner (verbe) : tapoter. - (47) |
| tapouner : mettre en tas - (39) |
| tapouner, v. tr., fermer d'un bouchon, d'un tapon, arranger les cheveux en tapon. - (14) |
| tapounis, taponnis. n. m. - Ensemble d'objets sans valeur. - (42) |
| tapouter. v. - Tapoter. - (42) |
| tapoyer. v. n. Marcher dans la boue. (Massangy). - (10) |
| tappiner : fouler aux pieds - (60) |
| taprale, pistolet fait avec du bois de sureau. - (27) |
| tap'tchu (on) : tapecul - (57) |
| tapu (nom masculin) : battoir à linge. On dit aussi tapon. - (47) |
| taquai - serré, pressé. - Note pain n'â pâ réussi, ce co qui al â taquai. - Ses bas sont faits trop sarrai â sont préque taquai. - (18) |
| taque (nom féminin) : plaque en fonte qui recouvre le mur du fond de la cheminée. - (47) |
| taqué (p.p.) : mal levé (pain, gâteau) - (50) |
| taqué : mal cuit, mal levé, aplati, en parlant d'un pain. - (56) |
| taquè : mal levé, mal cuit, (pain, gâteau) - (48) |
| taque : plaque de cheminée. - (09) |
| taque : plaque du foyer - (48) |
| taqué : n. m. Mal cuit, gâteau mal levé en cuisine. - (53) |
| taqué, adjectif qualificatif : qui n'a pas levé. - (54) |
| taqué, e, adj. se dit principalement du pain dont la pâte est dense parce qu'elle a mal levé. Le pain «taqué » est comme battu, foulé. La même locution s'emploie en parlant d'une terre piétinée ou battue par de fortes averses de pluie. (voir : taquer.) - (08) |
| taqué, peu levé (en parlant d'un gâteau). - (27) |
| taque, s. f. plaque : la « taque » du feu. cette plaque en fonte est adossée à la muraille. - (08) |
| taque, sf. plaque de cheminée. - (17) |
| taque. s. f. Plaque de fonte. La taque de la cheminée. ISainpuits). - (10) |
| taquéchi, v. a. secouer longuement et avec un bruit agaçant. - (24) |
| taquée : pâte mal levée - (43) |
| taquegni, v. a. secouer, frapper, tirer, le tout à petits coups et mollement. - (22) |
| taquegni, v. a. secouer, frapper, tirer, le tout à petits coups et mollement. - (24) |
| taquelette, s. f. os de forme plate qui sert de castagnette aux enfants des campagnes. - (08) |
| taquenâ, s.m. boiteux qui taque du pied. - (38) |
| taquenailler, v, boiter, en frappant le sol du pied. - (38) |
| taquenâillou, s.m, bricoleur. - (38) |
| taquer : Claquer, péter, faire du bruit en frappant. « V'là la charetier, j'entends taquer san fouat ». - Jeter avec force. « Quâ ce qui sarve de se fare du mauvâ sang ? An se taquerait la tête cont' la meureille qu'an arait les gueumes de raste » : à quoi sert de se faire du mauvais sang ? On se jetterait la tête contre les murs qu'on aurait des bosses pour tout profit. - (19) |
| taquer le marmot, loc., avoir froid, et avoir peur. On voit que c'est autre chose que la locution française « croquer le marmot ». Cependant, comme forme, elle lui ressemble. Taquer voulant dire claquer, « taquer le marmot », c'est claquer des dents de froid ou de frayeur. - (14) |
| taquer, faire du bruit. - (05) |
| taquer, v. n. le tisserand « taque » sa toile lorsqu'il en prépare le tissu. Le mot a le sens de battre, fouler, tasser. Dans l'Yonne « taquer » les échalas de vigne c'est les enfoncer à coup de maillet. - (08) |
| taquer, v. tr. et intr., battre, fouler, tasser, claquer. Imite le bruit du tic-tac du moulin. - (14) |
| taquer. Ce mot est resté dans le langage des imprimeurs. Nos campagnards lui donnent la signification de tasser, d'aplatir. An ai trop marché su lai tarre quand il étot moyée : teut le cortil ast taqué. - (13) |
| taquer. Claquer, faire un bruit semblable au tic-tac d'un moulin. De la métaphore taquer sa langue , on a fait taco pour un bavard, et tacoter pour bavarder. On appelle tacote, une cliquette et la fleur nommée stellaria vulgaris. - (03) |
| taquer. Primitivement taquer a voulu dire chez nous d'une façon exclusive frapper le coup de métier qui serre chaque fil nouveau dans la toile, avec un bruit sec et spécial, tac ! L'origine du mot est donc une onomatopée. On a ensuite étendu son sens à d'autres actes qu'à celui du tisserand ; on dit assez volontiers taquer pour taper de quelque coup qu'il s'agisse, quand ils sont brefs et surtout dans le sens du foulage des étoffes. - (12) |
| taquer. v. a. Frapper. (Jussy). - (10) |
| taquer. v. a. Tisser ; par allusion à certaine opération du tissage. Quand les fils d'une toile, d'un tissu quelconque, ne sont pas assez serrés ou sont un peu lâches, on dit qu'ils n'ont pas été assez taqués. (Beugnon). - (10) |
| taquéssi ou traquéssi, v. a. secouer longuement et avec un bruit agaçant. - (22) |
| taqueuchi : Frapper à petits coups successifs. « T'as pas causu fini de taqueuchi ? ». « La grale a taqueuchi les denrées ». - (19) |
| taqueure, s. f. se dit de la toile qui a été « laquée » par le tisserand. - (08) |
| taqui : pas levé - (44) |
| taqui : Se dit d'une pâte qui ne s'est pas relevée à la cuisson. « Tan Jo n'était pas prou chaud, y est par cen que tan cac'eu est taqui ». - (19) |
| taqui, adj. se dit en parlant du pain lorsqu'il est sans trou ou à peu près ; il est alors peu digeste. - (38) |
| taqui, adj., épais, lourd. Se dit du pain qui n'a pas beaucoup de trous, mal levé : « J'ai migé du pain taqui ; ô n'vout point passer. » - (14) |
| taqui, taqué : (adj) (pain, pâte, gâteau) mal levé - (35) |
| taqui, taqué : adj., syn. de gasi. - (20) |
| taqui. Pâteux. Ex. : « du pain taqui ». - (49) |
| taquier : s. m., charpentier en bateaux. Voir fûtier. - (20) |
| taquin, contrariant, qui va toujours s' opposant dans les plus petites choses à ce que les autres désirent... - (02) |
| taquòt, adj., bavard. Vient de taquer, le bavard faisant, pour ainsi dire, claquer sa langue. - (14) |
| taquot, s. m. digitale pourprée - (08) |
| taquot. s. m. Marteau. (Irancy). - (10) |
| taquòte, s. f., petite tape, et aussi cliquette. Tout est bon aux gamins pour se façonner cet instrument : des bâtons fendus, des planchettes coupées, des os plats bien nettoyés, etc. Souvent ils se mettent par bandes et, le soir, exécutent des retraites pittoresques et furieusement rythmées. - (14) |
| taquòter, v. intr., bavarder, tapoter, faire claquer. - (14) |
| tar : s. f. terre. - (21) |
| târ, adv., tard : « Ol é v'nu su l’târ. » - (14) |
| târâ : un tarare (appareil servant à nettoyer les grains après le battage) - (46) |
| tarabate : tarabusteur - (51) |
| tarabâte n.f. (onom.). Casse-pieds. - (63) |
| tarabater : chercher un objet dans un fouillis. A - B - (41) |
| tarabater : chercher quelque chose au travers d'un désordre - (34) |
| tarabater : tarabuster - (51) |
| tarabâter v. Casser les pieds. - (63) |
| tarabater, feurâgni : chercher quelque chose au travers du désordre - (43) |
| tarabiscoté : déformé, façonné à l'excès. - (33) |
| tarabuster, v. ; ennuyer, inquiéter ; note Lili, al ost ben tarabusté. - (07) |
| taraillon, s.m. courtilière. - (38) |
| taralo, corbeille demi-sphérique. - (28) |
| tarare-pon-pon. Expression burlesque dont on se sert non seulement en Bourgogne, mais dans tout le royaume, pour donner à entendre qu’on ne croit point telle et telle chose. On dit pouë et pou-pouë à Dijon dans le même sens… - (01) |
| tararô, s. m., crible pour les grains. - (40) |
| taraudée. n. f. - Raclée, correction : « Elle n'était jamais contente quand elle n'avait pas eu sa taraudée de chaque jour. » (Colette, Claudine à Paris, p. 206) - (42) |
| tarauder : s'occuper avec des riens - (51) |
| tarauder, v. a. battre quelqu'un. - (08) |
| tarauder. v. - Corriger, battre. - (42) |
| tarbe - mot du vieux patois bourguignon, cité dans la préface de ce vocabulaire. Il signifie terrible. - (18) |
| tarbe, terrible ; abréviation du latin terribilis... - (02) |
| tarbe. Terrible, en bourguignon tarible, taribe et par syncope tarbe. - (01) |
| tarbe. : Terrible. Dérivation naturelle du latin terribilis. - Le mot tarbôlai, faire le terrible à l'égard de quelqu'un, secouer, tourmenter une personne, est aussi en usage. - (06) |
| tarbeûlè : agiter, secouer - è n'pouvô entré, è tarbeûlè lè pôtch, il ne pouvait entrer, il secouait la porte - (46) |
| tarbeulé : bousculé. - (66) |
| tarbeûlè : rouler vite (en voiture) - (46) |
| tarbeuler : secouer. (A. T II) - D - (25) |
| tarbeuler : tancer, malmener. - (32) |
| tarbeuler, bousculer. - (26) |
| tarbognot. s. m. Raiponce. (Armeau). - (10) |
| tarbôlai, secouer quelque chose avec bruit, faire le terrible. - (02) |
| tarbôlé, tarbeûlé ; faire un gros bruit en remuant fortement des objets. - (16) |
| tarbölé, vt. secouer violemment. Faire rouler. - (17) |
| tarbolée, s. f., grand nombre. - (40) |
| tarbôler, frapper fort contre une porte. - (27) |
| tarbotte : fuseau. - (32) |
| tarbouille et tarboille. Vouivre, serpent fantastique On trouve sur la commune de Savigny, près de la ferme de Borée, une excavation naturelle du roc qui porte le nom de tarboille... - (13) |
| tarbouiller, v. tr., troubler, tourmenter, secouer, bousculer quelqu'un. - (14) |
| tarboulè : v. t. Tarabuster. - (53) |
| tarbouler (se) : s'inquiéter, avoir des préoccupations. Ex : "Pour quion fée qu't'êt' tarboule coume ça ?" - (58) |
| târd, tâ adv. Tard. - (63) |
| tarder (a pas r') : bientôt, très bientôt. Ex : "J'vons avouée d'yau à pas r'tarder !" - (58) |
| taré : s. m. fossé, souvent plein d’eau. - (21) |
| tàre, s. f., terre, bien, sol à cultiver, le plus profond amour du paysan. Une bonne femme, veuve, s'en allait à tous les enterrements, et, s'approchant de la bière du défunt, disait à celui-ci : « Te vas vouér mon houme. Dis-li que j'nous portons ben, que j'nous compourtons ben, et seùrtout que j'faisons ben valouér ses târes. » - (14) |
| tareaû (on) : fossé - (57) |
| tareau (on) : ruisseau - (57) |
| tarebe, adj. terrible : « ç'ô eun p'tiô taribe. » - (08) |
| tarèche : terrine en terre cuite. B - (41) |
| tareche : terrine en terre cuite - (34) |
| tarèchon : s. m. petit tarès. - (21) |
| tarée. s. f. Quantité pressée, accumulée. - (10) |
| tareiller (v.t.) : 1) chercher dans la terre - 2) butter les pommes de terre - (50) |
| tarello : van. - (29) |
| Tarenne, Tareine (La). Petite rivière qui prend sa source dans le département de la Côte-d'Or, près de Saint-Léger-de-Fourches, et traverse les communes d'Alligny et de Moux pour aller se jeter dans l'Arroux. - (08) |
| tarer :râcler. - (21) |
| tarernacle : s. m., espèce de tabouret en bois, très résistant, sur lequel on applique le poulain quand on veut gerber. - (20) |
| tarès : s. f. pot où l'on met le lait. - (21) |
| taresse (nom féminin) : terrine, récipient de terre cuite. (Voir Terrasse.) - (47) |
| taresse, s. f. terrine, vase de poterie. - (08) |
| taressounée (nom féminin) : contenu d'une taresse. - (47) |
| taressounée, s. f. une pleine terrine, une terrine remplie jusqu'au bord. - (08) |
| tareûche, s. f., synon. de trape. (V. ce dernier mot.) - (14) |
| tareuche. Terrine, formé de tarre, comme le mot français de terre. - (03) |
| targe : s. f., bouclier de Jouteur. - (20) |
| tari*, s, m. grand pot à vin. - (22) |
| tariauder : porc, sanglier soulevant la terre avec leur groin - (34) |
| taribari (al), loc. amusement connu en français sous le nom de colin-maillard. - (08) |
| taribe, et tèribe, adj., terrible. - (14) |
| taricher, v., piétiner en long et en large. - (40) |
| tariére (na) - uvron (n') : tarière - (57) |
| tarin bofalou : terre légère, sans consistance. A - B - (41) |
| tarin d'bluge : terre alluviale calcaire. A - B - (41) |
| tarin d'bô : terre argilo-siliceuse acide d'ancienne forêt, peu fertile. A - B - (41) |
| tarin d'tcheule : terre très argileuse dont le sous-sol sert à faire de la brique. A - B - (41) |
| tarin, s. m., nez. - (40) |
| tarine, s. f., terrine, soupière. - (14) |
| tariôder : soulever la terre avec les cornes en parlant d'un taureau en colère. A - B - (41) |
| tarioner : pour un porc ou un sanglier, remuer la terre avec le groin (syn. rveuilli*). A - B - (41) |
| tarionner : remuer de la terre comme un taureau en colère - (43) |
| tarionner : remuer de la terre, comme un taureau en colère - (34) |
| tariôt : fossé généralement large, contrebas. Du bas latin terralium. A donné son nom à la Place des Terreaux. - (62) |
| tarleuche : Gros nœud formant pomme ou crosse à l'extrémité d'un bâton « An se sarve d'in bâtan à tarleuche quand an jue à la treue » - (19) |
| târme (on) : terme - (57) |
| tarme : Terme. « Sa vaiche est à tarme ». Ironiquement. « O li a vendu payé en trois tarmes, chéque fois ren ». - (19) |
| tarme. n. m. - Terme. - (42) |
| târô : le fossé - (46) |
| târô, fossé. - (16) |
| târoéyé, faire des fosses pour y planter de la vigne. - (16) |
| taròsse, s. f. plat de terre à laver la vaisselle. - (22) |
| taròt, s. m., gros robinet des foudres : « Ol ainme tant s'piquer l'naz, qu'ô s'couch'ròt su l'dos pou bouére au taròt. » - (14) |
| tarper : monter avec difficultés - (51) |
| tarpi, vt. ecraser, piétiner, aplatir. - (17) |
| tarpillé, vn. trépigner, s'impatienter. - (17) |
| tarpöre taupöre. sf. taupinière. - (17) |
| tarr... : voir terr... - (20) |
| tarra : Butter, terme d'agriculture. « Tarra des tapines ». - (19) |
| târrâ n.m. Chape de glaise sur un parquet de bois. - (63) |
| tarrailli : terrasser - (57) |
| tarraillou (on) : terrassier - (57) |
| tarrain : terrain - (43) |
| tarrain : Terrain « Le ban tarrain », la couche de terre arable « in feu tarrain » un terrain fort, un terrain argileux. A Mancey « Les tarrains roges ou ptiets tarrains » : terrains calcaires à couleur ocre. - (19) |
| tarrain. Terrain. - (49) |
| tarraire : Sorte de guêtre de toile, sans sous pied, que l'on met pour aller travailler dans les terres, d'où son nom. - (19) |
| tarrate : Courtillère, taupe-grillon. Dicton « In cavalier descend de san chevau pa tuer eune tarrate ». La courtillère est un insecte si nuisible que tout le monde est intéressé à la détruire. - (19) |
| târre (lai) : (la) terre - (37) |
| tarre (n.f.) : terre - (50) |
| târre (na) : terre - (57) |
| tarre : (nf) terre ; champ - (35) |
| tarre : terre - (51) |
| tarre : terre, terrain - (43) |
| târre : Terre. « Traveilli la tarre » : travailler la terre, être cultivateur « Eune bonne tarre » : un champ fertile. - (19) |
| târre de brîre n.f. Terre de bruyère. - (63) |
| tarre grasse : (nf) argile - (35) |
| tarre grasse : argile - (43) |
| târre grâsse n.f. Argile. - (63) |
| târre n.f. Terre. - (63) |
| târre queûte : terre cuite - (37) |
| tarre, s. f. terre. - (22) |
| tarre, s. f. terre. - (24) |
| tarre, s. f. terre. une grande partie du Morvan prononce «tarre» comme en bourgogne et dans quelques autres provinces. En quelques lieux « tiare. » - (08) |
| târre, s. f., terre. - (40) |
| tarré, s. m. terré, couche de terre argileuse et battue que les pauvres gens placent sur leurs greniers pour tenir lieu de carreaux ou de plancher. - (08) |
| tarre, s.f. terre : tarre foulotte, terre fine, friable comme de la poudre. - (38) |
| tarre, terre : terre - (48) |
| tarre, terre, - (05) |
| tarre. Terre ; c’est aussi l’adjectif tendre. En français, de la viande bien tendre, est en bourguignon de lai viande bé tarte, mais quoiqu’à Paris on dise du pain tendre, on dit à Dijon du pain frais, et non pas du pain tarre. - (01) |
| tarré. Tiendras, tiendra. - (01) |
| târreau : Terreau, compost, mélange de débris organiques et de terre utilisés comme engrais. - (19) |
| tarreau, n.m. fossé. - (65) |
| tarréche : Grand plat de terre pouvant aller au four. - (19) |
| târrèche n.f. Récipient en terre cuite. - (63) |
| tarrée, terrée, tarreau. Terreau, compost. - (49) |
| tarrer : (vb) binner - (35) |
| tarrer : butter des légumes - (43) |
| tarrer : terrer (les pommes de terre (treuffes)) - (51) |
| târrer v. Butter. - (63) |
| tarrére. Tarière. - (49) |
| tarresse, terrasse. Terrine. - (49) |
| tarrette, courtillière, taupe-grillon. - (05) |
| târreuse n.f. Buttoir. - (63) |
| tarri : (nm) terrier - (35) |
| tarriâ, s.m. fossé au bas d'une vigne où s'écoulent les eaux de pluie. - (38) |
| tarriat, s. m. piocheur acharné, remueur de terre. - (24) |
| tarriau : Fossé, endroit bourbeux. Vieille chanson : « J'en avais eune brave culotte. Qu'était de piau. Que j'avais trouée tote môle dans in tarriau ». - (19) |
| tarriau n.m. (vx.fr. terral, terreau, fossé). Fossé. - (63) |
| tarriau, s. m. fossé (du vieux français terrail). - (24) |
| tarriau, s. m. fossé. - (22) |
| tarriau, s. m., fossé de champ. - (40) |
| tarrib'illement : Adverbe, d'une manière terrible. - (19) |
| tarrib'lle : Terrible. « I fa in fra tarrib'lle ». « O n'est pas bien tarrib'lle ». - (19) |
| tarrier. Butter : amasser la terre au pied d'une plante. Ex. : « tarrier des pommes de terre ». - (49) |
| tarrin : (nm) terre, terrain - (35) |
| tarrioner : travailler la terre bricoler dans la terre (au jardin) - (51) |
| tarrioñner v. 1. Piocher. 2. Péj. Gratouiller sans efficacité. - (63) |
| tarrires*, s. f. guêtres de toile pour se garantir de la terre en piochant. - (22) |
| tarrires, s. f. guêtres de toile pour se garantir de la terre en piochant. - (24) |
| tarrœlli, v. n. piocher en creusant. - (22) |
| tarrœt’e, s. f. courtillière. - (22) |
| tarrœte, s. f. courtilière. - (24) |
| tarrœyi, v. n. piocher en creusant. - (24) |
| tarroux - meuré : terreux - (57) |
| târroux : Terreux, couvert de boue « Des sabeuts târroux ». « In cu târroux » : un ouvrier agricole. - (19) |
| tarrouze : charrue à deux versoirs, buttoir - (43) |
| tartabija, sm. bancal, mal bâti. - (17) |
| tartari : variété de blé noir. VI, p. 4-8 - (23) |
| tartari : sarrasin sauvage - (39) |
| tartari, s. m. sarrasin de tarlarie. le « tarlari » est très en vogue dans une partie de notre région parce qu'il produit plus que le sarrasin commun et redoute moins la gelée, son principal ennemi. Sa qualité est très inférieure, aussi le réserve-t-on aux volailles et aux porcs. - (08) |
| tartavéle, s. f., babillarde, femme qui jacasse toujours. - (14) |
| tartelée, s. f. rhinanthe glabre ou crête de coq. Celle des prés est appelée vulgairement herbe aux poux. - (08) |
| tarteri : rhinanthe crête-de-coq (plante) - (43) |
| tarteuch'e : s. f. pomme de terre. - (21) |
| tarteùfe, et tarteùfle, s. f., pomme de terre. - (14) |
| tartevalle, s.f. pie grièche. - (38) |
| tartevéle, s. f., crécelle. La tartevelle étant une partie de la trémie d'un moulin, on comprend l'analogie de l'application, comme on l'a comprise pour Rain-néte. (V. ce mot.) - (14) |
| tartevelle : (nf) épouvantail - (35) |
| tartevelle : s. f., vx fr. tartavelle, crécelle. - (20) |
| tartevelle, n.f. pie-grièche. - (65) |
| tartevelle, s. f. crécelle dont on se sert dans les villes du voisinage pour remplacer les cloches pendant les offices du Vendredi Saint. - (08) |
| tartevelle, tairtevelle, tartavelle (C.-d., Chal., Morv.).- Expression servant à désigner une personne bavarde. On dit : parler comme une tartevelle. La tartevelle on tartavelle était au moyen âge une crécelle dont on se sert encore dans quelques localités pour remplacer les cloches le jour du Vendredi-Saint. Littré dit que le mot peu usité de tartevelle désigne une partie de la trémie d'un moulin. Il est probable que cet instrument aura été ainsi dénommé en raison de l'analogie qui existe entre le bruit produit par lui et celui de la crécelle dont il s'agit. - (15) |
| tartevelle. s. f. Crécelle. - (10) |
| tartiboulotte, s. f., salsifis sauvage. - (11) |
| tartoilli : tâter - (51) |
| tartoïlli v. Tripoter, chatouiller, peloter. Voir aussi palpouilli. - (63) |
| tartoïllon n.m. Tarte aux fruits. - (63) |
| tartoufe, pomme de terre. - (16) |
| tartouffe (nom féminin) : pomme de terre. On dit aussi treuffe. - (47) |
| tartouffe : pomme de terre (treuffe) - (60) |
| tartouffe : voir truffe - (23) |
| tartouffe. Pomme de terre. Ce nom paraît être une importation d'Outre-Rhin : Les Allemands disent kartoffel Cependant M. Robert Mitchell le dérive de l'italien tartofalo, truffe... - (13) |
| tartouffes, s. f. pl., pommes de terre. - (40) |
| tartoufle (C.-d., Chal., B., Morv.), tartouillâ (Char.).- Pomme de terre ; du même mot vieux français (on disait aussi catroufle) qui s'est appliqué à la pomme de terre après avoir été donné à la truffe, à laquelle elle ressemble et qui est appelée cartofel en allemand, tartufo en italien. Truffe venant du lalin tubera, pluriel de tuber (d'où vient le français tubercule), tartufle traduisait l'expression terroe tuber (Ménage). Dans beaucoup d'endroits la pomme de terre est aussi appelée simplement treuffe, c'est-à-dire truffe. Dans d'autres localités, on l'appelle encore tapine. Est-ce pour topine, venant de topinambour ? Enfin, dans le Morvan, les pommes de terre sont des crompires. Ce mot, venant de l'allemand, est un reste des anciennes invasions, comme schloff, pour coucher, schnick ou chnaps, eau de vie, nix, etc. - (15) |
| tartouillar. Pâte avec tranche de fruits, cuite au four sur une feuille de chou. - (49) |
| tartouillat, tartoillat (n.m.) : tarte cuite sur une feuille de chou avec des morceaux de poires - (50) |
| tartouillat, tartouillon : s. m., gâteau de pâte à pain et de pommes coupées en morceaux ou d'autres fruits. Dans certains endroits on prononce merdouillat. Voir Caqueu. - (20) |
| tartouiller : tripoter, manipuler. A - B - (41) |
| tartouiller : manipuler - (44) |
| tartouiller. Faire de la tarte ou de la tourte. Par extension, cuisiner malproprement. Te me dégoutes en tartouillant quemant celai. A Saint-Quentin on dit touiller. - (13) |
| tartouiller. Fouiller, barbotter, patauger dans l'eau malpropre. Se dit pour mal laver le linge. - (49) |
| tartouiller. Tripoter maladroitement quelque chose, porter des mains malpropres sur des objets précieux, toucher avec affectation. Etym. Littré donne tartouiller dans le sens de faire de la mauvaise peinture;il en ignore l’étymologie. - (12) |
| tartouillet : tarte épaisse en pâte et en fruits. (C. T IV) - S&L - (25) |
| tartouilli : tripoter - (57) |
| tartouillon : petit tartouillet. (C. T IV) - S&L - (25) |
| tartou'yé, toucher souvent et longuement une personne ou une chose ; s'tartouyé, se toucher honteusement. - (16) |
| tartouyon, s. m. pâtisserie grossière, sorte de tarte. - (22) |
| tartoyé : crêpe (matefaim*) très épaisse contenant des cerises ou des fragments de poire (en B : tartoya). A - (41) |
| tartoyi : chatouiller. Jeu de mains. A - B - (41) |
| tartöyi : (vb) tripoter - (35) |
| tartoyi : chatouiller, jeu de mains - (43) |
| tarto-yi : travailler la pâte - (43) |
| tarto-yi : tripoter - (43) |
| tartöyon : (nm) sorte de clafoutis - (35) |
| tarto-yon : clafoutis rustique avec des pommes ou des poires, cuit sur des feuilles de chou dans le four à pain encore chaud - (43) |
| tartòyon, m. pâtisserie grossière, sorte de tarte. - (24) |
| tartre, s. m. s'emploie quelquefois mais rarement pour éminence de terrain comme le français tertre. - (08) |
| tartrie n.f. Rhinanthe des prairies sèches et peu pâturées. - (63) |
| tas (adj.pos.m. et f.pl.) : tes - (50) |
| tas (ai), loc. a tas, en masse, en grande quantité. - (08) |
| tas (être tout dans le même), locution verbale : ne pas être en forme. - (54) |
| tas de pierres. La prison. L'aspect des anciennes prisons, ou l’on ne voyait presque aucune fenêtre a l'extérieur, était assez celui d'un tas de pierres. - (12) |
| t'as, 2me pers. ind. prés, du v. avouer, tu as : « T’as donc ben du mau, que t'baules jòr et neùt ? » - (14) |
| tas, plur. de l'adj. poss. ton, ta. tes : « tas çans, tas mâïons », tes champs, tes maisons. - (08) |
| tasse : Coupe en argent à deux anses, que les époux achetaient en se mariant. - Voir à trempée. - (19) |
| tâsse. n. f. - Ensemble de rejets sur une souche. - (42) |
| tassée (tâssée) : s. f., vx fr., contenance d'une tasse à vin. Tiens, entre voir à la cave, j’ vas t’ payer un' tassée de vin blanc. - (20) |
| tasson : blaireau. - (29) |
| tâ-tâ - mot employé avec les petits enfants qu'on enlève dans ses bras. - Veins, mai petiote Lilie, veins que te peurnâ ai tâtâ !... Houp ! - I eume don mon petiot chéri de Gugusse !... Haut l'tatâ ! - (18) |
| tata, tête en l'air, irréfléchi, impulsif. - (27) |
| tatan (na) : tante - (57) |
| tatan*, s. f. manière plaisante de désigner une femme en parlant à un jeune enfant (v. chon-chon). - (22) |
| tatan, s. f. manière plaisante de désigner une femme en parlant à un jeune enfant (v. chonchon). - (24) |
| tatan, s. f., tante. Du Langage enfantin. - (14) |
| tatas. s. m. Pâtisserie grossière. (Plessis-Saint-Jean). - (10) |
| tate-me-le (tâte-me-le) : s. m., individu qui se mêle de ce qui ne le regarde pas. - (20) |
| tâter : palper avec insistance - (37) |
| tâter lai poule : se rendre compte avec un doigt si la poule va pondre dans la journée - (37) |
| tâter, v. a. goûter, manger ou boire en petite quantité pour essayer ou apprécier une chose ; je ne sais si le vin est bon, je n'en ai point « tâté. » - (08) |
| tatére : Viorne, viburnum lantana. « Eune rieute de tatére ». - (19) |
| tâteuné, tâtonner. - (16) |
| tateurron : monticule - (43) |
| tatevelle, étourdi, impulsif, voire dangereux (par ex., en parlant d'un cheval) ; mauvaise herbe dans les champs et les prés qui compromet les récoltes (melampyre). - (27) |
| tate-vin (tâte-vin) : s. m., pipette en fer-blanc ou en verre à l'aide de laquelle on puise du vin dans un fût par le trou de bonde. - (20) |
| tâte-vin : Petite tasse en argent dans laquelle on goûte le vin. Pipette en fer blanc ou en verre pour puiser une petite quantité de vin par le trou de bonde du tonneau - (19) |
| tati : mamelle. - (31) |
| tati, s. m., trayon de vache. - (40) |
| tatiller. v. - Chuchoter. (Saint-Martin-sur-Ouanne, selon M. Jossier) - (42) |
| tatiller. v. n. Bavarder en chuchotant. (Saint-Martin-sur-Ouanne). - (10) |
| tâtillon, s. m. celui qui s'occupe de minuties, qui se mêle de tout, qui touche à tout. - (08) |
| tâtillouner, v. n. s'occuper de minuties, aller et venir en touchant à tout. - (08) |
| tâtis : pis de vache, de chèvre - (37) |
| tâtis : seins de femme - (37) |
| tatoïlli v. (vx.fr. tastoillier) Chiffonner, tripoter. - (63) |
| tâtou : homme qui « tâte » un peu trop les femmes à chaque occasion - (37) |
| tatoue. s. f. GaItette. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| tatouillai - remuer dans l'eau en s'amusant, tortiller des choses dans l'eau. Dans le sens de Tairtoillai. Voyez ce mot. - Quoi que te tatouille don quemant cequi ? te te moille tote. - (18) |
| tatouillai, diminutif de tâter, palper ; en latin, le mot titillare signifie chatouiller... - (02) |
| tatouillai. : (Pat.), tatoilier(dial.). Du latin titillare. - (06) |
| tatouille : s. f., tripoteuse. - (20) |
| tatouille, s. f., tripotée, volée de coups de poings : « Gare ! si j'te r'trouve, j'te ficherai eùne tatouille. » - (14) |
| tatouiller : v. a., vx fr. tastoillier, chiffonner, tripoter. - (20) |
| tatouiller, v. tr., donner, flanquer, ficher une tatouille. (V. ce mot.) Veut dire aussi : chiffonner, souiller, tatillonner. - (14) |
| tatouiller. v. - Barboter, jouer dans l'eau. Autre sens : faire la vaisselle. Déformation de patouiller. - (42) |
| tatouiller. v. n. Faire des lavages de vaisselle, des tripotages de ménage et de cuisine. (Etais). - (10) |
| tatouilli v. Battre, corriger. - (63) |
| tatouilli, v. a. palper longuement. - (22) |
| tatouillis. n. m. - Lavage mal fait, se dit d'une vaisselle sale. - (42) |
| tatouillis. s. m. Cuisine malpropre et repoussante. (Etais). - (10) |
| tatouillon : s. m., tripoteur. - (20) |
| tatouillon. n. m. - Celui qui tatouille. - (42) |
| tatouillon. s. m. et f. Souillon, celui ou celle qui s'occupe du lavage de la vaisselle, des bas offices du ménage et de la cuisine. - (10) |
| tâtounner. v. - Tâtonner. - (42) |
| tatoux (tâtoux), tatouse : s. m. et f., tâleur, tâleuse. - (20) |
| tatòyi, v. a. palper longuement et malproprement. - (24) |
| tatr : s. f. tarte. - (21) |
| tatrée. s. f. Tartine (Armeau). - (10) |
| tatse : tache - (43) |
| tâtse n.f. Tâche, travail, ouvrage. Faut pas faire la tâtse d'vant d’faire le viau. Il faut faire les choses dans le bon ordre. - (63) |
| tatse n.f. Tache. - (63) |
| tatsi : tacher - (51) |
| tâtsi : tâcher - (51) |
| tatsi v. Tacher. - (63) |
| tâtsi v. Tâcher. - (63) |
| tattier : s. m., viorne mancienne (viburnum lantona). - (20) |
| tau, s. m. sauvageon, tige sur laquelle on greffe les bonnes espèces de fruits. - (08) |
| taublle, table. - (05) |
| taud, taudion : s. m., taudis, débarras. - (20) |
| taudion : tablier très usagé, malpropre. (S. T III) - D - (25) |
| taudion : taudis, une pièce en désordre - (46) |
| taudion, s. m. 1. Taudis étroit. — 2. Petite toupie, toton. - (22) |
| taudion, s. m. taudis étroit. - (24) |
| taudion, taudis. - (27) |
| tauger, v. n. marcher à grands pas, faire de grandes enjambées, sauter avec force. - (08) |
| tauillon : (tô:yon - subst. f.) il s'agit de la toison complète après la tonte ; elle comprenait les crottes qui, à la vente, augentent le poids. Les toisons étaient roulées, les crottes bien dissimulées à l' intérieur, ficelées et entreposées dans un endroit sec. - (45) |
| taule (n.f.) : 1) moule à tarte - 2) table (en anc. bourguignon, en morvandiau tabye) - (50) |
| taule : Jeune sarment, pampre, rameau de vigne. « Les taules sant déjà grandes ». - (19) |
| taule, s. f. pousse tendre de vigne (du latin thalla). - (24) |
| taule, s. f. pousse tendre de vigne. - (22) |
| taule, s. f. table. usité seulement dans une partie de la région. - (08) |
| taule, s. f., table. - (40) |
| taule, s. f., table. S'est mieux conservé que faule, et, quoique moins souvent, se dit encore concurremment avec tàbe. (V. ce dernier mot.) - (14) |
| taule, s.f. table. - (38) |
| taule. Table. - (03) |
| taule. Table. Je ne sache pas qu’on ait jamais dit taule ni tôle en français, quoique je me souvienne fort bien d'avoir lu tolée en burlesque, pour exprimer le nombre de personnes que tenait une table. - (01) |
| taule. Voiqui nos invités quairrivant, dépouache-tai de mette lai taule. Taula est le nom d'une planche, en patois du Midi. Au Moyen-âge on écrivait tauble. Le célèbre jugement dernier, de l'hôpital de Beaune, est ainsi désigné dans l'inventaire de 1501 « une tauble de plate peinture. » Du latin tabula qui a formé établi. - (13) |
| taule. : (Dial. et pat.), table. C'est la dérivation naturelle du latin tabula. - (06) |
| taulée, s. f., tablée, ensemble de convives réunis autour de la table, et aussi série de mets qu'on y a déposés : « Y étòt la fouére. Si vous éveins vu qué taulée !... Ah! mes aimis !... » - (14) |
| taulée, tablée ; du mot taule, table. - (02) |
| taulée. s. f. Volée de coups. (Mailly-la-Ville). - (10) |
| taulon (n.m.) : vase en terre pour mettre l'huile - (50) |
| taumeuro : légère éminence de terre ou de pierres, voire apportées. (RDM. T IV) - B - (25) |
| tauniai, tauniée - battre quelqu'un ; raclée. - Al l'é tauniai quemant qu'en faut ; â s'en souveinré. - R'quemance voué, si ne te tauniairai pâ ! - I l'i ai beillé ine taugnée pâ piquée des vers. - (18) |
| taupaissé : ombré par places. (S. T III) - D - (25) |
| taupâre, s. f., taupinière. - (40) |
| taupe : Taupe, talpa. « Prendre en taupe » : prendre par dessous, introduire l'extrémité d'un levier sous un fardeau pour le soulever. - (19) |
| taupe et tingue. : Onomatopée exprimant le choc des verres, comme celle de tipe-taupe signifie une volée de coups. - (06) |
| taupe, n.f. taupe, taupinière. - (65) |
| taupe, taupière : s. f., vx fr. taupière, taupinière ; monticule ou élévation de terre ; tas de grains formé après le battage pour être vanné ; petit bâtiment quelconque et spécialement, remise pour instruments agricoles. - (20) |
| taupe, taupire : taupinière - (43) |
| taupenire, s. f. taupinière. - (24) |
| tauper, taupigner. Battre quelqu’un De là taupée, et taupignée, rossée. Etym. inconnue. - (12) |
| tauper, tôper : attraper (quelqu'un), prendre - (48) |
| tauper. v. - Attraper : « S'il arrive à l'tauper, i' va p'téte ben s'en rappeler !». (Sougères-en-Puisaye) S'emploie également en français vulgaire dans le même sens. - (42) |
| taupére : Taupinière, tas ayant la forme d'une taupinière. « Ol a eune bonne taupére de blié su san gueurné ». - (19) |
| taupére. Tas, silo. « In-ne taupére de froment ». Désigne encore une taupinière. - (49) |
| taupére: tas de grain (sur le grenier) - (48) |
| taupette : bouteille de 37,5 cl - (48) |
| taupi : taupier - (51) |
| taupî n.m. Taupier. - (63) |
| taupi ou topé. : Quand les compagnons ouvriers se rencontrent, ils se disent : tope-là, en signe de confraternité, et ils se frappent dans les mains et se les étreignent. - (06) |
| taupi, s'associer à, consentir à, être de bon accord... - (02) |
| taupiée. n. f. - Taupinière. - (42) |
| taupière, s. f., monceau de grains. Analogie avec les monceaux de terre soulevés par les taupes. - (14) |
| taupière, s.f. taupinière. - (38) |
| taupière, tas de grains. - (05) |
| taupière. Pour taupinière. C’est plus court, aussi grammatical, et plus conforme à l'étymologie, talpa, taupe. - (12) |
| taupin. s. m. Noir comme une taupe. (Villiers-Saint-Benoît). - (10) |
| taupine (n.f.) : topinambour - (50) |
| taupine, s. f. topinambour. - (08) |
| taupine, s. f., abrév. de topinambour. On en voit fréquemment de petits champs ; mais ne se cultive que pour les bestiaux. - (14) |
| taupine. n. f. - Taupinière. - (42) |
| taupiner. v. - Trépigner. - (42) |
| taupiner. v. n. Frapper des pieds. (Sainpuits). - (10) |
| taupines : topinambours - (37) |
| taupîre (na) : taupinière - (57) |
| taupire : (nf) taupinière - (35) |
| taupire : tas provisoire de pommes de terre dans le champ - (34) |
| taupire : tas provisoire de pommes de terre dans le champ, avant d'être mises en cave ou en silo ou tas de blé dans la grange après le battage au fléau - (43) |
| taupîre n.f. 1. Taupinière. 2. Silo de pommes de terre provisoire, simple protection de feuillages ou de paille contre le verdissement. - (63) |
| taupire*, s. f. réduit pour le grain. - (22) |
| taupret n.m. Taupinière enherbée, fourmilière. - (63) |
| taur (n.m.) : treuil du char pour fixer le chargement avec une corde (aussi virot) - (50) |
| tauraille, taure. n. f. - Génisse. - (42) |
| tauraille. s. f. Génisse. (Ronchères). - (10) |
| taure (nom féminin) : jeune vache qui n'a pas vêlé. - (47) |
| taure : génisse - (61) |
| taure : génisse. - (66) |
| taure : petite vache. - (09) |
| taure : génisse. - (32) |
| taure : génisse. Ex : "Le Paul, il a de ben belles tores au pré !" (Orthographe conforme à la prononciation). - (58) |
| taure, s. f., jeune vache. - (40) |
| taure, taurie (n.f.) : vache qui n'a pas encore vêlé, génisse (aussi tourie) - (50) |
| taure, taurie, s. f. génisse, vache qui n'a pas encore vêlé. Le mot « taurie » s'applique souvent à une jeune vache tandis que « taure » ne désigne ordinairement qu'un veau femelle. - (08) |
| taureau (n.m.) : butte, colline - (50) |
| taurée : terreau, mélange de boue, de bouses de vache enlevé dans la cour de ferme. On meto la taurée dans les jardins : on mettait le terreau dans les jardins. - (33) |
| taurée : 1 n. m. Détritus. - 2 n. m. Terreau. - (53) |
| tauriau (n.m.) : taureau - (50) |
| tauriau (on) : taureau - (57) |
| tauriau : taureau. - (66) |
| tauriau, s. m., taureau. - (40) |
| taurie, tourie : s. f., génisse ; taure. - (20) |
| taurie. Jeune vache qui n'a pas encore viâlé. C’est le féminin de taureau. Le radical taur est celtique : il rappelle le tarvos trigarannos de l'autel des Nautes parisiens... Taurie a pour synonyme bourguignon : guichotte. Vins don mai petite taurie, vins, mai guichotte. Je pense que ce dernier mot vient de « guiche », corde ou lien qui sert à attacher le bétail ou à suspendre un objet. Cette expression est restée dans le langage héraldique : « un cornet ou cor de chasse d'argent enguiché de gueules. » - (13) |
| taurnâyer (v.t.) : tournoyer - (50) |
| taurnée (n.f.) : tournée - (50) |
| taurner (v.t.) : tourner - (50) |
| taurte (n.f.) : tourte - (50) |
| taut, taute (adj.-qual.,adv.) : tout, toute - (50) |
| tautsi : conduire les bœufs en criant - (43) |
| taûyon : toison, chevelure, femme sale - (39) |
| tauzau (adv.) : toujours - (50) |
| tavain - taon, grosse mouche. - Vé les bô, les tavains sont enraigés aipré les bétes. - Mets des brainches aipré les chevaux pour empouâchai in pecho les taivains. - (18) |
| tavain : (nm) taon - (35) |
| tavain, n.m. taon. - (65) |
| tavain, s. m., mouche plate, taon, - (40) |
| tavain, s.m. taon. - (38) |
| tavain, taon. - (05) |
| tavain, tava’ : taon. Du latin tabanus. - (62) |
| tavale, s.f. sapine de vin à la disposition, au temps des vendanges, des tireurs de cuve et pressureurs. - (38) |
| tavan : s. m taon. - (21) |
| tavan, s. m. taon (du latin tabanus). - (24) |
| tavan, tavain : s. m., Iat. tabanus, taon. - (20) |
| tavanaise : tévulsif à odeur de crésyl, appliqué sur les animaux de trait, pour éloignés les taons (tavains ou tavas). - (62) |
| tavane. Taverne, cabaret… - (01) |
| tavaser (verbe) : faire semblant de travailler. - (47) |
| tavaser : Taquiner, tracasser. « Ne vins pas me tavasser ». - Faire mal. « J'a eune dent que me tavasse ». - (19) |
| tavein, s. m. taon. - (22) |
| tavelé, ée. Marqué de la petite vérole. (Soucy). - (10) |
| tavelle : gros bâton. A - B - (41) |
| tavelle (n.f.) : 1) gros morceau de bois, gourdin - 2) levier qui sert à faire tourner le treuil du char - (50) |
| tavelle : (nf) trique - (35) |
| tavelle : barre pour tourner le treuil du chariot - (48) |
| tavelle : gros bâton - (34) |
| tavelle : gros bâton - (44) |
| tavelle : trique - (43) |
| tavelle : cheville qui aide à serrer. - (33) |
| tavelle n.f. (du lat. tabellam, planche). Bâton, trique. - (63) |
| tavelle : s. f., vx fr., bâton, trique. - (20) |
| tavelle. Gros gourdin. - (49) |
| tavelle. s . f. Tache de rousseur, de petite vérole. (Vertilly). - (10) |
| tavèn, taon. - (16) |
| tavin : taon. A - B - (41) |
| tavin (on) : taon - (57) |
| tavin : taon - (43) |
| tavin : taon - (48) |
| tavin : taon. - (66) |
| tavin : Taon. « Ol a mis des fringes à ses bus pa viri les tavins ». « Ol est si maléde que la premére môche que va le piquer pourrait bin être in tavin » : il est si malade que la première crise pourrait bien être fatale. - (19) |
| tavin : un taon - (44) |
| tavin : mouche, taon, insecte piquant bovins et chevaux par forte chaleur. L'été les tavins piquont : l'été les taons piquent. - (33) |
| tavin n.m. (du lat. tabanum, le taon). Taon. - (63) |
| tavin, s. m., taon, grosse mouche. - (14) |
| tavin, s.m. taon. - (38) |
| tavin, subst. masculin : taon. - (54) |
| tavin. Nom patois de la mouche appelée taon. - (13) |
| tavin. Taon, grosse mouche diptère, de la famille des tabaniens. Etym. vieux français tavan, grosse mouche, tavaner, bourdonner. - (12) |
| tavin. Taon. - (03) |
| tavin. Taon. - (49) |
| taviner, v., sauter d'un pied sur l'autre, en les flaques d'eau. - (40) |
| tayer (se), se taire - (36) |
| tayi : v. tailler. - (21) |
| tazouner (verbe) : perdre son temps à des travaux inutiles. - (47) |
| t'cer, v. a. toucher, frapper, battre : « n' l' téce pâ », ne le frappe pas. - (08) |
| tchâ ! : interjection utilisée pour faire avancer les bœufs - (39) |
| tchâffer : manger avec bruit - (39) |
| t'chale ! Cri pour arrêter les bœufs au travail. - (49) |
| tchâler : exciter les bœufs de l'aiguillon. - (52) |
| tchâler : faire avancer les bœufs - (39) |
| tchamoure : flanc de courge. - B - (41) |
| tchamoure : flan de potiron - (51) |
| tchamoure n.m. (or. inc.). Flan de courge. - (63) |
| tchan : timon. A - B - (41) |
| tchan fortsu : timon fourchu reliant le dzeu* au tchan* de tsardzu*. A - B - (41) |
| tchantchau (tortire) (torti) : stockage du pain sur deux barres de bois pendues au plafond - (51) |
| tchantchau : pain avant d'être divisé - (34) |
| tchantchau n.m. Gros morceau de pain. - (63) |
| tchantcho : pain entier, avant qu'il ne soit divisé. A - B - (41) |
| tcha-tcha : petite buse - (39) |
| tchatchas : 1 n. m. Étournaux. - 2 n. f. Grive. - (53) |
| tchatche (la) : verve - (57) |
| tchatre : scène de théâtre faite de planches montées sur des tonneaux ou des plateaux. A - B - (41) |
| tchâtre : planches montées sur des plateaux, tonneaux pouvant servir de théâtre - (34) |
| tchâtre n.m. Théâtre. - (63) |
| tchau : chevron, petite pièce de bois de moindre valeur - (34) |
| tchaû : - (39) |
| t'chau, tiau. Grosse bûche de bois, morceau de tronc. Tibia ; on dit : « le t'chau de la jambe ». - (49) |
| tchau, tige - (36) |
| tchaulè, tiaulè : v. t. Battre quelqu'un. - (53) |
| tchaulée, tiaulée : n. f. Volée de coups. - (53) |
| tchauler : conduire les bœufs en criant - (34) |
| tchauler v. Encourager les bêtes de la voix, les appeler. Il était fréquent d'appeler les vaches avec un "tché, tché, tchaû" et les cochons avec un "gouri, gouri, tchaû". - (63) |
| tchauleux n.m. (de l'excl. tché, tché) Conducteur de bœufs. - (63) |
| tchéé, tchéé excl. Cri d'appel des vaches. - (63) |
| tcheinde : teindre - (51) |
| tcheinde v. Teindre. - (63) |
| tcheindre : teinter - (57) |
| tchèl : tuile. (LCSS. T IV) - S&L - (25) |
| tchéqu'coup : quelquefois - (57) |
| tchéque : quelque - (57) |
| tchéquon : quelqu'un - (57) |
| tchéqu'un, e. pron. indéf- Quelqu'un, quelqu'une. - (42) |
| tché-tché : expression utilisée pour appeler les bovins. A - B - (41) |
| tché-tché : exclamation servant à appeler un troupeau de bovins - (34) |
| tcheû (du) : cuir - (57) |
| tcheû (on) : cœur - (57) |
| tcheu : cuit - (57) |
| tcheuche : souche sans les racines. - (30) |
| tcheule : tuile (en B : teulon*). A - (41) |
| tcheule (na) : tuile - (57) |
| tcheule n.f. Tuile. - (63) |
| tcheule : n. f. Tuile de toiture. - (53) |
| t'cheule. Tuile. - (49) |
| t'cheuler. Tuiler. - (49) |
| t'cheulerie. Tuilerie. - (49) |
| tcheulon n.m. Morceau de tuile. - (63) |
| tcheul'rie (na) : tuilerie - (57) |
| tcheume (d'la) : mousse - (57) |
| tcheumer : mousser - (57) |
| tcheure (na) : cure (presbytère) - (57) |
| tcheure (na) : presbytère - (57) |
| tcheuré (on) : curé - (57) |
| tcheûre : cuire - (57) |
| tcheurieû (on) - tcheuriou (on) : curieux - (57) |
| tcheuriosité (na) : curiosité - (57) |
| tcheûsse (na) : cuisse - (57) |
| tcheûsson (na) : cuisson - (57) |
| tcheute (na) : cuite (cuisson de l'alambic) - (57) |
| tchevertine : clématite (appréciée des chèvres). A - B - (41) |
| tchevre : chèvre (en B : tsèvre). A - (41) |
| tchi : mot utilisé pour activer ou démarrer un attelage de bœufs. A - B - (41) |
| tchi : exclamation pour activer ou démarrer un attelage de bœufs - (34) |
| tchiaiffer : faire du bruit avec ses mâchoires en mangeant - (37) |
| tchiarcelet : n. m. Tercelet. - (53) |
| tchiâre, tiâre : n. f. Terre. - (53) |
| tchia–tchia (on) – étourniau (n’) : étourneau - (57) |
| tchiau, tiau : 1 n. m. Mauvais outil. - 2 n. m. Ouvrier incapable. - (53) |
| t'chie ! Cri pour exciter les bœufs au travail. - (49) |
| tchiéter - quéter - fére la quéte : quêter - (57) |
| t'chin. (Fém. T'chenne). Tien, tienne. Expression locale : « à la t'chenne mon vieux » pour à ta santé, à la tienne ! - (49) |
| tchintre : partie de champ se labourant dans le sens de la largeur. Pâture. A - B - (41) |
| tchinzaîn-ne (na) : quinzaine - (57) |
| tchinze : quinze - (57) |
| tchio (avoir du). n. m. - De la force, du courage : « Eh Daniel ! Vins don' bouère un canon, ça va t'dounner du tchio ! » ( Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| tchiri, subst. masculin : moineau. - (54) |
| t'chiri. Moineau. - (49) |
| tchirik : n. m. Moineau. - (53) |
| tchi-tchou excl. Cette exclamation était proférée par l'animateur des danses pour inciter les cavaliers à embrasser leurs cavalières et réciproquement. - (63) |
| tchmou : timon d'attelage à vache - (51) |
| tchô : chevron, petite pièce de bois de faible valeur. A - B - (41) |
| tchôler : conduire des bœufs en criant. A - B - (41) |
| tchon : timon d'attelage à vache - (51) |
| tchon n.m. Timon. On dit aussi tmon. - (63) |
| t'chon. Timon : « le t'chon du char ». Se dit aussi d'une sorte de petit timon, employé pour atteler plusieurs paires de bœufs, les uns derrière les autres. - (49) |
| tchoquer v. Cogner, heurter. - (63) |
| tchouauler : chanter en labourant - (39) |
| tchoubel : un oiseau - (44) |
| tchouenne (na) : couenne - (57) |
| tchouer le feu : éteindre le feu - (44) |
| tchouillou (on) : tueur - (57) |
| tchouiner - tchouin-ner – tchouner : couiner (pleurnicher) - (57) |
| tchouîn-ner : grincer (manque d'huile) - (57) |
| tchoûlle : branche de noisetier - (39) |
| tchoûller : verbe utilisé pour parler du cri de la buse - (39) |
| tchu (n.m.) : cul - (50) |
| tchu (on) : cul - (57) |
| tchû : qui - (57) |
| tchu : tuer - (51) |
| tchu : cul - (39) |
| tchuâ – coûvri : couvert (temps) - (57) |
| tchua (na) : queue - (57) |
| tchua de pouaisson (na) : queue de poisson - (57) |
| tchua-de-pouâ (na) : queue-de-cochon - (57) |
| tchuai d'ratte (na) - tchua d'ratte (on) : prêle - (57) |
| tchuaini (on) : cognassier - (57) |
| tchuaissi – uver : couver - (57) |
| tchuaissia (na) - couvia (na) : couvée - (57) |
| tchuan (on) : coin (instrument métallique) - (57) |
| tchuang (on) : coing - (57) |
| tchu-bianc (on) : cul-blanc - (57) |
| tchu-d’sac (on) : cul-de-sac - (57) |
| tchu-d'bouteille (on) : dessous-de-bouteille - (57) |
| tchuè : tuer - (46) |
| tchuè : v. t. Tuer. - (53) |
| tchuer : tuer - (37) |
| tchuer : tuer - (57) |
| tchuer lai lampe : éteindre en la soufflant la flamme de la bougie ou de la lampe à pétrole - (37) |
| tchuer : tuer - (39) |
| tchuer. v. - Tuer. - (42) |
| tchuiner- tchouin-ner : couiner (grincer) - (57) |
| tchuissot (on) - tcheussot (on) : cuissot - cuisseau - (57) |
| tchul. n. m. - Cul. - (42) |
| tchulot (du - on) : culot - (57) |
| tchulotte (na) : culotte - (57) |
| tchulotte (na) : pantalon - (57) |
| tchulotté : culotté - (57) |
| tchulotte. n. f. - Culotte. - (42) |
| tchupassiau (on) : culbute - (57) |
| té ! interject., tiens ! Marque l'étonnement, l'ironie. - (14) |
| té (n. m.) : petit local où l'on élève les volailles, les lapins, les porcs (l'té aux poules) - (64) |
| té (n.m.) : toit ; porcherie, écurie des porcs - (50) |
| té (n.m.) : salamandre (aussi ta) - (50) |
| te : tu - (43) |
| te : tu - (51) |
| te : Tu. « Qu'est-ce que te dis? ». - Toi. « Camarade, sauve te ». - Te. « Te vas te fare mouilli ». - (19) |
| té, int. tiens. Voir tenin. Té, lé chaie, formule pour appeler un chat. - (17) |
| te, lu, toi : t'ë, tu es ; t'é, tu as. - (16) |
| té, pr. des deux genres. tel. Té que, tel quel. - (17) |
| te, pron. person., tu, toi : « Te m'fais droguer, te m'fais gémî. » — « Dépôche-te ; sauve-te. » - (14) |
| té, s. m. galle, protubérance qui se forme quelquefois sur le dos ou les reins du bétail à cornes, surtout dans la jeunesse. - (08) |
| té, s. m. salamandre terrestre assez commune dans les lieux humides : méchant, comme un « té », c'est-à-dire très méchant, est un des dictons du pays. « ta » - (08) |
| te, t' pron. Tu. T'vins-ti o te réste ? - (63) |
| te, t’, teu : tu (pr.pers. de la 2ème pers, du singulier) - (50) |
| te, té. pron. pers. - Tu : « Te l'as-ti ben r'gardé ? Te vas pas y r'véni' !' » - (42) |
| t'é. T'a. Ai té vu, il t'a vu. - (01) |
| té. Tes, pluriel du pronom ton ou ta. On met té devant une consonne, tés devant une voyelle, té pairan, tes parents, tés anfan, tes enfants ; té est aussi le mot dont on use quand on donne quelque chose à un inférieur, comme si on lui disait tén, impératif bourguignon de tenir. On s'en sert de même pour appeler un chien… - (01) |
| te: tu - (48) |
| tèb[y]e : table. - (52) |
| tébé, s. m. tabac aux environ de Château-Chinon, à Montigny-sur-Canne notamment. - (08) |
| tébétiére, s. f. tabatière, boite à tabac. - (08) |
| tebeut : s. m., chicot (d'un arbre, d'un arbuste, etc.). Voir tancot. - (20) |
| tébié, s. m. tablier. - (08) |
| téboué, adj. surpris, étonné. n’est guère usité que dans cette locution : « i n’ seu pâ téboué de c’qui », supposant toujours que la personne surprise a des motifs pour ne pas s'étonner outre mesure. - (08) |
| tec, s. m. toit, étable, écurie. le « tec » est particulièrement le logis des porcs. - (08) |
| tecé, tcé, vn. téter. - (17) |
| téchan : Blaireau. « Eune beurne de téchan » : un terrier de blaireau. - Partie d'un pressoir à grand point qui assure la base de la vis, ce sont deux énormes blocs de pierre fichés dans le soi. - (19) |
| tèchant : s. m. blaireau, grosse cale de pressoir. - (21) |
| tèche : une tache - (46) |
| téche : (téch' - subst. f.) meule de gerbes entassées dans la grange. - (45) |
| téche, sf. tache. - (17) |
| tèche, tache ; tèché, tacher ; é gnè pa d'tèche suz eù, il n'y a rien à leur reprocher. - (16) |
| técherand (n.m.) : tisserand - (50) |
| técheure, s. f. tissage, action de tisser la toile. - (08) |
| téchi, v. a. tacher. - (22) |
| téchœ, s. m. salamandre (à peau «tachée »). - (22) |
| têchon : blaireau (grec : taxo). - (32) |
| téchon : blaireau, animal vivant dans un terrier et ne sortant que la nuit. - (33) |
| téchon : blaireau - (39) |
| téchon, têchon. s . m. Petite terrine. (Soucy, St-Maurice-aux-Riches-Hommes). - (10) |
| tèchou : le bon tèchou est celui qui empile bien les gerbes, qui "tisse" la meule. - (45) |
| tèchti, ie, adj. tacheté, ée. - (17) |
| téchu, s. m. tissu, étoffe fabriquée par le tisserand. - (08) |
| téchus (n.m.) : tissus - (50) |
| tecq ou tect. Toit à porcs, du latin tectum. - (03) |
| tecq, toit à porcs. V. souë. - (05) |
| tecq-à-porcs, et tect, s. m., réduit où l'on fourre les pourceaux. - (14) |
| tect : étable, porcherie. II, p. 11-12 - (23) |
| téébale : n. f. Timbale. - (53) |
| téét', : n. f. Tête, voir Bobêchon. - (53) |
| tégnou : (tégnou - adj.) mal peigné, désigne un individu aux cheveux longs et sales, comme si la teigne s'y était installée. - (45) |
| tégot. s. m. Ecuelle fêlée. (Armeau). - (10) |
| téhia. s . m. Taureau. (Ménades). — A Saint-Germain-des-Champs, terria. - (10) |
| tei. Tels, tel, telles, telle. - (01) |
| teiche, s. f., tache, salissure. - (14) |
| teiche, tiche, tisse, s. f. gerbier, meule de gerbes entassées dans la grange, monceau qu'on construit avec plus ou moins d'industrie en empilant les gerbes les unes sur les autres. - (08) |
| teiche. Tache, taches, substantif féminin. - (01) |
| teicheran, s. f. tisserand, celui qui tisse la toile. - (08) |
| teigne : s. f., personne désagréable et méchante. - (20) |
| teignoux : qui a mauvais caractère, méchant - (37) |
| teigxoux, teignouse : adj., teigneux, teigneuse. - (20) |
| teil, tilleul, teillot. - (04) |
| teillai : enlever l'écorce, le filament du chanvre après qu'il ait été aigé, prendre le miel d'une ruche. - (33) |
| teille : Impôt. « Je vins de payer ma teille ». Peu usité. - (19) |
| teillè : v. t. Tailler. - (53) |
| teille, stature. - (05) |
| teille, taille, impôt. - (05) |
| teiller (v.t.) : 1) séparer la filasse de la chènevotte - 2) tailler - (50) |
| teiller et tiller le chanvre, séparer l'écorce textile de la partie ligneuse appelée chenevotte. Depuis quarante ans,on ne teille plus dans les environs de Beaune, car on ne sème plus de chenevière. - (13) |
| teiller : enlever l'écorce du chanvre - (39) |
| teiller, v. a. tiller, séparer la filasse de la chènevotte. « tailler. » Ces veillées de teillage au coin du feu ne sont pas des écoles de morale. - (08) |
| teillerie, s. f. assemblée de femmes qui tillent le chanvre, réunion de « teilleuses. » - (08) |
| teilles, s. f. plur. tailles, impositions de toute nature. - (08) |
| teilli : Tailler. « Teilli eune boucheure ». Pour la vigne voir sarper. - (19) |
| teillis : Taillis « I est défendu d'aller en champ dans les teillis ». - (19) |
| teillon, 1. s. m. tranche de viande. — 2. s. m. pl. filasse de chanvre grossière. - (22) |
| teillons, s. m. pl. filasse de chanvre grossière. - (24) |
| teillot, tilleul - (36) |
| teillotte, s. f. action de teiller le chanvre et, par extension, la soirée, la veillée où l'on teille. Le tillage du chanvre est dans nos campagnes un divertissement nocturne plutôt qu'un travail. - (08) |
| teillou, ouse, s. teilleur, celui qui tille ou teille le chanvre. - (08) |
| tein, s. m. temps : le tein est à la pluie. Ciel : le tein est tout bleu. - (22) |
| teinde, v. tr., teindre, imbiber d'une couleur. - (14) |
| teindeux. n. m. - Teinturier. - (42) |
| teindeux. s. m. Teinturier. — Fait, au féminin, teindeuse. - (10) |
| teindu, part, de teinde, teint. - (14) |
| teindu, teinduse : part, pass., teint, teinte. - (20) |
| teinne ! (y otl’) : (c’est le) tien ! - (37) |
| teins, teinrez, teinrâ, teinro - divers temps du verbe tenir. - Moi, i teinrâ bein cequi, ailé. - Ci ne teinro pâ, aitaichez don mieux. - En fauro qu'à teneussaint cequi entre z-ô trouas. - (18) |
| teinteurer : teinter - (43) |
| tèje de Biane : un attardé de Biarne - (46) |
| tel : exprime une forte ressemblance - (61) |
| tèle, s. f., toile, de lin ou de chanvre. - (14) |
| télégraphe, téléphone : s. m., fil de fer tendu en travers d'une cour et le long duquel peut glisser la chaîne d'un chien de garde pour lui permettre de parcourir la cour sans toutefois en sortir. - (20) |
| tèli : s. m. crochet auquel on attache le seau pour puiser de l'eau. - (21) |
| tellière : s. f., vx fr. tellère, nom ancien d'une pièce du pressoir à grand point, paraissant être le plot qui repose sur la semelle et soutient le banc (voir pressoir). - (20) |
| tel'men : adv. Tellement - (53) |
| téméraire (téméröre ?), adj. menaçant. Vache téméraire : qui regarde les passants d'un air farouche. - (17) |
| téméraire : adj., hautain, cassant, autoritaire. - (20) |
| témoin : s. m., petite branche qu'on épargne quand on tond un arbre. - (20) |
| témoingnaige,s.m. témoignage, déposition d'un témoin : « a n'é pâ v'lu beiller son témoingnaige », il n'a pas voulu déposer devant le juge. - (08) |
| temone, s. f crochet de bois servant à atteler les bovins à la charrue. - (24) |
| témouaigni : témoigner - (57) |
| témouègnaige : témoignage - (48) |
| témouègnaize : témoignage - (39) |
| témouègner : témoigner - (48) |
| temple, s. f. tempe comme en vieux français. - (08) |
| temple, s. f., tempe : « L'mauvâ drôle ! ô m'a fichu eùne beûgne sur la temple. » - (14) |
| temps (dans le) (loc.adv.) : autrefois - (50) |
| temps (le) : ciel - (57) |
| temps : ciel. - (29) |
| temps : Temps. « Le temps me deure » : le temps me paraît long. - Le ciel. « Le temps se nargit » : le temps est fin. - « Dans nin temps » autrefois. - (19) |
| temps me dure (le) : s'ennuyer (dans le sens : cela n'en finit pas). Ex : "L'hiver... eh qué l'temps m'dure !" ou Ex : "Quand ma fille vint pas m'vouée, l'temps m'dure !" - (58) |
| temps : s. m., ciel (le Paradis). - (20) |
| temps : s. m., temps vécu, âgé. Combien de temps avez-vous ? - (20) |
| temps, s. m. air, ciel, horizon, saison, etc. - (08) |
| tempsdurement : ennui - (61) |
| tem'ria, tunbria, sm. petit tombereau. - (17) |
| tenan. Tenant. - (01) |
| tenant (à) : Locution, d'une manière continue. « Traveilli à tenant » : travailler sans désemparer. - (19) |
| tenant (à), loc. d'une manière assidue et continue : travailler à tenant. - (24) |
| tenant (a), loc. d'une manière rapide et assidue travailler à tenant. - (22) |
| tènbale, vase en fer-blanc, avec anse, fermé d'un couvercle, dans lequel la vigneronne porte la soupe, aux vignes, à son mari. - (16) |
| tende v. Tendre. - (63) |
| tendeument. Ennui, mélancolie. On dit le temps me « deue » pour le temps me dure, me parait long. - (08) |
| tendeure n.m. (contraction de le temps me dure) Ennui, mélancolie. - (63) |
| tendiole, s. f. panier long dont on se sert pour décharger les pommes de terre. - (08) |
| tendon : arrête-bœuf. (RDM. T IV) - C - (25) |
| tendon : plante épineuse (bugrane), encore appelée arrête-bœuf - (48) |
| tendon : plante épineuse : arrête bœuf. - (33) |
| tendou : (nm) chargeur du char - (35) |
| tendou : chargeur du char - (43) |
| tendou, ouse, s. celui qui tend des pièges : un « tendon » de pièges, c’est à dire un braconnier qui possède l'art de prendre le gibier avec des lacets ou autres engins. - (08) |
| tendous de t'svallons : tendeurs de gerbes - (43) |
| tendron (n.m.) : bugrane (ou arrête-boeuf) - (50) |
| tendron (tindron) : s. m., scion de canne à pêche. - (20) |
| tendron, n.m. bugrane. - (65) |
| tendron, s. m., bugrane, arrête-bœuf, plante à la tige épineuse, et dont la racine, longue parfois de 50 centimètres, est un obstacle à la charrue et en même temps un objet de gourmandise pour les gamins. - (14) |
| tendron. Adonis, arrête-bœuf, bugrane : plante épineuse à fleurs bleues (Onomis fructosa). - (49) |
| tendrons, s. m. ne s'employant qu'au pluriel et désignant certaines plantes à racines profondes qui nuisent à la culture des champs. - (11) |
| tendue : s. f., vx fr., banne de devanture de magasin. - (20) |
| tendue, s. f. cloison en briques qui forme les compartiments d'une habitation. Cette chambre est trop grande, on y fera une « tendue. » - (08) |
| tendue, s. f., grande et grosse toile, que l'on tend pour certains usages : tente devant une boutique, bâche sur une voiture, etc. Pour la lessive, c'est la pièce de toile qui reçoit les cendres, et qu'en Champagne on appelle le sadri. - (14) |
| tendue. Banne, tente (pour garantir un magasin du soleil). - (49) |
| tendue. Cloison légère dans l’intérieur des maisons, plus particulièrement cloison en briques. Etym. tendere, développer, étendre un voile, un rideau, un mur. - (12) |
| tenduré, sm. ennui. - (17) |
| tendurou, ouse, adj. ennuyé, mélancolique. - (17) |
| tène, pr. poss. tien, tienne. - (17) |
| teneau, tenot. s . m. Petit cuvier. - (10) |
| tenebricosa, autrement dite « crache-sang ». - (45) |
| teneille : Tenaille. - (19) |
| tèner : être essoufflé, oppressé - (39) |
| teni (v.t.) : tenir - (50) |
| teni : Tenir. « Veux-tu bin te teni tranquille ! ». - (19) |
| tenî, ett'nî, v. tr., tenir, garder. - (14) |
| teni, t'ni,v. a. tenir avec diverses acceptions étrangères au français. — être maître de — posséder, jouir de etc.. - (08) |
| tenir (Se) : v. r., se traiter, se soigner. Ils se tiennent bien, c'est-à-dire ils ne se refusent rien, ils vivent bien. - (20) |
| tenne (lai) (pron.pos.f.s.) : la tienne - (50) |
| tenne (lai) : tienne (la) - (39) |
| tenne (le, lai),tennes (les) : tien (le), tienne (la), tiens (les), tiennes (les) - (48) |
| teno. Proprement c'est un cuvier… - (01) |
| tenoo ou tenò. Tenais, tenait. - (01) |
| tenotte : petite cuve que l'on mettait sous le cuvier pour recueillir l'eau de lessive - (39) |
| tenotte, tinette, s. f. vase en bois où on lave le linge et qui sert à divers autres usages. - (08) |
| tenre - tendre. - Teins, voiqui ine poume qu'à bein tenre. - Ci ne vaut ran, crois-moi, d'aivoir le cœur si tenre ; ci tuche ai lai faibliesse. - (18) |
| tenre : tendre (adj.), tendre (verbe) - (48) |
| tenre, adj. des deux genres. tendre comme en français. S'emploie pour mollasse, mouvant. Un pré où l'on enfonce est « tenre. » La terre est « tenre» après les grandes pluies. - (08) |
| tenre, adj. tendre. - (17) |
| tenre, v. a. tendre : « tenre » la main, donner de l'aide, du secours. - (08) |
| tenrement, adv. tendrement, avec tendresse. - (08) |
| tenrète, sf. lierre. - (17) |
| tenronneau. adj. Tendre. (Maillot). - (10) |
| tentaule, adj. tentant, qui cause le désir, la tentation. un cabaret est « tentaule » pour l'ivrogne. - (08) |
| tentchon : chausson aux pommes - (39) |
| t'entends-ben : interjection très courante pour renforcer une affirmation. Ex : "Eh j'atais fâché ! T'entends-ben !" - (58) |
| tenter l’diâb’e : rechercher les ennuis, provoquer - (37) |
| tentition : source d'ennuis, personne agaçante - (61) |
| tentoilli : tremper dans l'eau, dans la boue - (34) |
| tentoyi : tremper dans de l'eau ou de la boue. A - B - (41) |
| tepe : souche d'arbre (faire la tepe = bouder). A - B - (41) |
| tepene ou teupin. Pot ; du vieux mot tupin. - (03) |
| tépeune : bidon à lait. (CH. T II) - S&L - (25) |
| tepeùne, s. f., grand vase en fer-blanc, de forme particulière, contenant le lait qu'apportent les laitières des campagnes. - (14) |
| tepin (C.-d., Mâc.), teupin (Morv.), tepenne, tepene (Chal., Br.).- Pot, et spécialement les vases en fer-blanc dans lesquels les laitières de la campagne mettent le lait qu'elles apportent à la ville. L'étymologie se trouve dans le même mot, vieux français, qui viendrait, suivant Guillemin et Ragut, de tepere, ad tependum, tiédir. - (15) |
| tepin : Pot, « In tepin de beurre » : un pot de beurre. « In tepin de piche » : un pot de chambre. « Ol est chordiau c 'ment in tepin » : il est sourd comme un pot. - (19) |
| tepin : s. m., vx fr. lupin, pot en terre. Au flg., tête. - (20) |
| tepin, n. masc. ; vase en terre pour le sel. - (07) |
| tepin, s. m. pot à lait. Diminutif tepenon (du vieux français tupin). - (24) |
| tepin, tepinier, pot, potier de terre. - (05) |
| tepiner (tep'ner) : v. n., boire un pot... ou plusieurs. - (20) |
| tepinier, potier de terre, Tepenier, nom propre (Ce nom a été jadis et est encore aujourd'hui très commun â Château-Chinon et dans ses environs). - (04) |
| tepon : personne têtue, peu loquace. A - B - (41) |
| teppe, n.m. friche. - (65) |
| teppe, toppe, steppe, terre vague. - (05) |
| tèrage, s. m., action déterrer, de butter. (V. ce dernier mot.) - (14) |
| terbeuler, remuer, secouer avec vigueur. - (28) |
| terbouler (v. tr.) : bouleverser, mettre sens dessus dessous – tracasser, inquiéter - (64) |
| terbouler, teurbouler (v.) : rouler, faire rouler fig. : malmener, bousculer - (50) |
| terbouler. v. - Tourmenter: « Ya ben l'déquoué dé m'terbouler : depis qu'on bouét l'vin dé c't'année, l'Françoués il a pas dessoûlé. » (G. Blanchard, En pleuchant mes truffes, p.32). Altération de triboler (usité au XIIe siècle), puis tribouler (à la Renaissance), ce verbe désigne, depuis son origine du latin ecclésiastique tribulatio, tourmenter, troubler. Le dialecte poyaudin a conservé ce mot, alors que le français n'a gardé que tribulation dans le sens de mésaventure. - (42) |
| térë, târë, terre de déblais, boue sèche de chemin amassée. - (16) |
| tèreau, et tàreau, s. m., fossé. - (14) |
| tèrée, s. f., terreau, fumier réduit en terre. - (14) |
| terèse, s. f. petit manteau de femme avec capuchon. la mode en est passée. - (08) |
| terfioter (v. int.) : bricoler, s'occuper à des petits travaux sans importance - (64) |
| tergéte, s. f., targette. - (14) |
| tergète, targette. - (16) |
| tergillure, tragéyure. s. f. Entorse. - (10) |
| téri (v. int.) : tarir, en parlant d'un puits, d'une fontaine - (64) |
| téri : Tarir. « La fontain-ne de Drefy ne térit jamâ ». Cesser d'avoir du lait, « Sa vaiche a téri ». - (19) |
| teri de long, loc. abréger un travail afin de le faire vite. - (24) |
| teri és beuches, loc. tirer à la courte paille. - (22) |
| teri és beuches, loc. tirer à la courte paille. - (24) |
| teri on point, loc. coudre un peu. - (22) |
| teri on point, loc. coudre un peu. - (24) |
| teri su l'use, loc. être bientôt usé, hors d'usage. - (24) |
| téri v. Tarir. - (63) |
| téri, tarir ; vèche térie, vache qui n'a plus de lait. - (16) |
| teri, v. a. 1. tirer. — 2. Traire. - (24) |
| teri, v. a. tirer. - (22) |
| térine, sorte de vase en terre. - (16) |
| térion. s. m. Essaim d’abeilles. - (10) |
| terle : gros coup asséné. ivresse alcoolique. A - B - (41) |
| terler : donner des coups de tête ou de cornes. A - B - (41) |
| terlujotte, n. fém. ; ver luisant ; mauvaise herbe dans les blés. - (07) |
| terlure : Etre brillant. « San nez trelut ». - (19) |
| termi : cage à poussins. (B. T IV) - S&L - (25) |
| ternet : grappe de cerises. A - B - (41) |
| ternot, tournot. Trochet : « un ternot de ceriges ». - (49) |
| terô : monticule. A - B - (41) |
| terragier. : (Terram agere), celui qui, dans la commune, remplissait les fonctions de répartiteur de la dîme. - (06) |
| terraillon : s. m., vx fr., terrassier. - (20) |
| terraing (n.m.) : terrain - (50) |
| terraro : panier plat à deux poignées dont on se servait autrefois pour transporter la terre. (BD. T III) - VdS - (25) |
| terrarot. Sorte de panier pour transporter de la terre. Te remplirai les terrarots, et pus moi, i les porterai... - (13) |
| terrasse (nom féminin) : grande jatte en terre cuite. - (47) |
| terrasse, n.f. pot à crème. - (65) |
| terrasse, taresse, s. f. terrine, petite cuve en terre cuite qu'on appelle « trappe » en Morvendeau bourguignon. - (08) |
| terrasse. n. f. - Grande terrine en grès. (Voir F.P. Chapat, p.186) - (42) |
| terrasse. s. f . Terrine, plat, écuelle de terre. (Puysaie). - (10) |
| terrassée. n. f. - Contenu d'une terrasse. - (42) |
| terrassee. s. f. Terrinée, le contenu d’une terrasse. (Puysaie). - (10) |
| terre : s. f. Plus bas que terre, au-dessous de tout. Traiter quelqu'un plus bas que terre. - (20) |
| terreau, fossé. - (05) |
| terreau, tarreau, tarriau : s. m., vx fr. terral et terreau, fossé. Cinq hameaux ou écarts, dans le département de Saône-et-Loire, s'appellent Le Terreau ou Les Terreaux. - (20) |
| terreau. Fossé. - (03) |
| terrechon, tarrechon : s. m., pot en terre. - (20) |
| terreor. : Dérivation naturelle du latin territorium et signifiant, comme ce mot latin, territoire. (Franch. de Villy-en-Auxois, 1264.) - (06) |
| terresse (n.f.) : grand récipient en grés où l'on récupérait la crème sur le lait - (50) |
| terrière, tarrière : s. f., guêtre, jambière. - (20) |
| terrinon. s. m. Vase à traire les vaches. (Merry-la-Vallée). - (10) |
| territouaîre (on) : territoire - (57) |
| terrotte, tarrotter : s. f., courtillière (gryllolaipa vutgaris). - (20) |
| terroux, tarroux. Terreux, souillé de terre. - (49) |
| terroyer et torreyer. Creuser des terraux pour planter la vigne... - (13) |
| tertaus (adj.qual.) : tous, la totalité (aussi tortous) - (50) |
| tertifoignas : (têrtifouégnâ: - subst. m.) tarte ou gâteau que les convives estiment mal cuit, indigeste ; le terme est plutôt mal reçu par la maîtresse de maison ! - (45) |
| tertifoniâ - pauvre, mauvais gâteau. - Ce n'â pâ du gâteau cequi, c'â du tertifoniâ. – I ai fait cueurre dan note feu in tertifoniâ. - (18) |
| tertos, tertous. Tous (sans exception). C'est un superlatif de tous. « Bondzo tertous ». Ce mot appartient à bien des patois de l'Est et du Nord. - (49) |
| tertouéille, tertouéillon, s. f. femme ou fille malpropre, mal tenue, souillon, torchon. - (08) |
| tertouéiller : tripoter dans un liquide - (48) |
| tertoueiller : (têrtouèyé - v. trans.) remuer quelque chose dans l'eau, une serpillière; le mot est péjoratif et caractérise un rinçage douteux ; ce sens est voisin de patouyé qui concerne souvent le plaisir des enfants à jouer avec l'eau et s'apparente à patauger. - (45) |
| tertouéillou, ouse, s. et adj. celui ou celle qui est sale, dont les vêtements sont souillés de boue ou d'ordure. (voir : patouéillou.) - (08) |
| tertous (pr. inféf.) : tous - (64) |
| tertous : tous. - (32) |
| tertous : tous, tous autant qu'ils sont. Ex : "Ils étint tertous à la noce de la Simone !" - (58) |
| tertout : tout le monde, tous - (60) |
| tésse, s. f. petit tas de gerbes fait en prévision de la pluie. - (22) |
| tessi saireugne : interjection utilisée pour faire taire un chien - (39) |
| tessier, s. m., tisserand, « tessier de tèle ». — On se souvient, à Verdun, du tisserand qui payait un gamin pour faire battre son miétier, tandis qu'il allait au cabaret boire le vin blanc avec les camarades. Pendant ce temps sa femme, qui entendait le bruit du travail, croyait naturellement que son homme travaillait. - (14) |
| tesson (Pressoir a) : voir pressoir à bascule et trouille. - (20) |
| tesson. Blaireau. - (49) |
| tessonnier : s. m., vx fr. eslacenerie, marchand de corps gras. - (20) |
| tessu, s. m. et adj., tissu. - (14) |
| testaman. Testament, testaments. - (01) |
| tes-te, s.f. tête. - (38) |
| testicoter. v. intr., chipoter, contester : « Oh! l' mauvoulant ! à tout bout d'champ ô testicòte. » - (14) |
| tes-tin-ne, s.f. tête du lit. - (38) |
| tet : Tesson, débris de vaisselle. - (19) |
| tet' : tête. S'te tet qu'ol y : cette tête qu'il a. - (33) |
| tet, sm. salamandre. - (17) |
| tet. Petite salamandre très commune dans notre pays et ressemblant au têtard. On dit proverbialement : al ast méchant quemant un tet bardot. Cette locution n'a aucune raison d'être, car ce petit animal est tout-à-fait inoffensif. - (13) |
| tét. Triton ; salamandre. - (49) |
| têta : pommer (salade) - (51) |
| têta : Têtard. Voir coue de casse. - (19) |
| tetaigne. Tétine, poétiquement, sein, mamelle. - (01) |
| tétar (n.m.) : gros arbre découronné, arbre élagué (aussi écornat, sud-Morvan) (étym. : de tête) - (50) |
| tétar, s. m. qui a une grosse tête ; une tête, un faîte, une cime difforme. - (08) |
| têtard. n. m. - Poterie ratée. (Treigny) - (42) |
| têtard. s. m. Pièce de poterie manquée et mise au rebut. (Treigny). — Capuchon de l’alambic. - (10) |
| têtaud, têton. s . m. Têtard, arbre ébranché périodiquement, à qui on ne laisse que la tête. (Etais). - (10) |
| têtàyé, v. n. observer prudemment en tendant la tête. - (22) |
| têtàyer, v. n. observer prudemment en tendant la tête. - (24) |
| téte (de), loc, par cœur : « Alle sait ben ; alle répète de téte toute sa leçon. » - (14) |
| tête (fâre lai) : bouder, être « pas gracieux » - (37) |
| téte (na) : tête - (57) |
| tête : Tête « Eune tête de sauge » la partie supérieure d'un saule dont on coupe périodiquement les branches. - Taie « Eune tête d'oreiller ». - (19) |
| téte d’heûrchon : mal peigné, hirsute - (37) |
| téte de bressan n.f. Nuage rond apparaissant à l'est. - (63) |
| tête de mouni : espèce de poisson ??? - (51) |
| téte : tête - (39) |
| tête, s. f. tête. Se dit pour chevet, la partie du lit que les italiens nomment le capezzale. - (08) |
| tète, s. f., taie : « La laveuse m'a pardu eùne tète d'oriller. » - (14) |
| téte, s. f., tête, sommité : « La téte de l'âbre. » - (14) |
| téte, tête (é long). - (26) |
| téte. Tête, têtes. - (01) |
| téte-à-tchua (na) : tête-à-queue - (57) |
| téte-à-téte (on) : tête-à-tête - (57) |
| téte-bêche : tête-bêche - (57) |
| téte-de-loup (na) : tête-de-loup - (57) |
| téte-de-nègre (na) : tête-de-nègre - (57) |
| tételaige. : Attelage. C'est là ce que M. Littré dénomme une distorsion du français. - (06) |
| tételeige, attelage... - (02) |
| téter, v. n. former une tête ou pomme. Se dit de certains végétaux et principalement des choux. (voir : cabeucher.) - (08) |
| téter, verbe intransitif : boire (beaucoup). - (54) |
| teterale : Biberon « Donne voir la teterale à tan ptiet pa le fare cougi ». - (19) |
| té-te-ren (Tiens-toi-bien). s . m. Garde-genoux. (Saint-Germain-des-Champs). - (10) |
| tétes, s. f., fils de chanvre de seconde finesse. - (14) |
| tètèt, s. m., sein. Se dit tout particulièrement, en langage enfantin, des seins de la nourrice. - (14) |
| tétière, s. f., bande de linge faisant partie de la cale, ou bonnet de femme; petite coiffe d'enfant. - (14) |
| tétine (na) : têtière - (57) |
| têton, têtaud. n. m. - Arbre étêté ; synonyme d'atêton. (Voir F.P. Chapat, p.187) - (42) |
| têton. s. m. Sommet de la tète, d’un arbre, d’une colline. (Soucy). - (10) |
| tétou : (té:tou - adj.) têtu, obstiné. - (45) |
| te-trelle : récipient pour faire téter les veaux - (43) |
| tetseu : (tr. lit. : toucheur) conducteur de bestiaux. Avant-guerre : ouvrier qui ramenait les bovins chez les emboucheurs (engraisseurs de bœufs) qui les avaient acheté dans les foires. A - B - (41) |
| tette-vache. s . m. Crapaud qu’on rencontre dans les étables. (Perrigny-lès-Auxerre). - (10) |
| tétu : têtu - (57) |
| teû : (pr pers) tous - (35) |
| teu : Pavé de grès. « Y a eune parraire de teus à Nantan » - (19) |
| teû : salamandre - (37) |
| teû : Tort, préjudice. « T'as ésu teû ». « Cen li fa du teû ». « Fare teû » : faire perdre de l'argent, « J'aimerais mieux vos davoi le temps de ma vie que de vos fare teû ». - (19) |
| teu : tous - (43) |
| teu d'Ion, tout le long ; teu d'Ion du ch'mèn, sur toute la longueur du chemin. - (16) |
| teu d'mènme, tout de même : locution excluant le doute; s'a teu d'mènme vrâ, c'est réellement vrai, se dit quand on reconnaît être vraie une chose sur la vérité de laquelle ou avait tout d'abord des doutes. Mènme ke, voulant dire : de plus, en outre, se rattache à cette locution. - (16) |
| teu le deù, tous deux. - (16) |
| teu lé tra : tous les trois - (43) |
| teu plèn, beaucoup ; é sau teu plèn d'monde, ils sont en grand nombre ; béyë m'z'an teu plèn, donnez-m'en beaucoup. Teu plèn se dit encore pour : tout plein, empli. - (16) |
| teu por in co, tout à coup, s'emploie pour exprimer quelque chose de subit. - (16) |
| teu, adj. tous. - (22) |
| teu, adj. tous. - (24) |
| teû, s. f., toux : « Que teù qu'alle a ! » - (14) |
| teu, teute, tout, toute ; teu chèkun : locution excluant l'exception. - (16) |
| teu’ (un) : tour, balade…. Courte promenade. (on admettra également « teu’ » pour un tas : voir « teurot »). - (62) |
| teube : (nm) petit bout de queue - (35) |
| teucer (v.t.) : toucher - (50) |
| teuche : s. f. tas de gerbes dans le champ. - (21) |
| teucher : toucher - (48) |
| teucher : (teuché - v. trans.) toucher au sens propre et par euphémisme frapper, corriger. - (45) |
| teûcher, et tòcher, v. tr., toucher. - (14) |
| teucher, v. a. toucher de la main, frapper, battre. « teucer, t'cer. » en quelques lieux « tocher. » - (08) |
| teuchi v. Tousser. Voir rembeuter, teurèler, teuraler, ranchner. - (63) |
| teucsin : Tocsin « An sonne le teucsin, y a le fû en quéque endra ». - (19) |
| teûdre : Tordre. « An teud les linsus pa les fare sachi ». « Teûdre la gueule cantre » : faire la grimace en signe de dégoût, « O n'a pas le gousier teurdu » : il boit volontiers. - Expression, « Teûdre des rieutes » : tordre des harts (liens pour les fagots). - (19) |
| teuffe (na) - sappe (na) : touffe (d'arbres) - (57) |
| teugnâ : têtu, entêté. A - B - (41) |
| teugnâ : dadais. Du genre « grand-adolescent-boutonneux-lymphatique ». - (62) |
| teugna : indolent. (A. T IV) - S&L - (25) |
| teugna : lent - (44) |
| teugnâ : adj. Lent. - (53) |
| teûgnâ, -ârde n. et adj. (de teugne). 1. Insatisfait, indécis. 2. Maquignon (les maquignons mimaient souvent un vif mécontentement lors des transactions). - (63) |
| teugnâ, subst. masculin et adjectif qualificatif : lent, mou, hésitant. - (54) |
| teugnat : têtu, indécis - (34) |
| teugnat : têtu, indécis - (43) |
| teugnât, teuniât : personne ayant mauvais caractère, mal commode, teigneux. - (56) |
| teugnat. Lambin, indécis, hésitant, long à se décider. Ce mot est très employé. - (49) |
| teugne : (nf) cuscute - (35) |
| teûgne : teigne - (43) |
| teûgne n.f. Tête. - (63) |
| teugnè, train-nè : v. t. Traîner. - (53) |
| teûgner : battre, rosser - (48) |
| teugner, v., travailler de mauvaise humeur. - (40) |
| teugner, verbe intransitif : traînasser. - (54) |
| teugner. Hésiter. Ne pas se presser, prendre son temps pour se décider. - (49) |
| teûgni v. Pleurnicher, bouder. - (63) |
| teugniâ, adj., lambin, fainéant. - (40) |
| teûgniât, teûgniôt : lent, hésitant - (37) |
| teûgnier : hésiter, ne pas arriver à se décider - (37) |
| teuillards : tuiles - (44) |
| teuiller, attiser - (36) |
| teuilles : enjambées. Ne s'emploie guère que dans l'expression : faire de grandes teuilles. - (52) |
| teûjo : toujours - (46) |
| teujo, adv. toujours. - (17) |
| teùjo, tôjo, toujours ; teùjo se dit aussi pour : cependant, néanmoins ; é vo fô teujo v'ni, il vous faut néanmoins, malgré tout, venir. - (16) |
| teujon, s. m. tison, charbon allumé. - (08) |
| teûjon, teûyon (n.m.) : tison - (50) |
| teujonner v. Tisonner. - (63) |
| teule : (nf) tuile - (35) |
| teule : tuile - (51) |
| teule, tèle : tuile - (43) |
| teule, teupe. Souche de vieil arbre. Fig. Personne peu intelligente. - (49) |
| teûler (se) (v.pr.) : se dit des chèvres lorsqu'elles se battent avec leurs cornes - (50) |
| teulire (tlire) : tuilière - (51) |
| teulle : tuile - (34) |
| teulon : tuile (en A : tcheule*). B - (41) |
| teûlon : (nm) tesson - (35) |
| teûlon : tesson - (43) |
| teûlon n.m. Marmitte, gamelle. - (63) |
| teumer, v. a. verser, répandre : « teumer » de l'eau, répandre de l'eau. - (08) |
| teûmi : Lourdeau, empoté teuqué : Toqué, qui a le cerveau félé. - (19) |
| teune : cuve (= tonne). - (21) |
| teune. pron. poss. - Tienne. - (42) |
| teunée (pour teurée). s . f. Dépôt de terre au sommet d’une vigne. (Courgis). - (10) |
| teuniâ, s.m. homme lent au travail ; teunier, v, travailler lentement. - (38) |
| teunne, tounne. n. f. - Tonne : chariot sur lequel était placé une citerne métallique, utilisé pour l'épandage du purin. - (42) |
| teunya : propre à rien. (E. T IV) - S&L - (25) |
| teupaille (la polaille) : va mal (la volaille) - (43) |
| teûpe : (nf) « o fait la teûpe » : il boude - (35) |
| teupe : souche - (34) |
| teupe : souche - (51) |
| teupe : souche d'arbre - (44) |
| teupe n.f. (d'une racine pré-celtique tippa, butte). 1. Souche. 2. Tête. Alle fayot la teupe. 3. Mauvais caractère, mauvaise humeur. - (63) |
| teuper : bouder (en ne bougeant pas comme une souche (une teupe)) - (51) |
| teuper v. Faire la tête, ne rien dire. - (63) |
| teupeune, s. f., grande jatte pour refroidir le lait. - (40) |
| teupeunne n.f. (du francique toppin, marmite). Seau en fer blanc (ou bac) avec bec verseur. - (63) |
| teupin n.m. Vx.fr. tupin, pot en terre. Fig. Tête. - (63) |
| teupin, n.m. pot. - (65) |
| teupin, s. m. vase, écuelle, assiette en poterie grossière où l'on met la pâtée des volailles et qu'on dépose à leur portée. - (08) |
| teupine : s. f. cruche dans laquelle on verse le lait après l'avoir écumé. - (21) |
| teupine, n.f. vase, jatte. - (65) |
| teûpnâ, -ârde n. (de teupe). Boudeur. - (63) |
| teûpner v. (de teupe). Bouder, faire la gueule. - (63) |
| teupnot, -otte adj. Qui fait la tête. - (63) |
| teupon (m), grappe. - (26) |
| teuppe : (nf) souche ; touffe ; monticule - (35) |
| teuppe : souche avec ses racines. - (30) |
| teuppe : souche, touffe, monticule - (43) |
| teuquer : Cogner, toucher violemment. « O s'est teuqué la tête cantre l'équarri » : il s'est cogné la tête contre l'angle du mur. - (19) |
| teûr d’corpiât : farce, « entourloupette » - (37) |
| teurais, n. masc. ; coteau. - (07) |
| teûraler : (vb) tousser - (35) |
| teuraler : tousser de manière importante - (51) |
| teûraler, teussi : tousser - (43) |
| teurbeuîlli v. Tituber, tourner. - (63) |
| teurbeûyi : (vb) tituber - (35) |
| teurbillè, treubillè : v. i. Marcher en ivrogne, manquer d'équilibre. - (53) |
| teurbiller, v., tournoyer sur soi-même. - (40) |
| teurboulé : tracassé - (60) |
| teurboulè : v. t. Bousculer en tous sens. - (53) |
| teurbouler : remuer en tous sens. - (52) |
| teurbouler : tourmenter, tracasser - (48) |
| teurbouler : tomber en roulant. - (33) |
| teurbouler, v. a. rouler, faire rouler et au fîguré malmener, mener rudement, bousculer : « ç' mauvà-z-honm' m'é tote teurboulée pô ran », ce mauvais homme m'a toute bousculée pour rien. - (08) |
| teurbu, s. m. tribut, produit, revenu : « eun mauvâ pré n' beille pâ d' teurbu », un mauvais pré produit peu. - (08) |
| teurbulent, adj. turbulent, querelleur, tapageur. s'emploie substantiv. : « ç'ô eun teurbulan. » - (08) |
| teurchi : v. pulluler. - (21) |
| teurchi, v. n. émettre des rejets : du blé qui feurche. - (22) |
| teurdon : logement aménagé pour le bétail. (RDM. T IV) - B - (25) |
| teurdre : tordre - (43) |
| teurdu : Adjectif, tordu. - (19) |
| teurè (teureau) (teurê: - subst. m.) C'est un nom assez répandu en Bourgogne pour désigner en général un terrain qui "fait le gros dos". une petite élévation de terre. - (45) |
| teuré : côteau. (VC. T II) - A - (25) |
| teure, pour tur, turc (le c ne se prononce pas). s. f. Larve de hanneton. (Bléneau). - (10) |
| teure. n. f. - Gros ver blanc, larve du hanneton. (Bléneau, selon M. Jossier) - (42) |
| teureai, s. m. élévation de terre, éminence de terrain. - (08) |
| teureai., teureau (n.m.) : élévation de terre, monticule, colline - (50) |
| teureau, s. m. élévation de terre, monticule, colline. - (08) |
| teurée (n.f.) élévation de terre, colline - (50) |
| teurée : Nom féminin, talus, surélévation. - (19) |
| teurée, subst. féminin : colline. - (54) |
| teureiller (v.) : chercher dans la terre, fouiller - buter les pommes de terre - (50) |
| teureiller : (teu:rèyé - v. intr.) travailler la terre malproprement et, par extension, travailler en général d' une manière sale, et sans méthode. On peut rapprocher ce mot de r'béyé, mais ce dernier concerne l'action du groin des sangliers et des porcs. - (45) |
| teureiller, v. a. chercher dans la terre, en fouillant, une pierre, une racine, etc. : « teureiller » une roche, essayer de l'extraire du sol avec un instrument quelconque. - (08) |
| teurelée, s. f. petite élévation de terre, ados, talus formé par une charrue ou de main d'homme sur la limite d'un champ. - (08) |
| teurelée, teurlée (n.f.) : talus, colline, élévation de terre - (50) |
| teurèler, teuraler v. (p.ê. du vx. fr. treyaler, faire sonner trois cloches à la fois). Tousser. - (63) |
| teurfan : personne très active - (48) |
| teuriâ : n. m. Taureau. - (53) |
| teuriâ, s.m. taureau. - (38) |
| teuriaige, s. m. triage. Se dit de certaines divisions territoriales. - (08) |
| teurian (n.m.) : instrument à deux dents pour tirer le fumier du char - (50) |
| teurian : houe à dents pour gratter ou tirer - (39) |
| teurian, s. f. instrument à deux dents recourbées qui sert à tirer le fumier étendu sous les animaux. - (08) |
| teuriau : (nm) taureau - (35) |
| teuriau : taureau « San teuriau a ésu la prime » : son taureau a été primé. - (19) |
| teûriau n.m. Taureau. - (63) |
| teurie : génisse ou taure. Le radical taur est celtique. - (62) |
| teurie : Génisse. - (19) |
| teurie : s. f. génisse. - (21) |
| teurie, s.f. génisse. - (38) |
| teûrie, torie, et tourie, s. f., taure, génisse, jeune vache qui n'a point encore vêlé. - (14) |
| teurier : sevrer - (48) |
| teurier : trier - (48) |
| teurier : trier - (39) |
| teurier, v. a. métathèse de trier. choisir, mettre à part, séparer, et au fig. sevrer. On dit " teurier » un veau et même « teurier » un enfant pour sevrer. - (08) |
| teûrieû : trieur, tarare - (37) |
| teurio : taureau. - (62) |
| teurion : clos. (RDC. T III) - A - (25) |
| teurion : petit enclos dans un local ou dans un pré. Le teurion des couechots : l'enclos des cochons. - (33) |
| teurion : 1 n. m. Enclos réduit dans un local ou dans un pré. - 2 n. m. Pièce ou endroit très sale. - (53) |
| teurlâ : (nm) personne entêtée - (35) |
| teurlas (sonner le), (sonner) creux - (36) |
| teurlat : personne entêtée - (43) |
| teurlat, teurlot n.m. (de teurler). Têtu. - (63) |
| teurle : gros coup reçu, ivre - (34) |
| teurle : gros coup reçu, ivresse - (43) |
| teurle, torle n.f. 1. Morceau de bois impossible à fendre du fait de la présence de nœuds. Voir teupe. 2. Caboche, tête dure. 3. Saillie formée par les cornes naissantes d'un animal. 4. Cuite. - (63) |
| teurlée : amas de terre. - (09) |
| teûrlée : petite colline boisée - (37) |
| teurlée : talus - (48) |
| teurlée : talus. - (52) |
| teurlée : talus. - (33) |
| teurlée : talus - (39) |
| teurlée, turlée (petit tureau). s. f. Butte, dépôt de terre plus ou moins élevé, au haut d’un champ. (Mailly-la-Ville). - (10) |
| teurlée. n. f. - Butte de terre naturelle, ou constituée au bout d'une vigne, en vue d'un épandage ultérieur. - (42) |
| teurlentin : personne qui agit lentement - (51) |
| teurlentiner : agir lentement - (51) |
| teurler : (vb) donner un coup de tête, de corne - (35) |
| teurler : donner des coups de tête, de corne - (34) |
| teurler : donner des coups de tête, de cornes - (43) |
| teurler : taper avec la tête - (51) |
| teurler v. (du lat. pop. turbulare, provoquer de l'agitation). Donner des coups de tête, se doguer. - (63) |
| teurler. Donner des coups de tête. « Se teurler », se frapper tête contre tête. Se dit surtout des moutons et des chèvres qui ont l'habitude de se battre à coups de tête. - (49) |
| teurleusette (pour trelusette). s. f. Ver luisant. (Annay-sur-Serein). - (10) |
| teurlin (avoir le) : n. m. Être déprimé, ennuyé. - (53) |
| teurlot : têtu - (51) |
| teurlot, teurlat n.m. Têtu. - (63) |
| teurlu, s.m. lumière filtrante. - (38) |
| teurlue, s. f. aperçu, vue lointaine ou confuse d'un objet. - (08) |
| teurluer, v. n. briller faiblement, projeter une lueur sans éclat : « in viot ben d' lai l’ clieucé qui teurluot au soûlot. » - (08) |
| teurlugeotte. s. f. Lézard. (Guillon). - (10) |
| teurlujotte : lézard gris. (VC. T II) - A - (25) |
| teurlûre, v. n. briller, reluire. - (08) |
| teurmenter : tourmenter, inquiéter - (48) |
| teurmies, tremies, s. f. plur. semailles de printemps, telles que blé de mars, orges, avoines, sarrasins et même pommes de terre. - (08) |
| teurnant : assemblage de 3 petits paquets de chanvre. - (21) |
| teurne (na) : tresse - (57) |
| teûrnée (aine) : (un) grand nombre - (37) |
| teûrnée (aine) : (un) groupe de plusieurs noix, noisettes, beaucoup en quantité - (37) |
| teurnée, s.f. tas de fruits ; branche chargée de cerises. - (38) |
| teûrner : pour le lait, se décomposer, se « séparer » (« mon lait ot teûrné ! ») ; pour la viande, s’avarier - (37) |
| teûrner : tourner - (37) |
| teûrner âtour du pot : ne pas aborder la question franchement - (37) |
| teûrner, vîrer : se déplacer sans bus précis - (37) |
| teurnot (de çrises) n.m. Grappe de cerises. - (63) |
| teurnot (in teurnot d'ries), s.m. branche courte de cerisier, chargée de fruits. - (38) |
| teurot : Monticule, élévation de terrain « Je sus monté su le teurot de Morchétiau ». - (19) |
| teurot : monticule. Certains altèrent le mot (par une apocope) jusqu’à « teu’ » pour un tas. - (62) |
| teurot n.m. Monticule de terre. - (63) |
| teurot : n. m. Petit monticule. - (53) |
| teurot, s. m., monticule de terre. - (40) |
| teurot, s.m. robinet ; teurou s.m. homme qui tire du vin. - (38) |
| teurot, s.m. robinet de bois ou de métal. - (38) |
| teurot, subst. masculin : colline. - (54) |
| teurper : se garnir (en parlant d'un buisson) - (51) |
| teurqouéze. s. f. tricoises, tenailles. - (08) |
| teurrê, terreau : forte montée - (48) |
| teurreau, tereau. Tertre, petit monticule. - (49) |
| teûrrée. Côteau, colline : « la teûrrée de Sanvignes ». - (49) |
| teurriè : v. t. Trier. - (53) |
| teursauter, v. n. tressaillir, faire un soubresaut. - (08) |
| teursiot. n. m. -Variété de cépage. (Leugny, selon F. Clas) - (42) |
| teurte : Tourteau, résidu de la fabrication de l'huile de noix. « Ce pain est deu c 'ment de la teurte » - (19) |
| teurte : s. f. résidu du colza quand on en a fait de l'huile. - (21) |
| teurteller, teurtaller. v. n. Trébucher, chanceler, tituber. Se dit par altération de tortaller (tortè ire), aller de côté, aller de travers. (Chassignelles, Etivey). - (10) |
| teurtelotte, s. f. tourterelle. « toterelle. » - (08) |
| teurteu : tous. - (66) |
| teurteu, tous, sans exception : va vinrë teurteu, vous viendrez tous. - (16) |
| teurtevaller (pour tarteveller). v. n. Causer sans cesse, faire en parlant autant de bruit qu’une tartevelle. (Sermizelles). - (10) |
| teurtilli : Tortiller. - (19) |
| teûrtin, tous. - (26) |
| teurtö, adj. [tretous]. tous. - (17) |
| teûrtonner : aller et venir en s’affairant pour peu de chose - (37) |
| teurtôs : tous - (39) |
| teurtôs, teurtoûs : tous - (48) |
| teurtot : Tous, tout le monde. « Banjo teurtot » bonjour à tous. « An ne peut pas être teurtot riches ». - (19) |
| teurtous : tous. - (09) |
| teurtous, les tous, tous - (36) |
| teurtous, teurtos, trétous, tourtous, adj. tous en général, sans exception : « v'né via, v'né teurtous », venez vite, venez tous, tous ! - (08) |
| teurtous, tretous (s non prononcé), tous. - (38) |
| teûrtoûss’ ! : tous ensemble ! la totalité (« ai lai boûnne vôt’e, teûrtoûss’ ! ») - (37) |
| teurtsi (tseurtsi) (treutsi) : chercher - (51) |
| teuruelle : truelle - (48) |
| teuruelle : truelle - (39) |
| teuruelle, s. f. truelle de maçon. « teurualle. » - (08) |
| teuryau : s. m. veau. - (21) |
| teurziau (nom masculin) : petite meule de céréales formée de treize gerbes. - (47) |
| teurzir, v. germer. - (38) |
| teus, s.m.pl. roches sortant de la montagne ; du nom du dieu gaulois Teutatès. - (38) |
| teussai, tossai - tousser. – I teusse tré bein, vais en fau qui en pairle ai mon médecin. - A teusso hier pu qu'âjedeu. - (18) |
| teusse : Toux, rhume « J'ai la teusse » : je suis enrhumé. « Teusse de peu que deure jeûsqu 'à la mau » : bronchite incurable. - (19) |
| teussè : v. i. Tousser. - (53) |
| teusse, s. f. toux, action de tousser : « sai teusse n' déféni pâ », sa toux ne cesse pas; tisane pour « lai teusse. » - (08) |
| teussé, tousser. - (16) |
| teussé, vn. tousser. - (17) |
| teusse. Tette, tettent. L'infinitif se prononce tecé, teter. - (01) |
| teusser (v.) : tousser - (50) |
| teusser : sucer, téter, cheuler. - (66) |
| teusser : toucher - (37) |
| teusser : tousser - (48) |
| teûsser : tousser (« ai teûsse ! » : il tousse ! - (37) |
| teusser : toucher un objet ou toucher de l'argent - (39) |
| teûsser, et tosser, v. intr., tousser. - (14) |
| teusser, têter. - (27) |
| teusser, tousser. - (26) |
| teusser, v. n. tousser, avoir de la toux. - (08) |
| teusser, v., tousser. - (40) |
| teusserie (na) : tousserie - (57) |
| teusserie, s. f., toux. - (40) |
| teussi - rencaissi : tousser - (57) |
| teussî : tousser. - (62) |
| teussi : Tousser. « O n'est pas d'arrâte de teussi». - (19) |
| teût : Tôt. « Teût ou tâ » : tôt ou tard. - Vite, « Ol a ésu teût fait de se rûner ». - (19) |
| teut é keu, tout à coup. - (16) |
| teut : s. m., éminence rocheuse, rocher. - (20) |
| teut’relle : (nf) récipient muni d'une tétine pour faire téter les veaux - (35) |
| teute, téte. n. f. - Tétine. - (42) |
| teutée (la) : tétée - (57) |
| teûter : (vb) téter - (35) |
| teuter : têter - (43) |
| teutié. Bâton, comme qui dirait tortil, avec lequel on serre les chars de foin à l'aide d'une corde. - (03) |
| teutquemant. Tout comme, semblablement.... - (13) |
| teutrale (na) : sucette (pour bébé) - (57) |
| teutrèle n.f. Seau ou copon à tétine. - (63) |
| teutseux : toucheur de bestiaux - (34) |
| teutsou, totsou : toucheur de bestiaux. Avant la guerre, ouvrier qui ramenait les bovins des emboucheurs, achetés aux foires de la région - (43) |
| teuxchaint : toussaint - (51) |
| teûyau : tuyau, tube - (37) |
| teûzâler : avoir froid, frissonner - (37) |
| tèvin : un taon - (46) |
| tèvin : (tévin - subst. m.) taon; on frotte le cuir du cheval avec de l'huile de cade pour le protéger des taons - (45) |
| tévor. : (Dial. ), ou tévour, tiédeur (rac. lat. tepor). - (06) |
| téyé, tailler. - (16) |
| thaleméterie. : (Bas latin talemarius, boulanger), boulangerie. (Cout. de Châtillon, 1371.) - (06) |
| thé, s. m. thym. s'applique vaguement à quelques plantes odorantes, mais principalement, je crois, au thym bâtard ou serpolet, thymus serpillum. Ce thé-là abonde dans nos terres en friches. - (08) |
| théogonique : qui a un rapport avec la généalogie des dieux. - (55) |
| theûrlée, theûret : petit monticule, petite montée (boisée ou non) - (37) |
| theurot. Sommet d'une montagne : le theurot de Meloisey, celui d'Arcenant. C'est probablement l'origine de Thury et des deux Thorey. D'après M. Cocheris, l'anglo-saxon tor signifie petite montagne. Ce radical primitif est commun aux races japhétiques et sémitiques : on pourrait remonter jusqu'au Taurus de la Turquie d'Asie. - (13) |
| thiac : qui ? - thiac cè ? qui peut savoir ? - (46) |
| thiale, thièle, tuile. - (16) |
| thiathia (familier), femme parlant trop, à tort et à travers, et nom d'une espèce de fauvette. - (16) |
| thiô, tuyau ; thiô d'pleume, tuyau de plume. On dit, aussi: un thiô d'chou, un thiô d'sélède, pour la partie charnue, encore mangeable, du chou, de la salade. - (16) |
| ti (al ôst-ti...?) : il (interrogatif) (est-il...?) - (48) |
| ti : particule interrogative qui se place immédiatement après le verbe (t'as ti soué ? (est-ce que tu as soif?)) - (64) |
| ti a taille (A), locut. adv. D’estoc et de taille. Sans doute pour à tire à taille, de la pointe et du taillant. - (10) |
| ti élément ajouté au verbe pour lui donner une tournure interrogative. T'fais-ti, ô fait-ti, vos faÿez-ti, is faÿant-ti ? - (63) |
| t'i pas ?: Ioc, est-il pas ?, n'est-il pas vrai ? - (20) |
| ti. - Particule (contraction de « t-il » à l'origine), rythmant la phrase interrogative ou exclamative : « Te vas-ti mieux ? Faut-ti qu'te viennes ? T'as-ti vu ? Te manges-ti ? Mon pauvre, c'est-ti pas possible ! » - (42) |
| tia : claie. (BD. T III) - VdS - (25) |
| tiâ : interjection pour faire avancer les bœufs - (48) |
| tiâ : porte d'écurie à claire-voie. - (31) |
| tia : en avant (pour un attelage de bovins). - (33) |
| tiâ ? - qui est-ce ? qui est ? - Tiâ que veint lai ? - Tiâ lai ? – Et pu, tiâ que sait ?... En ne peut réponde de ran. - (18) |
| tia tia : un oiseau - (46) |
| tîa, Corbingne ! : allons, Corbin ! - (36) |
| tiâ, interj. dont se servent les charretiers pour mettre leurs bœufs en mouvement. - (08) |
| tiacard. n. m. - Fromage blanc. (Diges, selon M. Jossier) - (42) |
| tiacard. s. m. Fromage mou. (Diges). - (10) |
| tiaci, s. m. porc, cochon mâle ou femelle. - (08) |
| tiacle sè : Qui le sait ? - (46) |
| tiacoter : bavarder. (E. T IV) - S&L - (25) |
| tiafer : (tyafè - v. intr.) manger avec bruit, comme un porc : l'animal aspire sa pâtée liquide à grosses goulées bruyantes ; le verbe a une valeur onomatopéïque. - (45) |
| tiaffai : manger bruyamment en actionnant fortement les mâchoires, comme un porc dans son auge. - (33) |
| tiaffè, t'chiaffè : v. t. Manger en faisant du bruit. - (53) |
| tiaffer : aspirer avec bruit les débris alimentaires coincés entre les dents, ou encore faire du bruit en mangeant (voir : tiaper). - (56) |
| tiaffer : manger avec bruit (comme un porc), mâchouiller - (48) |
| Tiain-ne : Etienne. Au féminin : Tiain'ette. - (19) |
| tiaique (d’lai) : (du) fromage blanc (peu usité) - (37) |
| tiair, adj. clair. - (17) |
| tiairé, tiaré, vt. n. éclairer. Flamber. Au fig. loc. tiare vô, que j'te dise, attends voir que je te dise, laisse-moi l'expliquer. - (17) |
| tiaire. v. a . Guérir. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| tiairté, sf. clarté. - (17) |
| tialai : Encourager par la voix son attelage de bœufs. Dans la difficulté on tialo : dans la difficulté on encourage les bœufs de la voix. - (33) |
| tiâler : voir tiauler - (23) |
| tiamoure : (nf) flanc de courge - (35) |
| Tiannî (l’) : (l’) Étienne - (37) |
| tianponné, vn. marcher avec difficulté. Je n'seros tianponné, je n'en puis plus. - (17) |
| tiaper, laper - (36) |
| tiaper, v. n. faire avec la langue ou avec les lèvres un bruit ou un mouvement qui exprime la sécheresse de la bouche , l'altération. - (08) |
| tiaquai. - C'est une variante de cliaquai, surtout dans le sens de jeter là avec dédain, colère. - Voyez du reste ce mot. - (18) |
| tiaque : fromage - (48) |
| tiaque, claque. - (26) |
| tiaque, sf. claque. - (17) |
| tiaquenbec, sm. claque-en-bec, fromage blanc. - (17) |
| tiâr, s. f., clé. - (14) |
| tiarcelat, s.m. tiercelet. - (38) |
| tiarcelet (n.m.) : tiercelet - (50) |
| tiarcelet : Tiercelet. « Le tiarcelet mige les ptiets ujaux ». - (19) |
| tiarcer, v. piocher la vigne pour la troisième fois. - (38) |
| tiarch’let : tiercelet - (37) |
| tiâre, t'chiâre : n. f. Terre. - (53) |
| tiarjolot. Sorte d'iris. On en plantait autrefois sur le faîte des toits de chaume. Dans les villages de la plaine, on prononce tiéjaulot. - (13) |
| tiarre. s. f. Terre. (Domecy-sur-le-Vault). - (10) |
| tiassou, tasson. n. m. - Blaireau. - (42) |
| tia-tia (n.f.) : grive - (50) |
| tia-tia (n.m.) : grive - aussi mauvie - (50) |
| tia-tia (tya tya) mot familier par lequel la fermière appelle ses animaux, les porcs par exemple ; un tyatya est un oiseau bavard ; une tya-tyat' est une femme bavarde. volontiers médisante. - (45) |
| tia-tia : (nm) (familier) cochon ; cri pour les appeler - (35) |
| tiatia : étourneau - (48) |
| tia-tia : grive. La litorne. - (62) |
| tia-tia : petit oiseau bruyant - (37) |
| tia-tia : Sorte de petite grive qui va en bande. - (19) |
| tiatia : gadoue. - (33) |
| tia-tia : s. m., onomatopée servant à appeler le cochon et, par ext., à désigner le cochon lui-même. - (20) |
| tia-tia, s. m. litorne, grive. - (08) |
| t'iat'ia, s. m. porc (langage plaisant). (Onomatopée). - (24) |
| tia-tia, s. m., grive litorne, « étourneau ». - (40) |
| tiatia, s.m. porc. - (38) |
| tia-tia. s. m. Onomatopée par laquelle on désigné, en plusieurs endroits, le cochon, le vanneau et le sansonnet. Voyez Quia-Quia. - (10) |
| tiatias : étourneaux. Une voulée de tiatias : une volée d'étourneaux. - (33) |
| tiatias : s. m., chachas, grive litorne (turdus pilaris). - (20) |
| tia-tier : causer exagérément, « jacasser » - (37) |
| tiau - tronçon, morceau informe, ce qui reste. - Tote mes dents sont chouétes ; i n'en ai pu que des tiau. - En n'y é pu de bô dans le feu ; seulement deux ou trois tiaux. - (18) |
| tiau (n.m.) : 1) tibia - 2) gros bâton ou morceau de bois - (50) |
| tiau : gros morceau - (48) |
| tiau : Gros morceau. « Je li ai copé in ban tiau de pain ». - Tige. « In tiau de lapines ». - (19) |
| tiau : grosse branche. - (30) |
| tiau : mauvais outil. - (31) |
| tiau : tige. Et morceau de plume laissé sur la peau d’oiseau plumé…ou tuyau de plume naissante. - (62) |
| tiau : (tyô: - subst. m.) tige de plante du genre du panais ; à rapprocher du fr. tuyau - (45) |
| tiau, gros morceau (ex., un tiau de pain). - (27) |
| t'iau, s. m. tige de pomme de terre. - (24) |
| tiau, s. m., fétu, fragment de bois, ramille. - (14) |
| tiau, s. m., souche, plus petite que le tancot (cf, ce mot). - (40) |
| tiau, s.m. tige de plante coupée presque au ras du sol. - (38) |
| tiau, sm. chaume de céréale. Insertion des plumes d'un oiseau, étui des plumes naissantes. - (17) |
| tiau, tchiau : 1 n. m. Mauvais outil. - 2 n. m. Ouvrier incapable. - (53) |
| tiau. s. m. Tige de blé, de pomme de terre, etc. Voyez quiau. - (10) |
| tiaudon, s. m. baraque, cabane, bicoque. - (08) |
| tiaulai : chanter des ritournelles, des répétitions monotones, ou même simplement onomatopée. - (33) |
| tiaulè, tchaulè : v. t. Battre quelqu'un - (53) |
| tiaulé, vn. monter en chaume : se dit des céréales. - (17) |
| tiaûlée (aine) : (une) forte correction - (37) |
| tiaulée : grand nombre, troupe (tralée) - (60) |
| tiaulée : troupe d'enfants. - (09) |
| tiaulée, tchaulée : n. f. Volée de coups. - (53) |
| tiaulée. s. f. Troupe bruyante. Une tiaulée d’enfants. - (10) |
| tiaulement (nom masculin) : chant pour encourager les bœufs au travail. (Était-ce bien efficace ?). - (47) |
| tiaulement, s. m. action de tiauler, de chanter pour égayer, pour exciter les bœufs. - (08) |
| tiauler (se), v., se battre. - (40) |
| tiauler (v.t.) : chanter à l'oreille des boeufs en parlant des galvachers - (50) |
| tiauler (verbe) : chanter en vue d'inciter les bœufs au travail. - (47) |
| tiauler : battre, fouetter, rosser - (48) |
| tiaûler : battre, rosser - (37) |
| tiauler : chanter en conduisant les bœufs. - (09) |
| tiauler : encourager les boeufs, aiguillonner - (60) |
| tiauler : houspiller, fouetter, exciter. - (56) |
| tiauler : tiauler les bœufs = les encourager de la voix. III, p. 25 - (23) |
| tiauler, tiâler. se dit du chant particulier que les laboureurs ou les charretiers chantent à pleins poumons pour charmer l'oreille de leurs bœufs. - (08) |
| tiauler, v. a., corriger un enfant en le frappant. A aussi le sens de chanter en conduisant les bœufs pendant le labourage, comme l'indique le Glossaire du Morvan, p. 840. - (11) |
| tiauler, v. tr., chanter pour exciter ses bœufs : « Egué ! v'qui le p'tiot barger qui tiaule. » - (14) |
| tiauler. Battre quelqu'un, corriger un enfant. Tiaulée, rossée, correction. Etym. dans le patois de l’Auxois, tiauler veut dire exciter un attelage, non seulement de la parole et au sifflet, mais avec le fouet. Kiaquer (claquer), kiâler, kiôler ou kiauler, signifient frapper avec le fouet, et sont de parfaites onomatopées ; nous avons emprunté le mot aux patoisants, et nous en avons un peu étendu le sens. - (12) |
| tiauler. v. n. Appeler, crier. (Pasilly). — Chanter en conduisant les bœufs. (Châtel-Censoir). - (10) |
| tiaume, s. m., baraque en planches à l'arrière des bateaux, où couchent les gardiens. - (14) |
| tiaume, s. m., pièce où l'on travaille, échoppe. - (40) |
| tiausse : rossée entre enfants. « Gaffe la tiausse à la sortie ! ». Pourrait venir de « chausse-trape » : le piège. On dit aussi frottée. - (62) |
| tiaux, s. m., petits tuyaux de plumes qui garnissent le corps des jeunes oiseaux. Ces plumules sont comme les ramilles de la bête. - (14) |
| tiavot, s. m. maladie cutanée des porcs. - (08) |
| tiche - amas de gerbes ; lieu où on les serre. – Les bliets sont bais c’t’année ; préparons nos tiches. - Les gairgoichons an aibimai note tiche. - (18) |
| tiche : tas de gerbes dans la grange, tisse - (48) |
| tiche : n. f. Tas de gerbe de céréale. - (53) |
| tiche : petit tas de gerbes recouvert avec une autre - haut d'un tas de gerbes en grange ou dehors - (39) |
| ticherand : tisserand. - (32) |
| ticherand : Tisserand. « Dans n'in temps i avait des ticherands dans tos les vlages, ma aujourd'heu la toile se fa à la mécanique ». - (19) |
| tié ! tié ! : expression utilisée pour appeler un troupeau de bovins - (43) |
| tie vaches : gros crapaud. IV, p. 32 ; VI, p. 43-17 - (23) |
| tié, sf. clé. - (17) |
| tiéle : Tuile. « In cove à tiéles pliates ». - (19) |
| tièle, s. f., tuile. Un des anciens produits verdunois. - (14) |
| tièle. Tuile ; tiéler, tuilier. - (03) |
| tiéler, s, m., tuilier : « Les tiélers ont été d'la noce ; i s'avont preùm'nés pendant deux jors por la ville, d'avou canne-major, fifre et tambour. » - (14) |
| tiélerie, s. f., tuilerie. Nous en avons encore quelques-unes. - (14) |
| tielle : tuile. On dira « tialle » si on force l’altération de tielle. - (62) |
| tielle : une tuile - (46) |
| tielle, tiellat. s. f. et m. Tuile, tuileau. (Domecy-sur-le-Vault). - (10) |
| tielle, tiellerie, tiellier, tuile, tuilerie, tuilier. - (05) |
| tielle. : Confiscation. (Cout. de Châtillon, 1371.) On appelait tilletaige un droit qu'on payait au souverain, au renouvellement des offices. - (06) |
| tiellerie : une tuilerie - (46) |
| tiendre : v. a., tenir. - (20) |
| tiendre, v. tr., tenir. - (14) |
| tiendron, s. m., herbe rampante, qui accroche (bugrane). - (40) |
| tiendu, part., de tiendre, tenu. - (14) |
| tiener, pencher un vase. - (28) |
| Tienne, Tiény : diminutifs de Etienne - (48) |
| Tiéno, Etienne ; Tiénète, Etiennette. - (16) |
| tiénot, tiénote. nom propre pour etienne. etiennette. on supprime quelquefois la voyelle initiale sans changer la forme : tiène, tienète. le tiène, le tiènot, la tienète, la tiénote. - (08) |
| Tiénotte : diminutif de Etiennette - (48) |
| tient. Par extension, agiter, remuer quelque chose. Etym. plus vraisemblable, bouliguer est un fréquentatif du vieux français bouler qui voulait dire bousculer, agiter. - (12) |
| tier. Tiers, troisième. - (01) |
| tierce, tiarce, s. f. la troisième partie ou le tiers d'une récolte. - (08) |
| tiercer : v, n., vx fr, tiercier, donner la troisième façon à un champ ou à une vigne. Voir biner et semarder. - (20) |
| tiercer, v. a. prendre le tiers d'une récolte. Dans un champ de blé, celui qui « tierce » prend une gerbe sur trois. - (08) |
| tiercer, v. piocher pour la troisième fois. - (65) |
| tiercer, v., piocher la vigne pour la 3ème fois. - (40) |
| tiercet : s. m., vx fr., action de tiercer ; vigne ou champ qui a reçu la troisième façon. - (20) |
| tierci : Donner la troisième façon à la vigne. « Ses vignes sant tiercies ». - (19) |
| tiès'lè : épervier - (48) |
| t'iéteure, s. f. teinture; peinture. Verbe t'iédre. - (24) |
| tieû : cuve. - (21) |
| t'ieula, s. m. poussin le plus malingre de la couvée. Dernier-né en général : le t'ieula de la famille. - (24) |
| tieule : tuile - (48) |
| tieule, n.f. tuile. - (65) |
| tieulou, s. m., ouvrier qui travaille à la tuilerie. - (40) |
| tieuque. s. m . Couvercle. (Athie). - (10) |
| t'ieurde, s. f. courge. T'ieudri, pied de courge. - (24) |
| t'ieure, s. f. 1. curette. — 2. Presbytère, cure. - (24) |
| tieutiot : paysan - (60) |
| tie-vache : tire-vache. Gros crapaud se nourrissant au pis du lait de la vache (l'auteur rapporte, sans témoigner). - (58) |
| tifian (n. m.) : sorte de fourche recourbée à deux dents, servant à abattre la paille ou le fumier - (64) |
| ti'fien. n. m. - Tire-fumier, fourche en fer à trois ou quatre dents recourbées. - (42) |
| tifouner (verbe) : remuer les braises du feu. - (47) |
| tignasse - chevelure épaisse et mal peignée. - Al é ine tignasse, pair exempe, quemant ine tête de lou. – Ma pigne don in pecho tai tignasse ; te fas pô. - Quée tignasse ! - (18) |
| tignasse, tête mal peignée ; kè tignasse ! se dit de la tête d'un enfant qui n'apprend rien. - (16) |
| tignasser : Lésiner, être très regardant. « Quand an n'a pas de qua fare an est bin forci de tignasser ». « Dans ste maijan y est tos les jos la Sainte Tignasse » : dans cette maison on lésine toujours. - (19) |
| tigne : Teigne, maladie de la peau. Cuscute, cuscuta europea, plante parasite de la luzerne. - (19) |
| tigne, s. f., teigne, insecte, gale à la tête et à l'écorce des arbres. - (14) |
| tigne, s.m. teigne ; adj. (attribut) : méchant. - (38) |
| tigne, teigne. - (16) |
| tigner (se), se gratter la tête (se disait surtout des enfants qui avaient des poux.) - (27) |
| tigner (se}. Se gratter la tête comme si l’on avait la teigne. - (12) |
| tigner, v. tr., gratter : « Que c'qu'ôl a donc, c'peùt houme, qu'ôl é tout l'temps à s'tigner ? » - (14) |
| tigner, v., accueillir du bout des lèvres. - (40) |
| tignon, teigneux. - (05) |
| tignou (on) : teigneux - (57) |
| tignou (ze) :(n.adj ) contrariant, agaçant - (35) |
| tignou : méchant - (46) |
| tignou : teigneux. - (62) |
| tignou, qui a la teigne ; du vieux mot tigne. - (03) |
| tignoû, s. m., teigneux, qui a la teigne. - (14) |
| tignou, s.m, personne qui agace jusqu'à être méchante. - (38) |
| tignou, teigneux, qui a la teigne. - (02) |
| tignou, teigneux. - (16) |
| tignou, tigne – teigneux, teigne. Ou simplement dans le sens de tignasse, comme précédemment. - Al é ine tête de vrai tignou et pu â se graitte ai to manmant quemant s'al aivo lai tigne. - Pigne tai don, que t'é l'air d'in tignou en diro préque in râchou. - (18) |
| tignou. : Teigneux, qui a une éruption chevelu. - (06) |
| tignoux : Teigneux, terme de mépris « Qu'est ce qu'o veut ce chetit tignoux ? ». - (19) |
| tignoux, adj., coléreux, irritable. - (40) |
| tignoux. Teigneux; par extension malpropre, désagréable. - (12) |
| tijaine, n. fém. ; tisane. - (07) |
| tike, manie et mouvement convulsif. - (16) |
| tikio, loquet servant à ouvrir la porte. - (16) |
| tillai, enlever les filaments du chanvre... Dans le Châtillonnais, on dit tiller des cheneveuilles. (Voir ce dernier mot.) ... - (02) |
| tillai. : Enlever aux tiges de chanvre leurs filaments. On dit en Franche-Comté tili. (Tiss.) - En Picardie, on appelle tile la partie intérieure de l'écorce de tilleul, dont on fait des cordes à puits. M. Hécart, dans son dictionnaire Rouchi, cite ce passage d'un mémoire de 1768 : « Eune corde de tille pour le puits de l'intendance.» Tiller c'était donc écorcer l'aubier du tilleul (en latin tilia), et, par extension, écorcer les tiges de chanvre. - (06) |
| tillé, se dit d'une lanière d'écorce détachée par la foudre sur un arbre. - (26) |
| tillé, vt. séparer les fibres du chanvre de la chenevotte. - (17) |
| Tillenâ : Tillenay - (46) |
| tiller : v. a., teiller, peigner le chanvre. - (20) |
| tiller, casser les tiges du chanvre pour séparer la filasse. - (27) |
| tiller, v. tr., teiller, enlever les filaments des tiges de chanvre. - (14) |
| tillerie, s. f., groupes de femmes teillant le chanvre. - (14) |
| tilleux, -euse adj. Fibreux, filandreux. - (63) |
| tilleux, teilleux, teilleuse : adj., flbreux, filandreux, filandreuse (se dit des végétaux, en particulier des légumes tels que raves, radis et autres). - (20) |
| tilli : Teiller le chanvre. « Dans in temps pa passer les vaillées an tillait eune mâche de chande ». - (19) |
| tilli v. (fr. teiller) Peigner le chanvre. - (63) |
| tillin : tilleul. (PLS. T II) - D - (25) |
| tillo : tilleul. - (29) |
| tillö, sm. tilleul. - (17) |
| Tillô. Rue de Dijon, habitée autrefois par une partie des vignerons de la paroisse Saint-Philibert. Un grand tilleul, en bourguignon tillô, avait donné le nom à cette rue, sur quoi l'on peut voir Tabourot, à la fin du prologue de ses Ecraignes. Or, comme c'est dans cette rue du Tillô, et dans celle de lai Roulôte que la naïveté du langage bourguignon s'est le mieux conservée… - (01) |
| tillol. n. m. - Tilleul. - (42) |
| tillol. Tilleul, du vieux mot tilleau. - (03) |
| tillons, filasse d'étouppes. - (05) |
| tillons, s. m., fils de chanvre de troisième finesse, mèches d'étoupe. - (14) |
| tillot - tilleul. - Es aute fouai en y aivo su lai pliaice in tillot l'aivou qu'en se réunissot pou les aisemblées de lai commune. - Le tillot â in àbre bein utile pour ses flieurs dan lai médecine. - On dit aussi : Tiot. - (18) |
| tillot (n.m.) : tilleul - (50) |
| tillot : Fleur de tilleul. « Eune infusian de tillot ». - (19) |
| tillòt, et tillol, s. m., tilleul. - (14) |
| tillot, s. m. tilleul, arbre peu commun dans le pays. - (08) |
| tillòte, s. f., action de teiller, veillée où l'on teille. - (14) |
| tilloû, adj., celui qui teille. Le féminin (tillouse) est plus employé, le teillage étant principalement un travail de femmes. - (14) |
| tilloux : Filandreux « La viande de chevau est tillouse ». - (19) |
| timbale, s. f. vase en fer blanc ordinairement de forme arrondie et dont on se sert pour transporter des comestibles sous la forme liquide ou solide. - (08) |
| timber (v.) : tomber, faire une chute - (50) |
| timber, v. n. tomber, faire une chute : « i seu timbé dan l’ chemi », je suis tombé dans le chemin. - (08) |
| timbouo, s.m. tambour. - (38) |
| timonneau, s. m. petit timon de charrue auquel on attelle les bœufs - (08) |
| timonot : Petit timon qui s'adapte au joug d'un attelage de renfort. « Timonot teurtot, je vins charchi in banjo », contre petterie qu'on attribue à un jeune « bouéran » allant chercher un timonot chez le voisin. - (19) |
| timounot : petit timon - (39) |
| tin (le) (pron.pos.m-s.) : le tien - (50) |
| tin : Petite salamandre qui vit dans l'eau. - (19) |
| tin ça vla (loc. adv.) : immédiatement, sur le champ - (64) |
| tîn canquette ! : interjection utilisée pour appeler les oies - (39) |
| tin : pron. poss. Tien. - (53) |
| tin, tenne, ad. poss. tien, tienne. - (08) |
| tinailler, n.m. cellier. - (65) |
| tinalier : s. m., local où sont les cuves et les pressoirs, - (20) |
| tinatte, tinette. n. f. - Baquet, souvent constitué d'un demi-tonneau rempli d'eau dans lequel on déposait les bidons de lait à refroidir. - (42) |
| tînchi : tâcher - (57) |
| tindre : Teindre. « Y est eune veille reube qu'alle a fait tindre ». - (19) |
| tine : baquet échancré pour les vendanges. - (09) |
| tine : cuve où l'on met le raisin de la vendange. II, p. 43-a - (23) |
| tine : s. f., cuve. - (20) |
| tine, s. f. baquet à l'usage des puisatiers. - (08) |
| tine, s. f., cuvier, grande cuve dans laquelle on met à fermenter le raisin. - (14) |
| tine, vase en bois, en forme de tonneau, servant à transporter le vin nouveau. - (16) |
| tine. n. f. - Baquet en bois, généralement tonneau coupé en deux. Le poyaudin a conservé le terme ancien français issu du latin tina, carafe à long col pour le vin. La tine au XIIe siècle était une cuve, un baquet ou une bassine. - (42) |
| tinerie : s. f., syn. de tinalier. - (20) |
| tîngni : plaindre (se) - (57) |
| tingot - tingau : ustensile, récipient. Souvent usagé et récupéré. Ex : "J’vas douner un tingot d’blé à mes poules." - (58) |
| tingot (un) : un récipient - (61) |
| tingot : récipient (gaumiot) - (60) |
| tingot. s. f. Pièce de vaisselle. (Rogny). — Voyez tégot. - (10) |
| tin-ne : Tien, tienne. « Je pairie que man cutiau cope pu que le tin-ne ». « Vlà ma pâ, vlà la tin-ne ». « Cen tin-ne » : ce qui est à toi. - (19) |
| tinne, s.f. benne pour porter le vin. - (38) |
| tinne. Tonneau défoncé par un bout et percé, dans la partie supérieure, de deux ouvertures destinées à passer un grand bâton. La tina fut en usage chez les Latins dès les premiers temps de la fondation de Rome. On disait aussi tunna, d'où nous avons fait tonne et tonneau. Ce mot tunna se trouve dans une lettre de Clovis à Théodoric. Les habitants de Laval appellent tinne un grand vase en terre, une sorte d'amphore. - (13) |
| tinoir : s. m., syn, de tinalier. - (20) |
| tinqu'à : jusqu'à - (57) |
| tinre : tendre (adj. et verbe). - (29) |
| tinre : tendre - (39) |
| tinsse-toué-ben : tiens-toi-bien. Expression, presque onomatopée. Prononcé, par exemple, chaque fois que l'on fait avancer le chariot, à l'intention de celui qui, juché sur le chargement, y entasse les gerbes dans un ordre précis. Aux chevaux : inutile de dire : "Hue". Ceux si avancent jusqu'à la javelle suivante. - (58) |
| tins-te-ben : s. m., tiens-toi-bien, chariot d'enfant, cage montée sur roulettes, dans laquelle on place les petits enfants pour leur apprendre à marcher. Voir charrayot. - (20) |
| tintarat. s. m. Creuset, terrine, écuelle de terre ; généralement, tout vase de poterie commune. — A Etivey, on entend par tintarats, au pluriel, les mauvais ustensiles de cuisine et objets mobiliers mis au rebut. - (10) |
| tintébin : véhicule en mauvais état, veille voiture, vieille charrette - (39) |
| tintébin, s. m. petite armoire. - (08) |
| tintébon : (tintébon - subst. m.) partie en saillie qui permet de se tenir solidement, sur un chariot en mouvement par exemple ; ce pourrait être les èfrouin:ch' , les ridelles (voir ces mots). - (45) |
| tintelle et dindelle, petite cloche... - (02) |
| tinter : v. a. Tinter un mort, sonner le glas pour un mort, Dites-donc, savez-vous qui c'est qu'on tinte ? - (20) |
| tinter. Se dit, dans le Châtillonnais, d'une cloche qu'on sonne lentement. (Voir au mot dindelle.) - (02) |
| tintéra* (être à), loc. être décédé : quand nous serons à tintéra. - (22) |
| tinteure : Teinture. - (19) |
| tintin : pis. - (29) |
| tintoin (nom masculin) : grand bruit. - (47) |
| Tinventaire de l 1 Hôtel-Dieu de Beaune : « item, plusieurs bruches où sont confitures.. ensemble une bruchie, des tuppins de terre, des cuillers et plusieurs autres choses. » À Dijon on prononce brechie. - (13) |
| tiô : tige de plante dépouillée de ses feuilles. (B. T IV) - D - (25) |
| tiô : un bout de bois, le tronc du chou de Bruxelles dénudé lorsque les choux ont été récoltés, les restants de plumes sur une volaille (on dit également éguyottes.) - (46) |
| tiö, sm. clos. Voir entio. - (17) |
| tiö, sm. clou. - (17) |
| tiôche, sf. cloche. - (17) |
| tiochö, sm. clocher. - (17) |
| tiöe, sf. claie. Voir tonnevent. - (17) |
| tiölé, vt. clouer. - (17) |
| tiôlée n.f. (de trôlée, grande quantité, tripotée) 1. Bande (enfants, oiseaux, etc.). 2. Râclée. - (63) |
| t'iolée ou tapée, s. f. groupe nombreux : une t'iolée d'enfants. - (24) |
| tiôlée : s. f., trolée, bande. Une tîôlée d'enfants, d'oiseaux, etc. - (20) |
| tion-ner : grincer - (60) |
| tioqué, cloqué, vn. glousser (se dit de la poule appelant ses poussins). Par ext. se dit des femmes, que l'on croit enceintes. - (17) |
| tiosser : glousser. - (31) |
| tiosure (ō), sf. clôture. - (17) |
| tiot (n. m.) : tige de la pomme de terre - (64) |
| tiot : Tilleul, tilis europea. « Eune parche de tiot ». « I étaient sités seu le Tiot » : ils étaient assis sous le tilleul, le Tiot avec un T désigne un tilleul très ancien qui ombrage une petite place au hameau de Dulphey. - (19) |
| tiôt, adv. tôt. - (17) |
| tiot. s. m. Tine servant à emporter le vin du pressoir. (Armeau). — C’est une contraction de tinot. - (10) |
| tïotte (pour tirotte). s. f. Seau pour traire les vaches. (Diges). - (10) |
| tiotte. n. f. - Seille : seau large et bas utilisé pour la traite des vaches. (Diges, selon M. Jossier) - (42) |
| tiou : homme qui teillait le chanvre - (43) |
| t-i-pas ? loc. interrogat., n'est-ce pas ? « T-i-pas qu'y é c'qui qu't'as été qu'rî ? » — T-i-pas entre aussi dans une autre locution exclamative : « Eh ben ! quoi ? l'fieû à Jean l'a embrassée. É pi éprâs ?... V’là-t-i-pas ! » - (14) |
| tiplâiller (v. tr.) : manipuler sans précautions, en abîmant - (64) |
| ti-possible : adj. Impossible, être compliqué. - (53) |
| tiquet, s. m. (V. Bète nouére.) - (14) |
| tiquiot : mot désignant une targette (le tiquiot d’lè pôtch, la targette de la porte) - (46) |
| tiquiotè : manipuler la clé dans la serrure, chercher le trou de la serrure avec la clé - (46) |
| tir (a) : tas allongé de foin. - (21) |
| tir o co : tirer au plus court - (46) |
| tîr’poler : pincer, taquiner, en tirant les vêtements - (37) |
| tira ! tire ! marche ! impératif du v. tirer, employé par nos mariniers : « Tira louïa la mailla ! » Tire en suivant la maille (la corde) ! (V. Fe tira, Louïa, Mailla.) - (14) |
| tirage, desserte. - (05) |
| tirâilli : tirailler - (57) |
| tiraillou (on) : tirailleur - (57) |
| tira'lli : Tirailler, avoir de la peine à s'entendre pour conclure un marché. - « J'ins tot de mouême fait marchi ma y a bin fallu tira'lli ». - (19) |
| tirant : part, prés,, qui tire à soi, rapiat. Les Bressans sont tirants, mais paient comptant ; les montagnards ne sont pas tirants, et parlent tout de suite de payer, mais quéqu’fois c'est tout. - (20) |
| tire (être à la), loc. avoir peu d'argent, être besogneux. - (22) |
| tire (être à la), loc. manquer d'argent, avoir peine à faire face à ses affaires. - (24) |
| tire : Vin qui sort de la cuve. « Eune fillette de tire ». « Tire-foin » : crochet pour tirer le foin. « Tire-point » : tiers-point. « Etre à la tire » : être dans la gêne. - (19) |
| tiré à droite, à gauche, pour : se diriger à droite, à gauche. - (16) |
| tiré lè vaiches : traire les vaches - (46) |
| tiré lë vèche, traire les vaches ; tiré un fût, le mettre en bouteilles ; tiré d'lia, puiser de l'eau ; tiré sur quelqu'un : lui ressembler un peu ; tiré quelqu'un : faire son portrait, et quand la table est servie, en désignant un mets prêt à être mangé, le chef de famille dit aux personnes attablées : tiré, pour : servez-vous. - (16) |
| tire : s. f., action de tirer. Prendre du vin à la tire, à longue tire, tirer du vin à la pièce au fur et à mesure des besoins. - (20) |
| tire : s. f., rangée, ligne. Une tire « d'hautains ». - (20) |
| tiré : v. t. Traire. - (53) |
| tîre, Lâzaire ! : sers-toi, Lazare ! (dans le plat qui est devant toi, sur la table) - (37) |
| tire, s. f. rang de vigne isolé dans un champ. Synonyme d'hutain. - (24) |
| tire, s. f. tirage : ce chemin est meilleur, il y a moins de « tire » ; il y a de la « tire » pour grimper sur cette montagne. - (08) |
| tire, s. f., trait, haleine : « J'ons marché dru ; j'sons v'nus iqui tô d'eùne tire. » - (14) |
| tiré. Tirez, tirer. - (01) |
| tire-à-chien. n. m. - Mauvais ouvrier, maladroit, arcandier. - (42) |
| tire-a-chien. s. m . Arcandier, mauvais ouvrier. (Puysaie). - (10) |
| tire-bonjour. Visière de casquette. - (49) |
| tire-bourre : s. m., tire-bouchon. - (20) |
| tire-brése (on) : tire-braise - (57) |
| tire-cheveux (A) : Ioc, en se prenant aux cheveux. - (20) |
| tire-fien, s. m. fourche en fer dont on se sert pour enlever le fumier des étables. - (08) |
| tire-foin : s. m., harpon de fer emmanché qui sert à tirer le foin dans le fenil pour le donner â manger au bétail. On l'appelle aussi grappin à foin. - (20) |
| tire-fu (on) : tire-feu - (57) |
| tîre-lairigo (ai) : sans qu’on n’en voie venir la fin - (37) |
| tirelarigô et tôrelôrigô, sorte d'onomatopée qui exprime le son du fifre, et, par extension, le joueur de fifre lui-même. Boire à tirelarigô, c'est boire comme un musicien, comme un fifre. Le mot flûter, dans le sens de boire largement, n'a pas d'autre origine... - (02) |
| tirelarigô ou torelorigô. : (Pat.) Dans le dialecte, larigot et larigaude signifient gosier. – On dit boire à tirelarigô ou torelorigô ; de sorte qu'on pourrait entendre de ces mots, boire à tire-gosier ou à tord-gosier. Larigot, dans le dialecte, signifie aussi flûte, flageolet, fifre (Roq. et Lac.), et l'on sait que siffler ou flûter une bouteille est un dicton proverbial. Boire à tirelarigô c'est boire comme un joueur d'instrument à vent. - (06) |
| tire-lignòt, s. m., cordonnier. Employé dans le sens ironique. (V. Lignòt.) - (14) |
| tire-monde. n. f. - Sage-femme. Néologisme probablement formé sous l'influence du verbe mettre au monde. - (42) |
| tire-monde. s. f. Sage-Femme. (Saint-Fargeau). - (10) |
| tire-pattes : s. f., sage-femme. - (20) |
| tire-poi. Jeter des draigies au tire-poi. Dans les baptêmes de village, les parrains et marraines lancent dans la rue des poignées de dragées que les enfants se disputent en se tirant les cheveux et les oreilles. (V, Foire.) - (13) |
| tirepoler (se), v. pr., se tirer l'un l'autre par les vêtements en jouant. - (11) |
| tirepoler : agacer, vouloir jouer en tiraillant sur les vêtements, « tripatouiller ». - (56) |
| tîre-pouaîs : tire-poils (jeu d’enfants) - (37) |
| tirer (v. tr.) : traire (tirer les vaches) - (64) |
| tirer (v.t.) : 1) traire. Tirer las vaices - 2) arracher. Tirer las treuffes - (50) |
| tirer (verbe) : traire. - (47) |
| tirer : traire - (44) |
| tirer : traire - (48) |
| tirer : traire et se servir à table : « Tirez don’ ! » : servez vous ! - (62) |
| tîrer â treûffes : procéder à l’arrachage des pommes de terre - (37) |
| tirer au renard : pour un animal c’est tirer de toutes ses forces sur sa longe ou son attache en arrière avec entêtement pour essayer de se libérer. - (59) |
| tirer au renard. loc. verb. - S'éclipser sans se faire remarquer, afin d'éviter un travail ou une corvée que l'on sent proche. - (42) |
| tirer du côté de : loc, ressembler plus à... qu'à... I tire du côté de son père (c'est-à-dire il ressemble plus à son père qu'à sa mère). - (20) |
| tîrer du cou : avoir des difficultés - (37) |
| tîrer lâs vaic’es : traire les vaches - (37) |
| tirer : v. n., se dit d'une affaire ou d'un ménage dans lesquels la gêne pécuniaire est manifeste. Comme ça tire chez ces gens-là ! - (20) |
| tirer, v. a. tirer le bois, le scier, le couper avec une scie manœuvrée à deux. Un ouvrier pousse, l'autre tire. — tirer les vaches, les traire en pressant les trayons etc… - (08) |
| tirer, v. arracher (tirer les treuffes - arracher les pommes de terre). - (65) |
| tirer, v. tr., traire, se diriger vers. On dit aussi tirer un portrait, et tirer en portrait. - (14) |
| tirer, v. traire (tirer les vaches). - (65) |
| tirer, verbe transitif : arracher. - (54) |
| tirer. v. - Traire : « Faut tirer les vaches avant la nuit ! » Ce mot est employé dans plusieurs dialectes français. - (42) |
| tireré. Tireras, tirera. - (01) |
| tire-sciou (on) : tire-clou - (57) |
| tire-tire, a tire-tire : loc. adv., empruntée au jeu qui consiste à faire lirer sur une corde par deux groupes opposés. - (20) |
| tirette : s. f., appareil composé d'un fil de fer et de leviers coudés, qui sert à ouvrir une porte à distance. On l'appelle aussi « tire-suisse ». - (20) |
| tirette. n. f. - Seau en fer ou en bois, large et bas, utilisé pour recueillir le lait de la traite des vaches ; synonyme de soueille, tirouée, tiotte, selle. - (42) |
| tirevacher : secouer quelqu'un en tous gens. (E. T IV) - C - (25) |
| tire-verteaux, tire-vretiaux : s. m., et f., tire-vers, personne qui travaille la terre et qui, par suite, ramène les vers à la surface du sol. Voir verteau.. - (20) |
| tirfin : Crochet à fumier. Pour décharger le fumier on se servo du tirfin : pour décharger le fumier on se sert du crochet à fumier. - (33) |
| tiri - tirogni : tirer - (57) |
| tiri : (vb) souffler (vent) - (35) |
| tiri : (vb) traire - (35) |
| tiri : tirer - (57) |
| tiri : tirer, traire - (51) |
| tiri : Tirer. « Tiri la cue ». Traire, « Tiri les vaiches ». « Tiri su l'euse » : être bientôt usé (voir euse). « Tiri au sort » : passer le conseil de révision. « Tiri in point » : coudre un peu. - (19) |
| tiri : traire - (43) |
| tiri : traire - (57) |
| tiri à la beûtse loc. Tirer au sort (à la courte paille). - (63) |
| tiri v. (du lat. trahere, tirer) 1. Tirer. 2. Arracher (pommes de terre) 3. Traire. 4. Souffler : la bise tire, faut s'mette au coûte. - (63) |
| tiri : v. tirer. - (21) |
| tiri, s. m., moineau. On se sert aussi parfois de ce mot, presque une onomatopée, pour donner une idée du chant de l'oiseau. (V. Passerâ, Mouniau, Saugeri.) - (14) |
| tirlopai (se) : s'agripper aux habits. - (33) |
| tirô, tirou, sm. tiroir. - (17) |
| tirogne : nerf ou tendon de la viande. (CH. T II) - S&L - (25) |
| tirou, ouse, s. tireur, celui qui tire. S'emploie surtout en parlant des ouvriers qui arrachent quelque chose du sol : un « tirou », une « tirouse » de pommes de terre ; un « tirou », une « tirouse » de chanvre. - (08) |
| tiroû, s. m., tireur à l'arc, au fusil. - (14) |
| tirouaîr (on) : tiroir - (57) |
| tirouaîr-caisse (on) : tiroir-caisse - (57) |
| tirouais : tiroir - (39) |
| tiroué (n.m.) : tiroir - (50) |
| tiroué (nom masculin) : seau à traire. - (47) |
| tirouê : un tiroir - (46) |
| tiroué, s. m. tiroir. - (08) |
| tirouée. n. m. - Seau bas et large, utilisé pour la traite des vaches. (Grandchamp, selon M. Jossier) - (42) |
| tirouée. s. f. Seau de zinc ou de ferblanc servant à traire les vaches. (Grandchamp). - (10) |
| tirouér, s. m., tiroir. - (14) |
| tirouère : tiroir - (48) |
| tirours. : Lieux où, hors de la ville, on donnait la question aux criminels. - Plus tard ce mot a signifié chantiers. (Cout. de Chàtillon, 1371.) - (06) |
| tiroux : Tireur. « Y est in ban tiroux ». - (19) |
| tirpailler, v. tr., tirailler. S'emploie surtout dans le sens de réciprocité : « Te t'tirpailles tôjor d'avou tes camarades. » - (14) |
| tirpauler : se battre. (REP T IV) - D - (25) |
| tirpauler : tirer une personne par les habits. (BD. T III) - VdS - (25) |
| tirpauler, tirer quelqu'un par les bras, les épaules. - (28) |
| tirpiller : v. a., tirailler. - (20) |
| tirpoler - (39) |
| tirpoler (se), v., se menacer par invectives. - (40) |
| tirû (n.m.) : tireur, celui qui tire - (50) |
| tirvaché, étiré. - (26) |
| tirvaché, vt. tirailler brutalement dans tous les sens. - (17) |
| tirvacher (se), se tirer par les vêtements comme font souvent les enfants. - (27) |
| tirvaucher. Tirailler. - (03) |
| tirveûgné, tirailler. - (16) |
| tirvouignè : tirailler dans tous les sens (aussi tirvâchè ses manches) - (46) |
| tisaigne, s. f. tisane, boisson médicamenteuse. - (08) |
| tisaine, s. f , tisane. Quand nos villageois pensent avoir besoin d'une infusion, ils la font avec n'importe quelle plante : mauve, tilleul, camomille, quatre fleurs, ou autre. - (14) |
| tisaîn-ne (na) : tisane - (57) |
| tisain-ne : Tisane, infusion « Eune tisain-ne de tillot ». En parlant du vin « Y est cen qu'est de la bonne tisain-ne ! ». - (19) |
| tisin-ne. Tisane. - (49) |
| tison : (nm) étincelle - (35) |
| tison, s. m., lérot (rat fruitier). - (40) |
| tisse (n. f.) : gros tas de gerbes dressé après la moisson dans l'attente de la batteuse - (64) |
| tisse : meule. - (66) |
| tisse : une meule de gerbes de blé, d'avoine, avant battage, on dit aussi une matte. - (46) |
| tisse est synonyme de chappe (V. ce mot). Hangar ou remise, à côte de la ferme. Les murs sont faits d'un tissu de branchages recouvert de boue et de mortier. Le mot et la chose n'existent que dans les villages de la plaine. - (13) |
| tisse, meule (de récoltes). - (26) |
| tisse, récoltes amassées en un monceau... - (02) |
| tisse, s. f. (voir : teiche.) - (08) |
| tisse, tas de gerbes, de foin, etc. - (16) |
| tisse. Meule de récoltes, non engrangées et laissées dans les champs. Etym. le bas latin tassare, tasser dans le sens d'empiler. - (12) |
| tisse. n. f. - Empilage de foin ou de paille, entreposé dans une grange ou un grenier. - (42) |
| tisse. s. f. Quantité de gerbes de blé rentrées et empilées dans la grange. - (10) |
| tissiâ : ensemble de cinq javelles ou gerbes. (B. T IV) - D - (25) |
| tissier. n. m. - Tisserand. - (42) |
| tissier. s. m. Tisserand. (Puysaie). - (10) |
| tite, titer. Téter. - (49) |
| titer, v. tr., téter. Du parler enfantin. - (14) |
| titi : Sein, téton. « Donner le titi à in ptiet » : donner le sein à un enfant. - (19) |
| titi : tétine de la mamelle. - (62) |
| titi de rate, n.m. sedum. - (65) |
| titi, n.m. sein, mamelle. - (65) |
| titi, s. m., sein, mamelle : « Aga ce p'tiot, coumc ôl agripe le titi d'sa neûrice ! » - (14) |
| titi. Tétin. - (03) |
| titi-borgnat : roitelet. (F. T IV) - Y - (25) |
| titilli : titiller - (57) |
| titine, pis de la vache, etc. - (16) |
| titis - les seins des jeunes filles - Ile à déji grande, et en voit ai pogne ses titis. - Lai Génie é des gros titis, ci fairé ine jolie feille. - (18) |
| ti'vache, tire-vache, tette-vache. n. m. - Gros crapaud, le nadou, que l'on rencontrait dans les étables. On prétendait qu'il tétait les vaches lorsqu'elles étaient couchées. - (42) |
| tivouée (n. f.) : seau à traire - (64) |
| tiyi : v. tiller. - (21) |
| tjinné, vt. incliner. - (17) |
| tjive, sm. crible. - (17) |
| tjivé, vt. cribler. Écraser, au pr. et au fig. on dit aussi cribjer. - (17) |
| tlèyé, vn. haleter, respirer difficilement, battre des flancs. - (17) |
| tlire (teulire) : tuilière - (51) |
| t'mon : (nm) timon de la charrue - (35) |
| t'mon : timon - (43) |
| t'mon fortsu : timon fourchu reliant le joug à la chaine de la charrue - (43) |
| tmon n.m. Timon. On dit aussi tchon. - (63) |
| tnaille n.f. Tenaille. - (63) |
| t'neau : n. m. Tonneau. - (53) |
| t'ni : tenir - (48) |
| tni : tenir - (51) |
| t'ni : tenir - (57) |
| tni v. 1.Tenir. 2. Elever. 3. Ressembler. Ô tint d'sa mère ! - (63) |
| t'ni : tenir - (39) |
| tnin, vt. tenir. ind. prés, j'té (ē), impér. té (ē), pp. tnun. - (17) |
| t'no, grand envier pour lessive. - (16) |
| t'notte, t'no : baquet en bois, tinette, tonneau. Aileume la lampe o fait si noir que dans un t'no : allume la lampe, il fait aussi noir que dans un tonneau. - (33) |
| t'nue (na) : tenue - (57) |
| to - moi, toi, moi aussi, toi aussi. - Moi-to, i veux ailai ai lai fête. - I irai vos cherchai, et pu toi-to, André, te veinré. - I veins vos dire bonjour, ai vo aitot, en passant. - Voyez : Aito. - (18) |
| to (on) : tour (mouvement circuaire) - (57) |
| to : s. m. tour du puits. - (21) |
| to : toit. Voir ta . - (21) |
| to : Tour. « Chéquin san to » : chacun son tour. Treuil de char, voir etale. - (19) |
| to : tout - (43) |
| to métenant - tout à l'heure, tout de suite. - Vos veinras to métenant, ci seré prau. - En vos faut fâre cequi to métenant. - (18) |
| tô n.m. Crapaud sonneur à ventre jaune. - (63) |
| to sou - tout seul. - Al étaint to sou qu'à traiveillaint. - Moi, i me pliai mieux to sou. -Voyez du reste : To, tote. - (18) |
| to sou : seul - (43) |
| tö, teu, adj. tout. - (17) |
| to, tön adj. poss. Ton. - (63) |
| to, tos, totes Pron. adv. Tous. - (63) |
| tô, tôs, tout' : adv. Tout, tous, toute. - (53) |
| tô, tòte, s., adj. e tadv., tout, toute. - (14) |
| tô, tou : crapaud - (48) |
| to, tote - tout, tous, toute. - En é plieuvu tote lai jornée. - Quand ile traiveille ile â tote ai son aifare. - To ne vait pas mau. - To prée. - Tot pliain. - To sou. - (18) |
| to. Tout, tous. On écrit tôt devant une voyelle, tôt a padu, tout est perdu. - (01) |
| tocer. : (Dial et pat.), tetter. (Cout. de Beaune, 1370.) - (06) |
| Tochaint n. Toussaint. - (63) |
| toche. Touche, touchée, touchent. - (01) |
| toché. Touché, touchez, toucher. - (01) |
| tocher (v. tr.) : frapper un animal pour le faire avancer (tocher des vaches) - (64) |
| tocot : talus, butte - (48) |
| tocot, s.m. alkécange (plante). - (38) |
| tocsin : s. m. Syn. de tracassin. - (20) |
| tocson, homme grossier. A Rennes, on dit un gros tocson pour exprimer un homme sans éducation. - (02) |
| tocson. : Homme grossier. Ce mot est d'importalion étrangère. A Rennes, on dit un gros tocson pour exprimer un homme épais et sans culture. - (06) |
| tocsouléter. v. n. Goûter, manger entre le dîner et le souper ( Etais). - (10) |
| tode. Torde, tordent. - (01) |
| tôdi, maison malpropre où tout est en désordre. - (16) |
| todje : tordre - (46) |
| tôd'jor, adv., toujours. - (40) |
| todjre, vn. tordre. prp. todiu. - (17) |
| todju : tordu - lè branches d'âbre toutes todjues, les branches d'arbre toutes tordues - (46) |
| todvillon ou totevillon, personne qui touche à tout. (Voir au mot totevillai.) - (02) |
| todvillon ou tôtevillon. : Qui tiraille tout, qui touche à tout. - (06) |
| todzo : toujours - (51) |
| todzo. Toujours. - (49) |
| tœle, s. f. tuile. Se tœlé, se cintrer en forme de tuile, sous l'effet des intempéries. - (22) |
| tœle, s. f. tuile. Se tœler, se cintrer en forme de tuile, sous l'effet des intempéries : la planche s'est telée au soleil. - (24) |
| tœne, s. f. cuve à vendange (du vieux français tine). - (24) |
| tœne, s. f. cuve à vendange. - (22) |
| tœneri, s. m. grange, cellier contenant les cuves. - (22) |
| tœneri, s. m. grange, cellier contenant les cuves. - (24) |
| tœpenot, s. f. personne lourde et un peu simple. - (24) |
| tœpin, s. m. pot à lait. Diminutif : tepenon. - (22) |
| tòfeur, s. f., touffeur, chaleur lourde, temps étouffant : « Auj'deù, on n'y teint pus. Qué chaud ! I fait tòfeur. » - (14) |
| toffer, v. ; fumer ; ça toffe. - (07) |
| tôgnè : battre, rosser - (46) |
| tôgnée : correction. - (66) |
| tôgnée : une volée - (46) |
| toie, lit de plume, couëtre. - (05) |
| toignon, teinturier ; toindre, teindre ; toindu, teint. - (16) |
| toilée : n. f. Touffe. - (53) |
| toilette : péritoine. - (32) |
| toilleau, ll mouillées, s. m. taureau. (voir : toireai.) - (08) |
| toiller : tondre à ras l'herbe (en parlant de l'herbe mangée par les animaux). (G. T II) - D - (25) |
| toiller. : (Du latin tollere), enlever. (Charte de Seurre, 1278.) On a dit tolir dans le dialecte, et aussi bien toloit que tolu au participe passé . - (06) |
| toinde (v.) : teindre - (50) |
| toinde : teindre - (39) |
| toinde, toindu, toindro- divers temps du verbe teindre. - I ai envie mai robe à toindou pou lai toinde en blieu. - Tes bas n'étaint dière bein toindus ; â ne sont déji pu nairs. - Le pére Rouhète toindro bein note couverture, en me sembe. - (18) |
| toindou - tainturier. Voyez toinde. - (18) |
| toindre : v. t. Teindre. - (53) |
| toindre, v. a. teindre, mettre en couleur. au partie, passé « toindu » comme en bourgogne. - (08) |
| Toîne : Antoine, on dit aussi Toinot. - (19) |
| Toîne n. Antoine. - (63) |
| Toino, Tono, Antoine ; Toinète, Antoinette. - (16) |
| Toinon, prénom, Antoinette. - (38) |
| tointeûre (n.f.) : teinture - (50) |
| tointeure : teinture - (48) |
| tointeure : teinture - (39) |
| tointeure, s. f. teinture, couleur quelconque. - (08) |
| tointue. s. f. Teinture. (Ménades). - (10) |
| toirais, toirie - taureau, jeune vache. - Vos é lai deux jolis toîrais que fairant ine fameuse paire de boeufs. - Vendez-moi don vote toîrie pour rempliaiçai note vaiche l'année que veint. - (18) |
| toirde (v.) : tordre - (50) |
| toirdre, v. a. tordre. - (08) |
| toire, veau femelle. - (26) |
| toireai, s. m. taureau. « tauriau. » - (08) |
| toirie, s. f. jeune vache, vache qui n'a pas encore vêlé. « tauhie » - (08) |
| toise carrée : s. f., ancienne mesure de surface en général. La toise carrée de Paris valait 3 mètres carrés 798. La toise carrée dé Dijon et de Mâcon valait 5 mètres carrés 935. - (20) |
| toise curbe : s. f., ancienne mesure de volume en général. La toise cube de 6 pieds de côté ou toise de Paris valait 7 mètres cubes 403. La toise cube de 7 pieds 1/2 de côté ou toise de Dijon et de Mâcon valait 14 mètres cubes 460. - (20) |
| toise : s. f., ancienne mesure de longueur en général. La toise de Paris, de 6 pieds, valait 1 mètre 949 ; donc le mètre vaut 0 toise 513 de Paris. La toise de Mâcon de 7 pieds 1/2, comme la perche, valait 2 m. 436 ; donc le mètre vaut 0 toise 410 de Mâcon. La toise de Dijon était la même que celle de Mâcon, tandis que la perche de Dijon était plus grande que celle de Mâcon. - (20) |
| toit : appentis (pour les cochons) - (61) |
| toit : (prononcer : toué) appentis réservé au cochon que l'on engraisse, ou à la volaille. Ex : "Va don fermer l'toit aux poules !" - (58) |
| toiton : habitacle du cochon, des lapins. (P. T IV) - Y - (25) |
| toiton, s. m. petit toit, mauvais toit. Se dit d'une loge à porcs, d'un pauvre logement en général. - (08) |
| toitot, toiton (n.m.) : loge à porc - pauvre logement - (50) |
| tôje, et tôjor, adv., toujours. - (14) |
| toje, toujours. - (05) |
| toje. Toujours ; du vieux mot tojors, par contraction et corruption. - (03) |
| tojo ou toje : Toujours « O se leve tojo de ban métin ». « Y est toje autant de gagni». - (19) |
| tôjo, adv. toujours. - (38) |
| tôjor : toujours - (48) |
| tôjôr : adv. Toujours. - (53) |
| tôjor. Toujours. En bourguignon, au lieu de tôjor on dit quelquefois, surtout en vers, torjo, ce qui, dans la rencontre, est commode pour la rime… - (01) |
| toké, heurter ; s'toké lai tëte, se heurter la tête... - (16) |
| toké, tokë, celui, celle qui disent des choses insensées, incohérentes. - (16) |
| tokriâ, larve du hanneton. - (16) |
| tol : s. f. jeune pousse de vigne. - (21) |
| tolai - taler. - Note chevau m'é aitraipai le pied ; ma c'â qu'a m'é bein tolai. – Mes soulés me tolant ; ci me fait gambillai. - Le drôle en piaichant é aitraipai labre et pu l'é bein tolai. - (18) |
| tole : branche - (48) |
| tolé : talé. Qualifie un fruit qui a reçu un coup, est étendu familièrement à une personne. - (62) |
| tolè : tallé - (48) |
| tolè : v. t. Taler. - (53) |
| tole, branche de vigne réservée pour la production. - (16) |
| tole, s. f. branche d'arbre, rameau : « a fau coper le tôles deu châgne, deu boulâ », etc. « taie. » - (08) |
| toler (v.t.) : taler, entasser - (50) |
| toler : taler - (48) |
| toler : taler. - (52) |
| toler : (tolè - v. trans.) meurtrir, contusionner, frapper ; le mot est plus fort que taper. - (45) |
| toler, v. a. blesser, contusionner, meurtrir : " i m' seu tolé lai jô », je me suis meurtri la joue. - (08) |
| toler, v. taler. - (38) |
| tolereai (n.m.) : morceau de pâte de pain qui est mal levé et qui s'aplatit - (50) |
| tolereai, s. m. morceau de pâte de pain qui est mal levée et qui s'aplatit. se rattache à « toler », meurtrir, écraser. - (08) |
| toletarre, s.m. tale-terre : c'est-à-dire paysan. - (38) |
| toleure : talure - (48) |
| toleure : meurtrissure - (39) |
| toleure, s. f. contusion, meurtrissure, blessure en général mais sans effusion de sang. - (08) |
| tollai : yalé. Le blé tolle au printemps (ou trécho). - (33) |
| to'llan : Tortillon de vieux linge. - (19) |
| tolle (n.f.) : branche - (50) |
| tolle : branche (« raifistoller » : rattacher comme s’il s’agissait de branches cassées) - (37) |
| tolle : branche. - (52) |
| tolle : branche. - (33) |
| tolle : (tol' - subst. f.) branche ; se dit aussi brin:ch' voir aussi pî:no ; on retrouve les deux mots dans les verbes étolnè et ébrin:ché. - (45) |
| tolle : branche - (39) |
| tolle : n. f. Touffe d'herbe. - (53) |
| tolle, branche - (36) |
| tolle, n.f. branche, touffe d'herbe ou toute pousse dans la vigne. - (65) |
| tolle, s. f., touffe, monceau. Ex. : une tolle d'herbe, une tolle de grain. - (11) |
| toller (se) : cogner (se) - (39) |
| tôllion - personne, femme surtout, avec de sales habits, très mal soigneuse. - Lai pôre Christine, çâ ine vraie tôllion. – C’â bein demaige ; ile s'haibille qu'en lai prenro pou ine tôillon. - (18) |
| tollou (-ouse) (adj.m. et f.) : qui a beaucoup de branches - (50) |
| tollu : n. f. Entrave, pièce de bois attachée au cou et laissée pendante entre les pattes pour entraver le bétail. - (53) |
| tolon (n.m.) : talon - (50) |
| tolon, tolou : n. m. Instrument en bois pour écraser, talon. - (53) |
| tolot, s.m. gros bacon attaché au cou des vaches pour les empêcher de courir. - (38) |
| tolot, tailot : partie basse et grosse du talon (ain tolot d’zambon) - (37) |
| tolou : gros morceau de bois assez court et terminé par un renflement en forme de massue pour écraser les pommes de terre dans le fourneau et préparer la pâtée des cochons ; on dit aussi bolou, en référence à la boule de l'outil. - (45) |
| tolou, ouse, adj. branchu, qui a beaucoup de branches, de rameaux : « eun châgne tolou, eune verne tolouse. » (voir : tôle.) - (08) |
| toltin, toudze : toujours - (43) |
| tolû (n.m.) : battoir ; taloir - (50) |
| toluchè : v. t. Marteler. - (53) |
| tolucher : frapper à petits coups. (RDM. T IV) - B - (25) |
| tomber d'yau : uriner. Mieux disant que "pisser". Ex : "Vas don pu loin pour tomber d'yau !" - (58) |
| tomber sous la jeusse : état limite de l’évanouissement. La jeusse (juche) servait à faire percher les volailles. - (59) |
| tomber : v. a. et n., faire tomber, laisser tomber, mettre bas (déposer). Tomber un bloc de pierre. - (20) |
| tomberiau n.m. Tombereau. - (63) |
| tombériau : tombereau. Servait surtout à charrier le fumier jusqu'aux champs de labours. Faute d'autre véhicule personnel plus urbain, il pouvait servir à transporter la famille en certaines occasions. - (58) |
| tomberiau, s. m. tombereau. - (24) |
| tombériau. n. m. - Tombereau. - (42) |
| tomberiau. Tombereau. - (49) |
| tomberieau (bareu) : tombereau - (51) |
| tombeùriau, s. m., tombereau. - (14) |
| tombrau : n. m. Tombereau. - (53) |
| tombriâ, s. m., tombereau. - (40) |
| tombrià, s.m. tombereau. - (38) |
| tombure : s. f., action de tomber ; lésion résultant de la chute. J'ai une tombure à la tête. - (20) |
| tomé, tumé, vn. déborder. - (17) |
| tomer, toumer : verser - (48) |
| tomer, v. ; verser un liquide. - (07) |
| tomiron, s. m., gâteau grossier, que les ménagères, confectionnent avec de la pâte et un peu de graisse, quand elles font la cuisson du pain. Les enfants dévorent tout cela. - (14) |
| ton (avoir du). exp. - Force, courage ; synonyme de tchio : « Éprès i' s'errosont la dalle eveuc du bon picton ; i' sentant pus si l'hou tt' les talle, ça leu dounne du ton. » (Fernand Clas, p. 32) - (42) |
| tön, to adj. poss. Ton. Voir to. - (63) |
| tonai. Tourné, tournez, tourner ; c’est aussi tonné et tonner. El é bé tonai ste neù, il a bien tonné cette nuit. Ai fai tan de bru qu'on n'antan pa Dieu tonai, il fait tant de bruit qu’on n'entend pas Dieu tonner. - (01) |
| tonarre. Tonnerre. - (01) |
| tonbrö, tonbret, sm. tombereau. - (17) |
| tondeure, s. f. tonte, la quantité de laine que produit la tonte d'un mouton : la « tondeure » d'une brebis, d'un troupeau. - (08) |
| tonduse : part. pass. f., tondue. - (20) |
| tonevent, sm. [tournevent]. claie. - (17) |
| tongné, tôgné, vt. frapper à coups de poing. - (17) |
| Tôni, prénom, Antoine. - (38) |
| toniche, interj. familière aux femmes surtout. Elle n'est probablement qu'une variante adoucie de tonnerre, considéré comme juron. - (08) |
| Tonin, Tonine n. Antonin, Antonine. - (63) |
| tonnâiller. v. - Évoque le bruit du tonnerre dans le lointain. - (42) |
| tonnalé : Tonnelier « San grand père était tonnalé ». - (19) |
| tonnare : Tonnerre, foudre. « Le tonnare a cheu su in peup'lle ». « In tonnare en piarre », un bolide. Dans la croyance populaire la foudre tombait tantôt en feu, tantôt en pierre ; une hache en pierre polie trouvée dans le sol passait pour être « In tonnare en piarre ». « Le diabe jue à la bole », se dit quand le tonnerre gronde fort coup sur coup. - (19) |
| tonne - pour tourne, du verbe tourner. - Tonne tai don de ce cotai qui. - Tonne don lai tabe de vé lai porte. - (18) |
| tonne : citerne sur roues - (48) |
| tonne : Nom féminin, demi- muid, 5 à 6 hl. « Eune tonne de Noah », un demimuid de vin blanc de Noah. - (19) |
| tonne : tonnerre - (44) |
| tonne : s. f., fosse d'aisances. - (20) |
| tonne, s. f., tonnerre. - (40) |
| tonne, subst. féminin : tonnerre. - (54) |
| tonne, tounnère : tonnerre - (48) |
| tonné, vt. tourner. - (17) |
| tonneau : s. m., ancienne mesure de capacité pour les liquides. Il valait : à la jauge de Mâcon, 209 litres 120 ; à la jauge de Dijon, 228 litres 525 ; à la jauge de Marcigny, 230 litres 547. Aujourd'hui, en Maçonnais, le tonneau ou ponçon contient de 215 à 216 litres. - (20) |
| tonneau : s. m., ancienne mesure de capacité pour les solides tels que charbon de terre, minerai, plâtre, chaux, etc., valant 28 décalitres 027. - (20) |
| ton-ner : tonner - (57) |
| tonner, tourner. - (26) |
| tonnet, s. m. petit tonneau. diminutif de tonne. - (08) |
| tonneu, planche à hacher la viande. - (27) |
| tonniau : tonneau - (43) |
| tonniau : tonneau. - (66) |
| tonniau en gueule n.m. Tonneau sans couvercle, toujours utilisé debout. - (63) |
| tonniau n.m. Tonneau. - (63) |
| tonnieau : tonneau - (51) |
| tonnö, sm. [tourneauj. Disque de bois épais servant à hacher la viande ou les légumes. - (17) |
| tonon. Tournons. - (01) |
| tonsuré : qui a reçu la tonsure (cérémonie religieuse d'entrée dans la cléricature, au cours de laquelle un évêque. - (55) |
| Tontine, Tonton, Jeanne. - (16) |
| tonton : s. m., toton, sorte de dé à jouer traversé par une cheville sur laquelle on le fait pivoter. Voir frise. - (20) |
| tonton, s. m., oncle. Du langage enfantin. - (14) |
| tonton, s. m., toton : « La diâbe de malin ! ô l'fait virer c'ment eùn tonton. » - (14) |
| tontonnier, totonnier : s. m., qui est comme un toton, qui va partout et touche à tout. - (20) |
| toò. Tuais, tuait. - (01) |
| toôïon, s. f. toison, laine que donne un mouton : « i é chis toôions chu mon gueurné », j'ai six toisons sur mon grenier. - (08) |
| topai, tope, topons - frapper en mains pour promettre, consentir. - Topons en mains ! – Eh bein, ç'â convenu, tope lai ! - (18) |
| topais, topot - un tas, une poignée. - In topais de carottes et de bliettes. - Ile aivot in petiot topo de flieurs. - Chèque fouai qui me pigne, i ai in topot de cheveux. - (18) |
| topat. s. m. Petit tas. (Gizy-les-Nobles). - (10) |
| tope : Friche. «Aller en champ su les topes » : mener paître le bétail dans les friches communales. Ce mot a été francisé, on dit teppe. - (19) |
| tope : terrain inculte. - (29) |
| tope, terrain en friche. - (16) |
| tôpeire, s. f. tas, monceau : une « tôpeire » de blé, d'avoine. - (08) |
| tôper : attraper (quelqu'un) - (48) |
| toper : s. f. gros tas. - (21) |
| topère : tas provisoire de pommes de terre installé dans un champ, avant qu'elles ne soient mises en cave ou en poté*. A - B - (41) |
| topére : (tô:pé:r' - subst. f.) Tas de grain entassé sur le grenier qu'on remuait régulièrement, surtout quand la moisson s'était faite par temps humide. - (45) |
| tôpëre, taupinière. - (16) |
| toperia : monticule. (RDT. T III) - B - (25) |
| topéte, s. f., petite fiole, flacon : « Eh ! la Glaudine, baille-me eùne topéte de sirop. » - (14) |
| topette : carafe de vin d’un quart de litre - (37) |
| topette : n. f. Petite bouteille de vin de 33cl. - (53) |
| tôpette, s. f. fiole, petit flacon à gros ventre : une « tôpette » de sirop, de liqueur. - (08) |
| topeune : petite bouteille - (43) |
| topeunne : (nf) seau à lait muni d’un bec verseur - (35) |
| topier, s.m. taupinière. - (38) |
| topine : topinambour - (43) |
| topine : n. m. Topinambour. - (53) |
| topine : s. f., topinambour. Voir tapine. - (20) |
| topinre, taupinière. - (26) |
| toppe - champ, terrain non cultivé, qui n'est pourtant pas un pré, mais une chaume bien herbeuse, presque un pâturage. – Te vas menai lai vaiche dans lai toppe de Junchère. - Ceute année, i vas laiborai lai toppe du Pràlot. - Dan les années moillées, ine toppe sert bein. - (18) |
| tôppe : friche ou teppe, lande, terre de médiocre qualité. Lieu-dit, exemple : « La Teppe Bernard ». - (62) |
| toppe : n. f. Petite butte herbeuse ou en friche. - (53) |
| toppe, s. f. mauvaise pâture, friche. - (24) |
| toppe, s.f. teppe ; friche. - (38) |
| toppe. Lieu inculte, terre en jachère. C'est un feignant qui ne sait pas cultiver, tous ses champs sont eu toppe. De là sont venus le verbe dêtopir et le substantif détopissement... - (13) |
| toppe. Nom de lieu et de champ. - (03) |
| toquai - dans le sens de tête en l'air, d'original, et aussi dans le sens de toucher, frapper une chose contre une autre. - C'â in toquai ! - En â vrai, tote ceute famille lai â ine famille de toquai ! - Fais bein aitention, ne vai pâ toquai lai soupière, te lai casserâs. - (18) |
| toqué, heurter quelqu'un ou quelque chose... - (02) |
| toqué. : Celui dont le cerveau a reçu quelque forte impression. - A Toulouse, un toc est une espèce de folie. (Voc. des poésies de Goudelin.) A Genève recevoir une toquée, c'est recevoir des coups. (Gloss. gen. ) - Ce vocable semble avoir été emprunté à l'italien toccare. - (06) |
| toquer (C.-d., Chal., Br., Morv.). - Heurter, vieux mot employé dans le sens de frapper à la porte ; vient probablement de toc-toc, qui est une onomatopée… - (15) |
| toquer (v.) : cogner, frapper - (50) |
| toquer, v. a. frapper, heurter. On dit toquer une porte ou toquer à une porte. - (08) |
| toquer, v. tr. et intr., toucher, frapper, heurter : « O s'é toqué la téte cont' eùn âbre. » — « A c'maitin, j'ai toqué à ta porte. » - (14) |
| toquer. Choquer, taper, cogner, frapper à la porte. Etym. vieux français, tocar, frapper, cogner, heurter à l'huis. - (12) |
| toquer. Heurter ; vieux mot. - (03) |
| toquerai : ver blanc. (MLV. T III) - A - (25) |
| toquot : toqué (?). Butté entêté. - (33) |
| toquot, s. m. bête à cornes qui a une grosse tête, bête mal conformée ou mal coiffée. - (08) |
| toquot, s. m. bourrelet, bandeau rembourré qui protège la tête des enfants contre les chocs ou les chutes. - (08) |
| toquot. n. m. - Essoufflement, palpitations, dus à la peur ou à une émotion : « Je m'se us fait courser pa'l' chien d'la Nénette, i' m'a foutu un d'ceu toquot ! » Mot dérivé du verbe onomatopéique « toquer ». - (42) |
| toquot. Sorte de coiffe, portée par les femmes de l'Auxois... Le mot breton tok signifie chapeau. - (13) |
| tor (ō), sm. et f. tour. - (17) |
| tor : tour - (48) |
| tôr : treuil du char - (43) |
| tôr n.m. Treuil placé à l'arrière du char. - (63) |
| tôr : n. f. et n. m. Tour. - (53) |
| tôr : tour - (39) |
| tor, s. f. tour, bâtiment élevé. - (08) |
| tòr, s. f., tour, bâtiment rond. - (14) |
| tor, s. m. tour, tournée, mouvement circulaire. - (08) |
| tôr, s. m., tort, dommage. - (14) |
| tòr, s. m., un tour, une tournée. - (14) |
| tôr, toûr n.m. Treuil placé à l'arrière du char. - (63) |
| tor, tour, promenade, attrape. - (16) |
| tor. Tour, dans toutes ses significations, tant au pluriel qu’au singulier ; c'est aussi tort. Vous avez tort, vos aivé tor. - (01) |
| torbéillon (n.m.) : tourbillon ; vent impétueux qui tourbillonne - (50) |
| torbeillon, s. m. tourbillon, vent impétueux qui tournoie. - (08) |
| torbeillonner, v. n. tourbillonner, tournoyer. - (08) |
| torbiller, v. marcher d'une façon incertaine, comme le fait un ivrogne qui n'est pas solide sur ses jambes. - (38) |
| torbouler : tomber en roulant ou rouler quelque chose - (39) |
| torche : Coussin qu'on met sur la tête des bœufs ou des vaches quand on les attelle et sur lequel on serre le lien qui les attache au joug. En français le mot torche désigne le linge roulé que dans certains pays les femmes mettent sur leur tête pour porter un fardeau. - (19) |
| torche : s. f. tampon de foin appliqué aux quatre coins de la voiture. - (21) |
| torche, coussinet pour porter un fardeau sur la tête. - (16) |
| torché, essuyer... - (02) |
| torche, s. f. torche, faisceau lie ou tordu de paille, de foin, de chanvre, de tout ce qui peut servir à torcher. - (08) |
| torche, s. f., faisceau tordu de foin, de chanvre, de paille, etc. N'a rien de commun avec la torche éclairante ou incendiaire. - (14) |
| torche. Bourrelet d'étoffe en forme de couronne, que les laitières mettent sur leur tête pour recevoir le pot au lait. C’est un mot d'origine celtique : le torch était un diadème d'or ou de bronze qui ceignait le front des rois ou des chefs. - (13) |
| torchée : une correction, une volée, aussi toutouille - (46) |
| torcher (v.t.) : essuyer, frotter pour enlever la saleté - (50) |
| torcher : essuyer - (48) |
| torcher le nez, locution verbale : essuyer. - (54) |
| torcher, v. a. essuyer, frotter vivement. - (08) |
| torcher, v. essuyer (torche-toi donc la figure). - (65) |
| torchi - essû'illi : essuyer - (57) |
| torchi : Torcher. « Torchi les assiètes » : essuyer la vaisselle. - (19) |
| torchir : v. n., épaissir. - (20) |
| torchon de cheindre : une liasse de chanvre pour faire des cordes. - (33) |
| torchon : s. m., voir guenille. - (20) |
| torchon, s. m. torchon, quantité d'écorce de chanvre entrelacé, ce que produit une « pougnie de daignes. » « torçon. » - (08) |
| tord-bouayaux (on) : tord-boyaux - (57) |
| torde : tordre - (48) |
| torduse : part. pass. f., tordue. - (20) |
| toré : potage épais. (S. T III) - D - (25) |
| toré, s. m. terrier : le « tore » d'un lapin, d'un renard. - (08) |
| torè, sm. taureau. - (17) |
| toré, toriâ, taureau ; torie, génisse. - (16) |
| tôrée : boue épaisse - (39) |
| torée : n. f. Ordure. - (53) |
| torée, s. f. terre qu'on ramasse dans les cours de ferme ou sur les chemins et dont on se sert comme d'engrais ; boue, fange, qui renferme des détritus fertilisants. On emploie les « torées » pour améliorer les prairies. - (08) |
| torele (torle) : s. f., saillie formée par les cornes naissantes d'un animal. - (20) |
| torelé, vn. couvrir une vache. - (17) |
| toreler (Se) (se torler) : v. r., se doguer, se battre à coups de tête comme les bêtes à cornes, se heurter la tête mutuellement. - (20) |
| tôrer (se) : salir (se) - (39) |
| torer, v. a. couvrir de boue, crotter, salir. - (08) |
| torghé. : Frotter, essuyer avec une torche de paille tordue en paquet. (Rac. lat. torquere.) Les villageois demandent un torchon de paille pour frotter ou boucheter (dial.), c'est à-dire, étriller leurs chevaux en sueur. - Une torche (dans l'acception de flambeau) a dû être, dans l'origine, de la paille tortillée et enduite de résine. Le dimanche des Brandons, les villageois ont coutume dejeter en l'air des torches de paille ou de sarment enflammées. - (06) |
| torgigner. v. n. Faire des contorsions, des mouvements nerveux, en mangeant des fruits acides. (Courgis). - (10) |
| torgniole, torgniaûle : coup assené à quelqu'un, assez fort pour lui faire éclore une « gnole » (une bosse) - (37) |
| torgnole : gifle - (37) |
| torgnoler : gifler - (37) |
| toriau, et touriau, s. m., taureau. - (14) |
| törie, töre, sf. taure. - (17) |
| torie. Génisse, jeune vache qui n'a pas encore porté… - (01) |
| torie. Génisse. Nous disons également teurie et tourie. - (03) |
| torio : taureau - (44) |
| torjo. Voyez tojor. - (01) |
| torle Voir teurle. - (63) |
| torlicou : torticolis. - (33) |
| torlorigo ; boire à torlorigo, boire avec excès. - (16) |
| torlorigot (à) : à gros bouillons. - (32) |
| torlorigot (à), loc. adverbiale, beaucoup, considérablement. Corruption de « tire-larigot », mais employée dans une autre acception que celle de boire : « J'peux pas sôrtî ; i pleùt à torlorigot. » - (14) |
| torman, tourment ; tormanté, très inquiet et fortement sollicité. - (16) |
| torme, sm. terme. - (17) |
| torment : tourment - (51) |
| torment, s. m. tourment, inquiétude. - (08) |
| torment, s. m., tourment, inquiétude. - (14) |
| tormentation - tourment, chagrin. - Lai pôre Gotte ! quainne tormentation ile é de lai mailaidie de son homme ! - Mai chère Jeanne, que lai vie â don remplie de tormentations ! to les jors, quoi !... to les jors ! - (18) |
| tormentation, s. f. tourment, trouble, inquiétude d'esprit : « s' beillé d' lai tormentation », se donner du souci, du tracas. - (08) |
| tormentaule, adj. qui cause du tourment : les enfants sont bien « tormentaules. » - (08) |
| tormenter : tourmenter - (43) |
| tormenter : tourmenter - (51) |
| tormenter : Tourmenter. « Y sarve de ren de se tormenter ». « Y est le diabe que le tormente » : il a le diable au corps. - (19) |
| tormenter, v. a. tourmenter, inquiéter. - (08) |
| tormenter, v. tr,, tourmenter, inquiéter. - (14) |
| tormentin : Tourmenteur, ce mot n'est employé que dans l'expression « Saint-Martin, Saint Tormentin », allusion aux tourments de ceux qui, à la Saint Martin (14 novembre), doivent déménager ou simplement payer leur fermage. - (19) |
| tormentine, térébenthine. - (05) |
| tormentine. Térébenthine, par corruption. - (03) |
| tormindi, pour tourne-midi. Nom vulgaire de la chicorée sauvage (cliicorium intybus). - (08) |
| tornage (on) : tournage - (57) |
| tornailler, v. intr., tournailler, tourner de côté et d'autre sans but bien arrêté. - (14) |
| tornâiller, v. ne rien faire, aller et venir sans but. - (38) |
| tornailler, v., tourner en rond, sans but. - (40) |
| tornâiller. v. - Tournoyer. - (42) |
| tornâillou, s.m. celui qui "tornaille". - (38) |
| tornau (n.m.) : pelle à défourner le pain - (50) |
| tornè : tourner - è tornè, virè, è f’sè ran du tout, il tournait, virait, il ne faisait rien du tout - (46) |
| tornè, brâté : 1 v. t. Tourner. - 2 n. m. Gâteau vite fait. - 3 n. m. Pièce de bois pour sangler les chars. - (53) |
| torné, tourner ; s'torné, se tourner. - (16) |
| torneau, s. m. grande pelle de forme ronde sur laquelle on pose les galettes au sortir du four. - (08) |
| tornée : assolement. (RDC. T III) - A - (25) |
| tornée : tour. En vl'ai ène tornée ! : en voilà une affaire, une histoire ! - (52) |
| tornée, s. f. tournée, promenade : « fera eune tornée », sortir de chez soi, faire un tour. - (08) |
| tornée, s. m., tournée : « L'piéton a fini sa tornée. » - (14) |
| tôrner (se) v. Se retourner. - (63) |
| torner : tourner - (51) |
| torner : tourner - (57) |
| torner : tourner - (48) |
| torner : Tourner. « Torner le deu à quéquin ». - Retourner. « Torner les jevales ». - S'altérer. « Man vin a torné ». - (19) |
| tôrner v. 1.Tourner. 2. Retourner, bouleverser. Y li a torné les sangs ! Ça l'a bouleversé, il en est tombé malade. - (63) |
| tôrner v. Tourner. Tôrner le cul au râtiau. Refuser la nourriture (en parlant d'une vache). - (63) |
| torner, et teùrner, v. tr. et intr., tourner, et aussi retourner : « Piarot, torne-te, qu'on te vouéye eùn brin. » - (14) |
| torner, v. a. tourner, détourner, changer la direction par un détour, conduire à une autre place. Pour rassembler un troupeau qui est en dommage, le maitre crie à ses « valôts : torné lé beurbis, torné lé vaiches ! » - (08) |
| tôrner, v. tourner. - (38) |
| Tôrneu: Tournus. « La foire de Tôrneu est le premé san-médi du mois ». - (19) |
| tornia (na) : tournée - (57) |
| torniboélle (n.f.) : culbute - (50) |
| torniboelle, s. f. culbute : « fére lai torniboelle », culbuter. Ce terme est très usité clans notre région ou plutôt il est le seul employé pour exprimer la chose. - (08) |
| torniôle, s. f., torgniole, coup : « O m'fesòt mau ; ma j'te li é fichu eùne boune torniòle. » - (14) |
| tornis (je), prét. de torner : « Je tornis, je r’tornis... J'ai évu biau fâre ; j'n'ai ran treuvé. » - (14) |
| tornis, s. m., tournoiement, maladie (hydalite dans le cerveau) qui envahit parfois les troupeaux de moutons. Ces bêtes, alors, perdent l'appétit, baissent la tête, tournent du môme côté, ont des vertiges, chancellent et tombent. On appelle encore ce mal lordòt. (V. ce dernier mot.) — Même cause que la pourriture, qui réside dans le ventre, tandis que le tornis frappe le cerveau. - (14) |
| tornot - planche ou plateau rond sur lesquels on met les galettes, les flans, avant de les enfourner. - Prautezmoi don deux tornots, tenez ; voiqui pui vâ chauffai le for. - In tornot et in roulot, c'a bein quemôde. - (18) |
| tôrnot, s.m. ciel de lit. - (38) |
| tornotte (nom féminin) : corbeille en osier. - (47) |
| tornoû : pièce de bois pour enrouler la corde sur le virot - (48) |
| torpilli : torpiller - (57) |
| torre (tourri) : génisse - (51) |
| torreau - tertre, éminence de terrain. - I l'ai trouvai su le torreau de lai Prée. - Te m'aitendrée â dessu du torreau, teins. - (18) |
| torrée (tas de) : de cendres. (E. T IV) - S&L - (25) |
| torrée : terreau, boue épaisse - (48) |
| torro : fossé. (E. T IV) - VdS - (25) |
| torsaillue. n. f. - Entorse. (Bléneau, selon M. Jossier) - (42) |
| torsaillue. s. f. Entorse. (Bléneau). - (10) |
| torser : essuyer - (39) |
| torson : torchon - (39) |
| tort (faire). loc. verb. - Faire frissonner de douleur, de gêne : « Te vas-ti arréter d'grincer des dents, te m'fais tort ! » (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| tortaille, adj. tordu. - (38) |
| tortaillou, -ouse, s. qui marche en zig-zag. - (38) |
| tortampion - homme amuseur, qui perd son temps, qui embarrasse au lieu d'aider. - T'é in tortampion, vais. - C'â in tortampion c't'homme lai ; en ne peut pâ du tot comptai su lu. - (18) |
| tortampion, adj., boiteux, qui oscille fortement des deux côtés, comme un battant de cloche : « La vouéte-vous aller couci-couça, d'avou sa panière au brai? Y ét eùne drôle de tortampione ! » (V. Gambi, Jarréard, Tortibi.) - (14) |
| tortampion. : (Tortis pedibus), qui a les pieds tordus ou contrefaits. - (06) |
| tortchau d'eau. Nénuphar. - (49) |
| tortchau, tortiau. Crêpe cuite dans la « casse ». - (49) |
| tortchére, gouére. Sorte de crêpe épaisse généralement cuite au four. L'ustensile de cuisine qui sert à les faire cuire se nomme aussi « tortchére ». - (49) |
| tortchiére : petit four de campagne - (39) |
| tôrte, s. f. tourte, gros pain de forme arrondie. - (08) |
| tôrte, s. f., tourte, pâtisserie. - (14) |
| tôrte, tourte, et tôrtelòte, s. f., tourterelle. - (14) |
| torte, tourterelle. - (05) |
| tortè. Bâton de bois servant à faire tourner un cylindre de bois, placé à l'arrière d'un char à ridelles, sur lequel s'enroule un câble qui sert à consolider un changement de foin. - (49) |
| tortè. Sorte d'échelle suspendue à plat au plafond de la maison, pour placer les tourtes de pain. - (49) |
| torte. Tourte de pain. - (49) |
| torteillai : tortiller. On dit aussi torteillai une petite branche pour en faire une rouette. - (33) |
| tôrteillar, teurteillar, s. m. bûche de forme irrégulière et qui est rejetée comme défectueuse à l'époque de l'empilage des bois de moule. - (08) |
| tôrteiller, teurteiller, v. a. tortiller, tordre fortement ou en plusieurs places, faire des courbes, des sinuosités. (voir : entorteiller.) - (08) |
| torteiller, v. tr., tortiller, tordre. - (14) |
| torteillio pot viro : treuille rudimentaire permettant d'attacher un chariot de foin en vrac. - (33) |
| torteillon, s. m., paille tortillée, bois, chiffon tordu, — et aussi petite servante de village. - (14) |
| tôrteillon, teurteillon, s. m. morceau de bois tordu ou propre à être tordu, poignée de paille ou de foin tortillé pour différents usages. (voir : torchon.) - (08) |
| Torteillot : manivelle du treuil. La corde étant fixée au bout de la parche (perche), le torteillot permettait d'enrouler la corde au pot viro. - (33) |
| torteillot : morceau de bois pour serrer le contenu d'un chariot (comme virôt) - (39) |
| tortenpion et tartenpion. Adjectif bizarre qui s'applique aux personnes qui ont les jambes arquées et qui marchent de travers. C’est un mot de la langue enfantine : on dit à un bébé tu tords ton pion lorsqu'il tourne en dedans la pointe de ses pieds. - (13) |
| torteralle (n.f.) : tourterelle - (50) |
| tortet (on) - jaron (on) : trique - (57) |
| tortet (on) - ringâ (on) - trique (na) - ragot (on) : bâton - (57) |
| tortet, s. m., bâton court et noueux, servant à frapper ou à abattre les fruits des arbres. - (11) |
| torteuilli v. Tortiller. - (63) |
| torte-yi : tortiller - (43) |
| torti (tortire) (tchantchau) : stockage du pain sur deux barres de bois pendues au plafond - (51) |
| torti : (nm) sorte d’échelle suspendue sur laquelle on entrepose les pains - (35) |
| tortî, tortiaud n.m. Râtelier à pain (on retrouve la tourte, le tortia panis médiéval, le pain rond). - (63) |
| tortiâ-torté : n. f. Tourte. - (53) |
| tortiaux : (toujours employé au pluriel, "tortial" n'existe pas, et pour cause) paire de sabots. Ex : "Oute-moué tes tortiaux, té vas tout m'salie !" - (58) |
| tortibi, adj., tortu, bossu, bancal, quiconque a une forme déviée. Devient volontiers le nom propre du mal partagé : « Dis donc, Nan-néte, Tortibi voudròt ben t'fâre les doux zieùs. » - (14) |
| tortière : tourtière. Cocotte en fonte large, peu profonde et munie d'une anse. On y cuisait grapiau et râpée avant l'apparition de la poêle. - (52) |
| tortillard : s. m., nom qu'on donne au tramway de Mâcon à Fleurville en raison du tracé sinueux de la voie et surtout du mouvement de roulis auquel sont soumis les voyageurs. - (20) |
| tortilli : tortiller - (57) |
| tortillon : gros morceau - (60) |
| tortin : roublard - (60) |
| tortire (torti) (tchantchau) : stockage du pain sur deux barres de bois pendues au plafond - (51) |
| tortis. : Assemblage de fils tordus en un faisceau. C'était un ornement proscrit pour certaines classes, par l'édit somptuaire municipal de Dijon de 1380. - (06) |
| torto - tous. – Se met à la fin d'une phrase ou d'un membre de phrase. - Vos veinras torto, sans manquai. - Al étaint torto ai lai messe. - (18) |
| tortos : (tortô: - pronom indéfini) tous ; selon un procédé de renforcement du pronom ; le préfixe est probablement équivalent à "très", ce que confirme le sens du mot : "tous sans exception". - (45) |
| tortosa : soucis - (44) |
| tortouéiller : tortiller - (48) |
| tortsi : (vb) essuyer - (35) |
| tortsi : torcher - (43) |
| tortsi : torcher - (51) |
| tortsi v. Torcher. - (63) |
| tortson : torchon, serviette de table - (51) |
| tortson n.m. Torchon. - (63) |
| tortsonner : passer le torchon (torchonner) - (51) |
| tortsonner v. Saboter, mal exécuter un travail. - (63) |
| toru, e, adj. pâle, défait. - (08) |
| torzeiller, v. a. tordre, tortiller. - (08) |
| torzeilleure, s. f. entorse, foulure du pied. - (08) |
| tos, tot pron., adv. Tous. On ne dit tos que dans de rares cas, la règle est de dire tot. Ô les a tot pris ! mais Y'est pas p'tos pareil ! - (63) |
| tossai - tousser et téter. - Voir Teussai et Totai. - (18) |
| Tossain. La fête de la Toussaint… - (01) |
| tôssaingn' (lai), s. f. la toussaint, la fête de tous les saints. - (08) |
| tossaint : Toussaint. - (19) |
| tossè : téter, sucer (aussi teusser) - (46) |
| tösse, sf. tisse, tas de céréales ou de foin à l'intérieur des granges. Meule au dehors. - (17) |
| tossé, téter. - (16) |
| tossé. Tousser, toussez. - (01) |
| tosser : têter. - (29) |
| tosser, têter. - (28) |
| tossir (v.t.) : tousser - (50) |
| tot (ö), sm. toit. - (17) |
| tot : tout - (51) |
| tôt : Tout. « Le sola lut pa toi le mande ». « I se sant tot dit » : ils se sont dit les pires injures. « Aile a ésu en se mairiant eune dozain-ne de tot linge » : elle a eu en se mariant une douzaine de chaque sorte de linge composant un trousseau complet. « Tot par in co » : tout à coup. Au féminin, tote. « Tote la jorné ». - (19) |
| tot comptan, loc. tout comptant, tout de suite, sur le champ, immédiatement : j'y vais « tô comptan », j'y vais de suite. - (08) |
| tot dré : tout droit - (51) |
| tot mitenant, adv. ; tout à l'heure. - (07) |
| tôt partôt, loc. tout partout, à toute place, en tous pays : « i é veu ç'lai tôt partôt. » - (08) |
| tot pr'un cop loc. Tout à coup. - (63) |
| tôt p'un cop : (exp. adv.) tout à coup - (35) |
| tot p'un coup : tout d'un coup, soudain - (51) |
| tot pyien loc. adv. Beaucoup. - (63) |
| tòt pyin, loc. beaucoup, en quantité ; littéralement « tout plein » : avoir tòt pyin d'argent, tòt pyin d'enfants. - (24) |
| tot son saoûl : tout son saoul - (51) |
| tot sou : tout seul - (51) |
| tôt, tote : (adj.) tout, toute - (35) |
| tot, tote pronom. Tout, toute. - (63) |
| tôt, tote, adj. tout, toute : « i seu tô mailaide ; ile étô tote ailoirie », je suis tout malade, elle était tout étourdie. - (08) |
| totai et tossai - téter. - Beille don ai totai ai tai petiote. - Le père Raveau, lu, c'a lai bouteille qu'a tosse. - Métenant, les enfants totant bein â biberon. - (18) |
| tôt'bise : exp. À toute vitesse. - (53) |
| toté : tous (adj. indéf.) « toté tra » tous les trois - (35) |
| tote : toute - (43) |
| tôte. Toute, toutes. - (01) |
| tôtefoi. Toutefois. - (01) |
| toteine, s. f. tétine, pis de la vache, de la brebis, de la truie, etc. - (08) |
| totens. : (Dial.) «Par totens de toutes les manières. » (S. B.) - (06) |
| toter (v.t.) : téter - (50) |
| tôter : tâter - (57) |
| toter : téter - (48) |
| toter : (totè - v. trans.) téter. Al o: tan qu'lè vèch' sè toté: , son lè pich' è bâ: "il est temps que la vache soit tétée, son lait coule à terre. - (45) |
| toter : téter - (39) |
| toter, v. a. téter, sucer la mamelle d'une nourrice : « son p'tiô tote encoi », son enfant tette encore. - (08) |
| toteuilli, tortiller... On dit dans le Châtillonnais tatouiller. (Voir au mot Tatouillai.) ... - (02) |
| toteuilli. : En vieux français tortuer. (Du latin torquere.) Ce mot a un sens déshonnête. On dit dans le Châtillonnais, tatouiller. - (06) |
| totevillai, tortiller, aller en zigzag... - (02) |
| totine : (totin') tétine. - (45) |
| totiot : la cheville en bois du virot - (46) |
| totitô. : Petits gâteaux, et totéa pâte à engraisser la volaille. (A. P., 2• et 3• noëls de mon recueil.) - (06) |
| totjelöt, sm. michot de pain grossier. - (17) |
| tot-lolo, tout-lolo : s. m., enfant dégénéré physiquement et psychiquement. - (20) |
| toto : 1- la mamrnelle pour la vache ou la truie. 2 - le sein de la femme. - (45) |
| toto : pou - (48) |
| toto : pou. - (66) |
| toto : téton - (48) |
| toto de rê : un téton de rat (ironique, pour désigner qqch. de minuscule). - (56) |
| totô, souliers... - (02) |
| toton (tôton) : s. m., osselet. Jeu de totons, jeu d'osselets. - (20) |
| totosse : une tétine d'enfant, une cheulotte - (46) |
| totôt, s. m. trayon de vache ou de truie, tétine de la mamelle, bout de sein. On prononce en plusieurs lieux «tétôs ». - (08) |
| totoû : se dit d'un enfant qui tète son pouce - (48) |
| tot-pliaint : Litt. Tout plein, beaucoup. « Y avait tot pliaint de mande au bal ». - (19) |
| totréle : (tot'rèl') trayon. - (45) |
| totse à totse loc. Côte à côte. - (63) |
| totseux n.m. Toucheur, maquignon, marchand de bestiaux. - (63) |
| totsi (les vatses) v. Guider à l'aiguillon. - (63) |
| totsi : (vb) toucher ; mener (les vaches) - (35) |
| totsi : toucher, mener (vaches) - (43) |
| totsi v. Toucher. - (63) |
| totsou d’vatses : (nm) bouvier - (35) |
| totsou d'vatses, « quand on labore avu 4 vatses il faut un totsou » : bouvier - (43) |
| tottou : celui qui tête son pouce - (37) |
| tou (n.m.) : conduit, rigole ou canal ; voûte d'étang - (50) |
| tou : (nm) petit crapaud - (35) |
| toû : petit crapaud - (43) |
| tou : petit crapaud. (B. T IV) - D - (25) |
| tou : petit crapaud. Dicton : le tou chante lai pleue. (RDM. T IV) - B - (25) |
| tou : Rainette, petite grenouille. - (19) |
| toû bôt : crapaud - (37) |
| tou, n.m. petit crapaud. - (65) |
| tou, s. m. ouverture, conduit, rigole, canal, voûte d'étang. - (08) |
| tou, s. m., aqueduc établi sous une route, sous une chaussée. - (14) |
| tou, s.m., petit crapaud nocturne. - (40) |
| touâ : taie (d'oreiller, d'édredon) - (48) |
| touâdre : tordre - (57) |
| touai (pron.pers.2ème du m.et f.s.) : toi - (50) |
| touai : le toit - (46) |
| touai, tai : pron. pers. Toi. - (53) |
| touaie (n.f.) : taie d'oreiller - (50) |
| touaîlage (on) : toilage - (57) |
| touaíle (n.f.) : toile - (50) |
| touaîle (na) : toile - (57) |
| touaîlerie (na) : toilerie - (57) |
| touailes (lâs) : (les) draps du lit, mis dans le lit - (37) |
| touailes (s’fouîner â) : aller se coucher - (37) |
| touaílette (n.f.) : toilette - (50) |
| touailette (na) : toilette - (57) |
| touâillè : v. t. Faire de grandes enjambées. - (53) |
| touâillée : n. f. Grande enjambée. - (53) |
| touaíller (v.t.) : marcher vite - (50) |
| touailler : enjamber, franchir. (RDM. T IV) - B - (25) |
| touâiller : marcher à grands pas - (48) |
| touailler : (touâ:yé - v. intr.) marcher vite et à grandes enjambées : la toise mesurant 1m.94, cela supposerait de grands pas ! Toiser en français signifie évaluer une longueur ; le verbe évoque ici plutôt la démarche de l'arpenteur qui allonge le pas pour mesurer une bordure de champ. - (45) |
| touailler, v. n. marcher vite, s'avancer en hâte, à grands pas. - (08) |
| touailleure : (touâ:yeu:r') barres en bois qui solidarisent les deux ridelles ; elles sont terminées à chaque extrémité par un demi-cercle métallique (les boué:t') et fixées par des chevilles ; la touâ:yeur' du bas est plus courte que celle du haut. - (45) |
| touaillie : (touâ:yi:) une grande enjambée. - (45) |
| touaillon, tuaillon. Sorte de pinceau fabriqué avec des petites lanières de toile fine, employé généralement pour badigeonner la gorge. Pinceau. - (49) |
| touailloner. Badigeonner la gorge en cas de laryngite, de diphtérie. - (49) |
| Touaine (l’) : (l’) Antoine - (37) |
| touair’cée : correction corporelle - (37) |
| touairais : petit taureau - (39) |
| touairc’ée : essuyée, mouchée, terminée - (37) |
| touairc’er : essuyer, moucher, terminer - (37) |
| touairc’er l’lit’e : boire le litre plein, en entier - (37) |
| touairdu : tordu - (37) |
| touairie : taure - (39) |
| touaise (aine) : (une) toise, mesure de longueur (1m949) - (37) |
| touaîse (na) : toise - (57) |
| touaîser : toiser - (57) |
| touaisiéme (adj.num.ord.) : troisième - (50) |
| touait (n.m.) : 1) toit - 2) appentis, cabane - 3) porcherie - (50) |
| touaît (on) : toit - (57) |
| touait : écurie des poules, des oies, des porcs, des chèvres - (37) |
| touaîture (na) : toiture - (57) |
| touard’e : tordre - (37) |
| touarde, touerde (v.t.) : tordre (aussi toirde) - (50) |
| touardu (p.p.) : p.p. du verbe tordre - (50) |
| toubà, s. m., tabac. A ses passionnés. Quand un nécessiteux vous demande quelques sous, c'est plutôt pour son tabac que pour son - (14) |
| touché (oū), vt. frapper fort. - (17) |
| toucher (v.t.) : tousser - (50) |
| toucher. v. - Foncer, courir très vite : « T'aurais vu l'yeuve et les deux chiens derriée ! Ca touché pa' la plaine, fallait voi' ça!» (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| touche-touche, à touche-touche, touche-a-touche, Ioc, adv., côte â côte. Mol et lui nous habitons touche-â-touche. - (20) |
| touchi : torcher - (57) |
| touchi : toucher - (57) |
| touchi : Toucher. « Regarde z' y mâ n y touche pas ». Frapper le bétail pour le faire avancer. - (19) |
| toudze, toudzo : (adv.) toujours - (35) |
| toudze, toudzo adv. Toujours. - (63) |
| toue ! toue ! : interjection utilisée pour appeler les chiens ou pour chasser les buses - (39) |
| touë ! touë, appel adressé aux chiens pour les faire venir. - (14) |
| toué (adjectif) : toi. - (47) |
| touè : toi - (48) |
| touè : toit - (48) |
| touè : toit - (39) |
| toué. pron. pers. - Toi. - (42) |
| touée (n.f.) : terrier, tanière de blaireaux, lapins, renards... - (50) |
| touée (nom féminin) : taie d'oreiller. - (47) |
| touée, s. f. taie d'oreiller. dans les villes voisines, « toie » - (08) |
| toueile : toile. - (32) |
| toueille, s. f. toile en général. - (08) |
| touéillon : torchon, chiffon - (48) |
| toueillon ou toillon. Linge de toile usé qui sert à laver la vaisselle. Prends ton toillon pour récurer les aissiettes... - (13) |
| touèle : la toile - (46) |
| touèle. n. f. - Toile. - (42) |
| touèlette : péritoine du porc - (48) |
| Touène : diminutif de Antoine - (48) |
| touèrâ, touèrê : taureau - (48) |
| touèrde : tordre - (48) |
| touèrè : (touèrê: - subst. m.) taureau ; la touèri: est la taure, la génisse ; quand le veau mâle est castré, il se nomme châ:tron, et devient embô:ch', quand on le met à l'engraissement pour le vendre. - (45) |
| touèrie : génisse, taure - (48) |
| touet : 1. toit. 2. soue, poulailler. Diminutif : touèton. - (52) |
| touet : cabane à cochon, à volailles… - (33) |
| touét. n. m. - Toit. - (42) |
| touèton : petit toit - (39) |
| touéton, toiton. n. m. - Petit bâtiment en pierre adossé à la ferme, et recouvert d'un toit d'un seul versant. Le touéton est utilisé comme poulailler, clapier, porcherie etc. - (42) |
| touétue. n. f. - Toiture. - (42) |
| toufe, adj. lourd et humide, dans l'expr. : il fait touffe. - (17) |
| toufeur : chaleur. - (29) |
| toufeur, chaleur suffocante ; é fé toufeur, on étouffe de chaleur. - (16) |
| touffan, ante, adj. étouffant, suffocant : « l’temps ô touffan. » - (08) |
| touffeur : chaleur étouffante - (48) |
| touffeur : chaleur lourde, étouffante ; également sens d'aliment ou plat trop sec, qui étouffe. - (56) |
| touffeur, touffoyer, chaleur suffocante. - (05) |
| touffeur. Chaleur étouffante et lourde, approche de l'orage. Ce mot s'emploie sans article, et seulement avec le verbe faire. Ex. : « Il fait touffeur aujourd'hui, je ne sortirai pas. » Etym. étouffer avec l’aphérèse de l’é initial. - (12) |
| touffiée. n. f. - Fumée épaisse. (Mézilles, selon H. Chéry) - (42) |
| toufo, petite touffe. - (16) |
| tougnard, tougnarde : adj., qui tougne. - (20) |
| tougne ou tougnèche. s. f. femme indolente. - (24) |
| tougne, s. f. femme indolente. - (22) |
| tougne, tougnasse : s. f., femme ou fille tougnarde et indolente. - (20) |
| tougneau (nom masculin) : tonneau. - (47) |
| tougner : v. n., pleurer, pleurnicher. - (20) |
| tougni, v. n. pleurnicher. - (22) |
| tougni, v. n. pleurnicher. - (24) |
| tougnon, tougnasson : s. m., homme ou garçon tougnard et indolent. - (20) |
| touh-tien, touh-touh. interj. - Appel du berger pour faire revenir son chien : « Touh-tien Dick ! » - (42) |
| touiller : agiter, mélanger pour obtenir plus d'homogénéité (cuisine), par des pressions verticales au moyen d'un ustensile (cuillère en bois, etc...). - (56) |
| touîller : bien remuer un mélange liquide - (37) |
| touilleuse n.f. Petite cuillère. - (63) |
| touilli : touiller - (57) |
| touilli v. Touiller, remuer. - (63) |
| touïllon (oū), sm. farceur, vaurien. - (17) |
| touillon : lavette - (44) |
| touillon : lavette munie d’un manche - (35) |
| toûillon : toison - (48) |
| touillon n.m. Morceau de paille liée pour nettoyer, frotter. - (63) |
| touillon : s. m., vx fr. toaillon, syn. de panouillon. - (20) |
| touillon, femme malpropre... - (02) |
| touillon, n.m. lavette. - (65) |
| touillon, panoyon : lavette munie d'un manche - (43) |
| touillon, s. f., femme négligée. - (40) |
| touillon, s. m. lavette, pinceau à laver (du vieux français loaille, serviette). - (24) |
| touillon, s. m. lavette, pinceau à laver. - (22) |
| touillon, s. m. torchon, toute espèce de linge dont on se sert pour essuyer, pour torcher. - (08) |
| touillon. Lavette généralement fabriquée avec les feuilles qui enveloppent l'épi de maïs. Sert à laver la vaisselle. - (49) |
| touind’e : tendre, tirer dessus, allonger - (37) |
| touinde : teindre - (48) |
| touine : Veston. « Ol a sa touine seu san gaban ». - (19) |
| touinter : teinter, teindre - (37) |
| touinteure : teinture - (48) |
| toûjon n.m. Drainage de fortune fait avec des matériaux de récupération divers. - (63) |
| toujou (adv.) : toujours - (64) |
| toulâs : chaume après moisson - (39) |
| toule (n. f.) : sorte de jarre où l'on conserve l'huile, l'eau-de-vie (syn. toulon) - (64) |
| toûle (na) : nénuphar - (57) |
| toule : cruche en grès (mot très ancien) - (60) |
| toule : espèce de bonbonne en grès. (VC. T II) - A - (25) |
| toule : récipient en terre servant à stocker l'huile. - (33) |
| toûlè : v. i. Beugler. - (53) |
| toule, s. f. vase en poterie dans lequel on met ordinairement la provision d'huile. - (08) |
| toule, toulon : jarre de terre cuite vernissée de forme ventrue à fond plat, avec goulot étroit et comportant 2 anses "en oreilles" opposées. Elle sert à contenir des liquides, et notamment, de l'huile de noix (ingrédient de base alimentaire d'usage quasi-quotidien) Ex : "J'ons ben des calons à c't' an - née. J'vons brament en fée deux bounes toules." Une petite toule est un toulon. - (58) |
| toûle. n. f. - Grosse poterie en grès à deux anses. (Voir F.P. Chapat, p.l89) - (42) |
| toule. s. f. Grosse bouteille. (Puysaie). - (10) |
| touler : (tou:lè - v. intr.) produire un son dans un instrument à vent ; sens volontiers dépréciatif, d'autant que le verbe s' emploie pour klaxonner. La toulot' est la petite corne qu'emploient les chasseurs pour se repérer et appeler leurs chiens. - (45) |
| touler, v. a. appeler quelqu'un en criant : « tou, tou ! » - (08) |
| toulipe, s. f., tulipe. - (14) |
| toulipe, sf. tulipe. - (17) |
| toulipe, tulipe. - (16) |
| toulon (n. m.) : sorte de jarre où l'on conserve l'huile, l'eau-de-vie (syn. toule) - (64) |
| toulon, s. m. vase en poterie dans lequel on met l'huile. - (08) |
| toulon. n. m. - Petite poterie en grès avec une anse et un petit bec verseur. - (42) |
| toulon. s. m. Petit tonneau, bouteille, vase, amphore. (Perreuse). - (10) |
| toûlotte : n. f. Flûte, mais aussi un instrument à vent rudimentaire qui fait du bruit. - (53) |
| toulotte, s. f. tête. - (08) |
| toumai : verser, ou renverser. Les buveurs toumont bien : les buveurs versent bien. - (33) |
| toumate. n. f. - Tomate. - (42) |
| toumer : verser, ou renverser. - (52) |
| toumer : verser, renverser - (39) |
| toumer, tumer (pour tomber). v. a. Verser, renverser. Quand deux hercules luttent l’un contre l'autre, celui qui renverse son adversaire, dit qu’il l’a tombé, qu’il l'a tumé. - (10) |
| toun, adj. poss. 'ton' devant une voyelle : toun éraille, ton oreille. - (38) |
| toun. adj. poss. - Ton. - (42) |
| toûnâ n.m. Tonnerre. - (63) |
| tounâre mé breule : juron. VI, p. 7 - (23) |
| tounâre, s. m. tonnerre : « tounàre d'eun chien » ou « d'ain cien ; tounâre de loup vârou ; que l’ tounâre m' breule ! ! » autant d'exclamations familières au Morvandeau lorsqu'il veut affirmer sa foi devant les hommes. - (08) |
| tounàre, s. m., tonnerre. Sert fréquemment de juron : « Ah ! te n'voux pas m'acouter. . . mille-tounâres ! » - (14) |
| tounare, tonnerre - (36) |
| touné, teuné, tonner ; tounâr, tonâr, tonnerre. - (16) |
| toune, tonne, s. f. tonnerre. la « toune » d'avril, suivant le dicton agricole du pays, fait les biens réjouis, c'est-à-dire les récoltes prospères. - (08) |
| toùneau, s. m., tonneau. - (14) |
| touneille, s. m. tonnerre. adoucissement du viril « tounâre. - (08) |
| touner : tonner - (43) |
| touner : tonner - (61) |
| toûner v. Tonner. - (63) |
| touner : tonner - (39) |
| touner, v. intr., tonner. - (14) |
| touner, v. n. tonner : « acouté comme a toune. » - (08) |
| touner, v. tonner. - (38) |
| touniaû (on) : tonneau - (57) |
| touniau : tonneau. - (52) |
| tounnâ : (nm) tonnerre - (35) |
| tounnâ, s.m. tonnerre. - (38) |
| tounnâre : tonnerre - (43) |
| tounne (lai), (l’) tounnârre : (le) tonnerre - (37) |
| toûnne lai : le tonnerre, il se disait beaucoup le quatrain suivant, au sujet d’une conversation entre un homme et une femme aux champs : « y crai ben qu’y toûnne ! - mai boûnne ! - mâ non ! paûrre hoûmme ! - y ot mon dârré qu’beûrdoûnne ! » - (37) |
| tounne, tonne (n.f.) : tonnerre - (50) |
| tounneiller, tonneiller. n. m. - Artisan qui fabrique ou répare les tonneaux ; déformation de tonnelier. - (42) |
| tounner, teunner. v. - Tonner. - (42) |
| tounnerre, teunnerre. n. m. - Tonnerre. - (42) |
| tounniau (n.m.) : tonneau - (50) |
| tounniau, tounneau. n. m. - Tonneau. - (42) |
| toupat. s. m. Petit morceau de bois. (Nailly). - (10) |
| toupe, s. f. mauvaise pâture, friche. - (22) |
| toupé, v. a. heurter de la tête : il s'est toupé à la poutre. - (22) |
| touper : v. n., syn. de daguer. - (20) |
| touper, v. a. heurter de la tête : il s'est toupé à la poutre. Pour le bétail on dit teurler. - (24) |
| toupillai, tourner comme une toupie. - (02) |
| toupillai. : Sauter ou tourner comme une toupie, de même que trebillai c'est tourner comme un treb i; car ces choses et ces mots se ressemblent et ont même origine. - Par extension, le même mot signifie fouler aux pieds, marcher sur. On dit triper sur la robe d'une femme. – Trebillai c'est tourner sur soi-même et se trémousser. - (06) |
| tour, n.m. treuil. - (65) |
| tour, tour a batir (bâtir) : s. m., outil dé tonnellerie, basé sur le même principe que le serre-nœud chirurgical (voir Larousse illustré), et que l'on emploie pour faire joindre les douelles d'un fût. - (20) |
| tourbillé : v. i. Ne pas marcher droit. - (53) |
| tourdio : gâteau épais. - (30) |
| touriau : taureau. Ex : "Demain, j'mène la barrée au touriau !" - (58) |
| touriau. n. m. - Taureau. - (42) |
| tourie : (nf) génisse - (35) |
| tourie : génisse - (43) |
| tourie : une génisse - (46) |
| toûrie n.f. Génisse. - (63) |
| tourie, génisse. - (05) |
| tourie, taurie (n.f.) : génisse - (50) |
| tourie, torie. Taure, génisse. - (49) |
| tourillon (on) : taurillon - (57) |
| tourillon, s. m. courtilière, insecte qu'on nomme quelquefois taupe-grillon. - (08) |
| tourillon, taurillon (n.m.) : courtillière - (50) |
| tourmidi (pour tourne-midi). s. m. Chicorée sauvage, ainsi appelée, dit Jaubert, à cause de ses fleurs météoriques, ou dont l’épanouissement est soumis à l’influence de la lumière, et qui, quoique sessiles, se tournent vers le soleil. (Diges). - (10) |
| tourmidi, tourn'midi. n. m. - Chicorée sauvage. - (42) |
| tourn’bouler (pour tournebouler). v. n. Tourner sur soi-mème. — Faire tourn’bouler sur lui-même. (Auxerre). - (10) |
| tournache : s. f., vx fr. tornace, tour forte. Nom d'un écart de la commune de Charnay-lès-Mâcon. - (20) |
| tournage, s. m. changement de position au jeu de billes. Le joueur mal placé demande le tournage à moins que son adversaire n'ait dit à l'avance : « fen tournage », sorte de veto qui interdit probablement le changement de place. - (08) |
| tourneau. s. m. Plateau de bois circulaire, sur lequel les ménagères étendent et manipulent avec la roulotte la galette qu'elles veulent faire. - (10) |
| tourne-cul : s. m., toueur, remorqueur à une seule aube placée à l'arrière. Littré ; grappin. - (20) |
| tournée (aine), (aine) teûrnée : (un) grand nombre, beaucoup - (37) |
| tournée (tapée) : un grand nombre - (51) |
| tournée : rigole, petit fossé pour arroser - (43) |
| tournée, sévère correction administrée à un enfant ; exprime aussi un certain laps de temps comme dans l'expression : J'ai travaillé une bonne tournée. - (27) |
| tourne-merde : s. m., tête du cochon, et spécialement le groin. - (20) |
| tourne-midi (n. m.) : collation que l'on prend vers dix heures du matin - (64) |
| tourner : se tourner en = se transformer en... III, p. 18 - (23) |
| tourner a la mort : loc, entrer en agonie. - (20) |
| tourner comme une treuffe, locution verbale : mal fonctionner. - (54) |
| tournevan : (nm) demie-porte superposée à une porte pleine - (35) |
| tournevent : demi-porte pleine - (43) |
| tournevoillon, s. m. collation nocturne à la fin de la « voille » ou veillée. Le tournevoillon se compose ordinairement d'aliments peu substantiels, de noix, de châtaignes, etc., assaisonnées de quelques verres de vin blanc ou rouge. - (08) |
| tourniau : étourneau. VI, p. 16 - (23) |
| Tourniau : nom de mulet. VI, p. 16 - (23) |
| tourniau, tourneau. n. m. - Assiette en grès au bord relevé et au fond percé de trous, utilisée pour égoutter le fromage blanc. (Voir F.P. Chapat, p.l89) - (42) |
| tourniau. s . m. Sansonnet. (Annay-sur-Serein). - (10) |
| tourniaûle : mot féminin signifiant le tournis (virot) - (46) |
| tournibranle. n. m. - Se dit d'une personne mal faite physiquement, « mal branlée ». - (42) |
| tournibranle. s. m. Homme mal tourné, mal bâti. (Perreuse). - (10) |
| tournis, teûrnis, lourdot : vertiges, fort mal de tête - (37) |
| tournivoler, tourniboler, tournibouler. v. - Tourner sur soi-même : « Ça tournibolait autour de lui, coumme des ch'vaux d'bois. » (Fernand Clas, p.270). Déformation du français tournebouler. - (42) |
| tourno : planche à hacher. (S. T III) - D - (25) |
| tournot. Plateau circulaire en bois sur lequel on travaille la pâtisserie. - (13) |
| tournue. s. f. Pour tournure, sole, alternement de culture. (Etais). - (10) |
| tournûre ; on demande à quelqu'un si un temps depuis longtemps pluvieux ou trop sec finira bientôt, et il répond : é n’an pran pâ lai tournûre, pour : rien n'en donne l'indice. - (16) |
| tourquiau, s. m. tourteau, miche de pain. - (08) |
| tourquiéle, s. f. tourtière, marmite peu élevée dans laquelle on fait cuire les galettes. - (08) |
| tourri (torre) : génisse - (51) |
| tours (faire les...) : faucher le blé à la faux tout autour du champ pour ménager un passage à la moissonneuse-lieuse (il n'était pas rare que des champs, souvent exigus, soient d'un côté ou tout autour ceints de haies rendant le travail de la machine impossible directement). - (58) |
| tourte (na) - touârtale (na) : tourterelle - (57) |
| tourte : Tourterelle. « In nid de tourte ». - (19) |
| tourte : une galette de pommes de terre râpées. - (33) |
| tourte d’pain (aine) : (une) miche de pain de forme arrondie - (37) |
| tourte : n. f. Galette de pommes de terre râpées, non pas avec les râpes d'aujourd'hui qui font des languettes, même fines, mais avec une râpe qui donne une purée de légumes crue, égouttée, mélangée avec le fromage de la ferme, prises à la cuillère et aplaties en galettes dans la friteuse. - (53) |
| tourte, s. f., tourterelle. - (40) |
| tourte, s.f. pigeon, tourterelle. - (38) |
| tourte. n. f. - Tourterelle. (Arquian) - (42) |
| tourte. Tourterelle, par contraction du latin turtur. - (03) |
| tourticouli : Torticolis. « J'ai étrapé in tourticouli, je peux pas brâter la tête ». - (19) |
| tourtier : claie suspendue pour rangement vertical des tourtes de pain de 6 kg - (60) |
| tourtiére : tourtière - (48) |
| tourtière : large cocotte en fonte, peu profonde, munie d'une anse pour la pendre dans la cheminée ou, plus tard, sur la cuisinière dont on avait enlevé les ronds. - (33) |
| tourtière, coquelle : n. f. Large cocotte en fonte, peu profonde, munie d'une anse pour la pendre dans la cheminée ou plus tard sur la cuisinière dont on avait enlevé les ronds. - (53) |
| tourtière, s. f. galette. - (08) |
| tourtière, taurtiére (n.f.) : crêpe épaisse aux fruits* - (50) |
| tourtnade : s. f., tournement de tête, vertige. - (20) |
| tourtot, s. m., entrave pour les vaches ou les chèvres au champ. - (40) |
| tourtous : tous. Nous étions tourtous ensemble : nous étions tous ensemble. - (33) |
| tousse, s. f., toux : « L'pauv'vieux ! ôl a eùne tousse qui ne persupôse ran d'bon. » - (14) |
| tousserie. Toux continue. « Aul ait in-ne tousserie à n'en plus finir » (pour une longue toux). - (49) |
| toussî, et tossî, v. intr., tousser : « Queù reùme ! Ol a toussi tôte la neùt. » - (14) |
| toussie, « L » toux, tussis. - (04) |
| toussie, s. f. toux, action de tousser. - (08) |
| toussir. Tousser, plus rationnel que le français ; du latin tussire. - (03) |
| toussir. Tousser. - (49) |
| toût : tôt - (57) |
| tout d’bout : sans s’arrêter - (37) |
| tout l’toutime : le total, l’ensemble - (37) |
| tout par un coup, tout par une fois : loc. adv., tout d'un coup, une bonne fois. - (20) |
| tout plein, beaucoup. - (27) |
| tout pour tout, adv. partout. - (38) |
| tout trempe (âte) : (être) tout mouillé - (37) |
| toût. adv. - Tôt : « C'est trop toût pou' cueilli les c'ries ! » - (42) |
| toutage, total, totalité. - (05) |
| tout-contre, adv., tout près : « J'voulôs li parler ; je m'sis éprôché tout-contre lu. » - (14) |
| tout-drèt, adv., tout juste, à l'instant : « Je v'lòs aller d'vé lu, quand tout-drèt ôl ét érivé. » - (14) |
| toute sotche : toute sorte - (46) |
| toûte, toûtai - corne, trompette ; la faire retentir. - I veins de fâre ine toûte aivou du sauce ; tenez, écoutez. –Quoi que c'â don que ceute toûte qu'en entend. - Le vaicher veint de toûtai ; lâche note vaiche. - (18) |
| toûte, trompette faite avec de l'écorce de coudrier enroulée. - (27) |
| toûter, boire à lia régalade, jouer de la toûte. - (27) |
| toutié : un gâteau - (46) |
| toutime : tout, totalité - (48) |
| tout-linge : s. m., ensemble des pièces qui constituent un trousseau de lingerie. En se mariant, elle a eu une douzaine de tout-linge. - (20) |
| toutou, s. m. crapaud. Ainsi nommé à cause du rapport suppose de son cri ou chant avec l'aboiement d'un petit chien. Dans l'Yonne on l'appelle « nonau lulu », par allusion encore à son chant monotone. (voir : bot.) - (08) |
| toutouiIle, correction à un enfant. - (27) |
| toutouille. Correction, taupignée, Etym. Ce mot me parait créé par nous et n'avoir de parenté, même lointaine, avec aucun autre. - (12) |
| toutoûte : la grande tige creuse aérienne de l'oignon de un mètre environ qui portait une boule de graines à son extrémité - (46) |
| tout-plein, adv., en quantité, beaucoup. - (14) |
| tout-sou : Seul(e), voir sou. - (19) |
| toux de vers : s. f., toux causée ou réputée causée par la présence de vers intestinaux. - (20) |
| tôverein. Trouveriez, trouverions, trouveraient. - (01) |
| tôyer : faire des enjambées - (39) |
| tozo (adv.) : toujours - (50) |
| tôzors : toujours - (39) |
| tra : Trois. Le père Jeannot Millot qui avait fait les campagnes du premier empire racontait qu'il s'était battu avec des ennemis qui avaient des « feusis à tra cos ». Tra n'est plus usité. - (19) |
| tra : adj. num. trois. - (21) |
| trabeùcher. v. n. Trébucher. (Etivey). - (10) |
| trabuchot, s. m., obstacle sur la route. - (40) |
| tracassai ou traicaissai, mener une vie déréglée. Les Bourguignons disent encore tracasser dans le sens de ranger, disposer, remettre en place... - (02) |
| tracasse : s. f., tracas, inquiétude. Avoir la tracasse. - (20) |
| tracasse : s. f., tracassiére. - (20) |
| tracasser : v. n., aller et venir, ranger, remuer, fouiller. - (20) |
| tracasser, v. tr. et intr., aller et venir, ranger, replacer, remettre en ordre, mais en se donnant du mal. Forme réfléchie : se faire du souci. - (14) |
| tracasser. Ce verbe, admis par l'Académie, est d'un usage très fréquent dans les environs de Beaune... Au figuré, tracasser est synonyme de contrarier... - (13) |
| tracassi : tracasser - (57) |
| tracassin (on) : charivari - (57) |
| tracassin : (nm) charivari - (35) |
| tracassin n.m. Personne anxieuse, tourmentée. - (63) |
| tracassin : s. m., charivari qu'on fait aux veufs ou veuves qui se remarient avec des célibataires. - (20) |
| tracassin, s. m. charivari. - (22) |
| trace : haie. (SS. T IV) - N - (25) |
| trace : haie. III, p. 31 ; III, p. 61-k - (23) |
| trace : haie. - (33) |
| tracer, v. a. aller souvent dans un lieu, fréquenter un pays. - (08) |
| trâchi : traîner ses groles, ses savates - (43) |
| trachia : individu qui traîne les pieds en marchant - (43) |
| trachion : branches qui restent après avoir fait les fagots - (43) |
| trachionner : battre avec un bâton - (43) |
| trachionner : bricoler - (43) |
| trachionni : bricoleur - (43) |
| trachllion, m. tronçon de bois suspendu au cou du bétail pour l'empêcher de courir. - (24) |
| trachllionner, v. n. traîner les pieds bruyamment comme avec des chaussures trop larges. - (24) |
| trachlliouné, v. n. traîner les pieds bruyamment comme avec des chaussures trop larges. - (22) |
| trachon n.m. (à rapprocher du mot charolais trachion, bâton) Coup, secousse, choc brutal. - (63) |
| trachonner v. Faire les 100 pas. - (63) |
| traçhyâ : (nm) individu qui marche en traînant les pieds - (35) |
| traçhyi, traçhyonner : (vb) traîner les pieds - (35) |
| traci : tracer - (43) |
| traci : tracer - (57) |
| tracle : charrette - (44) |
| tracle : véhicule médiocre. En particulier la bicyclette. - (62) |
| trâcle : véhicule plutôt léger, mais sommaire et peu confortable. - (56) |
| tracle : s. f., traclon : s. m., vx fr., trasce, pal, garrot, billot. - (20) |
| trâcle, s. m., jouet pouvant supporter un enfant, fait avec des planches et des roues de fortune. - (40) |
| trâcle, subst. masculin : sorte de petit chariot fabriqué par les enfants, ancêtre des caisses à savon d'aujourd'hui. - (54) |
| trâcle, trâque : n. m. Vieil engin. - (53) |
| tracler, traclonner : v. n., bas-lat, trascinare, traîner une tracle. - (20) |
| traclette : s. f., vx fr,, claquette, claquoir des marchands d'oublies, planchette munie d'une poignée métallique mobile sur charnière et à laquelle un imprime un mouvement rapide de va et vient pour déterminer une série de chocs bruyants. - (20) |
| trac'lle : Vieux meuble sans valeur et très encombrant. « Ou'est-ce que te veux fare de ce trac'lle ? ». - (19) |
| traclonnier : s. m., individu qui traine ses grolles ou « fait peter » ses sabots en marchant, par assimilation à l'animal qui traîne sa tracle. - (20) |
| tracotte : machine - (48) |
| traçou (on) : traceur - (57) |
| tracusser. v. n. Aller sans cesse par voie et par chemin. De trac , chemin, voie, sentier, et ussir, usser, sortir, s’en aller. (Percey). - (10) |
| trafiqué, v. n. s'agiter, déployer de l'activité. - (22) |
| trafiquer, v. n. déployer de l'activité bruyante : on l'entend trafiquer toute la nuit. - (24) |
| trager. Se dit pour passer habituellement dans un lieu, en parlant d'un animal ; du latin transire, ou plutôt trajicere. - (03) |
| tragéyer (Se). v. pronom. Se tourner, se déranger les nerfs. — Se tragéyer, se tergiller le pied, se fouler, se tortiller le pied, ou, autrement, se donner une entorse. (Etais). - (10) |
| trâgneau, trânaie, traînaie : traîneau (véhicule sans roues), chasse-neige tiré par des chevaux, personne qui traîne, vagabond - (48) |
| trai. Trait, traits. - (01) |
| traïant : s. m. et f., vx fr. traiant, fourche à trois dents. Voir triandine. - (20) |
| traibeucher, v. a. briser, fouler, renverser. Ne s'emploie plus guère qu'en parlant des blés, des herbes, couchés et foulés par le vent, les pluies d'orage, la grêle, etc. - (08) |
| traicaisse. Tourmente, tourmentes, tourmentent. - (01) |
| traicaissé. : Nicot traduit par vestigare, investigare (suivre quelqu'un pas à pas), le vieux mot français tracer. C'est aussi le sens du verbe anglais to trace, qui est sans doute l'origine de notre mot du patois. Dans son acception neutre, traicaissé signifie se donner du mouvement pour ranger ou mettre en ordre quelque chose ; il signifie aussi user des plaisirs sans ménagement. - (06) |
| traicaisser, v. a. tracasser, disputer avec minutie, marchander avec insistance. S'emploie souvent dans le sens d'aller et venir avec une sorte d'agitation : que « traicaissez-» vous donc dans ce pays-là ? - (08) |
| traice : n. f. Trace, vestige. - (53) |
| traiche, traice, s. f. traite de lait, ce qu'une vache donne de lait chaque fois qu'on va la traire : « aine bonne traiche. » - (08) |
| traicoter en maiç’ant : marcher les pieds « en dedans » - (37) |
| traidzi : travailler - (51) |
| traific : n. m. Trafic. - (53) |
| traige ou treige, à Dijon et à Besançon, c'est un corridor fermé... - (02) |
| traige, traiger - passage étroit entre deux maisons ; fréquenter un lieu. - I n'eume pâ passai pou le traige des Forey. - Ces gens lai ne faisant que traiger pour iqui. - In traigeou, ç'â in vôlou. - (18) |
| traige. Passage étroit, ruelle. Darré chez neus i on s un traige pour gagner lai riveire. De là est venu « traiger » marcher sournoisement. I te défends de veni traiger chez neus. À rapprocher du vieux verbe se traire, se retraire. - (13) |
| traige. Petit passage entre deux maisons, couloir dans une maison, passage en général. Etym. Vieux français trège, bas latin tragina y chemin de voitures. - (12) |
| traiger, fréquenter, passer. - (05) |
| traiger. Passer souvent, fréquenter un endroit. Vient de trège. - (12) |
| traignâs : vagabond, homme qui aime à « traîner », oisif. - (32) |
| traîgnât, trâgneau, trânoû : personne qui traîne, vagabond - (48) |
| traigneau : une personne jamais pressée - (44) |
| traîgneau, s. m. chanson dont la mélodie se prolonge, se traîne. - (08) |
| traigniâ : quelqu'un qui ne fait pas grand-chose - (46) |
| traignia. Fainéant, flâneur, vagabond... - (13) |
| traigniau. n. m. - Traîneau. - (42) |
| traije, sm. passage, sentier commun. - (17) |
| traijer, v. n. aller cà et là, passer souvent dans le même endroit, fréquenter un lieu, un pays. « trézer. » - (08) |
| traijer, vn. passer. - (17) |
| traiji : Parcourir « Y est des endras que je n'ai jamâ traijis ». - (19) |
| tra'Ile : Treille. « Eune tra 'lle de mornans » : une treille de chasselas. - (19) |
| traime, s. f. trame, fil du tissu fabriqué par le tisserand. - (08) |
| traimer, v. a. aller et venir avec fatigue ou ennui : « i traime » depuis ce matin pour faire cet ouvrage, c’est à dire un ouvrage fastidieux ou pénible. - (08) |
| train (faire ou mener du), loc. faire du bruit, même faiblement : chut ! ne fais point de train. - (24) |
| train (fare ou mené du), loc. faire du bruit, même faiblement : chut ! ne fais point de train. - (22) |
| train (na) : fourche (à 4 ou 5 dents) - (57) |
| train dâs nounous(l’) : (le) train partant de château-chinon (direct pour paris, sans changer) dans lequel prenaient place les nourrices (souvent en nombre important) se rendant à paris pour allaiter un enfant parisien (de leur sein) - (37) |
| train : s. m. fourche à tr01s dents employée surtout pour arracher les pommes de terre. - (21) |
| train. s. m. Objet (table, chaise, etc.) qui, étant dérangé de sa place, est censé traîner. Remets voir ce train-là à sa place. (Sormery). - (10) |
| train’èshe : mauvaise herbe (?). Commune, rampante, du genre liseron, renouée (polygorum). À noter le suffixe péjoratif « èshe ». - (62) |
| traînasse (n.f.) : clématite, liseron des champs - (50) |
| traînasse : herbe, sorte de chiendent, on dit également grimon. - (46) |
| traînasse : 1 n. f. Morceau de tapis roulant en caoutchouc récupéré à la mine qu'on clouait sous les sabots. - 2 n. f. Tapis roulant dans la mine. - (53) |
| traînasse : voir obis - (23) |
| traînasse, n.f. toutes plantes rampantes (renouée). - (65) |
| traînasse, s. f. clématite, plante grimpante appelée vulgairement herbe aux gueux. - (08) |
| traînasse, subst. féminin : clématite, liseron. - (54) |
| trainasse, tranasse (?) : plante : renonce des oiseaux. - (33) |
| trainasse. Liseron des champs. - (49) |
| traînchi - tronchi - trausc'iller : suer - (57) |
| traînchi : trancher (contraste) - (57) |
| traine : s. f. à la traine, en désordre. - (20) |
| traîne, traînerie, s. f. maladie organique qui se prolonge, maladie de langueur, d'épuisement. - (08) |
| traine, trame de tisserand. - (05) |
| traineai, s. m. traîneau, appareil à l'aide duquel on traîne des roches ou autres objets d'un poids considérable. - (08) |
| traine-boisson, trâne-boisson. n. m. - Traîne-buisson, fauvette à tête noire. - (42) |
| traîne-bouchon, n. masc. ; fauvette. - (07) |
| traîne-bûche : n. m. Asticot de rivière dans un étui. - (53) |
| traîne-bûche, n.m. larve de phrygane. - (65) |
| traîne-bûche. s. m. Larve de l’éphémère. (Environs de Saint-Florentin). - (10) |
| traine-caisse. Traineur, ou traineurs d'épée. Ene caisse, en bourguignon c'est une poêle, avec laquelle par mépris on compare l'épée de certains fainéants, comme si le corps rond et creux de la poêle, avec le manche qui est au bout, ressemblait à une épée, composée d'un pommeau, d'une poignée et d'une garde par le haut, et d'une lame par le bas. Traine-caisse est encore plus injurieux que traine-gaine. - (01) |
| traînée. s. f. Galette qui cuit pendant que le four chauffe, et qu’on appelle ainsi sans doute, parce qu’on est obligé de la changer de place à chaque instant, suivant que le feu est déplacé. (Chastenay). - (10) |
| traine-gaine (traine-gaîne), traine-ta-gonole (traîne-ta-gonole), traine-la-grolle (traîne-la-grolle) : s. m. et f., personne indolente qui traîne ses guêtres, ses gôniaux, ses grolles, qui va grollassant. Voir le vx fr. trainegainer, v. - (20) |
| traine-guignon (traîne-guignon) : s. m. et f., malchanceux. - (20) |
| trainerie. Maladie de langueur. - (49) |
| traine-sac (traîne-sac) : s. m., diable de camionneur, brouette sans pieds, à deux petites roues très basses et en fer, dont l'avant est muni d'un rebord métallique, et qui sert à transporter les sacs de farine et diverses espèces de ballots. - (20) |
| traine-son, trâne-son. n. m. - Garçon qui travaillait avec le meunier et dont l'essentiel de la tâche consistait à la manutention et à la livraison des sacs de son ou de farine. - (42) |
| traîneux, traingnot. n. m. - Vagabond, celui qui traîne. - (42) |
| traing (n.m.) : train - (50) |
| traing : train - (39) |
| traîngnaud : personne qui traînasse - (51) |
| traîngnauder : traînasser - (51) |
| traingneau : trainard. Négligent et lent ; certains disent aussi « clampin » qui viendrait de : clopin (boiteux) + lambin (?). - (62) |
| traingnot. s. m. Fièvre endémique, qui vous ôte les forces et fait que l’on traîne longtemps. Il est ben malade, le pour’ garçon ; v’là pus d’un an qu'il a eu le traingnot. (Auxerrois). - (10) |
| trainiâ. Trainard, individu sans ordre, qui laisse trainer ses affaires. Même sens au figuré. - (12) |
| trainiau (traîniau), trainiaude : s. m. et f., vx fr. trainel, personne ou objet qui traîne, qui encombre ; traînard ; guenille ; etc. - (20) |
| traîniau, adj., lambin, paresseux. - (40) |
| traîniau, subst. masculin : traînard ou objet inutile, sans valeur. - (54) |
| trainiau, train-niau. Objet sans valeur, encombrant. - (49) |
| trainiaud (e): (nm.f) fainéant (e) ; trainard (e) - (35) |
| traiñnaîche n.f. Renouée, liseron (traînasse). - (63) |
| traîn-nâilli : traînailler - (57) |
| traîn-nâilli : traînasser - (57) |
| traîn-ne (na) : traîne - (57) |
| train-nè, teugnè : v. t. Traîner. - (53) |
| trainne. gaingne - fainéant, coureur de rues. - Il faut voir Gaingnes, lequel mot signifie aussi : jambes. Du reste, devenu peu usité. - (18) |
| traînne. n. f. - Se prononce train-ne. Traîneau attelé, utilisé au transport du fumier. - (42) |
| train-ne-bàle , s. m., triqueballe, éfourceau. C'est ce véhicule qui sert à transporter les longs et lourds troncs de sapins qui nous viennent du Jura, et passent comme des géants défunts en faisant résonner les galets des rues. - (14) |
| train-nèche ou train-neraiche : Trainasse, renouée, polygonum convolvulus. - (19) |
| traiñne-cul (à) loc. A tomber par terre, à traîner par terre. Ôl est saoûl à traiñne-cul Il est ivre à tomber par terre. - (63) |
| traîn-née (na) - traîn-nia (na) : traînée - (57) |
| train-neguinnerie, train-niauderie : perte de temps - (43) |
| traiñne-la-gorle n. Personne indolente, qui traîne ses guêtres. - (63) |
| traîn-ner : traîner - (51) |
| traîn-ner : traîner - (57) |
| train-ner : Trainer. - (19) |
| traiñner v. Traîner. - (63) |
| train-ner, et trâner, v. tr., traîner. - (14) |
| train-nesse : renouée liseron, chiendent rampant - (43) |
| trainniais - trainard, lent, négligent. - Ma dépouâche tai don, sacré trainniais. - C'â in trainniais, cequi, ce n'â pâ in ovré. - (18) |
| traîn-niaû (on) - leûnâ (on) : traînard - (57) |
| traîn-niau (on) : traîneau - (57) |
| traîn-niau (on) : traîneur - (57) |
| trainniau : traîneau - (43) |
| train-niau : Traineau, chariot sans roues pour aller sur la neige ou pour transporter des fardeaux. - Lambin, traînard. « Vins dan train-niau ! ». - Marmaille. « Je peux guère sôdre à cause de mes train-niaux » : je ne peux guère voyager parce-que je suis obligée de trainer ma marmaille partout avec moi. - (19) |
| traiñniau n.m. Traîneau. - (63) |
| train-niau, train-niou : 1 n. m. Traînard. - 2 n. m. Vagabond. - (53) |
| traiñniaud, -aude n. et adj. Traînard, nonchalant. - (63) |
| traiñniauder v. Errer, traîner. - (63) |
| train-niaux, s. m., vieux linges, vieux rideaux, vieux débris. Non pas tout objet qui traîne, mais plutôt tout objet qui, par sa chétive qualité ou sa vétusté, est presque hors de service et bon à laisser traîner : « Oh ! qu'é-ce qu'y é que c'qui ? V'tu ben j'ter tous ces train-niaux ! » - (14) |
| trains. n. m. pl. - Traces laissées par une charrette ou par des pas. - (42) |
| traipe, s. f. grand vase en poterie de forme arrondie et qui sert à divers usages. - (08) |
| traipp' : n. f. Trappe. - (53) |
| traippe - terrine. - Note vaiche nô beille trouas traippes de lait per jor. - Ecràme lai traippe, en â temps. - (18) |
| traippe : grande jatte de lait - (37) |
| traippe : récipient en terre pour le laitage. - (31) |
| traiquoice, tracasserie. (Voir au mot tracasser.) - (02) |
| traire au plaist. : (En latin trahere ad placitum), citer en justice. (Franch. de Seurre, 1278.) - (06) |
| traisse, pian : haie - (36) |
| traisse, trasse : haie - (37) |
| traisse. n. f. - Quantité de lait donnée par une vache ou une chèvre en une seule traite. - (42) |
| trait-carré : Lignes perpendiculaires, angle droit. « Te dis que l'as appris le dessin a peu te sais pas tant seurement fare le trait-carré ». - (19) |
| traite : Traître. - (19) |
| traiti : Voile qu'on tend au dessus de la tête des jeunes mariés au moment de la bénédiction du prêtre. « Il est tenu par deux amies de la mariée et ne doit pas toucher la tête des époux, cela porterait malheur ». - (19) |
| traitije : Traîtrise. « Méfie tu de st 'individu, olyva de traitije ». - (19) |
| traivailler : fermenter, pour le vin. se gondoler, pour le bois - (37) |
| traivailler : travailler - (39) |
| traivaiye ! (y m’) : (j’y) « rumine » ! cela me met en souci ! - (37) |
| traivars (ai) (loc.adv.) : à travers - (50) |
| traivars' : n. m. Traverse. - (53) |
| traivarse : traverse - (39) |
| traivarsé : v. t. Traverser. - (53) |
| traivarse, traverse (n.f.) : vent d'ouest - (50) |
| traivarser (v.t.) : traverser - (50) |
| traivarser : traverser - (39) |
| traivau. Travaux. - (01) |
| Traive. L'électeur de Trêves en 1701. - (01) |
| traiveil (n.m.) : travail - (50) |
| traiveil : travail - (48) |
| traiveil : n. m. Travail. - (53) |
| traiveil : travail - (39) |
| traiveil, s. m. travail, peine, fatigue. . - (08) |
| traiveillé : v. i. Travailler. - (53) |
| traiveiller (v.t.) : travailler - (50) |
| traiveiller : travailler - (48) |
| traiveiller, v. n. travailler. On dit par ellipse : j'ai travaillé mes bœufs, il ne travaille pas ses vaches, pour dire j'ai fait travailler mes bœufs, il ne fait pas travailler ses vaches. - (08) |
| traivers : terrain en pente (latéralement) - (48) |
| traiversai. - Outre le sens ordinaire du français, avoir le délire traverser en parlant des malades. - I veins de voué le Pierrot al â aissez mailaide ; â traiverse per moment. - Al â moins bein qu'hier ; tote lai nuit al é traiversai, le pôre chère homme. - (18) |
| traiverser : traverser - (48) |
| traiviaûle( d’), (d’) traivârs : (de) travers - (37) |
| traizer : aller ici et là - (39) |
| trajectouaîre (na) : trajectoire - (57) |
| trajer : parcourir, fréquenter - (60) |
| trajer, tracer, tracusser (Br.), treijer, trezer (Morv.), tréjer, treiger (C.-d.). - Fréquenter un endroit, y passer habituellement, aller et venir fréquemment. Cette expression vient du vieux français trasser, dont il est resté trace, tracer, tracasser, pris soit dans le sens d'aller et venir, soit dans celui de tourmenter. La racine est le latin trajicere (traverser)… - (15) |
| trâjer, v. intr., rôder, aller çà et là, parcourir, traverser : « On dit qu'eùn loû a trâjé dans l'bos. » Rappelle le substantif trajet. - (14) |
| trajer, v. parcourir. - (38) |
| trajet : s. m. targette. - (21) |
| trajge. : Passage d'une rue à une autre dans une maison entre deux voies publiques. (Du latin trajectus.) - (06) |
| trakéchi v. Tracasser. - (63) |
| trâlé, ée. adj f. Sec, hâlé. (Etais). - (10) |
| trâlé, ée. adj. - Sec, desséché. - (42) |
| trâle, s. et adj., mauvais. — En quelques localités signifie aussi une petite servante. Pourquoi ? Elles ne sont pas toutes mauvaises. - (14) |
| trale, servante, fille très-commune... - (02) |
| trale. : Servante, fille du commun. Dans le vieux français trauler signifie courir ça et là (Lac.) (Rac. lat. tralatio ou translatio, action de se transporter d'un lieu à un autre.) Dans le patois de Genève, tralée veut dire séquelle, quantité. On dit une tralée d'enfants. (Gloss. gen.) Tral-tral est une sorte d'onomatopée, exprimant l'empressement et la précipitation des mouvements ou de la démarche de quelqu'un. - (06) |
| tralée : grande quantité (tiaulée) - (60) |
| trâlée, s. f., raclée, volée, et toute cette curieuse famille de mots : Daubée, Dégelée, Peignée, Pile, Rincée, Roulée, Tricotée, etc. — On n'a que l'embarras du choix dans cette abondance de synonymes. - (14) |
| trâlée, s. f., troupe, affluence, grande quantité, ribambelle : « Qué trâlée à c'te fouére ! » - (14) |
| trâler, drâler, trôler, trâner : errer sans but précis - (37) |
| trâler, v . intr., aller, se promener avec excès, courir de tous côtés. - (14) |
| traler, v., courir en vitesse, çà et là. - (40) |
| trâler. v. - Sécher : « Et pendant ce temps-là, nous on trâle ; au point, mes bons Saints, créyez moué, qu'si vous v'lez pas entende un râle, dounnez à bouée à ceux qu'ont soué ! » (G. Blanchard, En pleuchant mes truffes, p.l42). Autre sens : trembler. (Arquian) - (42) |
| traller, v. n. avancer en sautant sur un pied comme dans certains jeux d'enfants. - (08) |
| tralu, trélu. Rayon lumineux projeté à travers les vitres d'une fenêtre. - (49) |
| tramblai. Trembler. - (01) |
| trameule : trémie à grains. A - B - (41) |
| trameule : trémie à grains - (34) |
| trameûre : Trémie. « I ne faut pas fare aller le m'lin si an n'a point de grain à mentre dans la trameûre ». - (19) |
| trameure. s. f. Trémie. (Athie). - (10) |
| tramois, trémois. s. m. Blé, grain quelconque semé en mars, et qui est ainsi appelé parce qu’il ne reste que trois mois en terre. - (10) |
| tramois. n. m. pl. - Travaux de printemps dans les champs. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| trampai. Tremper, trempé, trempez. - (01) |
| tramper : Tromper. « Y a que stènes que ne fiant ren que ne se trampant pas ». - (19) |
| trampoux : Trompeur. - (19) |
| trampue, s. f., soupe froide, avec du vin et du sucre. - (40) |
| trampusse (f), mélange d'eau sucrée, de vin et de pain. - (26) |
| trampusse : (faire trampusse) tremper du pain dans du vin sucré ou du lait pour se redonner des forces - (46) |
| tramue : trémie à grains - (43) |
| tramure, trémie de moulin. - (05) |
| tramyeu : s. m. entonnoir du vannoir. - (21) |
| tran : Trident, fourche de fer à trois dents dont on fait usage pour enlever le fumier des écuries. - (19) |
| tran : trident. Fourche parfois utilisée pour le fumier : « Sale c’ment un’ douille de tran ».C’est l’apocope de trident. - (62) |
| tran : une fourche à dents - (46) |
| tran, s. m., fourche de bois, à trois dents. - (40) |
| tran, s. m., fourche en fer à trois dents, trident. - (14) |
| tran, s.m. fourche à trois ou quatre dents en fer et qui sert à transporter le fumier. - (38) |
| trânai : traîner, tirer ou errer, traîner les chemins sans but. - (33) |
| tranbleman ; leu l’tranbleman, amas tumultueux de personnes, de nombreux objets divers. - (16) |
| tranchè : cailler - le lait est tranchè, le lait est caillé - (46) |
| tranche : Tronche, arbre têtard dont on coupe périodiquement les branches, souvent ce sont des « tranches » qui servent en guise de bornes, à marquer la limite des bois particuliers. - (19) |
| tranche : s. f., ancienne mesure de surface pour les terres, valant 3 coupées de Paris, soit 9 ares 576. - (20) |
| trancher : v. n., vx fr. tranchier, aigrir, se cailler. Du lait tranché. - (20) |
| tranchet, s. m. petite branche d'arbre ou d'arbuste : un « tranchet » de cerises, petit rameau chargé de ces fruits. - (08) |
| tranchi : trancher (couper) - (57) |
| tranchòt, s. m., grand couteau tranchant, hache, hachette. - (14) |
| tranchouaîr (on) : tranchoir - (57) |
| trancot, bâton court, trique. - (05) |
| tran-d'lé (en) loc. adv. Par là. - (63) |
| trâne-bousson (traîne-buisson). s. m. Fauvette. (Etivey). - (10) |
| trânée, s. f. traînée, ce qu'on traîne après soi : une « trânée » de bois et au fig. une « trânée » d'enfants. - (08) |
| trâner lai gairaiye : être dans la misère - (37) |
| trâner, v. a. traîner, tirer après soi. - (08) |
| tranou : homme habitué à traîner, vagabond. - (33) |
| tranpë, soupe de pain et de vin sucré. - (16) |
| tranpe, tout mouillé, se dit des personnes et des vêtements. - (16) |
| tranpusse*, s. f. trempette de pain dans du vin sucré. - (22) |
| tranpusse, s. f. trempette de pain dans du vin sucré. - (24) |
| tranquille (être), loc. être aisé : ces gens sont tranquilles depuis qu'ils ont hérité. - (24) |
| tranquille (être), loc. être aisé : ces gens sont tranquilles. - (22) |
| tranquiye : tranquille - (46) |
| tranquiye, tranquille. - (26) |
| transelé, adj., défraîchi, flétri, fané. - (40) |
| transigi : transiger - (57) |
| transpeurci : transpercer - (57) |
| transpir, s. m., transpiration, sueur : « J'ai sâclé tout l'tantôt. Y étòt deùr ; j'en ai l’transpir. » - (14) |
| transpiri - tronchi - trauchi - trausc'iller : transpirer - (57) |
| transportou (on) : transporteur - (57) |
| trantelantai. : Amuser quelqu'un, le tenir au-delà de son but, en latin transtenere. - (06) |
| tran-tran. Faire du tran-tran, c'est faire de l'étalage et du bruit pour rien. Dans le Châtillonnais, faire des trains ou faire de ses trains, c'est montrer quelque ostentation, quelque fatuité. Le tran-tran des affaires signifie la routine, la conduite des affaires... Les Bourguignons ne se sont pas contentés de leur singulier substantif tran-tran ; ils ont fait le verbe trantelantai, amuser, traîner en longueurs... - (02) |
| tran-tran. : Voie, route, méthode, routine des affaires. (Rac. lat. trames qui a le même sens). - (06) |
| trao, s.m. trou. - (38) |
| trap : s. f. grande terrine où l'on lave les légumes. - (21) |
| trapan. s. m. Montant de cheminée. (Fléys). - (10) |
| tràpe (C.-d., Chal., Br.), traipe (C.-d., Morv.).- Grand vase à lait en poterie grossière ; du vieux français trappe, terrine, venant lui-même du bas latin frappa, même sens (du Cange)… - (15) |
| trape : n. m. Récipient en grès pour le lait. - (53) |
| trape : s. f., vx fr., grande terrine. Autrefois le mot s'appliquait même aux vases de métal. - (20) |
| trape, jatte évasée pour recevoir le lait. - (16) |
| trape, s. f., vase en terre, de grande dimension, dans lequel on met principalement le lait. - (14) |
| trape. Grand vase à mettre le lait. - (03) |
| trapeçi, v. a. percer, en parlant de la pluie. - (24) |
| traperser : v. a., traverser. On disait couramment à Mâcon la rue Trapersière pour la rue Traversière (auj. rue Batilliat). - (20) |
| trapet : manger bruyamment - (60) |
| trapeux. s. m. Fauvette. (Perrigny-lès-Auxerre). - (10) |
| trapi : Peiner. « J'en ai tot de mouême vu le bout mâ y n'est pas san trapi ». - (19) |
| trapi, v. n. peiner longuement (du vieux français treper, trépigner). - (24) |
| trapi, v. n. peiner longuement. - (22) |
| trapir : v. n., vx tt. treper, trépigner, s'agiter. - (20) |
| trapir. Fouler aux pieds ; du vieux mot français tréper. - (03) |
| trapon (n.m.) : petite porte qui ferme un escalier de cave - (50) |
| trapon : porte. Ouvrant bas/haut ou haut/bas, pour l’accès au grenier ou à la cave. - (62) |
| trapon : trappe horizontale d'accès à la cave - (48) |
| trapon : (trapon - subst. m.) porte horizontale donnant accès à l'escalier de la cave. Ce mot est tout simplement le diminutif masculin du mot français trappe, au sens d' ouverture à abattant. - (45) |
| trapon : n. f. Trappe de cave. - (53) |
| trapon, porte horizontale fermant l'entrée d'une cave. - (16) |
| trapon, s. m. petite porte qui ferme horizontalement l'entrée d'un escalier de cave. - (08) |
| trapon, s. m. porte horizontale permettant en la soulevant de passer d'un étage à un autre ; ouverture dans le plancher d'un fenil pour jeter le foin au-dessous. - (24) |
| trapon, s. m. trappe. - (22) |
| trapon, s. m., planche, ou feuille de fer, fermant l'ouverture inclinée ou horizontale des caves. Diminutif masculin de trappe : « As-tu ben fremér l’trapon ? » — « L’trapon étòt ovri ; ôl a métu le pied d'dans, é pi ôl a chu à bas d'I'escayé. » - (14) |
| trapotte : piège à bascule. - (62) |
| trapouéssaule*, s. f. tache produite sur le linge au cours d'une lessive mal réussie. - (22) |
| trappan : Trappe. « Le trappan du grené », dans certaines maisons le grenier n'a d'autre accès qu'une trappe à laquelle on accède par une échelle. - « Culotte à trappari » culotte à pont. - (19) |
| trappe (na) : jatte - (57) |
| trappe : jarre. Gros pot en terre recevant le lait, le beurre, le saindoux… - (62) |
| trappe : Terrine, vase plus bas et plus évasé que le tepin. « Eune trappe de cailli » une terrine de lait caillé. - (19) |
| trappe : terrine - (39) |
| trappe, terrasse. Grande terrine pour le lait. - (49) |
| trappe, vase large à lait, etc. - (05) |
| trappe. Terrine. Etym. Inconnue. - (12) |
| trappe. Vase circulaire et évasé, en terre vernissée. Si an fait ben chaud, an faut mette dans lai cave les trappes de laissiâ pour les empouacher de torner.... Dans le Nord de la France, on dit une telle. - (13) |
| trappir, trépigner, fouler aux pieds. - (05) |
| trappiste : s. m., fabricant de trappes ou pièges à animaux. - (20) |
| trappistine : s. m., fromage fabriqué par les religieuses trappistines de Saint-Clément, à Mâcon. Du trappistine. - (20) |
| trappon : petite trappe - (43) |
| trappon : s. m., trappe ; pont de pantalon ; planchette fixée devant les yeux de certains animaux pour limiter leur champ visuel. Lève-donc le trappon de la cave. Culotte à trappon. - (20) |
| traqué, terme de chasse. C'est l'acte de diriger le gibier des forêts sur les chasseurs, en faisant beaucoup de bruit... - (02) |
| trâque, trâcle : n. m. Vieil engin, vieille mécanique. - (53) |
| traquéchi, v. n. se dit d'un bruit rythmé accusant l'état d'usure, comme fait, par exemple, en roulant, une voiture disloquée. - (24) |
| traquéchin, s. m. charivari. - (24) |
| traquenale : Crécelle. « Padant que les clieuches sant à Rome les enfants de choeu corant pa les rues dave leu traquenale » : pendant que les cloches sont à Rome (du Vendredi Saint au jour de Pâques) les enfants de chœur passent avec leur crécelle pour annoncer l'heure des offices. - (19) |
| traquenaler : Faire un bruit comparable à celui de la crécelle. « T'as pas fini de traquenaler dave tes sabeuts ? ». - (19) |
| traquenasser. v. - Boiter, traîner la patte. - (42) |
| traquenasser. v. n. Boiter. (Etais). - (10) |
| traquer, v. a. aller, chercher, tirer de côté et d'autre. - (08) |
| traquet : broyeur - (43) |
| traquet, s. m. bavardage continu, caquetage de femme. - (08) |
| traqueté, v. n. se dit d'un bruit rythmé accusant l'état d'usure, comme fait, par exemple, en roulant, une voiture disloquée. - (22) |
| traquœte, s. f. ustensile ou véhicule usé et bruyant. - (24) |
| traquotte, s. f. crécelle, instrument dont on se sert le vendredi saint pour remplacer les cloches muettes. - (08) |
| traquou (on) : traqueur - (57) |
| tràsor, s. m., trésor, tout ce qu'on croit d'une grande valeur. . . et qui trompe souvent. - (14) |
| trasse (nom féminin) : haie. - (47) |
| trasse (une) : une haie - (61) |
| trasse : Tresse. « Eune trasse de cheveux ». - (19) |
| trasse, s. f. tresse, cordons, ficelles, cheveux nattés. « traisse » ou « traice » - (08) |
| trasse, s. f., tresse, cheveux nattés, etc. - (14) |
| trasser : Haleter. « Ce bu trasse, est-ce qu 'o est malède ? ». - (19) |
| trasser, v. a. tresser : cette femme « trasse » mal ses cheveux. - (08) |
| trasser, v. tr., tresser, arranger en tresse. - (14) |
| tratracer, v. n. aller et venir, marcher sans dessein, sans but. Se dit encore pour marcher péniblement, avec effort, en parlant par exemple d'un homme infirme qui s'efforce de marcher. - (08) |
| traû : gros morceau - (48) |
| trau : n. m. Morceau. - (53) |
| trau, trô (n.m.) : bout, morceau - (50) |
| traub'ille (na) : table - (57) |
| trauble : s. f., table. - (20) |
| traûbliée : Tablée. « Eune greusse traûbliée de mande ». - (19) |
| traub'lle : Table. « Mentre la nappe su la traub 'lie ». « La Traub 'lle riande » : roche de forme circulaire qui se trouve dans le bois de Mancey et qu'on vient voir comme une curiosité. Le mot traub'lle a vieilli, on dit aujourd'hui : table. - (19) |
| traubye (tabye) : table - (51) |
| traubye : (nf) table - (35) |
| traubye : table - (43) |
| traulé, v. n. s'occuper la nuit à de vagues et interminables besognes. - (22) |
| traûlée, thiaûlée : correction corporelle - (37) |
| trauler, trôler (v.t.) : se promener sans but - (50) |
| trauler, v. n. aller de côtés et d'autres, faire des démarches sans résultat. Prend quelquefois le sens de valeter, de trimer. Faire « trauler » quelqu'un, c'est imposer à autrui une sorte de corvée, l'action d'aller et venir pour des riens. - (08) |
| trauler, v. n. s'occuper la nuit à de vagues et interminables besognes. - (24) |
| traupner : tourner en rond, sans but défini - (34) |
| traupner v. S'activer à des tâches très variées et peu suivies qui prennent du temps et qui font dire : je n'ai rien fait mais je n'ai pourtant pas arrêté ! Dz'ai traupné du grand matin, midi soûnot dz'avos encô ren fait ! - (63) |
| travâ : travers - (57) |
| travâ, travers. - (38) |
| travail, n.m. solive. - (65) |
| travailli : travailler - (43) |
| travailli : travailler - (51) |
| travailli : travailler - (57) |
| travaillou (on) : travailleur - (57) |
| travan : Chevron, poutrelle. - (19) |
| tràvàr (à), loc. préposit., à travers : « J'seû donc été cheû lu, tôt à tràvàr le bôs ; ma je l'ai pas treùvé. » - (14) |
| tràvâr, s. m., travers, caprice, inconduite : « L'pauv'garçon, je n'sais pas c'qu'ô d'veinra ; ma ô doune dans l’tràvâr. » - (14) |
| travar. Travers. - (01) |
| travârse (la) : qui traverse . Vent d’ouest, ou chemin qui coupe en travers, raccourci. - (62) |
| travârse (na) : traverse - (57) |
| travârse : Vent d'Ouest « La Croix Rotte (lieu dit) est bien à l'euvri de la travârse » : la croix Rotte est à l'abri du vent d'Ouest. - Entretoise, pièce de bois « Des travârses de chemin de fé ». - Du verbe traverser, raccourci de chemin. « In chemin de travârse ». - (19) |
| tràvarse, s. f., chemin qui coupe en diagonale, et raccourcit. Le paysan prend toujours « la tràvarse ». - (14) |
| tràvarse, s. f., vent âpre de l'Ouest : « Le vent de tràvarse. La tràvarse. » - (14) |
| travarse, s.f. vent d'ouest. - (38) |
| tràvarser, v. tr., traverser, passer d'un côté à l'autre. - (14) |
| travas (En), préposit. adverb. En travers. (Sermizelles). - (10) |
| travâsse, s. f. vent de l'ouest. - (22) |
| travau (on) : travail - (57) |
| travau : (nm) travail - (35) |
| travau, s. m. solive qui se pose parallèlement avec d'autres pour remplir l'espace d'une travée, entre deux poutres. - (08) |
| travau, s. m., poutre, solive. - (14) |
| travaucher. v. - Marcher de travers, ou de long en large comme le fait le chasseur dans un champ : « I' travauchait coumme un soulaud »(Fernand Clas, p.263) - (42) |
| travaucher. v. n. Cheminer à travers champs à la manière du chasseur au chien d’arrêt en quête de gibier. (Puysaie). - (10) |
| travé (à), loc. par terre : ne jette pas de l'eau à travé. - (24) |
| travé (à), loc. par terre : ne jette pas de l'eau à travé. - (22) |
| travé : Travers. « Aller de travé » tituber. - (19) |
| travé s. m. étendue : un grand travé de vignes. - (22) |
| travé, s. m. étendue : un grand travé de vignes. - (24) |
| traveilli : Travailler. « I faut traveilli padant qu'an est jeune ». - Fermenter en parlant d'un liquide. « Man vin blianc traveille ». - (19) |
| traveilloux : Travailleur, ouvrier acharné au travail. « Y est in traveilloux ». - (19) |
| traver, s. m. montagne, escarpement, pente abrupte. - (08) |
| traverse : vent d'ouest - (43) |
| traverse n.f. Vent d'ouest, morvan. - (63) |
| traverse : s. f. vent d'ouest. - (21) |
| traverse : s. f., vent d'ouest. - (20) |
| traverse, n.f. vent d'ouest, parfois de nord-ouest apportant la pluie. - (65) |
| traverse, vent d'ouest, chemin plus court, adversités. - (16) |
| traverseigne : trou du fenil à l'étable pour descendre le foin - (39) |
| traversière : s, f., passage perpendiculaire aux raies longitudinales et allant généralement d'un bout à l'autre d'une terre. Voir rase. - (20) |
| travette. s. f. Petite fille curieuse, qui veut tout voir et tout savoir. (Auxerre, Villeneuve-sur-Yonne, Joigny). - (10) |
| traveurse : (nf) vent d’ouest ; raccourci - (35) |
| traveursée (na) - travarsée (na) : traversée - (57) |
| traveurser - travarser : traverser - (57) |
| traviôle (aller de), marcher de travers. - (40) |
| travlli v. Travailler. - (63) |
| travoéyé, travailler ; quand un enfant a brisé un objet, on lui dit ironiquement : t'é bèn travoéyé ! - (16) |
| travon : s. m., solive, poutrelle. - (20) |
| travon, m. solive (du latin trabes). - (24) |
| trayan, s. m. fourche recourbée dont on se sert pour enlever ou tirer le fumier des étables. - (08) |
| trayant, s. m. trident. - (24) |
| trayon, s. m. solive. - (22) |
| traze : Treize. « Les gens c 'ment liune sant rares. - Bien seur y en a pas traze à la dozain-ne ». La superstition attribuant une influence néfaste au nombre treize est encore assez vivace : « Ne te ments pas en route aujourd 'heu y est in venrdi traze ». - (19) |
| trazin : Treizième objet qu'on donne par dessus le marché. « J'ai ageté eune dozain-ne d'ûs in pliet bout cher mâ j'ai ésu le trazin ». - (19) |
| tràzor, s. m. trésor : « ol é troué ain trâzor », il a trouvé un trésor. - (08) |
| tré bein - beaucoup. - Bien moins souvent le sens ordinaire du français.- I ons aivu tré bein de treuffes c't'année. - Ces gens lâi ant tré bein de pogne, ailé. - C'â tré bein, i vos en fas mon compliment. - (18) |
| trë bèn, beaucoup. - (16) |
| tré ben, beaucoup. - (27) |
| tré, tra : (adj. num.) trois « Y est aut c'ment tré dagts »(m. à m. c'est haut comme trois doigts) - (35) |
| trébein, trébin (loc.) : très bien - (50) |
| trében, adj., contraction de très bien, beaucoup : « Si l'cœur t'en dit, j'peux t'en bailler, des calas ; j'en ai trében. » - (14) |
| tréberder : tourmenter - (48) |
| tréberté, e, adj. tourmenté, perplexe. - (08) |
| tréberter (se), v. réfl. se tourmenter, ou, comme on dit familièrement, se tracasser. - (08) |
| tréberter : déranger, faire trébucher. (LF. T IV) (RDF. T III) - A - (25) |
| trebeu : mauvaise voiture - (44) |
| trebeû : un tacot - (46) |
| trébeuler : trébucher. - (32) |
| trébeurter (se) (v.pr.) : se tourmenter, se tracasser - (50) |
| trébeurter (v.) : tourmenter - (50) |
| trebi : petit tourbillon de poussière annonciateur d'orage - (46) |
| trebi : un jeune enfant qui commence à marcher (avec une connotation d'enfant espiègle) - (46) |
| trebi, et trebillot, s. m., toton, toupie, petite toupie : « Ol ét adrèt ; ô fait joliment virer son trebillot. » il arrive assez fréquemment qu'on prend le plus court des deux mots, et qu'on se contente de trebi. - (14) |
| trebi, sm. tourbillon. Toupie. Personne très active. - (17) |
| trebi, trebillot - toupie. - Voiqui les petiots que faisant ailai lô trebis. - Le petiot de lai Ninze, en lançant son trebis, al é aitraipai le nôte ai lai tête. - Les trebis et les trebillots ainonçant le chaud. - (18) |
| trebi, trebillot. Sorte de toupie que les enfants font tourner avec un petit fouet à la lanière de cuir. Ce substantif a formé le verbe trebiller, chanceler. Etym. Tremere, trembler. - (12) |
| trebi. Sabot, sorte de toupie…. - (01) |
| trébie. s. f. Toupie. (Athie). - (10) |
| trebil. Jouet d'enfant : sorte de toupie qu'on appelle aussi tonton et vire-tonton. Par extension, homme ou femme qui ne peuvent pas rester en place. Trebiller, tourner sur soi-même , vaciller , chanceler. En voqui un quai trop levé le coude : égué ! quemant qu'à trebille. Les Latins appelaient terebellum une tarière, instrument qui perce en tournant. - (13) |
| trebillai - chanceler, trembler en marchant. - I ne sai pâ cequi ai, i trebille en mairchant. - Le pôre gairson, â trebillo ; al en aivo aissez. - (18) |
| trebillai on trepillai, se trémousser, tourner sur soi-même. De là vient le mot trébi, toupie, et tripô, jeu de paume... - (02) |
| trebillai ou trepillai est un synonyme de tripai, qui signifie, dans le Châtillonnais, marcher sur quelque chose. Triper sur la robe d'une femme... Aujourd'hui ce mot signifie en français maison de jeu, d'où est venu tripotage, tripoter une affaire... - (02) |
| trebillé, vn. tourner comme un trebi. Vaciller sur ses jambes, avoir le vertige. - (17) |
| trebiller (C.-d., Chal., Br.). – Tourner vivement, et, par extension, chanceler sur ses jambes, comme un homme ivre ; du vieux français, même mot et même sens. Le Chalonnais, l'Yonne et le Morvan ont la trébie, sorte de toton ou toupie appelée en Bresse trebillo, et dans le Mâconnais trebillon. Ces mêmes régions emploient le verbe trépiller dans le sens de trépigner (vieux français tréper, fouler aux pieds, et trépiller sautiller, se démener). - (15) |
| trebiller : chanceler en marchant. (RDM. T IV) - B - (25) |
| trébiller : chanceler. - (29) |
| trebiller : v. n., tourner ; tituber. - (20) |
| trebiller, tourner, vaciller. - (05) |
| trebiller, v. tr., tourner rapidement, comme un toton, se trémousser. Se prend aussi parfois dans l'acception de chanceler : « J'seû tout élourdi ; j’trebille. » - (14) |
| trebiller. Tourner vivement, vieux mot. - (03) |
| trebilli : Tituber « Ol est saoul à trebilli ». - (19) |
| trebillot, petite toupie, fiarde. - (05) |
| trebillot, trebillou : s. m., syn. de tonton. - (20) |
| trébin : beaucoup - (48) |
| trébin : beaucoup (très bien : beaucoup). - (32) |
| trébin : beaucoup. Tu m'en ai dounné trébin : tu m'en as donné beaucoup. - (52) |
| trébin : beaucoup. Tu m'en ais douner trébin : tu m'en as donné beaucoup. - (33) |
| trébin pu : beaucoup plus. - (33) |
| trébin, adv. très bien, beaucoup, en grand nombre, en grande quantité : il y a « trébin » de fruits dans le jardin, « trébin » d'hommes à la foire, « trébin » d'eau dans la rivière, etc. - (08) |
| trebin, adv., beaucoup. - (40) |
| trebœyi, v. n. tibuler. - (22) |
| trebœyi, v. n. tituber. - (24) |
| trebolin, s. m. personnage court et gros. - (24) |
| tréchai : refaire une haie en lassant les arbustes entre les pieux. - (33) |
| tréchai : taller (se dit des céréales), après avoir passé le rouleau sur les jeunes blés pour les coucher ceux-ci marcottent, ils poussent de nouvelles racines et se forme un nouveau pied. - (33) |
| trèche : s. f., vx fr., affût, train d'un char (roues non comprises). - (20) |
| tréche, s. f. talle, ensemble des pousses ou rejetons qui sortent de la racine ou du collet des végétaux. le blé est clair, mais il sera assez garni car il y a de belles « tréches. » - (08) |
| tréchée : cépée de taillis, soupière. - (33) |
| trécher : proliférer (en parlant de la végétation) - (61) |
| trécher, v. n. taller, projeter des talles, des pousses, des racines hors de terre : mon blé est vigoureux, il « tréche » bien. - (08) |
| tréchot. s. m. Noix ou noisette tenant à la branche. (Massangy). - (10) |
| trécique : scarificateur pour améliorer le sol - (39) |
| trécique, tricique : sorte de canadien sans roues, scarificateur - (48) |
| tredaine : Tiretaine, étoffe grossière. « Eune culotte de tredaine ». - (19) |
| trediblou, ouse, adj. trembleur, timoré, craintif. substant. celui qui tremble, qui a peur. - (08) |
| tredzi : se familiariser avec sa famille ou ses voisins. A - B - (41) |
| trédzi : (vb) travailler (en commun) - (35) |
| trédzi v. (du lat. trebiare, fréquenter). S'activer en permanence. - (63) |
| trée : flèche de chariot qui relie l'avant à l'arrière train. - (33) |
| tréébin : adv. Beaucoup. - (53) |
| tréebin : beaucoup - (39) |
| trééquè : v. t. Trinquer. - (53) |
| trèf, trèfle, fourrage et carte de jeu. - (16) |
| trefe : pomme de terre. A - B - (41) |
| treffe, n.f. pomme de terre. - (65) |
| trèffe, treuffe. Pomme de terre. - (49) |
| trèffière. Champ planté de pommes de terre. - (49) |
| trèfle : voir truffe - (23) |
| tréfondre : Suinter à travers le fond d'un récipient. - (19) |
| trèfondre : v. s'écouler à travers quelque chose (pore de vase, etc.) . - (21) |
| tréfonger, v. a. pénétrer par l'imbibition, transpercer en humectant, en mouillant profondément un objet plus ou moins spongieux. une grande pluie « tréfonge » une muraille. - (08) |
| tréfoulé, partie, passé d'un verbe tréfouler, inusité dans le même sens à l'infinitif. Mouillé, trempé jusqu'aux os. Le mot rappelle la loc. français : pluie battante. - (08) |
| tréfouler, v. a. accabler, surcharger au propre et figuré. - (08) |
| trège : passage entre deux maisons - (46) |
| trège ou treije (C.-d.). - Passage, trace fréquentée (voir trajer). - (15) |
| trège, passage dans une maison. - (27) |
| trège, passage étroit. - (16) |
| trégeiller, v. n. trembloter, avoir des frissonnements, s'agiter convulsivement. - (08) |
| trèger : aller et venir - (48) |
| tréger : vaquer. - (32) |
| trégir, v. ; pousser, en parlant des graines qui sortent de terre. - (07) |
| tregouissi, v. a. secouer énergiquement quelqu'un par plaisanterie. - (22) |
| trégueiller, v. n. grelotter de froid ou de peur, frissonner, trembler. - (08) |
| treille, vigne qui s'attache par ses vrilles à des supports... - (02) |
| treiller : germer - (39) |
| treillot, treillerot. s. m. Petite serpette, petite serpe. (Argenteuil, Armeau). - (10) |
| treimble, s. m. tremble, espèce de peuplier dont les feuilles tremblent au vent. - (08) |
| treimblement, s. m. tremblement. On prononce souvent « treimbeulement » par métathèse. - (08) |
| treimbler, v. n. trembler. On dit à l'actif « treimbler » les fièvres, pour marquer le frissonnement que cause la fièvre. - (08) |
| trëinâyé, rester en arrière des autres et courir les rues. - (16) |
| treint, s. f. trident. - (22) |
| treite. Traitre, traitres. - (01) |
| treitea. Tréteaux. - (01) |
| treizain n.m. 1. Treizième objet ajouté à la douzaine. 2. Tas de gerbes, 13 en principe. - (63) |
| treizain : s. m., treizaine, treizième objet ajouté à la douzaine. - (20) |
| treizeau : s. m., ancienne mesure de poids, correspondant au 1/8 de l'once comme le gros, et valant 3 grammes 824. - (20) |
| tréjé, passer sur une propriété en l’endommageant. - (16) |
| tréje,tréze (n.m. ou f.) : passage étroit - (50) |
| tréjer, trézer (v.) : aller ça et là ; passer souvent au même endroit - (50) |
| tréluire. Briller ; envoyer des rayons lumineux. - (49) |
| trélure : luire, briller - (39) |
| trelure, luire à travers, être transparent. - (05) |
| trélûre, v. intr., briller, luire, luire à travers. - (14) |
| tréma (pour trémail, trémoie, trémois, tramois). s. m. Mélange d’avoine et d’orge, ainsi appelé parce qu’il n’est resté que trois mois en terre. (Perrigny-lès-Auxerre). — Voyez tramois. - (10) |
| trémanci(r), trémoinci(r) (v.) : trembler - (50) |
| trémanci, trémoinci, v. n. trembler, avoir un frisson prolonge. au partic. présent « trémancissant » ou « trémoincissant » = tremblant, frémissant. - (08) |
| trémansir, « L » trembler, tremiscere. - (04) |
| trémansir, trembler - (36) |
| tremanté - en souci : inquiet - (57) |
| trembe, s. m., tremble, arbre. - (14) |
| trembe, s. m., tremblement : « Aus'tôt qu'ô r'montit d'la cave, l’trembe l'peùrnit ; ôl avòt évu frèd. » - (14) |
| tremb'illant : tremblant - (57) |
| tremb'illante (na) : tremblante - (57) |
| tremb'ille (on) : tremble - (57) |
| tremb'illement (on) : tremblement - (57) |
| tremb'illotant : tremblotant - (57) |
| tremb'illoter - gueurlotter : trembloter - (57) |
| tremb'illotte (na) : tremblotte - (57) |
| tremb'illou (on) : trembleur - (57) |
| tremble (n.m.) : tremble - (50) |
| tremble : s. m., vx fr., tremblement, frisson. - (20) |
| tremble-au-vent : s. m., frisson dont l'intensité varie comme le tremblement des feuilles agitées par le vent. - (20) |
| trembler, v. intr., pris dans un sens particulier : « Ol a tremblé la fieûve tout l'maitin. » Le l tombe devant l'e muet. - (14) |
| tremblerie : s. f., vx fr., tremblement. - (20) |
| tremblotte : s. f., syn. de tremble. - (20) |
| trembye n.m. Tremble. - (63) |
| trembyi v. Trembler. - (63) |
| trembyo : s. m. peuplier, tremble. - (21) |
| trème. Ronron de chat. - (03) |
| trémensi : avoir très froid - (39) |
| trementcha (na) : tourment - (57) |
| trementer : tourmenter - (57) |
| trémeune : délire, divagation. - (29) |
| trémeure (n.f.) : trémie - (50) |
| trémeure : trémie - (39) |
| trémeure, s. f. trémie, ouverture par laquelle le grain tombe sous les meules du moulin. - (08) |
| tremis, grains semés au printemps. - (05) |
| tremis, s. m., plante cultivée entre deux céréales. - (40) |
| tremis, s. m., semailles du printemps, blé, orge, avoine, etc. Plusieurs localités de Bourgogne appellent les « tremis » - (14) |
| tremois : Grains alimentaires autres que le blé. Les plantes qui les produisent. - (19) |
| tremoue, s. m. culture secondaire d'une céréale (qui se fait en trois mois environ) après l'enlèvement de la récolte principale. - (24) |
| trémouére (n.f.) : trémie - (50) |
| trémoussi : trémousser - (57) |
| trempe : (adj. verbal) trempé(e) - (35) |
| trempe : Correction manuelle. « San père li a fichi eune trempe ». - « Etre trempe », être mouillé : « Je sus trempe c'ment eune sope ». - Participe passé du verbe tremper. « La sope est trempe, vin voir la miji ». - (19) |
| trempe adj. Trempé, mouillé. - (63) |
| trempe v. Tremper. - (63) |
| trempe : adj., trempé. Mon mouchoir est tout trempe. Trempé de chaleur, syn. de mouillé de chaud. Voir mouillé. - (20) |
| trempe, adj., trempé : « Ah ! voui, qu'ça tombôt ! Qué pleuë ! J'sis toute trempe. » - (14) |
| trempe, s. f., trempée, raclée, roulée : « O li en a ben prou fait ; ôl évòt pigé ses poumes la neùt. Ma itou ô li a fichu eùne trempe ! . . . » - (14) |
| trempe, subs. masc. pluie utile et bienfaisante. Ex. : un bon trempe. - (11) |
| trempè, tripè : v. t. Tremper. - (53) |
| trempée : Breuvage composé de vin sucré dans lequel on a mis à tremper du pain grillé. Le jour des noces, les proches parents, tantes, marraines des nouveaux époux préparaient la trempée qu'on prenait en sortant de l'église, avant de se mettre à table pour le repas de noce ; chacun de ces parents préparait une trempée de sorte qu'on prenait quelquefois quatre ou cinq de suite. La trempée était présentée aux épousés dans une coupe en argent, appelée tasse achetée par les mariées ou par leurs pères et mères - (19) |
| trempée : voir rôtie - (23) |
| trempée au vin (n.f.) : cardamine des prés - (50) |
| trempée : (si on veut être plus précis, on peut dire : trempée au vin, bien qu'il ne puisse y avoir de confusion). Mélange d'eau et de vin en quantités variables (la trempée était d'autant meilleure à proportion que le vin dominait). Gardée au frais, on la portait aux moissonneurs, sur leur lieu de travail, qui la consommaient au cours d'une pause. Ex : "C'est-t-y qu'té vas pourter la trempée à tes houmes ?" - (58) |
| trempée, et trempéte, s. f., pain trempé dans du vin chaud et sucré ; grand régal pour les enfants. Le bourguignon l'appelait goguée. Quand le vin sucré était chauffé à point dans les cendres, on y trempait du pain grillé ; c'était « faire la goguée ». - (14) |
| trempée, s. f. forte averse de pluie qui mouille profondément la terre. - (08) |
| trempée, s. f., forte pluie : « Ol a reçu, en r'venant d'la fête, eùne fameuse trempée ; l'iâ li dégoulinòt du dos. » - (14) |
| trempée, s.f. pain trempé dans du vin. - (38) |
| trempée. n. f. - Soupe de pain trempée dans du vin ou du cidre, servie fraîche et sucrée. - (42) |
| trempée. Vin sucré offert aux jeunes mariés après leur coucher pendant leur première nuit de noces, par les jeunes gens et les jeunes filles ayant assisté au mariage. On dit : « porter la trempée ». Cette vieille habitude s'est conservée jusqu'à nos jours. - (49) |
| tremper (la soupe) : verser de l'eau très chaude dans une soupière préalablement remplie de pain coupé en tranches auquel on ajoute quelques cuillerées de crème. - (58) |
| trempette, trempotte, trempusse, s. f., soupe au vin. - (20) |
| trempouille : forte pluie - (61) |
| trempue, trempure. n. f. - Pluie suffisante pour tremper la terre. - (42) |
| trempure. s. f. Ondée suffisante pour tremper la terre. (Puysaie, Auxerre, etc ). - (10) |
| trempus. Mets national. Vin sucré dans le que l’on casse des morceaux de pain grillé. - (12) |
| trémuer, v. n. s'émouvoir, s'ébranler, changer : le temps « trémue », nous aurons de la pluie. - (08) |
| trèn, bruit, - (16) |
| trenan : Brin de tresse ou d'un ouvrage de vannerie ou de rempaillage. « Ste chaire a des trenans d'eusés ». - (19) |
| trënasse, herbe dite : à cochon, très efficace, en décoction, contre les dissenteries invétérées ; se dit aussi d'une femme lente à l'ouvrage. - (16) |
| trenbier, vn. trembler. - (17) |
| trenblé ; sa fé trenblé se dit pour beaucoup, fortement, comme dans cette locution : é mènje, sa fé trenblé ! il mange énormément. - (16) |
| trener : Tresser. « Trener à trois » : tresser à trois brins. - (19) |
| tréngnâr, celui qui, en marchant, reste en arrière des autres. - (16) |
| tréniâ : qui traîne. Morceau de bois ou de fer qui soulève la charrue sur le chemin. - (31) |
| trenpusse, sf. trempette. - (17) |
| trentaîn-ne (na) : trentaine - (57) |
| trentaiñne n.f. Trentaine. - (63) |
| trépaisser (v.t.) : trépasser - (50) |
| tréparcer : traverser (celt. trébarz : de part en part). - (32) |
| tréparcer, v. tr., transpercer, traverser : « L’soulò tréparce les niuages. » — « I pleuvôt, y pleuvôt ! ôl é r'venu tréparcé. » - (14) |
| tréparsé : traversé ; se dit d’un vêtement traversé par la pluie. - (52) |
| trepassein. Mourions, mouriez. Ai trépassein, ils mouraient. Aivan qu'ai trépassein, avant qu'ils meurent. - (01) |
| trèpché, vt. transpercer, percer. - (17) |
| trepe : pot à lait. (C. T III) - B - (25) |
| trepe : touffe - (43) |
| trepé : Trepied, ustensile de cuisine fait d'un cercle de fer supporté par trois pieds. « La marmite est su le trepé ». - (19) |
| trèpe, jatte de terre dans laquelle on met du lait. - (02) |
| trepegni : trépigner - (57) |
| trepegn'ment (on) : trépignement - (57) |
| trepei. Trépied, trépieds. - (01) |
| treper : taller (blé), émettre des tiges secondaires à la base de la tige principale - (43) |
| tréperçai - transpercé. - Ne se dit que dans le sens de mouillé par la pluie. - I seux to tréperçai, tant il choué fort. - Si s'é mau trouvé, pou in manmant al à revenu tréperçai jeusque és os. - (18) |
| trépercé ; une pluie qui mouille un homme jusqu'à la peau le tréperce. - (16) |
| trépercer. Transpercer. Mauvaise prononciation locale. Trépercer s'applique surtout à la pénétration de l’eau à travers des vêtements. - (12) |
| trepersé, adj., trempé jusqu'aux os. - (40) |
| trepid (on) : trépied - (57) |
| trépid : trépied - (43) |
| trépié, teurpié, s. m. trépied, tronc d'arbre, souche un peu élevée au-dessus de terre par ses racines qui représentent des pieds. dans les maisons pauvres ces troncs-là servent quelquefois de tables. - (08) |
| trépigner, v. fouler l'herbe avant la fenaison. - (65) |
| trepille. Frétille. Trépiller est le fréquentatif du simple triper, que Nicot explique pétiller, baudir, sauter avec bruit des pieds, et ajoute que c'est un verbe familier en Languedoc. J'ai lu tréper pour danser, dans les Vigiles de Charles VII, par Martial de Paris, dit d'Auvergne. - (01) |
| trépille. n. f. - Fauvette. - (42) |
| trépille. s. f. Fauvette. (Sommecaise, Saint-Martin-sur-Ouanne). - (10) |
| trépiller : remuer - ex : tu trepilles comme une vache qui veut faire viau. (LS. T IV) - Y - (25) |
| trépiller, v. n. trépigner, danser, sauter, remuer vivement les pieds. - (08) |
| trépiller, v. tr., trépigner, sauter, fouler aux pieds : « Ol étòt si gros en coulâre, qu'ô l’trépillòt. » - (14) |
| trépiller. v. a. Fouler aux pieds. (Auxerrois). - (10) |
| trepire*, s. f. trépied de foyer. On disait aussi un trepi. - (22) |
| trepire, s. f. trépied de foyer. On disait aussi un trepi. - (24) |
| treplöt, sm. petit tas. - (17) |
| trepogne : s. f., syn. de tritri. - (20) |
| trepogner : v. n., agir en trepogne. - (20) |
| tréporçaule, adj. sujet à être percé, traversé et mouillé avec excès par la pluie ou par l'humidité en général. Se dit d'un vêtement, d'une toiture qui ne sont pas imperméables. - (08) |
| tréporcer, transpercer - (36) |
| tréporcer, trepocer (v.) : transpercer - (50) |
| tréporcer, v. a. transpercer, mouiller, tremper jusqu'aux os : « i seu tréporcé. » - (08) |
| tréporsé : traversé. Vêtement traversé par la pluie. Quand o pieu trebin on o tréporsé : quand il pleut beaucoup on est traversé. - (33) |
| tréporsè: transpersé (par la pluie) - (48) |
| treppe : (trèp' - subst. f.) gros bol en bois, plus gros qu'une écuelle et dans lequel on mangeait la panade (soupe au pain) ou la soupe au lard. - (45) |
| trequai : le maïs, on dit aussi turqui - (46) |
| trequi, s. m. maïs. - (24) |
| très ben (pas). loc adv. - Très peu, pas beaucoup. - (42) |
| très, adv., beaucoup, extrêmement. Abréviatif de trében : « J'évôs très faim ; j'ons été sòper d'avou l'vouésin. » N'est pas d'un usage bien courant ; on dira plutôt : « J'évos gros faim. » - (14) |
| tresaler - sautraler : tressauter - (57) |
| trésaler : trembler, chevroter, vibrer. « Sonner les cloches à en trésaler ». - (62) |
| trésaler, v. intr., chevroter en chantant. Ce mot, autrefois, a signifié trembler. La voix tremble, en effet, quand on chevrotte. - (14) |
| tresaler. Chevroter en chantant, ce qui passe pour une élégance. - (03) |
| trésaller : v. a., vx fr. trésaler, tressaillir, résonner, tinter, carillonner. - (20) |
| tresaller, carillonner, sonner. - (05) |
| trèselé*, v. n. chanter d'une voix traînante et vibrante. - (22) |
| trèseler, v. n. chanter d'une voix traînante et modulée (du bourguignon tréseler, carillonner). - (24) |
| treseler, v., tressaillir, avoir peur. - (40) |
| tréseller : trembler en chantant. (A. T II) - D - (25) |
| tréser. v. n. Germer, lever. (Athie). - (10) |
| trési - germer, pousser hors de terre les tout jeunes bleds qu'on appelle Trésies. - En voit les carottes que trésissant déji. - Les orges commençant de trési. - Les trésies sont bein jolies, Dieu les bénisse. - (18) |
| trési : germer. - (29) |
| trési : (tré:zi - v. intr.) germer, lever. - (45) |
| trési, trîser : germer, lever, trésir, germer - (48) |
| tresi, vn. lever : se dit des semences. - (17) |
| tresiâ, s. m., tas de trois gerbes redressées. - (40) |
| trésiau : tas verticaux de gerbes de céréales laissées sur le chaume à la moisson, en attendant le ramassage. - (62) |
| trésie, germination. - (28) |
| tresille, sf. ensemencement. Levée. Emblavure. - (17) |
| trésir : germer. Se dit de semences où les pousses commencent à poindre. Connu mais non utilisé chez nous, ce mot viendrait du celte tra (au delà) et du latin exire (sortir). - (62) |
| trésir (C.-d., Br., Chal.), treusir (Aux.), tréser (Y.), trezi (Morv.). - Germer, lever, en parlant des plantes. C'est un de ces mots, comme clairer, taler, gauger, reverper, trocber, veurder, etc., qui font le charme pittoresque du patois bourguignon, et méritent de passer dans la langue française… - (15) |
| trésir (verbe) : germer. - (47) |
| trèsir : lever, en parlant des graines. (G. T II) - D - (25) |
| tresir ou traisir. : Germer, sortir de terre. - (06) |
| trésir : 1 v. i. Apparaître. - 2 v. i. Sortir de terre. - (53) |
| trésir, germer (se dit en particulier des céréales qui commencent à sortir du sol). - (27) |
| tresir, germer, poindre, sortir de terre... - (02) |
| trésir, germer. - (26) |
| tresir, sortir de terre, poindre. - (05) |
| trésir, tersir. Germer, sortir de terre. « Le bié commence à tersir ». - (49) |
| trésir, v. imp. sortir de terre. Se dit seulement des végétaux. - (11) |
| trésir, v. intr., surgir, pousser, poindre, germer, sortir de terre. Se dit des plantes et des herbes : « Y'là l'blé qui trésit. » - (14) |
| tresir, v., pousser, germer hors du sol. - (40) |
| trésir. Germer, poindre. - (03) |
| trésir. Pas d'équivalent dans le pur français. Tresir signifie le fait par une plante de sortir de terre en montrant la - (12) |
| tresö, sm. groupement des javelots d'avoine eu vue du chargement sur les voitures. - (17) |
| trespercer, transpercer. - (04) |
| tressauter, v. intr., faire un soubresaut, tressaillir. - (14) |
| tressauter, v. n. tressaillir, faire un soubresaut. - (08) |
| tressauter. Synonyme patois de tressaillir. Un gros coup de taboulot nous ai fait tressauter... - (13) |
| tresse : haie. - (52) |
| tresse, trasse (n.f.) : haie sèche faite avec des branches entrelacées horizontalement (aussi trace) - (50) |
| tresseau : petites moyettes de quelques gerbes. (BD. T III) - VdS - (25) |
| tresser : tailler. - (52) |
| tresseure, v. n. action de l'eau qui s'infiltre dans la terre pour reparaître ailleurs. - (08) |
| tressière, endroit d'où se tire le sable. Ce mot, qu'on ne trouve dans aucun dictionnaire français, est particulièrement usité dans le Châtillonnais... - (02) |
| trèssôté, tressaillir subitement sous le coup d'une surprise agréable ou désagréable. - (16) |
| tressue. Sue abondamment. - (01) |
| tressuer, v. intr., suer abondamment : « Oh! laisse-me ; quand ô jabòte, ô m'fait tressuer. » - (14) |
| trestous, tous en général. - (04) |
| trétau : n. m. Tréteau. - (53) |
| trété quelqu'un, le régaler d'un bon repas ; trété d’aut an bâ une personne est lui faire toutes sortes de reproches : aujourd'hui on tréte les vignes malades. - (16) |
| tretelai, vaciller, n'être pas solide sur ses jambes. - (02) |
| treteler. Chanceler, marcher en titubant. Etym. inconnue. - (12) |
| trétiau, s. m., tréteau. Soutient souvent la planche sur laquelle se hisse le violonneux des fêtes. - (14) |
| tretô, composé du superlatif très et de l'adjectif tout, pour mieux exprimer l'idée de totalité... - (02) |
| treto. Tous sans exception. Tretous est du petit peuple… - (01) |
| treto. : (Pat.), trestuit (dial.), c'est-à-dire très tout, un très grand nombre de personnes. - (06) |
| trétot. n. m. - Têtu. « L'Nicolas te parles d'un trétot, i' veut rein savouèr ! » (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| tretous et teurious. Tous. - (13) |
| tretous, et teùrtous (fém. teùrtousses), pron. indéfini, tous ; mais dans une acception superlative, comme qui dirait : très tous, tout à fait tous. - (14) |
| tretous, tous ensemble. - (05) |
| tretous. Tous, comme un superlatif de tous. - (03) |
| trètye : s. f. écheveau de fil. - (21) |
| treû (na) - gaille (na) : coche (femelle du cochon) - (57) |
| treu : Pressoir, le mot ne s'emploie plus que dans l'expression : « Maître en treu » : patron du pressoir, celui qui dirige les opérations au pressoir. - (19) |
| treu : Trop. « Tâche de ne pas veni treu tâ ». - (19) |
| treu : truie - (51) |
| treu en bâton : saucisson (expression) - (51) |
| treu : s. m., vx fr. troll, treuil, pressoir. Voir trouille. - (20) |
| treu, s. m. pressoir. Verbe : trouilli. - (22) |
| treu, s. m. provision de fil qu'on portait au tisserand pour en faire une pièce de toile. - (24) |
| treù. Pressoir… - (01) |
| treûbé : v. i. Aller vite. - (53) |
| treubeu : se dit d'une vielle voiture qui va en cahotant. (LF. T IV) (RDF. T III) - A - (25) |
| treubeuilleu (on) - treubeuillot (on) - fiârde (na) : toupie (petite) (jeu) - (57) |
| treubi : gamin. - (32) |
| treubi : tourbillon de poussière, animal très vigoureux. (CST. T II) - D - (25) |
| treubillè, teurbillè : v. i. Marcher en ivrogne, manquer d'équilibre. - (53) |
| treuble, s. f. filet de pêche appelé en français trouble ou treuble avec un diminutif troubleau ou trubleau. - (08) |
| treuc : Troc, s'emploie dans la locution. « Changi treuc pa treuc » : échanger sans soulte ni retour. - (19) |
| treucher : taller (plante) - (48) |
| treuchi : Taller, pousser de nombreux rejets. « Ces bliés étint cliés mâ i ant bien treuchi ». - (19) |
| treuchi, v. n. émettre des rejets : du blé qui treuche (du vieux français trocher). - (24) |
| treucsin : Charivari. « Mener le treucsin », usage à peu près disparu qui consistait à faire à la porte des veufs convolant en secondes noces un tapage infernal. - (19) |
| treucuôde (n.f.) : cloporte (de Chambure) - (50) |
| treucuôde, s. f. cloporte. Notre mot signifie queue de truie par assimilation du corps de la bestiole avec la queue pelée d'un cochon. - (08) |
| treue - truie, et jeu avec une petite balle ou petite boule. - I ai vendu notre treue ai lai foire. - Les couchons veillant mieux que les treues. - Pôre enfant, t'é vraiment sâle quement ine treue. - Nina, veins don jue ai lai treue ; i ai une jolie cambole, moi. - (18) |
| treue (n.f.) : truie - (50) |
| treûe (na) : truie - (57) |
| treue (nom féminin) : truie. - (47) |
| treûe : (nf) truie - (35) |
| treûe : truie - (37) |
| treûe : truie - (48) |
| treue : truie. - (29) |
| treue : truie. - (66) |
| treue : Truie. « Ol a eune bonne treue, o vend des neurains tos les ans ». - Sorte de jeu. « An se sarve d'in bâtan à tarleuche quand an jue à la treue ». - (19) |
| treue : truie. Certains disent « gaille », alors qu’ailleurs c’est une chèvre, une femme maigre ou vieille ou les deux. - (62) |
| treue : truie. on dit aussi « gamelle ». - (52) |
| treûe : une truie - (46) |
| treue : voir couchon - (23) |
| treue : truie. La treue fait ses peutiots : la truie fait ses petits. - (33) |
| treûe baîrrée : insulte à une femme de mauvaises mœurs - (37) |
| treue n.f. Truie. - (63) |
| treue : (treu: - subst. f.) truie, femelle du porc. Le porc reproducteur est le verrat. Le mot a pris un sens péjoratif qui dépasse largement le territoire morvandiau ; il désigne plus que les prostituées, les malfaisants, les gens odieux sans distinction de sexe. En revanche la gay' ne désigne que la truie elle-même. - (45) |
| treue : s. f., truie. - (20) |
| treue : truie - (39) |
| treue : truie. - (32) |
| treue, gai-lle : n. f. Truie. - (53) |
| treue, gaille. Truie. Fig. Le mot « treue » s'emploie comme insulte, car on lui donne le sens de femme de mauvaise vie.... - (49) |
| treue, n.f. truie. - (65) |
| treue, s. f. truie, femelle du porc. - (08) |
| treûë, s. f., truie. Un garçon disait à une fille couraude : « Va-t-en ; t'né qu'eùne treûë. » - (14) |
| treue, sf. terrasse. - (17) |
| treue, sf. truie. - (17) |
| treue, subst. féminin : truie. Au sens figuré, il qualifie de façon péjorative une personne fainéante, trop enveloppée ou négligée. - (54) |
| treûe, truie et nom d'un jeu d'enfant. - (16) |
| treüe, truie. - (05) |
| treue, truie. - (26) |
| treue, truie. - (27) |
| treue. n. f. - Truie. - (42) |
| treue. Truie. - (03) |
| treuf : le trèfle - (46) |
| treuf : pomme de terre - (44) |
| treuf a la patte : purée - (44) |
| treufe - trèfle. - Les treufes sont aissez bais, c't'année. - Vai don cherché ine voiture de treufe pou le déjeunai des bêtes demain. - (18) |
| treufe (n. m.) : trèfle - (64) |
| treufe : Truffe. « An dit qu'y a des treufes dans le beu de Manci mâ naguin ne les charche ». - (19) |
| treùfe, et treùfle, s. f., pomme de terre : « J'ai métu à cueùre des treùfes d'avou des raves : y é gros bon. » - (14) |
| treufe, s. m. trèfle, plante fourragère. Il y a cinquante ans le Morvan ne connaissait d'autre trèfle que celui des jeux de carte. - (08) |
| treûfe, s. m., trèfle, plante. - (14) |
| treufe, sm. trèfle. - (17) |
| treufe, truffe et pomme de terre. - (16) |
| treufe. Truffe, truffes… - (01) |
| treuffe (d'la) : tourteau - (57) |
| treuffe (n.f.) : pomme de terre (aussi treffe) - (50) |
| treuffe : (nf) pomme de terre - (35) |
| treuffe : la pomme de terre - (46) |
| treuffe : pomme de terre - (34) |
| treuffe : pomme de terre - (43) |
| treuffe : pomme de terre - (51) |
| treuffe : pomme de terre - (48) |
| treuffe : pomme de terre. - (52) |
| treuffe : pomme de terre. - (59) |
| treuffe : une pomme de terre ; des treuffes en piau : pomme de terre en robe des champs. - (56) |
| treuffe : voir truffe - (23) |
| treuffe : pomme de terre. Dans le Morvan o y aivot trebin de treuffes : dans le Morvan il y avait beaucoup de pommes de terre. - (33) |
| treuffe n.f. (de truffe). Pomme de terre. - (63) |
| treuffe : (treuf' - subst. f.) 1-pomme de terre , mot issu de truffe, produits qu'on trouve en terre. 2-trèfle aussi bien la plante que la carte à jouer : joué è treuf', jouer trèfle. Le trèfle blanc s'appelle le trouyo. - (45) |
| treuffe : n. f. Pomme de terre. - (53) |
| treuffe : pomme de terre. - (32) |
| treuffe ou truffe : pomme de terre (tartouffe) - (60) |
| treuffe, s. f. pomme de terre. - (08) |
| treuffe, s. f., pomme de terre. - (40) |
| treuffe, subst. féminin : pomme de terre. - (54) |
| treuffe. Pomme de terre. Treuffe est le patois de truffe. A l’apparition de la pomme de terre bien des gens l’appelaient truffes. - (12) |
| treuffe. s. m. Trèfle. (Guillon). - (10) |
| treuffes - pommes de terre. - I venons de piaicher nos treuffes. - I ons aivu quinze sai de treuffes dan note champ. - (18) |
| treûffes : pommes de terre - (37) |
| treuffes à la patte n.f.pl. Pommes de terre prélevées sur celles cuites pour les cochons ou les volailles, placées dans un torchon, tappées contre une pierre ou une poutre avant d'être posées sur des cendres chaudes ou sur la plaque du fourneau quelques minutes avant d'être consommées sans accomodement. - (63) |
| treûffes ai lai paitte : pommes de terre au lard et aux pattes de volailles - (37) |
| treûffes beûriées : pommes de terre écrasées avec un peu de gras - (37) |
| treûffes en paitouillotte : pommes de terre en ragoût - (37) |
| treuffes : pommes-de-terre - (39) |
| treuffes, n. fém. plur. ; pommes de terre. - (07) |
| treuffes, pommes de terre - (36) |
| treuffi : (nm) champ de pommes de terre - (35) |
| treuffi : champ de pommes de terre - (43) |
| treuffiât : boursouflé (comme une treuffe). - (56) |
| treuffle, s.f. pomme de terre. - (38) |
| treufle, treufe. n. m. - Trèfle. - (42) |
| treûgnon (n.m.) : pépin et tige d'un fruit (pomme, poire) - (50) |
| treùil, et treù, s. m., pressoir. - (14) |
| treuil, n.m. pressoir. - (65) |
| treuille, triolet : trèfle - (43) |
| treuille. n. f. - Treille. - (42) |
| treuiller (v.t.) : boire souvent et beaucoup (de l'a, fr., troilleor = celui qui gouvernait le pressoir et percevait les droits (de Chambure indique trouiller) (aussi trauiller) - (50) |
| treuiller (verbe) : boire rapidement et avec excès. - (47) |
| treuiller : boire - (61) |
| treuiller : boire comme un trou ou faire du bruit en buvant - (60) |
| treuiller : pressurer - (43) |
| treuiller, v. n. attendre longtemps avec ennui, avec impatience, droguer. - (08) |
| treuillet : trèfle - (51) |
| treuilli : écraser. A - B - (41) |
| treuilli : écraser - (34) |
| treuilli : écraser, tordre (le linge) - (43) |
| treuilli : trier - (57) |
| treuilli v. (de treuil, du lat. troculum, le pressoir). 1. Treuiller. 2. Ecraser. - (63) |
| treûillòt, s. m., pain résultant de l'écrasement des noix, résidu après l'huile faite. - (14) |
| treuillou (nom masculin) : gros buveur. - (47) |
| treuion n.m. (Ce mot pourrait avoir été construit à partir de treue, truie) Partie de la porcherie réservée à la truie et ses petits. - (63) |
| treulè : v. t. Bâcler. - (53) |
| treulé, pauté. Jeune berger chargé de la garde des porcs. - (49) |
| treûler : manquer le but - (37) |
| treûler, verbe transitif : saboter. - (54) |
| treumeau, s. m. trumeau, jambage en pierre taillée qui sépare deux ouvertures de maison. - (08) |
| treumi, trémoi. - (26) |
| treupe, trope n. f. (du v. fr. treper, taper du pied). Touffe de végétaux, résultat du piétinement. - (63) |
| treûper : (vb) (en parlant du blé) taller, émettre des tiges secondaires à la base de la tige principale - (35) |
| treupèt, sm. troupeau. - (17) |
| treupi v. Repousser en partant du pied pour un végétal ; on dit aussi rtreupi. - (63) |
| treûpid : (nm) trépied - (35) |
| treuquer : Troquer, échanger. « Treuquer in chevau borne cantre eune éveuilli ». - (19) |
| treuqui, s. m., maïs (grain). - (40) |
| treusir : (trésir) sortir de terre, germer - (46) |
| treut : Morceau, tronçon « In treut de boudin » : un morceau de boudin de la longueur du boyau dans lequel il a cuit. - (19) |
| treut : Trot. « San chevau a fait tote la mantée au treut ». - (19) |
| treutchi (du) : maïs - (57) |
| treute : Trotte, distance « Y a eune bonne treute de Manci à Tôrneu ». - (19) |
| treuté, vn. trotter. - (17) |
| treuter : Trotter. « Tins te bin, an va treuter ». - Marcher beaucoup, courir çà et là. « Y est eune fane que n'est jamâ chez lyine, aile treute tot le temps ». - (19) |
| treutinié, vn. trottiner. Faire des embarras. - (17) |
| treutjelé, vn. [torteler]. fuir en trébuchant. Se dit d'un animal blessé, d'un lièvre démonté. - (17) |
| treutsi (teurtsi) (tseurtsi) : chercher - (51) |
| treutyi : s. m. maïs. - (21) |
| treuvé, trouver ; La Fontaine disait aussi treuvé. - (16) |
| treùver, v. tr., trouver. Ce verbe n'a pas donné le substantif treùve. - (14) |
| Treuvi : (NL) Trivy - (35) |
| Treuvijaud (e): habitant (e) de Trivy - (35) |
| treûyer : voir à peine clair - (37) |
| treûyi : (vb) trier ; récolter le miel - (35) |
| treûyi : presser, serrer - (43) |
| treûyon : (nm) cour fermée où on nourrit les porcs - (35) |
| treuyon : cour fermée où l'on nourrit les porcs - (43) |
| treûyot, trûyot : trèfle - (37) |
| treuzeler, v. carillonnner ; rassembler les gerbes trois par trois. - (38) |
| treuzi, v. germer. - (38) |
| trêve, repos des armes... - (02) |
| trevè[y] : travail. - (52) |
| trevè[y]er : travailler. - (52) |
| trèveché, vt. traverser. - (17) |
| trévider. v. a. Transvaser. (Soucy). - (10) |
| trevoir, v. tr., entrevoir. - (14) |
| trévouâ (v.) : entrevoir, voir confusément - (50) |
| trévouâ, v. a. entrevoir, voir à un faible degré ou confusément. se dit d'une personne qui a la vue mauvaise ou qui n'est pas en situation de voir librement. - (08) |
| trévouai - entrevoir. - I ne seus pâ aivûille tot ; ai fait i trévouai in pechot, voilai to. - I vos ai trévus mas que vos passaint devant chez no. - (18) |
| trévouère : apercevoir, deviner - (48) |
| trévu, entrevu ; trévoé, apercevoir confusément. - (16) |
| tréye, pied de vigne courant sur un treillis de lattes ou de fil de fer duquel lui vient son nom. - (16) |
| treyer : trier - (43) |
| trézaler : Carillonner. « Y est dan fête demain qu 'i trézale stu sa? ». « Trézaler en chantant » : chevroter - (19) |
| trézaler, v. tressaillir ; faire trembler sa voix en chantant. - (38) |
| trezéa, clocher... Du mot bourguignon trezea, clocher, a été fait le verbe traizelai ou trezelai, sonner, carillonner. - (02) |
| trezea. : (Très haut.), clocher. D'où trezelai, sonner les cloches. - (06) |
| trezelai, sonner... - (02) |
| trézeler. Sonner plusieurs cloches, carillonner. Trézeau, sonnerie composée de trois cloches... - (13) |
| trezelon. Sonnons les cloches solennellement, avec mesure et accord, pour honorer la fête. Celle espèce de musique se faisant anciennement avec quatre cloches, on a dit de là quadrillonner, selon Ménage, et par contraction carillonner. En Bourgogne, où l’on n’employait à cela que trois cloches, on a dit treseler, quasi troiseler, et par treseler on entend carillonner. - (01) |
| trezeule. Carillonne. Voyez trezelon. - (01) |
| trézeûler, v. intr., carillonner, sonner les cloches solennellement. - (14) |
| trézi (v.t.) : lever en parlant d'un semis - (50) |
| trëzi, lever, en parlant des graines, lorsqu'elles sortent de terre. - (16) |
| trézi, v. n. se dit des graines lorsqu'elles lèvent et commencent à couvrir la terre : les blés sont « trézis ». - (08) |
| trézie (n.f.) : semaille qui lève - (50) |
| trézie, s. f. semaille lorsqu'elle lève : voilà une belle « trézie » ; les « trézies » ont besoin de pluie. - (08) |
| trézir. Se dit d'une graine dont le germe commence a sortir de terre. Mon troqué ast trézi. (V. Troqué.) - (13) |
| tri : tirer - (43) |
| tri, tric, s. m. triage, action de mettre à part, de séparer par un choix. Dans un lot de moutons on fait le « tri » ou « trie » de ceux qu'on veut vendre ou qu'on veut conserver. - (08) |
| trian : Espèce de cage où l'on emprisonne la poule couveuse (la cluche) avec ses poussins. Les barreaux de cette cage sont espacés de façon que les poussins puissent sortir et rentrer librement alors que la poule reste prisonnière. - (19) |
| triandine : Bêche dont le fer est partagé en trois dents. - (19) |
| triandine : fourche à dents mouchetées. Généralement à 9 dents, pour charger des cailloux…des pommes de terre (sans les blesser). - (62) |
| triandine : sorte de pioche. (B. T IV) - S&L - (25) |
| triandine n.f. Fourche à fumier à 9 dents pour ramasser les pommes de terre ou les topinambours. - (63) |
| triandine, s. f. bêche à dents (v. fig. à rochi). - (24) |
| triandïne, traîandine : s. f., vx fr, traïant, bêche dont le fer au lieu d'être plein est divisé en trois dents. Voir traiant. - (20) |
| tribler, triebler, triubler. : (Dial.), écraser. (Du latin terere.) « Tribler les espèces en très tenue purrière el mortier del cuer. »(S. B.) - (06) |
| tribolot, s. m. espèce de toton, jouet d'enfant. - (08) |
| tribouler, tourmenter. - (05) |
| tribouler, v. tr., turbuler, tourmenter. - (14) |
| tribouler. Tourmenter ; du latin tribulare, d'où est venu tribulation. - (03) |
| tribunal : s, m., personne appartenant au monde judiciaire. - (20) |
| tricacher. Marcher difficilement, en se dandinant, en se déhanchant. - (49) |
| tricage. s. m. Dans les pays de flottage, triage des bûches marque par marque, pour faire les piles de chaque marchand. (Pays riverains de la Cure et de la Haute- Yonne). — Voyez triquer. - (10) |
| trichai, tromper au jeu... - (02) |
| tricô. : Gourdin. D'où le mot tricoté quelqu'un, c'est-à-dire le battre à coups de tricô. - (06) |
| tricodöt, sm. fruits secs, friandises de la veillée. - (17) |
| tricoise : tenaille. - (66) |
| tricoise, s. f., grosse tenaille à l'usage des maréchaux pour ferrer les animaux. - (11) |
| tricot d'piau n.m. Maillot de corps. - (63) |
| tricot n.m. Pull-over. - (63) |
| tricôtai. Tricotet, tricotets, sorte de danse gaie, ainsi nommée, parce que le mouvement du pied y est aussi prompt que l'est celui de la main d’un tricoteur, ou d’une tricoteuse de bas. - (01) |
| tricoté : v. t. Tricoter. - (53) |
| tricoter, v. intr., traîner le pied en marchant, battre le pavé à la manière des ivrognes. - (14) |
| tricöts, tricots, sm. bonbons et fruits secs que les parrains jettent aux enfants après un baptême. - (17) |
| tricouèses : tenailles - (48) |
| tridaine, tiretaine. - (05) |
| tridin-ne : trichine (sorte d'étoffe). (RDM. T IV) - B - (25) |
| triendine, s. f., grande fourche à bêcher, à trois dents. - (40) |
| trient, s. m., fourche à trois dents, contraction de trident. - (11) |
| trient, trident. - (05) |
| trier, « L » sevrer, trahere, tirer (de la mamelle). - (04) |
| trier, v. a. choisir et sevrer. (voir : teurier.) - (08) |
| trier. v. - Seuvrer, selon M. Jossier. - (42) |
| trier. v. a. Sevrer. (Puysaie). - (10) |
| trifouillé, vn. remuer dans l'eau. - (17) |
| trifouiller, v. tr., chercher, mais en remuant beaucoup et sans ordre ; mettre sens dessus dessous. - (14) |
| trifouilli : trifouiller - (57) |
| trigaud : trompeur - (60) |
| trigaud. n. m. - Sournois, fourbe, hypocrite. - (42) |
| trigauder. v. - Opérer comme un sournois, comme un trigaud. - (42) |
| trigori. Désordre, vie licencieuse, débauche, nommée ici trigori par corruption du mot trihori, sorte de branle gai de Bretagne. - (01) |
| trigouchi (se) : Se colleter, se tirailler. « Ces dreules sant toje après se trigouchi ». - (19) |
| trigouerie : n. f. Grand nombre. - (53) |
| trigouri : bruit désordonné, chahut. (RDM. T III) - B - (25) |
| trigouri : ménage mal tenu. (CH. T III) - S&L - (25) |
| trigouri, sm. remue-ménage, désordre. - (17) |
| triji : v. commencer à sortir de terre (se dit des plantes). - (21) |
| triler. v. n. Se plaindre. Se dit sans doute par une sorte d’analogie avec le petit cri strident, un peu plaintif, que poussent les bécasses lorsqu’elles se rappellent au moment de leur passage. (Saint-Bris). - (10) |
| triller, v. n. germer, pousser, sortir de terre. (voir : trézi.) - (08) |
| trillon : dôme en grillage pour isoler une volaille, un lapin. - (66) |
| trimai, trimer, marcher vite et beaucoup... - (02) |
| trimard : journalier ambulant, chemineau - (48) |
| trimardeau. n. m. - Traînard, vagabond. Désigne plus précisément 1’ouvrier agricole, qui va de ferme en ferme à la recherche d'un travail (Sougères-en-Puisaye). En ancien français, au XIIe siècle, un trumel / des trumiaus signifiait « la jambe». Au XIVe trumer voulait dire « aller çà et là, s'enfuir ». On retrouve le mot « trimarder » au XIVe dans le sens de « cheminer, marcher avec fatigue ». Il reste une trace de ce sens en français argotique actuel : 1. Trimard signifie : chemin, route, et par extension vagabond. 2. Trimarder signifie : vagabonder, courir les grands chemins. 3. Trimardeur signifie : vagabond, allant de ville en ville chercher du travail. - - (42) |
| trimardié, s. m. coureur de grands chemins, vagabond. - (08) |
| trimbailer : transporter des affaires, « transbabuter » - (37) |
| trimballer - chambilli : tituber - (57) |
| trimballer, faire danser. - (05) |
| trimbier (v.t.) : trembler - (50) |
| trimbler, v. trembler (moderne). - (38) |
| trimblier : Trembler. « Trimblier de peu » : trembler de frayeur. - (19) |
| trimb'lle : Tremble, populus tremulus. « Inpid de trimb'lle ». - (19) |
| trimé, aller vite, avec fatigue, d'un lieu à un autre. - (16) |
| trimer : travailler dur - (44) |
| trinbalé, porter une chose et conduire une personne d'un lieu à un autre, sans avantage pour elle. - (16) |
| trinballer. Traîner un objet dans tous les sens. Teus les jors an le voit trimballer sai bourouette su lai grand’ route. C'est une altération du verbe trinqueballer, qui signifiait danser en s'entrechoquant. Il y a certainement quelque rapport entre ce mot et les expressions se balader, avoir les bras ballans... - (13) |
| trinchi : tourner (cailler) - (57) |
| trindje, sf. tringle. - (17) |
| trîner : courir. - (66) |
| tringler : faire l'amour - (44) |
| tring'lle : Tringle. - (19) |
| tringniau, s. m. 1. traîneau. — 2. Homme jamais pressé, traînard. Féminin tringniaude. - (24) |
| tringniau, s. m. traîneau. Homme jamais pressé, traînard. - (22) |
| tringnô : mendiant. - (66) |
| trinhné : (tr. litt. : trainée) renouée liseron, chiendent rampant. A - B - (41) |
| trinké, choquer les verres avant de boire ; à lui seul, le mot allemand trenken veut dire : boire ; les Anglais disent : drinking (drinkin) de drink, boisson ; mots dans lesquels le choc des verres n'apparaît pas. Si j’trinkèn ! invitation à boire, dans un repas. - (16) |
| trin-ne-guin-ne, s. f. longue traînée de fil, d'herbes ou de lianes emmêlées. - (22) |
| trin-ne-guin-ne, s. f. longue traînée de fil, d'herbes ou de lianes emmêlées. Personne jamais tournée. - (24) |
| trin-niâ, s.f.(de la), herbes aux racines traînantes, le chiendent par exemple. - (38) |
| trinqu’bailer : promener, déplacer dans tous les sens - (37) |
| trinqueballe : triqueballe - (48) |
| Trinquelin. Nom de la petite rivière qui passe au pied du monastère bénédictin de la Pierre-Qui-Vire. - (08) |
| trinquenaler : v. n., bringuebaler, brimbaler. - (20) |
| trinquet. s .m. Mesure de bois de chauffage ayant 4 pieds en tous sens. Un trinquet de souches. Un trinquet de coupiaux. - (10) |
| trintchet, trinquet, trintcher. n. m. - Mesure de volume, utilisée pour le bois de chauffage. Le « trinquet » représentait un cube de quatre pieds en tous sens, soit un volume de 2,2 stères. - (42) |
| triolai. Triolet, triolets, sorte de poésie ancienne, renouvelée en 1649, pendant le blocus de Paris. Chaque triolet consiste en huit vers, le premier desquels, le quatrième et le septième ne sont qu'un seul et même vers, et c'est de cette triple répétition que vient le mot triolet. - (01) |
| triolet : trèfle violet (en A : sainfoin*). B - (41) |
| triolet : Nom masculin. Trèfle. - (19) |
| triolet : trèfle violet - (34) |
| triolet n.m. Trèfle violet. - (63) |
| triòlet, s. m. trèfle des champs. - (24) |
| triomfan. Triomphant, triomphants. - (01) |
| triomfle. Triomphe. - (01) |
| trion : local à l'air libre où sont nourris les cochons (en B : ronde*). A - (41) |
| trion : cloche grillagée. Posée sur la nourriture des poussins, leur permet d’y accéder librement, à l’abri des volailles adultes. - (62) |
| trion : s. m., vx fr., mue, cage à poussins. Syn. de buidon. - (20) |
| trioulet, s. m. trèfle des champs. - (22) |
| trioulot. s. m. Trèfle rouge. (Béru). - (10) |
| tripai - fouler, marcher sur ; très mouillé. - Al ant to tripai note champ en passant ; al à aibimai. - Quée plieue i sons revenus tripai jusqu'es os. - (18) |
| tripai, marcher sur. Expression très-usitée dans le Châtillonnais. (Voir au mot trebillai.) - (02) |
| tripai. : Marcher sur quelque chose.- En latin tripudiare (Voir toupillai.) - (06) |
| tripaitouiller : mélanger dans le but de cacher une malversation - (37) |
| tripaitouîller : remuer dans tous les sens un liquide avec les mains - (37) |
| tripaitouiller : toucher partout, « peloter » - (37) |
| tripant, te, adj. Lessivé ; ruisselant d'eau. - (17) |
| tripé (adj.) : tremper (syn. éjé, enfondu) - (64) |
| tripé : être mouillé - (46) |
| tripé : mouillé - (44) |
| tripè : mouiller - (46) |
| tripè : piétiner - (46) |
| tripé : trempé (mouillé) - (61) |
| tripé : trempé par la pluie. - (66) |
| tripé : trempé, pénétré de pluie, mouillé d’eau - (37) |
| tripé : trempé. IV, p. 37-7 - (23) |
| tripé : mouillé. - (32) |
| tripé : très mouillé - (39) |
| tripé, adjectif qualificatif : trempé, mouillé, transpercé par la pluie. - (54) |
| tripé, e, adj. mouillé, trempé. s'emploie emphatiquement avec le partic. passé mouillé : « al ô v'ni tripé, moueillé », il est venu trempé jusqu'aux os. - (08) |
| tripé, mouillé. - (27) |
| tripé, trempé d'eau, taché de boue. - (16) |
| tripè, trempè : v. t. Tremper. - (53) |
| tripé, vn. fouler, piétiner. - (17) |
| tripé. Trempé, mouillé jusqu'aux os ; forme altérée de trempé. - (12) |
| tripée : mouillée, trempée (moule) - (60) |
| tripe-poussö, sm. huissier. Faiseur d'embarras. - (17) |
| triper : mouiller (beaucoup) - (48) |
| triper : Vaciller en parlant de la lumière d'une lampe qui varie d'intensité par saccades. - (19) |
| triper, v. a., broyer, écraser. (V. Pautrer, et, pour les congénères, Trépiller.) - (14) |
| triper, v. transpercer (je suis tripé : je suis transpercé par la pluie). - (65) |
| triper. v. - Friper, élimer, user en parlant des vêtements. Autre sens : être trempé jusqu'aux os. (Arquian) - (42) |
| triper. v. a. User, déchirer un habit à force de le tirer, de le frotter, de se traîner en jouant. (Perreuse et un peu partout). - (10) |
| tripette : ne pas valoir tripette : ne pas valoir grand-chose (entre autre, gustativement). - (56) |
| tripette, loc. ne pas valoir tripette, c'est ne rien valoir du tout. - (08) |
| tripeu, plate-forme ou balcon en haut d'un escalier, devant la porte d'un premier étage. - (27) |
| tripeuter : Tripoter, s'occuper sans arrêt de petits travaux domestiques. - (19) |
| tripler. Dans notre patois de la plaine on dit mes uillots triplent, lorsqu'on a des étourdissements ou plutôt des éblouissements. C'est encore plus fort que d’y voir double ! - (13) |
| trip'lle : Triple. - (19) |
| tripo, escalier, avec tablier en pierre à son sommet, devant la porte d'une maison. - (16) |
| tripô. Tripot. - (01) |
| tripô. Voir au mot trebillai. - (02) |
| tripolins (es) : chahuter. - (66) |
| triporcer : transpercer par la pluie - (39) |
| tripot, s. m. gros travail journalier et ménager. - (24) |
| tripot, s. m., besogne, ménage : « Aile é dégordie, tô d'meinm e; tô les jòrs alle a fini son tripot d'boune heûre. » - (14) |
| tripot. Salle de jeu de paume. Au siècle dernier, toutes les villes avaient un tripot : celui de Beaune se trouvait rue Gandelot derrière la maison qui porte le n° 27 de la rue de Lorraine... - (13) |
| tripotée : beaucoup de choses. - (66) |
| tripotée, grande quantité. - (27) |
| tripougner, v. tr., farfouiller, déranger, abîmer avec les mains. - (14) |
| trippé : trempé de pluie, mouillé - (37) |
| trippes, intestins, d'où étripper. - (05) |
| triquage (n.m.) : triage, séparation des lots - (50) |
| triquage, s. m. triage, action de choisir dans une masse, de la séparer par lots, par catégories. - (08) |
| triquai - trier, choisir, déméler. - En â nécessaire de triquai ces treuffes qui ; car en y en é que se peurissant.- Trique voué les grosses brainches dans lai faigots pour fâre du bo de chauffaige. - (18) |
| triqualer, v. trembler de froid. - (38) |
| triqualou, -ouse, s. qui tremble de froid, - (38) |
| trique (n.f.) : gros bâton - (50) |
| trique : baguette rigide - (44) |
| trique : bûche qui a séjourné dans l'eau. - (09) |
| trique n.f. Bâton. - (63) |
| trique : s. m. Attends, si je prends « un » trique, te vas voir ! - (20) |
| trique, s. f. bâton d'une certaine grosseur, branche ou tige assez forte pour l'attaque ou la défensive. - (08) |
| trique, s. f., jambe : « J't'li ai fichu des coups de saibot su ses triques ; j'lai ben fait lâcher. » - (14) |
| triqué, vt. démêler, classer par catégories des animaux ou des plantes, moutons, semences, etc... - (17) |
| triquée : une volée à coups de trique - (46) |
| triquée n.f. Râclée, correction. - (63) |
| triquer (v.) : trier, séparer par lots - (50) |
| triquer (v.t.) : battre avec une trique - (50) |
| triquer : battre à coups de trique - (48) |
| triquer : faire séjourner le bois dans l'eau. - (09) |
| triquer : donner des coups de trique - (39) |
| triquer, v. a. battre : triquer un petit maraudeur. - (24) |
| triquer, v. a. trier, clioisir, séparer. - (08) |
| triquer, v. n. sauter, danser lourdement. - (08) |
| triquer. v. a. Trier marque par marque les bûches amenées par le flot, afin de pouvoir établir les piles de chaque marchand. (Pays riverains de la Cure et de la Haute-Yonne). — En général, séparer, choisir. - (10) |
| triqueut : Grosse trique. « Quand o travarse le beu la né ol a tojo in ban triqueut dans sa main ». - (19) |
| triqueuter : Frapper à coups de trique, battre. « O s'est fait triqueuter ». - (19) |
| triquoise, tenailles. - (27) |
| triquoises : tenailles. (S. T III) - D - (25) |
| triquòt, s. m., gourdin, bâton taillé dans une grosse branche. - (14) |
| triquòtée, s. f., roulée, trempée. - (14) |
| triquoter, v. n. marcher en traînant le pied, en zig-zag. se dit des ivrognes et des vieillards dont le pas est mal assuré : pauvre homme il ne marche plus, il « triquotte. » - (08) |
| triser : germer - (48) |
| trisi : lever (sortir de terre pour une graine) - (57) |
| trissè : s'enfuir - (46) |
| trissè : v. pr. S'enfuir. - (53) |
| trisse. adj. -Triste. - (42) |
| trisser : sortir de terre. (MM. T IV) - A - (25) |
| trisser. v. n. S’effiloquer, se disjoindre ; se dit d’une étoffe dont l’usure disjoint les fils. (Beugnon, Perrigny). - (10) |
| tri-tri n. (onom.). Personne hyper-active. - (63) |
| tritri : s. m. et f., personne qui fait ses embarras, qui se donne de l’importance, qui s'agite dans le vide, mouche du coche. - (20) |
| triyandine : fourche à dents. - (21) |
| trò (C.-d., Br., Chal., Morv.). - Morceau, souche ; s'emploie pour trognon (on dit un tro de choux). Vient du latin truncus, tronc, dont il est la prononciation bourguignonne. - (15) |
| trô : gros morceau - (48) |
| trô d'boudin : un long morceau de boudin - (46) |
| trô : n. m. Gros morceau. - (53) |
| tro : s. m. rouleau de boudin. - (21) |
| trò, adv., trop. Plusieurs dévots au culte du vin blanc trouvent souvent que trò ce n'est pas assez. - (14) |
| trô, trou, s. m. tronc, petite souche, racine d'arbuste. - (08) |
| tro. Ne s'emploie que pour tro de boudin ou de chou. - (03) |
| tro. Tige de certaines plantes : « un tro de chou » par exemple. - (49) |
| trô. : Trop. Trô ra trô, bourguignonisme et réduplicatif pour trop r'est trop. - (06) |
| tro’ : trognon. Tronçon de différentes plantes…et part de boudin. - (62) |
| trobiller : trébucher, vaciller. - (29) |
| trobiller, v., risquer de tomber, de gauche à droite. - (40) |
| trobiyé, treubiyé, marcher d'un pas chancelant, comme un homme ivre. - (16) |
| trôbli. Troublai, troublas, troubla. - (01) |
| trôblle, s. f. table. - (22) |
| troby : s. f. table . - (21) |
| trobye : table. - (30) |
| tròbye, s.f. table. - (24) |
| trocard. n. m. - Sorte de seringue métallique servant à perforer la panse des vaches, après une trop grande absorption d'herbe fraîche. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| troche : touffe compacte d’herbe. Souche à tiges multiples…qui trochent. - (62) |
| troché, pousser des tiges ; en latin truncos agere... - (02) |
| troche, s. f., touffe d'herbe. - (40) |
| troche, s. f., trochée, gros épi, souche à plusieurs tiges, poignée d'herbes, tresses de maïs suspendues pour sécher, touffe ou bouquets de fleurs ; « Eùne troche de sersifis, de râïns, » etc. - (14) |
| troche, touffe d'herbe. - (28) |
| troche. Souche à plusieurs tiges ; en vieux français troische est un bouquet de fleurs. - (03) |
| troché. : (Dial. et pat.), pousser des tiges, c'est-à-dire littéralement devenir dru, en parlant d'une plante. - (06) |
| trocher (C.-d., Br., Chal.), trècher, troicher (Morv.). - Terme d'agriculture, signifiant proprement taller. Taller se dit d'une souche projetant autour d'elle plusieurs tiges. Suivant Littré le mot trocber est usité en français et s'applique à l'ensemble des rameaux d'une plante coupée à ras de terre ; il vient du patois bourguignon et dérive du vieux français troche, signifiant faisceau, bouquet, touffe d'herbes ou de plantes. C'est parfaitement exact. Le mot troche s'écrivait troiscbe au moyen âge ; il a également formé trosse ou trousse, signifiant faisceau, paquet (du Cange, Nicot). Trocher signifiait pulluler. L'étymologie en est probablement truncus agere, pousser des tiges. - (15) |
| trocher : pousser des tiges. - (66) |
| trocher, troche, taller, pulluler. - (05) |
| trocher, v. tr., pousser par le pied, devenir dru : « Les blés ont déjà troché. » ont poussé en troches. - (14) |
| trocher. Émettre des rejets, des pousses. - (49) |
| trocher. Taller, se dit d'une plante qui pousse en touffes qui s'accroissent sans cesse. Etym. en breton l'oseille, qui est la plante trochante par excellence s'appelle trechon ; l'ancien français avait trochée, touffe d'herbe ou de plante, que nous avons d'ailleurs conserve avec le même sens. - (12) |
| trocheu, groupe de plusieurs fruits sur la même coursonne. - (27) |
| trœbiyi : v. chanceler. - (21) |
| troéche, troche ; troéché, trocher, jeter plusieurs tiges. - (16) |
| trœfa : s. f. tourte. - (21) |
| trœpalé : v. pulluler (plante). - (21) |
| troer (v.) : trouer - (50) |
| troeu, s. m. provision de fil avec laquelle le tisserand faisait une pièce de toile. - (22) |
| trognon n.m. Résidu d'un aliment dans lequel on a mordu, tel un fruit ou encore un légume ou même du pain. - (63) |
| troi. Trois. - (01) |
| troichai, troicherant - en parlant des blés, des plantes en général, qui, en sortant de terre, poussent plus ou moins de tiges. - Les Bliets, c't'année, troichant bein. – Aivou in pecho de plieue les orges troicherant. - (18) |
| troiche et troichot. Agglomération de pousses ou de feuilles : eune troiche de févioles, de piarsil, de salade. Troicber, pousser dru et serré. A rapprocher de trognon, en patois : tronjon. A m'ai fait mau ai lai joue en me jetant un trognon de chou. - (13) |
| troiche, s. f. trochet, bouquet, touffe de grains ou de fruits qui garnissent le rameau d'une plante ou d'un arbuste : une « troiche » de sarrasin, de chenevis, de noisettes, de cerises. - (08) |
| troiche, troichie, troicho - petite poignée, petit bouquet de quelque chose ; pincée. - Voiqui ine troiche d'herbe joliment vivace que pousse du jor au lendemain. - Te m'aiporterez ine troichie de piersi qu'à dan le coin du jairdin. - Beille moi z-en ran qu'in troicho. - (18) |
| troichenotte, s. f. petit trochet, rameau en corymbe du sarrazin qui porte le grain, bouquet de fruits sur la même branche. - (08) |
| troicher, v. n. taller. Se dit des plantes qui, étendant leurs racines autour d'elles, projettent des tiges nombreuses. - (08) |
| troinche (n.f.) : tranche - (50) |
| troinche, s. f. tranche, morceau, tronçon. - (08) |
| troincher (v.t.) : trancher - (50) |
| troincher, v. a. trancher, couper par morceaux, fendre, faire une fosse. - (08) |
| troinchou (n.m.) : tranchoir - (50) |
| troinchou, s. m. billot ou planche de forme arrondie sur laquelle on coupe le lard. - (08) |
| troizeime. Troisième. - (01) |
| troké, treuké, maïs. - (16) |
| trôlai - aller souvent dans le même endroit, généralement pour bavarder. - Ile ne fait portant que trôlai tot porqui ! Quainne habitude ! en faut que trôlaint pertot et tôjeur ! - (18) |
| trôlai, aller partout colportant des nouvelles... - (02) |
| trôlée, s. f., coureuse, fille dévergondée, qu'on trouve partout... et qu'on laisse. - (14) |
| trôlée. n. f. - Ribambelle : « Je te rencontre dans le jardin sur les murs, l'air fou, ridicule, une trôlée de matous autour de toi. » (Colette, Claudine à l'école, p.91) - (42) |
| trôler (v. int.) : rôder (syn. ferler) - (64) |
| troler : flâner, se promener. (R. T IV) - Y - (25) |
| trôler : marcher en flânant. - (09) |
| trôler : rôder pour voler. - (66) |
| trôler, et trauler, v. intr., courir çà et là. - (14) |
| trôler, rôder dans le village ou dans les propriétés, souvent pour dérober. - (27) |
| trôler, trauler (v.t.) : aller de-ci de-là, vagabonder - (50) |
| troler. Fouiller, chercher, traîner. - (49) |
| trôler. v. - Traîner, vagabonder : « I' faut toujou' s'déméfier d'tous ces galtrus qu'trôlont pa' les chemins. » (Fernand Clas, p.l8). Autre sens : courir après les femmes. Ce verbe est directement conservé de l'ancien français troller signifiant au XIIe siècle promener, chercher à la trace ou courir çà et là, par dérivation du latin populaire tragullare (tirer-traîner). Le français n'a pas gardé ce mot, sauf.en terme de chasse (aller à la trolle, chercher au hasard). - (42) |
| trôler. v. n. Attendre en piétinant, en allant et revenant plusieurs fois sur ses pas. J’ai trôlé ; il m’a fait trôler pendant deux heures. (Auxerre). — On dit aussi droguer, dans le même sens. - (10) |
| trôler. : (Dial. et pat.), aller partout colporter des nouvelles. - Du grec, divulguer, et chuchotement. - (06) |
| trôlerie. n. f. - Action de traîner : «Au bout de cinq ou six jours de trôlerie dans les bois. » (Colette, Claudine à l'école, p.132). Autre sens: vagabondage sexuel, frivolité. - (42) |
| trôleux, se. n. m. - Traîneur, vagabond : « Et monsieur qui huche après toi, et qui regarde en boeuvarsé ! T'es bien la pareille qu'avant. Trôleuse, va ! « (Colette, Claudine à l'école, p.426). Autre sens : coureur de jupons. - (42) |
| trôlû, traulû (-use) (n. et adj.m. et f.) : celui ou celle qui erre, qui vagabonde - (50) |
| tromb'illon (on) : tromblon - (57) |
| trombyâ : tombereau. - (29) |
| trompai, sonner de la trompe... - (02) |
| trompai. : Sonner de la trompe. - Cors à tromper, dit une charte de 1386 des franchises de Couchey. - (06) |
| trompaite. Trompette. - (01) |
| trompaule, adj. sujet à tromper. Se dit des personnes et des choses. Les gens « trompaules » sont ceux qui cherchent à duper le prochain. Un marché « trompaule » est un marché moins avantageux qu'on ne le supposait. - (08) |
| trompe-laquais. n. f. - Grosse poire à chair ferme, qui se consomme cuite ; elle est utilisée également pour fabriquer du cidre. - (42) |
| trompôle: trompeur - (48) |
| trompou, ouse, adj. et s. trompeur, celui qui fraude et fait des dupes. - (08) |
| trompoû, s. et adj., trompeur, un qui promet... et ne tient pas. - (14) |
| tronce, s. f. tronc d'arbre, souche. Les vieilles « fronces » servent souvent de limites aux propriétés. - (08) |
| tronce, tronche (n.f.) : tronc d'arbre, souche - (50) |
| troncener, v. a. tronçonner, couper par petits éclats, émonder. - (08) |
| tronche, s. f. arbre dont les branches sont coupées en têtard. Verbe tronchi, couper toutes les branches. - (24) |
| tronche, s. f. arbre dont les branches sont coupées en têtard. Verbe : tronchi, couper toutes les branches. - (22) |
| tronche, s. f., tronc, arbre dépouillé de ses branches, grosse bûche qu'on brillait jadis dans les cuisines, bûche de Noël. - (14) |
| tronchner v. Tailler, couper, tronçonner. Tronchner les beuchons dave le voudze. Tailler les buissons avec le croissant. - (63) |
| tronchon, s. m., tronçon. - (14) |
| trone. Trône. - (01) |
| tronquillon, s. m., pied de maïs qu'on arrache avant de labourer, parce qu'il détournerait la charrue. - (14) |
| trop ben : peu, pas beaucoup - ou l'inverse, selon la présence de l'adverbe. Ex : "Des truffes ? J'en aurons pas trop ben" Ou à l'inverse : Ex : "Des truffes ? J'en aurons trop ben". C'est à dire beaucoup (mais pas forcément de trop !). - (58) |
| trop bin (loc. adv.) : beaucoup - (64) |
| trop piein (on) : trop-plein - (57) |
| trop : adv., vx fr., excessivement. Il est trop mignon, c't enfant. - (20) |
| trop : s. f. touffe végétale. - (21) |
| tropais - troupeau. - Ah ! voiqui in joli tropais de motons ! - (18) |
| trope : touffe, souche. A - B - (41) |
| trope : Touffe trosser : Trousser, relever. « Y bien de la borbe, fa voir attentian à trosser ta culotte ». - (19) |
| trope Voir treupe. - (63) |
| trôpe, s. f. troupe, réunion confuse : « eune trôpe de monde », un tas de monde. - (08) |
| trôpe, s. f., troupe, foule. - (14) |
| trope, tope. Touffe d'herbe luxuriante dans un pâturage. - (49) |
| troper : tallage des céréales, des souches. A - B - (41) |
| tropiau n.m. Troupeau. - (63) |
| trôpiau, s. m. troupeau : « ain trôpiau d' berbis. » Se mettre en « trôpiau », se ramasser, se grouper. - (08) |
| troplée. Touffe. - (49) |
| trôpner : tourner en rond, errer. A - B - (41) |
| troppe : touffe, souche - (34) |
| troppe, n.f. touffe de végétaux. - (65) |
| tropper : tallage des céréales, des souches - (34) |
| trop-soûl : s. m., dégoûté, syn. de dénourri. Ch'tit trop-soûl, te renâcles devant la soupe ! Voir viande à gens soûls. - (20) |
| troqué. Epi de mais séché au four. Ce mot est-il une altération de Turquie ou dérive-t-il de l'allemand troken, sécher ? Chi lo sa ! A Beaune, on dît communément « du turquis. » - (13) |
| troqué. Troquez. Vo troqué, vous troquez. - (01) |
| troquet - turquis, maïs. - Les troquets ne s'ainonçant dière bein, i ne sai pâ ! - I ailons éguernai note troquet to ces sairs qui. - Menez don note troquet à melin. - Les rô des troquets sont superbes. - (18) |
| tròquèt (C.-d., Chal.), troquis, torquis (Br.), trouquet, turquet (Morv.). - Maïs, pour turquet ou turquis, blé de Turquie. Le maïs était ainsi appelé, bien qu'il soit originaire de l'Amérique, parce qu'on croyait autrefois que toutes les productions exotiques venaient de l'Orient, tel le coq d'Inde qui s'appelle en anglais turkey coq. - (15) |
| troquet : bistrot - (48) |
| troquet : maïs - (48) |
| troquet : n. m. Maïs. - (53) |
| troquet, et troquis, s. m., maïs. C'est avec la farine de maïs qu'on prépare les gaudes, ce mets si aimé et si répandu en Bourgogne. Troquis est une corruption de turquis, pour blé de Turquie (lequel, par parenthèse, nous vient d'Amérique). - (14) |
| troquet, maïs. - (28) |
| troquet, s. m. maïs, appelé vulgairement aussi turquet, blé de turquie fort mal à propos puisqu'il nous vient d'amérique. - (08) |
| troqui : maïs. A - B - (41) |
| troqui (n.m.) : maïs, blé de Turquie (de Chambure indique troquet) - (50) |
| troqui : (nm) maïs - (35) |
| troqui : maïs - (34) |
| troqui : maïs - (44) |
| troqui : maïs - (51) |
| troqui : maïs. De Turquie, d’où le maïs serait venu. - (62) |
| troqui n.m. (turquis, pour blé de Turquie. Le nom vulgaire du maïs a été troquet pendant des décennies). Maïs. - (63) |
| troqui : maïs. (CH. T II) - S&L - (25) |
| troqui, s.m. maïs (de Turquie). - (38) |
| troquie, maïs, blé de Turquie. - (05) |
| troquie, turquie. Maïs. - (49) |
| troquis : maïs - (43) |
| troquis. Maïs, corruption de Turquis, blé de Turquie. - (03) |
| troquiyère, s. f., champ de maïs (de troquis), parfois d'une belle étendue. - (14) |
| trôs(dâs) : (des) troncs - (37) |
| trôs, adj. num. trois. Dous, trôs, deux ou trois, une petite quantité : Pruntez mö dous, trôs sous, prêtez-moi quelques sous. Baillez don ai c't enfant doos, trôs bonbons. - (17) |
| tros, tronçon. - (04) |
| trossi : (vb) relever son tablier (en signe de politesse) - (35) |
| trôssillon ou trôsillon, paquet. C'est un diminutif du mot trossel (trousseau), appartenant à la langue romane... - (02) |
| trôssillon. : (Pat.), paquet, diminutif de trossel, mot du dialecte qui signifie poche, trousseau. - Troussé son sai et sé quille, c'est-à-dire s'en aller. - (06) |
| tròt, s. m., trognon, tronçon de diverses sortes de choses : « Tròt de chou, » tige intérieure du chou dépouillée de ses feuilles; « Tròt de boudin », morceau coupé de la spirale du boudin, etc. - (14) |
| trot, tronçon de bois, de boudin, etc. - (05) |
| trot. Morceau de boudin. Dans la côte de Nuits on prononce trou. Dans la Basse- Bretagne trô signifie tour, circuit. On sait que le boudin est disposé en cercle et qu'on a appelé ressort à boudins certains appareils dont se servent les mécaniciens. - (13) |
| trôtai. Trotter… - (01) |
| trotsi v. (déform. de chercher). Chercher. - (63) |
| trotte : s. f., allure. S'avoir ni trotte ni mode, n'avoir ni goût ni grâce. - (20) |
| trottouaîr (on) : trottoir - (57) |
| trottouaire : n. m. Trottoir. - (53) |
| trou d’baile : anus - (37) |
| trou d’lai baissie : trou percé directement dans le mur, pour l’écoulement des eaux domestiques usées - (37) |
| trou d'balle : anus - (48) |
| trou ou plutôt trô, mais avec une prononciation très fermée de l’ô qui a un son intermédiaire entre au, ou et on. Morceau de quelque chose, trô de bois, mais surtout trô de boudin. Etym. tronc, qui vient lui-même de truncus, coupé. - (12) |
| trou, treu, tru : s. m., vx fr. tros, pièce, morceau. - (20) |
| trou. adv. - Trop. - (42) |
| trouâ - trois. - A sont trouas enfants, dont ine feille. - (18) |
| trouâ, trois. - (38) |
| trouai, troue, trourô - divers temps du verbe trouver. - An les é trouai vé chez le Caillet. - I troue qu'en fait bein chaud âjedeu. - Vos en trourâs encore des resses dans mai chambre. - (18) |
| trouaîch'lé : adj. Effet du tallage. - (53) |
| trouaîs : trois - (57) |
| trouais : trois - (39) |
| trouaîs-huit (on) : trois-huit - (57) |
| trouaîsième (on) : troisième - (57) |
| trouaisième : troisième - (39) |
| trouaîsièm'ment : troisièmement - (57) |
| trouais-pieds : trépied - (39) |
| trouaîs-quârts (on) : trois-quarts - (57) |
| troub'ille (on) : trouble - (57) |
| troub'ille : Adjectif, trouble, du verbe troub'iller, pas clair « Tan vin et troub'ille ». - (19) |
| troub'ille féte (on) : trouble-fête - (57) |
| troub'iller : troubler - (57) |
| troubje, sm. trouble. - (17) |
| trouble (une) : engin de pêche. Large poche de filet montée sur un arceau en demi – cercle lié à un long manche. - (62) |
| trouble, adj., troublé : « A quand j'I'ai vu, ça m'a baillé eùn còp ; j'en seû-core toute trouble. » (V. Enfle, Gonfle, Trempe.) - (14) |
| troubleté. s. f. Grande obscurité. (Gurgy). - (10) |
| troublié, vt. troubler. - (17) |
| troublir : v. a., troubler. - (20) |
| troub'lle : Nom, trouble, instrument de pêche. « Pauchi à la troublle ». - (19) |
| troubouler, teurbouler : bousculer en tous sens. - (33) |
| troub-ye : épuisette - (43) |
| troubyi : troubler - (43) |
| troucher. v. a . Frapper de la tête, donner des coups de cornes, en parlant des animaux. (Collan). - (10) |
| trou-du-cul : s. m., terme d'affection admirative réservé généralement aux enfants. - (20) |
| trouè : v. t. Trouver. - (53) |
| trouècher : taller (plante) - (48) |
| trouée, s. f. trouvaille. - (08) |
| trouée. n. f. - Truie. - (42) |
| trouée. s. f. Truie. (Diges). Quand une femme mène sa trouée aux v’rats, il faut qu’elle soit à jeun avant de partir, que la poche de son tablier soit tournée à l’envers, et que tout le long du chemin, quoi qu’il arrive et quelles que soient les personnes qu’elle rencontre, elle ne cesse de dire : « Dix coichons, quate coches, dix coichons, quate coches. » sans cela, la portée qu'elle veut avoir ne réussirait pas. - (10) |
| trouer (v.t.) : trouver - (50) |
| troûer : trouver - (37) |
| trouer : Trouver « Quâ charche troue ». - (19) |
| trouer : trouver - (48) |
| trouer : trouver - (39) |
| trouer, v. a. trouver. - (08) |
| trouer, v. croire, trouver. - (38) |
| trouès : trois - (48) |
| troués. adj. num. - Trois. - (42) |
| trouès-pattes : trépied - (48) |
| troufignon n.m. Anus. - (63) |
| troufignon. Croupion. Terme commun à plusieurs régions (la Bresse, par exemple). - (49) |
| trou-fignon. s . m. Orifice de l’anus. (Auxerre). - (10) |
| trouillâd (on) : trouillard - (57) |
| trouillage : s. m., pressurage. - (20) |
| trouillard, trouilleur, s. m., buveur de profession, qui boit avec excès. Le Glossaire du Morvan, p. 889, indique trouiller, boire à petits coups. - (11) |
| trouille : s, f., vx fr. troille, treuil, pressoir. Voir treu. - (20) |
| trouille, s. m., résidu de divers produits écrasés. - (14) |
| trouille. Diarrhée. Fig. Peur en face du danger, manque de courage. On dit : « avoir la trouille ». Ce terme est commun avec les régions voisines. - (49) |
| trouille: (çà d'lè trouille) en parlant d'un tissu qui ne se tient pas, on utilise également le mot drouille - (46) |
| trouilleau : le trèfle - (46) |
| trouïllée : s. f., vx fr. troillie, syn. de serrée. - (20) |
| troûiller : boire exagérément - (37) |
| trouïller : v. a., vx fr. troillier, pressurer, fouler avec les pieds. - (20) |
| trouiller, et treûiller, v. tr., écraser, surtout en pariant du raisin, mais aussi des noix, etc. - (14) |
| trouiller, v. n. boire à petits coups et fréquemment, gobelotter, s'attabler pour boire. - (08) |
| trouiller, v., écraser la purée, la compote. - (40) |
| trouilleur : s. m., vx fr. troilleor, pressureur. - (20) |
| trouilli v. (de touiller). Chiffonner, froisser. - (63) |
| trouillot (n.m.) : trèfle blanc - (50) |
| trouillot, s. m. nom vulgaire du trèfle blanc ou rampant, trifolium repens. - (08) |
| trouillot, s. m., vin de basse qualité. - (11) |
| trouillou : (trouillard) quelqu'un qui a peur - (46) |
| troûillou : buveur « attitré » - (37) |
| troule. n. f. - Grosse femme mal habillée, peu attirante. (Mézilles, selon H. Chéry) - (42) |
| troup' : n. f. Troupe - (53) |
| troupe joyeuse (La) : nom sous lequel se reforma en 1625 l'abbaye de Maugouvert qui venait d'être dissoute. - (20) |
| troupiau (n.m.) : troupeau - (50) |
| troupiau : Troupeau. « In greux troupiau de moutans ». « Aller en troupiau » : aller à la débandade. - (19) |
| troupiau, s. m., troupeau. - (14) |
| trousé, vt. trouer. pp. trousé, ie. - (17) |
| trousel. s. m. Trousseau. (Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| trouspette. s. f. Petite fille vive, espiègle. - (10) |
| trousseai, s. m. trousseau de mariée. « troussiau. » - (08) |
| troussé-bé ! (t’s’rai) : tu n’en auras pas ! - (37) |
| trousse-cul : s. m., paire de cordons fixés à mi-hauteur du tablier et qu'on noue au-dessous des fesses pour serrer les vêtements contre le corps. - (20) |
| troussel : Trousseau. « Dans in temps les filles felint la toile de leu troussel, aujourd'heu i agetant bin la toile tote faite ». - (19) |
| troussel : s. m., vx fr. toursel, trousseau, layette. - (20) |
| troussel*, s. m. trousseau. - (22) |
| troussel, s. m. trousseau (du vieux français toursel). - (24) |
| troussel, trousseau d'une jeune fille. - (27) |
| troussel, trousseau. - (16) |
| troussel. Trousseau. - (49) |
| trousse-pis. n. m. - Soutien-gorge. On reconnaît bien dans ce néologisme l'image à laquelle il fait appel ! (Sainte-Colombe-sur-Loing) - (42) |
| trousser (Se). v . pron . Se dit ironiquement et par moquerie pour se trouver. Il se trousse, elle se trousse mal. - (10) |
| trousser, couper du bois en trots, en tronçons. - (05) |
| troussiau (n.m.) : trousseau - (50) |
| troussiau, s. m., trousseau. - (14) |
| troussière : longe en corde - (33) |
| troussière. n. f. - Longe, sangle pour guider les chevaux. - (42) |
| trousson : s. m., vx fr. tros et trous, tronçon. Couper du bois à troussons. - (20) |
| trouve, s. f., trouvaille : « Ma fi! j'ai fait iqui eùne ben ch'tite trouve » - (14) |
| trouvé, subst. partie. enfant trouvé. - (08) |
| trouver de (Se) : suivi d'un Infinitif, v. r., faire une action, être après faire quelque chose. Je me trouvais de passer... Ma foi, je suis entré. - (20) |
| trouver le drœ (se), loc. se trouver en face, profiter d'une coïncidence. - (24) |
| trouvu (-e) (p.p. m. ou f.) participe passé du verbe trouver - (50) |
| trouvu, part, passe. trouvé. Peu usitée aujourd'hui. - (08) |
| trouwer de (se) v. Etre en train de faire quelque chose. - (63) |
| trouwer v. Trouver. - (63) |
| trôvai. Trouvés, trouvé, trouver. - (01) |
| trôvé. Trouvez. - (01) |
| trôveron. Trouverons, trouveront. - (01) |
| trôvi. Trouvai, trouvas, trouva. - (01) |
| trôvire. Trouvâmes, trouvâtes, trouvèrent. - (01) |
| trôvoo, trôvò. Trouvais, trouvait. - (01) |
| troyot, troyet. Trèfle blanc des prés. - (49) |
| tru, s. m. pressoir. Verbe tròyi. - (24) |
| trualle : Truelle. « La trualle du platrier est pu fine que stine du maichan » : la truelle du plâtrier est plus fine que celle du maçon. - (19) |
| truan. Truand, lâche et vilain fainéant. - (01) |
| truant, vagabond, déguenillé. (Voir au mot drillai.).. - (02) |
| trubard, trubert. s . m. Garde-genoux à l’usage des laveuses. - (10) |
| trubard. n. m. - Garde-genoux en bois des lavandières synonyme de cabasson. - (42) |
| trublot. n. m. - Trèfle sauvage. - (42) |
| trublot. s. m. Trèfle sauvage. (Diges). - (10) |
| truché, vn. menacer de la tête et des cornes. Se dit des béliers, des taureaux et des vaches. - (17) |
| trucher. Donner des coups de cornes et des coups de tête comme font les bœufs, les chèvres et les moutons. Les enfants arrignent les béliers en leur criant : truche, coco ! Trucher est un vieux verbe d'argot qui signifiait battre traîtreusement, se servir de ruse, d'où, par extension trucher, mendier, truc, ressort caché. Le patois de l'Yonne dit breucher. - (13) |
| truellot : carrosse à laver. - (66) |
| truffe (n. f.) : pomme de terre - (64) |
| truffe : pomme de terre - (61) |
| truffe : pomme de terre. III, p. 31-u ; V, p. 4-8 - (23) |
| truffe : Pomme de terre (d'une utilisation presque exclusive). Ex : "Faut qu'les truffes alles sint pleuchées !" - (58) |
| truffe, treffe : s. f., pomme de terre. - (20) |
| truffe. n. f. - Pomme de terre. - (42) |
| truge : s. m., croisée de trois chemins, carrefour, place. Ce nom est celui de plusieurs hameaux ou écarts du département de Saône-et-Loire. - (20) |
| truie, jeu, treue (Le jeu dont parle Rabelais, et auquel nous avons plus d'une fois pris part, a pour instruments des perches et le sabot (la corne du pied) d'un porc. C'est cette « truie », par synecdoche , qu'un des joueurs a pour tâche de faire entrer dans un trou ad hoc, dont les autres joueurs défendent l'entrée). - (04) |
| trû'illot : trèfle blanc - (48) |
| tru-illot : n. m. Trèfle. - (53) |
| truillot, subst. masculin : trèfle. - (54) |
| truillot. Tourteau de graine oléagineuse, principalement de noix. C'est un régal pour les enfants : mossieu l'huilier, beillez moi don un petit bout de truillot, ç'atl si bon ai mainger ! Treuil est l'ancien nom du pressoir et treuiller signifiait pressurer : le truillot est le résidu qui reste sur le treuil. Un inventaire de 1463 mentionne « ung petit presseur à roue à truiller le vin ». - (13) |
| truillots, tourteaux d'huilerie, de treuil, pressoir. - (05) |
| truite, s. f. a propos de ce poisson si commun et de si excellente qualité dans nos ruisseaux ou petites rivières, on remarque que le Morvan bourguignon prononce, suivant les lieux, « trute, treute, et truite. » - (08) |
| trûlon. n. m. - Raccommodage grossier. - (42) |
| trûlot : plante : trèfle blanc. On aimo ben voir du trûlot : on aime bien voir du trèfle blanc. - (33) |
| trûlot : petit trèfle - (39) |
| trulot. s. m. Truble, engin de pèche. (Fléys). - (10) |
| truon, s. m., mue à poussins. - (40) |
| truot, trèfle sauvage. - (28) |
| truotte, jeu de gamins. (Voir au mot driol.) - (02) |
| trûte, s. f., truite - (14) |
| trute. Truite, truites… - (01) |
| truyau, s. m., trèfle cultivé à fleurs blanches. - (40) |
| truyo : trèfle. (E. T IV) - S&L - (25) |
| truyo, mauvaise herbe. - (16) |
| tryi v. Trier. - (63) |
| ts’neuille : (nf) chenille - (35) |
| ts’vau, tseuvau : (nm) cheval - (35) |
| ts’veille : cheville de fer - (43) |
| tsâ : char, chariot à quatre roues (en B : tsé). A - (41) |
| tsâ : chat - (43) |
| tsacogni v. Travailler bruyamment. - (63) |
| tsacun adv. Chacun. Tsacun fait cment i vout. Chacun fait comme il veut. - (63) |
| tsafaud n.m. 1.Echafaudage. 2. Etage ouvert d'un hangar. - (63) |
| tsâgne : (nm) chêne - (35) |
| tsâgne : chêne - (43) |
| tsagne : chêne - (51) |
| tsâgne n.m. Chêne. - (63) |
| tsâgnon d'co n.m. (de chaînon) Nuque. - (63) |
| tsagrin n. et adj. Chagrin. - (63) |
| tsaiñne : (nf) chaîne - (35) |
| tsain-ne : chaîne - (43) |
| tsaînne : chaîne - (51) |
| tsaîñne n.f. Chaîne. - (63) |
| tsaintre : (nf) contour du champ - (35) |
| tsaintre : extrémité du champ où l'on tourne la charrue - (43) |
| tsaintre n.f. Chaintre ou tournière : surface réservée aux demitours des attelages. Voir viron. - (63) |
| tsaire : tomber - (34) |
| tsaire : tomber, choir - (43) |
| tsairi, «le tsairi serveu ari à porter le ballou tsé sos la batteuse » : grande pièce de toile de chanvre mise dans les daraises du char pour transporter le colza après la moisson - (43) |
| tsairire : entrée sans barrière - (43) |
| tsalé : sentier. - B - (41) |
| tsalé : sentier - (34) |
| tsalée : (nf) sentier déblayé dans la neige - (35) |
| tsalée : sentier dans la neige ou dans les moissons fait par le passage des bêtes ou des hommes - (43) |
| tsaleur : chaleur - (51) |
| tsallée n.f. Passage étroit aménagé dans le foin, le blé, la neige. - (63) |
| tsambe : (nf) jambe - (35) |
| tsambe : jambe - (43) |
| tsambre : chambre - (43) |
| tsambre n.f. Chambre. - (63) |
| tsamoure n.f. Flan de courge. Ce plat, peu coûteux, était régulièrement servi aux vendangeurs du Beaujolais que l'on a appelé les tsamouris. - (63) |
| tsampailli v. Secouer. - (63) |
| tsamper : chasser à coups de bâton, renvoyer aux champs. A - B - (41) |
| tsamper v. (de l'a.fr. échamper, faire sortir du champ, faire fuir) Mettre dehors, chasser à coups de bâton. - (63) |
| tsamporau : (nm) vomitif, mélange de vin et de café - (35) |
| tsamporau n.m. (prononciation locale de "chabrot" ?) Café allongé de vin. - (63) |
| Tsamporlain n.m. 1. Au cimetière de Sivignon (lieu-dit). 2. Au ciel (dans l'au-delà) ; là encore ce mot est d'usage purement local. - (63) |
| tsamps : champs - (51) |
| tsance : chance - (51) |
| tsance n.f. Chance. - (63) |
| tsanceux adj. Chanceux. - (63) |
| tsand(r)e : (nm) chanvre - (35) |
| tsande n.m. Chanvre. - (63) |
| tsande. Chanvre. - (49) |
| Tsandeleuse n.f. Chandeleur. - (63) |
| tsandeule n.f. Chandelle. - (63) |
| Tsand'leu : (nf) Chandeleur - (35) |
| tsandlî n.m. Chandelier. - (63) |
| tsandzi : changer - (51) |
| tsandzi v. Changer. - (63) |
| tsanhner : finir un travail. A - B - (41) |
| tsanhner : finir un ouvrage - (34) |
| tsanin : légère brume à l'horizon, signe de beau temps. A - B - (41) |
| tsanin : (nm) brume - (35) |
| tsanin : légère brume à l'horizon, signe de beau temps - (34) |
| tsanin : légère brume à l'horizon, signe de beau temps - (43) |
| tsanin n.m. (du v. fr. chalin, brume de chaleur). Brume matinale qui couvre les vallées. - (63) |
| tsan-ner : achever, tuer en donnant le coup de grâce - (51) |
| tsañner v. (du lat. tardif cannare, couper la gorge). Achever (une bête). - (63) |
| tsanoine n.m. Chanoine. - (63) |
| tsanrron : charron - (51) |
| tsanrronner : charronner - (51) |
| tsanson : chanson - (43) |
| tsanson : chanson - (51) |
| tsanson n.f. Chanson. - (63) |
| tsant : chant - (51) |
| tsanter : chanter - (43) |
| tsanter v. Chanter. - (63) |
| tsanteu, -euse n.m. Chanteur. - (63) |
| tsantiau : pain avant d'être divisé - (43) |
| tsanvre, tsindre : chanvre - (43) |
| tsape : (nf) avant-toit, abri non fermé attenant à la maison - (35) |
| tsape : abri non fermé attenant à la maison - (43) |
| tsape n.f. Appentis, hangar de fortune, fait de troncs et de branches et recouvert de genêts. - (63) |
| tsapelle : chapelle - (51) |
| tsapeule n.f. Chapelle. - (63) |
| tsapeurne : (nf) charme (arbre) - (35) |
| tsapiau : chapeau - (43) |
| tsapiau n.m. Chapeau. - (63) |
| tsapieau : chapeau - (51) |
| Tsapli (re) : (nm.f) habitant (e) de la Chapelle du Mont de France - (35) |
| tsapô : éclat de bois produit lorsqu'on taille du bois à la hache. A - B - (41) |
| tsapon : (nm) copeau (de hache) - (35) |
| tsaponir : rang de vigne - (43) |
| tsapoter : tailler des morceaux de bois à la hache pour faire des manches, des piquets, etc. A - (41) |
| tsapoter : (vb) couper grossièrement - (35) |
| tsapoter : couper en petits morceaux, hacher - (51) |
| tsapoter : couper grossièrement - (43) |
| tsapoter : tailler à la hache des morceaux de bois, pour faire des manches, des piquets - (34) |
| tsapoter v. (du v. fr. chapoter, fendre du bois). Bricoler sans efficacité, découper, hacher, mettre en morceaux. I' ant tsapoté cment i'ant pu. - (63) |
| tsapoteu : petit atelier de bricolage dans une ferme. A - B - (41) |
| tsapoteu : (nm) coin du fournil où on coupe le bois - (35) |
| tsapoteu : petit atelier de bricolage dans une ferme - (34) |
| tsapoteu adj. Bricoleur, avec une connotation péjorative. - (63) |
| tsapreune : charme - (43) |
| tsaque adj. indéf. Chaque. - (63) |
| tsaquer (ra) : rattraper (quelque chose qu’on vous lance) - (35) |
| tsarailler : transporter - (43) |
| tsarailli : transporter - (51) |
| tsarayi v. (de charroyer) Charrier. - (63) |
| tsarbon n.m. Charbon. - (63) |
| tsarboné : (nm) charbon du blé - (35) |
| tsarboñnî n.m. Charbonnier. - (63) |
| t'sarco : véronique (botanique) - (43) |
| tsardon : chardon - (51) |
| tsardon n.m. Chardon. - (63) |
| tsardoñneret n.m. Chardonneret. - (63) |
| tsardzeu n.m. Chargeur. - (63) |
| tsardzi (tsèrdzi) : charger - (51) |
| tsardzi v. Charger. - (63) |
| tsardzi, tsairdzi : remplir, charger - (43) |
| tsardzment : chargement - (51) |
| tsardzu : avant train de la charrue (en B : tsédzu) A - (41) |
| tsardzu n.m. 1.Avant-train de la charrue. 2. Petit trinqueballe. - (63) |
| tsaré : grand drap de toile de chanvre (en B : tséri) A - (41) |
| tsaré, charé. Grand carré de toile, placé sur le cuvier pour recevoir les cendres, quand on fait la lessive. Pèlerine mise par le berger pour se protéger de la pluie, du froid. - (49) |
| tsarer : transporter avec un char (en B : tséri). A - (41) |
| tsarère : chemin de bois utilisé pour le débardage. (en B : tsérire). A - (41) |
| tsari : échauder. - (30) |
| tsâri v. Charrier. - (63) |
| tsârîre n.f. Chemin dans les bois. - (63) |
| tsarivari : grand bruit de casseroles fait à l'occasion du remariage d'un veuf. A - B - (41) |
| tsarivari : charivari - (43) |
| tsarivari n.m. Charivari. - (63) |
| tsârme n.m. Charme. - (63) |
| tsârmée n.f. Lieu planté de charmes. - (63) |
| tsarnîre n.f. Charnière. - (63) |
| tsarogne n.f. Charogne, bête crevée. - (63) |
| Tsarolles : NL Charolles - (35) |
| tsaron n.m. (de char). Espace entre deux rangs de vigne. - (63) |
| tsarpagnâ : (nm) braillard - (35) |
| tsarpente : charpente - (51) |
| tsarpenti : charpenter - (51) |
| tsarpenti : charpentier - (51) |
| tsarpentî n.m. Charpentier - (63) |
| tsarrette (tssarrte) : charrette - (51) |
| tsarrire : (nf) sentier forestier - (35) |
| tsârron n.m. Charron. - (63) |
| tsarrte (tsarrette) : charrette - (51) |
| tsartî n.m. Charretier. - (63) |
| tsat : chat - (51) |
| tsat, tsatte adj. Gourmand, gourmande. Voir gormand. - (63) |
| tsat, tsatte n. Chat, chatte. - (63) |
| tsat’gni : (nm) châtaigner - (35) |
| tsâtagne : châtaigne - (43) |
| tsâtagni : châtaignier - (43) |
| tsâte-boquin n.m. Couteau mal aiguisé. - (63) |
| tsateugne : (nf) châtaigne - (35) |
| tsâteugne n.f. Châtaigne. - (63) |
| tsâtî v. Châtier. - (63) |
| tsâtiau n.m. Château. - (63) |
| Tsâtifou (le père ou la mère) Equivalent du Père Fouettard. - (63) |
| tsâtio : château - (43) |
| tsâtlain n.m. Châtelain. - (63) |
| tsâtnî n.m. Châtaignier. - (63) |
| tsâtrer : châtrer - (51) |
| tsâtrer v. Châtrer. Faire, dans l'expression Qui qu'te tsâtre ? Que fais-tu ? - (63) |
| tsâtron : châtrons - (51) |
| tsâtron n.m. Châtron, jeune boeuf nouvellement castré. - (63) |
| tsatron, tsaitron. Châtron. - (49) |
| tsâtrou : châtreur - (51) |
| tsatte n.f. Langue (surtout en parlant d'un enfant). - (63) |
| tsattîre n.f. Chattière. - (63) |
| tsau : chaud - (43) |
| tsau : chaux - (43) |
| tsau p’tion (à) : (locution) petit à petit - (35) |
| tsauçhinette n.f. Socquette que l'on roulait sur la cheville. - (63) |
| tsauçhon cot, tsauçhon couet n.m. Chausson court (pour sabot). - (63) |
| tsauçhon n.m. Chaussette de laine tricotée arrivant au bas du mollet. - (63) |
| tsaud : chaud - (51) |
| tsaudire : (nf) chaudron - (35) |
| tsaudire : chaudière - (43) |
| tsaudîre n.f. Chaudière, machine à vapeur. - (63) |
| tsaudron : chaudron - (43) |
| tsaudron n.m. Chaudron. - (63) |
| tsaudroñnî n.m. Chaudronnier. - (63) |
| tsauffâdze n.m. Chauffage. - (63) |
| tsauffer : chauffer - (43) |
| tsauffer : chauffer - (51) |
| tsauffer v. Chauffer. - (63) |
| tsauffeu n.m. Chauffeur. - (63) |
| tsaup’tion (à) : petit à petit - (43) |
| tsausse : (nf) bas - (35) |
| tsausse, tsauche n.f. Bas, chaussette longue. Pour guérir le mal de gorge il fallait dormir avec les chaussettes de laine que l'on venait de quitter enroulées autour du cou. - (63) |
| tsausses : bas (les) - (43) |
| tsausses, tsauches n.f.pl. Bas de femme. - (63) |
| tsaussette : chaussette - (43) |
| tsaussi : (vb) tasser le foin - (35) |
| tsausson : (nm) chaussette (courte) - (35) |
| tsaussons : chaussons - (43) |
| tsauter v. Sauter. - (63) |
| tsautse-motte (de tsautsi et motte) n.f. Bergeronnette. - (63) |
| tsautsi : chaussé (être) - (43) |
| tsautsi : tasser - (43) |
| tsautsi v. 1. Tasser (le foin), écraser, piétiner. 2. Côcher (une volaille). - (63) |
| tsaux : chaux - (51) |
| tsavauder : passer sur une rangée de plantation sans faire de dégât - (34) |
| tsavenot : paille grossière du chanvre après teillage. Les bouts de chanvre de 50 cm ou plus sont mis près de la cheminée et servent à allumer les cigarettes - (43) |
| tsavnîre n.f. Terre plantée de chanvre. - (63) |
| tsavoniô : poisson chevesne (en B : bian = blanc). A - (41) |
| tsavotse : (nf) chouette chevêche - (35) |
| tsavotse : chouette - (43) |
| tsavouette : cheville placée sur l'age de la charrue pour donner de l'entre* à la raie* (= sillon). A - B - (41) |
| tscheuffrai : appeler, réveiller. - (30) |
| tsé (tsère) : char agricole - (51) |
| tsé : (nm) char - (35) |
| tsé : char, chariot à quatre roues - (34) |
| tsé : char, chariot à quatre roues - (43) |
| tsè n.m. Char. - (63) |
| tsèche n.f. Chasse. - (63) |
| tsècheu n.m. Chasseur. - (63) |
| tsédzu : avant train de ta charrue - (34) |
| tsédzu : train avant de charrue - (51) |
| tsefer : parler à voix haute, appeler quelqu'un. A - B - (41) |
| tsefer : appeler quelqu'un - (34) |
| tséjîre n.f. (du lat. caesariam, cage à fromage, chasière en v. fr.). Cage à fromage. - (63) |
| tsembrus (se) : grand et maigre - (51) |
| tsemin : chemin - (43) |
| tsemise : chemise - (43) |
| tsende : chanvre. A - B - (41) |
| tseneuille : chenille - (43) |
| tsèr adj. Cher, coûteux. - (63) |
| tsèr au fû loc. Excessivement cher. - (63) |
| tserbon : charbon - (43) |
| tserboné : blé atteint du charbon - (43) |
| tsèrdon : (nm) chardon - (35) |
| tserdon : chardon - (43) |
| tsèrdzi (tsardzi) : charger - (51) |
| tsèrdzu : (nm) avant-train de la charrue - (35) |
| tsère : chaise (en B : tsire). A - (41) |
| tsère : choir, tomber. A - B - (41) |
| tsère (tsé) : char agricole - (51) |
| tsère : (vb) tomber - (35) |
| tsère : cher - (51) |
| tsère : tomber - (43) |
| tsère : tomber - (51) |
| tsêre v. Tomber, choir. - (63) |
| tséri : (nm) toile grossière destinée à récupérer les enveloppes des grains après le battage ou à passer l'eau de la lessive - (35) |
| tséri : grand drap de toile de chanvre - (34) |
| tseri : transporter avec un char - (34) |
| tsérire : chemin de bois utilisé pour le débardage - (34) |
| tserri : bâche de toile pour charrier à dos d'homme - (51) |
| tsérrue : (nf) charrue - (35) |
| tserrue : charrue - (43) |
| tsérrue : charrue - (51) |
| tsèrrue n.f. Charrue. - (63) |
| tserte : charrette, tombereau. B - (41) |
| tsèrte : (nf) tombereau - (35) |
| tserte : charrette - (43) |
| tserte : charrette, tombereau - (34) |
| tsèrte n.f. Charrette à deux roues, tombereau. - (63) |
| tsertsi v. Chercher. - (63) |
| tsertssi (quequ'tsouze) : chercher (quelque chose) - (43) |
| tsésire : cage à fromages. B - (41) |
| tsésire : cage à fromage - (34) |
| tsésire : cage à fromage - (43) |
| tsesse : (nf) chasse - (35) |
| tsesse : chasse - (43) |
| tsèsse : chasse - (51) |
| tsèssi : chasser - (51) |
| tsessou : chasseur - (43) |
| tséssou : chasseur - (51) |
| tseu : fane de pomme de terre ou de betterave (syn. brou*). A - B - (41) |
| tseu (te) : tombé(e) - (51) |
| tseu : ensemble des feuilles du pied d'un même légume : pommes de terre, betteraves, etc. (peut-être de caput : tête). (C. T IV) - S&L - (25) |
| tseuffer : appeler très fort. (C. T IV) - S&L - (25) |
| tseuffer : crier - (51) |
| tseûffer : parler à grande voix, appeler quelqu'un - (43) |
| tseuffer v. Appeler, héler. Ce verbe pourrait venir du vieux français huper ou houper qui a donné chupper ou chuffer dans le mâconnais : pousser un cri aussi long que le souffle le permet. Voir ci-après tseuffette. - (63) |
| tseuffette n.f. Houppette, petite houppe. - (63) |
| tseugnâ, tsougnâ n. et adj. Pleurnichard. - (63) |
| tseuiller : économiser - (43) |
| tseumer : rester tranquille, chômer - (51) |
| tseumnée : cheminée - (51) |
| tseumnée, tseuvnée n.f. Cheminée. - (63) |
| tseune : chienne - (51) |
| tseunne : (nf) chienne - (35) |
| tseunne : chienne - (43) |
| tseunnerie n.f. Chiennerie, contrariété, saleté, villénie, objet sans valeur. Voir beuteunerie. - (63) |
| tseun'vire : (nf) chanvrière - (35) |
| tseûr adj. Sûr. Y'est pas bié tseûr. - (63) |
| tseurtsi (teurtsi) (treutsi) : chercher - (51) |
| tseuveu (tsveu) : cheveu - (51) |
| tseuv'née : (nf) cheminée - (35) |
| tseuvnottes n.f.pl. Morceaux de chanvre, chènevotte. - (63) |
| tseuvre : (nf) chèvre - (35) |
| tseuvre à côrnes (à la) loc. A califourchon. - (63) |
| tseuvre n.f. 1. Chèvre. 2. Chevalet de sciage. - (63) |
| tseuvre. Chèvre. - (49) |
| tseuvron n.m. Chevron. - (63) |
| tsev’née : cheminée - (43) |
| tsevau : cheval - (43) |
| tsevau, chevau. Cheval. - (49) |
| tsevaux (tsvaux) : cheval - (51) |
| tsève : chèvre - (51) |
| tsevenère : petit champ réservé à la culture du chanvre. A - (41) |
| tsevenire : petit champ réservé à la culture du chanvre - (34) |
| tsevenire : petit champ réservé à la culture du chanvre - (43) |
| tsevenote : paille grossière de chanvre après taillage. A - B - (41) |
| tsevenotte : paille grossière du chanvre après taillage - (34) |
| tsevesse : fane - (43) |
| tseveuille-varveuille : cheville en fer ou en bois reliant l'avant à l'arrière-train d'un char. A - B - (41) |
| tseveux : cheveux - (43) |
| tsevion : cheville en bois - (43) |
| tsevire : civière, brouette (en A : baya). - B - (41) |
| tsevire rolire : civière à roue, brouette. A - B - (41) |
| tsèvre : chèvre - (34) |
| tsèvre : chèvre, petite paille qui restait sur le côté de la batteuse - (43) |
| tsèvre à beû : chèvre à bois, chevalet pour couper le bois - (43) |
| tsevron. Chevron. - (49) |
| tsevrons : chevrons - (43) |
| tsez (vez): chez - (51) |
| tsez sa : chez soi - (51) |
| tsézire : (nf) cage à fromage - (35) |
| tsézu : avant-train de la charrue - (43) |
| tsi : (vb) chier - (35) |
| tsiâ adj. Chiant. - (63) |
| tsibreli n.m. Chibreli, danse bourguignonne. - (63) |
| tsichlet n.m. Tiercelet. - (63) |
| tsico : hoquet. A - B - (41) |
| tsicot : (nm) hoquet - (35) |
| tsicot : hoquet - (34) |
| tsicot : hoquet - (43) |
| tsicot n.m. 1. Hoquet. 2. Chicot. - (63) |
| tsicotter : (vb) avoir le hoquet - (35) |
| tsier v. Chier. - (63) |
| tsièvre : (nf) menue paille - (35) |
| tsievre-corne : support du panussiau (panier-oiseau), hotte du vigneron. - (30) |
| tsin (Fém. Tsenne). Chien, chienne. - (49) |
| tsin : (nm) chien - (35) |
| tsin : chien - (43) |
| tsin : chien - (44) |
| tsin : chien - (51) |
| tsin, tseunne n.m, f. Chien, chienne. - (63) |
| tsiner v. (fr. pop. chiner) Plaisanter, se moquer. - (63) |
| tsiparder v. Voler, chaparder. - (63) |
| tsipoter (se) : se contrarier, se quereller. A - B - (41) |
| tsippoter : se contrarier, se quereller - (43) |
| tsiquenaude : chiquenaude, genêt en fleur - (43) |
| tsiquenaude n.f. Genêt en fleurs. Voir balai. - (63) |
| tsiquenôde : genêt en fleurs. A - B - (41) |
| tsiqu'naudes (en) : (loc adv) en pleine fleur (genêts) - (35) |
| tsire : (nf) chaise - (35) |
| tsire : chaise - (34) |
| tsire : chaise - (43) |
| tsire : chaise - (51) |
| tsire : chaise. - (30) |
| tsîre n.f. (anc. fr. chaiere). Chaise. - (63) |
| tsmin : chemin - (51) |
| tsmin n.m. Chemin. - (63) |
| tsmise : chemise - (51) |
| tsmise n.f. Chemise. - (63) |
| tsnaîlle n.f. Chenille. - (63) |
| ts'ni : (nm) balayure ; boule de poussière - (35) |
| tsni n.m. Chassie. - (63) |
| tsô cosse : par intermittence. - B - (41) |
| tso, dessau : dessous - (43) |
| tsoctire (grouire): poule qui couve - (51) |
| tsoîsi v. Choisir, trier, sélectionner. - (63) |
| tsômer : (vb) rester ; habiter - (35) |
| tsomer : rester - (43) |
| tsomer v. Demeurer, habiter. - (63) |
| tsoper v. Choper. - (63) |
| tsopine n.f. Bouteille. Ancienne mesure valant ½ pinte et contenant 0,757 l.Voir fioûle. - (63) |
| tsopiner v. Boire beaucoup de chopines. - (63) |
| tsoqueute : poule qui veut couver - (51) |
| tsoquter : vouloir couver - (51) |
| tsorti v. Sortir. D'quoî don qu'ô tsort çhtu-là. - (63) |
| tsou : (nm) chou - (35) |
| tsou : chou - (51) |
| tsou à huile, tsou grâs n.m. Colza. - (63) |
| tsou gras : colza. - B - (41) |
| tsou gras : colza - (34) |
| tsou gras : colza - (43) |
| tsou raives, tsou raves : choux-raves - (43) |
| tsou rmau n.m. Chenopode, épinard sauvage. Autre nom de l'olaïllon. - (63) |
| tsou varmou : chénopode. A - B - (41) |
| tsougnâ, tseugnâ n. et adj. Pleurnichard. - (63) |
| tsougni : (vb) pleurnicher - (35) |
| tsougni : pleurnicher - (43) |
| tsougni : pleurnicher - (51) |
| tsougni v. Pleurer. - (63) |
| tsou-gras : (nm) colza - (35) |
| tsou-rève : (nm) rutabaga - (35) |
| tsou-rève : rutabaga - (43) |
| tsouse : (nf) chose - (35) |
| tsoûtner, choûtner v. Flairer, renifler, chercher. - (63) |
| tsouze : chose - (51) |
| tsouze n.f. Chose. - (63) |
| tsvalet n.m. Chevalet. - (63) |
| tsvalî n.m. Chevalier. - (63) |
| tsvau (à) loc. A califourchon. - (63) |
| tsvau n.m. Cheval. - (63) |
| tsvauder, tsvautssi : passer sur une rangée de plantations sans faire de dégâts - (43) |
| tsvautsi v. Chevaucher. - (63) |
| tsvaux (tsevaux) : cheval - (51) |
| tsveille : cheville (corps humain) - (51) |
| tsveillon : cheville (pièce métallique) - (51) |
| tsvène : (nm) chevesne - (35) |
| tsvet n.m. Chevet, première couche de gerbes disposées sur l'aire de battage. - (63) |
| tsvêtre n.m. Chevêtre. - (63) |
| tsveu (tseuveu) : cheveu - (51) |
| ts'veu : (nm) cheveu - (35) |
| tsveu n.m. Cheveu. - (63) |
| ts'veuille : (nf) cheville ; cheville ouvrière du char - (35) |
| tsveuille n.f. Cheville. - (63) |
| ts'veûillon : (nm) petite cheville - (35) |
| tsvîre n.f. (du latin tardif cibariam ; le mot français civière vient de tsvîre et non l'inverse). Brouette. Voir çhvîre. - (63) |
| tsvô d'tsérue : (tr. lit. : toucheur) conducteur de bestiaux. Avant-guerre : ouvrier qui ramenait les bovins chez les emboucheurs (engraisseurs de bœufs) qui les avaient acheté dans les foires. A - B - (41) |
| tsvôdé : passer sur une rangée de plantation sans faire de dégâts (verbe chevaucher déformé). A - B - (41) |
| t't à l'heû (loc. adv.) : maintenant, à présent - (64) |
| t'taleur : à l'heure actuelle - (61) |
| t'tàlheûre, adv., tout à l'heure. Prononciation très rapide. - (14) |
| t'ter : téter - (57) |
| tter v. Têter. - (63) |
| tton n.m. Trayon, téton. - (63) |
| tTrèger, fréquenter une maison et ses habitants. - (27) |
| tu : Toi, s'emploie quelquefois au lieu de te. « Méfie tu ! ». - (19) |
| tua (nom féminin) : porte. - (47) |
| tuaie. s. f. Petite barrière. (Etaules). - (10) |
| tuan ; s'â tuan, pour : c'est très fatigant ; é s'tûe d'trévoéyé, il travaille à l'excès ! i m’tue d'leu dire, je ne cesse de leur dire... - (16) |
| tuau, tiau, s. m. petit fragment de bois, brin de ramilles, fétu en général, racine d'arbuste. - (08) |
| tu-autam. Tu autem. Entendre le tu autem signifie proverbialement savoir conduire une affaire, être alerte, adroit, intelligent, entendre à demi-mot… - (01) |
| tuberlose. n. f. - Tuberculose. (Sainte-Colombe-sur-Loing) - (42) |
| tubouais (on) : cognée (grosse pour abattre les arbres) - (57) |
| tubouais (on) : hâche (pour couper les arbres) - (57) |
| tuché : v. t. Toucher. - (53) |
| tûcher, v., frapper (plus fort que talucher). - (40) |
| tûchîn : mot masculin désignant la fête de fin des moissons - (46) |
| tue-bois, s. m. cognée à l'usage des charpentiers, par allusion sans doute à la férocité de l'outil ou à l'énergie de l'ouvrier. - (08) |
| tue-bois, subst. masculin : menuisier. - (54) |
| Tue-Chien. Réjouissance après une grosse besogne rurale terminée, comme la moisson ou la vendange. A proprement parler le tue-chien est un repas ou l’on mange tout, ou l'en égorge la basse-cour, ou l’on tue jusqu'au chien, faute d'autre chose à donner à manger pour faire honneur à ses convives. Exagération gouailleuse d'expression pour figurer qu'on va mettre les petits pots dans les grands. - (12) |
| tuer (le fu) : éteindre (le feu, la lampe) - (43) |
| tuer : (vb) éteindre (le feu, la lampe) - (35) |
| tuer : éteindre - (51) |
| tuer la lampe : éteindre la lumière. - (59) |
| tuer v. Eteindre (le feu, la lampe). - (63) |
| tuer, v. éteindre (le feu). - (65) |
| tueux d'cotson n.m. Tueur de porc à domicile. Voir saigneux. - (63) |
| tuf : conduit pour vider un étang - (48) |
| tuf : pont bas pour franchir une rigole dans un champ, ou passage d'un petit ruisseau sous un chemin, une route. - (33) |
| tuf, s. m. conduit en pierre et quelquefois en bois de chêne qui sert à l'écoulement complet des eaux lorsqu'on vide les étangs. - (08) |
| tûhote : bois pour monter la mèche d'une lampe. III, p. 32-x - (23) |
| tuile de Sauyeu : tuile de Saulieu, tuiles plates - (39) |
| tûiô : n. m. Tuyau. - (53) |
| tuïon, s. m. tison, débris d'une bûche à demi consumée. « teujon. » - (08) |
| tuïonner, v. a. tisonner, remuer les tisons du feu. - (08) |
| tuissé, soustraire. Cette expression, peu commune, est usitée dans le Châtillonnais, parmi le peuple, pour exprimer l'acte de dérober furtivement un objet... - (02) |
| tuiter, se dit d'un oiseau qui chante. - (27) |
| tujan : Tison, bûche à demi consumée. « Y a in ban tujan dans la chevenée ». - (19) |
| tuje - touje : toujours - (57) |
| tûje, adv. toujours. - (22) |
| tùje, adv. toujours. - (24) |
| tuji : Attiser. « Tuji le fu » : attiser le feu. Vieille chanson : « I m'avint mis au carre du fu pa y tuji les brainches ». - (19) |
| tuji : v. attiser (le feu). - (21) |
| tujo : s. m. tison. - (21) |
| tüjon : tison. Pou faire du feu o fayot plusieurs tüjons : pour faire du feu il fallait plusieurs tisons. - (33) |
| tujon, tison. Lambin, lent dans son travail. - (49) |
| tujonner, pigon. Tisonnier. - (49) |
| tujonner. Tisonner. Lambiner, ne pas se presser. - (49) |
| tumber : tomber - (48) |
| tumber, v. n. tomber, faire une chute. - (08) |
| tumbereai, s. m. tombereau, voiture qui se renverse à volonté avec ce qu'elle contient. Dans quelques parties du « tombeuillau, tombllhiau. » tomber ou tumer en patois signifie verser, d'où tombereau. - (08) |
| tumbraie : tombereau - (48) |
| tumbrais : (tun:brê: - subst.m.) tombereau, véhicule à deux roues qui peut être déchargé en le basculant ; ainsi tombe le chargement. - (45) |
| tumé, renverser un liquide par- dessus les bords d'un vase. Le latin tumere se dit d'une rivière qui déborde de son lit ; mais ce verbe est neutre, au lieu que les Bourguignons font le leur neutre et actif à la fois. - (02) |
| tumé. : Renverser un liquide par-dessus les bords d'un vase. (Du verbe latin tumere.) En Champagne on écrit teumer (Grosl.), et on y appelle teumelerie la charge d'un tumereà (tombereau). - (06) |
| tumer, v. tr., répandre, verser. - (14) |
| tumer, verser, répandre, toumer. - (04) |
| tumer. v. a. Répandre, renverser. (Béru, Chassignelles). — Voir tourner. - (10) |
| tumeriau. s. m. Tombereau. (Argenteuil). - (10) |
| tunbé, tomber. On disait autrefois d'un conscrit ayant tiré un numéro qui l'obligeait au service militaire : el â tunbé. - (16) |
| tuoû - tueur.- I m'en vâ chercher le tuoû de couchons ; i vos invite ai veni méger du boudin. - Vote Daudi n'é pâ pu de cœur qu'in tuoû ; vos l'i dira ; â comprenré bein. - (18) |
| tuou (oū), sm. tueur. - (17) |
| tupin : voir tepin. - (20) |
| tupinerie : s. f., nom ancien d'une partie de la rue Sigorgne, à Mâcon, où se faisait le commerce des tupins. - (20) |
| tupinier : s. m., vx fr., fabricant ou marchand de tupins. Tupinier est devenu un nom de famille. - (20) |
| turbin. n. m. - Potiron. (Mézilles, selon H. Chéry) - (42) |
| tureau. s. m. Tertre, éminence, berge, talus. Le tureau de Jonches. Le tureau de Bar. — En plusieurs endroits, on dit ture, teure, turée, teurée. Du celtique tor, hauteur. - (10) |
| turelure, turelurelu. Mots faits exprès pour représenter le son de la flûte… - (01) |
| turelutaine, vielle organisée. On peut, je crois, ranger ce mot dans les onomatopées ou locutions imitatives. - (02) |
| turiau, teriau. Taureau. - (49) |
| turlu. n. m. - Oiseau, le courlis, échassier migrateur. - (42) |
| turlu. s . m. Allouette huppée. — Au figuré, étourdi, qui ne prévoit rien, qui ne pense à rien. (Perreuse). - (10) |
| turluröt, sm. allées et venues, agitation inutile. - (17) |
| turlutaine - expression vulgaire ou moqueuse pour dire un instrument de musique. - Al é menai sai turlutaine, que c'éto vraiment bein joli. - AI é jue d'ine turlutaine ; i ne sai pâ quemant ci s'aipeule. - Beille voué in bout de sauce qui te faisâ ine petiote turlutaine. - (18) |
| turlutaine, teurleutaine, s. f. flûteau d'enfant, jouer de la « turlutaine. » - (08) |
| turlutaine. Fifre ou flageolet. - (03) |
| turluter, teurleuter, v. n. flûter comme les petits bergers. Se dit encore du bruit qui se produit souvent dans le feu pendant la combustion. Un feu qui « turlute » est une annonce de visiteurs. - (08) |
| turluter, v. intr., jouer du fleùtiau. Sens ironique. - (14) |
| turluter. v. n. Flâner, paresser ; siffler, chanter, faire comme l’alouette, la calandre, qui rossignolettent, qui fringolent, qui s’envoisent et qui turlutent. (Argentenay). - (10) |
| turne : n. f. Maison négligée, non entretenue. - (53) |
| turqui : le maïs, on dit également trequai. - (46) |
| turquie : s. m., blé de Turquie, maïs. C'est à tort qu'on imprime turquis. - (20) |
| tutonner. v. n. S’amuser. (Germigny). - (10) |
| tutouayi : tutoyer - (57) |
| tûtter : siffler - (37) |
| tutu : hotu. Poisson d’eau douce à chaire peu appréciée ; peut qualifier tout autre poisson de médiocre qualité. - (62) |
| tû'yau : tuyau - (48) |
| tüyau n.m. Tuyau. - (63) |
| tuyau : s. m., chaume, tige creuse des graminées. - (20) |
| tû-yau : tuyau - (39) |
| tûyer : secouer le feu - (39) |
| tùyer, v. a. tuer. Tùyer le fùye. Éteindre la lumière. - (24) |
| tû'yon : tison - (48) |
| tûyon : 1 n. m. Aiguillon. - 2 n. m. Tison. - (53) |
| tûyon : bûche. - (32) |
| tûyon : crochet du poêle, petit bout de bois enflammé qui reste dans le poêle - (39) |
| tûyonné : v. t. Activer. - (53) |
| tuyonner. v. n. Passer son temps à des riens, faire comme ceux ou celles qui, pour tuyauter une collerette, une garniture de bonnet à petits plis, se servent à cet effet de tuyaux de paille. (Saint-Martin-du-Tertre). — A Véron, tuyenner, flâner. - (10) |
| tùzon, s. m., tison. S'emploie au figuré : « Y ét eùn vrâ tùzon que c'crapaud-là ; ô còrt épras tôtes les filles. » - (14) |
| tyéche : cloche. - (29) |
| tyée : clef. - (29) |
| tyèrre, clé. - (26) |
| tyeu : enclos, clou. - (29) |
| tyeû : s. f. queue. - (21) |
| tyeû : s. m. cœur. - (21) |
| tyeula : s. m. le dernier venu d'une couvée ou d'une série d'animaux. - (21) |
| tyeule : s . f. tuile. - (21) |
| tyeule : tuile. - (29) |
| tyeûre : v. cuire. - (21) |
| tyeurtou : s. m. molleton pour entourer le maillot des enfants. - (21) |
| tyin, clou. - (26) |
| tyo : claie. (RDM. T IV) - C - (25) |
| tyo : clairière. - (29) |
| tyoche, cloche. - (26) |
| tyochin : clocher. (PLS. T II) - D - (25) |
| tyochin, clocher. - (26) |
| tyoe, claie. - (26) |
| tyueu : s. f. cuve. - (21) |
| u (n’) : œuf - (57) |
| u : (nm) œuf - (35) |
| u : article contracté (archaïque) au - (35) |
| u : au - (43) |
| u : œuf - (43) |
| u : œuf - (51) |
| û : Œuf. « Eune cruge d'û» : une coquille d'œuf. « Y est la pouleille que chante qu'a fait l'û », se dit lorsqu'une personne se défend alors qu'on ne l'accuse pas. Vieille chanson : « Lorsque j'étais vers ma maîtresse, j'étais content, je li parlais de neutés bus, de la charrue et de ce que neutés pouleilles fiint des ûs, fiint des ûs ». - (19) |
| u : s. m. œuf. - (21) |
| u [ubi], pron. inlcrrog. où dans l'expression : d'u vé, d'où vient ? Voir va, vou. - (17) |
| û n.m. Oeuf. - (63) |
| û pné n.m. Oeuf pourri. - (63) |
| u, eu, part. pass. du verbe avoir. S'emploie en divers lieux pour allé : « i seu u », je suis allé. on dit encore : « i seu eu, i seu reu », avec le duplicatif : « i seu reu ai môlingn' », je suis allé à moulins. - (08) |
| u, œuf. - (05) |
| û, s. m., œuf. Ne change pas au pluriel. - (14) |
| u. Eus, eut. - (01) |
| u. Œuf. - (49) |
| u. : se change souvent en eu, comme léugne pour lune, fotéugne pour fortune, fléute pour flûte, injéustice pour injustice. (Lamon.) - U se change aussi en e. Ex : femeire pour fumée. - (06) |
| uchain : essaim - (39) |
| uchin, s. m. essaim. « échaingn'. » - (08) |
| Udzène : (NP) Eugène - (35) |
| ue - interjection pour diriger les chevaux à droite ; quelquefois simplement pour les faire avancer. - Ué ! –Tire don ai ue. - Le chevau de tête â ailé tro ai ue, et i ai vu le momant qu'y ailaint versai. - (18) |
| ugeau. Oiseau. - (03) |
| Ugène, Eugène ; Ugènie, Eugénie. - (16) |
| ugeraub'lle : Erable, acer campestra. « Eune parche d'ugeraub'lle ». - (19) |
| ugerintse : chiendent. A - B - (41) |
| ugerintse : chiendent - (34) |
| ugnon (n’) : oignon - (57) |
| ùgnon, s. m., oignon, comestible, et racine de plante. - (14) |
| ugnon. Oignon. - (03) |
| uhaizes, s. m. plur. usages, terrains des communes. - (08) |
| uille (n’) - pârche (na) : perche (en bois) - (57) |
| uille, œil. - (05) |
| uillet, œillet. - (05) |
| uillet, s. m., œillet, fleur, et trou pour lacet. - (14) |
| uillet. Œillet. - (49) |
| uillo. Diminutif d'œil, qui n'est pas sans grâce. Nous disons de même uillet pour œillet. - (03) |
| uillot ou ulliot, uyot - œil, yeux. - Ah ! mes ulliots ne sont pu bons quemant qu'al étaint. - Ses ulliots ant l'air mailaides, pu à sont bitou et pu in pecho rouge, moinme su le blian. - Note patron, i ne sai pâ si al â genti, ma al é des ulliots qui perçant. - (18) |
| uillot : n. m. Œil. - (53) |
| uillot, œil. Quand t'airai mau ez uillots, te mettrai dessus un p' chot de freumaige blanc. La forme «uoils» était usitée en Bourgogne au Moyen-âge... - (13) |
| uillot. Œil. - (49) |
| ujau : (nm) oiseau - (35) |
| ujau : Oiseau. « Chéque ujau troue san nid biau » : chacun aime son chez soi. - « Chanter les ujaux » : donner une sérénade à une fiancée la veille de ses noces, vieille coutume aujourd'hui disparue. - (19) |
| ujau d’la mô : (nm) chouette (mot à mot « oiseau de la mort) - (35) |
| uje adj. Usé, fatigué, usagé. - (63) |
| ujeau : oiseau - (51) |
| ûjeau d'la mô n.m. Chouette. - (63) |
| ûjeau n.m. Oiseau, sexe masculin. - (63) |
| ûjer v. User. - (63) |
| ujeraube : érable - (51) |
| ûjô : s. m. oiseau. - (21) |
| ukaristie, Eucharistie. - (16) |
| ulbere et hurebère. Eumolpe de la vigne, appelé aussi écrivain, à cause des caractères qu'il trace en rongeant les feuilles. Le nom ancien est hurebec, littéralement bec de huron. Huron est l'ancien nom du furet. - (13) |
| ûle, s. f., huile : « Faut pas j'ter l’ûle su l'feù. » - (14) |
| u'lliet : Oeillet. « In boquet d'u'lliets ». U'lliet de jardin, dianthus caryophyllus. - (19) |
| ultin n.m. (or. inc.). Rang de vigne unique, séparant deux terres. - (63) |
| umpi, emplir. - (26) |
| un , eun' art. ind. Un, prononcé "eune" et écrit "eun') avec une apostrophe pour conserver son genre tout en forçant la liaison. Eun' heurchon, eun' ujeau, eun' û pené. Un hérisson, un oiseau, un œuf pourri. - (63) |
| un pouèch'no : un peu - (48) |
| un, eune. Le masculin prend chez nous un son nasal qu'on pourrait écrire heûn. Dans le Morvan, on prononce ungne. Les gens du Cambraisis disent in... - (13) |
| undyeu : ongle. - (29) |
| une bougnette : une petite tache (sur un vêtement). - (56) |
| une gueurlette : une brebis, je ne l'ai entendu dire que par mon beau-père qui avait quelques moutons. - (66) |
| uni : unir - (57) |
| uninian ; teut uniman, tout bonnement, tout simplement. - (16) |
| unitié, sf. unité. - (17) |
| unque, sm. ongle. - (17) |
| ure : s. f., vx fr. aure, jurassien eura, savoisien ura, vent. - (20) |
| ure. Eûmes, eûtes, eurent. - (01) |
| ureû, heureux ; ureuseman, heureusement. - (16) |
| Urope, Europe. - (16) |
| urouéille : oreille. - (29) |
| ûrtie, s. f., ortie : « O s'a piqué les mains aux ûrties. » - (14) |
| us, use : adj., usé. « Un taplt de drapt vert us. » (Archives dép., F. 1198, 24 oct. 1680). Ne s'emploie plus que sous la forme use pour les deux genres. Ton pantalon est tout use ; il a « besoin de rapetasser ». - (20) |
| usâdze : (nm) coutume - (35) |
| usage : s. m. Se pas faire d'usage de, ne pas faire cas de, dédaigner. Le Champagne, j'en bois jamais, j'en fais pas d'usage. - (20) |
| usagi - use : usagé - (57) |
| usaigé, adj. usager, celui qui possède la connaissance, l'usage ou la jouissance des choses. - (08) |
| usaige, s. m. usage, coutume, emploi ou pratique d'une chose. - (08) |
| usaige, sm. usage. - (17) |
| use : (adj. verbal) usé (e) - (35) |
| use : usé - (57) |
| use : s. m., vx fr., usage, usure. Ta robe, all' tir' sus l'use. - (20) |
| use, adj. usé : « O cort trop ; ses saibots sont d'jà tout uses. » - (14) |
| use, adj. usé, usée. - (65) |
| use, adj. usé. Se dit d'un objet qui se détruit par l'usage prolongé qu'on en a fait : cet habit est « use. » une chose s'en va « d'use » ou « sur l'use » lorsqu'elle commence à se détériorer. On prononce euze dans une partie de la région. - (08) |
| use, s. m., usage, user, usure : « Qu'voux-tu ! les afâres ne peuvent pas tôjor durer ; y a d'l’use dans l'ménage. » - (14) |
| user : oser - (57) |
| userable : voir iserable. - (20) |
| useriôle : variété d'érable en pays calcaire A - (41) |
| useriole. Érable - (49) |
| usiaû (n') : oiseau - (57) |
| usiau, s. m. oiseau. - (24) |
| usieau, oiseau. - (05) |
| usille, oseille. - (05) |
| usille, s. f., oseille. - (14) |
| Usine, subst. féminin : ancienne usine Schneider. - (54) |
| usiter : v. a., employer, user de. UsIter une expression. - (20) |
| usse : petit champ près des maisons - (39) |
| ussié, huissier. - (16) |
| ussine, oussigne, tige d'osier dont un père menace de frapper son enfant indocile, en lui disant : si fpran eune oussigne ! - (16) |
| Ustache, Eustache ; Sent Ustache, saint Eustache. - (16) |
| ustubrelu : Au hasard, étourdiment « à l'ustubrelu ». - (19) |
| usurfruit, sm. usufruit. - (17) |
| usurier : s. m., avare. - (20) |
| utau : grande salle pavée dans les fermes aisées. (AS. T II) - S&L - (25) |
| utau, s. m., intérieur d'une maison, logis, cuisine. - (14) |
| utau. Maison, puis cuisine. - (03) |
| uti - outil. – En fau des bein bons uti pou fâre de paireils ôvraiges. – Oh ! ce n'â pâ les uti qui manquant ; ç'â lai science. - (18) |
| uti : Outil. Voir à euti. - (19) |
| uti, e, adj. usé, fatigué, avarié. se dit surtout du linge, des étoffes en général. - (08) |
| uti, outil (du latin utile, chose utile). - (16) |
| uti, outil. - (26) |
| uti, s. m. outil, instrument de travail. - (08) |
| ùti, s. m., outil, ustensile, instrument. - (14) |
| util, outil. - (05) |
| utille, adj. utile. - (17) |
| utillitié, sf. utilité. - (17) |
| utri (adj.) : pourri - (64) |
| utri. adj. - Moisi, humide : « Va don' voué dans l'ormouée du fond, ça sent l'utri ! » - (42) |
| uver : faire des œufs - (57) |
| uvrir, ouvrir. - (05) |
| ux, yeux. - (05) |
| ùye, s. m. œuf. - (22) |
| uye, s. m. œuf. - (24) |
| uyo (terme enfantin), oeil. - (16) |
| uyo : cri pour faire tourner un animal à droite - (46) |
| uyo bleu : bleuet. - (29) |
| uyot : n. m. Œil. - (53) |
| û-yot, s. m., oeil. - (40) |
| uyot, s.m. oeil ; uyot ves-rot, uyot varot ; peut-être pour désigner des yeux perçants ; ma mère disait parfois : ch'ti uyot ves-rot, en regardant mes yeux, mais je ne me souviens plus quelle grimace je faisais alors. - (38) |
| uÿòt, uillòt, et euillòt, s. m., œil : « Alle é si gentite ! j'li ai biqué les deux uÿòts. » - (14) |
| Uzèbre : (l’) Eusèbe - (37) |
| uzèjé, celui qui connaît et suit les habitudes d'une maison. - (16) |
| uzéje, usage, coutume. On dit aussi d'un vêtement solide qu'il fera un bon uzéje, pour dire qu'il durera longtemps. - (16) |
| uzéne (l’) : (l’) eugène - (37) |
| uzeriaûle n.m. (du lat. acerabulum, l'érable, et du gaul. abolos, le sorbier) Erable. - (63) |
| ûzet : usé - (48) |
| uziau : oiseau - (43) |
| Uzoule : (NL) Ozolles - (35) |
| v(e)nange, s.f. vendange. - (38) |
| v’ladze : hameau - (43) |
| v’ladze : village ; hameau - (35) |
| v’lai ! (lai) : (la) voilà ! - (37) |
| v’lé : hameau - (35) |
| v’lousse, velousse. s. m. Vieux chien paresseux. (Etivey, Pasilly). - (10) |
| v’naigre : vinaigre - (43) |
| v’nenger, v., vendanger. - (40) |
| v’ni : venir - (43) |
| v’ni : venir, venu « v’ni au monde » naître ; « l’an qu’vint » l’an prochain - (35) |
| v’ni d’pied, v’ni d’son pied : effectuer le trajet à pied - (37) |
| v’ni u monde : naître - (43) |
| v’ni, v., venir. - (40) |
| v’nioube : mercuriale - (43) |
| v’noge : vendange. - (62) |
| v’noinge, vendange ; v'noingé, vendanger ; v'noinj'ro, vendangerot, petit panier qui reçoit tout d'abord les raisins cueillis. - (16) |
| v’rat (nom masculin) : verrat. - (47) |
| v’rat : (nm) verrat - (35) |
| v’rat : verrat - (43) |
| v’ri (pour verri, verdi). adj. Transi, blêmi, vert de froid. (Percey). - (10) |
| v’rie: (nf) verrue - (35) |
| v’rouillot (pour verrouillot). s. m. Verrou. - (10) |
| v’rue : verrue - (43) |
| v’sie : (nf) vessie - (35) |
| v’sie : vessie - (43) |
| v’yée : veillée - (43) |
| v’yi : veiller - (43) |
| v’yie : (nf) veillée - (35) |
| va (ā), pron. interrog. où, Va qu'tu vais, va qu'el a, où vas-tu, où est-il ? - (17) |
| vâ (on) - veurcot (on) : ver - (57) |
| vâ : (vb) voir « väyans-vâ » - (35) |
| va : voir - (51) |
| va bèn, cela va bien! (approbation). - (16) |
| va d’cosse : va vite - (43) |
| vâ d'târre (on) : lombric - (57) |
| vâ, s.m. ver de terre. - (38) |
| vâ, s.m. verre à boire, vitre. - (38) |
| vacabon, vagabond ; se dit d'un enfant qui court les rues. - (16) |
| vacant, adj. ouvert à tout venant : laisser sa maison vacante. - (24) |
| vachar : sorte de fromage. - (30) |
| vache : Vesce, vicia sativa, plante fourragère. - (19) |
| vachelin, s. m., nom donné au fromage de Gruyère - (14) |
| vachi (on) : vacher - (57) |
| vachire (na) : vachère - (57) |
| vacilli : vaciller - (57) |
| vaderia, s. m., lézard vert des murs. - (40) |
| vadoux, vadouse : adj., fade, insipide. - (20) |
| vadriâ, s.m, lézard vert. - (38) |
| vadrouilli - rôder - leûner : vadrouiller - (57) |
| vagabond, s. m. vagabond, individu qui n'a ni feu ni lieu. - (08) |
| vaguenauder. v. - Baguenauder. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| vai pour va. : (Dial. et pat.) Saint Bernard emploie toujours ce mot. - (06) |
| vai. C'est le singulier des trois personnes du verbe aller, au présent de l’indicatif. Item vai à l’impératif pour va, vai-t'an, va-t'en, vais-y, vas-y. - (01) |
| vaice,vaiche (n.f.) : vache - (50) |
| vaiche (nom féminin) : vache. - (47) |
| vaiche : une vache - (46) |
| vaiche : vache - (48) |
| vaiche : Vache. « O n'est ban que pa aller en champ les vaiches» : il n'est bon que pour conduire les vaches au paturage, il n'a aucune instruction. « La vaiche a ban pî » : c'est une bonne vache à lait, se dit de quelqu'un qui est riche et se laisse facilement exploiter. - (19) |
| vaiche : n. f. Vache. - (53) |
| vaiche, s. f. vache. « vaice. » - (08) |
| vaiché, s. m. vacher, celui qui conduit les vaches aux champs. - (08) |
| vaiche, vache. - (05) |
| vaicher (verbe) : se dit du taureau qui s'accouple. - (47) |
| vaicher, v. a. se dit du taureau qui s'accouple. - (08) |
| vaicher, vachet, berger de vaches, etc. - (05) |
| vaichére, s. f. vachère, bergère. « vaicire », aux environ de Dun-les-Places, Saint-Agnan, etc. - (08) |
| vaicherie : Troupeau de vaches. - (19) |
| vaichi : Vacher. On désigne plus particulièrement sous le nom de vaichi le pâtre communal. - (19) |
| vaichire : Vachère « Ol a in feu valot a peu eune ptiète vaichire ». - (19) |
| vaidriâ, gros lézard vert. - (27) |
| vaie : veau - (48) |
| vaïe. s. f. Bourse pleine. (Etais). - (10) |
| vaie. s. f. Veau. (Athie). - (10) |
| vaîgnâ : adj. et n. m. Nonchalant. - (53) |
| vaigne : vigne. - (29) |
| vaigne ou veigne. : Vigne. - Les Bourguignons, rattachant tout à cette principale richesse de leur sol, avaient adopté les termes de vaigne meure comme renfermant l'idée du meilleur refuge possible. Ainsi ce vers du 6e chant du Virg. vir. : Dei vo conduze au vaigne meure, est bien un langage du cru ; il signifie : Dieu protège vos pas et vous amène à bon port. - (06) |
| vaigneraille, un vigneron... - (02) |
| vaigneraille. : Vigneron. (En latin vitis arator.) Dans le Berri on dit un vat-au-vigne. - (06) |
| vaigneron. Vigneron, vignerons… - (01) |
| vaïgonder. v. - Chanceler, ne pas tenir sur ses gonds s'emploie aussi en parlant d'une personne. - (42) |
| vaigonder. v. n. Chanceler, pencher alternativement à droite et à gauche, par manque d’aplomb. Se dit, à Migé, d’un objet quelconque, d’un tourillon, par exemple, d’un volet, d’une porte, qui, par suite d’usure ou d’une circonstance analogue, oscille, guinche, en tournant sur son pivot ou sur ses gonds. - (10) |
| vaildingue : chute spectaculaire - (37) |
| vaildinguer (env’ier) : « envoyer promener », ne pas écouter - (37) |
| vaildinguer : s’étaler au sol brutalement - (37) |
| vaîler : vêler - (48) |
| vaileur, sf. valeur. - (17) |
| vaille. Valent, comme dans cette phrase : Cé jan lai ne vaille ran, ces gens-là ne valent rien. Vaille signifie aussi tantôt, je vaille, en français je veille, tu vaille, tu veilles, ai vaille, ils veillent, ou il veille, et tantôt le substantif féminin, tant au pluriel qu'au singulier, lai vaille de Noei, la veille de Noël, lé vaille dé bonne fête, les veilles des bonnes fêtes. - (01) |
| vaillé. Veiller. - (01) |
| vailler, v. tr., veiller, passer la soirée à causer, à chanter en teillant le chanvre ou égrenant le troquet. - (14) |
| vailleur, s. f. valeur, le prix d'une personne ou d'une chose, ce qu'elle vaut moralement ou matériellement. - (08) |
| vaillissance. n. f. - Prix, valeur, estimation. (M. Jossier, p.117) - (42) |
| vaillissance. s. f. Prix, valeur, estimation. (Puysaie). - (10) |
| vaillu. Valu. - (01) |
| vaillue, s. f. valeur, le prix d'une chose. - (08) |
| vailouère (vallouère) : valoir - (39) |
| vain - appesanti par la chaleur. - En â to vain âjedeu ; ç'â un pecho signe de plieue. - Qu'i seu don vain ! i n'en peu pu. - (18) |
| vain : Non repu en parlant du bétail. « Ces bâtes sant vaines ». - (19) |
| vain dieu : juron - (46) |
| vain, adj. manquant de force, épuisé de fatigue. Ex. : je suis vain. - (11) |
| vain, faible, abattu. - (04) |
| vain, vaingne, adj. vain, fade, mou, sans énergie, sans force. un homme, une femme malades sont « vain » ou « vaingne. » - (08) |
| vaîne : longue perche - (60) |
| vaîner : corriger - (60) |
| vaingnâ, s. m. accablement, prostration causée par une extrême lassitude ou par l'indolence. On dit d'un paresseux que le « vaingnâ» le traîne. - (08) |
| vaingna. Paresse. Avoir le vaingna, c'est être enviné, c'est ne pouvoir travailler à cause de l'excès de boisson fait la veille. Dans le Morvan, ce mot est adjectif et a le sens de faible, souffreteux : o diont tous qu'i sus vaigne. - (13) |
| vain'ne : faible, sans force, dolent. Les lymphatiques etint vain'nes : les lymphatiques étaient dolents. - (33) |
| vain-néé : n. m. Coup de fatigue. - (53) |
| vain-ner : Vanner, nettoyer le grain au moyen du van. « Ol est après à vain-ner san blié » : il est en train de vanner son blé. - (19) |
| vainniâ - appesantissement par la chaleur. V. Vain. - Pou c'temps qui en é le vainniâ. - I a le vainniâ tot ai fait. - (18) |
| vain-noux : Tarare, instrument qui sert à nettoyer le grain et remplace avantageusement le van. - (19) |
| vains dieux ! : faux dieux ! - (37) |
| vair, vaire : adj., vx fr., bigarré, varié, vairé. Grume vaire, grume qui varie. - (20) |
| vair’rons (dâs) : (des) vairons, tout petits poissons de ruisseau - (37) |
| vairàyé ou vairié, v. n. se dit des raisins lorsqu'ils commencent à « varier », à se teinter à l'approche de la maturité. - (22) |
| vairé : mûr - (60) |
| vaire : adj. changeant de couleur (se dit du raisin qui mûrit). - (21) |
| vairelé : adj., vx fr., syn. de vair. - (20) |
| vairier, v. n. se dit des raisins lorsqu'ils commencent à « varier », à se teinter à l'approche de la maturité. - (24) |
| vairin - poison, venin du reptile, bête méchante. - Les vipères c'â grôs méchant ; en faut voué qu'mant qu'à lançant lote vairain. - Ile s'é mis d'aipré mouai quement un vairin. - Ces fonnes lai sont des vairins. - (18) |
| vairin. Verin. On a dit et écrit vérin pour signifier une corruption formée par un ver… - (01) |
| vairir : v. n., syn, de varier. - (20) |
| vairon, s. m. petit poisson qui abonde dans nos ruisseaux et qui n'est pas le goujon. - (08) |
| vairou (Loup). Loup-garou ; du latin vavare, loup errant. - (03) |
| vais - veau. - Le boucher â venu vouai note vais. - (18) |
| vais, impér. du verbe aller. vas, dans une partie de la région. Le son s'assourdit quelquefois en é : vé. - (08) |
| vaise (passer par) : loc, se dit d'une chose qui n'a pas eu lieu, n'a pas été faite. - (20) |
| vais'lier : s. m. vaisselier. - (21) |
| vaisse : vache. - (52) |
| vaisse : vache - (39) |
| vaîsse. s. m. Paresseux, flâneur, vagabond, rôdeur. (Vallery). - (10) |
| vaisseler : v. n., laver la vaisselle. Cette eau n'est pas pour boire ; elle est bonne qu'à vaisseler. - (20) |
| vaîsser. v. n. Rôder, flâner, faire le paresseux. - (10) |
| vaisses (lâs) : (les) vaches - (37) |
| val (aller en) : faire des visites. Faire la tournée de personnes de connaissance. Viendrait de « aller à val »: descendre dans la vallée. - (62) |
| val, vel ; faire la val, la vél : voisiner, faire la causette chez les voisins. - (16) |
| vala : Valoir. « Y da vala à po près cinquante sous » : cela doit valoir à peu près cinquante sous. « O n'a jamâ ren valu » : il n'a jamais été bon à rien. - (19) |
| vale : Maison, chez-soi. « Demorer à la vale » : rester à la maison. « Tot chemin va en vale » : tous les chemins sont bons pour rentrer chez soi. « O ! vale, ô ! vale, ô ! » : cri du berger qui ramène le bétail à l'écurie. - (19) |
| valeman : exclamation utilisée pour faire ralentir un attelage de bœufs. A - B - (41) |
| valet, n.m. employé agricole. - (65) |
| valeû n.f. Valeur. - (63) |
| vâli ! interj. dont on se sert pour appeler un veau qui se sauve, qui s'échappe avec impétuosité : « vâli ! vâli ! » on n'emploierait pas ce terme pour appeler un bœuf ou une vache dans la même circonstance. - (08) |
| vali, veau - (36) |
| valider : se promener en convalescence. - (09) |
| valle - le village que l'on habite. - I m'en vâ ai lai Valle. - A dessus de lai Valle. - On dit aussi lai Velle. - (18) |
| valle (è lè), tomber d'un arbre ou d'un toit. - (27) |
| valle (la), la maison. - (05) |
| vâ'lle : Veille « La vâ'lle du jo de l'an, le 31 Décembre ». - Colchique, colchicum automnale, plante qui fleurit à l'époque où commencent les veillées, d'où son nom. - (19) |
| va'llée : Veillée. « J'ins jué à la borre tote la va'llée ». - (19) |
| vallement : exclamation pour faire ralentir un attelage de bœufs - (34) |
| vâllhe, ll mouill., s. m. vase. - (08) |
| va'lli : Veiller. « Venis dan va'lli vé nos stu sa » : venez donc passer la veillée chez nous ce soir. - (19) |
| vallot, valet. - (04) |
| va'lloux : Veilleur, celui qui vient à la veillée. Il se présentait parfois en ces termes : « Bin le bansa, volez vos in va'lloux ? ». - (19) |
| valoir peu : loc, ne valoir rien. Ah ! qu'il vaut peu, qu'il vaut peu de monnaie ; que c'est donc du ch'tit monde I - (20) |
| valoir : v. n. abs., avoir de la valeur, du pris. Ça vaut. - (20) |
| vâlot (n.m.) : valet - (50) |
| vâlot : valet - (48) |
| valot : Valet, domestique. « In feu valot » : un domestique capable de faire les gros travaux de culture. - (19) |
| valot : valet, domestique. Le valot o dev'nu rare : le valet est devenu rare. - (33) |
| vâlot : n. m. Valet, domestique. - (53) |
| vâlot : valet - (39) |
| vâlot, s. m. serviteur, domestique, homme à gages. Faire le « bon vâlot » signifie flatter, câliner quelqu'un dans un but plus ou moins intéressé. - (08) |
| valou : Valeur. « Cen n'a pas grand valou ». - (19) |
| valouaîr - valai : valoir - (57) |
| valouche, s. f. flocon de neige. - (22) |
| valsoux : Valseur. « Man cousin était in ban valsoux ». - (19) |
| valter : chasser quelqu'un. - (09) |
| vambotte : pou de l'homme. - (30) |
| van n.m. Voir vannoir. - (63) |
| van, s.m. grenier ouvert ; vannoir. - (38) |
| van. Vent. - (01) |
| van’noir (un) : tarare. Qui sert au vannage mécanique des graines de céréales après le battage. - (62) |
| vanbé, vt balancer, dandiner. Se vanbé, se gondoler (en parlant du bois). [A Châtillon : mettre les cloches en vambe = en branle.] - (17) |
| vanbi, ie, adj. tordu, déformé, gondolé. - (17) |
| vaner (se) : (en parlant des poule) se vautrer dans la poussière - (35) |
| vangniau. n. m. - Vanneau. - (42) |
| vanguié, celui qui fabrique des vans. - (16) |
| vanitai. Vanité, vanités. - (01) |
| vanjance. Vengeance, vengeances. - (01) |
| vanle : s. m., élan, balancement. Prendre son vanle. - (20) |
| vanlé*, v. a. balancer. - (22) |
| vanler (Se) : v. r., s'élancer, se balancer, prendre son vanle. - (20) |
| vanler : (vb) bercer - (35) |
| vanler : Osciller, balancer. « Le vent fa vanler la cuche des abres ». - (19) |
| vanler v. Tituber, pencher dangereusement, être déséquilibré, chanceler. (En Bresse ce verbe signifie brasser, remuer : on vanle le "vin cuit" qui n'a de vin que le nom puisqu'il s'agit en fait d'une confiture de pommes, en utilisant un pétouillon, longue perche de bois. En Bresse nos vanle le vin, vés nos y'est l'vin qu'nos fait vanler ! - (63) |
| vanler : v . balancer. - (21) |
| vanler, v. a. balancer (comme dans un van). - (24) |
| vanlère : Balançoire. « Les bouérans ne sant pas en poin-ne pa fare eune vanlére, i layant deux brainches de sauge l'eune après l'autre a peu y fa l'affare » - (19) |
| vanlére : s. f. balançoire . - (21) |
| vanlire, s. f. balançoire. - (24) |
| van-ma : prochainement, bientôt. (ALR. T II) - B - (25) |
| van-né, vanner. - (16) |
| vanner (Se) : v. r., se dit des oiseaux quand ils s'ébrouent dans le sable ou la poussière. - (20) |
| van'ner : vanner - (48) |
| van-ner : vanner. - (52) |
| van-ner : vanner - (39) |
| van-nette : grande corbeille. - (52) |
| van'nette : petite corbeille plate tenue à deux mains pour donner à manger au bétail ou pour vanner le grain - (48) |
| van-nette : grande corbeille. - (33) |
| vanni (s'), vanner (s') Se frotter dans la poussière pour se déparasiter (poules). Voir s'poûilli. - (63) |
| vañnî n.m. 1.Vannier. 2. Bohémien. - (63) |
| van-niau (on) : vanneau - (57) |
| van-nintte, vannette. - (26) |
| vannitiè, sf. vanité. - (17) |
| vannitioû, adj. vaniteux. - (17) |
| vannoir : tarare - (34) |
| vannoir n.m. Connu sous les noms de tarare, tarare ventarelle, vanneuse, éventeur à grain ou encore traquinet. - (63) |
| vannoir : s. m., tarare, van mécanique. - (20) |
| vannoire, n.m. tarare. - (65) |
| vannou : (nm) tarare - (35) |
| van-nouaîre (na) : tarare - (57) |
| vannoure, sm. personne nonchalante ; lâche, paresseux. - (17) |
| vanou : tarare - (43) |
| vanoures : déchets de céréales après qu'elles aient été vannées - (43) |
| vanta : Vantard. « Ne fa pas la batije de crare ce qu'o dit, y est in vanta ». - (19) |
| vantadou, vantard, hâbleur, bavard. - (27) |
| vantchou (on) - vanteuriau (on) - vantou (on) : vantard - (57) |
| vantée. s. f. Tas de blé qui vient d’être battu et nettoyé au van. (Lindry). - (10) |
| vanteille (nom féminin) : portillon interdisant l'entrée des volailles dans la maison d'habitation. - (47) |
| vanterais, s. m. fanfaron, celui qui se vante ridiculement. - (08) |
| vanteriâ (n.m.) : vantard, fanfaron - (50) |
| vantié, vt. vanter. - (17) |
| vantin (d') : tablier. (CLF. T II) - D - (25) |
| vantise, s. f. vanterie, fanfaronnade. - (08) |
| vantise, s. f., vantardise, vanterie. N'est pas notre défaut dominant. Le caractère ouvert y prête peu. - (14) |
| vantoû, adj., vantard, vaniteux, « coq de village ». - (14) |
| vantou, ouse, adj. et s. vantard, celui ou celle qui se vante, qui fait des embarras en mentant. - (08) |
| vantou, sm. vantard. - (17) |
| vantre. Ventre. - (01) |
| va-nu-pids : Va-nu-pieds, vagabond. - (19) |
| vapée, vapie, sf. portée ; nichée. Par ext. ène vapée, un tas, une quantité. - (17) |
| vaque, s. f., vache. Cette prononciation n'empêche pas de dire : « Fromage vachelin. » (V ce dernier mot.) - (14) |
| vâquier, v. n. vaquer, demeurer vacant, inoccupé, hors de sa place, flottant, lâche. Un drap « vâki' », lorsqu'il est mal plié et que les bords ne se rejoignent pas. - (08) |
| var : ver - (48) |
| var : vert. - (29) |
| vâr leûyant : ver luisant - (37) |
| var : ver - (39) |
| vâr, adj., vert ; au figuré, bien portant, solide : « Voui, l’bounlioume, ôl é vâr et drèt c'ment eùn châgne. » - (14) |
| vár, prép., vers. (V. Vé.) - (14) |
| var, s. m., ver de terre, de fruits, etc. - (14) |
| var, varte, adj. vert, dans une partie de la région bourguignonne et nivernaise. - (08) |
| vâr, vârtiau : ver de terre - (37) |
| var, vé'. prép. - Vers : « Te vas-ti v'ni' vé 'moué, que j'te couéffe ! » - (42) |
| vâr, vert ; varde, verte. - (16) |
| var. C'est tantôt l'adjectif verd ou vert, viridis ou vegetus, tantôt le substantif var, ver vermis, ou vers versus, carmen. - (01) |
| var. n. ou adj. - Ver, verre ou l'homonyme vert. - (42) |
| varbe. Verbe. - (01) |
| varcöle, sf. vêtement de travail, salopette. - (17) |
| varcoraux : Aigreurs. « Totes les fois que je bois du vin noviau y me fout les varcoraux ». - (19) |
| vârcouriau : colique - (37) |
| varcouriau : n. m. Aigreur d'estomac, mal de ventre. - (53) |
| varcouriau : troubles digestifs - (39) |
| varcouriot, s. m., brûlure gastrique ou œsophagienne. - (40) |
| vard, varde, adj. vert, -e. - (38) |
| vardâtre : Verdâtre. « Ol a bin mauvâse mine, ol en est vardâtre ». - (19) |
| vardauge, s. f. proyer, oiseau qu'on nomme vulgairement verdière des prés. Dans quelques contrées le ou la « verdauge » est le bréant ou bruant. Ce dernier oiseau est aussi nommé verdais, verdin, verdoie, verdule. - (08) |
| varde : Verte. « Eune pomme varde ». « Te nos racontes des totes vardes » : tu nous en contes de raides. Le masculin « vo » n'est plus employé. - (19) |
| vardeune : Lézard vert, lacerta viridis. « Cen n 'a pas pu de vartu que les vardeunes à Noué » : cela n'a pas plus de pouvoir que les lézards verts à Noël, allusion à l'engourdissement dans lequel sont plongés les reptiles pendant l'hiver. - « Ol est mauvâ c'ment in vardeune », d'après la croyance populaire on ne peut faire lâcher prise à un « vardeune » quand il vous a mordu, qu'en lui trempant la queue dans l'huile bouillante. - (19) |
| vardeure, s. f. verdure. Se dit de l'état de ce qui est vert par la couleur et de ce qui est acide. - (08) |
| vardeùre, s. f., verdure. - (14) |
| vardi : Verdir. « Te t'es sité dans l'harbe, t'as vardi ta culotte ». - (19) |
| vardière : Verdier, oiseau à plumage vert « In nid de vardières ». Le mot est du féminin, « eune vardière ». - (19) |
| vardière, s.f. verdier. - (38) |
| vardillon, verdillon. s. m. Raisin vert. (Soucy). - (10) |
| vardilloux : Adjectif, verdâtre. « C't'avouaine râste vardillouse », elle ne mûrit pas régulièrement. - (19) |
| vardot : lézard vert - (44) |
| vardou : Verdure, fourrage vert. « Ses bâtes mijant de la vardou ». - (19) |
| vardouet. n. m. - Verdier. - (42) |
| varduïot (n.m.) : lézard vert - (50) |
| varduïot, s. m. gros lézard vert. - (08) |
| vardze : partie mobile du fléau qui frappe les céréales. A - B - (41) |
| vâre : Qui commence à mûrir, ne s'emploie que dans l'expression « greume vâre », « Y commache à y avoir de la greume vâre » : on commence à voir des grains de raisin qui commencent à mûrir, à changer de couleur. - (19) |
| vâre, s. m., verre, à boire, de vitre, etc. - (14) |
| vâre, sm. verre. - (17) |
| vareire. Fenêtre ou fenêtres de verre… - (01) |
| varenne. s . f. Terre sablonneuse, maigre et de petit produit. - (10) |
| varet, vairet, sm. verrat. - (17) |
| vareûse n.f. Veste. - (63) |
| vargainche, émulation, amour-propre... - (02) |
| vargainche. : Emulation, amour-propre. (Du latin vergognia.) - (06) |
| varge : mot féminin désignant un fouet - (46) |
| varge : Verge, battoir du fléau ou partie du fléau qui frappe le blé. - (19) |
| varge : verge, partie du fléau. - (33) |
| varge, et parfois vorge, s. f., verge : « Pou l'fâre aller, i m'faut la varge. » - (14) |
| vargé, s. f. jardin planté d'arbres fruitiers. - (08) |
| varge, s. f. verge avec la même signification qu'en français. Se dit aussi de la partie du fléau qui est mobile et qui frappe sur l'aire de la batterie. « varze. » - (08) |
| varge, s.f. verge du fléau. - (38) |
| varge, verge. - (05) |
| varge, verot. n. m. - Partie souple du fléau qui frappe les gerbes. - (42) |
| varge, verot. s. f. Partie du fléàu qui frappe la gerbe étendue sur l’aire. (Puysaie). - (10) |
| varge. n. f. - Verge. - (42) |
| varge. s. f. Ivraie. (Argenteuil). - (10) |
| varge. Verge, verges. - (01) |
| varger, s. m., verger. Nos fruits y sont excellents. - (14) |
| varger. n. m. - Verger. - (42) |
| vargeti. Vergetai, vergetés, vergeta. - (01) |
| vargette, s. f. brosse : cheveux coupés en « vargette », comme en français coupés en brosse. - (08) |
| vargi : Verger. « Les abres du vargi sant bien flieuris ». - (19) |
| vargie, verger. - (05) |
| varglié : Verglas. « Y a bin du broille, si i gele ste né y ara du gevra, a peu du varglié demain ». - (19) |
| vargliéchi : Verglacer, faire du verglas. « Y a vargliéchi ste né ». - (19) |
| vârgne n.m. Aulne, verne, vergne. - (63) |
| vârgnîre n.f. Lieu planté d'aulnes, aulnaie. - (63) |
| vargogne. Honte, pudeur… - (01) |
| vargougne, s. f., vergogne. - (14) |
| varguinche : ébats exagérés. (F. T IV) - S&L - (25) |
| varguinches, sf. sottises ; mauvaise conduite ; esclandre ; escapade. - (17) |
| varguinchou, sm. individu qui fait des sottises. - (17) |
| vâri : Commencer à mûrir en parlant du raisin. « In raijin lot vâri » : un raisin à moitié mûr. - (19) |
| variaison : s. f., véraison. - (20) |
| variaisser : verglacer - (39) |
| vàrié, se dit du raisin qui commence à noircir. - (16) |
| varier se dit, en Bourgogne, des raisins qui commencent à mûrir. Les verbes tourner et éclaircir, usités dans certains pays, sont moins expressifs. Notre mot dérive du latin classique : varians uva. - (13) |
| varier : v. n., tourner (en parlant des fruits, spécialement du raisin, quand ils commencent à prendre la couleur de la maturité). - (20) |
| varilliai, verglas. - (05) |
| variner et vériner. Pleuvoir légèrement. Vannerie et vérinerie, petite pluie fine. I ne veux point prenre de parapleue : teut ce qui ç'ast des vanneries. - (13) |
| varitâbe, adj., véritable, qu'on peut croire. - (14) |
| varité, s. f., vérité. - (14) |
| varjète, s. f., vergette, brosse pour habits : « O n'se beilleròt jamâ ein pauv'coup de varjète ! » - (14) |
| varjôtte ( prononcez varjeûte ), baguette. Fesée ai varjôtte, fusée à baguette. En latin, virgula, petite branche. - (02) |
| varjôtte. : Baguette. Fesée ai varjôtte, fusée à baguette. (Du latin virgula, petite branche.) - (06) |
| varjus : Verjus, vin acide « Y est pas du vin que te nos fa boire y est du varjus ». - (19) |
| varjus, s. m., verjus, et tout ce qui est acide par manque de maturité. - (14) |
| varjus. n. m. - Verjus, raisin vert. - (42) |
| var-luzòt, s. m., ver-luisant. On sait que c'est la femelle seule du lampyre qui jette sa lueur dans l'obscurité. - (14) |
| varmeigne. Vermine, vermines. - (01) |
| varmine : vermine - (48) |
| varmine : Vermine, insectes nuisibles. « Si i fiait in greux hivé cen détrurait la varmine ». - (19) |
| varmine : vermine - (39) |
| varmine, s. f., vermine. - (14) |
| Varmine. Prononciation patoise de vermine. Je cite ce mot pour indiquer le sens particulier que nos vignerons lui donnent. Une vermine désigne tout animal rampant, couleuvre, vipère, crapaud lézard. Si te vas dans le bôs, te prenrai ben garde aux varmines. - (13) |
| varmôlu. Vermoulu, vermoulus. - (01) |
| varmoucheau (n.m.) : ver luisant - (50) |
| varmoucheau, s. m. ver luisant. - (08) |
| varmouhu, e, adj. vermoulu. - (08) |
| varmoulu : Adjectif, vermoulu, on dit aussi artujené. - (19) |
| varmoulu : vermoulu - (39) |
| varnager (v.) : il varnage lorsque le ciel se couvre de nuages et annonce la pluie - (50) |
| varnager, v. intr. Se dit lorsqu'on voit le temps se couvrir de nuages : « Eh! j'pouvons rentrer, compâre ; i va varnager. » - (14) |
| varnager, v. n. on dit que le temps « varnage » lorsque le ciel se couvre de nuages et annonce une perturbation atmosphérique. - (08) |
| varnaqueulâre, varnacueulâre (adj.m. ou f.) : vernaculaire (mot initié par Pierre Léger) - (50) |
| varne : aulne (ou vergne). A - B - (41) |
| varne (n.m.) : verne, aulne - (50) |
| vârne (na) : aulne - aune - (57) |
| vârne (na) : verne - (57) |
| varne : aulne (verne) - (61) |
| varne : verne (aulne) - (37) |
| varne : verne, aulne. - (52) |
| varne : Verne, vergne, aune, alnus glutinosa. « Eune boucheure de varnes ». - (19) |
| varne : verne, aulne. - (33) |
| varne : 1 n. m. Aulne .- 2 n. m. Vergne. - (53) |
| varne : verne - (39) |
| varne, vergne, vieux nom de l'arbre que nous appelons, en français, l'aulne. - (16) |
| varne, verne, aulne. - (05) |
| varne. n. m. - Aulne. - (42) |
| varne. Vergne (ou verne), aulne. - (49) |
| varnère : plantation d'aulne. A - B - (41) |
| varnère, verna,varnère. Plantation de vergnes, aulnaie. Lieu humide planté de vernes. Ce mot vient des Gaulois. - (49) |
| varni : Vernir. « I faudrait bin varni ce cornot ol est tot reuilli ». - (19) |
| varnier : aulnaie. - (52) |
| varnier : aulnaie. - (33) |
| varnier : n. f. Aulnaie. - (53) |
| varò, s. m., verrou. - (14) |
| varô. Verrou, verrous… - (01) |
| varole, s. f. variole, petite vérole. le mot est chez nous aussi honnête que la maladie. - (08) |
| varoo. varò. Viendrais, viendrait. - (01) |
| varot, cf. uyot. - (38) |
| varot, s.m. verrou. - (38) |
| varou, s. m. verrou de porte. - (08) |
| vârou, vairou ou vérou, s. m. sorcier, vaudois qui se déguise en loup pour aller au sabbat ou à la maraude. - (08) |
| varoux : Véreux « Eune pomme varouse ». - (19) |
| varouyé la porte, la fermer au verrou. - (16) |
| varper (s’ r’) : (se) déclencher, réagir vite - (37) |
| varpi : rallonger un char pour l'utiliser pour transporter des chênes - (39) |
| varpi, verpi. n. f. - Vipère, aspic. - (42) |
| varpi, verpie. Reptile. Fig. Enfant vif On dit : « ch' tite varpie ». - (49) |
| varpi, veurpi : serpent, orvet - (37) |
| varpie, verpie : s. m., vipère. - (20) |
| varpillerie, s. f. diarrhée des bêtes à cornes. - (08) |
| varpouille : s. f., vermine, fripouille. - (20) |
| varquieux, euse (pour vertueux, euse). adj. Se dit, à Appoigny, des plantes légumineuses qui, par suite d’une surabondance de sève, se maintiennent vertes trop longtemps et ne peuvent pas sécher. Des z’haricots varquieux. - (10) |
| varra, s.m. verrat. - (38) |
| varrat : Verrat. « In vieux varrat» : un vieux verrat. Au figuré un vieux paillard. - (19) |
| varrat, verrat. - (05) |
| varrat, vrat n.m. Verrat. - (63) |
| varre : verre. - (29) |
| vârre : Verre. « In varre de vin donne des chambes, à ce qu'an dit, ma j'en ai bu eune dozain-ne a peu je peux tot de mouême pas me teni ». - (19) |
| vârre du c’vau : verre du cheval (seau, et par extension verre à boire, de forte capacité) - (37) |
| varre : n. m. Verre. - (53) |
| vârre, s. m., verre. - (40) |
| varret (on) : verrat - (57) |
| varreu : Verrou. « Mentre le varreu » : pousser le verrou. - (19) |
| varron n.m. Hypodermose bovine. Maladie provoquée par une mouche dont la larve se développait sous la peau des bovins, aujourd'hui éradiquée. - (63) |
| varrot (on) : verrou - (57) |
| vârrou (n.m.) : verrou - (50) |
| vârrou : verrou - (37) |
| varrouilli : verrouiller - (57) |
| vârrue : Verrue. « Ol a les mains plieines de vârrues ». - (19) |
| varse : fossé, creux - (37) |
| varsé : v. t. Verser, coucher. - (53) |
| varser : perdre l’équilibre, se retourner dans le fossé - (37) |
| varser : verser un liquide dans un récipient - (37) |
| varser : Verser. « Varser à boire ». - Coucher. « Les bliés sont varsés pa la pliô ». - (19) |
| varser, v. tr. et intr., répandre : « Ol a voulu sarvir le fricòt, é pi ôl a varsé toute la sauce. » — « Ton siau é trop plein ; ô va varser. » - (14) |
| varser. v. - Verser. - (42) |
| vart (-e) (adj.m. ou f.) : vert (-e) - (50) |
| vart, vort, te, adj. vert, te, au propre et au figuré. - (17) |
| vartau : Petit ver. « In vartau de cherije ». On donne aussi le nom de Vartaux aux habitants de la commune de Vers. - (19) |
| varte. adj. - Verte. - (42) |
| vartelé. e, adj. véreux, qui renferme des vers. - (08) |
| vartiau (n.m.) : petit ver de terre - (50) |
| vartiau ou var : ve. de terre ou du fruit par exemple. - (62) |
| vartiau : n. m. Ver de terre. - (53) |
| vartiau : ver. - (32) |
| vartiau, s. m. petit ver de terre. - (08) |
| vârtingô : demi-folie - (37) |
| vartiot : un petit ver. - (56) |
| vartlé(e) : véreux (se) - (39) |
| vartouché (-e) (p.p., adj.m. et f.) : vermoulu (-e), véreux (-eus) - (50) |
| vartu (n.f.) : vertu - (50) |
| vartu : Vertu, efficacité. « Y est in remède que n'a pas grande vartu ». - (19) |
| vartu, s. f., vertu, qualité de l'âme, et propriété d'un médicament, d'une plante. - (14) |
| varulle. Verrouilles, verrouille, verrouillent. Le substantif vorullô, diminutif de varô, c'est un petit verrou, une targette. Verrouillet n'est pas français. - (01) |
| varullô, verrou d'une prison. - (02) |
| varulô. : Verrou. - (06) |
| varvaux : s. m., verveux. - (20) |
| varveau : voir verreux - (23) |
| varvelle : branches servant à attacher le timon avec l'avant-train - (60) |
| varvelle : cheville - (39) |
| varvelles, vervalles, vervelles, vervolles. s. f. pl. Anneaux dans lesquels glissent les verrous d’une porte. — Pantures de porte ou de volet. (Courson, Etivey). - (10) |
| varvole : voir barboulotte - (23) |
| varvou : verveux,l’engin de pêche. - (62) |
| varyèçhi v. Verglacer. - (63) |
| varyès n.m. Verglas. - (63) |
| vascée, s. f., luzerne sauvage. - (40) |
| vase, la vase, le bourbier qui se dépose au fond de l’eau... - (02) |
| vasou : ver de vase - (44) |
| vasou, subst. masculin : ver de vase. - (54) |
| vasouilli : vasouiller - (57) |
| vassale, s.f. vaisselle. - (38) |
| vasse : Vesse. « Vasse de lout » : vesse de loup, espèce de champignon. - (19) |
| vasselage (probablement pour vassetage, vastage, du latin vastatio). s. m. Dévastation, ravage causé par un fléau. (Saint-Martin-du-Tertre). - (10) |
| vasselier : Vaisselier, meuble où l'on met la vaisselle. - (19) |
| vasselier, s.m. vaisselier. - (38) |
| Vasseu. C'est dom Côme Levasseur, religieux feuillant, bien nourri, qui prêcha le carême à Dijon, l’an 1703… - (01) |
| vassi : Vesser. - (19) |
| vassible, vacible (?) : adj., inculte. Des terres vassibles. - (20) |
| vassible, vacible (?) : s. m., bas-lat. vacivus, friche. Un fonds de vassibles. - (20) |
| vassie : Vessie. « Eune blague en vassie de cochan ». - (19) |
| vaste : Veste. « Eune vaste de coutil ». - (19) |
| vatou, vatout. s. m. Cerise aigre. (Montillot, et généralement dans tous les pays à cerises). - (10) |
| vatse : (nf) vache - (35) |
| vatse : vache - (43) |
| vatse : vache - (51) |
| vatse n.f. Vache. I s'en faut toudze pas d'l'épaisseu d'eune vatse. Il s'en faut de peu. - (63) |
| vatu. Vertu, vertus. On dit proverbialement faire de nécessité vertu… - (01) |
| vau : Val, combe, dépression de terrain. « En vau » : en val, en bas. « Ol a cheu à vau des égrés » : il est tombé en bas de l'escalier. - (19) |
| vau*, s. m. caveau funéraire. - (22) |
| vau, s. m. caveau funéraire. - (24) |
| vaucant, adj. ouvert à tout venant. - (22) |
| Vaudemon. Charles-Henri de Lorraine, prince de Vaudemont, souverain de Commerci, gouverneur du Milanais en 1701. - (01) |
| vaudois, vaudoise. s. m. et f. Sorcier, sorcière. Souvenir lointain de l’une des abominations reprochées aux Vaudois. (Ménades). - (10) |
| vaudoisé, envaudoisé, qui pratique l'hérésie des Vaudois qu'on accusait de sortilèges, envaudoyer, ensorceler. - (04) |
| vaudoué, vaudouéille, s. sorcier, sorcière. - (08) |
| vaudouéille, vaudoise, s. f. araignée. - (08) |
| vaudoux, adj. fade, insipide. - (22) |
| vaudoux, adj. fade, insipide. - (24) |
| vaudrœlliat, adj. qui ne donne que des feuilles et pas de fruit. - (22) |
| vaudrœlliat, adj. qui ne donne que des feuilles et pas de fruit. - (24) |
| vaudru : Se dit des arbres et arbrisseaux dont la sève trop puissante pousse à la végétation et non au fruit. « Ste vigne est treu vaudruje, i n' y vint jamâ de raijins ». - (19) |
| vaudru, adj., qui pousse vigoureusement, presque avec excès. Se dit des plantes. - (14) |
| vaudru, poussant trop dru. - (05) |
| vaudru, s. m. place dans un pré où ne pousse que de l'herbe trop drue et sans valeur nutritive. - (22) |
| vaudru, s. m. place dans un pré où ne pousse que de l'herbe trop drue et sans valeur nutritive. - (24) |
| vaudru. Se dit d'une plante qui pousse avec trop de vigueur, comme si l'on disait, je pense, elle vient dru ; le verbe est vaudruger. - (03) |
| vaudruger, v. intr., pousser dru. (V. Vaudru.) - (14) |
| vauge : vouge. Serpe sur un long manche pour émonder, en particulier dans les haies. Dans le genre voir goyard. - (62) |
| vauléé (ai lai) (loc.) : en aval, en bas, plus bas que le lieu où l'on est - (50) |
| vaulée (ai lai), loc. adv. en aval, en bas, plus bas que le lieu où l'on est : jeter « ai lai vaulée », jeter à terre. - (08) |
| vaulée, s. f., vallée. - (14) |
| vaulée, vallée, plaine au pied d'une montagne. On dit encore à Recey, dans le Châtillonnais, tomber à la vallée, c.-à-d. tomber... - (02) |
| vaulée. : Vallée, plaine au pied d'une colline. - Tombé à la vaulée, c'est se laisser cheoir. Dévaulé (de valle ire), c'est descendre, tomber en ruines . - (06) |
| vaulô. Valet, valets. - (01) |
| vaulœ, s. m. domestique de culture. - (22) |
| vaulœ, s. m. domestique de culture. - (24) |
| vaûlot (on) : commis - (57) |
| vaune. adj. Du latin vannus. Vain, lâche, mou, paresseux. Qualification méprisante et injurieuse en usage à Etivey, à Domecy-sur-Cure et à Nitry. — Voyez vène, qui doit être une altération de vaune. - (10) |
| vaûran (on) : vaurien - (57) |
| vauran, s. m., vaurien, fainéant. - (14) |
| vauran, sm. vaurien. - (17) |
| vauran. s. m. Vaurien. (Etivey). - (10) |
| vauran. Vaurien… - (01) |
| vaurant, vauro, veillant - divers temps du verbe valoir. - Dan in an ces motons qui vaurant bein quinze francs. - Se dit aussi pour vaurien. - Ne vos y fiez pas ; ceute houme lai à in vaurant. - (18) |
| vauren : (nm) vaurien - (35) |
| vauren : Vaurien. « O ne fara jamâ qu'in grand vauren ». - (19) |
| vaurò. Vaudrait. Meù vaurò, mieux vaudrait. - (01) |
| vaus (pr.pers. 2ème pers.pl.) : vous - (50) |
| vautet. Morceau de lard avec lequel on graisse les scies. On l'appelle quelquefois un pissou. Les gens de Pommard donnent méchamment le nom de vautet à un instituteur. Je ne saisis pas l'analogie. - (13) |
| vautrilli : Se dit de l'état d'un champ de blé dont les épis sont couchés sur le sol dans toutes les directions comme si quelqu'un s'y était vautré : « Ce blié est vautrilli ». - (19) |
| vauveler. v. n. Flâner. (Etais). - (10) |
| väyan : (nm) pupille de l’œil - (35) |
| vché, vt. verser. - (17) |
| vchie n.f. Vessie. - (63) |
| vè (ē), prêp. vers. - (17) |
| vè (ë), sm. veau. - (17) |
| vé : (prép) chez - (35) |
| vé : Ver. « In vé de tarre » : un ver de terre, un lombric. « Nu c'ment in vé ». - (19) |
| vé : vers - (44) |
| vé : vers - (46) |
| vé : Vers, près de. « Vins vé ma » : viens près de moi. - (19) |
| vé, prép. de lieu. vers : « vin vé lu », viens vers lui : « i son été vé Sauleu », nous sommes allés vers Saulieu, près de Saulieu. - (08) |
| vé, prép., vers, auprès de : « Quand sa blonde veint vé lu, ôl é tout chouse, é pi ô n'pout ran li dire. » - (14) |
| vé, vée - vers, du côté de. - Al â bein métenant vé le pont du bô. - (18) |
| vë, vers : vë lu, vers lui ; vë lai, vers elle. - (16) |
| vé, ves (prép.) : vers, chez - (50) |
| vé, vez. Chez. « Vin don vé nos ». (Expression très employée). - (49) |
| vé. Vers, préposition. Vé Noei, vers Noël. - (01) |
| vea. Veau, veaux… - (01) |
| veai, s. m. veau. notre forme représente le bourguignon « véa » dont la seconde voyelle se diphtongue en ai. - (08) |
| veau (faire le), exp. vêler. - (65) |
| vece : pet - (43) |
| véchâ, s. m. vaisseau, futaille, tonneau. - (08) |
| vèche de loup. Lycoperdon, vesce de loup. - (49) |
| vèche : s. f. vache. - (21) |
| vêche, s. f., vache. - (40) |
| vèche, vache : véché, vacher ; ailé le véche au chan, conduire les vaches aux champs. - (16) |
| vèche, vache. - (26) |
| vèche, vètse. Vache. - (49) |
| vèche. Vesce, plante ; vesse. - (49) |
| vécher. Vesser. - (49) |
| véchi : s. m. 1° dans les villages de grandes prairies : gardien du grand troupeau. 2° en Bresse : - (21) |
| véchie, s. f. vessie. - (08) |
| veci : péter - (43) |
| veci. Voici. On a dit anciennement vela et veci, pour voilà et voici… - (01) |
| vécu : mangé - (61) |
| vèdiure, sf. verdure. - (17) |
| vée : vers, près de - (48) |
| vée : 1 adv. Environ. - 2 prép. Vers. - 3 n. m. Vin. - 4 Adj. num et n. m. Vingt. - (53) |
| vée : vers - (39) |
| veez-ci, veez-la (dial.), veci, velai (pat.). - Voici, voilà. Par une étrange transformation, ces verbes sont devenus des prépositions avec la singulière addition de pronoms personnels, comme : j'an veci, j'an velai, ou je te veci, je te velai. - Je te velai ben épontau,, c'est-à-dire te voici bien effrayé. - (06) |
| vegne : vigne - (43) |
| vegne : s. f. vigne. - (21) |
| vegnis (je), je suis fatigué, abattu au point de m'endormir. - (28) |
| véheux : voir verreux - (23) |
| vei : prép. Dès. - (53) |
| veign' : n. f. Vigne. - (53) |
| veigne (n.f.) : vigne - (50) |
| veigne, s. f., vigne, le « bois tortu ». - (14) |
| veigne. Ce mot, quand il est verbe, signifie vienne ou viennent. Quand il est nom, c'est au singulier une vigne, ou au pluriel des vignes. - (01) |
| veigneron, et veigneroune, s. m. et f., vigneron, et vigneronne. - (14) |
| veignòbe, s, m., vignoble. - (14) |
| veignòle, et vignòle, s. f., vigne sauvage. - (14) |
| veillair, veillant - divers temps du verbe valoir. – Les fruts ne pourrant pâ mâdeu veillair grand chose. - Le pore gairçon â n'é pas quaite so veillant. - (18) |
| veillar, s. m. vieillard, moins usité que vieux : un vieux. - (08) |
| veillardin, ine, adj. vieillot, celui qui se fait vieux. S'emploie en parlant des animaux comme des personnes : un homme « veillardin », une vache « veillardine. - (08) |
| veillasse : Vieillesse. « Si jeunasse savait, si veillasse pouyait ». - (19) |
| veille (n. f.) : colchique - (64) |
| veille : Vieille, féminin de vieux. - (19) |
| veille : s. f. Aller aux veilles, se rendre à un bal de noces, qui, à la campagne, est ouvert à tout le monde. Voir Soupe. - (20) |
| veille, s. f. vieille femme : « lai poure veille vai mûri », la pauvre vieille va mourir. - (08) |
| veîlle, s. f. vielle, instrument de musique qui a presque disparu après avoir réjoui pendant des siècles les oreilles peu exigeantes de nos pères. Il y a cinquante ans la vielle était encore de toutes les fêtes champêtres. - (08) |
| veille, s. f., vieille, dont le masc. est le français vieux. - (14) |
| veille. s. f. Colchique. (Diges). — Partout ailleurs, on dit veillotte. - (10) |
| véille. Vieille, vieilles. - (01) |
| veillée : liseron, liane que les gamins fumaient - (43) |
| veillerie : s. f., vx fr., veillée ; société de personnes veillant ensemble. - (20) |
| veillesse, s. f. vieillesse. - (08) |
| veîlleu, veîllou, s. m. vielleur, joueur de vielle. L'ancien « veilleu » Morvandeau chantait autrefois avec gaité en s'accompagnant de sa « veille » qu'il pressait amoureusement sur son cœur. - (08) |
| veilleuse : fleur mauve de la colchique d'automne fleurissant le 8 septembre (fête de notre dame), date à laquelle on commençait les veillées traditionnelles. A - B - (41) |
| veilleuse : fleur mauve de la colchique d'automne - (34) |
| veilleuse, n.f. colchique. - (65) |
| veilli : Vieillir. « O commache bien à veilli ». - (19) |
| veilli, v. n. vieillir, devenir vieux - (08) |
| veilli. Veiller. - (49) |
| veillie (n.f.) : liseron des champs - (50) |
| veillie : mot féminin désignant le liseron - (46) |
| veillie, liseron sauvage. - (28) |
| veillie, s. f. mauvaise herbe en général. Désigne particulièrement le convulvulus arvensis ou liseron des champs, volubilis sauvage - (08) |
| veillie. Veillée. - (49) |
| veillotte, vêille, voille. n. f. - Colchique d'automne « tue-chien », plante toxique. - (42) |
| Veimade. Weimar. C'est Bernard de Saxe, duc de Weimar, qui ayant assiégé Brisac au mois d'août de l'an 1658, prit la place par capitulation le 16 de décembre suivant… - (01) |
| veingne, s. f. vigne. Un grand nombre de Morvandeaux accompagnés de leurs femmes et de leurs enfants s'en vont chaque année vendanger dans le pays des « veingnes », c’est à dire en Bourgogne. - (08) |
| veinrâ, veinro, veneussaint - divers temps du verbe venir. - Ile veinré dès lai voille. - Vos veinrâ sans manquai. - En fauro qu'à veneusssaint â moins ine heure d'aivance. - (18) |
| veiz, voyez, viez. - (04) |
| velâ, velaint, velu - divers temps du verbe vouloir. - A velaint veni d'aivo nous.- I velâ lio fâre lote ovraige, et pu â n'ant pâ velu. - (18) |
| velai. Voilà. Voyez veci. - (01) |
| velaize (n.m.) : village - (50) |
| velaizouais (-ouaise) (n.m. et f.) : villageois (-oise) - (50) |
| vélan. Voulant. - (01) |
| velantei. Volontiers. Velantei approche un peu de l'ancien voulentiers. - (01) |
| vèlée (ē-ë), sf. portée d'une vache. - (17) |
| vêleuche, vêloeche (prononcer comme "œuf ") : nonchalant, se laissant vivre, faisant tout avec lenteur (voir : veleusse). - (56) |
| veleuse, v'leuse (adj.m. ou f.) : faible,mou (molle) sans consistance morale ou physique - (50) |
| vèleusse : nonchalant, fainéant, personne avachie - (48) |
| veleusse, v'leusse, adj. faible, mou, lâche, sans consistance au physique et au moral. - (08) |
| veli. Voulus, voulut. - (01) |
| velin. : (Dial. et pat.), venin. - (06) |
| vélire (na) : délivrance (placenta des animaux) - (57) |
| vélire (na) : placenta (après vêlage) - (57) |
| velle. Ce mot a deux acceptions bien différentes : La première est restée dans plusieurs lieux-dits avoisinant les maisons : en lai velle, sous lai velle, darré lai velle. L'autre est synonyme de veillée. J’irons ai ce seir en velle chez mon oncle Toniche. (Nom patois d'Antoine.)... - (13) |
| veller. v. a. Verser, retourner, renverser. — v. n. La voiture a vellé. (Armeau). — Du latin vellere. - (10) |
| vèlo (na) : vélo - (57) |
| vèlo n.m. Vélo. - (63) |
| velò. Voulait. - (01) |
| velon. Voulons. - (01) |
| velonie, s. f. vilenie, ordure. on balaie les « vilonies » d'une maison, d'une chambre. - (08) |
| velontai - volontiers (outre le sens ordinaire du substantif). - A nos é rendu bein velontai ce service lai. - (18) |
| velor, s. m., velours, toute chose douce au toucher. - (14) |
| velor. Velours. Quelques Bourguignons disent veleur. - (01) |
| velou : Velours. « Eune culotte de velou ». - (19) |
| velousse, apostrophe à un chien qui a fait une sottise. - (27) |
| velousse, sans vigueur, qui se laisse aller. - (28) |
| velu. Voulu. - (01) |
| ven, et vein, 3e pers. indic. prés., vient. - (14) |
| vén. Viens, vient, et l'impératif viens. - (01) |
| venâgre, s. m. vinaigre. - (22) |
| venan. Venant. - (01) |
| venange, s. f., vendange. - (14) |
| venangeoû, s. m., vendangeur. - (14) |
| venangeou, s.m. vendangeur. - (38) |
| venanger, v. tr., vendanger. - (14) |
| venanger, v. vendanger. - (38) |
| venangeròt, s. m., panier à vendange. (V. Menangeròt.) - (14) |
| venasse. s. f. Venette. Avoir la venasse. (Vallery). - (10) |
| vendandze : vendange - (43) |
| vendandze : vendange - (51) |
| vendandze n.f. Vendange. - (63) |
| vendandzeu, euse n. Vendangeur. - (63) |
| vendandzi : (vb) vendanger - (35) |
| vendandzi : vendanger - (51) |
| vendandzi v. Vendanger. - (63) |
| vendandzou : (nm) vendangeur - (35) |
| vendandzou : vendangeur - (43) |
| vendangeou (on) : vendangeur - (57) |
| vendangeux. n. m. - Vendangeur. - (42) |
| vendangi : vendanger - (57) |
| vendaule, adj. qui est propre, convenable pour la vente, de facile débit. Une denrée bien « vendaule » est une bonne marchandise qui trouve beaucoup d'amateurs. - (08) |
| vende : vendre - (48) |
| vende : vendre - (39) |
| vendenge : Vendange. « Aller en vendenge » : aller dans le vignoble pour aider à la vendange. Le raisin qu'on est en train de vendanger : « Vlà de la brave vendenge ». - (19) |
| vendengeoux : Vendangeur. « An porte la marande es vendengeoux » : on porte à dîner aux vendangeurs. - (19) |
| vendengi : Vendanger. « Y est sovent qu'an vendenge treu d'houre » : souvent on vendange trop tôt. - (19) |
| vendeurdi : vendredi - (51) |
| vendeurdi, vendredi. - (16) |
| vendition, s. f. vente, trahison. - (08) |
| vendition. s. f. Vente. (Vallery). - (10) |
| vendou (on) : vendeur - (57) |
| vendou, s. m. vendeur, celui qui vend quelque denrée : « eun cher vendou », un homme qui vend cher sa marchandise, qui recherche les marchés avantageux. - (08) |
| vendoux : Vendeur. « Ol est ban vendoux » : il est bon vendeur, il fournit consciencieusement la marchandise telle qu’il l'a vendue. - (19) |
| vendre la quoue en l'air : vendre sans garantie pour l'acheteur - (43) |
| vendre, v. a. trahir, dénoncer quelqu'un par trahison : j'ai été « vendu », j'ai été trahi ; tu sais mon secret, ne me « vends » pas. - (08) |
| vendue : s. f., vx fr., vente. - (20) |
| vendue, s. f., vente : « Etòs-tu à la vendue de c'pauv’Tiénot ? On n'en a, dà ! pas r'tiré grand'chouse... » - (14) |
| vendzance n.f. Vengeance. - (63) |
| vendzi v. Venger. - (63) |
| vène. adj. Paresseux, lâche, mou, débile, peu disposé à travailler. (Vallery). - (10) |
| vené. Venez. - (01) |
| venelle : petit escargot. - (09) |
| venette, peur, inquiétude. - (05) |
| veneûsse, subj. de venï, vînt : « Por miger dlia pôchouse, y éròt folu qu'ô veneùsse pu tôt. » - (14) |
| venger (Se) : v. r., reporter la violence d'un sentiment sur une action sans lien avec la cause de ce sentiment. - (20) |
| vengeur : Vindicatif. « I faut se méfier de liune, ol est vengeur ». - (19) |
| vengi - r'vingi : venger - (57) |
| vengi : Venger. « Ol a fait cen pa se vengi ». - (19) |
| veni : Venir. « Neutés voisins sant venis va'lli ». - Devenir. « Ol est bien veni vieux ». - Pousser, croître. « Y est in cheti pré, i z'y vint des lauches a peu des coues de rates » : c'est un mauvais pré, il y pousse des laiches et des presles. - (19) |
| venî, et v'nî, v. intr., venir : « Te m'proumets ben de v'nî au mitan du jòr ; j’vouérons ça. » - (14) |
| veni. Venir. - (01) |
| vénia : paresse. - (31) |
| veninge : vendange. - (29) |
| venir au monde, exp. naître. - (65) |
| venir : v. n., vx fr., devenir. Il vient tout gaga. - (20) |
| venison, époque où l'on fait le vin, où l'on chasse, etc. - (27) |
| vèn-ne, veine ; el é d'lai vèn-ne, il a de la chance ; ou dit aussi : eune vèn-ne de târe, une veine de terre, d'un terrain spécial. - (16) |
| vennezi. s. m. Quantité considérable. Un vennezi de fourmis. (Courgis). - (10) |
| venò. Venais, venait. - (01) |
| venoinge (n.f.) : vendange - (50) |
| venoinge, ou menoinge - vendange. - Les venoinges n'étaint pâ jolies. - Les menoingeou, c'â por tré bein ine pôre classe. - (18) |
| venoinge, s. f. vendange. - (08) |
| venoingerot : petit panier en osier pour la vendange. - (31) |
| venoinges, n. fém. plur. ; vendanges. - (07) |
| venoinges. Vendanges. Aidieu painers, venoinges sont faites. Cette locution proverbiale signifie qu'il ne faut pas se préoccuper des choses dont on n'a plus besoin. A Nuits et à Beaune, nous nous servons de grands paniers allongés, munis à leur centre d'une anse très forte et de deux poignées aux extrémités. Ces objets sont d'un maniement plus facile que les benâtons en usage à Gevrey et à Dijon. (V. Benne.) Ils peuvent être empilés facilement sur des voitures, ce qui rend facultatif l'emploi des ballonges et des rondeaux. A partir de Chassagne et dans toute la côte châlonnaise on se sert de hottes... - (13) |
| venonge, venange : vendange. - (32) |
| venongé, vendanger... - (02) |
| venonge. Vendange, vendanges. - (01) |
| venongé. : Vendanger. (En latin vinum agere, préparer le vin.) - Venonge et venoinge, vendange. (Cout. de Beaune, 1370.) - (06) |
| venr’di : (nm) vendredi - (35) |
| venr'di : vendredi - (48) |
| venrdi : Vendredi. « Y est du mande sage, i fiant mâgre le venrdi ». « Les us du venrdi saint » : les œufs pondus le vendredi Saint. Ils passent pour avoir la propriété de préserver du vertige les « chaplioux de calas » et de les empêcher de « cheu à vau du noué ». - Dicton : « Venrdi, le pu biau ou le pu ch'tit », sous entendu jour de la semaine. - (19) |
| venrdi n.m. Vendredi. - (63) |
| venr'di : n. m. Vendredi. - (53) |
| venrdru : lézard vert - (34) |
| venre, vt. vendre ; pp. vendiu. - (17) |
| vénré. Viendras, viendra. - (01) |
| venredi - vendredi. - A m'é premi cequi por venredi. - (18) |
| venredi (n.m.) : vendredi - (50) |
| venredi : vendredi - (39) |
| venredi, s. m. vendredi, le sixième jour de la semaine. - (08) |
| venredi, sm. vendredi. - (17) |
| venredi, vendredi. - (04) |
| venscier - étre essouscié : essouflé (être) - (57) |
| venscier : haleter - (57) |
| vent (au), exp. orienté au sud. - (65) |
| vent (avoir du) : avoir du souffle. Ex : "L’chien à Batot a fougalé ma barrée. A ben fallu couri’ anpré. Y’ab ! l'vent m' a ben manqué un moument !..." (Batot, surnom = Baptiste). - (58) |
| vent (avoir du) : loc, se dit d'une fiarde qui est couratière. - (20) |
| vent (l'grand vent) Vent qui souffle du sud-ouest. - (63) |
| vent (l'vent byanc) Vent du sud-est qui souffle avant l'orage. - (63) |
| vent : Vent, vent du sud. « Hiya y était la bije, aujord'heu y est le vent » : hier c'était le vent du nord, aujourd'hui c'est le vent du sud. « Du côté du vent » : au sud, « Le sinté va de vent en bije ». - Bruit, rumeur « Y est-y-vrâ que la Louise se mairie ? - Y paraîtrait, i en co in vent ». Les autres vents sont : la travarse ou vent d'ouet, le materreau ou vent d'est. - (19) |
| vent bianc : (nm) vent du sud-est - (35) |
| vent blanc : s. m., vent du sud-est, ainsi appelé parce qu'il souffle longtemps sans amener la pluie. Voir bise noire. - (20) |
| vent' : n. m. Ventre. - (53) |
| vent : s. m., sud. Greffier de vent (greffier de la justice de paix du canton sud de Mâcon). - (20) |
| vent, grand vent : vent du sud - (43) |
| vent, n.m. vent du sud. - (65) |
| vent, s. m. haleine, respiration, souffle. Une personne atteinte d'oppression dit qu'elle ne peut avoir ou tirer son « vent. » - (08) |
| vent, s. m., vent du Sud. - (14) |
| vente : ventre - (48) |
| vente : ventre - (39) |
| vente, s. f. le mot se montre fréquemment dans la toponomastique rurale. Il désigne un terrain boisé ou défriché à une époque plus ou moins reculée. - (08) |
| venteuriâ : n. m. Vantard. - (53) |
| ventilateûr (on) : ventilateur (hélice) - (57) |
| ventrain-ne : Colique, se dit en parlant des animaux « San chevau a ésu eune ventrain-ne ? ». - (19) |
| ventre jaune. Voir Bressande. - (20) |
| ventrée, s. f. colique, tranchée. S'emploie en parlant des personnes comme des animaux. - (08) |
| ventrière : Petit placard occupant l'embrasure d'une fenêtre. « Tes sulés sant dans la ventrière ». - (19) |
| ventrou : le ventre (d'un enfant : son petit ventrou). - (56) |
| vents-voules (des). n. m. pl. - Ce mot évoque le mouvement dans l'atmosphère lorsque la pluie attendue s'est transformée en vent (Sougères-en-Puisaye). Au XIIe siècle, une venvole était une chose légère qui vole à tout vent. Le dialecte poyaudin a conservé avec vents-voules l'idée du vent. - (42) |
| venun. Venu, venus. Le Bourguignon dit aussi venu, tant au pluriel qu'au singulier, de même que venun. Le dernier est plus élégant… - (01) |
| véot, s. m. vérot, espèce de raisin qui mûrit mal et qui est acide. - (08) |
| vëprë, l'après-midi, à partir de trois heures. - (16) |
| vêpre, soir ; bon-vêpre, bonsoir. - (05) |
| vêpreau (Le). s. m. Le goûter. (Argenteuil). - (10) |
| véprée, soirée, après-dinée. - (05) |
| vêprée, vesprée (La). s. f. La soirée, entre l’après-midi et la nuit. ( Bœurs et environs). - (10) |
| vêprée. Après midi ; vieux mot. - (03) |
| vêprer, v. tr., faire le goûter de quatre heures : « Allons, les p'tiots, v'là quat'heûres qui sounont ; j'nous en vons vêprer. » - (14) |
| vépres (on) : vêpres - (57) |
| vêprô (éprâs), loc., après le soir, à la nuit tombée. - (14) |
| vépro (fare) : goûter dans l'après-midi. (MLV. T IV) - B - (25) |
| véprò, et véprau, s. m., le goûter de quatre heures du soir (pris à la vesprée). On l'appelle aussi « les quat'heûres ». - (14) |
| vëpro, petit repas qui se fait à quatre heures du soir : ce qu'on appelle aujourd'hui : faire les quatre heures. - (16) |
| véprot - petit repas du soir, ordinairement vers les quatre heures, d'où on l'a appelé les quaitre heures. - I ailons ailai fâre véprot. - (18) |
| véprot, repas de 4 heures du soir. - (05) |
| véprotter, manger à 4 heures. - (05) |
| vequi, et v'qui, prép., voici. - (14) |
| vequi. Voici, ou plutôt voilà. - (01) |
| ver, verde, adj. vert. Un temps « vert » est un temps froid, apre, nébuleux. - (08) |
| ver. Chemin qui monte en serpentant jusqu'au sommet d'une montagne : le ver de Melôyé (Meloisey), le ver de Lusigny. - (13) |
| vèragé (se), vr. être mangé aux vers ; se tacher sous l'influence de l'humidité. - (17) |
| verc(a-in)le : bridon pour mettre aux chevaux. (RDM. T IV) - C - (25) |
| verchère : pâture généralement close, près de la ferme, où l'on mettait les bêtes quand on ne pouvait les mener aux champs. - (30) |
| verchère, n.f. bonne terre, terre de qualité. - (65) |
| verchère. Terre cultivée autour de la maison. Ce terme nous vient des Gaulois. - (49) |
| vercolle. f. s. Espèce de bricole en cuir à l’usage des porte-faix et des gens qui roulent la brouette. (Bléneau). - (10) |
| ver-coquin, s. m., chenille, qui attaque le raisin à sa maturité. Elle occasionne moins de dégâts que le ver-de-vigne. Se dit aussi, au figuré, pour le ver-couraud. — C'est encore le nom familier de l'helminthe qui se développe dans la tête du mouton, et lui occasionne le tournis. - (14) |
| vercorau (avoir le) : avoir des crampes d'estomac après avoir mangé des fruits verts. (S. T IV) - S&L - (25) |
| ver-couraud, s. m., ver fantaisiste, que l'ouvrier ou le paysan prétend avoir dans l'estomac, et qu'il s'efforce de tuer en buvant la goutte (souvent des gouttes) chaque matin. - (14) |
| ver-couraud, ver-coureau, ver-coreau , ver-coriau, ver-coron (corromp ?) : s. m., ver imaginaire auquel les buveurs attribuent la pituite et les renvois aigres de l'estomac. C'est pour « tuer le ver » qu'ils boivent dès le saut du lit. - (20) |
| vercouriau (n.f.) : aigreur d'estomac - (50) |
| vercouriaû : aigreurs d'estomac, coliques - (48) |
| vercouriau, s. m. aigreur d'estomac. Se dit encore par extension d'un homme d'humeur aigre. - (08) |
| vercouriôt : 1 n. f. Brûlure dans la gorge. - 2 n. f. Verdeure. - (53) |
| vercouro, s.m. renvoi acide de l'estomac. - (38) |
| vercourtau : aigreur. - (31) |
| verd, gui des arbres. - (05) |
| verdaille. s. f. Sorte de camisole qui se serre à la taille et que portent les femmes de la campagne, les travailleuses des champs, pour aller et venir, pour verder plus commodément en faisant leur ouvrage. (Migé). - (10) |
| verdaine : s. f., xx fr., verdain, verdan : s. m., champ de céréales encore vertes. - (20) |
| verdais - le gros lézard vert. - En copant l'herbe dan le bô, fais bein aitention ès verdais. - Lai serpent le bon onguent ; le verdais le coutais. - (18) |
| verdalin (vr'dalin), verdeau, verdiau : s, m., raisin qui ne varie pas, c'est-à-dire reste toujours vert, ou bien varie en raison non pas de la maturation, mais de conditions défavorables. - (20) |
| verdauler (vr'dauler), vertailler (vr'tailler) : v. n. Fréquentatifs de verder. - (20) |
| verdazin, verdan, verdain, verdoin, verdoine : s. m. et f., lézard vert. - (20) |
| verde, adj. stérile. Se dit en parlant des femmes comme des femelles d'animaux. - (08) |
| verdeiller, v. n. être vert. S'emploie surtout en parlant des grains qui ne sont pas murs : du seigle « verdeillé. » - (08) |
| verdeillot, ote, adj. un peu vert, qui n'a pas encore atteint la maturité. - (08) |
| verdeler. v. n . Commencer à mûrir, en parlant des raisins. (Auxerre). - (10) |
| verdelle : voir lisette - (23) |
| verdelle, verdeziau. n. f. - Lézard vert. - (42) |
| verdelle. s. f . Lézard vert. — Figurément, petite fille vive et mutine. (Puysaie). - (10) |
| verder (vr'der) : v. n., aller et venir, rôder. T'as bien vr'dé aujourd'hui. - (20) |
| verder : courir. (F. T IV) - Y - (25) |
| verder. v. - Remuer, s'agiter, ne pas tenir en place. - (42) |
| verder. v. n. Ne pas tenir en place, aller de droite et de gauche ; courir, vagabonder. — Veut dire aussi, faire vitement, aller rapidement. Dans la main d’un écolier qui écrit vite, la plume verde. — On prononce généralement veurder. - (10) |
| verderiau, verdeziau. s. m. Lézard vert. - (10) |
| ver-de-vigne, s. m., chenille ainsi nommée par les vignerons. Au moment de la floraison, elle attaque le raisin, dont elle coupe les tiges tendres. Plus dangereuse que le ver-coquin. — Et cependant c'était avant le phylloxéra ! (V. Var, Ver-coquin, Ver-couraud.) - (14) |
| verdiais, sm. verglas. - (17) |
| verdier, vredi (vr'di) : s. m., lat. viridarium, verger, et spécialement verger attenant à l'habitation. Huit hameaux ou écarts du département de Saône-et-Loire sont dénommés Le Verdier ou Les Verdiers. - (20) |
| verdigo : agitation désordonnée (propre aux enfants). Ex : "Aga l’gamin, il arrête pas ! Un vrai verdigo !" - (58) |
| verdigot. n. m. - Vif, turbulent ; s'emploie essentiellement en parlant d'un enfant. - (42) |
| verdillis. n. m. pl. - Épis verts. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| verdin : gros morceau de bois, un peu long - (60) |
| verdiner : faire sonner un objet métallique. III, p. 5-3 - (23) |
| verdiner : tinter, faire un bruit de ferraille continu. Ex : "Acoute don y'eu auto coume al verdine !" - (58) |
| verdiot (n. m.) : osier rouge - (64) |
| verdjau. Iris d'eau, roseau. - (49) |
| verdon (vr'don) : s. m., vx fr., corde, cordeau, cordon. Tirer le verdon : tirer la corde de hâlage; tirer la corde du greul, pour bercer l'enfant. - (20) |
| verdon. s. m. Petite cincenelle servant à haler les bateaux vides, particulièrement sur les canaux. (Navigation de l’Yonne et de ses affluents). - (10) |
| verdot. Gros lézard vert. - (49) |
| verdreau, n.m. lézard vert. - (65) |
| verdrelle. f. s . Lézard. (Arcy-sur-Cure, Bazarnes). — Partout ailleurs , on dit verdelle. - (10) |
| verdret, nom rustique du lézard vert, sans doute à cause de sa couleur. - (11) |
| verdru : lézard vert. A - B - (41) |
| verduron. Individu pale, défait. - (12) |
| véré, e, adj. devenu vert, rendu vert : ces fraises ne sont pas mûres, elles ne sont que « vérées. » - (08) |
| véreau : voir verreux - (23) |
| vérer : mûrir. Ex : "Les noisettes al' sont pas encore vérées !" - (58) |
| vergâgne : n. f. Remarque désobligeante. - (53) |
| vergainches ou vergaingnes - dissipations, sottises. - Al é fait ses vergainches, i en répond. - Te fairez don tôjors des vergaingnes ? On dit aussi souvent feurgainches. - (18) |
| vergâme (n.m.) : jugement sur le prochain - (50) |
| vergâme, s. m. ce qu'on pense du prochain, le jugement que l'on porte sur lui, l'opinion qu'on en a : dire son « vergâme » à un homme, lui dire son fait, lui faire son procès, lui donner son paquet. - (08) |
| vergencé, de diverses couleurs. Se dit de la couleur de la peau à la suite d'une contusion. - (27) |
| vergencé, vargencé. adj. - Tacheté, marbré par le froid, en parlant de la peau. - (42) |
| vergencé, vargencé. adj. Tacheté, moucheté ; dont la peau, dont le visage est marbré par le froid. (Soucy, Sens). - (10) |
| vergentai - livide, c'est-à-dire d'un teint rougeâtre, noir, bleu, gris, soit pour la figure, les plaies. - Ceute personne lai é lai figure tote vergentée. - Son doigt â vergentai ai c't'heure. - (18) |
| vergenté (-e) (adj.m. et f.) : vergeté (-e), couperosé (-e) - (50) |
| vergenté, e, adj. vergeté, marqué de diverses couleurs, surtout de taches rouges. - (08) |
| vergeon : s. m., vx fr., petite verge, branché, rameau. - (20) |
| vergeons. n. m. pl. - Ramilles de bouleau, utilisées pour la confection de balais. - (42) |
| vergeons. s. m. pl . Menues branches de bouleau pour faire des balais. (Ronchères). - (10) |
| vergeter : v. n., végéter. - (20) |
| vergette : s. f., brosse dure. - (20) |
| vergette. Dans l'origine, c'était une petite verge, une baguette à battre les habits. Plus tard on a appliqué ce mot à une brosse. Ast-ce que t’ai vergetté ton gilet... - (13) |
| vergier : Étendue d’une verge carrée, étendue qui était d’environ quarante perches. - (55) |
| vergillon, s. m., manche de fouet, verge. A quelque parenté avec vorgine. - (14) |
| vergnau. Instrument de pêche. - (03) |
| vergogne. f. s. Honte, pudeur. — Mener la vergogne, vivre en libertin, dans la débauche, dans la honte et l’impudeur. (Sainte-Magnance). — Du latin verecundia. - (10) |
| véri v.i. Changer de couleur, mûrir, en parlant du raisin. - (63) |
| vérif'illi : vérifier - (57) |
| vérignée : n. f. Petite pluie. - (53) |
| vérimeux, adj., venimeux. - (14) |
| vérin, s. m., venin. - (14) |
| verin, venin. - (05) |
| vérin. Venin. - (03) |
| vérir, v. changer de couleur (pour les grains de raisin). - (65) |
| véritai. Vérité, vérités. - (01) |
| verjo (Ai lai) : à l'abri de la pluie. (RDM. T II) - B - (25) |
| verluhant : ver luisant. IV, p. 29 - (23) |
| vermeûre, s. f., vermine, tout ce qui est en terre en automne. - (40) |
| vermichela : vermoulue. - (29) |
| vermisselé : adj., vermoulu, mangé par les vermisseaux. - (20) |
| vermisselé, troué par les vers ; se dit surtout des fruits. - (16) |
| vermoiché (-e), vemouéché (-e) (adj.m. ou f.) : vermoulu (-e) (étym. : de ver et moulu) - (50) |
| vermoiché, vermouéché, e, adj. vermoulu. - (08) |
| vermoichereai (n.m.) : ver luisant - (50) |
| vermoichereai, s. m. ver luisant, femelle du lampyris splendidula. - (08) |
| vêrmouèché (s') : (v. pron.) être mangé des vers, en parlant du bois ; être vermoulu. - (45) |
| vêrmouèch'rê : (subst. m.) 1- larve de hanneton, appelée par d'autres vêrmouchâ:. 2- lampe à huile. - (45) |
| vermussé, adj., rongé par les vers. - (40) |
| vermusslé, vermoulu. - (26) |
| vernage : bruit, agitation bruyante, remue-ménage. Ex : "Vieux loufou, vas-tu en fini' avec ton vernage ? Té nous assabouis !" - (58) |
| vernaille (vr'naille) : s. f., nom collectif. Bfanchettes de verne ; objets de rebut ; individus de peu de-valeur. - (20) |
| vernais, s. m. terrain humide où croissent les bouleaux et particulièrement les vernes ou aunes. - (08) |
| verne : aulne - (48) |
| verne n.m. Verne, aulne. - (63) |
| verne, subst. masculin : aulne. - (54) |
| verne, varne, s. f. aune, l'arbre le plus répandu dans nos vallées marécageuses. Le verne a donné son nom à un très grand nombre de prairies ou de pâturages plus ou moins complètement défrichés. - (08) |
| verne. Aulne ; vieux mot. - (03) |
| verneau, s. m. lieu planté d'aunes ou vernes : le bois de verneau, commune de Saint-Léger-de-Fourches. - (08) |
| verneux. adj. Véreux. (Soucy). - (10) |
| verni, s. m. lieu planté d'aunes ou vernes, pâturage humide anciennement défriché. Il y a des « vernis » dans toutes nos vallées tourbeuses. - (08) |
| vernoîs n.m. Lieu planté de vernes. - (63) |
| vernois, s. m. lieu planté d'aunes. - (08) |
| vernouiller. v. n. Remuer sans cesse dans son lit. (Courgis). - (10) |
| vernuchant : voir verluhant - (23) |
| vérote (n.f.) : petite barre percée de trous dans lesquels s’adapte le bout des "aifroinches" d'une charrette - (50) |
| vérote, s. f. petite barre percée de trous dans lesquels s'adapte le bout des affranches d'une charrette. La «. vérote » sert à exhausser le véhicule pour le transport des fourrages. - (08) |
| véroter, v. a. commencer l'engraissement d'un animal, d'un bœuf, d'une vache, d'un porc, etc. : il a acheté un cochon pour le « véroter. » - (08) |
| vérou, s. m. sorcier. - (08) |
| verpe, verpie. f. s. Vipère. Qualification injurieuse en usage à Etivey. - (10) |
| verpelaine : voir verpillère - (23) |
| verpi : vipère rouge. IV, p. 32 - (23) |
| verpiller, et varpiller, v. intr., remuer. - (14) |
| verpiller. v. n. Ne pas tenir en place, aller et venir sans cesse. - (10) |
| verpillère : chenille du paon de nuit. IV, p. 28 - (23) |
| verpillère : grosse chenille - (60) |
| verpillo. Remuant comme le renard, du vieux mot verpil. - (03) |
| verpillon. s. m. Qui tourne, vire et remue sans cesse, en parlant d’un enfant. Du latin verpilio. - (10) |
| verpillòt, et varpillòt, adj., remuant. - (14) |
| verpillot, vif, remuant, bien portant. - (05) |
| verquin : s. m. rangée de foin. - (21) |
| verre (m), verglas. - (26) |
| verré, adj., attaqué par les vers (en parlant du fromage). - (40) |
| verrer : maturité des noix, des noisettes ou châtaignes - (60) |
| verreux : courtillière. IV, p. 28 - (23) |
| verri, ie. adj. - Oxydé par le vert de gris. - (42) |
| verri, ie. adj. Oxydé, rouillé. - (10) |
| verrignerie, petite pluie continue mais qui mouille peu. - (27) |
| verrine. n. f. - Verrue. - (42) |
| verrine. s. f. Verrue. (Puysaie). - (10) |
| vers : prép., près, auprès (sans mouvement). - (20) |
| vers, pré. auprès de (pour le moment, je reste vers mes parents). - (65) |
| versaule, adj. sujet à verser : une voiture très « versaule. » - (08) |
| verse (ai) - grande pluie, dite en un seul averse. - Deu ce maitin en plieu ai verse. - Ma regaide don, lai plieue choué ai verse quemant s'en lai beillot pou ran. - (18) |
| verse : dépotoir - (44) |
| verse, n.f. dépotoir. - (65) |
| verse, subst. féminin : décharge publique à ciel ouvert. - (54) |
| vertau, vertchau, vertiau. Ver de terre, lombric. S'il s'agit d'un verre de bois, on dit ; « un ch'tit vertau ». - (49) |
| vertchiaux : ver de terre - (44) |
| verteau, vretiau (vr'tiau) : s. m., ver. Voir tire-verteaux. - (20) |
| verteaulé, vretiaulé : adj., véreux, piqué des vers. - (20) |
| vertellé, envermé. Véreux, rongé par les vers. - (49) |
| vertingo (vr'tingo) : s. m., vertigo, caprice. Prendre son verling. - (20) |
| vertiot : ver - (60) |
| vervari. s. m. Zigzag, circonvolution, détour. (Sénonais). - (10) |
| vervoulu, ue. adj. Etourdi, dissipé, d’une grande vivacité, en parlant d’un enfant. (Etivey). — Du bas latin vervolutus. - (10) |
| vés - vez : auprès - (57) |
| vés : vers - (57) |
| vés prép. Vers, chez. - (63) |
| vês, prép. auprès de. - (38) |
| vesaille. f. s. Petit poisson. (Rogny). - (10) |
| vèser, vn. se sauver, prendre la fuite : se dit du bétail qui entend ou croit entendre des taons ou des mouches piqueuses et s'enfuit, la queue en l'air, dans toutes les directions. - (17) |
| vesne, vesse. - (04) |
| vesnier (vess'ni) : s. m., vx fr., vesseur, merdeux, homme de rien. C'est un sal' vess'ni. - (20) |
| vesout : n. f. Flemme. - (53) |
| vesprot. Le soir, la tombée de la nuit. - (13) |
| ves-re, se dit dans l'expression : la greume ves-re, lorsque le grain de raisin commence à rougir (cf. greume). - (38) |
| vesseriâ, s. m., orgelet. - (40) |
| vessie (v'ssie) : s. f., ballon de caoutchouc entouré d'une enveloppe de cuir. - (20) |
| veste de piau : veste de cuir - (43) |
| veste d'piau n.f. Veste de cuir. - (63) |
| ves-ti, v. vêtir. - (38) |
| vet, va. - (04) |
| vetàyé, v, n. zigzaguer. - (22) |
| vétlau. Ver. - (03) |
| vêtre : Vêtir, revêtir. « Ol est tot vêti de neu ». « Ol a vêti ses habits des dimanches ». « Je va vêtre mes sulés ». - (19) |
| vêtu en bordelle, habillé en bordelle : loc, s'applique à la personne dont les vêlements de dessous dépassent en bas ceux de dessus, comme les ailes de la bordelle (hanneton) dépassent ses élytres. - (20) |
| vétu en nenard, habillé en renard : Ioc, s'applique â la personne dont les vêtements ont plus de valeur qu'ellemême, comme la peau du renard a plus de prix que sa chair. - (20) |
| vêture n.f. Vêtement, habit, élément d'habillement. - (63) |
| veu - vide. - A ne mége don ran ? AI â veu quemant une lentarne. - La fillette â préque veude ; en i é ai peune cin bouteilles de vin. - (18) |
| veu, gui. V. verd. - (05) |
| veu, part. passé du verbe voir. vu. s'emploie pour entendre dans cette locution très usitée : « i é veu dire », j'ai entendu dire. - (08) |
| veu. Gui de chêne, du latin viscus. - (03) |
| veu. Singulier des trois personnes du verbe vouloir au présent de l'indicatif. - (01) |
| veuche : un pet. - (56) |
| veuche : vache - (44) |
| veûche d’loup : vesse de loup (champignon) - (37) |
| veuçhe n.f. 1. Pet silencieux (vesse) 2. Vesse de loup (lycoperdon). - (63) |
| veuçhe n.f. Vesse, pet. - (63) |
| veuche, veuchie : n. f. Vessie. - (53) |
| veuche, veusse-de-loup, s. f. vesse-de-loup, champignon de mauvaise odeur. - (08) |
| veucher : faire une veuche. - (56) |
| veucher, verbe transitif : bâcler, saboter un travail. - (54) |
| veucher, veusser, v. n. vesser. - (08) |
| veûcher, voûchir : péter sans bruit (« vesser ») - (37) |
| veuçhi v. Péter silencieusement. - (63) |
| veuchie : vessie - (48) |
| veuchie : vessie - (39) |
| veuchie, ou par abréviation v'chie - vessie. - A souffre ai lai veuchie. - (18) |
| veûchou, vouchou : celui qui pète sans bruit de façon habituelle - (37) |
| veude (adj.m. et f.) : vide - (50) |
| veude, adj. vide, où il n'y a rien. - (08) |
| veuder (v.) : vider - (50) |
| veuder, v. a. vider, rendre vide. On « veude » une bouteille, un tonneau, un vase quelconque rempli de quelque chose, mais on « aitairit » un puits, une fontaine, un réceptacle dont le contenu se renouvelle naturellement. - (08) |
| veûdje : le vide - èl é fè l'veûdje auto d'lu, il a fait le vide autour de lui - (46) |
| veudjeret, sm. verdereau, lézard vert. - (17) |
| veûe (n.f.) : vue - (50) |
| veue, s. f. vue, la faculté de voir. - (08) |
| veûë, s. f., vue. - (14) |
| veugne : (nf) vigne - (35) |
| veugne : vigne - (51) |
| veugne : vigne. (MLB. T II) - S&L - (25) |
| veugne n.f. Vigne. - (63) |
| veugne. adj. Mou, sans énergie, sans vigueur. (Courson). — Voyez vaune. - (10) |
| veugn'ron : (nm) vigneron - (35) |
| veugnron n.m. Vigneron. - (63) |
| veuguier. v. a. Vider, rendre vide ; du latin vacuare. (Etivey). - (10) |
| veuille : (nf) veille - (35) |
| veuille n.f. Veille. Alle s'est envnie la veuille au sa. - (63) |
| veuillerie (rom féminin) : liseron. - (47) |
| veûillie : espèce d’herbe nuisible dans le jardin - (37) |
| veûillie : liseron des champs. D’autres disent vrille ou éveuillie . - (62) |
| veuillie, n.f. liseron des champs. - (65) |
| veuillie, s.f. liseron sauvage. - (38) |
| veûillie, voîllie n.f. Liseron. - (63) |
| veuillotte, viotte, villotte, voyotte. n. f. - Petit tas de foin. - (42) |
| veûlan : mot masculin désignant une faucille - (46) |
| veule, adj. faible, flasque, mou, et au figuré sans énergie, sans vigueur. - (08) |
| veule, idem. - (04) |
| veule, maigre, stérile... - (02) |
| veûlé, voler ; veûlou, voleur ; s'il arrive à quelqu'un du mal qu'il a mérité : te n'I'é pâ veûlé, lui dit-on. - (16) |
| veule. : Maigre, stérile. - A Rennes, un homme veûle signifie un homme mou, sans énergie. - A Valenciennes, veûle a le sens de léger, étourdi. - Une terre veûle est une terre légère. Dans le dialecte français veulz ou veuls veut dire paresseux, inerte, indolent. - (06) |
| veûlée : une petite pluie - (46) |
| veune - subjonctif du verbe venir. - (18) |
| veune (na) - trique (na) : baguette (pour taper) - (57) |
| veurcalé : véreux (contenant des vers) - (57) |
| veurco : s. m. ver blanc. - (21) |
| veurdai - aller de tous côtés ; souvent dans le même endroit. - Ile ne fait que veurdai tot por qui. - To les sairs â veurdant dan les rues. - (18) |
| veurdai : faire vite, se dépêcher. Ça veurdot : cela allait très vite. Quand on o en retard o faut veurdai : quand on est en retard il faut se dépêcher. - (33) |
| veurdailler, v., flâner çà et là. - (40) |
| veurdailli : verdoyer - (57) |
| veurdailli v. Verdir. - (63) |
| veurdaler : se déplacer au hasard, vagabonder. A - B - (41) |
| veurdaler : (vb) traîner, flâner - (35) |
| veurdaler : aller de ci de là - (51) |
| veurdaler : prendre la mouche et aller dans tous les sens. - (62) |
| veurdaler, veurdôler, veurder v. 1. Sortir pour faire la fête. 2. Errer. 3. Courir les chemins. - (63) |
| veurdalin Voir veurdelin. - (63) |
| veurdaller : se déplacer sans motif, vagabonder - (34) |
| veurdè : roder. (RDT. T III) - B - (25) |
| veurdè : v. pr. Se dépêcher. - (53) |
| veurdée (faire une), faire une sortie. - (40) |
| veurdée : (nf) raclée - (35) |
| veurdée : correction, virée. Correction infligée à quelqu’un et aussi une promenade rapide : une « virée ». - (62) |
| veurdée : correction. (S. T III) - D - (25) |
| veûrdée : promenade prolongée avec copains - (37) |
| veurdée : rossée - (48) |
| veurdée : virée (faire une veurdée). - (33) |
| veurdée n.f. (du francique wrotan, aller ça et là). Sortie, virée (pour faire la fête). - (63) |
| veurdée : n. f. Virée. - (53) |
| veurdée/veurder : sortie/sortir pour faire la fête. A - B - (41) |
| veurdeillai : se trémousser. - (33) |
| veurdeillot : enfant remuant. - (33) |
| veurdelin, veurdalin adj. Vert, pas mûr, en parlant d'un fruit. - (63) |
| veurdelle, s. f. lézard de couleur verte, lacerta viridis. - (08) |
| veurder (Chal., Morv.), vironder (Char.), verder (C-d., Y.), vreuder ou vreudai (C.-d.), vertauder, vernailler (Morv.). - Aller de droite et de gauche, tourner, virer, ne pas tenir en place ; de vertere, tourner, qui a produit vertige. Cependant le gracieux terme charollais vironder semble plutôt venir de virer. En Champagne, où le mot veurder existe, il a de préférence le sens de fuir, s'enfuir… - (15) |
| veurder (v.t.) : s'en aller, s'enfuir - (50) |
| veurder (verbe) : se balader, aller à l'aventure. - (47) |
| veurder : (vb) aller et venir, ne pas tenir en place - (35) |
| veurder : aller vite, tomber avec force (pluie etc...). - (56) |
| veurder : battre, fesser, rosser - (48) |
| veurder : courir à perdre haleine. (R. T IV) - Y - (25) |
| veurder : remuer de tous côtés. - (62) |
| veurder : rôder, aller et venir. (RDV. T III) - A - (25) |
| veurder : se promener. - (66) |
| veurder : sortir - (44) |
| veurder Voir veurdaler. - (63) |
| veurder : traîner, se promener - (39) |
| veurder, aller de côté et d'autre, surtout pour travailler. - (27) |
| veurder, v, courir, marcher vite à travers champ. - (38) |
| veùrder, v. intr., rôder, tourner de droite et de gauche, sans but déterminé ; voisiner chez l'un, chez l'autre : « Tôjor te veùrdes ; te n'peux donc pas rester iqui ? » - (14) |
| veurder, v. n. aller et venir avec agitation, rôder, se mouvoir en tous sens sans changer beaucoup de place. - (08) |
| veurder, v. n. tomber avec force, avec violence. On dit de la pluie, de la neige, de la grêle qu'elle « veurde » lorsqu'elle fouette la terre par rafales. - (08) |
| veurder, v.; marcher prestement. - (07) |
| veurder. Tourner rapidement. I vâs fâre veurder mai fiarde. (V. ce mot.) Par extension marcher vite, remuer, s'agiter. Qu'éque t'ai don ai veurder teute lai jornée à l’entor de lai mâzon. Peut-être de l'allemand verden. - (13) |
| veurder. Tourner, par extension faire vite. Etym. vertere. - (12) |
| veurder. v. - Tourner autour. « Il y a aussi la femme du Justin. Elle est bien avenante et plusieurs voisins veurdont autour d'elle. » (G. Pimoulle, Parfums d'enfance, p.26) - (42) |
| veurdeuilli v. Verdir, rester ou devenir vert. - (63) |
| veurdi : verdir - (51) |
| veurdiau (nom masculin) : végétation arbustive des lieux humides, surtout connue sous ce nom sur les bords de Loire. - (47) |
| veurdiau, adj., acide, vert. - (40) |
| veurdiau, verdiau (n.m.) : osier pourpre - par extension, végétation des bords des rivières (au pluriel : les veurdiaux, verdiaux) veusse de loup (n.f.) : lycoperdon - (50) |
| veurdiller, v. n. aller de côtés et d'autres sans but, s'agiter sans motif et pour des riens. - (08) |
| veurdillon, s. m. celui qui va de côtés et d'autres pour ne rien faire. Se dit d'un enfant très vif qui s'agite sans cesse : « eun p'tiô veurdillon. » - (08) |
| veurdillou, ouse, adj. celui qui va et vient, qui s'agite pour des riens, pour des minuties. - (08) |
| veùrdin, s. m., caprice, idée fantasque, folie : « Que qu'te voux donc c'ment c'qui ? V'là còre tes veùrdins qui te preùnent ! » - (14) |
| veurdin, s.m. quelqu'un ou quelque chose qui "veurde". - (38) |
| veurdingaud : (nm) fêtard - (35) |
| veurdingo n.m. 1. Vertige. 2. Idée fixe, obsession, coup de folie. - (63) |
| veurdion : personne très active, qui ne tient pas en place - (48) |
| veurdion : qui ne tient pas en place - (39) |
| veurdissant : verdissant - (51) |
| veurdjou : arbrisseau de marécage. A - B - (41) |
| veurdjou : arbrisseau de marécage - (34) |
| veurdôler : (vb) culbuter, se renverser - (35) |
| veurdôler v. Tourner, bousculer. Les verbes beurdôler, beurdoûler semblent ne pas impliquer de mouvement tournant. - (63) |
| veurdôler Voir veurdaler. - (63) |
| veùrdon (tirer le), loc., bercer un enfant à l'aide de la corde attachée au berceau, et qui le balance. - (14) |
| veûrdon : berceau oscillant - (37) |
| veùrdon, verdon, verdot, vredot, et vrediot, s. m., corde de la grosseur du doigt, avec laquelle on attache un bateau. Le veùrdon est plus fort que la vrisse. (V. la locution suivante, et Vrisse.) - (14) |
| veurdon. Corde servant à faire balancer le berceau. Longue perche servant aux mariniers à pousser, diriger le bateau sur le canal. - (49) |
| veùrdoû, s. m., flâneur, musard, qui va et vient en perdant son temps. - (14) |
| veurdrot, veurdru n.m. Lézard vert. - (63) |
| veurdru : (nm) lézard vert - (35) |
| veurdru : lézard vert - (51) |
| veurdze : (nf) battant du fléau - (35) |
| veurdze n.f. Battant du fléau. - (63) |
| veurdzi : verger - (51) |
| veurdzi n.m. Verger. - (63) |
| veurghiâ, s. m. verglas. (voir : guiaice.) - (08) |
| veurghiaisser, v. impers. verglacer, faire du verglas. - (08) |
| veurgi (on) : verger - (57) |
| veurgoilli : zigzaguer - (51) |
| veurguer : égrener - (57) |
| veurguinche, s. m., vent froid et violent. - (40) |
| veurloupiot n.m. Nom plaisant donné au ver luisant en mâconnais au début du XXè s. Le nom est oublié à Sivignon mais le petit ver luisant est encore là. - (63) |
| veurmine (na) : vermine - (57) |
| veurmine n.f. Insectes, vers, animaux malpropres, bêtes nuisibles. Au sens figuré, personnes indésirables, gibier de potence. - (63) |
| veurnaille : (nf) verge souple - (35) |
| veurnailli : (vb) fouetter - (35) |
| veurnailli v. Virer, tourner, s'agiter. - (63) |
| veurne : (nm) aulne - (35) |
| veùrneùler, et vernauler, v. intr., flâner, rôder, se promener sans but, courir, perdre son temps. (V. Gueùrnouiller, Veùrder.) - (14) |
| veurni : vernir - (57) |
| veurnioule : (nf) meule à aiguiser - (35) |
| veurnoux : venimeux - (57) |
| veurper : (vb) tourner bride, repartir aussitôt - (35) |
| veurper v. Faire demi-tour, virer. - (63) |
| veurpis (nom féminin) : vipère. - (47) |
| veurse n.f. Verse. I pyout à veurse ! - (63) |
| veurser : verser - (57) |
| veursi v. Verser. L'froment est veursi. - (63) |
| veursiaû : ver - (48) |
| veursou (on) : verseur - (57) |
| veursou: (nm) arrosoir - (35) |
| veursouaîr (on) - oreille (n’) (pour une charrue) : versoir - (57) |
| veurtalé : fruit véreux. A - B - (41) |
| veurtalé : fruit véreux - (34) |
| veurtalé : véreux - (35) |
| veurtalé : véreux, boutonneux - (51) |
| veurtalé : vérré - (44) |
| veurtalé adj. Véreux. - (63) |
| veurtchau : ver de terre, asticot - (34) |
| veurtcheau : vers, asticot - (51) |
| veurtcho : ver de terre (lombric), asticot. A - B - (41) |
| veurtchouin-ner : bouger sans arrêt - (57) |
| veurtiau : (nm) ver de terre - (35) |
| veurtiau n.m. Ver de terre. - (63) |
| veurtiaû, s. m., ver de terre. - (40) |
| veurtiau, subst. masculin : ver de terre. Utilisé aussi au figuré pour désigner quelqu'un de très souple. - (54) |
| veùrtingô, s. m., vertigo, fantaisie, caprice, toquade, idée déraisonnable : « A prepos de bottes, all'vous a des veùrtingôs !... » — « Quand ô prend son veùrtingô, n'y a pus moyen d'en jouir. » - (14) |
| veurtoïlli, enveurtoïlli v. Tituber. - (63) |
| veurtoïllon n.m. Tournis. - (63) |
| veurtot (nom masculin) : ver de terre. - (47) |
| veurtsère : petit champ situé à proximité de la ferme. A - B - (41) |
| veurtsère : petite terre à proximité de la ferme - (34) |
| veurtsire : (nf) bonne terre près de la maison - (35) |
| veurtsire n.f. Petite terre à proximité de la ferme, pré recevant les eaux usées de la ferme, verchère. - (63) |
| veurvalle (d'la) : liseron (sauvage) - (57) |
| veurzé, s. m. verger. (voir : vargé.) - (08) |
| veurzer (n.m.) : verger - (50) |
| veusse (na) : verse - (57) |
| veusse (na) : vesse - (57) |
| veusse : (nf) pet - (35) |
| veusse : pet - (48) |
| veusse de loup : vesse-de-loup, lycoperdon - (48) |
| veusse : vesse - (39) |
| veusse-de-loup (na) : vesse-de-loup - (57) |
| veusse-de-loup : champignon - (39) |
| veusser : péter - (48) |
| veusser : vesser - (39) |
| veûssi : péter - (35) |
| veussi : vesser - (57) |
| veûte : Votre. « Veûte maijan est pu grande que la neutre ». - (19) |
| veutés : Vos. « Posez dan veutés sulés vos serez mieux âge dave des sabeuts ». - (19) |
| veûtre : Vôtre. « Veûte pa est pas mauvâse mâje ne changerais pas la min-ne cantre la veûtre ». - (19) |
| veùv', s. m., veuf. Ce mot est le même pour le féminin. - (14) |
| veuyie : liseron. - (29) |
| veuyie, s. f., liseron rose des champs. - (40) |
| véve, veuf et veuve. - (16) |
| vève. Veuf, veuve. (S'emploie pour les deux genres). - (49) |
| vévre ou vesvre : lieu réputé humide. Tel un champ. Chez nous des lieux-dits : Vesvre, le Cul de Vesvre .Voir le lien avec mère en gueule. - (62) |
| Vèye ke vêye, vaille que vaille. - (16) |
| véyie : (nf) liseron - (35) |
| vëyie, petit liseron sauvage ; vëyie bombarde, gros liseron blanc des haies. - (16) |
| vez (tsez): vers, chez - (51) |
| vez : chez - (57) |
| vez li : chez lui - (57) |
| vez sa : chez soi - (51) |
| vez. Préposition qui a le sens de vers, auprès de. Vins vez moi i le beillerai du bonbon. — Si te veux veni vez chez neus demain , i regarderons c’ t’ effare iqui... - (13) |
| vezai. Perdus. J’étein vezai, nous étions perdus comme le son de la veze se perd en l'air. Veze est une espèce de musette… - (01) |
| vezai. : Perdu. L'on dirait d'un animal qu'il est en danger de crever parce qu'il est enflé comme une veze ou musette. Ce dernier mot vient du latin vesica, vessie. - (06) |
| vezette, s. f. girouette, personne dont les idées changent à chaque instant, qui n'a pas de tenue dans le caractère. - (08) |
| vezon : s. m., vx fr. vezé (adj.), ballonnement abdominal dû à la présence de gaz dans l'intestin. Avoir le vezon, avoir besoin de vesser. Voir petat. - (20) |
| vez-sai : chez-soi - (57) |
| vi - vif, cru. - Qu'al â don vi ceut enfant lai. - Le toutou quand en lli beille in bout de laird, al l'aivole to vi. - (18) |
| vi, vife, adj. vif, actif, pétulant, vigoureux. - (08) |
| vi. Singulier des trois personnes de voir à l'aoriste de l'indicatif, ou des trois personnes de vivre au présent de l'indicatif. Vi est quelquefois adjectif, mor vou vi, mort ou vif. Ai son pu mor que vi, ils sont plus morts que vifs. - (01) |
| viâ (adv.) : vite, à l'instant même - vin viâ = viens vite - (50) |
| viâ : vite - (48) |
| via n.f. Désignait quelques routes relativement droites supposées être d'anciennes voies romaines ou royales. - (63) |
| viâ : n. m. Veau. - (53) |
| via, adv. vite, sur-le-champ, à l'instant même : « cor via, vin via », cours vite, viens vite. - (08) |
| viâ, s, m., veau. - (40) |
| via, veau, je cite ce mot pour rappeler une locution facétieuse, très usitée dans les environs de Beaune. Faire viâ, c'est manquer son coup, ne pas réussir, en un mot « revenir bredouille ». Lai Nannette ast aillée au bal, parsonne n'ai velu danser dévou lai : elle ai fait viâ ! Dans les salons, on appelle cela « faire tapisserie. » - (13) |
| viâ. Veau. Prononciation locale. - (12) |
| viâdze : (nm) voyage ; pèlerinage - (35) |
| viadze : voyage - (43) |
| viâdze n.m. Voyage. - (63) |
| viâdzeux, -euse n. Voyageur. - (63) |
| viadzou : (nm) voyageur ; pèlerin - (35) |
| viae, veau. - (26) |
| viage : Pélerinage. « Dans in temps an allait en viage à Saint-Ythare, à présent an va à Lourdes ». - (19) |
| viage : s. m., voyage, pèlerinage. - (20) |
| viage, s. m. voyage. Pèlerinage : ils allèrent en viage à Saint-Criat. - (22) |
| viage, s. m. voyage. Pèlerinage : ils allèrent en viage à Saint-Criat. - (24) |
| viâge, s. m., voyage, longue course. - (14) |
| viage, s.m. voyage. - (38) |
| viaige - voyage. - An ne dai pa ailai en viaige le dimoinge ni les fêtes. - I vos souhaite bon viaige. Ce mot commence de vieillir. - (18) |
| viaige (n.m.) : voyage - (50) |
| viaige, s. m. visage par la chute de l's médial. - (08) |
| viaige, s. m. voyage : « partir en viaige », se mettre en route. - (08) |
| viaige, voyage. - (05) |
| viaige. Pèlerinage. À la suite d'un vœu fait par une personne malade, on allait en viaige à des sanctuaires renommés : à Rome, à Jérusalem, à Saint-Jacques de Compostelle et, plus près de nous, à Fourrières, au Mont Roland, vers Dole, à Sainte Reine d'Alise, etc. En cas d'empêchement, on envoyait quelqu'un a sa place... - (13) |
| viaige. Voyage, voyages. - (01) |
| viâjoù, s. et adj., voyageur. - (14) |
| viâlée : n. m. Placenta de la vache après vêlage. - (53) |
| vialet (n.m.) : petit chemin, sentier (aussi violet) - (50) |
| vialet : s. m., sentier. - (20) |
| vialet, « L » chemin, sentier, via. - (04) |
| vialet, s. m. petit chemin, sentier. - (08) |
| vialire : s. f. blouse bleue des paysans. - (21) |
| vian : Nom masculin, voir rian et pare. Passage, brisée dans un bois. - (19) |
| viance (fére viance) : v. t. ind. Faire penser à. - (53) |
| vianche : s. f., branche de clématite sauvage que les enfants fument en guise de cigare. Voir arveuille. - (20) |
| viandasse. Mauvaise viande. - (12) |
| viande a gens soûls : loc, ce qui se mangé par gourmandise quand on n'a plus faim. Voir trop-soûl. - (20) |
| viande n.f. Chair. La Fernande, alle a bié d'la viande (elle est bien en chair). - (63) |
| viande, s. f. chair en général, même en parlant de l'espèce humaine. - (08) |
| viandou (être), aimer la viande - (36) |
| viandou : bête en viande - (39) |
| viandoù, adj., qui aime la viande, qui en mange beaucoup. - (14) |
| viandou, ouse, adj. gras, charnu : un homme « viandou », une femme « viandouse. » - (08) |
| viandous : bien garni de viande - (48) |
| viandoux, viandouse : adj., qui aime la viande, qui en mange beaucoup. - (20) |
| vianne (Que le guiable me) ! Sorte d’imprécation en usage à Sommecaise, et par laquelle on souhaite : ou bien, que le diable vous poursuive, vous pourchasse, et alors vianne serait là pour vane, vanne (de venari , chasser), ou bien, que le diable vous exténue, vous fasse disparaître, et alors vianne serait encore là pour ane (de vaner, evanescere). - (10) |
| vian-ner (v. int.) : produire un bruit sourd et violent – manifester de la vivacité, de l'énergie, en parlant d'une action (ça va vian-ner (ça va barder)) - (64) |
| viant, viaint, vieussaint - divers temps du verbe voir. - A ne viant pâ cequi d'un bon ulliot. - Ai c't'heure à ne viaint ran devant lo. - I les viâ assi bein qui vos vouai. - En fauro qu'à les vieussaint ; â se décideraint to de suite. - (18) |
| viard (?), viarre (?) : s. m., bas-lat. vierrum, vassible mis en culture de façon intermittente. - (20) |
| viard : essart - (43) |
| viarer : flaner. (DC. T IV) - Y - (25) |
| viarer. v. - Flâner. (Sommecaise, selon M. Jossier) - (42) |
| viarer. v. n. Flâner, aller et venir, être sans cesse par voie et par chemin. (Sommecaise). — Du latin viare. - (10) |
| viarge, s. f. vierge. Ne s'emploie qu'en parlant de la Sainte Vierge, de la Mère de Dieu : « lai Viarge Mairie, lai Boune Viarge. » - (08) |
| viarge. n. f. - Vierge. - (42) |
| viârne, s.m. verne. - (38) |
| viau (n.m.) : veau - (50) |
| viau (on) : veau - (57) |
| viau : (nm) veau - (35) |
| viau : un veau. - (56) |
| viau : veau - (37) |
| viau : veau - (43) |
| viau : veau - (48) |
| viau : veau. - (59) |
| viau : Veau. « I ne faut pa fare le lin devant d'avoi le viau ». Ce proverbe a le même sens que : il ne faut pas vendre la peau de l'ours. « Mentre in viau dans eune grange », au figuré, signifie mettre un petit objet dans une grande boîte : « Y teindra bin an ment bin in viau dans eune grange ». « Grand viau » : au figuré, grand paresseux. - (19) |
| viau n.m. Veau. - (63) |
| viau : s. m. veau.· - (21) |
| viau : veau - (39) |
| viau, s. m. veau : « fére viau », faire veau, vêler. Il y a d'autres formes dans la région. on dit « via », dans la commune d'Anost : « i via», un veau; « fére via », vêler. - (08) |
| viau, s. m., veau. - (14) |
| viau. n. m. - Veau. - (42) |
| viau. Veau. - (49) |
| viaûde, riaûde : baguette flexible - (37) |
| viaule : Féminin de viau, synonyme de génisse. « J'ai détrilli eune viaule » : j'ai sevré une génisse. - (19) |
| viaule : s . f. génisse. - (21) |
| viaule, s. f. génisse. - (22) |
| viaule, s. f. génisse. - (24) |
| viaule. s. f. Yèble. (Lasson). - (10) |
| viauler (verbe) : vêler. - (47) |
| viauler : faire veau - (39) |
| viauler, v. intr., vêler : « Noute vaque a brament viaulé. » - (14) |
| viauler, v. n. vêler, faire veau. - (08) |
| viauler. v. - Vêler, faire viau. - (42) |
| viauler. v. n. Vêler, faire viau. (Bléneau). - (10) |
| viaulerie (nom féminin) : jeune bétail. - (47) |
| viaulerie, s. f. jeune bétail, veaux de tout âge : cet homme n'a pas de bœuf, il n'a que de la « viaulerie » - (08) |
| viaulotte, s. f petite génisse qui vient d'être sevrée : « eune brave viaulotte », une jolie taure. - (08) |
| viauter (se). v. - Se vautrer. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| viaux : veau - (44) |
| viaz, à l'instant, vite. - (04) |
| vicant : Vivant. « Ol est tojo vicant ». Peu usité. - (19) |
| vicant, vicante : s. m. et f., vivant, vivante. - (20) |
| vicant. adj. m. Qui vit, qui n’est pas mort. Il est encore vicant. Voyez viquer. - (10) |
| vicare : Vicaire. - (19) |
| vichou, sm. veau nouveau-né. - (17) |
| viciou, ouse, adj. vicieux, euse. - (17) |
| vicre. Petit oiseau, ainsi nommé de son chant par onomatopée. C'est, je crois, le traquet. - (03) |
| Victor. C'est le duc de Savoie, Victor-Amédée, IIème du nom, qui, en 1701, paraissait être dans nos intérêts. - (01) |
| victouaîre (na) : victoire - (57) |
| victouére, s. f. victoire. - (08) |
| vicu : Vécu. - (06) |
| vicu. Vécu. Quelques-uns ont dit vivu, s'imaginant qu'en patois il est permis de corrompre les mots à discrétion. C'est un abus. Le Bourguignon a ses règles comme le Français. A Dijon, où est l'atticisme du Bourguignon, vicu est le terme d'usage pour vécu, et vicant pour vivant. - (01) |
| vicul. n. m. - Têtard. Autre sens : déhanchement accentué de certaines femmes dans la rue, comme le fait le vicul, le têtard dans la mare. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| vicul. s. m. Têtard. (Sainpuits). - (10) |
| vidangeou (on) : vidangeur - (57) |
| viderio : lézard vert. (R. T IV) - Y - (25) |
| vidouaîr (on) : vidoir - (57) |
| vidye : vide. (B. T IV) - D - (25) |
| vie - chemin, sentier. - I l'ai rencontrai â long des vies de Ch'taisneu. - A vos fauré passai por les vies de Bouhey. - (18) |
| vie (n.m.) : chemin, sentier - (50) |
| vie des vaiches, chemin que suivent habituellement les vaches pour aller paître. - (27) |
| vie n.f. Bruit, désordre, tapage. - (63) |
| vie que dure (Faire) : Ioc, faire vie qui dure, c'est-à-dire économiser. - (20) |
| vié, imper, du verbe voir. voyez : « vié-lu », voyez-le. - (08) |
| vïé, impérat. de vouér, voyez : « Vïé donc c'qui ! » - (14) |
| vie, s. f nourriture, ce qu'il faut manger pour vivre. - (08) |
| vie, s. f. voie, chemin, sentier. - (08) |
| vieau : veau - (51) |
| vieau, veau. - (05) |
| vie-de-corps (travailler à). loc. verb. - Travailler avec vigueur, de toutes ses forces. (Lainsecq, selon M. Jossier) - (42) |
| vie-de-corps (Travailler a). locut. Travailler de toutes ses forces, en proportion de la vigueur, du degré de vitalité que l’on possède. (Lainsecq). - (10) |
| vieile n.f. et adj. Vieille. - (63) |
| vié'ille : vieille - (48) |
| vieille : vielle à roue - (51) |
| vieille, s. f., vielle. Vieille n'empêche pas viéleù. On remarquera que pour « vieille » nous disons veille, et que nous trouvons moyen de dire vieille pour l'instrument « vielle ». - (14) |
| vieille, subst. féminin : vielle. - (54) |
| vieillerie (nom féminin) : vieillesse. - (47) |
| vieillerie : s. f., vieillesse, sénilité. - (20) |
| vieilli : vieillir - (57) |
| viéilli : vieillir - (48) |
| vieilli : vieillir - (39) |
| vié'illie : liseron des champs - (48) |
| vieillie. s. f. Liseron ou volubilis des champs. (Etivey). - (10) |
| viéle. Vieille. On dit : « la viéle », « ma viéle » pour ma femme. - (49) |
| viéleû, et viéloù, s. m., joueur de vielle. Personnage indispensable aux fêtes et aux bals, où il a pour trône une planche posée sur deux tonneaux, ou deux tréteaux. - (14) |
| viéleu. Vielleur… - (01) |
| viéleu. : On appelait ainsi ceux qui jouaient les airs des noëls sur la vielle pendant les avents de Noël, dans les rues de Dijon et aux portes des habitants. - (06) |
| viélle (n. et adj.) : vieille - (50) |
| vielle fonne : vieille femme (« gonnelle », même signification, peu usité) - (37) |
| viendre : v. n., venir. - (20) |
| viendre, et veindre, v. intr., venir. - (14) |
| viendu, et veindu, part, de venî, ou de viendre, venu. - (14) |
| viérdze n.f. Employé seulement pour la Vierge Marie. - (63) |
| vieû, ami ; un homme âgé ne craint pas de dire, par amitié, à un enfant : mon vieû. - (16) |
| vieuille. n. f. - Vieille. - (42) |
| vieuill'rie. n. f. - Vieillerie. - (42) |
| vieûle (na) - vioûle (na) : vielle - (57) |
| vieulet, adj. violet. - (17) |
| vieulon, sm. violon. - (17) |
| vieus, (eū), adj. vieux. Voir vöill. - (17) |
| vieux grand-père, n.m. arrière-grand-père. - (65) |
| vieux. Nom donné à l'instituteur ou au directeur d'école ; les adjoints sont appelés : « p'tits vieux » ou « p'tchets vieux ». - (49) |
| viez, viot - divers temps du verbe voir. - (18) |
| vîfe, v. intr., vivre, être en vie, se nourrir. - (14) |
| viger. v. n. Appeler fort, parler, crier très-haut. — On dit activement : Il m'a vigé. (Dollot, La Belliole). — Du latin vigor. - (10) |
| vigneron : s. m., celui qui cultive la vigne à moitié fruits. - (20) |
| vigneronnage : s. m., ensemble des terres dont l'exploitation est confiée à un vigneron ; mode d'affermage d'un domaine vignoble à moitié fruits. - (20) |
| vigneronne : s. f., mante religieuse (mantis religiosa). Syn. de chevrule. - (20) |
| vigneronnerie : s. f., ensemble des terres dont l'exploitation est confiée à un vigneron. - (20) |
| vignoble : s. m., vigneronnerie. - (20) |
| vignolate, s.f. mercuriale. - (38) |
| vignôle : Clématite des haies, herbe aux gueux, clématis vitalba. « Quand j'allais à l’écôle je passins tojo pa la rue es meûs pa femer de la vignôle ». La vignôle qui croît dans les haies a un bois très sarmenteux, très poreux, ce qui fait que, d'un morceau coupé entre deux nœuds et allumé d'un bout on peut aspirer la fumée par l'autre bout, comme on fait d'un cigare, cette fumée a d'ailleurs un goût détestable. - (19) |
| vignole, n.f. clématite vigne blanche. - (65) |
| vignole, vigne sauvage. - (05) |
| vignole. Vigne sauvage qui produit la lambroche. - (03) |
| vignoule : s. f. clématite, vigne blanche. - (21) |
| vigoureux : adj, rigoureux. Un hiver vigoureux. Voir rigoureux. - (20) |
| vigourou, ouse, adj. vigoureux, euse. - (17) |
| vigrain : chiendent. (A. T IV) - S&L - (25) |
| vigreu (-ouse) (n. et adj.m. et f.) : bien portant (-e) - (50) |
| vigreu, vigresse au féminin vigoureux, bien portant, vivace. - (08) |
| vigro : vigoureux, en bonne santé. (B. T II) - B - (25) |
| vigron, s.m. chiendent. - (38) |
| vigron. Chiendent. - (49) |
| vigrot (-e) (adj.m. ou f.) : vif (vive), vivace, éveillé (-e) - (50) |
| vigrot (e) : vigoureux, vif,vive, agile - (48) |
| vigrot : vigoureux. - (31) |
| vigròt, adj., vif, éveillé. — Se dit aussi de tout corps poli, de la glace surtout : « Allons glisser ; la glaice é ben vigròte (glissante). - (14) |
| vigrot, otte, adj. vif, vivace, éveillé. Se dit particulièrement d'un enfant alerte et gai. - (08) |
| vigrot. Abréviation patoise de vigoureux. - (13) |
| vigueriot, vigueriotte - vif et animé ; se dit des enfants. - C'te petiote feille lai â vigueriotte quemant to. - Lote petiot Nini â genti, vigueriot, révoillé. - (18) |
| vîhou : voir vrat - (23) |
| vî'ille (na) : vieille - (57) |
| vilaige, s. m., village. - (14) |
| vilain (faire) v. Se fâcher, se mettre en colère. - (63) |
| vilain (Faire) : loc, présenter un aspect déplaisant, inquiétant, menaçant, etc. On « fait vilain » quand on pleure, parfois quand on rit, souvent quand on fait les yeux doux, toujours quand on est en colère. - (20) |
| vilain (faire), locution verbale : rouspéter, protester, se fâcher. - (54) |
| vilain (le). le diable qu'on appelle encore le « peut », c’est à dire le laid. - (08) |
| vilain : Vilain. « Fare vilain » : se fâcher, se mettre en colère. « Quand ol y a savu ol a fait vilain » : quand il l'a su il s'est mis en colère. Féminin : vilain-ne. - (19) |
| Vilain n.m. Le diable. - (63) |
| vilate. : (Dial. ), bourgade. - (06) |
| vilbeurquin : villebrequin - (48) |
| vilchot (n. m.) : individu stupide (de Villechaud, village au sud de Cosne) (t'es un vieux vilchot) - (64) |
| vilège, village. - (16) |
| villaige (l mouillé), sm. village. - (17) |
| villaige (nom masculin) : hameau. - (47) |
| villaige : village - (48) |
| villaige, s. m. village. « vilaize. » - (08) |
| villaine. Une coureuse, une infâme. Les deux ll se mouillent. - (01) |
| villaize - (39) |
| villardeau, adj. rabougri, malingre, vieillot. - (22) |
| villardôt, adj. rabougri, malingre, vieillot. Féminin villardotte. - (24) |
| ville (l mouillé), sf. ville. - (17) |
| villebeurquin : villebrequin - (39) |
| villerette - vrille. - Percez moi don vouai ce bout de pliainche qui aivou lai villerette. - Prends gairde ; aivou ine villerette en ai encore beintot fait de fende le bô. - (18) |
| Villeroi. Frauçois de Neufville, maréchal, duc de Villeroi. - (01) |
| villette : s. f, Syn. de dremille. - (20) |
| vïlli v. Veiller. - (63) |
| vïllie n.f. Veillée. - (63) |
| villionie - chose de peu de valeur ; personne malpropre ou peu estimée ; injure de village. - Ce n'â ran ce que vos aichetai lai ; c'â de lai villionie. - Ile dit villionie ai sai petiote ; ce n'a pâ bein. - Ote tai don, villionie que té ! - (18) |
| villon (on) : osier - (57) |
| villon : s. m. lien dont on se sert pour attacher la vigne. - (21) |
| villon : s. m., vx fr., branchette d'osier. - (20) |
| villon, s. m. osier mince et souple. - (22) |
| villon, s. m. osier mince et souple. - (24) |
| villonire (na) : oseraie - (57) |
| villons, osiers. - (05) |
| villotin : gamin des villes - (37) |
| vilna. n. m. - Chevesne, poisson d'eau douce. - (42) |
| vilna. s. m. Poisson de rivière ressemblant à la carpe. - (10) |
| viloler, v. a. virer, tourner. - (08) |
| vilonie, vilaine chose, parole, action. - (05) |
| vilonie. Déloyauté, action basse ; vieux mot. - (03) |
| vin bourru, exp. vin nouveau. - (65) |
| vîn ci ! vin ! : interjection utilisée pour appeler les bovins - (39) |
| vin d'plosses n.m. Piquette, mauvais vin. - (63) |
| vin : s. m. Vin de table, vin ordinaire. Voir bon et bouché. - (20) |
| vin. Vins, vint. - (01) |
| vinâgre : Vinaigre. « Du vinâgre de vin », du vinaigre naturel. « Vinâgre des quat 'voleus » : vinaigre extrêmement fort. - (19) |
| vinâgre, et vignâgre, s. m., vinaigre : « J'nain-me point causer d'avou éle ; c'qu'all'vous dit, y é du vinâgre. » - (14) |
| vinaigri : (nm) récipient contenant du vinaigre - (35) |
| Vincentine : s. f., nom que certaines paroissiennes de Saint-Pierre et de Saint-Clément de Mâcon donnent à celles de Saint-Vincent. - (20) |
| vîn-ci ! vîn ! : viens-ici ! viens ! (interjection pour appeler les vaches) - (48) |
| vindicâcion, vengeance (du latin vindicare). - (16) |
| vindicatif, vindicative : adj., qui revenge. - (20) |
| vindication, s. f. vengeance. - (08) |
| vinée : cave (à vin, naturellement). Par nature, un endroit tempéré, et frais. Ex : "Par ceu chaleûre, met don ton froumage blanc dans la vinée. Ca m'est dévie qu'j'y passerint ben tout nout' temps...si j'peuvint !" (Facultatif, traduction : j'ai dans l'idée qu'on y passerait bien tout son temps, si on pouvait… sous-entendu : mais il y a l'ouvrage à faire dehors !). - (58) |
| ving (n.m.) : vin - (50) |
| ving : vin - (39) |
| vingn', s. m. vin. - (08) |
| vingn’: vin - (52) |
| vingnaigre. Vinaigre. - (01) |
| vingne, sf. vigne. - (17) |
| vingne, vigne. - (26) |
| vingron, vigron (n.m.) : chiendent (aussi grouâche) - (50) |
| vingtain-ne : vingtaine - (57) |
| viniagré : le vinaigre - (46) |
| vinier. : Gardien des vignes. (XIIIe siècle.) - (06) |
| vin-ne : veine - (43) |
| vinou (être), aimer le vin - (36) |
| vinredi: vendredi. - (29) |
| vîns don ! : viens donc ! - (37) |
| vint de r’aît’ler (ai) : (il) vient de mettre le foin en « meûches » au râteau - (37) |
| vint der’vint (ain d’) : (un) aller et retour - (37) |
| vin-ye, vieille. - (26) |
| viôlaite. Violette, violettes. Quelques Bourguignons disent viôlôte, et je ne le condamnerais pas dans la rime. Viôlaite cependant et viôlai sont de la véritable prononciation de Diion… - (01) |
| viole (n.f.) : vielle - (50) |
| viole : Vielle. « Le père Mathey nos fiait dansi tos les dimanches dave sa viôle ». Vieux refrain : « Ringningnin ma viôle. Pa gagni man pain. S'y était pas ma viôle, je craverais de faim ». - (19) |
| viole, vielle. - (05) |
| viole. n. f. - Vielle. - (42) |
| violené, s. m. joueur de vielle, de violon. - (08) |
| violer, joueur de vielle. - (05) |
| violer. v. n. Jouer sans cesse de la viole et du violon. (Montillot). - (10) |
| viôlette : Violette, viola odorata. « Viôlette à la sarpe » : pervenche, vinca minor. « Je vins de me preumener vé la fontain-ne du Cliô y a de la viôlette à la sarpe dans st 'endra, y se touche tot ». - (19) |
| violette de serpent n.f. Violette inodore. - (63) |
| violette de serpent : s. f., violette inodore. - (20) |
| violeux. s. m. Rôdeur. (Bléneau). - (10) |
| viölle, sf. vielle, viole. - (17) |
| violœ, s. m. chemin étroit, sentier. - (24) |
| violon. Criocère du lis, insecte rouge, ainsi nommé à cause du bruit doux et incessant qu'il fait, et qu'on entend en l'approchant de son oreille. - (03) |
| violoneu n.m. Violoniste. - (63) |
| violonou (on) : violoneux - (57) |
| violonou (on) : violoniste - (57) |
| violote, s.f. violette. - (38) |
| violouneu, s. m. celui qui joue du violon. - (08) |
| violouneux (-ouse) (n.m. et f.) : violoneux (-euse) - (50) |
| violouneux. n. m. - Joueur de vielle. - (42) |
| viomner (v.t.) : 1) bourdonner - 2) se déplacer à toute vitesse - (50) |
| viomnû (-use) (n.m. et f.) : celui ou celle qui joue de la vielle - (50) |
| vïon, s. f. vision, visée, vue. - (08) |
| vion, s. m. ligne tracée sur place pour partager un bois, un pré : allons faire le vion. - (22) |
| viondener : émettre un son vibrant. A - B - (41) |
| viondner : faire du bruit - (44) |
| viondner, bondner, vrondner v. Vrombir, bourdonner, marmonner Ô viondnot ! Nos arot dit un beurdon dans/un pta. Il marmonnait ! On aurait dit un bourdon dans une corolle de digitale. - (63) |
| vioné : moteur bruyant. - (66) |
| vionè : produire un bruit de bourdonnement, de ronflement - (46) |
| viôner (C.-d.), vionner, viouner (Morv.), viouner (Char.), viorner (Y.). – Onomatopée traduisant le bourdonnement des mouches, et s'appliquant principalement au ronflement de la toupie, ou au sifflement de la pierre lancée par une fronde. Dans la Bresse, pour rendre ce dernier bruit, on emploie le verbe bondener, c'est-à-dire bourdonner. - (15) |
| vioner : ronronner. (R. T IV) - Y - (25) |
| vioner : prononcer : vion-ner. Ronfler : bruit propre à un moteur (un peu poussé en régime) ou un bourdonnement d'insecte. Ex : "Quand il a passé avec sa moto, ça vion-nait !" - (58) |
| viôner. Siffler, faire le bruit du vent. Ex. : « Les balles nous vionaient autour de la tête comme des tavins ! » Etym. onomatopée. - (12) |
| vion'ne : vielle - (48) |
| vion-ne : instrument de musique, vielle - (39) |
| vionné, vn. bourdonner. Hésiter, tatillonner. Qqf. bougonner. - (17) |
| vionner : le bruit que fait un insecte près des oreilles. - (66) |
| vion-ner : ronfler, siffler - (60) |
| vionner : ronfler. (MM. T IV) - A - (25) |
| vion-ner : jouer de la musique, aller vite - (39) |
| vionner, v. n. se dit du bourdonnement des mouches, des insectes de toute espèce. On prononce vion-ner. - (08) |
| vionner, v.; faire entendre du bruit (comme un violon). - (07) |
| vion'ner, vioûner : bourdonner, aller vite, faire de la musique, vrombir - (48) |
| vion-nou (oure) : joueur de musique - (39) |
| vion'noû : musicien, joueur de musique - (48) |
| vionnou, s. m. celui qui joue de la vielle, du violon ou de tout autre instrument du même genre. - (08) |
| vionou : celui qui viône - (46) |
| vions - temps du verbe avoir. - (18) |
| vions, s. m. pl. ligne tracée sur place pour partager un bois, un pré : allons faire les vions (de vion, petit chemin (champenois, provençal). latin via, voie). - (24) |
| viorne (n.f.) : obier - appelée vauzelle en Nivernais (étym. : d'ou Vauzelle près de Nevers) - (50) |
| viorne : voir obis - (23) |
| viorne, s. f. instrument de musique. - (08) |
| viorner. v. n . Ronfler, faire du bruit en tournant. Ça viourne. — Se dit, par onomatopée, pour exprimer le ronflement produit par une chose plate, une palette de bois, par exemple, qui frappe l’air en tournant vivement sur elle-même. - (10) |
| viot. n. m. – Lie : dépôt gluant que l'on trouve dans le fond d'un verre de cidre. L'apparence du viot est si repoussante que l'on jette aussitôt le contenu du verre. (Sougères-en-Puisaye) - (42) |
| viotte, villotte, veuillotte, voyotte. s. f. Se dit des petits tas de foin faits dans les prés par les faneuses, pour servir à former les meules. (Joigny, Gy-l’Evêque, Perreuse, etc.). - (10) |
| vioules. s. f. pl. Guêtres. (Vincelottes). - (10) |
| vioùlon, s. m., violon. Qu'il soit joué bien ou mal, il fait la joie des noces et des fêtes. - (14) |
| vioûlou (on) : vielleur - (57) |
| vioùlouner, v. intr., jouer du violon. - (14) |
| vioùlouneux, s. m., joueur de violon. Indispensable à ceux qui aiment à danser. Aussi tant recherché de la jeunesse. - (14) |
| viouner (v.t.) : siffler ; faire vibrer l'air en se déplaçant - (50) |
| viouner (verbe) : tourner en rond en faisant du bruit. (Y'a eune mouche beurdine qu’eume vioune autour). - (47) |
| viouner : bourdonner - (35) |
| vioûner : jubiler - (37) |
| vioûner mâ qu’chent gueûrlons en ain beûc’on d’âcaûzet : « rouspéter » très fortement en marchant de long en large - (37) |
| viouner, grincer - (36) |
| viouner, v. n. produire un bruit vibrant et sifflant. Se dit d'une pierre lancée par une fronde, d'une toupie qui tourne, qui viounent par suite de leur mouvement rapide. - (11) |
| viouner, v. n. vibrer, siffler. - (08) |
| viouner. Ronfler ; grincer « faire viouner sa pirounelle » (sa toupie). - (49) |
| viourner, viorner, viôner. v. - Tourner, virevolter : « Il a fait viôner la jupière Léone et M Rey, le coupeur, avec une désinvolture que j'admire. » (Colette, Claudine à Paris, p.235). Mot imagé à partir de la viorne, autre nom de la clématite des haies, dont les vrilles s'enroulent autour de toutes les tiges alentour. - (42) |
| vipare (un) : vipère (une). L’inversion des genres est à remarquer. - (62) |
| vipâre, s. m., serpent. - (40) |
| vipé : vipère. IV, p. 32 - (23) |
| vipée : voir vipé - (23) |
| vipée, s. m. vipère. - (08) |
| vipeire. Vipère, vipères. - (01) |
| vipere (masc), vipère. - (27) |
| vipère (un) : une vipère - (61) |
| vipère (un) : vipère - (43) |
| vipére : Vipère. « J'ai vu remuer quéque chose dans ce bochan je sais pas si y est eune sarpe ou in vipère ». Comme on le voit, en patois contrairement à ce qui existe en français, sarpe (serpent) est du féminin et vipére du masculin. - (19) |
| vipére : n. f. Vipère. - (53) |
| vipère : s. m. Un vipère. C'est pa' un vipère, c'est une serpent. - (20) |
| vipère, n.m. vipère mais de genre masculin. - (65) |
| vipère, vpire n.m. Vipère, employé au masculin. - (63) |
| viquer : v. n., vivre. - (20) |
| viquer. v. - Vivre, dans le sens de se nourrir. (Sainpuits, selon M. Jossier) - (42) |
| viquer. v. n. Vivre, particulièrement dans le sens de se nourrir, de manger. Il faut viquer pour être fort. On vique ben cheu li. (Pasilly, Sainpuits). - (10) |
| vir’beurquien. s . m. Vilebrequin, qui vire. Ce mot, tout dénaturé qu’il est, est encore plus exact que celui admis aujourd’hui-par l’Académie. - (10) |
| vîr’vâris (dâs) : plusieurs tournants successifs - (37) |
| vira ! impérat. de virî, tourne ! Terme de marine fluviale. (V. Pire, et Riaume.) - (14) |
| viradze : virage - (51) |
| viragö, sm. tête en l'air. - (17) |
| virai, tourner; d'où est venu viro, vertige, et virago, jeune fille étourdie... - (02) |
| virai. : Tourné, traduit -Le Virgile virai est la traduction de Virgile en vers bourguignons. Le verbe patois virai vient du latin girare, tourner sur soi-même comme sur un pivot. Voyons ses diverses significations au propre comme au figuré: al é le virô, c'est-à-dire il a le vertige. Une virago est une jeune fille étourdie. - Une virolée s'entend, dans nos campagnes, d'une coquille d'escargot ou de limaisse. - (06) |
| virandiau, s. m., dévidoir, et aussi ustensile servant à envider le fil pour la pêche. - (14) |
| virandiau, s. m., jeu avec une toupie lancée à la main ; genre de loterie. - (40) |
| virandiaux : virages serrés. Généralement pluriel parce que sous-entendus « en série ». - (62) |
| virandouaises : histoires, mensonges, affabulation. O raconte des virandouaises : il raconte des histoires. - (33) |
| viravions : virages - (60) |
| virâyé, tourner longtemps, par exemple, autour d'une personne. - (16) |
| virboquin. Vilebrequin. - (49) |
| virbrekèn, vilebrequin. - (16) |
| virdagö, sm. dévidoir. - (17) |
| viré, tourner ; la tète vire dans les étourdisseinents. - (16) |
| viré, vn. tourner. Avoir le vertige. - (17) |
| viré. Tourné, tournez, tourner. - (01) |
| vireau, s. m. petit rouleau autour duquel on fixe la corde qui retient le foin sur un chariot. - (08) |
| vireau, virot (n.m.) : petit rouleau autour duquel on fixe la corde qui retient le foin sur le char - (50) |
| virebatoudèche. Pie grièche. - (03) |
| virebeurquin, s. m. vilebrequin, outil dont la mèche sert à percer des trous. - (08) |
| vireboutchin (on) : villebrequin - (57) |
| virebroquin, s. m., vilebrequin. - (14) |
| viremain : s. m., vx fr., tour de main. En un viremain il l'a foutu par terre. - (20) |
| viremain, s. m., tour de main, action rapide, le temps de tourner la main : « En eùn viremain ôl a métu l'éteûle su sa cadole. » - (14) |
| viremain. Tournemain. - (01) |
| vire-merde : s. m., bousier. Voir charraye-merde. - (20) |
| virer (Se). v. pronom. Se tourner à droite, à gauche. — Se carrer, se virer, se dit d’une femme qui, ayant bonne opinion de sa personne et de sa toilette, fait la belle en marchant, pour appeler l’attention sur elle. - (10) |
| virer (v.t.) : tourner, changer de direction - (50) |
| virer, tourner ; revirer, retourner ; devirer, détourner. - (05) |
| virer, v. a. tourner, faire un détour, aller de côté et d'autres, détourner, changer la direction de, mener dans un sens contraire. On « vire » un troupeau qui s'égare ou qui est en dommage - (08) |
| virer. Arrêter, détourner le bétail qui va brouter sur la propriété voisine. - (49) |
| virer. Au jeu, tourner la carte qui sera l’atout. - (12) |
| virer. Tourner. - (03) |
| vireroo, virerò. Tournerais, tournerait… - (01) |
| viretonton. Petite toupie que l’on fait virer avec le pouce et l'index : les Comtois lui donnent le nom de pironnelle. - (13) |
| viretonton. Petite toupie qu'on fait tourner avec les doigts; au figuré, homme sans caractère, qui tourne à tous les vents. Etym. vireton, virer. - (12) |
| virette : vrille. - (29) |
| virette. Vrille, outil de menuisier. Le verbe virer, tourner, a formé un assez grand nombre de mots. En Bourgogne, nous appelons virebrequin l'outil que le français écrit, à tort, vilebrequin. - (13) |
| vireu : étourdi après avoir dansé une valse par exemple. Les petites filles qui tournent en se donnant les deux mains, sont ensuite "virottes " ! - (66) |
| vireu : vertige. (S. T III) - D - (25) |
| vireu, virotte : la tête me tourne. - (66) |
| vireus, deux bâtons qui font manœuvrer le tour qui est à l'arrière d'une voiture pour serrer la corde qui maintient le foin ou les gerbes. Aujourd'hui on emploie une seule tige de fer à crémaillère. - (27) |
| virgo, subst. masculin : alliage nickel-chrome. - (54) |
| virgoine : viorne - (60) |
| virgouenne : voir obis - (23) |
| virgouillat n.m. Zig-zag, embardée, virage. - (63) |
| virgoya : virage. Marcher, rouler en zig-zag. A - B - (41) |
| virgoya : virage - (34) |
| virgoya : virage - (44) |
| viri : oison. (F. T IV) - Y - (25) |
| viri : Tourner, virer. « Te vires treu co, te vas varser » :tu tournes trop court, tu vas verser. - Faire revenir, détourner. « Vire dan ta vaiche, al va aller dans les maufaits ». - Riposter vertement. « Je l'ai bien viri ». - (19) |
| viri : virer - (43) |
| viri : virer - (57) |
| viri v. 1.Virer, chasser, enlever. 2. Tourner. 3. Devenir, se transformer. - (63) |
| virî, v. intr., tourner : « Arrà dou bou virî ! » Vite, et tournez ! Du vocabulaire de l'ancienne marine fluviale. - (14) |
| virie, verie (vrie) : s. f., virée, tournée, allée et venue. - (20) |
| virli (C.-d.). - On qualifie ainsi dans la Côte-d'Or les individus qui sont nos ancêtres très éloignés, ou ceux de nos descendants qui vivront dans un avenir très lointain. C'est une intéressante expression qui mériterait d'être employée dans la Bourgogne entière… - (15) |
| virli : l'arrière-grand-mère - (46) |
| virmarions*, s. m. pl. ornements en arabesques, synonyme de menat’ius. - (22) |
| virmarions, s. m. pl. zig-zags involontaires dans la marche. Ornements en arabesques : synonyme de menat'ius. - (24) |
| viro (le) : tête qui tourne. - (66) |
| virò. Vertige. Virô de virer, et virer de girare. L'Italien dit copogiro ou giracapo, anciennement capogirlo. - (01) |
| virocher, aller et venir sans but. - (05) |
| viroîment, sm. vertige. - (17) |
| virole, s.f. panaris. - (38) |
| viroler, v. a. tourner, aller en rond. « viholer, viloler. » - (08) |
| viron n.m. 1.Extrémité de champ où l'on tourne, chaintre. 2. Petite promenade ramenant à son point de départ.. - (63) |
| virondeau, s. m. tranche coupée sur la circonférence d'un pain rond. - (08) |
| vironder : tourner en dansant - (37) |
| vironder v. Tourner en rond, vagabonder. - (63) |
| vironder : v. n., tourner, faire un tour, se promener. - (20) |
| vironder. Tourner sur soi-même ou autour d'un objet quelconque. - (49) |
| virondiau : pas de danse, virage sur la route - (37) |
| virondjau : petite partie d'un champ où se propagent des mauvaises herbes, des maladies - (34) |
| virondjau n.m. et adj. Chemin envahi par les herbes, virage, tournant. Sens figuré : tracassé, soucieux. - (63) |
| virondjau. Farandole, ancienne danse, sorte de ronde. - (49) |
| virondjo : partie d'un champ où se développent les mauvaises herbes ou les maladies des cultures. A - B - (41) |
| virot - vertige. - Que c'â don malheureux ! tote nos berbis qu'ant le virot ! - I ne sai pâ ce qui ai ; çâ quemant le virot. - (18) |
| virot (mau) : mal blanc situé autour des ongles - (39) |
| virot (n.m.) : treuil de char pour fixer le chargement - (50) |
| virot : le cabestan, le treuil pour serrer le foin sur une charrette - (46) |
| virot : le vertige - (46) |
| virot : morceau de bois pour serrer la mâtre d'un chariot. - (31) |
| virot : pièce de bois sur laquelle s'enroule la corde du chariot (sorte de treuil) - (48) |
| virot : vertige. Comme « lordot ». - (62) |
| virot : morceau de bois utilisé pour serrer le contenu d'un chariot - (39) |
| virot, espèce de panaris qui tourne autour de l'ongle. - (05) |
| virot, n. masc. ; maladie qui fait tourner les agneaux. - (07) |
| viröt, öte, adj. qui a le vertige, le tournis (en parlant des moutons). - (17) |
| viròt, s. m., panaris, dit tournant ; mal blanc qui vient au bout du doigt, dont la peau s'enlève à peu près en spirale, et par conséquent vire. - (14) |
| virot, s. m., vertige. - (40) |
| virot, s.m. treuil sur les chars pour serrer les foins, pailles ou autres céréales. - (38) |
| virot, subst. masculin : étourdissement. - (54) |
| virot, virotte : étourdi, pris de vertige - (48) |
| virot. Barre horizontale enfoncée dans l'arbre des anciens pressoirs... Virot : étourdissement. A ne peut pus s'teni, an dirot qu’al ai le virot. La famille franc-comtoise de Virieu portait d’azur à trois vires ou cercles d’or. (V, Revirer.) - (13) |
| virot. s. m. Tournis.(Vassy-sous-Pisy). - (10) |
| virou : (nm) vertige - (35) |
| virou : verrat - (60) |
| vîrou : voir vrat - (23) |
| virvâches - en forme de ziguezags. - Sai robe â tote couvri de petiotes flieurs et de lignes en virvâches. - Ces sentés lai faisant des virvâches to por les champs. - A fait quemant des virvâches en mairchant. - (18) |
| virvaris, s. m. pluriel. détours, sinuosités, allées et venues obliques. Une rivière qui serpente fait de nombreux « virvaris ». - (08) |
| virvocher, v. enrouler. - (38) |
| virvouairie : n. f. Compliqué, va dans tous les sens. - (53) |
| virvoulter. v. - Virevolter. - (42) |
| vis : Vis. « In vis de pressoi ». En patois vis est masculin et l'S se prononce. - (19) |
| vis' n.m. Vis. Y'est maulaiji d'catsi les gros vis'. - (63) |
| vis, vif. - (04) |
| visâdze n.m. Visage. Peu employé, on dit surtout "figueure". - (63) |
| visai - uutre le sens ordinaire du français, ce mot a le sens dérivé de loucher. - Ce gairson lai vise ; çâ bein demaige. - Préque to les enfants visant. - Al â bein aidroit, ma al â visou. - (18) |
| visaige, s. m. visage, figure, mine. - (08) |
| visaige, s. m., visage. - (14) |
| visair, s. m. celui qui regarde de côté, de travers, un peu en dessous, en inclinant la tête. - (08) |
| visarnai, regarder au visage... - (02) |
| visarni. : Regarder en face. - (06) |
| vise-au-trou : s. f., sage-femme. Voir guette-au-trou. - (20) |
| viser : v. a., regarder. Vise-le donc. Voir aviser. - (20) |
| viseter, v. a. visiter, aller voir en visite, examiner. - (08) |
| viseygère, figure, face parfaitement en évidence. En latin, visum gerere veut dire porter le visage haut. - (02) |
| visi : viser - (57) |
| visibje, adj. visible. - (17) |
| visiére (na) : visière - (57) |
| visitier, vt. visiter. - (17) |
| visitje, sf. visite. - (17) |
| vister (faire). v. - Éjecter violemment, faire valser dans un moment d'énervement : « D'colère, il a tout fait vister pa' la cour ! » - (42) |
| vistitia, s.m. roitelet. - (38) |
| vistre. Jeu de cachette. Ce mot est commun avec d'autres régions. - (49) |
| vit' : adv. Vite. - (53) |
| vit’ment : (adv) vite - (35) |
| vit’ment : rapidement - (37) |
| vit’ment : vite - (43) |
| vite (se dépêcher), loc., redondante très usitée : « Hardi ! hardi ! dépôche-te vite! » - (14) |
| vitement : Adverbe, vivement, rapidement. - (19) |
| vitement adv. Vite, rapidement. - (63) |
| vitement. Lestement, vite. (Mot familier). - (49) |
| viteriol. Vitriol. - (49) |
| vitiesse, sf. vitesse. - (17) |
| vitir, vître, vêtir, habiller. - (05) |
| vitrat. n. f. - Fauvette à tête noire. - (42) |
| vitrat. s. m. Fauvette à tète noire. (Villeneuve-les-Genêts). - (10) |
| vitrau n.m. Vitrail. - (63) |
| vitrau : s. m., vitrail, vitre. - (20) |
| vitrau, sm. vitrail. - (17) |
| vître (v.) : vêtir, habiller - p.p. vîtu (-e) = vétu (-e) - (50) |
| vitre : vêtir - (57) |
| vitre n.m. Vitre. - (63) |
| vître, v. a. vêtir, habiller. au partic. passé « vîtu », à l'impér. « vitéz ». - (08) |
| vitrer. v. a. Vêtir. (Fresne, Sacy). - (10) |
| vitri. Vitrier. - (49) |
| vîture, s. f. vêtement, habit, pièce quelconque de l'habillement. - (08) |
| vivaice, adj. vivace. - (17) |
| vivant, part. prés, employé dans la formule invocative du « Bonjour à Mars ». Il signifie, là, l'état d'une personne éveillée. (V. Dormant.) - (14) |
| vive : vivre - (48) |
| vive v. Vivre. - (63) |
| vive, viveussains, vivu - divers temps du verbe vivre. - Al ai vivu quemant ce qui tote sai vie. - I vourâ qu’â viveussaint encore quêque années. - (18) |
| vive. Animal fabuleux vivant caché, disait-on, dans les ruines des vieux châteaux, des couvents, pour veiller sur un trésor enfoui. Cet animal ne sortait que la nuit. - (49) |
| viveuter : Vivoter. « Des mauvâses an-nées c 'ment cen an ne vit pas an viveute ». - (19) |
| vivre, vn. vivre ; pp. vicu. - (17) |
| vivre. Jeune fille ou femme résolue, opiniâtre et vive jusqu'à la pétulance… - (01) |
| vivre. : Même mot que guivre, serpent. (Voir ce vocable.).D'après Lamonnoye, le mot vivre signifie aussi jeune fille éveillée. « Lai pucelle n'étô pa de cè vivre qui vo beuille. » On disait aussi guivre, vouipre et vevre ; tous ces mots dérivent du latin vipera. - (06) |
| vivu (p.p.) : participe passé du verbe vivre - (50) |
| vivu (p.p.) : p.p. du verbe vivre - (50) |
| vivu : p. passé de « vivre » - (35) |
| vivu : vécu - (48) |
| vivu : vivre, bien vivre. Dans un bon repas on aivot bien vivu : dans un bon repas on avait bien vécu. - (33) |
| vivu part. pas. Participe passé de vive (vécu) Nos ans toudze bié vivu : on a toujours bien vécu. - (63) |
| vivu : part, pass., vécu. - (20) |
| vivu : v. t. Vivre dans le sens de « bien vivre». - (53) |
| vivu, part, du v. vivre, vécu : « Seigneur! tô l'temps qu'ôl a vivu, at-t-i été minâbe ! » - (14) |
| vivu, part, passé du verbe vivre. vécu. - (08) |
| vivu, part. passé de vivre (fr. vécu). - (40) |
| viye : la ville - si tu vè en viye, èchète me don du pain, si tu vas en ville, achète-moi donc du pain - (46) |
| viyonie, vilenie (expression de grand mépris). - (16) |
| Vizai (De). Jean d'Auneau, sieur de Vizé, premier auteur du Mercure galant, dont, pendant près de quarante années, il a donné règlement un volume par mois. Il est mort en 1710. - (01) |
| vizé, loucher, regarder obliquement. - (16) |
| vizége, visage ; dévizégé quelqu'un : lui abîmer la figure et le faire connaître pour ce qu'il est réellement. - (16) |
| vizter v. Visiter, aller en visite, examiner. - (63) |
| v'là ! prép., voilà ! « Allons, bon ! v’là qu'ô s'met à chougnier, mét'nant ! » - (14) |
| v'la : voici - (57) |
| vlà : Voici, voilà. « Ma le chaud » : voici le beau temps. « Tiens ne te vlà : couci-couci » : ni bien ni mal. « Ah ! bin c 'ment va t'y ? Oh ! y est tiens ne te vlà » : Et bien, comment ça va ? Oh couci-couci. - (19) |
| vla : voilà - (51) |
| v'là : voilà - (57) |
| vlà prép. Voilà, il y a. (Mais cette dernière locution est souvent remplacée par "y fait": y fait longtemps que dz'lu dis. Cela fait longtemps que je le lui dis). Voir woilà. - (63) |
| v'là quii pas , ne voilà-t-il pas. - (38) |
| vlà v. défect. Voilà. Voir woilà. (N.b. voilà a valeur de verbe défectif dans les expressions où il peut être remplacé par vois là ou voyez là. - (63) |
| v'là. prép. - Voilà. - (42) |
| vladze : village - (51) |
| vlâdze n.m. Village. - (63) |
| vlage : Village. « Sa maijan est tot à fait au bout du vlage ». - (19) |
| vlai (prép. ou adv.) : voici ; voilà - (50) |
| v'lai : voilà - (48) |
| v'lai : prép. et adv. Voilà. - (53) |
| vlai : voila - (39) |
| vlai, prép. voilà. - (17) |
| vlantée : volontiers - (52) |
| vlau (n.m.) : poussée, coup - (50) |
| vlau, s. m. poussée : « i va t' f... lé vlaus », je vais te donner la chasse. - (08) |
| vlauder. v. - Flâner. (Perreuse, selon M. Jossier) - (42) |
| vlauder. v. n. Flâner, vagabonder. (Perreuse). - (10) |
| vlaudeux. n. m. - Paresseux. - (42) |
| vlaudeux. s. m. Paresseux, vagabond. (Ibid.). - (10) |
| v'laux. Fessée. Ce mot s'emploie au pluriel. On dit : « donner les v'laux » pour donner la fessée. - (49) |
| V'lê : Villers-Rotin - (46) |
| vli, s. m. liseron des champs. - (08) |
| vliâ, s.m. veau. - (38) |
| vlô, vt. vouloir; pp. vlu. Voir voïllo. - (17) |
| v'loir : v. t. Vouloir. - (53) |
| v'lonté, adv. volontiers : « i l’ f'ré v'lonté », je le ferai volontiers. - (08) |
| vlontè, sf. volonté. - (17) |
| vlontö, adv. volontiers. - (17) |
| vlösse, sf. mauvais chien, cagne. Fainéant. - (17) |
| v'lous (on) : velours - (57) |
| v'louté : velouté - (57) |
| v'lu (p.p.) : participe passé du verbe vouloir = voulu - (50) |
| v'lu, part, du v. valoir, voulu. - (14) |
| v'lu, part, passé du verbe vouloir. voulu : « i n'é pâ v'lu », je n'ai pas voulu. On prononce en beaucoup de lieux « v'leu » pour « vouleu ». - (08) |
| v'n i : venir - (39) |
| v'nâgre :s. m. vinaigre. - (21) |
| v'nange : vendange. (B. T IV) - S&L - (25) |
| v'nanger : vendanger. (S. T IV) - B - (25) |
| vni (v.t. et p.p.) : venir ; venu - (50) |
| vni : venir - (51) |
| v'ni : venir - (57) |
| v'ni : venir - (48) |
| vni p.p. de vni. Venu. - (63) |
| vni rester : venir habiter - (51) |
| vni v. Venir. Y'est vni d'misère ! Ça a crû sans force, chétivement. - (63) |
| v'ni : v. i. Venir. - (53) |
| v'ni, v. n. venir. - (08) |
| v'ni', véni'. v. - Venir : « Vou' allez ben v'ni' nous vouèr pou' la Nouël! » - (42) |
| v'ni, venir ; vo vinrë, vous viendrez ; i v'ni, je vins ; i vènro, je viendrais. V'ni se dit aussi pour croître ; un enfant vèn bèn quand il croît bien ; se dit également, dans ce sens, d'un arbre, d'une plante. - (16) |
| v'niant : venant - (57) |
| vnin, vn. venir ; pp. vnun. loc. adv. en venant, en tirant à soi. - (17) |
| v'nouaingé : v. t. Vendanger. - (53) |
| v'nue : venue - (57) |
| vô : voir. - (66) |
| vo : vous - (48) |
| vô : pron. pers. Vous. - (53) |
| vô, adv. [voir, voire]. vraiment. Donc. Explétif souvent employé. El a vô iage, il est vraiment aisé. J’m’étonne vô si té chöse se feré, je m'étonne voire si telle chose se fera. Vé vô icin, viens voire ici. Marche vô [s. ent. po vô], comme tu te tés, bé marche donc [pour voir], comme tu te tiens bien. (Ellipse de po vô (videre) provoquée par la proximité de l'homonyme vô (vere). - (17) |
| vô, voi, sf. voix. - (17) |
| vo, vos, vaus, vôs, v’ (pron. pers. 2ème pers. du pl.) : vous v' pour l'élision - ex. : ch’v’ez = si vous avez - (50) |
| vô, vt. voir. - (17) |
| vo. Vous. Vo devant une consone, vos devant une voyelle : vo vené, vous venez ; vos allé, vous allez. Vo est aussi le pluriel de votre : va bontai, mais il faut vos devant une voyelle ; vos aimor, vos amours. - (01) |
| voai (une), loc. une fois : il y avait une voai... - (24) |
| voai, comme quand on dit : Faite voai, dite voai, c'est un adoucissement à ces deux impératifs, qui auraient quelque chose de dur sans cette interjection… - (01) |
| voaissali, s. m. buffet-vaisselier. - (24) |
| voce, vouéce, s. f. vesce, légumineuse peu cultivée dans le mais assez répandue dans la région bourguignonne. - (08) |
| vocin, prép. voici. - (17) |
| vodiuron, sm. verduron, fruits verts, herbes acides. - (17) |
| vodret, s. m. lézard vert. environ d'Avallon. - (08) |
| voé, voir ; voéyon-voé, nous allons voir, examinons ; voéyon-voé se dit aussi à un enfant, pour : vas-tu obéir ? Voyons-voir est une locution très en usage, même parmi les lettrés. - (16) |
| vœgne, s. f. vigne. - (22) |
| vœgne, s. f. vigne. - (24) |
| vœgneron, s. m. 1. Vigneron, spécialement celui travaillant la vigne d'autrui à moitié fruit. — 2. Oiseau qui, autrefois, faisait son nid dans les ceps de vigne. - (22) |
| vœgneron, s. m. 1. vigneron, spécialement celui travaillant la vigne d'autrui à moitié fruit. — 2. Oiseau qui, autrefois, faisait son nid dans les ceps de vigne. - (24) |
| voéki, voici; l'vovki, le voici. - (16) |
| voélà, voélâ don ! hélas, hélas donc ! voilà don exprime une plus forte douleur que voilà ! - (16) |
| vœllyes, s. f. pl. bal de noces, la nuit : de jolies vœllyes. - (24) |
| vœllyes, s. f. pl. bal de noces, la nuit : de jolies vœllyes. - (22) |
| vœrdat, s. m. gros lézart vert. - (24) |
| vœrdelin, adj. à moitié mûr, encore un peu vert. - (22) |
| vœrdelin, adj. à moitié mûr, encore un peu vert. - (24) |
| vœrdoeuye, s. m. gros lézard vert. - (22) |
| vœrgain, s. m. regain roulé au râteau dans le pré. Verbe : vœrguœné. - (22) |
| vœrteau, ou vé, s. m. ver. Vœrtalé, vermoulu. - (22) |
| vœusche de loup : n. f. Lycoperdon, vesse de loup. - (53) |
| voève, vouève (n.f.) : veuve - (50) |
| vœzé, v. n. se déplacer avec grande vitesse : il vœze. - (22) |
| vogin, sm. voisin. - (17) |
| vogingne, sf. voisine. - (17) |
| voginöge, voginaige, sm. voisinage. - (17) |
| vogne - veine. - A n'é point de sang dans les vognes. - Ah ! vos é de lai vogne, vo ! - (18) |
| vogrer : égrainer. Le vogrou est l’égrainoir. - (62) |
| vogrer, v. tr., écosser, égrener : « A c'maitin, j'ai vogré des pois ; à c'tu souér, j'vous vogrer l'troquet cheû l'pâre Toumas. » - (14) |
| vogrer. Égrener. - (03) |
| vogue, n.f. fête patronale. - (65) |
| vogue, s. f., fête populaire dans un village. On dit volontiers tout simplement : « Vons à la fête, vons à la fouére (la foire de Ciel, etc.). » - (14) |
| voguettes : rames. (PSS. T II) - B - (25) |
| voi ou voire : Vrai. « Mâ est-y voi ?- Oh y est bien voire » : mais est-ce vrai ? - Oh c'est bien vrai. - (19) |
| voi, voir... - (02) |
| voi, vueve, veuf, veuve, voif, voive. - (04) |
| voi. Voix, vox. C'est aussi le singulier des trois personnes de voir à l'indicatif. Item l'impératif et l'infinitif du même verbe ; et enfin un cri, dont la véritable prononciation est vouai, qui sert àexprimer quelque sentiment de douleur… - (01) |
| voi. : Adverbe répondant à l'adverbe latin scilicet. « Al é demandé voi si j'aito contan de celai. » Voi répond ici au latin verum : voyez voir, c'est la traduction littérale de vide verum. Il y a aussi le verbe voi (voir), qui fait au participe présent voisant et au participe passé voisu. - (06) |
| voïage, sm. voyage. - (17) |
| voibin, exclamation, « eh bien ! » - (40) |
| voicher, v. ; verser. - (07) |
| voici, voilà. Actuellement, maintenant, au moment où l’on parle. Ex. : « Ou donc allez-vous, comme voici ? » « Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il va faire, comme voilà ? » - (12) |
| voie, voe, sf. voix. - (17) |
| voigne, vouégne, s. f. veine : « ôvri lai voigne », saigner. - (08) |
| voijînner : fréquenter assidûment les voisins - (37) |
| voilette : s. f., volette. - (20) |
| vöill, lie, adj. vieil, vieille. - (17) |
| voille - veille. - Venez deû lai voille, cair en yé ai préparai. - C'â lai voille de Nouée en fait maigre. - (18) |
| voille (Il mouillées). s. f. Tue-chien, plante à belle-fleur d’un bleu rosé, qui vient dans les prés et dont la racine est, dit-on, mortelle pour les chiens. (Puysaie). - (10) |
| voille, s.f. veille. - (38) |
| voïlle, sf. veille. - (17) |
| voïllé, vn. veiller. - (17) |
| voille, vouéille, s. f. veille avec la même signifie, qu'en français. - (08) |
| voïllée, sf. veillée. - (17) |
| voiller, v. intr., veiller, faire la voillie. - (14) |
| voiller, v. veiller. - (38) |
| voiller, vouéiller, v. a. veiller, passer la soirée ou la nuit sans se coucher, en partie de plaisir ou pour travailler, surveiller. se dit absolument pour garder un malade. - (08) |
| vöillerie, sf. vieillerie. - (17) |
| voillerotte, s. f., colchique des prés. - (40) |
| voillerotte. C'est le colchique d'automne, cette fleur pâle et empoisonnée qui croit dans les prés et annonce les veillées d'hiver. - (13) |
| voilles, veillettes, colchique. - (05) |
| voillie, s. f., veillée. Un des délassements les plus goûtés du village. C'est là que les amoureux se donnent carrière. Une bonne femme du pays appelait ces réunions des « nids à mariages ». - (14) |
| voîllie, veûillie n.f. Liseron. Voir aveilli. - (63) |
| voillie, voillée. n. f. - Veillée. - (42) |
| voillie, vouéillie, s. f. veillée, assemblée nocturne. La « voillie » morvandelle comme l'escraigne bourguignonne réunit toutes les bonnes langues du village ou du hameau. - (08) |
| voillie. s. f. Veillée. (Courgis, Puysaie). - (10) |
| voïllô (ŏ), vn. valoir. - (17) |
| voïllô (ō), vt. vouloir. Voir vlô. - (17) |
| voillotte, s.f. crocus. - (38) |
| voillou, -ouse, s. veilleur, veilleuse. - (38) |
| voilloûse, s. f., fleur d'automne (Colchicum autumnale), nommée « veilleuse » parce qu'elle fleurit à l'époque des veillées. Femme qui veille les malades. Petite lampe de nuit. - (14) |
| voillouse, vouéillouse, s. f. veilleuse, femme chargée de veiller auprès des malades ou des morts. - (08) |
| voillouse. Veilleuse, fleur d'automne, colchicum autumnale, ainsi nommée parce qu'on commence les veillées à l'époque où elle fleurit. - (03) |
| voine, veine. - (05) |
| voingeance, s. f. vengeance. - (08) |
| voinger, v. a. venger, tirer vengeance. - (08) |
| voingner, v. n. se dit des animaux, cheval, mulet, âne, etc., qui lèvent le derrière en se jouant. - (08) |
| voiqui - voici. - Voiqui l'hyver qui veine, et pu i n'ons dière de bô. - Deupeu hier, ç'â prôt, teins voiqui. - Voiqui ârré !! - (18) |
| voiqui, prép. voici : « voiqui mai fon-n', voiqui mai gaimine », voici ma femme, voici ma fille. - (08) |
| voiqui, vouchi (prép. et adv.) : voici - (50) |
| voir (S'en) : loc, éprouver des difficultés, des ennuis, des malheurs. Ahl c' que j' m'en suis vu avec ces gens-là, c'est rien de l’ dire ! - (20) |
| voir : S'ajoute souvent à « dan » pour renforcer une injonction, on a ainsi : « Finis ! Finis dan Finis dan voir ! ». - (19) |
| voir. Petit mot qui ne veut rien dire du tout ; nous l’ajoutons pour fortifier la phrase. Ex. : « Regardez voir un peu où nous en sommes. » « Voyons donc voir que je voie si je verrais avec vos lunettes ! » - (12) |
| voirai. Verrai. - (01) |
| voire et vos. Cet adverbe n'est employé que dans la locution beaunoise voyons voire... - (13) |
| voire, vraiment. - (04) |
| voireman. Vraiment. Voyez voai. - (01) |
| voirge, s. f. verge, menus brins de bouleau. « voirze. » - (08) |
| voirgée, s. f. la quantité d'épis répandue sur l'aire pour être battue par la « voirge » du fléau. - (08) |
| voirje : fouet. - (29) |
| voirlou. Dans le Châtillonnais, on dit encore aujourd'hui : crier comme un voirlou. Il faudrait dire : crier comme un harlou, vieille expression forgée à l'aide du mot breton harz, qui signifie obstacle. Les Bretons disaient : harz ar bleiz, obstacle au loup, c.-à-d. haro sur le loup, courez sur le loup, barrez le passage au loup... - (02) |
| voirò. Verrais, verrait. - (01) |
| voirray, verrai. - (04) |
| voiseux (rat). Le loir ou le lérot, se dit des gens maigres, malingres. Etym. inconnue. - (12) |
| voisinal : adj., vicinal, limitrophe. Chemin voisinal. - (20) |
| voisous. : (Dial. et pat.) Ce mot a différents sens selon qu'il vient soit du verbe voisier ou vezier (d'où l'adjectif boisdie, du latin versutia, artifice), soit d'un autre verbe voiser. (Du latin vadere, courir, errer.) - Dans la première acception,voisous au cas sujet et voiseor, voiseur au cas régime, signifient trompeur, artificieux. - (06) |
| voissali*, s. m. buffet-vaisselier. - (22) |
| voiteûre, s. f., voiture. - (14) |
| voiteure, voiture. - (05) |
| voiteûrei, s. m., voiturier, messager d'un point à un autre. - (14) |
| voitte (Ah). - exclamation dans le sens de bâte, ah bate. - Al â capâbe de veni vos chercher... Ah voitte ! - Voiqui quemant ci doit éte, teins… Ah voitte. – Vos n'y éte pâ du to. Sens de négation. - (18) |
| voiturey, voiturier. - (16) |
| voive- veuve. - Voilai lai pôve Lisabeth qu'à voive ; bein jeune encore. - Voive et pu se remairiai, ç'â aissez chanceux. - (18) |
| voive, veuf, veuve. - (05) |
| voive. s. f. Veuve. (Ménades). - (10) |
| voive. Veuve. - (03) |
| voivre : regain, deuxième coupe de foin - (43) |
| voiyé, veiller ; voiyë, veillée. - (16) |
| voiyie : veillée. - (29) |
| vôl : (nm) valet de ferme - (35) |
| vola : vouloir - (43) |
| vola : vouloir - (51) |
| vôla : s. m. domestique de ferme. - (21) |
| volage. adj. - Farouche, vif, nerveux, en parlant d'un animal. - (42) |
| volai. : Vouloir ; futur du dialecte il vorront, futur du patois ai vorron. « Enseure (suivre) me vorront. » (S. B.) - (06) |
| volan (le) : faucille pour couper les orties ou le colza - (43) |
| volan (n.m.) : serpe (aussi volin) - (50) |
| vôlan : (nm) grande faucille - (35) |
| volan : grande faucille. Permet de former en javelles ce qui a été coupé par le faucheur. Du gaulois volamno. - (62) |
| vôlan, grande faucille, sans dent. - (16) |
| volant : Faucille à lame coupante qui a remplacé la faucille à lame dentée qu'on utilisait naguère. - (19) |
| volant : sorte de serpe à long manche pour tailler les haies (goujard) - (60) |
| volant n.m. Grande faucille à lame large utilisée pour couper l'herbe. Il ne faut pas la confondre avec la faucille à lame étroite utilisée pour moissonner, la fauçeuille, qui est fauçeuillie ou beurtsie (c'est-à-dire affûtée dent par dent). - (63) |
| volant : n. f. Serpe à long manche pour élaguer, en forme de croissant, différent du goujard. - (53) |
| volant : s. m. faucille. - (21) |
| volant : s. m., faucille à couper le blé. - (20) |
| volant, n.m. outil à lame ronde (grande faucille, croissant pour couper les haies). - (65) |
| volant, s. m. faucille. - (24) |
| volant, s. m., espèce de faucille aiguisée et battue comme la faux et longuement emmanchée, qui sert à moissonner. La faucille au contraire est à dents. - (11) |
| vòlant, s. m., faucille qui n'est pas dentée en scie. On appelle diâbe vòlant un enfant dont on ne peut venir à bout. - (14) |
| volant. Faucille. - (03) |
| volatille, sm. volatile. - (17) |
| volâyé*, v. n. moduler une espèce de tyrolienne, spéciale aux petits bergers. - (22) |
| volàyer, v. n. moduler une espèce de tyrolienne spéciale aux petits bergers ou petits « vaulœs ». - (24) |
| volé (è lè) : (loc. adv.) en dégringolant de quelque chose, en bas. - (45) |
| vòle, adj. léger; se dit d'un terrain lorsqu'il est bien ameubli. - (24) |
| vôle, mensère : commis de ferme - (43) |
| völé, vt. n. voler. - (17) |
| volée (ai lai), loc. en bas, en descendant. (voir : vaulée.) - (08) |
| volée, donner une volée, c.-à-d. battre quelqu'un... - (02) |
| voleille : Volaille. « Y est en Brache qu’on troue les maïllos voleilles ». - (19) |
| vôleille : n. f. Volaille. - (53) |
| voleilli : v. pousser le cri des bergers. - (21) |
| volein. Volions, voliez, volaient. - (01) |
| vôler, v. intr., voler, dans l'air, et aussi dans les poches. - (14) |
| voleû : un voleur - (46) |
| voleux : Voleur. « Stu que n'a ren n'a pas peu des voleux ». « Voleux de pain » : paresseux qui ne gagne pas le pain qu'il mange. - (19) |
| voleux, vouleux. n. m. - Voleur. - (42) |
| voleux. Voleur. - (49) |
| volie, sf. volée. - (17) |
| vôliée : Liseron, convolvulus arvensis. « Ces bliés sant cousus de vôliée » : ces blés sont envahis par les liserons, ils sont comme cousus au sol par les liserons. - (19) |
| voliée peunarde : Grand liseron des haies, à fleurs blanches, à rhizomes et à odeur désagréable. Voir peuna. - (19) |
| volin, s. m. venin, poison. On dit : prenez garde, cette herbe porte « volin », pour : cette herbe est vénéneuse. - (08) |
| volin, volant. Grande faucille sans dent. - (49) |
| volisse, s. f. volige, planche très mince de bois blanc qu'on emploie à divers usages. - (08) |
| volisse. s. f. Fraude, tromperie. (Etais). - (10) |
| vollant, faucille. - (05) |
| vollée (ai lai) - en bas, par terre. - Note petiot â choué ai lai voilée de son lé. - Aivan de vos en ailai vos jeterâs du fouin ai lai voilée du fenau. - (18) |
| vôlo, vâlo, valet, domestique. - (16) |
| volo. Domestique. - (03) |
| vòloir, et vòlouér, v. tr., vouloir : « Eh ! pardine ! Je v'lons ben. V'lez-ti, vous ? » - (14) |
| volontée, adv. ; volontiers. - (07) |
| vôlot (on) : serviteur - (57) |
| vôlot (on) : valet - (57) |
| vòlot, s. m., volet, fermeture de fenêtre. - (14) |
| volot, valet, domestique. - (05) |
| vòlot, vaulot, et vàlot, s. m., valet, domestique : « Dis c'que t' voudras, je l't'rai point ; j'sis pas ton vòlot. » Dans une tout autre acception du mot que l'on vient de citer, on dit parfois aux enfants, comme terme d'amitié caressante : « Mon vòlot. » - (14) |
| volou : (nm) voleur - (35) |
| voltigi : voltiger - (57) |
| voltigi : Voltiger. «J'ai vu voltigi des papiôles » : j'ai vu voltiger des flocons de neige. - (19) |
| voluche (Rate). Chauve-souris. - (03) |
| volume : s. m., embarras. Faire du volume, faire des embarras. - (20) |
| volumineux, volumineuse : adj., qui fait du volume. - (20) |
| volverie (volv'rie), volveroye (volveroïe) : vx fr. volver (v. n.), s. f., prétentaine. Courir la volverie. - (20) |
| voma : bientôt. Ex : « voma, les jornées seront pu cortes ». (RDC. T III) (C. T IV) - A - (25) |
| vômi (ò très ouvert), vt. vomir. - (17) |
| vonge (nom masculin) : instrument tranchant pour émonder les haies. - (47) |
| vonge : n. m. Vouge, outil pour élaguer les branches. - (53) |
| vonge, s. m. vouge, instrument dont on se sert pour élaguer, émonder ou « plesser » les haies vives. - (08) |
| vonnai, e, adj. fatigué à l'excès, exténué. - (08) |
| vons, 1re pers. pl. du prés, du v. aller, allons : « J’vons bon train, bé seùr ; mâ n'a pas pouë, le ch'vau sait son afâre. » - (14) |
| vont' (adjectif) : votre. - (47) |
| vor - dret vor - din vor - vor mouait'nant : maintenant - (57) |
| vor (de) : vert (e) - (39) |
| vor, vorde, adj. vert, verte. suivant les localités « var, varte ; ver, verde ; vor, vorde. » - (08) |
| vorace n. et adj. Glouton, goinfre. - (63) |
| vôrai, s. m. verrat, porc mâle. « vôra. - (08) |
| vorâille, subst. féminin : matériel, outillage. - (54) |
| vorâiller, verbe intransitif : travailler dur. - (54) |
| vorâillou, subst. masculin : personne qui travaille sans arrêt ou débrouillard, bricoleur, qui tire parti de tout. - (54) |
| voraire ou vouairère, vitre, fenêtre, croisée... - (02) |
| vorat : verrat. On meno les treues au vorat : on mène les truies au verrat. - (33) |
| vorât : mâle du porc, outil pour faire les cordes - (39) |
| vorchères, s. f. pl., terres, faciles à cultiver, (rapproché par étymologie populaire de revorcher, retourner à la bêche). - (40) |
| vord, au féminin vorde, vert, verte... - (02) |
| vord, vorde. : Vert, verte (du latin viride). On voit que le patois a mieux conservé que le français (vert, verte) les formes de la descendance latine. - (06) |
| vordeure (n.f.) : verdure - (50) |
| vordillon, s. m. gros morceau de pain, de bois, etc. - (08) |
| vòre, adv. maintenant : vòre qu'on est arrivé (du vieux français or). - (24) |
| vôre. Verre. Varre est plus usité à Dijon que vore, qui est de Chatillon-sur-Seine. - (01) |
| voreillé : v. t. Essayer plusieurs fois en vain. - (53) |
| vorein. Voudrions, Voudriez, voudraient. - (01) |
| voreire. : Fenêtre vitrée, verrière. - (06) |
| voret : voir vrat - (23) |
| voret, vret, varet. Verrat. - (49) |
| vorge ou vorgine : Espèce d'osier qui croît spontanément au bord des rivières. - (19) |
| vorge, sf. verge. Plante commune (solidago virga aurea). - (17) |
| vorge. s. f. Fouet. (Argentenay). - (10) |
| vorgeon. s. m. Manche de fouet, de ligne à pêcher. (Auxerre, Festigny). - (10) |
| vorger. v. a. Fouetter, battre avec un fouet. (Argentenay). - (10) |
| vorgiller, v. se dit lorsque le liquide sortant d'un robinet coule en hélice, c'est-à-dire mal. - (38) |
| vorgine : osier sauvage. Petit saule croissant au bord des rivières. - (62) |
| vorgine, s. f., branche de saule, d'osier, baguette : « Si te r'veins trop târ ; ta meire prendra eùne vorgine por te fouailler.» Diminutif de vorge, peu usité. — C'est également la branche que coupent les enfants pour y tailler un seùillòt. (V. ce dernier mot.) - (14) |
| vorgine, vourgine, vregine : s. f., rejet de saule ou d'osier qui pousse spontanément dans les lieux bas et humides. - (20) |
| vorgines : buissons au bord de l’eau. (VSLD. T II) - S&L - (25) |
| vorgines, s. f. pl., rameaux de saule des rivières ou des étangs. - (40) |
| vori, vouri. s. m. Oison. (Saligny, Villeneuve-la-Dondagre). - (10) |
| vormine, vormeune, s. f. se dit non-seulement des insectes, des vers, des animaux malpropres de tout genre, mais encore de toutes les bêtes nuisibles, des oies, des belettes, des fouines, des lapins, etc. - (08) |
| vorò. Voudrais, voudrait. - (01) |
| voron. Voudrons, voudront. - (01) |
| vorot - verrou. - Vos fermerâs bein lai porte à vorot. - Voiqui lai neu vai tirai le vorot. - (18) |
| vòrou, s. m., verrou. (V. Varò.) - (14) |
| vorout : verrou. - (33) |
| vorpit : fausse maille permettant d'allonger la flèche d'un chariot pour transporter des grumes. - (33) |
| vorrait (n.m.) : verrat - (50) |
| vorrat : verrat (porc mâle) - (48) |
| vorriller. v. a. Verrouiller. Vorrille ben la porte. (Etivey). - (10) |
| vorru. s. m. Verrou. (Annay-la-Gôte). - (10) |
| vorsai : verser. O l'é vorsé la remorque : il a versé la remorque. Vorse à bouère : verse à boire. - (33) |
| vorse, s. f. verse : « lai pleue ô chouée ai vorse », la pluie est tombée à verse ; « lai vorse » des blés, des herbes. - (08) |
| vorser : verser - (48) |
| vorser : verser. - (52) |
| vorser : verser - (39) |
| vorser, v. a. renverser, jeter par terre : les blés sont « vorsés. » « vosser » - (08) |
| vorsiôle, vorsôle : qui verse facilement - (48) |
| vorsôle - (39) |
| vortaille: Gros tortillon de foin qu'on roule avec soin et qui forme l'angle de la masse de foin qu'on charge sur un char. - (19) |
| vorteille : s. f. tampon de foin appliqué aux quatre coins de la voiture. - (21) |
| vorteiller (se) : se rouler. - (31) |
| vorteiller, v. a. tordre, tortiller. - (08) |
| vorteiller, v. tr. , rouler (quelqu'un) par terre, sur l'herbe, le battre : « Si te m'dis quête chouse, j'te vorteille dans l'pré. » A la forme réfléchie : « Ô s’vorteille sur les meûles. » - (14) |
| vorteiller. Se replier, se rouler comme un serpent blessé. Aittends, galopin ! i vâs te fâre vorteiller quemant celai dans lai luzarne. On dit aussi feurteiller. Ces mots sont des formes du français frétiller... - (13) |
| vorteillerie, s. f., ce qui est traîné, sali, maculé. Par analogie, les gens qui ne se respectent pas, qui se traînent dans le vice ou la débauche : « Que c'qu' yé que c'qui ? Y é d'la vrâ vorteillerie ! » - (14) |
| vorteilli : v. 1° enrouler. 2° faire du mauvais travail. - (21) |
| vorteillon, s. m. rondin de bois, petite bûchette arrondie comme une bobine. - (08) |
| vorvelle, s.f. pièce de serrure. - (38) |
| vos : vous - (43) |
| vos : vous - (51) |
| vos : Vous. « Tot cen est à vos » : tout cela est à vous. « Vos êtes bien genti » (l'S se lie) : vous êtes bien aimable. - (19) |
| vos, pr. pers. vous. - (17) |
| vôs, pron. pers., vous : « Vôs v'lez v'nî. » - (14) |
| vos. Voyez vo. - (01) |
| vosce (n. f.) : vesce (t'es yé coumme un faix d'vosces (tu es mal fagoté)) - (64) |
| vosce (n.f.) : vesce - (50) |
| vosce de loup : vesse-de-loup, lycoperdon. - (33) |
| vosces. n. f. pl. - Vesces. - (42) |
| voshe : vesse. Par exemple vesse-de-loup, le lycoperdon. - (62) |
| vossai - vesser. - Que ces gens lai sont don sales ! A potant, â vossant sans geingne !... Et pu no, qui n'osons ai pogne dire ! - (18) |
| vosse - vesces (outre le sens relatif à l'article qui précède). - Les Renaud ant dan lai couteûre in joli champ de vosses. - C'â d'in bon profit les vosses ma voiqui, çâ demande encore in terrain que lô conveune. - (18) |
| vosse de loup. Sorte de champignon vénéneux; nom scientifique, lycoperdon, qui a le même sens. - (03) |
| vosse : vesce - (39) |
| vosse, s. f., explosion comprimée et muette, vesse. - (14) |
| vosse, sf. vesce. - (17) |
| vosse-de-loû, s. f. , champignon vénéneux, et mal odorant. - (14) |
| vosser, v. intr., vesser. Ne commentons pas. - (14) |
| vosses : vesces - (48) |
| vossou. Vagabond déguenillé et malpropre. Cet ignoble qualificatif dérive évidemment de vesse. Rappelons, à ce sujet, que la vesse de loup est un petit champignon vénéneux qui croît dans les pâquiers. - (13) |
| vos-tés adj. poss. Vos. - (63) |
| vot : adj. poss. Votre. - (53) |
| vote - votre. - Vote maillon ; vote prai ; vote chaipais. - (18) |
| vôte (le, lai), vôtes (les) : vôtre (le, la), vôtres (les) - (48) |
| vote (vôte) : s. f., vx fr. volte, volute, enroulement ; terme de batellerie, enroulement d'une amarre autour d'un plot. Faire vote, donner vote, amarrer. - (20) |
| voté : (adj possessif) vos - (35) |
| vote : votre - (48) |
| vôte : Voûte. « La vôte du fo » : la voûte du four. - (19) |
| vote, voton : votre - (43) |
| vote, vôtre ; on dit aussi : veute. - (16) |
| vote, voute adj. poss. Votre. - (63) |
| vôte, voûte adj. poss. Vôtre. - (63) |
| vote. Votre. Voyez note. - (01) |
| vôtement, mot nouveau introduit par le suffrage universel, ce qui prouve en passant que l'idiome morvandeau n'est jamais au dépourvu pour exprimer les choses nouvelles s'emploie de préférence au pluriel, les vôtements, pour signifier les élections. - (11) |
| vôter : Voûter. « Eune cave bien vôtée ». - (19) |
| votés : vos - (51) |
| vôti. Volai, volas, vola. - (01) |
| votiure, sf. voiture. - (17) |
| votiurier, sm. voiturier. - (17) |
| votre, s.f. morceau de lard dont la couenne est importante et dont on se sert pour graisser la scie. - (38) |
| votyure, voiture. - (26) |
| voù - où. - Voù que te vâs don quemant ce qui, deû le maitin ? - Voù qu'an faut mette ce qui ? - C'est une abréviation de Lai-vou. - (18) |
| vou (voû) : adv., où. - (20) |
| vou : où. IV, p. 2-3 - (23) |
| voù c'à-t-i qu'ôl é? loc, où est-il ? littéralement : où c'est-il qu'il est? — Dans les conversations, cette redondance du « c'est-il que » revient très fréquemment. (V. le mot suivant.) - (14) |
| voù 'c'que ? loc., contraction de voù c'â-t-i que : « Voù 'c^que t'as été ? Voù’c'que c'est ? » — On a pu voir écrit oùsque, plus court, mais moins correct. (V. le mot précédent.) - (14) |
| vou, adv. [ubi]. où. Généralement employé précédé de la : Lavou. Voir u et va. - (17) |
| voù, adv. de lieu, oùi : « Là voù donc qu'te vas ? » — « Là voû qu'c'est, c't endrèt ? » - (14) |
| vou, conj. [aut]. ou. Vou bé, ou bien. - (17) |
| vou, conj. altern. ou : « eune vou deusse », une ou deux. - (08) |
| vou, conj. alternat., ou, ou bien. - (14) |
| vou, où ; la vou, même signification. - (16) |
| voû, s. m. jouet d'enfant, espèce de petite planchette que l'on fait tourner rapidement à l'aide d'une ficelle. Lorsque le joujou est lancé avec force, le mouvement de rotation produit un bruit semblable à celui du vent. - (08) |
| voù. Où, adverbe de lieu. Je me trôve bé voù je seù, je me trouve bien où je suis. Voù a-t’i ? où est-il ? Voù a-t’i alai ? où est-il allé ?... - (01) |
| vouâ (v.t.) : voir - (50) |
| vouâ, v. a. voir : « i vé voua ç'lai », je vais voir cela. - (08) |
| vouache : s. f. sorte de vesce sauvage qui étouffe les blés. - (21) |
| vouah ! excl., bah ! ah bien oui ! — Se jette également comme cri de douleur: « Ah ! vouah ! que coup ! J'n'en poux pus ! » - (14) |
| vouâh ! vouais ! Pour Ouais ! - (12) |
| vouah. Exclamation de douleur. - (03) |
| vouai : n. m. Oui. - (53) |
| vouaice, s. f. pie, oiseau que la plus grande partie de la région nomme « agasse. » - (08) |
| vouaîe (aine) : (une) oie - (37) |
| vouaîe (na) : voie - (57) |
| vouaie potoche (aine) : (une) oie de la race la plus bête des oies - (37) |
| vouaif : n. m. Veuf. - (53) |
| vouaîle (na) : voile - (57) |
| vouaîle (on) : voile - (57) |
| vouaîler : voiler - (57) |
| vouaîlette (na) : voilette - (57) |
| vouaîlier (on) : voilier - (57) |
| vouaille, adv., exclamatif. - (40) |
| vouaillenai : se promener. (C. T IV) - A - (25) |
| vouâillon – mot de mécontentement, de mépris, adressé ordinairement aux femmes ; quelquefois aux petites filles par leurs mères. - Ceute fonne lai çâ ine vouâillon. – Ah ! petiote vouâillon ! aitend ! aitend ! - (18) |
| vouaill'rote : n. f. Colchique. - (53) |
| vouaîlure (na) : voilure - (57) |
| vouain-ne : Veine. « Ol a du sang de raive dans les vouain-nes » : il a du sang de râve dans les veines, il est mou. - (19) |
| vouaiqui : prép. et adv. Voilà que, voilà qui. - (53) |
| vouair : voir - (57) |
| vouair, voué : v. t. Voir. - (53) |
| vouaire : voire - (57) |
| vouaîrie (na) : voirie - (57) |
| vouais ou vouâ - exclamation de surprise, de fatigue. – Vouais ! le voiqui qu'à veint déji, et i ne seû pâ prau ! – Voua ! i n'en peu pu ! - (18) |
| vouaisin (n.m.) : voisin - (50) |
| vouaisin (on) : voisin - (57) |
| vouaisinage (on) : voisinage - (57) |
| vouais-ne, s.f. veine. - (38) |
| vouaisrâ, vouaisraint - divers temps du verbe voir. – Te vouaisrâ, vais, mon gairson, si t'y étâ. - Qu'à veune ; â vouaisrain si çâ pou rire. - Si vos vivains encore quéque temps, vous vouaisrain qu’â serant héroux. - (18) |
| vouaisse (na) : vesce - (57) |
| vouaite (d’lai) : (de l’) ouate - (37) |
| vouaiterier (on) : voiturier - (57) |
| vouaiteure (n.f.) : voiture - (50) |
| vouaiteure (na) : voiturage - (57) |
| vouaiteure (na) : voiture - (57) |
| vouaiteûre ai hardes (lai) : (la) voiture à deux roues, à timon fixe, à barreaux épointés au sommet pour transporter du bois coupé, des fagots, du foin, des céréales etc… - (37) |
| vouaiteurer : voiturer - (57) |
| vouaitt’ ! (âh) : (ah) non ! penses-tu ! ouiche ! - (37) |
| vouaitte (d’lai) : (de la) ouate - (37) |
| vouaiture : n. f. Voiture. - (53) |
| vouaiv' : n. f. Veuve. - (53) |
| vouaix (n.f.) : voix - (50) |
| vouaîx (na) : voix - (57) |
| vouaiyée (lai) : (la) veillée - (37) |
| vouaiyer : veiller - (37) |
| vouaiz'ner : voisiner - (57) |
| vouarme, s. m., sapin femelle. - (14) |
| vouasse (pour ouasse). s. f. Pie. (Bessy). - (10) |
| vouasser (pour ouasser). v. n. Faire comme l’ouasse, le corbeau, la pie, jacasser, japper, crier. (Coulours). - (10) |
| vou'ate : mais non - (48) |
| vouate : Ouate. « Faut li mentre d'la vouate su l'estomac ». - (19) |
| vouate : Ouiche. « Ah ! vouate ! » : Ah ouiche ! - (19) |
| vouate, s. f., ouate. - (14) |
| vouave : Veuf, veuve. « Ol âme bien sa fane, ol a bien peu qu'alle vene vouave ». - (19) |
| Vouavre, Ves-vre (la), personne ou être fabuleux qui hante les abords des vieux châteaux. - (38) |
| vouayage (on) : voyage - (57) |
| vouayageou (on) : voyageur - (57) |
| vouayagi : voyager - (57) |
| vouayance (na) : voyance - (57) |
| vouayant (on) : voyant - (57) |
| vouayg'ner : 1 v. i. Baguenauder. - 2 v. i. Bavarder. - (53) |
| vouayou (on) : voyou - (57) |
| voûchi ! (ai lai) : (il n’a pas) éclaté (en parlant d’un pétard) - (37) |
| vouchie, s. f. vessie : « aine vouchie d' coisson », une vessie de cochon. - (08) |
| vouderiez, 2e pers. conditionn. de valoir, voudriez. - (14) |
| voudze (goya) : vouge - (51) |
| voudze : (nm) serpe à long manche - (35) |
| voudze : faucille à grand manche - (43) |
| voudze : serpe à long manche - (34) |
| voudze n.m. Croissant à long manche, pour tailler les haies, vouge. Voir goyon. - (63) |
| voué - oui. - Est-ce que t'ébeillé ai méger és vaiches ? Oh voué. - En vos fauré laiborai le champ sur la Pierre ?... Voué note mâte. - (18) |
| voué - voir. – II y a divers temps à l'article qui précède. - I quemance de ne pu dière voué cliair. - Aitends voué, teins, qui airaingeâ ce qui. - (18) |
| voué : oui - (48) |
| voué : Oui. Voir oué. - (19) |
| voué : voir - y vè voué, je vais voir – èr’vouè ! au revoir ! - (46) |
| voué : voir vrat - (23) |
| vouè : voir - (39) |
| voué, partic. d'affirm. oui. On prononce voué ou voui suivant les localités. - (08) |
| voué, voui, pour : oui ; le v sert à accentuer la prononciation ; les étrangers reconnaissent un Bourguignon à ses voui. Ce mot est souvent précédé de mais, de oh ! mais ; mais voui ! oh ! voui ! oh ! mais voui ! L'on dit aussi : bèn sûr que voui ! - (16) |
| vouè[y]e : veille. - (52) |
| vouè[y]er : veiller. - (52) |
| vouée : n. f. Voix. - (53) |
| vouée. n. f. - Voie. Voix. - (42) |
| vouef (on) : veuf - (57) |
| vouèf : veuf - (39) |
| vouei. Oui, dont on fait vouei, changeant oui en ouei… - (01) |
| voué-illai : veiller. L'hiver on voué-illo : l'hiver on veille. - (33) |
| voueille (lai) : (la) veille - (37) |
| vouèille : veille - (48) |
| voueille : n. f. Veille. - (53) |
| voueille : s. f. veilleuse (plante). - (21) |
| vouéillé : v. i. Veiller. - (53) |
| voueille : veille - (39) |
| voueillée : n. f. Veillée. - (53) |
| voueillée, voueillie : veillée. - (33) |
| vouéiller (v.t.) : veiller - (50) |
| vouè'iller : veiller - (48) |
| voueiller : veiller - (39) |
| voueiller, v. n. se dit d'une graine qui s'ouvre, qui crève, qui éclate par suite d'une complète maturité. - (08) |
| voueilles (lâs) : (les) moutons et les brebis - (37) |
| vouéillie (n.f.) : veillée - (50) |
| vouè'illie : veillée - (48) |
| voueillie : veillée - (39) |
| voueillot : veillée écourtée. - (33) |
| vouèlai : voilà - (48) |
| vouèle : voile - (48) |
| vouèlè, vouèqui : voilà, voici - (46) |
| vouèle. adj. - Faible, débile. (Mézilles, selon H. Chéry) - (42) |
| vouéle. n. f. - Voile. - (42) |
| vouéler (se), v. réfl. se bomber, se déjeter, se gondoler. - (08) |
| vouène (n.f.) : veine - (50) |
| vouèner : v. vanner. - (21) |
| vouènou : s. m. vannoir. - (21) |
| vouèqui : voici - (48) |
| vouér, v. tr., voir : « T'f'ras c'qui ? J'voudròs ben l’vouér. » - (14) |
| vouèr. v. – Voir : « On va ben vouèr si i' va v'ni' ! » - (42) |
| vouèra : s. m. verrou. - (21) |
| vouère (verbe) : voir. - (47) |
| vouèrè : verrat. (B. T IV) - D - (25) |
| vouère les houres de... loc. attendre avec impatience l'heure, le moment de... : vouère les houres de partir. - (24) |
| vouére, adv. voire, vrai, vraiment : « vion vouére, dion vouére », voyons voire, disons vraiment, et non pas comme on le suppose vulgairement voyons voir, disons voir. - (08) |
| vouergé : verger. (B. T IV) - D - (25) |
| vouèrge : s. f. verge. - (21) |
| vouèrguer : v. égrener. - (21) |
| vouèrie, chose mauvaise, bonne à être jetée ; mauvais sujet. - (27) |
| vouésenage, s. m., voisinage. - (14) |
| vouèsin : s. m. voisin . - (21) |
| vouésin, s. m., voisin. - (14) |
| vouésse, vesce, plante fourragère dont les pigeons aiment la graine. - (16) |
| vouèt-chi : voici - (39) |
| vouèteure, vouèture : voiture - (48) |
| vouèt-lai : voila - (39) |
| vouèture : voiture - (39) |
| voueurs, coureurs d'écraignes ou d'assemblées du soir. (Voir écraigne.) .. - (02) |
| voueurs. : Coureurs d'écraignes ou assemblées du soir chez les vignerons de la rue Saint-Philibert à Dijon.- Voüeur dérive du latin votum, parce que ceux qu'on qualifiait de ce nom venaient offrir leurs voeux au beau sexe. - On les appelait aussi varlots ou amoureux. - (06) |
| vouève (na) : veuve - (57) |
| vouève : veine - (39) |
| vouève : veuve - (39) |
| vouéve, adj. et s. veuf, veuve. - (08) |
| voûge : Serpe à long manche. « Ol a tandu sa boucheure à grands cos de voûge ». Le mot est français mais ne prend pas d'accent. - (19) |
| voûge, gouyârd : vonge (outil à lame en croissant, à long manche, pour élagage des haies) - (37) |
| vouge, goyard, goyat. Grosse serpe à long manche pour tailler les haies. - (49) |
| vouge, serpe à long manche. - (05) |
| voui : oui - (57) |
| voui adv. Oui. - (63) |
| voui ! : oui ! - (37) |
| voui : oui - (39) |
| voui, adv., oui. - (40) |
| voui, particule affirmât., oui: « Quand j'te dis que voui ! » - (14) |
| voui. Oui. - (49) |
| vouiche ! particul. exclamât., oui ! C'est un oui presque toujours dérisoire : « Te crais, pauv' petiote, qu'ô t'parle pou l'bon motif ?... Ah! ben vouiche! » (V. Ouiche, Voui.) - (14) |
| vouida, vraiment. - (16) |
| vouigné : v. i. Pleurnicher. - (53) |
| vouîgner, vouîner : grincer, aller vite - (48) |
| voûilla (na) : veillée - (57) |
| vouillaû (on) - appendis (n') : appentis - (57) |
| vouillaû (on) : hangar - (57) |
| vouille (na) : colchique - (57) |
| voûille (na) : veille - (57) |
| vouilleau, hangar. - (05) |
| vouillerotte : colchique. (RDM. T III) - B - (25) |
| voûilli : veiller - (57) |
| vouilliére (na) : volière - (57) |
| vouillot (nom masculin) : duvet. - (47) |
| vouillot, s. m. duvet, plume fine des oies, des canards, et en général de tous les oiseaux. - (08) |
| voûillou (on) : veilleur - (57) |
| vouin, vouin cade caillerotte, s. m. chant de la caille suivant l'interprétation des oreilles morvandelles. - (08) |
| vouiner (verbe) : lancer des ruades. On dit aussi voinder. - (47) |
| voûïner : hennir. - (52) |
| vouiner, v. a. lever le derrière, lancer des ruades. se dit surtout des chevaux en liberté. - (08) |
| voûïnner : hennissement du cheval qui s'apprête à ruer. - (33) |
| vouinvouin, s. m. grimace maussade, grommellement d'un visage grogron. - (08) |
| vouiter, v. a. dire oui, donner son consentement ; le contrat est prêt, il ne reste plus qu'àle « vouiter. » - (08) |
| vouivre, fée ; d'où le mot vesvre. Le bois de Vesvre ou Verne signifie le bois des fées. - (02) |
| voul (n.m.) : vol - (50) |
| voûl n.m. Vol. - (63) |
| voûl : vol (d'oiseau, de voleur) - (39) |
| voul, s. m. vol, action de voler dans l'air. - (08) |
| voulâ : (vb) vouloir - (35) |
| voula : Vouloir. « Y est pas tot de voula i faut pouya ». « Voula mau » : haïr, « Si te li dis cen t 'vas te fare voula mau » - Volonté. « Je veux qu’y sait c 'ment cen, y est man voula ». - (19) |
| voulai : vouloir - (57) |
| voulai mau : détester - (57) |
| voulaige, adj. volage, léger, capricieux, folâtre. - (08) |
| voulan (on) : faucille - (57) |
| voulan, s. m. volant, instrument à lame courbe avec un long manche, tenant de la serpe et de la faucille. On s'en sert principalement pour tondre les haies et les buissons d'épines. - (08) |
| voulant (nom masculin) : faucille. - (47) |
| voulant (on) : volant - (57) |
| voûlant : faucille - (37) |
| voulant : faucille, à ne pas confondre avec le goujard. - (52) |
| voûlant : goyard - (48) |
| voulant : serpe à long manche pour élaguer en forme de croissant pour élaguer, différent du goujard. Pou coper les épeunes on peurno un voulant : pour couper les épines on prend un voulant. - (33) |
| voûlant : grosse faucille - (39) |
| voulanté, s. f., volonté. - (14) |
| voulantei, adv., volontiers. - (14) |
| voule, adj. léger, sablonneux. Se dit seulement du terrain cultivé. - (22) |
| voulée (à la) : à la volée (façon de semer). - (21) |
| voûlée (na) - voûilla (na) - voûlia (na) : volée (d'oiseaux) - (57) |
| voûlée (na) : claque - (57) |
| voulée (na) : volée (correction) - (57) |
| voûlée : volée - (48) |
| voulenté. Volonté. - (03) |
| voûler - voulater : voler (dans les airs) - (57) |
| voûler (v.t.) : voler - (50) |
| voûler : voler - (48) |
| voûler en l’âr : voler en l’air, voltiger - (37) |
| voûler en lâs pieûmes : (de quelqu’un) se précipiter sur lui pour lui administrer une correction - (37) |
| voûler v. Voler. - (63) |
| voûler : voler (oiseau, prendre) - (39) |
| voûler, v. n. voler, s'élever dans l'air. - (08) |
| voulet (n.m.) : volet - (50) |
| vouleû (on) : voleur - (57) |
| vouleur : petite poussière qui vole, par exemple sur un vêtement. - (56) |
| voulineu, euse, adj. vénéneux. - (08) |
| voûlins : emplacement à foin ou à paille dans la partie supérieure de la grange - (48) |
| vouloé, vouloir ; el é v'lu, il a voulu. - (16) |
| voulouèr : vouloir - (39) |
| voulû (use) (n.m. et f.) : voleur, voleuse - (50) |
| voulu(e) : velu(e) - (48) |
| voûlu(e) : velu(e) - (39) |
| voulu, adj. velu ; vâ voulu, ver velu, chenille. - (38) |
| voulu, adj., velu. — A remarquer encore que nous disons voulu pour « velu », et v’lu pour « voulu ». - (14) |
| voulu, e, adj. velu, couvert de poil. Se dit particulièrement d'un corps au poil en désordre, hérissé. - (08) |
| vouô – cri ou exclamation pour faire arrêter un cheval. - Vouô ! vouôo !! Voir ue et dia. - (18) |
| vouoilli : v. veiller. - (21) |
| vouoillou : s. m. celui gui participe à la veillée. - (21) |
| vour, our : adv., vx fr. or, maintenant. - (20) |
| vouraint, vourot - divers temps du verbe vouloir. - Voir : velaint, velâ. - A vourot bein veni davou no. - Les enfants vourraint s'aibuyer âjedeu pou ne pâ ailai en l'école. - Vô vourâs bein, n'eusse pâ, piaichai nos treuffes demain. - (18) |
| voure, adv. maintenant. - (22) |
| vourie : fère lè vourie, c'est faire la fête - (46) |
| vourioeu, s. m. verrou. - (22) |
| vourrai, verrou. - (05) |
| vourrue : verrue. - (29) |
| vout, 3e pers. prés, du v. valoir, veut. - (14) |
| vout'. adj. et pron. poss. - Votre, ou le vôtre : « En counnaisseurs, c'est sûr, j'irons faie un p'tit tour dans vaut' canton. » (G. Chaînet, En Chicotant mes braisons, p.20) - (42) |
| voûtai : ronfler. Le vent d'hiver voûte dans la cheminée : Le vent d'hiver ronfle dans la cheminée. - (33) |
| voute - vont - vouton - vouta : votre - (57) |
| voute (adj.pos.pl.) : votre - (50) |
| voûte (donner), loc., terme de marinage, qui signifie : attacher. (V. le mot suivant.) - (14) |
| voûte (le, lai) (pr.pos.m. et f.) : le vôtre, la vôtre - (50) |
| voûte (lever), loc., terme de marinage, qui signifie : détacher. (V. le mot précédent.) - (14) |
| voûté (oū) (se), vn. se vautrer. - (17) |
| voute : votre - (39) |
| voute, adj. poss. votre : « ç'ô eunc languerale couman vout' fon-n' », c'est une bavarde comme votre femme. - (08) |
| vout'e, adj. poss., votre. - (14) |
| voute, vote adj. poss. Votre. - (63) |
| voûte, vôte adj. poss. Vôtre. - (63) |
| voûter (v.) : rouler, tourner, tourbillonner (se dit du vent lorsqu'il souffle avec violence) - (50) |
| vouter, v. n. rouler, tourner, tourbillonner. Le vent a « voûté » toute la nuit. S'emploie avec le sens actif : le vent m'a « voûté » sur la montagne. - (08) |
| voûter. faire voû, où, où, comme le vent qui souffle avec force ou comme le jouet d'enfant qui porte le nom de « voù» par onomatopée. - (08) |
| voûtre (le - la) : vôtre (le - la) - (57) |
| voûtres (les) : vôtres (les) - (57) |
| voyâbe, adj., visible. - (14) |
| voÿadze : voyage - (51) |
| voyager, voyagère : adj., vx fr., viager, viagère. - (20) |
| voyageuse : voir chvau - (23) |
| voyaigeur : n. m. Voyageur. - (53) |
| voyan. Voyant. - (01) |
| voyant : Prunelle de l'oeil. « Ol a eune taiche su le voyant » : il a une taie sur l'oeil. - (19) |
| voyant, n.m. pupille de l’œil. - (65) |
| voyée, voulée. n. f. - Volée, bande d'oiseaux : « Les chasseux il' ont l'vé une voyée d'pédrix. » - (42) |
| voyotte, voiyotte (n.f.) : colchique d'automne - (50) |
| voyottes. n. f. pl. - Yeux - (42) |
| voyottes. s. f. pl. Les yeux. - (10) |
| voyu, part, du v. vouér, vu. - (14) |
| voyue : valeur - (37) |
| vrâ : Vrai. « Y est partant vrâ » : c'est pourtant vrai. A quelqu'un qui affirme une chose dont on se permet de douter on dit : « Y n'est pas si seur que s'y était vrâ ». - (19) |
| vrâ, adj. vrai ; i’ost vrâ, c'est vrai. - (38) |
| vrâ, adj., vrai : « De vrâ. Pô d'vrâ. » - (14) |
| vrâ, adj., vrai. - (40) |
| vrà, vrai ; vrâman, vraiment. On dit aussi : vrë, s'â vrë. - (16) |
| vrai (de) loc. En vérité, vraiment. - (63) |
| vrai adv. Vraiment, très, tout-à-fait. - (63) |
| vrai : adj, vrai frère, vraie soeur, frère ou soeur de père et de mère. - (20) |
| vrai : adv., vraiment, très, tout-à-fait. C'est vrai bête. - (20) |
| vrat : verrat. III, p. 36-3 - (23) |
| vrat, varrat n.m. Verrat. - (63) |
| vrat. n. m. - Verrat. - (42) |
| vré (de) (loc.) : en vérité, véritablement - (50) |
| vré (de), loc. en vérité, véritablement : a-t-il fait cela « de vré », cette vache est trop chère « de vré. » - (08) |
| vre : vert(e) - (43) |
| vrecer : verser - (43) |
| vredai (pat.) et vreder (dial.). : Courir ; du latin veredus, cheval de chasse. (Quich.) - (06) |
| vredai, aller çà et là. Dans le Châtillonnais, on dit veurder... - (02) |
| vredai. Fuir, du bas latin veredare. - (01) |
| vredalain, vredeu-ya : fruit pas mûr - (43) |
| vredâler : traîner, flâner - (43) |
| vredan : Cordon fait le plus souvent d'un « chemeut », une extrémité de ce cordon est fixée à la partie supérieure du berceau, c'est au moyen de ce cordon qu'on donne au berceau une oscillation qu'on suppose propre à provoquer le sommeil du bébé. « Tiri le vredan » : bercer. - (19) |
| vreder : Aller et venir, courir çà et là sans motif sérieux. « Quevà ce qu’alle est aré allé vreder ? » : où est-elle encore à courir ? - (19) |
| vredeuil : lézard vert - (43) |
| vredôler : culbuter, se renverser, dégringoler - (43) |
| vredou, vredeure : verdure - (43) |
| vredze : partie du fléau qui frappe les céréales - (43) |
| vrée : adj. Vrai. - (53) |
| vregigné, vn. suinter, couler : se dit des plaies. - (17) |
| vréille : vrille - (48) |
| vreille : vrille - (39) |
| vreille, s. f. vrille, foret. - (08) |
| vreille, s. f., vrille. - (14) |
| vreillotte, s. f. petite vrille. - (08) |
| vremœne, s. f. vermine, sens plaisant : sauvez-vous, vremœne ! - (22) |
| vremœne, s. f. vermine, sens plaisant : sauvez-vous, vremœne ! - (24) |
| vremouilli : v. se dit des porcs qui défoncent le terrain avec leur groin. - (21) |
| vrenaille : verge souple - (43) |
| vrepi : vipère - (51) |
| vrepie : vipère. - (30) |
| vrésembiable. Vraisemblable. - (49) |
| vretalé : véreux (fruit) - (43) |
| vretau, s. m. ver. Vretaulé, vermoulu. - (24) |
| vretiau : ver de terre - (43) |
| vreto : ver - (43) |
| vretoyi : zigzaguer - (43) |
| vretoyons : virages - (43) |
| vretsère : verchère, petite terre de bonne qualité à côté de la maison - (43) |
| vreû, veurde : (adj) vert (e) - (35) |
| vreugeö, vorgeö, sm. verger. - (17) |
| vri, v. a. tourner (pour le foin). Ramener (pour le bétail en maraude). - (24) |
| vrille, n.f. plante grimpante (liseron des champs). - (65) |
| vrillée, vrillie. n. f. - Liseron des champs. - (42) |
| vrillée, vrillie. s. f. Liseron des champs. (Lainsecq). - (10) |
| vrillennes. s. f. pl. Vrilles des plantes sarmenteuses ou grimpantes. Les vrillennes de la vigne. - (10) |
| vrilli : vriller - (57) |
| vrillotte. s. f. Petite vrille. - (10) |
| vrimou, ouse, adj. venimeux, euse. - (17) |
| vriou, s. m. verrou. - (24) |
| vrisse, et vérisse, s. f., corde avec laquelle les mariniers tirent les bateaux : « Tirer la vrisse. » Elle est d'un usage aussi fréquent que le veùrdon ; longue et d'un diamètre moindre, elle sert pour amarrer. - (14) |
| vritiè, sf. vérité. - (17) |
| vrombi ou frombi. : Action d'un corps qui, en s'agitant, ou après avoir été lancé, détermine le frémissement de l'air.- On dirait que les mots latins fremere et vibrare se sont concertés pour donner naissance à cette expression : « Quan lé cliôche de sain Bereigne son en branne, tôte lè piarre du clioché an vrombisse. » - C'est ainsi que se serait exprimé un bon vigneron du quartier Saint-Philibert, au temps d'Aimé Piron et de Lamonnoye. - (06) |
| vrombi. Ce mot est fort usité dans le Châtillonnais ; il se dit de l'air qui frémit quand on sonne les cloches. Les jeunes écoliers ne manquent pas de dire : Ma toupie vrombit, pour indiquer le frôlement de l'air... - (02) |
| vrondé, v. n. tourner autour en agaçant : je n'aime pas qu'on vronde autour de moi. - (22) |
| vronder : bourdonner - (35) |
| vronder, v. n. tourner autour en agaçant : je n'aime pas qu'on vronde autour de moi. - (24) |
| vrondner, viondner, bondner v. Vrombir, bourdonner, marmonner. - (63) |
| vrou : verrat. (RDM. T IV) - C - (25) |
| Vroûle : (NL) Vérosvres - (35) |
| Vroûles n. Vérosvres. - (63) |
| Vroûlon (ne) : (nm.f) habitant (e) de Vérosvres - (35) |
| vroûlon, vroûlonne n. et adj. De Vérosvres. - (63) |
| vrouvrou, sm. verrat. - (17) |
| v'rrat : verrat - (61) |
| vruiilö, sm. verrou; qqf. verrat. - (17) |
| v's, contraction de vôs, vous : « V'nez donc causer eùn brin d'avou moi à c'tu souér ; v's aivez ben l'temps. » (V. Vôs.) - (14) |
| vsillant, vgillant, vregillant, adj. vif, remuant. - (17) |
| vsongné, vesogné, vn. grogner, maugréer. - (17) |
| vtchi (en) (loc.) : en voici - (50) |
| vtrot, virotte, adj. étourdi, sujet au vertige. s'emploie au propre et au figuré une femme dit d'elle-même : « i seu bin virotte », je suis bien étourdie. - (08) |
| vu : Employé jadis dans l'expression : « J'y ai vu dire » : je l'ai entendu dire. Probablement déformation du verbe ouir. (J'ai ouï dire). - (19) |
| vu p.p. de woî. Entendu. Dz'y ai vu dère. Je l'ai entendu dire. - (63) |
| vucre, vivre ; el é vicu, il a vécu. - (16) |
| vude, vide ; vudé, vider. - (16) |
| vudiè : vider - (46) |
| vudié, vt. vider. - (17) |
| vudier, vider. - (05) |
| vudje, adj. vide. - (17) |
| vudye, vide. - (26) |
| vudyeu : vider. - (29) |
| vue-basse : Myopie. « Ol a la vue-basse » : il est myope. On dit d'un gourmand qui à table choisit toujours le plus beau fruit, le plus gros morceau de gâteau : « Ol a la vue-basse, o ne voit pas les ptiets morciaux ». - (19) |
| vugni : débattre (se) - (57) |
| vuide, adj., vide : « Ol a la téte vuide coume ein touneau parcé. » - (14) |
| vuider, v. tr., vider. - (14) |
| vuit, adj. numéral, huit. - (14) |
| vut : huit - (46) |
| vutje, adj. num. huit. - (17) |
| vyi : veiller - (51) |
| vyo : veau. (LCSS. T IV) - S&L - (25) |
| vyô, vyà, veau ; vyàlé se dit de la vache qui a donné son veau. - (16) |
| vyôle, vyeule, instrument de musique ; se dit même pour violon, basse, contrebasse. - (16) |
| vzou : s. m. instrument employé par le tuilier pour malaxer sa terre. - (21) |
| v'zou, faiseur ; ein v'zou d'anbarâ, un vaniteux qui cherche, par ses manières, à se donner de l'importance ; se dit aussi de certains fabricants, en ajoutant le nom de la chose qu'ils fabriquent : ein v'zou d'ail'mète, un fabricant d'allumettes ; ein v'zou d'p'né, un fabricant de paniers, etc. - (16) |
| w, le double v n’existe pas dans notre patois. - (08) |
| wagon-yet (on) : wagon-lit - (57) |
| waigon : n. m. Wagon. - (53) |
| warder. : (Dial.), garder. - Le composé rewarder signifie regarder et, au figuré, avoir de l'intérêt pour quelqu'un ; d'où les mots werdon et guerdon, qui signifient récompense. - (06) |
| weït. : Gué, passage à sec d'une rivière ; mot provenant, selon M.Burguy, du haut allemand waten. - L'emploi du double w provient, dans certains vocables bourguignons, de la proximité du patois lorrain qui avait commencé par subir l'influence de la prononciation et de l'orthographe germaniques. - (06) |
| wét’cha : voici. (LCSS. T IV) - S&L - (25) |
| woî v. Voir. Faut y woî p'y crâre. Il faut le voir pour y croire. - (63) |
| woîci prép. et adv. Voici. - (63) |
| woignon n.m. Oignon (on dit surtout eugnon). - (63) |
| woilà v. défect. prép. et adv. Voilà. Voir vlà. - (63) |
| woilà, woilà-woilà interj. Sert à ponctuer, opiner, dans une conversation : il équivaut à "bien", "bien, bien", "certes". - (63) |
| woîle n.m. Voile. - (63) |
| woîlette n.f. Voilette. - (63) |
| woîrie n.f. Voirie. - (63) |
| woîsin n.m. Voisin. - (63) |
| woîs-tu ! équivalent du "voyez-vous" ou du "écoutez" qui précède la phrase de nombre de personnes. - (63) |
| woite interjection. Exclamation de dépit ou d'impuissance. - (63) |
| woîtûre n.f. Voiture. - (63) |
| woîx n.f. Voix. - (63) |
| wouavre, s. f. la pierre de la Wouavre est un énorme bloc de granit qui se dresse au versant du mont Beuvray. - (08) |
| woulâ mau loc. (vx.fr. malvoloir) Vouloir du mal à quelqu'un, avoir de l'antipathie pour quelqu'un. Y'est dépeu ç'dzo là qu'alle lu a woûlu mau ! Mal prendre quelque chose, être contrarié par quelqu'un ou quelque chose. Dz'y ai woûlu mau ! - (63) |
| woûla v. Vouloir. Assez employé dans des expressions telles que : Y wout pas pyoure : la pluie ne se décide pas à tomber. Y wout pas martsi : ça refuse de fonctionner. - (63) |
| wôyou n.m. Voyou. - (63) |
| wu p.p. Participe passé de voir. - (63) |
| x Il n'y a aucun mot commençant par "x" dans le parler charolais où les "x" se prononcent généralement comme des "z" ou des "s" : – le Zavier (Xavier), l'ézamen (examen), – l'espérience (expérience), le sylophone (xylophone), l'esposichon (exposition). - (63) |
| x. : La lettre x remplaçait deux s et sc, comme le témoigne ce passage du premier sermon de l'avent de Saint Bernard : « Criz meismes monta en ciel, ki en dexendit, etc. - Son ixuge (issue) fu del soverain ciel. » - (06) |
| y - Cela. Locution explétive et parasite, en grand usage dans le Chalonnais. « Je vas vous y faire, vous y porter », pour dire cela, cet objet ; tient lieu, tantôt d'un régime direct, et tantôt d'un sujet impersonnel. - (15) |
| y - prononcez cette lettre comme dans pays. – I y vâs (j'y vais). Ciyré bein (ça ira bien). - (18) |
| y (pron.pers.compl.) : leur - (50) |
| y : Ce, pronom démonstratif. « Y est c 'ment si te chantais ». - Cela. « Donne m'y dan » : donne moi donc cela. « Rangez y bien » : range bien cela. Y. : « J'y vas ». - (19) |
| y : il ou je - (37) |
| y : ils - (43) |
| y : pronom neutre « Faut pas y craindre » - (35) |
| y : pronom personnel. Pour le ou la, lui (j’y prends, j’vas y dire…à ta mère). Cette alternative viendrait de l’ « arpitan ». - (62) |
| y 1. Pron. et adv. s'emploie avec le sens de "le" dans les expressions impératives telles que : dis-y, dis-le, fais-y, faisle, prends-y, prends-le. 2. Pron. démonstr. dans les expressions telles que : y'est point la poueiñne ce n'est pas la peine, y'est peur ma c'est pour moi, y'est bin/aiji c'est bien facile. - (63) |
| y ch’craisse, d’aû d’choûs ! : ça se couvre au loin ! - (37) |
| y en vout bin dœre, loc. c'est par un grand hasard que cela a pu réussir. - (24) |
| y est : c'est - (51) |
| y est bin tôt si..., loc. ce sera bien juste si... - (24) |
| y est u fùye, loc. se dit lorsqu'une marchandise est rare et chère : c'est la panique à la hausse. Littéralement : c'est au feu. - (24) |
| y prendre à la chœvre, loc. (à la chèvre). S’offusquer d'une observation, d'une remarque. - (24) |
| y' : n. m. C'. - (53) |
| y : pronom, s'emploie au lieu de te, ta, tes, pronom, et de ça, cela, démonstratif. J'y sais pas. T'y verras ben. - (20) |
| y, i nô : 1 pron. pers. Je, j'. - 2 pron. pers. Il. – 3 pron. pers. Nous. - (53) |
| y, pron. démonstr., ce, cela. Remplace et le sujet impersonnel et le régime direct : « Y va faire un peùt temps. » — « Ranges-s-y, nétoye-s-y. » — « J'y maingerò ben. » — « Y é lu ! » (c'est lui !) - (14) |
| y, pronom personnel, sujet 1ère personne (et souvent aussi 4ème pers.) ; se prononce i devant les consonnes et y devant les voyelles - (07) |
| y, s'emploie explétivement dans le discours : vous « y » mentez, vous « y » chantez, « quoi que vos y dié », qu'est-ce que vous dites, « quoi que vos y fie », qu'est-ce que vous faites ? - (08) |
| y. Dans l’Avallonnais, y, avant un verbe, s'emploie pour je . Y m’en épante, je m’en étonne. Y n’chaut feu cha, je ne peux faire ça. (Montillot). - (10) |
| y’e : œil. Difficile à écrire ce singulier y+e.= « Évoir un ch’ni dans y’e ». Bien dire « e » et non pas « eu » - (62) |
| y’en a p’faire, y’abonde : beaucoup - (43) |
| y’en d’vole coûmme vaic’e qu’pyche ! : il pleut abondamment ! - (37) |
| y’en seûs brâment âye ! : j’en suis bien content ! - (37) |
| y’ot brave : c’est joli ! - (37) |
| y’ot l’y ! : c’est lui ! - (37) |
| y’ot moins qu’ran ! : c’est peu de chose ! : ça ne vaut même pas la peine d’en parler ! - (37) |
| y’ot prou ç’tit ! : ça a très mauvais goût - (37) |
| y’ot raîpé ! : c’est terminé ! c’est fichu ! - (37) |
| y’ot ran d’voyue ! : ça n’a aucune valeur ! - (37) |
| ya : liard. A - B - (41) |
| ya : liard - (34) |
| y'ab ait don ben : souhait de passer à autre chose = que le diable emporte. Ex : "Y'ab ait don ben soun' auto !" (= qu'il nous ennuie à klaxonner comme cela...ou bien : il n'a que de son auto à parler...ou encore : le bruit de sa voiture nous casse la tête...). - (58) |
| y'ab : diable : Juron. Ex : "Y'ab mé pète !" "Y'ab mé brûle !" "Y'ab m'arrache !" "Y'ab m'empourte" (= m'emporte). - (58) |
| yabe, yamme. n. m. - Diable. - (42) |
| yâche : laiteron. Plante des champs qui produit un latex et entre dans : le panier d’herbes pour les lapins. - (62) |
| yâche : s. f. laiteron maraîcher (sorte de chardon). - (21) |
| yaice (d'la) : glace - (57) |
| yaice (n.f.) : glace - (50) |
| yaice : (nf) glace - (35) |
| yaice, glace - (36) |
| yaici : glacé - glacer - (57) |
| yaiçon (on) : glaçon - (57) |
| yaisse : glace - (39) |
| yaisson : glaçon - (39) |
| yâm yâmont loc. adv. Là-bas (en amont). - (63) |
| yame : en haut (en B : yamou). A - (41) |
| yamner (v.t.) : glaner - (50) |
| yâmon'haut loc. adv. Là-bas en haut. - (63) |
| yâmon'haut-la-cheume loc. adv. Tout là-haut à la cîme. - (63) |
| yamonnhaut : là-haut - (51) |
| yamont : là-haut - (43) |
| yamont’haut, yamou-l’haut : (loc adv) là-haut - (35) |
| yamontsu : là-dessus - (43) |
| yamou (yavou) : là-bas - (51) |
| yamou : en haut - (34) |
| yamou-l'haut la cheume : (exp) au sommet - (35) |
| yampote : tique gorgée de sang (voir beurlin*). A - B - (41) |
| yampote : tic (parasite) - (51) |
| yampote n.f. (de lande) Tique. Autres noms : loup d'bôs, piou d'bôs. - (63) |
| yampotte : tic gorgé de sang - (34) |
| yampotte : tique gorgée de sang - (43) |
| yan : s. m. gland. - (21) |
| yand (n.m.) : gland - (50) |
| yand (on) : gland - (57) |
| yand : (nm) gland - (35) |
| yand n.m. Gland. - (63) |
| yan-not : épi d'avoine - (39) |
| yape n.f. (onom.). Gifle. - (63) |
| yaper : gifler. A - B - (41) |
| yaper : (vb) laper - (35) |
| yaper : jeter - (51) |
| yaper : laper - (43) |
| yaper v. 1.Gifler. 2. Piaffer. - (63) |
| yapet n. Personne qui n'arrête pas de parler. Ch'tu-là, y'est un yapet ! - (63) |
| yapi : bardane (botanique) - (51) |
| yâpî : bon causeur mais sans malice - (37) |
| yappe : se dit en parlant de légumes trop cuits ou d'une plaie suintante - (39) |
| yappè : v. i. Patauger. - (53) |
| yapper : gifler - (34) |
| yapper : gifler - (43) |
| yapper : aboyer - (39) |
| yappou - (39) |
| yaquer v. (de claquer) Lancer violemment. - (63) |
| yâr, liard, ancienne monnaie dont quatre faisaient un sou ; se dit aussi jour : lierre. - (16) |
| yârd, s. m., liard : « O n'a pas por deux yârds de jugeòte. » - (14) |
| yarder, v. intr., liarder, lésiner. C'est : « còper eùn yârd en quate. » - (14) |
| yardesse : plaie, coupure - (39) |
| yards, s, m., boutons éruptifs des enfants au premier âge. (V. Curie.) - (14) |
| yarre (n.m.) : lierre - (50) |
| yarre. n. m. - Lierre. - (42) |
| yasse (n. f.) : entrelacement d'épis servant à lier les gerbes (j'en ai râs la yasse (je suis excédé, j'en ai assez)) - (64) |
| yasse : lien de seigle - (48) |
| yasse : paille de seigle dont on fait des liens : glui. Pou faire une gerbe o fayot une yasse : pour attacher une gerbe il fallait un lien de paille de seigle. - (33) |
| yatrée : n. f. Quantité de produit semi-fluide. - (53) |
| yâtrer : battre une personne, la mettre hors d'état de nuire. A - B - (41) |
| yatrer : battre avec la main - (51) |
| yatrer : battre quelqu'un, le mettre hors d'état - (34) |
| yatrer : battre quelqu'un, le mettre hors d'état - (43) |
| yâtrer v. (de yier, lier). Battre, mater, (un enfant) en utilisant un lien (d'osier). - (63) |
| yâtrer : (yâtrè - v. neutre) battre, tabasser (de préférence à grands coups de corgie) - (45) |
| Yaude : (NP) Claude - (35) |
| yaûde : couteau de poche (peu usité) - (37) |
| Yaûde : Claude - (39) |
| Yaude : Claude. - (29) |
| Yaude, Glaude n. Claude - (63) |
| yaude. Couteau mal emmanché dont la lame remue, retombe. - (49) |
| yaue, s. f. eau. - (08) |
| yauquet (nom masculin) : loquet. On dit aussi vauquau, liquou, liquotte. - (47) |
| yâvant : là – bas. « As-tu b’soin d’aller yâvant ? ». - (62) |
| yâvau loc.adv. Là-bas en bas (en aval). - (63) |
| yâveu : adv. là-bas. - (21) |
| yavô : (loc adv) là-bas - (35) |
| yavô bas, yavô d’en bas : (loc adv) en bas - (35) |
| yavou (yamou) : là-bas - (51) |
| yé : il y a - (48) |
| y'é : Il y a. - (52) |
| yé : lit - (43) |
| y'é : il y a. - (33) |
| y'é : exp. Il y a. - (53) |
| yè : v. t. Lier - (53) |
| yé : vers. Près de... Ex : "Ben tou, té s'ras yé moué !" - (58) |
| yè. C'est. « Yè lui », pour c'est lui. - (49) |
| yé… : chardon blanc, sans épine, dont les lapins sont friands. - (16) |
| yeau : eau - (51) |
| yeau : sureau yeble - (51) |
| yeau. n. f. - Eau. - (42) |
| yé-bas : (loc adv) en bas - (35) |
| yèce n.f. Glace. - (63) |
| yèche : s. f. glace. - (21) |
| yée (adv.) : guère - (64) |
| yée, ruée (n.f.) : chemin de desserte, chemin encaissé - (50) |
| yée. adv. - Guère. - (42) |
| yége (on) - yège (on) : liège - (57) |
| yége, liège. - (16) |
| y'en ai : exp. Y' en a, certain. - (53) |
| y'en é : Il y en a. - (52) |
| yener : v. glaner. - (21) |
| yer : lier,attacher, attacher le joug sur la tête des boeufs - (48) |
| yèr' : lierre - (48) |
| yer : (yé - v. tr.) attacher. - (45) |
| yerder : (yêrdè - verbe neutre) en parlant de bûcherons à l'ouvrage dans la forêt, cesser un moment le travail pour boire un coup autour du feu. Voir aussi le mot borjé - (45) |
| yerge, laiteron. - (28) |
| yèrle, hiéble. - (16) |
| Yernâ : Liernais - (48) |
| yérux (-use) (n.et adj.m. et f.) : glaireux (-euse) - (50) |
| yèse : (yès') autre nom du lien de paille (liasse). - (45) |
| yesse : glace. A - B - (41) |
| yesse : glace - (34) |
| yesse : glace - (43) |
| yessire : glacière. Autrefois, cave ou excavation où l'on conservait la glace en été (visibles par exemple aux châteaux de Dré, Lugny ou Rambuteau). A - B - (41) |
| yessire : glacière - (43) |
| yéssire : glacière ; autrefois cave, excavation où l'on conservait de la glace pendant l'été - (34) |
| yesson : glaçon - (43) |
| yet (on) : lit - (57) |
| yet : (nm) lit - (35) |
| yet : lit - (51) |
| yet, yit n.m. Lit. - (63) |
| yète : tiroir. - (29) |
| yéte, tiroir d'une armoire. - (16) |
| yèto. Il était. C'était. - (49) |
| yette (nom masculin) : tiroir de la table où l'on range le pain. - (47) |
| yette : tiroir - (60) |
| yette : s. f. tiroir à glissière. - (21) |
| yeû (pr. pers. et adj. poss.) : leur - (64) |
| yeu : Oeil. « J'ai in cheni dans l'yeu » : j'ai une poussière dans l'œil. « Avoir les yeux à la fricassée » : avoir le regard fripon, provoquant. - Bourgeon « J'ai sarpé ma vigne à trois yeux ». - (19) |
| yeu adj. poss. Leur. - (63) |
| yeu n.m. Oeil (on dit eun' yeu ou un' yeu mais deux/yeux). Viri d'yeu loc. Tourner de l'oeil. T'vas pas viri d'yeu, nom de Dieu ! Ce mot est le seul commençant par un „y“ ayant le même statut que le „y“ du français. - (63) |
| yeu pron. Le leur. - (63) |
| yeu : glui - (39) |
| yeu : leur. Ex : "A c’teu là, il z' ataint dans yeu lit !" - (58) |
| yeu, leû : pron. pers. ind. et adj. poss. Leur. - (53) |
| yeu, oeil, au singulier comme au pluriel ; l'yeu m'fé mô, l'oeil me fait mal. - (16) |
| yeu, pron. pers. plur. leur, (voir : leu.) - (08) |
| Yeu. n. m. - Dieu : « On va à l'églie pou' prier l'Bon Yeu. » - (42) |
| yeu’ : leur. Et « yeus » pour leurs (et pour la liaison). Pronom personnel, adjectif ou pronom possessif. - (62) |
| yeue. n. f. - Lieue : ancienne mesure linéaire de 4 km. « La Gearmaine alle est partie hier, alle est ben à dix yeues d'ici a'c'teue ! » - (42) |
| yeumaçou : gluant - (57) |
| yeumèsse : limace - (51) |
| yeumouaice (na) : limace - (57) |
| yeune : gerbe de céréales. A - B - (41) |
| yeune : gerbe de céréales - (34) |
| yeuner : glaner - (57) |
| yeunette : lunette - (51) |
| yeunou (on) : glaneur - (57) |
| yeupe (na) : bardane - (57) |
| yeur : (yeu:r - subst. f.) grande corde qui arrime le chargement d'un chariot. - (45) |
| yeuse : n. f. Lieuse. - (53) |
| yeuse. n. f. - Lieuse, faucheuse. - (42) |
| yeûsse : (nf) capuchon de paille de la ruche (autrefois) ; « chapeau » de la gerbière - (35) |
| yeûsse : capuchon de ruche - (43) |
| yeusse : bout de l'essieu avec la clavette ou rentrent les roues (On dit : « les roues battont és yeusses » quand les roues grincent. Une personne qui est essoufflée dira « i bat es yeusses ») - (39) |
| yeuter, zyeuter v. Regarder fixement, épier. - (63) |
| yeuve (n. m.) : lièvre - (64) |
| yeuve. n. m. - Lièvre - (42) |
| yeuvre (un) : un lièvre - (61) |
| yeuvre, lièvre. - (27) |
| yeux. pron. pers. et poss. - Leur, leurs. - (42) |
| yév(r)e, subst. masculin : lièvre. - (54) |
| yéve (n.m.) : lièvre - (50) |
| yéve : lièvre - (48) |
| yève : lièvre - (51) |
| yéve : (yé:v' - subst. m.) lièvre. - (45) |
| yève : lièvre - (39) |
| yèvo. Il y avait. - (49) |
| yèvre (on) : lièvre - (57) |
| yèvre : (nm) lièvre - (35) |
| yèvre : un lièvre - (46) |
| yèvre, levrot : lièvre - (43) |
| yèvre, s. m., lièvre : « O n'a pas évu d'prix à l'écôle. Que v'tu ? Ol a dlia mémouére c'ment ein yièvre ! » - (14) |
| yi (pr. pers.) : lui (donne-yi (donne-lui), j'vâs yi die (je vais lui dire)) - (64) |
| yi. adv de lieu. - Y : « Va yi don' ! T'as rein à crainde, il est parti déd 'pis c'matin ! » - (42) |
| yi. pron pers. - Lui : « l'yi racontait eune drôle d'histouée, la demiée Joué qu’j'l'a vu ! » · - (42) |
| yiâche, f. pissenlit. - (24) |
| yiaice (lai) : (la) glace - (37) |
| yiande (d’lai) : (de la) viande - (37) |
| yiard d’beûrre (ain) : (une) petite quantité - (37) |
| yiârre (du) : (du) lierre - (37) |
| yiavaut, loc. là en bas : cours vite yiavaut en bas de la vigne. - (24) |
| yîc’er : glisser - (37) |
| yièche, s. f. eau congelée. - (24) |
| yien (n.m.) : lien - (50) |
| yien : lien - (37) |
| yien : lien pour vache fixé à la crèche - (48) |
| yien n.m. Lien. - (63) |
| yienne n.f. Glane, poignée d'épis ramassée après le ramassage des gerbes. - (63) |
| yienner v. Glaner. - (63) |
| yier : lier - (37) |
| yier v. Lier. - (63) |
| yiétîre n.f. Litière. - (63) |
| yieû d’paiye : lieur de paille, au pied de la « grille », à claire-voie, de la « batteuse » le jour de la machine à battre - (37) |
| yieûe (aine) : (une) lieue - (37) |
| yieumetôt ou yieumu, loc. là-haut : aller chercher un nid yieumetôt sur l'arbre. On dit aussi yieumulou. - (24) |
| yieuse n.f. Lieuse. - (63) |
| yieût’nant (ain) : (un) lieutenant - (37) |
| yieux (ain) : (un) vieux - (37) |
| yieux « coucou » : vieux « beau » se croyant encore « drû » - (37) |
| yiév’e (ain) : (un) lièvre - (37) |
| yiève n.m. Lièvre. - (63) |
| yièvre, lièvre. - (16) |
| yin : (yin: - subst. m.) lien. C'est le nom qu'on donne au lien du fagot, fait d'une petite branche de jeune coudrier très flexible. Ce lien pouvait aussi être en glui qu'on laissait tremper pour pouvoir le torsader (opération qui se faisait le soir à la maison). - (45) |
| yiœner, v. a. glaner. - (24) |
| yit, yet n.m. Lit. - (63) |
| ymagène. : (Dial.), image. Ce mot seul démontre bien que c'est des cas obliques que se forment les dérivés ; imagène est en effet formé du régime imaginem (sujet imago). - Le livre de Job dit : « Faisons un homme à nostre ymagène et à nostre semblant. » - (06) |
| yô : sureau yèble (plante calcifère). B - (41) |
| yo : yeux. - (33) |
| Yo Rèvè : L'Huis des Meuniers - (48) |
| yoble, yobe, s. m. hièble, yèble, sureau herbacé. L'yèble n'est pas une plante de nos terres granitiques. - (08) |
| yocotai : « le village de l’homme » (près de st léger-de-fougeret) - (37) |
| Yôde, Claude. - (16) |
| yôdo, yôdine, niais, niaise. - (16) |
| yole : (yol’ - subst. f.) hièble, ou sureau hièble; le sureau arbuste, et non l'arbre nommé seu. Il mesure de 40 à 80 cm. - (45) |
| yole : sûreau yèble - (48) |
| yome-t’haut : (loc adv) la-haut (à Brandon) - (35) |
| yon (n. m.) : lien en bois pour lier les fagots ou cercler les tonneaux (ête mal dans ses yons (être mal à l'aise, éprouver de la gêne)) - (64) |
| Yon : (NL) Lyon - (35) |
| yong : long - (37) |
| yongueûr : longueur - (37) |
| yonnais : s. m., lyonnais. - (20) |
| yoñnais, -aise adj. Lyonnais, -aise. - (63) |
| yoper : boire d’une seule lampée - (37) |
| yopou : buveur à « cul-sec » - (37) |
| yoquot (n.m.) : loquet - (50) |
| yosse : cheville qui relie l'attelage à l'outil, petite cheville de fer à l'extrémité de l'essieu, sorte de goupille. - (33) |
| y'ot : c'est (au sud d'une ligne Brazey-en-Morvan-Montreuillon) - (50) |
| yôter : lutter à bras le corps. A - B - (41) |
| yoter : lutter à bras le corps - (34) |
| yotou, yotouse : se dit d'un fruit dont le stade de maturité est dépassé, donc plus ou moins ramolli et inconsommable (voir plutôt « guiôtou »(se) : qui tourne en eau, fruit qui a tourné). - (56) |
| yot-t-aine moins qu’ai ran ! : c’est une personne de mauvaise moralité ! - (37) |
| yotte. n. f. - Glotte. - (42) |
| you : eux - (57) |
| youfoufou : Cri de joie que poussent ou plutôt poussaient autrefois les jeunes gens certains jours de liesse : noces, tirage au sort, fête de village. « Chouper des youfoufous ». - (19) |
| yourde, yousse. s. f. Jeu qui consiste à lancer des bûches à une distance déterminée. (Vertilly). - (10) |
| youta : leur (féminin) - (57) |
| youtés : leurs - (57) |
| youton : leur (masculin) - (57) |
| youvant - yovant : là-bas - (57) |
| yuche, yeuche. n. m. - Perchoir pour les poules ; synonyme de guche, guiche. - (42) |
| yucher, yeucher. v.- Percher, grimper. - (42) |
| yuée (n.f.) : glui - (50) |
| z - est assez souvent employé par euphonie. Voir Lio. - (18) |
| z : Se met quelquefois devant une voyelle pour l'euphonie. « I ant amené leux enfants dave zeux ». « Avant z'hiya » : avant-hier. - (19) |
| z' : n. m. La lettre « z » est employée pour la prononciation de la liaison quand cela est nécessaire. - (53) |
| z’gueunioule, z’gonioure : manivelle - (43) |
| z’ind’e : gendre - (37) |
| z’neu : genou - (43) |
| z’ter ai bâs : faire tomber par terre, renverser - (37) |
| z’ter, zeûter : jeter - (37) |
| z’ûyots : yeux - (37) |
| z’yeûter, airgairder : regarder - (37) |
| za en ayer. : (Dial.), ça en arrière, c'est-à-dire autrefois. (S. B.) - (06) |
| zabot : - (39) |
| zaboueiller : faire son travail salement - (39) |
| zabouérer : faire son travail salement - (39) |
| zadou : peureux - (39) |
| zadou, peureux - (36) |
| zadouére : mot utilisé dans l'expression « couri lai zadouére » et qui signifie courir les femmes - (39) |
| zafre (adj.m. et f-.) : âcre (aussi jafre) - (50) |
| zagouégner : essayer de faire quelque chose sans y arriver - (39) |
| zagouiller : même sens que les mots précédents - (39) |
| zaguai - remplir complètement, un sac, par exemple, même en tassant. - Tenez, vos ne vô pliaindrâs pâ, i vâ zaguai. - Oh voué, al é bein zaguai. - Voiqui ine bâche, zaguez fort… la bonne meseure ! - (18) |
| zague : égoïne (outil de charpentier). A - B - (41) |
| zaguè, nioquè : 1 v. i. Cogner. - 2 adj. n. m. Plein. - (53) |
| zagué, très plein (ex.: un sac zagué de blé). - (27) |
| zaguer : donner des à-coups - (48) |
| zaguer : faire courir les vaches en imitant le bourdonnement des taons. (RDV. T III) - A - (25) |
| zaguer : prendre la mouche - (44) |
| zaguer : (zagè - v. trans.) donner des à-coups pour vaincre une résistance. Au figuré, revenir à la charge. - (45) |
| zaguer, courir (se dit, par exemple, des vaches qui font une course désordonnée dans les prés). - (27) |
| zaguer, v. a. fouiller dans un trou avec un instrument pointu, piquer à coups redoublés en poussant et en tirant à soi. - (08) |
| zaguer. Entasser quelque denrée sèche dans un panier ou dans un sac. An faut ben zaguer lai faireune pour lai fâre teni dans eune bâche. Le participe, zagué, s'emploie, par extension, dans le sens de chargé : Voiqui un âbre quasi zagué de coings. La locution provençale « de zig et de zag » exprime parfaitement l'idée de secouer latéralement. - (13) |
| zaibie, s. f. jable, rainure dans les douves d'un tonneau pour fixer les pièces de fond. - (08) |
| zaibuée, s. f. jabloire, outil de tonnelier qui sert à creuser les jables. - (08) |
| zaibuer, v. n. creuser des jables, les feuillures des douves. - (08) |
| zaicaisser : jacasser, bavarder - (37) |
| zaimâ, adverbe de temps. Jamais. - (08) |
| zaimâs : jamais - (37) |
| zainre. s. m. Gendre. (Ménades). - (10) |
| zaipioûner : pleurer en criant - (37) |
| zaippe : voix, parole, langue « bien pendue » (« jappe ») - (37) |
| zaipper (v.t.) : japper - (50) |
| zaipper : japper - (37) |
| zaippi : celui qui parle sans arrêt, qui est bavard (« qui ai d’lai zaippe ») - (37) |
| zairdin d’queûré : terme servant à qualifier un jardin dans lequel poussent, mélangés, légumes et fleurs plus herbes dans les allées - (37) |
| zaisse, faire des zaisses, c'est trébucher comme un ivrogne qui marche en diagonale et pour lequel la rue n'est pas assez large... - (02) |
| zaivéle, s.f. javelle, poignée de blé, d'avoine coupés. - (08) |
| zaivelle : javelle - (39) |
| zaivellon : plusieurs javelles attachées ensemble - (39) |
| zambaize, s. m. jambage de porte, de croisée, de cheminée. - (08) |
| zambe (n.f.) : jambe - (50) |
| zambe : jambe - (37) |
| zambe : jambe. - (52) |
| zambe ! (aine b’alle) : rien du tout ! - (37) |
| zambe : jambe - (39) |
| zambie : bord de ruisseau - (39) |
| zanzon (artugeon) (artuzon) : vers du bois - (51) |
| zanzonner (artugeonner) (artuzonner) : attaquer par les vers du bois - (51) |
| zâque (fâre l’) : (faire le) « malin » - (37) |
| zâque : geai - (37) |
| zâr (n.m.) : jars - aussi zair - (50) |
| zar : jars. Le zars gîle : le jars siffle. - (52) |
| zar : jar - (39) |
| zâr, zair, s. m. jars, mâle de l'oie. - (08) |
| zarbe : gerbe - (37) |
| zarbe, gerbe - (36) |
| zarbe, s. f. gerbe. (voir : jarbe.) - (08) |
| zarbé, s. m. gerbier, amoncellement de gerbes dans la grange. - (08) |
| zarbeillon : petite gerbe - (39) |
| zarber : empilage des gerbes dans la grange - (37) |
| zardaingne (nom masculin) : jardin. - (47) |
| zardin, jardin - (36) |
| zardiner (v.t.) : jardiner - (50) |
| zarding (n.m.) : jardin - (50) |
| zardingn', s. m. jardin. - (08) |
| zardouére (n.f.) : sexe du coq ou du jars - (50) |
| zargouner, v. n. jargonner, parler d'une manière inintelligible ou avec beaucoup de bruit. - (08) |
| zaricot, faiviôle : n. m. Haricot. - (53) |
| zaroler : bougonner - (39) |
| zarolou : personne qui bougonne - (39) |
| zarzeille : vesce poussant dans les blés - (39) |
| zarzéille, zarzéillerie (n.f.) : vesce qui pousse dans les blés - (50) |
| zarzeillerie : vesce poussant dans les blés - (39) |
| zau : coq. On dit ailleurs jau, pouilleau et cau. - (52) |
| zaue (n.f.) : joue - (50) |
| zauler, zôler (v.) : geler - (50) |
| zaune (adj.m. et f.) : jaune - (50) |
| zaupiller (v.t.) : sauter dans tous les sens ; remuer (aussi jaupiller) - (50) |
| zaur (n.m.) : jour - (50) |
| zaurnéé (n.f.) : journée - (50) |
| Zeainne (lai) : (la) Jeanne - (37) |
| Zean’nêtte (lai) : (la) Jeannette - (37) |
| zebai, ébats. Prendre ses zebai, prendre ses ébats. - (02) |
| zélateur : qui fait preuve d'un zèle souvent excessif pour une cause ou une personne. - (55) |
| zèlée : gelée - (39) |
| zèler : geler - (39) |
| zélôder, v. n. se dit des gelées blanches, des petites gelées nocturnes du printemps : « a z'lôde », il gèle un peu. - (08) |
| zenau (n.m.) : genou - (50) |
| zentite : gentille - (37) |
| zèpper : japper, aboyer. - (52) |
| zéro : Zéro en chiffre se dit de quelqu'un qui n'a aucune autorité, qui ne compte pas. « Y est in zéro en chiffre ». - (19) |
| zèro : n. m. Zéro. - (53) |
| Zérot, otte. diminutif de Lazare, nom d'homme. Le diminutif Lazarette pour les femmes est très répandu dans le pays. (voir : lazaret.) - (08) |
| zeter (v.t.) : jeter - (50) |
| zeter (z'ter) : jeter - (39) |
| zetû (n.m.) : jeteur - (50) |
| zeu, eux ; s'â zeu, ce sont eux. - (16) |
| zeûce, jeusse (n.f.) : perchoir pour les volailles - (50) |
| zeucer, jeusser (v.t.) : jucher - (50) |
| zeucher. v. n. Jurer. (Ibid.). - (10) |
| zeuchon. s. m. Juron. (Ibid.). - (10) |
| zeuher, v. a. jurer, faire un serment ou un juron. (voir : jeurer.) - (08) |
| z'euilles : les yeux, on dit aussi les z'euillots - freum tes 2 z'euillots si t'veu bin dromir, ferme tes 2 yeux si tu veux bien dormir - (46) |
| zeûment, s. m. jurement, imprécation, serment. - (08) |
| zeument. s. m. Jurement. (Ménades). - (10) |
| zeune (n.et adj.m. et f.) : jeune - (50) |
| zeune : jeune - (39) |
| zeune, adj. jeune. - (08) |
| zeunesse (n.f.) : jeunesse - (50) |
| zeûpe (aine) : (une) jupe - (37) |
| zeurer (v.t.) : jurer - (50) |
| zeûrer : jurer - (37) |
| zeurer : jurer. - (52) |
| zeurer : jurer - (39) |
| zeûrliquouée (aine) : (une) grosse quantité de denrées diverses - (37) |
| zeûrliquouée : giclée en quantité - (37) |
| zeûs d’ç’aûc’es : café très clair, extrêmement léger, pas réussi du tout. l’expression provient du fait qu’autrefois, le café, après avoir été moulu au moyen d’un moulin à main, était disposé sur le haut de la cafetière, dans un linge identique à une chaussette, afin de le passer - (37) |
| zeûsqu’ai : jusqu’à - (37) |
| zeussé : juché, perché. - (52) |
| zeusse : perchoir - (39) |
| zeusser - (39) |
| zeusseron : dard de guêpe ou abeille - (39) |
| zeûste : juste - (37) |
| zeux : eux - (51) |
| zeux : eux - (39) |
| zeux : pron. pers. Eux. - (53) |
| zeux, zeules : eux, elles - (48) |
| zeûz’ment : jugement, opinion - (37) |
| zeûzer : juger - (37) |
| zevée, s. f. haie vive. environs d'Avallon. - (08) |
| zézette, s. f., furet. - (40) |
| z'gra, s.m. secret. - (38) |
| z'gros, s.m. cahot. - (38) |
| zi di (leur zi di) : v. t. Leur dit. - (53) |
| ziasse : agasse, pie, etc. (P. T IV) - Y - (25) |
| ziasse. n. f. - Pie. - (42) |
| zibasse, s. f. nuée d'orage accompagnée de vent et souvent de grosse pluie. - (08) |
| zible. Hièble. On prétend que l'odeur de cette plante chasse les rats des greniers. - (03) |
| ziboulée : giboulée - (39) |
| zicle, s. f. canonnière en bois de sureau, petite seringue pour lancer de l'eau. - (08) |
| zicler, zigler, v. a. lancer avec force comme par un jet, surtout en parlant d'un fluide. - (08) |
| zideler (se), sauver (se) - (36) |
| zideler (verbe) : s'émoucher. Se dit des vaches qui courent en tous sens par temps d'orage. - (47) |
| zideler, zigueler (v.) : courir la mouche (bêtes à cornes) - (50) |
| zideler, zigueler, v. n. courir la mouche. se dit des bêtes à cornes que les insectes poursuivent et qui courent à travers les pâturages : cette vache a « zid'lé » toute la journée. - (08) |
| zidrou : grosse andouille - (39) |
| zieu, leu. Œil : « in zieu ». - (49) |
| zieu, s. m. œil. - (22) |
| zieu, s. m. œil. - (24) |
| zieù, s. m., œil : « O m'a foré son dèt dans l’zieù. » - (14) |
| zieutè : v. t. Observer, regarder. - (53) |
| zieuter : regarder fixement, scruter. A - B - (41) |
| zieuter : regarder fixement - (34) |
| zieuter. Lancer un coup d'œil. Ce mot est relativement récent. Il a été formé par plaisanterie. Il est commun à toutes les régions. - (49) |
| zigairatte : cigarette - (37) |
| zighier pour gicler ou jicler. (Voir ces mots.) - (15) |
| zigotter : gigoter - (39) |
| zigouégner : se dit d'un manche d'outil qui remue - (39) |
| zigouilli : zigouiller - (57) |
| zigouner (verbe) : couper avec un outil mal affûté. - (47) |
| zigue : jambe - (37) |
| zigue : danse - (39) |
| zigue, s. f. gigue, jambe. - (08) |
| zîler : bruit d'insectes (moustiques) - (39) |
| Zin. nom de localité de Gien-sur-Cure , commune du canton de Montsauche. - (08) |
| zinde (n.m.) : gendre - (50) |
| zindre, zinre, s. m. gendre. - (08) |
| zingouais (d’) : (de) guingois, (de) travers - (37) |
| zinguer : donner un coup de sabot, faire une ruade. - (52) |
| zinguer : donner des coups de pieds - (39) |
| zinre : gendre - (39) |
| zinre, s. m. genre ; « l’ zinre himaingn' », le genre humain. - (08) |
| zinzanie. Pour zizanie. - (12) |
| zinzonner : frissonner de froid ou de fièvre - (37) |
| ziolées, s. f. plur. fêtes de mariage. - (08) |
| ziolle. Nom patois de la plante appelée « hiéble » ; les marchands peu scrupuleux emploient sa graine pour donner de la couleur au vin. - (13) |
| zipon, s. m. jupon, vêtement de femme. - (08) |
| zipoûner : tirer les habits de quelqu'un, tirailler - (39) |
| zipper : donner un coup de tête dans le pis - (48) |
| zîquiâtte (grande) : personne « montée en graine » (grande « zigue ») - (37) |
| ziquier : gicler, s’éloigner, partir rapidement - (37) |
| zîv’e : givre - (37) |
| zizi : (nm) gésier - (35) |
| zizi : Oiseau dans le langage enfantin. « Regarde dan le brave ptiet zizi ». - (19) |
| zizi, s. m. gésier. - (22) |
| zizi, s. m. gésier. - (24) |
| zizi. Oiseau. (Langage enfantin). - (49) |
| z'ment, s. f. jument. - (08) |
| znâve : genévrier - (39) |
| zno (n.m.) : genou - (50) |
| z'nos : genoux - (39) |
| z'nou, s. m. genou. (voir : geno.) - (08) |
| zo : Eux. « I z'y ant été zo deux » : ils y sont allés eux deux. Zo ne s'emploie guère que dans l'expression ci-dessus, dans les autres cas on dit ; eux : « J'y sus allé dave z'eux ». - (19) |
| zô deux – eux deux, ensemble. C'est ici un exemple du z euphonique. - Al ailain zô deux ai lai messe. – A sont tôjeur zô deux. – On peut voir Lô. - A vouraine bein, zeux ; ma lu ne veut pas. - (18) |
| zober : (zobè - v. neutre) heurter quelque chose de dur (en parlant du corps humain). - (45) |
| zogne : s. f., vielle. A rapprocher de l'ital. zonzo, bourdonnement, et sampogna, musette. - (20) |
| zoguer : faire attendre, élancer. (RDV. T III) - A - (25) |
| zoguer, v. tr., pousser avec le bout d'un bâton, frapper, serrer du coude. Un écolier dit en classe : « M'sieu, mon vouésin m'zogue. » Après une mauvaise rencontre : « L'gueùrdin ! ô t'li a zogué son rotin dans l'dos. » - (14) |
| zoinre, v. a. joindre. au participe passé « zoindu. » - (08) |
| zointeure : jointure - (39) |
| zointeure, s. f. jointure, articulation : avoir mal dans les « zointeures. » - (08) |
| zolée (n.f.) : gelée - (50) |
| zoler : geler - (37) |
| zondée : pluie subite et passagère - (39) |
| zôpè (v. neutre) en parlant d'un veau, donner des coups de museau dans le pis de la vache afin de faire descendre le lait. - (45) |
| zôpe : (zôp' - subst. f.) choc violent. - (45) |
| zôpiner : piétiner - (39) |
| zor (nom masculin) : jour. - (47) |
| zôr : jour - (39) |
| zôr, zour, s. m. jour. - (08) |
| zormer : germer - (39) |
| zormon : germon - (39) |
| zornau : mesure agraire, travail fait dans une attelée de bœuf - (39) |
| zornau, zournau, s. m. journal. (voyez jornau.) - (08) |
| zornée : journée - (39) |
| zornée, zournée, s. f. journée : aller en « zornée », aller travailler pour autrui moyennant le salaire du jour. - (08) |
| zou ! excl., vite ! promptement ! « Allons, zou ! » - (14) |
| zôu ! : expression qui signifie « allez ouste » - (39) |
| zoû (l’) : (le) joug - (37) |
| zouaie, s. f. joie, contentement, plaisir. - (08) |
| zouaïve (on) : zouave - (57) |
| zouarne : flûte. V, p. 40 - (23) |
| zouayeu, euse, adj. joyeux. - (08) |
| zoubé : assommé - (44) |
| zouber : heurter, cogner contre quelque chose - (48) |
| zoûerlaimine (fâre) : employer des explosifs pour creuser un puits - (37) |
| zouin (nom masculin) : gras de porc mis à sécher dans un boyau et utilisé notamment pour soigner les gerçures. - (47) |
| zouli (-e) (n.et adj.m. et f.) : joli (-e) - (50) |
| zouli, adj. joli, agréable, gracieux. — nom de bœuf. - (08) |
| zouna (on) : zona - (57) |
| zoupe : choc lors d'une chute - (48) |
| zouper, jouper (v.) : sauter - (50) |
| zoûr (âte ai) : (en) avoir terminé avec le travail que l’on s’était tracé dans les temps impartis (contraire : « âte embourbé ») - (37) |
| zoûr nâssant (l’) : (le) lever du jour - (37) |
| zourmer. v. n. Germer. (Ibid.). - (10) |
| zournau (ain) : une surface cultivable (variable, mais en moyenne de 33 ares, 33 centiares) - (37) |
| zourneau (ain) : (un) journal quotidien - (37) |
| zouye, zouille. n.f. - Oie. (F.P. Chapat, p.199) - (42) |
| zozo, celui qui joue le rôle de niais. - (16) |
| zozo, s. m. un zozo est un individu qui est costumé d'une manière bizarre ou grotesque. - (08) |
| z'ter, v. a. jeter. - (08) |
| zu (n.m.) : joug pour l'attelage des boeufs - (50) |
| zu : joug - (39) |
| zu : joug. - (52) |
| zu, interj. pour chasser un chien. - (08) |
| zu, s. m. joug des bœufs. Environ de Corbigny. - (08) |
| zuarne (n.f.) : cornemuse - (50) |
| zue, s, f. lieu où l'on fait rouir le chanvre, rouissoir, routoir : « l’ cindre ô dan lai zue », le chanvre est dans le rouissoir. - (08) |
| zui, v. n. jouir : « i veu zui, qu'a zuisse d' son bin », je veux jouir, qu'il jouisse de son bien. - (08) |
| zulotte : demi-joug pour une seule bête - (39) |
| zut ! dire zute ! à quelqu'un est lui dire qu'on ne le craint pas, qu'il n'aura pas ce qu'il demande. Cette expression est familière ; elle peut se traduire par : tu peux chanter. On passe toujours l'index sous le nez, lorsqu'on dit : zute ! Un parallèle de zute est beurnike. - (16) |
| zuze, zuize, s. m. juge. - (08) |
| zuzement, zuizement, s. m. .jugement. - (08) |
| zuzer, zuizer, v. a. juger. - (08) |
| zyeuter, yeuter v. Regarder fixement, épier. - (63) |
