| Le MorvandiauPat | Les parlers bourguignons-morvandiaux |

Printemps 2000. J’ai le plaisir de vous présenter quatre feuillets consacrés à la musique la plus communément pratiquée en Morvan et dans le reste du Monde. Cette musique interprétée par l’instrument à vent et à cordes le plus communément répandu chez les bipèdes- saufs les muets bien entendus- c’est la langue. La langue d’ici, à la fois langue vivante et langue de mémoire vive, mais aussi les
langues de partout, de partout car il est dit que les cultures régionales ne se sauveront que par la force de leur solidarité.

des Langues er Patois de Bourgogne |
|||||
des Langues er Patois de Bourgogne |
|||||
| 2015-1 (N°28) | 2015-2 (N°29) | 2015-3 (N°30) | 2015-4 (N°31) | ||
| 2014-1 (N°24) | 2014-2 (N°25) | 2014-3 (N°26) | 2014-4 (N°27) | ||
| 2013-1 (N°19) | 2013-2 (N°20) | 2013-3 (N°21) | 2013-4 (N°22) | ||
| 2012-1 (N°15) | 2012-2 (N°16) | 2012-3 (N°17) | 2012-4 (N°18) | ||
| 2011-1 (N°10) | 2011-2 (N°11) | 2011-3 (N°12) | 2011-4 (N°13) | ||
| 2010-1 (N°4) | 2010-2 (N°5) | 2010-3 (N°6) | 2010-4 (N°7) | 2010-5 (N°8) | 2010-6 (N°9) |
| N°29 - 2008-1 | N°30 - 2008-2 | N°31 - 2008-3 | |
| N°25 - 2007-1 | N°26 - 2007-2 | N°27 - 2007-3 | N°28 - 2007-4 |
| N°21 - 2006-1 | N°22 - 2006-2 | N°23 - 2006-3 | N°24 - 2006-4 |
| N°17 - 2005-1 | N°18 - 2005-2 | N°19 - 2005-3 | N°20 - 2005-4 |
| N°14 - 2004-1 | N°15 - 2004-2 | N°16 - 2004-3 | |
| N°9 - 2002-1 | N°10 - 2002-2 | N°11 - 2002-3 | |
| N°5 - 2001-1 | N°6 - 2001-2 | N°7 - 2001-3 | N°8 - 2001-4 |
| N°1 - 2000-1 | N°2 - 2000-2 | N°3 - 2000-3 | N°4 - 2000-4 |
La première édition des Noëls Bourguignons parut en 1700 sous le titre de Noei tó novéa composai en lai rue du Tillô chez Jean Ressayre à Dijon. Cette première édition comportait 13 noëls en patois bourguignon.
Les noëls de Bernard de La Monnoye connurent en Bourgogne, mais même au-delà des limites de la Province, un très grand succès.
Dans ses noëls, Bernard de La Monnoye, sous couvert de l'usage d'un patois peu répandu au-delà de la Bourgogne, s'est permis d'écrire avec un ton plutôt libéré et a inséré au sein de ses noëls des critiques sur la société d'où son surnom de "bourguignon salé". Cela lui valut quelques contestations mais qui n'ont en rien nuit à la large diffusion de ses noëls auprès du public.
L'édition de 1720 constitue, dans l'histoire des éditions des Noëls Bourguignons une étape importante. C'est en effet la première à proposer un glossaire alphabétique à la suite des noëls contenant des définitions, des explications étymologiques voire des anecdotes sur la plupart des termes bourguignons des noëls.
Elle paraît en 1720 sous le titre Noei Borguignon de Gui Barôzai, quatreime edicion don le contenun at en fransoi aipré ce feuillai. C'est aussi la première édition où le pseudonyme de Gui Barôzai figure de manière aussi explicite dès la page de titre. Tout laisse à penser que, dans cette édition, l'auteur prend toutes les précautions possibles pour ne pas être reconnu.
Jacquin Lucie
Attention : Les 3 points de suspension qui suivent un mot, indiquent que celui-ci ne comporte que la première définition, consultez le glossaire pour plus d'informations.
Liens : Glossaire des Noëls Bourguignons
Les Noëls Bourguignons de Bernard de La Monnoye - Jacquin Lucie - Mémoire de master 1 / juin 2016D'après mes remarques, sur huit à neuf cents mots de mon Glossaire bourguignon, il y en a plus de deux cents qui dérivent du gallois et du breton, cent soixante environ qui dérivent du latin, une trentaine venant du grec, quelques-uns de l'anglais et de l'italien, un petit nombre du tudesque, et enfin plusieurs autres ayant une étroite alliance avec les langues romanes du Nord ou du Midi. On voit par cette nomenclature que c'est l'élément gaulois qui domine ; et comment en serait-il autrement, puisque les Bourguignons se trouvèrent, après leur conquête, immédiatement en contact avec le paysan gallo-romain, qui n'avait pas oublié la langue de ses pères ?
Le Glossaire que je donne à la suite de cet exposé sommaire est non-seulement le résumé de mes lectures et de mon étude de la littérature romano-bourguignonne, mais encore des souvenirs de mon enfance et de mes remarques assidues pendant un long temps. À l'époque de mes jeunes années, plus j'étudiais le français et plus j'étais frappé de la différence et du choix de ses expressions avec celles que j'entendais journellement autour de moi, soit dans la bouche d'une vieille gouvernante qui m'avait élevé, soit chez les paysans de la contrée châtillonnaise, soit dans une partie de la ville que j'habitais avec mes parents.
C'était donc une langue particulière, dont mon éducation de collége m'éloignait ; mais d'où venait-elle et où remontait son origine ?... Telles sont les questions que je me suis souvent adressées et qui ont provoqué les études que je résume dans cet ouvrage.
Nota bene. — Il ne faut point perdre de vue que le but principal de ce Glossaire est de faire l'étude de certains mots qui, pour n'avoir jamais été analysés, ne figurent dans aucun de nos dictionnaires et sont, pour la plupart, exclus en France du droit de cité. Je dois dire qu'après avoir lu scrupuleusement plusieurs manuscrits du XIIIe et du XIVe siècles, et entre autres un de nos volumineux romans rimés des Trouvères et d'autres chansons de geste, j'ai rencontré peu d'analogies et peu de congénères de ces mots de notre idiome bourguignon : c'est donc dans des sources plus éloignées que le provençal et le français qu'il faut aller chercher leurs racines. On les trouvera en effet bien plutôt parmi les paysans que parmi les poètes, toujours épurateurs du langage ; on les rencontrera, dis-je, bien plutôt dans ce qui nous reste de la vieille langue gauloise, dans le Breton : Bretonnant (en Armorique) par exemple, que dans nos pays civilisés depuis plusieurs siècles.
L'ouest de la France est resté gaulois même après la guerre de la Vendée ; ses chants populaires, nouvellement recueillis, portent le cachet de la naïveté et de la langue primitive de notre sol. Citer l'idiome breton, c'est incontestablement rappeler les racines celtiques qui se cachent dans les replis de notre vieux langage ; mais mon intention n'est pas d'en abuser. J'exposerai loyalement mes aperçus étymologiques, et le lecteur lui-même en tirera les déductions naturelles. Loin de moi l'idée de lui rien imposer sur un terrain difficile et souvent conjectural.
Il faudra bien se rappeler aussi dans tout le cours du Glossaire suivant que la terminaison des verbes est en ai ou é à l'infinitif pour nos verbes français terminés en er ; en i pour ceux en ir, et en oi pour ceux en oir ; que la voyelle ô surmontée de l'accent circonflexe doit se prononcer eu ; qu'enfin, pour toutes les autres parties du discours, l'orthographe bourguignonne a son type et ses règles particulières, qui seront développées dans la deuxième partie.
Thomas Joachim Alexandre Prosper, Mignard - 1802-1891
Attention : Les 3 points de suspension qui suivent un mot, indiquent que celui-ci ne comporte que la première définition, consultez le glossaire pour plus d'informations.
Lien : Glossaire étymologique et comparé de l'idiome bourguignon
Le patois dont nous donnons le glossaire n'a pas une grande originalité. Tandis que le provençal, le breton, le picard, ont l'importance d'une langue, avec leurs monuments, le bourguignon et notre idiôme, son congénère, ne sont à peu près composés que de vieux mots français et de locutions exotiques que les diverses occupations étrangères ont pu laisser sur notre sol ; on y rencontre aussi des expressions autochtbones qui n'ont pas d'équivalent dans les autres patois. Un contemporain du roi Jean, s'il revenait au monde, comprendrait mieux le langage de nos paysans que celui des salons et des académies.
Ce Glossaire est loin d'être complet ; l'accent, la désinence, la configuration variant souvent d'un canton et même d'un village à un autre. On y verra du moins la physionomie de l'idiôme rustique que nos pères nous ont transmis presque sans altération dans sa naïveté première. Dornestica verba.
Jules Guillemin - 1860
Ce glossaire est composé de mots pris dans Rabelais, Froissard, Montaigne , Villehardouin , Ronsard, etc. ; dans les dictionnaires de Furetière (1690) et de Trévoux ; les grammaires de Robert et Henri Étienne, etc.; dans les glossaires de Roquefort, de Du Cange, de la chronique des ducs de Normandie ; dans le livre des Métiers, celui de la Taille de Paris (1292) ; dans les romans, fabliaux, chants et théâtre des XIIe, XIIe, et XIVe siècles , etc.
Nous ne pouvons donner à ce travail accessoire toute l'extension qu'il nécessiterait, c'est-à-dire fournir des exemples à l'appui de nos citations, ni même indiquer pour chacune d'elles l'auteur où nous avons puisé; nous nous bornerons donc à donner en première ligne le mot français authentique, avec sa signification actuelle, puis, en italique, le vocable morvandeau correspondant, quand il en diffère.
LATIN. Nous ne citerons ici que les mots particuliers à notre patois et qui ne se trouvent, que nous sachions, ni dans l'ancien fiançais, ni dans les autres dialectes. Ces mots sont en petit nombre, mais nous ne doutons pas qu'une étude plus complète du morvandeau n'en fasse découvrir bien davantage. Mot suivi d’un « L »
Histoire de Château-Chinon - E. Bogros - 1864
Après la publication du savant mémoire de l'honorable secrétaire de la Société d'Archéologie sur le patois de la Bresse chalonnaise en général, et du canton de St-Germain-du-Bois en particulier, il semblera peut-être inutile de s'occuper de celui d'un autre canton contigu. Cependant, comme il le dit lui-même, de nombreuses variantes existant entre les divers lieux de ce pays, à tel point même que les habitants de St-Germain ne comprendraient rien au pur langage de ceux de Montpont ou de Varennes-St-Sauveur, il est possible qu'on trouve quelque intérêt dans la comparaison de celui du canton de Montrêt, outre un beaucoup plus grand nombre de mois.
Le dialecte dont il s'agit est parlé non-seulement dans toutes les communes du canton, mais encore dans plusieurs du voisinage, telles que celles de Baudrières, de St-Germain-du-Plain, de Lessard, de Thurey et de Tronchy. C'est le patois des Boutards ou habitants des bois, ainsi qu'on l'appelait autrefois, pour le distinguer du patois des Tappons, du patois des Bressans et autres. On ne doit pas chercher les racines de ce dialecte dans la langue des Grecs, ni des Celtes , ni des Bourguignons ou des Francs. Tous les mots en paraissent dérivés de la langue latine défigurée dans le Moyen-Age, comme ceux des langues française, italienne et espagnole. Ce patois remonte donc à la domination romaine, dont les ruines recouvrent encore le sol du pays. Il a survécu à cette domination, malgré l'invasion des Barbares du nord et la destruction de toutes les habitations. On pourra en juger par le vocabulaire d'un assez grand nombre de mots qu'on va en donner. Il se rapproche plus du bon français que le patois bressan du département de l'Ain et des cantons de Cuiseaux et de Montpont ; plus aussi que le patois Tappon de St-Usuge, Mantcony, Frangy, etc.
On le distingue surtout :
B. Gaspard docteur-médecin - 1866
Lien : Notice historique sur la commune de Montrêt (arrondissement de Louhans )
Remarques préliminaires essentielles :
Un dialecte est le langage écrit d'une ancienne province ; le patois est le langage vulgaire et non écrit de cette même province. Le Vocabulaire suivant offre l'étude raisonnée et comparée de ces deux langages ayant eu cours dans l'ancienne province de Bourgogne.
Les exemples du dialecte sont pris dans les meilleurs documents du moyen âge, et les exemples du patois sont choisis dans les documents du langage le plus populaire et le plus exactement reproduit.
L'utilité du Vocabulaire dont il s'agit est de présenter et d'expliquer les vocables que Lamonnoye, limité au petit nombre d'expressions de ses noëls, n'a pu donner lui-même dans son Glossaire de ces noëls, et d'obtenir ainsi un dictionnaire assez général du patois bourguignon.
J'ai recueilli, dans celui que je donne, les mots, les locutions, les proverbes, les dictons empruntés au langage parlé, et j'y ai consigné tous les vocables qui rappellent le mieux les moeurs, les coutumes et l'histoire de la province ; de plus, j'y ai signalé plusieurs analogies de langage que présentent d'autres provinces avec celle de Bourgogne ; j'y ai reproduit l'orthographe qui était usitée dans le dialecte et j'y ai écrit les mots du patois comme le veut l'usage et comme l'écrivent nos poètes les plus populaires.
Il faut qu'on sache bien d'abord que, dans le patois bourguignon, la terminaison de l'infinitif des verbes est en ai ou é pour ceux de la 1re conjugaison terminés en er dans le français ; qu'elle est en i pour ceux de la 2e conjugaison terminés en ir, et en oi pour ceux de la 3e conjugaison terminée en oir ; qu'enfin la voyelle ô surmontée de l'accent circonflexe se prononce eu.
La science est en mesure d'affirmer aujourd'hui, contre des opinions vagues et légères, que les patois ne sont pas plus un langage de convention que les idiomes d'oc et d'oïl sortis comme eux du latin et du roman ; et qu'à côté des dialectes épurés ou d'une langue mûre, il y a eu et il y aura toujours un parler vulgaire, un patois dont la source n'a été et ne sera jamais différente de la leur.
Ces simples remarques indiquent le but et les motifs du Vocabulaire suivant.
Table des abréviation employées au vocabulaire.
M. Mignard de l'Académie de Dijon – 1870
Lien : Vocabulaire raisonné et comparé du dialecte et du patois de la province de Bourgogne - 1870
François Merle (1819-1879) ne s'est pas intéressé au patois d'une région plus ou moins bien définie (comme le Morvan ou l'Auxois), mais au patois de son seul village natal, Montigny-Saint-Barthélemy, dans le canton de Précy-sous-Thil, un peu au sud de Semur, dans l'Auxois, aux limites du Morvan (une des communes voisines est d'ailleurs Dompierre-en-Morvan et on peut même dire légitimement que Montigny appartient au « très grand Morvan »...
Le dossier
Malheureusement, comme le montre le dossier qui nous a été confié par Madame Pavese, François Merle n'eut certainement pas le temps d'aller au bout de son projet. La page des conjugaisons est datée du 28 juillet 1875 (monsieur le Curé n'a plus que 4 ans de vie) ; le dossier est constitué de 16 pages ; certaines de ces pages sont des brouillons ; d'autres sont manifestement plus élaborées, même si l'ordre alphabétique n'est pas parfaitement respecté ; souvent les mêmes mots sont repris. On trouve d'autre part des formes qui attendent une définition. Dans l'ensemble les notes sont assez lisibles, à condition de connaître un peu le patois et d'utiliser une bonne loupe, car l'écriture de monsieur le Curé était vraiment petite. Nous avons reproduit ce qui nous a semblé être la première page ; on y trouve la lettre A, suivie immédiatement de la lettre C. Nos lecteurs pourront la comparer avec la première page de ce glossaire que nous avons essayé de rétablir, plutôt que d'établir.

Le patois de Montigny
Le patois du village natal de François Merle est celui de l'Auxois, au sud de Semur ; nous ne voudrions pas fatiguer nos lecteurs avec une étude phonétique (que nous serions d'ailleurs incapables de faire à partir des seuls documents écrits). On pourra se limiter à quelques faits ; le r disparaît devant certaines consonnes ; c'est le cas de porter devenant pot'ier ; le fait se retrouve dans tout le nord-est du département, y compris dans les environs de Dijon (où toutefois la consonne ne connaît pas d'altération palatalisante puisque porter devient poter). Dans cette région, le z ' (z palatal) devient, comme dans tout le nord-est du département, sauf à Dijon où il devient z comme en français commun (sans doute sous l'influence de la ville, attirée par la « bonne prononciation » et le « beau parler »). On trouvera sans mal des exemples dans des mots comme naiger «rouir» qu'on pourra comparer avec le dijonnais naisou, nom d'une fontaine sur les pentes du Mont Afrique, bien connue des marcheurs du dimanche et des autres jours. Le s palatal devient ch dans des formes comme picher « pisser » (évolution inconnue dans les environs de Dijon).
Enfin le suffixe -eau (du latin -ellu) devient ici -è : (voyelle longue) que François Merle écrit aix ou ais (graphies nous n'avons pas modifiées), alors que dans les environs de Dijon, il devient -ya :, dans des mots comme paisseau (échalas) devenu ici paichaix, mais paissiâ à Dijon.
Le vocabulaire
Le glossaire proposé par François Merle est riche d'environ 300 mots ; c'est peu par rapport à beaucoup d'ouvrages identiques ; il convient de penser que c'est un travail imparfait et qu'une véritable recherche eût nécessité des séjours plus constants à Montigny. Il est évident que l'abbé n'avait pas le temps de se livrer à cette activité qui l'eût éloigné de ses ouailles de Fontaine. Et on sait que son ministère dépassait largement la religion. On peut penser qu'il a travaillé beaucoup avec sa mémoire d'enfant et d'adolescent. On notera que le vocabulaire des techniques agricoles est peu représenté, de même que les noms des plantes et des animaux, sinon les plus fréquents comme le houx et la pie. En revanche, certains termes peuvent être considérés comme faisant partie du français régional. Mais ces quelques lignes nous apportent, malgré leurs lacunes, un rare témoignage sur la langue de nos proches ancêtres, plus proche de celle de Molière que de celle de Vercingétorix. Que François Merle en soit remercié, par-delà les années qui nous séparent de lui.
Documents commentés par Gérard Taverdet - 04 / 2013
Le Glossaire du Morvan renferme les principaux échantillons de l'idiome parlé dans l'enceinte d'une circonscription relativement assez étroite, circonscription qui emprunte ses limites naturelles, on l'a déjà dit, à la constitution géologique de son territoire. II offre un champ d'études tout à fait neuf aux investigations des philologues.
En dépit de nos longues recherches, nous ne le croyons pas complet. II n'est guère possible de ramasser du premier coup dans un cadre donné tout le langage d'une population. Beaucoup de mots, les plus intéressants peut-être, demeurent en-dehors de cette première récolte parce qu'ils se présentent rarement dans l'usage. Ces mots, s'ils se conservent au fond de nos solitudes, formeront l'arrière-ban du contingent morvandeau.
Tel que nous avons pu le composer cependant nous espérons qu'il ne sera pas sans utilité.
La Chaux, juillet 1878. - Eugène de Chambure (1813 – 1897)
Attention : Sur cette page n'apparait que la première définition, consultez le glossaire pour beaucoup plus d'informations.
Lien : Glossaire du Morvan

Il est à désirer que les petites localités puissent trouver leurs historiographes; par eux, bien des objets ignorés seront tirés de l'oubli ou de la destruction, bien des sujets serviront plus tard à fournir une lumière inattendue ; de l'ensemble de ces petites histoires sortira naturellement la véritable histoire de la nation.
L'homme qui se livrera à ce travail ne devra espérer ni de nombreux lecteurs, ni l'éclat d'une œuvre intéressante, mais il aura la satisfaction d'avoir facilité des recherches utiles aux habitants et d'avoir, en les groupant, donné quelque valeur à des débris qui n'en avaient aucune dans leur isolement. Il sera personnellement assez rémunéré par la jouissance de fouiller le passé, de sentir, à la moindre découverte, ces émotions qui doublent la vie ; de se créer enfin des occupations variées, incessantes, très-actives, qui mettent l'existence à l'abri de l'ennui, des défaillances du cerveau et des épreuves naturelles à l'humanité.
Ce modeste travail est, par sa nature, réservé à l'homme qui, après une vie laborieuse, éprouve toujours, dans le calme de la retraite, le besoin d'occuper les facultés qui lui restent ; un petit jardin, des goûts modestes et des recherches historiques suffisent largement pour lui assurer une heureuse vieillesse.
Châtel-Censoir, le 10 janvier 1880.
Recherches sur l'histoire de Châtel-Censoir - E. Pallier
Lien : Bulletin de la Société des Sciences Historiques et Naturelles de l'Yonne - Année 1880
Notre Société a compris l'utilité de ce travail et a voulu y apporter son contingent. Elle a confié la mission de l'exécuter à une commission de cinq de ses membres. Celle-ci avait déjà à sa disposition divers glossaires de certains cantons, de quelques communes, que le Bulletin de la Société avait publiés à diverses époques. Elle a voulu élargir la source de ses informations et, à cet effet, elle a, par une circulaire explicative et détaillée, invité tous les instituteurs du département à recueillir, avec soin et maturité, tous les mots qui, bien qu'exclus du Dictionnaire de l'Académie, étaient encore habituellement usités dans leurs résidences, et à lui en adresser un relevé aussi complet que possible. Un grand nombre d'entre eux ont déféré avec empressement à cette invitation, et, après plusieurs mois d'étude, ont transmis à la Commission des relevés et des séries si étendus, qu'ils pouvaient presque passer pour des dictionnaires du patois de leur localité. Il s'agissait alors de faire de ces cinquante ou soixante relevés, une concentration qui les réunirait tous dans un ensemble à soumettre à un examen et à une appréciation attentive...
...Mais il restait à faire une autre et non moins épineuse étude. C'était, sur chaque mot, sur sa véritable signification, sur la recherche de son origine, et sur son interprétation exacte, un travail d'appréciation, qui devait souvent faire exclure tout ce qui n'était que le mot français faiblement défiguré par une prononciation vicieuse, et à chaque mot conservé attacher une traduction à la fois nette et concise. M. Jossier, auteur déjà d'un précieux et vaste dictionnaire des termes employés à tous les degrés et par tous les agents et ouvriers de l'industrie de la construction, était naturellement désigné pour ce nouveau travail, et il l'a accompli avec un zèle, une perspicacité et une précision de style auxquels nous ne saurions donner trop d'éloges. C'est son œuvre, révisée seulement par nous, que nous présentons à la Société et au public.
Nous avons cru devoir prendre pour titre, non le Dictionnaire du Patois, mais le Dictionnaire des Patois de l'Yonne. C'est que ce département a été formé d'une partie de l'Auxerrois avec sa Puysaie, d'une partie de la Bourgogne avec son Morvand, et de plusieurs autres cantons empruntés au Sénonais et à la Champagne, et que les patois de ces diverses contrées n'ont souvent aucune ressemblance. Quoique nous soyons du centre de la France, le langage de nos campagnes ne ressemble guère à celui du Berry que M. le comte Jaubert a donné pour le patois du Centre, et nos patois du Morvand et de la Puysaie, si profondément différents l'un de l'autre, le sont au moins autant de ceux de nos vignobles auxerrois, et de nos plaines de la Champagne et du Sénonais.
Bulletin de la Société des Sciences Historiques et Naturelles de l'Yonne - 1882 -
Lien : Bulletin de la Société des Sciences Historiques et Naturelles de l'Yonne - Année 1882
Grâce au concours de nos fidèles collaborateurs, MM. l'abbé Doret, le docteur Gillot, le colonel Désveaux, François Dejussieu, nous pouvons publier une nouvelle liste des vocables propres au Morvan autunois...
Un écueil à éviter dans la formation de notre Glossaire, c'est de recueillir certains vocables empruntés à l'argot des faubourgs urbains. Ces vocables n'ont en effet aucun rapport avec le but que nous poursuivons. Les mots que nous recherchons appartiennent, sinon à une langue éteinte, au moins à une langue stationnaire et qui ne s'enrichit plus tandis que l'argot croît et se développe chaque jour dans les sous-sol du langage contemporain, avec une déplorable fécondité. Cette distinction est essentielle. Elle s'impose et doit toujours être présente à l'esprit de nos collaborateurs, afin d'abréger un travail d'élimination qui exige souvent de longues recherches et absorbe un temps précieux. La recherche et l'étude des vocables propres au langage local suffisent à notre tâche qui perdrait son utilité et son intérêt par la confusion du passé avec le présent. Réunissons donc précieusement les uns et laissons les autres dans les lieux où ils ont pris naissance, et le quart d'heure de chaque séance que nous réservons à la formation de notre Glossaire sera utilement occupé.
Lien : Mémoires de la Société éduenne. Tome 18 - Glossaire du Morvan Autunois - 1890.
La forme locale du langage et l'accent du pays d'origine constituent pour chaque homme un des caractères les plus marqués de son individualité. La façon dont chacun de nous parle est un signe plus sûr pour le faire reconnaitre que les données les plus rigoureuses de l'anthropométrie, fut-ce cette fameuse empreinte du pouce qui ne se retrouve jamais la même pour des millions de sujets.
II en a toujours été ainsi dans tous les temps, et pour tous les peuples.
Donc nous avons un accent particulier et des vocables à nous. De cet accent je n'ai rien à dire, il est, et voilà tout. Mais j'ai pensé qu'il serait peut-être intéressant de grouper en un recueil ces expressions particulières à notre ville et à ses environs. Ce genre de travail à été fait pour plusieurs provinces, et il a été favorablement accueilli par les personnes curieuses de la littérature locale.
Outre cet intérêt, un vocabulaire de nos provincialismes peut avoir une utilité assez grande pour l'histoire générale du langage, surtout au moment où le nivellement de la Iangue française, si l’on me permet cette expression, s'achève avec rapidité. La facilité des moyens de communication, les voyages multipliés qui mettent aujourd'hui en relation constante toutes les villes de province avec Paris, les liens commerciaux qui se nouent en un réseau serré sur toute l’étendue du territoire, mélangent les dialectes dans un courant incessant. Ils y perdent leur originalité, et il est aisé de constater, sans sortir de notre ville, que beaucoup de nos vocables spéciaux sont d'un usage de plus en plus restreint. La classe lettrée ne s'en sert plus du tout, la bourgeoisie s'en défie, et l’on ne retrouve plus guère intacts, que dans les faubourgs, les vrais mots bourguignons. Encore est-il certain que beaucoup vieillissent et seront promptement tomb »s en désuétude. II est des pages de mon modeste volume qui ressemblent à un herbier, elles renferment des fleurs à demi desséchées. Encore un peu et elles n'auront plus ni couleur, ni odeur, ce seront des expressions qu'on ne comprendra plus et qu'exhumeront avec surprise les du Cange de l’avenir. Hâtons-nous de les cueillir pendant qu'elles fleurissent encore dans les parterres de la Grille de fer, de la Porte au fermerot, de la Porte Guillaume, du Pont Arnaud, etc., partout enfin ou ce dialecte fournit à la verve un peu gouailleuse des Dijonnais le secours de ses pittoresques ressources.
Ce petit vocabulaire ne vise nullement à la science ; on s'en apercevra de reste dès la première page. II n'a pas non plus la prétention d'être complet ; quel est donc le dictionnaire complet, en quelque genre, et en quelque nombre de volumes que ce soit ?
Beaucoup d'expressions ont du echapper à mes patientes recherches, et bien que d'aimables collaborateurs, plus érudits et plus compétents que moi, aient eu la gracieuseté de joindre leurs efforts aux miens, je suis certain que de nombreux oublis me seront signales. Cependant, je demande qu'on passe au Littré ces oublis avant de me les reprocher. Combien ces quatre volumes m'ont arraché d'illusions, et combien de mots charmants, dont je m'enorgueillissais déjà, ils m'ont pris pour les remettre dans le grand fonds commun de la langue francaise ! Je cite à la volée : chapoter, manigance, ouvrée, margoullis, mâchurer, requinquer, sapine, tire-larigot, agasse, affutiau, poussier, girie, gargouiller, paisseau, patrouiller, casse, trôler par les rues, etc., etc. Oui, tous ceux-là, je les croyais à moi, et j'ai dû les rendre ! Mais il en est, par exemple, que je ne veux pas restituer, ce sont ceux dont certains de nos voisins se servent, surtout ceux de l’Est, comme choses à eux propres et personnelles, et qu'ils nous ont tout bonnement empruntés ! Quand ils m'auront démontré que ces mots sont leurs propres créations, venues sans notre aide, je ferai droit à leurs revendications, en attendant, je défends notre bien !
Je dis notre, avec intention, car, on le comprend, je fais avant tout une œuvre bourguignonne. Aussi, dans ce petit livre, par nous, ce sont les Bourguignons que j'entends, de même que quand j'emploie le mot national, cela veut dire bourguignon, et plus particulièrement bourguignon dijonnais.
Non que je veuille défendre nos fautes de langage, mais j'ai pour elles quelque tendresse, qui rappelle celle des parents pour les enfants mal venus. Et puis, fautes est bientôt dit ! Qui donc décidera que ces jolis verbes clairer, trésir, trocher, achatir, etc. ne sont pas aussi français que leurs frères des dictionnaires classiques ? Qui donc a la certitude de posséder le dépôt indiscutablement sur du français impeccable, régulier, immaculé ? Sont-ce les Parisiens ou les Berrichons, les Marseillais ou les Ponantais ?
Inutile débat !
Les Athéniens parlaient l'attique, les Florentins parlaient le toscan, les Dijonnais parlent le bourguignon !
Cunisset-Carnot - Dijon le 18 juin 1889
Lien : Vocables Dijonnais
... Le langage bourguignon, particulièrement celui de Beaune, adoucit les aspirations : manche fait moinge, d'où remoingeoux, celui qui fait métier de rebouter les membres disloqués ; sarcher pour chercher...
L’r des infinitifs est constamment muet : i vas parti, j'aillons maingé. Nous sommes plus logiquesque le français qui prononce l’r dans les infinitifs en ir comme finir, et qui le tait dans ceux en er comme manger. Ss se prononcent quelquefois ch : il en est ainsi pour le substantif poichon et pour les verbes laichier et picher. Ici, comme ailleurs, il n'y a pas de règle, car nous disons raimasser et non raimacher.
J'ai éliminé de ce Dictionnaire une foule de mots qui ne sont qu'un français différemment accentué, comme aidier pour aider, fouâcher pour faucher, laicher pour laisser, liquot pour loquet, miot pour muet, moichenou pour moissonneur, ousiau pour oiseau, cuchin pour coussin, etc. J’ai surtout évité d'admettre certains mots français que je suis bien surpris de rencontrer dans des glossaires bourguignons, tels que : bahut, goulot, haquenée, pelouse, poltron, taquin, s'accointer, etc.
Les indications qui précèdent sont loin d'être suffisantes : rechercher dans nos mots patois, dans leurs déclinaisons, dans leur syntaxe, la part qui revient aux diverses langues d'où ils sont tirés, est un travail trop au-dessus de mes forces. Je me contente de poser ici quelques jalons, abandonnant aux maîtres de la philologie le soin de tirer quelque profit du présent Dictionnaire ...
Ch. Bigarne - 1891
Lien : Patois & Locutions du Pays de Beaune - Contes & Légendes – Chants populaires
Voici un Glossaire tout entier de création nouvelle. Aucune publication spéçiale n'existe, pour Verdun au moins, ayant pu nous servir de point de départ. Nous avons tout pris sur le vif...
Pour mieux atteindre ce but, nous reproduisons, à l'appui de presque tous les mots, des phrases du cru dans lesquelles ces mots figurent, révélant ainsi leur véritable acception.
Sans aucun texte imprimé où puiser des exemples, nous avons dû nous contenter de ces autorités orales. Toutes les formules citées sont de celles journellement employées par nos populations, et partant, d'une authenticité que nul n'aura la pensée de contester...
La région dialectale de notre Glossaire s'étend de Verdun-sur-Doubs à Chalon-sur-Saône. C'est une très minime portion du département de Saône-et-Loire, pour lequel on pourrait certainement dresser plus d'une demi-douzaine de glossaires. C'est suffisamment se restreindre. Cependant plusieurs lexicographes se sont restreints davantage. Chaque village, chaque hameau pourrait, en effet, fournir un recueil de mots ; mais sur cette échelle la lexicologie deviendrait excessive... elle arriverait à ses trente-six mille vocabulaires. On ne doit pas encore songera cet enfantement.
S'en tenir à nos anciennes provinces serait trop peu diviser le travail ; établir deux ou trois dictionnaires par département donnerait déjà, un formidable résultat. C'est dans cet ordre d'idées que nous avons essayé notre groupement. Quel qu'il soit, nous croyons avoir, en le faisant, apporté notre petit caillou au monument que préparent les dialectographes.
François Fertiault - 1896
Lien : Dictionnaires du langage populaire Verduno-Chalonnais
De la prononciation nous signalerons simplement les particularités les plus remarquables.
Les diphtongues au, eau, se changent en id ; couteau, château, se prononcent coutid, chatid.
Ui se prononce eu ; pleue, aufd'heu ou dj’d'heu, treue, pour pluie, aujourd'hui, truie.
Eu se change en ou ; enjôlou, mentou pour enjôleur, menteur.
La consonne l est mouillée quand elle est précédée d'une labiale ou d'une gutturale : bliaude, gliaude, pour blaude (blouse), Claude. Les petits couteaux d'un sou fabriqués à Saint-Claude, dans leJura, sont appelés, par abréviation, des gliaudes et même des yaudes.
Sont mouillés également tous les mots où se trouve intercalée la consonne s : maison, raisin, oiseau deviennent mâyon, râyin, ouyau ou uyau et même uyâ.
Enfin, tout vrai Bourguignon, même parlant bien français, décèle immédiatement son origine a sa façon d'allonger l'a lorsque cette voyelle se trouve comprise dans un mot terminé par une syllabe muette (en général tous les mots en able) et, au contraire, d'abréger la voyelle o dans les mots terminés en ot ou en op ; ainsi l’a se prononce comme s'il était surmonté d'un accent circonflexe dans : rave, cave, jacques, table, grave, valet, avare, qui deviennent râve, câve, Jâcques, etc., et l’o devient bref, aigu, dans gigot, canot, marmot, haricot, magot, sirop, galop, etc.
Cependant la prononciation de l’a redevient normale lorsque cette voyelle ne précède plus immédiatement la syllabe finale muette. Ainsi, ravier, caverne, jaquette, tablette, gravier, valetaille, avarice, qui sont des augmentatifs des mots pris ci-dessus comme exemples, se prononcent correctement.
Quant à ce qu'on est convenu d'appeler l'accent du pays, il tient le milieu entre la redondance méridionale et le grasseyement des hommes du nord. II consiste principalement en une manière chantante de parler qu'il est impossible de représenter par des caractères typographiques.
Enfin, malgré son imperfection, la présente étude sera, nous l'espérons, un jalon posé dans la voie où il est désirable de voir s'engager les recherches des philologues provinciaux ; nous souhaitons qu'en la parcourant nos compatriotes croient sentir cette fraiche saveur de terroir que fait passer sur les lèvres le vin exquis de nos coteaux.
A chaque mot cité, la forme donnée la première est celle qui se rapproche le plus de la racine étymologique.
La prononciation est indiquée, aussi approximativement que possible, par des accents graves ou circonflexes, suivant que la syllabe est brève ou longue en patois.
Quant aux indications de départements, placées entre parenthèses après chacune des formes des mots cités, elles se rapportent aux régions bourguignonnes dans lesquelles sont usitées ces formes.
Pour alléger le texte et en faciliter la lecture, ces indications ont été abrégées de la manière suivante :
Côte-d'Or (C.-d.), Chalonnais (Chal.), Charollais (Char.), Bresse (Br.), Morvan (Morv.), Dijon ou Dijonnais (Dij.), Yonne (Y.).
A. Perrault-Dabot - 1897
Lien : Le Patois Bourguignon
Non ; le patois est de beaucoup plus ancien que le français actuel, puisqu'il était la langue des vieux Bourguignons, de leurs rois, de leurs ducs, tandis que le français actuel ne remonte guère qu'à trois siècles ; de sorte que, sauf quelques mots empruntés aux langues celtique et gauloise, le patois bourguignon continue la langue déformée des peuples latins, c'est-à-dire, la langue romane ; langue dont le français a tempéré les rudesses, mais non sans altérer souvent ses analogies avec le latin.
Voici quelques avis à retenir pour la lecture de notre patois.
Abbé Philippe Garnier(1824-1902 ?)
Lien : Nuys, Nuis, Nuiz, Nuits, Nuits-Saint-Georges : son histoire dans les temps et son patois
Édité avec une introduction et des notes par M. André MARY.
Le présent glossaire a été rédigé d'après les notes du regretté M. Georges Potey à qui l'on doit de nombreux articles d'histoire et d'archéologie locale et une Histoire de Minot demeurée manuscrite. Ces notes, prises par l'auteur au cours des années 1901-1903, ont été relevées par lui-même en 1905, en deux séries alphabétiques : la première comprend les mots patois proprement dits ou sans correspondants dans le français usuel, avec la signification en regard ; le seconde se présente sous l'aspect d'un lexique français-patois pour les termes courants ayant une étymologie commune ; une liste de locutions, de. proverbes et de formules enfantines complète ce vocabulaire, où l'auteur n'a cessé d'intercaler des additions jusqu'en 1910. Il était dans le dessein de M. G. Potey de refondre son travail et d'en combler les lacunes : la mort ne lui a pas permis d'exécuter ce projet. Tel qu'il est, le recueil qu'il nous a laissé m'a semblé apporter une contribution non négligeable à l'étude des parlers populaires de la Bourgogne, et j'ai pensé faire oeuvre utile en l'éditant. On en trouvera ci-après toute la matière ; les mots, transcriis d'une façon simple et claire, ont été reclassés dans une seule catégorie et selon un ordre strictement alphabétique ; à la suite figurent formules, expressions et idiotismes divers. J'ai fait précéder le tout d'un petit précis grammatical dont la préface esquissée par M. G. Potey et principalement les mots et les phrases du glossaire m'ont fourni les éléments.
Georges Potey
Lien : Le patois de Minot par Georges Potey
Notre collègue, le vénérable chanoine Denizot, de Dijon, m'a envoyé, il y a déjà longtemps, un vocabulaire patois, formant un manuscrit de trois cents pages, dont 154 de vocabulaire proprement dit, 6 de supplément, 126 de causeries ou de chansons, 2 d'étymologies, le tout précédé de 12 pages de préliminaires, prononciations, quelques temps de verbes. C'est un travail considérable dont je suis autorisé à disposer. Mon choix ne pouvait être douteux quel dépôt était mieux désigné que notre Société, la Société d'Histoire et d'Archéologie de l'arrondissement de Beaune du chanoine Denizot, arrondissement auquel appartient Sainte-Sabine ? Ce volume ne saurait avoir une meilleure place.
Il est à remarquer que Patois de Sainte-Sabine varie beaucoup du nôtre, beaucoup de celui de Dijon, beaucoup de tous les patois au fond c'est le même, mais la prononciation, quelle différence. Plus on s'élève dans les régions montagneuses, plus elle devient rude...
Je prétends que mon patois de Sainte-Sabine serait célèbre comme celui des environs de Dijon, si Sainte-Sabine, au lieu d'être un petit village, était une grande ville, et qu'il s'y fût trouvé un La Monnoye en temps opportun, par exemple il y a une cinquantaine d'années.
Eh bien au moins, il s'y trouvera un Denizot.
Je prends ce patois au milieu du XIXe siècle, alors que nous l'entendions encore de la bouche de nos grands pères et de nos grand'mères. A cette date il s'est déjà bien gâté dans la compagnie du français il a pris des manières de Monsieur son style en général, ses locutions, ses tournures de phrases, sont bien altérées toutefois il n'a pas mal gardé les mots. De sorte que, malgré sa mine de parvenu il a conservé son air de paysan des Montagnes.
Photographions-le à ce point il est temps.
J'ai vu, il y a trente ans au plus, (mettons vers 1830), que quelqu'un, revenu d'un pays éloigné où il parlait français, n'aurait pas osé continuer dans sa famille, ou devant ses camarades, dans la crainte de paraître fier ou pédant ; maintenant on s'en fait une gloire au contraire. Et même, sans avoir voyagé, on en voit qui s'essayent à parler autrement que la masse du peuple. Moi-même j'ai été du nombre de ceux-ci. Pardonne-moi mon cher, patois, si je t'ai négligé ou pour mieux dire trahi. Je t'aime toujours bien, va c'est pourquoi je vais parler de toi au long, et ceux qui ne t'ont pas connu seront bien aise d'avoir ton portrait. "Pour mouai d'abord i me raipeule que quan i étâ petiot, i demandà ai mon père ou bein ai main mére queman qu'on perlo ai Vandenausse, ou bein ai Châsilley, ou bein ai Ch'taisneu. I me souvain aito qui étâ bein âille (i) Aise.
Abbé J. Denizot, chanoine
Lien : Vocabulaire patois (Sainte-Sabine et ses environs)
Conte du Maignen : en patois de Chaulgnes (Nièvre) par l'Abbé J. M. Meunier - 1912
Monographie phonétique du parler de Chaulgnes, p. 205 J.M. Meunier.
Recueil de chants populaires du Nivernais (Quatrième série)- Paul Delarue et Achille Millien - Publication de la Fédération des Oeuvres Laïques de la Nièvre
Lien : Gallica - Conte du Maignen
La bête emplumée : en patois de Chaulgnes (Nièvre) par l'Abbé J. M. Meunier - 1912
Lien : Gallica - La bête emplumée
Je me suis laissé dire qu'il y a des Messieurs, savants comme de gros livres, qui ne feraient sûrement pas quatre fautes dans une dictée, qui veulent bien se donner la peine d'apprendre le patois de chez nous. Comme ils doivent peiner, je m'en fais une idée je connais les gens du pays, pour les faire parler quand ils se méfient de vous, c'est bernique! Il faut leur arracher les mots du ventre. Et bien je crois tout de même que ceux qui ont envie de conserver notre vieux patois ont raison. C'est peut être pas qu'il est bien beau, ni bien facile à écrire, ni qu'il y ait chez nous des malins qui aient fait des chansons, comme l'on dit qu'il y en a du côté de Marseille ou bien de Toulouse, mais tout de même, c'est un parler qui me plaît, et il ne ressemble pas aux autres, ni à celui des gens de Royer, ni à celui de ceux de Boyer, ni à celui d'Etrigny, des habitants de Nanton, de Corlay ou de La Chapelle, c'est un patois qui est à nous seuls !
Si l'on n'y prend pas garde il va se perdre tout à fait, moi je trouve que ce serait bien dommage. Avec le progrès qui s'introduit partout, voilà que le patois est passé de mode, tout comme les chapeaux des Bressanes ou des Mâconnaises, et les culottes courtes des hommes de Romenay !
Il y a déjà bien longtemps que j'ai envie de conserver quelques petits bouts de ce vieux bon patois. Cela me serait peut être plus commode qu'à ces Messieurs les savants parce-que moi, je suis un paysan, que j'ai parlé comme on cause chez nous pendant bien des années, et que moi-même, aujourd'hui, quand je suis tout seul avec ma femme, si je n'y prends pas garde, cela m'arrive bien encore de parler comme à Mancey. Un moment je me suis dit : si je faisais un dictionnaire ? Mais j'ai pensé qui le lira ?
C'est à l'initiative de Mademoiselle Marguerite Thibert et de Monsieur André Talmard que le dictionnaire de Monsieur Charles Millot (1841-1922) doit d'être édité.
La Société des Amis des Arts et des Sciences (la S.A.A S.T.) les remercie vivement et se trouve très heureuse de pouvoir le présenter au cours de cet été 1998. Cet ouvrage fut écrit par l'auteur entre 1905 et 1922. Son fils, Charles Millot (1875-1952), comprenant l'importance de ce travail, le poursuivit, le compléta, et réalisa sa première mise en forme.
Lien : Dictionnaire de patois de Mancey - Charles Millot (1841-1922)
... L’appel qui terminait l'avertissement de 1903 a été entendu.
Notre lexique a passé de douze cents à trois mille articles. Nous lui avons donc fait dix-huît cents additions, maïs il faut tenir compte aussi d'environ cent suppressions.
D'autre part nous n'avons recueilli que quelques échantillons des mots se terminant en au, iau, eau, oux et use, désinences qui sont une déformation mâconnaise des finales al, eau, eux et ue du vocabulaire français (chevau, cheval ; bourriau, bourreau ; crassoux, crasseux ; poiluse, poilue).
Cela nous amène à signaler l'abus fait, dans le parler maçonnais, des préfixes de (décesser, descier, dessortir, dôler, etc.) et re (raugmenter, reconsoler, recoucher, rentrer, de.).
Il nous faut mentionner aussi l'altération des genres : un vipère, une serpent, un gaufre, une centime, un paire, un vis, etc.
Il y a, d'autre part, suppression de l'accent sur l’é final dans un certain nombre d'adjectifs et de participés passés pris adjectivement, gonfle, réchappe, trempe, use, etc.
Enfin les participes passés en ert des verbes irréguliers en ir sont régularisés : ouvri pour ouvert, souffri pour souffert, etc.
L'orthographe a été l'objet de notre attention toute particulière : nous avons dû, en.effet, pour l'établir, tenir compte du sens, de l’étymologie (quand elle est vraisemblable) et de la prononciation. Tel arpan (et non arpent), batafil (et non batafy), brelot (et non breleau), garreut (et non garrea). gnaqué (et non niaque), etc.
Nous avons été amenés quelquefois à franciser des mots dont la forme est constamment-altérée dans l'usage (devantier, qui se dit devanti ; regrigné, qui se dit regreni ; etc).
Nous avons écrit certains, mots, dont l'origine est insaisissable, en nous basant sur leur analogie avec d'autres, comme palegaud (lever le palegaud : tomber à la renverse).
Nous avons, d'autre part, orthographié y le mol qui, à Mâcon, s'emploie pour le, la, les, pronom, et pour ça, cela, démonstratif (j'y dis : je dis cela), alors que certains auteurs l'ont écrit i (1); or, i doit être réservé, selon nous, pour la notation des prononcers populaires de il et de lui (i dit ; il dit ; j'i dis : je lui dis).
Telles sont, les principales observations d'ordre grammatical que nous avons à formuler.
Quant à l'accent, il est lourd, pâteux, traînard. La dernière syllabe de la phrase est particulièrement prolongée : une bâffe. la bâlle, la mâlle, moi, toi... Des biques... Dans les sons nasalisés an et on, la prononciation est inversée : Môcan pour Mâcon, argeont pour argent, flocan pour flocon, contan pour canton, etc. (2).
A la campagne, l'o bref, dans certaines conditions, est prononcé ou : coumune pour commune; rouche pour roche, etc. De même l’e bref est prononcé a : tarre pour terre ; Piarre pour Pierre, etc...
Sous les pseudonymes de « Personne » et « Tout-le-Monde » nous avons publié, en 1903, un Lexique du Langage populaire de Mâcon et des environs - L. J. et L. L. - Janvier 1926 - J. Buguet-Comptour, Imprimeur, Mâcon
Ouvrage publié avec une subvention du Conseil Général de Saône-et-Loire, un encouragement de l'Académie de Mâcon, et quelques souscriptions particulières.
Lien sur le site de Gallica : Le langage populaire de Mâcon et des environs

Lacrost dont le patois m'est familier, depuis longtemps, a été le point de départ de mon enquête. Mon questionnaire a été établi petit à petit après de longues conversations avec les paysans de Lacrost; c'est après seulement que j'ai été dans les villages voisins où j'ai recueilli de nombreuses variantes dans les méthodes de travail et dans les mots.
Dans une première partie, je décris les choses et leurs noms ; puis je classe les continuations les plus caractéristiques des sons latins dans les patois étudiés ; enfin un glossaire présentera dans leur ordre alphabétique les mots que m'a permis de recueillir l'étude des travaux de la campagne.
Dans la description comme dans le glossaire, sauf indication contraire, le mot indiqué le premier est celui de Lacrost : il m'a été impossible en effet de donner à la fois toutes les variantes, parfois fort nombreuses; aussi ai-je choisi Lacrost, qui, situé au centre de l'aire que j'étudie est, bien souvent, un intermédiaire entre plusieurs régions. Les variantes sont données au bas de la page dans la Description et suivent la forme de Lacrost, dans le Glossaire.
Les définitions contenues dans le Glossaire sont aussi brèves que possible : l'explication détaillée des mots ayant été donnée sous une forme plus méthodique dans la première partie. De même les étymologies proposées dans le Glossaire ne sont pas accompagnées de leur justification : pour les contrôler, on se reportera à la partie phonétique.
Nos patois offrent certains sons inconnus au français ; il est donc pratiquement impossible de les transcrire exactement en conservant l'orthographe française. Pourtant, pour ne pas astreindre les lecteurs régionaux à l'étude des signes phonétiques, j'ai essayé de donner de chaque mot une transcription en signes français ; transcription bien approximative, trop souvent, et qui demande, elle aussi, quelques explications.
Le patois a des voyelles nasales placées devant -n ou -m, ex. : an-née, fan-ne. Pour qu'on lise an- et non a- j'ai dû couper d'un tiret les deux -n-.
Le signe ch' représente un son très semblable au -ch allemand, ex. : ich.
-ly-, doit être lu en toutes positions : l mouillée.
J'ai transcrit- très inexactement- par -s- et -z- un son très fréquent dans les patois de la Bresse Savoyarde et qui correspond aux -th- anglais sourd et sonore (ex. : thing, the).
M. A. Robert-Juret - Les patois de la région de Tounus - 1931 - Protat Frères, Imprimeur à Macon

...On sait que les patois du Mâconnais sont sur les confins de la langue d'oïl et de la zone intermédiaire dénommée franco-provençale. Cette zone, où se mêlent les influences du nord et du midi, s'étend sur la rive de la Saône opposée au Mâconnais. Sur la rive droite l'influence des parlers d'oc apparaît plus au sud ; Clessé et ses environs sont tout entiers compris dans le domaine d'oïl.
Certes, dans cette contrée, des différences se marquent d'une commune à l'autre, mais elles ne portent que sur un nombre assez restreint de mots. C'est ainsi que bruyère se dit abreure à Clessé, brire à Hurigny, villages distants l'un de l'autre de 13 kilomètres. De même feu, qui se dit fû-ye à Clessé, se dit feuye à Hurigny, fiou à Montbellet, fué à Vérizet, fu à Martailly. A part ces variations, qui d'ailleurs ont été notées, on peut dire que, dans l'ensemble, le glossaire de Clessé vaut pour toute la région mâconnaise...
Extraits de la préface de André Mary
Graphie et prononciation :
Les mots patois hors d'usage depuis vingt ou trente ans sont indiqués par un astérisque (*).
Les formes françaises, archaïques ou d'un usage restreint, de certains mots patois ont été mises entre crochets [ ].
Abréviations grammaticales :
Exemples :
Dans le lexique ci-après, certains mots patois ont été présentés dans une phrase donnée comme exemple d'emploi de ces mots ; le lecteur est averti que, dans ces cas, pour plus de clarté, la phrase est en français, seul le mot cité est patois.
Dans le reste de l'ouvrage, les exemples et les citations sont toujours rigoureusement et entièrement transcrits en patois.
Emile Violet - 1932
Lien : Archives de la parole - Enregistrements à la Sorbonne en 1927 - M. Emile Violet
Lien : Gallica - Le patois de Clessé
Le patois de ChlliéssiChlliéssi est on pâys en bise de Môcon. Le patois y ère parlé pœr tout le monde tant que vé 1880 ; mais à çu moument on a quemançi à face causé en français quiéques enfants ; petièt t'à petièt le patois a été en démenùyant, se bin qu'en çu moument a n'est pllieu que causé que prœ les préssœnnes d'on sartain n'âge, et y est quemoude à comprendre qu'a va s'étieindre dave le deri de celés qu'ont appris à le parlé quand al éreint joeunes. |
Le patois de ClesséClessé est un pays au nord de Mâcon. Le patois y fut parlé par tout le monde jusque vers 1880 ; mais à ce moment on a commencé à faire causer en français quelques enfants ; petit à petit le patois a été en diminuant, si bien qu'en ce moment il n'est plus causé que par les personnes d'un certain âge, et il est commode à comprendre qu'il va s'éteindre avec le dernier de ceux qui ont appris à le parler quand ils étaient jeunes. |
Lien : Gallica - La légende de Saint-Claude
Le conte a Saint-LliaudeSaint-Lliaude est le patron des sàyioeux dipe qu'al a coupé, autrevô, lu peuplles de la prairie de Sant'Ouyan. |
La légende de Saint-ClaudeSaint-Claude est le patron des faucheurs depuis qu'il a coupé, autrefois, les peupliers de la prairie de Saint-Oyen. |
Lien : Gallica - Au temps jadis
Dans le tempsJ'ai entendu dère bien des coeups, à ma grand, quemeint lus vieux éreint malreux. Dans çu teimps on manjut du cheti pein prœ pouvò vendre le bllié ; on fosait de la galette de cartouchlles qu'ère sarrée quemeint on gôzon, même on avait essàyé de fare moudre de les creuses de calons pr'en fare de la férœne. |
Au temps jadisJ'ai entendu dire bien des fois à ma grand-mère, comment les vieux étaient malheureux. Dans ce temps on mangeait du chétif (mauvais) pain pour pouvoir vendre le blé ; on faisait de la galette de pommes-de-terre qui était serrée comme une motte de terre, même on avait essayé de faire moudre des coquilles de noix pour en faire de la farine. |
Les équivalents français des mots ici recensés ne sont donnés qu'à titre d'aide-mémoire. Le lecteur devra toujours se reporter aux références indiquées pour connaitre tous les sens possibles de ceux-ci, les expressions dans lesquelles ils entrent, leurs conditions d'emploi, etc... Dans, les cas de synonymie - ou d'analogie - il est fait renvoi au premier des mots cités dans le texte. Quand on se réfère à une note, la désignation de celle-ci est liée par un trait d'union au numéro de la page où elle se trouve.
Recueil de chants populaires du Nivernais - Paul Delarue et Achille Millien - Publication de la Fédération des Oeuvres Laïques de la Nièvre
Glossaire réalisé par Georges Delarue, ethnomusicologue, fils de Paul Delarue
Graphie et prononciation
Les sons particuliers des patois maçonnais ont été notés ainsi qu'il suit :
Abréviations grammaticales :
S. m. Substantif masculin. — S. f. Substantif féminin. — V. a. Verbe actif. — V. n. Verbe neutre. — V. r. Verbe réfléchi. — Adj. Adjectif. — Pron. Pronom. — Adv. Adverbe. — Prép. Préposition.— Interj. Interjection. — Loc. Locution.
Dans le lexique certains mots patois ont été présentés dans des phrases données comme exemple d'emploi de ces mots. Le lecteur est averti que, dans ces cas particuliers, et pour plus de clarté, ces phrases sont en français, seul le mot cité est patois.
Émile Violet
Lien : Annales d'Igé en Mâconnais
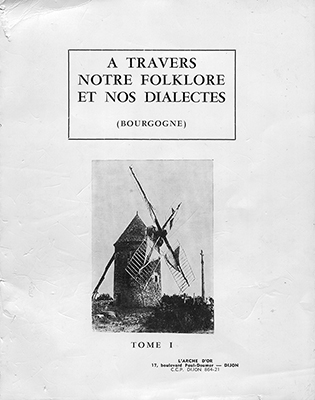
Liste de mots issue des tomes 2, 3 et 4 de "A travers notre folklore et nos dialectes (Bourgogne)".
Pour vous repérer dans la compilation, figure en fin de définition de chaque mot le lieu et le numéro du tome de sa provenance, exemple :
Patois du Dijonnais (D) :
Patois du Val de Saône (VdS) :
Patois du Beaunois (B) :

Patois du Chatillonnais (C) :

Patois de l'Auxois (A) :
Patois de Saône-et-Loire (S-L) :

Buxy (29 juin 1966) - (BY. T IV)
Fley (M. Jusseau-Legros, 29 avril 1965 et 29 juin 1966) - (F. T IV)Patois de l'Yonne (Y):
Patois de la Nièvre (N) :
Glossaire du Patois de Poiseul-lès-Saulx (Côte-d'Or)
NOTA. — Le son in est un son très spécial intermédiaire entre a, ê et in — eu comme dans feu — eû comme dans fleur — o comme dans pot - ô comme dans fort - An - a le son nasal - e se fait légèrement sentir dans boe, iae, chée, roe, etc. — er final des verbales comme le français (é).
Le son in très spécial, que nous n'avons pu transcrire phonétiquement autrement, existe seulement dans les mots ; Atin, Bourlin, Bourretinre, Brandvignin, Brou-inte, Byeussnin, Cabotin, Calin, Charinre, Charinte, Chinre, Chinze, Chouconninte, Crinze, Cuy-inte, Darin, Darinre, Devantin, Doussnin, Do-yin, Drinle, Echay-inte, Elminte, Etin, Fègain, Fin, F'min, F'minre, Fremir, Gach'nin, Genelinre, Grenin, Grougelin, Guéchintte, Idy-inle, In-ye, Jan-ninte, Jèbin, Kenelin, Keumintte, Kinre, Kinsse, Labourin, Lin, Loginte, M'chin, Ménin, M'nuzin, Mo-in-rou, M'rizin, Nin, Oj'din, Ougelin, Peutin, Pity-inte, P'nin, Pomin, Porin, Poulin, Pourin, Premin, Prenin, Prinve, P'tignin, Py-inche, Ratlin, Récoy-in, Rivinre, Sarfin, Saty-in, Sèbin, Serin, Seuffy-in, S'rizin, Suby-in, Suy-in, Tapinte, Teûrtin, Topinre, Tyin, Tyochin, Van-nintte, Vin-ye.
Roger Ratel - 29 juin 1956 - A travers notre folklore et nos dialectes (Bourgogne) - Tome II
Peu d'habitants parlent aujourd'hui patois. Mon village situé dans la vallée de l'Ouche, que sillonnent trois voies de communications, devait être "francisé" plus vite que les autres. Cependant les vieux paysans parlent volontiers le patois entre eux. Il leur semble qu'en employant leur langue ancestrale, ils se sentent davantage dans leur élément et que leur dialecte s'harmonise mieux avec la rusticité des travaux de la terre et de leur vie quotidienne. Peut-être même, ont-ils le sentiment de faire partie d'une classe sociale qui équivaudrait pour eux à une espèce de noblesse et utilisent-ils, dans leurs rapports, un langage qu'ils jugent être vraiment le leur.
NOTA. - les auteurs de ces glossaires étant décédés, il nous a été impossible de recourir à une transcription phonétique plus scientifique.
P. Billiet - 1958 - A travers notre folklore et nos dialectes (Bourgogne) - Tome I
Glossaire établi par M. P. Joigneault - (27 juin 1958 et 30 janvier 1959) - A travers notre folklore et nos dialectes (Bourgogne) - Tome III
Utilisant l'important glossaire établi par M. Henri Guyard, M. A. Colombet présente les remarques suivantes sur le patois de Villers-la-Faye :
A travers notre folklore et nos dialectes (Bourgogne) - Tome III - 30 janvier et 26 juin 1959
Le patois du Charollais et du Brionnais d'après les notes de Mme Deville-Nigay.
Notre correspondante a vécu principalement à Saint-Julien-de-Jonzy et a pu recueillir le patois de cette région et des régions voisines.
Patois du Charollais et Patois du Brionnais diffèrent essentiellement par l'existence dans le premier de formes en ts, dz pour ch, j, qe, et même c ou s doux (phénomène qui a dû se produire au XIIe siècle).
Ts : tsevau (cheval), tsar (char), tsa (chat), tson (chou), Tsarolles (Charolles), cotson (cochon), vatse (vache), atseti (acheter), avantsi (avancer).
Dz : dzardin (jardin), dzolie (jolie), dzeu (jeu), dzelée (gelée), dzifle (gifle), cadze (cage), mandzi (manger), Dzean (Jean), Dzeorges (Georges).
On trouve ausi ch, j pour ç ou s doux : chaijon (saison), choupe (soupe), abechi (abaissé), mechon (moisson), pechon (poisson), méjon (maison), tcheuche (souche), betschi (bêcher), abshès (abcès) etc...
Comme autres particularités signalons qu'en Charollais les verbes en er se terminent généralement par i à l'infinitif (sauf quelques-uns comme : aimer) :
labori (labourer), petsi (pêcher), bordi (border), catsi (cacher), meuchonni (moissoner), avali (avaler) etc... Le suffixe -ier devient également i : papi (papier), poiri (poirier), greni (grenier), peni (panier), sriji (cerisier) etc... Le suffixe -ière devient ire : tsevenire (chenevière), barrire (barrière), brire (bruyère), pâtire (patière), etc...
Par ailleurs -eau, devient -iau : coutiau, ratiau, martiau, siau, tomberiau, etc..., -ui devient -eu : breu (bruit), freu (fruit), etc...
Les palatalisations s'ont assez nombreuses : byan, coupye (couple), ampyeu (ample), pyessi (plessis), doboye (double), etc...
A travers notre folklore et nos dialectes (Bourgogne) - Tome III - Mme Deville-Nigay (28 février 1963)
A travers notre folklore et nos dialectes (Bourgogne) - Tome IV - M. Chenu

Ceci n'est pas un glossaire du patois bourguignon (il y faudrait cinq cents pages) mais un lexique des mots de notre parler que j'ai été amené à utiliser dans mon récit car je n'en trouvais pas d'autres. Pour les remplacer, il faudrait en effet une phrase entière, voire un long paragraphe.
Le lecteur sera sans doute amusé par le rapprochement que je me suis plu à faire entre ces mots et les racines celtiques des mots les plus usuels de notre langue celtique le breton.
Je ne cherche pas, par là, à ridiculiser les étymologistes académiques qui, à ma connaissance, ne se sont jamais livrés à cet intéressant exercice. Faute de connaître cette langue sans doute. J'ai simplement voulu suggérer qu'au lieu d'aller chercher fort loin chez les Grecs, les Hébreux et les Latins et ailleurs l'origine des mots familiers de nos provinces, on pourrait d'abord fouiller, tout près de nous, dans cette riche langue, encore parlée, qui est probablement ce que l'on peut trouver de plus proche de nos anciens parlers gaulois et de plus adéquat à notre tempérament "français" en général.
Car enfin, les langues celtes furent parlées très longtemps en France. Grégoire de Tours nous dit qu'ayant à combattre l'hérésie du pélagianisme, il dut, pour envoyer ses missionnaires dans les "pays", choisir ceux de ses prêtres "qui parlaient gaulois". Cela prouve qu'en l'an 600 le paysan français parlait encore un dialecte gaulois. Rien d'étonnant donc à ce que l'on en retrouve des paillettes dans nos vieux langages, ce que je me suis amusé à faire par jeu, puis ensuite avec passion car, sur ce terrain, on va d'étonnements en émerveillements et bien des choses s'éclairent dans nos vieilles expressions et nos "lieux-dits".
Encore faut-il, bien sûr, connaître une langue celtique et je me suis toujours demandé pourquoi l’Université n'en avait jamais mis une, au moins le breton, au programme des "Humanités".
Henri Vincenot
En janvier 1980, Monsieur Louis Devoir, Maire, faisait paraître dans le journal communal de Saint Germain des Champs un " dictionnaire " du patois local. Il écrivait :
" Ce modeste recueil de mots de notre patois a surtout pour but, malgré la faiblesse de nos moyens, d'aider à sauver peut-être de l'oubli total le parler usuel de nos ancêtres.
C'est un glossaire de quelques mots qui sont de moins en moins employés dans nos conversations.
Nous avons essayé, en les orthographiant, de nous rapprocher le plus possible de leur prononciation, ici, dans notre commune de Saint Germain des Champs. "
Il est vrai qu'il faut garder mémoire de ce patrimoine qu'est la langue. C'est pourquoi nous avons repris ce travail en l'enrichissant du souvenir et de la connaissance du patois d'autres personnes de la commune.
Merci donc à Madame Renée Bachelin, Madame et Monsieur Geneviève et Jean Commaille de Lautreville, Monsieur Ferré Jean du bourg, Monsieur Jean Gaudin de Montmardelin, Monsieur Paul Millot qui ont bien voulu corriger, enrichir de mots et d'expressions ce glossaire.
Ce travail n'est pas clos. Il attend critiques et enrichissements de toutes celles et de tous ceux qui ont connaissance du patois local et souhaitent qu'en soit gardé le souvenir.
Quelques remarques préliminaires :
- Les "a " commençant un certain nombre de mots patois datent des générations fin du 19è siècle, début du 20ème. Il étaient ensuite généralement escamotés.
- L'infinitif des verbes du 1er groupe, ainsi que le participe passé se prononçait "ai" au masculin et "ée" au féminin. Nous l'écrirons donc ainsi. Le taureau o m'nai ai la fouaîre : Le taureau est emmené à la foire. La vaiche o m'née ai la fouaîre : La vache est emmenée à la foire.
- Le "c" à la fin des mots ne se prononçaient pas. Exemple "Aiveuc li" s'entendait "aiveu li".
Michel Millet
Lien : Patois local. - Saint Germain des Champs
Lien : Le patois giblotin
Prononciation et graphie :
Un tilde sur le premier d’un double "n" permettra de faire apparaître certaines nasalisations
qui diffèrent du français. A titre d'illustration, le mot "année" (prononcé "an-née" en patois) se
transcrira : "añnée", ce qui fera ressortir la nasale "an" de la première syllabe.
Le tréma au dessus d'une voyelle permettra de la détacher phonétiquement comme dans le
mot «noyer» qui s'écrira : le «nöyé», le son «oi» du français ne se prononçant pas ici. On écrira
également «mön aimi» («mon ami»). Donc "nöyé" se prononcera "no-yé" et "mön aimi"
"mone-aimi".)
L'apostrophe servira à représenter l'amuïssement d'une voyelle inaccentuée : "ts 'min" pour
"chemin".)
Une graphie particulière s'impose pour rendre compte d'un son chuintant semblable au "ich
laut" de l' allemand), c'est à dire du son CH prononcé entre les dents, qui correspond en patois aux
groupes consonantiques CL et FL. Il se transcrira : "çhy". Le mot "clou" s'écrira donc "çhyou"
et l'adjectif verbal "gonfle" que l'on emploie pour dire qu'une vache est "gonflée", c'est à dire
météorisée, (lorsqu'elle a mangé trop de trèfle), sera rendu par "gonçhye".
Il est également important de ne pas confondre deux sons très fréquents dans notre patois :
"eû" sera le son du français "feu" et: "eu" sera le son de "peur" ou "oeuf". Cette distinction
permet par exemple d'éviter une confusion entre la "feûille" (la feuille) et la "feuille" (la fille).
L'accent circonflexe sera aussi quelquefois utile pour différencier certaines voyelles en
insistant sur leur longueur. Cela nous évitera de confondre un mot comme "atsi" (merci) de "âtsi" (le
bouton d'or).
Le "h" aspiré ne se prononce pas dans les parlers de notre région. La lettre "h" sera néanmoins
maintenue dans le but de rendre les mots patois plus aisément reconnaissables à la lecture.
Le "k" servira à rendre le son initiale de mots tel que «curé» ou «cuit»: «keûré», «keût».
Les groupes BL et PL qui aboutissent à un "i" mouillé en patois, seront retranscris par BY et PY
comme dans "traubye" (table) ou "pyou" (pluie).
La consonne finale ne se prononcera pas (par exemple "nuit" donnera "neit", prononcé [né].)
Abréviations :
Adv : adverbe ; Adj : adjectif ; conj : conjonction ; dém. démonstratif ; excl : exclamation ; exp :
expression ; loc adv : locution adverbiale nf : nom féminin ; NL : nom de lieu ; nf : nom
féminin; nm : nom masculin ; NP : nom propre ; p.passé : participe passé ; pr interr : pronom
interrogatif ; pr. pers. : pronom personnel ; prép : préposition ; vb : verbe
Éric Condette
Lien : Petit lexique du parler de Trivy
Cet ensemble de documents a été réalisé approximativement entre les années 1963 et 1985. Il représente une somme considérable d'informations (et donc de travail) sur les origines du Morvan, son histoire, sa constitution et son organisation tant humaine que physique ou économique, son environnement, son tourisme etc... Son dernier volet, l'avenir du Morvan, est un instantané permettant de voir où nous en étions et où nous sommes arrivés (ou pas...). Toutes ces années de recherches, de compilation, de rédaction, de mise en page, de frappe (à la machine à écrire) étaient vouées à une disparition peu amène : au mieux le "Pilon" au pire "Le container"... Le résultat était le même, la perte de cette remarquable rétrospective.
Son auteur, qui a souhaité rester anonyme, a bien voulu me confier ses 1 300 pages afin que je les scanne et les mette à disposition sur ce site, évitant ainsi une regrettable disparition. Pour en faciliter la lecture, j'ai préféré détailler les 9 documents initiaux en chapitres, soit environs 150 fichiers accessibles en un seul clic. De plus les fonctionnalités des applications permettant la lecture des fichiers PDF vous permettent également (mieux que sur du papier) d'effectuer des recherches sur chaque document.
Lien : Le Morvan


Sur les patois, il existe certes de savants ouvrages et on peut parfois se demander s'il y a encore quelque chose à découvrir ; et on peut se poser le problème de l'utilité d'un travail comme le Glossaire de Mercurey. Qu'on se rassure ; il est difficile d'interroger chaque paysan, chaque vigneron et toutes les personnes qui, comme Joseph ANCELIN, ont consacré une petite part de leur vie à noter la vie de leur village natal, ont bien mérité du patrimoine national.
Le travail de Joseph ANCELIN est d'autant plus intéressant qu'il est ancien ; les études sur les patois peuvent vieillir ; mais les faits eux-mêmes resteront toujours pleins d'enseignements ; on ne le répétera jamais assez : les enquêtes sur le patois sont comme le vin qu'on récolte à Mercurey ; chaque année qui passe leur apporte une plus grande valeur.
C'est donc le patois du début du siècle que l'auteur a noté. Il a travaillé à une époque oü les enquêteurs de l'Atlas linguistique et ethnographique de Bourgogne n'étaient pas encore nés et il a pu entendre des faits qui, dans les années 60, avaient disparu depuis bien longtemps. Ce Glossaire de Mercurey a donc une grande valeur archéologique ; aujourd'hui Mercurey est devenu un gros bourg uniquement viticole ; il y a encore quelques personnes qui connaissent le patois ; et, à côté de ces anciens vignerons, il y a l'immense majorité de la population qui ignore sans doute que son village a parlé un jour une autre langue que le français ; nous sommes persuadé que ces couches plus jeunes découvriront avec plaisir la langue de leurs ancêtres.
Note de Gérard Taverdet
Joseph Ancelin (1882 - 1969)
Cette brochure a été éditée sous le patronage de l'Association Bourguignonne de Dialectologie et d'Onomastique ; l'A.B.D.O. est une association sans but lucratif (loi 1901) qui s'est donné pour mission de faire connaître les problèmes des patois et des noms de lieux et de personnes ; pour ce, nous organisons des colloques et publions des travaux dont le faible tirage ne peut intéresser les éditeurs professionnels.

L'ensemble des textes et documents rassemblés dans ce livre sont le résultat d'une collaboration entre Joséphine Dareau, ma grand-mère maternelle, et moi-même.
Au départ (dans les années 1974-1975) j'avais pris l'initiative de réaliser avec elle quelques enregistrements sur cassette. Je l'interrogeais sur sa vie, sur ses souvenirs, je lui faisais raconter des histoires et chanter des chansons.
Elle était un peu réticente au début mais peu à peu ces enregistrements sont devenus une véritable connivence entre nous.
En 1976, elle accepte de chanter quelques comptines dans les premiers disques de « Lai Pouèlée ».
La même année quelques unes de ses histoires sont publiées dans « L'Almanach du Morvan ».
Dans les années qui suivront, Joséphine Dareau ne cessera de creuser dans sa mémoire. Elle écrit sur des feuilles volantes puis sur des cahiers d'écolier. Les documents rassemblés dans cet ouvrage sont donc très divers. Ils se composent principalement :
Née « avec le siècle » Joséphine a vécu les principales transformations de la vie rurale. Fille unique, elle quitte l'école après le Certificat d'Étude et aide sa mère aux travaux des champs pendant la lere guerre mondiale. Elle épouse Claude Dareau en 1920 et monte à Paris où elle sera cuisinière dans diverses maisons bourgeoises. De retour au pays en 1945, elle continuera l'exploitation familiale avec son mari.
Joséphine Dareau est décédée en 1984.
Pour tenter de rendre l'ouvrage plus lisible, les textes français et morvandiaux sont transcrits en caractères différents.
Pour ce qui est de la graphie du morvandiau, les textes sont soit publiés dans la graphie spontanée de l'auteur soit dans une graphie modifiée selon quelques-uns des codes mis au point par l'Université Rurale Morvandelle. Ainsi, dans certains mots « ô » se prononce « ou » et « çhe » se prononce « se ».
On remarquera sans doute la terminaison en « et » (ou « ait ») de la 3e personne de l'imparfait de l'indicatif. C'est une des particularités de la langue de Mallerin. Cette terminaison est généralement « ot » dans la plus grande partie du Morvan. La terminaison « et » (prononcer « è »), que l'on peut considérer comme une francisation, touche surtout le Morvan Nord-Ouest.
Cette forme, très employée dans le récit, risque de prêter à confusion avec le passé simple qui sera généralement noté « ai » ou « é ».

René Lapierre, l'auteur de ce lexique de Rully, est médecin de campagne à la retraite. Né "par erreur" à Paris, selon sa propre expression,il est issu d'une famille qui, depuis 400 ans, s'est cantonnée dans la région comprise entre Chagny et Givry.
Parlant couramment le patois depuis son enfance, il a tout naturellement renoué les liens à peine interrompus par les années d'études. Il n'y a pas eu d'enquête programmée avec questionnaire préétabli et recherche systématique de l'échantillon de "témoins" représentatifs, mais un échange naturel et continu prendant près de 40 ans de sacerdoce. Lors de ses visites et consultations,ce médecin de campagne "ancien modèle" a su inspirer suffisamment confiance à ses patients pour qu'ils ne pratiquent pas l'auto-censure et continuent à s'exprimer librement dans leur parler familier. La première qualité du médecin n'est-elle pas de savoir écouter ?
La disparition d'un ami, parmi les derniers patoisants, a convaincu le Dr Lapierre de réunir ses notes en vue d'une publication.
Cette brochure a été éditée sous le patronage de l'Association Bourguignonne de Dialectologie et d'Onomastique ; l'A.B.D.O. est une association sans but lucratif (loi 1901) qui s'est donné pour mission de faire connaître les problèmes des patois et des noms de lieux et de personnes ; pour ce, nous organisons des colloques et publions des travaux dont le faible tirage ne peut intéresser les éditeurs professionnels.

Les trente six années (1945-1981) que j'ai passées à la gérance de la Coopérative Agricole de Charolles (actuellement AC2B) m'ont permis de découvrir toute la richesse, et surtout les variétés locales de ce parler. J'ai pu ainsi constater que le patois de la région de Charolles n'est pas homogène, mais composé de deux variantes qui seront distinguées dans ce document de deux façons différentes A et B (voir Localisation).
Le critère principal de différenciation entre ces deux zones est le vocabulaire : à titre d'exemple une poussinière s'appellera "peurson" en zone A et "piounire" en zone B (du verbe piouner = pleurer). La prononciation évolue également d'une zone à l'autre : le mot fourmilière se prononcera "manzouéré" en zone A, et "manzouari" en zone B.


La zone A correspond au Charolais de la plaine, calcaire et argileux, pays du "terrain gras" qui, en terme d'élevage, est traditionnellement le pays engraisseur (ou pays d'embouche).
La zone A est délimitée par les communes de Vendenesse-les-Charolles, Viry, Ballore, Baron, Gandvaux, Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne, Mornay, Martigny-le-Comte et une partie de Saint-Bonnet-de-Joux
La zone B correspond aux Monts du Charolais granitiques, pays du "terrain de sable" plus pauvre : c'est traditionnellement, le pays naisseur du Charolais.
La zone B est délimitée par les communes de Suin, Sivignon, Verosvres, Beaubery, Ozolles, Colombier-en-Brionnais, Gibles, Vaudebarrier, Marcilly-la-Gueurce et une partie du Haut-Mâconnais et Beaujolais.
L'évolution du parler en Charolais est donc liée à la géographie économique, dépendante elle-même de la géographie physique : la lecture de la carte de localisation montre que les frontières linguistique et géologique sont parfaitement superposables.
Cette région de la Bourgogne du sud est située dans la partie septentrionale du pays d'oil (qui se distingue par ses toits pentus couverts de tuiles plates) et au voisinage du pays d'oc avec ses toits plus plats couverts de tuiles creuses.
Emile Bonnot - 1991 - En ligne avec l'aimable autorisation de son fils Henri Bonnot
Lien : Le Patois Charolais par Emile Bonnot
Un tel travail a-t-il déjà été accompli ?

Alain Lejeune a daté l'évolution historique de ces mots, non pas à l'année près, à la manière d'un dictionnaire, mais en situant le siècle où les termes sont apparus pour la première fois dans les textes écrits. Cette perspective historique offre 1'avantage de mettre en valeur la notion de patrimoine culturel de la langue poyaudine, et rappelle au lecteur la richesse des brassages linguistiques qui ont nourri sa langue maternelle. Un voyage dans le temps fort agréable !
Il se dessine discrètement au fil des pages un intéressant tableau des différents phénomènes linguistiques ayant mené à la création des mots patois : néologismes, déformations et spécificités phonétiques viennent s'ajouter à la dérivation naturelle témoignant de la vie des mots depuis l'ancien français. On apprécie la logique désignant par bineux celui qui travaille avec une binette, ou par biquetier le berger d'un troupeau de biques (chèvres), alors que le berbitcher garde les berbis (brebis). On comprend que citrer consiste à fabriquer du citre (cidre), et entonner verser avec un entonnoir. On rencontre tour à tour le boeutier, bouvier conducteur de bœufs, ou le coquetier, marchand d'œufs et de volailles. On sourit face au r'naré, rusé comme un renard, ou devant le geigneux, très souvent en train de geindre. On aurait aimé inventer de jolis mots comme dessoiffer pour désaltérer, ou misérer pour souffrir. On acquiesce en évoquant la fruitaille pour l'ensemble des fruits, ou la rataille pour l'ensemble des rongeurs : de charmants raccourcis. Et quoi de plus naturel que la maladroiteté, la sombreté, la mauvaiseté, ou bien des diminutifs comme le garçougnot, la gaminotte, ou le poulaillon (jeune poulet) ? Tous ces savoureux néologismes nous font percevoir l'authenticité d'une langue orale toujours en évolution, directement modelée par un usage d'une étonnante vitalité.
Certains mots sont issus d'une dérivation adaptant la forme du mot à l'image évoquée par le sens. Ainsi comprend-on aisément les comparaisons implicites contenues dans s'achatrir (se détendre, s'étirer comme un chat), déjamber (faire un crochepied) ou enfondu (trempé jusqu'aux os). On ne peut trouver plus évocateur que le boursicot pour désigner le porte-monnaie, la canardouée pour le fusil de chasse, ou le cinglon pour la badine utilisée en vue de corriger 1' enfant turbulent. Le riche champ sémantique de la nourriture et de la gourmandise propose une gueulée pour une grosse bouchée et un avaloué pour un gros mangeur. Autant de témoignages d'une langue en permanente création au fil du temps.
Par ailleurs, la nécessité de simplifier un mot complexe ou d'en faciliter la prononciation a induit un certain nombre de déformations : ainsi beuglis pour beuglement, imbranlabe pour inébranlable, tuberlose pour tuberculose, flongle pour furoncle, cassiette pour casquette, guiah pour diable ... Phénomène habituel dans l'histoire linguistique d'un dialecte ou de la langue commune, la déformation des mots est toujours intéressante à observer car elle éclaire des aspects importants de la vie des habitants.
Si néologismes et déformations concernent l'évolution naturelle de toutes les langues, ce lexique met également en valeur un certain nombre de spécificités du dialecte poyaudin :
- l'effacement de voyelle en début de mot : ch'net, d'voère, d'vantier, r’bouler (chenet, devoir, tablier, écarquiller les yeux) ;
- l'effacement de consonne en fin de mot : bêtie, sottie, églie (bêtise, sottise, église). Cet effacement touche particulièrement le « r », final ou devant « e » muet : vendangeux, heu'e, cauri', confitue, bonjou ', toujou’ ;
- on note aussi la liaison omise après le pronom personnel « ils» : « Combein de charrettes il' ont rentrées ? Il' en ont rentré six dans la jornée ! » ;
- le changement de voyelle : [o]....[jo] siau, batiau, drapiau. [war].....[we] arrosouée, batoué, balançouée, armouée.
ou encore varmine, sarpent, aubarge, houmme...
- le changement de consonne : dargnier, boutchier, retchuler (dernier, bouquet, reculer)
- l'inversion de lettres sur une première syllabe : eretenir, erméde, ernifler (retenir, remède, renifler) berdouille, carpiter, formage (bredouille, crépiter, fromage)
- l'ajout du préfixe a- pour insister sur le mot : ahontir, apitance, aronce (faire honte, ration de nourriture, ronce).
Toutes ces caractéristiques linguistiques propres à la langue poyaudine ne constituent toutefois que des pistes, à considérer sans en rechercher systématiquement la rigueur. Gardons-nous d'oublier qu'un dialecte est plus souple qu'une langue officielle ; ses évolutions linguistiques plus mouvantes n'obéissent pas aussi nettement à des règles phonétiques. C'est là que réside aussi tout le charme d'un patois, langue souvent insaisissable, à 1'orthographe aléatoire, et non définie officiellement ; rien n'y est fixé, si ce n'est la vitalité de ses locuteurs.
Le lexique d'Alain Lejeune met bien en évidence la nature même d'un patois. Il s'agit d'un parler régional, langue propre à une population limitée géographiquement, et qui coexiste avec la langue dominante. Kaléidoscope aux multiples facettes, un patois utilise des mots ayant plusieurs variantes dans la forme(aboidrailler, chinchelotte, gigouée), ou bien une pluralité de sens pour le mème terme (guerlotter, brâter, déargoter, safre). D'un village à l'autre, on constate ces variantes, mais l'uniformisation n'est pas nécessaire, puisque tous peuvent s'entendre en utilisant la langue nationale commune. Une telle diversité apporte au dialecte une fantaisie, une fraîcheur, une hardiesse qui lui donne beaucoup de charme, charme que la lecture du lexique laisse à découvrir page après page. Comment ne pas se laisser séduire par la saveur de certains mots comme amigouneries, bernasserie, argousin, patouillat, affranchir ... Comment ne pas ressentir, comme si les yeux se posaient sur d'anciennes cartes postales couleur sépia, cette impression d'équilibre ordinaire entre les hommes et leur paysage, entre l'âpreté du quotidien et les rires partagés d'une même communauté. - Josiane Garand.

La recherche des différents mots et expressions du patois matourin a montré une grande diversité de vocabulaire. Chaque patois se différencie du village voisin, et parfois d'un hameau du village à l'autre. Les "faux amis" sont également courants, un même mot désignant des choses très différentes d'un village à l'autre. Mais cela n'exclut pas les influences subies par certains hameaux comme Argaud qui comptait 6 familles en 1950, dont 4 femmes, natives du village voisin de Saint-Pierre-le-Vieux, qui apportèrent avec elles leur dialecte. Le même type d'influences existe aussi entre le hameau de Chaux et le village de Montmelard. Ce qui explique notamment les quelques similitudes dans le patois de villages voisins, mais aussi l'existence de plusieurs termes pour désigner un seul et même mot français.
Le patois, étant un langage parlé, non écrit, ne possède pas d'orthographe normalisée. La phonétique et la racine utilisée pour le français ont été privilégiées pour l'écriture des mots. En général, la prononciation des mots patois est celle du français.
Quelques variantes doivent cependant être précisées : pour les voyelles, deux sons "eu" ont été distingués. L'un, correspondant au son "œuf", est noté "eu". L'autre, noté "eû", correspond à la prononciation de "feu" ou "vœeu".
L'accent circonflexe utilisé sur la lettre "a", précise qu'il faut insister longuement sur la syllabe correspondante. Par exemple, le mot "brâti" se prononce "braaati".
Le trait d'union "-" placé entre deux syllabes signale que celles-ci doivent être prononcées distinctement. Par exemple : "dzin-ner" ou "empra-yer".
Enfin, dans la majorité des cas, le son "che" français s'écrit et se prononce "tse" en patois, le son "ge" se dit "dze" et les syllabes "cl" et «, f1e" sont prononcées "che".
Avec l'aimable autorisation du co-président des Amis du Manoir, monsieur Alain Guérin.

Lien : Le blog de Dédé

La francisation galopante des parlers d'oïl ayant augmenté la moyenne d'âge des patoisants, il devient de plus en plus difficile de trouver des usagers pouvant témoigner d'un état ancien de la langue. De plus, leur raréfaction inexorable finit par donner à une bonne part d'entre eux un vague sentiment de honte à l'égard de ce "jargon" que dédaignent la plupart des habitants de la commune... Je crois même que si je n'en avais eu la pratique courante, l'entreprise de ce travail m'eût été impossible, car la bonne conduite d'une enquête demandait au préalable comme une sorte de "mise en confiance" linguistique. Aussi m' a-t-il paru urgent de consigner les caractéristiques de ce parler, pendant qu'on pouvait encore le faire.
C'est sur le lexique que j'ai fait porter la majeure partie de mon effort, car du langage c'est ce qui vieillit le plus vite. On trouvera donc, dans cet inventaire lexical, groupés par famille étymologique, l'ensemble des mots que m'ont livrés mes enquêtes auprès de la population. Chaque entrée lexicographique présente un mot, le plus employé de sa famille ou celui dont la formation est la plus ancienne ; son étymologie ; et enfin, une revue des mots de cette famille : dérivés, composés, allomorphes ... Il s'agit là du patrimoine lexicologique du patois, ou du moins, de ce que mes enquêtes m'ont permis de recueillir. Les adaptations récentes du français n'y ont évidemment aucune place ; mais à l'inverse, je n'ai pas jugé sans intérêt de montrer que certains types lexicologiques lui sont connus, même s'ils se retrouvent en français sous la même forme : ces mots, d'un emploi rare en français, appartiennent donc à un fonds ancien de la langue. En donnant le sens du mot, j'ai quelquefois, quand il ne s'agissait pas d'un mot technique, inséré un exemple de phrase où le mot est employé, pour lui restituer sa vie et sa saveur. Cet exemple est, la plupart du temps, emprunté à la vie quotidienne, quelquefois lié à une anecdote réelle, qui l'éclaire, et assorti d'une traduction, tantôt littérale, lorsqu'il faut rendre une tournure difficile, tantôt plus lointaine, quand il s'agit d'exprimer une notion délicate ou un effet de sens particulier. On ne s'étonnera donc pas du tour familier qu'il lui arrive de prendre : j'ai de propos délibéré sacrifié l'élégance du français à l'élégance du patois.
Xavier.Bertrand. septembre 1985
Concernant la graphie du patois
On ne saurait trop recommander au lecteur de se reporter chaque fois quïl sera nécessaire au tableau suivant :
Semi-voyelle et voyelles:
y (yod) (byô:d' / blaude) a a bref (adô: / ados) â: long et antérieur (â:br' / arbre) e é fermé (bé:t' / bête) è ouvert (bè / bec) ê intermédiaire (ê: / eau) i i bref (bik' / bique) î: long (bî:kyè / loucher) o o ouvert (co / ver blanc) ô fermé (cô / coup) u u long ou bref (bu: / lessive) an long ou bref (ran / rien) in long ou bref (chyindr' / chanvre) eu fermé (beu / boeuf) œ ouvert (kœrnèy' / corbeau) ou long ou bref (chou: / chouette)
Consonnes:
Comme il a été précisé supra, seules les consonnes suivantes diffèrent de l'orthographe traditionnelle.
C n'est conservé que pour un son dur sans ambiguïté (c'men / comment), pour un mot facile à repérer. Qu est conservé pour les mots-outils pour la même raison : (quouè qu't'en di ? / qu'en dis-tu ?). K apparaît dans les autres cas. (su que t'konâ: / celui que tu connais).
G garde sa valeur gutturale même placé devant e et i comme dans égeuryo / houx.
J le remplace dans sa valeur fricative comme dans bouèj' / beige.
S garde sa valeur sifflante (rèseu:r / ressuir). Z le remplace ailleurs comme dans ro:z' / rose.
Le patois est un parler rural employé par un groupe relativement restreint et d'usage surtout oral.Le patois est un dialecte qui ne s'est pas élevé au rang de langue littéraire (nous n'en connaissons pas d'œuvres écrites !). Dans les faits, la plupart des villages auront, malgré leur proximité géographique, un patois différent.
De nos jours le patois a maintenant quasiment disparu de nos campagnes ; seules, quelques personnes âgées le pratiquent de façon confidentielle.

Livre : PATOIS des Granges d'Auxonne - Association Ecomusée du Maraîchage et des Traditions Populaires du Val de Saône - 2009

D'une vieille famille nivernaise, l'auteur est né le 15 mars 1924 à Neuville-les-Decize de parents petits commerçants. Etudes à la Communale puis au Cours complémentaire de Decize et à l'Ecole normale d'instituteurs de Moulins.
En 1944, il gagne le Maquis Louis, implanté dans le Morvan et dans la foulée s'engage dans l'Armée de l'Air. En 1950, de retour à la vie civile, il renonce à l'enseignement et entame une carrière de journaliste. Il débute à la Dépêche de Saint-Etienne et poursuit ses activités au groupe des journaux stéphanois Tribune, Espoir, Dépêche, en poste successivement dans la cité forézienne puis à Roanne, Nevers et Chalon-sur-Saône.
Sur plus de six cent mots répertoriés et donnés dans les pages qui suivent avec leur définition beaucoup ont trait au monde rural, aux animaux et aux travaux de la ferme.
C’est que le patois morvandiau s’est longtemps maintenu au sein du milieu paysan, dans une région isolée où il était souvent le seul vocable usité.
Dans un ailleurs proche - et notamment entre Loire et Allier - le secteur où nous avons largement puisé, c’est un vocabulaire différent que nous rencontrons et qui varie fréquemment, d'une région à l'autre, voire d'une commune à l'autre, mais, comme dans le Morvan, tous ces mots d’autrefois s’effacent lentement, génération après génération et tombent peu à peu dans l'oubli.
Il était grand temps de leur faire reprendre souffle.
Le parler nivernais morvandiau – Louis Cassiat – Editions du champ des périés - 2009
Les mots figurant dans ce glossaire sont ceux utilisés dans ma famille nourricière, au hameau du Conrieux (Cne de Saulieu) dans les années 40.
Le patois étant une langue orale, j'ai essayé de transcrire en respectant au maximum la prononciation locale.Il existe des différences suivant la localisation (parfois à 10 km). Par exemple à Saulieu,on dit : "de l'aie" (de l'eau) tandis qu'à St Brisson on dit "d'yau" et qu'à quelques kilomètres au sud de Saulieu, on dit "de l'â". Les mots utilisés
en Côte d'Or, dans l'Yonne, la Saône-et-Loire ou la Nièvre peuvent être très différents.
Pour conserver la correspondance de la terminaison des verbes du 1er groupe, il a été utilisé "er", mais il faut lire "è".
Pour les verbes en "ir", il a été utilisé "ir" ou "i" (sans "r" qui n'est jamais prononcé).
Lorsque le son"è" en patois correspond à la lettre "a" en français, il a été orthographié "ai" (sauf quelques oublis).
G. Duvauchelle (2010)
Lien : Petit glossaire du patois de Saulieu et ses environs
Le patois montcellien, celui qui était encore en honneur il y a un peu plus d'un demi-siècle et qui va disparaître avec une génération qui sera bientôt dans la tombe, n'était ni pur, ni homogène comme le sont certains idiomes provinciaux, mais il était cependant bien aborigène. Bien qu'imprégné de terroir, il avait une originalité particulière. Pour des raisons ethniques et ethnographiques, il était hétérogène comme le territoire et comme les habitants eux-mêmes.
C'est un amalgame, une cristallisation de plusieurs dialectes, mais où sont dominants le Morvandiau et le Charollais. C'est, d'ailleurs, ce qui en fait les traits propres et saillants, le pittoresque.
Montceau, aux confins de trois anciens pays, le Chalonnais, le Morvan, le Charollais, bien que partie intégrante aujourd'hui du Chalonnais, en fut pendant longtemps écarté et n'eut jamais de relations avec Chalon par suite de l'éloignement et des difficultés des communications.
Quand en 1856 (Tous ces renseignements sont extraits des archives communales de Saint-Vallier.), Montceau fut érigé en commune, son territoire fut tiré des communes de Blanzy, Saint-Berain-sous-Sanvignes (Autunois), Sanvignes (Charollais) et Saint-Vallier (Chalonnais).
Mais il ne faut pas oublier que Saint-Vallier, appelé autrefois Saint-Vallier-en-Charollais jusqu'à la Révolution, fit partie du district de Charolles jusqu'au Consulat, époque où le Canton de Mont-Saint-Vincent dont dépendait Saint-Vallier fut annexé au Chalonnais.
D'autre part, dès 1883, l'extraction de la houille prenant de l'extension, l'Administration des Mines recruta des ouvriers un peu partout. Il en vint de tous les coins du département, des vignobles du Mâconnais et du Chalonnais, mais surtout des vertes prairies du Charollais et des montagnes boisées du Morvan.
Il est donc tout naturel que le vocabulaire et l'accent Morvandiaux et surtout Charollais soient restés dominants dans le dialecte Montcellien(C'est pourquoi nous aurons souvent au moins deux termes patois pour exprimer le même mot français. Il faut ajouter aussi que les guerres de 1914 et de 1940 exercèrent une influence bien marquée sur cette métamorphose par suite du séjour, chez nous, de nombreux évacués venus surtout du nord de la France. ). Il faut constater aussi qu'il s'est enrichi de termes exotiques par suite du séjour momentané ou prolongé de nombreux provinciaux venus tenter fortune dans notre riche cité. Les marchands de toile du Dauphiné, les maçons de la Marche, les marchands de parapluies, les cordonniers et les étameurs d'Auvergne nous donnèrent des termes et des tournures propres à leur pays d'origine.
Enfin, depuis le commencement du XXe siècle, pour des raisons très diverses, le vocable montcellien a subi des transformations telles qu'il n'est plus, aujourd'hui, qu'un français estropié, mal parlé, émaillé de tournures et de termes patoisants plutôt que patois.
Cette évolution est surtout due à l'instruction largement diffusée depuis un certain temps, à la radio devenue populaire, aux voyages plus fréquents et aux relations plus étendues qu'autrefois. Le changement de mentalité de la population et en particulier de la jeunesse y a également fortement contribué.
Autrefois, celui qui, après un séjour à la ville, parlait, à son retour, un français plus ou moins correct était considéré comme un pédant,« un fseux d'embarras». Pour ne pas être ridiculisé, il reprenait bien vite le langage local.
Aujourd'hui le contraire se produit. Les jeunes gens rient et se moquent même des vieilles personnes qui, dans leurs conversations, font appel au dialecte qui a bercé leur enfance.
Ce patois, méprisé actuellement, était cependant, à mon avis une langue plus française que le français mal parlé de nos jours. C'était le vieux français de chez nous, celui des Celtes, des Gallo-Romains et des Burgondes, celui de l'époque médiévale, de la Renaissance et des XVIe et XVIIe siècles ; c'était en un mot la langue maternelle de tout le pays.
Le dédain et, à plus forte raison, la proscription brutale de l'idiome populaire n'est pas de mise. Au lieu de le proscrire sans merci, « respectons-le, étudions-le et servons-nous en à l'école ». Le maître peut en tirer un excellent parti en l'employant comme auxiliaire dans l'enseignement de la langue nationale, la seule qui doit être étudiée. Il fournira un bon point de départ pour la leçon de français. Un excellent exercice est de faire rédiger de temps en temps une rédaction dans le langage familial de l'enfant, c'est-à-dire, en patois du pays ; puis après correction commune au tableau noir, de la donner à reproduire en bon français.
De cette façon, un double but sera atteint.
La langue nationale enrichira son vocabulaire et y gagnera en pureté ; le langage local assurera sa survivance.
Nota - Nous nous sommes appliqué, dans cette nomenclature, à éliminer un certain nombre de termes qui, bien que français sont considérés comme faisant partie du patois montcellien. À ce titre, ils figurent dans certain recuei1. Il en est ainsi de « civière», brancard pour porter le fumier ; « demettre » luxer ; « turquie » maïs ; « pochon », « ringard », « jeannette », « poreau », etc.
Si, par inadvertance, quelques-uns de ces mots ont échappé à notre perspicacité, nous prions les lecteurs de nous en excuser.
D'autre part, bien des mots patois employés dans la région, ne sont pas particuliers à Montceau : on les emploie aussi dans d'autres régions.
Antoine Maringue - 1951
Un peu de folklore montcellien

Cet ouvrage ne constitue pas une étude étymologique et historique de la langue morvandelle. Il a été établi de la manière la plus concise où seul le mot à écrire est en relief et accompagné de sa traduction, avec ici ou là, quelques explications, les plus brèves possibles en français. Quelques annotations sur des variantes attestées aussi en usage sont quelquefois fournies lorsque cela nous a paru nécessaire.
Dans le nouveau petit dictionnaire morvandiau-français, deux termes, séparés par une virgule, sont quelquefois mentionnés dans les entrées, ex. : pouillau, pauillau = coq ; force, faurce = fourche. Le premier provient de l’écriture usuelle du morvandiau, le second de l'adaptation à l’essai de la graphie naturelle selon Roger Dron.
Ces deux couples de termes peuvent aussi indiquer deux prononciations différentes, la première réservée à la variante nivernaise du parler morvandiau, la seconde aux acceptions plus générales de cette langue, ex. : creûgnon, croûgnon = croûton ; bauler, bouâler = beugler ; empizer, empiger = entraver ; lurai, luron = mouton...
D'autres acceptions, aussi employées, mais moins courantes, sont portées entre parenthèses () après la définition du terme, ex. : (queudre, coudre, coutre = noisetier).
Nous avons également voulu mettre à l’essai la graphie de è (ouvert) = ai et de é (fermé) = aí selon la proposition de Roger Dron . Tous les mots ne sont pas concernés, surtout dans le cas du è (ouvert) = aì mais nous avons cependant noté certains d'entre eux qui comportent le é (ferré) = aí avec la bivocale (diphtongue) ai et son accent aigu sur le i, ex. : touaíle : toile ; touaílette : toilette ; quaírné = de quart, de travers.
Par contre nous avons souvent écrit le son é ou è, plus ou moins ouvert ou plus ou moins fermé à l'aide de la bivocale (diphtongue) ai au lieu de é ou è.
Certains substantifs ou adjectifs ne comportent pas de déclinaison au féminin dans les entrées du nouveau petit dictionnaire. Ce sont ceux qui ne présentent pas de difficultés de déclinaison. Les autres sont accompagnés du suffixe désinentiel féminin précédé d'un trait d'union (et quelquefois de la dernière syllabe du substantif ou de l'adjectif) et mis entre parenthèses, ex. : avaigni (-e) = affaibli, affaiblie ; courandier (-ière) = coureur, coureuse ; feuillu (-use) = feuillu, feuillue ; pauillu (-use) : pauilleux, pauilleuse ; malhéru (-use) : malheureux, malheureuse.
Roger Dron emploie également l'accent aigu (´) sur le é dans le son fermé de certains mots où l'on ne l'attend pas, ex. : morvandélle, âbaudréiller = écrabouiller, bobéille = bobine du rouet, cancouélle = hanneton, daguenélles = poires séchées au four, queurnéille = corneille...
Ces sons sont fermés en morvandiau mais ouverts en français régional, parler sous la dépendance du français standard. Nous avons maintenu ce procédé dans le nouveau petit dictionnaire morvandiau-français. De Chambure utilisait aussi quelquefois ce procédé, ex. : patouéillou.
Norbert Guinot (2012)
Lien : Lexique Colombier en Brionnais de Michel Nioulou
Lien : Le Témoin gaulois - Témoignages - Entre Mhère et Brassy - René Collinot - 2014

L'Atelier Patois d'Epinac vous présente le résultat de nombreuses et passionnantes séances des jeudis après-midi.
Quinze à vingt membres très actifs, évoquent leurs jeunesses à travers de petits récits de leurs jeunesses au temps ou les anciens parlaient le patois couramment. C'est un véritable exercice de mémoire, une récolte laborieuse faite de souvenirs des activités de cette époque minière et agricole.
La richesse de ce lexique sont les exemples cités, tous tirés de ces récits, ce qui évite une mauvaise interprétation et une orthographe au plus juste, proche du langage autrefois usité à Épinac. Y ont été également ajoutés les mots rarement utilisés ou en voie de disparition de la langue française.
Attention ce petit livre est avant tout un outil de travail et de recherche. A vous Amis lecteurs de venir corriger nos manquements, nos oublis, nos erreurs.
L'alphabet de la langue française se compose de 26 lettres alors que l'on recence 36 phonèmes en français. Aussi pour transmettre, le plus exactement possible, un langage uniquement parlé, nous avons recours à divers signes.
Dans le dictionnaire patois, 1'on trouve également des mots présents dans les dictionnaires Larousse et Le Robert, quand ces mêmes mots sont anciens et peu usités, mais présents dans les textes étudiés.
Il y a mille manières d'aborder la réalité d'un lieu.
Marie Dominique Jacomy
Qu'est-ce que t'dis - Lexique du parler creusotin
Lien : Lexique du canton de Quarré les Tombes
Livres édités par "Mémoires Vivantes du Canton de Quarré les Tombes", les bénéfices sont destinés à la restauration du petit patrimoine local. Voir : Boutique
Sa mère étant originaire de Saint Prix en Morvan, (jadis Saint Prix sous Beuvray) elle utilisait souvent, bien qu'ayant quitté son pays natal, et comme sa mère, des mots du langage morvandiau que je connais bien et que j'ai plaisir à retrouver dans votre glossaire (Patois local. - Saint Germain des Champs). Il se pourrait donc, si vous me le permettez, que j'ajoute quelques mots de ci de là, mais qui ne sont peut-être pas employés dans votre commune ! Je suis en train de recopier tout cela sur mon PC et j'essaierai de vous envoyer le tout si vous le souhaitez ! Mais d'ores et déjà je puis faire quelques suggestions.
Contribution de Gérard Gros
Lien : Patois local - Saint Prix
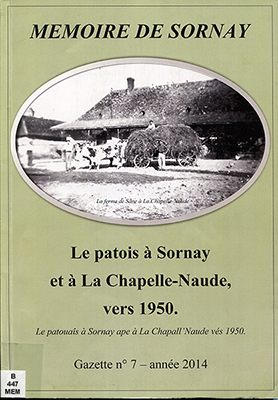
En écrivant le patois de Sornay, nous voulions que les gens ne le connaissant pas, et qui liraient nos articles puissent le "restituer" en restant le plus près possible de l'original, même s'il est très difficile de retrouver le intonations si spécifiques à cette langue très colorée, aux expressions si riches.
1) Difficultés liées à la richesse de l'orthographe française : comment écrire un son très courant et banal mai qui, en français, a beaucoup de graphies différentes ?
Par exemple, le son "ai" peut s'écrire en français : è (ça pèse), é (événement), ai (aiguille), ais (je fais), ai (paiement), ait (lait), ei (peigne), et (cadet, jouet) ou e tout simplement (perdu, merci, essaim, aérienne, benne, hirondelle)... Il en va de même pour bon nombre d'autres sons (ain-ein-in, o ou au, an-en...).
Quelle orthographe choisir alors ? Chaque fois que cela est possible on opte pour celle qui "rappelle" le mot français. Par ex.: "il a fouait" (il a fait) et non "il a fouè" - "la grainge" (la grange) plutôt que la "gringe".
De plus, certains sons patois se prononcent différemment du son français : le 2ème "ai" de "airmaîre" ressemble plutôt au "ê" de "bêêê". On a choisi de l'écrire "aî" pour le distinguer du "ai" de "fouait".
En patois, on prononce certains sons "ain" en les "traînant", on les écrira "aîn" : la "chaîn-ne, l'avouaîn-ne". Idem pour le son "ou" quand il est "traîné" : doûter (enlever), le poûge...
2) Les mots qui s'écrivent comme le français mais se prononcent différemment en patois :
- en français le "eu" s'écrit de la même façon dans "feu" et dans "beurre". Mais on sait qu'il ne se prononce pas pareil. Or en patois, le "beurre" se prononce comme "feu". Il a donc fallu trouver comment le noter et on choisi de mettre un "eû" pour tous les mots comme "feu", en gardant le "eu" pour les autres. Ainsi, on écrit «le beûrre" ; "pieus" (= (ne) plus).
- de même, "année" en français se prononce "année", alors qu'en patois on dira "an-née". Pour le noter, on dû mettre un tiret pour séparer les 2 syllabes et montrer que l'on prononçait "an".
- le mot "aiguille" : en français on entend le "u" et le "i", mais en patois, on entend le "u" mais pas le "i", on écrira donc : "aigu'ille". (Voir plus loin le son "ill").
3) De même, le "e" nous a posé problème. Il est souvent muet à la fin des mots en français, mais en patois il arrive que l'on doive le prononcer. Pour le signaler, on a choisi de l'écrire "e" quand il devait s'entendre et de le remplacer par "'" quand il était muet. Par ex.: "la pouârte d'la graing'" ? On prononce le "e" de "pouârte" mais pas celui de "graing'".
- quand le "e" se trouve au milieu d'un mot, on est obligé de l'écrire "eu" en patois : ex. dans "peurdu", car on entend "e" et non pas "è" comme "perdu" en français.
4) On en arrive au son "ill" qui en français peut s'écrire "ill" (paille), "y" (voyou), et même "i" (pied, premier), ou "ï" (glaïeul, aïeul). Il faut bien avoir en tête que lorsqu'on écrit "ill", le "i" ne s'entend pas : pa-ille, ve-illée, rou-iller... sauf dans "famille, fille, bille, aiguille ..." !
En patois, nous rencontrons souvent le "ill" en fin de mot, par ex. "la traub'ille", "ensemb'ille". Et là encore on a dû mettre un "'" avant le "ill" sinon cela ferait "traubille" (comme famille).
5) Le plus difficile, voire impossible, est de transcrire un son patois qui n'existe pas en français : "la scia" (la claie), "le sciau" (le clos), "le scion", "le sciochi" (le clocher), "sascier" (sarcler)... (Principalement les sons "cl" qui se prononcent d'une façon bien spécifique en Bresse et que l'on a du mal à vous faire "entendre" sur papier !... Ce son est voisin de celui rencontré dans les mots de la langue allemande : mädchen – kûche – billig ...) Nous avons tranché en décidant que nous l'écririons «sci» et que nous signalerions ce son en gras.
Avec l'aimable autorisation de Monsieur André Massot
Lien : Association Mémoire de Sornay
Le patois nivernais - plus précisément : le parler des habitants du Val-de-Bargis (Vallons de la Syllandre et du Mazou) avant-guerre.
C’est un enfant du pays, André Devallière, qui a su en consigner certains mots et expressions et les ordonner en un lexique dont cette publication, "en ligne", est un aboutissement inattendu. Ces mots - dont certains nous paraissent aujourd'hui à peine intelligibles - constituent alors le vocabulaire quotidien de la petite communauté rurale formée par les habitants des hameaux du moulin et du Pressour (Châteauneuf-val-de-Bargis, Nièvre). Ainsi s'interpelle-t-on, gentiment, autour du lavoir : " vins don là que j'te biche ! " parfois, le ton monte : " té vas-t-y m'bafuter longtemps ? " alors adolescent, l'auteur, entre deux balades à vélo, saisit au vol les hannetons et, parfois, telle ou telle expression. Quelques années plus tard, il a l'heureuse idée de coucher ces dernières sur un cahier d'écolier.
Ressusciter ce parler, aujourd'hui inusité, n'est pas une entreprise aisée. Pour y parvenir, l'auteur choisit avec raison de replacer ces mots dans leur contexte, en les insérant dans des exemples destinés à "rendre" l'accent local, très spécifique et très appuyé, aux "r" fortement roulés. Il appartient au lecteur de fournir un effort équivalent et de se donner la peine d'essayer de lire à haute voix ces bribes de conversations interceptées par l'adolescent. C’est une humanité oubliée, ni meilleure ni pire, qui se rappelle à notre souvenir. À cette occasion, on mesure une fois encore que rien ne justifie la condescendance avec laquelle, parfois, on la considère. Les expressions savoureuses ne manquent pas. Elles raviront tous ceux qui aiment les mots et, surtout, seront l'occasion d'entendre à nouveau battre le cœur d'un monde à jamais disparu, qui fut pourtant, des décennies durant, celui de nos ancêtres - en une époque où le temps filait moins vite qu'aujourd'hui. Merci à tous ceux qui, tel André Devallière, prennent le temps de témoigner : la vie y gagne en sens.
Petit lexique du parler nivernais du Val de Bargis : André Devallière
Mise en page : Philippe Cendron
Lien : Petit lexique du parler nivernais du Val de Bargis
50 mots - Sur les 110 hectares dans la vallée de l’Arroux à l’extrémité sud du Morvan j’élève les célèbres vaches blanches charolaises dont la renommée n’est plus à faire ; une dizaine d’hectares est consacrée à des cultures fourragères vivrières (blé, orge, avoine, triticale) destinées à nourrir les animaux durant la période hivernale.
Les lecteurs de mes différents billets trouveront ici un glossaire de mots ou d’expressions du patois morvandiau ou tout simplement propre à notre métier que j’enrichirai au fil des semaines.
Lien : Journal d'une ferme en Bourgogne
Le gros travail que nous avons réalisé sur le patois amognard, et cela après plusieurs années de collectage, de lectures et de compilation, est une oeuvre éditoriale et donc une création intellectuelle.
J'espère que vous comprendrez aisément donc, que vous pouvez nous citer et mettre un lien vers notre page, mais ne pas intégrer notre travail.
Lexique du langage du canton de St-Benin d'Azy et quelques éléments en provenance de : La Machine, Magny-Cours, Luthenay-Uxeloup et St-Parize le Châtel recueillis au cours du XXème siècle par Mme. Fernande VAGNE (1907 - 2000).
Synthèse et mise en forme : P. de Haut.
Pour accéder au lexique (qui ne fait plus partie de cette compilation), suivez ce lien : Lexique de patois amognard
Wiki nivernais, base de connaissances consacrée au département de la Nièvre au service des historiens, généalogistes et chercheurs. Ce projet est collaboratif, gratuit, c'est un élément majeur du projet GenNièvre.
Mots et expressions entendus dans la région de St Benin des Bois, proposés par Francis Hagel et Jacques Girard.
Liens : Accueil GenNièvre - Page patois
Nous sommes des descendants des Éduens : ce peuple de la Gaule celtique installé dans la Nièvre et dans notreSaône et Loire, qui coopéra avec les Romains en participant à la constitution de leurs légions, avant de se rallier à Vercingétorix. Ceci n’expliquant pas forcément tout cela, nous pratiquons un patois que les "Sociétés savantes" désigneraient comme un parler régional, où se mêlent des racines latines non-usuelles du type bas-latin et latin ecclésiastique, gauloises et plus précisément celtes, voire germaniques. Nous particularisons ce parler par l’altération "forcée" de certaines syllabes, l’utilisation de verbes désuets aux conjugaisons particulières, l’usage complexe de diphtongues (deux timbres successifs émis dans une même syllabe), la pratique d’élisions (la voyelle élidée est remplacée par une apostrophe)…et en abusant, à dessein, de consonnes "alvéolaires" prononcées avec un contact entre la langue et les alvéoles (renflement du palais derrière les
dents du haut) "sifflant" les "ch" et les "ss" et que nous écrirons "sh" pour rappeler la particularité phonétique... que le lecteur voudra bien admettre, ainsi que le "î" accentué long et le "ÿ" couronné extra-long.
Après chacune des deux guerres mondiales et le développement des transports, le brassage des populations et l’importation d’argots : certains mots ont été influencés ; mais voilà comment on "causait" au Meix Bouroux, rue de Mirande, à Varennes le Grand, jusqu’au XXème siècle.
Pour sauvegarder l’intérêt de ce répertoire, nous exclurons beaucoup de mots usuels, qui sont issus d’une altération simple du français, par exemples :
Hubert Brun
Lien : L'Égarouillôt - Bulletin N°3 de l'atelier Patois du Sud Chalonnais
Lien : Le patois de Sivignon d'Olivier Chambosse
Lien : Patois de la région de Cosne sur Loire
Lien : le site web de Donzy-le-Pertuis n'exixte plus !
WebArchive : Parler un peu bourguignon
Le patois n’est pas une langue, mais la déformation du français, variant d’une région à l’autre. L’instruction primaire devenant obligatoire depuis 1881, l’école devenait laïque, le patois y perdit sa place.
En lisant le si joli poème d'André Mary "le grapillot" je me suis souvenue de notes sur notre patois Châtillonnais que j'avais prises il y a fort longtemps...
Il faut dire que je connais bien le patois de Saône et Loire, spécialement de Saint-Léger sur Dheune et du Creusot d'où ma famille est originaire... Ce patois possède un nombre incalculable de mots, si riches qu'un linguiste en a d'ailleurs rempli un livre de plus de 500 pages, c'est vous dire ...
Lorsque je suis arrivée dans le Châtillonnais, j’ai trouvé un patois, certes encore vivant, mais beaucoup moins important en nombre de mots que celui auquel j'étais habituée...
Néanmoins j'ai peu à peu consigné ces mots que l'on utilisait dans les villages, et dans la famille de mon mari par exemple...
J’ai retrouvé hier mon petit carnet, et j'ai pensé qu'il serait intéressant de faire revivre ce patois Châtillonnais si sympathique...
Si vous, amis lecteurs Châtillonnais, connaissez d'autres termes patois que je n'ai pas cités, ce serait sympa de me les faire connaître ….
ChrisTal de Saint Marc(Pseudo)
Lien : Le patois du Châtillonnais...

Antoine Maringue est né le 17 octobre 1867 à Marly-sur-Arroux, village situé à quelques kilomètres de Perrecy-les-Forges.
En 1885, il rejoint Marmagne où il occupe son premier poste comme instituteur (adjoint) à l’école des Chaumes. Puis, nommé à Perrecy-les-Forges où il exercera pendant une dizaine d’années, il fera la connaissance d’une jeune institutrice, Élise Alemanus, née au Creusot le 22 février 1875 dans une famille très connue de cette ville.
Ils se marieront le 1er mars 1897 à Perrecy-les-Forges, puis partiront enseigner à Saint-Vallier, à l’école des Goujons.
Antoine Maringue terminera sa carrière comme directeur d’école au Magny, à Montceau-les-Mines, où il résidait au 32 rue Henri-Chausson en 1926.
Pendant sa retraite il écrira et publiera son œuvre en 1951.
Il est décédé le 31 juillet 1957 à Montceau, à l’âge de 90 ans.
Ce livre de 160 pages, illustré de nombreuses cartes postales anciennes et photos, fait écho au “Causer du Creusot” de Lucien Gauthé. Il est vrai que l’histoire de nos deux villes ouvrières met en évidence nos racines communes. C’est un monde disparu qui nous fait signe, chacun sourira en redécouvrant dans le glossaire des expressions entendues autrefois dans les rues et dans les familles de Montceau et des environs.
À notre époque où les souvenirs s’effacent si rapidement, ce livre a le mérite de sauver de l’oubli les coutumes et légendes du pays montcellien.
Lien : Les Nouvelles Éditions du Creusot - Un peu de folklore montcellien - 2011

Ce petit ouvrage est le fruit d’un travail collectif réalisé par les Nouvelles Editions du Creusot. Sur la base d’une thèse universitaire consacrée au Parler des ouvriers du Creusot, écrite par une jeune ethno-linguiste, Marie Dominique JACOMY, dans les années 80 du siècle passé, nous avons, avec le concours précieux et savant de l’auteure, tenté de combler un manque bien souvent signalé : l’absence aujourd’hui de lexique du parler creusotin. Les rares ouvrages précédents sur ce sujet sont en effet épuisés depuis longtemps !
Le témoignage des Anciens et l’expérience quotidienne des plus jeunes ont été confrontés au sérieux scientifique pour donner à cet ouvrage – non exhaustif ! – sa saveur de mémoire toujours vivante du langage populaire et familier du Creusot et de sa région…
Lien : Les Nouvelles Éditions du Creusot - Qu'est-ce que t'dis - 2019

Dans les années 1960, Bruno Lamas passe ses vacances dans la ferme de ses grands-parents paternels à Moutiers-Saint-Jean, en Auxois, véritable creuset d'un parler et d'un art de vivre où se mêlent des influences du Morvan, du Châtillonnais et du Dijonnais. Chaque année, pendant plusieurs semaines, il vit au rythme de ces paysans bourguignons, partage leur quotidien, leurs valeurs et leurs conversations. Il s'imprègne de leur culture, de leurs traditions et de leur patois, à tel point qu'aujourd'hui encore il utilise des mots ou des expressions entendus alors. Ce patois, où chaque « r » démultiplié ronronne toujours à ses oreilles, l'auteur le fait revivre grâce à ce dictionnaire. Il ne se contente pas de nous donner la traduction et la définition de près de 200 mots, mais les illustre avec une anecdote, une historiette. Ainsi, au fil de l'alphabet, est évoquée, avec malice et bonne humeur, la vie des villages de Bourgogne pendant les Trente Glorieuses.
Lien : Editions Sutton - Petit dictionnaire de patois bourguignon - 2023
